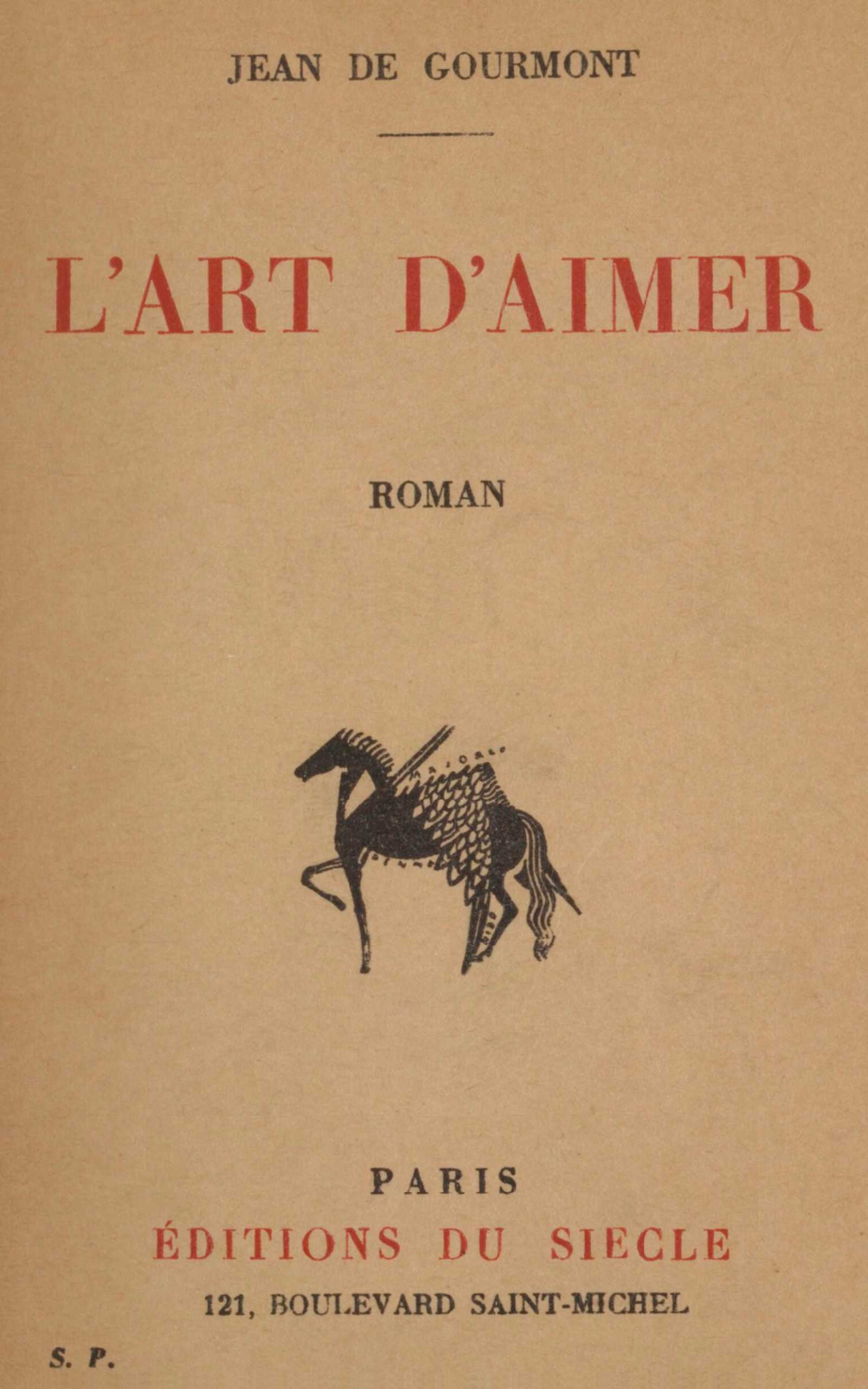
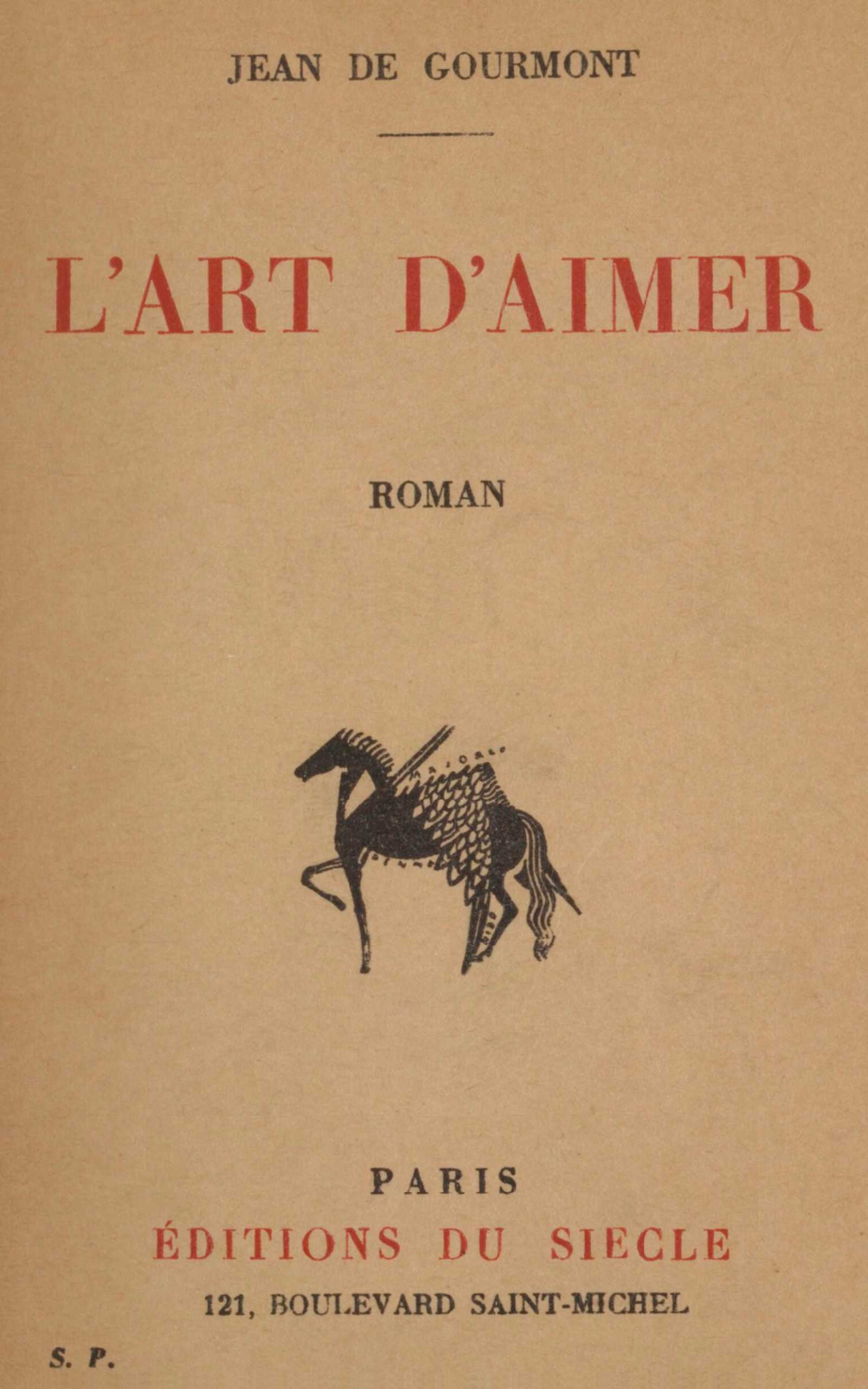
JEAN DE GOURMONT
ROMAN
PARIS
ÉDITIONS DU SIÈCLE
121, BOULEVARD SAINT-MICHEL
DU MÊME AUTEUR :
AUX « ÉDITIONS DU SIÈCLE » :
CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS :
TOUS DROITS RÉSERVÉS
Copyright by Éditions du Siècle, 1925
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE UN EXEMPLAIRE UNIQUE SUR VIEUX JAPON A LA FORME, PORTANT LE No 1 ; DIX EXEMPLAIRES SUR MADAGASCAR LAFUMA, NUMÉROTÉS DE 2 A 11 ; VINGT EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE VAN GELDER ZONEN NUMÉROTÉS DE 12 A 31 ET CINQUANTE EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL LAFUMA NUMÉROTÉS DE 32 A 82. L’ÉDITION ORIGINALE, AINSI QUE LES EXEMPLAIRES DESTINÉS A LA PRESSE, A ÉTÉ TIRÉE SUR PAPIER D’ALFA.
ON A TIRÉ EN PLUS VINGT EXEMPLAIRES HORS COMMERCE DONT TROIS SUR VIEUX JAPON A LA FORME, NUMÉROTÉS DE I A III ET DIX-SEPT SUR VÉLIN PUR FIL LAFUMA, NUMÉROTÉS DE IV A XX.
L’ART D’AIMER
— Rite ?
— Raymond ?
— A quoi songent tes yeux qui regardent loin, je ne sais vers quel passé où je n’étais pas près de toi ?
En amour, songeait-il, il n’y a pas de passé, et Rite ne vit que depuis l’instant où mes lèvres lui ont donné une âme, la mienne…
— Mes yeux ne contemplent aucun passé plus lointain que toi, Raymond ; mais je suis triste ce soir du mal que je vais être obligée de te faire, peut-être, en te parlant de moi-même et de ma vie réelle. Depuis ce soir de juin où je t’ai rencontré, au lit de mort de Marthe, nous ne nous sommes pas quittés, nous avons vécu en dehors du temps et de l’espace dans l’absolu de notre amour. Tu ne m’as pas interrogée et je ne t’ai pas fait de confidences… Il semblait que nous vivions comme au seuil de la mort qui éterniserait notre baiser… Oh ! Raymond, j’ai peur ce soir, parce qu’il va falloir te quitter et reprendre cette vie d’hypocrisie qui est la vie de toutes les femmes mariées… Je serai toujours à toi, mais je ne pourrai plus te donner de mes journées que quelques heures volées…
En disant cela, Rite était plus pâle sous le toit de ses cheveux blonds, des larmes scintillaient dans ses yeux plus noirs, et la respiration de ses seins se précipitait…
Raymond comprit qu’aucune parole ne serait assez forte et assez belle pour exprimer une douleur digne de ce désespoir. Alors, il approcha de sa bouche la brûlure des larmes de Rite et, tenant cette belle tête dans ses mains, il but cette voluptueuse salure des larmes, gonflé d’amour et de l’orgueil d’avoir inspiré une si vive et sincère douleur. Avec une sorte de désespoir, il serra cette chair contre sa chair, et l’approchant de lui, ils se mêlèrent…
Il savait bien l’onction des possessions mouillées de larmes. Accroché à ses épaules comme à un rocher, tout son être se tendait vers cette bouche dorée qui l’aspirait et buvait son désir.
Rite, soulevée comme une vague qui retombe sur elle-même en déchirant ses volutes, sanglotait de voluptueux sanglots ; et contemplant la gravité douloureuse de son visage, au moment même où sa chair se brisait sur le sable, Raymond écoutait dans tout son être le heurt précipité de cette chair blanche, mouillée de son propre parfum qui l’écrasait. Peu à peu, la respiration s’éteignit et ils demeurèrent immobilisés dans cette sorte de rêve voluptueux où les chairs qui se sont données ne se sont pas encore reprises et où le miracle de la transsubstantiation amoureuse se prolonge… Les baisers sonnent alors dans le cerveau comme des cloches sous-marines et les mains qui s’étreignaient jusqu’à se briser se détendent et s’endorment.
Toute la chair se replie, se referme comme une corolle trop profondément respirée, et la dernière caresse s’emprisonne dans la digitale sacrée, prise comme une fougère dans le baiser glacé de l’étang.
Ils demeurèrent ainsi longtemps silencieux, et Raymond, les yeux fermés, la tête appuyée sur le sein de Rite, respirant les mousses mouillées de son aisselle, se parlait à lui-même et s’interrogeait devant cette nouvelle vie qui allait commencer.
Rite, comme toutes les femmes, était donc mariée. Au fond, cela le rassurait et restituait à leur amour cette sorte d’abstraction des contingences quotidiennes qui font d’une liaison une sorte de rêve enchanté.
Depuis un mois qu’il vivait avec Rite, il s’était abandonné, fleur coupée, à ce courant de sensualité qui le roulait dans son remous, à cette sorte d’ivresse dionysiaque qui le soulevait et le faisait jaillir. Il trouvait dans cette chair fraternelle une sorte d’identification de son être avec un autre être, une totalité de vie instinctive si reposante : ne plus penser, n’être plus qu’une vibration heureuse de son propre rythme harmonisé en un autre rythme, se contempler soi-même, comme éternellement dans ce miroir ébloui qu’est l’âme d’une femme qui vous aime.
Mais parfois, même en ces minutes de communion sensuelle où la vie est presque comme un parfum intellectualisé, Raymond s’isolait et partait, secrètement seul, sur la route du songe. Instinctivement inquiète de cette fuite imperceptible, Rite demandait :
— Où es-tu, Raymond ?
— Je suis là, répondait-il, et, en disant cela, il lui semblait, en effet, qu’après un envol dans la plaine des souvenirs, il était revenu se poser, oiseau domestiqué, sur le sein de sa bien-aimée.
Elle avait un mari : une sorte d’intendant de sa chair et de sa vie. Elle avait avoué cela comme on confesse un péché, le péché de n’avoir pas su attendre le miracle de la venue de Raymond. Mais cette confession, elle avait eu la délicatesse de ne pas la dire tout de suite, afin de laisser à ces quelques semaines tout leur parfum d’absolu.
« Cette situation, pensa Raymond, complique à la fois et simplifie les choses : il s’agit simplement d’inscrire sa vie dans ce cadre. Et quant à ce mari, ne pas s’en occuper, le nier : il n’est pas plus pour elle qu’un ancien amant oublié. »
Raymond n’était pas jaloux du passé, peut-être parce qu’il avait trop d’orgueil et trop de confiance en lui-même.
— Une femme que j’aime, pensait-il, est à jamais marquée de mon sceau.
Peut-être eût-il fallu, à cette minute, rassurer Rite et lui expliquer le provisoire de cette incomplétude de vie. Il se contenta de lui affirmer, par un baiser où leurs dents se choquèrent, tandis que dans son regard Raymond mettait toute sa mysticité amoureuse, l’indissolubilité de leur tendresse.
Il se fit un peu douloureux et sembla héroïquement surmonter une peine déjà obsédante. Alors ce fut Rite qui le rassura : elle viendrait chaque jour vers lui, et ce serait chaque jour une nouvelle Rite, lentement préparée, parfumée, embellie pour ces heures sacrées, que l’attente et le désir feraient plus ardentes.
— Et puis, et en disant cela elle savait bien qu’elle exprimait la pensée secrète et profonde de Raymond, et puis tu mettras toute ton intelligence à nous préparer cette vie nôtre qui sera l’harmonie définitive…
— L’harmonie définitive, reprit Raymond, définitive…
Et il songeait à la mort, qui viendrait un jour recouvrir les rythmes éteints de leurs chairs et de leurs âmes comme la marée montante efface sur la grève les pas entremêlés des éternels fiancés.
Déjà Rite s’était levée et Raymond, la tête appuyée dans sa main, contemplait la nudité de son amie, d’une sensualité plus intellectuelle que le corps doré de sa première Marguerite. Les bras levés d’un geste ailé, elle allait s’habiller lorsque Raymond l’arrêta : il voulut qu’elle vînt vers lui et qu’elle penchât vers son corps encore allongé la caresse de ses cheveux, et qu’elle lui donnât, sous cette voûte parfumée comme un sous-bois, sa bouche encore vierge de rouge. Le baiser de Rite parcourait le corps de Raymond, mordait la fragilité des fraises égarées dans les mousses de sa poitrine, et tout à coup, grave, ce baiser s’immobilisa et il sembla à Rite que jamais elle n’avait aussi intensément bu l’âme de Raymond.
De son bras, il l’avait attirée vers lui, et il sentait maintenant tout le poids de cette chair qui s’écrasait sur son corps comme un fruit où les lèvres ont mordu et qui verse sa saveur.
La lumière bleue du soir caressait la croupe de Rite et la ligne creusée de son dos montait vers la coupelle de ses cheveux défaits, et qui semblaient dans cette clarté un peu plus mate, une source dorée par le couchant.
Vite Rite fut debout, inquiète maintenant de l’heure…
— Tu m’apparais tout d’un coup, dit Raymond en souriant, comme une Amazone descendue de son cheval et encore toute haletante de la course…
— Oui, Raymond ; mais ne me parle plus : demeurons sur ce baiser qui m’a versée en toi et qui fut comme une tendresse après l’ardeur et la brûlure de notre amour. Il m’est doux de penser que tu vas vivre dans cet encens de nos vespres, et ton fauteuil d’osier qui craque sous mon poids gardera l’empreinte…
Raymond s’était levé et, tandis que Rite achevait de s’habiller, il s’était agenouillé devant elle et soulevait encore sa jupe courte pour baiser ses genoux et poser tendrement sa tête rêveuse contre le bouclier sacré de son ventre.
Il la reconduisit jusqu’au carrefour voisin où, alignés comme des bêtes au repos, des taxis attendaient. Le moteur ronronna et, dans un léger craquement de mécanique, la voiture s’éloigna. Une dernière fois, leurs yeux échangèrent une pensée, Rite referma ses paupières mouillées d’émotion sur l’image de Raymond ; quelque temps encore, Raymond aperçut dans le lointain une main blanche qui éclairait le crépuscule, comme un lys dans l’allée des jardins de son enfance.
Raymond se reprochait presque cet allègement qu’il éprouvait en se sentant seul dans la rue.
— Mais c’est mieux ainsi, se dit-il : la perpétuelle présence eût fini par user cet amour que je veux inépuisable. Je le cultiverai savamment comme une plante rare, et il est bien qu’un peu de divine amertume vienne aggraver des sentiments de cette qualité. Les êtres que l’on aime sont un peu semblables aux paysages qui ont besoin d’un peu d’éloignement pour être compris et admirés.
« Il faut aussi en amour savoir se quitter pour, dans une solitude réfléchie, diriger cet amour, l’analyser, en prendre une réelle conscience. L’amour, ce n’est en somme que la culture de son intelligence, de sa sensibilité et de sa sensualité. Aimer une femme, c’est s’aimer soi-même en cette femme.
« Je vais donc pouvoir, enfin, continuait Raymond, en allumant une cigarette, mettre un peu en ordre la gerbe de nos sentiments et de nos images, les noter dans la solitude et pour moi-même ; je sais trop combien nos sensations, même les plus vives, sont fugitives si nous ne leur donnons cette éternité, peut-être mensongère encore, de l’écriture. Vivre même intensément les plus somptueuses passions, ce n’est rien si nous ne savons esthétiquement emprisonner ces instants dans un rythme ou dans la courbe d’une image. O Rite, ton amour serait vain, aussi vain que les amours bleues des libellules, si mon cerveau ne le créait pas à chaque minute et si mon instinct d’éternité ne lui donnait pas déjà comme une immobilité de statue dans un temple.
« Je veux que ton odeur de femme que j’ai respirée comme le plus émouvant des poèmes, parfume les siècles et que les jeunes hommes qui viendront après nous, viennent boire à cette source de mes songes.
Et, devant Raymond qui était rentré chez lui et s’était assis à sa table, le fantôme blanc de Rite s’était dressé, agrandi, et à travers l’ogive de ses cuisses, il regardait dans le ciel au-dessus des toits, poindre les premières étoiles.
Raymond se souvenait de leur première soirée, déjà illuminée d’une subite et ardente sensualité. Dès que cette porte s’était refermée sur leur solitude, il avait, sans dire une parole, ouvert son corsage et posé sa tête entre ses seins. Elle s’était tout de suite voulue nue, pour être plus pure et sa chair blanche, veinée de bleu, lui fut une apparition inoubliable, une lumière qui depuis jamais ne s’était éteinte.
— Elle est là, dit Raymond, elle est toujours là, plus réelle que la blancheur réelle de cette Bacchante de marbre qui domine ma cheminée.
« Je baisai sa bouche qui s’ouvrit comme une blessure, je tenais sa tête blonde dans mes mains, et là, debout, sa chair seule éclairant la nuit, silencieusement nos deux corps se sont unis en une instinctive et subite inclusion dans le frémissement de sa chair mouillée comme les roses du matin.
« Je la pris dans mes bras et la portai sur le divan, baisant ses seins qui s’offraient à mes lèvres. Alors, je m’agenouillai devant ce corps embaumé de sa propre tendresse et je demeurai longtemps enfermé dans ce parfum qui se soulevait vers la sélection de ma bouche…
« — Je suis tienne, Raymond », disait-elle, en une plainte musicale qui suivait la courbe ascendante de son trouble déjà rasséréné.
« Mais du plus profond d’elle-même, inépuisablement, montait cette plainte inguérissable qui retombait toujours sur elle-même.
« Elle m’emportait dans son rythme où j’étais emprisonné en une étreinte douloureusement voluptueuse : battement d’aile du cygne de Léda.
« Rite ! Tout de suite je trouvai ce nom qui la personnalisait et la distinguait dans mes associations d’images et de sentiments de ma Marguerite dorée, à laquelle d’ailleurs je ne pensais plus que comme à de lointains et doux souvenirs d’enfance.
« Rite me parlait de moi-même, qu’elle me disait aimer depuis quelques années déjà, et je compris mieux que c’était la tendresse de Marthe pour moi qui avait créé en elle cette cristallisation.
« — Marthe t’aimait, Raymond, et peut-être plus sensuellement et plus totalement que tu ne l’as cru. Morangis, à qui tu l’avais donnée, ne fut accepté par elle que par une sorte de docilité à tes volontés ; et puis, Morangis, c’était encore un peu toi, puisqu’il était ton ami.
« Elle rêvait de te conquérir un jour et de te donner à toi la vraie floraison d’une sensualité encore hésitante et incertaine. Mais, disait-elle, avec une humilité si orgueilleuse, je ne suis pas encore digne de lui, et même cet amour qui est en moi, plus fort même que mon désir, je ne saurais même pas, enfant que je suis, le lui exprimer.
« Elle trouvait aussi une douceur amertumée dans cette privation de toi qu’elle s’imposait.
« Et moi, continuait Rite, lorsque Marthe me parlait ainsi, ses grands yeux noirs illuminés de fièvre, elle m’apparaissait un peu comme une sainte. Je la serrais sur mon cœur et puis, tendrement, je baisais la coupole de son sein où vivait un dieu… toi, Raymond. Et je t’aimais, nous t’aimions toutes les deux et nous nous aimions en toi.
« Me comprends-tu, Raymond : je te cherchais en elle et sa jeune chair m’était sacrée et comme imprégnée de toi. Oui, et dans nos exaltations de tendresse, c’est ton nom, répété comme un écho par nos deux voix, qui fusait de nos lèvres parfumées.
« Et aujourd’hui qu’elle n’est plus, je pense que je n’aurais pas été jalouse d’elle, ni elle de moi et que nos deux bouches se seraient approchées pour se donner ensemble à ton baiser. »
Raymond évoquait ces premières confidences de Rite, où elle lui avait apporté avec le don total de son être, la passion insoupçonnée de cette petite Marthe qu’il n’avait fait qu’effleurer, comme on respire une rose dans l’allée d’un jardin.
Il se leva, et dans un rayon de sa bibliothèque, il prit un grand cahier où dormaient d’anciens dessins de Newsky… Il le feuilletait, indifférent à toutes les attitudes fixées là de Marguerite.
— Ah ! la voici : Marthe !
Il la contempla avec une tendresse nouvelle et un peu affligée en songeant à la maîtresse exaltée qu’il avait perdue, qu’il n’avait jamais vraiment possédée. Mais il ne put s’empêcher de sourire, en pensant que cette sensualité, qu’elle cultivait pour lui, c’était Rite qui en avait goûté les fruits déjà dorés et onctueux. Et ce premier soir de solitude dans son cabinet de travail silencieux, sa pensée se réfugiait dans le souvenir lointain de sa petite Marthe, venant vers lui avec tant de confiance, lui apporter la petite pomme encore verte de sa virginité.
… Et quant à Rite, l’idée qu’elle était rentrée chez elle, auprès de ce mari dont il venait d’apprendre l’existence imprécise, le rassurait. Il savait qu’elle serait lasse et triste jusqu’au silence, et qu’en réalité, elle se retrouverait chez elle une étrangère auprès d’un étranger. Rite était trop absolue pour désormais donner rien d’elle-même à cet homme. Et Raymond trouvait cela admirable qu’un mari puisse redevenir tout à coup l’étranger qu’on ne reconnaîtra jamais plus, et qui ne sera plus désormais qu’un affectueux ennemi dont on accepte par habitude la tyrannique et inutile présence.
Raymond alluma une cigarette anglaise dont le parfum subtil se mariait au goût de l’amour :
— C’est encore un peu d’elle que je hume, dit-il, les mots même que je prononce exhalent aussi le parfum de sa chair respirée et bue.
Malgré la promesse qu’elle s’en était faite à elle-même, Rite ne put venir vers Raymond ni le lendemain ni les jours qui suivirent. De petites lettres seules exprimaient son désespoir, un désespoir si sincère que Raymond en était ébloui et réconforté.
— En amour, se disait-il, l’important n’est pas que celle qu’on aime soit heureuse, mais qu’elle ne soit pas heureuse loin de vous.
Pourtant, dans cet état de quiétude orgueilleuse, Raymond comprenait qu’il fallait répondre à ce désespoir par une douleur exagérée, et créer, à côté de l’absolu quotidien qui leur échappait, un autre absolu plus abstrait, fait d’une pensée perpétuelle et perpétuellement cultivée. Il lui écrivit de longues lettres, il écrivit ce qu’il n’avait pas parlé, donnant ainsi une répercussion réfléchie à leurs sentiments, un symbole à leurs gestes d’amour, et comme une direction à leur vie.
Il y a des amours qui ne se sont pas développés et n’ont pas parcouru leur hyperbole, parce qu’ils n’ont pas eu cet appui des mots, créateurs de valeurs mystiques et sentimentales. Un amour qui ne s’enveloppe pas de cette magie des mots n’est rien qu’un pur abandon physique et s’épuise de lui-même…
Mais en amour, il ne faut pas parler, il faut écrire. Une lettre est une présence plus précise que la présence réelle : elle met une gravité lyrique dans le souvenir et fixe, à notre volonté, les étapes d’une passion.
Écrire, c’est aussi une manière de se montrer tel que l’on désire être aimé et les mensonges et les exagérations d’une lettre d’amour sont peut-être plus vrais que la vérité. La noblesse des sentiments que l’on exprime devient une véritable autosuggestion et il y a dans l’amour ainsi cultivé une sorte de perfectionnement moral qui n’est pas sans beauté.
Dans ces premières lettres de la première absence, Raymond voulut surtout maintenir son amie en état de ferveur, et chacune de ses phrases était une caresse et une possession. D’ailleurs, pris lui-même à ce piège des évocations, il constatait l’état de grâce physique où le mettait cette littérature, et il passait ainsi de longues heures, tout son être tendu vers la chair de Rite encore idéalisée dans son souvenir et comme couchée dans son parfum sur la table même où il écrivait.
Il voulait que Rite exaltât aussi, voluptueusement, ces heures d’absence et que ses lettres fussent une lointaine et réelle copulation. Raymond trouvait dans cet échange de leurs désirs et dans cette tension de leurs deux êtres, exaspérés par l’attente, une volupté plus grande que dans la fusion sans mystère de leur baiser.
Mais tandis que sa vie s’organisait dans cette attente ardente, dans cette solitude fervente, Raymond écrivait chaque jour à Rite le désarroi où le laissait son absence : « Tu devrais être là dans chaque minute de ma vie », et c’était plus qu’une plainte amoureuse, presque un reproche dont Rite sentait toute l’amertume. Alors ses lettres à elle étaient un long déchirement, un reniement si sincère de ce passé qui s’accrochait à sa vie que Raymond, se comprenant aimé comme il le voulait, trouvait enfin dans cet amour une sérénité qu’il n’avait peut-être jamais atteinte.
Il se souvenait avec quelle intensité Rite lui avait exprimé le désir de voyager avec lui, de partir sur un mystérieux bateau où ils auraient été isolés du reste du monde.
— Qu’importe où on arrive, disait-elle, mais ne jamais plus retrouver celle que l’on fut, la Rite qui te cherchait dans la nuit.
— Partons dans ce songe, répondait Raymond, coupons toutes les amarres qui nous attachent à notre étroite vie sociale. Nous voici en pleine mer, l’horizon n’est plus qu’une ligne indéterminée, il n’y a plus que nous dans la lumière et dans le vent : jouissons de ce vide où nous nous balançons en une sorte d’éternité, gargarisons-nous de ce sentiment de l’inutilité de tous les devoirs et de toutes les ambitions. L’univers se résume en ta forme et dans ton parfum. Nos souvenirs eux-mêmes sont engloutis : nous vivons en un perpétuel présent qui est une lente et rêveuse pénétration de nous, une mystique pariade d’insectes divinisés. Je me sens si merveilleusement adapté à ta chair que je ne sais plus dissocier mon corps du tien, cette plaintive mélopée qui sort de ta joie résonne en mon être, et je ne puis me dissocier de cette bouche sexuelle qui se contracte sur mon songe et lui parle à voix basse. Chacun de tes mouvements perpétue cette sensation de plénitude, ce point d’orgue de béatitude parfumée qui nous suspend au-dessus de nous-mêmes.
Je parlais : elle ne m’écoutait pas et je ne m’écoutais pas moi-même ; c’était seulement la musique de ma voix qui s’enlianait à ses pensées, au rythme de sa chair soulevée qui se heurtait à mon corps et s’y brisait comme le clapotis des vagues sur les galets du rivage.
Rite, je ne me souviens plus de notre voyage, et nous n’avons abordé à aucun autre port que notre désir de nous. Il ne m’en reste que l’image de tes yeux réfugiés sous tes paupières et semblables au regard des statues… l’image aussi de ta belle tête où s’accrochaient mes mains dans ce heurt de nos deux rythmes qui se cherchaient et se repoussaient et qu’une soudaine gravité harmonisait.
Soirs où les parfums montent dans les corolles : j’ai plongé tout mon visage dans cette rose rouge dont mes mains écartaient les pétales dentelés et où s’écrasait mon baiser.
Rite était revenue. Tout d’un coup, elle avait été là, entrée silencieusement par la porte que Raymond avait laissée entr’ouverte. Elle s’est couchée comme un christ douloureux dans les bras de Raymond, le visage englouti dans sa poitrine. Raymond appuie contre lui ce corps qui n’est plus qu’une pensée de tendresse, et voici que deux yeux remplis de larmes se lèvent vers lui :
— Ne m’interroge pas, Raymond. Mes lettres t’ont dit ma vie de l’absence. Que cette minute renoue notre vraie vie.
Comprenant que dans cette atmosphère religieuse toute parole serait discordante, Raymond se contenta de baiser les yeux de Rite et son baiser tomba sur une bouche mouillée de larmes qui la brûlaient et la rafraîchissaient…
A ce contact, toute la chair de Rite frémit et Raymond sentit que déjà dans ce sanglot de sa joie elle venait de se donner à lui en pensée. Il savait la merveilleuse correspondance des larmes et de la sensualité, et le parfum des roses après l’orage. D’elle-même, elle s’est poignardée au glaive sacré ; le sang de sa propre blessure se mêle au sang de son amant, et elle s’effondre sanglotante, la bouche collée au cou de Raymond qu’elle mord avec une ardente tendresse.
— Maintenant, dit Raymond, laisse-moi m’agenouiller à tes pieds et t’adorer ; que tes mains appuient contre ton parfum la prière de ma bouche : les rythmes de ton être entrent en moi comme le susurrement d’une source sous les herbes. Mes mains qui dessinent ton corps se lèvent vers l’extase de tes seins, et tes cuisses se nouent à mon cou comme des bras.
« Mes lèvres parcourent la ligne de ton corps et c’est une conscience plus précise et plus belle que je prends ainsi de ta beauté.
« C’est toi qui me domines et j’approche de mon baiser ta callipygie qui s’écrase et m’impose sa brûlante fraîcheur.
« Tu es couchée le long de mon corps comme un hêtre abattu par l’orage, les feuillages dorés de tes cheveux éclaboussent mon ventre. Les prières de nos deux bouches se répondent et une même joie nous soulève vers la même délivrance.
« Demeurons ainsi dans cette communion de nos âmes et de nos chairs, et que, délivrés du poids de notre trop lourd désir, notre fugitive pureté se contemple avec des regards d’enfant.
« O Rite, disait-il encore, par delà le désir de ma chair, tu es belle, et à cette minute, je t’aime avec mon intelligence qui comprend le miracle de ta perfection…
Longtemps encore, Raymond parla dans le silence du crépuscule bleu et il sentait bien que ces mots d’adoration spirituelle étaient pour Rite une possession plus profonde encore que la possession physique ; ils nouaient autour de son âme des bras d’éternité et la faisaient surgir devant elle-même si miraculeusement belle qu’elle semblait vêtue de son propre rayonnement.
— Et, lourde ainsi des mots versés en elle, pensa Raymond, elle ne sentira presque pas l’absence de quelques jours qui va nous séparer encore.
Penché à sa fenêtre, il la regardait lentement s’éloigner et lorsque le dernier visage tendu vers lui se fut effacé, il s’installa confortablement dans le silence et ouvrit un livre qu’il ne lut pas. Il revivait les dernières heures et les ajoutait aux heures passées afin de les harmoniser dans cette patine du passé qui stylise les sentiments humains comme elle polit les pierres des monuments et le métal des monnaies.
— Le bonheur est rétrospectif, dit-il, et en réalité constitué par les mille petites pierres du désir cruel et de la joie toujours incomplète. Le bonheur est dans le regret…
« D’ailleurs, ajoutait Raymond, il n’y a pas de présent : lorsque nous jugeons et comprenons la vie, elle est déjà éteinte, morte. Il se passe à peu près pour nos sentiments ce qui se passe dans le rêve que nous reconstituons avec la logique de notre conscience réveillée. Le bonheur, ce n’est qu’une création de notre intelligence, c’est de l’art.
« Je n’ai jamais été heureux que par répercussion intellectuelle, par raisonnement ; j’ai seulement senti très intensément l’absence, le vide d’un être qui, par sa seule présence, m’apportait cette sensation de plénitude physique qui est aussi une plénitude intellectuelle.
« La volupté, elle-même, ce n’est peut-être pour l’homme qu’une sensation de puissance intellectuelle, une joie de sentir que par lui une femme s’extasie et tourbillonne dans la vague de ses plaintes, de ses extases et de ses sanglots. L’homme ne s’attache à une femme que par cette puissance qu’il se découvre auprès d’elle : les sentiments se greffent sur cette sensation physique et peuvent d’ailleurs devenir de puissants feuillages. Mais il ne faudrait pas non plus trop s’enorgueillir des raisons pour lesquelles une femme nous aime : nous ne sommes aussi pour elle que l’instrument du plus grand plaisir.
Et Raymond se souvenait de ce mot de Rite, lui criant dans une minute d’exaltation sensuelle :
— Je t’aimerais mieux mort qu’infidèle.
Aphorisme où l’amour et la haine se confondent et nous laissent, hommes et femmes, dans cette absolue solitude, dont aucun amour ne peut nous délivrer.
Mais Raymond avait été très flatté de cette parole qui lui affirmait sa propre valeur : il n’avait d’ailleurs à cette minute ni le désir de mourir ni celui d’être infidèle.
— Tant qu’on aime une femme, prononça-t-il, la fidélité n’est pas héroïque, car il nous serait alors physiquement impossible de la tromper.
Assuré que Rite ne viendrait pas ce lendemain, Raymond sortit et alla frapper à la porte de son ami Morangis, qu’il se reprochait d’avoir abandonné, le soir même de la mort de Marthe. Il le trouva dans son oratorio, improvisant à l’orgue une de ces subtiles musiques qu’il dédaignait de noter et qui étaient l’expression immédiats et fugitive de son état d’être.
Raymond qui était entré silencieusement, sans se faire annoncer, écoutait cette symphonie douloureuse où revenait comme une obsession une pensée qui ne pouvait se préciser et dont un arpège subtil semblait effacer l’image sonore à mesure qu’elle se dessinait…
Morangis aperçut Raymond ; il se leva et vint vers lui, le visage illuminé d’une sorte de douloureuse joie intérieure.
— Tu as bien fait, Raymond, de ne pas venir me voir plus tôt. Tu as compris que j’avais besoin de m’enfermer avec son image, avec des souvenirs qui prennent maintenant une immuable intensité.
Il parla ainsi longtemps de Marthe et Raymond comprit que maintenant qu’elle était morte, Morangis la créait à sa volonté, sans être dérangé par les réalités de la vie.
« Aucune amante, pensa Raymond, ne pourrait lutter avec une morte.
« Ah ! si nos amantes savaient mourir avant la décristallisation de nos sentiments, comme nous les aimerions éternellement ! »
Ainsi muni d’un sentiment immuable, Morangis avoua à Raymond qu’enfermé dans cette sentimentalité qu’il poussait jusqu’au fétichisme, il s’adonnait, en toute sécurité, aux fantaisies sensuelles et à la chasse à de faciles bonheurs.
— J’ai, dit-il, dépassé à jamais le stade de l’amour. Le libertinage, en dehors de tout sentiment, est plus pur : joie esthétique.
— Peut-être, répondit Raymond, qui savait dissocier son intelligence de sa sensibilité et de sa sensualité, il y aurait dans le domaine de l’amour bien des idées à retourner, bien des valeurs à renverser. Je m’amuserai peut-être un jour de lucidité à ce jeu de renversement des valeurs sentimentales. On arriverait à cette conclusion que l’amour devenu un art doit échapper à l’emprise non seulement de la morale, mais du sentiment.
Et, songeant ironiquement à lui-même, halluciné par le parfum d’une femme :
— Oui, dit-il, nous en sommes encore aux pauvres amours qui s’enferment sous la courtine secrète des alcôves, aux amours qui se cachent comme des péchés, ne se dévêtent que pour l’offrande subreptice et pour la minute de la fugitive vibration.
« Oui, Morangis, il y a peut-être un amour de l’amour qui dépasse les petites éternités qu’échangent deux êtres en rut : ces grands jeux sensuels où les couples et les images se répercutent, exaltant les cerveaux. Il y a en vérité une noblesse dans ces jeux à la fois dionysiaques et apolliniens, une noblesse esthétique et une gravité religieusement humaine que le christianisme des esclaves a salies bassement.
« En vérité, Morangis, ajouta Raymond, étonné de cette conclusion où le conduisait son raisonnement : la vie d’un homme intelligent ne peut trouver sa plénitude dans cette unique volonté d’accaparer les sensations voluptueuses d’une amante et de s’enfermer toute une vie dans l’infini minuscule et étroit d’un ventre de femme.
« Mais, s’empressa d’ajouter Raymond, ce raisonnement est faux comme tous les raisonnements d’ailleurs : en réalité, il n’y a de véritable joie en amour qu’associée à un état de sentiment. Mais les mots nous mènent souvent vers une logique purement verbale…
« Comme des cailloux jetés dans un étang, les mots jetés en nous font des remous et des cercles infinis. Il n’y a plus de mots vierges qui ne connaissent que l’étreinte d’une seule idée, d’une seule image, fidèles amantes. Les mots sont des catins qui ont couché avec toutes les idées et toutes les métaphores. « Cléopâtre », ce mot m’évoque cette reine-éphèbe d’Égypte, son histoire, son serpent sous les figues, Antoine qui eût pu conquérir le monde et lui préféra l’amour et la mort, les galères qui fuient dans le soir de la bataille perdue, emportant l’étreinte des amants ; il m’évoque l’Égypte et Rome, Shakespeare et le souvenir d’êtres chers associés à ma vie ; il m’emmène en des alcôves, il reconstitue des gestes, des spasmes, des larmes, des adieux, des regrets et, par association d’images, toute une vie de sentiment, de réflexions et de pensées…
« Mots, colliers accrochés à tant de cous, ceintures parfumées de tant de secrets !
« L’art d’un Mallarmé redonne aux mots une virginité, comme l’amour redonne aux êtres leur pureté…
« Est-ce vrai ? je ne sais : cela est vrai au moins à la minute où je le pense. Ce que nous pensons, disons ou écrivons nous étonne parfois autant que si nous lisions ou écoutions la pensée d’un autre. C’est qu’en somme celui qui écrit avec notre main, qui parle avec notre bouche, est un être mystérieux que nous ne connaissons qu’à la minute même où il s’exprime par la parole ou par l’écriture.
« Cet être mystérieux, ce double aussi invisible et insaisissable que le corps astral des occultistes, c’est notre subconscient, qui a, sans nous en avertir, recueilli des images, des sensations, des émotions, des pensées, des idées. Oui, nous sommes parfois étonnés de cette richesse qui est en nous et qui ne se revèle que lorsque notre conscience est endormie. Ah ! il y aurait là une belle théorie à développer sur le rôle des stupéfiants, ces révélateurs des images et des pensées.
« Pourtant, continua Raymond, je ne sais pas au juste quelle dose d’opium et de cocaïne il faudrait absorber pour atteindre l’intuition bergsonienne. Exactement, Morangis, la dose nécessaire pour tuer l’intelligence, ennemie de Dieu et de M. Bergson. Il ne faut pas médire de l’opium qui ne suspend en nous la vie organique que pour exalter les cerveaux, éteindre notre sens moral et religieux et faire de l’existence intellectualisée un phénomène purement esthétique. Le point de vue spectaculaire de Jules de Gaultier.
« Peut-être qu’au lieu d’être un danger, comme on le proclame, l’usage généralisé de l’opium sauverait le monde. En vérité, il ferait de tous ces vains agités qui ne rêvent que meurtre et mercantilisme, des artistes ivres de leur rêve et leur donnerait cette immobilité en une divine euphonie qu’ils ne trouveront jamais dans l’abrutissement de la vitesse… J’évoque ici les Chinois de la belle époque, riches d’un subsconcient dont ils prenaient une inoffensive conscience par l’art.
« A cette vie subconsciente participent les cellules de notre être : c’est pour cela qu’elle est notre vie profonde et que, pour se connaître il faut la faire monter à la conscience. Car une vie, une pensée, purement subconscientes, resteraient inexistantes. En réalité, ce subconscient n’existe qu’à la minute où nous en prenons conscience. Comprends-tu, Morangis ? Cette petite remarque que tu écoutes d’un air distrait, c’est pourtant une réfutation indiscutable de toute la philosophie bergsonienne.
« Et toi, Morangis, lorsque par ta musique tu libères les émotions englouties dans ta sensibilité, tu prends d’elles une sorte de conscience musicale, car la musique est une parole aussi, et, oui, une sorte de conscience primitive…
— Ma musique, répondit Morangis, me redonne la présence réelle de Marthe jusqu’à toucher ses mains et ses lèvres et jusqu’à la sensation du contact et du parfum de sa chair secrète. Si par je ne sais quel miracle ces rythmes musicaux qui ont la courbe de ses hanches et de ses seins, pouvaient se fixer, se matérialiser, je la recréerais vivante.
— Et je l’aimerais, pensa Raymond avec un sourire ironique et mystique.
Il ne pouvait oublier les confidences de Rite et en même temps qu’il s’abandonnait à une rêveuse et vaine désolation, il admirait cette constance où s’emprisonnait son ami, et cette illusion plus vraie pour lui que la vérité. Et Raymond, pour lui-même prononça cet aphorisme :
— En amour, c’est vraiment nous qui créons notre propre bonheur : se croire aimé d’une femme est beaucoup plus important que d’être réellement aimé d’elle si nous doutons de son amour.
« Nous ne sommes peut-être jamais aussi heureux que lorsque notre amie nous trompe, parce qu’alors, par une affectueuse compensation, elle tient à nous donner l’illusion d’une tendresse parfaite. »
Raymond et Morangis étaient sortis dans cette lumière de cinq heures qui, au mois de juin, bleuit déjà l’atmosphère qui va se faner ; ils erraient sur les quais le long des boîtes des bouquinistes, ces petits cercueils où dorment les pensées mortes. Instinctivement leurs pas les menaient vers le pont des Arts d’où ils communieraient à cet apaisement, à cette sérénité du soir qui couvre de silence les inquiétudes du jour. Ils marchaient silencieusement sur l’ombre élargie des feuilles que le vent agitait et qui faisait un tapis mouvant et abstrait à leurs pas fraternels. Des femmes passaient, à demi nues, les seins bien dessinés sous la mousseline des corsages et le rythme de leur marche semblait poursuivre et étreindre un mystérieux et invisible amant. Une belle femme en mouvement, c’est comme une multiplication des gestes de l’amour. Chacun de ses mouvements est une offrande interrompue.
Et dans une sorte d’hallucination intellectualisée, Raymond imaginait ce troupeau de jeunes femmes piétinant sa chair dans ce soir déjà bleu et écrasant de leurs callipygies mystérieuses les songes inquiets de ses désirs.
— Vois, Morangis, dit-il, toutes ces jeunes femmes qui s’écoulent comme un fleuve vers on ne sait où. Avec quelle admirable incuriosité elles passent devant ces monticules de livres ; elles savent bien, elles, que l’explication de la vie n’est pas dans ces livres. Elles ne la cherchent d’ailleurs pas, se contentant de vivre leurs petites vibrations d’insectes amoureux.
« Il y a des heures où je voudrais n’être que cela : un animal sans autre inquiétude que les satisfactions de ma vie physique, répercutées dans mon intelligence. Et je ne puis encore songer sans tristesse à mon enfance et à ma jeunesse arrêtées dans leur élan instinctif par l’inutile absorption de deux mille ans de littérature. Pourtant, en vérité, de toute ma jeune puissance de réaction, je fus, au collège, le plus mauvais des élèves, déjà guidé par ce principe de n’apprendre que ce qu’il m’amusait d’apprendre. Pour qu’il puisse assimiler les notions qu’on veut lui faire absorber de force il faut que le cerveau salive une curiosité secrète… Oui, j’étais un mauvais élève, Morangis, parce que j’aimais déjà la vie : au lieu d’enregistrer seulement des aphorismes comme on me le demandait, j’analysais et voulais déjà vérifier la composition chimique des pilules morales, philosophiques et religieuses qu’on offrait à mon jeune cerveau. Mes maîtres me considéraient déjà comme un mauvais esprit, mais j’ai compris depuis ce que valait cette réprobation et que les êtres ne se découvrent vraiment eux-mêmes que dans la mesure où ils réagissent contre leur famille et leurs maîtres. C’est pour cela qu’il est décourageant de fabriquer soi-même des enfants qui, pour nous continuer, devront nier et renier nos idées, nos sentiments, et notre œuvre, si nous sommes des artistes ou des spécialistes de la pensée.
« Mais toi, Morangis, quelle fut ton attitude dans cette période de gavage intellectuel de l’enfance ?
— Non, répondit Morangis, je ne fus pas un mauvais élève, peut-être seulement parce que je possédais une mémoire extravagante. J’enregistrais phonographiquement tous les mots et les vagues idées qui s’y accrochaient. C’est tout ce bagage inutile qui me gêne et m’alourdit encore aujourd’hui. Si je mettais en mouvement cet engrenage comme le disque d’un phonographe, il te déroulerait le songe d’Athalie, la colère de D. Diègue, les Oraisons funèbres de Bossuet, Télémaque, des hugolâtries, des niaiseries lamartiniennes, tout Musset, des soleils en toc de Leconte de Lisle, etc., jusqu’à des dates historiques ne correspondant à rien et à des théorèmes de géométrie aussi vains que les mots croisés. Les disques se sont peut-être un peu usés à ne pas servir : il y aurait des trous, des crissements…
« Mais je puis t’avouer, Raymond, qu’avec cette culture vraiment remarquable, je suis bien l’être le plus ignorant que l’on puisse rêver. D’ailleurs cela n’a aucune importance, car les idées ne me serviraient à rien dans une vie seulement sensible aux émotions musicales, sensuelles et sentimentales.
— La plupart des êtres sont dans la même situation que toi, répondit Raymond ; ils portent en eux le lourd et encombrant parasite d’une éducation littéraire qui ne sert qu’à étouffer leur jugement et à leur donner le dégoût de toute connaissance directe. L’instruction généralisée que rêvent nos politiciens actuels serait un fléau : il n’y a peut-être pas un être sur mille qui mérite cette culture intensive que l’on veut imposer à tous les citoyens français… Moi qui fais mon métier de savoir et de comprendre, toutes les notions un peu nettes que j’ai acquises, je ne les ai atteintes qu’après avoir soigneusement rejeté les vérités qu’on m’enseigna. Le guide le plus sûr dans la vie intellectuelle, c’est l’esprit de dissociation et de contradiction. Non pas qu’il suffise de retourner les mensonges sur le dos pour en fabriquer des vérités, mais cela permet de comprendre que, de quelque côté qu’on les contemple et les possède, les idées ont leur beauté, comme les femmes.
— Comme les femmes, répéta Morangis, qui n’avait peut-être retenu que ces derniers mots des confidences philosophiques de Raymond. Mais on ne parle pas pour être entendu, et seulement peut-être pour se préciser à soi-même certaines pensées et leur donner la vie évocatrice du verbe.
Raymond songeait :
— Je ne suis pas un vieillard ; pourtant, déjà entre ma génération qui s’épanouit avant de s’effondrer et la génération qui monte vers la crête de la vie, il y a vraiment un abîme de siècles. Nous, nous vivons la vie à petites gorgées savantes pour en savourer l’ivresse ; eux veulent vivre intensément, avec une rapide et brutale intensité. Je les contemple et m’émerveille de cette puissance de leurs sensations, de l’éblouissement de leurs joies, mais au bout de mes réflexions, je m’aperçois qu’ils ne sentent rien qu’un vertige inconscient de vitesse : leur joie, c’est moi, immobile, qui la ressens, en spectateur amusé ou passionné.
« Ils ne sont qu’une cavalcade inconsciente que mon intelligence stylise et crée : éternise. La beauté, la volupté ne sont rien qu’une vibration fugitive si une conscience ne les réfléchit pas, n’en laisse pas sur une pierre ou sur une toile, en un rythme de poésie ou de musique, une empreinte profonde. Il faut que nous laissions dans les stries de la terre où notre âge sera enseveli la trace de notre vie, en hiéroglyphes que les hommes futurs déchiffreront. Je les vois se pencher vers nos empreintes fossiles, s’émouvoir de nos sentiments reconstitués, de nos Pompeï resurgis des entrailles de la terre.
« Oui, Morangis, nous étions, nous, des spectateurs d’une vie à laquelle nous mettions tout notre orgueil d’aristocrates à ne pas participer. C’est nous qui faisions manœuvrer les esclaves de l’action et du cirque et jugions la beauté des gestes. Nos neveux sont entrés dans l’Arène, et nos nièces aussi : elles ont retroussé leurs manches et leurs cottes, elles travaillent elles-mêmes, s’enivrant de l’esclavage qu’elles ont pris pour une royauté ; elles dédaignent l’amour qui est un divin narcissisme et ne connaissent plus que les vulgaires sensualités sans répercussion intellectuelle. Ce sont des esclaves.
« Je comprends maintenant la beauté de notre éducation, restrictive des joies faciles de la vie. Le but de cette éducation était de retarder la vie, d’en prolonger l’attente et de créer ainsi intellectuellement une sorte de bovarysme du bonheur que l’existence réelle n’arrivait pas toujours à décristalliser. Le chef-d’œuvre de cette méthode d’éducation fut la jeune fille, dont l’espèce artificielle n’est plus représentée que par quelques rares individus réfugiés comme les castors dans quelques coins lointains de province. La jeune fille, être de luxe et d’art, protégée contre les heurts et les souillures de la vie par une enveloppe d’ouate imbibée de morale, coque parfaite de la nymphe… Mais quel envol voluptueux, lorsque l’abeille emmaillotée se dégage de ses entraves et découvre les champs de parfums de l’amour.
« L’amour, ce n’est rien, n’est-ce pas ? que notre fonction animale et fatale de reproducteur des instincts accumulés de l’espèce. La femme que nous idéalisons, ce n’est rien que notre pauvre femelle dont le ventre portera le douloureux poids de notre brutale sensualité et se déchirera pour s’en libérer ; ce n’est qu’un pistil énamouré que nous, adorantes étamines, nous enveloppons de nos hommages qui ne sont que des pièges. Pièges à douleurs, pièges à mensonges, pièges à regrets.
« La vie, la femme, l’amour, Morangis, ce n’est rien que de petites réactions chimiques perdues dans l’immensité des mondes. Ce n’est rien, si nous ne les divinisons pas par notre sentiment intellectualisé ; par une création lyrique perpétuelle.
« L’homme est tout de même un animal merveilleux : il ne vit que quelques instants, mais il a inventé l’éternité, où le moindre de ses baisers se répercute d’échos en échos, de cascades en cascades, dans l’infini illusoire du temps et de l’espace. Et pourtant, c’est vrai, puisqu’il le conçoit.
Ils s’étaient immobilisés au milieu du Pont des Arts et, appuyés au balcon de fer, ils contemplaient sans prendre une conscience précise de ce paysage familier, la proue de la Cité fendant les eaux de la Seine. Morangis interrogeait maintenant Raymond sur sa vie et s’inquiétait encore de Marguerite, à laquelle Raymond ne pensait déjà plus que comme à un personnage de roman. Mais par délicatesse envers Morangis inconsolable de la mort de Marthe, Raymond ne voulut pas lui avouer son nouvel amour pour Rite. Morangis n’eût peut-être pas compris que l’on pût si facilement renouveler son absolu. Il se contenta de l’évoquer, comme une maîtresse momentanée. D’ailleurs on n’est jamais assuré, même des éternités que l’on veut imposer et s’imposer.
— Intelligente, ajouta-t-il, et cultivée : la culture intellectuelle chez une femme est plutôt favorable aux curiosités sensuelles. On n’imagine pas ce qu’une lecture de littérature érotique peut éveiller de sensualité chez une femme ; mais les idées les plus pures se transforment aussi en elle en excitations sexuelles…
« Si bien, Morangis, que deux amants qui s’aiment et se possèdent ne sont en somme que le heurt de deux sensualités chargées d’images et d’excitations recueillies dans la vie et dans la littérature. Il n’y a pas de fidélité cérébrale.
Et Raymond pensait, en effet, que s’il possédait Rite, ce soir, il posséderait en elle l’image de cette jeune fille aux yeux verts, dont il avait un instant sur les quais frôlé la croupe vivante, d’une main rêveuse et troublée.
— Que ce désir refoulé enrichisse mon désir de Rite, souhaita-t-il : le désir d’une autre virginité qu’elle ne m’a pas encore donnée.
Il y rêvait. Et conscient d’une paresse dont son orgueil était un peu humilié, il se surprit à confier à Morangis qu’il travaillait à un roman, depuis longtemps annoncé. Et, en disant cela, il le croyait presque lui-même et s’imaginait qu’il était en train de réaliser tout ce qu’il rêvait d’écrire et qu’il n’écrirait sans doute jamais. Autosuggestion pour maintenir la température de son orgueil humain. Il enviait presque la sérénité médiocre de ces hommes de lettres parasites qui, n’ayant ni vie ni passions personnelles, s’attachent, se collent comme des sangsues à l’œuvre de quelque grand écrivain et vivent de son sang, de sa pensée et de sa gloire. Rien ne les distrait de leur tâche de nécrophore, ni une inquiétude, ni un doute sur l’intérêt de leur besogne : ils continuent sans hésitation à percer leurs petites galeries dans l’œuvre célèbre, qu’ils considèrent comme leur propriété exclusive ; et ils vivent là bien à l’abri de la vie, dans cette œuvre qu’ils déforment selon la médiocrité de leur admiration :
— Ce sont, dit-il, des déformateurs de valeurs.
— Ces vulgarisateurs des grandes œuvres, même en les déformant à notre usage, sont tout de même plus utiles que les fabricants de romans-feuilletons, observa Morangis…
— Non, répliqua Raymond, le roman-feuilleton n’est pas si méprisable que cela : il constitue, en somme, la vraie littérature populaire et est une sorte de perpétuation des romans de chevalerie, de nos chansons de gestes. Ce sont des œuvres idéalistes qui cherchent à s’élever au-dessus de la vie quotidienne : aventures, sentiments, personnages, tout y est irréel, jusqu’aux crimes, jusqu’aux amours, jusqu’aux trahisons et aux vengeances. Le peuple n’aime que ce qui l’arrache à la réalité de sa vie, et ce qu’il demande à la littérature, c’est du songe et du mensonge. Et il y a peut-être plus d’art dans cette transposition, si médiocre soit-elle, de la vie, que dans le réalisme, inventé par des intellectuels saturés de fiction…
« C’est au bout de longues années de romantisme que Flaubert a trouvé la formule romanesque de Madame Bovary ; mais le peuple se moque de cette Madame Bovary, qui est une vraie femme, il se moque des vraies notations de psychologie et de paysages. Ce qu’il désire, c’est du rêve, c’est du faux, c’est de l’imagination, c’est s’évader de l’atmosphère où il est obligé de vivre. Il veut que dans les romans qu’on lui offre, il y ait du merveilleux jusqu’à l’absurde, et plus un roman sera faux et invraisemblable, plus il le trouvera beau. Il faut aussi que ce roman soit non pas mal écrit, mais écrit simplement, c’est-à-dire en clichés et en lieux-communs d’idées où il se retrouve. Il n’aime pas les métaphores neuves, parce qu’il ne les comprend pas, tandis que ces bons clichés, ces vieilles monnaies usées, n’est-ce pas lui qui les a lui-même fabriquées ?
« Ce public a raison : ces clichés sont pour lui aussi vrais, aussi clairs que les images du cinéma. Et le cinéma est peut-être le critérium le plus efficace des œuvres littéraires. Otées les orties de mauvaise et prétentieuse littérature qui envahissent les pièces d’Henri Bataille, par exemple, que reste-t-il de ces chefs-d’œuvre ? Un vulgaire scenario de cinéma, ni meilleur ni pire que la plupart des romans-feuilletons avec ou sans épisodes…
« Je viens justement de voir « Le Scandale » mis à l’écran. C’est d’une pauvreté et même d’une fausseté psychologique étonnantes.
« Tout le succès de Bataille auprès du public (le peuple s’étend jusqu’aux plus hautes classes de la société) est dans cette fausseté par laquelle il échappe au réalisme.
— Si les hommes pouvaient se douter que leur mort est si prochaine, réfléchit Morangis, peut-être ne songeraient-ils pas à fabriquer d’inutiles œuvres de littérature ou d’art. Mais nous ne connaissons la mort que par l’expérience des autres, expérience qui n’a aucune valeur pour nous…
— C’est vrai, dit Raymond ; la mort, c’est… livresque. Même avec cette expérience livresque et l’exemple de la disparition de nos voisins, la mort demeure pour nous tout à fait extérieure : il nous faut faire effort pour comprendre que cela nous arrivera aussi, un jour, de mourir. Nous le comprenons intellectuellement, mais cela ne nous touche pas, n’atteint pas notre sensibilité. Nous sommes un peu comme les arbres qui ont semé leurs graines et se perpétuent par elles identiques à eux-mêmes. Nous avons transposé cérébralement la vie souterraine et profonde de nos cellules, mais même si nous savons échapper aux lois de la reproduction, l’amour, même stérile, demeure toujours le geste de notre prolongement cellulaire, et c’est seulement cela qui compte : la génération et la mort se confondent. L’idée de l’individu n’est qu’une création de notre cerveau.
« Ce qui est important, c’est la race, la grande forêt, la grande colonie des cellules humaines, et, cela, des aventures comme la guerre le font comprendre. Les valeurs que nous donnons aux individus sont bien superficielles. Au point de vue de la collectivité cellulaire, qu’un grand musicien comme Granados soit englouti dans un torpillage, cela n’a peut-être pas l’importance que l’on croit, la sensibilité qu’il représente retrouvera son expression dans d’autres êtres et personne n’est indispensable. La signification des êtres supérieurs, c’est nous collectivement qui la leur donnons, qui les en revêtons comme d’une chasuble dorée pour dire la messe devant laquelle nous nous agenouillerons, reconnaissant le dieu qui est en nous et qui est l’âme de la forêt collective des cellules humaines…
Après avoir quitté Morangis et dîné seul à la terrasse d’un restaurant des quais, devant la lumière pâle du soir, Raymond décida qu’il irait visiter Madeleine, cette Madeleine qu’il avait toujours aimée avec plus de tendresse que de passion et qui demeurait pour lui une sorte de stabilité affectueuse dans sa vie tourmentée. Il ne l’avait pas revue depuis la mort de Marthe et sa rencontre avec cette nouvelle Rite qui l’avait plus définitivement encore séparé sensuellement de Madeleine. Il savait seulement par de longues lettres reçues de Normandie qu’elle avait dû pour sa santé retourner passer quelques semaines dans sa famille, d’où elle avait ramené à Paris un jeune neveu qu’elle semblait avoir adopté. Le ton affectueux de ces lettres avait rassuré Raymond :
— Elle a compris, pensait-il, qu’il ne fallait pas abîmer notre amour par de vains reproches afin qu’il garde toute sa douceur dans notre souvenir. Mais si vraiment après nous être possédés, nous sommes capables de nous aimer affectueusement, c’est peut-être que nous ne nous sommes en réalité jamais aimés. Car l’amour ne condescend jamais à l’amitié, il lui préfère la haine ou l’oubli.
Madeleine accueillit Raymond avec toute la spontanéité de sa vraie tendresse, mais Raymond fut presque déçu de constater la sérénité de son amie à son approche ; il avait, dans son imagination, prévu une étreinte plus angoissée et des larmes qui ne coulèrent pas.
Elle parlait d’elle-même comme si désormais, elle existait en dehors de lui, de son séjour réconfortant sous les arbres, et de cet enfant, encore mystérieux pour Raymond, qu’elle avait découvert là-bas et qui était bien, disait-elle, le plus joli petit être que l’on pût rêver :
— Il est là, ajouta-t-elle, indiquant au fond de la pièce où ils se tenaient une porte fermée que voilait une lourde tenture : il lit dans le silence les livres que je lui choisis dans ma bibliothèque : Villiers, Laforgue, Verlaine, Mallarmé. Je veux que sa jeune intelligence soit émue de tout ce qui m’émut, afin que rien de moi ne lui soit étranger… Je te le montrerai tout à l’heure ; je l’ai arraché à sa famille qui ne savait d’ailleurs que faire de cette sensibilité inquiète et que j’ai tout de suite rassurée.
Et Madeleine évoquait en silence ces heures d’initiation tendre où elle avait senti venir vers elle la confiance de ce grand enfant égaré qui s’était épanoui en elle comme une fleur coupée dans une coupe d’eau fraîche.
— Comprends-tu, Raymond, Dionys (je l’appelle Dionys à cause de sa beauté androgyne) est comme le fils de mon cerveau. Je lui ai donné la vie intellectuelle.
Elle ajouta :
— Toutes les vies, Raymond, car il est aussi mon fils incestueux et je l’aime ; je l’aime comme s’il me donnait ta propre enfance que je n’ai pas caressée. Je te dirai un jour la fraîcheur de cette sensualité pure comme un poème verlainien et d’une sanglotante ardeur. Il me semble qu’il est à la fois ton enfant et le mien, et en même temps, c’est toi encore que je mêle à mon sang, à ma pensée, à mes souvenirs. Je lui parle souvent de toi et il sait que mon corps dont il est le timide jardinier fut le sous-bois de tes songes et de tes exaltations ; il sait aussi que c’est ton amour qui a fructifié mon intelligence de femme.
Raymond écoutait ces aveux avec une surprise un peu attendrie, flatté aussi de cette fidélité à son souvenir que Madeleine associait à son inconstance. Il ne pouvait s’empêcher d’admirer avec quelle belle vigueur les idées qu’il avait semées dans l’âme de son amie avaient levé, et il se réjouissait de constater le pur immoralisme de cette femme qui avait dépassé le stade des craintives morales.
— Elle aime cet enfant comme son fils, pensa Raymond. C’est, en effet, chez elle, une déviation de l’instinct maternel, et elle trouve dans cette transposition sensuelle plus de plénitude que dans le pur amour maternel qui est souvent, quoique sacré, une déception.
« Même sans se l’avouer, les mères sont presque toujours amoureuses de leur fils qui est, plus totalement que leur mari, la propre extériorisation de l’idée de beauté qu’elles se font de l’homme. Leur fils, c’est une idéalisation virilisée d’elles-mêmes. Elles sont jalouses de ce petit mâle qui leur ressemble, et s’il est beau, elles mettront tout leur soin à le lui cacher, afin qu’il ne cherche pas à prendre une plus précise conscience de sa beauté et de sa virilité dans d’autres femmes.
« Elles désirent que cet enfant demeure éternellement à ce stade de l’enfance et des promesses jamais réalisées complètement. Et les amantes qui les leurs prennent et les accaparent sont pour elles des femmes vicieuses et mauvaises.
« C’est un métier ingrat d’être mère, et de vouloir retenir près de soi un jeune mâle dont le seul instinct vivant est de fuir et de vivre pour lui-même.
Et Madeleine raconta à Raymond les prémisses de cette tendresse, leurs premières approches mystiques et sensuelles dans cette atmosphère religieuse. Elle s’était peu à peu substituée à ce Dieu qu’on lui avait appris à adorer… et, dit-elle, son premier agenouillement sensuel fut vraiment une adoration mystique.
— L’éducation religieuse, observa Raymond, est décidément une méthode excellente : elle préserve les jeunes hommes des sensualités hâtives et en accumulant en eux des désirs toujours irréalisés, des curiosités idéalisées, elle les prépare au sacerdoce de l’amour. Je crois que les grands amoureux ont toujours poussé dans des terres mystiques.
— Oui, répondit Madeleine, et, là-bas, dans ce petit village de Normandie où le mot amour n’est jamais prononcé qu’associé à une abstraction divine, il semble que tous les êtres sont hantés par les images d’une sensualité défendue. Je ne parle pas des paysans qui, eux, vivent la vie normale de leurs bêtes, mais sans mystère et sans répercussion cérébrale.
« Je songe surtout aux malheureux prêtres jeunes que j’ai fréquentés là-bas, et dont la vie secrète était un brasier mal éteint. L’amour défendu est leur unique pensée qu’ils essaient en vain de transposer en amour divin. L’un d’eux s’était épris pour moi, peut-être pas d’un amour, mais d’un désir à la fois timide et irrésistible, qui me touchait et m’inquiétait.
« Jamais il n’osa me dire son tourment, mais sa main tremblait lorsqu’il touchait la mienne, et ses yeux illuminés violaient la chair de ma gorge et de mes bras nus…
« Peut-être l’aurais-je accueilli, si je n’avais pas été toute prise par ma tendresse pour Dionys. Je l’aurais accueilli par pitié et peut-être aussi par un goût assez puéril du sacrilège, vestige d’une vieille hérédité catholique, souvenirs de ferventes communions de jadis, et aussi parce que l’intensité de son désir m’eût tentée.
« Mais je veux, Raymond, te dire l’épilogue ridicule et sinistre de cette aventure sentimentale. Ce prêtre m’a envoûtée et de la façon la plus réelle. Ne pouvant me posséder moi-même, il s’est résigné à ne posséder que mon image. Tu sais qu’il existe à l’usage des ermites, volontaires ou involontaires, des sortes de mannequins en caoutchouc, de la forme et de la grandeur d’une femme, munis de toutes les portes de l’amour, et que ces cénobites violent dans le secret de leurs nuits tourmentées… Amantes secrètes que l’on enferme dans un tiroir après l’extase.
« Mais voici ce qui fut dans cette simulation de l’amour un véritable envoûtement : l’amante de caoutchouc était faite à ma ressemblance ; on avait reproduit mes cheveux, mes yeux, ma bouche, mes seins, et improvisé le reste par intuition sans doute ou par analogie.
« Chaque soir — je l’appris par une indiscrétion vraiment indiscrète — et durant de longs mois, je fus ainsi violée en effigie par ce faune un peu divin et diabolique. Et j’ai presque honte, Raymond, de raconter cette aventure, même à toi, qui en comprend pourtant toute la tristesse…
— Je connaissais, en effet, ces turpitudes mystiques, dit Raymond, mais seulement par le catalogue d’un de ces singuliers spécialistes. Mais vois-tu, Madeleine, rien ne peut nous mettre l’abri des désirs indésirables…
Puis, tout à coup, éclatant de rire :
— Oh ! je me souviens même du prix assez élevé de ces simulacres ; mais aussi qu’avec la ressemblance d’une personne aimée, désirée ou perdue, c’était beaucoup plus cher. Enfin, Madeleine, accepte cette étrange transsubstantiation : le désir, d’où qu’il vienne, est toujours un hommage.
La porte drapée s’ouvrit doucement au fond de la pièce, dans la pénombre, et Dionys apparut, subitement intimidé par la présence de Raymond. Mais Madeleine, d’une voix tendrement maternelle, l’appela et le présenta à Raymond.
C’était un jeune homme de seize à dix-sept ans peut-être, blond et mince comme une jeune fille et qui regardait Raymond avec de grands yeux bleus hallucinés. La lumière de la lampe mettait un halo de clarté pâle autour de ses cheveux féminins.
Il s’assit sur un tabouret aux pieds de Madeleine et leva vers elle l’inquiétude muette de ses yeux.
Raymond l’interrogea sur ses lectures et à ses réponses d’une fervente spontanéité, il comprit qu’il y avait dans cet être un peu efféminé une sorte de lyrisme grave, dont Madeleine buvait directement les rythmes mais qui un jour peut-être se préciserait en fusées verbales.
— Il y a dans la jeunesse des hommes, dit Raymond, un mystère que je contemple toujours avec un certain respect : je songe à l’homme qu’il sera lorsque je ne serai plus. Et je ne puis m’empêcher de penser : il sera peut-être le génie que nous attendons.
« Il y a en nous (quoique cette division soit bien puérile et au fond inexacte) — une double personnalité : la personnalité innée, produit de l’hérédité, et que nous trouvons dans notre organisme même à notre naissance, comme un bourgeon contient toute l’envergure de la fleur future — ; et la personnalité acquise, résultat de l’éducation et des hasards de l’expérience personnelle.
« Peut-être que ceux que l’éducation transforme sont ceux qui n’ont pas une très puissante personnalité innée et que ceux qui se développent fatalement selon leur personnalité innée ne sont que la résultante inconsciente de leur hérédité. Un homme de génie serait déterminé par les apports de ses ancêtres : il ne serait que le produit des mélanges de sang et de race qui se fixent en lui pour un éclair fugitif… Il n’est pas libre.
« Ou bien l’homme de génie serait au contraire le moins marqué par la fatalité des ancêtres, le plus ouvert aux influences directes : celui, en somme, dont la race n’est pas fixée, et qui cherche son équilibre dans la vie même, équilibre intellectuel qui ne s’inscrit pas dans les muscles.
« Oui, c’est cela, continua Raymond, l’homme de génie est une sorte de mutation brusque dans l’évolution humaine, une sorte d’hybride dont l’espèce ne se fixe pas, ne se reproduit pas physiquement. Mais pourtant, l’homme de génie féconde sa race intellectuellement, et tout de même par répercussion, sexuellement.
« Il y a une véritable identification entre le cerveau et le sexe.
« Le cerveau d’une femme est encore une vulve avide de l’homme. Et de même que sexuellement la femme happe l’homme pour boire sa sève, intellectuellement la femme se nourrit du cerveau de l’homme et des éjaculations de sa pensée…
« La personnalité d’une femme ne peut être dissociée de sa ferveur amoureuse, de cette tension béante qui l’ouvre aux pollens de l’homme. Mais qu’elle reçoive la semence de l’homme en un spasme physique ou qu’elle accueille sa pensée intellectuellement, il n’y a là qu’une simple transposition.
« C’est pour cela que la littérature féminine n’est, en général, qu’une vibration sensuelle ou qu’une exaltation sentimentale. Il n’y a pas de littérature féminine d’idées, ou bien ce n’est que de la spéculation sentimentalisée. Une femme pense avec son désir et son sexe et la philosophie qu’elle adopte est toujours celle de son amant du moment.
« Mais, ajouta Raymond, il y a aussi une sorte de… tribadisme littéraire, et beaucoup de femmes de lettres ne sont qu’un compromis entre l’homme et la femme. C’est une véritable dégradation de l’énergie virile vers la féminité normale et passive.
« Et puis, en réalité, c’est peut-être trop simple de n’envisager l’individu que sous l’aspect de la sexualité. Les êtres ne trouvent leur plénitude physique et intellectuelle, leur complétude que dans l’amour ; et l’homme ne se réalise complètement lui-même que baigné dans le parfum de la femme qui provoque l’érection de son cerveau et la sécrétion de ses idées.
Madeleine qui avait écouté Raymond avec beaucoup d’attention souriait intérieurement à ces dernières pensées et tandis que sa main caressait les cheveux de Dionys qui avait posé sa tête contre son sein, elle se promettait bien d’être pour son jeune amant cette plénitude physique et intellectuelle que l’on trouve dans l’odeur mouillée de l’amour.
Raymond pensait que Rite ne savait pas arranger sa vie, afin de lui donner un peu de son amour quotidien et il se plaignait à elle-même dans une lettre, sans vouloir en comprendre les raisons, de ses visites trop espacées.
— On perd le divin contact, disait-il, et ce qui est peut-être plus grave, l’équilibre de sa sensualité.
Et il se demandait s’il ne serait pas obligé de chercher à cette Rite trop intermittente une coadjutrice…
Pourtant, Raymond rejeta vite cette pensée sacrilège et se suggestionna le bonheur douloureux de la fidélité dans l’attente. Fidélité que des lettres quotidiennes de Rite, si lourdes d’évocations et de désirs, entretenaient par leur atmosphère d’éternité.
— Il me semble parfois, songeait Raymond, que les ferveurs de mes lettres n’ont que ce but inconscient de provoquer son amoureuse admiration dont j’ai besoin. Je ne l’aime peut-être que parce qu’elle est le plus merveilleux miroir où je puisse me contempler : je m’y contemple, en effet, comme l’être le plus parfait, le plus beau et le plus puissant qui soit au monde.
« Il faut qu’une femme nous donne cette sensation d’être l’amant le plus puissant, et il semble que pour un homme, cette qualité de puissance sexuelle contienne toutes les autres : l’esthétisme, l’intelligence, l’esprit… etc. Et c’est vrai. Nous aimons la femme qui nous assure cette domination sur la vie, cette royauté, et qui seule entre toutes les femmes, a compris l’exception que nous étions.
« O Rite, c’est toi qui es vraie, c’est toi qui es sincère et verses de vraies larmes, lorsque tu me cries ton désir d’une vie perpétuellement mêlée à la mienne, désir que je ne cultive moi-même que comme un rêve impossible et pourtant nécessaire à la cristallisation d’un absolu intellectuel.
« Mais si tu n’étais qu’un des visages fugitifs de cet absolu ? L’amour est une ascension subite d’où l’on redescend dès les premiers pas. Dès cette minute où les lèvres se sont jointes, le doute et l’inquiétude entrent dans l’âme, et la première fleur cueillie est déjà un peu fanée.
« Un amour, c’est une double certitude qu’on s’impose et que la vie contrarie toujours. C’est une entreprise de s’aimer : il y entre de la volonté, et une faiblesse aussi qui est encore la plus sûre servante des amants.
Ce glissement fragile des lettres sous la porte : parmi ces papiers pâles et inutiles, l’écriture de Rite luit comme une feuille d’or dans un sentier. Son écriture qui s’est affinée, contractée comme pour mieux refléter le style de Raymond, est déjà une caresse.
Raymond ne se précipite pas sur cette lettre pour l’ouvrir et la dévorer : il se prépare à cette lecture par quelques minutes de recueillement et suppute les délices de ces pages.
Ces mots qu’elle lui envoie ont dormi dans ses rêves de la nuit et dans son parfum du matin : ils sont une présence qui se serre contre l’âme et contre la chair ; ils sont les gestes mêmes de l’amour et il y a dans cette évocation de l’étreinte une communion réelle plus puissante peut-être sur les sens que l’étreinte elle-même…
Raymond alors s’abandonne à ces mots qui le violent, à ces sentiments qui l’enveloppent de leur musique. La flamme du cerveau gagne toute la chair et il assiste comme un spectateur troublé et ému à cet embrasement de ses images et de ses émotions réveillées : hallucination vraie qu’il prolonge et qu’il cultive, et dont pourtant il ne veut pas épuiser toute la magie. Que ces pages gardent encore un peu de leur phosphore pour l’illumination des heures seules du soir.
Mais ce matin, la lettre est légère et ne contient que ces mots qui semblent trembler de joie :
… « Je serai chez toi à trois heures, aujourd’hui.
Rite. »
Et, au bas de la feuille, le baiser rouge et amoureusement appuyé de ses lèvres. Raymond posa sa bouche contre cette émouvante empreinte dont il admira en outre le dessin parfait : la forme du baiser de Rite.
Il l’attendait maintenant avec une impatience qu’il n’arrivait pas à dominer et qui ne s’apaisait que pour guetter, l’oreille collée à la porte, les bruits de l’escalier. On sonna. Retrouver sa sérénité et paraître venir du lointain de son cabinet de travail pour ouvrir avec calme cette porte contre laquelle il était en attente.
La sérénité marque une confiance plus assurée, pensa Raymond, et il ne faut pas donner, même aux êtres que l’on désire le plus violemment, cette impression d’inquiétude et d’angoisse qui leur ferait trop sentir que nous sommes leurs esclaves. L’amour est une lutte entre deux êtres et si l’on tient à la tendresse d’une femme, il ne faut jamais qu’elle soit tout à fait sûre de notre amour. Le jour où elle en est assurée, cela ne l’intéresse plus… Il est même sage d’entretenir une petite plaie saignante au cœur des femmes, comme les cornacs entretiennent une blessure vivante à l’oreille des éléphants…
Rite a jeté son léger manteau de soie sur le bras tendu d’une déesse de bronze, ses lèvres s’écrasent sur la bouche de Raymond qui, debout, tenant la belle tête de son amie dans ses deux mains, immobilise longtemps ce baiser dans le silence. Et puis, prolongeant ce bouche à bouche qui déjà fait défaillir Rite, il la soulève et les jambes pendantes sur son bras, il la porte sur le divan, s’agenouille devant elle et la contemple.
— Je t’aime ainsi, Rite, encore toute vêtue de tes robes légères et transparentes à travers lesquelles je devine ta chair vivante. Mes lèvres aiment ces prémisses de ton parfum mordu à tes aisselles blondes, et mes mains te cherchent sous les feuilles.
— Il n’y a peut-être, pensa Raymond, rien de plus pur et de plus émouvant que cette ligne du ventre qui descend vers le secret de la femme ; les mains les plus douces sont encore trop rudes pour en caresser l’émotion vivante : seul le velours sensible des lèvres est assez délicat pour se poser sur cette chair qui est déjà un vertige de désirs et de parfums où tout notre être va se glisser défaillant.
« Deux colonnes de blancheur se referment sur ma prière, Rite, et j’écoute la plainte parfumée de ton être qui se verse dans mon baiser. Laisse-moi m’enfermer dans ce rythme qui se soulève vers moi et m’attire comme un vertige : ton visage est grave comme le visage d’une morte, ton regard a fui sous tes paupières entr’ouvertes : j’aime cette douleur que je poignarde en toi à coups précipités et dont je mordrai à ta bouche la dernière convulsion. Ton sanglot se défend et m’exile ; tu es pâle et froide et j’écoute, la tête sur ton sein, les battements fous de ton cœur qui ne veut pas s’apaiser…
« Reposons-nous dans cette clairière de silence, dans cette forêt où les branches qui frôlent mon front sont ta chevelure, où mes lèvres qui ont bu la sève des tiges déchirées, ont le goût de tes bouches. Mais déjà le songe de ta chair que je tiens emprisonné dans ma main comme un oiseau blessé, palpite et continue sa rêveuse ascension : emporte-moi, que je participe aux battements de tes ailes, au battement de ta chair qui claque comme un linge mouillé dans le vent. Demeurons longtemps dans ce parfum qui nous enveloppe et que l’enlianement de tes jambes à mon corps immobilise le double élan de nos êtres… O Rite, donne aussi à mes yeux, qui te cherchent, l’intensité de ton regard à cette seconde où la projection de nos joies se mêle et s’extasie.
… Et Raymond qui contemplait l’harmonieuse défaillance de Rite, admirait ce rayonnement qui l’illuminait et la nimbait comme du halo d’une sainte.
— Jamais, ô Rite, dit-il, ton visage n’est aussi pur qu’après l’amour : tes yeux, lorsque la flamme du désir s’est éteinte, ne sont plus qu’une lumière spiritualisée. Mais une femme n’atteint la plénitude de sa beauté que dans l’angoisse du désir à la minute électrisée où l’éclair de sa douloureuse joie va la déchirer. Nous n’avons vraiment qu’une vague intuition de la beauté des femmes que nous n’avons pas possédées. Et peut-être même qu’une femme laide, si elle aime intensément son amant, peut lui donner parfois l’illusion de la plus rayonnante beauté. Mais l’amour transfigure l’homme lui aussi, et n’est-ce pas le mythe admirable revivifié dans le conte de Mme de Beaumont : La Belle et la Bête.
— J’aime ce que tu me dis, Raymond, réfléchit Rite : je n’aurai jamais été belle que pour toi. Vois : ma chair aussi, comme mes yeux, se spiritualise ; elle écoute tes mots et tes pensées. Mais tes mots sont encore des caresses parce que j’aime la gravité sensuelle de ta voix. Lorsque je suis seule dans cet enfer quotidien qu’est ma vie loin de toi, je l’écoute encore, je la sens sur moi comme la tendresse de tes yeux et de tes mains. Et je m’endors, enroulée dans tes mots que je me récite comme une prière.
Et Rite, allongée dans sa forme spiritualisée, caressant distraitement les fraises de ses seins, évoquait ces longues heures de vie familiale où elle s’isolait si obstinément dans la pensée de Raymond.
— Oui, dit-elle, un peu comme en mes jeunes années de ferveur mystique, je m’isolais dans la pensée de Jésus. J’ai compris depuis que ce Jésus que je créais de tout mon amour, c’était toi, Raymond, celui qui devait venir me sauver…
Elle souriait avec cette expression de tristesse inquiète qui traîne toujours dans le bonheur :
— Je ne crois plus qu’en toi, dit-elle.
Mais, par une héroïque délicatesse, Rite ne s’abandonnait jamais à parler à Raymond de sa vie réelle. Elle se souvenait que Raymond lui avait écrit un jour : « Je ne veux pas, Rite, qu’une confidence de toi donne une précision vivante à cet être dont je veux faire abstraction. Je sais seulement qu’« il » t’est dévoué et qu’il travaille pour toi : c’est un noble but, dont il est lui-même anonymement anobli à mes yeux.
« Ta vie d’ailleurs ne le regarde pas, car une femme n’appartient qu’à elle-même, et il n’y a sacrement religieux ni civil qui puisse lui faire aliéner sa liberté. »
Il ajoutait : « Notre amour n’est pas un contrat : qu’il demeure en dehors et au-dessus de toutes les conventions sociales (qu’il faut d’ailleurs respecter). Oui, Rite, notre amour est une vie intérieure, un état d’être qui peut s’adapter à toutes les conditions d’existence. »
Pourtant, Rite, à cette heure de sécurité apaisée, ne pouvait s’empêcher de songer à la douceur que ce lui serait de demeurer dans cette atmosphère faite de la respiration de leurs âmes et de leurs chairs. Elle dit seulement avec timidité :
— Ne plus s’en aller, Raymond !
Mais Raymond ne lui répondit qu’en la serrant plus fortement contre lui-même, lui exprimant par cette étreinte muette les douloureuses nécessités de la vie et qu’il en avait encore une plus vive conscience et une plus vive douleur qu’elle-même…
La tête dans son bras et couchée sur le ventre, Rite offrait ainsi à Raymond la tentation de sa belle croupe, que dorait la lumière du soir. Elle s’abandonnait à cette contemplation de Raymond qu’elle sentait sur elle comme un vivant fluide et elle écoutait monter en elle un désir lentement résurgi. Blottie dans le silence odorant de ses cheveux blonds, elle était toute en attente de cette lumière qui allait envahir sa chair et son cerveau.
… A une caresse interrogative de Raymond, elle avait tourné vers lui un regard un peu inquiet :
— Oh ! Raymond, c’est si petit !
Mais elle était si heureuse d’avoir cette virginité à lui offrir : elle accueillit cette joie douloureuse qui la clouait à sa propre volupté, et le visage tourné vers Raymond, quêtant la morsure de sa bouche :
— Je suis encore un peu plus tienne, dit-elle, secouée d’un sanglot d’une intensité si aiguë qu’elle ne pouvait en éteindre la brûlure.
Soulevé par cette vague qu’il dominait, Raymond se sentait comme accroché à une épave battue par le flot qu’il embrassait de ses deux bras.
Ils se rembarquèrent dans la barque mouillée, et à toutes rames se jetèrent au fond de l’abîme, ivres dans la vague qui les avait submergés. Le flot les a jetés nus et défaillants sur le sable : ils ferment les yeux pour écouter en eux-mêmes la réverbération de ces minutes intenses. Par quelques mots à voix basse, ils se prouvent à eux-mêmes la réalité de leur présence :
Raymond disait :
— Les femmes qui accueillent avec confiance cette plus secrète et plus intime inclusion, en sont récompensées par une volupté d’une répercussion sexuelle plus étendue et où deux harmonies se répondent et se confondent…
« Mais, Rite, tous les gestes de l’amour associés à un état de sentiment sont beaux et harmonieux…
Et, évoquant la complication de certains de ces gestes :
— Ils redeviennent instinctifs, observa Raymond, lorsqu’ils rentrent dans l’automatisme de l’expression amoureuse. Un maître organiste songe-t-il à la complication du jeu des pédales lorsqu’il exécute une symphonie ? Vous, nos amantes, vous êtes nos orgues divines : nos mains et nos bouches exécutent instinctivement la symphonie de nos désirs.
— Surtout, pensa Raymond, lorsque nous avons longuement étudié l’harmonie et le contrepoint de la volupté et exécuté beaucoup de gammes.
— Que ta pensée me suive toute cette soirée, dit gravement Rite, au moment où son baiser d’adieu se détachait des lèvres de Raymond. Songe à mes heures silencieuses devant un livre où je revivrai nos images.
Elle ajouta, exprimant une décision subite :
— A demain, Raymond ; je veux être désormais ta Rite quotidienne… Oui, qu’importe tout ce qui n’est pas toi…
Fidèle au serment qu’elle s’était fait à elle-même, Rite s’était, en effet, assuré la liberté de ses après-midi, et parfois même elle s’attardait jusqu’à la nuit, jusqu’au matin, insatiable de se donner comme si elle eût voulu en quelques semaines brûler l’ardeur de tout son être dans le brasier de leur amour. Elle n’avait pas d’autres curiosités que cette révélation que lui était sa propre sensualité. Entourée des livres de Raymond, elle n’en ouvrait jamais un seul et Raymond admirait ce dédain pour sa forêt de feuilles mortes. Jamais non plus, elle n’eut le désir d’une promenade le long des rues ou dans l’allée d’un jardin : elle venait chez Raymond comme une dévote vient à l’église et elle priait de toute sa chair.
Emporté dans ce courant de mysticisme sensuel, Raymond lui-même oubliait toutes les autres préoccupations de la vie, et se retrouvait complètement lui-même dans ce merveilleux égoïsme de l’amour.
Il contemplait de loin la vaine agitation des hommes. La gloire elle-même lui paraissait vaine : la conscience de lui-même qu’il prenait dans l’amour de Rite n’était-elle pas supérieure à tous les reflets que lui renverrait l’admiration des hommes ?
— Il y a peut-être, disait-il, une plus parfaite plénitude dans cette excitation cérébrale que donne l’amour, non plus pour la réalisation d’une œuvre, mais pour la réalisation de soi-même.
« J’aurais pu passer ma vie à décortiquer des philosophies et des esthétiques : j’y aurais récolté peut-être quelques amères feuilles de laurier. J’ai préféré le spectacle de mes propres sensations et de mes propres idées, jets d’eau qui retombent toujours sur eux-mêmes. Mais peut-être aussi est-il plus sage d’avoir donné son cerveau à grignoter à quelques belles femmes que de l’avoir livré à l’incompréhension des foules.
Et, en s’analysant plus profondément, Raymond trouvait dans son nirvana même l’élan immobile d’un arbre sain et lourd de ses feuilles. La vie lui semblait comme éternisée, et cette jeunesse qui faisait de son propre corps nerveux de faune une perpétuelle flèche tendue vers la joie, il la sentait aussi immuable que l’éternelle fraîcheur des étoiles. Il n’éprouvait aucune inquiétude métaphysique, mais seulement le désir obscur de capter toujours plus de vie. Il se surprenait à interroger les yeux des femmes avec une sorte de désespoir de ne pouvoir absorber et s’enrichir de toutes ces petites gouttes de beauté cristallisées en parfum d’éternité fugitive.
Cette hantise de l’odeur féminine troublait Raymond.
— Jusqu’ici, dit-il un soir à Morangis, qui était venu le surprendre, nous n’avons fait entrer dans notre conception esthétique de la femme que des données visuelles ; il faudrait enfin y faire pénétrer nos impressions odorales qui sont presque tout dans l’amour.
« C’est son odeur qui fait la beauté de la femme.
« Instinctivement, à la vue d’une femme, nous devinons son parfum d’amour, ce parfum qui nous prendra tout entier, corps et âme. Car la vue est en quelque sorte la synthèse de tous nos sens. Notre œil respire et palpe la chair, et ne nous trompe pas.
« D’ailleurs, il y a un rapport mystérieux et certain entre les lignes, les couleurs, l’expression d’une femme et son parfum et son baiser. Lorsqu’un poète de génie aura fixé ces concordances intuitives, il aura enrichi notre raison d’une connaissance nouvelle.
— Si bien, répondit Morangis, que, respirer une femme, c’est déjà l’avoir possédée…
— Oui, dit Raymond : le goût du fruit est dans son parfum. Mais cela prouve aussi qu’il ne peut y avoir d’esthétique absolue. L’esthétique est individuelle et correspond à notre sexualité…
Après un silence, il ajouta :
— A notre orgueilleuse et éphémère virilité : petite vibration d’insecte dans la lumière. Je songe malgré moi aux personnages du passé, ancien ou récent, dont nous ne pouvons plus imaginer les amours que par nos propres gestes, nos propres émotions. Contemplés de très haut, tous ces émois ne sont pas plus individualisés et différenciés que les gestes d’accouplement des mantes ou des scarabées.
« Vois, Morangis, cette mauvaise peinture qui représente une très belle femme de la fin du 18e siècle, une de mes aïeules : je sais son nom, mais il ne reste d’elle que cela : la vanité d’une étiquette et cette imprécise empreinte sur une toile. Elle n’est plus rien, ni du passé ni du présent : elle est comme si elle n’avait jamais vécu. Sous quelles caresses a-t-elle vibré, crié son petit cri de joie étouffé sous la terre ?
« Si on réfléchissait plus sérieusement à ces banalités et à la vanité des éternités, peut-être finirait-on par mieux diriger sa vie, apprendrait-on à ne pas l’encombrer de désirs inutiles, à équilibrer sagement ses joies et ses peines afin d’en fabriquer une harmonie, une sérénité…
« Mettre son orgueil dans le sentiment même de la fragilité de cet orgueil. Prendre conscience de sa grandeur dans la vanité de la grandeur. N’aimer la gloire que comme une vérification de sa propre valeur et n’en accepter le mensonge que comme un levain de perfection. Perfection sans autre but que cette perfection même, abstraction faite de toute idée de lâche récompense. La récompense est une insulte, une humiliation.
Pourtant, réfléchit Raymond, qui parlait plus pour clarifier ses propres pensées que pour convaincre Morangis qui, sans doute, l’écoutait distraitement. Mais Raymond aimait cette immobilité silencieuse de son ami qui lui donnait l’illusion d’être compris.
— Pourtant, Morangis, toute perfection réclame, comme la beauté, un miroir où prendre conscience d’elle-même. Il suffit qu’un être nous regarde (fût-il un mythe divin ou sentimental créé par notre propre imagination), nous regarde et nous approuve. La solitude n’est que vide et inconscience : ceux qui ont pu la supporter et s’en enrichir ne l’ont fait que par une sorte de dédoublement de leur personnalité, dont l’un des personnages admirait l’autre.
« La solitude serait la mort, Morangis… Toi-même qui es seul, ne vis-tu pas avec le fantôme de Marthe, plus réelle en toi qu’elle ne le fut jamais dans sa réalité charnelle…
— Oui, répondit Morangis : elle est là et il me semble qu’elle nous écoute…
Mais Raymond poursuivait le fantôme de son idée, curieux de la conclusion à laquelle il allait aboutir :
— Personne n’a jamais pu supporter la vraie solitude… Les ermites du désert dansaient leur ascétisme et leurs flagellations sous l’œil de Dieu, miroir idéalisé. D’ailleurs, nulle beauté dans ces humiliations et ces sacrifices : ce n’est qu’un marché, un échange, une volonté assez intelligente dans sa naïveté d’être, un jour prochain, heureux éternellement. Si Dieu existait, c’est lui qui serait la dupe de ce marché. En réalité, il n’y a pas d’amour désintéressé : même celui qui prétend se sacrifier à l’être aimé n’est pas pur, puisqu’il trouve sa volupté dans l’idée orgueilleuse du sacrifice accepté.
« En vérité, je te le dis (selon la formule du Christ), tout être vivant n’a qu’un désir, qu’une volonté, et tous ses gestes, même les plus contradictoires, tentent de le réaliser : être heureux. C’est un tropisme aussi fatal que celui qui fait tendre les protozoaires vers la lumière. Quels que soient les modes de transposition de cette tendance fatale, tous les hommes agissent et s’agitent vers cette lumière du bonheur, les Don Juan comme les martyrs volontaires. Et ces derniers sont encore les plus voluptueux, les plus exigeants : ce sont de formidables poètes qui dédaignent une vie qu’ils jugent médiocre, ce qui prouve la qualité de leur lyrisme, pour une autre vie divinisée qu’ils se créent et qui devient pour eux la réalité.
« Oui, même celui qui se suicide cherche encore le bonheur dans la paix et dans le néant.
« La vie est amour, joie, bonheur, jusque dans ses détresses, ses déchirements et ses angoisses.
Un matin d’une agaçante pureté, une lettre de Madeleine apprit à Raymond qu’elle avait dû subitement repartir pour la Normandie, au chevet de sa pieuse tante à l’agonie. Le plus cruel pour elle avait été de partir sans son Dionys auquel elle voulait épargner le spectacle inesthétique de la mort. Il n’arrivera, disait-elle, que lorsque tout sera prêt pour la cérémonie rituelle et le réconfortant banquet qui suivra. En attendant ce jour encore imprécis, elle confiait Dionys à Raymond, le priant de le préserver de toute mauvaise accointance et de le lui garder dans toute cette pureté dont elle se réservait la possession impure.
Mais Raymond, dont toutes les heures vivantes étaient enlianées à la présence de Rite, se déchargea de cette garde sur Morangis et lui remit le jeune éphèbe aux grands yeux bleus. Morangis, un peu troublé par la féminité équivoque de ce jeune dieu, l’emmena chez lui. Il sentait en lui un peu de cette fierté que l’on éprouve à posséder un beau lévrier décoratif ou un somptueux chat angora.
Mais il s’aperçut tout de suite qu’il y avait une âme sensible et inquiète dans ce jeune animal de style. Un soir que devant le silence rêveur de l’enfant timide, Morangis s’abandonnait à ses improvisations musicales, il se retourna tout d’un coup et vit que Dionys, la tête dans ses mains, pleurait, la poitrine soulevée d’un sanglot.
Ému de cette émotion, Morangis s’était approché, et à genoux devant le divan où Dionys était assis, il l’attira vers lui, le serra sur son cœur et l’embrassa. Il fut tout étonné d’avoir cherché les lèvres de l’enfant qui n’avait pas chassé ce baiser, encore mouillé de son sanglot. Il ne savait pas si c’était sa propre musique qu’il baisait aux lèvres de Dionys ou s’il était seulement inconsciemment attiré vers la féminité qui se cachait en ce corps d’éphèbe. Il voulut refouler en lui ce sentiment qui était déjà plus qu’une curiosité et il en exagéra la tendresse en essayant par des mots fraternels de consoler la douleur qui avait jailli du cœur de Dionys.
Mais, incapable de se comprendre lui-même, Morangis vint voir Raymond et confessa son émoi imprévu. Raymond rassura son inquiétude : il n’y avait rien d’anormal dans son trouble qui n’était pas le trouble sensuel d’un inverti :
— C’est la femme encore que tu cherches et que tu trouves dans Dionys.
« Je pense même, ajouta Raymond, qu’en l’aimant sensuellement, Madeleine est plus près du lesbianisme que toi de la pédérastie. Tout cela est très compliqué, vois-tu, Morangis, parce que les sexes ne sont pas aussi différenciés que nous avons la commode habitude de le croire. Il y a des hommes qui sont presque des femmes et certains écrivains dans cette situation équivoque y gagnent une réceptivité qui leur tient lieu de génie créateur ; il y a aussi des femmes qui sont au seuil d’une virilité interdite : cela leur donne une perpétuelle inquiétude créatrice d’art…
— Comme ce serait curieux, observa Morangis, si l’on pouvait analyser ce dosage des sexualités dans les produits de la littérature et de l’art.
— Oui, reprit Raymond, mais cette science n’est pas impossible à atteindre. Déjà on sait que les pédérastes (il n’y a pas de mot honnête pour les désigner) sont organiquement plus près de la femme que de l’homme. Et de même que les femmes trop virilisées cherchent à se croire des hommes dont elles singent l’apparence, les hommes féminisés n’ont qu’un désir : réintégrer une féminité qui est leur véritable sexe. Ils se conçoivent femmes, se donnent entre eux des noms de femmes et s’interpellent « chérie, ma chérie ». L’un d’eux, n’est-ce pas assez caractéristique ? s’est donné le nom argotique du sexe féminin.
« Ce bovarysme sexuel correspond certainement a un désir d’équilibre physique, à la nostalgie d’une féminité perdue comme un paradis. Mais ce bovarysme féminin signifie surtout que, quoique doués des témoins de la virilité, ils ont en réalité des cerveaux de femme…
« Il y a aussi le bovarysme viril des femmes qui, lui aussi, correspond à un état physiologique, et au même désir d’équilibre… D’ailleurs, cette dissymétrie entre le cerveau et le sexe existe chez tous les artistes. L’art, c’est en effet, pour eux, leur véritable équilibre.
« Oui, cette dissymétrie entre le cerveau et le sexe a été fructueuse, c’est par elle que la sensualité est devenue un plaisir conscient, un art désintéressé. Sans cette conception des déséquilibrés, il n’y aurait pas eu de vie artistique, il n’y aurait même peut-être pas eu de conscience : la conscience est une inquiétude, un déséquilibre divin. En vérité, une conscience qui ne serait que le reflet d’une vie parfaitement équilibrée et adaptée ne serait plus perçue et rentrerait dans l’automatisme de l’instinct.
« C’est parce que tu es un artiste, Morangis, un déséquilibré, que tu te cherches en des sensualités équivoques. Que cela ne te trouble pas, au point de vue moral. La morale est individuelle et nous devons chacun nous créer la nôtre, respirable…
« Au fond, tout cela n’est qu’une question de sécrétion glandulaire, et je songe que si on imposait à nos célèbres Corydons quelques injections opothérapiques, ils redeviendraient des êtres normaux : il leur pousserait subitement une crête et des ergots, signes de virilité. Mais ce qu’il y aurait de plus miraculeux, c’est que par ce traitement, leur morale, leur philosophie, leur esthétique seraient retournées, en même temps que la femme retrouverait pour eux son parfum et sa beauté.
« Mais, en vérité, ce serait dommage, et que cette hypothèse d’un efficace traitement opothérapique nous soit seulement une preuve de la sincérité de leur morale…
— C’est très curieux, observa Morangis : tu me fais comprendre toute l’œuvre d’André Gide.
Mais Morangis avait compris aussi que lui-même n’était pas un monstre, et il s’abandonna à son attrait pour Dionys, vérifiant ainsi sur lui-même que l’esthétique s’appuie sur les émois momentanés de nos sens, et que, comme le lui disait Raymond, en souriant, la beauté n’est peut-être qu’un compromis entre les sexes : un androgynat.
Une lettre de Madeleine interrompit ces accordailles esthétiques. La vieille dame était morte et il fallut embarquer Dionys pour les funérailles officielles. Dans cette lettre, Madeleine racontait à Raymond ses émotions des derniers jours, au chevet de la mourante où elle s’était rencontrée avec l’amoureux de son effigie.
Assurés que la moribonde ne pouvait plus les entendre, désormais engloutie dans une inconscience définitive, ils avaient discuté religion et théologie. Par une sorte de sadisme mystique, Madeleine s’amusait à détruire les dernières touffes de foi auxquelles ce pauvre être essayait de se raccrocher : elle lui démontrait facilement combien il était ridicule d’imaginer que le fils de Dieu (comme si Dieu pouvait avoir un fils ! Pourquoi pas un neveu ? Un cousin à la mode de Bretagne ?) se soit fait homme pour sauver la terre et son humanité, c’est-à-dire un grain de poussière dans l’espace.
« Et cette conception révoltante d’un Dieu martyr ! D’abord, en tant que femme, écrivait Madeleine, je n’aime pas les martyrs : ils ont un petit air de supériorité qui vexe mon amour du bien-être et mon dégoût de la souffrance inutile. Mais même à ce point de vue, votre Christ ne m’inspire aucune pitié, et sa mort, momentanée, ne me touche pas. Je ne comprends pas qu’on ait pu si longtemps se lamenter sur cette aventure. Ce qui est vraiment tragique, ce n’est pas la mort d’un homme qui se réveille Dieu au bout de trois jours, c’est notre mort à nous, et cette certitude que notre conscience s’éteint avec nous.
« Les vrais héros, les êtres vraiment divins, Monsieur l’Abbé, c’est nous, les incroyants, qui avons le courage, sans espoir, d’aller jusqu’au bout de notre humanité…
« Et au contraire, que trouve-t-on comme précipité psychologique au fond de vos héroïsmes de couvents et de presbytères ? de la lâcheté ; pas d’abnégation, mais une abdication. Et il y a un si parfait égoïsme dans votre rêve d’éternité de musique céleste…
— Vous êtes si belle, Madame, répondit le prêtre, lorsque vous parlez avec cette violence. Il y a une flamme dans vos yeux, et une lumière sur vos lèvres.
Emportée par son raisonnement, et oubliant à la fois la moribonde, dont le rythme d’agonie se maintenait, et aussi les singulières transpositions sensuelles du pauvre ecclésiastique, Madeleine continua :
— On finira par comprendre la beauté de ce sentiment déjà enté sur les âmes d’élite : que toute la noblesse de notre vie se suffit à elle-même, nous suffit à nous-même, et qu’elle trouve en son orgueil sa récompense. Il nous paraîtrait humiliant d’accepter une récompense, fût-elle éternelle, pour la beauté désintéressée de nos gestes ou de nos sentiments. Votre récompense chrétienne n’est qu’un marché où le croyant n’a vraiment aucun mérite ; ce qu’il sacrifie est si peu de chose auprès de ce qu’il espère.
« Notre noblesse est de ne rien demander, de ne rien accepter. Dans la vie même, n’a de valeur que ce qui se donne sans arrière-pensée, sans marchandage. L’amour n’est l’amour que lorsqu’il est une double offrande spontanée…
« Les êtres nobles que nous sommes devenus, au bout d’une longue évolution de notre race, ne supporteraient plus de servir un prince ou un roi : pas même un Dieu. La prière nous semble une humiliation, non seulement pour celui qui prie, mais aussi pour celui qui est prié. La prière est une véritable négation de l’idée de Dieu, d’ailleurs, puisque Dieu, c’est la liberté.
« Il faut, concluait Madeleine, que cette évolution de la sensibilité humaine ait sa répercussion sur le sentiment religieux…
Le prêtre réfléchit quelques instants.
— Cette répercussion existe déjà, dit-il. Ainsi, à l’heure actuelle, il nous serait impossible, dans nos sermons, de parler de l’Enfer dans les mêmes termes que jadis ; nos infidèles fidèles riraient si nous les menacions de chaudières de poix éternelle. Même les supplices décrits par Dante les feraient sourire. En réalité, l’idée de l’enfer tend à disparaître de notre religion ; cette idée évolue vers une sorte de supplice, de torture morale : la privation de Dieu, quelque chose d’analogue à ce que peut être, en amour, la privation de l’être aimé.
(Tu vois, mon cher Raymond, écrivait Madeleine, que ce prêtre vicieux est tout de même un homme intelligent. Et quant à mon sermon que je résume ici, peut-être avec un peu de littérature, avoue qu’il se souvient de ton propre enseignement. Et j’espère que cet essai de conversion à rebours va t’amuser quelques instants.)
Mais la suite de l’aventure était plus difficile à conter. Madeleine s’y exerça avec sincérité. Ce pauvre prêtre avait mis une intonation si douloureuse dans ces derniers mots : « la privation de l’être aimé », que Madeleine n’avait plus songé à se moquer de lui : elle sentit que son enfer, il le vivait sur la terre dans la privation de l’être qu’il désirait. Et peut-être aussi parce qu’une chasteté de quelques jours la rendait plus sensible au désir de cet homme, elle prit sa main, la tint quelques instants dans les siennes, et puis, se levant, elle lui fit signe de la suivre. Elle confia la garde de la moribonde momifiée dans son inconscience à une domestique appelée discrètement, et dit avec autorité :
— Venez avec moi, Monsieur l’Abbé, j’aurais quelques conseils à vous demander au sujet des dernières volontés de ma pauvre tante… Qu’on ne nous dérange pas.
Il l’avait suivie, obéissant et tremblant. Jamais il n’avait imaginé que ce rêve pût se réaliser. Il avait peur.
Dès que la porte de la chambre se fut refermée sur leur isolement, il tomba à genoux près du fauteuil où Madeleine s’était assise et sans oser la toucher, la tête dans ses mains il sanglota.
Il confessa ce qu’il avait souffert et il avoua même le cruel mysticisme du simulacre et que sa cellule de prêtre était devenue une sorte de reliquaire de son amour silencieux : fleurs fanées tombées de son corsage, herbes foulées par ses pieds, fruits où ses lèvres avaient mordu, et relique plus précieuse encore : quelques cheveux dérobés à son peigne, et même un peu de sable mouillé.
Mais maintenant qu’il se trouvait devant elle, son âme et sa chair tremblaient. Il lui semblait que si le corsage de Madeleine s’ouvrait comme un tabernacle, il allait défaillir, et tout à coup il se releva et voulut fuir.
Alors, Madeleine, toute émue, se leva elle aussi, vint vers lui et lui donna sa main à baiser. Il se prosterna sur cette main qui s’offrait à ses lèvres et y appuya sa bouche tremblante.
— Laissez-moi partir maintenant, dit-il timidement.
Il balbutiait : « Ce serait un sacrilège, une profanation… Non, il faut que vous demeuriez inaccessible comme une sainte… Il y a des gestes effrayants… »
Et il sortit après avoir baisé le bas de la robe de Madeleine.
« Je suis demeurée toute la soirée troublée de cette scène, écrivait-elle à Raymond, et je n’ai plus du tout envie de me moquer de cet homme, de son amour, et de son fétichisme. Il m’a transposée en une effigie, qu’il crucifie et transperce de son désir, mais mon être demeure et demeurera à jamais pour lui une chose sacrée, inaccessible, comme il dit… Ce sentiment de profanation qu’il éprouverait devant la trop douce réalité est peut-être le plus bel hommage au mystère de ma beauté. J’ai compris aussi, chez lui, cette impossibilité d’un geste qui lui semble inharmonieux parce que son éducation religieuse et mystique le lui a toujours fait concevoir comme l’image érigée du péché et du diable. Peut-être ne croit-il plus ni à Satan ni au péché, mais il croit en moi, et sans doute perdrait-il la foi s’il se permettait cette prière blasphématoire… »
Le lendemain la moribonde s’éteignit. Déjà Madeleine avait télégraphié à Dionys : elle avait hâte qu’il fût là, et pour avancer cette minute du revoir, elle alla le cueillir à la gare, voisine de quelques kilomètres. Sous le prétexte d’un trop gênant soleil elle avait baissé les rideaux bleus de la voiture et brusquement, elle avait attiré Dionys vers son baiser et mêlé son corps au sien. Madeleine fermait les yeux, et elle ne pouvait s’empêcher d’évoquer la chaste et sanglotante prière de son fétichiste, et c’était un peu lui qu’elle emprisonnait de ses deux bras et dont elle baisait les lèvres avec une ferveur religieuse. Et peut-être qu’à la même minute Dionys mêlait à son émoi le souvenir encore vivant des caresses de Morangis.
Mais Dionys avait senti qu’il ne fallait faire aucune confidence à Madeleine : il éprouvait même, en son âme secrète, une sorte de fierté d’avoir quelque chose à lui cacher. Et pourtant il avait un peu de honte d’être si facilement redevenu un collégien, transposant en une amitié masculine, son désir d’une domination féminine. Maintenant qu’il se retrouvait auprès de Madeleine, il se sentait rassuré, peut-être par ce qu’il y avait de maternel et de tyrannique dans l’amour de cette femme.
Et quant à Morangis, lorsqu’il eut perdu son inquiétant joujou, il s’avoua à lui-même que c’était encore Marthe qu’il avait cherchée dans cet éphèbe, d’une vicieuse passivité.
C’est toujours au moment où la vie semble se fixer, s’endormir en une trop facile béatitude, qu’elle se réveille, piquée au sein par une mouche imprévue.
Comme chaque soir, depuis près de deux mois déjà, Rite, après les vêpres d’amour chez Raymond, était rentrée chez elle, silencieuse et grave, serrant sous son manteau ses émois et ses sentiments comme une gerbe de roses rouges dont les épines blessaient encore délicieusement sa chair.
On l’attendait, sans oser l’interroger, tant elle avait mis d’assurance dans sa volonté d’une liberté sans explications, sans ces comptes rendus hypocrites et mensongers des heures échappées au bagne officiel.
Par une sorte de compensation, lui, qui jadis sentait si vivement le poids de la chaîne matrimoniale, la trouvait maintenant trop légère. Dès la minute où il avait terminé sa tâche quotidienne (une vague direction de cabinet d’affaires), il se précipitait, le cœur inquiet d’une inquiétude sans précision, vers l’appartement vide où, penché à la fenêtre, il interrogera des yeux la silhouette des passantes jusqu’à ce qu’il ait reconnu la robe et la démarche de Rite.
Il avait enfin trouvé une obsession : un peu de poésie douloureuse était entrée dans sa vie monotone et trop confiante. Et puis cette crainte obscure de la perdre donnait à ses yeux une valeur nouvelle à Rite : il s’apercevait qu’elle était belle, fine, trop belle pour lui, trop intelligente pour sa médiocrité, et avait la sensation obscure qu’elle ne pouvait pas l’aimer, qu’elle ne l’avait jamais aimé. Ces réflexions subconscientes créaient en lui un état de passion intérieure qui ennoblissait son existence. Un désir noble avait surgi dans son âme : reconquérir celle dont il n’avait pas su comprendre la beauté exceptionnelle.
Florentin, ce mari de Rite, était un homme d’une quarantaine d’années, d’une éducation distinguée, d’une intelligence assez vive mais peu cultivée, et se faisant une sorte de vanité de ce mimétisme de bon ton. Rite n’avait épousé cet homme sans relief que par indolence ou plutôt par une espèce de renoncement à l’ambition irréalisable de recréer autour d’elle le véritable milieu qui était le sien. C’est seulement à Raymond qu’elle avait confié le secret de sa naissance qui la faisait la fille naturelle d’un grand nom français. Elle avait, toute sa jeunesse, souffert de ce secret, jusqu’au jour où Raymond lui avait fait sentir qu’il fallait être fière de ce bouturage illégal de deux races différentes, auquel elle devait sa fragile majesté et aussi cette inquiétude physiologique qui se traduisait par le lyrisme de sa sensualité.
— C’est notre amour, lui disait Raymond, qui recrée en toi l’atmosphère de ta race : nous retrouvons notre équilibre physiologique et intellectuel dans notre mysticité sensuelle, un peu comme les poètes rééquilibrent leurs angoisses aux rythmes de leur poésie. Nous sommes des poètes, Rite, et notre amour est notre art vivant.
Ce soir-là, comme à son habitude, Rite avait abandonné son taxi au coin d’une rue voisine, et, sans se hâter, s’était acheminée vers sa demeure. Elle était encore un peu ivre de sa voluptueuse lassitude et hallucinée des dernières images dont elle se souvenait : les petites mains de Raymond parcourent et dessinent son corps, la surprise de sa bouche qui brûle sa chair, s’attarde aux plis parfumés, les écarte comme les pétales d’une fleur pour y engloutir son visage. Elle entendait encore la voix de Raymond qui, presque timidement, lui demandait : « … blessée… encore un peu… peut-être ? » Mais non, et d’elle-même, elle s’était piquée à la tentation, graduant elle-même les rythmes de sa joie et offrant à Raymond l’émouvant paysage de sa mouvante féminité.
Et puis, dans la lumière dorée du crépuscule, Raymond avait désiré que, debout et pure comme une statue vivante, elle marche vers lui, sur lui, et qu’elle s’écrase de tout son poids parfumé sur l’exaltation de son rêve. Étendu comme un Christ descendu de la croix, il s’abandonnait à ce baiser de toute la chair de Rite qui s’écrasait contre sa chair.
Ces images enveloppaient Rite d’une sorte de carapace lumineuse qui l’isolait du reste du monde. Elle entra et vint vers son mari avec un visage si rayonnant et si chaud qu’il en fut tout d’abord baigné d’une joie involontaire. Peu habitué à analyser ses sensations, il ne comprenait pas cette joie orgueilleuse qui se mêlait à une sorte d’angoisse qui l’étouffait. Il aurait voulu pouvoir exprimer à Rite son admiration neuve, son amour douloureux et ridicule. Au bout de quelques heures presque silencieuses, Rite prétexta une lassitude imprévue et se retira, non pour dormir, mais pour échapper à une présence qui heurtait ses pensées.
Mais lui, sincèrement inquiet peut-être de cette fatigue et de la cernure des yeux de Rite, vint à pas de loup se pencher sur son sommeil. Rite ferma les yeux et harmonisa sa respiration pour simuler un calme repos : elle se souvenait qu’un soir déjà, où il était venu interroger sa langueur, il l’avait si intensément serrée contre lui que, malgré la révolte de tout son être, elle avait dû permettre le geste sacrilège.
Elle s’était juré de ne plus jamais permettre cette profanation dont elle ne pouvait même pas se confesser à Raymond. Immobile et souriant à ses souvenirs, Rite prolongeait une volontaire insomnie… et évitait comme instinctivement tout contact, remontant le drap jusqu’à son menton pour cacher la nudité de ses bras et étouffer le parfum de ses aisselles. Elle s’endormit dans la blancheur de l’aube ; le soleil vint dorer ses cheveux et aviver les pointes de ses seins tendues comme de petites bouches vers un baiser. Elle avait rejeté le drap, et sa main semblait dormir posée sur le duvet de son ventre que sa respiration soulevait harmonieusement. Cette respiration accentua subitement son rythme, envahit le corps tout entier et se détendit en un sanglot déchiré :
— Raymond ! Raymond !
A ce cri, le mari eut un sursaut de subite détresse qui le figea quelques secondes, les yeux hallucinés, la gorge serrée ; il venait de tout comprendre.
Puis son angoisse éclata en un accès de rage ; sa main brutale, qui avait arraché la chemise de Rite, s’agrippa à la touffe secrète, se crispa sur la blessure sacrée encore émue du rêve ensommeillé, et, d’un geste de meurtrier, il avait arraché les pétales de la rose en poussant des cris de damné et des injures d’ignominie. Il saisit ce corps blanc qui hurlait de douleur, le jeta violemment sur le plancher et piétina avec rage le ventre déchiré dont le sang coulait le long des cuisses. Ivre de meurtre et de douleur, il s’était jeté sur la chair hurlante de Rite, mordant ses seins et son ventre, et puis, pris d’un accès d’érotisme, il s’était étendu sur elle, l’écrasant de toute sa fureur de mâle outragé, et comme d’un coup de poignard il avait pénétré dans la blessure sanglante, s’y acharnait avec une sensualité désespérée et mauvaise, s’ensanglantant à cette chair évanouie et comme morte sur laquelle il gît maintenant épouvanté.
La tête dans ses mains, il contemple le désastre, il a peur de ces yeux clos, de cette immobilité froide. Si elle était morte ! Il appelle…, des soins maladroits s’improvisent, un médecin arrive qui ne comprend pas, mais qui devine la stupide tragédie.
Rite demeura tout un jour dans un état d’inconscience : ses yeux bleus qui regardaient ne voyaient pas et de sa poitrine lentement soulevée montait une plainte douce et musicale. Lorsqu’elle se réveilla, le lendemain, au crépuscule, son mari était là, à son chevet, qui la contemplait et essayait de lui sourire. Elle se souvint obscurément d’abord de ce qui s’était passé, et puis, comme si tout à coup elle prenait conscience de ce qu’il y avait de ferveur dans cette brutalité de son mari, elle répondit par un sourire au sourire hésitant de son bourreau. Pour la première fois, elle le regardait avec fierté et attendrissement ; elle s’endormit, apaisée, en tenant sa main dans la sienne.
Ce ne fut qu’au bout de quelques heures que, s’étant réveillée seule dans la chambre close, elle retrouva Raymond en elle ; mais l’image évoquée s’effaça ; sa vie demeurait comme suspendue, dans cette minute d’une horrible sensualité où elle avait senti sa chair intime se déchirer, branche arrachée à un arbre. Elle devinait aussi un tel amour dans cette jalousie et dans cette cruauté qu’elle se soumettait à celui qui l’avait brutalisée et qui maintenant se penchait avec une timide adoration vers cette blessure encore sanglante.
Des jours s’écoulèrent, ouatés de silence : Rite trouvait dans sa faiblesse même et dans l’immobilité imposée à sa chair meurtrie une sorte d’euphorie nirvanique. Et si, en un éclair de lucidité, elle évoquait l’inquiétude de Raymond, cette pensée qu’il souffrait lui était presque douce : il saurait bientôt que c’était son nom jailli de son cœur à elle qu’on avait écrasé sur la chair de son amie : elle avait l’orgueil de son martyre.
Elle constata aussi avec une joie secrète que son mari avait souffert : son visage contracté avait pris une expression douloureuse qui le sculptait et lui donnait de la beauté. Il devenait pour elle un être nouveau et elle souriait en songeant que c’était la Rite que Raymond avait transfigurée qui avait opéré ce miracle.
Ce que Florentin aimait en Rite, c’était, en effet, l’amante de Raymond. Le nom de Raymond ne cessait de s’imposer à son esprit. Il essayait d’imaginer cet être mystérieux dont l’amour avait illuminé le visage de Rite d’une telle clarté qu’il en était lui-même ébloui. Il ne pouvait s’empêcher de le concevoir beau, rayonnant de charme et d’intelligence, et si, parfois, en lui-même, il l’injuriait, c’était d’une façon un peu blasphématoire et comme on injurie un dieu.
En réalité, sans oser se l’avouer, il aimait ce Raymond mystérieux qui dormait comme une hostie consacrée dans le sein de sa femme ; il aurait voulu le connaître, lui aussi, le mêler à leur vie. Il lui semblait que son nouvel amour pour Rite s’effondrerait comme un songe, si ce Raymond disparaissait de leur existence.
Après des semaines de silence obsédant, un soir, à cette minute du crépuscule d’été où le ciel et le paysage se mêlent en une même fugitive sérénité, Florentin avait osé questionner Rite.
Étendue sur sa chaise longue devant la lumière du soir dont elle emplissait ses yeux comme d’une musique de clarté, elle était si pâle qu’on eût dit qu’elle avait versé tout son sang. Une rose rouge qu’elle caressait et baisait comme une bouche éclairait le soir : son parfum lui évoquait les sensualités mystiques de l’amour ; et, s’abandonnant à l’amère douceur des vains regrets, elle pleura, engloutissant la rose dans sa bouche mouillée de larmes, trouvant encore une réelle volupté dans cette sensualité qui lui était permise.
— Pourquoi pleures-tu ? demanda Florentin inquiet. Souffres-tu davantage ?
— Non, je suis triste seulement de ma faiblesse, et plus triste encore de n’apporter que peine et douleur à ceux qui m’aiment.
Elle ajouta, et il y avait dans l’intonation de sa voix une angoisse cachée qui voulait être rassurée :
— Je comprends bien que tout est fini maintenant pour moi et que je suis désormais seule dans la vie.
Alors Florentin se révolta à cette pensée. L’abandonner… Jamais il ne l’avait aussi passionnément aimée ; c’est lui qui avait eu peur de l’abandon ; elle ne pouvait pas savoir ce qu’elle était pour lui, maintenant surtout qu’il avait compris.
Et presque malgré lui, il ajouta :
— … L’autre… non plus, je pense…
En lui-même, il avait prononcé : « Raymond » — leur Raymond qui les avait baptisés à une nouvelle vie.
Durant ces semaines silencieuses, il avait longuement médité, réfléchi, il avait plus vécu intérieurement que pendant tout le reste de son existence. Il confessa timidement à Rite la sorte de respect qu’il éprouvait maintenant pour Raymond.
— Puisqu’il t’aime, il fait partie de ta vie, de notre vie. Oui, j’ai souffert comme un dieu, mais cette souffrance pour toi m’a fait te mieux comprendre, te mieux admirer… à travers lui.
Il avoua encore que, dans ses premiers jours de douleur et de prostration, tandis que Rite était réfugiée dans une sorte de léthargie protectrice, mû par une invincible curiosité et un besoin d’ajouter encore à sa torture, il avait fouillé les tiroirs secrets de Rite et découvert les lettres de Raymond. Il était imprégné de ces mots d’amour, de sensualité et d’inquiétude mystique ; il avait ainsi vécu leur amour qui était comme une idéalisation et une conscience du sien, demeuré jusqu’alors obscur en lui parce qu’il n’avait su trouver les mots qui le précisaient…
— Maintenant, j’ai compris ta beauté, ta divinité de femme. Mais c’est par lui, Rite, que je t’ai trouvée : tu es celle qu’il t’a faite et c’est sa Rite que j’aime.
Et, sans qu’il s’en doutât peut-être, il entrait aussi dans son nouveau sentiment une sorte de masochisme, et depuis qu’il avait goûté à cette noble volupté de la souffrance, il se voulait toute sa vie crucifié à cette croix.
Masochisme ! il ne connaissait même pas cette dérivation de l’instinct sexuel, si instinctive à l’homme qu’il semble bien qu’elle ait toujours existé : on la trouve dans les religions publiques et privées : fustigations, avilissements, flagellations, physiques et morales, piétinements et écrasements divins.
… L’amant, en tous les siècles, qui aima sa torture, fut un masochiste avant Sacher-Masoch. Toujours des hommes ont aimé être piétinés, humiliés, battus. C’est un orgueil et une excitation que d’être martyrisé, et il n’y a peut-être de véritable volupté que dans la douleur.
… Chaque jour, maintenant, Florentin venait se confesser à Rite, et il tentait aussi de lui arracher des confidences, des précisions aux évocations des lettres. Il se complaisait à imaginer ces pariades divinisées par le sentiment, et il lui semblait qu’il y participait. Il récitait des phrases lues dans les lettres de Raymond et qui s’étaient imprimées en lui : il était Raymond, et, penché vers Rite, il baisait ses yeux et cherchait sa bouche qui fuyait.
— Ne me trouble pas, dit-elle…, tu sais que je suis… blessée… encore…
Mais en même temps qu’elle prononçait ce mot, elle se souvenait de la minute où il l’avait si virilement poignardée, et pour lui montrer qu’elle lui avait pardonné, elle lui tendit sa bouche entr’ouverte : il y écrasa un baiser dont il s’arracha pour tomber à genoux devant Rite, la tête dans sa robe, en sanglotant. Émue, Rite mêla sa plainte et ses larmes aux siennes ; ils ne savaient pas la vraie raison de leurs pleurs, dont ils sentaient seulement la voluptueuse brûlure.
Rite s’était levée ; elle allait pouvoir sortir en voiture. Florentin savait que cette première sortie serait pour une visite à Raymond, et il acceptait cette pensée dont la cruauté le troublait et lui donnait une excitation mystique qu’il n’osait pas formuler. Il avait honte de s’avouer qu’il aimerait Rite au retour de ces visites à Raymond. Il demanda :
— As-tu des nouvelles de « Lui » ?
Rite ferma les yeux et ne répondit pas.
Raymond, ne recevant aucune lettre de Rite, s’était inquiété, d’une inquiétude indignée : il n’imaginait pas qu’ainsi, en plein amour, Rite pût se déprendre de lui. Enfin, au bout de longs jours, il reçut un mot où son amie lui contait la tragique aventure : le rêve d’où avait jailli son nom, la déchirure sanglante…
Tout à fait rassuré, puisque Rite l’aimait toujours :
« Que c’est beau ! s’écria-t-il, c’est pour moi qu’elle a souffert : quelle femme héroïque. »
Il s’inquiétait seulement de savoir si on lui avait abîmé son idole. Et tout de suite il lui écrivit ce qu’il avait souffert, lui, dans cet angoissant et inexplicable silence, et aussi cet horrible tourment d’être privé de son amour à un moment où il ne s’était jamais senti aussi fervent et attiré vers sa chair par un aimant plus puissant. « Au moins, ajoutait-il, tu n’as pas douté de moi, Rite : ma pensée t’a soutenue dans ton martyre : qu’elle soit toujours comme un divin palladium entre toi et ton bourreau. » Et, lyrique, il s’écriait : « O Rite, qu’on ne te touche pas, tu es mienne et tu es sacrée… »
Rite répondit avec une mélancolique simplicité que le bourreau, honteux de sa cruauté, une cruauté, hélas ! lourde d’amour, s’était adouci et qu’il avait été, qu’il était encore le plus tendre des gardes-malades : « Souviens-toi, continuait-elle, de notre espoir de jadis qu’il me trompe, qu’il me fuie et s’évade enfin de ma vie. Mais non, il est plus que jamais attaché à moi… » Et elle lui faisait comprendre la ferveur morbide de ses sentiments. Elle écrivit de longues pages sur ce sujet, se complaisant à la description de cette singulière psychologie… Elle disait encore qu’elle ne pouvait pas ne pas être touchée de l’obstination de cet homme à l’aimer infidèle, à l’aimer surtout infidèle : « Il t’accepte dans sa vie, parce que, dit-il, c’est toi qui m’as faite la Rite surnaturelle que je suis… C’est si vrai, Raymond, qu’il me semble qu’en effet, on ne peut pas être jaloux de toi. Et si tu disparaissais de ma pauvre vie, je m’enorgueillirais encore de me sentir celle que tu as aimée et faite un peu à ton image… Oui, s’il était possible que d’autres hommes que mon mari m’aiment, c’est la Rite de Raymond qu’ils aimeraient, eux aussi, en moi. »
Quelques jours après cette lettre, Rite, malgré sa faiblesse, ne put résister à son désir de revoir Raymond, de se retrouver et de se reconnaître en lui. Mais ils sentirent l’un et l’autre que leur divin secret s’était évaporé comme d’un flacon mal clos, et quoiqu’ils fussent seuls dans cette chambre feutrée et tapissée de livres, ils sentaient une présence invisible, une pensée qui les regardait.
Et puis Rite avait conscience de sa faiblesse physique et se la reprochait comme un crime envers Raymond : elle savait instinctivement que les hommes sont incapables de sacrifice. Tout de même, elle voulut donner à Raymond la joie de caresser et de respirer son corps immobile. Mais comme il se penchait vers ses seins et que son baiser descendait vers l’ogive interdite, elle prit la tête de Raymond dans ses mains et la posa entre ses seins.
— C’est moi qui t’aimerai, dit-elle. Ma bouche te dira toutes les pensées de mon amour et de mon désir. Et je donnerai à la joie de tes yeux ton paysage choisi.
Lentement Rite s’habillait ; la chair de ses jambes apparaissait plus nue et plus pure sous la soie des bas qu’elle accrochait à ses jarretelles noires. Raymond s’était agenouillé pour baiser le coin de chair nue qui jaillit des bas comme une fleur de désir, et la tentation de son baiser souleva le voile qui adhérait à la belle croupe de Rite. Elle se penchait à cet instant pour accrocher le bouton de son soulier, accusant ainsi l’orbe de sa féminité… Répondant à une pensée secrète :
— Cela, au moins, dit Raymond, est bien à moi.
Rite, tournant vers lui son visage, a souri : elle veut bien ; et déjà les petites mains de Raymond s’emplissent de ses seins, tandis qu’il écrase contre lui la brûlure glacée de sa croupe… Les cheveux de Rite, qu’elle avait réchafaudés, s’écroulent et noient la tête de Raymond. Il l’a prise dans ses bras, portée sur le divan et la console par des baisers de tendre douceur de la douloureuse joie qu’il lui a donnée.
Il semblait maintenant à Rite que leur vie allait reprendre sa plénitude, mais déjà, à la minute de l’adieu, elle sentait qu’ils n’étaient plus seuls et qu’elle-même ne pouvait plus désormais s’isoler dans sa pensée de Raymond. Elle songeait que, ce soir même, on l’interrogerait et qu’on se pencherait sur son silence et sur les images qu’elle voudrait préserver de toute curiosité. Elle songeait qu’on la désirerait, encore toute émue des caresses de Raymond.
Lorsqu’elle fut bien seule avec elle-même dans cette voiture qui la reconduisait à sa prison, elle eut subitement une pensée de révolte contre l’orgueilleux égoïsme de Raymond. Pourquoi, se demandait-elle, ne m’a-t-il pas gardée, emportée loin de ces tristes complications sensuelles et sentimentales. Alors elle prit une détermination subite : elle partirait seule vers des paysages d’apaisement où elle oublierait la douleur des derniers mois et se laverait dans la solitude des images qui avaient blessé sa chair et son âme. Et puis, pensait-elle encore, peut-être que Raymond viendra me rejoindre, et nous retrouverons la pureté de notre ferveur. Elle se reprochait maintenant d’avoir été trop sensible à la sensualité de son mari si tragiquement réveillée. Elle sentait qu’elle allait le détester, et déjà en rentrant ce soir-là elle s’enferma dans sa chambre et se refusa à toute conversation, à toute confidence.
Le lendemain, elle partit : elle n’emportait avec elle qu’un peu d’argent et les lettres de Raymond. Elle mit encore pour lui un mot à la poste où elle disait son brusque départ et ce besoin d’un isolement où, loin de lui, elle le retrouverait plus intimement.
Raymond trouva cette décision subtile et sage.
— Elle me fuit… vers moi, se dit-il. Mais la rejoindre, ce serait bien grave.
Et il se donna à lui-même quelques semaines pour réfléchir : il lui écrirait, il vérifierait ses sentiments. En attendant, il allait profiter de cette trêve pour écrire quelques articles en retard et mettre au point ses notes sur sa Marguerite dorée : il y avait là dans cette aventure la matière d’un roman qu’il aurait plaisir à écrire pour lui-même, pour la joie de retrouver celui qu’il fut et de fixer ses propres émotions.
Sa chasteté involontaire s’épanchait dans ce livre dont il écrivait presque régulièrement chaque jour une dizaine de petites pages, correspondant aux pages du volume futur ; elles s’accumulaient devant sa table, couvertes des hiéroglyphes de son écriture aristocratique. Ces pages, écrites sur un papier de pur fil, blanc comme la chair de Marguerite, il les voulait pures de toute bavure, de toute tache et de toute impureté ; plutôt que d’y laisser la trace d’une correction inesthétique, il préférait recommencer la page.
D’ailleurs, une hésitation dans l’expression d’une idée ou dans la notation d’une image n’est-elle pas le signe d’une défaillance de l’esprit ? Ne pas poursuivre : retourner en arrière et repartir de l’idée ou de l’image initiales.
Sa Marguerite à la toison d’or revivait dans ces pages, et il était ému d’évoquer la somptueuse sensualité de sa chair. Il écrivait tendu vers elle, encore enivré de son parfum.
« Peut-être, notait-il, ne peut-on faire revivre les gestes de l’amour que si, au moment où on les décrit, on est dans le même état de grâce, dans le même état de désir et d’amour, fût-ce d’un nouvel amour.
« Faire l’amour ou le transcrire en écriture ou en art, c’est la même sensualité qui s’épanche ou se transpose. Et c’est aussi la même fécondation des êtres et des races, car il y a une fructification sensuelle des cerveaux, et il y a aussi des livres qui sont de puissants aphrodisiaques. Que d’êtres qui ne doivent la vie qu’à l’excitation que fut pour leur géniteur une ardente lecture.
« … Le style d’un écrivain, c’est une présence réelle. Nous mettons dans ce rythme des phrases toute notre musique intime, toute notre vibration intime. La langue que nous parlons et écrivons est une adaptation de notre être au monde extérieur, une captation d’images, de sensations et d’idées que nous traduisons par la courbe de notre voix : elle fixe notre parole du moment avec l’émotion de son accent, la sonorité et la sensualité de ses vibrations…
« Alors on comprend que nos écritures et nos styles, malgré leur prétention de s’inscrire dans un marbre éternel, sont en réalité aussi éphémères et aussi fugitifs que la parole et l’organisme qu’elles expriment. Nos livres ne sont que des fantômes, et les vers même les plus fortement frappés ne sont que des photographies sans couleur et sans parfum de nos sensations vivantes.
« Les mots que nous employons pour traduire physiologiquement nos réactions vitales et intellectuelles évoluent extérieurement à l’homme, si bien que la langue d’hier est déjà une langue morte dont nous conservons les feuilles sèches dans ces herbiers que sont nos livres.
« D’ailleurs, si tout à coup les entomologistes de la littérature disparaissaient, les langues évolueraient avec une telle rapidité que peut-être deux générations qui se suivraient ne se comprendraient plus.
« Mais nous nous donnons l’illusion d’œuvrer pour la postérité. En réalité, la postérité demeure pour nous mystérieuse, et on ne peut savoir quelle déformation elle fera de notre pensée actuelle. L’œuvre des écrivains redevient de la matière vivante que les hommes transposeront selon leur sensibilité du moment. Ainsi la vie est une création perpétuelle, un remous, une éternité qui s’écoule comme un fleuve, un fleuve qui prendrait sa source dans la mer même où il se jette.
« Ce roman que j’écris, ce m’est une façon de fixer pour moi des images, de me retrouver moi-même dans ces subtilités de sentiments et de sensations. Je ne saurai jamais l’idée que cette femme d’une somptuosité blanche et dorée pouvait se faire de moi. Avait-elle même conscience de sa beauté ? Sa perfection physique lui semblait une chose si simple et ne la consolait pas des amertumes de la vie. Ce fut peut-être l’impossibilité de nous pénétrer intellectuellement qui fit la violence de notre amour : les amours inoubliables sont celles qui ne coïncident jamais. Inoubliables ? Nos souvenirs, même les plus émouvants, tomberaient dans l’oubli, si parfois nous ne remontions les poids de l’horloge du souvenir. »
Et tout à coup, par delà le souvenir de Marguerite, et comme à travers l’ogive de sa toison d’or, dressée comme un arc de triomphe sur l’allée de sa jeunesse, deux visages de femmes souriaient à Raymond et tendaient vers lui leurs lèvres fraternelles.
Il s’émut à cette évocation de ces deux sœurs, de dix-huit et de dix-neuf ans, qui s’étaient associées pour l’aimer et dont il ne se souvenait plus des petits noms, pourtant prononcés jadis avec tendresse. Elles étaient assez différentes dans leur fraternité pour se compléter l’une l’autre. « Blonde » aux yeux noirs et « Brune » aux yeux bleus, elles semblaient avoir, par un jeu gracieux échangé pour un instant leurs yeux. Raymond aimait respirer et mêler les parfums divers de ces deux chevelures et sentir leurs deux bouches se disputer son baiser. Et si Blonde s’attardait trop longtemps à une intime communion, d’un petit heurt de sa tête obstinée, Brune la délogeait et continuait goulûment le songe interrompu.
Raymond souriait à cette impudeur naïve et comprenait avec quelle sincérité les jeunes filles les plus timides s’extasient devant les intimités de l’homme. Oui, avec la même religiosité que nous mettons, nous autres hommes, à nos adorations et agenouillements devant le sexe de la femme.
« Brune, plus agile, a envahi Raymond de tout son poids parfumé : elle écrase ses petits seins en fleur sur la poitrine de Raymond en mordant sa bouche d’un baiser qui se crispe. La voilà toute agitée comme un arbuste fragile dans le vent de l’orage : elle crie sa violente petite joie et s’abat toute moite sur sa proie. Alors Blonde a presque peur pour Raymond et dit :
« — Tu vas l’étouffer : tu lui fais mal. »
« Et, pour protéger Raymond, elle bouscule Brune qui roule de côté dans son sanglot : et, rêveuse, d’un mouvement qui la mêle à Raymond et qui la berce, elle semble prier, muette, une danse religieuse qui ne veut pas s’interrompre. »
Raymond évoquait ces images : il les voyait toutes deux réconciliées et collaborant gracieusement à son plaisir : éclairs de chair dont l’onction se pose et s’immobilise sur son baiser ; la gravité de leurs yeux à cette minute où, s’accrochant aux épaules de Brune qu’il a comme rivée à son propre émoi, Blonde les contemple et s’abat, petite colombe frémissante sur la bouche de Raymond.
Jeux gracieux et éphémères dont il ne reste qu’une saveur aux lèvres et une image imprécise dans l’imagination qui la recrée. Mais Raymond se souvenait que Blonde était devenue vraiment amoureuse et jalouse : elle usait de ruses pour éloigner Brune. Il s’évada de ces complications qui ne l’amusaient plus. L’amour n’est acceptable qu’entre les êtres de même race…
Pourtant ma Marguerite dorée ? Oui, mais sa beauté exceptionnelle la mettait au-dessus de toutes les aristocraties de l’esprit et de la race. D’ailleurs, ai-je aimé son âme, me suis-je jamais inquiété de ses sentiments autrement que pour m’assurer de toute la ferveur dorée de sa sensualité ?
Rite s’était réfugiée dans un petit village des Cévennes, à l’abri de toute civilisation : une maison de paysan construite en terre, comme le nid des termites au bord d’un ruisseau anonyme au fond d’une vallée sans nom. Nul bruit que celui des herbes que le vent couche, et le frôlement d’ailes des oiseaux qui percent l’air d’un cri gradué selon les heures du jour. Pas d’autre bibliothèque que les bois aux mille feuilles vivantes, pas d’autre inquiétude que celle qui s’est accrochée à votre chair comme un parasite et que l’on traîne avec soi.
Parfois Rite songeait que peut-être le vrai bonheur résidait dans cette vie diminuée ; parfois aussi, elle voulait secouer cette torpeur et agitait les ailes de son désir et de sa pensée : faire signe à Raymond qu’il vienne, non pas partager avec elle cette inquiétante quiétude, mais la réveiller de ce nirvana où elle allait sombrer, elle, son amour et jusqu’à ses souvenirs ; qu’il l’emporte avec lui, petite bouche de sensualité mystique collée éternellement à sa chair, vivant de son souffle et des mouvements de son être.
Et, avant que cette impulsion ne se soit éteinte dans le vent dont les orgues l’hypnotisaient et l’accrochaient au sol comme les feuilles déjà roussies par le soleil, Rite courut vers le petit bureau de poste de la bourgade lointaine et, sans plus réfléchir, envoya un télégramme à Raymond :
« Rite t’attend. Toute tienne. »
Et déjà, Raymond était là près d’elle, et elle projetait sur le paysage désormais effacé, inexistant, les images de sa vie nouvelle. Au bout du sentier que fixaient ses yeux hallucinés se dressait le fantôme gigantesque de Raymond qui allait la cueillir comme une bruyère du vallon, et l’emporter par delà l’horizon vers leur vraie vie qui allait commencer.
Au moment où Raymond reçut cet appel de Rite, il s’apprêtait à sortir pour un dîner où il était convié et où il devait rencontrer le poète Gammes, le poète aux jeunes filles nues dont il aimait le paganisme mystique. Cette journée avait été pour lui une journée d’inconsciente attente et de mystérieuse angoisse. Mais était-ce cet appel de Rite qu’il attendait avec cette intuition inquiète ?… Partirait-il ? Obéirait-il à ce signal de détresse ? Attendre : n’y plus penser jusqu’à demain ; la réponse s’inscrirait d’elle-même sur le disque du subconscient. Partir ? c’était peut-être ne plus jamais revenir seul et libre ; c’était imposer à sa vie la certitude d’un amour déjà blessé par la douleur. N’est-ce pas curieux que les souffrances partagées, au lieu de mêler les êtres indissolublement, les sépare et les disjoint. Peut-être parce que la souffrance nous isole et nous fait réintégrer notre personnalité incommunicable. Les sentiments blessés par quelque souffrance ne marchent plus qu’à cloche-pied ; ils ne sauraient aller bien loin sur le chemin de l’amour.
Mais ne pas partir, c’était peut-être rejeter de sa vie le plus sincère et le plus vivant des amours.
— J’ai besoin d’être aimé, dit-il, de m’aimer moi-même dans l’adoration d’une femme. Retrouverai-je jamais ce don total et spontané d’un être d’élite bien adapté à ma chair ?
Ces pensées contradictoires se bousculaient dans la cervelle de Raymond, tandis qu’il s’habillait automatiquement. Dans la glace où il faisait bouffer la mèche blonde qui tombait en toit de chaume sur son front, il se reconnut, et, devant la gravité émue de son propre visage, il sourit à ce trouble qui avivait l’éclat de ses yeux. Il savait que cet air discrètement romantique qu’il promenait dans la vie lui attirait toujours la sympathie des femmes :
« Ce qu’elles devinent peut-être en moi, c’est, sous la douceur d’une apparente féminité, une force qui dédaigne de s’exercer en dehors de l’amour.
« Au lieu de m’attarder en des absolus provisoires, j’aurais dû peut-être répondre à tous ces sourires sans lendemain qui me faisaient signe. C’est toujours avec un certain désespoir que les yeux de mon désir abandonnent le sillage d’une femme inconnue dans la rue. Ma formule : toutes en une, se confond, en vérité, avec cette même formule retournée : une en toutes. Car c’est toujours nous que nous cherchons dans le parfum des femmes, et peut-être, en réalité, avons-nous plus de chance de nous trouver dans la diversité que dans cette obstination de l’amour unique, destiné à la même faillite et à la même incomplétude.
« Dans quelque vingt ans, je serai vieux. Aurai-je engrangé assez de souvenirs pour l’hiver de cette vieillesse réfléchie ? Hélas ! à mesure que l’homme fléchit sur sa tige, son cerveau mûrit, se développe comme le cerveau des pavots où tintinnabulent les graines noires de ses pensées. L’homme prend une conscience inutile de la vie au moment qu’elle lui échappe, et parfois c’est à l’âge où l’amour lui est interdit qu’il en comprend trop tard la tentation illuminée.
« J’ai toujours admiré le sérieux avec lequel les hommes de tous les âges et de toutes les races, devant le néant d’une vie éphémère, se sont créé tant d’obstacles à la volupté, la réglementant comme un jeu de cartes ou un jeu de croquet, où il n’est permis de passer la sonnette que dans certaines conditions et positions.
« Ah ! l’amour est le jeu où il faut le plus tricher avec les règles. Se dire que tout y est beau et permis, et ne conserver les interdictions que pour les esclaves. »
Pour se rendre à ce dîner, Raymond fit un long détour pour jouir de la lumière calme du soir et du trouble que mettait en lui cette sérénité. Il longea le jardin du Luxembourg, dont les grilles déjà closes lui évoquaient un passé désormais impénétrable. Il s’arrêta un instant devant la grande allée qui monte vers le bassin au petit amour fragile : les deux grands vases aux mêmes fleurs rouges mettaient une clarté dans la pénombre ; une silhouette se dessina, fantôme d’un souvenir :
— Ce fut là, dit-il, qu’elle me dit adieu, avec son sourire au bord des larmes. Je noterai cela, afin de ne jamais perdre le goût de ce dernier baiser.
Il entrait maintenant dans le salon inconnu où Mme Ferrugine l’accueillit avec une affabilité exagérée. C’est le privilège des femmes du monde de donner aux êtres qu’elles choisissent l’impression qu’ils sont pour elles des personnages d’une qualité exceptionnelle. Mme Ferrugine, qui était riche et sensible aux choses de l’art, s’était donné le rôle de protéger les poètes ; elle aimait à s’entourer de ces mystiques acrobates du rythme, et lorsqu’ils récitaient leurs vers, elle s’enorgueillissait de leur succès, comme si ce fût elle qui les eût dressés à ces tours de force de rime et de sentiment. Gammes était là, illuminé de la clarté des chairs nues des jeunes filles qu’il avait chantées et qui faisaient autour de lui une ronde invisible. Ses gestes timides semblaient frôler de jeunes seins avec l’amoureuse crainte de les blesser : cela lui donnait un air un peu douloureux qu’il éventait avec des mots. Sa parole était une musique, une musique un peu métallique et rebondissante qui évoquait les cascades des ruisseaux sur les pierres sonores et l’éclaboussement lumineux de leur écume.
On dîna, un vrai dîner : ce poète mystique se nourrit comme nous du sang des agneaux, et des lièvres arrachés à leur rêve de clair de lune.
La conversation, bien menée par Mme Ferrugine, ne s’écarte pas de la poésie ; il semble qu’on s’est assemblé non dans une salle à manger, mais dans un temple, après l’office, pour manger rituellement les agneaux et les taureaux du sacrifice. Des fruits couvrent la table : de belles pêches rosées comme des chairs à la Boucher offrent à la tentation de nos mains et de nos bouches leur callipygies minuscules.
Tandis que le repas s’achève dans cette atmosphère de roses coupées et de fruits plus odorants encore que les fleurs, d’autres invités arrivent pour la soirée de poésie et de musique. Raymond s’est installé à l’écart, près d’une fenêtre, où ne lui arrive qu’une brise imprécise des musiques qui déjà ont déclenché leurs accords. Il reconnaît au vol de célèbres rengaines dont l’émotion s’est tout évaporée. Mais tout à coup, voici qu’au-dessus de la vague musicale des notes noires et blanches s’élève la pureté d’une voix qui est déjà l’évocation d’un être précis, une voix qui semble apporter le contour, le parfum d’une gorge et le tremblement d’une bouche. Immobilisé dans son émoi, Raymond écoute, la gorge contractée, les yeux pleins de larmes, cette voix jamais entendue qui semble venir du plus lointain de son enfance et lui apporte la forme musicale d’un être mystérieux et fraternel.
La voix s’est tue. Raymond demeure hypnotisé dans cette vibration qui l’enveloppe encore de sa résonance, de son parfum ; il respire cette voix et y engloutit le songe de son visage.
Tout à coup, la voix est là, devant lui ; il l’a reconnue : une jeune fille, si blanche dans sa robe noire, si pâle sous ses cheveux noirs, est là devant lui : elle le regarde, elle lui parle :
— C’est pour vous que je suis venue, Raymond. C’est pour vous que j’ai chanté.
Cette exaltation intérieure où l’avait mis sa voix entendue, et que lui avouait Raymond, elle l’avait sentie… elle l’avait voulue. Elle disait encore :
— Je ne vous connais que par ce que vous avez révélé de vous dans quelques livres, mais je vous reconnais, je vous cherchais.
Et le ton d’assurance de sa voix signifiait : « et nous ne nous quitterons plus jamais, maintenant que nous nous sommes trouvés ». Et cela, lui aussi, Raymond, l’acceptait et déjà il s’installait dans cette nouvelle éternité qui lui était destinée. Il ne savait même pas son nom, mais elle était bien celle qui avait toujours vécu près de lui, en lui. Rien ne l’étonnait de son corps mince, aux petits seins miraculeux, aux jambes de Diane, aux mains longues et si pâles que n’alourdissait aucune bague. Il reconnaissait ses moindres gestes et l’éclair de son sourire vite éteint.
— Mais non, répondit-elle à une question de Raymond : pas une jeune fille, une jeune femme, Simone de…
Mais le poète s’était assis à une petite table au milieu du salon et lissait l’éventail de sa barbe comme on accorde un violon ; il allait nous donner tous les poèmes de sa dernière récolte. Raymond s’était assis à côté de Simone, et la lumière qui émanait d’elle le baignait d’une clarté parfumée qui les enveloppait et les mêlait dans ce silence que les psalmodies du poète faisaient religieux. Raymond n’écoutait même plus la monotonie de ces rythmes où s’accrochait l’odeur des herbes et des jeunes chairs nues dans le soleil. Ces vers n’étaient pour lui qu’une musique évocatrice de la pureté de Simone devant laquelle il se sentait timide comme un enfant.
Un instant, le visage de Simone s’est tourné vers Raymond et de sa bouche au dessin si intact, une lumière a souri vers lui un sourire qui lui paraît une offrande qu’il n’oserait jamais cueillir. Pourtant, il a conscience que dès cet instant Simone est déjà sienne, mais il y a une telle adoration dans l’amour nouveau qu’il ressent pour cette femme qu’il s’y mêle une sorte de torture et de crainte mystérieuse : n’être peut-être pas digne de sa perfection et de sa beauté.
Lorsqu’elle partit, il l’accompagna : il lui fallut tout un effort de raisonnement pour quitter son bras et l’abandonner au seuil de sa demeure. Mais elle dit avec une telle assurance de revoir et de vie partagée :
— Je pars pour quelques jours : je reviendrai vers vous, que Raymond comprit qu’il ne fallait pas tenter de diriger un amour qui s’imposait à sa vie et qui allait submerger toutes ses pensées.
Miraculeusement, sa vie se simplifiait et se résumait en un nom et en une forme féminine : Simone. Cette Simone d’une heure avait déjà envahi le passé, et, rentré chez lui, ce soir-là, Raymond s’aperçut que le décor de son intérieur était comme rajeuni, renouvelé d’un désir nouveau. Il veilla longtemps, afin de revivre seconde par seconde les émotions de cette soirée, et, pour ne pas en perdre les images à la fois immuables et fugitives, il les nota et il avait conscience qu’il atteignait dans ce nouvel amour le sommet d’une vie d’où il ne pouvait plus que descendre vers les regrets et la nirvanique sérénité. Il évoquait timidement la lumière de « sa » bouche, et un frémissement à la fois physique et psychique le parcourait : il songeait que lorsque le baiser de cette bouche s’écraserait sur sa bouche, il défaillerait…
— Pourtant, se disait-il, avec quelle assurance elle est venue vers moi : elle savait orgueilleusement que, puisqu’elle m’a choisi, je lui appartiens.
Mais il sourit en se disant qu’en effet tout ce qu’il avait pu écrire, toutes les idées qu’il avait momentanément exprimées n’étaient peut-être au fond qu’un appel dans la nuit vers cette âme et cette chair privilégiées.
— La littérature n’est peut-être que cela : une petite lampe de ver-luisant qui s’allume dans la nuit, petit phare de désir et d’amour. C’était pour elle seule ; elle seule a compris le signe : elle seule est venue.
Il ne songeait plus du tout que Rite l’attendait dans sa chaumière romantique des Cévennes, et lorsque le télégramme, jeté sur sa table avant de partir, le lui rappela, il décida qu’il ne partirait pas.
— C’est curieux, pensa-t-il, les amours subissent les mêmes lois que les étoiles : elles atteignent le sommet de leur ascension et déclinent vers l’horizon de l’oubli.
« Ceci, rectifia-t-il, pour lui-même, n’est qu’une image d’une poésie mensongère. En réalité, nos amours subissent la même loi que la matière vivante. Cette loi peut se traduire graphiquement par une branche d’hyperbole. Cette courbe, se récitait-il, est « exactement celle de la combinaison de l’hémoglobine avec l’oxygène », formule qu’il avait découverte dans une revue de biologie et devant laquelle il avait longtemps rêvé à cette courbe hyperbolique qu’est la limite de nos sentiments, de nos idées et de nos conceptions humaines. Oui, pensait-il, nos théories philosophiques les plus générales subissent cette fatalité chimique et mathématique et ne peuvent pas ne pas suivre la courbe de cette hyperbole : notre conception de l’éternité, de Dieu lui-même, n’est qu’une hyperbole. Cela tient à la composition chimique de notre sang… Mais qu’importent ces théories devant la réalité même éphémère du sentiment nouveau qui m’emplit : l’hyperbole de ma pensée s’élance vers toi, Simone.
Il eût voulu savoir quelles images et quelles pensées occupaient son esprit à cette heure où il se penchait vers son fantôme. Il ne savait rien de sa vie, de ses relations, mais il possédait cette faculté merveilleuse d’abstraire les êtres qu’il aimait de leur milieu, de les isoler en lui-même. Simone avait dit : « Je partirai demain », et il ne s’était même pas inquiété de savoir vers quel pays, vers quel manoir, vers quels êtres familiers. Il savait que l’amour, dès qu’il est entré dans une âme, ne projette plus sur le monde qu’une seule image : celle de l’être aimé. « Le seul paysage de Simone, ce sera moi. » Une inquiétude cependant naissait en lui : ne pas décevoir l’idée qu’elle s’est faite de moi ; et un désir d’atteindre une sorte de perfection intellectuelle, esthétique et sensuelle qui serait digne de sa propre perfection à elle. Pour la première fois, la gloire lui parut une fleur qui valait la peine d’être cueillie pour l’offrir à Simone. Il dit : « Je cueillerai cette fleur pour elle, si elle la désire.
« Les femmes que nous aimons, au cours de notre vie, marquent les étapes de notre évolution intérieure, et peut-être que ce nouvel amour plus spiritualisé correspond à la maturité de mon cerveau, à une défaillance déjà de mon être physique. »
Le lendemain, un simple mot de Simone donnait son adresse à Raymond, là-bas, dans un petit coin de l’Anjou qu’il ne connaissait pas. Il lui écrivit aussitôt une petite lettre d’une timidité hésitante ; elle répondit avec simplicité et assurance, intellectualisant ses sentiments en un style d’une miraculeuse sûreté. Cela fit presque peur à Raymond : il craignit tout d’un coup que l’on aime en lui plus son intelligence que sa sensualité, davantage ses pensées que ses baisers.
— Mais non, rectifia-t-il, c’est bien que ce soit d’abord le cerveau qui soit pris, c’est du cerveau que descend l’excitation de la chair.
Il attendait le retour de Simone, annoncé d’une façon incertaine. Certains jours, cette attente se faisait inquiète et presque douloureuse, comme s’il craignait d’être la dupe d’une hallucination. Il écrivait alors des lettres spontanées qu’il n’envoyait pas, mais qu’il lui communiquerait plus tard, lorsque par sa présence, elle aurait raffermi la première certitude de son amour : « Ce seront, disait-il en souriant, des témoignages de ma sincérité du moment. Et même si ces pages doivent demeurer secrètes, elles resteront près de moi la notation d’une minute de ma vie. »
Le silence de Simone se prolongeait. Raymond eut alors l’impulsion de partir, de s’égarer quelques jours dans l’inconnu, de se perdre pour mieux se retrouver et d’échapper ainsi à ce doute qui affaiblissait son orgueil. Mais voyager ?
— Il y a, dit-il, des êtres qui partent seuls, vers des paysages, des monuments, des souvenirs historiques ; ils prennent des trains et des voitures à heure fixe pour aller contempler des cathédrales ou des sculptures célèbres. Ils croient naïvement qu’il y a une émotion esthétique pure ; non, il n’y a d’émotion esthétique qu’associée à un état de sentiment, à un état de désir. Je ne me souviens que des paysages et des monuments contemplés au bras d’une amie ; et telle voûte de verdure, telle avenue gothique suspendue au-dessus d’un baiser gardent pour moi, dans mon souvenir, ce caractère d’émotion esthétique que ne m’ont pas donné les chefs-d’œuvre classés dans les guides.
« Je ne veux partir, s’affirma Raymond, que pour domestiquer mon obsession, la promener par la main dans le calme d’un bois, vérifier sa puissance et sa sincérité.
Il se laissa donc emmener en auto par une amie de lettres trop occupée à équilibrer ses rythmes poétiques pour dérouter ses propres méditations. Mais dès qu’il fut là, dans cette maison inconnue, dans ce paysage sans aucune réverbération de souvenirs, il eut peur de cet isolement et de ce silence si lourd de ses propres pensées qu’il en était assourdi. Il n’eut qu’une idée : fuir, revenir à Paris où peut-être Simone l’attendait. Prétextant alors un important rendez-vous d’affaires. Raymond se fit conduire à la gare prochaine. Il souriait en pensant que s’il avait exprimé à ses hôtes le véritable motif de sa fuite précipitée, on l’aurait jugé peu sérieux. Se hâter vers des combinaisons d’affaires qui assureront le confort d’une existence inutile, cela est en effet admis et admiré ; mais mépriser ces contingences pour ne plus s’intéresser qu’au parfum et aux sentiments d’une femme, n’est-ce pas puérilité et folie ?
C’était bien vers une lettre de Simone que s’était embarqué Raymond et que le train, scandant le bruit de ses roues et trouant la verdure déjà fanée de septembre, le menait de tout son essoufflement. Il lui semblait maintenant qu’il n’arriverait jamais assez vite, et le taxi qu’il prit à la gare de l’Est dut, pour lui obéir, accélérer son allure et fendre les flots des promeneurs indignés. Des petits groupes de femmes se soulevaient comme des vagues et déferlaient, écume bariolée, sur les trottoirs.
La lettre de Simone était là qui l’attendait. Raymond monta chez lui et s’enferma avec son mystérieux trésor. Son cœur battait à coups précipités : cette lettre était déjà une présence ; il la baisa religieusement avant de l’ouvrir.
En quelques mots d’une simplicité volontaire, Simone fixait un rendez-vous prochain et disait sa certitude que cette minute du revoir allait renouer sans heurt leur soirée merveilleuse à leur vie tout entière. Il faut toujours affirmer ce que l’on désire et capter les êtres dans sa propre suggestion. « Elle avait, écrivait-elle encore, trouvé dans la solitude de son petit fief provincial, de nouvelles raisons sur lesquelles appuyer son sentiment : elle voulait, en effet, donner à son impulsion l’assentiment de son intelligence. »
« Les femmes, elles, ne doutent jamais d’elles-mêmes, observa Raymond : c’est ce qui fait leur force. Elles savent toutes qu’elles sont chacune la plus belle, la seule vraiment belle : elles nous le persuadent facilement lorsque leur chair a tenté nos mains, nos lèvres et nos yeux. »
Le jour du rendez-vous, Raymond avait dû, afin de ne pas arriver trop tôt chez Simone, errer dans les allées des Tuileries et tourner autour du bassin où voguaient des flottilles puériles. Il évoquait son enfance, à la fois déjà lointaine et si proche, où il s’hypnotisait à ces mêmes jeux ; mais cet enfant qu’il avait été, il le retrouvait en lui, à cette heure où, avec tant d’obstination, son âme s’accrochait à l’illusion du bonheur.
— Les hommes, comme les enfants, songeait-il, jouent à n’être pas eux-mêmes : nous sommes tous des comédiens qui jouons des rôles en vérité aussi puérils et inutiles que ces jeux de petits bateaux lancés sur le songe de ce bassin. Peut-être même que la vie n’est acceptable qu’ainsi transmuée en comédie ou en tragédie : en jeux. Les moments où l’homme n’est pas en scène pour la comédie qu’il se joue sont des moments d’ennui ou de désespoir où il sent le vide de son être éphémère. Le croyant qui cesse de jouer à l’éternité perd pied dans le néant de sa fugitive animalité. Mais, en réalité, l’homme échappe facilement à cette dangereuse conscience de la vie, car il possède en lui-même tout une friperie de costumes et de masques où cacher son véritable visage. Ces masques de son visage, de son corps et de son âme, il les revêt même lorsqu’il est seul avec lui-même, car c’est surtout à soi-même qu’on doit se jouer la comédie : médiocre, incapable d’une pensée vivante et personnelle, on se créera grand penseur, écrivain, artiste, et on arrivera à en donner et à s’en donner l’illusion ; disgracié physiquement, on aura l’ambition d’être admiré pour sa beauté, d’être aimé de la plus belle femme, et on y réussira, tandis que le vrai grand homme, lassé de sa supériorité réelle, dédaignera l’œuvre où il pourrait la refléter et se donnera la joie d’être estimé pour une futilité : la danse, les échecs, la musique, la vanité des galons, des décorations, des succès féminins.
L’homme est un comédien apte à tous les rôles qu’il se suggestionne, et c’est peut-être les rôles pour lesquels il est le moins doué naturellement qu’il joue le mieux, parce qu’il y met l’ambition de réaliser la chose la plus difficile… C’est peut-être pour cela que le monde appartient aux imbéciles qui se croient intelligents et qui le sont, puisqu’ils le croient, tandis que les êtres supérieurs doutent d’eux-mêmes, se jugent inférieurs… et le sont.
Cet enfant, costumé en marin, se croit, sans doute, à cette heure crépusculaire, le plus grand corsaire qu’on aie jamais imaginé… et moi-même qui souris de son illusion, je ne sais plus me retrouver moi-même, sous le projecteur de mes hallucinations : je vais comme un tropisme attiré par la lumière et le parfum de Simone.
Raymond regarda l’heure à sa montre :
— Je suis presque en retard. C’est bien…
Elle est là, debout, devant lui, un peu plus pâle dans la lumière du soir qui fait ses yeux plus sombres et l’éclair de son sourire plus rayonnant.
Raymond s’est assis près d’elle sur un petit divan bas : il a pris sa main dans la sienne et la baise ; mais elle, d’un mouvement spontané, appuie contre son sein la tête de Raymond.
— Faut-il baiser son cou, atteindre déjà sa bouche ? se demande-t-il.
Il se dégage doucement et s’agenouille pour une adoration et une contemplation muettes, comprenant combien il est difficile, en ces premières minutes, de trouver les mots qui seraient ceux que l’on écoute dans le silence.
Mais Simone s’est levée, traduisant son exaltation intérieure par du mouvement autour de lui, un enveloppement d’elle-même, de ses gestes, de ses mots… Et à cette joie vivante qu’elle ne pouvait étouffer, Raymond comprit qu’elle non plus n’était pas aussi sûre que cela qu’il viendrait, à l’heure commandée, se coucher à ses pieds. A ce signe, il se sentit victorieux et trouva enfin les mots qui disaient l’obsession confiante de son attente et de sa solitude. Il parlait maintenant de lui, de son désir d’identification avec un être d’une perfection divinisée, qui était-elle, Simone, miraculeusement venue vers lui, pour le sauver du péché du doute…, etc…
Attirée par la musique de ces paroles, Simone était venue à son tour s’agenouiller aux pieds de Raymond, levant vers lui ses grands yeux noirs dont les pupilles agrandies disaient la ferveur de sa sensualité. Un frémissement de son corps courba sa tête sur les genoux de Raymond qui, se penchant doucement, mit un baiser sur la nuque de Simone. Elle écouta longuement la pensée de ce baiser, et puis, accrochant ses mains au cou de Raymond, elle attira sa bouche vers sa bouche. Ils burent longuement la spiritualité de leurs âmes.
Lorsque Simone releva la tête, les yeux noyés d’une eau de songe, ses cheveux s’effondrèrent sur ses épaules. Elle secoua sa belle tête pour en épandre les vagues et dit en riant :
— Les cheveux sont faits pour tomber !
Raymond noya ses mains dans cette nuit dorée et, y engloutissant son visage, en respira longuement le parfum mystique et sensuel.
Déjà ses lèvres gagnaient la chair nue des épaules et ses mains dégrafaient le corsage de Simone pour cueillir son sein ; mais Simone, saisissant les mains de Raymond, les écarta doucement du fruit secret qu’elles voulaient cueillir, et les baisant tendrement :
— Laissez-moi venir à vous lentement, afin que ma pensée soit tout envahie. Ne sentez-vous pas déjà que je suis toute à vous, Raymond ?
Raymond vécut, les deux jours suivants, avec la sensation de ce baiser, petite rose rouge et brûlante qui s’était écrasée sur sa bouche.
— Même si je ne devais jamais posséder Simone plus complètement, se disait-il, je garderais encore longtemps la sensation d’avoir pénétré dans sa pensée vivante. Et il entrait une si pure mysticité dans son amour qu’il ne désirait presque pas un plus complet abandon.
Simone est venue chez Raymond : elle a pris possession de cette demeure silencieuse dont l’atmosphère est faite de ses pensées et de la respiration de son être ; elle s’y promène comme dans un parc familier, cueillant des livres, des papiers, lisant toutes les lettres, les notes intimes de Raymond, à la fois ravi et inquiet.
— Il faudra, se dit-il, avoir bien soin de soustraire à sa curiosité ce que je voudrai lui cacher.
Et pour fixer quelques instants l’inquiétante curiosité de Simone, il lui fit lire des notes sur l’amour qu’il avait jadis écrites et qui étaient déjà une intuition d’eux-mêmes, lui disait-il.
Ces notes, inspirées par Rite, s’adaptaient d’ailleurs merveilleusement à l’amante que serait Simone ; elle sourit et pensa qu’en effet, Raymond l’avait devinée et qu’elle serait cette maîtresse fervente que son imagination avait intuitivement créée.
Assis près d’elle sur un petit tabouret de paille, Raymond contemple ces jambes longues et fines qui se noueront à son corps, à son cou ; il jouit de cette intimité immobile qu’il ne veut pas brusquer, de cette sensation d’une présence harmonieuse qu’un geste trop brutal pourrait faire s’évanouir. Il attend qu’elle vienne vers lui, qu’elle s’ouvre à lui, elle et toutes les tentations de sa chair qui est là, encore enfermée et cachée sous la pulpe de ses vêtements.
Simone a jeté les feuillets : elle est émue, et, pour cacher une larme qui vient mouiller ses yeux, elle écrase son visage contre la poitrine de Raymond ; puis, levant vers lui son visage ébloui, elle lui tendit sa bouche entr’ouverte où il but le frémissement qui montait comme une vague le long de sa chair. Il s’installa dans ce baiser, aspirant cette bouche qui avait la saveur mouillée d’un fruit où les dents ont mordu.
Il tenait Simone contre lui, la tension de son être posée toute en désir sur la respiration soulevée de sa chair.
Peut-être fallait-il poursuivre ? Il esquissa, scrutant une approbation, un geste de contact plus intime, mais la main de Simone écrasa ce geste qui déjà s’était immobilisé… Toute défaillante, et réagissant contre l’émoi auquel elle aurait voulu s’abandonner :
— Ne me touche pas ! ne me touche pas ! Raymond, dit-elle, mettant dans ce cri et ce premier tutoiement une tendresse implorante.
Elle ajouta, en souriant :
— Non, ne me touche pas, Raymond. Tu serais encore un peu seul… Et puis non, pas ainsi, comme par surprise et dans cette impudeur de nos vêtures.
Et Raymond sut gré à Simone d’avoir arrêté son élan de bonne volonté et de ne l’avoir pas obligé à d’inesthétiques approches.
— Ne sois pas triste, Raymond : dans deux jours je viendrai vers toi et je me donnerai toute à toi, sans vaine pudeur, puisque déjà, en pensée, je suis tienne.
Raymond n’était pas affligé : il eût même été fort peiné de cet incomplet décorticage de Simone, et si gêné aussi de se montrer lui-même dans une exaltation comme entravée.
Debout, pour l’adieu, il tient Simone dans ses mains, la serre contre lui et lui fait sentir encore la ferveur d’une émotion qu’il lui gardera. Elle demeure ainsi contre lui ; de son corsage qui s’est ouvert, un sein a jailli, si blanc dans le soir qu’à l’émotion sensuelle de Raymond qui le baise se mêle une émotion intellectuelle. Simone s’arrache à cette étreinte dont elle veut pourtant se sentir liée, enveloppée jusqu’à la minute de la divine détente, et, un peu titubante, elle s’en va, silencieuse, lourde de son désir qu’elle garde en elle comme un dieu.
Déjà Raymond s’apprête à la communion promise : il a caché un peu sous des verdures et sous des fleurs vives l’accumulation trop sévère de ses livres. Il eût voulu reconstituer pour Simone l’atmosphère de son enfance en son petit manoir normand dont le paysage disparu demeurait le vrai décor de sa vie intérieure. Des images se poursuivaient en lui comme des nuages chassés par le vent dans un ciel d’automne. Assis dans le fauteuil d’osier où Simone avait laissé son empreinte, il les suivait du regard…
« Une buée monte de la terre au soleil couchant, l’été, enveloppant les choses, les arbres et les bêtes qui dorment, d’une fine mousseline mouillée…
« Les odeurs se soulèvent, les feuilles de peuplier, pièces d’or de contes de fée, pleuvent et versent leur parfum de pourriture neuve… L’avenue de hêtres, allée de cathédrale gigantesque, s’imprécise, et l’incertitude de son dôme la stylise, en fait une émouvante architecture… Le brouillard nous gagne comme la mer montante ; on se sent perdu : le paysage n’a plus de rives. Il n’y a plus d’arbres, plus de haies, plus de sol même : on vogue dans une onde immatérielle, lumineuse encore, mais qui s’éteint peu à peu comme le corps d’une méduse qu’on a sortie de la mer…
« C’est la nuit qui s’est levée du sol entr’ouvert et, fumée imperceptible, s’est heurtée à tous les angles du paysage, s’est accrochée à la coupelle des arbres et dans leurs chevelures ; à travers les branches, elle a gagné le plafond très bas du ciel. Le monde entier est envahi de cette fumée : j’étouffe. J’ai peur. J’entends mon pas qui sonne sur la terre caillouteuse et se heurte à de grosses pierres ; des branches mouillées de nuit cinglent mon visage et emplissent ma bouche d’un goût de verdure pâlie…
« Voici l’étang, invisible et froid : je devine la voilette verte qui cache son visage et dont les mailles, que les bœufs ont déchirées en s’abreuvant, vont se réparer silencieusement dans la nuit… Rentrer dans la maison secouée par le vent qui se glisse dans les couloirs comme dans des tuyaux d’orgue… Ma bougie veille à côté de moi : mon ombre s’agrandit, empiète sur le plafond où elle se brise : elle répète tous mes gestes, les exagère ironiquement, semble se moquer de moi. La bougie a clignoté ses dernières heures, elle est morte : l’ombre est rentrée en moi-même : la nuit est noire comme la mort. Immobile, je suis comme une momie éternisée où seule ma pensée vacille encore et veille sous des bandelettes d’images…
Le film des souvenirs se déroulait, mêlant les années et les saisons. Raymond prit dans une petite coupe de cristal une cigarette que Simone avait tenue dans sa bouche et qu’elle n’avait pas allumée : c’était un peu de ses lèvres qu’il aspirait. Dehors, c’est le silence absolu, le vrai silence des champs. Il songe aux enlianements que la nuit emporte comme le courant d’un fleuve, aux accords qui se prolongent, aux plaintes graduées des amants qui se martyrisent, à tous les déclenchements des chairs parfumées. Il songe à Simone et s’agenouille en pensée, près du lit, où, étendue dans la gravité du sommeil, elle lui évoque la Vénus du Titien dont la main se parfume à son propre songe.
Cinq heures. Raymond attend Simone. Penché à la fenêtre, il interroge la rue : chaque taxi est un espoir qui se précipite, chaque silhouette lointaine de femme est une Simone. Il aimait cette petite angoisse de l’attente amoureuse, lorsqu’il était sûr qu’on viendrait. Elle viendra : elle s’est préparée à cette visite un peu nuptiale avec une piété un peu mystique. Et il songeait aux purifications parfumées, ou plutôt qui développent le parfum de la chair : il ne voulait, en effet, qu’aucun parfum étranger ne voile la divine et personnelle odeur de la femme. « Cette odeur de leur sang et de leur onctueuse sève, c’est, plus encore peut-être que la musique de leur âme, ce qui nous enchaîne à elle. D’ailleurs la femme a le parfum de son âme et de son intelligence. »
Instinctivement, Raymond avait plongé son visage dans les plis secrets d’une rose rouge ; il lui parlait avec tendresse, et c’était déjà l’âme de Simone dont l’encens l’enveloppait de ses subtiles volutes.
Mais maintenant les battements de son horloge de porcelaine lui scandaient des minutes plus lourdes : la lumière plus sereine de six heures aggravait son inquiétude, et c’était presque comme si Simone était déjà repartie. Un peu agité, il avait inspecté l’escalier, interrogé la spirale de ce puits et, s’abandonnant au destin, il était rentré vers son attente immobile, laissant derrière lui la porte de l’escalier entr’ouverte…
Un peu pâle, troublé comme si désormais Simone ne viendrait plus jamais, il s’assit dans son fauteuil de fakir et, fermant les yeux, il écouta les battements de son cœur et de ses pensées. Une de ces pensées s’accrocha à l’image de Rite un instant surgie, et il aurait presque voulu être maintenant assuré d’une longue solitude pour lui écrire, la rassurer de l’angoissante torture où il l’avait laissée. Le fantôme de Rite s’était assis sur ses genoux et, tout à coup, il sentit à son cou la fraîcheur parfumée de deux bras, tandis qu’une bouche un peu tremblante écrasait ses yeux clos.
C’était Simone qui, sans qu’il l’entendît, était entrée, à pas feutrés, par la porte laissée entr’ouverte et venait de baiser son songe. En même temps, le fantôme de Rite s’était évanoui devant la réalité de Simone.
— Toi ! enfin, dit Raymond.
— Oui, répondit Simone, moi toute, et toute ma vie à toi.
Elle s’était agenouillée devant lui, plus blanche qu’un magnolia, ses grands yeux noirs illuminés levés vers lui et pleins d’une si ardente mysticité que Raymond sentit tout à coup ses yeux se mouiller d’émotion. Il prit la belle tête de Simone dans ses mains, et il eut une seconde l’impression inoubliable de tenir entre ses doigts la chose la plus précieuse et la plus parfaite du monde : sensation qui dépasse le désir. Il contemplait cette petite bouche dont le dessein et le sourire étaient une lumière qui semblait éclairer toute la pièce.
Lentement, Simone s’était levée et avait posé la lumière de son sourire contre la bouche de Raymond. Ils burent longuement leurs souffles, s’installant dans ce baiser qui faisait lever leur chair. Et puis, sans quitter cette bouche qui s’accrochait à la sienne, Raymond avait pris Simone dans ses bras et l’avait portée sur le divan, dans la pénombre d’une petite pièce où veillait une lampe bleue. Déjà sa main se parfumait au secret de Simone qui s’ouvrait à elle ; mais Simone ne voulut pas s’abandonner à ces prémisses incomplètes. Gravement, elle se dévêtit et apparut à Raymond dans sa blanche nudité qu’elle enliana à la nudité de Raymond. Longue possession immobilisée dont ils écoutaient le heurt intérieur et la lente prière qui montait comme un hymne à leur cerveau. Ils demeurèrent ainsi dans cette communion silencieuse où les battements de leurs chairs rythmaient leurs pensées. Englouti dans le songe parfumé où il se déchirait, Raymond broutait la salure mouillée des aisselles, tandis que ses mains dessinaient la ligne de ce corps et le vêtaient du fluide de sa caresse.
Sous son baiser, les fraises des seins s’étaient levées et tendues vers ses lèvres. Maintenant, ils jouent comme des enfants, et, tout à coup, Raymond a senti sa tête emprisonnée dans l’étau des jambes de Simone qu’il respire. Il la tient dans ses mains comme une coupe où ses lèvres boivent lentement. Elle ferme les yeux et écoute monter en elle une plainte qui s’angoisse et s’étouffe en un battement de tout son être. Ses deux mains pressent contre l’émotion de sa chair le baiser de Raymond qui boit son parfum.
Raymond demeure silencieusement enivré dans cet encens, se faisant un collier de blancheur des longues jambes de Simone. Alors, avec des mots, encore parfumés d’elle, il lui dit sa beauté et la mystérieuse correspondance de ses gestes d’offrance et d’amour avec l’expression de ses yeux et de son sourire. Il se retrouvait en elle si merveilleusement celui qu’il avait toujours cherché qu’il avait, disait-il, la sensation de ne plus rien désirer au delà d’elle-même. Elle serait pour lui l’amante de sa chair et de son intelligence ; et la fraternité de leurs êtres, leur identification leur paraissait déjà si parfaite qu’elle leur semblait presque incestueuse.
— Oui, parle-moi, Raymond, disait Simone : ta parole est une présence, une possession prolongée dans mon âme. Tout mon être s’accroche à tes mots, et puis aussi tes pensées me révèlent à moi-même. Oui, les pensées, les désirs obscurs de mon enfance, de ma vie, s’éclairent à la lumière de ton intelligence. Car, Raymond, plus encore que ma chair, c’est mon âme que je te donne, avec la même impudeur que mon corps. Je ne veux pas avoir de secrets pour toi : que tu sois mon refuge contre mes incertitudes et mes doutes. Tu seras ma volonté aux heures de défaillance, et mon exaltation aux minutes découragées. Je te parlerai de moi, comme parfois j’ose me parler de moi-même à moi-même, et je trouverai dans ton assentiment le courage ou l’orgueil de me contempler dans ma sincérité.
La nuit était peu à peu tombée sur leurs confidences. Simone ne voulut pas se lever pour dîner ; Raymond lui apporta des fruits et des gâteaux et ils burent des vins dorés dont ils grisèrent leur fatigue. Simone jeta vite la cigarette qu’elle venait d’allumer : elle avait hâte de se perdre encore dans l’hallucination de sa joie. Elle s’est glissée, comme un serpent de tendresse, le long du corps de Raymond qui s’abandonna à cette tendre curiosité. La petite bouche de sensualité rêveuse parcourt sa chair, éveille la fragilité de ses mamelons d’homme dont elle caresse son baiser, et puis elle s’est immobilisée, grave, tout emplie du fruit qu’elle convoitait secrètement.
— Donne-moi ta bouche, Raymond, je veux que tu te communies de ma communion.
« Maintenant, dit-elle en souriant, c’est toi qui es mon cheval de rêves : obéis à mes impulsions, Raymond, obéis au commandement de ma voix. Et elle se précipitait, retombant sous le galop qui la soulevait et l’éclaboussait de son éclair et de son écume.
D’un commandement bref, elle savait arrêter l’élan de la course, afin d’en perpétuer le divin essoufflement. S’arrêter d’une brève contraction au bord du précipice et reprendre la lente ascension vers la suprême détente où s’éteint la lumière du désir. Elle disait encore, d’une voix un peu angoissée :
— Attends-moi, Raymond, je suis loin encore, je cours vers toi… Vois, je t’ai rejoint, donne-moi ta main… et faisons ensemble ce bond dans la lumière.
Et puis, comme attendrie de la plénitude détendue de son vol, les ailes repliées, Simone s’abattit sur le corps de Raymond et le couvrit du baiser de toute sa chair émue et reconnaissante.
Simone s’était endormie, et Raymond, qui retenait sa respiration pour ne pas l’éveiller, souriait en évoquant le dernier geste de Simone, geste de tendresse où elle avait appuyé contre sa joue l’élan encore mal éteint du thyrse sacré. Elle avait mis dans ce baiser d’adieu une telle maternelle effusion que Raymond en avait été troublé. Il contemplait maintenant la quiétude de Simone emportée dans le courant du sommeil ; seul le rythme de la respiration soulevait ses seins, et, à son cou, la pulsation d’une artère faisait battre son sang. Ses paupières closes faisaient plus blanche la pâleur de son visage et lui donnaient la gravité de la mort.
Raymond demeure de longues heures à contempler, à respirer le sommeil de Simone, ne voulant perdre aucune minute, aucune attitude de la beauté qu’elle lui donnait. Il entrait dans son admiration une sorte de sentiment religieux, de timidité religieuse.
La conscience qu’il prenait de cette beauté miraculeuse de Simone le faisait presque douter de lui-même : déjà se glissait en lui le doute qu’il cultiverait avec une douloureuse insistance : « Il n’est pas possible qu’elle m’aime. » Incertitude dont il ne voulait pas guérir et qu’aucune parole d’absolu, aucun geste de parfait abandon ne rassureraient complètement. Instinctivement peut-être, il se réfugiait dans cette incertitude qui nimbait Simone d’une auréole de divinité inaccessible. Ce que nous aimons dans la vie et dans les êtres, c’est ce qui, en eux, est et demeure inatteignable.
Simone s’éveilla dans le bleu fragile de l’aube, et, toute rafraîchie par le sommeil, elle donna à Raymond son parfum du matin, le dominant de sa frêle majesté.
Ils prolongèrent jusqu’après midi cet épuisement d’eux-mêmes qui exaltait leur cerveau et faisait jaillir de leurs lèvres les mots qui précisent les sentiments encore incertains. Mots qui sont comme l’expression instinctive d’une sensation immédiatement intellectualisée.
Dans cette communion de leurs chairs, ils se donnaient toutes les images accumulées de leur enfance et de leur jeunesse, et ils avaient cette sensation momentanée de ne s’être jamais quittés ; les souvenirs qu’ils évoquaient semblaient réveiller en eux une vie antérieure où ils avaient joué enfants dans les allées du même parc enchanté.
Raymond écoutait les confidences de Simone et la possédait ainsi dans toutes les années qui n’avaient été qu’une longue et inquiète recherche de son amour.
— Comme la plupart des jeunes filles de notre monde, disait Simone, je me suis mariée pour être libre, malgré les risques de l’aventure. Ce qu’il faut d’abord, c’est s’évader de la tutelle et de l’égoïsme de ses parents. Instinctivement, tout être sent qu’il ne se développera qu’autant qu’il réagira contre le milieu familial. Le mariage, c’est le premier round de la vie : il s’agit de vaincre son mari, son adversaire. Alors, soit qu’on le garde comme décor d’honnêteté, soit que, comme moi, on le rejette comme une bête morte, on est libre, et la vie commence…
— Et les enfants, Simone ? demanda Raymond.
— Le divorce leur donne un double foyer, et ce double courant d’idées fortifie en eux les dons d’observation, d’inhibition, le sens critique, et leur permet aussi de se choisir, par delà tous les devoirs inscrits dans les manuels, leurs vraies sympathies.
« Mon petit m’aime parce que je suis belle, et que la beauté, en somme, c’est peut-être le plus sûr symbole de la raison ; je lui apprends à mépriser les petites croyances et les petites querelles religieuses de son autre famille, et je sens d’ailleurs si bien qu’il est uniquement mon enfant à moi ; un père, ce n’est presque rien : une goutte de levain…
« Le mariage ! je regrette presque maintenant cette inutile expérience. J’aurais dû avoir le courage de me lancer seule dans la vie (oh ! je dis cela sans aucune idée de revendication sociale ! je ne suis pas féministe !). Mais, libre, j’aurais été puiser des enfants aux meilleures sources, aux meilleures races ; j’aurais mis de la fantaisie et de la variété dans les hérédités : expériences comme le greffage et le bouturage des roses : bouturage des chairs, des cœurs, culture des formes, des lignes et des couleurs… quel jeu divin !
« La société m’eût chassée de son parc aux étroites palissades, mais qu’importe : ce qu’on appelle la société, ce n’est qu’un collier de beau style dont on enchaîne les individus comme les chiens de race : lévriers de divan… Oh ! les courses à travers la steppe.
— Vous êtes un beau lévrier, Simone.
— Peut-être, Raymond, mais un lévrier qui veut choisir son maître en toute liberté. Si je viens m’agenouiller devant toi, Raymond, c’est que j’aime tes mains qui me rassurent et me caressent, tes petites mains intelligentes et douces comme des lèvres. Si je t’aime, c’est que je sens en toi un attachement de maître qui doute de son autorité. C’est moi, ton esclave, qui ai vaincu ton orgueil. Songe, Raymond, que tu es pour moi l’être le plus parfait ! Alors, lorsque je te vois tout tremblant d’émotion devant ma beauté offerte, quel orgueil j’ai d’être moi-même !
— Oui, Simone ; on aime les êtres pour le sentiment de puissance qu’ils nous donnent. Il faut que l’amour soit cela : une double exaltation. Les êtres sont dans la vie ce que l’amour les a faits, et ils ne redescendent jamais du faîte où l’amour les a fait monter. Ceux qui ont été aimés avec cette plénitude en gardent toute leur vie un rayonnement, une sagesse aussi, car quelle passion vaudrait celle-là qui nous met à l’abri des inutiles petites ambitions ? La gloire elle-même n’est auprès de l’amour qu’une belle prostituée : la gloire, c’est l’amour de la foule : l’amour, c’est l’amour de l’être choisi, le plus noble et le plus beau, celui qui nous divinisera…
— Parle-moi encore, dit Simone en appuyant la tête de Raymond contre la sienne : tes mots entrent en moi comme des baisers : ils tombent sur mon front, sur mes yeux, sur ma bouche, sur mes seins, sur mon ventre : tes mots, ce sont encore tes mains qui me prennent, tes lèvres qui me boivent, et ma bouche qui s’ouvre à tes mots se mouille du désir de te donner encore ma blancheur parfumée que tu exaltes. Tout mon être est un baiser mouillé vers toi…
— Regarde-moi, Simone. Mêlons nos regards où monte la lumière du désir, à cette minute qui va nous déchirer…
« O Simone, toute cette soirée, je garderai à mes lèvres le goût de ton amour.
Il fallait se quitter. A cette minute où les mains de Simone glissaient comme mortes des mains de Raymond, il retrouva déjà son angoisse, et, lorsque la porte fut fermée sur la silhouette de Simone descendant la spirale de l’escalier, Raymond eut tout à coup peur de l’avoir perdue. Il lui semblait absurde aussi qu’elle fût partie, qu’elle puisse vivre, ne fût-ce qu’une heure, loin de lui, qu’elle puisse avoir une pensée, un souvenir, faire un geste auxquels il ne participe pas. Par delà les exaltations des heures d’amour, les effusions des chairs et des mots, une sensation de solitude envahissait Raymond. Il dut, en une sorte de prière agenouillée devant l’image de Simone, se suggestionner une confiance momentanée : il lui écrivit pour lui persuader à elle-même qu’elle l’emportait tout entier dans ces heures de cruelle séparation. Il la consolait d’être loin de lui. Il se promettait aussi de lui écrire tous les jours, afin qu’elle fût perpétuellement attirée par sa pensée comme une petite goutte d’acier par un aimant.
Dès le réveil, le lendemain, l’image de Simone se jeta sur Raymond et ne le lâcha plus. Toute cette journée, il fut en attente d’une visite presque promise, mais Simone ne vint pas, et aucun mot d’elle ne vint le rassurer. Il s’inquiéta, d’une inquiétude hallucinée et incapable d’un geste. Le soir tomba sur cette vaine attente, sur cette journée qui avait si lentement et si douloureusement déplié ses heures inutiles. Alors s’embarquer dans la nuit, vers l’espoir du matin nouveau, sentir peu à peu ses pensées, son angoisse vaciller et s’éteindre : l’être tombe alors comme sur une autre planète où il se retrouve autre avec des souvenirs d’une vie différente. Raymond gardait en lui un souvenir obscur de cette vie nocturne où il se revoyait en des paysages familiers et pourtant ignorés de sa vie réelle et consciente.
Un pneumatique de Simone. Raymond tient la petite enveloppe dans sa main sans oser l’ouvrir. Il a peur des mots qu’elle contient et, en même temps, il en espère toute la joie de sa vie du moment : peut-être Simone sera-t-elle là tantôt… Mais non, la lettre annonce brièvement un départ nécessité par un deuil familial. « Mais, ajoutait Simone, dans ma solitude de là-bas, je revivrai plus intensément nos heures d’amour. En te perdant un peu, Raymond, ma peine avivera encore en moi mon désir de toi. Je t’écrirai. »
Elle n’écrivit pas, et l’angoisse de Raymond se mua en un doute qu’il cultiva : il osa s’imaginer que peut-être Simone était allée rejoindre un amour pas tout à fait épuisé. Mais il chassa vite cette image et se suggestionna la certitude d’une Simone inquiète comme lui et comptant les minutes qui les séparaient. Il évoquait l’heure merveilleuse où il avait tenu sa belle tête dans ses mains :
— Que c’eût été beau, si elle était morte à cette minute : elle fût demeurée, toute ma vie, une idéalisation de mon amour éternisé dans sa perfection… Ah ! Simone, que je t’aimerais morte, que j’aimerais mon désespoir qui trouverait des mots pour te recréer perpétuellement.
Mais un peu du parfum de Simone demeurait dans cette chambre où il l’avait possédée. Religieusement, Raymond s’agenouilla auprès du lit où se dessinait la forme de son corps, et il baisa la place où elle avait dormi. Il lui parlait avec un lyrisme dont il berçait sa peine :
— Parfum subtil, synthèse extatique du monde, je t’évoque, et voici que surgit l’élan sacré de ton corps pâle et souple où s’enroulent les volutes musicales de ma pensée. Tous les mots qui s’envolent de ma bouche ont l’odeur salée de ton amour. C’est ton parfum unique que pleurent les larmes qui tombent dans mon sourire ; c’est lui que je mâche dans la saveur un peu acre de cette feuille morte que le vent colle à mon inutile baiser, ô mon parfum, ma douleur, mon regret, mon amour…
« Tout mon être, traînant les images de sa vie, sa philosophie ironique et sa décourageante conception du monde, tous les mouvements de mon corps et de mon esprit ne sont plus qu’une paille fragile emportée vers le gouffre étroit de ton ventre, ô mon parfum, ma douleur, mon regret, mon amour…
« L’âcreté des écorces au printemps, quand la sève se mouille de joie neuve et soulève la chair des arbres qui s’érigent, ce m’est le goût mystique de ta joie, la sève de ton corps, le sang de ta blessure secrète, ô mon parfum, ma douleur, mon regret, mon amour…
« J’ai tenu dans mes mains la pensée de la belle tête si blanche dans les feuillages noirs de tes cheveux ; tes yeux levés vers moi montaient comme des astres dans la nuit, ô mon parfum, ma douleur, mon regret, mon amour.
Raymond sentait son amour pour Simone s’aggraver dans l’inquiétude et le silence, en même temps qu’il éprouvait une grande intensité de vie intérieure où ses jugements et ses pensées venaient se brûler. Nous jugeons la vie d’après nos passions et ce sont même nos passions qui éclairent notre vie. La sérénité des vieillards, c’est la sérénité de la nuit : c’est l’obscurité.
— On dit, réfléchit Raymond, que nos passions nous aveuglent. Oui, mais à la façon du soleil dont la lumière donne leur valeur aux objets.
Quelques lettres de Rite dormaient sur la table de Raymond : il n’avait pas voulu les ouvrir, indifférent à tout ce qui n’était pas l’amour de Simone. Il prit ces lettres dans sa main et sourit en songeant aux vaines tendresses, aux baisers fanés que contenaient ces fragiles enveloppes.
— En ces jours d’angoisse, peut-être injustifiée d’ailleurs, pensa Raymond, les épanchements de Rite me seraient d’une trop cruelle ironie. J’attendrai, pour communier à ces tendresses mortes, d’avoir retrouvé Simone.
Et pour occuper les heures vides, Raymond alla visiter Madeleine qui s’inquiétait de son silence et de son absence. Elle était, en effet, rentrée à Paris et avait organisé sa vie, plus étroitement encore, autour de son petit dieu. Seul Morangis était demeuré leur visiteur presque quotidien : Dionys, décidément doué pour la musique, semblait devoir devenir son disciple, et Morangis trouvait dans les dispositions musicales du jeune homme une raison nouvelle de s’attacher à lui. Il remarquait que les jeunes gens d’une sexualité un peu déviée étaient en général très doués pour les arts : poésie, musique, peinture, etc… Il épiloguerait avec Raymond sur ce sujet ; Madeleine, d’ailleurs, était très heureuse de sentir son Dionys attiré vers une carrière assez indéterminée qui n’exigerait aucun internement dans des écoles : ainsi, elle le garderait près d’elle et satisferait aux exigences de son devoir et de son égoïsme.
— Et puis, ajouta Raymond, auquel elle expliquait cette sage combinaison, il est bien inutile d’encombrer de science vaine la jeune intelligence de cet enfant dont le génie est dans sa beauté. Il est lui-même la propre réalisation esthétique de son âme. Que la musique et la danse donnent à ce beau corps sa parfaite eurythmie, et l’amour y ajoutera son rayonnement. Homme pour les femmes et femme pour les hommes, il est une sorte d’androgyne synthèse de la vie, mais condamné par cela même à une manière de stérilité.
Puis, changeant la conversation, Raymond demanda à Madeleine dans quel état d’âme elle avait laissé son lévite amoureux et d’une chasteté si mystérieusement vicieuse.
— J’ai longuement rêvé à son aventure, dit-il, et cherché les raisons de sa fuite devant ton offrande trop belle et trop réelle. Sa renonciation, Madeleine, ne fut peut-être pas aussi héroïque qu’elle t’a semblé ; elle fut peut-être seulement déterminée par l’impuissance où il se sentait devant la réalisation imprévue de son rêve. Il a fui, Madeleine…, parce qu’il ne pouvait pas combattre. Combien d’amoureux, incapables de prouver leur passion à la femme qu’ils désirent, se délivrent devant son image évoquée du rêve qui les obsède !…
— Peut-être, répondit Madeleine, mais je veux tout de même voir dans cette timidité une preuve d’amour mystique. C’est d’ailleurs beaucoup mieux ainsi et j’aurais sans doute regretté mon geste de pitié, si…
— Oui, Madeleine, mais laissons ce sorcier de village à genoux devant son symbole, et ne sourions pas trop de la naïveté de ses rites sexuels. Nous sommes tous un peu semblables à lui, nous qui souvent, dans les bras d’une femme réelle, ne trouvons l’inspiration amoureuse qu’en évoquant l’image d’une autre femme où même le souvenir d’une lecture. Nous possédons tous, dans le tiroir secret de notre subconscient, un symbole idéal de la femme dont les femmes que nous croyons aimer ne sont que d’imparfaites répliques.
A cet instant, Morangis entra tenant Dionys par la main. Madeleine reprit possession de son jeune amant avec un sourire où semblait fondre l’inquiétude secrète des dernières minutes. Maintenant, confortablement installée dans la chaude sérénité du moment, elle interrogeait Morangis sur ce concert où il avait bien voulu conduire Dionys.
— Du Beethoven, du Mozart, du Schumann, du Chopin… c’est très beau, répondit Morangis ; mais il n’y a plus dans ces musiques, même pour la fraîche inculture de cet enfant, aucun élément de nouveauté. Musique rétrospective qui ne correspond plus à rien et qu’il ne faut connaître que pour comprendre l’évolution de la sensibilité musicale. Se réunir dans un hangar aussi désolé et désolant que la salle Gaveau pour entendre ces divines rengaines, cela me semble aussi vain que si de jeunes poètes s’assemblaient à la mairie du VIe arrondissement pour écouter le Songe d’Athalie, les stances du Cid ou les Nuits de Musset…
Simone était revenue, sûre d’elle-même et sûre de Raymond. Son absence avait-elle été une épreuve qu’elle avait voulu s’imposer à elle-même ? Elle dit simplement, à cette minute du revoir où les yeux de Raymond cherchaient dans ses yeux le secret de sa pensée :
— Fais de moi ce que tu voudras.
Et lorsqu’à nouveau leurs bouches s’accordèrent pour la symphonie sensuelle et qu’ils se sentirent emportés dans le remous de leur joie, Simone s’écria que maintenant elle ne se sentait plus seule dans son exaltation et n’avait plus cette sensation un peu inquiétante d’être la proie d’un jeune faune qui avait soulevé le voile d’Antiope de sa nudité détendue.
— Cette sensation m’empêchait de m’abandonner complètement à toi, Raymond, de sentir ma pensée se fondre dans ton baiser comme un fruit dans la bouche. Je t’aime parce que je me suis identifiée à toi par une sorte de mimétisme physique et mental : ma voix a pris un peu de l’intonation grave de la tienne, et je me surprends à des gestes qui imitent instinctivement tes gestes. N’as-tu pas remarqué déjà que mon écriture, tout en gardant sa féminité, cherchait à imiter la subtilité précise de tes chers petits hiéroglyphes ? Et quant à mes pensées, Raymond, elles ne sont plus, elles ne veulent plus être que la répercussion des tiennes.
« Là-bas dans ma solitude un peu volontaire, je me suis sentie plus irrésistiblement envahie par toi que j’avais un peu voulu chasser. Oui, j’ai eu peur de cette emprise à laquelle je me suis enfin abandonnée avec la joie d’une Carmélite qui renonce au monde pour son dieu.
Ce furent alors les rendez-vous quotidiens : la vie s’organisait comme définitivement. Simone s’abandonnait jusqu’à l’épuisement et à l’évanouissement : sa chair pâle pâlissait encore sous l’étreinte dominatrice de Raymond et elle ne croyait jamais s’être assez donnée.
Raymond, qui ne se perdait jamais de vue, contemplait avec orgueil le merveilleux spectacle de ce corps transfiguré par la passion et qui, soulevé par son propre émoi, venait de battre sa chair de son tumulte parfumé. Et puis, avec une lenteur savante et comme réfléchie, il lui imposait la volonté de son rythme, et Simone, accablée jusqu’à l’angoisse, se tendait encore, toute crispée vers le désir qui la déchirait. Alors, s’accrochant aux fragiles épaules de Simone, Raymond écrasait contre lui cette crispation qui, tout à coup, se détendait en battements précipités. Et puis, repliés dans leurs ailes lasses, ils songeaient et se parlaient à voix basse.
Dès que Simone était partie, Raymond prolongeait les heures de communion en une sorte d’action de grâce. Il écrivait à Simone, analysant subtilement les nuances de leurs sentiments et de leurs sensations, réveillant par ses mots et faisant revivre esthétiquement les gestes essentiels de la journée, mettant au point l’état de leur âme et de leur amour. Lettres de direction spirituelle, philosophique et sensuelle. Il y exposait aussi des doutes presque sincères afin qu’ils isolent rassurés, et il ne pouvait jamais atteindre la certitude d’être aimé. Simone répondait longuement à ces lettres, et c’était un véritable examen de conscience où l’on sentait que chaque mot avait été amoureusement pesé pour exprimer la fraîcheur et la sincérité de son émotion. Elle avait un peu peur de ces éclairs de conscience que les notes de Raymond projetaient en elle. Ce qu’elle voulait, elle, c’était perdre pied dans la divine inconscience de son amour et que Raymond ne soit plus qu’une partie d’elle-même.
Parfois Raymond allait visiter Simone en son petit appartement suspendu au-dessus d’un jardin dont les branches indiscrètes entraient par la fenêtre. Dès l’instant où il partait vers elle, une sorte de rayonnement enveloppait sa marche et il jouissait de la plénitude de son être physique associée à un état d’éréthisme mental. Dans sa pensée, il caressait à la fois la chair de Simone et les idées philosophiques les plus abstraites. Il avait aussi une telle assurance de trouver Simone en sève amoureuse qu’il ne se hâtait pas ; déjà les arbres, les feuilles, les fleurs, les branches de ce jardin traversé étaient un peu de ses gestes et de son parfum.
Et voilà qu’il regrette presque de n’être pas libre et de ne pouvoir capter le mystère de cette inconnue qui lui sourit et qui a pour lui déhanché sa démarche. C’est avec une sorte de regret qu’il regarde s’éloigner ce petit être blond, si mince avec les deux fruits trop lourds de ses seins…
Simone l’attendait. Elle avait mis à son corsage bleu, piqué, comme en une eau pure dans la blancheur de sa gorge, une rose rouge qui semblait une bouche déjà mordue et qui saigne.
Raymond s’assit près de Simone et, se penchant vers elle, il respirait le sous-bois de son corps. Ils parlaient des mots qui s’étouffaient sur leurs bouches mêlées et puis, tout à coup, la gravité du désir se marqua sur leurs visages. En silence et avec une hâte un peu brusque, ils s’étaient dévêtus, et, nus dans le soleil, couchés dans l’herbe courte du tapis, ils s’enfermèrent dans leur étreinte. Les cuisses, haut, levées, Simone semblait une Leda qui vient d’accueillir son Cygne.
Maintenant, elle jouait à le dominer et, le tenant couché entre l’étau de ses longues jambes, Simone interrogeait Raymond sur l’état de ses sentiments : elle se voulait aimée lyriquement et demandait à Raymond si parfois, lorsque seul il pensait à elle, sa pensée prenait la forme des vers…
— Je suis trop conscient de ce qui se passe en moi pour être poète, répondit Raymond. Il m’est impossible de m’endormir et d’atteindre cet état de somnambulisme nécessaire à l’art poétique. Non, même en amour, je ne puis me perdre, échapper à ma conscience qui enregistre mes émotions ou mes douleurs. Mes joies les plus sensuelles sont encore des joies intellectuelles et peut-être que ma plus grande volupté est de comprendre que tu es belle et qu’en m’aimant tu me divinises.
« Il m’est peut-être aussi plus doux d’être aimé de toi que de t’aimer. En t’aimant, Simone, c’est moi que j’aime, le moi que tu as idéalisé, celui que je désire être vraiment. L’amour qui nous retient le plus longtemps est celui qui nous fait découvrir notre plus beau visage. Et, si nous changeons d’amour, c’est pour nous découvrir chaque fois un peu plus parfaits, un peu plus semblables à des dieux. Parfois, des êtres nous aiment pour des qualités que nous n’avons pas. Alors, quelle reconnaissance ! et quel agrandissement ! quel enrichissement ! Nous devenons vraiment tels que l’amour nous a créés. L’amour est une création, Simone ; il est aussi une gestation, et, comme dans la gestation physiologique, là encore c’est la femme qui porte l’homme et son destin…
« Entre tes petites mains, Simone, je suis devenu celui que tu aimes : un être nouveau qui a surgi de ton cerveau et de ton cœur. Ma vie commence à toi : « au commencement était Simone » ; mon enfance elle-même s’enroule à ton corps et s’y parfume et je ne la perçois plus que comme une inquiétude physique et métaphysique, une attente intuitive de toi.
— Parle-moi encore, Raymond ; j’aime la musique grave de ta voix, et cette lumière qui bouge sur tes mots fait lever les pointes de mes seins et les papilles de mon cerveau…
Simone s’était agenouillée aux pieds de Raymond et avait posé sa tête sur ses genoux. Elle évoquait en elle-même les promenades inquiètes de sa jeunesse le long de l’allée des sycomores dont les grains à l’odeur âcre et sucrée tombaient sur ses épaules nues.
— Cette morsure de tes dents blanches, Simone ! cette contraction muette de ta bouche qui me parle et qui écoute monter le sanglot de mon désir…
Simone, les mains croisées sur sa poitrine, prolonge l’action de grâce, comme après les communions de son enfance ; sa béatitude physique se spiritualise : elle se sent si pure après l’amour !
En un mouvement de sentimentalité lyrique, voici qu’elle exprime à Raymond son regret de n’avoir pas su garder pour lui toute la virginité de son être. Mais Raymond la rassura : « La virginité est négative, lui répondit-il, et il faut lui préférer l’expérience. Les belles femmes sont comme des violons de marques qui se font et se perfectionnent à l’usage.
— Mais, ajouta-t-il en souriant, il n’est pas indifférent qu’ils aient passé entre les mains de bons violonistes ; il y a aussi des amants qui faussent les plus expressives sonorités amoureuses.
« Non, Simone : il ne faut rien regretter : la virginité d’une femme, ce n’est pour l’homme qu’une volupté cérébrale ou sentimentale : elle ne vaut pas la profonde sonorité des femmes faites par l’amour. Les jeunes filles n’ont pas encore acquis l’amplitude de leur respiration amoureuse, et il est rare qu’elles atteignent le sommet de la joie. Souvent même une femme n’est amoureusement mélodieuse qu’après la maternité.
— Je suis donc heureuse d’être mère, répondit Simone, pour t’aimer mieux.
— Tu es aussi pour moi un éphèbe, et ainsi, Simone, je te possède plus intellectuellement. Jouons au jeu des correspondances : écoute les accords de ta double sensualité. Oui, Simone, (et Raymond songeait à Rite qu’il avait si facilement persuadée de ce nouvel abandon d’elle-même), c’est la plénitude.
Et Raymond ne put s’empêcher de sourire encore, en entendant Simone prononcer presque la même phrase que Rite :
— Je suis encore plus tienne, Raymond.
Elle ajouta :
— Tu as raison, c’est l’accord parfait. C’est une sensualité qu’il faudra cultiver… Cette double participation…
Ils s’habillèrent lentement dans le soir, et puis comme s’ils éprouvaient le besoin de s’évader d’eux-mêmes, ils partirent dîner à Montmartre, en un petit restaurant italien de la place Pigalle, dont Raymond aimait l’atmosphère un peu exotique. Une manière aussi de voyages sans fatigue et sans longs regrets. De n’entendre parler qu’italien qu’il comprenait mal, Raymond se sentait plus intimement isolé auprès de Simone. Il y avait là quelques belles Italiennes, du type consacré par l’art. Raymond les contemplait, et il n’avait jamais si bien compris à quel point notre esthétique picturale, qui en est restée à ces modèles italiens, est peu représentative de notre race française ; et il se surprit à prononcer cet aphorisme :
— L’art est une invention italienne.
Mais il se souvenait aussi d’une remarque de van Gennep que « le type artistique n’est pas anthropologiste ». Les documents de peinture et de sculpture sont des déformations. On ne peut reconstituer les types des peuples anciens, Égyptiens, Grecs, etc., d’après les monuments peints ou sculptés. Les nègres qui ne sont d’ailleurs pas des primitifs se camouflent dans leur art où ils se veulent les lèvres minces, le nez droit, les cheveux lisses…, etc…
« C’est que l’art correspond à autre chose : à une sorte de bovarysme des races, à un idéalisme qui, par cette figuration, peut devenir une suggestion physique, presque.
« Notre art français, lui aussi, s’évade du réalisme. Les types de la peinture et de la sculpture évoluent en dehors de toute réalité. Mais ce sont les êtres réels qui tentent de s’adapter à ce style artistique, avec une obéissance et une souplesse admirables. Il n’y a qu’à se promener dans les musées ou à feuilleter des gravures de modes pour se rendre compte de ces mutations de forme (mutations brusques) que peut y prendre le corps humain. L’art ne suit pas la réalité, c’est lui qui la crée ; c’est lui qui sculpte la chair vivante et impose aux femmes la courbe de leurs hanches et de leurs épaules, la forme de leurs seins et jusqu’à la longueur de leurs jambes. Les femmes se sculptent elles-mêmes en pleine chair d’après le modèle que leur imposent les poètes et les artistes.
« Au point de vue philosophique, l’art apparaîtrait comme une sorte de guide instinctif de la sensibilité, un guide inconscient des races vers un type bovaryque qu’elles n’atteindront jamais. »
— Mais, écoutons, Simone, la volubilité musicale de ces conversations que nous ne comprenons pas. Ces Italiens parlent autant avec leurs mains qu’avec leurs lèvres ; et c’est peut-être pour cela que leur littérature, qui est une danse lyrique, est intraduisible en français.
— J’aime, disait-il, cette musique imprécise que vient encore étouffer le chant de ces guitaristes napolitains, qui se mêle au romarin des sauces épicées et au goût de terre chaude du lacryma-Christi.
— O Simone, je veux boire, à ta bouche, une gorgée de ces larmes du Christ, en un baiser où je boirai aussi un peu de tes lèvres.
Elle se pencha vers Raymond et lui donna encore le blanc paysage de ses seins dont les fraises érigées n’étaient pas retombées.
La musique s’était tue, amarrée dans le silence. Peu à peu, l’herbe couchée des conversations se releva et son bruit s’épandit comme le vent dans la chevelure des forêts, éparpillant dans l’atmosphère bleuie par la fumée des cigarettes, un peu de l’odeur secrète des femmes.
Raymond qui n’était pas insensible à cette communion dionysiaque et qui en alimentait son exaltation silencieuse savait bien que Simone y participait aussi, inconsciemment, et que tantôt, dans son jaillissement, elle lui verserait un peu de ces sensualités éparpillées.
La porte s’ouvrit : c’était le peintre Dufy qui venait de sa proche impasse de Guelma. Il s’assit près de Raymond et de Simone, et tout en dévorant l’amertume d’une tige de céleri, il leur conta son voyage en Sicile où, par ses peintures, il avait révélé la lumière aux peintres siciliens qui ne l’avaient jamais regardée en face. Sensible aux bonnes choses, il dégustait le parfum de feuille morte d’un vin piémontais et l’expression de sa bouche marquait qu’il prenait conscience de cette joie. En même temps, d’un geste automatique, dans la marge du menu, il fixait les visages qui l’entouraient. Voici Simone, dont le visage se résume en des yeux immenses, lumière voluptueuse ; et ce sourire des dents blanches qui semblent avoir fait saigner la sensualité de ses lèvres. Auprès d’elle, l’ardente tristesse de Raymond dont les cheveux tombent, toit de chaume, sur son front tourmenté, l’inquiétude de ses yeux et le croissant de sa bouche…
Simone voulut rentrer : elle était lasse de cet éparpillement d’elle-même. Le retour en voiture fut un silencieux blottissement, un long bouche à bouche, un agenouillement parfumé. Lorsque la voiture s’arrêta devant la porte, Simone alanguie demeura là, étendue sur les coussins. Raymond la prit dans ses bras, lourde de sa lassitude et de son désir, la porta jusque chez lui et l’étendit sur son divan. Alors, ouvrant les yeux, d’un geste silencieux et volontaire, elle attira Raymond et le coucha contre elle dans le duvetis froissé de sa robe noire qui faisait plus blanche la matité de sa chair.
— Non, ne m’abandonne pas, Raymond, implora-t-elle ; que notre oraison fuse en même temps sa lumière ; et, de ses deux longues jambes, gantées de soie nouées à la taille de Raymond, elle étouffait le cri de sa chair qui allait jaillir.
« Maintenant, Raymond, vêts tout mon corps du velours de tes lèvres et de la soie de tes mains. Pose encore sur ma chair que l’amour a glacée la brûlure de ton corps de jeune faune, et donne aussi à ma bouche qui tremble ton émoi résurgi. Pénètre dans mon baiser encore sonore des mots de mon amour.
— Vois, Simone, voici déjà le matin : son premier rayon vient dorer la nuit de tes aines et fait sourire les fraises de tes seins. Endors-toi, je te couvrirai de mon corps, et je veillerai ton sommeil, afin de ne perdre aucune image de ta beauté, aucun rythme, aucune respiration de ton être.
Simone s’était endormie. De son sommeil apâli montait une buée attiédie que Raymond respirait avec toute la sensibilité de son intelligence. Il savait aussi qu’il boirait ce recueillement de la nuit, ce rafraîchissement de son parfum dans le premier baiser du réveil.
En même temps qu’il s’abandonnait à son adoration du corps de Simone, Raymond souriait de cette mysticité sensuelle dont il enveloppait les secrètes architectures féminines : chair divine, draperie sur le squelette que l’on sent déjà sous le baiser.
— Décidément, songeait-il, je ne guérirai jamais de cette religion de l’amour, transposition de la religion de ma race et de mon enfance. Mais est-ce l’amour mystique qui est une transposition du sentiment religieux ? En réalité, c’est bien le sentiment religieux qui est une transposition de l’amour.
« Il y a de l’inquiétude dans mon adoration et comme une peur secrète que mon bonheur d’aujourd’hui ne soit ma dernière joie. Je contemple Simone comme si je voulais emporter son image en une éternité de solitude et de regret. Il y a toujours entre les amants qui s’aiment le plus absolument cette perpétuelle menace de redevenir subitement l’un pour l’autre des étrangers qui ne se reconnaîtront plus ; et c’est pour cela qu’ils se redisent perpétuellement une confiance qu’ils ne possèdent pas.
« Ce qui donne sa valeur à une femme, c’est peut-être cette incertitude où nous sommes de la stabilité ses sentiments. Dès que nous croyons avoir atteint cette certitude, l’amour nous semble une prison dont il faut s’évader ; et on s’évade. Quand on se sent aimé d’une façon vraiment absolue, que peut-on encore désirer ? Comme c’est le désir qui constitue la passion, on est désormais sans but dans la vie. On est semblable à l’alpiniste qui a enfin atteint le sommet de sa montagne : il contemple un long instant le paysage vers lequel tendaient tous ses muscles et le désir de ses yeux, mais son but est atteint : il n’y a plus qu’à redescendre.
« Oui, redescendre et rentrer chez soi, fermer sa porte et se feuilleter comme un livre. Alors, on s’aperçoit que les joies les plus réelles n’ont guère plus de réalité que celles que nous avons imaginées. Et, par association passive des idées et des souvenirs, Raymond évoquait à cette minute l’image d’une jeune femme rencontrée dans la rue et dont il avait suivi le sillage irrésistiblement.
« L’intensité de mon désir muet a imprimé si fortement en moi son visage qu’il me semble que cette femme entrevue fait partie de ma vie réelle et je lui parle quelquefois, le soir lorsque je suis seul avec mes fantômes familiers.
« Oui, se souvenait Raymond, je l’ai suivie jusqu’au seuil de l’église Saint-Sulpice où elle a pénétré dans la monotone psalmodie des vêpres. J’ai senti la vanité de ma chasse au bonheur et je suis rentré chez moi emportant pour émerveiller mes songes le trésor d’un désir qui ne se réaliserait jamais.
« Et pourquoi, du fond de ma mémoire, résurgit-elle en cet instant, l’ironie de cette vieille complainte oubliée que me chantait un vieux paysan, dans mon enfance !

« Et, parmi d’autres couplets, celui-ci encore, dont je ne me souviens peut-être que parce qu’il demeure associé dans mon imagination à l’image des roues du moulin de mon enfance, tournant au fond d’un grand trou « comme pour un supplice éternel » :
« Nous fuyons devant nos désirs, peut-être parce que nous ne sommes jamais très sûrs de notre sincérité. La voix de nos péchés (nos remords et nos regrets) nous poursuit et nous hallucine…
Ils s’étaient quittés après le déjeuner, et déjà Raymond songeait au rendez-vous du lendemain. Cette pensée qu’il retrouverait Simone à cinq heures allégeait sa journée qu’il emplissait de quelque travail littéraire, exécuté automatiquement. Cela n’était vraiment pas l’essentiel de sa vie.
— Encore quelques pages et j’aurai terminé, se dit Raymond, en épinglant à son article sur Stendhal une longue citation d’un stendhalien exalté et chaste. Mais il ne résista pas au plaisir de justifier sa propre paresse, en épiloguant sur la vanité de la gloire : « l’œuvre laissée par un écrivain est indépendante de lui, écrivait-il, et qu’importe, lorsqu’on est mort, d’avoir été Baudelaire ou Casimir Delavigne, Sainte-Beuve ou Paul Souday. »
Mais déjà Simone était là, ayant devancé l’heure du rendez-vous, et frustrant presque ainsi Raymond de cette petite angoisse de l’attente qui précise en nous le désir de l’amour.
Penchée sur l’épaule de Raymond, Simone lit la page commencée. Elle dit :
— C’est bien, cela… mais hâte-toi…
Raymond aimait cette présence qui l’attendait, avec une particulière impatience, aujourd’hui. Simone s’était déjà penchée plusieurs fois sur le bureau de Raymond pour voir s’il aurait bientôt terminé sa besogne, si vaine, pensait-elle, auprès du parfum vivant qu’elle lui apportait.
Lasse d’attendre, elle vint, un peu traîtreusement, debout contre la table encombrée de livres, appuyer son sein nu contre le visage de Raymond :
— C’est celui-là que tu aimes le mieux. Dis-lui bonjour… Vois comme il est sensible à ton hommage. Dis-lui encore que tu l’aimes… Écris-le… et puis signe !
Maintenant, Simone se dévêtait, amoureuse elle-même de sa blanche apparition dans la glace. Raymond contemplait ce nu de l’après-midi dans cette lumière déjà apaisée qui semble non plus frapper la chair mais émaner d’elle. Déjà il s’était levé et tendait ses mains vers les fragiles épaules de Simone, lorsqu’on sonna.
— Trois coups harmonieusement espacés, c’est Morangis, dit Raymond. C’est le hasard d’une promenade qui l’amène ; un autre hasard…
Mais comme prise d’une inspiration subite :
— Non, répondit Simone, fais entrer ton musicien, et en même temps, d’un geste rapide, elle s’était drapée, nue, dans son manteau.
Morangis n’apportait à Raymond que son affectueux silence ; d’ailleurs, il était trop timide pour parler sincèrement devant Simone qu’il connaissait peu, et dont l’aristocratique beauté le troublait. Raymond, instinctivement, s’était réinstallé à sa table, comme prêt à écrire des phrases définitives.
— Tu travaillais, dit Morangis qui ne put s’empêcher de sourire. Ce fut Simone qui lui répondit :
— Oui, Raymond voudrait finir son article. Laissons-le seul un instant… ou plutôt, entrez dans le petit salon et jouez-lui quelqu’une de vos dissonantes musiques : cela l’inspirera. Et moi, je resterai bien sage et silencieuse auprès de lui, à vous écouter en le regardant écrire…
« Et vous savez, ajouta-t-elle en le poussant doucement dans la pénombre, je vous enferme au verrou avec l’harmonie de vos songes.
Puis, s’emparant de Raymond, elle lui dit tout bas :
— Toi…, toi, tout de suite…
« Cette musique, Raymond, scande le silence de nos baisers et le rythme de mon offrande, que tes yeux guettent comme une proie. Le désir de tes yeux monte et soulève ma chair hypnotisée… Tu as enjambé mon corps comme le tronc couché d’un hêtre abattu… Tes mains me rivent à toi et notre communion est une onctueuse prière… Bois à ma bouche la respiration de mon être.
Mais d’un baiser où il avait emprisonné les lèvres de Simone, Raymond éteignit le cri qui allait fuser de sa joie.
… Simone, pure comme une petite fille qui vient de se réveiller, s’est étendue sur le divan aux coussins honnêtement rangés et fume une rêveuse cigarette. Délivré, Morangis entra. On le complimenta sincèrement et Simone ajouta qu’elle avait été troublée par la ferveur de cette voluptueuse improvisation.
— Je pensais à Marthe, répondit-il. Et il y avait une telle émotion dans ses yeux et dans sa voix que Raymond se contenta de sourire intérieurement de cette sorte de collaboration posthume de Marthe à ses émois.
— Oui, continua Morangis, elle est ma perpétuelle passion, et je ne puis la chasser de ma vie ni de ma pensée. Ma vie, une solitude enivrée de son orgueilleuse tristesse. Se savoir seul, à l’abri des inutiles sympathies, seul avec cette obsession d’un être qu’on ne retrouvera jamais et qui est en nous la seule émotion vivante : une présence perpétuée.
— On ne combat victorieusement, dit Raymond, que les passions qu’on n’a pas ou qu’on n’a plus. Plutôt que de combattre ses passions, Morangis, il faut les cultiver, comme tu le fais, car c’est notre plus grande richesse, une richesse dont la plupart des hommes sont pauvres. Rien n’existe qu’associé à une ferveur sentimentale, et l’amour est peut-être notre plus réelle méthode de connaissance, lorsque nous savons le dominer intellectuellement. Je reste fidèle à cette vieille idée platonicienne du perfectionnement moral de l’être par l’amour. Il faut rejeter le bas moralisme chrétien qui confond l’amour et la procréation. L’amour est une culture de soi. C’est pour cela qu’il y a une noblesse mystique dans les amours saphiques des Renée Vivien, associées à la poésie, à la philosophie, à l’inquiétude religieuse. Il y en a une aussi dans les amitiés sexuelles masculines, lorsqu’elles sont un désir de perfection sentimentale.
« Mais je ne suivrai pas les Grecs sur ce chemin du divin, qu’il ne nous est pas interdit de trouver chez la femme, ajouta Raymond, en jetant à Simone un regard de tendre complicité.
« L’amour est vraiment notre œuvre d’art intime, et c’est dans cette idée que je mets la morale la plus haute.
« La conception chrétienne de l’amour : cette restriction de l’être et cette domestication des sentiments dans le mariage, est une pure immoralité. Tout sacrifice est une lâcheté, et l’être qui n’est pas notre joie, notre sérénité passionnée est un ennemi que nous devons chasser de notre vie.
« Mais, rectifia Raymond, il y a dans l’union de deux êtres qui se sont associés pour la vie, quelque chose de plus qu’un sentimentalisme sensuel : une sorte de tendresse incestueuse, plus forte que la sensualité et capable de résister à toutes les désillusions de l’étreinte matrimoniale. Si une femme « trompe » son mari, c’est parce qu’elle l’aime. Si elle ne le « trompait » pas, elle se « tromperait » elle-même, et c’est alors qu’elle le « tromperait » réellement lui-même.
« A ce sujet, la psychologie du théâtre et du roman est puérile, et la vie est bien plus compliquée que cela.
« Même morte, et surtout peut-être parce qu’elle est immuablement morte, Marthe est ta femme, Morangis. Et tu ne la trompes que pour revivifier en toi les souvenirs de votre amour…
— Et moi, répliqua Simone, je ne suis donc pour toi, Raymond, qu’une vivante reviviscence de tes premières amours…
— Non, Simone : c’est toi qui es ma femme ; les autres femmes que j’ai aimées ne furent que des préfigurations de ta divinité. Et, lorsque tu m’auras quitté, celles que j’aimerai encore, ne seront plus que de pâles images de ton éternité…
Après un moment de silence qu’il sentit peser comme un baiser sur les épaules nues de Simone, Raymond, amusé de son paradoxe, continua :
— Tu es si essentiellement ma femme, Simone, que je n’ai jamais désiré de toi un enfant. Car, l’enfant, c’est ce qui dissocie les amants. C’est le mystère de l’incarnation par lequel les dieux se diminuent. Que notre amour demeure une fleur perpétuelle, sans autre but que d’être un égoïste parfum…
« N’est-il pas beau et consolant aussi de pouvoir se dire que notre race fleurit en nous sa fleur suprême et que nos gestes d’amour se suffisent à eux-mêmes et ne veulent d’autre signification que leur propre beauté.
Simone s’était levée : devant la glace, sous le bras de la Bacchante de marbre auquel elle avait suspendu son chapeau, son bâton de rouge au bout des doigts, elle avivait le sang de ses lèvres :
— Il faut que je parte, Raymond, dit-elle, en se tournant discrètement vers Morangis, dont elle trouvait désormais inutile la musicale présence. Elle se voulait seule avec Raymond pour le dernier regard qu’on emporte ; Morangis comprit et sortit, silencieux.
— A ce soir chez Madeleine, lui glissa Raymond en le reconduisant jusqu’au seuil.
Debout, Raymond serra Simone contre lui, ses deux mains écrasant la petite croupe dionysienne.
— Oh ! Raymond, dit-elle tout à coup, inquiète ; et souriant d’un sourire qui était déjà une mystique morsure : « Je ne veux pas te laisser si orgueilleux… »
Ses cheveux s’étaient dénoués, épandus sur son front et sur ses épaules : à genoux, elle enferma sa prière dans ce secret.
Demeuré seul dans une sorte de rayonnement ébloui qui peu à peu s’était endormi, Raymond assis à sa table écoutait le rythme de ses songes. Toute la chair blanche de Simone neigeait sur ses pensées.
— Tu es, disait-il, la neige de mon enfance.
Sur une feuille bleue, sur laquelle Simone, en se dévêtant, avait jeté la rose rouge de son corsage, il écrivit :
Fidèle au rendez-vous qu’il s’était donné avec Morangis, Raymond vint ce soir-là sonner à la porte de Madeleine. On l’attendait.
Raymond était demeuré pour Madeleine l’amant de son intelligence, et c’était une empreinte indélébile. Et si Morangis se sentait attiré vers Madeleine qu’il visitait maintenant quotidiennement, c’était, sans qu’il s’en doute peut-être, leur double imprégnation des pensées de Raymond qui créait leur fraternité. Leur mutuelle tendresse pour le jeune Dionys ajoutait encore à ce lien moral, une sorte de secrète complicité sexuelle. Ainsi Dionys se trouvait être à la fois le complément sensuel et sentimental de Madeleine et de Morangis : un peu une femme pour Madeleine cérébralement virile, un peu un homme pour Morangis, artiste à la sensibilité féminine.
Élevé dans cette atmosphère de double adoration, Dionys prenait de plus en plus conscience de sa divinité, et se laissait aimer passivement, comme tous les dieux.
— Pourtant, réfléchit Raymond, en amour, c’est celui qui aime qui est le vrai Dieu, car c’est lui qui impose sa volonté, son sentiment, sa création d’un monde. Celui qui se laisse aimer est l’esclave…
Après quelques paroles de banalité affectueuse Raymond retomba dans son monologue interrompu, qu’il sut accrocher à la conversation commencée.
Madeleine pensait aussi que c’était celui qui aimait qui était le maître :
— Être aimé, dit-elle, c’est, en effet, tomber dans un décor étranger, sous les feux d’une lampe magique qui nous transforment, nous métamorphosent à nos propres yeux.
— Oui, continua Raymond, ce qui nous réjouit, en amour, c’est la sensation de notre puissance : faire jaillir d’une femme la plus grande volupté, lui imposer notre joie, mais surtout peut-être nos sentiments, nos jugements… La sensualité est plus cérébrale que physique, et notre volupté consiste davantage à décrocher l’exaltation d’une femme qu’à nous griser d’un vertige physique si fugitif.
« Chez certaines femmes aussi la sensualité se cérébralise, et c’est ce qui distingue les lesbiennes des femmes dites normales. Comme les hommes elles mettent leur volupté à vouloir donner de la joie et non plus à la subir ; elles veulent prendre au lieu de se donner. Les vraies lesbiennes dédaignent les passivités de l’amour.
— Cela se comprend, observa Morangis, puisque, dit-on, elles sont douées d’un bourgeon de virilité…
— Celles-là, reprit Raymond, ce sont les tribades, mais l’espèce en est fort rare. Non, la lesbienne n’est pas un être hybride, physiologiquement : elle est une pure femme, mais une femme qui conçoit la sensualité d’une façon virile, et la transpose cérébralement comme les hommes. Je me souviens des confidences indiscrètes que me fit sur ce sujet une jeune lesbienne qui n’avait plus de secrets, même physiques, pour moi. (Les lesbiennes passives ne dédaignent pas du tout les hommes un peu féminins dont la virilité, même excessive, ne les brutalise pas.) Celle-ci était aimée, à l’époque de cette confession, d’une Muse célèbre, célèbre surtout peut-être pour la rigueur de ses principes saphiques, pour l’orthodoxie de son dogme : jamais, en effet, aucun homme n’avait pénétré ni dans son cœur ni dans sa chair.
« Elle m’évoquait cette Muse nue dans sa nudité d’éphèbe, et, ceinte d’un olisbos, se précipitant vers elle, de toute son ardeur artificiellement inépuisable ! « Elle me violait encore des mots et des baisers de sa bouche, du désir de ses mains et de ses yeux, et, se réjouissant de ma craintive défaillance, me torturait sans pitié de l’orgueil factice, dont elle était armée. Triste possession qui ne me possédait pas. Je la revois lasse et découragée, ayant jeté loin d’elle sa ceinture virile et s’abandonnant enfin à mes reposantes caresses.
— C’est là vraiment, dit en souriant Madeleine, une forme imprévue du bovarysme…
— Oui, Madeleine, répondit Raymond, une forme d’un bovarysme physiologique, par lequel ces femmes se conçoivent hommes. Elles sont des hommes. Il y a des hommes qui se conçoivent femmes ; et ce sont vraiment des femmes.
Ils parlèrent ensuite d’eux-mêmes avec discrétion. Raymond ne faisait jamais de confidences à personne ; Madeleine, en toute pureté, s’abandonnait aux spontanéités de ses instincts et de ses passions, se faisant une morale de sa sincérité. Quant à Morangis, il trouvait dans les paroles de Raymond un assentiment à ses curiosités sensuelles. Dionys, blotti dans la robe de Madeleine, écoutait sagement en fumant de blondes cigarettes.
Chaque soir, lorsqu’il abandonnait Simone, Raymond lui remettait une petite lettre bleue, qui était comme la mise au point de leurs sentiments et de leur amour, un éclair de conscience que le lyrisme des mots atténuait.
Il sentait bien, au fond de lui-même, que ces écritures étaient une faiblesse et comme l’aveu d’un doute maladif, mais il ne pouvait résister à ce besoin de s’analyser et de fixer, pour une éternité illusoire, l’essentiel de leurs gestes et de leurs sentiments :
— C’est ma vie que je compose, pensait-il : c’est aussi physiologique que pour les abeilles la fabrication de leur miel… Sans l’agglutination de ma salive mystique, que serait le parfum de Simone ?…
« On n’écrit, pensait-il, que ce qu’on n’a pas complètement vécu, épuisé : c’est un prolongement des rythmes, des accords et des images : une création d’art. Aussi un état de désir cultivé : Je veux que ces heures de solitude soient baignées dans l’érotique mysticité de mes mots, qu’ils s’enroulent à elle comme des bras, qu’ils s’écrasent sur sa chair comme des baisers. Je veux que ma présence lui soit une obsession, qu’elle m’évoque parmi la tentation de mes livres dont elle fut un instant jalouse. Mais je la sais rassurée : elle sait maintenant que mes livres dorment dans leur poussière de pensée morte et que je ne les ouvrirai pas.
Un matin, parmi les lettres, les journaux et les papiers de son courrier, Raymond découvrit une nouvelle lettre de Rite. Il avait déjà fait le geste de la jeter dans les limbes où dormaient les autres messages de l’exilée, mais il songea que maintenant il se sentait assez affermi dans son sentiment pour Simone et qu’il pouvait sans danger de dispersion sentimentale, écouter la plainte de Rite et dérouler le film de ses dernières semaines. Commençant par la première lettre, il suivit donc la graduation de l’inquiétude de Rite jusqu’au point mort d’une sérénité découragée. Elle était enfin revenue près de son mari : « Maintenant que tu es loin et silencieux, c’est auprès de lui que je te retrouve, écrivait-elle, nous vivons en toi, et cette communion fait l’harmonie douloureuse de notre vie. » Mais sous ces mots qui semblaient accepter la cruauté de son destin, il y avait un cri d’appel auquel Raymond ne put résister. Il était ému, plus qu’il ne voulait se l’avouer, de la constance de cet amour et de cette divinisation de lui-même. Il profita donc d’un après-midi où Simone ne devait venir qu’à six heures pour donner un rendez-vous à Rite, en un petit coin de souvenirs où ils s’étaient jadis réfugiés un jour d’orage.
Rite est là debout dans cette chambre d’hôtel, son geste d’accueil replié par l’émotion. Ses lèvres tremblantes s’ouvrent et elle ne peut parler. De son visage immobilisé en un sourire grave et douloureux tombent ses larmes. Raymond s’est approché d’elle et la serre silencieusement contre lui. Il a posé sa tête sur le cœur de Rite qui sonne comme une cloche sous la blanche coupole de son sein. Puis tout à coup leurs bouches se sont cherchées et jointes et ils se boivent en fermant les yeux. Ils ne s’arrachent à l’obstination de ce baiser que pour se mêler dans leur nudité retrouvée. La chair de Rite frémit comme un violon sous la main de Raymond et ses larmes se mêlent à l’onction de sa joie. Enfermé dans le vertige de cette musique parfumée, Raymond, accroché aux genoux haut-levés de Rite se sent le divin rameur de cette barque dorée, que chacun de ses mouvements soulève au-dessus des vagues, au-dessus des songes. Fuir, se fuir, plus loin encore de soi-même et des fantômes du souvenir. En pleine mer. En pleine solitude.
Raymond n’avait peut-être jamais encore si lucidement compris la solitude où nous élève la communion sensuelle. Rite avait senti, elle, que la douleur des jours d’angoisse et d’attente aboutissait à cette heure dont le rayonnement abolissait le passé. Elle vivait dans un présent qui se prolongeait indéfiniment dans l’avenir. Elle ne songea même pas à interroger Raymond sur sa vie de l’absence, et lui-même, ne voulut pas, par de vaines paroles, réveiller des tristesses endormies.
Il se souvint seulement tout à coup que Simone l’attendait, et qu’il lui fallait partir. Malgré les effusions de sa tendresse sensuelle, Simone était encore pour lui l’incertain, donc l’amour. Rite ne comprit pas la cruauté de ce départ précipité dont Raymond atténua l’amertume par la langueur prolongée de son adieu :
— Nous nous sommes retrouvés, Rite, parce que nous ne nous sommes jamais perdus.
Simone, un peu fiévreuse, attendait Raymond. Il la surprit penchée au-dessus de l’escalier et l’ayant aperçu montant les marches elle était rentrée subrepticement chez elle, en refermant silencieusement la porte sur son inquiétude rassurée.
— Elle m’aime donc, se dit-il, puisqu’elle m’attend avec impatience. Mais je ne suis peut-être pour elle que l’eurythmie de sa chair et de sa sensibilité. Les hommes s’enorgueillissent d’être l’amant d’une belle femme. Ils ne sont souvent pour elle que cela : le régulateur de leur horlogerie sensuelle.
Raymond s’agenouilla près de Simone, étendue sur son divan : ses lèvres suivaient rêveusement la ligne de ses bras nus, qu’il souleva pour boire déjà un peu de son parfum secret, au creux de ses aisselles. Un peu de l’odeur de Rite se mêlait à sa rêveuse aspiration…
Mais Simone avait pris la tête de Raymond entre ses mains.
— Il y a ce soir, lui dit-elle, une lumière ardente dans tes yeux et sur ton visage. Je sens que tu m’aimes.
Et toute émue, elle baisa longuement la lumière des yeux de Raymond. Son baiser descendit vers sa bouche, s’y scella dans une respiration de toute sa chair ; et déjà la plainte de Simone montait dans la nuit qui les isolait du monde. Mélopée douloureuse qui semblait se déchirer, s’ensanglanter au thyrse sacré, et qui ne s’éteignait que pour résurgir, inlassablement.
La fatigue nerveuse, ainsi qu’un alcool, avivait la ferveur de Raymond, et Simone troublée de la perpétuation de ces accords sensuels, s’exaltait : de son âme jaillissait la spontanéité jusque-là réfrénée de ses mots et de ses sentiments.
— Tu n’as donc pas compris que je t’aime, Raymond : que je m’abandonne toute à toi et que je mets dans mon amour toute la religiosité de mon enfance. Je baise ton corps comme jadis, petite fille, je venais baiser les plaies sacrées du Christ. Mais le Christ, tu me l’as dit, était un peu comme André Gide : il aimait mieux les hommes que les femmes. Je lui en veux de s’être laissé aimer par Madeleine et de ne lui avoir donné en retour que le mensonge d’un songe.
— Qui sait ! Simone, répondit Raymond, en rêvant à cette image du fils de Dieu en exaltation sensuelle ; l’orgasme divin…
Mais Simone ne sourit même pas à cette évocation un peu blasphématoire.
— Laissons le Christ et ses amours incertaines, dit-elle un peu brusquement : il s’agit de nous et de notre amour… Oui, je sais, Raymond, ton insatiabilité toujours tourmentée épuise mon âme et ma chair…
« Ma mort seule, ajouta-t-elle un peu tristement, te guérirait peut-être de ce doute perpétuel que tu sembles cultiver en toi comme une plante empoisonnée. Même à cette minute où mes mots te supplient et pleurent leur sincérité, tu ne me crois peut-être pas encore. Mais je veux que tu me croies, Raymond, parce que je ne puis plus porter seule le secret que jusqu’à ce jour je t’ai caché pour ne pas t’inquiéter : je préférerais mourir que de te faire de la peine, mais en vérité je ne puis plus supporter l’injuste douleur de ton doute.
— Quel secret, Simone ? interrogea Raymond avec angoisse. Réponds-moi…
Elle se recueillit un instant, et comme hallucinée par sa propre pensée :
— Non, je ne veux pas te quitter une fois encore… Je ne peux pas, je ne peux plus vivre loin de toi… Si je meurs, Raymond, ce sera près de toi, clouée à ta chair comme à une croix, en me brûlant à ton désir et à ton amour…
— Quoi ? Simone, me quitter, mourir… tu me rends fou ; que veux-tu dire ? Nous nous aimons : nous ne nous quitterons jamais… jamais plus.
Et, en disant cela, Raymond avait déjà vécu la ferveur éternisée que lui offrait Simone.
— On veut nous séparer, Raymond, répondit-elle. On veut nous séparer pour que je vive… On veut m’arracher à mon divin bourreau… C’est toi le « bourreau », expliqua-t-elle, en souriant dans ses larmes.
« Écoute, et pardonne-moi la peine que je vais te faire, si tu m’aimes…
Simone avoua alors à Raymond l’état de fièvre dans lequel elle vivait depuis quelques mois, et qui souvent la faisait défaillir.
— Malgré ces faiblesses de ma chair malade, je n’ai jamais voulu me priver de venir vers toi. Tu te souviens de ce soir où je m’étais évanouie dans la voiture qui nous reconduisait chez toi et où tu me portas dans tes bras jusque sur ton divan ? O, Raymond, ce soir-là, je me suis donnée à toi avec un tel désespoir que j’aurais voulu mourir dans ton étreinte. Je savais que j’étais condamnée…
— Que dis-tu, Simone, condamnée…
— Oui, condamnée, Raymond, puisque je ne voulais pas te quitter ; je ne voulais pas obéir à mon médecin et partir — seule, ordonnait-il, — vers le soleil de la Corse ou de l’Algérie ; tout de suite.
« Ainsi, ajoutait-elle gravement, je te donne ma vie, Raymond, et lorsque je serai morte, je demeurerai à jamais dans ta pensée, associée à toute ta vie… Cette idée cruelle de la mort m’est maintenant presque douce, car je t’aurai moins perdu que si tu partais, si tu me quittais…
Raymond ne sachant comment exprimer son émotion par des mots, prit Simone contre sa poitrine, baisant ses yeux mouillés, buvant ses larmes : « Ma petite fille, répétait-il, ma petite fille. Non, ce n’est pas vrai… Je veux que tu guérisses, pour nous. Notre vie sera belle puisque nous nous aimons avec une si merveilleuse plénitude. »
Il se souvenait maintenant des défaillances de Simone dont il n’avait pas voulu s’inquiéter ; ces états de fièvre ne la rendaient-elle pas plus amoureuse, plus passionnée ? Et lorsque parfois elle s’était évanouie dans la détente de sa chair, Raymond avait admiré cette pâleur fervente immobilisée dans son étreinte. Maintenant qu’il comprenait l’héroïsme de Simone, il la trouvait plus belle encore, martyre de son amour, et, jamais plus fervemment qu’à cette minute, il n’eut le désir de posséder cette Simone nouvelle qui lui avait clamé son amour désespéré.
— Ne doute pas de moi, non plus, Simone, lui répétait-il, en l’écrasant toute contre lui : tu sais que je mourrais de ta mort…
— Il faut vivre pour moi, ajouta-t-il, pensant, dans la sincérité de son orgueil, que c’était là l’argument le plus convaincant.
Il lui parla longuement à voix basse, la caressant de ses lèvres, de ses yeux, de ses mains, de ses pensées, de ses désirs et de la musique de sa voix, jusqu’à ce que calmée et persuadée de l’indissolubilité de leur amour, elle promit à Raymond qu’elle partirait, qu’elle guérirait.
En une sorte d’hallucination fiévreuse et illuminée, elle voyait et déroulait devant eux le film de leur vie, associée désormais dans toutes ses minutes : elle avait confiance maintenant dans la vie, au moment où peut-être elle allait s’en évader.
Avec une grande lucidité et une subite volonté ardente de vivre, elle organisait les jours, les mois de l’absence, qui seraient une mutuelle et perpétuelle prière, une communion plus profonde de leurs pensées : la réelle identification de leurs deux êtres.
— Et puis, ajouta-t-elle, déjà revenue en pensée près d’un Raymond immuable dans son amour ; et puis, lorsque je serai un peu guérie, un peu sauvée, Raymond, je te ferai signe…
En prononçant ces mots, ses mains pâles faisaient dans l’air le geste d’appel qui rappelait Raymond. Debout dans sa fragile nudité, elle semblait une petite victoire, perçant le destin de la pointe rouge de ses seins.
— Oui, Raymond, je te ferai signe de toute mon âme, de toute ma chair blanche, agitée comme un drapeau dans le soleil. Tu viendras me prendre dans tes bras, et tu me porteras encore, évanouie dans mon émoi, vers la brûlure de ton amour. O, Raymond, je fondrai en toi comme une neige de tendresse accumulée… Oui, je serai encore ta neige parfumée !
Maintenant, Simone avait hâte d’être partie, d’être là-bas dans la brûlure du soleil de Corse qui la guérirait. Le départ, c’était déjà un peu le retour, et en le quittant, c’était encore vers Raymond qu’elle partait, vers ce Raymond définitivement conquis, par delà les inquiétudes et les doutes.
Il y avait, à l’heure de l’adieu, une profonde sérénité dans le désespoir de Simone ; mais Raymond, penché sur la main qui échappait déjà à ses lèvres, eut tout à coup cette impression que son amour s’était immatérialisé, et que désormais il le porterait en lui comme une hostie.
FIN
ACHEVÉ D’IMPRIMER POUR LE COMPTE
DES « ÉDITIONS DU SIÈCLE », ET PAR
LES SOINS DE L’IMPRIMERIE FRANÇAISE
DE L’ÉDITION, A PARIS, LE PREMIER
DE DÉCEMBRE MCMXXV
LES ROMANS DU SIÈCLE
Dans cette nouvelle collection de romans qui constitue, à nos yeux, une sélection résolument littéraire, indépendante de tout souci commercial, nous nous engageons à ne publier que des ouvrages très remarquables. Nous désirons que tous les genres y soient représentés, du roman psychologique au roman lyrique, par des œuvres que nous prétendons imposer uniquement en considération de leur valeur. C’est dire que nous nous adressons d’emblée à cette élite d’amateurs très lettrés de France et d’Europe qui depuis toujours assure le succès des vrais écrivains. C’est sur cette élite que nous comptons.
| No I. | — Jacques Reboul : Le Cavalier et la Mort | 7 50 |
| No II. | — Paul Vimereu : Saint Remi écoute | 7 50 |
| No III. | — Alfred de Tarde : Allegra ou le Clos des Loisirs | 7 95 |
| No IV | — Louis Thomas : L’Espoir en Dieu | 7 95 |
| No V. | — Henri de Ziégler : Les deux Romes | 9 » |
| No VI bis. | — Jean de Gourmont : L’art d’aimer | 9 » |
| A paraître : | ||
| No VI. | — Jean de Gourmont ; La Toison d’or. | |
| No VII. | — Robert d’Humières : Lettres volées. | |