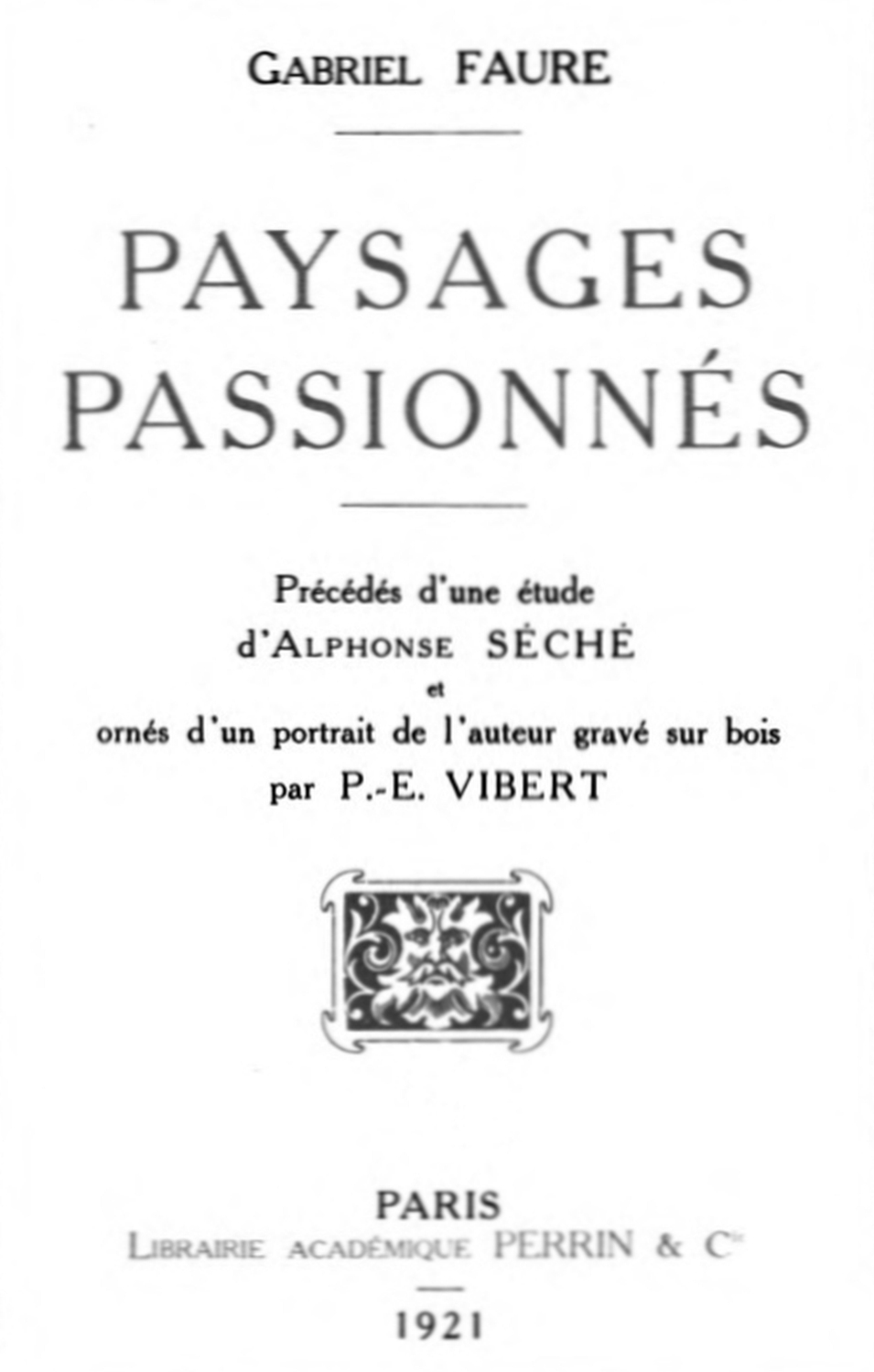
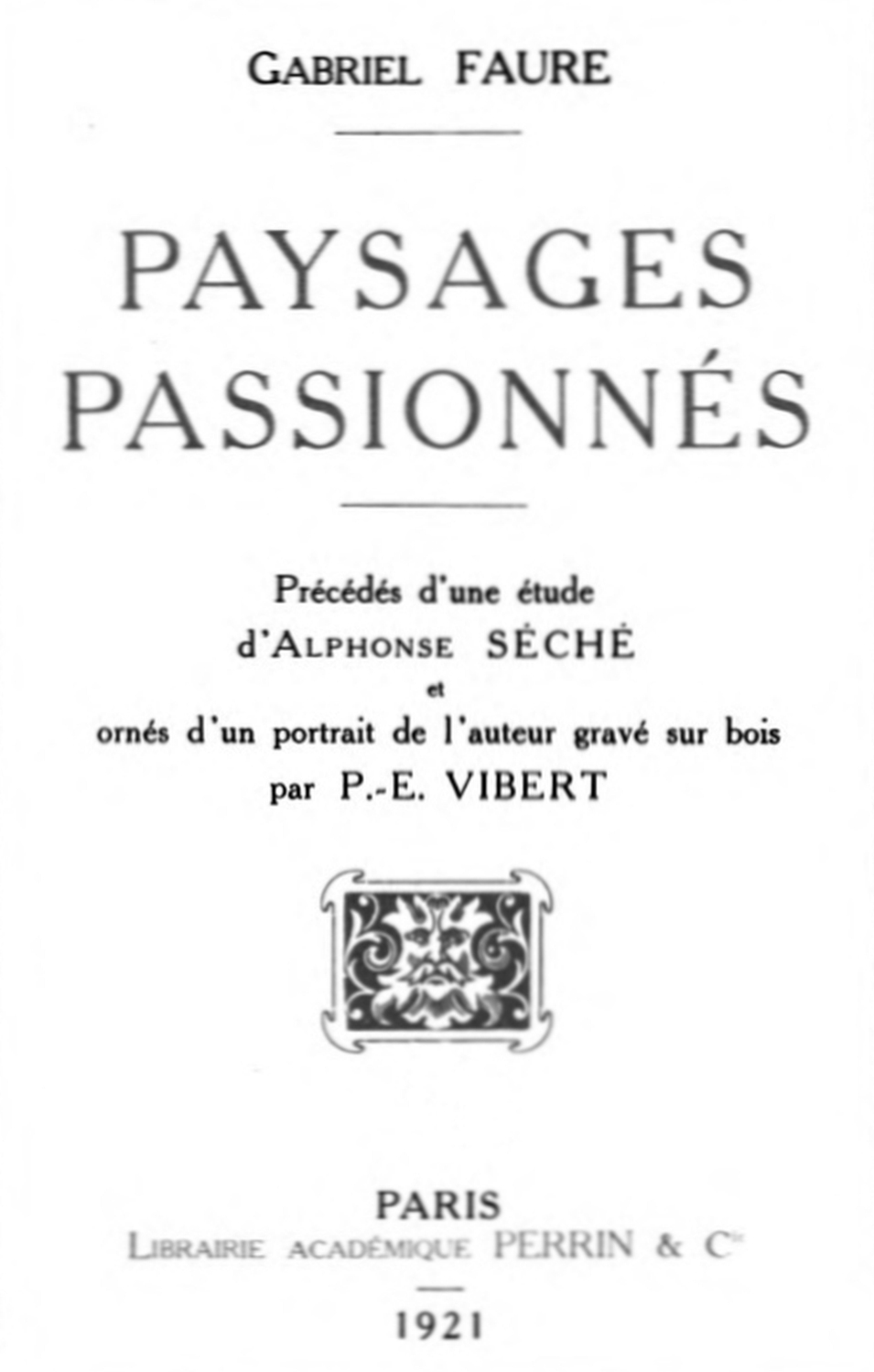

Note de l'éditeur
Gabriel Faure, paysagiste littéraire, par
Alphonse Séché
PAYSAGES PASSIONNÉS
I. À travers Lesbos
II. Le pays de Tristan
III. Cimetière italien
IV. Matin en montagne
V. Les jardins de Bellagio
VI. Souvenirs d'enfance
VII. Avec Stendhal à Parme
VIII. Le soir tombe sur l'Adriatique
IX. La maison de Titien
X. Le rossignol attardé
XI. Le printemps à Tolède
XII. Le village de Pétrarque
XIII. Les jardins de Châlons
XIV. Le long de la mer annunzienne
XV. Les soirs de Sienne
XVI. Pâques dauphinoises
XVII. Paysages musicaux
XVIII. L'automne à Nohant
XIX. Sur la tombe du Tasse
XX. Les roses d'Assise
XXI. Sur la terrasse de Valence
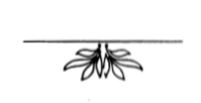

En 1909, parut, sous le titre de PAYSAGES PASSIONNÉS, un recueil de morceaux choisis de GABRIEL FAURE. Ce volume étant depuis longtemps épuisé, il nous a paru intéressant de donner, sous ce même titre—qui convient si parfaitement à l'œuvre de l'auteur—un choix de textes plus complet, portant sur l'ensemble des ouvrages publiés par GABRIEL FAURE pendant vingt années de vie littéraire (1900-1920).
Une étude—un portrait littéraire plutôt—de M. ALPHONSE SÉCHÉ, parue dans la MINERVE FRANÇAISE, ouvre ce volume, à la fin duquel on trouvera les notes bibliographiques concernant chacun des fragments publiés.
P. P.

Je ne puis lire un livre sans avoir le désir de connaître son auteur. Il ne m'est point possible de séparer l'homme et l'œuvre; dans celle-ci, je cherche son créateur; sans que j'y mette un calcul, elle m'intéresse en fonction de celui qui la fit. L'œuvre est pour moi un document humain et, quoiqu'elle lui survive, c'est l'homme qu'elle exprime qui me passionne.
Mais, dira-t-on, n'ignorons-nous pas le nom du statuaire qui sculpta la Vénus de Milo? Qu'importe, puisque nous avons la statue! J'en conviens; j'aimerais cependant savoir de quelles mains elle fut taillée. Serait-elle plus belle? Non, sans doute; mais, je le crois, sa beauté aurait quelque chose de moins archéologique; le souvenir de l'artiste animerait ses lignes et les humaniserait: moins divine, peut-être, elle serait plus femme. Elle ne vaut pas uniquement par l'harmonie de ses formes, elle est encore représentative du génie humain et du type de beauté d'une époque. J'aurais voulu posséder le nom du glorieux mortel capable de concevoir un tel type et de le fixer à jamais dans la splendeur du marbre.
Les fines statues de Jean Goujon me sont plus chères de ce que leur auteur m'est connu. En les regardant, je l'évoque; j'imagine le modèle et lui-même. Voilà quelles femmes il aimait; elles avaient su fixer l'idéal d'un aussi grand artiste. Comme cela me les rend proches d'avoir ainsi la faculté de vivre par la pensée en leur compagnie, en la compagnie de leur sculpteur et de cette société du XVIe siècle, si raffinée, dont les œuvres de Jean Goujon ont la grâce et l'élégance.
Littérairement, les vers des Regrets ne gagnent rien en perfection, du fait que la vie de du Bellay m'est familière; pourtant, parce qu'il m'est loisible de suivre Joachim dans cette Rome qu'il stigmatise et où il s'ennuie de son petit Lyré, ses sonnets ont, me semble-t-il, un attrait qu'ils n'auraient pas si j'ignorais tout du poète.
Les Nuits m'émeuvent d'autant plus que je sais la source de l'immortelle douleur qui s'y épanche.
Si cela est vrai d'un poème, d'une œuvre d'imagination, à plus forte raison l'est-ce d'un ouvrage où l'écrivain se place au centre de son livre, où sa personnalité et sa personne apparaissent à chaque page. Est-ce la Ville éternelle ou Stendhal que nous venons découvrir dans les Promenades dans Rome? Lisons-nous l'Itinéraire pour ce qu'il rapporte de contrées illustres et sacrées que nous ignorons? Nous ouvrons surtout ce livre à cause de la grande beauté de son écriture; nous l'ouvrons aussi à cause de son auteur: nous voulons voir "l'attitude" de Chateaubriand sur la terre des Hellènes et sur la terre d'Égypte; nous allons du pas de René vers l'Acropole et vers Jérusalem. "C'est la jeunesse de la vie, ce sont les personnes qui font les beaux sites," dit-il. Pour Chateaubriand, l'objet le plus captivant d'un site était lui-même. En face du plus magnifique spectacle, il ne s'oublie pas; il est comme la raison d'être de ce qu'il contemple, car rien pour lui n'existe, qui n'a lui-même pour conscience. Les hommes de sa race ont moins la faculté d'admirer que celle d'analyser, pour l'exprimer, l'émotion qui leur vient de la contemplation des œuvres de l'homme ou de la divinité. Tout leur est prétexte à exaltation; rien n'a d'importance que relativement à leur exaltation. N'est-elle pas le moyen de leur génie! Quand nous les lisons, c'est donc eux-mêmes que nous découvrons; les paysages dont ils nous entretiennent ont la couleur de leur pensée et de leur âme. Si l'homme nous est étranger, ces paysages perdent toute signification, puisque nous ne possédons pas la clef qui nous les rendrait pénétrables.
*
* *
Qui connaît Gabriel Faure lit ses ouvrages sans surprise, et, chose infiniment précieuse en l'espèce, il leur donne aussitôt sa confiance. Au moral, au littéraire, il s'accorde pleinement avec ce qu'il est en façade.
Ni petit ni grand, trapu, robuste et alerte à la façon d'un paysan qui s'en revient du marché poches sonnantes, les cheveux poivre et sel, hauts et drus, le front large, les yeux clairs, doux et malicieux, la bouche charnue, souriant sans contrainte sous la moustache déjà grisonnante, le nez solidement enté et de bonne greffe, il se dégage de toute sa personne une réconfortante impression d'intelligence ordonnée et de santé heureuse dues, l'une et l'autre, à un équilibre parfait de saines facultés. Regardez cette figure où le soleil rit sous la peau: pas d'accent violent, mais tout y est en place, harmonieux et fort. L'excessif, ici, n'est pas reçu. Aucune nervosité, pas de complications. Gabriel Faure a la franchise intellectuelle de sa poignée de mains et de son regard qui se pose voluptueusement sur les choses.
Ni sa mise, ni son front construit d'un rude ciment, ne dénotent beaucoup de fantaisie. On serait étonné qu'il fût d'esprit aventureux, bohème ou rêveur, j'entends chimérique. On le sent confortablement installé en ses vêtements, en sa chair, en ses idées, en son âme. Il est là bien d'aplomb sur son domaine qu'il cultive méthodiquement, soigneusement, sans hâte, avec tendresse et entendement. Il lui vient grande joie apparemment de son travail, ce pourquoi sa santé et sa face s'épanouissent. Sa mine est d'un sage, un sage soumis aux aimables préceptes d'Épicure. On songe, en le regardant, à quelque chat nourri de lait crémeux, qui préfère, aux amours de gouttière, ronronner une sieste au pied d'une vigne grimpante. Il doit aimer les petits plats mitonnés, les femmes un peu grasses, et tout ce qui dans la nature s'arrange assez harmonieusement pour procurer à l'homme de la volupté—de la volupté, plutôt que de la passion.
*
* *
J'ai connu autrefois un honorable magistrat, aimable homme et disert. Il était du midi et savait raconter comme seuls les méridionaux racontent, avec cette pointe d'accent qui est pour les mots ce que le soleil est pour les choses. Sa verve colorée autant qu'abondante, enchevêtrait avec tant de subtilité et de faste le vrai et le faux qu'on ne tardait pas, encore qu'on fût prévenu, à prêter au faux plus de créance qu'au vrai. Il possédait sur la Côte d'Azur une propriété. Revenant de Nice, je m'arrêtai pour le voir. "La maison est de peu d'apparence, m'avait-il dit, mais la situation!... une vue!... et la commodité: vous ouvrez la porte, vous descendez: vous êtes dans la mer." Quand j'arrivai, la nuit était tombée. La propriété de mon ami me parut fort loin de la gare et quelque peu perchée... Le lendemain matin, à la première heure, je me précipitai à la fenêtre. Quelle situation! La maison étouffait sous les arbres des propriétés voisines. Quelle vue! Le jardin minuscule était prisonnier de murs bientôt aussi hauts qu'il était large. Et la mer! Je la cherchai en vain. Mon ami me la montra pourtant. D'une lucarne de grenier, on l'apercevait à l'horizon entre deux pignons et à travers des branches que la brise matinale balançait paresseusement. L'après-midi, nous y fûmes. Il suffisait en effet d'ouvrir la porte et de descendre. Après vingt minutes de marche, d'ailleurs par des chemins charmants, on arrivait à la plage.
Par opposition, je me souviens d'un ancien camarade de lycée qui fit une fin prématurée en épousant une jeune veuve fortunée. Sans ambition, modeste de goûts, il s'établit non loin de Nantes dans une vieille demeure du XVIIe siècle, comme il en existe tant en ce gracieux pays que gâte malheureusement le court esprit de ses habitants.—J'ai acquis le droit de les juger en naissant parmi eux!—À quelque temps de son mariage, mon ancien camarade voulut bien m'inviter à le venir surprendre en sa thébaïde, lorsque j'irais faire une tournée au pays natal. "J'ai donné tes livres à lire à ma femme, elle désire vivement te connaître. Viens sans façon, tu seras reçu de même. La chambre d'ami ouvre sur le potager. C'est la partie la plus vaste de la propriété qui est petite. En étendant le bras, tu pourras cueillir le raisin de la treille; elle grimpe jusqu'à la fenêtre, ainsi qu'un rosier que mon beau-père planta le jour de la naissance de Louise, ma femme. Le raisin est bien un peu acide, mais les roses sentent bon, encore qu'elles se fassent de plus en plus rares. Au coucher du soleil, par ciel pur, les deux tours de la cathédrale sont visibles à l'horizon..." La lettre continuait sur ce ton familier et décent; j'acceptai l'invitation. Quelle surprise, une fois là-bas!... Tout était tel que mon hôte l'avait dit: la chambre, le potager, le rosier et ses roses, la treille et son acide raisin... Le soir même de mon arrivée, le ciel permit que j'aperçusse la haute silhouette de la cathédrale.
Me remémorant ma déception de jadis, je songeai, à part moi, qu'un ami de peu d'imagination est de rapports plus agréables qu'un autre qui nous sait captiver par les merveilles de son éloquence...
Je ne suis pas éloigné de penser de même relativement aux écrivains, à ceux du moins, romanciers ou voyageurs, qui nourrissent leurs livres de descriptions. En cette matière, qu'il s'agisse de la nature ou d'œuvres d'art, il convient de n'accepter pas sans réserve le témoignage des poètes et, en général, des grands lyriques. Leurs regards magnifient les choses sur lesquelles ils se posent; leur imagination par surcroît ajoute le miracle du rêve à l'éblouissement de la vue. Que reste-t-il de la froide réalité, pour nous qui ne la savons voir qu'en ses formes quotidiennes? Lisons les donc pour la splendeur de leur verbe et la somptuosité des décors qu'ils imaginent; évitons de les prendre pour guides. La prudence va jusqu'à conseiller de n'aller jamais visiter les contrées célébrées par eux! Nous n'y pouvons trouver que mensonge, non pas que les poètes mentent: ce sont les choses qui trahissent leurs visions.
Si Venise nous semble terne et sèche, auprès des pages inoubliables que lui consacra Barrés, si le pays de Madame Chrysanthème nous déçoit après lecture de Loti, si les Martyrs épuisent notre enthousiasme pour les paysages antiques, la faute en est-elle à ces prestigieux créateurs d'illusions? Non, elle est à nous, qui nous laissons duper par les apparences.
Ils sont plus nombreux qu'on ne croit, les gens qui ne voyagent jamais. Ce n'est pas incuriosité, c'est paresse, quelquefois aussi impécuniosité. Ils se rejettent sur la lecture. Sans quitter le coin du feu, ils font ainsi le tour du monde. Découvrant les pays à travers les grands écrivains, leur esprit est plein de visions incomparables. Que gagneraient-ils à voir par eux-mêmes? Rien. Ils le savent, aussi se gardent-ils de sortir de chez eux. Mais ceux qui sortent! Ils redoutent les créateurs d'images, les visionnaires. À celui qui dit: "Vous ouvrez la porte, vous êtes dans la mer;" ils préfèrent celui qui dit: "Les roses sont rares, le raisin est acide." Le premier est un poète, assurément, mais, en voyage, la compagnie du second expose à moins de déconvenue.
Eh bien, Gabriel Faure est plus près de ressembler à mon vieux camarade de collège qu'à mon honorable ami le méridional. Il est trop artiste, trop voluptueux, pour garer sa saine raison de toute griserie poétique, mais il a trop de bon sens, par ailleurs, il est trop réaliste—c'est encore ici un signe de volupté!—pour n'être pas appliqué, dans ses livres, à donner des choses une image où nous puissions sans peine les reconnaître...
*
* *
Gabriel Faure a publié des romans: la Dernière journée de Sapphô, la Route de volupté, l'Amour sous les lauriers-roses, les Amants enchaînés. Ces titres sont significatifs; le caractère voluptueux de l'écrivain s'y inscrit tout entier. Leur harmonie nuancée, d'ailleurs, écarte toute idée de sensualité brutale, de frénésie passionnelle...
Mon projet n'est point, au reste, de me livrer à l'analyse de l'œuvre romanesque de Gabriel Faure; je veux seulement noter la place considérable qu'y tiennent les paysages. C'est que Gabriel Faure prend, au fond, plus d'intérêt au décor de la vie qu'aux agitations du cœur. Un roman, pour lui, est toujours un peu prétexte à des promenades dans la nature. C'est un moyen d'animer ses paysages, de les passionner. Il procède à la façon des paysagistes classiques qui ne concevaient pas un tableau sans personnages. Il a des dons de psychologue, mais il est avant tout un contemplatif, un descriptif.
Très cultivé, ayant le goût des voyages et l'amour des chefs-d'œuvre, il était naturel qu'il portât ses pas vers l'Italie. N'est-il point au surplus, comme Stendhal, né au pied des Alpes[1]? Voilà qui donne envie de les passer!
C'est d'Italie que Gabriel Faure rapporta ses ouvrages les plus remarquables. Il a écrit sur la Lombardie, l'Ombrie, la Vénétie, le Piémont, l'Émilie des pages mieux que charmantes. L'Italie est devenue sa seconde patrie, celle de ses yeux; elle est l'enchantement de son esprit; il a besoin de son ciel, de ses monuments, de ses musées, de ses sites. Ceux là qui l'ont célébrée avant lui sont devenus ses amis. Il se plaît à ses mœurs, à ses coutumes; il en aime la langue rapide est tintante.
Le psychologue dirige souvent les promenades du peintre. Certes, Assise est douce, et les soirs de Sienne ont "une infinie suavité;" mais, n'est-ce pas le souvenir du Poverello et de sainte Catherine qui l'appelle? Il est trop lettré pour aller dans la nature avec son seul souci de volupté. Il a trop d'intelligence, il est trop artiste pour ne pas trouver plus de pathétique et plus d'éloquence aux lieux qui virent s'allumer ou s'éteindre quelque pensée de génie. À quoi bon parcourir des contrées illustrées par les événements ou les hommes, si l'on n'en doit saisir que l'aspect décoratif? La nostalgique campagne romaine ne nous émeut tant qu'à cause de sa gloire passée. Il y plane ce recueillement particulier aux paysages très anciens où se déroulèrent de grandes choses, qui furent les témoins des travaux, des luttes, des ambitions et des rêves humains. Ils peuvent, ces paysages, ne pas se ressembler, varier en leurs lignes, en leurs arbres, en leur ciel: ils ont tous cette quiétude harmonieuse et grave; ils ont tous cet aspect un peu solennel et heureux, reposé et méditatif. Ils nous enchantent et nous en imposent; ils nous enivrent et nous inquiètent. Il y a de la pensée dans leur lumière, une âme en chaque ombre. En Italie, tout est art, paysages, souvenirs, monuments; l'histoire y est partout mêlée aux choses dont on ne sait si elles ont été disposées pour servir de cadre à l'amour ou susciter nos méditations sur la vanité de la gloire. Par sa nature, sa culture, son esprit, Gabriel Faure était fait pour comprendre et dégager la voluptueuse beauté de cette terre illustre.
Aussi bien, il y a beaucoup du critique chez lui. C'est ce qui fait son originalité, ce qui lui assure un rang à part parmi les paysagistes littéraires. Il procède rarement à la manière d'un Byron ou d'un Chateaubriand. L'imagination ne l'emporte pas dans un grand mouvement désordonné au-dessus de la réalité. Ce n'est guère son rêve qu'il contemple, il se grise peu de sa vision intérieure. Il s'arrête devant les choses et, en homme averti et de goût, il les juge, s'en réjouissant dans la mesure où il leur reconnaît du mérite. Peut-être n'est-il pas très sensible. Il ne prend pas le lecteur à la façon d'un Loti, d'un Barrès, d'un d'Annunzio. Il n'est ni le voyageur ignorant qui n'aperçoit de la nature que la stricte façade, ni le poète, non moins ignorant, uniquement occupé de la relativité du monde avec lui-même. Le très vif plaisir qu'on éprouve à le lire vient en partie de la confiance qu'il inspire. On le devine soucieux de vérité. Le trait ferme, mais non point sec, de son dessin garantit l'exactitude du tableau. Il a raisonné ses impressions, ses sensations, avant de prendre la plume. De là l'ordonnance de son œuvre descriptive, sa parfaite unité, sa poésie contenue, son harmonie, son intelligence.
Son style est clair et mesuré; jamais de débordement romantique. Sa phrase a quelque chose du rythme racinien et de l'atticisme cher à Anatole France. Comme toujours chez lui, la raison s'allie ici à la volupté. Il voit net et harmonieux. Sa vue guide ses sentiments et détermine son esthétique. Il écrit comme il voit. Et, lorsqu'il assure que les tours de la cathédrale sont visibles à l'horizon, on peut le croire.
*
* *
Ô volupté des heures matinales, dans le virginal décor de l'éveil des choses, sur les montagnes ensoleillées! Toute la splendeur des horizons entre par les yeux dans l'âme, et chaque sensation devient jouissance. Les feuillages qui tremblent et luisent, le murmure du vent chantant dans les arbres, les parfums de la prairie en fleurs, les jeux de lumière, les lointains grelots d'un troupeau, tout se transforme en joie physique et l'on savoure le bonheur de vivre avec une telle plénitude, que, souvent, on en est oppressé. Les lèvres et les poumons hument avec délices un air irrespiré. La pensée erre et bondit dans l'espace, libre et sans entrave, se pose au hasard sur les choses; on finit par oublier sa personnalité et l'on sent en soi la vie universelle. On perçoit tous les souffles, tous les bruissements, tous les chuchotements des milliers de voix imperceptibles dont est tramé le silence des bois. Le cœur s'ouvre si largement que l'univers ne suffirait pas à l'emplir. On frémit pour une feuille qui tombe, un oiseau qui passe, un bourdonnement d'insecte, une odeur plus pénétrante... Enivrement merveilleux, qui, parfois devient presque du délire!
Outre qu'elle est particulièrement jolie, cette page offre un exemple excellent de la manière de Gabriel Faure paysagiste, critique et voyageur. Elle le montre amoureux voluptueux de la nature, qu'il analyse minutieusement pour en jouir davantage. Elle témoigne aussi de sa lucidité d'esprit, dans l'instant où l'enivrement devrait lui faire perdre la tête. C'est que le critique n'oublie point d'exercer son contrôle sur lui-même comme sur ce qu'il écrit. N'est-il point visible encore qu'il ne cesse de penser à son lecteur? C'est pour lui qu'il, travaille, qu'il se donne la peine de noter ses impressions les plus vives et les plus ténues. Il s'en voudrait de le décevoir par une inexactitude. L'éblouir à force de lyrisme n'est pas son but. Partout et toujours, il s'efforcera de lui inspirer de la sympathie. Ici, il l'intéresse discrètement par son érudition; là, il le charme par ses descriptions colorées et musicales. Exalte-t-il la beauté d'un site, relate-t-il la joie qui lui en vint, c'est avec l'espoir de nous pousser à le venir admirer. Il serait heureux que nous partagions sa volupté. Pas de promeneur moins égoïste. Il nous entretient de lui, et, cependant, l'on jugerait qu'il nous parle de nous-mêmes. Du moins, il est certain que c'est à nous et pour nous qu'il parle. Il a le constant désir de nous communiquer ses enthousiasmes et ses émotions. Tout en mettant ses impressions sur le papier, il nous donne l'illusion—suprême adresse—de paraître consigner les nôtres. Il s'institue notre guide. Marchant à nos côtés, il dépense sans compter son savoir, son goût, son talent, pareil à l'amant qui chante la douceur de l'heure à la femme aimée, afin qu'elle sente plus intensément la réalité de son bonheur.
*
* *
Qu'il nous conduise au pays de Stendhal, au pays de Tristan, ou bien dans les "décors tout trouvés pour des romans provinciaux" où vécut Georges Sand—car Gabriel Faure ne borne pas sa curiosité à l'Italie;—qu'il nous entretienne de l'Espagne, de la Bretagne ou du Dauphiné, il le fait dans les mêmes termes heureux. Son procédé littéraire reste identique parce qu'il est l'expression directe de sa nature.
Gabriel Faure jouit des paysages en sage et en lettré; il va son chemin, attentif, intelligent, prenant des choses tout le plaisir possible, en pleine possession de sa conscience, loin de toute surexcitation intellectuelle ou sensuelle. Il est un vivant miroir qui met son honneur à reproduire avec exactitude les objets qui s'y réfléchissent.
Je me le représente volontiers sous les traits d'un bon jardinier qui, pour avoir servi chez un romancier psychologue, aimerait les lettres et associerait respectueusement le souvenir des grands hommes à la beauté des paysages. Il parcourt le jardin à petits pas, ratissant minutieusement les allées, soignant avec amour les bégonias des plates-bandes et les rosiers de la terrasse. La pelouse par ses soins est toujours verte et rase, le banc de la tonnelle toujours propre. Et quand le soleil suspend des banderoles multicolores au panache du jet d'eau, il sent monter à ses yeux des larmes d'admiration, sourdre en son être une joie infiniment voluptueuse et sereine.
Alphonse Séché
[1]Gabriel Faure est né à Tournon (Ardèche), en 1877, d'une famille originaire de la Drôme.

Rhodope, aux pieds de Sapphô, lui parle doucement, presque à l'oreille.
—Te souviens-tu de nos premières journées à Érèse? Il me semble, à moi, qu'elles datent d'hier, parce que je les revis à chaque instant dans ma pensée. Comme j'étais heureuse de connaître cette Sapphô que, si souvent, j'avais entendu célébrer! Et comme je fus fière, lorsque je vis que tu t'attachais à moi! Ah! tu l'as peut-être oubliée, toi, notre première soirée au bord du golfe bruyant. De vastes oiseaux nocturnes planaient sur nos têtes, volaient vers la mer et semblaient s'y plonger; puis, enivrés de son parfum, ils se redressaient d'un coup d'aile et revenaient près de nous. Peu à peu l'ombre se fit soyeuse et transparente; Phébé parut. Nous vîmes le mince croissant sortir des flots. Pendant quelques instants, nous eûmes l'illusion d'une trière en flammes, brûlant dans la nuit. C'est ce soir-là que tu me proposas de venir jusqu'à Mitylène. "Tu verras, me disais-tu, tu verras comme l'autre rivage est plus beau, comme il est doux de s'y aimer." Et, tout en me parlant et me serrant contre toi, tu t'exaltais. Tu me disais des choses douces et caressantes, presque comme un amant. Dans la nuit semeuse de songes, il me semblait que je rêvais. "Oui, tu viendras, tu viendras, répétais-tu sans cesse, et tu verras comme je t'aimerai. Ici, le sol est rude, inégal et brusque, comme l'homme et comme ses étreintes. Tu verras là-bas combien cette île est plus belle et plus harmonieuse. Tout y est féminin. Le sol s'abaisse graduellement, insensiblement, en une succession de collines aussi rondes que tes seins." Tu vois, je me rappelle presque tes phrases mêmes; il me semble encore que j'entends ta voix chantante et grave. "On dirait, me disais-tu, une multitude de femmes, languissamment étendues les unes sur les autres; les vallées régulières et peu profondes sont les creux de leurs corps, où l'air s'engouffre et s'attarde pour mieux les caresser. La côte ne ressemble pas à celle-ci; c'est une suite de golfes recourbés comme des cithares et sonores comme elles. L'étreinte de la terre et des flots n'y est pas bruyante, sauvage, pleine de cris de douleur. Le vent n'y hurle pas ainsi que des fauves prisonniers se heurtant contre des murs. La mer vient mourir sur le rivage avec des roucoulements amoureux. Oui, tu viendras, ne cessais-tu de me répéter, et tu verras toutes ces choses. Et c'est là que nous nous aimerons." Je t'écoutais sans rien dire, ne comprenant pas. J'étais heureuse d'être près de toi. Je me laissais bercer par ces phrases douces et parfumées. Elles coulaient sur moi comme une chevelure ruisselant d'huiles aromatiques. Elles m'étourdissaient, me grisaient ainsi qu'un vin lourd, étrangement. Je me sentais prise dans ta voix comme dans les mailles d'un filet. Parfois, j'étais secouée de frissons, de grands frissons délicieux, surtout quand tu t'approchais de moi, quand tu me parlais presque è l'oreille. Le souffle de ta bouche se jouait dans mes cheveux, et c'était plus doux qu'une caresse. Toi, au contraire, tu me paraissais souffrir: tes paupières battaient vite et fort, comme les ailes d'un oiseau apeuré; tes prunelles avaient quelque chose d'ardent et d'étrange; par moments, tu te raidissais et semblais lutter contre quelqu'un. Tout à coup tu me saisis de tes deux mains et tu me dis: "Que tu es belle, Rhodope! Je voudrais que tu pusses te voir; tu serais amoureuse de toi-même." Et tu te levas, m'entraînant. "Viens, viens; rentrons. Demain matin, à l'aube, nous partirons." Le lendemain, je t'ai suivie, docile. Je n'ai même pas essayé de résister; ta volonté plus forte que la mienne me possédait tout altière... Ah! ce voyage à travers Lesbos, jamais je ne l'oublierai. Te souviens-tu? nous nous sommes embarquées sur le navire d'un commerçant qui allait à Pyrrha, où nous arrivâmes à la tombée de la nuit. Presque sans nous reposer, nous nous mîmes en route. Je n'étais jamais lasse. "Tu verras, me disais-tu toujours, tu verras..." Et ta voix suffisait à me donner du courage. Deux fois nous avons dormi en plein air, deux autres fois dans la paille, chez des paysans. Te rappelles-tu? l'un d'eux ne voulait pas nous ouvrir sa grange, nous prenant pour des mendiantes ou des voleuses; et cet autre qui nous offrit de partager sa couche... En traversant l'un des cols que nous avions à franchir, tu me désignas les deux sommets de l'île qui nous dominaient au nord et au sud, le Lepithymne et l'Olympe, où les veilleurs de nuit guettèrent les feux qui devaient porter en Hellade la nouvelle de la prise d'Ilion. Le sixième soir de notre voyage, nous couchâmes à Hiéra, et, le lendemain, au matin, tu me montras une dernière montagne: "De là-haut, me dis-tu, nous verrons Mitylène!" Alors, plus alertes, sans prendre haleine, nous avons gravi la côte. Et brusquement, en arrivant à la lisière d'un bois d'oliviers, nous eûmes devant nous l'inoubliable vision: tout le versant oriental de l'île, Mitylène, la mer Éolienne et, dans le fond, les rives d'Ionie. Nous restâmes longtemps, sans rien dire, les mains unies. Aucune de nous n'osait rompre le silence. Nous étions véritablement émues, presque angoissées. Le soleil, derrière nous, ne nous éblouissait pas de ses rayons. Il était cependant assez haut pour éclairer tout le paysage, sans le barrer de grandes ombres. Je le revois encore, comme s'il s'étendait, là, devant mes yeux. D'abord une infinité de collines assoupies au soleil, s'inclinant harmonieusement, par une pente très douce, jusqu'au rivage. Quelques-unes sont fleuries de lavande et de thym. Des bois d'orangers les parsèment de taches sombres que traversent des chemins blancs. Sur d'autres, des champs d'oliviers aux troncs noueux et tordus étalent le moutonnement de leurs touffes pâles. On voit remuer les femmes qui ramassent dans des corbeilles les olives tombées. Entre les coteaux serpentent de minuscules vallons ombragés de lauriers-roses, où coulent les ruisseaux que l'on aperçoit, par places, scintillant au soleil. Puis, entre les dernières collines et la mer, une étroite plaine où repose Mitylène. Autour d'elle, une dizaine de bourgs sont couchés dans la lumière, semblables à des bêtes paresseuses. Et, plus loin, la mer, l'immense mer miroitante, avec ses vagues aux claires crinières. Comme un vol de mouettes lassées, les voiles des pêcheurs rentraient au port. C'est toi qui parlas la première. "Admire, me dis-tu, la langueur de ce rivage qui se découpe en golfes réguliers et largement évasés, pour mieux s'offrir tout aux caresses de l'eau. Regarde surtout Mitylène, ses murailles peintes et ses toits de couleur. Elle est plus maquillée qu'une joueuse de flûte. Vois comme elle s'étend au long des flots, dans la fraîcheur des citronniers, avec des mollesses de courtisane. Elle s'est bâtie sur une presqu'île; elle a voulu sentir des deux côtés le baiser humide de la mer." Nous nous assîmes par terre, dans le bois d'oliviers, adossées contre un rocher où le soleil mettait des reflets roses. Ses rayons tombaient sur nous en larges médailles d'or, à travers les branches pensives et pâles où des cigales criaient. Quelques autres bruits nous parvenaient: un grelot tintant au loin, la cantilène d'un berger, des appels de femmes travaillant aux champs. L'air était tout chargé du parfum pénétrant des lauriers-roses et des lavandes. La brise était si faible que les feuilles bougeaient à peine, avec un murmure si doux qu'il fallait prêter l'oreille pour l'entendre. Quelquefois, cependant, un vent plus violent nous apportait l'odeur aphrodisiaque du sel et les âcres senteurs des plages où les poissons sèchent sur le sable chaud. Quand ces souffles tièdes et humides frôlaient la nuque, on avait la sensation d'une haleine. L'illusion était si forte que je me rappelle, une fois, avoir tendu mes lèvres pour un baiser...

Déjà, ayant dépassé les faubourgs de Douarnenez, le train filait en pleine campagne, à travers des bois de pins et des landes fleuries. Mais la ligne était le plus souvent creusée en tranchée, et l'horizon ne s'étendait pas.
Assis en face l'un de l'autre, Hélène et Maurice poursuivaient leur rêve intérieur. À chaque secousse du wagon, leurs genoux se heurtaient et ce contact était pour eux à la fois une gêne et une joie. De loin en loin, ils ramenaient leurs regards l'un vers l'autre, lentement, par un insensible mouvement de tête; puis, très vite, ils se détournaient et s'absorbaient de nouveau dans la contemplation du paysage fuyant à travers l'encadrement de la portière.
Le soleil couchant empourprait les arbres de reflets cuivrés et donnait aux granits, couverts de bruyères roses, des flamboiements d'incendie.
Tout à coup, Mauroy les appela:
—Venez, venez voir!
Ils s'approchèrent et se serrèrent l'un contre l'autre. Ils eurent comme un enivrement subit à ce nouveau contact plus complet. Ils goûtèrent la volupté d'un plaisir défendu. Le spectacle achevait de les griser. C'était pour eux un besoin physique de crier è chaque instant leur admiration.
La ligne s'était élevée peu à peu et courait maintenant sur le plateau. À travers les minuscules bois de pins, la baie de Douarnenez déployait sa courbe immense; presque en face d'eux, le Méné Hom la dominait de sa haute masse noire. Tout au bout de l'arc de cercle, le cap de la Chèvre se dessinait. Une large bande d'un rouge écarlate barrait l'horizon. Au-dessus d'elle, par une série de raies multicolores, plus étroites et plus mobiles, le ciel et l'océan se joignaient, et, dans le flamboiement universel, se distinguaient à peine l'un de l'autre. À mesure que le soleil déclinait, des nuages se formaient, très bas, comme sortant de l'eau, qui faisaient autant de taches sombres pareilles à des îles féeriques brusquement surgies. Une ligne de montagnes inconnues se découpait dans l'embrasement du ciel; et, par moments, le cap de la Chèvre, la côte de la baie, le Méné Hom lui-même, se confondaient avec les terres nouvelles et semblaient faire partie de ce paysage de légende.
Hélène et Maurice subissaient le mirage et se croyaient transportés sur les rives ignorées d'une mer tropicale, parmi des îles d'améthyste et d'émeraude, dans un de ces archipels de feu que les marins racontent avoir parfois aperçus, par les nuits pleines de lune, dans un halo fugitif.
—Ne vous semble-t-il pas, leur demanda Mauroy, que voici une merveilleuse et éclatante fresque de Puvis de Chavannes? Sur ce fond d'or et de pourpre, se dressent les tiges grêles de ces arbres qui lui étaient chers, de ces pins maritimes dont les grands troncs décharnés sont couronnés seulement d'une élégante touffe de feuillage. Oui, en vérité, ce train sacrilège traverse le bois sacré des muses. Je m'attends è voir une nymphe bondir derrière ces haies. J'aurais voulu que Puvis vînt sur les bords de cette mer où, depuis la naissance du monde, se couche, chaque soir, le soleil, et qu'il illustrât la légende de Tristan et d'Iseut. Les deux amants, tendrement enlacés, auraient passé dans ce paysage, qui paraît un décor de théâtre tant il est net et coloré, et qui cependant aurait été véridique, puisque Tristan et Iseut vécurent ici ou sur des bords semblables de cette même mer... Tenez, voici peut-être le bois de pins où le bon roi Marke les surprit, un jour, endormis côte à côte. Vous connaissez la scène adorable du vieux poème: Marke s'arrête, furieux, prêt à la vengeance; mais bientôt la pitié succède à la haine; Tristan est si beau, Iseut est si belle, qu'il s'attendrit; et, comme un rais de soleil tombe à travers le branchage sur le visage d'Iseut, il bouche avec son gant la fente par où passe le rayon...
Hélène et Maurice tressaillirent et se sentirent rougir. Une sorte d'embrasement pareil à celui du ciel et de la mer s'empara d'eux, et ils s'éloignèrent l'un de l'autre, presque étourdis.
Le soleil entrait alors dans l'océan, énorme, prodigieux, démesurément agrandi, éclaboussant l'air et l'eau de gerbes de flammes et d'étincelles. Tout l'horizon flamboyait dans une immense réverbération d'incendie. Pendant un moment, le ciel fut illuminé d'un rouge si vif qu'il donna l'impression de lueurs sanglantes. Puis, peu è peu, les tons violents s'adoucirent, décrurent progressivement jusqu'à la ligne de rencontre de l'air et de l'eau.
Quand ils débarquèrent à Audierne, la nuit était à peu près tombée. Du côté du couchant seulement, derrière la colline à laquelle est adossé le bourg, le ciel avait encore des traînées écarlates et faisait songer à je ne sais quelle forge où l'on travaillerait la nuit...
*
* *
L'étroit plateau qui rattache la pointe du Raz à la terre n'est qu'un morne désert granitique où le roc est à nu, où rien ne pousse, pas même un arbuste, pas même une plante. Devant soi, en droite ligne, comme continuant la pointe du Raz, des roches aux noms barbares, Gorlégreiz, Gorlébella, d'autres encore, parsèment le terrible chenal "que jamais marin ne traversa sans avoir eu peur ou mal," suivant le dicton du pays; derrière elles, se dessine la côte plate de l'île de Sein; puis, plus rien, l'infini, la mer sauvage, à perte de vue. Au nord, la baie des Trépassés, au fond de laquelle miroite l'étang de Laoual, sur l'emplacement où fut autrefois Is la maudite; puis la pointe de Van, le cap de la Chèvre, et, tout è fait à l'horizon, la pointe Saint-Mathieu, au large de laquelle on devine Ouessant. Au sud, s'étale l'arc de cercle de la baie d'Audierne, inhospitalière et rude, jusqu'aux rochers de Penmarc'h, où, par les nuits sans brume, on voit briller le phare d'Eckmühl.
Aucun autre rivage, si ce n'est la côte méridionale de l'île de Groix, ne donne la même impression farouche et grandiose. On se sent le jouet de forces mystérieuses et inconnues. Il semble que la fatalité seule soit maîtresse des hommes. C'est là que l'on peut le mieux se faire une idée de l'âme celtique. Au sein de cette âpre nature, les événements prennent un caractère inexorable. L'amour et la mort surtout y paraissent toujours voulus par quelque inflexible divinité. L'homme est ballotté au gré des mobiles destins, comme une barque au caprice des vagues. Pour lui, rien n'est fixe, rien n'est assuré, et chaque lendemain devient une anxieuse interrogation. Il vit dans une perpétuelle méfiance. L'eau, l'air, tout est son ennemi. Le sol lui-même, parfois, ne lui offre qu'une douteuse sécurité. Certaines terres basses s'effondrent et disparaissent à chaque raz de marée: un jour viendra, par exemple, où Penmarc'h ne sera plus, comme Is, qu'une cité marine dormant au fond des eaux d'un sommeil tourmenté; et parfois, par les nuits calmes, les pauvres marins errants tressailliront, en entendant de lointaines cloches sonner à d'invisibles clochers... Ce caractère fatal est le meilleur argument en faveur de l'origine celtique de la légende de Tristan et Iseut. Ce paysage, cette mer, ce ciel, cette atmosphère, toute cette nature en un mot est la preuve vivante qu'elle ne pouvait naître que sur ces bords ou sur les rivages pareils de la Cornouaille anglaise, dont la côte a tant de ressemblance avec celle-ci qu'elle paraît être sa sœur jumelle. En apercevant ces caps sauvages, ces énormes rochers, cette mer aux vagues fantastiques et aux marées inconnues d'eux, on dit que les légionnaires de César s'écrièrent: "Ici finit l'empire de nos dieux!" C'est cette même impression de teneur et d'effroi que nous éprouvons encore, nous autres, Latins; mais cette nature farouche s'harmonise entièrement avec les ardeurs impétueuses et toujours inassouvies de l'âme celte. Elle est bien fille du sol gaélique, cette poésie triste et pénétrante où l'amour devient le centre même de la vie. Alors que, sous des deux plus sereins, l'amour est surtout chose gaie, légère, frivole et sans lendemain, il est ici un sentiment douloureux et passionné, profond et terrible, tumultueux comme l'Océan. La légende de Tristan et d'Iseut a toutes les fureurs de cette mer, personnage d'ailleurs toujours présent et actif dans le drame. C'est sur elle, pendant une traversée, que les amants boivent le breuvage magique; c'est en face d'elle que s'écoule leur vie amoureuse, incertaine et agitée comme elle; c'est elle qui les sépare aux jours d'exil; c'est elle aussi qui les réunit et ramène Iseut vers Tristan qui se meurt. Le navire portant la blonde fille d'Irlande a passé devant ces rivages et doublé ce cap redoutable. Et là-bas, vers le sud, cette tache claire à peine perceptible: ce sont les rochers de Penmarc'h, sur lesquels Tristan se faisait porter chaque jour, pour voir apparaître de plus loin la blanche voile d'allégresse...

Comme ils passaient devant la porte d'un cimetière, Mme Fréneuse dit:
—Entrons un moment, voulez-vous?
Lucile, souffrante ce jour-là, avait préféré ne pas prendre part à la promenade qu'ils faisaient tous les trois, chaque jour, sur les rives du lac. René et Madeleine étaient partis, un peu gênés à l'idée qu'ils devaient rester loin d'elle pendant quelques heures; puis le malaise s'était dissipé dans la clarté radieuse du matin, et une sorte d'ivresse les avait peu à peu gagnés d'être libres et seuls pour la première fois. Mais ils évitaient de traduire, par des paroles ou des regards, les émotions qu'ils ressentaient.
René poussa la porte. Madeleine entra devant lui et se signa. Le cimetière était désert. Seul, un vol de moineaux s'enfuit à leur approche, avec des piaillements aigus. Infatigables gardiens, les cyprès funèbres veillaient sur les morts; leurs glaives endeuillés s'élevaient, en un morne et rigide alignement, le long des allées bordées de buis. Entre leurs troncs noirs se dressaient les marbres clairs des monuments mortuaires ou d'humbles croix de bois. Des grilles entouraient les tombes; des feuillages et des fleurs s'accrochaient aux fers déjà rouillés.
—Comme on doit mieux dormir ici, dit René, que dans ces modernes et somptueux cimetières où s'étale si affreusement le mauvais goût des Italiens d'aujourd'hui! Il me serait dur de penser que je reposerai un jour au milieu de ces hommes en redingote de marbre et de ces femmes en robes à volants, pleurant et minaudant, un mouchoir à la main, dans ces attitudes de grossier réalisme bourgeois qui rappelle les bonshommes de cire du musée Grévin. Combien l'ombre de ces cyprès doit être plus légère et plus douce!
—Moi, dit Madeleine, j'ai toujours fait le rêve d'être enterrée dans un de ces petits enclos funèbres où les paysans dauphinois ensevelissent leurs morts, au milieu même des champs où ils vécurent.
Autour du cimetière et sur les terrasses lumineuses qui s'étageaient au-dessus de lui, les arbustes en fleurs, les lauriers-roses, les arbres chargés de fruits, les mûriers, les oliviers d'argent terni, les orangers déployaient leur végétation luxuriante. Des vignes grimpaient aux troncs des arbres; quelques treilles n'avaient pas encore été vendangées, et les raisins trop mûrs, gonflés à éclater, répandaient une odeur lourde. La breva, qui commençait à souffler, traînait après elle les senteurs des jardins sur lesquels elle avait passé. La vie partout triomphait. Sous les cyprès s'élançant vers le ciel comme des prières, régnaient, au contraire, une paix claustrale, un silence de mort. Et, de ce contraste, un trouble étrange venait à René.
Il s'arrêta, passa la main sur ses yeux.
—Qu'avez-vous? demanda Madeleine.
—Jamais je n'ai pu pénétrer dans un cimetière sans être ému; mais nulle part comme en celui-ci, entre toutes ces images du néant et cette exubérance de la nature, je n'avais senti plus vivement combien sont voisines la mort et la vie. En entrant ici, je me suis vu pareil aux seigneurs de la fresque de Pise, qui, au retour d'une chasse, après avoir savouré la joie de vivre et les parfums des bois, rencontrant des cadavres, respirent la pourriture et la mort. Et je me suis souvenu d'une idée de Barrès, qui regrettait que les cimetières de ces villages ne fussent pas situés au bord même des lacs, pour qu'ils puissent recevoir les caresses des vagues rejetées sur les rives par les barques joyeuses. Ces visions de la mort doubleraient le plaisir des couples amoureux et leur donneraient l'exaltation qu'éprouvent les amants vénitiens, quand ils se signent au passage de leur gondole devant les murs rouges de San Michele, ou errent, en se tenant par la main, sous les ifs funéraires de l'île franciscaine. Il est bien naturel, en effet, que la volupté s'accroisse lorsqu'on songe qu'elle est périssable et que la seconde qui vient peut à jamais la ravir. Ah! qu'ils étaient prévoyants, ces amants d'autrefois qui donnaient en cadeau à leur maîtresse un memento-mori! Le petit squelette délicatement ciselé, tournant à chaque instant leur méditation vers la mort, rendait plus ardent leur désir.
Madeleine, sans rien dire, la tête baissée, marchait aux côtés de René. Elle aussi subissait violemment le contraste du décor à la fois funèbre et voluptueux. Et les paroles du jeune homme lui donnaient comme un étourdissement.
—N'est-ce pas Michelet, demanda-t-elle, qui conduisait sa fiancée au Père-Lachaise pour lui parler d'amour parmi les tombes?
—Oui. L'amour se plaît dans le voisinage de la mort; et, souvent, tous deux marchent la main dans la main, la main tiède et rose de l'amour dans les doigts décharnés de la mort. Je ne sais où j'ai lu que Don Juan commanda à Valdès Léal ce tableau, qui est à la Caridad de Séville, où l'on voit un évêque et un gentilhomme couchés dans leurs cercueils, dévorés par des larves immondes, minutieusement reproduites; l'amant des mille et trois se plaisait, assure-t-on, à exacerber la volupté de ses regrets en imaginant son beau visage, qu'il avait vu tant de fois se refléter dans des prunelles luisantes de désir, pareillement décomposé et mangé par les vers. Quand Henri Heine nous parle, dans ses Mémoires, de son amour pour la fille du bourreau de Düsseldorf, il se rappelle surtout les tresses de ses cheveux, ces tresses si rouges qu'elles avaient des reflets de sang et si longues qu'elles pouvaient se nouer sous le menton de la jeune fille en lui donnant l'aspect d'une décapitée... Mais nulle part la mort et la volupté ne sont moins séparables qu'ici. Je regrette de n'avoir pas apporté les œuvres de Leopardi; je vous aurais lu le poème où le solitaire de Recanati proclame la douloureuse fraternité de l'amour et de la mort, dans des vers de facture si sévère qu'ils rappellent les paysages du triste pays des Marches. "Nés en même temps, l'amour et la mort sont frères." Cette idée fut toujours chère aux âmes italiennes. Déjà Dante, au cours de la Vita Nuova, exalte sa passion en imaginant Béatrice recouverte d'un linceul; et déjà, sur les vieux murs du campo santo de Pise, dans ce Triomphe de la Mort, dont je vous parlais tout à l'heure, derrière la virago aux ailes de chauve-souris, le peintre a mis un bosquet touffu où, à l'ombre dorée des orangers, comme en une scène galante du Décaméron, des amants insouciants se divertissait et savourent les plaisirs de l'amour.
Ils étaient arrivés au bout d'une allée. Un arbousier, en plein soleil, couvert de baies rouges, semblait un arbre de corail. Sur une tombe, entourée d'une riche balustrade de marbre, un saule laissait mollement tomber les pleurs de son feuillage. À côté, la longue chevelure d'un eucalyptus ondoyait au vent avec des reflets argentés. L'odeur vanillée d'un laurier-rose ombrageant une tombe se mêlait à l'odeur âcre des buis et des cyprès. Par bouffées, le vent leur apportait les senteurs des jardins proches.
—Ah! dit-elle, ces parfums... ici...
Elle prononça ces mots d'une façon si tramante que René eut la sensation d'un frôlement charnel. Puis elle se redressa, gonfla ses narines pour mieux aspirer les arômes troublants. Ses lèvres s'entr'ouvrirent.
—Ah! dit-elle encore.
Elle baissa la tête, exhala un soupir profond, comme accablée par une volupté trop forte. Ses yeux rencontrèrent ceux de René. Ils frémirent jusqu'aux moelles et se sentirent pâlir.
—Arrêtons-nous un instant, dit-elle.
Elle s'assit sur la balustrade de marbre. Un petit lézard vert qui se chauffait au soleil s'enfuit précipitamment. Les branches du saule pendaient autour d'elle; pour se donner une contenance, elle essayait de les nouer et de les tresser. Très émue, elle attendait qu'il parlât.
Il était resté debout devant elle. Sur le chemin, les quenouilles des cyprès, à peine remuées par le vent, faisaient de grandes ombres parallèles.
Une femme du peuple, toute jeune, nu-tête et vêtue de noir, entra dans le cimetière. Ses zoccoli qui, suivant la mode du pays, ne lui couvraient que la pointe des pieds, claquaient sur le sol. Elle vint tout près d'eux et déposa un bouquet sur une tombe fraîchement creusée que marquait une simple croix de bois. La présence d'étrangers la gêna. Elle ne s'agenouilla qu'un instant, murmura une courte prière et s'en alla, essuyant furtivement ses larmes.
Quand elle fut sortie, Mme Fréneuse alla regarder l'inscription sur la croix.
—Il n'avait que vingt ans, dit-elle, en se rasseyant.
Le visage reposant sur la main et le coude sur le genou, dans cette attitude que Dürer a donnée à sa Mélancolie, elle resta immobile, les paupières baissées. Ce mélange d'idées profanes et religieuses agitait, sans qu'elle en eût conscience, le fond ténébreux et trouble de sa sensibilité. René devinait qu'elle luttait contre une langueur envahissante; il voulut profiter de son émoi.
—Madeleine, dit-il, je vis en ce moment une minute incomparable. Loin du monde, loin de tous, au milieu de ces morts qui nous enseignent, bien mieux que les sages parmi les vivants, que tout est vain et que c'est à peine si l'heure présente nous appartient, il me semble que je suis plus près de vous, et que, s'il est des paroles que nos lèvres ne peuvent prononcer, nos cœurs les disent et les entendent...
Il s'approcha d'elle et lui parla plus doucement, presque à l'oreille. À mots couverts, il lui fit comprendre combien il l'avait toujours désirée et quelles fêtes amoureuses il lui aurait prodiguées, si la destinée qui les avait mis en présence ne les avait pas en même temps, par la plus cruelle des ironies, séparés à jamais.
Elle l'écoutait avec une attention étonnée, pareille à ces profanes qui entendent pour la première fois de la musique nouvelle. Les paroles ardentes de René, tombant sur son désir inconscient, l'avaient soudainement embrasée, comme un flot d'alcool versé sur un feu qui couve. Le trouble sensuel peu à peu s'emparait d'elle, lui emplissait le cerveau d'une rumeur bourdonnante, ainsi qu'une coquille marine collée contre l'oreille. Elle n'avait plus le mouvement des lèvres qui lui était familier; sa bouche, au contraire, violemment contractée, trahissait son émotion. Et, tout à coup, elle se mit à trembler nerveusement, fébrilement, sans pouvoir s'arrêter, comme une feuille sous un vent d'orage. Elle se sentit les artères vides et le cœur pris dans un étau.
D'un effort prodigieux, elle tendit toute sa volonté et se leva.
—Marchons un peu... je vous en prie...
Il la suivit, machinalement, les yeux égarés. Elle avançait, sans se retourner, raidie dans une défense crispée. Parfois les branches basses l'obligeaient à se pencher; il voyait la taille flexible se courber d'un mouvement souple et gracieux. Comme elle passait près d'une tombe, sous un laurier-rose couvert de fleurs, il s'approcha d'elle, brusquement et l'appela.
—Madeleine!
Elle tressaillit, s'arrêta, et, sans le regarder, le supplia.
—Taisez-vous, je vous en prie...
Le soleil filtrait à travers les feuillages, lui mettait de petites taches sur la peau.
—Madeleine! dit-il encore.
Elle leva les yeux et leurs regards se rencontrèrent. Ils se crurent enveloppés d'une flamme. Tout vacilla autour d'eux. Ils eurent la sensation de perdre pied dans un gouffre sans fond. Alors, d'un même mouvement, sans prononcer une parole, ils s'étreignirent frénétiquement. Leurs bouches se prirent dans un baiser qui fut plus une morsure qu'une caresse. Quand leurs lèvres se descellèrent, il leur sembla qu'ils s'arrachaient la chair.
Elle s'appuya un instant contre le rebord de la tombe. Il restait immobile près d'elle. Une ombre lumineuse et fleurie flottait autour d'eux. Puis ils sortirent du cimetière. Elle avançait lentement, la tête basse, très pâle, exsangue. Il marchait à côté d'elle, n'osant pas la regarder, n'osant pas parler; par moments, il sentait ses jambes fléchir sous lui.

Au sortir de l'allée que bordait une double haie de hauts buis, et avant de s'engager dans le bois, René se retourna une dernière fois vers la maison qui semblait dormir encore. Quoique le soleil levant illuminât la façade d'une clarté déjà vive, toutes les fenêtres étaient closes; mais, de la ferme, à côté d'elle, montaient les bruits familiers de l'éveil matinal et des préparatifs pour les travaux des champs. Les coqs lançaient au ciel leurs appels éclatants. Sur le toit, les pigeons secouaient leurs ailes engourdies et commençaient à roucouler leur plainte monotone. Des chevaux, dans la cour, piaffaient bruyamment et parfois hennissaient, en proie à cet enivrement que les matins d'été versent à tous les êtres, aux animaux comme aux hommes, aux plantes mêmes qui semblent, au sortir du sommeil nocturne, s'étirer nerveusement et se tendre vers la radieuse lumière.
La brume estompait encore les contours des montagnes. C'était une matinée d'une pureté paradisiaque, comme il y en a parfois dans les Alpes, une matinée pareille à celles qui devaient luire à l'aube des temps, avant la naissance de l'homme. Toute la nature souriait à la vie, joyeusement, allègrement, sans cette langueur et ces hésitations des réveils de l'homme qui paraît redouter d'avance ce que le jour qui se lève va lui apporter de douleurs et de maux.
René traversa rapidement le petit bois qui, de tous les côtés, sauf vers la ferme, entourait la maison. Aux aiguilles des pins pendaient des gouttelettes de rosée que les rayons du soleil, donnant obliquement sur elles, faisaient briller comme des grains de cristal. Un duvet impalpable commençait à verdir les troncs des plus vieux chênes. Au sortir du bois, la pelouse recouvrait la montagne et la vêtait d'une souple tunique d'émeraude. Le gazon n'était traversé par aucun sentier; de loin en loin, montaient, dans la transparence de l'air, quelques massifs d'arbres distribués avec tant de grâce que l'on sentait bien que nulle main ne les avait semés, mais qu'ils avaient germé seuls, au caprice des vents. L'herbe était si haute et si drue qu'elle donnait l'impression d'une mousse épaisse, douce comme du velours frappé. Bien que l'on fût au début d'août, l'été frais et pluvieux n'avait pas fané toutes les fleurs; on rencontrait quelques retardataires, des épervières orangées, des soldanelles, des lis martagons dressant, comme un turban, leur corolle rouge. Par endroits, des touffes serrées de gentianes faisaient de larges taches bleues.
Une ivresse vint à René d'aller ainsi à l'aventure, dans le matin vermeil, sur cette pelouse humide où le jour naissant allumait toute une gamme de verts étincelants. Les alouettes se levaient devant lui, lançant au ciel leur joyeuse chanson. L'air vif des cimes, chargé de senteurs résineuses, le grisait ainsi que des gorgées d'élixir. Il lui semblait que son être s'épanouissait, qu'un afflux de sève gonflait ses muscles et précipitait le cours de son sang. Ô volupté des heures matinales, dans le virginal décor de l'éveil des choses, sur les montagnes ensoleillées! Toute la splendeur des horizons entre par les yeux dans l'âme, et chaque sensation devient jouissance. Les feuillages qui tremblent et luisent, le murmure du vent chantant dans les arbres, les parfums de la prairie en fleurs, les jeux de lumière, les lointains grelots d'un troupeau, tout se transforme en joie physique et l'on savoure le bonheur de vivre avec une telle plénitude que, souvent, on en est oppressé. Les lèvres et les poumons hument avec délices un air irrespiré. La pensée erre et bondit dans l'espace, libre et sans entrave, se pose au hasard sur les choses; on finit par oublier sa personnalité et l'on sent en soi la vie universelle. On perçoit tous les souffles, tous les bruissements, tous les chuchotements des milliers de voix imperceptibles dont est tramé le silence des bois. Le cœur s'ouvre si largement que l'univers ne suffirait pas à l'emplir. On frémit pour une feuille qui tombe, un oiseau qui passe, un bourdonnement d'insecte, une odeur plus pénétrante... Enivrement merveilleux qui, parfois, devient presque du délire... Tu les as connues, ô Jean-Jacques, ces ivresses d'un cœur ardent qui s'exalte dans la nature, loin des hommes, ivresses passagères, mais si intenses, qu'elles font vibrer nos fibres les plus secrètes et nous révèlent, mieux que les livres des philosophes, l'infini qui est en nous.
René s'arrêta sous les ombrages d'un bosquet de pins, à la lisière du plateau de Vouillant, d'où la vue embrasse, par-dessus le Drac, toute la plaine du Grésivaudan. La brume s'était déjà dissipée et les pics de la Chartreuse se détachaient nettement sur le ciel. Le soleil encore bas à l'horizon, éblouissant, ne permettait pas de voir, dans leur magnifique développement, les grandes Alpes, de Taillefer jusqu'au Mont-Blanc. L'air était pourtant si pur qu'on distinguait la croix plantée au sommet de Chanrousse. Le vent qui, chaque matin, se lève quand l'aube point, était tombé. Mais, parfois, un souffle, venu on ne savait d'où, courbait les pins. Un bruissement musical, pareil au bourdonnement de ruches en pleine activité, allait d'arbre en arbre avec une majestueuse lenteur et s'éteignait peu à peu dans les lointains feuillages. Alors, une paix grave régnait. Des bruits assourdis, le murmure du Drac, le sifflet d'un train montaient seuls de la vallée. Très haut, une troupe de milans en chasse tournoyait avec des cris aigus. Toutes les senteurs des cimes et des prairies flottaient dans l'air léger...

Comment quitter le lac de Côme sans m'arrêter quelques heures sur les rives fleuries de Bellagio? Je veux voir finir le jour du haut de ces terrasses de la villa Serbelloni qui, contournant le merveilleux promontoire, dominent tour à tour les trois bras du Lario. Les allées sont bordées de rosiers, de camélias, de magnoliers, de grenadiers aux troncs noueux et tordus, pareils à d'énormes câbles tressés, d'orangers, de citronniers, de cactus dressant leurs pointes bleutées, d'immenses aloès aux feuilles massives et charnues. Les lauriers-roses plient sous les grappes trop lourdes de leurs bouquets vénéneux. Par cet après-midi d'été finissant, de la terre surchauffée montent des senteurs plus grisantes que le moût des cuves, comme on en respire au printemps, à Florence, dans l'atmosphère sursaturée du Mercato Nuovo. On a l'impression d'avancer au milieu d'une serre où des pollens flotteraient dans l'air embrasé. Et par-dessus tous ces effluves, l'olea fragrans verse son arôme puissant. Aucun arbre en fleur ne dégage une odeur plus subtile, plus pénétrante, plus délicieusement voluptueuse que cet olivier d'Extrême-Orient qui s'est acclimaté au bord des lacs italiens, où il fleurit en septembre. Un seul arbuste suffit à embaumer tout un jardin; en approchant de son feuillage, on est environné d'un invisible encens; au soir tombant, la senteur est si forte qu'elle vous étourdit.
À chaque pas, au travers du fouillis de verdures qui borde le chemin, des échappées magnifiques s'ouvrent sur Bellagio, diamant que fait ressortir le saphir des trois lacs qui l'enchâssent, et sur les bourgades assoupies au bord de l'eau, dans un éblouissement de soleil. On aperçoit des villas blanches et roses, des maisons de plaisance au milieu de jardins et de beaux ombrages.
Devant moi, des bourdons fusent, puis retombent sur le sol. De petits lézards fuient à mon approche, se blottissent dans un trou de muraille et me regardent de leurs yeux luisants. Des pigeons marchent sur le gravier du chemin, pesamment, n'ayant pas la force de s'envoler, comme ces colombes dont parle Maurice Barrès, qui, demi-ivres des parfums accumulés sur les terrasses des îles Borromées, se levèrent d'un vol si lent qu'on aurait pu les prendre avec la main. De chaque côté du sentier, les fleurs penchées ont des langueurs d'amoureuses exténuées. Au sommet de leurs tiges, les cannas s'ouvrent tout grands aux caresses de l'air. De l'écorce brûlante des pins coulent de chaudes larmes de résine. Des mouches cantharides étalent sur les feuilles leurs ailes vertes, immobiles. Une buée d'or enveloppe les pointes des cyprès qui semblent vibrer dans l'atmosphère métallique. Des arbres tapissés de vignes vierges saignent ainsi que des chairs déchirées; d'autres, couverts de lierre et piqués de roses grimpantes, rappellent les portiques fleuris de Mantegna.
Sur la plus haute terrasse, à la cime même du promontoire d'où l'on embrasse les rives du lac ainsi que de la proue d'un navire, un vaste apaisement règne. Des pins parasols découpent sur le ciel leur élégante silhouette et font un encadrement délicat à ce paysage de lumière. Au-dessous d'eux, les jardins s'estompent dans une poussière bleue. Les troncs décharnés des oliviers se détachent sur le ciel, plus noirs encore; mais l'ombre de leur feuillage frémissant a toujours la même douceur virgilienne; quand le vent souffle, des ondes argentées se propagent à travers les branchages mouvants. C'est l'heure étale où le soleil incliné semble s'attarder à plaisir et s'arrêter avant de disparaître, comme s'il voulait immobiliser, pendant un instant, le somptueux décor qu'il illumine. L'immense nappe liquide reflète, ainsi qu'un miroir, les tons d'or et de cuivre que le déclin du jour met sur les choses. L'eau moirée de rides est pareille à un taffetas changeant; là où donne le soleil, elle luit comme un bouclier damasquiné, couvert d'écailles brillantes. Au loin, les montagnes se nuancent de teintes opulentes, se revêtent d'une paroi de métal étincelant. Sur les rives vermeilles, les bourgades reposent au milieu de halos lumineux. Tout près, Varenna, au débouché du val d'Esino, s'étend dans la fraîcheur de ses jardins. Le Fiume Latte est tari par les chaleurs; mais on devine encore la traînée du torrent qui descend, au printemps, en une cascade aussi blanche et aussi écumeuse qu'un ruisseau de lait. Près de l'eau, sur la voie ferrée taillée en plein roc, à côté de la route du Stelvio qui serpente en corniche au bord du lac, un train se hâte vers Colico; vu d'ici, il est tout petit, pareil à un jouet d'enfant; il s'engouffre dans les tunnels successifs, si courts parfois que la machine en sort avant que les derniers wagons s'y soient engagés. Vers le nord, de minces lignes claires permettent de deviner les villages lointains, tassés le long des rives comme des troupes de mouettes, Rezzonico et son vieux château, Gravedona, Dervio au pied du Legnone pointu. Un bateau blanc se dirige lentement vers Menaggio, laissant derrière lui un triple sillage qui va s'élargissant sans cesse. Du côté de Lecco, l'eau d'un vert uni, semblable à des émeraudes fondues, rappelle la poétique image de Dante, le fresco smeraldo in l'ora che si fiacca; du côté de Bellagio, au contraire, le lac étincelle aux derniers rayons.
Mais le soir tombe, il faut descendre. Avec le jour qui meurt, les parfums des fleurs se sont encore développés. Jamais la nature ne parle plus aux sens que par un crépuscule d'été. Le charme des matins, comme un amour de jeune fille, est tissé de tendresse légère et de pureté; la splendeur des après-midi est lourde de volupté. L'aube est joyeuse et candide; les couchants sont ardents et langoureux. Les touffes de lierre, les guirlandes fleuries pendent aux arbres, nonchalantes et lascives, comme des bras de bacchantes endormies. Dans mon exaltation qui croît peu à peu, j'ai l'illusion de me promener au milieu des jardins d'Armide; les couples enlacés que je rencontre deviennent les héros du Tasse oubliant le monde dans le délire amoureux. C'est que ces jardins, ainsi que la plupart de ceux qui se mirent dans ce lac, ne sont point inertes; tant de désirs y promenèrent leurs fièvres, tant de vices s'y abritèrent, tant de passions errèrent sous leurs verdures complaisantes, qu'ils sont comme saturés de ferments voluptueux. Ah! que Jean-Jacques eut raison d'abandonner sa première idée de placer ici les scènes de la Nouvelle Héloïse! La lutte héroïque, que Julie doit soutenir si longtemps contre l'amour défendu, aurait été par trop inégale. La nature, surtout cette nature encore soumise au vieux Pan, est la conseillère la plus dangereuse, l'auxiliaire la plus redoutable, la complice la plus insinuante des amants. Elle enseigne l'asservissement aux forces brutales. Il fallait toute la candeur du Poverello et de ses compagnons de la Pordoncule pour ne pas trouver Satan dans les allées ombreuses des bois italiens.
Sous le grand chêne vert, qui ombrage la terrasse près de la villa, je m'accoude à la balustrade de marbre dont les veines rouges semblent gonflées de sang. Entre les branches de l'arbre, au travers du rideau de feuilles qui s'interpose comme le premier plan d'un décor de théâtre, je vois les deux anses du lac palpiter sous l'ardente lumière. L'eau est pareille à de l'or en fusion, or miroitant jaune et roux. C'est le soleil qui, quoique disparu, produit encore cette magie, en éclairant des nuées qui flottent dans le lointain, au-dessus du mont Generoso. Les nuages, d'un cuivre éclatant, donnent au lac des lueurs fauves; les coins où le ciel est à nu rayonnent d'une clarté diffuse qui teinte l'eau de reflets plus clairs. Admirable symphonie! Le peintre qui la mettrait sur la toile serait traité de fantaisiste; dans la nature comme dans la vie, la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Entre les bras de Côme et de Lecco, la Brianza étale ses prairies, ses vignes, ses mûriers, ses oliviers, véritable jardin suspendu émergeant d'un bain d'or fluide. De nombreuses maisons aux toits rouges la parsèment. On aperçoit les jardins célèbres aux noms chantants, Melzi, Poldi, le parc de la villa Giulia et ses bosquets de camélias qui s'endorment dans la mollesse de l'air. Dominant le plateau et les rives, des collines aux courbes gracieuses s'élèvent, bondissent les unes sur les autres, vagues soudainement figées.
Peu de panoramas sont aussi séduisants. Certes, Florence, vue de Fiesole ou de San Miniato, et la douce vallée ombrienne contemplée, à Pérouse, du Giardino di Fronte, donnent des émotions plus profondes; mais, à coup sûr, il n'est pas vision plus voluptueuse. Peut-être même pourrait-on lui reprocher d'être trop belle. L'émoi causé est trop violent, trop physique. Nos sens sont entièrement pris par la langueur qui se dégage des choses, de cette eau surtout qui revêt le paysage de je ne sais quelle grâce féminine.
Peu à peu, la nuit est tombée. L'horizon s'est drapé de voiles soyeux. Une buée invisible est montée de l'eau, estompant les reliefs, enveloppant les rives de souples velours. Les collines se sont resserrées autour du lac. Des écharpes de vapeur flottent à la cime des arbres. Le ciel sans lune est criblé d'étoiles que l'humidité de l'air fait briller d'un éclat inaccoutumé. Les Pléiades, haletantes encore de la poursuite d'Orion, scintillent d'un frémissement précipité. La voie lumineuse ruisselle, pareille à une traînée de lait éblouissant. La soirée est très chaude. On entend le halètement d'un bateau qui s'éloigne vers Menaggio, resplendissant d'électricité. Puis le calme se fait, absolu. À peine, par instants, le vol maladroit d'une chauve-souris et le bruit inlassable du flot qui se casse au rivage. Du ciel argenté tombe une cendre bleuâtre sur les jardins dont les effluves montent toujours en ondes lourdes. Bellagio s'endort dans les parfums...

Il marcha longtemps sous les arceaux de verdure d'une allée touffue; puis, l'ombre étant trop épaisse et trop fraîche, il s'assit au bord d'une prairie ensoleillée, contre le tronc d'un vieux chêne. Des cyprès, devant lui, montaient haut dans le ciel et s'y découpaient en lignes nettes; leurs cimes, bruissant continuellement d'un murmure sonore, lui rappelèrent un vers de Théocrite qu'il se plut à répéter à haute voix. Parfois, quand le vent cessait tout à fait, mille bruits presque imperceptibles lui arrivaient. Un gland tombait. Une mouche volait près de lui avec un bourdonnement musical. De lourdes guêpes s'enfonçaient d'un vol bruyant dans les calices des fleurs. Un scarabée soulevait une feuille morte. De petits papillons blancs le frôlaient au visage, remuant avec peine leurs ailes souples et silencieuses, déjà exténués par la chaleur. Il ferma les yeux. Et, peu à peu, il fut pris d'une de ces émotions étranges, dont on ne peut dire la cause et qu'on essaie vainement de surmonter. Comme en un songe prestigieux, tout ce qui l'entourait avait disparu. Par l'effet d'un mirage subit, pareil à cette fata morgana qui se produit, à certains jours de grande lumière, sur les côtes de Reggio, et transporte les marins éblouis vers d'irréels rivages, il se retrouvait sur la terrasse brûlée de soleil où, souvent, pendant les longues journées d'août, il restait allongé et rêvait. Il ressentait le même émoi qu'alors, cet émoi inexplicable, sorte d'effroi panique, qui vient de l'immobile clarté de midi, du silence absolu des choses environnantes, de la torpeur complète de la nature. Les souvenirs d'enfance reviennent souvent ainsi, avec la plus extraordinaire netteté. Un souffle, un parfum, le son d'une voix, une sensation de bien-être et de chaleur suffisent pour vous rappeler un de ces instants passés; et, tout aussitôt, comme par un déclenchement automatique, vous voyez, vous sentez, vous attendez, comme vous avez vu, senti, entendu à cette minute-là. Il semble que le cœur batte des mêmes palpitations. Devant vous, toutes choses sont comme alors. Le même arbre incline la même branche. La même rose trop lourde s'effeuille. Le même nuage fait la même ombre mobile sur l'allée. La même haie de jasmins envoie la même odeur discrète et suave. Les mêmes cloches lointaines sonnent au même clocher... Et une envie de pleurer vous prend, car toujours ces réminiscences sont accompagnées d'une mélancolie poignante et grave qui va parfois jusqu'à l'angoisse. Est-ce un regret de ce qui fut et plus jamais ne sera? Est-ce qu'entre ces deux points identiques et pourtant si éloignés, nous souffrons de ne pouvoir saisir nos transformations intermédiaires, depuis l'enfant simple et bon que nous fûmes jusqu'à l'être compliqué que nous sommes? Est-ce tout simplement que la nature laisse des traces ineffaçables à cet âge avide où elle nous apparaît transfigurée par notre jeune imagination, peuplée de nos rêves et de nos chimères, à cet âge où le jeune Ruskin émerveillé, contemplant la plaine de Croydon s'écriait que les yeux lui sortaient de la tête? Toujours est-il que cette seule impression de campagne ensoleillée et silencieuse suffisait souvent à René pour lui rappeler la terrasse de la maison familiale d'où s'étaient envolés ses premiers rêves d'enfant. De même, il ne pouvait, au printemps, respirer le parfum des violettes sans revoir devant lui, avec une netteté qui allait jusqu'à l'illusion, le parc de son lycée au bord du Rhône, le grand parc qui lui paraissait alors un monde, et dont les longues allées, ombragées de marronniers aussi vieux que les vieilles murailles, prenaient des aspects redoutables et pleins de mystères... Ah! souvenirs d'enfance, pourquoi revenez-vous ainsi?

Je ne sais si Stendhal alla souvent à Parme et bien des invraisemblances dans son roman peuvent en faire douter; ce qui est certain, c'est qu'il n'oublia jamais le Corrège. "Qui n'a pas vu ses œuvres, déclare-t-il, ignore tout le pouvoir de la peinture. Les figures de Raphaël ont pour rivales les statues antiques. Comme l'amour féminin n'existait pas dans l'antiquité, le Corrège est sans rival. Mais, pour être digne de le comprendre, il faut s'être donné des ridicules au service de cette passion." Et voilà bien le secret de son admiration. S'il est vrai que, pour comprendre le Corrège, il faut s'être donné des ridicules au service de l'amour, nul n'était mieux qualifié que lui. Quand il passa pour la première fois à Parme, le 19 décembre 1816, et qu'il y découvrit les "fresques sublimes", il arrivait de Milan, les yeux, le cœur, l'esprit tout pleins de l'une des femmes qu'il a le plus aimées et qui jouèrent le plus grand rôle dans son existence. Il ne songeait qu'à cette Métilde Visconti ni qui lui avait paru "ressembler en beau à la charmante Hérodiade de Léonard de Vinci." Se doutait-il alors que, pendant neuf années, elle serait la plus ardente passion de sa vie, que, pendant neuf années, il mendierait son amour comme un affamé du pain, et qu'elle mourrait sans qu'il ait pu la posséder? Peut-être, inconsciemment, avait-il de tout cela une vague et secrète appréhension quand il déclarait, avec un amer regret, "qu'il n'avait jamais eu le talent de séduire qu'envers les femmes qu'il n'aimait pas du tout." Jamais, en tout cas, ne s'effaça le souvenir des vierges d'Allegri. Le 6 mai 1817, il fit le voyage de Corregio pour visiter la patrie du grand homme; il fut heureux d'y rencontrer "ses madones avec leurs beaux yeux si tendres qui courent les rues déguisées en paysannes." Et je crois bien que, tout en évoquant les rives langoureuses du lac de Côme, il revoyait la grâce des héroïnes corrégiennes, lorsqu'il trouvait des accents si émouvants pour rendre l'exaltation qui agitait la Sanseverina.
D'ailleurs, où cultiver mieux les passions de l'amour que dans cette ville de Parme, entourée de beaux remparts ombragés d'où l'on domine un immense horizon qui appelle le rêve et d'où la pensée, que n'arrête nulle barrière, peut s'élancer vers l'infini? Où songer mieux à la volupté que dans ce parc de la citadelle, où Stendhal enferme Fabrice del Dongo, et, mieux encore, sous les vieux marronniers du jardin de l'ancien palais ducal, où l'épouse trop oublieuse de Napoléon promena ses tardives ardeurs? Comme il vient vite aux lèvres le vers divin de Dante:
Et comme elle est douce cette soirée d'été finissant dans les allées désertes! Sur les gazons, fleuris au printemps de pâles violettes, les grandes feuilles mortes découpées mettent un vêtement de rouille où luisent, par places, les taches dorées de l'oblique soleil. Perpétuant les deuils anciens, de lourdes glycines éveillent la mémoire des hôtes dont le souvenir rôde sous les bosquets. Au milieu d'une île qu'entoure un lac artificiel, s'élève un petit temple d'Arcadie chargé de nous rappeler, lui aussi, la fragilité des jours heureux. Ah! pourquoi donc, maintenant, ne puis-je chasser de mon esprit les vers de Laurent de Médicis, ce refrain du Triomphe de Bacchus et d'Ariane:
Est-ce la tristesse du soir tombant? Est-ce la langueur de l'automne proche qui fait se serrer plus fort les mains? Mais, penché sur le lac, me voici rassuré. L'eau calme m'a renvoyé l'image tranquille du bonheur.

Me voici donc au terme de ma route; et demain, je remonterai vers Venise, fidèle à l'annuel rendez-vous des noces de l'Automne et de l'Adriatique... Ah! quand on s'embarque, dans l'affairement du départ, au milieu du tumulte de la gare, quand on serre les mains des amis qui vous souhaitent bon voyage tout en vous enviant, il ne semble pas que cela doive être si court. On a tant de choses à voir, tant de villes à visiter, tant de joies en perspective! Et voici que tout s'est déroulé si vite, si vite, qu'on a l'impression d'avoir assisté à une séance de cinématographe... Dans quelques jours je repasserai les Alpes, le cœur serré par ce regret de quitter l'Italie qui étreignit jusqu'à Mme de Staël, et redisant après elle le vers qui lui vint aux lèvres, tandis qu'elle gravissait les lacets de la route du Cenis:
Je ne m'étais arrêté qu'une fois à Rimini, il y a quelques années, entre deux trains, voulant avoir une idée du temple d'Alberti que je désirais depuis longtemps connaître. J'allais vers l'Ombrie, et je me souviens, ce même jour, d'un admirable crépuscule sur l'Adriatique et d'une entrée nocturne à Ancône... Il m'est facile d'en retrouver la date: c'était au mois d'août 1905, un jour d'éclipse de soleil. Je me vois encore sur la petite place de San Francesco, rassurant de mon mieux un groupe de vieilles femmes qui se lamentaient et s'affolaient à mesure que la lumière s'éteignait... Oh! devant cet arc d'Auguste, sous lequel plus de vingt siècles défilèrent, que sont quelques misérables années? Mais, pour nous, elles comptent autrement, tout au moins tandis que nous sommes encore, suivant l'image de Dante, parmi les vivants de cette vie qui n'est qu'une course à la mort,
Sur cette terre italienne, où tout est joie et volupté, où les heures coulent ainsi que de belles fontaines dont on voudrait pouvoir arrêter le cours, comme les jours passent, surtout lorsque la vraie jeunesse est finie, dès qu'on ne se borne plus à regarder devant soi et qu'on commence à se retourner! Tout à l'heure j'ai relu, sur la tombe d'Isotta, le sage avertissement: Tempus loquendi, tempus tacendi. Un jour vient, peut-être proche, où il n'y a plus qu'à se taire...
Avant que la nuit tombe, j'ai voulu revoir l'Adriatique qui, tant de fois, berça de son murmure mes rêves et mes espoirs. Tartanes et balancelles reviennent deux à deux, comme des couples amoureux, repliant leurs belles voiles lumineuses. Elles disparaissent derrière le môle où s'allume un feu. Avec le jour qui meurt, une brise tiède se lève, effleurant la peau comme une caresse. Ah! soirée de septembre sur la mer, triste douceur... Je ne sais quoi de grave est autour de nous. Le calme est tel que nous entendons battre nos cœurs. À peine, par moments, l'imperceptible bruit du flot qui se casse sur le sable mou. Et voici que, sans qu'on l'ait vu venir, la nuit est là. Une à une s'allument étoiles et planètes, tous ces astres que nous ne connaissons pas, dans nos villes aux maisons trop hautes, aux lueurs aveuglantes, et qui, en voyage, semblent vivre avec nous et nous suivre amicalement. Sur la rive, quelques lumières clignotent. Le son grêle d'un piano vient du grand hôtel déjà à peu près déserté. Une dernière barque rentre au port, glissant sur l'eau, silencieuse, comme un chat qui ferait patte de velours. Ah! soirée de septembre, triste douceur...

Comment est-elle autant délaissée des touristes, cette Pieve di Cadore si pittoresque et si curieuse? Certes, l'auberge y est médiocre et les richesses artistiques presque nulles; mais peu de bourgs d'Italie peuvent se vanter d'une plus jolie situation. La ville est bâtie sur une sorte de coteau aux mamelons verts, tout fleuris de jardins, au milieu de pelouses et de bois. Pas un chemin, pas une rue qui ne monte et descende, tourne et retourne. L'unique petite place est elle-même en pente et de guingois; c'est tout juste si l'on a pu trouver un étroit terre-plein pour y dresser la statue de Titien sur le plan du vieil hôtel de ville qui, lui aussi, est de travers par rapport aux édifices qui bordent la place. Ceux-ci ont gardé leurs antiques et simples façades. À Pieve, le modernisme n'a rien gâté. On trouve encore, dans quelques régions de l'Italie, des coins qui n'ont pas bougé depuis des siècles, et dont les habitants conservent, comme le dit M. Paul Bourget, "un instinct de durer et de faire durer que l'exécrable manie d'être au courant ne détruira pas de sitôt."
Un peu en contre-bas de la place, est la maison où naquit le plus illustre et le plus grand des peintres vénitiens. Nul décor n'était mieux fait pour exercer et séduire l'œil de celui qui devait être le premier des paysagistes et le maître incontesté de la couleur. Bâtie sur des hauteurs qu'entourent collines et pics, Pieve offre une incomparable variété de panoramas. Les jeux de lumière et d'ombre changent à chaque instant; le regard s'habitue à en saisir toutes les fugitives nuances. Chaque année, lorsque juillet torride faisait monter des canaux de Venise leurs miasmes de fièvre et leurs odeurs de soufre, ah! comme Titien avait la nostalgie de ces montagnes, de ces forêts, de ces prairies si reposantes aux regards fatigués! Pareil à ce prisonnier de Milton, qui, s'évadant un matin d'été, aperçoit dans la campagne mille choses ravissantes qu'il n'avait jamais remarquées, il éprouvait une joie d'enfant à découvrir de nouveau la nature. En sortant de chez lui, il gravissait la colline qui domine le cirque de Pieve et porté l'antique citadelle, gardienne du Cadore. Des chemins qui en font le tour, on a une série d'échappées sur les vallées qui s'allongent, à perte de vue, entre de hautes murailles vertes. De nombreux villages s'échelonnent comme des grains de corail le long du clair ruban des routes qui vont vers Auronzo, Bellune ou Cortina. Toutes les pentes sont tapissées de prés et de bois. La campagne n'est pas divisée en champs de cultures diverses; elle ressemble à un parc que l'on aurait dessiné ou plutôt conservé intact, tel que la nature le fit. Derrière les premiers coteaux, les montagnes surgissent. Et, vers le nord, les dominant toutes, se dressent les cimes dolomitiques de la chaîne des Marmarole,
comme les appelle Carducci, gigantesque barrière de trois mille mètres qui protège Pieve contre les vents froids.
Ces Marmarole, Titien pouvait les contempler des fenêtres mêmes de sa maison. Par-dessus les toits du village et les premières hauteurs boisées, leurs arêtes se découpent sur le ciel d'une luminosité presque toujours intense. Il les voyait se vêtir dans l'aube de teintes pâles aux tons laiteux, et, le soir, flamboyer au crépuscule avec des reflets d'incendie. Mais ce n'étaient point seulement ces cimes dentelées qui séduisaient et hantaient son imagination. Tout le paysage cadorin revit dans ses œuvres: les rocs à pic où s'accrochent de maigres sapins, les prairies, les bois sombres, les villages sur les hauteurs ou le long de la Piave, et surtout les beaux types musclés des montagnards adonnés à l'exploitation des forêts. Les paysans qui rentrent du travail n'ont pas changé depuis le temps où il les peignit; ils se meuvent en quelque sorte dans l'éternel, suivant un rythme séculaire. Ils ont toujours la tête forte et la barbe puissante de ses apôtres. À l'auberge, un notable de la ville, qui discute avec un de ses fermiers, a les traits nobles, le vaste front, le poil rude, le regard aigu que Titien se donna dans ses portraits de Florence et de Berlin. Ah! comme il est bien de cette race qui, sur la route de Venise à Augsbourg, joint l'énergie du Nord à la finesse méridionale, de cette contrée où l'air vif, les habitudes de travail et de frugalité assurent de robustes santés! C'est un vrai fils du Cadore et ses compatriotes ont le droit de l'honorer. Après avoir mis une plaque sur l'humble maison où naquit "celui qui par l'art prépara l'indépendance de sa patrie," ils lui élevèrent un monument sobre et de bon goût,—une des meilleures statues modernes que je connaisse,—avec cette simple inscription: "À Titien, le Cadore."
La région n'est pas riche en œuvres du maître; mais qu'importe! À Pieve, je ne suis pas venu chercher ses tableaux, mais son pays, le pays sur lequel ses yeux s'ouvrirent à la beauté du monde, où son âme d'artiste s'éveilla. C'est ici qu'il vécut dans les champs et les bois qui sont, pour qui les comprend, la meilleure école de vérité et de simplicité. La nature a toujours enseigné le goût du sincère, la haine du factice et du maniéré; Titien, l'un des premiers, l'aima et la peignit avec toute sa foi et toute son ardeur de paysan.
Par cette fin de bel après-midi d'été, dans cette Pieve où flotte une bonne odeur de saine campagne, le long des prairies émaillées de trèfles rouges, de sauges d'un beau bleu foncé, de colchiques et de boutons d'or, comme je comprends l'âme et l'œuvre du grand Cadorin! Montagnard au cœur solide, qui, presque centenaire, peignais encore d'une main assurée, c'est ici que je me plais à t'évoquer, mieux que dans les salles froides d'un musée, mieux qu'à Venise même où nul pourtant jamais n'éclipsera ta gloire. Tes plus pures joies, c'est ici que tu les éprouvas, au milieu de ces paysages que tes yeux d'enfant avidement contemplèrent, sur ce sol auquel t'attachaient toutes les racines de ton être, dans cette petite ville où le peintre illustre de la République Sérénissime, familier des plus grands, devant qui avaient posé les doges, les rois, les empereurs et les papes, n'était plus que le fils de Gregorio Vecellio. Il n'est pas de plus intime bonheur pour les hommes arrivés au faîte des honneurs que de revenir, chaque année, dans le village où ils naquirent. Loin de la vie factice, ils retrouvent la nature et la terre, avec lesquelles on n'a plus à jouer de rôle et devant qui tous sont égaux. C'est à Pieve, lorsque des revers l'assaillaient, que Titien retrempait son âme meurtrie et qu'il puisait en lui-même la force de lutter encore, pareil à ces arbres des forêts auxquels Dante, en une magnifique image, compare les ressorts de l'âme, à ces arbres qui se relèvent par leur vertu propre après la tempête,
Malgré tous les honneurs et toutes les somptuosités de Venise, c'était ici, dans cette modeste demeure, qu'il se sentait le mieux chez lui; et, comme l'Arioste sur sa maison de Ferrare, il aurait pu faire graver: Parva, sed apta mihi...
Comme la vie est bonne et la nature belle! Il suffit de savoir en jouir sans excès, dans le parfait équilibre des facultés. Les montagnards ont l'œil et l'esprit précis; ce sont des réalistes, avec pourtant ce désir d'idéal que leur donne la vue des cimes constamment tendues vers le ciel. Chez Titien, ne cherchez ni la profondeur de pensée d'un Léonard de Vinci, ni les visions grandioses et pathétiques d'un Rembrandt ou d'un Michel-Ange; n'y cherchez pas les effusions de ces purs lyriques qui, comme le Corrège, laissent simplement chanter leur cœur et nous émeuvent de leur émoi. Titien domine ses sujets et les soumet à son art avec une puissante et calme intelligence, une volonté, une maîtrise de soi qui lui permit d'exceller dans tous les genres. Son visage, ses traits, son aspect général étaient plus d'un homme d'action que d'un artiste. Ce n'était pas un rêveur. Nous le savons soucieux de ses intérêts comme un campagnard. Certes, ces tempéraments à base de raison pratique ne nous donnent jamais d'aussi intenses émotions que les poètes et ne nous entraînent pas à leur suite, haletants, vers les régions du mystère et de l'infini; mais ils enchantent l'esprit sans le troubler. Ils se servent de l'art pour nous dire la beauté des choses et la volupté de vivre. Enfantées dans la joie, leurs œuvres expriment et répandent la joie. Enseigner le bonheur: est-il meilleure destinée?
Mais déjà le soleil a disparu. Les cimes seules sont encore éclairées. Les Marmarole rosissent, puis, peu à peu, passent du rouge tendre au rouge ardent, se teignent de pourpre éclatante, semblent entrer en incandescence. C'est le crépuscule, l'heure magnifique que Gabriel d'Annunzio appelle justement l'heure de Titien "parce que toutes les choses y resplendissent d'un or très riche, comme les figures nues de cet ouvrier prestigieux, et paraissent illuminer le ciel plutôt qu'en recevoir la lumière." C'est ici que Titien emplissait ses yeux de ces reflets fauves qui flottait sur les objets comme les cheveux de la belle Flora sur sa divine chair. Et quand la nuit tombait, quand la dernière lueur s'éteignait sur le dernier pic des Marmarole, il regagnait paisiblement la vieille maison paternelle et bientôt s'endormait avec elle d'un bon sommeil de paysan laborieux.

En quittant l'église de Conegliano, j'ai grimpé jusqu'au château que j'apercevais tout rose dans la clarté vermeille. Il faut prendre d'étroites rues tortueuses, sans trottoir, aux cailloux pointus, passer sous des arcades et des voûtes qui semblent prêtes à tomber, monter des escaliers en ruines. De lourdes portes s'ouvrent sur de minuscules jardins. Des visages s'encadrent dans des fenêtres fleuries de géraniums. De loin en loin, quelques modernes devantures de magasins, malgré leur aspect misérable, ont l'air d'être étrangères dans les ruelles désertes où l'on a presque peur du bruit que l'on fait. L'âme du passé flotte autour des anciennes demeures. Rien n'est poignant comme ces intérieurs d'antique cité où rien n'a bougé; le contraste frappe surtout lorsque, au sortir des quartiers neufs tout radieux de s'étaler au soleil, on pénètre dans la ville d'autrefois qui étouffa pendant des siècles entre la colline et les remparts. Les façades y prennent, comme les vieillards, ces visages où se lit, avec la tristesse d'avoir vu trop de choses, une pensée sans cesse tournée vers la mort. Après les dernières maisons, on monte le long des murailles roussies qu'une chaude lumière console de leur abandon. Entre les pierres disjointes, poussent ces herbes fines et ces mousses qui croissent seulement dans la solitude.
De la terrasse qui précède le château, on découvre une magnifique vue sur la plaine trévisane et la vallée de la Piave, dont le cours se ralentit à l'approche des lagunes qu'on aperçoit à l'horizon, par les temps clairs. Au-dessus des champs flotte déjà la délicate brume de Venise. Au nord, le regard s'étend jusqu'aux premiers contreforts des Alpes, sur une série de verdoyants coteaux et de montagnes boisées, parsemées de villas et de bourgs groupés autour des campaniles. Les versants sont couverts des vignobles célèbres qui donnent un vin légèrement pétillant et parfumé. Au loin, le soleil qui meurt dore un de ces gros nuages cotonneux, où les Grecs croyaient que les immortels se cachaient pour mieux traverser l'azur, et qui servirent ensuite aux peintres de toutes les écoles pour représenter les scènes où Dieu descend sur terre. Les rayons glissent entre les créneaux et les arbres comme de souples écharpes de rêve. Les cimes des hauts cyprès, sous le vent qui peu à peu s'apaise avec le soir tombant, se balancent à peine sur le ciel éblouissant, pareilles aux mâts d'un navire doucement bercé par une mer calme. C'est l'heure irréelle où les choses se parent de toutes les gammes lumineuses du rose, de ce rose fugitif et passager, qui n'est pas une vraie couleur et rappelle la teinte incertaine de ces fleurs si peu colorées qu'elles semblent, dans un bouquet de fleurs rouges et blanches, comme un reflet adouci des unes et des autres.
À travers les grilles, la cour intérieure du château sourit si aimablement que j'ai envie d'y pénétrer. Une légère buonamano a raison des scrupules du gardien. Nous pourrons rester jusqu'à la nuit dans ce vieux jardin si évocateur avec ses cyprès, ses lauriers-roses, ses murailles de briques rouges qui s'avivent aux dernières lueurs du jour. Les allées sont étroites et mal entretenues; mais peu à peu, le jardin s'agrandit. Une brume impalpable monte de la terre chaude, estompe graduellement les formes, met du mystère autour de nous. Avec l'ombre, l'amour prend je ne sais quelle subite gravité; les mains s'étreignent avec plus de ferveur. Émouvante langueur des soirs italiens dans les parfums! Ah! douceur d'être deux quand tout s'efface et semble mourir pour quelques heures! Sans un cœur près du mien, je ne pourrais attendre la nuit dans ce jardin. Et je songe au vieux Dumas qui, à la fin de son Voyage en Suisse, arrivé sur les bords du lac Majeur, éprouve, dès le premier soir, l'effroi de la solitude et trouve cette jolie formule: "Espérer ou craindre pour un autre est l'unique chose qui donne à l'homme le sentiment complet de sa propre existence." Dans le tumulte et l'agitation des jours, nous ne sentons pas notre isolement; mais, vienne la paix vespérale, nous ne pouvons plus le supporter.
Le vent est tout à fait tombé. Le jet des hauts cyprès s'est figé dans le ciel noir. Au loin, une fontaine dit son éternelle et monotone chanson. Tout à coup, un cri rompt le silence. C'est un rossignol attardé que retient sans doute le charme tranquille de ce jardin d'été. Nous ne l'apercevons pas; il doit être dans un massif de lauriers-roses, sur une branche que nous voyons remuer. Il s'essaie d'abord timidement, redit la même note, à mi-voix, comme en un murmure. Il interroge les choses, écoute le silence. Puis, se croyant seul et se grisant de la douceur nocturne épandue autour de lui, il chante à plein gosier. Les trilles se succèdent, plus énergiques, deviennent des cris de joie et de désir. Il lance ses notes éclatantes par intervalles, semblant à chaque reprise clamer plus fort son appel d'amour. Et, toutes les fois, nous frissonnons, comme les amants de Vérone, lorsqu'ils entendaient le rossignol qui chantait sur un grenadier, dans le jardin des Capulets.

Libre, en ce début de mars, pour la é première fois depuis bien des années, je n'ai eu qu'un désir: fuir Paris et voir naître le printemps ailleurs qu'au bois de Boulogne ou au Luxembourg. Je suis parti pour l'Espagne. Je savais bien que la jeune saison n'y devait point avoir les grâces qu'elle revêt en Italie; mais je ne l'imaginais pas aussi rude. J'avais également lu que les deux Castilles n'étaient qu'une suite de plateaux désolés; je n'en pouvais supposer la sévérité et la tristesse. Il faut traverser ces solitudes interminables, desséchées, presque stériles, où, de loin en loin, quelques pauvres villages semblent des tas de pierres, où l'on marcherait des journées entières sans trouver un arbre, pour s'en représenter la désespérante mélancolie et la farouche grandeur. À moins d'une lieue de Madrid, commence une région tellement misérable—véritable désert sans oasis—qu'on l'appelle la steppe castillane. Quand on franchit, à la nuit tombante, les mornes étendues de ces champs de misère, on a comme des visions d'épouvante...
Dès ce premier abord, on comprend mieux l'âme espagnole. On s'étonne moins du caractère d'ardent fanatisme et de renoncement que le catholicisme lui a toujours imprimé, et l'on sent comment une religion de terreur a pu s'adapter si vite et si bien à un pays où la mort est partout, jusque dans les plaisirs. De même,—quoiqu'on doive se méfier de ces trop hâtives déductions—la simple vue de ces âpres paysages explique en partie l'aspect funèbre des peintures de Ribeira, de Zurbaran, des Herrera, du Greco, de Valdès Leal ou de Goya. Velasquez également est le plus souvent douloureux; quand il rit, comme dans ses Buveurs, par exemple, je ne sais pourquoi le rire sonne faux; et cette teinte rousse, où domine l'ocre et le violet, si saisissante quand on entre au Prado, dans la salle de ses chefs-d'œuvre, est celle même de la terre madrilène.
De toute l'Europe, c'est, je crois bien, l'Espagne qui, après la Suisse, a la plus haute altitude moyenne; l'exagération de ce relief lui enlève le bénéfice de sa situation méridionale et rend sa température, sauf sur la côte et dans l'Andalousie, toujours extrême: torride ou glaciale. En ces jours de mars, où les campagnes de l'Ile-de-France sont déjà toutes frémissantes sous les rayons du soleil nouveau, les lignes ferrées courent encore entre deux talus de neige. Il est vrai qu'avant d'atteindre Madrid, soit par Burgos, soit par Saragosse, les voies doivent s'élever à douze ou quatorze cents mètres, c'est-à-dire aussi haut que nos plus hauts chemins de fer de montagne... Et je ne tarde pas à m'apercevoir que, pour goûter le printemps, j'ai choisi l'un des rares pays où il n'existe pas. J'avais bâti un château en Espagne. La terre du Cid est une faiseuse d'illusions que je voyais à travers la magie des mots et que j'évoquais dans de chimériques paysages de soleil, de verdures et de fleurs. Mais qu'importe? Je connaîtrai du moins Tolède, où m'attire l'illustre écrivain qui presque nous la révéla. Je n'essaierai pas, cette fois, d'en pénétrer avec lui le secret. Le premier contact avec une telle ville est trop riche d'impressions pour qu'on puisse les analyser et les classer. Une autre année, je reviendrai à Tolède; à la suite du plus émouvant des guides, je poursuivrai le Greco jusque dans les chapelles presque inaccessibles et chercherai à discerner "l'élément arabe ou juif qui persiste sous l'épais vernis catholique." Aujourd'hui, je ne désire avoir qu'une idée générale de la ville et de la campagne qui l'entoure.
La traversée des plateaux de Castille m'a préparé à l'abord hostile de la Ciudad imperial, celle que Juan de Padilla, l'un de ses plus illustres enfants, appelait "la couronne de l'Espagne et la lumière du monde." Pourtant, elle aussi, je ne l'imaginais pas aussi rude. À un tournant de l'avenue ombragée qui la relie à la gare, elle surgit tout à coup, au-dessus du plateau roux et des collines fauves, rousse et fauve elle-même, patinée, calcinée, comme passée au four. Elle est tragique et guerrière; ou, plutôt, on sent qu'elle devait l'être, car, maintenant, elle est bien morte et figée dans son passé de gloire. Ses églises et ses nombreux couvents achèvent de lui donner un aspect de morne sévérité. Ce fut la première impression de Maurice Barrès qui déclare que "le paysage de Tolède et la rive du Tage sont parmi les choses les plus tristes du monde." Quand on cherche à embrasser l'ensemble du roc qui porte l'orgueilleuse cité, on aperçoit une masse indistincte de murs, de toits et de rochers, où tout se confond dans un chaos rougeâtre qu'avive par places l'éclat aveuglant de la chaux et que le soleil écrase de son linceul de plomb. Un lourd silence pèse sur ces ruines brûlantes autour desquelles le Tage lance son bouillonnement farouche. Et, en franchissant le pont d'Alcantara, qui réunit, sans les réconcilier, un portique rococo et une tour mauresque, je songe à une autre guerrière, fauve aussi, qu'encercle de même un torrent, à la rouge Vérone que baigne l'Adige. Mais comme elle sourit à côté de Tolède! Celle-ci évoque plutôt Ravenne, non comme silhouette, mais comme désolation et déchéance: toutes deux ne sont plus que des gardiennes de tombeaux. Entre ses murailles guindées où les fenêtres étroites et grillées ont l'air de meurtrières, la Tolède actuelle est même parfois un peu ridicule. Près de la place du Zocodover, un marchand de parapluies juché sur un âne étique me rappelle que je ne suis pas loin de la patrie de Don Quichotte et de Cervantès.
À Tolède, un soir, devant le rude paysage qu'on découvre du haut de l'Alcazar, Théophile Gautier eut un moment de méditation profonde où, se sentant absent de lui-même et loin de tout, il déclare avoir douté de sa propre identité et n'être revenu à la réalité qu'en prenant un bain dans le Tage, au pont d'Alcantara. Sur ce même pont, où je grillais tout à l'heure, une bise aigre m'enlève tout désir d'imiter le bon Théo. Il suffit d'un nuage et d'un coup de vent pour que le froid remplace la fournaise. Souvent, au terrible et glacial norte qui arrive des plateaux de Castille, succède brusquement le non moins redoutable solano qui apporte toute la sécheresse des déserts africains. Tolède ne ménage guère les transitions. Je n'ai pas remis mon par-dessus que le soleil reparaît et qu'un nuage de poussière m'environne: ce sont les chèvres de la ville qui rentrent en un interminable troupeau. D'où viennent-elles et qu'ont-elles bien pu brouter sur les collines pierreuses où l'herbe rare semble avoir été léchée par un incendie? Pourtant, de l'autre côté de la ville, il y a un semblant de campagne où fleurissent de maigres arbres fruitiers. Je remarque même un champ tout planté de pêchers roses; au milieu de cette âpre nature, ils ont la tristesse des exilés, comme ceux que j'aperçus, l'autre jour, à Barcelone, sur les flancs du sinistre Montjuich. À la teinte plus pâle de leurs fleurs, je reconnais aussi quelques abricotiers: mais comment leurs fruits ont-ils pu acquérir une si lointaine renommée? On compterait facilement les arbres. Peut-être y eut-il un temps où ces contrées furent fertiles: l'Espagne romaine était un des greniers de l'Empire. Aujourd'hui, les paysans disent qu'une alouette, pour traverser les Castilles, doit emporter son grain. Les gens de Tolède en sont arrivés à être fiers de leurs cigarrales, petits enclos brûlés de soleil, séparés les uns des autres par des tas de pierres, pauvres vergers presque sans ombre et plus poussiéreux que les bastides de notre Provence... Où trouver le renouveau avec ses doux bruissements, ses feuilles luisantes, ses bourgeons vernis prêts à éclater, ses herbes naissantes que balance l'air tiède? Le printemps tolédan n'est guère, suivant les caprices du soleil, qu'un hiver qui se prolonge ou qu'un été trop tôt venu...

C'est au milieu des collines Euganéennes, au pied du mont Ventolone qui le protège des vents, qu'est blotti le petit village d'Arquà où mourut Pétrarque. La route qui y conduit s'élève sur les pentes d'un cirque ensoleillé, où les vignes se mêlent aux figuiers et aux oliviers. Dans les jardins, lauriers, camélias et grenadiers poussent en pleine terre, drus et vigoureux.
J'avoue que ce n'est pas sans émotion que je pénètre dans le village du poète; mais je ne croyais pas être si vite près de lui. A peine ai-je fait quelques pas que je me trouve en présence de son tombeau. Qu'elle est saisissante cette place, devant la pauvre façade de l'église, avec ce simple sarcophage de marbre rouge soutenu par quatre colonnes! Du bord de la terrasse, la vue s'étend sur les maisons du village et la campagne. D'un jardin en contre-bas, jaillissent deux cyprès, gardiens immobiles et muets qui veillent sur le cercueil. Au-dessous d'un buste en bronze, une épitaphe nous dit que ce tombeau renferme les ossements de Pétrarque.
N'eût-elle que ce tombeau, Arquà serait immortelle. Mais elle garde jalousement un autre souvenir: la maison où l'amant de Laure vécut ses dernières années. Pour y monter, le chemin est rude; il n'a pas dû changer depuis le jour où l'on descendit le glorieux cercueil, au milieu de la prosternation de tout un peuple, sur ces mêmes pavés, entre ces mêmes murs.
Devant la maison est un petit jardin, d'ailleurs assez récent, puisqu'il ne figure pas sur d'anciennes estampes; mais il n'est pas douteux qu'il devait en exister un presque semblable du temps de Pétrarque. Celui-ci chérissait ses arbres et ses fleurs autant que ses livres, ce qui n'est pas peu dire, si l'on se rappelle quel bibliophile il fut. L'un des premiers, il sentit vraiment la nature, et son surnom de silvanus indique bien ses goûts. Il a rédigé un traité de jardinage des plus détaillés. Une de ses lettres est datée de "l'ombrage d'un châtaignier." Avec l'âge, son amour pour la campagne s'accrut, ainsi qu'il arrive presque toujours. L'éclat des cités bruyantes ne tente guère les regards prêts à s'éteindre; rien n'est aussi doux aux vieillards que les rayons d'un beau soleil. C'est ce qu'a exprimé Byron dans les strophes de Childe Harold où il évoque Pétrarque. "Si c'est dans la société que nous apprenons à vivre, c'est la solitude qui nous enseigne à mourir." Dans plusieurs de ses dernières lettres, le poète nous parle de son jardin, et surtout de l'arbre qui lui fut si cher, le laurier dont le feuillage l'avait couronné au Capitole et dont le nom lui rappelait l'amante inoubliée. Symbole de l'amour et de la gloire qu'il rechercha d'un zèle égal, Pétrarque chanta jusqu'à la fin le charme
Un étroit escalier monte à une petite loggia soutenue par trois colonnes. Tout est exigu dans la maison, ainsi qu'il le fallait pour le vieillard ayant constamment besoin d'un appui à la portée de sa main. L'amant de la solitude n'avait pas hésité entre le palais que lui offrait Venise, en échange du don de ses livres, et le calme asile que lui proposa François de Carrare dans les monts Euganéens. "Oh! écrit-il à un de ses amis de Parme, si tu pouvais voir mon nouvel Hélicon, je suis sûr que tu ne voudrais plus le quitter." La maison, très simple, comprend un vestibule sur lequel ouvrent les différentes chambres; presque toutes ont un balcon d'où l'on embrasse, soit les collines étagées s'abritant l'une l'autre contre les vents, soit, par-dessus les toits du village, la plaine de Battaglia.
La demeure où vécut un écrivain parle toujours à notre sensibilité, surtout quand elle est dans un village, et mieux encore au milieu des champs. C'est que la nature ne change guère, et qu'après plusieurs siècles, nous retrouvons les mêmes montagnes et les mêmes fleuves, et, bien souvent, les mêmes forêts et les mêmes prairies. Peu d'années, au contraire, suffisent à altérer l'aspect d'une ville; et, quand la maison du poète est intacte, autour d'elle, tout s'est modifié. Comment reconstituer la physionomie et l'atmosphère de la Florence où vécut Dante? Tandis que, dans ce village de Pétrarque, rien n'a bougé. Les choses sont restées tellement pareilles que je ne puis, pensant à lui, les regarder sans émotion. Malgré les six siècles qui nous séparent, je vois, de cette loggia, exactement ce qu'il voyait. Par sa précision et son intimité, c'est un des pèlerinages littéraires les plus poignants qui soient. Mais peut-être a-t-il pour moi un charme particulier. Les meilleures journées de ma jeunesse, je les ai vécues au temps des vacances, sur la petite terrasse de la maison familiale qui domine un hameau et un médiocre paysage; j'y ai vu mon père emplir ses derniers regards des mêmes horizons sur lesquels je voudrais un jour fermer mes yeux... Et il m'est facile d'imaginer le poète contemplant le village et les coteaux couverts de vignes, saluant d'un mot aimable les paysans qui passent et ne comprennent pas comment ce vieillard courbé et tout blanc, si semblable aux autres vieillards, peut à la fois être si simple et si glorieux.
Ah! qu'elle est pathétique, cette maison où il vécut ses ultimes jours, tandis que la mort s'avançait vers lui! Mais que ne l'a-t-on conservée intacte, ou même vide, au lieu d'y avoir accumulé pêle-mêle les objets les plus divers et jusqu'à la momie de sa chatte préférée! Heureusement, à côté de la chambre à coucher, on a respecté la petite bibliothèque où Pétrarque aimait à se retirer. Là, il était tranquille et isolé. Il échappait aux importuns, aux visiteurs, à tous ceux qui interrompaient ses travaux. "Lire, écrire, méditer, sont encore, avoue-t-il, comme dans ma jeunesse, ma vie et mon plaisir. Je m'étonne seulement, après un tel labeur, de savoir si peu." Il sent que les heures comptent double et le pressent. "Je me hâte... il sera temps de dormir quand je reposerai sous la terre." Couché très tôt, comme les paysans d'Arquà, il se lève avant eux, au milieu de la nuit, allume la petite lampe suspendue au-dessus de son pupitre, et travaille jusqu'à l'aube. C'est là qu'un matin de juillet, ses domestiques l'aperçurent, courbé sur un livre. Comme ils le voyaient souvent dans cette attitude, ils n'y prêtèrent point attention. Pétrarque était mort. M. Pierre de Nolhac croit avoir retrouvé le manuscrit où s'arrêta sa main tremblante, sur un renvoi aux lettres de Cicéron; il suppose que Pétrarque se leva pour aller vérifier une référence et qu'il s'évanouit en se rasseyant. Je préfère l'ancienne version d'après laquelle sa tête serait retombée inerte sur les pages du Virgile qui ne le quittait jamais, même en voyage. Tous les lettrés connaissent le manuscrit sur vélin, annoté de sa main, qui fait la gloire de l'Ambrosienne. Il me plaît d'imaginer qu'il prit ce volume pour se distraire un instant de son travail d'érudition. Il lut quelques vers du poète qui était né de l'autre côté des collines Euganéennes; il entendit les alouettes lancer leur appel au jour nouveau; et il s'éteignit doucement, avec la nuit, comme une lampe sans huile expire aux fraîcheurs du matin. Ainsi le dernier souffle du chantre de Laure aurait effleuré les vers du cygne de Mantoue...

J'avais entendu vanter les jardins de Châlons-sur-Marne; je ne les croyais pas aussi beaux. Remplis du frémissement de la radieuse matinée d'octobre, ils sont d'une véritable splendeur. Tout est en or, marronniers et platanes, hauts peupliers le long des canaux, pelouses et chemins uniformément recouverts d'un épais tapis de feuilles mortes dont la senteur pénétrante se mêle à l'odeur de la terre mouillée. D'autres feuilles en tombant se sont accrochées aux branches des arbustes qu'elles parent d'une imprévue floraison jaune. De tant refléter d'or, la petite rivière est toute dorée aussi. Seul, un immense hêtre pourpre troue cette symphonie de sa coulée de feu. Puis la féerie continue. La brume se dissipe peu à peu; le soleil pénètre dans les arbres, inonde le sol. C'est l'embrasement de l'or... Je félicite un vieux jardinier; mais il ne sait que s'excuser et se lamenter d'être seul pour lutter contre cet envahissement des feuilles; quand je lui dis qu'elles sont en ce moment la gloire de son parc, il me regarde d'un mauvais œil et s'éloigne.
Émouvante langueur des beaux matins d'octobre! J'évoque ce jardin de Lorraine dont nous parle Maurice Barrès. "Aucun vent, et les feuilles fragiles par un dernier lien tiennent encore aux arbres. Charmante minute immobile, extrême instant de l'âme précaire des jardins." Je sais bien que la nature ne peut qu'ignorer nos angoisses; pourtant il y a des moments où sa sérénité indifférente nous semble un raffinement de cruauté. Et j'ai honte de savourer tant de calme beauté, quand je pense à tous ceux qui, près d'ici, au fond des tranchées, ne voient de ce grave automne qu'un ciel trop souvent inclément. Et je songe aussi à l'ami très cher, tombé de l'autre côté de l'Argonne, à la lisière d'un bois dont les feuilles étaient vertes encore, et qui ne verra pas cet automne... Ah! quelle ironie dans la mélodie de Schumann, que nous aimions tant tous les deux, et qui me revient comme une obsession: "De quelles délices m'ont parlé les bois jaunis..."

À partir de Pesaro, la voie ferrée court le long de la grève, au milieu des cabines et des baigneurs étendus sur les plages au sable luisant. L'eau est si bleue, d'un bleu tellement intense, qu'elle a des reflets de métal et semble un bain chimique où les mains se teindraient d'azur en s'y plongeant. La mer est déjà orientale. Quand le vent souffle du sud-est, il vient directement de Grèce, tout chargé des parfums de la terre antique. Dans les voiles gonflées des tartanes palpite le Levant: jaunes ou rouges, rayées de larges barres brunes, leurs couleurs s'avivent et flamboient sur cette plaque de lapis-lazuli; quelques-unes arborent encore les emblèmes des pirates barbaresques, le croissant ou le soleil. "L'air est si pur que, parfois, aux fins de journées, les montagnes des côtes dalmates se dessinent nettement à l'horizon, à plus de quarante lieues. Je les revois encore, en ce crépuscule de septembre, se dressant comme des terres de rêve au-dessus de l'eau étincelante. Vers Ancône, le ciel était d'un violet sombre et tragique, bordé d'une bande écarlate. Les deux couleurs se heurtaient violemment, sans transition, sans gradation, comme les costumes moitié rouges et moitié bleus des pages du Pinturicchio..." Il me semble qu'elles sont d'hier ces lignes écrites il y a douze ans, lorsque j'aperçus pour la première fois l'Adriatique. Mais j'ai si souvent évoqué ce coucher de soleil que je n'ai qu'à fermer les yeux pour tout revoir, et le ciel, et la mer, et les barques lumineuses, et les nuages éclatants, comme il suffit de porter à l'oreille une coquille marine pour entendre le bruit des vagues qui la roulèrent pendant des siècles. Et je respire encore la brise de cette soirée passée sur le môle désert d'Ancône, éclairé par la lumière frémissante des constellations que, chaque nuit, et presque du même lieu de la terre, Leopardi contemplait "scintillantes sur le jardin paternel."
Avant d'aller voir Gabriele d'Annunzio à Venise, j'ai voulu faire un nouveau pèlerinage aux bords de cette Adriatique qu'il a si souvent et si magnifiquement chantée dans ses volumes de vers que j'ai emportés avec moi. Sur la page de garde de ses Laudi, je relis l'affectueuse dédicace où, de sa noble et haute écriture, le poète souhaite que la vie me soit toujours
Ah! combien je regrette la légende—plus belle que l'histoire—qui faisait naître Gabriele d'Annunzio, un matin de printemps, à bord d'une de ces paranzelle dont les voiles d'ocre et de carmin découpent leur triangle sur l'azur de l'eau ou du ciel! Mais enfin, comme le grand Celte de Saint-Malo, lui aussi était né "au bruit des vagues," au bruit de ces mêmes vagues qui viennent expirer le long de la voie ferrée. Le manteau du beau temps ne recouvrait alors que des campagnes pacifiques et une mer sans danger. Il n'en est plus de même aujourd'hui et je cherche en vain à l'horizon ces voiles dont j'attendais jadis le retour à chaque crépuscule. Depuis de longs mois, les petites villes de la côte ne s'endorment que d'un sommeil léger, sans cesse troublé par les alertes. Pescara notamment a été bombardée à plusieurs reprises. Ce n'est qu'un petit bourg insignifiant, dans un bas-fond, que je ne songerais guère à regarder de la portière, si mille souvenirs ne m'assaillaient aussitôt de toutes parts. Voici la plage où le jeune Gabriele respirait le vent du large. "Ah! quelle douce ivresse coulent dans mes veines les agrestes odeurs mêlées à l'air salin!" s'écriait-il au début de son Canto novo. Toujours la mer lui versa son baume fortifiant. "Divine gardienne, écrit-il, elle ondule devant ma porte; son chant a une vertu inconnue sur l'homme qui sait l'écouter."
Voici maintenant Francavilla, où il composa plusieurs de ses chefs-d'œuvre, près de l'étrange demeure du peintre Michetti; le site est superbe, entre la mer resplendissante et les collines lumineuses que dominent, à l'arrière, les sommets des Abruzzes. Tout autour, se déroulent les décors du Triomphe de la Mort: San Vito, le pays des genêts, l'ermitage qui s'élevait à mi-côte, dans un bosquet d'orangers et d'oliviers, en face d'une baie close par deux promontoires. Il me semble que, si j'errais un instant dans la campagne, je trouverais sans peine la petite maison, au fronton de laquelle Georges Aurispa avait écrit, dans le crépi frais, avec une pointe de roseau: Parva domus, magna quies. Et là-bas, n'est-ce pas Ortone, la blanche Ortone, pareille à une ville asiatique? Elle aussi fut récemment bombardée. Gabriele d'Annunzio la représenta, pendant une législature, au parlement italien. Tandis que le train avait un long arrêt en gare, j'ai tiré de mon sac le roman pour relire la magnifique description d'Ortone embrasée. "La ville en fête illuminait le ciel. Des fusées innombrables, partant d'un point central, se déployaient dans le ciel à la façon d'un large éventail d'or qui, lentement, de bas en haut, se dissolvait en une pluie d'étincelles éparses. On percevait un crépitement sourd, comme d'une fusillade lointaine, entrecoupé de coups plus graves que suivaient des explosions de bombes..." Je me suis arrêté, ne sachant plus si je lisais encore le roman ou le récit du dernier bombardement. Ironie des choses! Au feu d'artifice que regardaient les amants extasiés, ont succédé les lueurs des obus incendiaires. D'innocentes victimes paient la gloire du poète...

Charme des soirs de juin, à travers les rues et les jardins de Sienne! Une infinie suavité flotte dans l'air chargé du parfum des tilleuls en fleurs. Je ne sais quelle allégresse à la fois grave et voluptueuse vous étreint. Sur toutes les terrasses, d'où l'on domine les petites vallées qui s'insinuent entre les avancées de la ville, la bonne et saine odeur de la campagne d'été arrive à chaque souffle. Une telle proximité de la vie urbaine et des cultures n'est pas le moindre agrément de cette cité qui ignore ainsi la laideur des banlieues. Barrès a bien noté ce mélange d'architecture et de nature que l'on trouve si souvent en Toscane et en Ombrie, mais rarement autant qu'ici. Peut-être exagère-t-il, quand il déclare que ces terrasses surpassent en beauté les jardins de Florence, de Pallanza ou de Bellagio; mais comment imaginer plus nobles places que celles "où les femmes de Sienne, en tirant l'eau du puits sous des arbres centenaires, embrassent un illustre horizon?"
Si vous aimez les impressions d'autrefois, allez sur le Campo désert, quand la lune, derrière le municipe, projette sur la place la silhouette immense du Mangia. La façade du palais, noyée d'ombre, prend un aspect redoutable, et la petite chapelle, plus sombre encore, a je ne sais quelle allure de gibet. En face, les maisons allongent leur courbe blafarde que la lune bleuit par endroits. Quelques fenêtres éclairées rappellent que la vie continue. Quand un passant traverse la place, son pas retentit, étrange, sur les dalles. Puis, c'est un lourd silence qu'anime seul le bruit grêle de la Fonte Gaja. Sur ce Campo, dont parle déjà Dante, le passé surgit de toutes parts et vous angoisse. Certes, il y a des coins plus illustres et plus grandioses dans cette Italie où se superposèrent tant de civilisations, sur ce sol où l'on ne peut marcher sans soulever de la poussière d'histoire; mais je sais peu de villes où le rythme de la vie moderne se soit accordé au cadre ancien avec moins de changements. Qu'un enterrement, suivi par des pénitents à cagoule baissée, longe la place et s'engouffre dans une ruelle: vous voilà, sans effort, en plein trecento...
Mais les soirs incomparables de Sienne, c'est dans les jardins de la Lizza et sur les remparts qu'il faut aller les savourer. C'est là qu'il faut écouter la grande symphonie d'un tramonto, lorsque les pourpres du soir tombant recouvrent la campagne et que la ville s'assoupit dans une buée d'or. Faites le tour de l'ancien fort Sainte-Barbe et admirez une fois de plus quels artistes étaient les Toscans de la Renaissance. Quelle majesté et quelle élégance ont ces remparts de brique fauve portant, à chaque angle, les armoiries des Médicis soutenues par des cariatides! Comme les Italiens surent aménager cette forteresse, devenue inutile, pour créer un beau décor! Les fossés ont été transformés en jardins qui, en cette fin juin, resplendissent des lauriers-roses et des grenadiers en fleurs. Entre les verdures, les murs rouges flamboient. Sur les remparts, d'où l'on domine de magnifiques horizons, des allées d'arbres tressent une couronne de somptueux ombrages. Nulle part, je n'ai mieux goûté la magie de la lumière que les yeux avides boivent avec délices. De l'angle sud, on voit, derrière l'énorme vaisseau de San Domenico, toute la ville se profiler sur un fond mordoré. À côté de la tige du Mangia qui semble plus grêle encore, se dressent la tour rayée et la coupole du Dôme, avec l'arc unique et béant de la grande église projetée. Les autres bastions s'élancent vers les champs, dont les ondulations vont en s'estompant jusqu'aux collines qui ferment l'horizon, roses, violettes ou bleues, suivant les heures du jour. Ce soir, elles sont d'un mauve si fluide qu'elles paraissent transparentes. Une longue écharpe dorée flotte sur elles. Des nuages légers se font et se défont à chaque instant.
Une vaste paix s'étend sur la campagne. Des cloches lointaines, auxquelles d'autres répondent, sonnent l'angélus. Puis, toutes les cloches de Sienne, de leur voix proche et plus puissante, redisent le mystère de l'Incarnation. L'air est si limpide que je crois voir s'y propager les ondes sonores. Minute toujours émouvante où les moins religieux pressentent l'infini. Assis sous un chêne vert, en face de la cité mystique, pourquoi, ce soir, ne puis-je détacher ma rêverie du pauvre hameau de Palestine, où se déroula l'humble événement qui allait bouleverser le monde, au point qu'une fraction de l'humanité compta dès lors les années a partu Virginis?
Peu à peu, tandis que je songe, la nuit tombe. Dans la tiédeur de l'air, les parfums s'exaspèrent. Sur la terrasse qui regarde l'ouest, je cherche en vain à sentir la brise marine que les Siennois prétendent y respirer souvent; l'air est trop chargé des lourds effluves des tilleuls. Et voici que déjà commence la féerie des mouches de feu.
Il y a quelques années, j'arrivais à Pérouse par un éclatant crépuscule d'août qui embrasait la campagne et la ville de reflets d'incendie. La poussière même était lumineuse; les moucherons qui la traversaient luisaient comme de mobiles grains de phosphore. Et je m'imaginais que Ruskin avait dû faire, par un soir pareil, cette entrée à Sienne qui frappa si fort son imagination qu'il se la rappelait aux dernières heures de sa vie: "Comme elles brillent, s'écriait-il, comme elles brillent, les mouches de feu! On dirait des parcelles d'étoiles se mouvant derrière des feuilles de pourpre." C'est que jamais encore je n'avais pu venir dans l'Italie centrale en ces mois de printemps finissant qui sont pareils à notre été; j'ignorais le spectacle des étincelles animées qui couvrent, par les nuits de mai et de juin, les campagnes de Rome, de Toscane et d'Ombrie. Anatole France les avait vues jadis sur la voie Appienne, autour du tombeau de Cæcilia Metella, "où elles viennent danser depuis deux mille ans;" il les avait retrouvées le long de la route de Monte-Oliveto, près du puits de Sainte-Claire, où il s'entretenait, pour notre délectation, avec le R. P. Adone Doni. Nulle part, cette vision nocturne n'est, paraît-il, aussi saisissante que dans la campagne siennoise. Par milliers et milliers, les lucioles volent au-dessus des blés mûrs et des prairies, dans les haies et les verdures. Ce sont bien les parcelles d'astres que voyait Ruskin; parfois, quand la nuit est très sombre, lorsqu'on marche au pied d'un coteau dont la ligne se découpe sur le ciel, on a l'illusion d'une pluie de minuscules étoiles. Certains soirs plus chauds, elles sont si nombreuses que l'entrecroisement de leur vol lumineux fait comme un treillis de feu. Ces lueurs sont un appel amoureux. Étrange manifestation de la toute-puissance de l'amour qui, seul, animal ou humain, terrestre ou divin, exalte les êtres et les rend capables de prodiges! Par les nuits de printemps, l'arc enflammé des mouches de feu, dans les jardins de Sienne, clame le même désir que le chant éperdu des rossignols; et tous deux, au fond, participent du pareil besoin de s'unir, de n'être pas seul dans l'infini, qui fait jaillir les cris des amants. Se donner, voilà bien l'acte unique et sublime qui nous élève au-dessus de nous. Le sacrifice de soi en est la plus haute expression. Par ce soir de juin, je songe aux milliers d'êtres humains qui, prêts à bondir hors des tranchées, font d'avance le don d'eux-mêmes à leur pays. Et je comprends mieux la fille du foulon siennois, se jetant, pantelante, au pied du divin époux.

C'est un pauvre printemps de rien du tout, un pauvre petit printemps qui semble encore l'hiver, quand on revient de la Provence en fleurs. Et pourtant, qu'il m'émeut! Là-bas, c'est un printemps de millionnaire, un printemps de parvenu à l'exubérance insolente. Tout y éclot et y verdoie presque en même temps; l'ensemble cache les détails; trop de splendeurs colorées éblouissent à la fois les regards. On s'y promène ainsi qu'à travers ces musées d'Italie où les chefs-d'œuvre se touchent. Ici, c'est comme en un musée de nos provinces françaises où il faut chercher pour découvrir les belles choses; mais combien aussi elles en sont plus belles! Là-bas, on n'a pas même le loisir de désirer; à peine souhaitez-vous une fleur qu'elle s'épanouit. Ici, on connaît les joies de l'attente et la douceur de l'espérance; un bourgeon nouveau est un événement.
m'avait écrit un ami. Les montagnes sont, en effet, toutes blanches. En ce dernier jour de mars, seuls ont fleuri les amandiers, au pied du village abandonné que porte la colline; et la neige est si proche sur les hauteurs voisines qu'on se demande si ce n'est pas de la neige encore qui descend jusque-là.
—Ah! Monsieur, me disent les paysans, tout est en retard; parfois, les amandiers sont en fleurs dès janvier...
Ils disent vrai: tout est en retard. Les boutons roses des pêchers pointent à peine au long des branches; les pétales frileux n'ont pas osé s'ouvrir. Cerisiers et poiriers, dans le verger, sont pareils à du bois mort.
Enfin, ce matin, un tiède soleil luit. La bise, qui soufflait des plateaux glacés du Vercors, s'est subitement apaisée. Le dôme de Glandaz s'arrondit dans l'azur. Au seuil de la ferme, les coqs lancent leurs appels. Des roucoulements langoureux s'échangent au pigeonnier. Une première fauvette chante dans le jardin qu'illumine le rouge éclatant d'un pommier du Japon. Je ne sais quoi me dit que le printemps arrive, le vrai printemps, pas celui du calendrier. Il n'est pas encore là; pourtant c'est lui déjà...
Qu'il fait bon marcher sur la grand'route! Des hauts peupliers tombent, par milliers, les chatons bruns, chenilles fauves sur le ruban clair du chemin. Le ciel se découpe à travers les squelettes tourmentés des noyers. Au bord des fossés, tapissés de violettes et de primevères, la dentelle blonde des osiers s'accroche au bois des prunelliers blancs. Les ramures des ormes, chargées de grains rouges, luisent au soleil comme des chapelets de corail foncé. Tels qu'une nichée de minuscules angoras, les bourgeons soyeux des saules grimpent le long des branches. Mille petites pousses d'un vert tendre sortent aux tiges rampantes des lierres. Sur le talus, les pervenches tournent vers la lumière leur corolle bleue, du beau bleu pâle des nuits de mai.
Une allée de chênes descend à la Drôme; leur feuillage rouillé fait une tache d'automne dans le renouveau. Il semble que les vieux arbres ne veuillent point se soumettre à la loi qui nous régit tous, nous comme eux, sauf, hélas! en ces sombres années où ce n'est plus, suivant l'image d'Homère, les feuilles mortes qui tombent pour faire place aux jeunes bourgeons. Les cloches de Pâques sonnent pourtant dans tous les villages de la vallée. Quand donc les hommes échangeront-ils le baiser de paix?
Parmi tant de printemps—je m'effraie à les compter—qui déjà me ramenèrent en ce coin du Dauphiné, je me rappelle un jour d'avril où, sans raison apparente, des images funèbres m'assaillirent. Était-ce un pressentiment du deuil qui devait me frapper l'année suivante, presque à la même époque? Ce matin, au contraire, mes poumons se dilatent. J'aspire à pleines gorgées les effluves printaniers. À chaque pas, des arômes montent vers moi, m'enveloppent d'invisibles caresses; tantôt je sens la résine, tantôt la violette, tantôt la lavande et le thym, parures de nos terrains pierreux. Doux parfums, ah! comme je vous reconnais tous! Et comme je m'enivre, ô buis, dans vos allées! J'aime votre odeur forte, cette odeur à la fois amère et sucrée qui évoque pour moi les jardins d'Italie, où, si souvent, je promenai mes rêves et mes espoirs. Ineffable volupté des heures ainsi vécues dans le décor familier, plus douce peut-être encore lorsqu'on songe à l'universel cataclysme, mais que l'on a un peu honte de savourer ainsi. Cependant, terre maternelle, n'ai-je pas été créé pour t'adorer et pour jouir de toi? Je ne serai jamais de ceux qui te meurtrissent sans respect et sans amour.
Les cloches se sont tues. Dans le vaste silence, que rythme seulement le bruit de la rivière, s'exhale comme une allégresse végétale. Partout, autour de moi, les germes lèvent, la sève court, les écorces se dilatent. C'est le miracle qui commence, le miracle annuel qui transforme les branches plus sèches que le bois des fagots en rameaux feuillus où s'abriteront les jeunes couvées. Les blés nouveaux à peine sortis de terre ondulent joyeusement à la moindre brise. Des frémissements passent dans la lumière blonde... Ah! délices, délices infinies! Exalte-toi, mon cœur, et bats plus fort en ma poitrine! Mais quoi? Des larmes sous mes paupières... Pourtant, ce n'est qu'un pauvre petit printemps, un pauvre printemps de rien du tout...

Murmures du vent dans les feuillages, de la mer sur la grève, du ruisseau sur les cailloux; frisselis des hauts peupliers, bruissements des grands chênes; cris éperdus des rossignols par les belles nuits de mai; vibrations lointaines des cloches quand s'allonge sur la plaine l'ombre mauve des coteaux; bourdonnements des soirs d'été criblés d'étoiles; imperceptibles rumeurs de la terre assoupie sous le lourd soleil d'août; préludes des matins en montagne, lorsque les bruits des vallées montent, légers et cristallins, dans l'air raréfié: tout en la nature est rythme ou sonorité, mélodie ou symphonie. Aux fins d'après-midi d'octobre, que de fois j'ai admiré des crépuscules rutilants, plus éclatants que la fanfare des cuivres wagnériens! Dans les allées régulières de jardins à la française, je me souviens d'avoir fredonné instinctivement l'andante ou l'allegro d'une sonate classique. Et souvent, à la lisière d'un bois rougeoyant à l'automne, je me suis arrêté brusquement devant un paysage si romantique et si passionné que le cœur de Schumann semblait y saigner encore...
Ces frémissements de l'espace, ces chuchotements des eaux et des feuillages, ces milliers et ces milliers de voix de la nature, où Platon entendait déjà la sublime harmonie de l'univers, nombreux sont les poètes ou les prosateurs qui tentèrent de les exprimer en leurs écrits. Mais ce sont les musiciens qui, de tous temps, surent le mieux transcrire cette langue mystérieuse de l'infini. Merveille du génie humain: enfermer l'univers dans des lignes tracées sur du papier... Quelques notes, des accords, une gamme qui court, une phrase qui chante—et le paysage surgit!

L'automne est un "andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver." Cet andante, que célèbre George Sand au début de François le Champi, j'ai voulu l'entendre à Nohant même, en cette fin d'octobre qui prolonge, dans la tiédeur de ses ors, les belles journées d'un heureux été. J'ai voulu évoquer, dans son Berry, l'illustre romancière qui est encore là-bas, sur les bords de l'Indre, la "bonne dame de Nohant."
La Châtre, si souvent décrite par Sand, est une heureuse petite ville de l'ancienne France que le modernisme n'a presque pas gâtée. Peu de constructions neuves. Les rues tortueuses courent entre les maisons inégales, à pignons pointus, couverts de tuiles brunes que la mousse habille de velours vert. La couleur des pierres est en harmonie avec les teintes du paysage. Autrefois, quand le progrès des transports n'avait pas dérangé toutes choses, on bâtissait avec les matériaux de la région; ainsi, comme le note joliment André Beaunier, à propos du bourg de Guyenne où naquit Joubert, "les villages ne faisaient pas de tache dans la nature." La Châtre s'égaie de places que l'automne ouate de tapis d'or. Des jardins dorment à l'ombre des murs sur lesquels d'antiques cadrans disent la fuite lente des heures. Décors tout trouvés pour des romans provinciaux où les âmes ardentes et les caractères peu mobiles prennent un relief particulier.
J'erre à travers les rues, si grouillantes, paraît-il, les jours de marché, si tranquilles aujourd'hui. Que l'Indre est charmante, vue des ponts du Lion d'argent ou des Cabignats! Dans la brume s'estompe à moitié la tour carrée où la romancière emprisonne Mauprat. Voici la place de l'Abbaye qui domine la vallée de l'Indre, en face du coteau de la Rochaille dont le nom revient souvent dans ses récits. De là part le chemin qu'elle prenait presque toujours, quand elle rentrait à pied à Nohant.
Sous les ormes de la petite place, où elle se promenait encore il n'y a pas un demi-siècle, j'écoute, comme en un rêve, les souvenirs qu'égrènent pour moi les gens du pays. Ils évoquent la romancière avec tant d'ardeur et de précision qu'il me semble la voir s'avancer entre les arbres... Une minute de rêverie a fait le miracle... Oui, c'est bien elle, avec ses bandeaux et ses grands yeux pensifs. Sous la pluie d'or qui l'auréole, elle s'approche de moi et me sourit, comme on sourit à un ami inconnu dont l'émotion trahit l'admiration et le respect.
*
* *
La Châtre n'est somme toute qu'un vaste village, et les dernières maisons des rues sont des fermes derrière lesquelles s'étendent les domaines ruraux. Il ne faut pas s'éloigner beaucoup pour se trouver en plein Berry agricole, au milieu des cultures où, hélas! je n'ai pas la chance d'entendre "brioler" les laboureurs. Depuis quatre ans, les vieux ne chantent plus en creusant les sillons, et les jeunes ne savent pas "la classique et solennelle cantilène qui résume et caractérise toute la poésie claire et tranquille du Berry." Heureusement, la paix féconde va ramener les hommes dans les fermes. Malgré l'envahissement des procédés mécaniques, espérons que les tracteurs grinçants n'anéantiront pas complètement le poème des labours, et que, de cette plaine, monteront encore les chants magnifiques qui, par les après-midi et les crépuscules d'automne, semblaient l'âme sonore de la terre ivre de lumière et d'amour.
La journée, comme il arrive assez souvent en Berry, est brumeuse; rien de plus poétique, d'ailleurs, que ce brouillard léger qui estompe les lointains dans une sorte de buée grise. Voilà bien la Vallée-Noire que célébra George Sand; les moindres bois ont des apparences de forêts et l'on devine combien les légendes rustiques doivent facilement s'y emparer des imaginations populaires. Les premières fraîcheurs nocturnes ont déjà fait jaillir les colchiques dans les prés. Les noyers à moitié défeuillés prennent leur triste aspect d'hiver; ils dorment, immobiles, dans la tranquillité de l'air. Une paix grise recouvre la campagne. Cherchant à résumer l'impression que me donne cette rapide vision, j'inscris sur mon carnet une phrase que je retrouve, presque textuelle, au début de la Mare au Diable: "Il y avait un sentiment de douceur et de calme profond qui planait sur toutes choses."
Mais j'ai hâte d'arriver au terme de mon pèlerinage, et j'avoue que ce n'est pas sans émotion que je pénètre dans Nohant. Jamais je n'ai vu un village qui m'ait semblé si minuscule. Quelques maisons précédées de jardins, la petite église, le mur et le portail du domaine de George Sand encadrent une place qu'ombragent quatre ormes et deux noyers. Décor charmant d'opéra-comique que l'or d'octobre enlumine. L'église surtout est fort pittoresque avec son auvent surbaisse, où l'on ne peut guère pénétrer qu'en courbant la tête; on s'y rassemble aux jours de messe et de vêpres. Devant le porche, sur la place même, se dresse une croix au pied de laquelle est la "pierre des morts," large dalle où l'on dépose les cercueils. C'est sur elle que Flaubert pleurait à chaudes larmes, pendant les obsèques de son amie.
Et me voici dans le domaine qu'après la Révolution, la grand 'mère de George Sand, la fille de Maurice de Saxe, acheta avec les maigres débris de sa fortune. On sait qu'il appartient aujourd'hui à l'Académie française, l'usufruit en restant à l'unique descendante de la romancière, sa petite-fille Aurore, qui m'en fit aimablement les honneurs. Je ne veux point le décrire, pas plus que la maison toute pleine de souvenirs, la bibliothèque, le cabinet de travail, le théâtre des marionnettes. À peine, d'ailleurs, si je regarde, dans le tumulte des noms qui bourdonnent à mes oreilles. Delacroix, Dumas, Liszt, Chopin, Pauline Viardot, Daniel Stern, Clésinger, Rollinat, tant d'autres ont habité ces pièces! Et je ne parle pas de ceux qui vinrent seulement en hôtes de passage, comme Gautier qu'impressionna d'abord défavorablement l'accueil froid de George Sand, ou Balzac qui la trouva en pantalon turc et en pantoufles jaunes, fumant silencieusement pendant qu'il parlait. Je pense aux fidèles qui vécurent ici, dans l'affection rayonnante de celle qu'ils aimaient—sœur, amante ou mère, mais toujours amie passionnée et dévouée. Et presque tous, près de la femme qui fut l'une des plus grandes travailleuses du siècle dernier, ils travaillèrent. Cette atmosphère de labeur règne encore dans la maison, hantée d'une invisible présence, et surtout dans le salon où sont entassées tant d'œuvres d'art, autour de cette table sur laquelle se penchèrent les plus nobles fronts, près de cette chose à jamais vénérable, le piano de Liszt et de Chopin. Comment songer sans émotion à ces heures où Liszt et Sand s'asseyaient à cette table, elle terminant Mauprat, lui notant ses admirables transcriptions des Symphonies de Beethoven? Comment évoquer sans un serrement de cœur ces soirs d'été, où, sur ce piano, Chopin improvisait ses pages les plus frémissantes? Delacroix prolongeait ses veilles pour l'entendre. "Par instants, il vous arrive, par la fenêtre ouverte sur le jardin, des bouffées de la musique de Chopin qui travaille de son côté. Cela se mêle au chant des rossignols et à l'odeur des rosiers." Est-il beaucoup d'heures plus riches dans l'histoire de l'art et de la littérature? Ah! nuits pathétiques, belles nuits de mai, en ce coin perdu d'un village, où, tandis que Sand travaille sous la lampe, Delacroix écoute Chopin, et, sur la musique fiévreuse d'un prélude, ébauche en imagination l'une de ses grandes toiles tourmentées...
Autour de la maison s'étend le domaine, à la fois parc, jardin, verger et potager. L'ensemble est un peu triste et sévère; nulle part on ne découvre d'horizon. Ni vastes étendues pour le rêve, ni sites pittoresques et accidentés invitant à l'action. Il faut y travailler et l'on ne peut rien en tirer que de soi. Le cadre convenait à celle qui ne connut aucun repos avant qu'on l'eût allongée sous l'if centenaire qui, depuis quarante-deux ans, abrite son sommeil. Près de la dalle de grès noir, nue et sans ornement, qui recouvre ses cendres, donnent son père, sa grand'mère, son fils, sa bru, et la dernière venue, sa petite-fille, cette pauvre Gabrielle Sand, âme charmante de modestie et de bonté. Entre l'église basse et le jardin, ce cimetière champêtre, séparé du cimetière communal par une simple grille, est infiniment émouvant. "Verdure... laissez la verdure..." furent, paraît-il, les derniers mots de George Sand. Dormez en paix, ma bonne dame de Nohant! Pour vous, qui avez passé tant d'heures à écouter l'âme musicale des choses, le bruissement du vent dans les arbres continue de bercer votre rêve. Le grand if balance ses palmes toujours vertes; et, chaque année, quand l'automne recommence son andante mélancolique et gracieux, les ormes, désolés de vous avoir perdue, sur vos restes mortels versent leurs larmes d'or.

Le 17 décembre 1917, à Rome, sur les pentes du Janicule, se déroula une cérémonie comme on ne saurait en voir ailleurs qu'en Italie, où la poésie et l'histoire se mêlent sans cesse et s'exaltent l'une l'autre. Une foule immense s'était rendue, à l'appel des autorités, au couvent de Saint-Onuphre, pour célébrer la prise de Jérusalem au lieu même qu'avait choisi pour mourir l'auteur de la Jérusalem délivrée.
Me trouvant à Rome, quelques mois plus tard, à l'occasion du troisième anniversaire des journées de mai 1915, j'ai voulu revoir la chambre de Saint-Onuphre. Par un matin léger qu'emplissaient les parfums du printemps romain, j'ai gravi les pentes du Janicule et je me suis assis sur les gradins du petit amphithéâtre de brique aménagé à côté du chêne du Tasse. Des sociétés populaires y donnent des représentations et des conférences. Aujourd'hui le silence et la paix règnent en ce lieu charmant que semblent garder une douzaine de cyprès alignés comme des faisceaux de lances romaines. Quelques eucalyptus balançant leurs souples chevelures emplissent l'air de leur odeur aromatique et forte. Quant au chêne du Tasse, plusieurs fois foudroyé et déchiqueté par les orages, ce n'est qu'un tronc informe que soutiennent des crochets de fer. La piété des Romains essaya vainement de prolonger ses jours; mais une inscription l'immortalise: All' ombra di questa quercia—Torquato Tasso—vicino ai sospirati allori e alla morte—ripensava silenzioso—le miserie sue tutte. La vue est fort belle sur Rome et les montagnes de la Sabine. Le dôme de Saint-Pierre s'arrondit dans l'azur, derrière une ligne de pins parasols. Renan affectionnait cette retraite; c'est là qu'il fit le souhait qui m'avait jadis tant frappé. "Cher ami, écrit-il à Berthelot, celui qui demeurerait dans ces lieux, renonçant à l'action, à la pensée, à la critique, ouvrant son âme aux douces impressions des choses, celui-là ne mènerait-il pas une noble vie, et ne devrait-il pas être compté parmi ceux qui adorent en esprit?" Leçon de sagesse que, toujours, je tâchai de suivre, au cours de mes voyages d'Italie. N'étant ni érudit, ni professeur, ni critique, il m'était facile d'oublier le peu que je savais pour ouvrir seulement mon âme aux douces impressions des choses... Mais aujourd'hui, hélas! l'heure n'est plus aux molles rêveries. Même ici, sur cette terrasse qui semble l'un des derniers refuges de la poésie, parviennent les appels du clairon. Je vois flotter sur les monuments de Rome le drapeau tricolore qui rappelle l'anniversaire des jours où l'Italie se rangea à nos côtés. Et je songe à l'émouvante cérémonie qui, hier, se déroula dans le flamboyant décor de la place de Venise. Un régiment de Tchéquo-Slovaques, aligné sur les marches du monument Victor-Emmanuel, en face des membres du gouvernement italien et d'un ministre français, recevait le drapeau qui allait le conduire à la bataille et à la mort. Ces volontaires savent que l'ennemi ne leur fait point quartier; s'ils sont pris, le gibet les attend. Minute poignante où, derrière les officiers agenouillés et baisant le drapeau, les soldats entonnèrent leur hymne national, lent et grave comme un chœur religieux. J'eus une vision du temps des croisades. Que n'était-il, parmi les assistants, un Tasse pour la chanter?
*
* *
Quand, le 1er avril 1595, par une matinée froide et pluvieuse, le Tasse descendit de la voiture du cardinal Cintio Aldobrandini, à la porte du couvent de Saint-Onuphre, il se savait "attaqué d'un mal qu'il pressentait devoir guérir tous les autres." Aux moines qui accoururent vers lui, il dit simplement: "Je viens mourir au milieu de vous."
Ses dernières illusions étaient tombées; il avait bu le calice jusqu'à la lie. Même au seuil de la mort, le destin n'avait cessé de le railler. Le Tasse avait vu peu à peu s'évanouir l'ultime mirage que, par une sorte de raffinement cruel, la triste muse voilée de noir, qui ne le quittait plus, avait fait luire à ses yeux; il lui fallait renoncer à être, comme Pétrarque, couronné au Capitole. Et pourtant, le pape Clément VIII lui avait dit: "Vous allez recevoir une couronne que vous honorerez autant qu'elle honora ceux qui la portèrent avant vous." Mais, pour je ne sais quelles raisons, peut-être à cause de la maladie de son protecteur le cardinal Cintio, la cérémonie avait été renvoyée. En se réfugiant à Saint-Onuphre, le Tasse sentait que tout était bien fini pour lui. Peut-être eut-il encore un regret, quand son ami Cintio lui apporta la bénédiction du souverain pontife. "Voilà, soupira-t-il, la couronne que j'étais venu chercher à Rome." Aux moines qui se lamentaient à son chevet, il dit ces mots, que Chateaubriand mettra dans la bouche de Rancé: "Mes amis, vous me croyez laisser; je vous précède seulement." Et il murmura une suprême stance: "Si la mort n'était pas, il n'y aurait au monde rien de plus misérable que l'homme."
Le 25 avril, à dix heures du matin, ne pouvant plus suivre de sa faible voix le chant des frères, il serra d'une dernière convulsion son crucifix sur sa poitrine et balbutia: In manus tuas... La muse voilée de noir, qui lui resta fidèle jusqu'à la fin, apparut, ouvrant la porte bienheureuse. Il aperçut le refuge de paix, comme sa Clorinde expirante:
On enterra Le Tasse dans la petite église dont un cardinal français est aujourd'hui titulaire, sous une simple pierre, sans inscription, comme l'avait désiré le poète. Un sonnet d'Alfieri regrettait qu'un mausolée n'ait pas été élevé au poète par Michel-Ange. Comme si la simple pierre anonyme n'était pas plus émouvante que n'importe quel monument! Toujours est-il qu'au début du siècle dernier, on résolut de combler cette lacune: le résultat fut la déplorable statue que les moines montrent avec orgueil. Étrange conception d'un Tasse frisé, à moustaches conquérantes, vêtu d'un pourpoint à fraise et à crevés se terminant en draperie sur ses jambes nues.
Heureusement, la chambre où le Tasse rendit le dernier soupir fut à peu près respectée. Elle s'ouvre au fond d'un couloir qu'orne toujours une jolie madone de l'école du Vinci. On y a rassemblé des souvenirs du poète: son encrier de bois, son crucifix, des autographes, la petite cassette de plomb qui renferma longtemps ses os, le masque de cire moulé sur le cadavre, avec le laurier qui n'avait couronné qu'un cercueil. Voilà bien le long visage émacié et les traits anguleux que l'on retrouve sur les vieilles gravures accrochées aux murs. L'auteur de la statue n'était donc jamais entré dans cette chambre, sur la porte de laquelle on aurait pu graver, comme au fronton de l'église milanaise: Amori et dolori sacrum?
Trois fenêtres donnent sur les jardins du Vatican et sur l'église Saint-Pierre, que l'on découvrait entièrement, avant la construction des laides bâtisses modernes qui bouchent aujourd'hui l'horizon. Quand Leopardi vint ici, il ne songea point à regarder le décor; le "sombre amant de la mort" ne sut qu'y pleurer abondamment: ce fut, écrivit-il à son frère, l'unique plaisir qu'il avait goûté à Rome. Stendhal, toujours curieux, admira longuement le paysage qu'il déclare "un des plus beaux lieux du monde pour mourir." Quelle vision, en effet, pour un poète et un catholique de la Renaissance au seuil de l'éternité, que le dôme de Michel-Ange s'élevant sur le sépulcre de Pierre, dans la capitale de la chrétienté!
Devant le portique du couvent, où achèvent de s'effacer les fresques du Dominiquin, une place minuscule invite au recueillement. Quatre chênes verts ombrageant deux bancs de pierre en sont les seuls ornements. Du petit mur qui la borde, on a, sur Rome, une belle vue que gênent les arbres d'un jardin botanique s'étageant sur le flanc de la colline. Entre leurs cimes mouvantes, on distingue pourtant les principaux monuments de la ville, et notamment, après la boucle du Tibre, la masse brune du château Saint-Ange. Tout au fond, les montagnes de la Sabine s'estompent dans une brume bleue. Tandis que je regarde le noble paysage, les cloches de l'église Saint-Onuphre se mettent en branle. Quand, en 1849, il fut question de les envoyer à la fonderie, Garibaldi s'y opposa. "Respect, s'écria-t'il, respect aux cloches qui sonnèrent pour l'agonie du Tasse!" Entre chaque carillon, d'étranges clameurs montent d'un bâtiment en contre-bas. Je me renseigne: ce sont les cris des aliénés enfermés dans l'hospice voisin de San Spirito. Curieuse coïncidence: le prisonnier de Ferrare dort son dernier sommeil près d'un hôpital de fous. Était-il fou lui-même? La question est encore débattue. Folie assez légère, puisqu'elle résista à sept années d'internement parmi de véritables aliénés. Folie intermittente, puisque, pendant sa détention, le Tasse écrivit une trentaine de dialogues philosophiques et plus de quinze cents lettres, d'une absolue lucidité, dont la prose, au dire des critiques italiens, rappelle la langue de Cicéron. Folie sublime en tout cas, à qui l'on doit un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, que nous importe? Un poète chante, libre ou en cage: que lui demander de plus? "Qu'il nous entraîne dans un bel univers, comme dit Barrès à propos justement de Torquato, c'est tout son devoir, sa vertu efficace." Ce rossignol qui, dans un bosquet du Janicule, lance éperdument ses trilles et ses roulades, je ne cherche point à savoir sur quel arbre il s'est posé. Je ferme les yeux pour ne rien perdre de la mélodie. De même j'écoute, sans nul autre souci, le rossignol inquiet qui chantait parmi les lauriers,
À Goethe également, avant Carducci, s'était imposée la comparaison. "Pareil au rossignol, le Tasse emplit l'air et les bois des plaintes harmonieuses d'un cœur qu'embrase l'amour."
Les fous, du reste, ne sont-ils pas souvent les plus sages? Ils voient l'invisible et tout ce que nos yeux, éblouis par la moindre lumière, n'osent pas regarder. Les plus étranges imaginations des poètes ne furent souvent que des visions prophétiques. Qui donc, il y a seulement quatre ans, aurait eu l'idée que la guerre déchaînée par l'Allemagne donnerait au Tasse un regain d'actualité et que Rome célébrerait la prise de Jérusalem au tombeau de l'auteur de la Jérusalem délivrée?

Il poursuivit d'une voix plus rude:—Pendant les longues heures dans les tranchées, pendant les heures plus longues encore de l'hôpital, j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai compris que l'amour est une chose grave, plus grave que l'on ne croit quand on a vingt ans. Je me suis bien promis de ne plus donner mon cœur à la légère, de ne plus l'ouvrir que pour une véritable et profonde passion. Je veux un amour fort comme la mort. La voiture, arrivée au bas du coteau, traversait le Tibre sur un vieux pont en dos d'âne, dont pas une pierre n'avait dû bouger depuis les Romains. La nature plus riante ressemblait à un vaste jardin. Les mûriers, les vignes, les blés et les maïs se partageaient les champs. Les fermes disparaissaient à moitié sous les vergers et les tonnelles. On sentait que la vie était partout facile; et l'horizon, barré par d'harmonieuses collines, inclinait l'âme à la sérénité. Les propos de Georges prenaient je ne sais quelle âpreté au milieu de tant de douceur; Hélène en était toute troublée.
Pendant un nouveau silence, il examina sa voisine à la dérobée. Les yeux à moitié fermés, elle semblait regarder en dedans d'elle-même. Une émotion profonde l'étreignait, qu'elle s'efforçait vainement de dominer. Il pensa qu'il avait été peut-être maladroit et crut nécessaire d'effacer l'impression produite.
—Je vous en prie, oubliez ce que je viens de dire...
Il ne se doutait pas que, du trouble qui bouleversait Hélène, et qui venait, en effet, des paroles qu'il avait prononcées, naissait une sympathie plus ardente, une attraction irrésistible. Elle était de ces amoureuses qui, voulant être aimées passionnément, vont d'instinct à celui qui sera leur maître et non à celui qui pourrait être leur esclave. Au moment précis où Georges s'excusait et croyait l'avoir heurtée, elle éprouvait plus fortement que jamais le désir de s'abandonner à lui, d'appuyer la tête sur son épaule...
La voiture s'arrêta devant Sainte-Marie-des-Anges, vaste, laide et froide église moderne, élevée sur l'emplacement de la misérable cabane de branchages et de chaume où mourut saint François. Ils visitèrent le petit jardin clos où fleurissent les fameuses roses sans épines. Un frère en cueillit quelques-unes pour Mme Fonteney.
—Voilà, dit-elle, le symbole de l'amour divin... Lui, au moins, ne trompe jamais et ne fait point souffrir.
Et elle lui raconta le projet qu'elle avait eu d'entrer au couvent.
—Vous, au couvent!
—Pourquoi pas? J'ai l'âme très religieuse, mais je ne me suis pas encore sentie en état de grâce... Et pourtant, quelle douceur ce doit être de passer ses jours dans un cloître, loin du monde... C'est là qu'est le vrai bonheur.
—Allons donc! Le bonheur n'est qu'en vous seule. Vous êtes faite pour vivre et pour aimer... Ne sentez-vous pas ici comme une atmosphère de mort? Marchons vers la lumière...
Comme ils sortaient de l'église, une vendeuse de fleurs s'approcha d'eux.
—À mon tour, dit-il, de vous offrir des fleurs. Toujours celles-ci servirent aux déclarations. Elles traduisent le désir et l'ennoblissent. Je me rappelle avoir vu, à la Maison Carrée de Nîmes, un bas-relief qui devait servir d'enseigne à une boutique de fleuriste et portait cette délicieuse inscription: Non vendo nisi amantibus coronas, je ne vends mes bouquets qu'aux amoureux...
Il choisit les roses les plus rouges, des roses pourpres, couleur de sang, et les lui tendit.
—Que ces fleurs vous disent la violence de mes sentiments!
Elle respira les roses.
—Ah! soupira-t-elle, que leur senteur est forte!
—Oui, leur parfum est enivrant. Leurs épines sont nombreuses et acérées. Elles blessent, torturent, font payer parfois chèrement leurs joies. Elles sont le symbole de l'amour humain. Lui seul pourtant donne du prix à la vie...
La voiture gravissait lentement les lacets qui escaladent la colline, parmi les oliviers poussiéreux. Bientôt, à un tournant du chemin, Assise apparut dans son majestueux développement. Indifférent à cette vision, Georges regardait du coin de l'œil Mme Fonteney qui épinglait à son corsage un bouquet, où elle avait mêlé les roses rouges aux pâles roses de saint François.

Je connais des terrasses plus belles sur le flanc des coteaux de Toscane ou d'Ombrie. J'en sais d'autres, en France, qui se développent avec plus de majesté. Le rocher des Doms et le Peyrou dominent des plaines plus grandioses. Mais, mieux que ses rivales, cette esplanade valentinoise se mêle à la vie de la cité et partage ses émotions.
Aux soirs d'été, on vient y assister à l'agonie du jour. Rêves et désirs s'exaspèrent à suivre les jeux mouvants de la lumière. Ici, comme en Italie, j'ai compris l'antique souhait des mendiants qui remerciaient d'une aumône en disant: "Puissiez-vous jouir longtemps de vos yeux!" C'est devant cet horizon qu'un écrivain anglo-saxon évoqua ses souvenirs du Péloponnèse.
Comment la vue quotidienne de tant de beauté a-t-elle si peu formé le goût des habitants? Comment, après l'une de ces stations où ils regardèrent les sculptures de Crussol dressées dans la splendeur du soleil mourant, tolèrent-ils l'encombrant monument qui déshonore leurs boulevards? Et puis-je croire qu'il ait jamais contemplé d'ici le paysage, celui qui jeta sur le Rhône l'étrange pont dont le maigre dos d'âne coupe d'une courbe sans grâce les rives harmonieuses? Mais le bon géant, au passé lourd d'histoire, devant qui s'exaltait Flaubert à l'idée qu'il était "le fleuve d'Annibal et de Marius," dédaigne ces outrages et passe, méprisant.
Sur cette terrasse, un jeune Corse promena le premier tumulte de ses désirs. Mais il ne songeait guère à la volupté celui qui, dans un dialogue écrit ici-même, déclarait que l'amour était funeste aux princes. "Confiera-t-on le bonheur des hommes, s'écriait-il, à un enfant qui pleure sans cesse, qui s'alarme ou se réjouit au seul mouvement d'une autre personne? Confiera-t-on le secret de l'État à celui qui n'a point de volonté?" Dans les brouillards légers qui tissent sur les eaux des draperies d'argent, ce n'était point le dieu du Plaisir qui l'appelait; il voyait déjà la Gloire lui sourire, et vers elle il tendait ses bras nerveux et passionnés.
Souvent, sur ce Champ-de-Mars, où s'élève la statue d'un autre guerrier, je vins, aux jours tragiques de ces dernières années, apaiser mes angoisses et retremper mon espoir. Aujourd'hui, par ce lumineux été que ne troublent plus les appels du clairon, d'autres souvenirs me hantent.
J'évoque le bel Alphonse de Lamartine qui, devant ce paysage, ne put retenir un cri d'admiration. Ces larges horizons, aux lignes imprécises s'estompant dans la brume, se déroulaient suivant le rythme de ses vers; le murmure du Rhône, puissant et continu, montait vers lui pareil au monotone enchaînement de ses strophes.
Sous ces ombrages, un autre cygne chanta; et ses chants, aussi purs, étaient plus sobres et mieux ordonnés. De sa ville natale, où la montagne dauphinoise expire au bord de la rivière, Louis Le Cardonnel a reçu le don d'allier le lyrisme à la plus nette précision. Il me semble que j'entends votre voix, ô poète, en ce lointain jour d'avril où nous cheminions sous la verdure frissonnante des peupliers. C'est ici que vous fîtes le premier vœu de vous immortaliser par vos vers; c'est ici que vous rêvez de venir achever votre œuvre, voulant, comme vous me l'écriviez récemment, qu'elle ait désormais plus encore "un accent d'éternité."
*
* *
Moi aussi, par ce beau soir tout empourpré, je rêve d'un destin, mais qui ne viendra pas. Le laurier ne couronne que les poètes. La gloire ignore le simple ouvrier de lettres que je suis. Et pourtant, j'aimerais que mon nom à ces rives illustres fût à jamais lié. Oh! je n'aspire point à cette renommée passagère que le talent et quelque heureux hasard donnent parfois; je voudrais ne pas mourir tout entier. Est un véritable écrivain celui-là seul qui songe à se survivre. "Poète ou romancier, comme le déclare Brunetière, dramaturge, historien ou critique, il ne lui suffit pas d'être le peintre ingénieux ou le spirituel traducteur des mœurs et des idées du jour. Il vise plus haut! Il vise plus loin! Et son ambition, de quelque nom qu'on l'appelle,—amour de l'idéal ou préoccupation de la postérité, souci de perpétuer son nom ou désir d'exceller,—sa véritable ambition est de vaincre la mort et le temps."
Si modeste que soit mon œuvre, je puis m'accorder cette justice que toujours je m'efforçai d'y mettre le meilleur de moi-même et que je n'ai pas écrit une ligne sans essayer de la rendre digne de durer. Stendhal, qui naquit tout près d'ici, de l'autre côté de ces monts, déclarait: "Je n'estime que d'être réimprimé en 1900." Ah! que je donnerais tous les succès et les honneurs immédiats dont tant d'autres se contentent, pour la simple certitude d'être réimprimé au siècle prochain! Et qu'il m'est doux, sur cette terrasse de Valence, d'en savourer l'illusion, par ce beau soir tout empourpré!
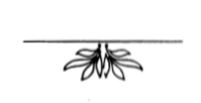
La bibliographie des œuvres de Gabriel Faure est assez compliquée, la plupart de ses études ayant fait l'objet de publications séparées, avant d'être réunies dans la forme ordinaire des anciens volumes à 3 fr. 50, et plusieurs d'entre elles ayant ensuite reparu, soit en tirages de luxe, soit en ouvrages de vulgarisation.
En réalité, son œuvre, à l'heure actuelle—octobre 1920—se résume en 10 volumes qui contiennent à peu près tout ce qu'il a publié, savoir: 4 romans (la Dernière journée de Sapphô, la Route de volupté, l'Amour sous les lauriers-roses et les Amants enchaînés) et 6 volumes de littérature ou voyage (trois séries d'Heures d'Italie, deux séries de Paysages littéraires et Pèlerinages passionnés).
Tous les morceaux publiés dans le présent recueil—à l'exception du dernier—sont tirés de ces ouvrages et les références données ci-dessous renvoient exclusivement à ces dix volumes. Lorsque certaines pages, particulièrement chères à l'auteur, ont été reprises par lui et figurent dans deux de ces volumes, on trouvera l'indication des différentes sources auxquelles le lecteur pourra se reporter. L'auteur a, du reste, revu les textes du présent ouvrage en tenant compte des diverses versions et en y apportant même de nombreux remaniements.
Ces morceaux choisis sont donnés à peu près dans l'ordre chronologique où ils ont paru.
*
* *
I.—À TRAVERS LESBOS. Écrit en 1900. Chapitre tiré de la Dernière journée de Sapphô.
II.—LE PAYS DE TRISTAN. Écrit en 1903. Ces pages, extraites de la Route de volupté, figurent également en partie dans la 1re série des Paysages littéraires.
III.—CIMETIÈRE ITALIEN. Écrit en 1905. Chapitre tiré de l'Amour sous les lauriers-roses, dont certains fragments ont été repris par l'auteur, à propos du lac d'Iseo, dans le 1er volume de ses Heures d'Italie.
IV.—MATIN EN MONTAGNE. Écrit en 1905. Tiré du chapitre II de l'Amour sous les lauriers-roses.
V.—LES JARDINS DE BELLAGIO. Écrit en 1905. Ce chapitre est formé de plusieurs passages de l'Amour sous les lauriers-roses, réunis par l'auteur dans la 1re série des Heures d'Italie.
VI.—SOUVENIRS D'ENFANCE.—Écrit en 1905. Fragment de l'Amour sous les lauriers-roses, repris partiellement dans la 2e série des Heures d'Italie.
VII-VIII-IX-X.—AVEC STENDHAL À PARME—LE SOIR TOMBE SUR L'ADRIATIQUE—LA MAISON DE TITIEN—LE ROSSIGNOL ATTARDÉ. Ces quatre morceaux, écrits en 1909 et 1910, figurent dans le 2e volume des Heures d'Italie.
XI.—LE PRINTEMPS À TOLÈDE. Écrit en 1911. Extrait du Triptyque printanier qui termine la 1re série des Paysages littéraires.
XII.—LE VILLAGE DE PÉTRARQUE. Écrit en 1912. Ce chapitre, tiré de la 1re série des Paysages littéraires, avait déjà paru, plus développé, dans le dernier volume des Heures d'Italie.
XIII-XIV.—LES JARDINS DE CHÂLONS—LE LONG DE LA MER ANNUNZIENNE. Ces pages, écrites en 1914 et en 1916, publiées d'abord dans deux volumes de guerre qui ne seront pas réédités (Paysages de guerre et De l'autre côté des Alpes) ont été recueillies par l'auteur dans ses Pèlerinages passionnés.
XV.—LES SOIRS DE SIENNE. Écrit en 1917. Tiré de la 2e série des Paysages littéraires. Quelques lignes sur les mouches de feu en ont été utilisées par l'auteur dans son roman des Amants enchaînés.
XVI.—PÂQUES DAUPHINOISES. Écrit en 1918. Extrait des Pèlerinages passionnés.
XVII.—PAYSAGES MUSICAUX. Écrit en 1917. Extrait de la 2e série des Paysages littéraires.
XVIII-XIX.—L'AUTOMNE À NOHANT—SUR LA TOMBE DU TASSE. Écrits en 1918. Figurent dans les Pèlerinages passionnés.
XX.—LES ROSES D'ASSISE. Écrit en 1920. Extrait des Amants enchaînés.
XXI.—SUR LA TERRASSE DE VALENCE. Écrit en 1919. Ce morceau n'a paru jusqu'ici qu'en une plaquette de luxe tirée à quelques exemplaires. Le Jugement que l'auteur y porte sur son œuvre lui donnait une place tout indiquée à la fin de ce recueil.

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.