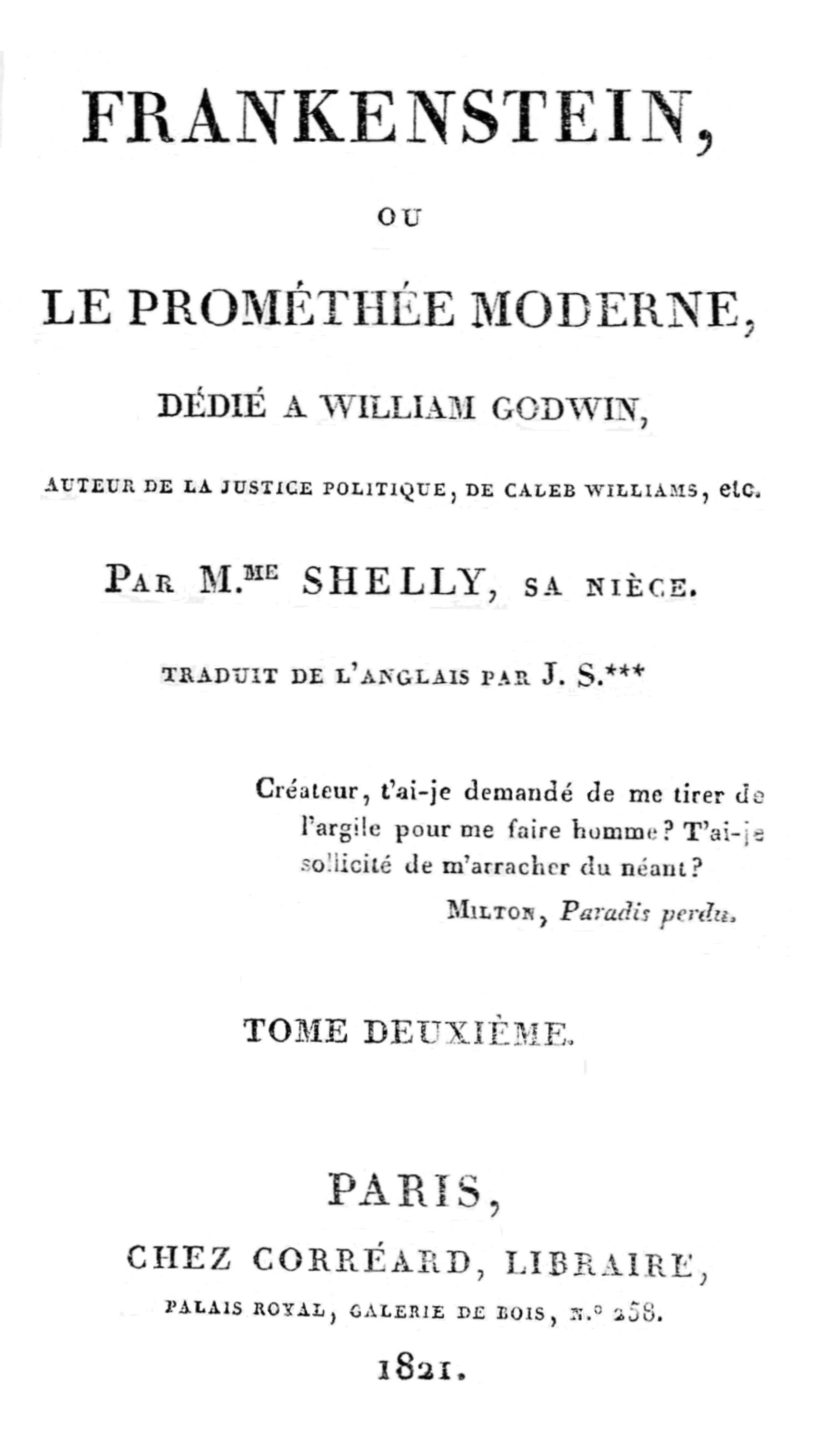
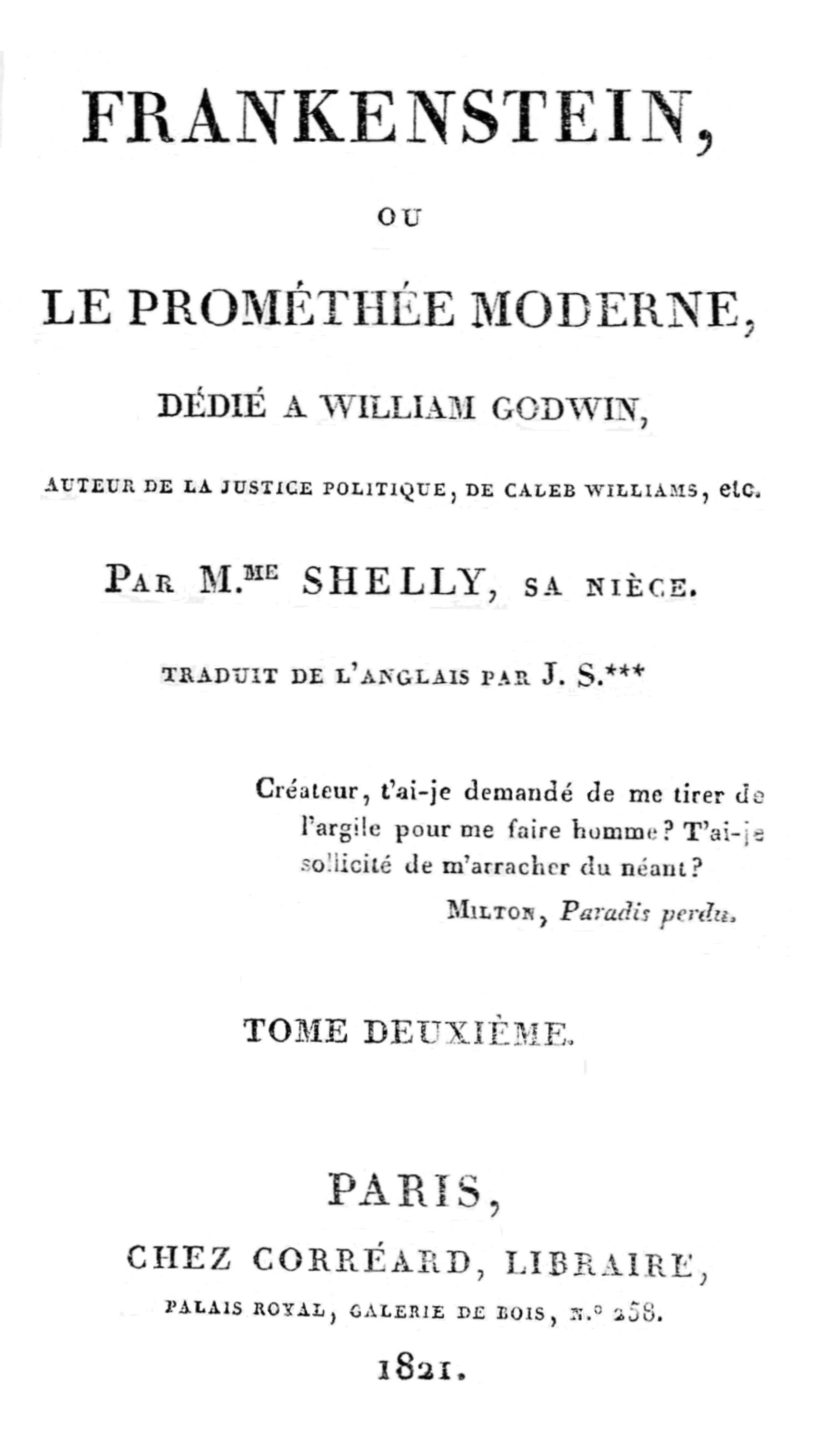
Créateur, t'ai-je demandé de me tirer de
l'argile pour me faire homme? T'ai-je
sollicité de m'arracher du néant?
MILTON, Paradis perdu.
TABLE
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
Rien n'est plus pénible pour le cœur de l'homme, que le calme glacial qui succède aux sentiments divers soulevés par une suite rapide d'événements, et la certitude qui enlève en même temps l'espérance et la crainte. Justine n'était plus! Et moi je vivais! Le sang circulait librement dans mes veines; mais mon cœur était oppressé par le désespoir et le remords, dont rien ne pouvait me délivrer. Le sommeil fuyait de mes yeux, j'errais comme un mauvais génie, certain d'avoir causé d'horribles malheurs, et convaincu que j'en préparais de plus horribles encore. Cependant je portais dans le cœur des sentiments de bonté et l'amour de la vertu. J'avais commencé la vie avec des intentions bienveillantes; et je désirais arriver au moment où je pourrais en faire preuve, et me rendre utile à mes semblables. Maintenant tout était changé: au lieu de cette paix de conscience, qui me permettait de jeter avec satisfaction les yeux sur le passé, et qui donnait à mes espérances une force nouvelle, j'éprouvais le remords et le sentiment du crime, qui me livraient à des tourments affreux et difficiles à dépeindre.
Cette situation d'esprit influa sur ma santé, dont le rétablissement était complet. Je fuyais la présence des hommes; j'étais tourmenté par la joie et le bonheur des autres; je ne trouvais de consolation que dans la solitude... dans une solitude profonde, terrible, semblable à la mort.
Mon père s'aperçut avec peine que mon caractère et mes habitudes étaient sensiblement changés. Il essaya de me prouver, par des raisonnements, combien j'avais tort de m'abandonner à un chagrin immodéré. «Pensez-vous, Victor, dit-il, que je ne souffre pas comme vous? Il est impossible d'aimer plus un enfant que je n'aimais votre frère (des larmes vinrent mouiller ses yeux); mais n'est-t-il pas du devoir de ceux qui survivent, de chercher à ne pas augmenter leur malheur, en laissant paraître l'excès du chagrin? C'est aussi un devoir pour vous-même; car la douleur excessive éteint toutes les facultés, ou rend même incapable de remplir les devoirs journaliers, sans lesquels l'homme n'est pas propre à la société».
Cet avis était bon; mais il n'était nullement applicable à ma position. J'aurais été le premier à cacher mon chagrin et à consoler mes amis, si le remords ne s'était mêlé à mes autres sentiments. Je ne pus alors répondre à mon père qu'avec un regard de désespoir; et, depuis, je cherchai à me dérober à sa vue.
Vers cette époque, à peu près, nous nous retirâmes à notre maison de Belrive. Ce changement me fut particulièrement agréable. Notre résidence à Genève n'était pas sans inconvénients; car, les portes de la ville étant régulièrement fermées à dix heures, il était impossible de rester plus tard sur le lac. J'étais libre alors.
Souvent, dans la nuit, quand toute la famille reposait, je prenais une barque et passais plusieurs heures sur l'eau. Tantôt, en déployant les voiles, j'étais poussé par le vent; tantôt, après avoir ramé jusqu'au milieu du lac, je laissais le bateau suivre son propre cours, en m'abandonnant à mes tristes réflexions. Souvent tout était tranquille autour de moi; seul, j'étais agité au milieu des scènes belles et majestueuses qui étaient sous mes yeux, et dont le silence n'était interrompu que par le cri des chauves-souris, ou le croassement des grenouilles voisines du rivage; eh bien! souvent j'étais tenté de me plonger dans le lac silencieux, pour que les eaux m'engloutissent à jamais avec tous mes malheurs; mais j'étais retenu en pensant à la douleur de l'héroïque Élisabeth, que j'aimais tendrement, et dont l'existence était attachée à la mienne. Je pensais aussi à mon père, et au frère qui me restait: les laisserai-je, par une lâche désertion, exposés, sans protection, à la méchanceté du Démon que j'avais lancé au milieu d'eux?
Dans ces moments, des larmes amères inondaient mon visage. Je désirais que la paix rentrât dans mon esprit, mais je ne la voulais que pour leur offrir des consolations et le bonheur. Vains désirs! le remords m'ôtait toute espérance. J'avais causé des maux irréparables, et j'étais continuellement agité par la crainte, que le monstre que j'avais créé, ne commit quelque nouveau forfait. J'avais un pressentiment confus que tout n'était pas fini, et qu'il commettrait encore quelque crime signalé, et dont l'énormité effacerait presque le souvenir du passé. J'avais toujours sujet de craindre, dès qu'une personne qui m'était chère, restait en arrière. On ne peut se figurer l'horreur que m'inspirait ce démon. Si je pensais à lui, mes dents se serraient, mes yeux s'enflammaient, et je brûlais d'ôter cette vie que j'avais donnée avec tant d'imprudence. Si je pensais à ses crimes et à sa méchanceté, ma haine et ma vengeance passaient toutes les bornes de la modération. Je serais monté au sommet le plus élevé des Andes, si j'avais pu, de là, le précipiter à leur pied. Je désirais le revoir, afin de faire retomber ma colère sur sa tête, et de venger la mort de Guillaume et de Justine.
Notre maison était celle du deuil. La santé de mon père était fortement ébranlée par l'horreur des derniers événements. Élisabeth était triste et découragée: elle ne trouvait plus de bonheur dans ses occupations accoutumées; il lui semblait que tout plaisir était un sacrilège envers les morts; elle pensait qu'une douleur éternelle et les larmes étaient le juste tribut qu'elle devait payer à l'innocence indignement sacrifiée. Ce n'était plus cette heureuse personne qui, quelques années auparavant, errait avec moi sur les bords du lac, et parlait avec ravissement de notre avenir. Elle était devenue grave, et parlait souvent de l'inconstance de la fortune, et de l'instabilité de la vie humaine.
«En réfléchissant, mon cher cousin, disait-elle, à la mort malheureuse de Justine Moritz, je ne vois plus le monde et ses œuvres, comme ils me paraissaient autrefois. Avant cette fin tragique, je ne voyais, dans les actions vicieuses et dans les injustices, que je lisais dans les livres ou dont j'entendais le récit, que des contes d'autrefois, ou des maux imaginaires; du moins ils étaient éloignés, et plus familiers à la raison qu'à l'imagination; mais maintenant le malheur a pénétré parmi nous, et les hommes me paraissent comme autant de monstres altérés de sang. Il faut cependant que je sois injuste. Tout le monde a cru la pauvre fille coupable; et, certes, si elle avait commis le crime qui l'a conduite à l'échafaud, elle serait la plus perverse des créatures humaines. Pour quelques bijoux, assassiner le fils de sa bienfaitrice et amie, enfant dont elle avait pris soin depuis sa naissance, et qu'elle paraissait aimer comme le sien! Je ne donnerais mon consentement à la mort de personne; mais je n'aurais pas hésité à regarder un être semblable comme indigne de rester dans le sein de la société: cependant elle était innocente. Je sais, je sens qu'elle l'était; vous partagez cette conviction, et votre opinion confirme la mienne. Hélas! Victor, quand le mensonge prend si bien l'air de la vérité, qui peut être assuré d'un bonheur certain? J'éprouve le même sentiment que si je marchais sur le bord d'un précipice, auprès duquel mille personnes seraient rassemblées, et chercheraient à me pousser dans l'abîme. Guillaume et Justine ont été assassinés, et le meurtrier échappe; il reste dans le monde, libre? et peut-être respecté. Je serais condamnée à mourir sur l'échafaud pour les mêmes crimes, que je ne voudrais pas changer de sort avec un être semblable».
J'écoutai ce discours dans la plus extrême agitation. J'étais le véritable meurtrier, non par le fait, mais par l'effet. Élisabeth remarqua facilement mon angoisse, prit ma main avec bonté, et me dit: «Mon bien cher cousin, il faut vous calmer. Dieu sait combien j'ai été affectée de ces événements; mais je ne suis pas aussi malheureuse que vous. Il y a, dans votre figure, une expression de désespoir, et quelquefois de vengeance, qui me fait trembler. Soyez calme, mon cher Victor; je sacrifierai ma vie pour votre repos. Nous serons certainement heureux au sein de notre pays natal, et loin du monde, qui pourra troubler notre tranquillité»?
En parlant ainsi, elle versait des larmes, et semblait se refuser aux consolations mêmes qu'elle me donnait; mais, en même temps, elle sourit, afin d'écarter le sombre nuage qui m'entourait. Mon père, à qui l'expression des malheurs, empreinte sur mon visage, ne semblait que l'exagération de ce chagrin, que je devais naturellement éprouver, pensa qu'un amusement conforme à mon goût, serait le meilleur moyen de me rendre cette tranquillité d'esprit dont je jouissais auparavant. C'est dans cette vue qu'il était venu à la campagne; ce fut dans la même vue qu'il nous proposa de faire tous ensemble une excursion dans la vallée de Chamouny. Je l'avais déjà parcourue; mais Élisabeth et Ernest ne la connaissaient pas; et tous deux avaient souvent témoigné un vif désir de voir un endroit, dont on leur avait dépeint les merveilles et la magnificence. Nous partîmes de Genève, pour cette tournée, vers le milieu du mois d'août, c'est-à-dire, près de deux mois après la mort de Justine.
Le temps était singulièrement beau; et, si mon chagrin eut été de nature à se dissiper par quelque distraction, l'excursion que nous avions entreprise, aurait certainement eu le résultat que mon père se proposait. Je ne pus néanmoins m'empêcher d'être touché de la beauté de la scène; elle me faisait quelquefois oublier mon chagrin, sans pouvoir l'effacer. Pendant le premier jour, nous voyageâmes en voiture. Le matin nous avions aperçu, de loin, les montagnes vers lesquelles nous nous avancions insensiblement. Nous vîmes le vallon à travers lequel nous montions, et qui était formé par la rivière d'Arve, dont nous suivions le cours, se refermer sur nous par degrés; et, au coucher du soleil, nous nous trouvâmes entourés, de tous côtés, d'immenses montagnes et de précipices; nous entendions la rivière rouler avec fracas parmi les rochers, et les cascades jaillir bruyamment autour de nous.
Le lendemain, nous continuâmes notre voyage sur des mules. Plus nous nous élevions, plus l'aspect de la vallée était magnifique et enchanteur. Les châteaux en ruine, suspendus sur les précipices, des montagnes couvertes de pins, l'Arve impétueux, les hameaux qu'on voyait de tous côtés parmi les arbres, tout formait une scène d'une beauté singulière. Elle paraissait plus belle et plus sublime, vue du côté des Alpes, dont la cime et les pyramides blanches et brillantes s'élevaient au-dessus de nous, et semblaient appartenir à une autre terre habitée par une autre race d'hommes.
Nous passâmes le pont de Pélissier; là, le ravin que forme la rivière s'ouvrit devant nous, et nous nous mimes à gravir la montagne qui le domine. Bientôt après nous entrâmes dans la vallée de Chamouny, plus merveilleuse et plus sublime, mais non aussi belle et aussi pittoresque que celle de Servox que nous venions de traverser. Elle était bornée par de hautes montagnes couvertes de neige; mais nous ne vîmes plus de châteaux en ruines, ni de campagnes fertiles. D'immenses glaciers bordaient la route; nous entendions les avalanches tomber avec un bruit semblable au roulement du tonnerre; nous pouvions même distinguer l'espèce de fumée qu'elles laissaient sur leur passage. Le mont Blanc, le suprême et magnifique mont Blanc, s'élevait du milieu des pics dont il est entouré, et de sa cime terrible dominait toute la vallée.
Pendant ce voyage, j'étais quelquefois avec Élisabeth, occupé à lui faire remarquer les différentes beautés de la scène. Souvent je retenais ma mule en arrière, pour me livrer à mes douloureuses réflexions. D'autres fois, je poussais l'animal au-devant de mes compagnons, pour les oublier, eux, le monde, et moi-même par dessus tout. Lorsque j'étais à quelque, distance, je mettais pied à terre, et me jetais sur le gazon, accablé par l'horreur et le désespoir. Nous arrivâmes à Chamouny à huit heures du soir. Mon père et Élisabeth étaient très-fatigués; Ernest, qui nous accompagnait, était content et dispos. La seule chose qui le contrariât dans son plaisir, était le vent du sud, et la pluie, dont ce vent semblait être le précurseur.
Nous nous retirâmes de bonne heure dans nos appartements. Je ne sais si ma famille trouva le sommeil, du moins je ne dormis pas. Je restai plusieurs heures à ma fenêtre, à observer la pâle lueur qui éclairait le sommet du mont Blanc, et à écouter le bruit de l'Arve, qui coulait sous ma fenêtre.
Le lendemain, malgré les prédictions de nos guides, le temps fut beau, mais nuageux. La source de l'Arveyron fut le premier but de notre curiosité: puis, nous parcourûmes la vallée jusqu'au soir. Ces scènes sublimes et magnifiques étaient la plus grande consolation que je pusse recevoir. Elles élevaient mes idées; et, si elles ne pouvaient bannir mon chagrin, du moins elles parvenaient à le dompter et à le calmer. Elles faisaient aussi quelque diversion dans mon esprit, aux pensées dont il était occupé depuis un mois. Je rentrai le soir, fatigué, mais moins malheureux, et je pus causer avec ma famille, plus gaîment qu'il ne m'était arrivé depuis quelque temps. Mon père était satisfait, et Élisabeth pleine de joie: «Mon cher cousin, dit-elle, vous voyez quel bonheur vous répandez dès que vous êtes heureux; ne succombez plus à la tristesse».
Le jour suivant, vers le matin, la pluie tomba par torrents, et d'épais brouillards cachèrent la cime des montagnes. Je me levai de bonne heure, avec un sentiment de mélancolie extraordinaire. Le temps me causait une impression dont je n'étais pas le maître: je revins à mes anciennes idées, et je retombai dans ma douleur. Je savais combien mon père serait surpris de ce changement subit: je voulus l'éviter jusqu'à ce que je fusse assez remis, pour pouvoir cacher les sentiments qui m'accablaient. Je savais aussi qu'on passerait la journée dans l'auberge; je résolus d'aller seul sur le sommet du mont Anvert, sans craindre la pluie, l'humidité et le froid, que j'étais accoutumé à supporter. Je me souvenais de l'effet terrible et toujours nouveau, dont mon esprit fut frappé, lorsque je vis ce glacier pour la première fois. Son aspect m'avait alors rempli d'un ravissement sublime, qui donnait des ailes à l'âme, et la transportait de ce monde de ténèbres, dans un séjour de lumière et de joie. La vue des beautés de la nature avait toujours l'effet d'élever mon esprit, et de me faire oublier les soucis passagers de la vie. Je connaissais le chemin: je résolus d'aller seul; je n'aurais voulu emmener personne; car la grandeur solitaire de la scène aurait cessé d'exister.
La pente est escarpée, mais la route est coupée de petits détours sans fin, au moyen desquels on peut gravir la direction perpendiculaire de la montagne. C'est une scène effrayante de désolation. On voit dans mille endroits les traces de l'avalanche d'hiver: la terre est jonchée d'arbres brisés et renversés; les uns sont entièrement détruits, d'autres sont couchés sur les rochers saillants de la montagne, ou sur d'autres arbres qu'ils traversent. Plus haut, la route est entrecoupée par des ravins de neige, au fond desquels des pierres roulent continuellement; l'un d'eux est surtout si dangereux, que le plus léger bruit, par exemple, la voix d'une personne qui parle haut, donne à l'air une commotion suffisante pour attirer la mort sur sa tête. Les pins ne sont ni grands ni touffus, mais sombres, et ajoutent à la sévérité de la scène. Je regardai la vallée qui était au-dessous de moi; d'épais brouillards, s'élevant des rivières qui la traversent, couronnaient les montagnes opposées, dont les sommets étaient cachés dans les nuages uniformes, tandis que la pluie tombait abondamment d'un ciel noir, et augmentait l'impression mélancolique que je recevais de ces divers tableaux. Hélas! pourquoi l'homme se glorifie-t-il d'avoir des sensations supérieures à celles de la brute, puisqu'elles ne servent qu'à multiplier ses besoins? Si nous étions bornés à éprouver la faim, la soif et le désir, nous serions presque libres; mais nous sommes émus par le moindre vent, par un mot prononcé au hasard, ou par le souvenir que réveille ce mot.
Voulons-nous nous reposer? un rêve a le pouvoir d'agiter notre sommeil. Voulons-nous quitter le lit? une seule pensée peut troubler la journée. Sentir, concevoir, ou raisonner; rire ou pleurer; s'abîmer dans le malheur, ou bannir les soucis, n'est qu'une seule et même chose; car il y a une fin, ou au chagrin, ou à la joie. Les jours ne peuvent se ressembler; rien ne peut durer; tout est variable!
Il était presque midi lorsque j'arrivai au sommet de la montagne. Je m'assis quelque temps sur le rocher qui domine la mer de glace. Elle était couverte de brouillards; les montagnes qui l'entourent en étaient également voilées. Dans ce moment, une brise dissipa le nuage, et je descendis sur le glacier. Sa surface est très-inégale: elle s'élève ou s'abaisse comme les flots d'une mer agitée, et parait sillonnée de crevasses profondes. La plaine de glace a près d'une lieue d'étendue: je mis près de deux heures à la traverser. La montagne opposée est un rocher nu et perpendiculaire. En face de moi, s'élevait le mont Anvert, à la distance d'une lieue, et au-dessus le mont Blanc avec une majesté terrible. Je m'arrêtai dans une crevasse du rocher, à contempler cette scène merveilleuse et effrayante. La mer, ou plutôt le vaste fleuve de glace, était renfermé dans des montagnes, dont les cimes aériennes dominaient les abîmes. Leurs pics, couverts de glace et éclatants, brillaient à la lumière du soleil parmi les nuages. Mon cœur, qui, auparavant, était plein de tristesse, éprouva alors une sorte de joie, et je m'écriai: «Esprits errants, s'il est vrai que vous soyez errants, et que vous ne reposiez pas dans vos lits étroits, accordez-moi ce faible bonheur, ou enlevez-moi aux plaisir de la vie pour me porter parmi vous».
À ces mots, je vis tout à coup un homme à quelque distance, qui s'avançait vers moi avec une rapidité surnaturelle. Il franchissait les crevasses de glace, parmi lesquelles j'avais marché avec précaution; il s'approcha, et me parut d'une stature qui excédait celle d'un homme. Je fus troublé: un brouillard couvrit mes yeux, et je me sentis évanouir; mais je fus bientôt remis par le vent froid des montagnes. En portant les yeux sur l'être qui approchait de plus en plus, je reconnus (objet de haine et d'effroi), celui que j'avais créé. Je frissonnai de rage et d'horreur, décidé à attendre son approche, et à engager avec lui un combat mortel. Il approcha; sa figure exprimait une douleur amère, mêlée de dédain et de perversité, et portait en même temps l'empreinte d'une laideur trop horrible, pour être supportable aux yeux des hommes. Mais je la remarquai à peine; la colère et la haine m'avaient d'abord privé de l'usage de la parole, et je ne la recouvrai que pour l'accabler de l'expression de ma fureur, de ma haine et de mon mépris.
«Démon, m'écriai-je, oses-tu venir près de moi? et ne crains-tu pas que je fasse tomber sur ta tête, le poids de ma terrible vengeance? Éloigne-toi, vil insecte, ou plutôt demeure, afin que je te réduise en poudre!.... Ah! si je pouvais, en terminant ta malheureuse existence, rendre à la vie ces victimes que tu as si méchamment immolées»!
—«Je m'attendais à cette réception, dit le démon; le monde hait les malheureux. Combien alors je dois être détesté, moi qui suis plus malheureux qu'aucun être vivant! Vous aussi, mon créateur, vous me détestez, et me méprisez, moi qui vous dois l'existence, et à qui vous êtes attaché par des liens que la mort de l'un de nous pourra seule dissoudre. Vous voulez me tuer? Comment oser vous jouer ainsi de la vie? Faites votre devoir envers moi; je ferai le mien envers vous et le reste de l'espèce humaine. Si vous consentez à mes conditions, je ne troublerai ni vous, ni elle; mais si vous vous y refusez, je rassasierai la mort, jusqu'à ce qu'elle regorge du sang de vos derniers amis».
—«Monstre abhorré! Démon que tu es! les tortures de l'enfer sont une vengeance trop douce pour tes crimes. Misérable démon! tu me reproches de t'avoir créé; viens donc, que j'arrache l'existence que je t'ai si imprudemment donnée».
Ma rage était au comble: je m'élançai vers lui, poussé par tous les sentiments qui peuvent animer un homme, contre l'existence d'un autre.
Il m'échappa sans peine, et me dit: «Calmez-vous! Je vous engage à m'écouter, avant de donner cours à votre haine contre ma tête maudite. N'ai-je pas assez souffert, sans que vous cherchiez à aggraver mon malheur! Quoique la vie ne soit qu'une accumulation de tourments, elle m'est chère, et je la défendrai. Souvenez-vous que vous m'avez fait plus puissant que vous ne l'êtes vous-même; ma taille est supérieure à la vôtre; mes membres sont plus souples; mais je n'essaierai pas de lutter avec vous. Je suis votre créature; et je veux être doux et docile envers le maître et le roi que la nature m'a donné, si vous remplissez envers moi les devoirs qui vous sont confiés. Ah! Frankenstein, ne soyez pas équitable pour les autres, et assez injuste envers moi, pour me fouler aux pieds, moi, pour qui votre justice, votre clémence et votre affection devraient être réservées. Souvenez-vous que je suis votre créature. Je devrais être pour vous un Adam; mais je suis plutôt l'ange déchu, que vous privez du bonheur, sans que j'aie commis aucun forfait. Partout je vois le bonheur, dont je suis seul irrévocablement exclus. J'étais bienveillant et bon; le malheur m'a rendu semblable au génie du mal. Rendez-moi heureux, et je pratiquerai encore la vertu».
—«Éloigne-toi, je ne veux pas t'entendre. Il ne peut y avoir rien de commun entre toi et moi; nous sommes ennemis. Éloigne-toi, ou essayons nos forces dans un combat, où l'un de nous devra succomber».
—«Comment pourrais-je vous émouvoir? Rien ne vous portera à jeter un regard favorable sur votre créature, qui implore votre bonté et votre compassion. Croyez-moi, Frankenstein: j'étais porté au bien; mon âme respirait l'amour de l'humanité: mais ne suis-je pas isolé, misérablement isolé dans la nature? Vous m'abhorrez, vous qui êtes mon créateur; quel espoir puis-je avoir en vos semblables, qui ne me doivent rien? Ils me méprisent et me haïssent. Les montagnes désertes et les affreux glaciers sont mon refuge. J'ai erré ici pendant plusieurs jours; les cavernes de glace, que seul je ne crains pas, sont une demeure pour moi, et la seule que l'homme n'envie point. Je reste dans ces climats glacés, qui me sont plus favorables que l'homme. Si toute l'espèce humaine savait que j'existe, elle ferait comme vous, et s'armerait pour me détruire. Ne dois-je pas haïr, à mon tour, ceux qui m'abhorrent? Je ne garderai aucune mesure avec mes ennemis. Je suis malheureux, et ils partageront mon malheur. Cependant, il est en votre pouvoir d'adoucir mon sort, et de le délivrer d'un démon, qui, si vous n'y prenez garde, peut devenir si terrible, que, non-seulement vous et votre famille, mais mille autres seront enveloppés dans sa rage. Laissez-vous aller à la pitié, et ne me dédaignez pas. Écoutez mon histoire: lorsque vous l'aurez entendue, abandonnez-moi, ou ayez pitié de moi, selon que vous m'en jugerez digne; mais, écoutez-moi. Les criminels ont obtenu des lois humaines, toutes cruelles qu'elles soient, le droit de parler pour leur propre défense, avant d'être condamnés. Écoutez-moi, Frankenstein. Vous m'accusez d'un meurtre; et, cependant, vous détruiriez avec joie votre propre créature. Ah! louez l'éternelle justice de l'homme! Cependant, je ne vous demande pas de m'épargner: écoutez-moi; et alors, si vous pouvez, et si vous le voulez, détruisez l'ouvrage de vos mains».
—«Pourquoi me rappelles-tu des circonstances dont la pensée me fait frissonner, et que j'ai créées moi-même pour mon malheur? Maudit soit le jour, Démon exécrable, où tu vis, pour la première fois, la lumière! Maudites soient les mains qui t'ont formé! Malédiction sur moi-même! Tu m'as rendu malheureux au-dessus de toute expression. Tu ne m'as pas laissé la force de voir si je suis juste ou injuste envers toi: Éloigne-toi! délivre-moi de la vue de ta forme détestée».
—«Je puis vous en délivrer, mon créateur, dit-il, en plaçant, devant mes yeux, ses mains que je repoussai avec violence; ainsi, j'ôte à votre vue ce que vous abhorrez. Vous pouvez encore m'écouter, et m'accorder votre pitié: je vous la demande, au nom des vertus que j'ai possédées autrefois. Écoutez mon histoire; elle est longue et étrange, et la température de ce lieu n'est pas bonne pour vos sensations délicates; venez dans ma cabane sur la montagne. Le soleil est encore élevé dans les cieux; avant qu'il descende pour se cacher derrière ces précipices couverts de neige, et éclairer un autre monde, vous aurez entendu mon histoire, et vous pourrez vous décider. Il dépend de vous que je quitte à jamais le voisinage de l'homme, et que je mène une vie innocente, ou que je devienne le fléau de vos semblables, et l'auteur de votre prompte ruine».
À ces mots, il marcha à travers la glace: je le suivis. Mon cœur était gonflé, et je ne lui répondis pas; mais, en avançant je pesai les différents motifs dont il s'était servi, et me déterminai du moins à écouter son récit. Cette résolution, dans laquelle la curiosité entrait pour beaucoup, fut confirmée par un sentiment de compassion. Jusqu'à présent, j'avais cru qu'il était le meurtrier de mon frère: je voulus connaître si cette conviction était à tort ou à raison. Pour la première fois, aussi, je sentis quels étaient les devoirs d'un créateur envers celui qu'il a formé; je compris que je devais le rendre heureux, avant de me plaindre de sa méchanceté: ces motifs m'engagèrent à consentir à sa demande. Nous nous mîmes donc à traverser la glace y et à gravir le rocher opposé. L'air était froid; la pluie recommençait à tomber: nous entrâmes dans la cabane; le Démon avec un air d'allégresse, moi le cœur oppressé et l'esprit abattu. J'avais consenti à l'écouter; je m'assis auprès du feu qu'avait allumé mon odieux compagnon: il commença ainsi son histoire.
«J'ai beaucoup de peine à me rappeler les premiers moments de mon existence; tous les événements de cette époque ne se retracent à ma mémoire qu'avec confusion et en désordre. Une étrange multiplicité de sensations me saisit; je vis, je touchai, j'entendis et je sentis à la fois; mais ce ne fut que long-temps après que j'appris à distinguer les opérations de mes divers sens. Je me souviens que, par degrés, une lumière plus forte agit sur mes nerfs, et me força de fermer les yeux. L'obscurité qui vint à régner me troubla; mais à peine m'en étais-je aperçu, qu'en ouvrant les yeux, comme je le suppose maintenant, la lumière vint de nouveau m'éclairer. Je marchai, et je crois que je descendis; mais je remarquai, dans ce moment, que mes sensations subissaient un grand changement. Auparavant, des corps sombres et opaques m'avaient entouré, sans que je pusse ni les toucher ni les voir; je vis alors que je pouvais errer en liberté, sans aucun obstacle que je ne pusse ou surmonter ou éviter. La lumière devint de plus en plus oppressive pour moi, et la chaleur me fatiguant à mesure que je marchais, je cherchai un endroit pour être à l'ombre. Ce fut dans la forêt, près d'Ingolstadt, que je me reposai de ma fatigue sur le bord d'un ruisseau, jusqu'à ce que, tourmenté par la fin et la soif, je m'éveillai de mon assoupissement. Je mangeai quelques graines que je trouvai sur les arbres ou sur le sol; j'étanchai ma soif au ruisseau, je m'étendis à terre, et m'endormis. Tout me parut sombre autour de moi lorsque je me réveillai; l'air était froid, et je fus presque effrayé, comme par instinct, de me trouver ainsi isolé. Avant de quitter votre appartement, j'avais ressenti le froid, et je m'étais couvert de quelques hardes; mais elles ne pouvaient suffire pour me protéger contre les rosées de la nuit. J'étais un malheureux sans appui, et digne de pitié; je ne connaissais rien et ne pouvais rien distinguer; mais, dominé par le chagrin qui me gagnait de toutes les manières, je m'assis et pleurai.
»Bientôt une douce lumière brilla dans les cieux, et me fit éprouver un sentiment de plaisir. Je me levai et vis un astre rayonnant sortir du milieu des arbres. Je contemplai avec une sorte d'étonnement cet astre dont la marche était lente, mais dont la lumière éclairait ma route, et j'allai de nouveau chercher des graines. J'avais encore froid, mais je trouvai, par hasard, sous un arbre un large manteau dont je me couvris, et je m'assis à terre. Aucune idée distincte n'occupait mon esprit; tout était confus. Je sentais la faim, la soif, la lumière et l'obscurité; d'innombrables sons frappaient mes oreilles, et des parfums divers mon odorat. Le seul objet que je pusse distinguer était la brillante lune, sur laquelle je fixai mes yeux avec plaisir.
»Les jours et les nuits s'étaient déjà succédés plusieurs fois, et l'astre de la nuit était considérablement diminué, lorsque je commençai à démêler mes sensations les unes des autres. Je distinguai insensiblement le clair ruisseau où j'étanchais ma soif, et les arbres qui m'ombrageaient de leur feuillage. Je fus dans l'enchantement d'avoir découvert qu'un son agréable, qui souvent frappait mon oreille, sortait du gosier des petits animaux aîlés, dont la masse innombrable avait bien souvent intercepté la lumière à mes yeux. Je commençai aussi à observer, avec plus de soin, les formes qui m'entouraient, et à voir les limites de la brillante voûte de lumière qui me couvrait. Tantôt je cherchais à imiter les chants agréables des oiseaux, sans pouvoir y réussir; tantôt je voulais exprimer mes sensations à ma manière; mais je rendais des sons rudes et inarticulés dont j'étais effrayé, alors même que je ne les entendais plus.
»La lune avait cessé de paraître; mais j'étais encore dans la forêt, quand son disque reparut de nouveau moins étendu. Pendant ce temps, mes sensations étaient devenues plus nettes, et mon esprit recevait chaque jour de nouvelles idées. Mes yeux s'accoutumaient à la lumière; je voyais les objets dans leur véritable forme; je distinguai l'insecte de l'herbe, et, par degrés, une herbe d'une autre. Le chant du passereau me sembla grossier, tandis que celui du merle et de la grive était doux et enchanteur.
»Un jour que j'étais transi de froid, je trouvai un feu qui avait été laissé par quelques mendiants vagabonds, et dont la chaleur me réchauffa agréablement. Dans ma joie, je mis la main sur les braises ardentes, mais je la retirai sur-le-champ en laissant échapper un cri de douleur. Combien il me sembla étrange que la même cause produisit des effets si opposés! J'examinai les matières du feu, et à ma satisfaction, je m'aperçus qu'il était composé de bois. Je réunis promptement quelques branches; mais elles étaient humides et ne purent s'allumer. J'en fus affligé, et je m'assis en examinant de nouveau l'action du feu. Le bois mouillé que j'avais placé auprès, se sécha et s'enflamma. Je réfléchis sur ce fait, et en touchant les branches je découvris la cause, et m'occupai à rassembler une grande quantité de bois que je mis à sécher, et que je destinai à l'entretien du feu. La nuit vint, et le sommeil avec elle; j'eus la plus grande crainte que mon feu ne s'éteignit; je le couvris avec soin de bois sec et de feuilles, au-dessus desquelles je plaçai des branches humides; j'étendis alors mon manteau, me couchai sur la terre, et me livrai au sommeil.
»Réveillé dès le matin, j'eus pour premier soin de visiter le feu. Je ne l'eus pas plutôt mis à découvert, qu'un léger vent l'enflamma bientôt. Ce fut une nouvelle remarque pour moi; je fis avec des branches une espèce d'éventail pour rallumer les braises, si elles étaient près de s'éteindre. Au retour de la nuit, je vis avec plaisir que le feu avait le double avantage d'éclairer et de chauffer, et que la découverte de cet élément m'était utile pour ma nourriture; car il me parut que quelques-uns des mets, que les voyageurs avaient laissés, étaient cuits, et avaient bien meilleur goût que les graines que je cueillais aux arbres. J'essayai donc de préparer ma nourriture de la même manière, en la plaçant sur les charbons embrasés. Je vis que les graines étaient dépouillées par cette opération, et que les noix et les racines en étaient bien meilleures.
»Cependant, la nourriture devint rare, au point que je passais souvent la journée entière à chercher vainement quelques glands pour assouvir ma faim. Frappé de cette observation, je résolus de quitter le lieu que j'avais habité, pour en chercher un où je pourrais plus facilement satisfaire le petit nombre de besoins que j'éprouvais. Dans cette émigration, je m'affligeai profondément de la perte du feu que le hasard m'avait présenté, et que je ne savais comment rallumer. Je passai plusieurs heures à réfléchir sérieusement à cette difficulté; mais je fus obligé d'abandonner tous les essais que je faisais pour la vaincre; et, enveloppé de mon manteau, je m'enfonçai dans le bois, en me dirigeant vers le soleil couchant. Je passai trois jours à errer de cette manière, et enfin je découvris la campagne. La neige était tombée en abondance pendant la nuit précédente, et les champs étaient d'une blancheur uniforme. Cette vue me parut triste, et je sentis mes pieds glacés par la substance froide et humide qui couvrait la terre.
»Sept heures venaient de sonner: j'étais impatient de pourvoir à ma nourriture et de trouver un abri. Enfin, j'aperçus une petite cabane sur un terrain élevée et qui avait sans doute été bâtie pour la commodité de quelque berger. C'était un spectacle nouveau pour moi: j'en examinai la structure avec beaucoup de curiosité. La porte était ouverte; j'entrai. Un vieillard était assis près d'un feu, sur lequel il préparait son déjeuner. Au bruit qu'il entend, il se retourne, me voit, pousse un cri, sort de la cabane, et court à travers les champs avec une rapidité dont il paraissait à peine capable à son extérieur débile. Je fus un peu surpris de sa forme, qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu, et surtout de sa fuite. Mais je fus enchanté en regardant la cabane. La neige ni la pluie n'y pouvaient pénétrer; la terre était sèche, et elle me présentait alors une retraite aussi délicieuse et aussi belle, que semblait le Pandémonium aux génies de l'Enfer, après leurs souffrances dans le lac de feu. Je dévorai avec joie les restes du déjeuner du berger, qui consistait en pain, en fromage, en lait et en vin; mais sans être flatté de ce dernier objet; accablé par la fatigue, je m'étendis sur la paille et je m'endormis.
»Il était midi quand je me réveillai. Excité par la chaleur du soleil, qui se réfléchissait avec éclat sur la terre couverte de neige, je me déterminai à recommencer mes voyages; je pris soin de placer les restes du déjeuner du paysan dans une besace que je trouvai; et, pendant plusieurs heures, je poursuivis ma route à travers champs, jusqu'à un village où je parvins au coucher du soleil: je fus émerveillé. Des cabanes, d'agréables chaumières et d'élégantes maisons appelaient tour à tour mon admiration. Les végétaux dans les jardins, le lait et le fromage sur les fenêtres de quelques chaumières, excitaient mon appétit. J'entrai dans l'une des plus apparentes; mais j'avais à peine franchi le seuil de la porte, que les enfants jetèrent des cris, et qu'une des femmes s'évanouit. Tout le village fut en l'air; les uns se mirent à fuir, les autres à m'attaquer, au point que, fortement meurtri par les pierres et autres projectiles qu'on me lançait, je m'échappai dans la campagne, et me réfugiai, rempli d'effroi, dans une petite cabane abandonnée, et qui me paraissait bien chétive auprès des palais que j'avais vus dans le village. Cette cabane, cependant, était contiguë à une chaumière d'une apparence agréable; mais, après l'expérience que je venais de faire, et qui m'avait coûté si cher, je n'osai pas y rentrer. Le lieu qui me servait d'asile était construit en bois; mais il était si bas, que je ne pouvais m'y tenir debout qu'avec peine. Le sol n'était pas recouvert d'un plancher, mais il était très-sec. J'avais l'avantage de pouvoir me garantir dans cette enceinte de la neige et de la pluie, malgré le vent qui y pénétrait par d'innombrables fentes.
»Dans cette retraite, je m'étendis à terre, heureux de l'avoir trouvée, quelque mauvaise qu'elle fût, contre l'intempérie de la saison, et encore plus contre la barbarie des hommes.
»Dès le matin, je sortis de ma cabane pour voir la chaumière adjacente, et examiner si je pouvais rester dans l'habitation que j'avais trouvée. Elle était adossée à la chaumière, et entourée, sur les côtés qui étaient exposés, d'une étable à cochons et d'une source d'eau limpide. De l'autre côté, elle présentait une ouverture par laquelle j'étais entré. Je couvris alors de pierres et de bois toutes les crevasses par lesquelles je pouvais être aperçu, mais de manière à pouvoir les déranger dans l'occasion pour sortir: je ne recevais la lumière que par l'étable, mais je n'avais pas besoin d'en recevoir davantage.
»Je venais de disposer ainsi mon habitation, et de la garnir de paille fraîche, quand je vis de loin la figure d'un homme. Je rentrai; car je me souvenais trop bien du traitement que j'avais éprouvé la veille, pour me mettre en son pouvoir. Cependant, j'avais pourvu à ma subsistance pour ce jour-là, en enlevant un morceau de pain grossier; je m'étais emparé aussi d'une coupe, afin de boire, plus commodément que dans ma main, l'eau pure qui coulait auprès de ma retraite. Du reste, j'étais à l'abri de l'humidité, et je pouvais même éprouver quelque chaleur dans le voisinage de la cheminée de la chaumière.
»Avec ces précautions, je résolus de résider dans cette cabane, jusqu'à ce qu'une nouvelle circonstance me détournât de cette résolution. C'était vraiment un paradis, en comparaison de la sombre forêt, ma première résidence, des branches à travers lesquelles je recevais la pluie, et de la terre toujours humide. Je déjeunai avec plaisir: après ce repas, j'allais enlever une planche pour puiser un peu d'eau, lorsque j'entendis un pas. Je mis l'œil à une petite fente, et je vis une jeune personne, un seau sur la tête, passer devant ma cabane. Elle était jeune et gentille, différente de ce que m'ont paru depuis les villageoises et les servantes de ferme. Son vêtement était simple, et se composait d'un jupon bleu, et grossier, et d'une jaquette de toile; sa belle chevelure était tressée, mais sans ornement; son visage avait l'expression de la souffrance et de la tristesse. Elle disparut; mais elle revint bientôt, portant le seau qui était alors presque rempli de lait. Au moment où elle passa, elle parut incommodée du fardeau. Un jeune homme, dont la figure exprimait le plus profond désespoir, vint au devant d'elle, prononça quelques mots avec un air de mélancolie, prit le seau sur la tête de la jeune fille, et le porta lui-même dans la chaumière. Elle le suivit, et ils disparurent. Peu après, je vis le jeune homme, quelques outils à la main, traverser le champ derrière la chaumière. La jeune fille avait d'autres soins, tantôt dans la maison, tantôt dans la basse-cour.
»En examinant mon habitation, je reconnus qu'une des fenêtres de la chaumière en avait d'abord occupé une partie, mais les panneaux avaient été fermés avec du bois. Il y avait cependant dans un de ces panneaux, une petite fente presqu'imperceptible, et par laquelle l'œil pouvait à peine pénétrer. À travers cette fente, on distinguait une petite chambre très-propre et très-soignée, mais peu meublée. Dans un coin, auprès d'un petit feu, était assis un vieillard, la tête appuyée sur les mains, dans l'attitude de la douleur. La jeune fille était occupée à arranger la chaumière; elle prit dans un tiroir un objet qui exigea le mouvement de ses mains, et s'assit auprès du vieillard. Celui-ci tenait un instrument, et en tira bientôt des sons plus doux que le chant de la grive ou du rossignol. Ce tableau était agréable, même pour moi, pauvre malheureux, qui n'avais jamais auparavant rien vu de beau. Les cheveux blancs, et la physionomie bienveillante du vieillard, commandaient le respect, en même temps que les manières douces de la jeune fille inspiraient l'amour. Il joua un air doux et triste, et je vis des larmes couler des yeux de son aimable compagne, tandis que le vieillard n'y prit garde que lorsqu'elle poussa des sanglots. Il prononça quelques mots auxquels la belle créature ne répondit qu'en laissant l'ouvrage, et en tombant à ses pieds. Il la releva, et sourit avec tant de bonté et d'affection, que j'éprouvai des sensations d'une nature particulière et accablante: c'était un mélange de peine et de plaisir, tel que je n'en avais encore jamais éprouvé, soit par la faim ou le froid, soit par la chaleur ou le plaisir de manger. J'étais incapable de soutenir ces émotions: je quittai la fenêtre.
»Bientôt après le jeune homme revint, portant du bois sur ses épaules. La jeune fille le reçut à la porte, aida à le décharger de son fardeau, apporta quelques morceaux de bois, et les mit au feu; le jeune homme l'amena dans un coin de la chaumière, et lui montra un grand pain et un morceau de fromage. Elle parut contente, et s'empressa d'aller chercher dans le jardin quelques racines et quelques plantes, qu'elle plaça dans l'eau et ensuite sur le feu. Elle se remit ensuite à son ouvrage, pendant que le jeune homme alla dans le jardin, et parut occupé à bêcher la terre et à planter des racines. Une heure après, la jeune femme alla le rejoindre, et ils rentrèrent ensemble dans la chaumière.
»Pendant ce temps, le vieillard était resté pensif; mais à l'approche de ses compagnons il prit un air plus gai. Ils se mirent à table: le repas fut promptement terminé. La jeune femme fut encore occupée à arranger la chaumière; le vieillard se promena en dehors au soleil, pendant quelques minutes, appuyé sur le bras du jeune homme. Rien ne pouvait surpasser la beauté du contraste qu'offraient ces deux excellentes créatures. L'un était vieux, avait des cheveux blancs, et une physionomie qui respirait la bienveillance et la tendresse. La figure du jeune homme était douce et gracieuse, et ses traits de la plus belle régularité; cependant ses yeux et son attitude exprimaient le plus profond chagrin et le désespoir. Le vieillard rentra dans la chaumière; et le jeune homme, avec des outils différents de ceux dont il s'était servi le matin, dirigea ses pas à travers les champs.
»La nuit arriva bientôt; mais à mon grand étonnement, je vis que les habitants de la chaumière avaient un moyen de prolonger le jour par l'usage des lumières; et je fus charmé de voir que le coucher du soleil ne mettait pas fin au plaisir que j'éprouvais à observer mes voisins. Pendant la soirée, la jeune fille et son compagnon se livrèrent à différentes occupations que je ne comprenais pas; et le vieillard reprit l'instrument, qui produisit les sons divins qui m'avaient enchanté le matin. Dès qu'il eût cessé, le jeune homme se mit, non pas à chanter; mais à prononcer des sons monotones, qui ne ressemblaient nullement à l'harmonie de l'instrument du vieillard, ni aux chants des oiseaux; je sus depuis qu'il lisait à haute voix, mais alors je ne connaissais pas la science des mots ou des lettres.
»La famille donna quelques moments à ces différentes occupations, éteignit ses lumières, et se retira, suivant mes conjectures, pour se livrer au repos.
»Je m'étendis sur la paille sans pouvoir dormir. Je pensais à tout ce dont j'avais été témoin pendant le jour. J'étais surtout frappé des manières douces de ces gens; et je désirais aller les trouver, mais je n'osais m'y résoudre. Je me souvenais trop bien du traitement que j'avais éprouvé le soir précédent de la part des barbares villageois, et je me déterminai, quelque fût la conduite que je dusse tenir par la suite, à rester tranquille dans ma cabane, à observer, et à essayer de découvrir les motifs qui dirigeaient leurs actions.
»Les habitants de la chaumière se levèrent le lendemain matin avant le soleil. La jeune femme arrangea la chaumière et prépara à manger; le jeune homme partit après le premier repas.
»Cette journée se passa de même que la précédente. Le jeune homme était constamment occupé au dehors, et la jeune fille à différents travaux dans l'intérieur: Le vieillard, que je reconnus bientôt aveugle, passait ses heures de loisir avec son instrument, ou en contemplation. Rien ne pouvait surpasser l'amour et le respect, que les jeunes habitants de la chaumière montraient envers leur vénérable compagnon. Ils lui rendaient avec grâce tous les petits services d'affection et de devoir; et ils en étaient récompensés par son bienveillant sourire.
»Ils n'étaient pas entièrement heureux. Le jeune homme et sa compagne se retiraient souvent à l'écart, et avaient l'air de pleurer. Je ne connaissais pas le motif de leur malheur; mais j'en étais profondément affecté. Si ces aimables créatures étaient malheureuses, il était moins étrange que je le fusse, moi qui étais un être imparfait et isolé. Cependant, pourquoi ces êtres charmants étaient-ils malheureux? Ils possédaient une maison délicieuse qui, du moins, était telle à mes yeux; ils n'éprouvaient aucun besoin: ils avaient un feu pour les réchauffer lorsqu'ils ressentaient le froid, et des viandes exquises pour apaiser leur faim; ils étaient couverts de hardes excellentes; et, de plus, ils jouissaient de la société et de la conversation l'un de l'autre, en échangeant chaque jour des regards d'affection et de bonté. Que voulaient dire leurs larmes? Exprimaient-elles réellement la douleur? Je ne pus d'abord résoudre ces questions; mais une attention suivie et le temps m'expliquèrent beaucoup de choses qui paraissaient d'abord énigmatiques.
»Il se passa beaucoup de temps avant que je découvrisse l'unique cause de l'inquiétude de cette aimable famille; c'était la pauvreté dont ils avaient à supporter toute l'horreur. Ils n'avaient d'autre nourriture que les végétaux de leur jardin, et le lait d'une vache, qui en avait fort peu pendant l'hiver, et que ses maîtres pouvaient à peine soutenir. Il leur est arrivé souvent, je crois, de souffrir des atteintes poignantes de la faim, surtout aux deux plus jeunes habitants de la chaumière, qui, plusieurs fois, plaçaient à manger devant le vieillard, sans se rien réserver.
»Ce trait de bonté me toucha sensiblement. J'avais l'habitude, pendant la nuit, de dérober une partie de leurs provisions pour ma propre consommation; mais, touché de la peine que je faisais à ces excellentes gens, je cessai, et me nourris de graines, de noix, et de racines, que je cueillais dans un bois voisin.
»Je découvris aussi d'autres moyens de les aider dans leurs travaux. Je vis que le jeune homme passait une grande partie de ses journées à ramasser du bois pour le feu de la famille; pendant la nuit je prenais souvent ses outils, dont je connus bientôt l'usage, et je rapportais assez de bois pour la consommation de plusieurs jours.
»Je me souviens qu'à la première fois, la jeune femme en ouvrant la porte le matin, parut très-étonnée de voir une grande pile de bois. Elle dit quelques mots à haute voix, et le jeune homme accourut, en exprimant aussi sa surprise. Je remarquai, avec plaisir, qu'il n'alla pas à la forêt ce jour là, mais qu'il le passa à réparer la chaumière et à cultiver le jardin.
»Peu à peu, je fis une découverte d'un intérêt encore plus grand. Je vis que ces personnes avaient une manière de se communiquer leurs idées et leurs sentiments par des sons articulés. Je m'aperçus que leurs paroles étaient suivies du plaisir ou de la peine, du sourire ou de la tristesse, tantôt dans l'esprit, tantôt sur la physionomie de ceux qui les entendaient. Je les croyais doués d'une science divine, je désirais ardemment l'apprendre; mais j'étais déconcerté à chaque essai que je tentai. Leur prononciation était vive, et les mots dont ils se servaient, n'ayant aucune concordance apparente avec les objets visibles, je ne pouvais trouver aucun moyen d'éclaircir le mystère de leur rapport. Cependant, à force de persévérance, et après avoir vu dans ma cabane plusieurs phases de la lune, je découvris les noms qui convenaient à quelques-uns des objets les plus familiers du discours: j'appris et appliquai les mots feu, lait y pain et bois. J'appris aussi les noms des habitants de la cabane eux-mêmes. Le jeune homme et sa compagne avaient chacun plusieurs noms; mais le vieillard n'avait que celui de père. La jeune fille s'appelait sœur ou Agathe, et le jeune homme Félix, frère ou fils. Je ne saurais décrire le plaisir que j'éprouvai en connaissant les idées appropriées à chacun de ces sons, et en parvenant à les prononcer. Je distinguai plusieurs autres mots, sans pouvoir les comprendre ou les appliquer, tels que bon, très-cher, malheureux.
»Je passai l'hiver ainsi. Les habitudes douces et la beauté des habitants de la chaumière me les rendaient chers. Étaient-ils dans l'affliction, je me sentais affligé. Étaient-ils contents, je sympathisais avec eux. Je vis peu d'autres personnes que celles dont je vous parle; et, si des étrangers entraient dans la cabane, leurs manières dures et leur air grossier ne servaient qu'à relever à mes yeux la supériorité de mes amis. Le vieillard, je pus le voir, essayait souvent d'encourager ses enfants; et quelquefois il les appelait pour bannir leur tristesse. Il leur parlait avec un air de gaîté, une expression de bonté qui me faisait plaisir à moi-même. Agathe écoutait avec respect, ses yeux se remplissaient quelquefois de pleurs qu'elle cherchait à cacher; mais en général sa figure et son ton étaient plus gais après les exhortations paternelles. Il n'en était pas de même de Félix. Il était toujours le plus triste du groupe; et il me parut, même malgré l'inexpérience de mes sens, avoir plus souffert que ses amis. Mais si son air était plus chagrin, sa voix était plus joyeuse que celle de sa sœur, surtout quand il s'adressait au vieillard.
»Je pourrais rapporter des exemples sans nombre, qui ne sont pas importants, mais qui peignent le caractère de ces aimables habitants. Au milieu de la pauvreté et du besoin, Félix aimait à porter à sa sœur la première petite fleur blanche qui perçait la neige. Le matin de bonne heure, avant le lever d'Agathe, il balayait la neige qui obstruait le chemin de la laiterie, tirait de l'eau du puits, et portait le bois qui était au dehors de la maison, où, à son étonnement continuel, il trouvait une provision toujours faite par une main invisible. Pendant le jour, il travaillait quelquefois pour un fermier voisin; du moins je l'ai pensé, en le voyant sortir souvent, et ne revenir que pour dîner, et sans porter de bois avec lui. Quelquefois il travaillait dans le jardin; mais il y avait peu à faire dans la saison de la gelée; alors il lisait pour le vieillard et Agathe.
»Cette lecture m'avait d'abord extrêmement embarrassé; mais, par degrés, je reconnus qu'il prononçait en lisant les mêmes sons que ceux dont il faisait usage en parlant. J'en tirai la conséquence qu'il trouvait sur le papier des signes pour des paroles, dont il avait le sens. Je désirais vivement les connaître; mais comment le pouvais-je, moi qui ne comprenais même pas les sons que marquaient les signes? Cependant, je fis des progrès sensibles dans cette science, mais je n'en fis pas assez pour suivre aucune sorte de conversation, malgré mon application et mes efforts. J'étais porté à ce travail par le désir de me découvrir aux habitants de la chaumière, et par la nécessité de n'en faire l'essai qu'après avoir appris leur langage; certain que, si je parlais comme eux, je les effrayerais moins de la difformité de ma figure, dont j'avais eu connaissance par le contraste que j'avais continuellement sous les yeux.
»J'avais admiré les formes accomplies de mes voisins, leur grâce, leur beauté, et leur teint délicat; mais combien je fus effrayé quand je me vis dans une eau transparente! Je reculai d'abord, me refusant à croire que je me fusse réfléchi dans ce miroir; convaincu enfin que j'étais en réalité le monstre qui est devant vous, je fus pénétré du plus profond désespoir et de la mortification la plus cruelle. Hélas! je ne connaissais pas encore les funestes effets de cette difformité!
»Le soleil devint plus chaud, et la lumière du jour plus longue. La neige disparut, les arbres cessèrent d'en être couverts, et la terre reprit une couleur noire. Dès-lors Félix eut beaucoup d'occupations, et ces braves gens ne furent plus exposés à l'horrible famine dont ils étaient menacés. Leur nourriture, comme je le remarquai depuis, était grossière, mais abondante; ils mangeaient suivant leurs besoins. Plusieurs nouvelles espèces de plantes vinrent dans le jardin qu'ils cultivaient; et ces gages de consolation se multipliaient chaque jour à mesure que la saison avançait.
»Le vieillard, appuyé sur son fils, se promenait tous les jours à midi, lorsqu'il ne pleuvait pas; car j'entendais dire qu'il pleuvait, quand le ciel versait ses eaux. La pluie tombait souvent; mais un vent, qui s'élevait, séchait promptement la terre; et la saison devint enfin bien plus agréable qu'elle n'avait été.
»Mon genre de vie dans la cabane était uniforme. Le matin, je suivais les mouvements de mes voisins; et dès qu'ils se dispersaient pour leurs diverses occupations, je dormais: je passais le reste du jour à observer mes amis. Lorsqu'ils s'étaient retirés pour se livrer au repos, j'allais dans la forêt, s'il y avait clair de lune, ou si la nuit était étoilée, chercher ma nourriture et du bois pour la chaumière. À mon retour, il était souvent nécessaire que je balayasse la neige qui était sur leur chemin; je faisais aussi tous les autres travaux auxquels j'avais vu Félix se livrer. Je remarquais ensuite leur étonnement sur ces travaux exécutés par une main invisible; et une ou deux fois, je les entendis dans cette occasion, prononcer les mots bon génie, miracle; mais je ne comprenais pas alors la signification de ces termes.
»Mes pensées devinrent plus actives; j'étais impatient de découvrir les motifs et les sentiments de ces aimables créatures; je cherchais à savoir pourquoi Félix paraissait si malheureux et Agathe si triste. Je croyais, insensé que j'étais! que je pourrais rendre le bonheur à ces êtres qui le méritaient si bien. Pendant mon sommeil ou loin d'eux, les formes du vénérable aveugle, de la douce Agathe et du bon Félix, se présentaient à mon esprit. Je les regardais comme des êtres supérieurs, qui devaient être les arbitres de ma destinée future. Mon imagination se figurait le moment où je me présenterais devant eux, et la réception qu'ils me feraient. Je pensais qu'ils supporteraient difficilement le premier abord, mais que, par une conduite douce et des paroles conciliantes, je pourrais gagner leur faveur, et ensuite leur amour.
»Ces pensées me réjouirent et m'animèrent d'une nouvelle ardeur. Je m'appliquai à apprendre à parler. Mes organes étaient rudes, il est vrai, mais souples; ma voix ressemblait fort peu à la douce musique de leurs intonations, mais elle prononçait avec assez de facilité les mots que je comprenais.
»Les ondées favorables et la chaleur vivifiante du printemps, changèrent beaucoup l'aspect de la terre. Les hommes, qui, avant cette métamorphose, avaient paru cachés dans des souterrains, se dispersèrent pour s'adonner à différents genres de culture. Les chants des oiseaux furent plus gais, et les feuilles commencèrent à garnir les arbres. Heureuse, heureuse terre, digne d'être habitée par des dieux, qui, un moment auparavant, était froide, humide, et malsaine! Mes esprits étaient transportés par cet aspect enchanteur de la nature; le passé fut effacé de ma mémoire, le présent était tranquille, et l'avenir s'embellissait des rayons brillants de l'espérance, et de mille joies anticipées.
»J'arrive maintenant à la partie la plus intéressante de mon histoire. Je rapporterai les évènements qui ont bouleversé tous mes sentiments, et m'ont fait tel que je suis aujourd'hui.
»Le printemps s'avançait rapidement; le temps devint beau, et le ciel sans nuages. J'étais surpris que la terre, auparavant déserte et triste, fût alors brillante de verdure et des fleurs les plus belles. Mes sens étaient charmés et rafraîchis par une infinité d'odeurs délicieuses et de vues magnifiques.
»Un jour, c'était celui consacré périodiquement au repos par mes voisins, le vieillard jouait de la guitare, et ses enfants l'écoutaient. Je remarquai sur la figure de Félix une expression de mélancolie inconcevable; il soupirait fréquemment. Le père suspendit sa musique, et, à son air, je jugeai qu'il demandait à son fils la cause de son chagrin: Félix répondit gaîment au vieillard, qui allait reprendre son instrument, lorsqu'on entendit frapper à la porte.
»C'était une dame à cheval, suivie d'un paysan pour guide. Elle était vêtue de noir, et couverte d'un voile épais de la même couleur. Agathe fit une question, à laquelle l'étrangère ne répondit, qu'en prononçant d'une voix douce le nom de Félix. Sa voix était harmonieuse, mais différente de celle de mes amis. À son nom, Félix accourut promptement vers la dame, qui, en le voyant, releva son voile, et me laissa voir une figure d'une beauté et d'une expression angéliques. Ses cheveux étaient d'un noir brillant, et tressés avec soin; ses yeux noirs, mais pleins de douceur et de feu; ses traits d'une proportion régulière; son teint admirable, et ses joues embellies par les grâces.
»Félix parut transporté de plaisir en la voyant; son visage, d'où le chagrin fut banni, exprima sur-le-champ une joie vive, et dont je l'aurais à peine cru capable; ses yeux étincelaient; ses joues étaient animées par le plaisir; et, dans ce moment, il me parut aussi beau que l'étrangère. Elle semblait livrée à divers sentiments: elle versait des larmes, et en même temps elle tendait la main à Félix, qui la baisait avec ravissement, et l'appelait, autant que je pus le distinguer, sa chère Arabe. Elle ne paraissait pas le comprendre, mais elle souriait. Il l'aida à descendre de cheval, renvoya son guide, et la conduisit dans la chaumière. Une conversation eut lieu entre lui et son père. La jeune étrangère se jeta aux pieds du vieillard, et voulut baiser sa main; mais il la releva et l'embrassa avec affection.
»Je vis bientôt, que l'étrangère prononçait des sons articulés, et faisait usage d'un langage particulier; mais qu'elle n'était pas plus comprise par les habitants de la chaumière, qu'elle ne les comprenait elle-même. Ils faisaient beaucoup de signes, que je ne savais pas interpréter; mais je m'aperçus que sa présence répandait la gaîté dans la chaumière, et dissipait leur chagrin comme le soleil dissipe le brouillard du matin. Félix paraissait surtout heureux, et accueillait son Arabe avec le sourire du bonheur. Agathe, la sensible Agathe, baisait les mains de l'aimable étrangère; lui montrait son frère, et semblait lui expliquer, par des signes, qu'il avait été triste jusqu'au moment de son arrivée. Quelques heures se passèrent ainsi à des démonstrations de joie dont je ne comprenais pas la cause. Je ne tardai pas à voir, au retour fréquent d'un son que l'étrangère répétait après eux, qu'elle cherchait à apprendre leur langue, et je pensai aussitôt à profiter des mêmes instructions pour le même but. L'étrangère apprit dans la première leçon à-peu-près vingt mots dont je connaissais déjà la plupart; mais je retins les autres.
»À la nuit, Agathe et l'Arabe se retirèrent de bonne heure. En se séparant de l'étrangère, Félix lui baisa la main, et lui dit: «Bon soir, chère Safie». Il resta beaucoup plus long-temps que de coutume, à s'entretenir avec son père. Je jugeai que leur aimable hôte, dont le nom était sans cesse prononcé, était le sujet de leur conversation. Je désirais ardemment les comprendre, j'y employais toutes mes facultés; mais je me consumai en vains efforts.
»Le lendemain matin, Félix alla à son ouvrage; de son côté, Agathe ne négligea aucune de ses occupations ordinaires. Quand elle eut tout terminé, l'Arabe s'assit aux pieds du vieillard, prit sa guitare et joua quelques airs si beaux et si touchons, qu'ils m'arrachèrent des larmes de chagrin et de plaisir à la fois. Elle chantait en modulant sa voix en riche cadence, et en l'élevant ou la baissant tour à tour comme le rossignol des bois.
»Elle cessa de chanter, et présenta la guitare à Agathe, qui la refusa d'abord, mais qui finit par jouer un air simple, en l'accompagnant des accents de sa voix, aussi doux, mais moins beaux que les accords admirables de l'étrangère. Le vieillard paraissait ravi, et dit quelques mots qu'Agathe tâcha d'expliquer à Safie, et par lesquels il voulait témoigner tout le plaisir qu'il ressentait de sa musique.
»Les jours se passèrent ensuite aussi tranquillement qu'avant l'arrivée de l'étrangère; seulement depuis ce moment, la joie avait remplacé la tristesse sur le visage de mes amis. Safie était toujours gaie et heureuse; elle et moi nous fîmes de rapides progrès dans la connaissance de la langue, de sorte qu'en deux mois je commençais à comprendre la plupart des mots prononcés par mes protecteurs.
»Pendant ce temps, la terre s'était couverte d'herbage, et les collines verdoyantes étaient parsemées de fleurs innombrables, d'une odeur et d'une vue agréables; les étoiles pâlissaient au milieu des bois devant la clarté de la lune; le soleil devint plus chaud, les nuits claires et embaumées. Mes sorties nocturnes étaient pour moi délicieuses, mais elles étaient devenues beaucoup plus courtes, depuis qu'il n'y avait plus qu'un faible intervalle entre le coucher et le lever du soleil; car je ne sortais jamais pendant le jour, dans la crainte d'éprouver le traitement dont j'avais souffert précédemment, dans le premier village où j'étais entré.
»Mes journées se passaient dans une attention continuelle, afin de savoir plus promptement parler: je puis aussi dire avec quelqu'orgueil, que mes progrès furent plus rapides que ceux de l'Arabe, qui comprenait fort peu et parlait difficilement, tandis que je comprenais et pouvais répéter presque tous les mots que j'entendais.
»En apprenant à parler, j'appris aussi la science des lettres, qu'on enseignait à l'étrangère. C'était pour moi un grand sujet d'étonnement et de plaisir.
»Le livre dont Félix se servait pour instruire Safie, était les Ruines, ou Méditations sur les Révolutions des Empires, par Volney. Je n'aurais pas compris le sens de ce livre, si Félix, en le lisant, n'eût donné des explications très-détaillées. Il avait, disait-il, fait choix de cet ouvrage, parce que le style déclamatoire imitait le genre des auteurs Orientaux. Avec cet ouvrage, je parvins à connaître un peu l'histoire, et à me représenter les différents empires qui existent actuellement dans le monde; j'eus aussi quelqu'idée des usages, des gouvernements, et des religions des différentes nations de la terre. Je connus la paresse des Asiatiques, le génie prodigieux et l'activité d'esprit des Grecs, les guerres et les vertus admirables des anciens Romains, leur décadence, la chute de ce puissant empire, la chevalerie, la chrétienté et les rois. Je connus la découverte de l'hémisphère Américain, et je pleurai avec Safie sur le malheureux sort de ses premiers habitants.
»Ces récits merveilleux m'inspiraient d'étranges sentiments. Comment l'homme était-il si puissant, si vertueux, si grand, et en même temps si méchant et si bas? Tantôt il paraissait une véritable émanation du mauvais principe; tantôt une conception noble et divine. La grandeur d'âme et la vertu me parurent le plus bel ornement d'un être sensible; la bassesse et la méchanceté, qui étaient le partage de tant de monde, me parurent la plus triste dégradation, une condition plus abjecte que celle de la taupe ou du vermisseau. Je fus long-temps avant de concevoir comment un homme pouvait se porter à assassiner son semblable, ou même pourquoi il y avait des lois et des gouvernements; mais, en apprenant les détails des vices et des meurtres, je cessai d'être surpris, et je reculai de dégoût et d'horreur.
»Chaque conversation des habitants de la chaumière me présentait alors de nouveaux prodiges. Les leçons que Félix donnait à l'Arabe, et auxquelles je prêtais toute mon attention, m'expliquèrent l'étrange système de la société humaine. J'entendais parler de la division des propriétés, de richesses immenses et de pauvreté excessive, de rang, de naissance et de noblesse.
»Les mots donnaient lieu aux réflexions. J'appris que les biens les plus estimés par vos semblables, étaient une naissance illustre et pure avec la richesse. Un seul de ces biens suffisait pour qu'un homme fût respecté; mais sans l'un ni l'autre, il était regardé, sauf un petit nombre d'exceptions, comme un vagabond et un esclave, fait pour consumer ses forces au profit d'un petit nombre d'élus. Et qu'étais-je, moi? Je ne connaissais nullement mon origine, ni mon créateur; mais je savais que je n'avais ni argent, ni amis, ni aucune propriété. J'avais d'ailleurs une figure d'une difformité hideuse et repoussante; je n'étais même pas de la même nature que l'homme. J'étais plus agile que lui, et je pouvais subsister d'une nourriture plus grossière; je supportais l'excès de la chaleur et du froid, sans ressentir aucun mal; j'étais enfin d'une taille beaucoup plus élevée que celle des hommes. En regardant autour de moi, je ne voyais et n'entendais personne qui me ressemblât. En ces moments, je me demandais si j'étais un monstre, une difformité que tout le monde fuyait et désavouait.
»Je ne saurais décrire la douleur dans laquelle ces réflexions me jetèrent: j'essayais de les éloigner, mais le chagrin s'augmentait sans cesse avec l'instruction. Ah! que n'étais-je toujours resté dans le bois où j'avais pris naissance, sans connaître ni éprouver d'autres sensations que celles de la faim, de la soif et de la chaleur!
»De quelle étrange nature est l'instruction! Elle s'attache à l'esprit, lorsqu'elle lui a été une fois inculquée, comme le lichen au rocher. Je désirais quelquefois bannir toute pensée et tout sentiment; mais j'appris qu'il n'y avait qu'un moyen d'étouffer toute peine, la mort.... la mort que je craignais, sans pouvoir la comprendre. J'admirais la vertu et les bons sentiments, j'aimais les manières douces et les aimables qualités de mes voisins; mais j'étais privé de communication avec eux, si ce n'est celle que j'obtenais furtivement, sans être vu, ni connu, et qui augmentait le désir que j'avais de compter parmi mes semblables, sans me satisfaire. Les paroles bienveillantes d'Agathe, et le sourire animé de la charmante Arabe, n'étaient pas pour moi. Les douces exhortations du vieillard, et la conversation vive du bien-aimé Félix, ne s'adressaient pas à moi. Malheureux, malheureux que j'étais!
»Je reçus de nouvelles et plus profondes leçons. J'entendis parler de la différence des sexes, de la naissance et de la croissance des enfants; combien le père aimait le sourire de l'enfant au berceau, et les vives saillies d'un fils plus grand; comment la vie de la mère se passait dans les soins précieux de leur éducation; comment l'esprit de la jeunesse s'étendait et s'instruisait; je sus ce qu'étaient un frère, une sœur; et je connus toutes les différentes parentés qui lient mutuellement un être à un autre.
»Mais où étaient mes amis et mes parents? Un père n'avait pas eu soin des jours de mon enfance, une mère ne m'avait pas béni par son doux sourire et ses caresses; ou bien, s'il en avait été ainsi, toute ma vie passée n'était qu'un point, un vide dans lequel je ne distinguais rien. Ma mémoire avait beau remonter dans le passé, il me semblait que j'avais toujours été de la même taille et des mêmes proportions. Je n'avais pas encore vu un être qui me ressemblât, ou qui recherchât quelque commerce avec moi. Qu'étais-je? Cette question revint encore; et je n'y répondis que par des gémissements.
»J'expliquerai bientôt la tendance de ces sentiments. Revenons maintenant aux habitants de la chaumière, dont l'histoire excitait en moi tour-à-tour des sentiments d'indignation, de plaisir et d'étonnement, mais qui ne faisaient qu'ajouter à l'amour et au respect que j'avais pour mes protecteurs; car j'aimais à les appeler ainsi par une illusion innocente et presque pénible.
»J'appris par la suite l'histoire de mes amis. Elle se grava profondément dans mon esprit; car elle se composait d'une foule de circonstances fort intéressantes et merveilleuses pour un être aussi inexpérimenté que moi.
»Le vieillard se nommait de Lacey. Il était descendu d'une bonne famille de France, où il avait long-temps vécu dans l'abondance, respecté de ses supérieurs et chéri de ses égaux. Son fils avait été au service de son pays, et Agathe avait eu rang parmi les dames de la plus grande distinction. Peu de mois avant mon arrivée, ils avaient vécu dans une grande et riche cité, dont le nom est Paris, entourés d'amis, et jouissant de tous les agréments que procurent la vertu, le bon goût, ou un esprit cultivé.
»Le père de Safie avait été la cause de leur ruine. C'était un marchand Turc, qui avait habité Paris pendant plusieurs années; mais qui, pour des raisons que je ne pus apprendre, devint suspect au gouvernement. Saisi et jeté en prison le jour même où Safie arriva de Constantinople pour le rejoindre, il fut jugé et condamné à mort. L'injustice de cette sentence était criante; elle indigna tout Paris, dont l'opinion générale fut que la condamnation avait pour motif, moins le crime imputé au Turc, que sa religion et ses richesses.
»Félix avait assisté au jugement; en entendant la décision de la cour, il ne mit aucune borne à son horreur et à son indignation. Il fit, dès ce moment, le vœu solennel de le sauver, et il chercha alors les moyens de réussir dans cette entreprise. Après beaucoup d'efforts infructueux pour pénétrer dans la prison, il découvrit, dans une partie du bâtiment, une fenêtre fortement grillée, qui n'était pas gardée, et qui éclairait le donjon où l'infortuné Mahométan, chargé de chaînes, attendait, dans le désespoir, l'exécution de l'affreuse sentence. Félix visita la grille pendant la nuit, et fit connaître au prisonnier les intentions dont il était animé.
»Le Turc, étonné et ravi, tâcha d'exciter le zèle de son libérateur, en lui promettant des récompenses et des richesses. Félix rejeta ses offres avec mépris; cependant, en voyant l'aimable Safie, qui avait la permission de visiter son père, et qui, par ses gestes, exprimait sa vive reconnaissance, le jeune homme s'avoua, que le captif possédait un trésor qui serait le prix le plus beau de ses peines et de ses dangers.
»Le Turc s'aperçut promptement de l'impression que sa fille avait faite sur le cœur de Félix, et tâcha de le mettre encore plus dans ses intérêts, en promettait de la lui donner en mariage, dès qu'il serait parvenu en lieu de sûreté. Félix était trop délicat pour accepter cette offre; cependant il regarda la chance de cet événement, comme l'accomplissement de son bonheur.
»Les jours suivants, tandis que tout se préparait pour l'évasion du marchand, le zèle de Félix fut excité par plusieurs lettres de l'aimable Safie, qui parvint à exprimer ses idées dans le langage de son amant, par le secours d'un vieux domestique de son père, qui comprenait le Français. Elle le remerciait, dans les termes les plus ardents, des services qu'il voulait rendre à son père; et en même temps elle déplorait avec douceur son propre sort.
»J'ai des copies de ces lettres; car je sus, pendant ma résidence dans la cabane, me procurer ce qui était nécessaire pour écrire, et je voyais souvent les lettres entre les mains de Félix et d'Agathe. Avant de nous séparer, je veux vous les donner; elles confirmeront ce que je raconte: pour le moment, comme le soleil est déjà très-bas, je me bornerai à vous en dire la substance.
»Safie racontait que sa mère était une Arabe chrétienne, prise et emmenée en esclavage par les Turcs; qu'elle avait séduit, par sa beauté, le cœur du marchand, et qu'elle en était devenue l'épouse. La jeune fille parlait avec orgueil et enthousiasme de sa mère, qui, née libre, méprisait l'esclavage auquel elle avait été réduite. Elle instruisit sa fille dans les principes de sa religion, et lui inspira des pensées élevées et une indépendance d'esprit, défendues aux femmes par Mahomet. Elle mourut; mais ses leçons se gravèrent en caractères ineffaçables dans le cœur de Safie: celle-ci tomba malade en songeant à la nécessité de retourner en Asie, où elle serait renfermée dans un harem, et occupée à des amusements puériles, peu convenables à la disposition de son âme, accoutumée à de grandes idées et à une noble émulation pour la vertu, tandis qu'elle était flattée agréablement par la perspective d'épouser un chrétien, et de rester dans un pays où les femmes pouvaient prétendre à un rang dans la société.
»Le jour fut fixé pour l'exécution du Turc; mais, pendant la nuit qui devait la précéder, il avait quitté sa prison, et, avant que le jour ne parût, il était éloigné de plusieurs lieues de Paris. Félix avait obtenu des passeports en son nom, de même qu'aux noms de son père et de sa sœur. Avant de rien entreprendre, il avait communiqué son plan à son père, qui rendit facile le succès de la ruse, en quittant sa maison, sous le prétexte d'un voyage, et en se cachant avec sa fille, dans l'un des quartiers obscurs de Paris.
»Félix prit la route de Lyon avec les fugitifs, et les conduisit par le mont Cenis à Leghorn, où le marchand se décida à attendre une occasion favorable pour passer en quelque partie de la Turquie.
»Safie résolut de rester avec son père jusqu'au moment de son départ. Le Turc, de son côté, n'attendit pas ce moment, pour renouveler la promesse d'unir sa fille à son libérateur: Félix ne les abandonna pas; et, en attendant cet événement, il jouissait de la société de l'Arabe, qui lui montrait la plus simple et la plus tendre affection. Safie lui chantait aussi les airs délicieux de son pays natal; et il s'entretenait avec elle à l'aide d'un interprète, ou de regards expressifs.
»Le Turc permettait cette intimité, et encourageait les espérances des jeunes amants, tandis que dans son cœur il avait formé des plans tout opposés. Il ne pouvait supporter l'idée que sa fille fût unie à un chrétien; mais il craignait le ressentiment de Félix en montrant du refroidissement, et il savait qu'il était encore au pouvoir de son libérateur, s'il voulait le livrer au gouvernement Italien, sur lequel ils s'étaient réfugiés. Il conçut mille plans pour prolonger la ruse jusqu'à ce qu'elle ne fût plus nécessaire, et pour emmener secrètement sa fille avec lui. Les nouvelles qui arrivèrent de Paris secondèrent beaucoup ses projets.
»Le gouvernement de France était fort irrité de l'évasion de sa victime, et n'épargna rien pour découvrir et punir celui qui l'avait sauvée. Le complot de Félix fut promptement connu, et de Lacey fut jeté en prison avec Agathe. Ces nouvelles parvinrent à Félix, et l'arrachèrent à ses douces pensées. Son père, aveugle et âgé, et son excellente sœur, gémissaient dans un donjon malsain, tandis qu'il jouissait de la liberté, et de la société de celle qu'il aimait. Cette idée était un supplice pour lui. Il convint sur-le-champ avec le Turc, que s'il trouvait une occasion favorable de fuir avant son retour en Italie, Safie serait mise dans un couvent à Leghorn. Ce projet arrêté, il quitta l'aimable Arabe, partit pour Paris, et se livra à la vengeance des lois, dans l'espoir que cette démarche rendrait la liberté à M. de Lacey et à Agathe.
»Vain espoir! Ses parents et lui gémirent pendant cinq mois en prison, dans l'attente d'un jugement, qui prononça la confiscation de leurs biens, et les condamna à un exil perpétuel.
»Ils trouvèrent en Allemagne un misérable asile dans la chaumière où je les découvris. Félix ne tarda pas à connaître la perfidie du Turc, pour qui lui et sa famille souffraient une oppression inouïe. Ce Turc, en apprenant que son libérateur avait perdu toute fortune et tout crédit, était devenu traître à sa conscience et à l'honneur, et avait quitté l'Italie avec sa fille, en envoyant insolemment à Félix une petite somme d'argent, pour qu'il pût, disait-il, se faire un sort.
»Tels étaient les motifs qui affligeaient le cœur du jeune homme, et le rendaient, lorsque je le vis d'abord, le plus à plaindre de la famille. Il aurait pu supporter la pauvreté, et s'en glorifier même, puisqu'elle avait été la récompense de sa vertu; mais l'ingratitude du Turc et la perte de sa bien-aimée Safie, étaient des malheurs plus amers et plus irréparables. Cependant, dès que la jeune Arabe arriva, il se sentit ranimé par une nouvelle vie.
»À peine avait-on appris à Leghorn, que Félix était privé de sa fortune et de son rang, que le marchand ordonna à sa fille de ne plus penser à son amant, mais de se tenir prête à retourner avec lui dans sa patrie. Le cœur généreux de Safie en fut outragé; elle voulut faire des remontrances à son père, mais celui-ci la quitta avec colère, et en lui réitérant ses ordres tyranniques.
»Peu de jours après, le Turc entra dans l'appartement de sa fille, et lui dit précipitamment, qu'il avait des raisons de croire que le secret de sa résidence à Leghorn avait été divulgué, et qu'il serait bientôt livré au Gouvernement Français. Pour prévenir ce danger, il avait loué un vaisseau qui devait le transporter à Constantinople, et qui dans quelques heures serait à la voile. Il avait l'intention de laisser sa fille aux soins d'un serviteur fidèle, qui l'emmènerait aussitôt que la plus grande partie de ses biens serait arrivée à Leghorn.
»Seule avec elle-même, Safie réfléchit à la manière dont elle devait se conduire dans cette circonstance. Elle envisageait avec horreur l'idée de résider en Turquie; sa religion et ses sentiments l'en éloignaient. Par quelques papiers de son père, qui tombèrent entre ses mains, elle apprit l'exil de son amant et le nom du lieu qu'il habitait. Elle hésita quelque temps, mais enfin elle prit une détermination. Prenant avec elle quelques bijoux qui lui appartenaient, et une petite somme d'argent, elle quitta l'Italie, et partit pour l'Allemagne, accompagnée d'une domestique qui était de Leghorn, mais qui comprenait un peu la langue Turque.
»Elle arriva saine et sauve dans une ville, à environ vingt lieues de la chaumière de M. de Lacey, mais elle y fut retenue par sa suivante qui tomba dangereusement malade. Elle lui prodigua les soins de la plus tendre affection, sans pouvoir l'empêcher de succomber. Le hasard voulut que l'Arabe, qui resta seule, sans connaître la langue du pays et les usages du monde, tombât en bonnes mains. La maîtresse de la maison où elle avait fait séjour, avait su par l'Italienne le nom de l'endroit vers lequel elle se dirigeait, et, après la mort de cette pauvre fille, elle prit les mesures les plus convenables, pour que Safie arrivât sans danger à la chaumière de son amant».
«Telle était l'histoire de mes chers voisins. J'en fus profondément frappé. J'appris même, en comparant les positions de la vie sociale qu'elle développait, à admirer les vertus de cette famille, et à détester les vices de l'espèce humaine.
»Cependant le crime me paraissait un mal dont j'étais loin. La bienveillance et la générosité étaient toujours devant mes yeux, et m'inspiraient le désir de devenir acteur dans cette scène active où tant d'admirables qualités étaient déployées et mises en jeu. Mais en faisant le récit des progrès de mon intelligence, je ne dois pas omettre une circonstance qui remonte au commencement du mois d'août de la même année.
»J'étais allé un soir, suivant ma coutume, dans le bois voisin, où je ramassais ma nourriture, et d'où je rapportais du bois pour mes protecteurs. Je trouvai par terre un portemanteau de cuir, qui contenait plusieurs articles d'habillement et quelques livres. Je m'en emparai avec empressement, et je revins avec ma prise dans ma cabane. Heureusement les livres étaient écrits dans la langue dont j'avais appris les éléments à la chaumière; c'étaient le Paradis perdu, un volume des Vies de Plutarque, et les Passions de Werther. Je ressentis la joie la plus vive de posséder ces trésors. Je me mis à étudier avec ardeur, et j'exerçais mon esprit sur ces histoires, pendant que mes amis se livraient à leurs occupations ordinaires.
»J'aurais peine à vous décrire l'effet de ces livres. Ils me présentèrent une infinité de nouvelles images et de nouveaux sentiments, qui me remplissaient quelquefois de ravissement, mais qui plus souvent me jetaient dans la plus profonde affliction. Dans Werther, dont l'histoire simple et touchante offre déjà beaucoup d'intérêt, on examine tant d'opinions, et on répand tant de lumières sur ce qui avait été précédemment obscur pour moi, que j'y trouvai une source intarissable de réflexions, et de nombreux motifs d'étonnement. Les habitudes douces et domestiques qu'il décrivait, les nobles sentiments et les sensations dont il parlait, et qui se portent vers un autre objet que soi-même, s'accordaient bien avec l'expérience que j'avais acquise parmi mes protecteurs, et avec les besoins qui naissaient pour toujours dans mon sein; mais Werther lui-même me parut un être plus divin qu'aucun de ceux que j'avais vus ou imaginés: son caractère était exempt de prétentions; mais il était réfléchi. Les discussions sur la mort et le suicide étaient propres à me remplir d'étonnement. Je ne prétendais pas juger la question; mais j'inclinai vers les opinions du héros dont je pleurai la fin, sans la comprendre précisément.
»Cependant, en lisant, je faisais une application plus personnelle à mes propres sensations et à mon état. Il me parut que j'avais quelque ressemblance, et en même temps une étrange différence avec les êtres dont je lisais l'histoire, et ceux dont j'écoutais la conversation. Je sympathisais avec eux, je les comprenais en partie, mais je n'avais pas l'esprit formé; je ne dépendais de personne, je n'avais de rapport avec qui que ce fût. Je pouvais librement cheminer vers la tombe; personne ne devait venir verser des pleurs sur ma cendre. Mon extérieur était hideux, et ma stature gigantesque: Que devais-je en penser? Qui étais-je? Qu'étais-je? D'où venais-je? Quelle était ma destinée? Ces questions revenaient sans cesse, sans que je pusse les résoudre.
»Le volume des Vies de Plutarque, qui était tombé entre mes mains, contenait les histoires des premiers fondateurs des anciennes républiques. Ce livre fit sur moi une impression entièrement différente de celle que j'avais éprouvée en lisant Werther. Les rêveries de ce jeune Allemand m'avaient appris à connaître le désespoir et les passions; Plutarque me montra de hautes pensées. Il m'élevait au-dessus de la sphère bornée de mes propres réflexions, à un point où je pouvais admirer et aimer les héros des siècles passés. Il y avait, dans ce que je lisais, beaucoup de choses qui étaient au-dessus de mon intelligence et de mon expérience. J'avais une connaissance très-confuse des royaumes, des vastes continents, des grandes rivières et des mers sans limites; mais je ne connaissais nullement les villes, ni les grandes réunions d'hommes. La chaumière de mes protecteurs était la seule école où j'eusse étudié la nature humaine; Plutarque me développa des actions nouvelles et plus fortes. En lisant l'histoire de ces hommes versés dans les affaires publiques, qui gouvernaient ou massacraient leurs semblables, je sentis naître en moi un ardent amour de la vertu, et une profonde horreur du crime; termes dont je ne comprenais pas bien la signification, mais qui, selon moi, n'avaient d'autre rapport qu'au plaisir et à la peine. Ces sentiments me portèrent naturellement à admirer les législateurs pacifiques, tels que Numa, Solon et Lycurgue, de préférence à Romulus et Thésée. La vie patriarcale de mes protecteurs contribua à graver fortement ces impressions dans mon esprit. Il se peut cependant qu'elles eussent été toutes différentes, si j'eusse été initié au monde par un jeune soldat, passionné pour la gloire et le carnage.
»Le Paradis perdu excita des émotions tout autres et bien plus profondes. Il en fut de cet ouvrage comme des deux autres, qui étaient tombés entre mes mains; je le pris pour une histoire véritable. Je me sentis agité par tous les sentiments d'étonnement et de crainte, que devait exciter la peinture d'un Dieu tout-puissant en guerre avec ceux qu'il avait créés. Souvent je m'appliquais à moi-même diverses situations, qui offraient un rapport frappant avec la mienne. Selon toute apparence, j'avais été créé, comme Adam, sans tenir en rien à un être vivant; mais d'un autre côté, son état était bien différent du mien. Il était sorti des mains de Dieu, parfait, heureux et prospère. Il restait sous la garde même de son créateur; il pouvait lui parler, et s'instruire en communiquant avec des êtres d'une nature supérieure: moi, j'étais malheureux, sans appui, et seul. Plus d'une fois, je considérai Satan comme l'emblème le plus fidèle de ma condition; souvent en effet, en voyant le bonheur des mes protecteurs, je me sentais, comme lui, rempli d'un sentiment d'envie.
»Une autre circonstance me confirma dans l'opinion que j'avais de moi-même. Peu de temps après mon arrivée dans la cabane, je découvris quelques papiers dans la poche du vêtement que j'avais emporté de votre laboratoire. Je les avais d'abord négligés; mais maintenant que je pouvais déchiffrer les caractères qui y étaient tracés, je me mis à les étudier. C'était un journal écrit par vous, et relatif aux quatre premiers mois qui précédèrent ma création. Vous décriviez avec un soin minutieux chaque opération qui concourait au progrès de votre ouvrage; vous mêliez à cette histoire le récit des évènements qui avaient rapport à votre famille.
»Vous vous souvenez sans doute de ces papiers. Les voici. Rien n'est omis de ce qui a rapport à mon origine maudite; toutes les circonstances qui l'ont amenée, quelque dégoût qu'elles offrent, y sont fidèlement conservées: la description la plus minutieuse de mon odieuse et dégoûtante personne y est tracée dans des termes qui peignaient votre horreur même, et rendaient la mienne ineffaçable. J'étais dans une souffrance affreuse en lisant ces notes. «Jour odieux où je reçus la vie, m'écriai-je avec désespoir! Maudit Créateur! Pourquoi as-tu formé un monstre si hideux, que toi-même tu t'en es éloigné avec dégoût? Dieu a fait l'homme beau, agréable, et à son image; ma forme présente aussi une ressemblance avec la tienne; mais une ressemblance horrible, plus horrible même par la ressemblance. Satan avait ses compagnons, ses diables, pour l'admirer, pour l'encourager; et moi, je suis solitaire et détesté».
»Telles étaient mes réflexions pendant mes moments de désespoir et de solitude; mais, revenant à contempler les vertus des habitants de la chaumière, leur caractère aimable et bienveillant, je me persuadais que, lorsqu'ils connaîtraient mon admiration pour leurs vertus, ils auraient compassion de moi, et ne feraient pas attention à ma difformité personnelle. Pourraient-ils éloigner d'eux un être monstrueux, il est vrai, mais qui implorait leur compassion et leur amitié? Je résolus, du moins, de ne pas désespérer, et, à tout événement, de me préparer à une entrevue qui déciderait de ma destinée. Je retardai cet essai de quelques mois; car le succès était assez important pour m'inspirer la crainte de ne pas réussir. Du reste, j'acquérais tant d'expérience chaque jour, que je ne voulus commencer cette entreprise, qu'après avoir ajouté quelques mois de plus à ma sagesse.
»Je remarquai, pendant ce temps, plusieurs changements dans la chaumière. La présence de Safie répandait le bonheur, et même plus d'abondance, parmi les personnes qui l'environnaient. Félix et Agathe donnaient plus de temps à leurs amusements et à leurs causeries; et ils étaient aidés dans leurs travaux par des domestiques. Ils ne paraissaient pas riches, mais ils étaient contents et heureux; leurs sentiments étaient paisibles, tandis que les miens devenaient de jour en jour plus tumultueux. Le progrès de mes connaissances ne servait qu'à me montrer plus clairement dans quelle affreuse position j'étais placé. J'entretenais l'espérance, il est vrai; mais elle s'évanouissait toujours, au moment où je voyais ma personne réfléchie dans l'eau, ou mon ombre à la clarté de la lune: faible image, ombre inconstante, dont je m'effrayais midi-même!
»Je m'efforçai de bannir ces craintes, et de m'affermir pour l'épreuve que j'avais intention de subir dans quelques mois. Quelquefois je laissais mes pensées s'abandonner au délire, et errer dans les plaines du paradis; j'osais me représenter ces êtres bons et aimables, sympathisant avec mes sentiments et dissipant ma tristesse; je croyais voir leurs figures angéliques sourire pour me consoler. Rêves insensés! Une Ève n'adoucissait pas mes chagrins, ne partageait point mes pensées; j'étais seul. Je me souvenais de la prière qu'Adam adressa à son créateur; mais où était le mien? Il m'avait abandonné, et, dans l'amertume de mon cœur, je le maudissais.
»L'automne se passa ainsi. Je vis, avec surprise et chagrin, les feuilles décroître et tomber, et la nature reprendre cet aspect stérile et froid qu'elle présentait, lorsque je vis pour la première fois les bois et la lune bienfaisante. Cependant, je ne fis pas attention à la température froide de la saison; j'étais plus propre, par mon organisation, à endurer le froid que la chaleur; mon plus grand plaisir était de voir les fleurs, les oiseaux, et tout le cortège enchanteur de l'été. Privé de ces agréments, je tournai davantage mon attention vers les habitants de la chaumière. L'absence de l'été n'avait pas diminué leur bonheur. Ce bonheur était de s'aimer et de se convenir; il ne dépendait que d'eux-mêmes, et n'était pas interrompu par ce qui se passait autour d'eux. Plus je les voyais, plus j'avais le désir de réclamer leur protection et leur amitié; mon cœur avait besoin d'être connu et aimé de ces intéressantes créatures; toute mon ambition se bornait à voir leurs doux regards tournés avec affection vers moi. Je n'osais penser qu'ils les détourneraient avec mépris et horreur. Le pauvre, qui s'arrêtait à leur porte, n'était jamais repoussé. Je demandais, il est vrai, des trésors bien plus grands qu'un peu de nourriture ou du repos; je prétendais à l'amitié, à la sympathie, et je ne m'en croyais pas tout-à-fait indigne.
»L'hiver approchait, et une révolution complète des saisons avait eu lieu, depuis que j'étais animé par la vie. Mon attention, à cette époque, fut tournée entièrement vers le plan que je ni étais formé, et qui était de m'introduire dans la chaumière de mes protecteurs. Je conçus une foule de projets; mais celui auquel je m'arrêtai, fut d'entrer dans leur habitation au moment où le vieillard aveugle serait seul. J'avais assez de sagacité pour deviner, que ma laideur hideuse et surnaturelle était le principal objet d'horreur pour ceux qui m'avaient vu précédemment. Ma voix, quoique dure, n'avait rien de terrible; je pensai donc que si, pendant l'absence de ses enfants, je pouvais obtenir la bienveillance et la médiation du vieux de Lacey, je parviendrais, grâce à lui, à être toléré par mes plus jeunes protecteurs.
»Un jour, le soleil brillait sur les feuilles rougeâtres dont la terre était jonchée, et inspirait la gaîté, sans répandre la chaleur; Safie, Agathe, et Félix partirent pour faire une longue promenade dans la campagne, et le vieillard, qui avait exprimé le désir de ne pas les accompagner, resta seul dans la chaumière. À peine ses enfants étaient-ils partis, qu'il prit sa guitare, et joua plusieurs airs d'une mélancolie douce, plus douce même qu'aucun de ceux que j'avais entendus auparavant. Sa figure était d'abord animée par le plaisir, mais bientôt elle exprima la méditation et la tristesse; enfin, le vieillard mit l'instrument de côté, et resta absorbé dans ses rêveries.
»Mon cœur palpitait avec force; c'était l'heure, le moment de l'épreuve, qui devait confirmer mes espérances, ou réaliser mes craintes. Les domestiques étaient allés à une fête voisine. Tout était silencieux au dedans et autour de la chaumière: l'occasion était excellente; cependant, au moment où j'allais mettre mon plan à exécution, je sentis mes forces défaillir, et je tombai à terre. Je me relevai; je m'armai de toute la fermeté dont j'étais capable, et j'écartai les planches que j'avais placées devant ma cabane, pour cacher ma retraite. L'air frais me ranima, je m'affermis de nouveau dans ma détermination, et je m'approchai de la porte de ma chaumière.
»Je frappai. « Qui est là, dit le vieillard? Entrez».
—«Excusez-moi, lui dis-je, je suis un voyageur qui a besoin d'un peu de repos, et que vous obligeriez beaucoup, si vous vouliez permettre qu'il restât quelques minutes devant le feu».
—«Entrez, dit de Lacey, et je chercherai à vous soulager; mais, malheureusement, mes enfants sont sortis; car je suis aveugle, et je crains qu'il ne me soit difficile de vous offrir quelque nourriture».
—«N'en soyez pas en peine, mon généreux hôte, je n'en ai pas besoin; je ne réclame qu'un peu de chaleur et de repos».
»Je m'assis, et il y eut un moment de silence. Je savais que chaque minute m'était précieuse; cependant j'étais indécis sur la manière dont je commencerais l'entretien; mais le vieillard me tira d'embarras en disant: «Étranger, je suppose, à votre langage, que vous êtes mon compatriote; êtes-vous Français»?
—«Non; mais j'ai été élevé par une famille Française, et je ne comprends que la langue de ce pays. Je vais, en ce moment, réclamer la protection de quelques amis que j'aime sincèrement, et dont j'espère obtenir l'amitié».
—«Sont-ils Allemands»?
—«Non, ils sont Français. Mais changeons de conversation. Je suis une créature malheureuse et abandonnée; je regarde autour de moi, et je n'ai ni parent, ni ami sur la terre. Ces aimables gens, que je vais trouver, ne m'ont jamais vu, et ne me connaissent que sous bien peu de rapports. Je suis rempli de crainte; car, si je ne réussis pas auprès d'eux, je dois m'attendre à être un rebut pour le reste des hommes».
—«Ne désespérez pas. Vivre sans amis, c'est assurément vivre malheureux; mais le cœur de l'homme qui est dégagé de tout intérêt particulier, ne renferme qu'amour fraternel et charité. Ayez donc confiance; et, si ces amis sont bons et aimables, ne perdez pas courage».
—«Ils sont bons, il n'en est pas qui soient meilleurs; mais, malheureusement, ils sont prévenus contre moi. J'ai un bon naturel; jusqu'ici ma vie a été innocente, et quelquefois bienfaisante; mais les personnes, dont je vous parle, sont aveuglées par un préjugé fatal, et, au lieu de voir en moi un ami bon et sensible, elles ne voient qu'un monstre détestable».
—«C'est un malheur, j'en conviens; mais, si vous n'avez aucun tort, ne pouvez-vous pas les détromper»?
—«Je vais l'essayer; et c'est cette tentative même qui m'accable de tant de terreur. J'aime tendrement ces amis; sans être connu d'eux, j'ai pu pendant plusieurs mois connaître les attentions journalières qu'ils se prodiguent mutuellement; mais ils croient que je veux leur nuire, et c'est ce préjugé que je désire détruire».
—«Où demeurent ces ami»?
—«Près d'ici».
—«Le vieillard garda le silence un moment, et dit: «Si vous voulez me confier sans réserve les détails de votre histoire, je vous serai peut-être utile pour les détromper. Je suis aveugle, et ne puis vous juger sur votre figure; mais il y a dans vos paroles un accent qui me garantit votre sincérité. Je suis pauvre et exilé, mais ce sera un véritable plaisir pour moi de pouvoir, en quelque manière, rendre service à une créature humaine».
—«Homme excellent! Je vous remercie, et j'accepte votre offre généreuse. Votre bonté me rassure; votre secours me permet d'espérer, que je ne serai pas chassé de la société de vos semblables, ni privé de leur intérêt».
—«Dieu vous en préserve, quand bien même vous seriez criminel; car ce malheur seul pourrait vous conduire au désespoir, et vous éloigner de la vertu. Moi aussi je suis malheureux, ma famille a été condamnée, et elle était innocente; jugez donc si je ne sens pas vos infortunes».
—«Comment pourrai-je vous remercier, mon excellent et unique bienfaiteur? Vous êtes le premier homme qui m'ait fait entendre des paroles bienveillantes; j'en serai toujours reconnaissant. Votre humanité me garantit tout succès près des amis que je suis sur le point de voir».
—«Puis-je connaître le nom et la demeure de ces amis»?
»Je me tus. C'était le moment décisif, où j'allais perdre ou obtenir à jamais le bonheur. Je m'efforçai de recueillir assez de fermeté pour lui répondre, mais cet effort épuisa toute la force qui me restait. Je tombai sur la chaise en sanglotant. Dans ce moment j'entendis les pas de mes protecteurs. Je n'avais pas un moment à perdre; je m'emparai de la main du vieillard, et je m'écriai: «Voici le moment!... Sauvez et protégez moi! Vous et votre famille, vous êtes les amis que je cherche. Ne m'abandonnez pas au moment de l'épreuve».
—«Grand Dieu! s'écria le vieillard, qui êtes-vous»?
»Au même instant la porte de la chaumière s'ouvre; Félix, Safie et Agathe entrèrent. Qui pourrait décrire l'horreur et la consternation dont ils furent saisis en me voyant. Agathe s'évanouit; et Safie, incapable de donner des soins à son amie, s'élança hors de la chaumière. Félix s'avança, et avec une force surnaturelle, m'arracha de son père aux genoux duquel je m'attachais; dans un transport de fureur, il me renversa par terre, et me frappa avec violence d'un bâton. J'aurais pu séparer ses membres, aussi facilement que le lion déchire la gazelle; mais j'avais le cœur oppressé par la plus amère douleur, et je me retins. Il se disposait à me frapper de nouveau; mais vaincu par la douleur et le désespoir, je quittai la chaumière; et, sans être aperçu, je parvins, au milieu du tumulte général, à m'échapper jusque dans ma cabane».
»Maudit, maudit créateur! Pourquoi vivais-je? Pourquoi, dans cet instant, n'ai-je pas éteint l'étincelle d'existence que vous m'aviez si imprudemment donnée? Je ne sais; le désespoir ne s'était pas encore emparé de moi; mes sentiments étaient ceux de la rage et de la vengeance. J'aurais eu du plaisir à détruire la chaumière et ses habitants, et je me serais rassasié de leurs cris et de leur malheur.
»Dès que la nuit fut arrivée, je quittai ma retraite, et je me mis à errer dans le bois: là, cessant d'être retenu par la crainte d'être découvert, je donnai cours à mes tourments par des hurlements horribles. Semblable à une bête féroce qui a rompu ses liens, je détruisais les objets qui faisaient obstacle à mon passage, et je traversais les bois avec la rapidité du cerf. Ah! que cette nuit fut affreuse pour moi! Les froides étoiles brillaient dans les cieux, et semblaient insulter à mon malheur: les arbres dépouillés agitaient leurs branches au-dessus de ma tête; de temps en temps, la douce voix d'un oiseau se lisait entendre au milieu du silence universel: tout, excepté moi, jouissait du repos ou du bonheur. Semblable au chef des Démons, je portais l'enfer en moi-même; sans avoir son génie, je voulais déraciner les arbres, répandre le ravage et la destruction autour de moi; et, après avoir assouvi ma fureur, m'asseoir sur les ruines, et en jouir.
»Je ne pus supporter ce dérèglement de sensations; je me sentis accablé par l'excès de l'exercice auquel je m'étais livré, et je tombai sur la terre humide dans la faible impuissance du désespoir. Parmi les hommes, nul n'avait pitié de moi, nul ne me prêtait assistance: devais-je amitié à mes ennemis? Non. De ce moment, je déclarai une guerre éternelle à l'espèce humaine, et surtout à celui qui, en me créant, me réduisait à ce malheur insupportable.
»Le soleil se leva; j'entendis des voix d'hommes, et je jugeai impossible de retourner, ce jour-là, dans ma retraite. En conséquence, je me cachai dans quelque taillis épais, déterminé à passer le temps à réfléchir sur ma situation.
»Le doux éclat du soleil, et l'air pur du jour me rendirent un peu la tranquillité. Je me rappelai ce qui s'était passé dans la chaumière, et je ne pus m'empêcher de croire que j'avais été trop prompt dans mes conclusions. J'avais certainement agi avec imprudence. Il était clair que ma conversation avait intéressé le père en ma faveur, et j'étais un insensé de m'être exposé à l'horreur de ses enfants. J'aurais dû habituer le vieux de Lacey à moi-même, et ne me découvrir au reste de sa famille, que lorsqu'elle aurait été préparée à me voir. Cette erreur ne me parut pas irréparable. Je méditai long-temps sur le parti que j'aurais à prendre, et je m'arrêtai à celui de retourner à la chaumière, de m'adresser au vieillard, et de le mettre dans ma cause par mes représentations.
»Ces pensées me calmèrent, et me jetèrent, vers l'après-midi, dans un profond sommeil; mais l'agitation de mon sang ne me permettait pas d'être bercé par des rêves paisibles. L'horrible scène de la veille se représentait sans cesse à mes yeux; les femmes fuyaient, et Félix, rempli de fureur, m'arrachait aux pieds de son père. Je me réveillai épuisé; et je profitai de la nuit, qui était déjà venue, pour sortir de ma retraite, et pourvoir à ma nourriture.
»Après avoir apaisé ma faim, je dirigeai mes pas vers le sentier bien connu, qui conduisait à la chaumière. Tout était tranquille. Je rentrai dans ma cabane, et je me mis à attendre l'heure à laquelle la famille avait coutume de se lever. Cette heure se passa, le soleil s'éleva dans les deux, et les habitants de la chaumière ne paraissaient pas. Je tremblais avec violence, dans la crainte de quelque malheur affreux. L'intérieur de la chaumière était sombre; aucun mouvement ne se faisait entendre: je ne puis décrire l'agonie de cette attente.
»Dans ce moment deux paysans vinrent à passer, s'arrêtèrent auprès de la chaumière, et causèrent ensemble en faisant des gestes violents; mais je ne comprenais pas un mot de leur conversation, parce qu'ils parlaient la langue du pays, qui différait de celle de mes protecteurs. Bientôt après, cependant, Félix s'approcha d'un autre homme: je fus surpris de voir qu'il n'avait pas quitté la chaumière ce matin; j'en eus même quelqu'inquiétude, et je prêtai une oreille attentive pour découvrir, dans ce qu'il dirait, le motif de ces visites inaccoutumées».
«Faites-vous attention, lui dit son compagnon, que vous serez obligé de payer un loyer de trois mois, et de perdre le produit de votre jardin? Je ne désire pas profiter d'un avantage injuste, et je demande en conséquence que vous preniez quelques jours pour peser votre détermination».
—«C'est tout-à-fait inutile, répondit Félix; nous ne pouvons plus désormais habiter votre chaumière. La vie de mon père est dans le plus grand danger, à cause de l'évènement affreux que je vous ai raconté. Ma femme et ma sœur ne reviendront jamais de leur terreur. Ne raisonnons pas davantage sur ce sujet. Prenez possession de voire bien, et laissez moi quitter ce lieu».
»Félix tremblait violemment en parlant ainsi. Il entra, suivi de ses compagnons, dans la chaumière, et partit au bout de quelques minutes. Depuis, je n'ai jamais vu personne de la famille de M. de Lacey.
»Pendant le reste du jour je restai dans ma cabane, accablé par un désespoir profond et stupide. Mes protecteurs étaient partis, et avaient rompu le seul lien qui m'attachait au monde. Pour la première fois, mon cœur se remplit de sentiments de vengeance et de haine; au lieu de chercher à les comprimer, je me laissais emporter par le torrent, abandonnant mon esprit aux idées du mal et de la mort. Si je me rappelais mes amis, la voix douce de M. de Lacey, les yeux attrayants d'Agathe, et la beauté merveilleuse de l'Arabe, ces sombres pensées se dissipaient, et un torrent de larmes coulait de mes yeux. Mais aussitôt que je reportais ma pensée sur le mépris et l'abandon dans lequel je me trouvais, ma colère se tournait en rage. Dans l'impuissance de nuire à aucun objet humain, je dirigeai ma fureur sur des objets inanimés. À l'approche de la nuit, je plaçai une grande quantité de combustibles autour de la chaumière; et, après avoir détruit tout vestige de culture dans le jardin, j'attendis avec la plus grande impatience que la lune fut cachée pour commencer mes opérations.
»À l'approche de la nuit, un vent terrible s'éleva, et dispersa promptement les nuages qui couvraient le ciel: ce vent, dont la force semblait égaler celle de l'avalanche, bouleversa mon esprit, et brisa toute ma raison. J'allumai une branche d'arbre sèche, et je tournai avec fureur autour de la chaumière maudite, les yeux incessamment fixés sur l'ouest de l'horizon, dont la lune touchait presque le bord. Une partie de son orbe fut enfin cachée, et je brandis ma branche; la lune disparut, et je mis le feu, en poussant un cri, à la paille, aux bruyères et aux genêts que j'avais rassemblés. Le vent augmenta la violence du feu, et la chaumière fut aussitôt enveloppée et dévorée par les flammes.
»Dès que je fus convaincu qu'aucun secours ne pourrait sauver quelque partie de l'habitation, je me retirai, en me dirigeant vers le bois, où je cherchai un asile.
»Maintenant que j'avais le monde devant moi, où devais-je porter mes pas? Je résolus de fuir loin du théâtre de mes malheurs; mais pour moi, haï et méprisé, tous les pays étaient également horribles. Enfin, je pensai à vous. J'appris par vos papiers que vous étiez mon père, mon créateur: à qui pouvais-je mieux m'adresser qu'à celui qui m'avait donné la vie? Félix qui avait appris beaucoup de choses à Safie, n'avait pas oublié de lui faire connaître la géographie: de cette manière j'avais appris les situations respectives des différentes contrées de la terre. Vous aviez indiqué que Genève était votre patrie; je résolus de porter mes pas vers cette ville.
»Comment faire pour m'orienter? Je savais qu'il fallait voyager dans une direction sud ouest, pour arriver à ma destination; mais je n'avais d'autre guide que le soleil. Je ne connaissais pas les noms des villes que j'avais à traverser, et je ne pouvais demander des renseignements à aucun être humain. Malgré ces difficultés, je ne perdis pas tout espoir. Je ne pouvais attendre de secours que de vous, de vous qui ne m'inspiriez d'autre sentiment que celui de la haine. Créateur insensible et lâche! tu m'avais doué de sens et de passions, et tu m'avais jeté dans le monde comme un objet de mépris et d'horreur pour l'espèce humaine! Il n'y avait que vous à la pitié et à la justice duquel je pusse prétendre, et je me déterminai à réclamer de vous cette justice, que j'essayerais en vain d'obtenir de tout autre être humain.
»Mes voyages furent longs, et mes souffrances cruelles. L'automne était avancé lorsque je quittai le lieu qui m'avait si longtemps servi de résidence. Je ne voyageais que de nuit, dans la crainte de rencontrer l'homme. La nature dépérissait autour de moi, et le soleil devint sans chaleur; la pluie et la neige tombaient de toutes parts; de grands fleuves étaient gelés; la surface de la terre était triste, glacée, et nue, et je ne trouvais aucun asile. Ah, terre! combien de fois ai-je vomi des imprécations contre celui qui m'avait créé! Je n'avais plus la même douceur de caractère; je n'avais plus que fiel et amertume. Plus j'approchais de votre habitation, plus je sentais profondément dans mon cœur le désir de la vengeance. Je ne me reposais pas, malgré la neige et la glace. Quelques incidents, et une carte du pays, qui était tombée entre mes mains, servirent à me diriger; mais souvent je m'égarais de mon chemin. L'horreur de mon désespoir ne me laissait aucun repos: chaque incident était un motif nouveau de rage et de malheur; mais une circonstance, que je vais rapporter, redoubla l'amertume et l'horreur de mes sentiments.
»J'étais arrivé sur les confins du Switzerland: le soleil avait déjà plus de chaleur, et la terre commençait à se couvrir d'une nouvelle verdure.
»J'avais coutume de me reposer pendant le jour, et de ne voyager que de nuit, pour éviter l'aspect de l'homme. Un matin, cependant, comme j'avais à traverser un bois profond, je hasardai de continuer mon voyage après le lever du soleil. C'était un des premiers jours du printemps: le charme du soleil resplendissant, et la fraîcheur embaumée de l'air m'inspirèrent un sentiment de joie. Je sentis renaître dans mon cœur des émotions douces et agréables, qui depuis long-temps paraissaient éteintes. Presque surpris par la nouveauté de ces sensations, je me sentis entraîné jusqu'au point d'oublier ma solitude et ma difformité; j'osai même goûter un moment de bonheur. De douces larmes arrosèrent encore mes joues, et mes yeux humides se levèrent avec reconnaissance vers l'astre bienfaisant auquel je devais une semblable jouissance.
»Je continuai à suivre les sentiers du bois, jusqu'à sa limite, marquée par une rivière dont le lit paraissait profond et le cours rapide, et dont les bords étaient ombragés par une grande quantité d'arbres déjà verdoyants. Je m'arrêtai dans cet endroit, sans savoir exactement le chemin que je suivrais, lorsque j'entendis des voix qui me forcèrent à me cacher sous l'ombre d'un cyprès. J'étais à peine sous cet arbre, qu'une jeune fille vint en courant vers l'endroit que j'avais choisi, et en riant comme si elle fuyait quelqu'un pour badiner. Elle continua sa course le long des bords escarpés du fleuve; mais, venant tout-à-coup à glisser, elle tomba dans l'eau. Je m'élançai de ma retraite, et après avoir longtemps lutté contre la force du courant, je parvins à la sauver, et à l'amener sur le rivage. Elle était sans connaissance; et j'essayais de la ranimer par tous les moyens possibles, lorsque je fus brusquement interrompu par l'approche d'un paysan, qui était probablement celui qu'elle avait fui en jouant. À ma vue, il s'élança vers moi, arrachant la jeune fille de mes bras, et courut vers la partie la plus épaisse du bois. Je le suivis aussitôt, et presque machinalement; mais l'homme, en me voyant approcher, ajusta sur moi le fusil qu'il portait, et fit feu. Je tombai, et il s'échappa dans l'épaisseur du bois avec une nouvelle rapidité.
»Telle était donc la récompense de ma bonté! J'avais sauvé de la mort un être humain, et, pour récompense, je souffrais maintenant d'une blessure qui avait déchiré la chair jusqu'aux os. Les sentiments de bonté et de douceur, qui m'avaient animé peu d'heures auparavant, firent place à une rage infernale et à des mouvements convulsifs. Enflammé par la souffrance, je vouai une haine éternelle à toute l'espèce humaine, et en méditant de terribles vengeances; mais l'irritation de ma blessure m'accabla, suspendit les mouvements de mon pouls, et me fit perdre les sens.
»Pendant quelques semaines, je traînai ma malheureuse vie dans les bois, en cherchant à soigner la blessure que j'avais reçue. La balle était entrée dans mon épaule; et je ne savais si elle y était restée, ou si elle avait traversé tout mon corps. Quoi qu'il en fût, je n'avais aucun moyen de l'extraire. Mes souffrances s'aggravaient encore du sentiment oppressif de l'injustice et de l'ingratitude qui en était la cause. Dans mes vœux journaliers je demandais vengeance, une vengeance entière et terrible, qui seule pourrait tenir lieu des outrages et des angoisses que j'avais soufferts.
»Après quelques semaines, ma blessure se guérit, et je continuai mon voyage. Mes souffrances ne devaient plus être adoucies par l'éclat du soleil, ou les douces brises du printemps; la joie n'était plus qu'une ironie qui insultait à mon désespoir, et me faisait sentir plus péniblement que je n'étais pas destiné à connaître le bonheur.
»J'approchais cependant du terme de mon voyage; deux mois après, j'arrivai dans les environs de Genève.
»C'était le soir. Je me cachai dans les champs qui entourent cette ville, pour songer de quelle manière je m'adresserais à vous. J'étais accablé par la fatigue et la faim, et beaucoup trop malheureux pour jouir des douces brises du soir, ou de la vue du soleil qui se couchait derrière les imposantes montagnes du Jura.
»Un léger sommeil m'arracha en ce moment à mes tristes réflexions; mais il fut bientôt troublé par rapproche d'un bel enfant, qui vint, en courant, et avec toute la gaîté de son âge, dans la retraite où je m'étais placé. Tout-à-coup, en le voyant, j'eus la pensée que cette petite créature était sans prévention, et avait vécu trop peu de temps pour avoir horreur de la difformité. Si, donc, je pouvais le prendre, et l'élever comme mon compagnon et mon ami, je ne serais plus solitaire sur cette terre peuplée.
»Cédant à cette pensée, je saisis l'enfant au passage, et le tirai vers moi. À ma vue, il couvrit ses yeux de ses mains, et poussa un cri d'effroi. J'ôtai de force la main qu'il tenait sur sa figure, et je lui dis: «Enfant, que crains-tu? Je n'ai pas l'intention de te faire aucun mal; écoute-moi».
»Il se débattait avec violence:—«Laisse-moi m'en aller, s'écria-t-il, monstre! vilain méchant! tu veux me manger, et me déchirer en morceaux.... Tu es un ogre.... laisse-moi m'en aller, ou je le dirai à papa».
—«Mon enfant, tu ne reverras plus ton père; il faut que tu viennes avec moi.
—«Monstre affreux! laisse-moi partir; mon papa est syndic;—c'est M. Frankenstein... Il te punirait, si tu osais me retenir».
—«Frankenstein! tu appartiens donc à mon ennemi... à celui de qui j'ai juré de tirer vengeance; tu seras ma première victime».
»L'enfant se débattait encore, et me chargeait d'épithètes qui portaient le désespoir dans mon cœur. Je lui pris le cou pour l'empêcher de crier, et je le vis aussitôt tomber mort à mes pieds.
«En contemplant ma victime, j'avais le cœur gonflé de joie et fier d'un triomphe infernal. Je frappai des mains, en m'écriant: «Moi aussi, je puis porter la désolation; mon ennemi n'est pas au-dessus de mes atteintes; cette mort le jettera dans le désespoir, et mille autres malheurs pourront l'affliger et l'accabler».
»En fixant mes yeux sur l'enfant, j'aperçus un objet qui brillait sur sa poitrine: je le pris, c'était le portrait d'une femme très-séduisante. Tout pervers que j'étais, j'en fus transporté, et je m'adoucis. Je contemplai quelques moments avec délices ses yeux noirs ombragés par de longs cils, et ses lèvres gracieuses; mais bientôt ma rage revint: je me rappelai que j'étais à jamais privé du bonheur que l'on peut attendre d'aussi belles créatures; et que celle dont je contemplais l'image, changerait, en me regardant, cet air divin de bonté en une expression de dégoût et d'effroi.
»Vous étonnerez-vous que de telles pensées me transportassent de rage? Je m'étonne seulement que, dans ce moment, au lieu de donner cours à mes sentiments en exclamations et en désespoir, je ne me sois pas précipité au milieu de l'espèce humaine, et que je n'aie pas péri en essayant de la détruire.
»Accablé par ces sentiments, je quittai le lieu où j'avais commis le meurtre. Je cherchais une retraite plus à l'écart, lorsque je vis une femme passer auprès de moi. Elle était jeune, pas aussi belle que celle dont je tenais le portrait, mais d'un aspect agréable, et brillant de tout l'éclat de la jeunesse et de la santé. Voici, pensais-je, une de celles qui sourient pour tout le monde, excepté pour moi; elle n'échappera pas: grâce aux leçons de Félix, et aux lois sanguinaires de l'homme, j'ai appris à préparer le mal. Je m'approchai d'elle sans en être vu, et je mis le portrait dans une des poches de son vêtement.
»Pendant quelques jours j'allai souvent à l'endroit où ces scènes avaient eu lieu: tantôt j'avais le désir de vous voir, tantôt j'étais résolu à quitter pour toujours le monde et ses misères. Enfin je vins dans ces montagnes, et j'ai erré dans leurs immenses solitudes, consumé par une passion brûlante que vous seul pouvez satisfaire. Nous ne nous séparerons pas que vous n'ayez promis de consentir à ma requête. Je suis seul et malheureux; l'homme ne veut pas m'admettre dans sa société; mais un être aussi difforme et aussi horrible que moi-même ne me repousserait pas. Ma compagne doit avoir le même extérieur et les mêmes défauts. Votre devoir est de la créer.
Le monstre cessa de parler, et fixa les yeux sur moi, dans l'attente d'une réponse; mais j'étais troublé, hors de moi, et incapable de recueillir assez mes idées pour comprendre toute l'étendue de sa proposition. Il continua:
«Il faut me créer une femme avec qui je puisse vivre dans l'échange de ces sentiments nécessaires à mon existence. Vous seul pouvez le faire; et je vous le demande comme un droit que vous ne devez pas refuser».
La dernière partie de son histoire avait rallumé dans mon cœur la colère qui s'était apaisée pendant le récit de sa vie paisible, parmi les habitants de la chaumière, et, lorsqu'il prononça ces derniers mots, je ne pus contenir plus long-temps la fureur qui me consumait.
—«Je refuse, répondis-je; et aucun supplice n'arrachera jamais mon consentement. Tu peux me rendre le plus malheureux des hommes; mais tu ne m'aviliras jamais à mes propres yeux. Irai-je créer un autre être semblable à toi-même, et dont la méchanceté, jointe à la tienne, désolerait le monde? Éloigne-toi! Je t'ai répondu; tu peux me torturer; mais je ne consentirai jamais à ta demande».
—«Vous avez tort, répliqua le Démon; et, au lieu de me servir de menaces, je me contenterai de raisonner avec vous. Je suis méchant, parce que je suis malheureux. Ne suis-je pas abandonné et haï par toute l'espèce humaine? Vous, mon créateur, si vous me mettiez en pièces, vous en triompheriez: souvenez-vous-en, et dites-moi pourquoi j'aurais pour l'homme plus de pitié qu'il ne m'en témoigne. Vous ne croiriez pas commettre un meurtre, si, me précipitant dans un de ces abîmes de glace, vous me fessiez périr, moi, l'ouvrage de vos mains. Respecterai-je l'homme lorsqu'il me méprise? Faites-le vivre avec moi dans un échange de bontés; et, au lieu de lui nuire, je lui ferai toutes sortes de biens en pleurant de reconnaissance de ce qu'il veut bien les accepter. Mais il n'en saurait être ainsi; les sens humains sont des barrières insurmontables à notre union. Cependant, les miens ne se soumettront pas à un esclavage honteux. Je vengerai mes injures: si je ne puis inspirer l'amour, j'inspirerai la crainte; et c'est surtout à vous, mon plus grand ennemi, parce que vous êtes mon créateur, que je jure une haine éternelle. Prenez-y garde: je travaillerai à votre destruction, et je ne m'arrêterai pas que je n'aie désolé votre cœur, de manière à ce que vous maudissiez l'heure de voire naissance».
Une rage infernale l'animait en prononçant ces paroles: sa figure se ridait en contorsions trop horribles, pour que des yeux humains pussent la regarder; mais il se calma promptement, et il ajouta:
«Je voulais raisonner; mais mon emportement s'y oppose; et cependant vous ne réfléchissez pas que vous êtes la cause de ses excès. Si un être quelconque éprouvait pour moi quelques emotions de bienveillance, je la lui rendrais au centuple; pour cet amour d'une seule créature, je ferais la paix avec l'espèce entière! Mais je vois que je me laisse aller à des rêves de bonheur qui ne peuvent se réaliser. Ce que je vous demande est raisonnable et modéré; je veux une créature d'un autre sexe, mais aussi hideuse que moi: ce présent est faible, mais c'est tout ce que je puis recevoir et je serai content. Il est vrai que nous serons des monstres séparés du monde entier; mais nous en serons plus attachés l'un à l'autre. Nous ne vivrons pas heureux, mais nous serons innocents, et à l'abri du malheur que j'éprouve maintenant. Ah! mon créateur, rendez-moi heureux; qu'un seul bienfait me permette de vous exprimer ma reconnaissance! Laissez-moi connaître le plaisir de toucher le cœur d'un être existant; ne me refusez pas ce que je vous demande»!
Je fus touché. Je frissonnai en pensant aux conséquences que pourrait avoir mon consentement; mais je sentis que ses raisonnements étaient assez justes. Son histoire et les sentiments qu'il exprimait dans ce moment, prouvaient quelque délicatesse. D'ailleurs, ne lui devais-je pas, à titre de créateur, toute la portion de bonheur qu'il était en mon pouvoir de lui accorder? Il remarqua un changement dans ce que j'éprouvais, et il poursuivit.
«Si vous consentez à ma demande, je ne paraîtrai jamais ni devant vous, ni devant aucun être humain. J'irai dans les vastes déserts de l'Amérique méridionale. Ma nourriture n'est pas celle de l'homme; je n'égorge ni l'agneau, ni le chevreau, pour assouvir mon appétit: les glands et les graines me suffisent. Ma compagne sera de la même nature que moi, et se contentera de la même manière de vivre. Les feuilles sèches nous serviront de lit; le soleil brillera pour nous comme pour l'homme, et mûrira notre nourriture. Le tableau que je vous présente est une image de paix et d'humanité: vous devez sentir que vous ne pourriez contrarier mes vœux que par abus de pouvoir et par cruauté. Tout à l'heure vous avez été sans pitié pour moi; je lis maintenant la compassion dans vos regards; laissez-moi saisir le moment favorable, laissez-moi obtenir la promesse de de ce que je désire si ardemment.»
—«Tu te proposes, répondis-je, de t'éloigner de la demeure des hommes, de vivre dans ces déserts où tu n'auras d'autre société que celle des bêtes féroces. Comment pourras-tu persévérer dans cet exil, toi qui désires l'amour et la sympathie de l'homme? Tu reviendras rechercher encore leur amitié, et tu ne trouveras que leur haine; la passion du mal se renouvellera, et tu auras alors une compagne pour t'aider à détruire. Cela ne se peut; ne m'en parles plus, car je n'y puis consentir».
—«Quelle inconstance dans vos sentiments! Il n'y a qu'un moment vous étiez ému par mes raisonnements; pourquoi vous endurcissez-vous contre mes plaintes? Je vous jure, par la terre que j'habite, et par vous-même qui m'avez créé, que je quitterai, avec la compagne que vous me donnerez, le voisinage de l'homme, et que nous irons habiter dans le lieu le plus sauvage. Je ne serai plus animé par le mal, car je connaîtrai la sympathie: ma vie s'écoulera tranquillement; et, à mes derniers moments, je ne maudirai pas mon créateur».
Ses paroles firent sur moi un effet étrange. Je fus touché de compassion, et je sentis un moment le désir de le consoler; mais, en le regardant, en voyant la masse informe se mouvoir et parler, mon cœur se souleva, et mes sentiments furent ceux de l'horreur et de la haine. Je m'efforçai de les étouffer. Je pensai que, dans l'impossibilité de sympathiser avec lui, je n'avais pas droit de le priver de la petite portion de bonheur qu'il était encore en mon pouvoir de lui accorder.
—«Tu jures d'être bon, lui dis-je; mais n'as-tu pas déjà montré un degré de perversité tel que je pourrais avec raison me défier de toi? Ne serait-ce pas une feinte pour accroître ton triomphe, en ouvrant une plus vaste carrière à ta vengeance?»
—«Qu'est-ce? Je croyais avoir excité votre compassion, et vous me refusez encore le seul bienfait, qui puisse adoucir mon cœur et me rendre bon! Si je n'ai ni devoirs, ni affection, la haine et le crime seront mon partage; aimé d'un autre, je n'aurai plus de motif pour être criminel, et tout le monde ignorera que j'existe. Mes défauts viennent d'une solitude forcée que j'abhorre; et mes vertus se formeront nécessairement dans la vie que je passerai avec une créature semblable à moi. Je connaîtrai les affections d'un être sensible, et je me rattacherai à la chaîne d'existence et d'évènements dont je suis maintenant exclus.»
Je me tus quelque temps, pour réfléchir à tout ce qu'il venait de dire, et aux différents raisonnements dont il s'était servi. Je pensais aux vertus qu'il avait promises au commencement de son existence; je compris que tout bon sentiment avait été éteint en lui par le dégoût et le mépris qu'il avait éprouvé de ses protecteurs. Je n'oubliai pas dans mon calcul son pouvoir et ses menaces: une créature qui pouvait exister dans les froides cavernes des glaciers, et éviter les poursuites au milieu de précipices inaccessibles, était un être qui possédait des facultés contre lesquelles il serait inutile de lutter. Après un long silence de réflexion, je conclus que la justice qui lui était due, celle qui était due à mes semblables, exigeait que je consentisse à sa demande. Je me tournai vers lui, en disant:
«Je consens à ta demande; mais j'exige le serment solennel que tu quitteras pour toujours l'Europe, et tout autre lieu dans le voisinage de l'homme, dès que je remettrai entre tes mains une femme qui t'accompagnera dans ton exil».
—«Je jure, s'écria-t-il, par le soleil et la voûte azurée du ciel, que, si vous vous rendez à ma prière, tant qu'ils existeront, vous ne me reverrez jamais. Retournez chez vous, et commencez vos travaux: j'observerai leurs progrès avec une sollicitude inexprimable; mais soyez sans crainte, je ne paraîtrai que quand vous serez prêt».
À ces mots, il me quitta brusquement, dans la crainte, peut-être, de quelque changement dans mes sentiments. Je le vis descendre la montagne avec plus de rapidité que le vol d'un aigle, et je le perdis bientôt de vue parmi les ondulations de la mer de glace.
Son histoire avait duré toute la journée, et le soleil était sur le bord de l'horizon lorsqu'il partit. Il était tard: je devais me hâter de descendre vers la vallée, pour n'être pas enveloppé par l'obscurité; mais mon cœur était oppressé, et ma marche lente. J'étais retardé par la difficulté de courir parmi les petits sentiers des montagnes, par l'embarras que j'éprouvais à poser mes pieds avec fermeté, et par les émotions dont j'étais occupé, et auxquelles avaient donné lieu les diverses circonstances de la journée. La nuit était fort avancée lorsque j'arrivai à moitié route du lieu de repos. Je m'assis auprès de la fontaine. Les étoiles étaient tantôt brillantes, tantôt cachées par les nuages; les sombres pins s'élevaient devant moi, et de temps en temps des arbres brisés et renversés par terre s'offraient sous mes pas. La scène était d'une solennité imposante, et fit naître en moi d'étranges pensées. Je pleurai avec amertume, et je frappai mes mains avec désespoir, en m'écriant: «Ô étoiles, vents et nuages, vous allez tous me railler: si vous avez réellement pitié de moi, ôtez-moi les sens et la mémoire; anéantissez-moi; et, si vous n'écoutez pas ma prière, fuyez, fuyez, et laissez-moi dans les ténèbres»!
Ces idées étaient extravagantes et tristes; mais je ne puis vous décrire combien j'étais accablé par l'éclat des étoiles, et combien je prêtais l'oreille à chaque coup de vent, comme s'il devait m'entrainer pour me détruire.
Le matin venait de paraître, et je n'étais pas encore arrivé au village de Chamouny. À mon retour, mon air hagard et étrange fut peu propre à calmer les craintes de ma famille, qui, toute la nuit, avait attendu mon retour avec inquiétude.
Le jour suivant, nous retournâmes à Genève. L'intention de mon père, en entreprenant ce voyage, avait été de me distraire, et de me rendre la tranquillité que j'avais perdue; mais le remède était loin d'avoir réussi. Ne pouvant se rendre compte de l'excessive douleur dont je paraissais souffrir, il se hâta de retourner à la maison, dans l'espoir que le repos et la monotonie d'une vie domestique adouciraient insensiblement mes souffrances, quelle qu'en fût la cause.
Pour moi, j'étais indifférent à tous leurs arrangements, et la tendre affection de ma bien aimée Élisabeth ne pouvait m'arracher à mon désespoir; la promesse, que j'avais faite au Démon, pesait sur mon esprit comme le capuchon de fer du Dante sur la tête des hypocrites en enfer. Tous les plaisirs de la terre et du ciel passaient devant moi comme un songe, et cette pensée seule avait pour moi la réalité de la vie. Devez vous vous étonner que je sois quelquefois possédé d'une sorte de démence; ou que je voie continuellement autour de moi une multitude d'animaux infâmes, et qui m'accablent d'un supplice continuel, dont l'horreur m'arrache souvent des cris et des gémissements?
Cependant, ces sentiments se calmèrent insensiblement. Je repris les habitudes journalières de de la vie, sinon avec intérêt, du moins avec assez de tranquillité.