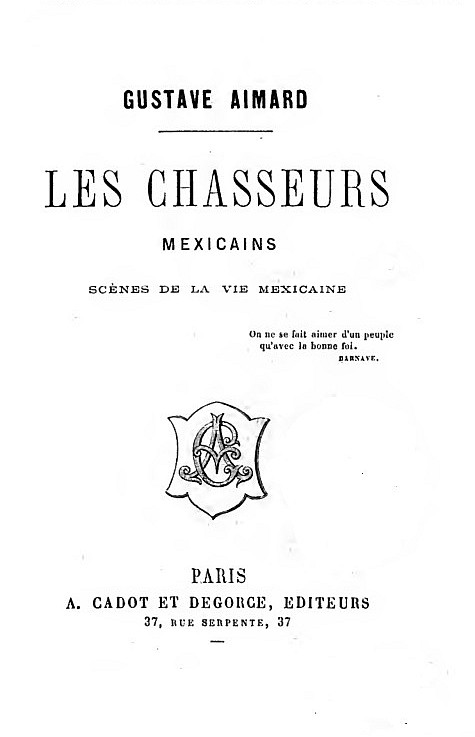
The Project Gutenberg EBook of Les chasseurs mexicains, by Gustave Aimard
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Les chasseurs mexicains
Scènes de la vie mexicaine
Author: Gustave Aimard
Release Date: October 10, 2018 [EBook #58069]
Language: French
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES CHASSEURS MEXICAINS ***
Produced by Camile Bernard & Marc D'Hooghe at Free Literature
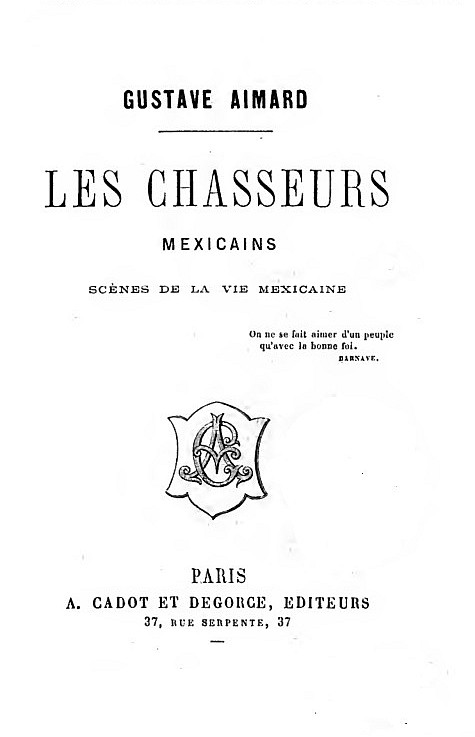
Depuis la pseudo-découverte du Nouveau-Monde, par Christophe Colomb, deux pays de cet immense continent ont eu, au détriment des autres, le privilège de concentrer sur eux seuls la curiosité des chercheurs d'aventures et la sympathie des penseurs.
Ces deux pays sont: le Pérou et le Mexique.
Deux causes ont, à notre avis, motivé cette préférence: d'abord, la mystérieuse auréole qui, jusqu'à ce jour, a enveloppé les fabuleuses richesses que sont censé renfermer ces pays; ensuite, la civilisation avancée, trouvée par les conquérants espagnols dans ces contrées, et qui formait un contraste si frappant avec la barbarie complète dans laquelle étaient plongés les autres autochtones de l'Amérique.
Quoi qu'il en soit, les événements graves dont le Mexique a été récemment le théâtre, en appelant plusieurs milliers de nos soldats sur ses rivages, ont de nouveau éveillé parmi nous une curiosité d'autant plus vive que, cette fois, nous sommes directement intéressés à connaître ce pays où depuis si longtemps déjà luttent vaillamment nos frères et nos amis, et qu'on nous a présenté sous tant de jours différents sans qu'aucun d'eux soit le véritable.
Nous ne prétendons, Dieu nous en garde, incriminer aucun des auteurs qui ont écrit sur la matière; mais il est un fait d'une vérité tellement mathématique que nul ne pourrait, non pas le révoquer en doute, mais seulement le discuter. Ce fait est celui-ci:
Si intelligent, si impartial que soit un homme qui parcourt un pays qu'il ne connaît pas et dont il ignore la langue, lorsqu'au bout d'un an ou de six mois de retour chez lui cet homme écrira la relation de son voyage, il est évident que, malgré lui, à son insu même, il aura tout vu de travers, et que, par conséquent, substituant sans s'en douter ses propres sentiments et ses habitudes personnelles aux mœurs qu'il prétend décrire, il faussera la vérité à chaque ligne et même à chaque phrase, et cela de la meilleure foi du monde.
Pour bien connaître un pays, il faut y être arrivé jeune, l'avoir habité longtemps, et avoir été, par les circonstances, contraint de vivre de l'existence des habitants, partageant leurs joies et leurs douleurs, et par cela même adopté pour ainsi dire par eux comme si on était un des leurs. Alors, mais alors seulement, on pourra écrire des récits véridiques sur ce pays, parce qu'on se sera complètement identifié avec ses coutumes et qu'on ne craindra pas de se tromper.
L'auteur du récit qui va suivre a vingt ans habité l'Amérique, ce qui, à défaut d'autres avantages, lui donne sur ses devanciers celui de pouvoir parler avec connaissance de cause du Mexique et des Mexicains, si calomniés, si méconnus, et cependant si dignes, à tant de titres, de la sympathie des hommes éclairés et des véritables penseurs.
Maintenant que nous avons exposé assez clairement, pour qu'ils soient bien compris, les motifs qui nous ont engagé à écrire cette nouvelle histoire sans plus longs préambules, nous entrerons en matière.
La journée du 9 juillet 1846 fut une des plus chaudes dont les habitants de México aient gardé le souvenir. Depuis neuf heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, la chaleur fut tellement étouffante que le sol semblait littéralement fumer.
Les Indiens eux-mêmes, cependant si aguerris contre cette température de feu, n'osèrent braver les ardeurs de cette chaleur incandescente et demeurèrent cachés au fond de leurs masures, incapables de se livrer à leurs occupations ordinaires.
Pendant tout le jour, les magasins restèrent fermés, les portes et les fenêtres des maisons closes, et la ville, transformée en désert, plongée dans un silence de mort que nul bruit ne venait troubler, prit soudain l'aspect de cette cité des contes arabes, dont les habitants avaient été tout à coup changés en statues par la baguette d'un puissant enchanteur.
Cependant, au coucher du soleil, une légère brise descendit des hauts plateaux des montagnes qui entourent la cité et fit passer sur la ville pâmée un peu d'air vivifiant. Sous la bienfaisante impression de cette brise si impatiemment attendue, les poitrines se dilatèrent, les fenêtres s'entrouvrirent, la ville tout entière, sortant de sa léthargie et rendue à la vie, sembla pousser un ah! de joie; les rues, les places et les azoteas, se remplirent de gens qui venaient aspirer, à pleins poumons, cette fraîcheur salutaire. La circulation se rétablit, et bientôt les habitants, oublieux de leurs angoisses passées, ne songèrent plus, avec l'insouciance d'enfants qui les caractérise, qu'à jouir le mieux possible, avec des cris, des rires et des trépignements d'enthousiasme, de la courte trêve que leur accordait la chaleur.
Cependant, cette joie, tout exhilarante qu'elle semblât aux regards désintéressés d'un indifférent, avait en elle quelque chose de forcé et de contraint qui certes n'aurait pas échappé à l'attention intelligente d'un observateur. On aurait dit que ce peuple, si follement joyeux en apparence, cherchait à se donner le change à soi-même, en cachant sous une gaieté, trop bruyante pour être réelle, les inquiétudes et les sinistres prévisions d'un malheur qu'il sentait prêt à fondre sur lui.
Vers huit heures du soir, la porte d'une grande maison située au milieu à peu près de la calle San Andrés, roula silencieusement sur ses gonds et livra passage à un homme enveloppé dans les plis épais d'un large manteau, les ailes du chapeau rabattues sur les yeux, et conduisant en bride un fort cheval trapu et râblé, qu'à sa tête petite, à ses yeux vifs, et à ses jambes fines, il était facile de reconnaître pour un de ces chevaux des prairies de l'ouest, auxquels les coureurs des bois et les chasseurs donnent le nom de mustangs, et qui, fort ordinaires en apparence, ont cependant des qualités qui les rendent si précieux pour les luttes incessantes de l'existence pénible du désert.
Derrière l'homme et le cheval, la porte se referma sans bruit.
L'inconnu s'éloigna dans la direction de l'Alameda, abandonnée par les promeneurs qui tous s'étaient, selon leur habitude, concentrés à Bucareli.
A México, après le coucher du soleil, il est défendu de parcourir les rues à cheval; cette mesure, fort bonne en soi, puisque son but est d'empêcher les accidents, a cependant des inconvénients graves pour les personnes que leurs affaires contraignent à sortir la nuit, et qui, si elles veulent partir en voyage, sont obligées de traverser toute la ville en conduisant leurs chevaux ou leurs mulets par la bride.
L'inconnu marchait en homme pressé. Après avoir longé l'Alameda, passé San Hipólito, il obliqua et traversa l'Acequia ou ruisseau d'Alvarado, sur un pont qui porte, lui aussi, le nom du héros castillan.
C'est à cet endroit, dit-on, que, lors de la fatale retraite de la Noche triste, le capitaine de Cortez, après avoir assuré le passage de tous ses compagnons, demeuré seul dans la ville, franchit d'un bond, et tout armé, la tranchée, alors plus large qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, après avoir traversé le pont, l'homme à la suite duquel nous nous sommes mis, s'engagea dans l'aristocratique faubourg de San Cosme, le faubourg Saint-Germain de México, et sortit de la ville par la garita de San Cosme, sans que le factionnaire placé à la barrière semblât attacher la plus légère attention à lui.
Arrivé sur la belle chaussée ombragée de grands arbres, que l'aqueduc partage dans toute sa longueur, l'inconnu s'arrêta, jeta un regard investigateur autour de lui et, certain de n'être surveillé par aucun regard indiscret, il laissa tomber les plis de son manteau et retira son chapeau pour éponger avec son mouchoir son front inondé de sueur.
Nous profiterons de l'occasion que nous offre le hasard pour faire faire au lecteur une connaissance plus intime avec ce personnage appelé à jouer un rôle important dans cette histoire.
C'était un homme de vingt-sept à vingt-huit ans au plus; sa taille svelte et irréprochable dépassait la moyenne et dénotait une vigueur peu commune et une rare agilité. Son front large, les lignes fines et hautaines de son visage présentaient dans leur ensemble une délicatesse presque féminine, rendue plus prononcée à cause de la teinte de mélancolie qui les adoucissait en ce moment. Ses yeux noirs grands et bien ouverts, regardaient en face, et, sous l'influence de la passion, lançaient de fulgurants éclairs sous d'épais sourcils qui se rejoignaient à la naissance du front. Son nez droit, aux narines mobiles, sa bouche un peu grande, aux lèvres charnues, dénotait chez cet homme une nature sérieuse et une grande force de volonté; une fine moustache, bien cirée, se relevait coquettement sur ses joues basanées; des flots de cheveux noirs et bouclés s'échappaient avec profusion de dessous son chapeau et tombaient en boucles parfumées sur ses épaules; c'était, en un mot, un de ces cavaliers hardiment campés, qui font rêver les jeunes filles et réfléchir les hommes.
Son costume, fort élégant, était celui des riches hacenderos, costume si souvent décrit par nous, que cette fois nous nous abstiendrons de le faire.
Bien que notre personnage ne portât d'autres armes apparentes que le sabre de cavalerie attaché à son côté, et le long couteau fiché dans sa botte droite, cependant, si les plis de son zarapé se fussent soulevés, peut-être eût-on aperçu les crosses de deux revolvers passés dans la faja de crêpe de Chine rouge qui lui serrait les hanches.
Tout ce que nous pouvons ajouter quant à présent pour achever ce portrait tant physique que moral, c'est que ce jeune homme se nommait don Pablo de Zúñiga, qu'il était originaire de Guadalajara, capitale de l'État de Jalisco; qu'il passait pour extrêmement riche, et que depuis peu de jours seulement il était arrivé à México, où il menait une vie fort retirée, ne voyant personne et ne sortant que la nuit. Sans doute, nous serons bientôt en mesure de compléter ces renseignements un peu vagues.
Après s'être reposé pendant quelques instants et avoir, à plusieurs reprises, essuyé la sueur qui coulait sur son visage, don Pablo remit son chapeau, sauta en selle, s'enveloppa avec soin dans son manteau, et, après avoir jeté un dernier regard en arrière, il fit sentir l'éperon à son cheval, qui s'élança aussitôt au sobrepaso ou amble, allure familière aux chevaux mexicains, dans la direction du pueblo de Popotla, en laissant sur la droite la fontaine de Tlaxpana.
Le pueblo de Popotla est fort ancien. C'est en cet endroit que, dit-on, Cortez, lors de la Noche triste, où son armée, surprise par les Mexicains, fut presque détruite, mit pied à terre auprès d'un ahuehuete, pour voir passer devant lui ses soldats en déroute. L'ahuehuete—en mexicain: seigneur des eaux—une espèce de cyprès qui ne pousse que dans les lieux humides et le voisinage des sources; les Indiens et les chasseurs ont une vénération profonde pour cet arbre, qui, au désert, leur révèle toujours la présence de l'eau.
Les habitants de Popotla, assis ou couchés devant leur portes sur des pétates, riaient et chantaient en s'accompagnant de l'inévitable jarabé; don, Pablo traversa le village au pas de son cheval, et, continua à s'avancer vers Tacuba, qu'il atteignit bientôt et qu'il traversa sans s'arrêter; appuyant alors sur la droite, il longea la colline au sommet de laquelle s'élève le sanctuaire de Nuestra Señora de los Remedios, s'enfonça dans un bois d'ahuehuetes séculaires fort touffu, et dans lequel il eut une difficulté extrême à se frayer un passage, et arrivé à peu près au milieu de ce bois, à un endroit où un amas de pierres noircies et moussues et un pan de mur encore debout indiquaient que ce lieu avait à une autre époque été habité, le jeune homme s'arrêta, descendit de cheval, et, s'asseyant nonchalamment sur un quartier de roc, il tordit une cigarette, l'alluma et se mit à fumer aussi paisiblement, en apparence, que s'il eût été tranquillement installé dans son confortable appartement de la calle San Andrés.
Il faisait une de ces magnifiques nuits américaines dont nos froids climats du nord ne sauraient donner une idée même lointaine, une de ces nuits intertropicales douces, claires, lumineuses, qui portent l'âme à la rêverie et à l'adoration du Créateur; le ciel, d'un bleu profond, était diamanté d'étoiles sans nombre, qui mêlaient leur lumière à celle plus nette de la lune; l'atmosphère, d'une indicible pureté, laissait à une grande distance distinguer comme en plein jour les moindres accidents du paysage; le vent frissonnait avec de bizarres murmures à travers les feuilles des arbres; des myriades de lucioles bourdonnaient en se jouant dans les rayons blanchâtres de la lune, et, par intervalles, des bruits sans nom, apportés sur l'aile de la brise, passaient indistincts et presque insaisissables, se confondant avec le susurrement continu des infiniment petits qui, sous chaque brin d'herbe, accomplissaient leur tâche laborieuse.
Plus d'un quart d'heure s'était écoulé depuis l'instant où don Pablo avait fait halte dans le bois, le jeune homme avait jeté sa cigarette presque consumée, et se préparait à en tordre une seconde entre ses doigts, lorsque le bruit d'un galop de chevaux, qui se rapprochait d'instant en instant du lieu où il se trouvait, lui fit brusquement lever la tête et prêter attentivement l'oreille.
Son attente ne fut pas de longue durée. Presque aussitôt les branches craquèrent, les buissons s'écartèrent brusquement sous l'effort irrésistible du poitrail de plusieurs chevaux, et quatre cavaliers, arrivant au galop, s'arrêtèrent devant don Pablo de Zúñiga, qui se trouva en un clin d'œil entouré par eux.
Le jeune homme s'était levé; il attendait, immobile, et sans témoigner ni crainte ni surprise, qu'il plût aux arrivants de s'expliquer.
Ceux-ci semblèrent se consulter à voix basse; puis, sur un signe muet de celui qui paraissait être leur chef ou leur maître, trois d'entre eux tournèrent bride et disparurent dans les profondeurs du bois, où le bruit de leur course rapide ne tarda pas à s'éteindre dans l'éloignement.
Un seul était demeuré: c'était un jeune homme de haute taille, vêtu à l'européenne, aux traits fins et distingués, à la physionomie hautaine, qui, sans prononcer une parole, sauta à terre, abandonna son cheval à lui-même et s'avança résolument vers don Pablo, bien qu'avec les formes de la plus exquise politesse.
Arrivé près de don Pablo, il le salua courtoisement en retirant son chapeau, mais sans parler.
Don Pablo lui rendit silencieusement son salut, et sortant son mechero, il alluma impassiblement sa cigarette.
Enfin, le nouveau venu, voyant que le jeune homme était ou du moins semblait résolu à ne pas lui adresser la parole le premier, se décida à entamer l'entretien.
—Vous êtes, n'est-ce pas, caballero, dit-il en s'inclinant légèrement, le señor don Pablo de Zúñiga?
Don Pablo, salua sans répondre autrement.
—Je suis, moi, señor, reprit le cavalier en fronçant les sourcils, don Luis de Sandoval.
—En êtes-vous bien sûr, caballero? dit alors don Pablo avec un accent d'inexprimable raillerie.
L'autre se redressa d'un air de menace.
—Ce doute, señor! s'écria-t-il.
—Où voyez-vous que j'émets un doute, caballero? interrompit le jeune homme de plus en plus railleur.
—Serait-ce donc une insulte, señor?
—Ni l'un ni l'autre, répondit froidement le jeune homme. J'ignore quel motif vous amène auprès de moi; je ne vous attendais ni ne vous désirais; vous venez sachant mon nom, vous trouvez convenable de me cacher le vôtre. Je constate le fait, voilà tout; où voyez-vous une insulte là-dedans, s'il vous plaît?
—Ainsi, répondit-il en se mordant les lèvres avec dépit, vous savez qui je suis?
—Parfaitement, señor.
—Voilà qui est étrange! Cette fois est la première que nous nous trouvons en face l'un de l'autre.
—C'est possible, señor; cependant, je vous le répète, je sais qui vous êtes; et, si vous en doutez, je vais vous le dire.
Son interlocuteur fit un geste de dénégation.
—Vous ne me croyez pas, continua le jeune homme; eh bien! Écoutez-moi. Bien que vous parliez le castillan avec une rare perfection, cependant il est facile à un Mexicain de vous reconnaître au premier mot pour étranger; vous êtes un Américain de la Louisiane, né à la Nouvelle-Orléans, et votre nom à demi français et à demi saxon est Williams Stuart de Clairfontaine, ce qui se comprend parfaitement, vos ancêtres du côté maternel étant Anglais, tandis que, au contraire, ils sont Français du côté paternel. Ai-je dit vrai, Monsieur, ou bien me suis-je trompé? Veuillez me faire l'honneur de me répondre.
—Ce que vous dites est vrai, Monsieur. Veuillez, je vous prie, excuser une supercherie indigne de vous et de moi, et pour laquelle je vous adresse tous mes regrets, et venir, si vous me le permettez, au motif qui me conduit ici, motif que vous devez ignorer.
—Vous vous trompez encore, caballero; ce motif, je le connais, reprit-il froidement.
—Oh! pour cette fois, caballero! s'écria le jeune Américain avec vivacité, je crois être certain que vous ne le pouvez savoir.
—Vous êtes cousin de miss Anna Prescott, señor; vos parents et les siens avaient formé des projets d'union entre elle et vous, projets fort compromis aujourd'hui, du moins quant à ce qui touche miss Anna: quel autre motif que celui de me demander une explication et peut-être une réparation par les armes, de ce que vous considérez comme étant une injure de ma part, a pu vous amener ici? Seulement, ce qui m'étonne, c'est la façon dont vous avez appris que vous m'y rencontreriez.
—Cette fois encore, señor, je suis contraint d'avouer que vous avez raison et que vous êtes parfaitement renseigné. Quant à la manière dont m'a été révélée votre présence ici, cela importe peu, je le suppose; laissons-le donc de côté, et faites-moi l'honneur de m'apprendre si je dois voir en vous un ami ou un ennemi. Vous voyez, señor, que j'agis franchement avec vous, et que du premier coup je vais au but.
—J'en conviens, señor; malheureusement, je ne puis en aucune façon répondre à cette franchise, répondit-il avec un sourire hautain.
—Pour quelle raison, señor?
—Parce que, señor, je ne vous reconnais aucunement le droit de m'adresser des questions, et que, par conséquent, je ne vous répondrai pas.
—Alors, señor, vous me ferez raison.
—Je pourrais vous refuser, señor, car je ne vous reconnais pas plus le droit de me provoquer que celui de me questionner; mais votre proposition me plaît, et j'accepte de grand cœur.
Tout cet entretien avait eu lieu sur le pied de la plus exquise politesse; les deux interlocuteurs n'étaient pas un instant sortis du ton de la bonne compagnie.
—Ainsi, nous nous battrons, reprit l'Américain.
—Oui, señor, puisque vous le désirez; reste à savoir le lieu, l'heure et le jour.
—Oh! señor, cela, si vous y consentez, peut facilement s'arranger: le lieu? Celui où nous sommes me semble fort convenable; le jour? ce sera aujourd'hui si vous voulez; quant à l'heure, à l'instant même.
—Soit, señor, répondit don Pablo en s'inclinant, mais à une condition.
—Quelle est cette condition, s'il vous plaît, señor?
—C'est que vous prierez les personnes qui vous ont accompagné jusqu'ici de nous servir de témoins.
—A quoi bon, señor?
—Parce que, répondit don Pablo avec un accent glacial, comme sans aucune raison plausible vous m'êtes venu chercher querelle, à moi que vous ne connaissez pas; comme vous vous êtes fait mon ennemi, et que si je n'y mets ordre, cette haine que vous m'avez injustement vouée peut briser le bonheur de ma vie entière, mon intention est de vous tuer, et que vous mort, je ne veux pas être accusé de vous avoir assassiné.
Si brave que fut le jeune Américain, il ne put, sans frémir intérieurement, entendre ces paroles prononcées avec une si froide assurance, il s'inclina devant don Pablo.
—Il sera fait ainsi que vous le désirez, señor, dit-il; je vais appeler mes amis; mais je ne suis pas encore mort.
—Non, mais vous le serez bientôt, je l'espère.
Williams Stuart sourit avec ironie: sans répondre, il porta à ses lèvres un sifflet en or qu'il sortit de la poche de son gilet, et en tira un son aigu et prolongé; puis, se tournant vers don Pablo:
—Mes amis seront ici dans un instant, lui dit-il; tandis que nous sommes seuls, ne pensez-vous pas qu'il serait convenable de régler entre nous les conditions de cette rencontre?
—Caballero, le duel n'est pas dans les habitudes de mes compatriotes, j'ignore donc comment on agit en pareil cas; je vous laisse libre de régler cette affaire comme vous l'entendrez, vous avertissant tout d'abord que j'accepterai tout ce que vous me proposerez sans exception.
—J'ai apporté des épées avec moi, Monsieur; mais peut-être ne savez-vous pas vous servir de cette arme et préférez-vous le pistolet.
—Peu m'importe, señor, nous nous battrons à l'épée.
En ce moment les trois cavaliers qui avaient accompagné le jeune Américain reparurent, accourant à son appel. Williams Stuart leur expliqua en quelques mots le service qu'il attendait d'eux. Ils s'inclinèrent silencieusement, mirent pied à terre et vinrent se ranger auprès des deux jeunes gens.
Ceux-ci quittèrent une partie de leurs vêtements et se placèrent l'épée à la main en face l'un de l'autre.
—Señores, dit don Pablo en baissant la jointe de son arme et faisant un pas en arrière, quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez bien que je n'ai rien fait pour amener ce combat, que le sang versé retombe donc sur celui qui a provoqué.
—Hâtons-nous, señor, s'écria Williams, quoi que le sort décide, j'en accepte d'avance la responsabilité; en garde donc, s'il vous plaît.
—Je suis à vos ordres, señor, répondit don Pablo. Les épées se croisèrent avec un froissement sinistre, et le combat s'engagea silencieux et acharné.
Soudain le galop furieux d'un cheval résonna dans l'épaisseur du bois, un cri d'angoisse se fit entendre et une jeune fille pâle, échevelée, mais admirablement belle, apparut, brisant ou renversant dans sa course affolée, tous les obstacles qui s'opposaient à son passage, et d'un bond prodigieux de sa monture s'élançant entre les deux adversaires:
—Arrêtez! s'écria-t-elle, arrêtez! Au nom du ciel!
Les deux hommes reculèrent en baissant leur épée.
—Ah! reprit-elle avec une indicible expression de bonheur, j'arrive à temps.
—Pour me voir mourir, ma cousine! répondit Williams avec un pâle sourire.
Et, s'affaissant sur lui-même, il tomba sur le sol et roula aux pieds du cheval qui se cabra avec terreur.
—Mon Dieu! s'écria la jeune fille avec désespoir, mort! lui! Est-ce possible?
D'un mouvement rapide comme la pensée, don Pablo se précipita vers le jeune homme, le releva, et, après avoir posé la main sur son cœur, qui battait faiblement, il tourna vers la jeune fille son visage pâle comme celui d'un cadavre.
—Rassurez-vous, señorita, dit-il d'une voix que, malgré sa puissance sur lui-même, la douleur faisait trembler, il vit encore, je le sauverai!
Miss Anna réprima un mouvement de joie en entendant ces paroles, et fixant un regard d'une expression indéfinissable sur le beau jeune homme qui demeurait tristement agenouillé près du blessé auquel il prodiguait des soins.
—Ingrat! murmura-t-elle d'une voix sourde.
Les trois cavaliers qui avaient accompagné M. de Clairfontaine, bien qu'ils lui eussent servi de témoins dans le duel qui avait eu pour lui une issue si malheureuse, étaient jusqu'à ce moment demeurés spectateurs muets et impassibles des événements qui s'étaient passés. En entendant les paroles prononcées par don Pablo et l'espèce d'engagement qu'il prenait de sauver son adversaire, ils jugèrent qu'il était temps qu'ils intervinssent et prissent au sérieux le rôle de témoins qui leur avait été assigné.
Miss Anna Prescott n'était pas seule dans le bois, plusieurs de ses peones l'avaient suivie pour lui servir d'escorte, mais laissés en arrière par la jeune fille dont le cheval semblait avoir des ailes, tant sa course était rapide, ils n'étaient arrivés que depuis quelques minutes seulement dans la clairière, sur la lisière de laquelle ils se tenaient immobiles et prêts à exécuter ses ordres.
Miss Anna, après avoir jeté un dernier regard sur le blessé, dont l'état lui sembla sans doute moins grave qu'elle ne l'avait cru d'abord, se préparait à se retirer, lorsqu'un des cavaliers s'approcha d'elle, et, après l'avoir saluée respectueusement, il la pria au nom de ses amis et au sien, de lui laisser deux de ses serviteurs, pour aider à transporter le blessé dans un endroit où il serait possible de lui donner les soins que réclamait impérieusement la situation dans laquelle il se trouvait.
—Vous avez raison, caballero, dit la jeune fille, paraissant plutôt répondre à ses propres pensés qu'à la demande qui lui était adressée; mieux vaut qu'il en soit ainsi; cela, sous tous les rapports, sera plus convenable. Disposez de mes peones comme bon vous semblera dans l'intérêt de mon cousin.
—Deux d'entre eux nous suffiront, señorita; nous avons l'intention de transporter notre ami dans une maison située à une courte distance de l'endroit où nous sommes; maison dans laquelle aucuns soins ne lui manqueront.
—Faites à votre guise, señores, je vous eusse offert la maison de mon père si je n'eusse craint de lui causer une trop forte émotion en amenant blessé, chez lui, sans qu'il y soit préparé, un parent pour lequel il professe une vive amitié.
—Mille fois merci, señorita, reprit son interlocuteur; mais je vous répète que là où nous nous proposons de conduire notre ami, on sera heureux de le recevoir et rien ne lui manquera.
La jeune fille donna l'ordre à deux de ses peones de demeurer à la disposition du blessé et de ses amis, puis elle prit congé des trois cavaliers, et, sans tourner la tête du côté de don Pablo, qui fixait sur elle des regards chargés de toute la douleur qui lui dévorait secrètement le cœur, elle quitta la clairière et ne tarda pas à disparaître, ainsi que son escorte, dans les profondeurs du bois.
Don Pablo suivit des yeux la jeune fille aussi longtemps qu'il la put apercevoir; il prêta l'oreille au bruit de sa course tant que le plus léger son en fut perceptible à son oreille, puis lorsque tout se fut éteint dans l'éloignement, un profond soupir souleva sa poitrine, et, d'un pas lent et automatique, il alla s'asseoir sur le quartier de roc qui, primitivement, lui avait servi de siège, laissa tomber sa tête dans ses mains et s'abîma dans ses pensées, sans plus s'occuper de ce qui se passait autour de lui, et laissant les amis de son adversaire maîtres d'agir à leur guise.
Ceux-ci étaient des Américains du Nord, froids et compassés, à la vérité, ainsi que la plupart de leurs compatriotes, mais, en somme, c'étaient de parfaits gentlemen, fort liés avec le blessé, qu'ils aimaient réellement. Ils prirent donc avec le plus grand soin toutes les précautions nécessaires pour que leur ami fût transporté le plus doucement et le plus commodément possible sur un brancard construit à la hâte par les peones.
Lorsque tout fut prêt, ils s'approchèrent de don Pablo et le saluèrent gravement.
Le jeune homme releva la tête et fixa sur eux un regard étonné; il avait déjà oublié leur présence.
—Que désirez-vous de moi, señores? leur demanda-t-il.
—Caballero, répondit l'un des trois Américains qui, jusque-là, avait porté la parole au nom de ses compagnons, avant de nous retirer, nous éprouvons le besoin de vous témoigner notre estime pour la façon dont vous vous êtes conduit dans cette malheureuse rencontre, et nos remerciements pour la généreuse initiative que vous avez voulu prendre en offrant de prodiguer vos soins à l'homme qui s'était proclamé votre mortel ennemi, et contre lequel vous avez si vaillamment combattu.
—Je vous remercie, señores, répondit tristement don Pablo; croyez que personne plus que moi ne regrette ce qui s'est passé; j'ai vainement essayé d'éviter ce duel; hélas! Dieu m'est témoin que j'eusse préféré mille fois que ce fût mon sang qui eût coulé dans ce combat; en ce moment encore si ma vie pouvait racheter celle de mon adversaire, j'en ferais avec joie le sacrifice.
Les trois Américains saluèrent cérémonieusement le jeune homme et se retirèrent lentement, accompagnés des peones qui portaient le blessé.
Don Pablo demeura seul.
Il jeta un regard circulaire autour de lui. A quelques pas, son cheval paissait tranquillement les jeunes pousses des arbres et l'herbe qui tapissait la clairière. La lune se couchait, la nuit se faisait plus sombre. Un silence lugubre planait sur la nature, on se serait cru au milieu d'un désert tant tout était calme et morne; parfois le vol pesant d'un oiseau de nuit ou les abois saccadés de quelque chien errant rompaient pour quelques minutes ce silence, qui reprenait ensuite plus profond.
Une heure s'écoula ainsi, sans que don Pablo changeât de position; soudain il sentit une main se poser doucement sur son épaule.
Le jeune homme tressaillit, comme s'il eût reçu une commotion électrique et se retourna vivement.
Miss Anna Prescott était devant lui, pâle et souriante, plus semblable dans ses longs vêtements blancs à une apparition de l'autre monde qu'à une créature mortelle.
—Est-ce que vous ne m'attendiez pas? lui dit-elle d'une voix suave et pure comme un chant d'oiseau.
—Je vous attendais, señorita, répondit-il avec une douloureuse émotion, mais je n'espérais pas vous revoir.
—Ingrat et oublieux! fit-elle avec tristesse, n'avez-vous donc pas compris pourquoi je suis venue?
—Pardonnez-moi, señorita, je suis fou, je ne comprends rien, ma tête se brise, mes artères battent à éclater, je souffre.
—Vous souffrez, don Pablo, murmura-t-elle avec une ironie triste, vous souffrez, vous, un homme fort et courageux, et moi, qui ne suis qu'une pauvre et faible jeune fille, est-ce que je ne souffre pas?
—Oh! dit-il avec prière, si vous saviez!
—Je sais tout; mais, au contraire de vous, je suis forte parce que j'ai la foi. Nous autres femmes si faibles, si pusillanimes, même dans les choses banales de la vie, lorsque le moment arrive où notre cœur s'ouvre à l'amour, c'est lui seul qui nous guide, et nous devenons plus fortes que les hommes, parce que l'amour résume notre existence tout entière.
—Oui, vous aimez, doña Anna, je le sais.
—Non seulement vous êtes ingrat et oublieux, don Pablo, mais encore vous êtes aveugle.
—Peut-être vaudrait-il mieux que je le fusse réellement, señorita, alors, j'espérerais, je me bercerais de folles chimères, et je serais heureux.
—Don Pablo, ce n'est pas agir en caballero et en homme de cœur que de vouloir obliger une jeune fille à vous révéler les secrets intimes de son âme, lorsque, pendant le voyage que mon père fit, il y a un an, à Guadalajara pour rendre visite aux parents de ma mère, le hasard nous mit, vous et moi, en présence à la sortie de l'église, je compris au premier mot que vous me dîtes, que mon sort était décidé; ai-je changé depuis lors? avez-vous une fois, une seule, eu à me reprocher la faute la plus légère, une de ces innocentes coquetteries que, sans y songer, se permettent souvent les jeunes filles? Non, jamais! A votre arrivée à México, après une séparation de plusieurs mois, ne vous ai-je pas revu avec les témoignages de la joie la plus sincère? Répondez.
—Hélas! señorita, tout ce que vous me dites est vrai, j'en conviens, je le reconnais; mais, je vous le répète, je suis fou, pardonnez-moi, ne m'accablez pas.
—Non, vous n'êtes pas fou, don Pablo, mais vous êtes jaloux, ce qui est pis, car cette jalousie est pour moi une insulte.
—Une insulte! doña Anna, s'écria-t-il avec douleur.
—Oui, don Pablo, une insulte; l'amour tel que je le comprends est la communion de deux âmes qui se fondent en une seule; il ne peut vivre que d'abnégation et de confiance, sinon il meurt ou plutôt n'a pas existé. La jalousie n'est produite que par le manque de foi et de confiance; celui qui est jaloux n'aime pas.
—Au nom du ciel! señorita, ne me parlez pas ainsi, vos paroles me brûlent et redoublent mon désespoir; ce qui s'est passé ici même il y a une heure à peine...
—Ah! oui, dit-elle avec colère, voilà bien votre tactique, à vous autres hommes, vous attaquez toujours au lieu de vous défendre. C'est à moi à me disculper à présent, n'est-ce pas? Eh bien, soit! je le ferai, non pas pour vous, don Pablo, mais pour moi, que vos injustes soupçons font mourir. Je suis Anglaise par mon père, mais par ma mère je suis Mexicaine comme vous; toute la fierté des deux races dont je sors s'est réunie en moi, je suis fille du soleil, et au lieu de sang, c'est de la lave de nos volcans qui bouillonne dans mes veines.
—Non, pas d'explication, je vous en supplie, doña Anna, s'écria-t-il en joignant les mains avec prière et en se laissant tomber aux pieds de la jeune fille, je vous crois, je dois, je veux vous croire.
Elle se redressa hautaine et fière, le couvrit un instant d'un regard d'une expression inexprimable, et, faisant un pas en arrière:
—Relevez-vous et écoutez-moi, don Pablo, lui dit-elle avec un geste de commandement suprême; aussi bien je veux en finir, il faut qu'une fois pour toutes, tout malentendu cesse entre nous.
Le jeune homme se sentit vaincu, dominé par ce caractère d'une énergie supérieure à la sienne; il obéit avec la docilité d'un enfant, intérieurement heureux de la franchise naïve avec laquelle la jeune fille lui dévoilait toute l'étendue de son amour.
—L'homme avec lequel vous vous êtes battu, reprit-elle, est un de nos plus proches parents, il vous l'a dit lui-même; il vous a parlé aussi des projets d'union formés par notre famille; mais ce que vous ignorez, c'est que cet homme est arrivé à México il y a quinze jours, envoyé par son père pour demander ma main et m'épouser. Mon père, sommé de tenir la parole qu'il avait autrefois donnée, peut-être un peu à la légère, répondit qu'il serait heureux de voir cette union se conclure, mais à la condition qu'elle me conviendrait. Je refusai: point n'est besoin de vous le dire, n'est-ce pas, Pablo? Master Williams Stuart de Clairfontaine est un parfait gentilhomme, d'une loyauté proverbiale, mais irascible et vindicatif à l'excès; le refus péremptoire que je fis de sa main, sans vouloir donner d'autre raison que mon éloignement pour un homme que je ne connaissais pas, le froissa dans son orgueil. Sur ces entrefaites, vous arrivâtes à México; votre retour redoubla mon courage; une heure environ après votre visite, mon père reçut celle de M. de Clairfontaine. Habitué à me voir toujours gênée, silencieuse et maussade en sa présence, il ne comprit rien à la joie que j'essayais en vain de dissimuler et qui éclatait malgré moi sur mon visage et dans mes paroles. Cela lui donna à réfléchir.
—Oh! doña Anna, pourrez-vous jamais me pardonner mes injustes soupçons? Je croyais que cet homme était un rival préféré.
—C'était, en effet, un rival, reprit-elle en souriant, mais nullement préféré; il dissimula, plaisanta avec mon père et avec moi-même, en me félicitant de la bonne humeur que je montrais et à laquelle je ne l'avais pas accoutumé jusque-là; et, sans y paraître attacher d'importance, il s'informa des personnes que depuis peu nous avions vues. Mon père ne soupçonnant pas le but vers lequel il tendait, lui parla de vous, de l'intimité de nos relations et de votre arrivée imprévue à México; arrivée, ajouta-t-il, qui le comblait de joie, à cause de l'amitié qu'il avait pour vous. Je ne sais quels furent les moyens dont se servit M. de Clairfontaine pour changer ses soupçons en certitude et amener une rencontre; mais ce soir, après avoir dîné chez mon père, il se leva aussitôt après les dulces, et s'excusant sur une affaire pressée qui l'obligeait à nous quitter, il se retira. Mais en prenant congé de moi, il me dit à voix basse avec un ton de sarcasme qui me glaça de terreur. Je sais, señorita, combien vous vous intéressez à don Pablo de Zúñiga; comme j'aurai l'avantage de le voir ce soir au Bosque de los ahuehuetes; j'espère que je pourrai demain vous donner de ses nouvelles. Il sourit avec amertume, tourna sur ses talons, et sortit. Vous savez le reste. Je voulais prévenir une rencontre entre vous; éviter un malheur qui briserait ma vie; j'accourus folle de douleur, trop tard, hélas!
Elle s'arrêta pâle et frissonnante, et essuya les larmes qui coulaient sur ses joues.
Il y eut un long silence.
Ce fut donc Pablo qui reprit la parole:
—Me pardonnez-vous, doña Anna? lui dit-il d'une voix craintive.
—On pardonne quand on aime, fit-elle avec émotion.
—Et vous m'aimez?
—Ai-je besoin de répondre à cette question? murmura-t-elle doucement.
—Vous êtes un ange, je suis indigne de vous! s'écria-t-il avec exaltation; comment pourrai-je racheter jamais ma faute.
—En ayant la foi.
—Oh! je l'ai, je vous le jure! mais, hélas! ce funeste événement peut briser tous nos projets de bonheur.
—J'espère qu'il n'en sera pas ainsi, don Pablo; mon père m'aime, il est bon et il est juste; il pardonnera.
—Que le ciel vous entende, doña Anna; mais je crains d'autres obstacles encore, et plus difficiles à renverser.
—Que voulez-vous dire? Quel autre obstacle que la volonté de mon père peut s'opposer à notre union?
—Votre père est Américain, doña Anna.
—C'est vrai; mais depuis vingt-cinq ans, il habite le Mexique où il s'est marié à une Mexicaine; d'ailleurs, qu'importe sa nationalité?
—N'avez-vous donc pas entendu parler de l'animosité sourde qui règne en ce moment entre le gouvernement des États-Unis et celui du Mexique.
—Je vis avec mes fleurs, mes oiseaux et mon cœur, don Pablo, répondit-elle en souriant; je laisse la politique aux hommes.
—Malheureusement la politique vous touche aujourd'hui.
—Comment cela?
—Un guerre est imminente; d'un jour à l'autre, elle peut être déclarée. Nous serons ennemis, alors.
—Non pas nous; ne suis-je pas Mexicaine.
—Oui, mais votre père.
—Don Pablo, mon père est un homme sage qui, croyez-le bien, y regardera à deux fois avant que de compromettre son repos, sa fortune et le bonheur de sa fille dans une querelle qui lui est complètement étrangère.
—Mais la guerre déclarée, tous les Américains habitant le Mexique seront obligés de le quitter pour se rendre aux États-Unis.
—Je ne sais pas prévoir les malheurs d'aussi loin, don Pablo; la destinée est aux mains de Dieu, lui seul sait ce qui arrivera; n'essayons donc point de soulever le voile dont il cache l'avenir; croyez-moi, cela est plus prudent.
—Vous avez raison toujours. Je suis un fou de ne pas m'abandonner complètement à vos bons conseils.
—Peut-être vaudrait-il mieux, dans notre intérêt commun, qu'il en fût ainsi. Maintenant que vous êtes plus calme et que la raison vous est revenue, laissez-moi vous quitter. Venez demain voir mon père, je l'aurai préparé à vous bien recevoir.
—Merci mille fois, doña Anna, vous me donnez le bonheur en me rendant l'espoir. Vous ne me demandez pas pourquoi je suis ici?
—Cela ne me regarde pas; les hommes ont souvent des affaires que seuls ils doivent connaître.
En ce moment le cri du hibou se fit entendre à deux reprises différentes.
Don Pablo tressaillit et se leva.
—Voilà un oiseau qui chante bien tard, dit la jeune fille avec un malicieux sourire. Je vous quitte, ne vous occupez pas de moi; mes serviteurs m'attendent à deux pas d'ici; ils sont nombreux, bien armés et braves.
—Un mot encore, señorita, je vous en supplie.
—Parlez, mais hâtez-vous, je devrais être partie depuis longtemps déjà.
—Si demain je ne me présente pas chez votre père, ne soyez pas inquiète et ne m'en veuillez pas. Il peut surgir tels événements qui, malgré moi, me retiendront loin de vous. Il m'est impossible, quant à présent, de vous en dire plus.
—Je vous entends, don Pablo; au revoir. Demain ou dans un an vous me trouverez toujours la même: triste de votre absence, heureuse de votre retour.
Et elle s'envola comme un oiseau.
—Oh mon bonheur! murmura le jeune homme en suivant du regard les plis de la robe blanche glissant à travers les arbres.
En ce moment le cri du hibou s'éleva de nouveau dans le silence, mais cette fois beaucoup plus rapproché.
Don Pablo s'assura que son sabre jouait facilement dans le fourreau, toucha sous son zarapé les crosses de ses revolvers, et plaçant deux doigts de la main droite dans sa bouche, il répondit au signal qui lui était fait, en imitant à son tour le cri du hibou. Puis retirant un loup de velours noir de sa faja, il le plaça sur son visage.
Presque aussitôt on entendit craquer les branches mortes sous les pas pressés de plusieurs individus; les broussailles furent écartées violemment, et une dizaine d'hommes masqués et enveloppés dans de longs manteaux entrèrent dans la clairière de plusieurs côtés à la fois.
—Enfin! murmura le jeune homme. Et croisant les bras sur sa poitrine, il attendit, calme et immobile, que tous les inconnus eussent pénétré dans la clairière.
En votant l'annexion du Texas aux États-Unis, le Congrès de Washington savait fort bien que la guerre avec le Mexique ressortirait de ce vote approuvé la même année par les représentants du Texas; aussi s'était-il de longue main préparé à cette guerre, en massant des troupes sur les frontières mexicaines et en avertissant les escadres du golfe du Mexique et de l'Océan Pacifique à être prêtes à agir au premier signal.
Cependant quelques négociations furent entamées; elles échouèrent, et le général Taylor, commandant les forces américaines, reçut l'ordre de marcher en avant sur le Río Grande, tandis que l'escadrille l'appuierait en longeant la côte jusqu'à Matamoros.
Tous les ports mexicains furent bloqués; le plan des Américains consistait en une série d'attaques simultanées sur les frontières mexicaines du nord, de l'ouest et de l'est.
Le premier engagement eut lieu le 24 avril 1846. Nous n'avons pas l'intention de suivre les opérations des Américains; ces opérations, fort habilement conduites et exécutées avec un succès constant, sont connues de tout le monde; d'ailleurs, nous sortirions du cadre que nous nous sommes proposé; nous constaterons seulement que la fortune se prononça constamment contre les Mexicains, et que partout où ceux-ci se trouvèrent en face des Américains, ils furent honteusement défaits par des forces toujours inférieures aux leurs.
Don Pablo avait donc faussé la vérité, lorsqu'il avait dit qu'une guerre était imminente entre le Mexique et les États-Unis, puisque cette guerre existait et que déjà plusieurs batailles sanglantes avaient été livrées et perdues.
Mais comme les opérations avaient lieu surtout du côté de la Californie, peu de personnes, excepté celles obligées par leur situation à suivre les événements politiques, étaient instruites de ce qui se passait.
La situation se rembrunissait de plus en plus, elle devenait critique, une catastrophe était imminente, la vérité commençait à se faire jour et les bruits les plus sinistres circulaient sourdement dans la population.
Nous reprenons maintenant notre récit au point où nous l'avons abandonné, tout en nous excusant de cette courte digression politique indispensable du reste pour l'intelligence des faits qui vont suivre.
Les inconnus arrivaient un par un, deux par deux, parfois même trois par trois, si bien qu'au bout d'un quart d'heure à peine, la clairière se trouva remplie et que don Pablo se trouva enveloppé par la foule qui, cependant, laissait entre elle et lui un espace libre de quelque pieds, et qui semblait témoigner que, provisoirement du du moins, elle le reconnaissait pour son chef.
Quelques-uns des arrivants étaient venus serrer la main de don Pablo, et, après avoir échangé quelques paroles à voix basse avec lui, ils s'étaient rangés à ses côtés.
Le jeune homme demeurait toujours immobile et calme au milieu de la foule, que, par sa position, il dominait complètement; au bout de quelques instants, un individu se glissa au travers des rangs et annonça à voix haute que tout le monde était arrivé et qu'il était inutile d'attendre plus longtemps.
Don Pablo leva le bras droit au-dessus de sa tête; aussitôt les chuchotements cessèrent et un silence de mort régna dans cette clairière, où cependant une centaine d'individus au moins étaient réunis.
—Señores, dit alors don Pablo d'une voix forte et qui fut parfaitement entendue de tout le monde, laissez-moi d'abord vous donner quelques nouvelles toutes fraîches et qui, j'en suis convaincu, vous intéresseront.
—Parlez, parlez, s'écrièrent plusieurs voix.
—Écoutez avec attention, car la chose en vaut la peine, reprit le jeune homme; sachez que le général Castro, qui commandait à Puebla de los Ángeles, en apprenant la reddition de San Francisco et de Monterey aux Américains, reddition volontaire, je le constate, s'est enfui en Sonora sans oser combattre; la Californie a été aussitôt annexée aux États-Unis. Ce n'est pas tout, continua don Pablo de son accent le plus railleur, le général américain Kearney est entré sans coup férir à Santa Fe et a officiellement déclaré le Nouveau Mexique annexé aux États-Unis d'Amérique.
A cette seconde nouvelle, plus grave encore que la première, les clameurs et les vociférations redoublèrent, et pendant quelques instants un tumulte effroyable régna dans la clairière.
—Je n'ai pas fini, reprit le jeune homme d'une voix forte qui domina les cris de la foule. La capitale du Nuevo León, Monterey, cette ville si riche où commandait le général Ampudia, s'est rendue après quelques attaques vigoureuses, j'en conviens, au général américain Taylor.
A cette dernière révélation, la fureur fut à son comble; pendant plus d'une demi-heure, il fut presque impossible d'obtenir un instant de silence.
—Je vais vous donner d'autres nouvelles et plus fraîches, moi, s'écria un des assistants. Le président Paredes se prépare à marcher en personne contre les Américains. Il a remis ses pouvoirs entre les mains du général Bravo, vice-président de la république. Il doit quitter demain la capitale.
—Vos nouvelles sont de ce matin, interrompit vivement un second; en voici d'autres: le président ne part plus, du moins jusqu'à nouvel ordre; des troubles ont éclaté à Puebla, à Guanajuato et autres villes importantes; Paredes veut faire tête à l'orage.
—Vive Dios! interrompit en riant un des assistants, il a raison, n'est-il pas une muraille?
Ce jeu de mots essentiellement mexicain puisque Paredes en castillan signifie littéralement muraille, eut un succès fou.
—Canarios! si forte que soit cette muraille, s'écria un railleur, nous la démolirons!
—Oui! bien! bravo! s'écria-t-on de toutes parts. Les cris, les rires, les quolibets se croisèrent alors dans tous les sens sur le nom du président et celui du vice-président qui prêtait aussi au calembour, car les Mexicains sont surtout gouailleurs; le tapage devint épouvantable; cependant peu à peu l'effervescence se calma et le silence se rétablit à peu près. Don Pablo profita de cet instant de calme pour reprendre la parole.
—Le ministère s'est retiré, dit-il, nous sommes en complète anarchie; n'est-il pas honteux que. México seule, la capitale de la république, demeure silencieuse et indifférente lorsque toutes les provinces font des pronunciamientos et proclament la déchéance du président qui, par son incurie, est cause de l'humiliation de nos armes et des échecs constants qu'elles ont éprouvés. Il n'y a qu'un homme qui dans les circonstances critiques où nous nous trouvons, puisse nous sauver; cet homme est le général Santa-Anna, que vous avez exilé, et qui pourtant est prêt à revenir se mettre à votre tête pour délivrer la patrie du joug que les étrangers prétendent nous imposer.
Cette proposition du jeune homme fut accueillie avec enthousiasme par tous les assistants.
Le prestige que Santa-Anna, cet individu qu'on a avec raison nommé le mauvais génie du Mexique, a su conserver toujours, est immense. C'est chose qui dépasse toute croyance que l'amour que les masses professent pour cet homme, et l'influence que pendant le cours d'une carrière trop longue pour la prospérité de son pays, il a exercée sur toutes les classes de la société mexicaine.
Il fut arrêté que le lendemain au point du jour le pronunciamiento commencerait, qu'on proclamerait la déchéance de Paredes et l'avènement du général Santa-Anna, le seul homme qu'on pût opposer avec chance de succès aux Américains.
Séance tenante, toutes les mesures furent prises par les conjurés pour faire réussir la révolte, les postes furent distribués, les chefs nommés, des mots de ralliement choisis, etc.
Lorsque toutes les mesures furent prises, tout convenu, don Pablo ôta son chapeau et, enlevant du même coup le masque qui lui cachait la figure:
—Caballeros! s'écria-t-il avec enthousiasme, l'heure des précautions pusillanimes est passée, les traîtres ne sont plus possibles lorsque tout le monde est d'accord: nous ne sommes plus des conjurés timides qui conspirent dans l'ombre, nous sommes des patriotes qui voulons renverser un tyran odieux et délivrer notre pays du joug honteux de l'étranger; c'est donc franchement, hardiment, à visages découverts, que nous devons entrer dans la lice. A bas les masques, caballeros, ils empêchent de voir les loyales figures des sauveurs de la patrie!
Ces paroles obtinrent un succès immense et furent couvertes d'unanimes applaudissements.
Les masques furent aussitôt enlevés et foulés aux pieds. Nous n'oserions pas affirmer que tout le monde fut satisfait de cette dernière mesure: sans doute certains conspirateurs craintifs n'auraient pas été fâchés de conserver les leurs, mais il leur fallut céder à l'entraînement général, et ce furent eux qui, du bout des dents probablement, montrèrent la joie la plus vive pour cette confiance que les conjurés témoignaient dans la justice de leur cause, et le succès que le pronunciamiento ne manquerait pas d'obtenir.
Il y a longtemps qu'on a dit pour la première fois que, dans les conspirations, ce sont les poltrons qui, une fois que leurs vaisseaux sont brûlés, vont le plus loin et compromettent les braves par le courage de mauvais-aloi dont ils font parade à contrecœur; il arriva cette fois comme les autres, et si on les avait laissé faire, bien que sans armes, ils auraient immédiatement marché sur la capitale: il est probable que dans leur for intérieur, tout en faisant cette motion incendiaire, ils avaient l'espoir de s'échapper en route, et de laisser leurs compagnons se tirer d'affaire comme ils pourraient.
Une heure plus tard, tous les conjurés galopaient vers México.
Rentré chez lui dans sa maison de la calle San Andrés, don Pablo de Zúñiga se jeta tout vêtu sur un hamac, en ayant le soin de placer ses armes à portée de sa main, et il s'endormit presque aussitôt.
Cependant, au lever du soleil, México présentait cet aspect menaçant qui, sans qu'aucun mouvement n'eût encore été fait, aucun cri poussé, présage les catastrophes; on sentait que la révolte était dans l'air.
Les Indiens qui habituellement approvisionnaient la ville, n'étaient pas arrivés; des magasins, aucun n'était ouvert; des groupes d'hommes aux allures étranges, aux manières farouches, sortant on ne sait d'où, se répandaient de tous les côtés et se massaient sur les rues et les places qui environnaient le palais du président; les azoteas des maisons se garnissaient de monde, malgré la chaleur toujours croissante du soleil.
Aucune femme ne paraissait dans les rues pour vaquer, selon l'habitude, aux soins journaliers du ménage; partout on n'apercevait que des hommes dont le nombre s'en allait croissant à chaque minute; la foule se faisait peu à peu considérable; des murmures et des chuchotements menaçants commençaient à se faire entendre çà et là dans les groupes de plus en plus nombreux; on ne voyait pas d'armes encore, mais on les sentait sous tous les manteaux et on comprenait vaguement qu'il suffisait d'un signal pour les faire tout à coup étinceler au soleil.
Mais ce signal, qui le donnerait? Nul ne le savait encore: la foule attendait inquiète et anxieuse, frémissant au moindre bruit et se massant de plus en plus aux alentours du palais.
Tout à coup on entendit au loin comme le grondement sourd de la marée qui monte, quand la mer bouleversée dans le plus profond de ses abîmes inconnus se tord sous l'effort convulsif de la tempête. Ce grondement, d'abord vague et indistinct, s'en allait grandissant avec rapidité, se rapprochant incessamment, et prit bientôt les proportions gigantesques d'un effroyable tumulte. C'était, bien la marée qui montait, mais marée humaine celle-là, cent fois plus terrible et plus redoutable dans sa furie que le choc produit par les éléments en fureur. L'horrible clameur, sortie de cinquante mille poitrines, vint se briser avec un indicible fracas plein de menaces contre les murailles du palais présidentiel.
La foule se sépara en deux sous l'effort tout puissant de l'invisible tempête, et ouvrit un large passage au milieu d'elle. Par ce passage se ruèrent aussitôt une masse confuse de cavaliers et de piétons courant à perdre haleine, hurlant à plein gosier et brandissant, avec des cris de menaces, des armes de toutes sortes.
C'était la révolte qui arrivait ivre de sang et de rage. Plusieurs cavaliers, revêtus de brillants uniformes, galopaient en tête des conjurés, et semblaient être leurs chefs. Parmi eux, le premier de tous, se tenait don Pablo de Zúñiga, mais lui il portait le costume civil, et n'avait aucune arme apparente.
Le peuple, rassemblé sur la plaza Mayor, salua avec des cris et des trépignements de joie l'arrivée des nouveaux venus. C'était le signal qu'il attendait.
Tous se mêlèrent aussitôt, et avec un ensemble admirable, ils se préparèrent à agir.
En un instant, les principales artères conduisant à la place furent bouchées par des barricades, improvisées avec une adresse et une facilité qui témoignaient en faveur de la science que la populace mexicaine a puisée pour la révolte dans les trois cent quatre-vingts révolutions qui ont suivi la proclamation de son indépendance, ce qui donne une moyenne de quatre révolutions par an: on deviendrait savant à moins.
Les barricades construites dans l'entrée des rues, d'autres furent établies sur les azoteas, car dans l'Amérique espagnole, où tous les toits des maisons sont plats et construits à l'italienne, dans les villes les batailles se livrent à la fois en haut et en bas, c'est-à-dire dans les rues et sur les maisons; des tireurs adroits s'embusquèrent derrière les barricades et on attendit. Une espèce de calme tumultueux, s'il est permis d'employer cette expression, succéda alors à l'indescriptible vacarme qui avait salué la jonction du peuple et des conjurés.
Ceux-ci, réunis en un seul groupe à l'angle de la calle de Tacuba, arrêtaient entre eux les dernières mesures avant de frapper un coup décisif.
Cependant, le palais demeurait toujours sombre et silencieux, portes et fenêtres fermées; rien ne semblait bouger à l'intérieur; ce silence était d'autant plus effrayant pour les révoltés, qu'ils savaient le palais bourré de troupes.
Le président et le vice-président, avertis pendant la nuit de la révolte qui se préparait, avaient agi en conséquence, et ils avaient tout préparé pour opposer une énergique résistance à ceux qui prétendaient les renverser du pouvoir. Un roulement de tambours se fit entendre, suivi presque immédiatement d'un appel de clairons; la foule poussa un cri de satisfaction: son attente allait être satisfaite, le président acceptait le combat.
Les portes s'ouvrirent toutes grandes; un régiment d'infanterie sortit en bon ordre et vint se ranger en bataille devant les murs du palais; à ce régiment en succéda un autre, puis un autre encore, en tout trois. Les soldats et les officiers faisaient bonne contenance et ne paraissaient être nullement effrayés par les cris, les insultes et les sifflets avec lesquels la foule accueillit leur apparition. Deux régiments de cavalerie parurent ensuite, suivis presque aussitôt par quatre batteries formant un effectif de dix pièces de canon. Par les portes ouvertes, on apercevait d'autres troupes massées dans les cours du palais. Au même instant, des tirailleurs garnirent toutes les fenêtres.
Le président Paredes était à la tête d'une véritable armée, la lutte menaçait d'être terrible, et la victoire chaudement disputée.
Les insurgés ne s'attendaient pas à un aussi grand déploiement de forces; plusieurs d'entre eux, les plus timides sans doute, commençaient à regarder en arrière, comme s'ils eussent songé déjà, en cas d'échec, à se préparer un refuge. Derrière les troupes, un groupe de cavaliers composé d'officiers supérieurs, le président et le vice-président en tête, entrèrent sur la place.
Le président était pâle, mais il semblait calme et résolu; son état-major marchait silencieux à sa suite.
Les cris de: A bas Paredes! Vive Santa-Anna! s'élevèrent de tous les coins de la place, mêlés aux sifflets et aux injures.
Le président fit un signe de la main.
Les tambours roulèrent tous à la fois et couvrirent les clameurs de la foule.
Lorsque le silence fut à peu près rétabli, le président fit avancer son cheval sur le front de bandière, et d'une voix haute et assurée:
—Que voulez-vous? dit-il. Ne suis-je pas le président élu par vos suffrages?
Sa voix fut étouffée par les cris et les hurlements de la foule, il lui fut impossible de continuer.
—A quoi bon parlementer? dit le vice-président, sabrons cette canaille!
—Cette canaille est le peuple, répondit le président, dont le mâle visage se voila de tristesse; le sang versé ne se lave jamais, il reste comme un stigmate indélébile sur celui qui l'a fait répandre.
—Ne discutons pas, agissons, le temps presse, reprit le général; dans quelques minutes il sera trop tard peut-être, je ne suis pas sûr des soldats. Ce serait une lâcheté d'abandonner le poste que le peuple vous a librement donné et de pactiser avec quelques mutins.
—Que faire? murmura le président, en laissant errer avec tristesse ses regards sur la foule frémissante.
Cependant les cris et les sifflets redoublaient, il fallait en finir d'une manière ou de l'autre: combattre, ou se retirer et s'avouer vaincu.
Le vice-président leva son épée.
La fusillade éclata, plusieurs hommes tombèrent dans les rangs du peuple.
Un cri terrible, poussé par toutes les poitrines à la fois, répondit à cette agression inattendue; la place tout entière s'alluma comme un volcan, et le crépitement sinistre des balles vint se joindre aux hurlements furieux des combattants.
La bataille était engagée.
Tout à coup don Pablo de Zúñiga, suivi de quelques hommes dévoués et résolus ainsi que lui, fit bondir son cheval au milieu de la place, déjà encombrée de morts et de blessés, et il s'élança vers les troupes.
Le général Bravo s'était mis à la tête de l'infanterie. Les insurgés reculaient, la situation devenait critique pour eux; quelques cris de sauve-qui-peut commençaient à se faire entendre çà et là; plusieurs révoltés cherchaient leur salut dans la fuite.
Le président était rentré sombre et pensif dans le palais, dont les portes s'étaient refermées derrière lui.
Le général Bravo jugea la situation; avec cette rapidité de l'homme de guerre; il galopa vers la cavalerie, immobile devant le Sagrario.
—Soldats, s'écria-t-ils en brandissant son épée, vive la patrie! balayez la place, chargez ces mutins! en avant!
—Au nom de la patrie, je vous arrête! lui dit don Pablo en le saisissant au collet et le renversant sur la croupe de son cheval; vous êtes mon prisonnier!
Cette agression avait été si subite, si rapidement exécutée avec tant d'audace, que le général était prisonnier avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait.
—Soldats! continua don Pablo d'une voix éclatante, massacrerez-vous de sang-froid vos frères et vos amis? A bas Paredes! vive Santa-Anna! En avant sur les traîtres!
Les traîtres, pour don Pablo de Zúñiga, étaient les partisans du gouvernement qu'il prétendait renverser. Il en est toujours ainsi en révolution: les vaincus sont des traîtres et les vainqueurs sont des héros.
—Vive Santa-Anna! à bas Paredes! à mort! à mort! s'écrièrent les cavaliers en se ruant la lance couchée à la suite de don Pablo sur les soldats demeurés fidèles au gouvernement.
Ce mouvement décida la victoire.
Les soldats rastérisèrent avec le peuple; le gouvernement, abandonné de tous ses défenseurs, roula dans le sang qu'il avait fait verser.
Le soir même, Paredes, Bravo, et, en un mot, tous leurs adhérents, furent, par un décret, déclarés traîtres à la patrie et mis hors la loi.
Un gouvernement provisoire fut installé en attendant Santa-Anna, réfugié à la Havane, et que don Pablo de Zúñiga reçut la mission d'aller prier de consentir à se rendre aux vœux du peuple mexicain, en reprenant le pouvoir pour sauver la patrie mise en danger par la mauvaise administration du président Paredes.
Le pronunciamiento avait réussi; moins de deux heures avaient suffi pour renverser un gouvernement et en installer un autre.
Maintenant, le général Santa-Anna serait-il plus heureux que son prédécesseur, et réussirait-il à chasser l'étranger qui souillait par sa présence le sol sacré de la patrie?
Les gens sensés le désiraient sans oser le croire.
Un mois plus tard, Santa-Anna, que les croiseurs américains avaient courtoisement laissé passer, débarquait à la Veracruz et était reçu par les trépignements enthousiastes du peuple, qui voyait en lui le seul général capable par ses talents de résister avec avantage aux Américains.
Usant de notre droit de conteur, nous franchirons maintenant un espace de quelques mois, et abandonnant provisoirement le plateau d'Anahuac, nous prierons le lecteur de nous suivre dans l'État de Jalisco, où vont se dérouler plusieurs scènes importantes de notre histoire.
Le 5 janvier 1847, vers neuf heures du matin, une troupe composée d'une dizaine de cavaliers bien montés et surtout bien armés—car à cette époque les grandes routes de la République mexicaine étaient infestées de bandits de toutes sortes, déserteurs de l'armée pour la plupart—après avoir traversé à gué une petite rivière, affluent perdu et sans nom du Río Grande ou du Río Santiago, ainsi qu'on le nomme indifféremment, s'engagea d'une allure assez rapide sur la route qui conduit du pueblo de Zapatlanejo à Tepatitlan, autre pueblo situé à vingt-cinq lieues environ de Guadalajara.
Cette route, bien ombragée, serpente à travers une plaine fertile et bien cultivée, à l'extrémité de laquelle, du point que les voyageurs avaient atteint, ils pouvaient apercevoir, à demi-perdu dans les lointains bleuâtres de l'horizon, le charmant pueblo de Tepatitlan, construit au sommet d'une éminence complètement boisée, d'où ses blanches maisonnettes jaillissent pour ainsi dire comme du milieu d'un bouquet de fleurs.
Nous avons dit que les voyageurs étaient à peu près au nombre de dix. Huit d'entre eux étaient des domestiques indiens ou peones; des deux autres personnes, la première était une femme ou plutôt une jeune fille, et la seconde un homme qui semblait avoir passé la cinquantaine, bien que sa taille droite, ses yeux gris et vifs, son visage plein et fortement coloré, et ses cheveux blonds et épais, témoignassent en faveur de la bonté et de la vigueur de sa constitution, et ne laissassent entrevoir aucun signe de décrépitude.
La jeune fille avait vingt ans à peine; elle était blonde, mignonne, gracieuse, et offrait dans sa personne le type le plus complet qui se puisse imaginer de la beauté saxonne dans toute sa splendeur.
La ressemblance qui existait entre les traits du vieillard et ceux de la jeune fille, dénotait une parenté fort rapprochée: en effet, c'étaient le père et la fille.
Le vieillard portait le costume européen avec cette rigide exactitude qui, du premier coup d'œil, fait reconnaître un Anglais dans toutes les parties du monde; la seule concession qu'il avait cru devoir faire au pays qu'il habitait temporairement, c'était d'avoir attaché un immense voile vert à la forme de son chapeau, afin de se garantir des rayons ardents du soleil; quant à la jeune fille, elle était si bien enveloppée dans des châles de toutes sortes, qu'il était impossible de rien apercevoir de son costume.
Le père et la fille cheminaient côte à côte à quelques pas en avant des peones et causaient entre eux en anglais, soit qu'ils préférassent employer cette langue, qui était la leur, soit qu'ils ne se souciassent point d'être compris de leurs serviteurs, dans la fidélité desquels ils n'avaient sans doute pas grande confiance.
Cependant plus ils avançaient du côté de Tepatitlan, la route d'abord déserte se peuplait de voyageurs, montés pour la plupart sur des chevaux camperos, c'est-à-dire galopeurs, passaient comme des flèches auprès de nos deux personnages, échangeaient avec eux un Dios guarde rapide et ne tardaient pas à disparaître dans les sinuosités du chemin.
Au moment où nous mettons en scène nos deux personnages, le vieillard parlait:
—Je vous avoue, ma fille, disait-il, que je ne partage nullement votre manière de voir, et cela se comprend: vous êtes jeune et moi je suis vieux, les voyages qui à votre âge sont pleins d'attrait, n'offrent plus au mien que des ennuis et des fatigues insupportables, surtout dans un pays comme celui où nous sommes, où les moyens de locomotion sont encore dans l'enfance, et se réduisent à l'emploi du cheval.
—Je conviens, mon père, répondit la jeune fille, qu'il serait plus agréable pour vous de voyager en voiture.
—Oui, de toutes les façons; j'ai besoin de prendre mes aises, la moindre fatigue me brise. Que voulez-vous, mon enfant? ce n'est pas de ma faute, vous ne devez pas m'en vouloir pour cela.
—C'est moi, mon père, qui regrette de vous voir ainsi errer sur les routes.
—Bah! vous le regrettez, Anna, dit le vieillard en souriant avec une légère teinte d'ironie; on ne s'en douterait guère, à voir la façon dont vous en usez avec moi depuis quelque temps.
—Est-ce un reproche que vous m'adressez, mon père?
—Nullement, mon enfant; mais convenez avec moi que je serais beaucoup mieux dans ma maison de la calle San Francisco, à México, confortablement étendu dans ma butaca, lisant le Times, le New-York Herald ou tout autre journal, que sur cette route, en proie au soleil, à la poussière, et ce qui est pis, sous la menace continuelle d'une attaque de salteadores.
—J'en conviens, mon père; mais vous savez que nous avons été contraints, à cause de la guerre, de quitter México et, sans la protection de don Pablo de Zúñiga, pour lequel le général Santa-Anna professe une vive amitié, peut-être aurions-nous été obligés de sortir du Mexique.
—Tout cela est vrai, mon enfant; mais pourquoi errer ainsi de ville en ville, au lieu de nous rendre tout simplement dans nos propriétés de Sonora ou du Nuevo León?
—Pouvions-nous traverser Guadalajara sans visiter nos parents?
—Non, certes, cela n'eût pas été convenable mais nous n'avons pas rencontré ces parents, la guerre leur a fait abandonner la ville pour se retirer dans une hacienda éloignée; nous sommes demeurés quinze jours à Guadalajara, livrés à nous-mêmes, mal logés et mal nourris, dans une horrible posada, où, entre parenthèses on nous a fait payer fort cher; nous n'avons rencontré personne de connaissance. Si don Pablo de Zúñiga eût été à Guadalajara encore, cela nous eût fait une société, mais il a disparu et personne ne sait ce qu'il est devenu; en quittant la ville, rien n'était plus simple que de nous diriger tout droit vers Tepic, où nous possédons une assez belle maison, rien ne nous aurait manqué là; pas du tout, je ne sais ce qui vous passe tout à coup par la tête, vous m'obligez à retourner sur nos pas pour aller je ne sais quoi faire à Tepatitlan.
—Mais, mon père, il doit y avoir un herradero à Tepatitlan. C'est fort curieux, dit-on; j'ai désiré le voir, c'est tout simple.
—Hum, fit le vieillard d'un air de doute, c'est possible, mais je n'en crois rien; vous devez avoir un autre motif. Tenez, Anna, soyez franche; avouez que vous me cachez quelque chose.
—Oh! mon père, répondit-elle en rougissant, vous ne le croyez pas!
—Moi, je le parierais, au contraire. Depuis quelque temps je ne vous reconnais plus; vous êtes complètement changée; tantôt vous voulez une chose, puis, sans motif aucun, cette chose ne vous plaît plus, et c'est une autre chose qu'il vous faut; vous êtes capricieuse, bizarre, nerveuse, inquiète, impatiente, que sais-je encore?
—Le portrait que vous faites de moi n'est pas flatteur, mon père.
—Malheureusement il est vrai, mon enfant, et cela me tourmente beaucoup, parce que je vous aime, et que je crains que vous ne me cachiez quelque chagrin secret.
—Quel chagrin puis-je avoir, mon bon père, auprès de vous?
—Que sais-je? il est si difficile de découvrir les pensées qui remplissent le cœur d'une jeune fille.
—Je suis heureuse, mon père; mes pensées ne vont pas plus loin que le désir de rester avec vous.
—Ah! pourquoi avez-vous refusé d'épouser votre cousin Williams, c'était un bon parti?
—Je ne l'aimais pas.
—L'amour serait venu.
—J'en doute.
—Alors c'est que vous en aimiez un autre?
—Peut-être, mon père!
—J'ai donc deviné?
—Je ne dis pas non.
—Pourquoi ne pas m'avoir instruit de cela plus tôt? vous savez que je n'ai pas l'intention de forcer vos inclinations, et, pourvu que celui que vous aimez soit digne de vous.
—C'est l'âme la plus grande, le cœur le plus loyal qui existe.
—Oui, je le sais, celui qu'on préfère a toujours toutes les qualités. Et quel est ce mortel si heureusement doué?
—Je ne puis vous le dire encore; excusez-moi, mon père.
—Bon! voilà que nous retombons dans le mystère à présent. Soit, comme il vous plaira; je n'insiste pas, d'autant plus qu'il faudra bien que vous parliez un jour ou l'autre.
La jeune fille sourit finement sans répondre.
—Avec tout cela, me voilà brouillé avec Williams et toute sa famille; je le regrette, ce jeune homme me convenait; je l'avais, tout enfant, fait sauter sur mes genoux; je m'étais habitué à le considérer comme mon fils.
—Il m'oubliera d'autant plus facilement, qu'il me connaissait à peine, mon père, et il redeviendra votre ami et le mien.
—J'en doute fort. A la suite de ce duel mystérieux, dont il s'est obstiné à me cacher les motifs, son caractère a complètement changé; il est devenu sombre, réservé, bref, ce n'est plus le même homme. A peine rétabli de sa blessure, au lieu de me venir voir comme auparavant, il a subitement quitté le Mexique et est reparti pour les États-Unis, sans même prendre congé.
—C'est un reste d'irritation contre moi, sans doute.
—Non, c'est une belle et bonne haine, Williams est orgueilleux et vindicatif, il ne vous pardonnera jamais d'avoir méprisé son alliance.
—Que puis-je faire à cela, mon père? C'est un malheur dont il me faut prendre mon parti; d'ailleurs nous ne nous reverrons probablement jamais.
—Peut-être le reverrons-nous plus tôt que vous ne le supposez, miss; j'ai appris qu'à peine débarqué à la Nouvelle Orléans, Williams était allé rejoindre le général Taylor en qualité de volontaire; cela doit cacher des projets que, sans doute, nous ne tarderons par à connaître.
—Mon cousin est un gentleman, mon père.
—Oui, mais c'est surtout un homme qui veut se venger d'une injure qu'il croit avoir reçue.
—Je ne puis croire que nous ayons à redouter quelque chose de lui; d'ailleurs il est loin d'ici.
—Pas autant que vous le supposez; Dieu veuille que je me trompe, mais je ne sais pourquoi j'éprouve à ce sujet des craintes vagues que je ne puis chasser de ma pensée.
En ce moment, un des peones, serviteur de M. Prescott, le seul, du reste, dans lequel il eût une entière confiance, s'approcha respectueusement.
—Que me voulez-vous, Santiago Ramírez? lui demanda le vieillard.
—Mi amo, j'aperçois une nombreuse troupe de cavaliers qui se dirige de ce côté: je viens prendre vos ordres.
—Hum! fit le vieillard en levant la tête, en effet je ne les avais pas vus. Que croyez-vous que sont ces hommes?
—Des rancheros, seigneurie; cela est facile à reconnaître.
—Mauvaise rencontre, n'est-ce pas?
—Je ne saurais vous répondre là-dessus avec certitude, seigneurie; les rancheros sont des corps francs levés par de riches hacenderos dans le but de servir de guerilleros pendant la guerre actuelle; quelques-uns sont honnêtes.
—Voilà qui n'est pas rassurant, mon pauvre Ramírez.
—Quels sont les ordres de votre seigneurie, mi amo?
Le vieillard jeta sur sa petite troupe un regard piteux qu'il reporta sur les cavaliers qui accouraient à toute bride.
—Il nous est impossible d'éviter leur rencontre, dit-il, nous ne sommes plus qu'à une courte distance du pueblo, continuons donc à avancer, et à la grâce de Dieu!
Santiago Ramírez salua respectueusement son maître et alla reprendre sa place en avant des autres peones.
Si la vue des rancheros, qui venaient à lui inquiétait M. Prescott, ils ne produisaient pas le même effet sur sa fille. Miss Anna les voyait, au contraire, se rapprocher avec joie; peut-être avait-elle, des motifs secrets pour qu'il en fût ainsi.
Disons tout de suite ce que sont les rancheros, pour ne plus avoir à y revenir plus tard.
Le ranchero mexicain a beaucoup de rapports avec notre fermier, en faisant, bien entendu, la part de la différence qui doit exister entre les mœurs du pays qu'il habite et le nôtre.
Le ranchero est le seul qui ait presque complètement échappé à l'influence délétère du clergé mexicain, pour lequel il professe un respect fort médiocre; cela tient au milieu dans lequel il vit. Perdu, pour ainsi dire, au milieu d'immenses solitudes, toujours au grand air, en face de la nature, il n'a aucun des vices des villes et possède au contraire les vertus des races nomades; loyal, hospitalier, d'une honnêteté proverbiale, d'une valeur à toute épreuve, il a conservé le sens moral, possède au suprême degré l'amour de la famille, brûle du désir de s'instruire et en cherche toutes les occasions: malheureusement elles sont rares pour lui.
La vitalité du pays est donc toute en lui, car il tient au sol qu'il cultive et qui lui appartient; sans argent souvent, mais vivant dans l'abondance, il est sincèrement patriote et foncièrement républicain, possède au suprême degré la haine de l'étranger, et, dénué de cette turbulence inquiète et souvent licencieuse des habitants des villes, il a instinctivement les véritables sentiments d'indépendance qui, le jour où cette race vigoureuse et rude aura, grâce à l'instruction, perdu ses préjugés, assureront l'autonomie du pays et constitueront à la nation mexicaine cette force réellement nationale qui lui manque encore, mais que l'avenir lui réserve.
Ce furent les rancheros qui, lors de la guerre de l'indépendance, formèrent ces redoutables cuadrillas qui tinrent si longtemps en échec la puissance espagnole et finirent par l'abattre. Indifférents aux bouleversements politiques qui depuis si longtemps bouleversent leur malheureux pays, ils laissent paisiblement les ambitieux et les intrigants des villes s'entre-détruire; ce n'est que lorsque l'étranger envahit les frontières et menace le sol qui les a vus naître qu'ils sortent de leurs déserts; mais alors ils déploient une indomptable énergie, ne se laissent abattre par aucun revers et ne déposent les armes que vainqueurs, ou quand la mort les leur arrache. Ils sont cruels souvent, cela tient à leur éducation sauvage, mais ils sont généreux et grands aussi, fidèles quand même à la cause qu'ils ont juré de défendre.
Leur costume est caractéristique, un peu théâtral peut-être, mais en somme, essentiellement pittoresque et va bien à ces hommes à charpente vigoureuse, aux traits hâlés et énergiques et aux allures martiales remplies d'une inexprimable désinvolture.
Cependant les rancheros se rapprochaient rapidement des voyageurs. Ils formaient une troupe d'une cinquantaine de cavaliers environ, et arrivaient comme un ouragan au milieu d'un nuage épais de poussière. A quelques pas en avant, galopait un cavalier qui devait être leur chef. M. Prescott poussa un cri de joyeuse surprise; dans ce cavalier, il avait reconnu don Pablo de Zúñiga, dont un moment auparavant il regrettait si fort l'absence et qu'il avait cherché vainement à Guadalajara.
Toute inquiétude disparut alors, et les voyageurs continuèrent gaiement leur route.
Les deux troupes ne tardèrent pas à se rejoindre et à se confondre.
Don Pablo accosta le vieillard de la façon la plus cordiale.
—Vous ne comptiez pas me rencontrer ici? lui dit-il après l'échange des premiers compliments.
—Je l'avoue, répondit M. Prescott; mais je suis charmé de cette rencontre. Mais vous, où alliez-vous ainsi à bride avalée?
—Moi! j'allais au-devant de vous.
—Comment! vous alliez au-devant de moi? ceci demande une explication, don Pablo.
Le jeune homme sourit en regardant la jeune fille.
—L'explication est facile à donner, répondit-il. J'ai su votre arrivée à Guadalajara, et le désir que vous aviez manifesté de me voir. Si grand qu'eût été pour moi le plaisir de passer quelques instants auprès de vous, malheureusement, j'étais retenu par d'importantes affaires; cependant j'allais tout abandonner pour vous aller rejoindre, lorsque je fus averti que non seulement vous aviez quitté la ville, mais que vous rebroussiez chemin du côté de México. Or, comme la route la plus directe pour se rendre à la capitale est celle-ci, j'ai supposé que vous la prendriez; j'ai pris mes mesures en conséquence, et me voilà.
—Bon! bon! fit en souriant le vieillard, tout cela peut être vrai: en tout cas, je suis heureux de cette rencontre.
—A la bonne heure; je vous ai fait préparer une maison dans laquelle vous serez à ravir. Comptez-vous demeurer quelques jours à Tepatitlan?
—J'y resterai le moins possible, puis je retournerai du côté du Pacifique.
—Vous n'allez donc pas à México?
—Non. Je compte me retirer soit à Tepic, soit à Monterey; au moins jusqu'à la fin de la guerre.
—Puisqu'il en est ainsi, laissez-moi faire, señor, je me charge de vous conduire, vous et la señorita, jusqu'à la résidence qu'il vous plaira de choisir.
—Comment cela, caballero? demanda timidement la jeune fille, toute rougissante de plaisir.
—Voici de quelle façon, señorita; le général Santa-Anna, après avoir quitté México, a pris le commandement de l'armée libératrice qui se réunit à San Luis de Potosí; j'ai formé une cuadrilla de rancheros forte de trois cents cavaliers, dont vous voyez une partie auprès de moi. Je compte me mettre en marche aussitôt après le herradero, qui va avoir lieu demain, pour rejoindre l'armée; je me mets donc à vos ordres, si toutefois mon offre vous agrée.
—C'est à mon père qu'il appartient de vous répondre, señor don Pablo; quant à moi personnellement, je serais charmée de profiter de votre escorte, surtout en ce moment où les routes sont infestées de salteadores.
—Ce qui en bon castillan, mon cher don Pablo, fit en riant le vieillard, veut dire que nous acceptons votre offre de grand cœur; ainsi voilà qui est convenu, vous pouvez compter sur nous.
Quelques minutes plus tard on atteignit le pueblo.
Tepatitlan regorgeait de monde, le village était en fête.
Don Pablo conduisit les voyageurs à la maison qu'il avait fait préparer pour eux; puis, lorsqu'il les y eut confortablement installés, il se retira discrètement en les avertissant qu'il viendrait les prendre le lendemain de bonne heure pour assister au herradero.
M. Prescott ne fit aucune observation à sa fille sur la façon bizarre dont ils avaient rencontré le jeune homme; seulement le soir, avant de se retirer dans sa chambre à coucher, il lui dit d'une voix légèrement railleuse, en l'embrassant:
—Quel hasard singulier! n'est-ce pas, Anna?
Ce fut toute la jeune fille rougit, mais elle ne répondit pas.
Le lendemain, ainsi que cela avait été convenu, don Pablo vint chercher ses hôtes, et, après leur avoir adressé les compliments d'usage, il les conduisit à des places réservées, d'où ils pouvaient voir commodément le herradero.
Au Mexique, les troupeaux paissent en liberté sur d'immenses pâturages, sous la surveillance de gardiens nommés vaqueros, aussi sauvages qu'eux.
Ces troupeaux, appartenant à plusieurs propriétaires, malgré le soin que mettent les vaqueros à les séparer, finissent, toujours par se mêler et si bien se confondre les uns avec les autres, qu'il devient presque impossible de reconnaître à qui ils sont. Pour obvier à cet inconvénient, une fois par an, tantôt pour les taureaux, tantôt pour les chevaux, les vaqueros réunissent tous les troupeaux, les conduisent tantôt à un village, tantôt à un autre, les renferment dans des corrales faits exprès, où ils les entassent par milliers. Une fois là ils les lacent, les séparent et les marquent au chiffre de chaque propriétaire, au moyen d'un fer chaud. C'est ce qui se nomme un herradero.
Les herraderos sont de véritables fêtes pour les vaqueros, et des prétextes de réunion pour les rancheros et les hacenderos; on les voit arriver de tous les côtés, vêtus de leurs plus beaux habits, montés sur leurs meilleurs chevaux, dans l'intention de lutter entre eux d'adresse et d'audace; aussi cette fête est-elle une véritable fantasia plus émouvante cent fois que celles exécutées par les Arabes, et dans laquelle le désir de se surpasser l'un l'autre excite à un si haut degré l'émulation de ces centaures, qu'ils accomplissent les prouesses les plus extraordinaires.
Il y a quelque chose qui saisit, intéresse et donne le vertige dans le spectacle étrange qu'offrent ces hommes, montés sur des chevaux fougueux, rompus à tous les exercices de l'équitation, se précipitant à fond de train dans un corral renfermant plusieurs milliers d'animaux effarés, presque fous de terreur, qui se foulent, se pressent, se poussent pour éviter l'atteinte du lasso qui les menace et que le vaquero fait tournoyer autour de sa tête, en poussant des cris rauques et sauvages, en tourbillonnant autour de cette masse vivante et indomptée, qui mugit, résiste et fait d'incroyables efforts pour rompre l'obstacle qui s'oppose à sa fuite.
Le herradero dura six jours, il y avait plus de vingt mille têtes de bétail à séparer et à marquer.
Deux jours plus tard, M. Prescott et sa fille, confortablement installés dans des palanquins portés par des mules, qu'ils devaient à la sollicitude attentive de don Pablo de Zúñiga, prenaient, escortés par le jeune homme et sa cuadrilla de rancheros, la route de San Luis de Potosí, où ils devaient rejoindre l'armée libératrice, prête à entrer en campagne contre les Américains, sous les ordres du général Santa-Anna, qui avait voulu prendre le commandement en personne.
Don Pablo et doña Anna, oublieux des soucis de la politique, étaient heureux d'être, pour quelques jours du moins, réunis l'un à l'autre, de se voir, de pouvoir se parler; ils jouissaient du présent sans se soucier de l'avenir, et avec cet égoïsme qui caractérise les amoureux, ils ne songeaient qu'à leur amour et au bonheur si doux d'être constamment l'un près de l'autre.
M. Prescott, tout en suivant d'un œil attentif le manège innocent des jeunes gens, savourait avec délices le plaisir beaucoup plus réel pour lui d'être confortablement étendu dans un palanquin à l'abri de toute fatigue.
Le voyage se fit sans événement digne d'être noté, et le neuvième jour après leur départ de Tepatitlan, les rancheros firent leur entrée à San Luis de Potosí.
La ville regorgeait de troupes et ressemblait à un camp; don Pablo de Zúñiga était arrivé juste à temps. Le général Santa-Anna était attendu le lendemain, et l'armée devait immédiatement marcher en avant.
A quelques pas seulement de la plaza Mayor, dans une ruelle étroite, sombre et boueuse située presque derrière la cathédrale et nommée le Callejón del Remedio, existait à l'époque où se passe notre histoire—et probablement existe encore à San Luis de Potosí à l'heure où nous écrivons, car le Mexique est le pays du monde où tout, hommes et choses, conserve le plus opiniâtrement sa physionomie et son immobilité de granit en dépit du progrès—une vieille masure, tombant presque en ruines et datant évidemment des premiers temps de la conquête espagnole; les fenêtres étroites garnies de vitres verdâtres, enchâssées dans du plomb et recouvertes de toiles d'araignées séculaires, les murs noirs, enfumés et fendillés çà et là, le sol en terre battue et raboteux, dénonçaient au premier coup d'œil cette masure pour un véritable bouge.
En effet, ce taudis infect, qui suintait le crime et la misère par tous les pores de ses murailles lézardées, était ce qu'à México on nomme un velorio, et servait de refuge aux gens sans aveu et aux bandits de toutes sortes qui d'ordinaire pullulent dans les grands centres de population, mais dont le nombre s'était augmenté dans des proportions considérables, non seulement à cause de la guerre, mais encore grâce aux événements politiques qui avaient plongé le pays dans un état d'anarchie indescriptible.
Le mot velorio est essentiellement mexicain, il n'a pas d'équivalent possible dans le langage des honnêtes gens, nous n'essaierons donc pas de le traduire; dans celui dont nous avons esquissé la description, dès que la nuit était venue, à la lueur douteuse de quelques candilejos, aux mêches charbonneuses, attachés contre les murs par des mains de fer, une nombreuse compagnie, mêlée d'hommes et de femmes, envahissait la salle, débouchait dans les pièces attenantes, montait à l'étage supérieur, et jusqu'au jour on dansait, on jouait, on buvait, et souvent on faisait pis encore.
Les celadores chargés du soin de veiller à la sûreté commune des habitants de la ville, les patrouilles qui parcouraient les rues pour maintenir le bon ordre, évitaient soigneusement les approches de ce repaire, et quels que fussent les cris qui s'en échappassent, le tumulte horrible qui y régnât, rendus volontairement sourds par la crainte, ils passaient sans s'arrêter et même en hâtant le pas, sans se risquer à jeter un coup d'œil du côté de ce redoutable velorio, si ce n'est afin d'assurer que quelques-uns de ses hôtes sinistres ne faisaient pas irruption au dehors et ne se mettaient pas à leur poursuite.
C'est dans cet affreux repaire que, deux jours après l'arrivée de nos voyageurs à San Luis, nous introduirons le lecteur vers dix heures du soir environ.
Il y avait chambrée complète, toutes les salles étaient pleines, toutes les tables garnies; dans le fond de la plus grande pièce, quelques musiciens ou soi-disant tels, car au Mexique, tout le monde a la prétention d'être musicien, placés sur une estrade assez élevée, jouaient à qui mieux mieux, sans se préoccuper les uns des autres, des airs, n'importe lesquels, que du reste personne n'écoutait.
Un nuage de fumée, produit par les candilejos, les sebos, les pipes et les cigares, planait comme une auréole lugubre au-dessus des consommateurs et assombrissait encore l'éclairage déjà plus qu'insuffisant de cette vaste pièce, qui se trouvait ainsi plongée dans une espèce de crépuscule brumeux dont, notons-le en passant, les habitués de la maison étaient loin de se plaindre, au contraire.
Là se trouvait réunie en ce moment la collection la plus complète de mauvais drôles qui se puisse imaginer, drapés fièrement dans des guenilles hétéroclites comme jamais Callot n'en a rêvé dans ses compositions les plus fantasques et les plus excentriques.
Le velorio était en liesse; il hurlait du haut en bas des imprécations et des blasphèmes dans toutes les langues connues et inconnue, car tous les pays du globe sans exception y étaient représentés par quelques coquins émérites.
Dans l'angle le plus obscur de cette salle ténébreuse, non loin de l'estrade sur laquelle se tenaient les musiciens, un homme, enveloppé d'un manteau, le chapeau rabattu sur les yeux, était assis seul à une table, le dos appuyé au mur, le coude sur la table, la tête dans la main; il fumait un mince papelito en laissant errer des regards investigateurs autour de lui sans songer à entamer la mesure de mescal placée devant lui.
Cet homme était entré un des premiers dans le velorio, au moment où les peones allumaient les sebos, il avait choisi cette place entre toutes, s'était assis, avait demandé de la liqueur; depuis lors il n'avait donné signe de vie que pour tordre une nouvelle cigarette, lorsque celle qu'il fumait touchait à sa fin. Dans tout autre lieu que celui où il se trouvait, ses allures étranges, son affectation à cacher son visage auraient appelé l'attention sur lui; mais dans ce bouge, chacun était trop occupé de ses propres affaires pour songer à celles des autres, et nul n'avait pris garde à lui. Seulement, comme par un accord tacite, afin de lui laisser plus de liberté, personne n'était venu s'asseoir à sa table: délicatesse de bandit, depuis que l'homme dont nous parlons devait intérieurement être très reconnaissant, car, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le velorio s'était si rapidement rempli que toutes les tables étaient garnies de buveurs, et que quelques-uns même, ne trouvant plus de place nulle part, s'étaient assis sur le bord même de l'estrade des musiciens et s'étaient fait servir là du pulque et du mescal.
Soudain un mouvement d'ondulation assez fort s'opéra dans la foule des buveurs, vigoureusement repoussés à droite et à gauche; et sans paraître se soucier des cris et des malédictions qui le saluaient sur son passage, un individu, cause unique de ce bouleversement, alla résolument s'asseoir sur le banc occupé déjà par l'inconnu et se plaça juste en face de lui.
Celui-ci tout en feignant d'être sérieusement absorbé par la confection d'une cigarette, jeta un regard de côté sur son voisin, et satisfait sans doute du résultat de son examen, il sortit son mechero et battit froidement le briquet.
Le nouveau venu était, en apparence du moins, un drôle de la pire espèce: il avait la taille athlétique, les traits patibulaires, les moustaches outrageusement retroussées, le chapeau penché sur l'oreille; il se drapait orgueilleusement dans un manteau en dents de scie, portait un long couteau dans la botte et une énorme rapière à lourde poignée de fer au côté; c'était en somme, le type complet du bandit mexicain dans ce qu'il a de plus odieux et de plus repoussant, avec cela le ton et les manières d'un gentilhomme.
Après s'être examinés pendant quelques secondes, les deux hommes se saluèrent d'une inclination de tête, et le nouvel arrivé, tordant rapidement une cigarette, s'adressa à l'inconnu.
—Pardon, señor caballero, dit-il avec une politesse exquise, me ferez-vous l'honneur de me prêter votre feu?
—Avec le plus grand plaisir, señor, répondit l'autre en tendant le mechero d'or curieusement ciselé qu'il tenait encore à la main.
—Mille grâces, señor, dit-il en allumant sa cigarette, éteignant le mechero et le rendant ensuite avec un salut à son propriétaire.
En ce moment un peon plaça une mesure d'infusion de tamarin et un gobelet en corne sur la table.
Le nouveau venu se pencha vers l'inconnu, sa mesure à la main.
—Vous en offrirai-je, señor? dit-il.
—Je vous remercie, répondit l'autre; vous voyez, caballero, que j'ai devant moi du mescal, auquel je n'ai pas encore touché.
—C'est pardieu vrai! Seriez-vous indisposé, señor?
—Pas le moins du monde, reprit-il avec intention; mais l'odeur de ce mescal me déplaît.
—Il n'est peut-être pas de bonne qualité?
—C'est probable; vous savez que le mescal est comme le pulque, il doit être bu nouveau, sinon il se gâte et devient exécrable.
—Hélas! fit le bandit avec un jeu de physionomie impossible à traduire, il en est ainsi de tout dans la vie.
—Vous êtes philosophe? dit l'autre avec un sourire.
—Oui, dans mes moments perdus: l'habitude de vivre seul agrandit et épure les idées.
—C'est juste, le jaguar chasse seul, les coyotes vont en troupes.
—Aussi le jaguar est le roi du désert; je méprise les coyotes. Vous offrirai-je de cette infusion de tamarindos, caballero? je vous assure qu'elle est excellente.
—J'accepte pour ne pas vous désobliger, répondit-il en tendant son gobelet.
L'autre versa.
—Je suis don Pedro de Arizona; dit-il en saluant, mais mes amis me nomment Matadiez, à cause probablement d'une grande légèreté de main et d'une dextérité que je possède dans le maniement du couteau.
—J'avais souvent entendu parler de vous avec éloge, señor Matadiez. Je bénis le hasard qui m'a fait vous rencontrer si à l'improviste.
Le bandit salua courtoisement.
—C'est moi, señor, dit-il, qui bénis cet heureux hasard. Votre seigneurie daignera-t-elle me dire son nom?
—Il est loin encore d'avoir acquis la grande célébrité du vôtre, caballero, mais tel qu'il est le voici: je me nomme don Augustín Zaputo, mais ceux qui me connaissent personnellement, mes amis, préfèrent m'appeler Trabuco.
—Quoi! s'écria le bandit avec l'apparence de la joie la plus vive, vous êtes le señor Trabuco?
—Pour vous servir, caballero, répondit-il modestement.
—Pardieu! la rencontre est heureuse, señor, depuis longtemps je brûlais du désir de faire votre honorable connaissance.
—Je vous avoue que moi aussi j'avais ce désir.
—La sympathie nous attirait l'un vers l'autre.
—Deux hommes comme nous doivent être amis.
—Inséparables comme les doigts de la main.
—A votre santé.
—A la vôtre.
Ils burent.
—Je ne comptais guère, en venant ici, me rencontrer avec vous, reprit Matadiez.
—Ni moi, je vous l'avoue.
—Voilà qui est extraordinaire, d'autant plus que nous avons échangé le mot d'ordre.
—C'est vrai; l'ami qui a consenti à nous mettre en rapports n'a pas songé à vous dire mon nom, de même qu'il aura jugé inutile de me dire le vôtre.
—C'est cela, il voulait nous faire une surprise.
—Que, pour ma part, je trouve charmante.
—Et moi délicieuse.
—Je lui adresserai mes sincères compliments pour cette attention délicate.
—Moi de même.
Il y eut un silence; ce fut Trabuco qui le rompit au bout d'un instant.
—Maintenant que la connaissance est faite et la glace rompue entre nous, dit-il, si nous causions un peu de nos affaires.
—Je n'y vois pas de sérieux inconvénients.
—J'ai à vous entretenir de choses fort sérieuses, et la foule est grande autour de nous.
Matadiez éclata de rire.
—Cette foule fait notre sécurité, dit-il. Tous les gens qui sont ici ont trop à s'occuper d'eux-mêmes pour songer à nous; leurs oreilles sont fermées: d'ailleurs ils me connaissent pour la plupart, et tant que nous demeurerons à cette table, nul ne s'avisera de s'approcher assez pour entendre ce que nous dirons. Parlez donc sans crainte, cher seigneur.
—On a dû vous toucher quelques mots déjà de l'affaire qui nous amène l'un vers l'autre.
—On m'en a parlé vaguement; il s'agit, je crois, d'un riche étranger qui voyage avec sa fille et quelques peones seulement.
—C'est cela même, il emporte, dit-on, avec lui, des sommes considérables, sans compter des bijoux de grande valeur.
—Quelle imprudence de se hasarder ainsi sur les grandes routes en temps de guerre; la police est si mal faite, fit-il en souriant.
—Et un malheur est si tôt arrivé, reprit l'autre sur le même ton; mais, vous le savez, ces Anglais—je crois qu'il est de ce pays—ne doutent de rien.
—Enfin, s'il lui arrive quelque chose, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même.
—Ainsi soit-il. Mais ce n'est pas tout.
—Je suis tout oreilles.
—Cet Anglais se rend à Tampico.
—Bon; il y a sur cette route des passages fort dangereux.
—C'est vrai. Ses richesses courent grand risque de ne pas arriver intactes à destination.
—Ni lui non plus.
—Pardon, il est convenu qu'on ne lui enlèvera pas un cheveu de la tête.
—Bah! Pourquoi donc?
—Parce qu'il est préférable de lui faire payer une bonne rançon.
—Mes compliments, señor, je n'avais pas pensé à cette ingénieuse combinaison.
—On ne peut songer à tout.
—Continuez, de grâce, vous m'intéressez vivement.
—Maintenant, passons à la jeune fille.
—C'est cela, passons à la jeune fille. Est-elle jolie?
—Charmante.
—Hum! nouvelle rançon alors. Ah çà! mais mon cher seigneur, cette affaire prend des proportions gigantesques, savez-vous? nous allons tous rouler sur l'or d'ici à quelques jours.
—Je l'espère; mais, quant à la jeune fille, sa rançon est réglée.
—Déjà?
—Oui.
—Combien?
—Vingt mille piastres.
—Beau chiffre, caray! et vous avez touché?
—Pas encore; mais il est entendu que je toucherai aussitôt après livraison.
—Ceci me semble régulier. Ah çà! continua-t-il en posant les coudes sur la table, penchant le corps en avant et regardant son interlocuteur bien en face, l'affaire se dessine bien, il y aura du profit, elle me sourit beaucoup, mais ce n'est pas tout encore.
—Bah! de quoi s'agit-il donc?
—Vive Dios! de nous entendre entre nous et de savoir comment nous réglerons.
—Oh! que cela ne vous inquiète pas, cher seigneur, vous serez content de moi.
—Je n'en doute pas, caballero, cependant les affaires sont les affaires, vous le savez; mieux vaut, je crois, nous entendre tout de suite, afin de nous épargner plus tard des discussions et des malentendus toujours regrettables entre gens d'honneur.
—Parfaitement raisonné. Eh bien! je serai franc; écoutez-moi.
—Je ne demande pas mieux.
—Je ne vous cache pas que, apportant l'affaire, avec tout autre qu'avec vous, cher seigneur, j'aurais posé certaines conditions peut-être un peu dures; mais entre nous il ne saurait en être ainsi, je mets un trop haut prix à l'avantage de vous avoir avec moi pour discuter: nous partagerons les bénéfices par moitié, cela vous convient-il!
—Pardieu! je le crois bien.
—Seulement...
—Ah! dit-il en faisant la grimace, il y a un seulement.
—Il y en a toujours.
—C'est juste; continuez.
—Seulement, comme je suis étranger dans cette province, que je ne connais personne, vous vous chargerez d'organiser l'expédition.
—Cela se peut arranger ainsi. De combien d'hommes pensez-vous que nous ayons besoin?
—Oh! mon Dieu! une douzaine tout au plus, pourvu que ce soient des gaillards solides et résolus; il ne faut pas nous exposer à un échec.
—Diable! ce serait malheureux. Et ces hommes qui les payera?
—Vous, naturellement.
—Hum! murmura-t-il avec une grimace, le bénéfice ne sera pas aussi grand que je le supposais.
—Pourquoi donc? Par le temps qui court, les hommes ne sont pas rares, vous en trouverez plus que vous ne voudrez; cela vous coûtera un millier de piastres tout au plus.
—Eh! eh! la somme est ronde.
—Oui, mais les bénéfices sont beaux.
—Je le sais bien.
—Enfin, cher seigneur, c'est à prendre ou à laisser. Ainsi décidez-vous.
—Je prends, caray! C'est égal vous me tenez la dragée haute.
—Allons donc! ne supposez pas cela, caballero, vous me causeriez un véritable chagrin en le croyant.
—Allons! c'est convenu.
—Vous me le jurez?
—Sur ma foi de gentilhomme.
—J'aimerais mieux autre chose, reprit-il en riant.
—Eh bien! sur la part que j'espère en paradis.
—C'est entendu, alors.
—Parfaitement.
—Voilà qui est bien. Maintenant, pour finir, l'heure, le jour et le lieu du rendez-vous?
—Connaissez-vous le Voladero del Macho.
—Caray! A quatre journées de chemin; je le vois d'ici.
—Eh bien! trouvez-vous lundi de la semaine prochaine, c'est-à-dire dans sept jours, vers cinq heures de la tarde au Barranco del Estrivo, à une lieue environ avant d'arriver au voladero; à cette heure-là, l'Anglais et sa fille passeront; surtout, n'oubliez pas d'être bien accompagné.
—Rapportez-vous-en à moi pour cela.
—Choisissez des hommes habitués au désert.
—Ah! pourquoi donc?
—Hum! on ne sait pas ce qui peut arriver, peut-être serons-nous forcés de nous réfugier dans la prairie.
—Je vois que vous n'oubliez rien.
—Il faut tout prévoir. Au revoir, señor Matadiez; Dieu vous garde!
—Au revoir, seigneur Trabuco. Que Dieu vous accompagne!
Les deux bandits se saluèrent cérémonieusement et se séparèrent.
Le señor Trabuco quitta immédiatement le velorio, où il laissa Matadiez décidé en apparence à y demeurer jusqu'au lever du soleil.
Cependant, à peine son complice eût-il franchi la porte du bouge, que Matadiez se leva brusquement et sortit à son tour.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, à peine arrivé au pouvoir, Santa-Anna, comprenant combien sa position était précaire, avait résolu de l'affermir en réparant les fautes de son prédécesseur, c'est-à-dire en poussant la guerre avec vigueur et en infligeant aux ennemis une éclatante défaite, ce à quoi, vu le petit nombre de soldats dont le général américain disposait, il espérait facilement parvenir, d'autant plus que lui-même avait mis l'armée mexicaine sur un pied formidable; du moins ses ordres avaient été donnés en conséquence aux généraux et aux gouverneurs de province.
Malheureusement, s'il est jusqu'à un certain point possible de grouper les hommes et de donner à cette agglomération hétérogène d'individus le nom d'armée, on n'improvise pas des soldats en quelques jours, et Santa-Anna devait, à ses dépens, en faire bientôt la triste expérience.
Disons, en quelques mots, ce qu'est l'armée au Mexique, ou du moins ce qu'elle était à l'époque où se passe notre histoire. D'ailleurs, malgré les événements qui sont survenus depuis, il est probable que, grâce au caractère apathique et insouciant des Mexicains, les choses sont toujours dans le même état, à moins qu'elles aient encore empiré, ce qui serait fort possible; car il est à noter que, lorsqu'un changement quelconque s'opère dans ce malheureux pays, ce changement a toujours lieu en sens inverse de la raison, c'est-à-dire de mal en pis.
Avant la proclamation de l'indépendance, sous la domination espagnole; l'armée était bien composée et surtout solidement organisée; la discipline était bonne, l'éducation militaire assez avancée; les officiers savaient assez bien leur métier pour instruire les soldats. Il est vrai que ces officiers étaient Européens pour la plupart, et que les quelques officiers mexicains qui se trouvaient dans les régiments indigènes ne dépassaient jamais ou presque jamais le grade de capitaine, qui était le plus élevé qu'il leur fut permis d'atteindre.
Aujourd'hui, tout cela a changé: autant autrefois l'état militaire était honorable, autant à présent il est méprisé. Cela est facile à comprendre; les soldats ne se recrutent que dans la classe infime de la société, parmi les leperos, les vagabonds et les criminels condamnés aux présidios. On les enchaîne les uns aux autres et sous la conduite de caporaux et de sergents armés de chicottes, on les conduit à coups de fouet à leurs régiments. Si on les laissait se rendre librement à leurs corps, pas un n'arriverait; ils déserteraient tous. Les Indiens, de pure race surtout, ont une antipathie invincible pour le service militaire; il est littéralement impossible de les retenir sous les drapeaux.
Quant aux officiers, nous sommes contraints d'avouer que, à peu d'exceptions près, ils n'ont pas une origine plus relevée que leurs subordonnés, les quelques jeunes gens de bonne famille qui se trouvent parmi eux, gâtés par les mauvais exemples qu'ils ont constamment sous les yeux, ne tardent pas à se perdre complètement et à adopter les vices et les habitudes de débauche de leurs compagnons.
Les soldats mexicains seraient bons s'ils étaient instruits et bien commandés, car il sont foncièrement braves; leur cavalerie est admirable d'entrain et de courage; malheureusement on ne saurait en dire autant de l'infanterie, on ne peut en rien se fier à elle; sa résistance est nulle, au premier coup de feu elle se trouble, se débande, et officiers en tête cherche son salut dans la fuite.
Cependant nous persistons à soutenir qu'il serait facile de faire d'excellents soldats de ces hommes primitifs, car ils possèdent instinctivement les vertus militaires: le courage, la sobriété poussée à son extrême limite et l'habitude des privations, qui leur fait supporter en riant les plus grandes fatigues, sans chaussures et avec quelques mauvaises tortillas de maïs pour toute nourriture.
Quel soldat européen serait satisfait d'un tel régime?
Il suffirait tout simplement, pour transformer l'armée mexicaine et en faire réellement ce qu'elle devrait être, que l'exemple partît de haut, c'est-à-dire qu'on plaçât à sa tête et dans ses rangs des officiers instruits, honnêtes et hommes de cœur; surtout, qu'on établît une discipline exacte et inflexible.
Une des choses qui, à notre avis, et à celui de personnes beaucoup mieux placées que nous pour juger sainement cette question, ont le plus influé sur la démoralisation de l'armée mexicaine, est la défense du duel entre militaires; il est défendu, sous des peines extrêmement sévères, à un officier de relever une insulte autrement qu'en paroles, même le cas échéant où il serait traité de lâche et souffleté: quel point d'honneur peut-il exister chez des hommes qui supportent sans sourciller les plus dégradantes injures?
Si les soldats mexicains sont plus braves que leurs chefs, la cause en est toute naturelle; ils se livrent journellement entre eux, sous le plus futile prétexte, des combats mortels au couteau, l'arme la plus redoutable qui soit, de sorte qu'ils ont pour la plupart le corps criblé de blessures.
Le résumé de tout ceci est que le moindre sous-officier des armées régulières d'Europe en sait davantage qu'un général mexicain, et que, en ligne, dix mille hommes de nos troupes déferont facilement une armée décuple mexicaine, si grand que soit d'ailleurs le courage individuel des soldats qui la composent; cela est fort triste, mais n'est malheureusement que trop vrai.
Cependant, de tous les côtés, les troupes, dont le rendez-vous général avait été assigné à Potosí, commençaient à affluer dans la ville.
Rien de navrant comme l'arrivé de ces détachements; la plupart étaient sans armes, à peine vêtus de pantalons et de jaquettes sales et en loques; les traits hâves et amaigris, accablés de fatigue pour la plupart, ils se traînaient avec peine, stimulés dans leur marche par les chicottes des sous-officiers, et attachés les uns aux autres comme des malfaiteurs.
Au fur et à mesure qu'ils arrivaient on les parquait en dehors de la ville, dans de grands hangars préparés exprès pour eux; on leur distribuait des vivres dont ils avaient un pressant besoin, puis, après un jour ou deux de repos, on leur donnait des vêtements et des armes; puis, une fois armés et revêtus de l'uniforme, immédiatement considérés comme soldats, ils complétaient les cadres des régiments d'ancienne formation, dont l'allure martiale et le vernis d'éducation militaire prêtait à l'illusion et encourageait la jactance des généraux, qui avec de tels hommes, se croyaient ou feignaient de se croire invincibles.
Ainsi qu'il l'avait annoncé, le général Santa-Anna avait quitté México pour se mettre en personne à la tête de l'armée destinée à opérer contre les Américains.
Il arriva à Potosí dix jours après nos voyageurs: il fit une entrée magnifique dans la ville, à la tête d'un nombreux état-major, étincelant de broderies d'or. Les rues avaient été pavoisées sur son passage, et il atteignit le Cabildo, préparé pour le recevoir, en traversant au pas de son cheval une foule innombrable qui le saluait sur son passage par des cris de joie enthousiastes, tandis que toutes les cloches sonnaient à grande volée, et que les gamins faisaient partir des bottes et des cohetes, qui çà et là brûlaient quelques rebozos, effrayaient les chevaux et éborgnaient les citadins paisibles.
Au Mexique, il n'y a pas de bonne fête sans pétards et sans feu d'artifice; seulement chacun tire son feu d'artifice à sa guise et au grand soleil.
Le général don Antonio López de Santa-Anna était, à cette époque, un homme de quarante-huit ans environ; sa taille était haute, bien prise, ses manières élégantes, son teint jaunâtre; ses traits avaient une noblesse remarquable; son front élevé et proéminent, son menton arrondi, son nez légèrement aquilin, sa bouche fine, mobile et un peu railleuse, ses yeux noirs, bien fendus et pleins de feu, donnaient à sa physionomie une expression extrêmement sympathique, complétée par une forêt de cheveux noirs et bouclés qui descendaient sur ses oreilles et ombrageaient ses pommettes, peut-être un peu trop saillantes.
Il portait un splendide uniforme couvert de broderies et constellé de diamants, et bien qu'une de ses mains, celle qui tenait la bride, fût mutilée, et que du côté droit une jambe de bois portât seule sur l'étrier, il faisait caracoler son cheval avec l'adresse d'un jinete émérite, et saluait gracieusement la foule à droite et à gauche, tout en s'entretenant avec les officiers qui lui faisaient cortège, et au nombre desquels se trouvait naturellement don Pablo de Zúñiga.
Placés à une fenêtre de la maison où ils étaient logés, M. Prescott et sa fille regardaient défiler le cortège avec cette curiosité ironique qui caractérise les Anglais qui ne trouvent rien de bien et rien de beau hors de leur pays, et se sont fait une loi du nihil admirari.
En passant devant leur fenêtre, le général Santa-Anna les aperçut, il les salua gracieusement et, se penchant vers don Pablo, il lui dit quelques mots à voix basse, en désignant la fenêtre du doigt.
Cette attention du président de la République mexicaine, toute flatteuse qu'elle fût pour l'amour-propre de ceux qui en étaient l'objet, contraria vivement M. Prescott; le digne gentleman prisait à leur juste valeur les faveurs des grands; celles dont Santa-Anna semblait vouloir le gratifier l'inquiétaient surtout; il connaissait depuis longtemps le général et savait par expérience qu'il en voulait surtout au coffre-fort des étrangers qu'il daignait distinguer; il avait quitté México pour se soustraire aux emprunts forcés du gouvernement, et ne se souciait nullement, surtout en ce moment qu'il avait tout à redouter, d'attirer l'attention et d'être remis en évidence.
Il rendit tant bien que mal le salut du général et se retira de la fenêtre en ordonnant d'un geste à sa fille de l'imiter.
—Qu'avez-vous donc, mon père? demanda miss Anna, et pourquoi quitter cette fenêtre quand le cortège n'a pas encore fini de défiler? C'est fort curieux, je vous assure.
—Très curieux, en effet, ma fille, répondit-il en hochant la tête; maudite soit la pensée que vous avez eue de vous montrer et moi avec vous; qui sait ce qui va arriver maintenant?
—Redoutez-vous donc quelque chose, mon père?
—Moi? rien absolument; je crois que nous ferons bien de partir ce soir même.
—Ce soir?
—Ma foi oui, et si vous me le permettez, je vais prévenir Santiago Ramírez de ramener les mules et les chevaux du corral, pendant ce temps, vous fermerez vos malles, de façon que, dans une heure au plus tard, nous pourrons quitter San Luis.
—Je ne comprends rien à cette résolution subite, mon père.
—Il est inutile que vous compreniez, miss, quant à présent du moins: plus tard, dans quelques jours, lorsque nous serons loin d'ici, je vous expliquerai...
—Mais, interrompit-elle, et don Pablo, qui s'est montré si parfait pour nous, que pensera-t-il de ce brusque départ?
—Il en pensera ce qu'il voudra, répondit-il avec un peu d'humeur; d'ailleurs, je laisserai pour lui une lettre dans laquelle je l'avertirai de mon intention de quitter immédiatement la ville, et comme lorsqu'il recevra cette lettre nous serons partis, il sera bien forcé de convenir que je ne l'ai pas trompé.
—Tout cela est bien étrange et m'inquiète réellement, mon père.
—Vous avez tort de vous inquiéter, miss, la chose est au contraire toute simple. Rien ne nous retient ici, n'est-ce pas? donc nous sommes libres d'en sortir quand il nous plaira. Eh bien! Il nous plaît d'en sortir tout de suite, voilà tout. Que trouvez-vous d'étrange dans tout cela? Je le trouve très naturel, moi.
La jeune fille hocha la tête.
—Enfin, murmura-t-elle comme si elle renonçait à découvrir la pensée secrète de son père.
—Ainsi, reprit celui-ci, voici qui est convenu, je vais avertir Santiago.
Il se leva et se dirigea vers la porte. En ce moment deux coups légers furent frappés en dehors.
—Bon, grommela-t-il entre ses dents, qui nous arrive à présent? Puis à voix haute: entrez, ajouta-t-il.
La porte s'ouvrit, don Pablo parut.
—Ah! c'est vous, don Pablo, dit M. Prescott, en prenant subitement son air le plus gracieux, soyez le bienvenu; j'allais envoyer chez vous pour prendre de vos nouvelles, car sans reproches, voici deux jours que nous n'avons eu le plaisir de vous voir.
—Je vous prie d'agréer tous mes regrets pour cette négligence involontaire, Monsieur, et je supplie miss Anna de me pardonner; mais, d'un côté, l'organisation de l'armée, et, de l'autre, l'arrivée de Son Excellence le général Santa-Anna, ne m'ont à mon grand chagrin pas laissé une minute de liberté.
—Je vous dirai comme mon père, don Pablo, soyez le bienvenu, répondit en souriant la jeune fille; vous voilà, vous êtes pardonné.
—Mille fois merci, mademoiselle, vous êtes bonne et charmante comme toujours.
—Ne voulez-vous pas prendre un siège?
—C'est que je n'ai qu'un instant à vous donner, je vous suis envoyé en ambassadeur.
—Hein? fit M. Prescott en dressant l'oreille, en ambassadeur, don Pablo?
—Ma foi, oui, Monsieur.
—Diable! on n'envoie ordinairement d'ambassadeurs qu'aux puissants de la terre et je suis un bien petit compagnon, moi, cher don Pablo, pour qu'on se croie obligé d'agir avec moi de cette façon.
—Vous êtes beaucoup trop modeste, Monsieur, et vous allez le reconnaître si vous me permettez de m'acquitter de la mission ou plutôt du message dont je suis chargé.
—C'est donc sérieux alors? demanda curieusement la jeune fille.
—Tout ce qu'il y a de plus sérieux, miss Anna.
—Voyons ce message, reprit M. Prescott avec un soupir étouffé, car il prévoyait que ses pressentiments allaient se réaliser; mais d'abord asseyez-vous, il n'y a rien de désagréable comme de causer ainsi debout.
—Je vous obéis, répondit le ranchero en se plaçant sur une butaca; je vous dirai tout d'abord, continua-t-il, que j'ai accepté avec un vif plaisir la mission dont on m'a chargé.
—Ah! fit l'Anglais, un peu rassuré par cette entrée en matière, de quoi s'agit-il donc?
—Oh! mon Dieu! de ceci tout simplement: Son Excellence le président passera aujourd'hui même l'armée en revue...
—Jusqu'à présent, interrompit M. Prescott en souriant, je ne vois rien qui nous soit bien personnel.
—Attendez.
—Soit.
—Mais laissez donc parler don Pablo, mon père, dit la jeune fille, avec un geste d'impatience.
—Je suis muet comme un poisson. Continuez, caballero.
Don Pablo s'inclina.
—Ce soir, reprit-il, l'ayuntamiento donne un grand dîner d'étiquette au Cabildo, pour célébrer l'arrivée à San Luis du président de la République.
—Cela est dans l'ordre.
—Ce dîner sera suivi d'un bal, qui se prolongera toute la nuit; les plus jolies femmes de Potosí assisteront à cette fête.
—Bon! grommela l'Anglais à part lui, le serpent commence à paraître sous les fleurs.
Miss Anna ne dit rien, mais elle redoubla d'attention. Don Pablo continua.
—En passant il y a quelques minutes, devant cette maison, dit-il, Son Excellence vous a reconnu, Monsieur Prescott.
—Hum! fit l'Anglais.
—Il a été étonné que vous n'ayez pas songé à vous présenter à lui lors de son arrivée, sachant l'estime profonde qu'il professe pour vous: ce sont les propres expressions de Son Excellence.
—Je suis très flatté de ces paroles, grommela l'Anglais d'un ton bourru; le général me fait trop d'honneur.
—Son Excellence a daigné se plaindre amicalement à moi, de ce qu'il considère comme un oubli de votre part. Mon cher don Pablo, a-t-il ajouté, veuillez, je vous prie, vous rendre auprès de M. Prescott; vous êtes un de ses amis, je crois, votre visite ne pourra que lui être agréable; dites-lui que s'il oublie ses amis, je n'oublie pas les miens, et que le seul moyen qu'il lui reste de se faire pardonner, c'est d'accepter l'invitation que je vous charge de lui faire de ma part, d'assister, ainsi que sa charmante fille, au bal qui a lieu ce soir au Cabildo.
—By God! s'écria l'Anglais en bondissant sur son siège, voilà ce que je craignais! Et il jeta un regard désolé sur sa fille.
—Comment, ce que vous craigniez? se récria don Pablo avec étonnement.
—Certes, reprit-il, et je le craignais si bien, que mon intention formelle est de partir ce soir même, n'est-ce pas, miss?
—Vous me l'avez dit en effet, mon père.
—Vous ne ferez pas cela, Monsieur.
—Et pourquoi ne le ferais-je pas, s'il vous plaît?
—Parce que ce serait blesser gravement Son Excellence le général Santa-Anna, qui, je dois vous en avertir, ne vous pardonnerait pas d'en agir ainsi sans motifs envers lui.
—En effet, mon père, ce que vous dit là don Pablo est sensé, vous êtes trop gentleman pour commettre une telle inconvenance.
—Ta, ta, ta, reprit-il avec obstination, qu'ai-je à faire, moi, étranger, moi, Anglais, avec le président de la République Mexicaine?
—Rien assurément, Monsieur, répondit don Pablo, mais il y a des convenances dont un homme comme il faut, un caballero, comme nous disons ici, ne saurait s'affranchir; et puis, ajouta-t-il d'un ton insinuant, à quoi bon, dans votre position surtout, blesser de propos délibéré un homme tout puissant qui d'un mot tombé de sa bouche peut vous faire repentir de ce manque de procédé?
—C'est vrai, ce n'est que trop vrai, je suis dans une véritable impasse, murmura-t-il avec abattement.
—Dont il vous est facile de sortir, reprit doucement le jeune homme, consentez à ce que le président désire, retardez votre départ d'un jour ou deux s'il le faut, cette preuve de condescendance vous obtiendra la protection efficace du général, et dans les circonstances présentes, cher Monsieur Prescott, vous conviendrez avec moi, que cette protection n'est pas à dédaigner pour vous.
L'Anglais marchait avec agitation dans la chambre.
—Que décidez-vous? reprit au bout d'un instant don Pablo. Quelle réponse donnerai-je au président?
—Eh! by God! que voulez-vous que je décide? suis-je libre de faire selon ma volonté, il faut bien que j'obéisse malgré moi à cet ordre tyrannique.
—Le mot est dur pour le général, cher Monsieur Prescott.
—Pardieu! vous en parlez bien à votre aise, don Pablo, je voudrais vous voir à ma place.
—Mon Dieu, j'accepterais tout simplement l'invitation du général et tout serait fini là.
—Mais, mon père, dit la jeune fille, je ne vois pas ce que vous trouvez de si terrible dans tout cela, moi.
—Bon, miss, répondit-il d'un ton de mauvaise humeur, vous ne pensez qu'au bal, vous, tandis que moi...
—Tandis que vous?
—Je m'entends, Dieu veuille que je m'abuse! Et s'adressant à don Pablo: Puisqu'il le faut, ajouta-t-il, j'accepte la gracieuse invitation de Son Excellence le général.
Ceci fut dit avec une intonation ironique à laquelle il était impossible de se méprendre, mais que le jeune homme feignit de ne pas apercevoir.
—Ainsi, voilà qui est convenu? reprit-il.
—Parfaitement convenu.
—Me permettez-vous de vous servir d'introducteur et de vous venir prendre ici?
—Vous me ferez plaisir, don Pablo.
—Miss Anna, je réclame de vous l'honneur d'être votre cavalier.
—J'accepte, señor, non seulement je vous retiens pour cavalier, mais encore pour danseur, dit-elle en lui tendant gracieusement sa main fine et aristocratique sur laquelle le jeune homme posa respectueusement ses lèvres.
Puis don Pablo prit congé de M. Prescott et de sa fille, et se retira les laissant s'occuper de leurs préparatifs pour le bal du Cabildo.
Lorsqu'il fut seul avec miss Anna, l'Anglais se laissa tomber avec accablement sur une butaca.
—Au diable l'idée que j'ai eue de voir passer ce damné cortège, dit-il, voilà un bal qui me coûtera cher.
Miss Anna, joyeuse comme toutes les jeunes filles de son âge, de la perspective de plaisir qui s'offrait à elle, se retira dans son appartement sans autrement s'inquiéter des doléances de son père, afin de se livrer aux soins si sérieux d'improviser une toilette qui, chose difficile, devait réunir les trois conditions essentielles pour une femme réellement comme il faut: la simplicité, le bon goût et l'élégance.
Maintenant, avouons franchement au lecteur que l'invitation faite par don Pablo ne venait pas directement du président, mais de don Pablo lui-même, et que le général s'était contenté de donner son consentement.
Le jeune homme aimait éperdument miss Anna, et le bal lui aurait semblé bien triste si elle n'y avait pas assisté; il est vrai qu'à part ce motif un peu égoïste, le ranchero en avait un autre plus noble et plus avouable, celui d'amener un rapprochement entre le président et l'Anglais, rapprochement qui, en assurant la protection de Santa-Anna, devait sauver M. Prescott d'une ruine imminente; les Mexicains ne se faisant aucun scrupule, en temps de révolution, de mettre sous séquestre les biens des négociants étrangers fixés dans leur pays, et de considérer ces biens comme étant de bonne prise.
Don Pablo fut ponctuel. A onze heures du soir, accompagné d'une douzaine de rancheros bien armés, il arriva devant la porte de la maison habitée par M. Prescott.
La jeune fille et son père montèrent dans un palanquin amené exprès pour eux. Les rancheros les entourèrent, et les deux étrangers se dirigèrent vers le Cabildo, fendant avec une certaine difficulté la foule joyeuse qui encombrait les rues et les places qu'ils traversaient.
La fête donnée au Cabildo de San Luis de Potosí par le général Santa-Anna, lors de son séjour dans cette ville, où il vint prendre en personne le commandement de l'armée destinée à opérer contre les troupes des États-Unis, est demeurée célèbre, à juste titre, dans les fastes mexicaines, non seulement pour la célérité avec laquelle cette fête fut improvisée, mais encore pour le luxe inouï et inconnu jusqu'à ce jour que le général y déploya.
En effet, jamais vice-roi, lors de la domination espagnole, jamais président, depuis la proclamation de l'indépendance, n'étaient parvenus jusqu'alors à réaliser les enchantements féeriques qui furent ce jour-là improvisés comme par la baguette d'un tout-puissant enchanteur; tenter d'en faire une description serait chose inutile et complètement impossible; nous nous bornerons donc à constater que notre vieille Europe elle-même, si compétente cependant en pareille matière, fut entièrement éclipsée par les splendeurs étranges de cette fête digne des Mille et une Nuits, et qui ressemblaient plutôt au rêve d'une imagination en délire qu'à la réalité.
A minuit, les salons étaient encombrés, les invités se sentant trop à l'étroit, commençaient à entrer dans l'immense jardin du Cabildo, dont les pelouses, les allées et les bosquets, furent bientôt envahis par la foule toujours croissante et qui, folle et rieuse, débordait de toutes parts.
Une illumination féerique en verres de couleur, chargés de devises en l'honneur du président, éclairait la fête. Plusieurs orchestres, composés d'instrumentistes habiles, Italiens pour la plupart et attachés à la suite du général, avaient été distribués dans les salons et sur les pelouses. On dansait un peu partout, alternant les valses et les contre-danses européennes avec les jotas, les tristes, les cachuchas et toutes les autres danses espagnoles et américaines, si voluptueuses et si entraînantes.
Une nuée de valets en grande livrée, chargés d'immenses plateaux d'argent couverts de rafraîchissements de toutes sortes, circulaient incessamment à travers la foule des invités.
Lorsque M. Prescott et sa fille, conduits par don Pablo de Zúñiga, entrèrent dans le Cabildo, la fête était à l'apogée de sa splendeur; le coup d'œil en était si réellement beau, que l'Anglais lui-même en fut ébloui un instant et sentit, sous l'influence de l'admiration qu'il éprouvait, se fondre son flegme britannique. Jamais même à Londres il n'avait assisté à un aussi magique spectacle.
Le général Santa-Anna, sans doute prévenu à l'avance de l'arrivée des étrangers, les attendait dans un premier salon, au milieu d'une foule d'officiers de tous grades, revêtus de magnifiques uniformes; en apercevant M. Prescott, il se dégagea des officiers qui l'entouraient et s'avança vers lui le sourire sur les lèvres.
M. Prescott et sa fille s'inclinèrent respectueusement devant le général et attendirent, selon l'étiquette, qu'il leur adressât la parole.
—Soyez le bienvenu, Monsieur Prescott, dit-il au bout d'un instant, j'ai craint de ne pas vous voir au milieu de nous; ne m'a-t-on pas dit que vous aviez l'intention de quitter San Luis aujourd'hui même?
—En effet, général, telle était ma résolution; mais elle n'a pas tenue devant le désir témoigné par Votre Excellence, et me voilà.
—Je vous en remercie, mon digne ami; votre départ, en nous privant de la présence de votre charmante fille, aurait, croyez-le bien, fort attristé notre fête.
Miss Anna s'inclina sans répondre.
—Messieurs, ajouta le général, j'ai l'honneur de vous présenter M. Prescott, un homme pour lequel j'éprouve une sincère affection, parce que, bien qu'il soit Anglais d'origine, son cœur est réellement mexicain, et son dévouement pour sa patrie d'adoption est sans bornes.
L'insulaire fit une grimace à ce compliment à deux tranchants, qui ressemblait fort à une lettre de change tirée sur sa caisse, et il répondit avec embarras aux compliments empressés des officiers mexicains.
—Donnez-moi votre bras, cher Monsieur Prescott, continua le général, laissez miss Anna aux soins de de don Pablo, et venez avec moi faire un tour dans la fête, nous causerons comme deux vieux amis pendant que la señorita dansera. Caballeros, ajouta-t-il en se tournant vers les officiers de son état-major, prenez part à la fête, divertissez-vous, vous êtes libres.
Les paroles du général, si bienveillantes qu'elles parussent, étaient un ordre auquel il fallait obéir. M. Prescott le comprit, et tout en maugréant intérieurement, il s'exécuta en apparence de bonne grâce.
—Je suis confus d'un tel honneur, général, dit-il en lui donnant son bras, sur lequel le président s'appuya sans façon, cette distinction va me faire bien des ennemis.
—Bah! répondit en souriant Santa-Anna, laissez donc, cher Monsieur Prescott, on sait que je vous aime.
—Don Pablo, reprit l'Anglais, je vous confie miss Anna.
—Elle est sous la sauvegarde de mon honneur, Monsieur, répondit le jeune homme.
—D'ailleurs, dès que le général m'aura rendu ma liberté, je vous rejoindrai.
—Je vous avertis, cher Monsieur Prescott, dit en riant le général, que je compte vous garder le plus longtemps possible; nous avons beaucoup à causer.
Et l'entraînant doucement à sa suite, le président passa dans un autre salon.
Don Pablo et miss Anna demeurèrent seuls, tous les officiers s'étaient dispersés sur l'ordre du général.
Depuis bien longtemps c'était la première fois que les deux jeunes gens se retrouvaient en tête-à-tête; aussi, bien que leur visage fût calme, leur cœur battait fort; ils étaient heureux de se voir ainsi isolés au milieu de cette fête, inaperçus dans la foule, seuls avec leur amour, de ne sentir peser sur eux aucun regard envieux ou jaloux, d'être l'un près de l'autre et de pouvoir, ne serait-ce que pendant quelques minutes, parler ce doux langage de la passion qui monte incessamment du cœur aux lèvres, déborde dans un mot, et lorsqu'on aime réellement, a des mélodies si essentiellement sympathiques, que tout disparaît devant elles, pour ne laisser vivre que le rêve, c'est-à-dire l'amour.
Nos deux jeunes gens errèrent longtemps au bras l'un de l'autre dans les allées ombreuses du jardin, sans songer à la danse qui les conviait, et se murmurant à l'oreille de ces mots sans suite, mais si doux à entendre et à répéter, bien qu'ils soient toujours les mêmes.
Les circonstances étaient graves; selon toutes probabilités la guerre serait rude, ils allaient se séparer dans quelques heures pour ne se revoir que dans bien longtemps; aussi avaient-ils une infinité de choses à se dire. Malgré eux ils étaient tristes, l'avenir leur apparaissait voilé de sombres nuages. Quand finirait cette guerre qui commençait à peine? Comment finirait-elle? M. Prescott consentirait-il à manquer aux engagements qu'il avait pris, et à les unir? Tous ces problèmes, qui se présentaient en foule à leur esprit et auxquels ils n'entrevoyaient aucune solution avantageuse, les inquiétaient gravement, et, par instants, rembrunissaient leur entretien. Mais l'amour reprenait vite le dessus, la foi en l'avenir reparaissait entourée d'une brillante auréole, l'espérance renaissait dans leur cœur, et ils oubliaient les heures qui devaient suivre pour ne songer qu'à l'heure présente, qui les rendait si heureux.
À plusieurs reprises ils avaient de loin entrevu M. Prescott, toujours au bras du général; le regard du pauvre Anglais avait semblé les suivre d'un air de reproche, comme s'il eût imploré leur intervention pour échapper au martyre auquel, depuis son arrivée à la fête, il était condamné; mais l'amour est égoïste, il n'a d'yeux et d'oreilles que pour lui, les deux jeunes gens étaient trop absorbés par leur intéressante conversation pour s'occuper de ce qui se passait autour d'eux. Le monde n'existait plus, ou du moins ils l'avaient tout entier concentré en eux-mêmes, et s'étaient faits aveugles et sourds pour tout ce qui ne se rapportait pas à eux.
Depuis longtemps déjà ils erraient côte à côte, lorsqu'à l'entrée d'un bosquet un domestique en grande livrée leur barra respectueusement le passage.
—Que désirez-vous, mon ami? demanda don Pablo.
—Señor caballero, répondit le valet en s'inclinant, est-ce au colonel don Pablo de Zúñiga que j'ai l'honneur de parler?
—A lui-même, mon ami; ensuite?
—Je suis envoyé à la recherche de Votre Seigneurie par le général don Antonio López de Santa-Anna, qui désire l'entretenir quelques instants.
—C'est bien, mon ami. Et où se trouve en ce moment le général Santa-Anna?
—Son Excellence attend votre seigneurie dans le grand salon des glaces.
—C'est bien, je vous suis; veuillez dire à Son Excellence que dans un instant je serai près d'elle.
Le valet salua respectueusement et se retira.
—Maintenant, chère Anna, ajouta don Pablo, permettez-moi de vous conduire au milieu de la fête, puis je vous quitterai pour me rendre aux ordres du général.
—Pensez-vous donc demeurer longtemps avec lui? répondit-elle.
—Je ne le crois pas; un ordre à me donner pour quelque nouveau corps qui arrive probablement.
—C'est-à-dire...
—C'est-à-dire l'affaire de quelques minutes tout au plus; aller et venir, voilà tout.
—S'il en est ainsi, caballero, il est inutile que vous preniez la peine de me reconduire dans la fête; toute cette foule m'ennuie, me fatigue; laissez-moi ici, je vous attendrai là dans ce bosquet.
Le jeune homme jeta un regard circulaire sur les objets environnants.
—Ce lieu est bien solitaire, dit-il.
—C'est ce que je désire; au moins ainsi personne ne me troublera dans ma rêverie.
—Vous ne serez pas effrayée de demeurer ainsi seule au fond de cette huerta immense?
—Effrayée de quoi, don Pablo? Qu'ai-je à redouter ici? D'ailleurs, ne m'avez-vous pas dit que vous resteriez à peine quelques minutes absent?
—C'est vrai.
—Ainsi?
—Puisque vous le désirez, je pars.
—Allez, caballero, je compterai les secondes en vous attendant, répondit-elle avec un doux sourire.
—Vous êtes charmante, dit-il en lui baisant la main; à bientôt.
Et il s'éloigna presqu'en courant, tant il avait hâte d'être de retour.
La jeune fille le suivit des yeux un instant, puis elle entra dans le bosquet et s'assit sur un banc de marbre qui en occupait le fond.
Ce bosquet, formé avec des liquidambars était extrêmement touffu, quelques verres de couleur placés çà et là au milieu des feuilles, y répandaient une lumière douce et mystérieuse; les bruits de la fête y parvenaient à peine, leur éclat était brisé, ils semblaient mourir en un murmure indistinct à travers l'épaisse muraille de verdure qui en absorbait les sons.
Quelques minutes s'écoulèrent pendant lesquelles la jeune fille se laissa voluptueusement aller au charme indicible de causer avec son cœur, en récapitulant tous les éblouissements de cette délicieuse soirée pendant laquelle rien n'avait fait ombre à son amour.
Tout à coup un pas léger fit craquer le sable d'une allée à quelques pas d'elle.
Un homme entra d'un pas rapide dans le bosquet. Miss Anna releva vivement la tête, un cri étouffé s'échappa de sa poitrine, et elle fit un mouvement pour se lever.
—Eh quoi! dit d'une voix railleuse l'homme qui venait de s'introduire si à l'improviste dans le bosquet, en suis-je donc à mon insu arrivé à ce point que ma présence seule cause un si grand émoi à miss Anna, que sa première pensée en m'apercevant soit de me fuir.
La jeune fille était d'une race vaillante, l'éducation qu'elle avait reçue l'avait habituée à compter sur elle-même; la première émotion causée par la surprise, apaisée, elle avait repris son calme et son sang-froid.
—En effet, répondit-elle, j'ai eu tort. Qu'ai-je à redouter de vous, Monsieur? pardonnez-moi un mouvement involontaire, je ne vous avais pas reconnu.
—Et maintenant que vous m'avez reconnu, dit-il avec intention.
—Maintenant, Monsieur de Clairfontaine, si je crains, c'est pour vous et non pour moi.
—Je vous remercie de cette sollicitude, mademoiselle, dit-il avec amertume.
—Votre présence ici, n'est-elle pas un danger pour vous?
—Oui, mademoiselle, mais ce danger je l'ai bravé pour vous entretenir un instant sans témoins.
—Saviez-vous donc me rencontrer ici, Monsieur?
—Depuis votre entrée au Cabildo, perdu dans la foule de vos admirateurs, reprit-il avec ironie, je vous suis pas à pas.
—Il est malheureux, Monsieur, répondit-elle sèchement, que cet entretien que vous paraissez si vivement désirer, je ne puisse vous l'accorder.
—Me sera-t-il permis de vous demander pour quel motif, mademoiselle?
—Il est de mon devoir de vous les faire connaître.
—Ah! il y en a plusieurs?
—Il y en a deux.
—J'écoute.
—Écoutez-donc, soit, puisque vous l'exigez.
—Je n'exige pas, mademoiselle, je prie.
—Votre prière ressemble tellement à un ordre, Monsieur, qu'il est facile de s'y tromper; j'attends une personne qui m'a quittée il y a quelques instants, et peut revenir d'un moment à l'autre.
—Cette personne ne reviendra pas aussi vite que vous l'espérez, mademoiselle; c'est moi qui ai fait prévenir don Pablo de Zúñiga que le général Santa-Anna le demandait, ce qui est faux, mais don Pablo sera retenu assez longtemps loin de vous pour me permettre de vous entretenir sans craindre d'être interrompu.
—Un guet-apens! s'écria-t-elle.
—Rassurez-vous, mademoiselle, une supercherie tout au plus, aucune violence ne lui sera faite, il sera ici avant une demi-heure; donc, si vous n'avez que ce motif...
—Pardonnez-moi, j'en ai un autre encore.
—C'est juste, je l'avais oublié.
—Monsieur de Clairfontaine, j'ai toujours été franche avec vous, cette fois encore je veux l'être; la première fois que dans la maison de mon père vous m'avez parlé des arrangements pris entre nos deux familles et de l'amour que vous éprouviez pour moi, je vous ai répondu...
—Vous m'avez répondu, mademoiselle, interrompit-il froidement: Monsieur Williams Stuart de Clairfontaine, les arrangements dont vous parlez ont été pris par nos deux familles, sans qu'on ait daigné me consulter. Mon cœur appartient à un autre; je ne puis vous épouser, je ne vous aime pas, et je ne vous aimerai jamais; je répète textuellement vos paroles, n'est-ce pas, mademoiselle?
—Eh bien! que voulez-vous donc de moi, Monsieur, et pourquoi avez-vous cherché cet entretien?
—Ah! ah! fit-il avec un rire nerveux, c'est que la réponse que je ne vous avais pas donnée alors, il faut que vous l'entendiez.
—Il faut? s'écria-t-elle en se levant hautaine et superbe.
—Je l'ai dit, répondit-il en s'inclinant sans faire un geste pour la retenir; moi aussi, mademoiselle, je veux être franc et loyal avec vous.
—Parlez donc, puisque je suis contrainte de vous entendre. Aussi bien, mieux vaut en finir une fois pour toutes, et que nous sachions l'un et l'autre à quoi nous en tenir.
—Cela vaut mieux en effet, mademoiselle; mais rassurez-vous, je serai bref, je n'ai plus que quelques minutes à demeurer près de vous.
—J'écoute, dit-elle froidement.
—Mademoiselle, à mon arrivée à México, je ne vous avais jamais vue, je venais, résolu à dégager la parole donnée par mon père; en vous épousant, je ne pouvais donc vous aimer encore, puisque je ne vous connaissais pas. Vous auriez, peut-être réussi à me faire consentir à renoncer à ce mariage, cela dépendait presque entièrement de vous.
—Comment cela, Monsieur? s'écria-t-elle intéressée malgré elle par ses paroles.
—Oh! bien facilement, mademoiselle, répondit-il avec une nuance de tristesse, vous n'aviez pour cela qu'à me considérer comme un galant homme qu'on estime, comme un ami, à vous confier à ma loyauté, m'avouer votre amour pour un autre, et vous auriez trouvé en moi un auxiliaire et au besoin un défenseur.
—Mais n'est-ce pas cela que j'ai fait?
—Oui; mais de quelle façon, mademoiselle, en vous faisant dès le premier jour mon ennemie et en me donnant publiquement les marques du plus écrasant mépris.
—Monsieur!
—Pardonnez-moi, mademoiselle, cette explication n'est pas complète, je n'ai pas terminé.
—Parlez, Monsieur.
—Je suis doué d'une malheureuse nature, mademoiselle, je vous l'avoue humblement; tout ce qui froisse mon orgueil me cause des blessures incurables; plus on veut m'abaisser plus je me relève, je suis un de ces hommes que la lutte attire malgré eux, qui n'admettent pas le mot impossible, et qui, dès qu'ils voient un obstacle, si formidable qu'il soit en apparence, se dresser devant eux, prennent aussitôt la résolution de le renverser, dût-il leur en coûter la vie. Vous m'avez dit que vous ne m'aimeriez jamais. Eh bien! moi, mademoiselle, je vous dis aujourd'hui que je vous aime; cet amour me dévore: c'est plus que de la passion, c'est du délire, de la folie.
—Monsieur! s'écria-t-elle avec épouvante.
—Oh! ne craignez rien de moi, mademoiselle, je suis gentleman; j'ai bravé les plus grands périls pour parvenir jusqu'à vous! J'ai voulu répondre à votre loyauté par une loyauté égale en vous disant: Miss Anna Prescott, je vous aime, et je vous épouserai! Malgré tous, malgré vous-même s'il le faut! Je l'ai résolu, et ce sera, dussé-je pour y parvenir y perdre ma vie et mon honneur!
—Oh! Monsieur, vous me faites peur.
—Tant pis pour moi, mademoiselle, répondit-il avec une mordante ironie, Dieu m'est témoin que ce n'est pas ce sentiment que je désire vous inspirer.
—Retirez-vous, Monsieur, retirez-vous, je ne veux pas vous écouter davantage, vos paroles sont horribles.
—Maintenant que je vous ai tout dit, je me retire, mademoiselle, bientôt j'aurai l'honneur de vous revoir.
—Vous? oh! jamais! jamais!
—Vous vous trompez, mademoiselle, reprit-il d'une voix railleuse, nous nous reverrons et cela avant quinze jours! au revoir donc!
Il s'inclina devant la jeune fille atterrée et s'élança hors du bosquet.
Presque aussitôt un bruit de pas précipités se fit entendre, et don Pablo parut.
—Miss Anna! Miss Anna! s'écria-t-il.
—Me voilà! me voilà! répondit-elle en courant à sa rencontre et s'appuyant sur son bras pour ne pas tomber.
—Qu'avez-vous, au nom du ciel! Que vous est-il arrivé?
—Rien, don Pablo, rien, venez, venez.
—Vous tremblez, votre visage est pâle comme celui d'un cadavre, vous êtes sur le point de vous évanouir.
—Non, ce n'est rien, je vous jure, l'odeur de ces fleurs peut-être, venez, sortons d'ici.
—Où voulez-vous aller, en l'état où vous êtes?
—N'importe où, don Pablo, pourvu que nous ne demeurions pas un instant de plus ici.
Ils sortirent du bosquet.
Miss Anna jeta un regard effrayé autour d'elle, tout était calme, silencieux et solitaire.
—Vous me cachez quelque chose, miss Anna, reprit don Pablo; que vous est-il donc arrivé pendant mon absence?
—Mais rien, je vous assure, répondit-elle en essayant de sourire; mais comme vous êtes demeuré longtemps absent, je ne sais pourquoi, je me suis sentie inquiète, et j'ai... eu presque peur; j'étais folle... Je suis complètement remise maintenant.
—Est-ce bien vrai, miss Anna?
—Oui, don Pablo, et puis, je ne sais, il m'a semblé apercevoir un homme qui me regardait à travers les feuilles, ma tête s'est perdue; voilà tout, don Pablo.
—Et cet homme l'avez-vous reconnu?
—Comment cela aurait-il été possible, je ne suis même pas sûre de l'avoir vu. Oh! j'aurais mieux fait de ne pas venir à cette fête.
—Ah! vous voyez bien qu'il vous est arrivé quelque chose! Maudits soient les mauvais plaisants qui m'ont forcé à vous quitter et m'ont retenu si longtemps loin de vous, miss Anna.
—Ainsi le général...
—Le général n'a pas su ce que je voulais lui dire, il m'a ri au nez.
—Et mon père!
—Votre père n'a pas quitté le général.
—Conduisez-moi vers lui, don Pablo, je désire me retirer.
—Déjà, miss Anna? dit-il avec résignation.
—Oui, vous me pardonnerez, n'est-ce pas, don Pablo, mais je ne sais ce que j'éprouve, je ne me sens pas bien.
—Je vous obéis, miss Anna.
Ils marchèrent silencieusement auprès l'un de l'autre, traversèrent la foule des invités sans même les voir, et entrèrent dans le Cabildo.
M. Prescott fut charmé du désir que témoignait sa fille de se retirer immédiatement, et il se hâta de l'emmener.
Don Pablo les accompagna jusqu'à leur maison, puis il prit congé d'eux et retourna auprès du président.
—Je saurai ce qui s'est passé, murmura-t-il en montant tout rêveur les marches du Cabildo, il faudra que miss Anna me le dise! Pauvre Anna! N'est-ce donc pas moi qui dois la défendre!
Quatre jours s'étaient écoulés depuis la fête splendide donnée au Cabildo de San Luis de Potosí, en l'honneur du président de la République mexicaine; Santa-Anna pressait l'organisation de son armée dont les divers corps continuaient à se grouper autour de la ville.
Un lundi, vers dix heures du matin, trois personnes étaient attablées et déjeunaient ou plutôt faisaient semblant de déjeuner dans la salle à manger de la maison habitée par M. Prescott.
Ces trois personnes, dont le lecteur a sans doute déjà deviné les noms, étaient M. John Prescott lui-même, sa fille miss Anna, et le colonel des rancheros, don Pablo de Zúñiga.
Malgré l'apparence appétissante des mets étalés avec profusion sur la table, les convives ne mangeaient que du bout des lèvres; les plats retournaient à l'office intacts pour la plupart; miss Anna, le visage pâle, les sourcils froncés, jouait machinalement avec son couteau, sans paraître entendre un seul mot de ce que disait son père et son convive, tant était profonde la méditation dans laquelle elle était plongée.
Cependant la conversation était animée entre les deux hommes et montée sur un diapason qui, en toute autre circonstance, aurait probablement motivé son intervention, car chacun des deux interlocuteurs s'échauffait de plus en plus et soutenait son opinion par des arguments qui motivait parfois de vertes répliques, si bien que la conversation, entamée sur un ton assez froid, mais cependant presque amical, s'aigrissait de plus en plus et menaçait, si elle se prolongeait pendant quelques instants encore, de dégénérer en querelle, ce qui pouvait amener de très graves complications entre nos trois personnages.
—Ainsi vous partez? dit don Pablo.
—Aujourd'hui même, dans quelques instants, répondit M. Prescott d'un ton bourru; plût au ciel que je ne fusse jamais venu dans cette ville maudite! Ah! c'est à vous que je dois cela, cher don Pablo, je m'en souviendrai, mon ami.
—Mais expliquez-vous donc, señor, reprit le jeune homme avec un commencement d'impatience. Voici une demi-heure que vous m'accablez de récriminations qui sont de l'hébreu pour moi.
—Oui, oui, vous feignez de ne pas me comprendre.
—Sur mon honneur, j'ignore entièrement les motifs qui vous font me parler ainsi.
—Bien vrai? dit-il en ricanant.
—Je vous le répète.
—Voilà qui est fort, par exemple.
—C'est possible, mais c'est ainsi.
—Vous ignorez la visite que j'ai reçue ce matin?
—Moi? Et comment voulez-vous que je sache si vous avez reçu des visites?
—Bon... Vous ne connaissez point le général Ochoa?
—Certes, je connais le général Ochoa, beaucoup même... Mais quel rapport?
—Un intime, cher Monsieur, puisque c'est lui qui est venu.
—Ah! Vous êtes donc lié avec lui.
—Moi? Dieu m'en garde.
—Pourquoi donc? c'est un homme comme il faut, un brave militaire.
—Oui, oui, fit-il en ricanant, un homme comme il faut, un brave militaire, qui m'a emporté cent mille piastres.
—Cent mille piastres! Le général Ochoa?
—Hélas! oui, tout autant; il est vrai que ce n'est pas en son nom qu'il me les a demandées.
—Ah! et au nom de qui?
—Au nom du général Santa-Anna, président de la République mexicaine. Que dites-vous de cela señor don Pablo?
—Je dis que je suis confondu, et que je comprends moins que jamais.
—Vous y mettez de la mauvaise volonté alors, car la chose est toute simple: S. Exc. le président de la République, mon ami, ainsi qu'il s'intitule, m'emprunte cent mille piastres pour prix de la protection qu'il m'accorde. Elle est jolie, n'est-ce pas, sa protection!
—Cet argent n'est pas perdu pour vous, il vous sera intégralement rendu.
—Ce n'est pas mon avis; voici le troisième emprunt que la République mexicaine me fait l'honneur de contracter avec moi le couteau sur la gorge, et je n'ai jusqu'à présent jamais entendu parler de remboursement.
—Auriez-vous la pensée que Son Excellence ait l'intention de ne point vous payer?
—J'ignore quelle est à ce sujet la pensée de Son Excellence; mais comme je ne veux pas m'exposer à un nouvel emprunt, je pars, et tout de suite.
—Vous avez tort, vous étiez en sûreté ici.
—Oui, comme dans une caverne; je ne demeurerai pas une heure de plus à San Luis.
—Soit, partez donc, puisque vous le voulez absolument.
—Vous aurait-on donné la mission de me retenir, par hasard?
—On ne m'a donné aucune mission auprès de vous.
—Vous me rassurez.
—Seulement, dans votre intérêt et à cause de l'amitié que j'ai pour vous, je me permets de vous engager à différer votre départ de quelques jours.
—Pour quelle raison?
—Parce qu'en ce moment les routes sont infestées de bandits de toutes sortes, et que vous risquez d'être dévalisé.
—J'en courrai les risques.
—Assassiné, peut-être.
—Tant pis pour moi.
—Mais votre fille?
—Ma fille... ma fille...
—Oui, vous ne pouvez pas l'exposer aux dangers d'un voyage fait dans de si mauvaises conditions, et qui présente des fatigues et des périls sans nombre.
—Ma fille est accoutumée à me suivre partout où je vais; quant aux dangers dont vous parlez, je n'y crois pas; d'ailleurs, je ne suis pas seul; j'ai avec moi une dizaine de peones dévoués, braves, et surtout bien armés, qui n'hésiteront pas à me défendre si on m'attaque.
—C'est de la folie, señor, croyez-moi, réfléchissez avant de prendre une résolution.
—Elle est prise d'une manière irrévocable.
—C'est votre dernier mot?
—Le dernier, oui.
—Puisqu'il en est ainsi, accordez-moi une grâce.
—Hum, voyons cette grâce, don Pablo; je vous avoue que depuis ma dernière entrevue avec le président, ma confiance en vous a considérablement diminué.
—Me rendez-vous donc responsable de ce qui s'est passé?
—Pardieu! qui donc m'a conduit ici, s'il vous plaît? Mais ne revenons plus sur ce sujet, je vous prie; voyons, finissons-en, que me demandez-vous?
—L'autorisation de vous faire escorter jusqu'à l'endroit où vous avez l'intention de vous rendre, par quelques-uns de mes cavaliers.
—Je vous remercie cordialement, don Pablo, mais je refuse.
—Vous refusez?
—Cela vous étonne?
—Au dernier point, Monsieur.
—J'en suis fâché, mais je ne veux plus, autant du moins que cela me sera possible, avoir le moindre rapport avec tout ce qui touche à l'armée mexicaine, officiers ou soldats; cher don Pablo, ajouta-t-il en se levant de table, excusez-moi si je vous laisse pour terminer mes préparatifs de départ.
—Vous me renvoyez?
—Nullement, restez, au contraire; pendant mon absence vous tiendrez compagnie à ma fille et vous lui ferez vos adieux, car si j'en crois mes pressentiments, il s'écoulera un laps de temps assez long avant que vous la revoyiez.
Ces dernières paroles furent prononcées avec une intention ironique qui n'échappa point au jeune homme et le remplit d'inquiétude.
L'irascible vieillard fit un léger salut, tourna sur les talons et passa dans une autre pièce, laissant les deux jeunes gens seuls.
—Au nom du ciel! s'écria don Pablo que signifie la conduite étrange de votre père avec moi, miss Anna?
La jeune fille releva sa tête languissante, se tourna vers don Pablo, et d'une voix triste elle répondit:
—Mon père est convaincu que vous êtes, sinon complice, du moins cause de la demande d'argent qui lui a été faite par le président Santa-Anna; voilà d'où provient sa colère.
—Mais c'est faux, je vous le jure.
—Je le sais, don Pablo; malheureusement, vous connaissez le caractère opiniâtre de mon père; aucun raisonnement ne le fera changer d'avis.
—Ce n'est que trop vrai; moi qui étais si heureux!
—Hélas! vous avez entendu, don Pablo, il faut nous séparer. Dieu sait quand nous nous reverrons, et si nous nous reverrons jamais.
—Votre père a-t-il donc l'intention de quitter le Mexique?
—Je le crains, don Pablo, bien qu'il ne cause que très rarement et fort peu avec moi, j'ai cru comprendre qu'il voulait réaliser sa fortune et abandonner ce pays, où, dit-il, toute sécurité est impossible.
—Ah! Miss Anna, c'est porter un jugement trop sévère sur une malheureuse contrée, sans cesse bouleversée, il est vrai, par des révolutions, mais qui cependant offre toujours une loyale protection aux étrangers qui l'habitent; mais cette discussion nous entraînerait trop loin, et le temps nous presse. Avez-vous toujours la même confiance en moi, miss Anna?
—En doutez-vous, don Pablo? répondit-elle en lui tendant la main avec abandon.
—Ainsi, vous ne partagez pas les préventions de votre père?
—Oh! non, don Pablo, je vous crois, au contraire, dévoué et loyal.
—Merci, miss Anna; puisqu'il en est ainsi, vous ne refuserez point de me faire connaître l'endroit où votre père compte se rendre?
—Non don Pablo, car je vous l'avoue, ce voyage m'effraie.
—Pourquoi partez-vous alors?
—Puis-je faire autrement, ne suis-je pas contrainte de me courber sous la volonté de mon père?
—C'est vrai, pauvre enfant; mais, rassurez-vous, je veillerai de loin sur vous, et, tout en demeurant invisible, je saurai vous protéger de façon à éloigner tout péril.
—Merci, don Pablo, dit-elle avec effusion; je savais bien que vous ne m'abandonneriez pas, malgré la mauvaise humeur de mon père contre vous, et la querelle injuste qu'il vous a faite.
—Moi, vous abandonner, señorita! que m'importe l'humeur d'un vieillard atrabilaire que l'avarice rend injuste! Je vous aime, miss Anna et, quoi qu'il arrive, je vous défendrai contre votre père lui-même, s'il le faut; mais il ne tardera pas à rentrer dans cette pièce, veuillez me nommer la ville dans laquelle il va chercher un refuge.
—Nous partons pour Tampico de Tamaulipas.
—Tampico? plus de doutes, alors; son intention est de quitter le Mexique! N'importe, je veillerai sur vous. Soyez donc sans craintes; cela me sera d'autant plus facile que cette direction est à peu près celle que prendra l'armée.
En ce moment, M. Prescott reparut.
—Eh bien! don Pablo, dit-il, vos adieux sont-ils terminés?
—Ils le sont, oui, Monsieur; il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous, avec le regret de vous voir d'une façon si blessante refuser mes offres de services.
—Ne m'en veuillez pas, don Pablo, il le faut; d'ailleurs, ne faites-vous pas partie de l'armée mexicaine?
—Vous le savez aussi bien que moi, Monsieur.
—Votre devoir exige donc que vous demeuriez auprès de votre général; ce serait y manquer, et par conséquent vous attirer de graves reproches de la part de vos chefs, que de me suivre dans un voyage qui peut durer très longtemps et vous empêcher de vous trouver à votre poste lorsque commenceront les hostilités.
—Mais, Monsieur, permettez-moi de vous expliquer...
—Rien, don Pablo, l'honneur vous ordonne de demeurer ici; moi, ma sûreté exige que j'en sorte le plus tôt possible; n'insistez donc pas sur ce sujet, mon parti est pris; ainsi, séparons-nous, voici ma main, adieu.
—Adieu donc, Monsieur, puisque vous l'exigez; ne me donnerez-vous pas de vos nouvelles?
—Je n'ose vous le promettre; les communications, déjà fort difficiles en ce moment, le deviendront sans doute beaucoup plus d'ici à quelques jours, peut-être seront-elles totalement interrompues; je ne saurais donc prendre aucun engagement à cet égard.
—Que votre volonté soit faite, Monsieur; excusez-moi d'avoir autant insisté, je me retire, adieu. Adieu, miss Anna, je prie Dieu qu'il vous protège pendant le périlleux voyage que vous allez entreprendre.
—Merci, caballero; Dieu ne nous abandonnera pas, j'en ai l'espoir.
Le jeune homme prit alors congé, il salua une dernière fois M. Prescott, porta à ses lèvres la main que lui tendait miss Anna, en détournant la tête pour cacher ses larmes; et il se retira le désespoir dans le cœur.
Lorsque le galop du cheval sur lequel s'éloignait don Pablo eut cessé de retentir en se confondant avec les autres bruits de la ville, miss Anna, qui, pendant les quelques minutes qui s'étaient écoulées était demeurée immobile et anxieuse, se leva, salua silencieusement son père, et, pâle et froide, elle traversa la pièce d'un pas de statue et se renferma dans son appartement.
—Oh! oh! murmura à part lui M. Prescott, en suivant sa fille du regard, aurais-je été trop loin, et la chose serait-elle plus sérieuse que je ne le croyais d'abord?
M. Prescott, de même que tous les esprits entiers et irascibles, lorsque, ce qui lui arrivait souvent, il s'était laissé emporter à la violence de son caractère, ne tardait pas à se repentir de ce qu'il avait fait; il comprenait avec une lucidité extrême l'injustice de sa conduite, et il aurait alors donné beaucoup pour que ce qui s'était passé ne fût pas arrivé; mais l'orgueil l'empêchait de convenir de ses torts, et tout en sachant qu'il était engagé dans une voie mauvaise, il y persévérait avec une opiniâtreté d'autant plus grande qu'il était secrètement honteux de s'être lui-même placé dans une position fausse, dont il ne savait plus comment sortir sans exciter les railleries de ceux qui l'entouraient et sans rougir aux yeux de sa fille.
Cette fois, comme dans bien d'autres circonstances, il n'hésita pas à convenir avec lui-même que, dans la querelle absurde qu'il avait faite à don Pablo de Zúñiga, tous les torts étaient constamment demeurés de son côté; que le jeune homme n'avait cessé de conserver vis-à-vis de lui la plus grande mesure et le plus profond respect; qu'il n'était aucunement cause de ce qui s'était passé entre lui et le général, et, qu'en somme, les offres qu'il lui avait faites, méritaient d'être prises en considération et non reçues avec mépris.
M. Prescott savait au moins aussi bien que don Pablo combien le voyage qu'il entreprenait était dangereux, et de quel secours lui aurait été, pour sa sûreté et celle de sa fille, une escorte de cavaliers dévoués, sur des routes infestées de bandits et rendues plus périlleuses encore en ce moment par la concentration des troupes mexicaines dans les provinces mêmes qu'il était contraint de traverser pour se rendre à Tampico de Tamaulipas, le port de l'Océan le plus rapproché du lieu ou il se trouvait.
Toutes ces réflexions et bien d'autres encore se présentèrent en foule à son esprit; mais il les repoussa opiniâtrement.
—Après tout, murmura-t-il, à la grâce de Dieu! J'ai dit que je partirais, je partirai quoi qu'il puisse arriver, et cela tout de suite, afin de montrer que je suis homme de parole, et que, dès que j'ai pris une résolution, je l'exécute.
Alors sans plus tarder, avec une ardeur fébrile qui montrait clairement la mauvaise humeur dont il était intérieurement dévoré, il termina ses préparatifs, en faisant ramener les mules et les chevaux du corral et charger ses bagages.
Les choses furent menées avec une rapidité si grande que, vers deux, heures de l'après-dînée, il quittait San Luis de Potosí et prenait au grand trot le chemin de Tampico.
Sa troupe se composait de douze hommes bien armés, résolus en apparence à se bien défendre en cas d'attaque; le mayordomo Santiago Ramírez marchait en avant pour éclairer la route.
M. Prescott et sa fille montés sur des mules d'amble se tenaient au milieu des peones.
Depuis sa sortie de San Luis, la jeune fille n'avait pas prononcé une parole, le vieillard était pensif, inquiet, et plus il s'éloignait de la ville, plus il regrettait de l'avoir quittée; mais pour rien au monde il n'aurait consenti à tourner bride et à revenir sur ses pas.
C'était le soir, entre Dolores et El Miaz, petites villes de l'État de San Luis, qui, en France, passeraient tout au plus pour de grands villages, en pleine Cordillères sur les flancs d'un canyon étroit, bordé de bois touffus, de mezquite et des liquidambars, au milieu d'une clairière complètement dissimulée par le fouillis de plantes de toutes sortes, qui lui formaient de tous côtés une impénétrable muraille de verdure; douze ou quinze individus à faces patibulaires et aux guenilles sordides, mais armés jusqu'aux dents, soupaient de bon appétit autour d'un feu de veille, allumé pour éloigner les bêtes fauves et combattre le froid piquant de la nuit dans les montagnes, tandis que leurs chevaux, attachés à des piquets, broyaient à pleine bouche une copieuse provende d'herbe fraîche et de maïs.
Ce campement était tout simplement une halte de salteadores; parmi ces bandits se trouvaient deux de nos connaissances, les señores Trabuco et Matadiez, rendus méconnaissables par les élégants costumes de campesinos, tout en drap et en velours de première qualité, qui avaient remplacé les loques informes dont nous les avons précédemment vus revêtus.
Ces deux dignes personnages semblaient jouir d'une certaine considération parmi leurs compagnons qui ne leur adressaient la parole qu'avec force témoignages de respect, leur obéissaient au moindre signe, leur réservaient la meilleure place au feu et leur laissaient prendre les plus savoureux morceaux, ne se servant que lorsque les deux caballeros, si étrangement privilégiés, avaient terminé leur repas.
Du reste, rendons cette justice à ces honorables caballeros, de constater qu'ils n'abusaient en aucune façon de l'ascendant qu'ils possédaient sur leurs compagnons, et qu'ils étaient, au contraire, d'une courtoisie parfaite et d'une aménité patriarcale dans leurs rapports avec eux.
Le souper s'était terminé juste au coucher du soleil; les bandits avaient alors fait leurs préparatifs pour passer la nuit le plus confortablement possible; les uns avaient donné la provende aux chevaux, les autres apporté du bois pour entretenir les feux de veille; deux sentinelles avaient été placées, soit pour guetter l'approche des rôdeurs suspects, hommes ou fauves, soit pour veiller dans les ténèbres au salut général; puis tous ces devoirs accomplis, les bandits libres de tous soins s'étaient accommodés à leur guise autour des feux, les uns s'étaient étendus sur le sol et roulés dans leurs zarapés, n'avaient point tardé à s'endormir d'un calme et paisible sommeil; d'autres avaient allumé leurs papelitos et fumaient avec cette béatitude extatique qui caractérise tous les hommes de la race méridionale; quelques-uns enfin, sortant du fond de leurs poches des jeux de cartes crasseux et usés par l'usage, taillaient un monte effréné; bref, le camp offrait l'aspect pittoresque d'une de ces haltes de bandits ou de bohémiens que le crayon humoristique de Callot et le pinceau puissant de Salvator Rosa ont si magistralement fixées sur la toile, ou jetées sur le papier.
Le seigneur Matadiez et son digne collègue, le seigneur Trabuco, assis un peu à l'écart sous l'abri protecteur d'un jacal, que leurs subordonnés avaient construit afin de garantir leurs précieuses personnes contre l'atteinte de la froide rosée de la nuit, causaient entre eux tout en s'envoyant réciproquement au visage les formidables bouffées de fumée bleuâtre, qu'avec une régularité mathématique, ils aspiraient de leurs élégants pajillos.
—Vous conviendrez avec moi, señor Matadiez, disait le señor Trabuco, que la vie que nous menons ici n'a rien de fort agréable, et que, pour peu qu'elle se prolonge quelques jours encore, nous sommes exposés à mourir, sinon de faim, mais tout au moins d'ennui.
—Je partage complètement votre avis, mon cher compère et honorable ami, répondit Matadiez en hochant la tête d'un air significatif; notre existence au milieu de ces montages sauvages, en compagnie de gens ignorants et bornés, n'est nullement récréative; mais, qu'y faire? Patience, cela ne saurait longtemps durer encore.
—Le ciel vous entende, cher compère! car je vous avoue que s'il me fallait demeurer seulement trois jours de plus ici, malgré la riche récompense, qui nous est promise, j'abandonnerais la partie, tant je sens l'ennui et le dégoût me monter au cerveau.
—D'un moment à l'autre nous aurons des nouvelles, ceux que nous attendons doivent depuis plusieurs jours déjà avoir quitté San Luis et ils ne sauraient être loin.
—Ah! çà, vous êtes-vous bien entendu avec l'homme qui nous emploie? Est-ce un caballero sur lequel on puisse compter?
—Je le crois, il m'a été présenté par une personne dans laquelle j'ai toute confiance, et qui m'a répondu de lui sur son honneur et corps pour corps. D'ailleurs, nos conventions sont, comme vous le savez, d'une simplicité biblique; cher compère: nous livrons la marchandise et nous sommes payés sur l'heure.
—Je ne comprends pas d'autres façons de traiter les affaires.
—Ni moi non plus; de cette manière, on évite des contestations souvent très désagréables.
—Quelle espèce d'homme est ce caballero?
—Lequel? celui qui nous emploie?
—Oui.
—Ma foi, je vous avoue que je l'ignore.
—Comment! vous l'ignorez?
—Oui; voici comment les choses se sont passées: il y a quelques jours, l'ami dont je vous ai parlé me fit prier de passer chez lui pour causer d'une affaire importante. A l'heure indiquée, je fus exact au rendez-vous: mon ami m'attendait. Après l'échange des premiers compliments, il me présenta au caballero, qui se tenait silencieux auprès de lui comme étant la personne qui désirait traiter avec moi.
—Vous l'avez vu, alors?
—Oui et non.
—Comment! oui et non; je vous avoue que je ne comprends plus.
—Vous allez me comprendre à l'instant, cher compère.
—Je vous avoue que je n'en serai pas fâché; je déteste les énigmes.
—Moi de même, n'ayant jamais eu le talent d'en deviner une seule; ce caballero était enveloppé jusqu'aux yeux dans un grand manteau; les ailes de son chapeau étaient soigneusement rabattues sur son visage, et, par excès de précautions sans doute, il portait un loup de velours par les trous duquel on voyait des yeux qui ressemblaient à des charbons ardents.
—Voilà qui est étrange! ce caballero voulait sans doute garder l'incognito.
—C'est ce que j'ai supposé, et comme je me pique avant tout d'être homme du monde, j'ai compris qu'il serait de mauvais goût de montrer une curiosité indiscrète, et je n'ai pas insisté.
—Vous avez agi en véritable caballero, cher compère; seulement, je me permettrai de vous faire observer que vous avez peut-être été un peu léger en cette circonstance.
—Le croyez-vous? fit-il en riant. Vous allez en juger: Après avoir poliment salué l'inconnu, je me tournai vers mon ami:—Ce señor désire garder l'incognito? lui dis-je.—Oui, me répondit mon ami. Cela vous déplaît-il?—A moi, personnellement, en aucune façon. Je suis d'avis que chacun est libre d'agir à sa guise et de traiter les affaires comme il l'entend.—A la bonne heure! s'écria joyeusement mon ami; vous êtes bien l'homme qu'il nous faut. Que vous ai-je annoncé? continua-t-il, en se tournant vers l'inconnu, toujours silencieux à son côté. Je saluai comme je le devais à ce compliment, et je repris: Malheureusement pour moi, je ne suis pas seul. Les caballeros qui m'accordent leur confiance ont besoin d'une garantie; ce sont mes associés, je dois leur rendre compte de ma conduite. Que leur dirai-je? que je ne sais avec qui je traite? Ils me tourneront le dos en me riant au nez, et me planteront là. Les choses ne peuvent donc s'arranger ainsi; il faut avant tout nous entendre.—Cela sera facile, señor, dit alors l'inconnu d'une voix hautaine. Quel est le nombre des drôles que vous commandez?
—Pardon, señor, répondis-je, justement froissé du ton de l'inconnu et des expressions impropres dont il s'était servi, mes associés sont de très honorables caballeros, avantageusement connus, et non des drôles.
—Bien répondu, par mon âme! s'écria le señor Matadiez en se frottant les mains.
—Peu importe, reprit sèchement l'inconnu; combien sont-ils?—Ma foi, cher compère, comme le nombre ne me revint pas tout de suite à la mémoire, à tout hasard je le doublai. Vingt-cinq, répondis-je.—Soit, dit-il; et, retirant une bourse de dessous son manteau: Prenez, ajouta-t-il en me la présentant; cette bourse contient cent onces, vous en disposerez comme vous le jugerez convenable, ce sont les arrhes de notre marché. Avez-vous d'autres observations à me faire? ou bien croyez-vous maintenant pouvoir, sans trop vous compromettre, traiter avec moi? Je pris la bourse, que je mis immédiatement dans ma poche, et; comme bien vous pensez, cher compère, je jugeai inutile d'insister davantage sur ce sujet; j'étais certain que je traitais avec un caballero.
—Vous avez eu parfaitement raison, cher compère; mais pardon de vous adresser cette question, vous avez la bourse?
—Caray! je le crois bien, elle est là, répondit-il en frappant légèrement sur la poche du côté de son dolman.
—Ah! ah! il est singulier que vous n'ayez pas jusqu'à présent songé à me faire part de cette circonstance, qui est cependant d'une certaine importance.
—J'y ai songé, cher compère, seulement je devrais vous demander votre avis.
—A quel propos?
—Nous avons promis de donner quatre onces à chacun de nos compagnons pour cette expédition, n'est-ce pas?
—Quatre onces, oui, c'est parfaitement cela?
—Eh bien, je me demande si je dois leur donner des arrhes de deux onces à chacun, par exemple, ou s'il est préférable que nous partagions tout simplement le contenu de la bourse entre nous deux; voilà ce qui m'embarrasse, vous ne m'avez pas fait l'injure, je me plais à le croire, de supposer que la pensée me soit venue un seul instant de vous frustrer de la part qui vous revient dans cet argent.
—Oh! cher compère, je connais trop votre délicatesse pour avoir eu cette pensée; ma réponse sera courte, mais catégorique: je suis d'avis qu'en affaires, on doit toujours exiger des arrhes, mais ne jamais en donner.
—Parfaitement raisonné, dit l'autre en riant. Ainsi, vous concluez...?
—Dame! c'est clair, je crois: je conclus à ce que nous partagions tout simplement le contenu de la bourse entre nous.
—A la bonne heure, reprit-il en faisant le geste, de porter sa main à sa poche, vous allez être satisfait, cher compère; mais, s'arrêtant tout à coup, j'ai une proposition à vous faire, dit-il.
—Voyons la proposition, répondit le señor Matadiez en pinçant légèrement les lèvres.
—Nous nous ennuyons considérablement ici.
—Le fait est que les divertissements ne sont pas nombreux.
—Si nous taillions un monte?
—Ah! et à propos de quoi?
—Pour tuer le temps, pas autre chose.
—Voilà une proposition qui me paraît bien séduisante.
—Vous acceptez?
—Un moment, je me consulte, nous intéresserons la partie, probablement?
—Oh! une misère.
—Oui, ma part contre la vôtre, par exemple, n'est-ce pas, cher compère? dit le señor Trabuco en posant amicalement la main sur l'épaule de son digne ami et en riant sournoisement; ce serait avec bien de la joie que j'accepterais cette partie, mais je crois que nous ne tarderons pas à en jouer une autre plus sérieuse. Écoutez.
Les deux bandits prêtèrent l'oreille; presque aussitôt, ils se levèrent.
Ils avaient reconnu le galop précipité d'un cheval, dont le bruit, semblable au roulement du tonnerre, se rapprochait de plus en plus de l'endroit où ils se trouvaient.
—Qu'est cela? murmura Matadiez.
—Nous allons le savoir, répondit Trabuco; éveillons toujours nos hommes, il est bon d'être sur ses gardes.
—C'est juste; mais il est inutile de les éveiller, nos gaillards sont déjà debout; ils ont un sommeil de coyote, rien ne leur échappe.
En effet, les bandits, éveillés par le bruit toujours croissant produit par le galop du cheval, se tenaient immobiles, embusqués derrière les broussailles, la main sur leurs armes et prêts à obéir au premier signe de leurs chefs; seuls, ceux-ci avaient conservé leur place au milieu de la clairière.
Cinq ou six minutes s'écoulèrent, puis tout à coup les buissons furent violemment écartés et un cavalier, lancé à toute bride, se précipita hors des fourrés et vint, par un prodige d'équitation, s'arrêter court à deux pas des deux hommes qui n'avaient pas fait un mouvement pour l'éviter.
Ce cavalier portait le costume des rancheros mexicains; il était masqué.
—Êtes-vous prêts? dit-il d'une voix brève avec un léger accent étranger.
—Nous le sommes, répondit Matadiez non moins laconiquement.
—Alerte à tous! ceux auxquels nous avons affaire me suivent, j'ai à peine deux lieues d'avance sur eux.
—Bon! comme ils marchent au pas, c'est une heure que nous avons devant nous, d'autant plus que les chemins sont mauvais.
—Quelle imprudence de voyager ainsi la nuit dans des contrées qu'on ne connaît pas! dit Trabuco d'une voix railleuse.
—Bref, reprit l'inconnu, nos gens seront bientôt au pied du voladero.
—Ils nous y trouveront, répondit Matadiez, rien n'est changé.
—Rien, seulement le respect le plus profond pour la jeune dame et pour son père.
—Nous sommes caballeros, señor: cette recommandation est inutile.
—Ainsi, je puis compter sur vous?
—Caray! n'avez-vous pas notre parole?
—C'est vrai; alors au revoir et ne manquez pas cette occasion, nous n'en trouverions que difficilement une aussi propice.
—Combien sont-ils?
—Quinze en tout.
—Peones ou caballeros?
—Peones, mais je les crois braves.
Les deux bandits haussèrent les épaules avec dédain.
—Tout est pour le mieux, dit Matadiez.
—Vous pouvez considérer l'affaire comme terminée, ajouta en riant Trabuco.
L'inconnu les salua de la main, tourna bride et s'éloigna aussi rapidement qu'il était venu.
Lorsque le bruit de sa course se fut éteint dans le lointain, Matadiez frappa à deux reprises la crosse de son fusil sur le sol.
A ce signal les bandits reparurent.
—A cheval, et au Voladero del Macho! ordonna Matadiez.
Les salteadores bondirent en selle et s'élancèrent comme une légion de démons sur les traces de leurs chefs.
Un voladero est une montagne dont le sommet s'avance dans l'espace, tandis que, au contraire, la base se creuse de façon à lui donner à peu près la forme d'un arc tendu dont la corde n'existerait pas. Ces montagnes, fort curieuses, ne se rencontrent qu'au Mexique. Et, selon toute probabilité, cette dépression de la base, qui en eut le point caractéristique, se produit chez elles à la suite d'un de ces innombrables cataclysmes qui bouleversent incessamment ce malheureux pays.
Beaucoup de sentiers passent au pied des voladeros, de sorte qu'il semble aux voyageurs que le hasard conduit dans ces parages, qu'ils franchissent une voûte immense, dont une moitié, émiettée par le temps, serait tombée au niveau du sol, tandis que l'autre, maintenue par des attaches invisibles, serait demeurée debout par un prodige d'équilibre.
Nous ajouterons que ce n'est qu'en employant les plus grandes précautions qu'on se hasarde à passer sous un voladero, et qu'il faut qu'on y soit absolument obligé, parce que les masses de terre et les blocs de rochers qui se détachent incessamment du sommet de la montagne, menacent à chaque seconde les voyageurs de les écraser sous leur poids ou de les engloutir tout vivants.
Le lieu était donc parfaitement choisi pour une embuscade; les bandits, échelonnés à droite et à gauche de l'étroit sentier que devaient suivre les voyageurs qu'ils attendaient, n'avaient à redouter aucune intervention fâcheuse, dans un endroit justement redouté et par cela même éloigné de toute habitation.
Cependant M. Prescott et sa fille s'approchaient assez rapidement du voladero, dont ils apercevaient déjà la masse imposante se détachant en noir, à une courte distance, sur le reste du paysage.
Le gentleman anglais avait préféré adopter la coutume mexicaine et voyager de nuit, pour éviter de trop grandes fatigues à sa fille et se ménager lui-même; car, dans les parages où il se trouvait en ce moment, la chaleur est tellement intense pendant le jour, que, à moins d'être né dans le pays, il est impossible d'y résister. La marche avait été ainsi réglée: on se mettait en route le soir à six heures, on marchait jusqu'à deux heures du matin, moment où la rosée commence à tomber et le froid à devenir glacial; à deux heures, on s'arrêtait jusqu'à sept, puis on repartait pour faire une autre halte à midi et laisser ainsi tomber la plus grande force de la chaleur. Mais, comme M. Prescott connaissait le pays qu'il parcourait et qu'il savait les nombreux dangers auxquels il se trouvait exposé, il avait pris, avec une intelligence rare, ses mesures, de façon à déconcerter les salteadores et les rôdeurs de toutes sortes qu'il savait, à n'en pouvoir douter, être embusqués derrière chaque pointe de rocher ou chaque buisson.
Ses peones, sur le dévouement et le courage desquels il comptait peut-être un peu légèrement, nous le craignons, avaient été, par ses soins, bien armés et montés sur des chevaux de choix; lui-même avait jugé prudent de placer deux pistolets dans ses fontes, de s'attacher un sabre au côté, et de porter en travers de sa selle une excellente carabine; la petite troupe, composée d'une douzaine d'hommes, avait été divisée en trois détachements; une avant-garde de deux cavaliers servant d'éclaireurs, le gros du convoi, sur les flancs duquel marchaient les mules de charge, conduites par des arrieros, et une arrière-garde de deux cavaliers; cet ordre de marche, adopté le premier jour de la sortie de San Luis, avait été depuis rigoureusement suivi. M. Prescott avait, comme de raison, eu le soin de conserver auprès de lui ceux de ses peones qu'il supposait les plus braves et les plus dévoués.
C'était donc dans cet ordre que la petite caravane s'avançait vers le voladero, dont elle n'était plus éloignée que d'une distance d'une demi-lieue environ, lorsque M. Prescott commanda de faire halte.
Le convoi devint aussitôt immobile; M. Prescott se pencha à l'oreille de son mayordomo et lui dit quelques mots à voix basse.
Santiago Ramírez s'inclina respectueusement, mit pied à terre, s'approcha d'une des mules de charge et ouvrit un ballot.
—Pourquoi nous arrêtons-nous donc, mon père? demanda miss Anna d'une voix languissante.
—Parce que, mon enfant, répondit M. Prescott, nous approchons du voladero, c'est-à-dire de l'endroit le plus dangereux que nous rencontrerons sur notre route, et qu'il nous faut prendre une précaution importante.
—Laquelle donc?
—Regardez, ma fille, répondit-il laconiquement. La jeune fille n'insista pas davantage; la lune reluisait presque comme en plein jour et permettait de distinguer à une assez grande distance tous les accidents du paysage; seul, le voladero était sombre et ressemblait, tant les ténèbres y étaient épaisses, à l'entrée d'un gouffre.
M. Prescott avait fait confectionner à México, avant que d'en partir, des espèces de sacs en cuir à forte semelle, semblables à ceux que, sous Louis XV, le maréchal de Saxe voulait faire adopter à la cavalerie française. Ces sacs de cuir, Santiago Ramírez était occupé en ce moment à en chausser les pieds des chevaux.
—Comprenez-vous? dit M. Prescott à sa fille.
—Je vous avoue humblement que non, mon père.
—C'est que vous ne vous donnez pas la peine de réfléchir, reprit-il en souriant; nous allons traverser une voûte dont le sommet s'écroule à chaque seconde sur la tête des voyageurs. La dernière fois que je suis passé par ici, j'ai remarqué que la percussion du son sous cette voûte occasionnait des ébranlements qui augmentaient ces écroulements dans des proportions considérables; j'ai moi-même failli être victime d'un éboulement qui eut lieu à deux pas de moi. Pour éviter que pareille chose nous arrive aujourd'hui et diminuer le danger autant que possible, je me suis précautionné de ces sacs, dont vous ne tarderez pas à voir l'effet.
Au moment où M. Prescott achevait sa démonstration, le mayordomo achevait, de son côté, de chausser les chevaux; puis, après avoir enlevé les grelots des mules de charge, il revint reprendre sa place auprès de son maître.
—Mes enfants, dit alors M. Prescott, écoutez bien l'ordre que je vous donne; de son exécution dépend probablement notre salut à tous. Lorsque nous atteindrons ce mélèze qui se trouve à trois cents pas de nous, là, sur la droite du sentier, nous enfoncerons les éperons aux flancs de nos montures et nous nous élancerons ventre à terre; nous franchirons ainsi la voûte du voladero, et nous ne nous arrêterons que cinq cents pas plus loin. Surtout pas un cri pendant toute la durée de cette course. M'avez-vous bien compris?
—Oui, seigneurie, répondirent les peones.
—Bon. Maintenant silence et en route! Le convoi se remit en marche.
Arrivés au point que leur avait désigné M. Prescott, les peones s'élancèrent à toute bride. Grâce aux sacs de cuir dans lesquels leurs pieds étaient enfermés, les chevaux, semblables au coursier-spectre de la ballade allemande, filaient silencieusement dans l'espace, et leur galop rapide ne produisait pas le moindre bruit.
La caravane s'engouffra sous la voûte avec une vélocité vertigineuse.
Tout à coup des torches étincelèrent dans la nuit, et de derrière tous les rochers s'élancèrent des cavaliers qui se ruèrent sur les voyageurs en poussant de grands cris et en brandissant leurs armes.
En se voyant ainsi attaqués à l'improviste, les voyageurs éprouvèrent d'abord un moment de folle terreur et ne songèrent qu'à chercher leur salut dans la fuite; mais promptement ranimés par les encouragements de M. Prescott qui, lui, avait bravement fait face au danger, et peut-être honteux d'abandonner ainsi leur maître et leur jeune maîtresse sans essayer de les défendre, les peones ne tardèrent pas à tourner bride; à leur tour, ils chargèrent résolument les bandits. Ceux-ci avaient supposé avoir bon marché des voyageurs; surpris par ce retour offensif, ils hésitèrent et mirent plus de mollesse dans leur attaque.
La défense s'organisait, le combat était rétabli, le résultat de la lutte devenait incertain; Matadiez et son digne ami Trabuco commençaient à être sérieusement inquiets; plusieurs de leurs compagnons avaient succombé, d'autres lâchaient pied: la position se faisait pour eux de plus en plus difficile.
Mais les deux bandits étaient gens de ressource et surtout fort experts en matière de guet-apens; de plus ils tenaient énormément à toucher la prime magnifique qui leur avait été promise pour la capture de M. Prescott et de sa fille; une plus longue hésitation pouvait les perdre; leur parti fut pris en un instant pour tenter un effort désespéré, qui, d'une façon ou d'une autre, serait décisif.
Matadiez jeta un cri strident; aussitôt toutes les torches s'éteignirent à la fois, et l'obscurité la plus profonde remplaça aussitôt la lueur blafarde grâce à laquelle, jusqu'alors, les combattants avaient pu s'entrevoir et diriger presque sûrement leurs coups.
Le combat continua donc dans les ténèbres; amis et ennemis se mêlèrent, se ruant les uns contre les autres avec un acharnement sans pareil.
Tout à coup de grands cris se firent entendre, et une dizaine de cavaliers, tenant chacun une torche allumée de la main gauche, s'engouffrèrent comme un ouragan sous la voûte en poussant le cri de guerre des rancheros.
Presque aussitôt une masse énorme de terre et de pierres détachées de la cime du voladero, tomba avec un fracas épouvantable au milieu des combattants, dont plusieurs furent littéralement broyés sous son poids.
Il y eut alors un désordre horrible, une panique effroyable parmi ces hommes acharnés à s'entre-égorger; les bandits comprirent que la partie était perdue pour eux, ils ne songèrent plus qu'à gagner au pied et s'élancèrent au hasard, poussés par l'instinct de la conservation.
Mais la fuite elle-même leur était devenue impossible; la partie de la voûte qui s'était écroulée avait formé derrière eux une infranchissable barrière; devant eux les rancheros, la carabine à l'épaule, n'attendaient qu'un signe de leur chef pour les tuer à bout portant.
Ce chef était don Pablo; il se tenait immobile, l'épée à la main, à deux pas en avant de sa troupe, contenant à grand-peine son cheval qui se cabrait de terreur, et cherchant d'un regard anxieux ceux au secours desquels il était accouru.
M. Prescott et sa fille avaient disparu. Un instant le jeune homme trembla qu'ils ne fussent ensevelis sous les décombres de la voûte, et une pâleur mortelle envahit son mâle visage.
—Bas les armes et pied à terre, misérables! cria-t-il d'une voix rude.
Les bandits obéirent avec une rapidité qui témoignait de la crainte qu'ils éprouvaient.
Ils n'étaient plus que huit, dont cinq avaient reçu de graves blessures, et ne se tenaient debout qu'avec les plus grandes difficultés.
Don Pablo les examina les uns après les autres avec la plus sérieuse attention.
—Que sont devenus vos chefs? dit-il enfin. Les bandits gardèrent le silence.
—M'entendez-vous? reprit-il avec un ton de menace qui fit courir un frisson de terreur dans les veines des plus braves.
—Ils nous ont abandonnés pendant l'obscurité, répondit enfin un blessé; nous ne savons ce qu'ils sont devenus.
Il y eut un silence de quelques secondes, pendant lequel on eût entendu battre le cœur dans la poitrine de ces misérables.
Don Pablo fixait sur eux un regard farouche.
—A genoux! reprit-il, et recommandez-vous à Dieu, vous allez mourir!
—Grâce! s'écrièrent-ils en joignant les mains avec une inexprimable angoisse.
—Pas de grâce! dit-il sèchement, et, se tournant vers ses cavaliers, il leva lentement son épée au-dessus sa tête.
Dix coups de feu éclatèrent, se confondant dans une seule détonation.
Un cri horrible se fit entendre, les, bandits roulèrent sur le sol.
Ils étaient morts.
—Justice est faite, dit froidement l'implacable ranchero, abandonnons aux coyotes les cadavres de ces misérables et mettons-nous à la recherche de ceux dont ils avaient voulu faire leurs victimes.
Santiago Ramírez s'approcha respectueusement de lui:
—Señor don Pablo, lui dit-il, les deux chefs se sont échappés; ne craignez-vous pas qu'ils aient réussi dans les ténèbres à s'emparer de mon maître et de ma jeune maîtresse?
—C'est ce que nous saurons bientôt, répondit le jeune homme d'une voix sourde.
—Et nous, que devons-nous faire, señor?
—Nous accompagner provisoirement; votre sûreté l'exige.
Santiago Ramírez s'inclina et rejoignit les autres peones, qui se rangèrent derrière les rancheros. Sur un signe de don Pablo, les cavaliers sortirent au galop de la voûte; au bout de quelques minutes, ils se retrouvèrent en rase campagne, hors de l'ombre projetée par la masse imposante du voladero.
La nuit était claire et étoilée, la lumière suffisante pour qu'il fût facile, à une assez grande distance, de distinguer les divers accidents du paysage; les torches, devenues inutiles, avaient été éteintes.
Les rancheros galopaient ainsi depuis vingt minutes environ, lorsqu'ils se trouvèrent presque subitement en face d'une troupe assez considérable de cavaliers rangés en bataille en travers de la route, et qui semblaient leur barrer le passage.
—Qui vive?—Qui vive?—cria une voix forte.
—Mejico e Independencia!—Mexique et Indépendance!—répondit aussitôt don Pablo en continuant d'avancer.
—Qué gente?—Quelles personnes?—reprit la voix?
—Rancheros.
Un hurrah joyeux accueillit cette dernière réponse, et un cavalier s'élança au-devant de don Pablo.
Ce cavalier était M. Prescott.
Les deux troupes se confondirent en une seule. Les nouveaux venus faisaient partie de la cuadrilla de don Pablo; le jeune homme les avait laissés en arrière pour éclairer la route et arrêter les fuyards.
M. Prescott était pâle, défait; il paraissait en proie à une grande agitation; tout son flegme britannique avait disparu; il était accablé de douleur.
—Ma fille, s'écria-t-il, dès qu'il fut près de don Pablo, ma fille, où est ma fille?
Le jeune homme baissa tristement la tête sans répondre.
—Oh! reprit le vieillard en se tordant les mains avec désespoir, elle est morte!
—Non! non! s'écria vivement don Pablo, elle vit.
—Où est-elle alors, rendez-la-moi, ma fille, je la veux.
—Hélas! elle a disparu; mais, ajouta-t-il vivement, elle ne saurait être bien loin encore, nous la retrouverons, je vous le jure; sans doute elle aura fui pendant le combat.
Le vieillard hocha tristement la tête à plusieurs reprises.
—Non, dit-il avec amertume, elle a été enlevée, j'en suis sûr! les misérables me l'ont ravie.
—Revenez à vous, Monsieur, miss Anna ne peut-elle donc pas s'être échappée comme vous à la faveur des ténèbres?
—Je vous répète, don Pablo, qu'elle a été enlevée comme je l'ai été moi-même.
—Que voulez-vous dire?
—Un bandit s'est jeté en croupe sur mon cheval, a saisi la bride et m'a entraîné malgré tous les efforts que j'ai tentés pour recouvrer ma liberté; vous voyez bien que ma pauvre fille a été elle aussi victime d'un odieux guet-apens? Oh! mon Dieu! mon Dieu!
Une sueur froide inonda le front du jeune homme.
—Malheur à moi, murmura-t-il, si ce que vous dites est vrai, Monsieur! Mais non, je ne puis le croire, cela n'est pas, reprit-il avec énergie, cela ne saurait être, miss Anna nous sera rendue; qu'est devenu le bandit qui vous a enlevé?
—Eh! le sais-je, le misérable a été arrêté par vos cavaliers; à peine libre j'ai voulu retourner sur mes pas; j'aurais retrouvé ma fille, moi, si l'on m'avait laissé me mettre à sa recherche.
Puis, vaincu tout à coup par la douleur, le malheureux vieillard se renversa sur son cheval et aurait roulé sur le sol si don Pablo ne l'avait retenu en lui jetant les bras autour du corps.
Il était évanoui.
Le jeune homme le considéra un instant avec une impression impossible à rendre.
—Pauvre père! murmura-t-il d'une voix que l'émotion faisait trembler, quelle punition terrible de son entêtement insensé! Mais, sur mon âme, je lui rendrai sa fille, je le jure, ou bien je périrai!
Les rancheros avaient mis pied à terre et installé un campement provisoire pour la nuit; don Pablo ne voulait pas s'éloigner du voladero avant d'en avoir minutieusement exploré tous les environs; il espérait ainsi découvrir quelque indice qui le mit sur les traces de miss Anna.
M. Prescott avait été étendu sur des couvertures; Santiago Ramírez et don Pablo lui prodiguaient les soins les plus empressés et essayaient par tous les moyens de le rappeler à la vie.
Le vieillard demeura près d'une heure sans connaissance. Enfin, il rouvrit les yeux, jeta des regards égarés autour de lui; puis tout à coup le souvenir lui revint, il jeta un grand cri et fondit en larmes.
Don Pablo ne l'avait pas quitté, il lui prit la main.
—Courage, lui dit-il d'une voix douce; courage, pauvre père!
—Ma fille, murmurait le vieillard à travers ses sanglots; ma fille! mon Dieu! Don Pablo, vous me la rendrez, n'est-ce pas? s'écria-t-il tout à coup en fixant sur le jeune homme ses yeux rougis par les larmes.
—Je l'ai juré, Monsieur, répondit-il d'une voix grave; Dieu a entendu mon serment.
—Soyez béni, don Pablo, pour cet espoir cependant bien faible que vous faites entrer dans mon cœur. Oh! ma fille! ma pauvre fille!
Le jeune homme confia M. Prescott aux soins de ses peones, et, après lui avoir de nouveau serré la main et répété le mot: courage! il s'éloigna à pas lents d'un air pensif.
Plusieurs feux de bivouac avaient été allumés. Don Pablo s'assit devant l'un d'eux, et s'adressant à l'un de ses officiers:
—Qu'avez-vous fait du bandit qui est venu si étourdiment donner dans votre embuscade? Vous ne l'avez pas fusillé, j'espère?
—Non colonel, pas encore, répondit l'officier, supposant que peut-être vous désireriez l'interroger; provisoirement, nous l'avons solidement garrotté et placé sous bonne garde.
—Vous avez bien fait; quel homme est-ce?
—Hum! il a l'air d'un assez triste sujet, colonel; c'est un grand drôle à mine patibulaire, taillé en hercule, qui s'est défendu comme un démon lorsque nous l'avons arrêté et qui même a blessé deux hommes.
—Donnez l'ordre qu'on me l'amène à l'instant; peut-être pourra-t-il nous fournir quelques renseignements précieux.
—Je doute qu'il consente à parler, colonel; depuis son arrestation, malgré toutes les questions qui lui ont été adressées, il s'est obstiné à ne pas vouloir répondre.
—Peut-être serai-je plus heureux que vous. Donnez, je vous prie, l'ordre qu'on le conduise en ma présence.
L'officier se hâta d'obéir; il revint au bout de quelques minutes suivi de plusieurs rancheros qui amenaient, ou plutôt portaient au milieu d'eux, car il refusait de marcher, bien que ses jambes fussent à peu près libres, notre ancienne connaissance, le señor Matadiez.
Le bandit n'avait rien perdu de son effronterie, ni de sa cynique assurance. Le seul changement qui s'était opéré en lui, c'est que ses yeux de chat-tigre semblaient lancer des flammes sous ses sourcils froncés à se joindre, et que l'expression de sa physionomie était encore plus farouche que de coutume.
Don Pablo jeta sur le drôle un regard investigateur, et s'adressant à l'officier:
—Capitaine, dit-il froidement, faites prendre les armes à dix cavaliers et qu'ils se tiennent prêts pour une exécution.
Le capitaine fit un signe, dix rancheros s'approchèrent, la carabine à la main et se placèrent silencieusement en face du prisonnier.
Celui-ci demeura impassible, indifférent en apparence à ces préparatifs dont cependant il comprit toute la menaçante signification.
—Tu es condamné à mort, prépare-toi à mourir, dit don Pablo d'un ton bref en s'adressant au prisonnier.
Le bandit sourit avec dédain.
—Je suis condamné à mort depuis ma naissance, répondit-il d'une voix railleuse; un peu plus tôt un peu plus tard, toute créature humaine doit en arriver là, c'est le but commun, nul être vivant ne le peut éviter. Faites donc de moi ce qu'il vous plaira.
—Tu ne crains pas la mort?
—Pourquoi la craindrais-je, c'est la fin de tout.
—Ou le commencement!
—Peut-être; que m'importe!
—La vie est belle cependant, quand on est jeune, fort et riche.
—Oui, mais quand on est pauvre, elle ne vaut pas la peine qu'on prend à essayer de la prolonger.
—Hum! Si au lieu de te faire exécuter, comme c'est mon droit, je te pardonnais?
—Vous plaisantez, colonel! dit le bandit avec un tressaillement involontaire.
—Suppose un instant que je parle sérieusement.
—A quoi bon supposer ce qui ne saurait être? répondit-il en haussant les épaules. Vous m'avez arrêté en flagrant délit; c'est une partie comme une autre engagée entre nous. J'ai joué, j'ai perdu, je dois payer.
—Alors, tu veux mourir?
—Je ne dis pas cela. Il y a toujours chez l'homme le plus brave un sentiment instinctif qui le pousse à conserver la vie.
—Tu peux vivre si tu le veux.
—Est-ce un marché que vous me proposez, colonel?
—C'est un marché, oui, señor Matadiez.
—Hein? s'écria le bandit dont l'œil lança un fulgurant éclair, vous me connaissez?
—Oui, je te connais.
—Et me connaissant vous me feriez grâce?
—Non seulement je te ferai grâce si tu le veux; mais encore je te rendrai riche.
—Bon; alors on peut s'entendre. Il est inutile de me tenir ainsi plus longtemps garrotté comme un novillo; ordonnez qu'on détache mes liens et qu'on nous laisse seuls.
—Si je fais ce que tu désires, tu n'essaieras pas de t'échapper?
—Ma foi, non; la vie me pèse, j'irai de moi-même me placer devant les carabines de vos soldats, je vous le jure, quand vous me l'ordonnerez; si vous me connaissez, vous savez qu'on peut avoir confiance en ma parole.
Don Pablo fit un signe d'assentiment.
—Déliez cet homme, dit-il.
On obéit; le bandit poussa un rugissement de joie et fit sur place un bond prodigieux sur lui-même, comme pour s'assurer qu'il était réellement rentré en possession de toutes ses facultés.
Les soldats s'éloignèrent; le colonel et le bandit demeurèrent seuls.
En recouvrant sa liberté, Matadiez avait repris toute son insouciance.
—Alors, fit-il en riant, ce ne sera pas encore pour cette fois.
Et s'approchant vivement de don Pablo:
—Colonel, lui dit-il sans lui donner le temps de lui adresser la parole, je sais ce que vous désirez de moi; je ne tromperai pas votre attente. Je vous dois la vie, je m'acquitterai loyalement; je n'ai jamais renié mes dettes, et, vive Dieu! celle-là est sacrée. Vous voulez savoir, n'est-ce pas, ce qu'est devenue la jeune fille qui a disparu? Je l'ignore; mais je le saurai bientôt, soyez tranquille. De plus, non seulement je vous aiderai à la sauver, mais encore je m'engage à vous apprendre, quoique je ne le sache pas moi-même, quel est l'homme qui m'avait payé pour m'emparer de la pauvre enfant. Vous ai-je deviné, est-ce bien là tout ce que vous désirez de moi?
—Tu m'as deviné, en effet, et c'est tout ce que je désire de toi; si tu tiens la promesse que tu me fais, je te le dis à mon tour, sois tranquille.
—Bon, ne parlons pas de cela maintenant, reprit-il d'un ton enjoué; après la réussite nous réglerons cette affaire.
—Soit. Un mot encore?
—Parlez.
—Comment te trouvé-je de si bonne composition, toi cependant si...
—Féroce? bah! dites le mot, allez, colonel; deux raisons m'ont engagé à agir ainsi que je le fais; la première, c'est que vous avez été franc avec moi, et que vous m'avez témoigné de la confiance en me rendant ma liberté sur parole; la seconde, c'est que je suis peut-être un tigre, mais qu'à coup sûr je ne suis pas un loup; je tue sans remords un homme, et cela bravement, en face, mais je répugne à enlever les enfants et les femmes, je trouve cela lâche. J'ai été malgré moi entraîné à tenter cette expédition, elle me répugnait; mais j'étais à bout de ressources et je ne voulais pas mourir de faim. Voilà mon excuse, si quelque chose peut excuser une action aussi indigne.
—Bien, je m'attendais à cette réponse, je suis heureux de ne point m'être trompé sur ton compte; allons, tu vaux mieux que ta réputation, je ne désespère pas de te voir revenir au bien.
—C'est bien difficile, colonel, répondit-il en hochant la tête... cependant qui sait?
Don Pablo appela d'un geste le capitaine qui se promenait de long en large à quelques pas en attendant la fin de ce long entretien.
—Cet homme est libre, lui dit-il, rendez-lui son cheval et ses armes.
Le capitaine s'inclina.
—Merci, dit Matadiez, cette dernière faveur achève de m'attacher à vous; adieu, colonel; avant peu vous aurez de mes nouvelles, et j'espère que vous serez satisfait; où vous retrouverai-je?
—Auprès du général Santa-Anna.
—Cela suffit, adieu.
Il salua respectueusement le colonel, reprit ses armes qu'un ranchero avait apportées, caressa son cheval, se mit en selle d'un bond, et partit ventre à terre dans la direction du voladero.
Don Pablo le suivit un instant du regard, puis il pencha son front pensif en murmurant:
—Ce moyen était le seul qui m'offrit des chances de succès; ai-je eu tort de l'employer? Peut-être!
Et il demeura plongé dans ses réflexions.
Nous abandonnerons provisoirement le camp des rancheros, et, faisant rétrograder notre récit de quelques heures, nous retournerons sous la voûte du voladero au moment où, sur l'ordre de Matadiez, les torches avaient été éteintes toutes à la fois.
Miss Anna, effrayée par l'obscurité subite qui avait instantanément succédé à la lueur douteuse qui jusque-là avait éclairé le combat, mais conservant cependant toute sa présence d'esprit, s'était, autant que cela lui était possible, rapprochée de son père, dont elle sentait combien il était important pour elle de ne pas être séparée.
Tout à coup elle frissonna; elle avait senti une main presser doucement la sienne et s'appuyer fortement sur la bride de son cheval, qui, obéissant à l'impulsion nouvelle qui lui était donnée, au lieu d'avancer comme elle le désirait, reculait peu à peu, mais par un mouvement continu, de façon à sortir de la mêlée. Inquiète de cette direction donnée malgré elle à sa monture, la jeune fille, soupçonnant un nouveau piège, se tint sur ses gardes, prête à tout événement, et résolue à faire face au danger, quel qu'il fût, qu'elle prévoyait.
Miss Anna ne ressemblait en rien à ces jeunes filles de notre vieille Europe, qui, abritées sous l'aile tutélaire d'une mère inquiète et attentive, ou derrière les murailles épaisses d'un couvent, rendues faibles et craintives par l'invisible mais toute puissante protection qu'elles sentent planer incessamment autour d'elles, tremblent au bourdonnement d'une mouche qui vole, et s'évanouirent à l'appréhension d'un danger imaginaire; issue de deux sangs fiers et énergiques, l'indomptable volonté et le sang-froid de la race anglo-saxonne se réunissaient en elle au courage patient et dévoué, et à l'angélique douceur de la race hispano-américaine; élevée au Mexique, au milieu des continuelles révolutions qui bouleversent ce malheureux pays, elle s'était, enfant, accoutumée à regarder le danger en face, à ne chercher de protection qu'en elle-même et à agir sous l'impulsion de son propre cœur.
On se tromperait fort si, d'après ce que nous venons de dire, on se figurait miss Anna comme une espèce d'amazone se plaisant au milieu du danger et parfois le recherchant pour se donner la joie d'y échapper par sa force et son courage; il n'en était rien: dans la vie ordinaire, miss Anna était une jeune fille douce, modeste, rougissant au moindre mot et obéissant passivement, sans colère ni impatience, aux ordres souvent un peu durs de son père, heureuse même d'être ainsi délivrée de toute responsabilité personnelle et de pouvoir se livrer en liberté à ses rêves de jeune fille. Mais, dans les circonstances exceptionnelles, son caractère s'éveillait pour ainsi dire; il grandissait avec les événements, et, si graves qu'ils fussent, il la maintenait toujours à leur niveau.
Cette fois encore, à l'approche du danger, miss Anna sentit croître son courage; la situation était pour elle excessivement critique; isolée pour ainsi dire au milieu de tous ces hommes qui combattaient avec acharnement dans les ténèbres, elle comprit qu'elle n'avait de secours à demander à personne, que c'était en elle-même qu'elle devait chercher protection, et que, si elle hésitait à se défendre, elle était perdue.
Son parti fut pris en un instant.
Feignant de se tromper sur les intentions de l'homme qui tenait son cheval, elle cessa d'essayer à dégager sa bride, et, se penchant légèrement en avant:
—Est-ce vous, Remigo Vásquez, demanda-t-elle, qui essayez de me sortir de la mêlée?
—Oui, señorita, répondit une voix étouffée dont l'intonation sinistre aurait dissipé tous ses doutes, si par hasard elle en avait conservé; c'est l'ordre de votre père.
—Bien, dit-elle, approchez-vous et prenez ma valise; elle est à moitié dégrafée. Je ne veux pas qu'elle demeure entre les mains de ces bandits.
Presque aussitôt la jeune fille sentit les mains de l'inconnu sur la croupe de son cheval. Réunissant les rênes, elle appuya vigoureusement les éperons aux flancs de l'animal, qui hennit de douleur, le fit cabrer et le lança en avant avec une rapidité vertigineuse.
Le cheval partit à fond de train, renversant du poitrail tous les obstacles qui s'opposaient à son passage. La jeune fille entendit un blasphème, une balle siffla à son oreille et perça son chapeau: c'était probablement le bandit qui essayait de se venger du tour qu'elle lui avait joué.
La jeune fille ne s'occupa point de cet incident, elle ne songeait qu'à fuir et à sortir de la mêlée; tout à coup un fracas horrible retentit, une masse de terre et de rochers s'était détachée de la voûte et était tombée à deux pas derrière elle; une seconde de plus elle était engloutie sous les décombres.
Le cheval épouvanté redoubla de vitesse, emportant dans sa course furieuse sa maîtresse à travers la campagne.
Miss Anna était sauvée, provisoirement du moins, du péril le plus grand qu'elle avait à redouter.
Les rochers avaient élevé en s'amoncelant une infranchissable barrière entre elle et ses ravisseurs; malheureusement elle était seule, car elle se trouvait séparée à la fois de ses amis et de ses ennemis, et abandonnée au milieu de la nuit dans un désert inconnu.
Elle continua cette course affolée, poursuivie pendant quelques instants encore par les horribles cris d'agonie des misérables écrasés sous les décombres; puis les cris et le tumulte des combats s'éteignirent peu à peu, tout retomba dans le silence et elle demeura seule, essayant vainement de calmer sa monture et de ralentir sa course furieuse qui augmentait à chaque seconde.
Elle n'avait échappé au péril d'être enlevée et peut-être assassinée par les bandits que pour se voir presque aussitôt exposée à être précipitée dans quelque fondrière ou brisée sur les rochers de la route par un animal emporté que la terreur rendait fou.
La nuit était claire et étoilée, la route large, la jeune fille ne désespéra pas de son salut; renonçant à arrêter son cheval, elle se borna à le diriger autant que possible en ligne droite, tout en lui parlant et en le flattant doucement avec la main, attendant avec le stoïcisme d'un esprit énergique qui a la conviction d'avoir tout fait pour se sauver, soit que le cheval buttât contre une pierre invisible et roulât avec elle sur le sol, soit, ce qui était moins probable, qu'il s'arrêtât de lui-même; préparée à l'un ou à l'autre événement, la jeune fille adressa à Dieu une fervente prière et continua, résignée à ce que le ciel ordonnerait d'elle, sa course fiévreuse dans la nuit.
Depuis plus d'une heure déjà, semblable au coursier-fantôme de la légende allemande, le cheval filait silencieusement dans l'espace, portant courbée sur son cou et cramponnée à sa crinière la jeune fille que, malgré tout son courage, la terreur commençait à envahir; les arbres échevelés fuyaient à droite et à gauche de la route, les accidents du paysage se noyaient dans les teintes mates de l'horizon.
Ce steeple-chase effroyable continuait avec la même vertigineuse rapidité; le cheval soufflait du feu par les naseaux; il faisait entendre des rauquements sourds et des ahans de fatigue; un nuage de fumée grisâtre l'enveloppait comme un linceul, et malgré les efforts de la jeune fille, il maintenait toujours cette allure affolée qui menaçait d'aboutir à une épouvantable catastrophe.
Cependant l'aspect du paysage peu à peu se modifiait, la route devenait meilleure, les arbres plus resserrés et plus touffus prenaient l'apparence d'une alameda, tout semblait présager qu'on approchait d'un pueblo ou du moins d'une ranchería; déjà se voyaient, à une assez courte distance, se détachant de la masse sombre de l'horizon sur laquelle ils tranchaient, ces murs en adobe, blancs et peu élevés qui, au Mexique, aux environs des villages, servent à clore les champs et les propriétés rurales.
Miss Anna releva doucement la tête et jeta un regard anxieux autour d'elle, l'espoir lui remontait au cœur: les villageois quittent le lit de bonne heure pour aller soigner les bêtes au corral et commencer les durs travaux des champs. Tout n'était pas perdu; la jeune fille pouvait être sauvée, si Dieu, qui jusque-là l'avait si évidemment protégée, consentait une fois encore à lui venir en aide.
Cependant, à droite et à gauche du chemin, perdus dans la brume, commençaient à apparaître des ranchos épars çà et là, sentinelles perdues du village qui nécessairement ne devait pas être loin.
Peu à peu les ranchos se rapprochèrent à droite et à gauche, s'alignèrent de chaque côté de la route, puis enfin ils se joignirent et se soudèrent pour ainsi dire les uns aux autres, et formèrent une large rue. Miss Anna, toujours emportée par son cheval, entrait dans un pueblo.
L'aube commençait à rayer les nuages de nuances plus claires; à l'horizon, des teintes blanchâtres envahissaient le ciel, le soleil ne tarderait pas à se lever, le jour à paraître; derrière les fenêtres de quelques ranchos, des lumières tremblotantes annonçaient le réveil des habitants; au bruit saccadé du galop précipité du cheval, plusieurs portes s'entrouvrirent. Miss Anna poussa alors des cris de détresse en demandant du secours.
Tout à coup un cavalier apparut à l'extrémité opposée du village; un coup d'œil lui suffit pour comprendre la situation désespérée de la jeune fille.
—Courage! lui cria-t-il, redressez-vous sur la selle!
La jeune fille devina plutôt qu'elle n'entendit cette recommandation et obéit instinctivement, car, malgré tout son courage et sa force de volonté, la pauvre enfant, en proie à un vertige horrible, n'avait plus pour ainsi dire conscience de ce qui lui arrivait. Le cavalier inconnu s'élança à toute bride et arriva comme un ouragan au-devant de la jeune fille, en faisant tourner son lasso autour de sa tête.
Tout à coup le lasso s'abattit sur le cou de l'animal; le cheval, effaré, fit un effort terrible, poussa un hennissement de douleur et s'abattit foudroyé sur les genoux, frissonnant de terreur et soufflant avec force.
La jeune fille lâcha la bride, ferma les yeux, et, adressant une suprême prière à la Divinité, elle s'évanouit.
Mais elle ne toucha pas le sol, des mains empressées l'avaient enlevée de selle et empêchée de se briser le crâne sur le cailloutis pointu qui pavait la route.
Lorsqu'elle reprit ses sens, il faisait grand jour, plusieurs femmes l'entouraient et lui prodiguaient des soins.
La jeune fille souleva péniblement sa tête alourdie par la douleur et jeta un regard anxieux autour d'elle, essayant de rappeler ses idées confuses encore et de se souvenir de ce qui s'était passé.
Miss Anna était à demi couchée sur une butaca dans une chambre modestement meublée, mais très propre; le soleil entrait joyeusement par les fenêtres ouvertes et donnait un air d'indicible gaieté à cette pauvre demeure.
La pitié la plus sincère, l'intérêt le plus réel animaient le visage des femmes qui entouraient la jeune fille; elle sourit doucement en les regardant avec reconnaissance et referma les yeux.
Mais cette fois elle n'était plus évanouie, le calme renaissait peu à peu dans son esprit, l'intelligence voilée par le choc de tant d'événements terribles reprenait son empire et recommençait à se faire jour, la souffrance s'éveillait de nouveau avec le souvenir.
Quelques minutes s'écoulèrent sans que le plus léger bruit vînt troubler le silence religieux qui régnait dans la chambre; enfin miss Anna sentit qu'on lui prenait délicatement la main, en même temps une douce voix murmura à son oreille:
—Pourquoi pleurer ainsi, señora, votre souffrance redoublerait-elle? Au nom de la sainte Vierge de Guadalupe, ayez confiance en nous, nous serions si heureuse de vous soulager.
Miss Anna rouvrit ses yeux pleins de larmes, la douleur l'avait vaincue, elle pleurait.
—Merci, répondit-elle en essayant de sourire, merci; vous êtes bonnes et je vous rends grâce des soins si touchants que vous avez prodigués avec une délicatesse si grande à une étrangère. Dieu vous récompensera.
—Nous n'avons fait que notre devoir, señorita, reprit la femme qui déjà lui avait parlé; mais Dieu soit loué, vous êtes sauvée maintenant.
—Hélas! murmura la jeune fille en sentant redoubler sa douleur, c'est vrai, mon Dieu! je suis sauvée.
La jeune Indienne, pauvre fille aussi ignorante qu'elle était bonne, se trompa à l'expression de ces paroles.
—Vous pourrez continuer votre voyage aussitôt que vos forces seront revenues, dit-elle avec douceur; votre cheval n'est point blessé, on en a pris le plus grand soin; et puis, voyez, votre valise est là près de vous, sans que rien y manque.
—Oh! fit-elle avec un geste de nonchalance charmante, ce n'est point de cela que je voulais parler.
—Comment vous sentez-vous à présent, señora?
—Mieux, beaucoup mieux; j'espère que dans quelques heures mes forces seront assez revenues pour me permettre de continuer mon voyage.
—Ne vous hâtez pas autant de vous remettre en route, señora; bien que nous ne soyons que de pauvres Indiens, grâce à Dieu, si restreintes que soient nos ressources, elles nous permettent encore d'offrir une hospitalité, sinon luxueuse, du moins décente aux voyageurs dans votre position.
—Merci, mon enfant; comment vous nommez-vous?
—Anita, señora, pour vous servir, répondit-elle avec une révérence; mon mari a été pressé il y a quelques jours, et a été forcé de se rendre à l'armée que son Excellence le président a rassemblée à San Luis de Potosí, pour battre les hérétiques.
—De sorte que vous êtes seule ici maintenant, mon enfant, reprit miss Anna, amusée par le gentil babil de la pauvre fille.
—Hélas! oui, señora, répondit-elle en portant ses mains à ses yeux mouillés de larmes, et bien triste, allez.
—Je vous crois, chère petite, et je vous plains sincèrement. Nous reviendrons sur ce sujet, ajouta-t-elle avec intention.
—Je suis à vos ordres, señora.
—Mais dites-moi, ma chère Anita, quel est l'homme généreux qui m'a si providentiellement sauvée d'une mort horrible?
—Je ne le connais pas, señora, il est forastero, étranger,—et entrait en même temps que vous dans le village.
—C'est Dieu qui l'envoyait à mon secours, murmura pieusement la jeune fille.
—Oh! bien certainement, señora.
—Et qu'est-il devenu? A-t-il continué sa route?
—Non, señora; il a déclaré qu'il ne s'éloignerait pas avant de savoir comment vous êtes, et il attend qu'il vous plaise de le recevoir.
—Pourquoi ne m'avoir pas dit cela plus tôt?
—Désirez-vous donc qu'il entre?
—A l'instant, si cela est possible.
—Vous allez être satisfaite. Et la jeune Indienne quitta la chambre, suivie de ses compagnes, auxquelles elle avait fait signe de ne pas demeurer davantage.
En effet, miss Anna était complètement remise de son affreux accident et n'avait plus besoin que de calme et de repos.
Quelques minutes s'écoulèrent; enfin la porte s'ouvrit et Anita reparut, précédant l'homme qui avait si adroitement lacé le cheval au milieu de sa course furibonde, et, selon toutes probabilités, préservé la jeune fille d'une chute mortelle.
L'inconnu entra timidement dans la chambre, marchant sur la pointe du pied pour empêcher ses lourds éperons de grincer sur le sol, et il s'arrêta devant la jeune fille, la tête basse et tournant gauchement et d'un air embarrassé son chapeau entre ses mains.
Miss Anna examina attentivement cet homme et un frisson de crainte la saisit sans qu'il lui fût possible de se rendre compte de l'émotion étrange qu'elle éprouvait à la vue des traits sinistres de cet individu, qui pourtant était son sauveur. Cependant elle surmonta cette première impression, et lui faisant un geste gracieux de la main:
—Approchez, señor, lui dit-elle d'une voix douce et harmonieuse, mais légèrement tremblante, je tenais à vous voir et à vous exprimer moi-même la vive reconnaissance que je conserverai pour le signalé service que vous m'avez rendu.
—Señorita, répondit l'étranger d'une voix sourde, vous ne me devez aucune reconnaissance pour ce que j'ai fait; tout vaquero mexicain sait lacer un cheval emporté; ce n'est pas un grand mérite; il n'y a donc pas là un motif à un remercîment de la part d'une personne comme vous!
—Au contraire, car vous avez agi sous l'impression d'un bon mouvement, puisque je vous suis complètement étrangère.
—En êtes-vous sûre, señorita? répondit-il en relevant enfin la tête et la regardant avec une expression singulière.
—Mais, murmura la jeune fille surprise et troublée de cette réponse à laquelle elle était si loin de s'attendre, je le crois... je le suppose, du moins, je ne me rappelle pas vous avoir jamais vu.
—C'est vrai, señorita, jamais vous ne m'avez vu; j'ajouterai même que jamais, jusqu'à ce moment, je n'avais moi-même eu l'honneur de vous voir, et cependant vous ne m'êtes pas étrangère.
—Je ne vous comprends pas, señor.
—En effet, ce que je vous dis là vous doit sembler bien extraordinaire; lorsque je vous ai rencontrée si providentiellement, señorita, je vous cherchais.
—Vous me cherchiez, moi! s'écria-t-elle avec une surprise de plus en plus grande.
—Oui, señorita, reprit-il froidement, seulement, je conviens avec vous que, lorsque j'ai lacé votre cheval, j'ignorais que ce fût à vous que je rendais ce service, car la nuit était trop sombre, et j'étais trop éloigné de vous pour vous reconnaître.
—Vous me confondez, señor, vous m'effrayez même en me parlant ainsi; comment vous étiez-vous mis à ma recherche, quel intérêt si grand aviez-vous donc à me rencontrer?
—Rassurez-vous, señorita, et pardonnez-moi si je vous parle comme je le fais; mon intention n'est point de vous effrayer, au contraire; un seul mot vous instruira de mes intentions, et, j'en suis convaincu, me fera obtenir votre confiance.
—Parlez, au nom du ciel, señor.
—Señorita, j'ai juré cette nuit même au colonel don Pablo de Zúñiga, qui m'a généreusement donné la vie, que je lui ramènerais miss Anna Prescott. Me comprenez-vous maintenant, señorita? Est-il besoin de plus amples explications?
—Oh! mon cousin! mon cher et loyal don Pablo! s'écria-t-elle avec élan; où est-il?
—A quelques lieues d'ici à peine, avec votre père; arrivé trop tard pour vous sauver, il vous a vengée, du moins, et d'une façon terrible.
—Et mon père? Parlez-moi de mon père.
—Votre père est sain et sauf, señorita, auprès de don Pablo, je vous le répète; mais son désespoir est grand, car il ignore où vous êtes et ce qui vous est arrivé.
—Oh! je ne veux pas demeurer un instant de plus ici; conduisez-moi auprès de mon père.
—Vous avez donc confiance en moi, à présent, señorita?
—Oui, confiance entière. Ne venez-vous pas de la part de don Pablo de Zúñiga?
—C'est vrai, señorita, dit-il avec un sourire.
—Partons, partons le plus tôt possible.
—Croyez-vous que vos forces soient assez revenues pour faire une longue traite à cheval, señorita? Peut-être vaudrait-il mieux attendre encore une heure ou deux.
—Non, pas une seconde; partons, je vous en prie.
—Je vous obéis, señorita, répondit-il en s'inclinant; dans dix minutes les chevaux seront sellés.
—Merci... Attendez! Pensez-vous pouvoir vous procurer un cheval dans ce pueblo?
—Le vôtre est frais et reposé, señorita.
—Aussi n'est-ce pas pour moi, répondit-elle en souriant; c'est pour cette chère enfant.
—Pour moi, señorita! dit Anita avec une surprise joyeuse.
—Oui, je vous emmène avec moi; j'espère avant peu vous rendre votre mari.
—Oh! señora, fit-elle en tombant à ses genoux et en baisant ses mains avec effusion, que vous êtes bonne et que je vous aime!
—Relevez-vous, chère petite, ne pleurez pas. Bientôt vous serez heureuse, je vous le promets. Je n'aime pas les dettes, ajouta-t-elle avec un charmant sourire, et je veux m'acquitter avec vous. Ainsi c'est convenu, hâtez-vous de faire vos préparatifs, nous n'avons pas de temps à perdre.
Ainsi qu'il l'avait promis à miss Anna, Matadiez, car nos lecteurs ont sans doute reconnu déjà ce digne personnage, revint au rancho, conduisant par la bride trois chevaux soigneusement sellés et harnachés.
—Partons! s'écria joyeusement la jeune fille, et elle s'élança vers la porte.
—Attendez! dit tout à coup Matadiez en la retenant par le bras, il se passe dans le pueblo quelque chose d'extraordinaire; laissez-moi m'informer.
Et il sortit sans attendre la réponse de la jeune fille.
En effet, une rumeur étrange de cris et de trépignements de chevaux, mêlés à des rires et à des blasphèmes, se faisait entendre au dehors.
Matadiez, ainsi que nous l'avons dit, surpris des rumeurs subites et de mauvais augure qui s'étaient élevées dans le village, s'était précipité au dehors, dans le but d'obtenir des renseignements et de rassurer miss Anna, qu'il avait laissée inquiète et soucieuse dans la chambre, interrompue dans ses préparatifs de départ. Mais à peine eut-il mis le pied dans la rue, que la surprise le cloua stupéfait sur le seuil même du rancho au spectacle étrange qui s'offrit soudain à ses regards, stupéfaction qui ne tarda pas à se changer en épouvante lorsque lui fut révélée toute la portée de l'événement qui s'était accompli en si peu d'instants et s'était, comme un coup de foudre, abattu sur le malheureux village.
Une troupe nombreuse de cavaliers, qu'à leur costume il était facile de reconnaître pour des soldats des États-Unis, avait fait irruption dans le pueblo, dont elle gardait toutes les issues.
Un bivouac avait immédiatement été établi sur la place même du village, et pendant que les soldats visitaient tous les ranchos afin de s'approvisionner des vivres dont ils avaient besoin, ou s'emparer sans scrupule des objets de valeur que le hasard ferait tomber dans leurs mains, le commandant du détachement entouré de quelques officiers, avait fait comparaître devant lui l'alcade et le curé du pueblo, auprès desquels il s'informait des ressources de la population.
Ce commandant était un jeune homme de haute mine, aux traits sombres et aux regards perçants; il parlait le castillan avec une grande facilité, et, tout en interrogeant les deux hommes tremblants devant lui, il mâchonnait d'un air préoccupé le bout de son cigare et jouait avec la dragonne de son sabre; probablement il n'écoutait pas les réponses faites aux questions qu'il adressait, son esprit était ailleurs.
Les Mexicains, sans armes et surpris à l'improviste par cette invasion subite d'ennemis qu'ils étaient loin de supposer aussi près d'eux, ne comprenaient rien à ce qui leur arrivait, épouvantés surtout à la vue d'hommes qu'on leur avait représentés comme étant des hérétiques relaps, sans foi ni loi, tenant bien plus du démon que de la race humaine, se signaient avec désespoir, adressaient de ferventes prières au ciel, et, dans l'impossibilité reconnue d'opposer la moindre résistance, assistaient, muets, sombres et résignés, en apparence, au pillage de leurs pauvres demeures, tandis que leurs femmes, moins patientes, poussaient des cris de détresse et résistaient de toutes leurs forces aux exigences souvent exorbitantes des soldats qui les repoussaient en riant et continuaient, avec cette impassible persévérance qui distingue leur nation, à piller et à briser ce qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient point emporter avec eux.
Ces soldats ne semblaient appartenir à aucun corps régulier; c'étaient évidemment des coureurs et des batteurs d'estrade de l'armée américaine. Mais comment avaient-ils osé s'aventurer aussi loin de leur quartier-général dans un pays où tout devait leur être hostile? Voici ce que Matadiez, qui, après tout, était un drôle intelligent et surtout très avisé, cherchait en vain à deviner.
Cependant, le pillage, organisé sur une grande échelle, s'exécutait avec un ensemble et une régularité qui témoignaient de la longue expérience acquise par ces braves gens en pareille matière; les choses se passaient avec une connaissance approfondie des ressources des malheureux Indiens et des moyens à employer pour les dépouiller complètement sans cependant leur faire jeter les hauts cris, que le digne Mexicain, saisi d'admiration pour une si magnifique manière de procéder, fut contraint de s'avouer humblement à lui-même son incontestable infériorité.
Matadiez, poussé malgré lui par la curiosité, et surtout fort inquiet, avait machinalement fait quelques pas en avant et était ainsi arrivé, sans même y prendre garde, jusqu'au milieu de la place, où le chef des Américains continuait, à bâtons rompus, l'interrogatoire de l'alcade et du curé.
Tout à coup, les yeux du jeune officier tombèrent par hasard sur le bandit; il tressaillit; sa physionomie s'éclaira; ses yeux lancèrent une lueur étrange et laissant là, sans plus y songer, l'alcade et le curé, il s'élança sur le Mexicain et lui posa rudement la main sur l'épaule.
—Pardieu! s'écria-t-il, la rencontre est heureuse, car c'est vous que je cherche, mon drôle.
—Hein! répondit le Mexicain au comble de la surprise, et cherchant vainement à reconnaître son singulier interlocuteur, vous me cherchez, moi, señor, et pour quel motif, sainte Vierge!
—Tu vas le savoir, et d'abord, que fais-tu ici? Comment y es-tu venu? Es-tu seul?
—Voilà bien des questions à la fois, señor, répondit froidement le Mexicain; je ne suis plus jeune, j'ai toujours remarqué qu'il était beaucoup plus facile d'adresser des questions que d'y répondre, et surtout qu'on ne se compromettait jamais en gardant le silence; vous trouverez donc bon, s'il vous plaît, que ma bouche demeure close au moins jusqu'à ce que je sache quel est le noble cavalier qui me fait ainsi l'honneur de m'interroger.
L'officier se mit à rire.
—Allons, reprit-il, tu es un drôle avisé; c'est bon, nous nous entendrons bientôt.
—C'est possible; mais j'en doute.
—Peut-être, aie patience, dans un instant je suis à toi.
Se retournant alors vers ses officiers, qui l'avaient rejoint et se tenaient immobiles derrière lui:
—Messieurs, reprit-il, veillez à ce que l'ordre ne soit pas troublé et qu'on n'écorche pas trop ces pauvres diables. Si la guerre a des exigences, n'oublions pas que nous sommes des gentlemen, et devons agir comme tels. Je vous recommande la plus grande vigilance; que personne, sans mon autorisation, ne puisse s'échapper du village, que chacun soit prêt à sauter en selle au premier signal; Quant à vous, señores, ajouta-t-il en s'adressant à l'alcade et au curé, rentrez paisiblement dans vos demeures, exhortez les habitants à être soumis et calmes. A la moindre apparence de trahison, je brûle le village. Vous m'avez bien compris, donc, soyez prudents. Adieu.
Les officiers se retirèrent d'un côté, les Mexicains de l'autre, le commandant et Matadiez demeurèrent seuls.
Le bandit avait assisté avec une curiosité croissante à cette scène. Parfois, il lui avait semblé que la voix de l'homme qui donnait des ordres si péremptoires ne lui était pas inconnue, mais vainement il avait essayé de se rappeler où et dans quelles circonstances ces notes stridentes et railleuses avaient déjà frappé son oreille.
—Là, reprit l'officier dès qu'ils furent seuls; maintenant, à nous deux, mon maître, tu dis donc que tu ne me reconnais pas?
—Ma foi non; et, à ce propos, s'il vous était égal de ne point me tutoyer, cela me serait agréable.
—Oh! oh! le señor Matadiez est susceptible, à ce qu'il me semble.
—Non, je suis caballero, et je désire être traité comme tel, voilà tout.
—Soit, fit-il en riant, nous ne chicanerons point là-dessus; maintenant, venons au fait.
—Je ne demande pas mieux, de cette façon, j'apprendrai peut-être quelque chose.
—C'est du choc que jaillit la lumière, dit l'autre en raillant.
Matadiez se redressa d'un air offensé.
—Caballero, dit-il sèchement, vos façons de converser ont le privilège de m'agacer extraordinairement les nerfs; la patience n'est point comptée au nombre de mes qualités; je n'aime pas les railleurs, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent. Peu m'importe comment vous êtes parvenu à savoir mon nom, qui, d'ailleurs, jouit, je m'en flatte, d'une certaine célébrité; mais il y a un fait qui, pour moi, est positif, c'est que je n'ai point l'honneur de vous connaître et par conséquent rien à vous dire et rien à écouter de vous; donc, je vous prie de me laisser tranquille et d'aller à vos affaires sans vous occuper des miennes, qui ne vous regardent aucunement.
—Eh bien! voilà le malheur, cher señor Matadiez, reprit l'autre sans quitter cette intonation railleuse qui avait le privilège de si fort agacer le Mexicain, c'est qu'au contraire vos affaires me regardent non seulement beaucoup, mais qu'en ce moment elles sont les miennes.
—Ah! par exemple! s'écria le Mexicain.
—Du calme, mon maître, interrompit l'autre en riant; vous ne tarderez pas à me comprendre; ne vous ai-je pas dit que je vous cherchais?
—En effet, mais je n'en ai pas cru un mot.
—Vous avez eu tort, car c'est la vérité. Puis changeant de ton subitement: Pardieu, cher señor Matadiez, il faut avouer que vous avez la mémoire bien courte; prenez garde, c'est un grand malheur en affaires que je manque de mémoire.
—Allons, il paraît que les énigmes vont recommencer, fit le Mexicain avec résignation.
—Pas le moins du monde, je m'explique, au contraire.
—Dieu le veuille!
—Écoutez-moi avec attention.
—Je ne fais que cela depuis une demi-heure, et je veux perdre ma place en Paradis si je suis plus avancé qu'au premier mot.
—C'est que vous avez oublié l'affaire qui vous a été proposée à San Luis de Potosí, voilà tout.
—Hein? s'écria-t-il avec surprise.
—Ah! ah! la mémoire vous revient, à ce qu'il paraît.
—C'est possible, continuez.
—Vous avez oublié aussi le cavalier qui vous est venu trouver au Voladero del Macho?
—Comment, il se pourrait que ce fût...?
—Moi, pardieu! Allons donc, vous vous souvenez maintenant.
—En effet, mais qui me prouve...
—Que je ne vous trompe pas?
—C'est ce que j'allais dire.
—Ceci. Et sortant une longue bourse de son dolman, il la lui mit dans la main; la reconnaissez-vous? dit-il.
—Oui, c'est bien la même, répondit le Mexicain en examinant minutieusement la bourse plutôt pour se donner le temps de réfléchir que pour éclaircir des doutes qu'il ne conservait pas, car depuis quelques instants ses soupçons s'étaient fixés, et il avait reconnu le personnage mystérieux en face duquel il s'était trouvé plusieurs fois déjà; veuillez reprendre cette bourse, ajouta-t-il en la lui présentant.
—Allons donc! fit le jeune homme en repoussant son bras; elle est en de trop bonnes mains; veuillez la conserver en souvenir de moi, caballero.
Matadiez salua et fit disparaître la bourse dans sa poche.
La situation se compliquait étrangement; il était évident que le jeune officier, maître du village qu'il avait fait complètement cerner par sa troupe, rendrait toute fuite impossible; d'un autre côté, une indiscrétion pouvait, d'un moment à l'autre, lui apprendre la présence de miss Anna, que, du reste, une visite domiciliaire ferait facilement découvrir; Matadiez, homme de ressources cependant, était forcé de convenir tout bas que son esprit ordinairement si fertile en expédients lui faisait complètement défaut dans la circonstance présente.
Durant le cours de toute son existence, et Dieu sait si elle avait été émaillée d'accidents de toutes sortes, il ne s'était jamais vu aussi embarrassé pour commettre une mauvaise action qu'il l'était cette fois pour en faire une bonne.
Décidément le métier d'honnête homme ne lui réussissait pas; en somme, il ne savait comment se retirer du mauvais pas dans lequel un malencontreux hasard lui avait joué le tour de le jeter.
Le jeune officier l'examinait d'un air narquois, en fixant sur lui, avec une persévérance fatigante, ses yeux perçants qui semblaient vouloir lui arracher ses plus secrètes pensées du cœur; peut-être déjà avait-il des soupçons?
Matadiez le craignit; il comprit que toute hésitation le perdrait sans ressource; il se résolut à tenter un grand coup et à jouer, ainsi qu'on le dit vulgairement, le tout pour le tout.
La grande force des Mexicains réside surtout dans leur finesse; nul ne saurait lutter de ruse avec eux. Comme toutes les races métisses longtemps courbées sous le joug énervant de l'esclavage, ils ont fait de la fourberie leur arme principale, et là où l'audace leur serait plutôt nuisible que profitable, ils se replient sur eux-mêmes, affectent une bonhomie narquoise, prennent les manières félines du chat sauvage, se courbent humblement devant ceux qu'ils veulent tromper, et, ouvrant l'arsenal si complet de leur astuce, ils engagent résolument la lutte dont neuf fois sur dix ils sortent vainqueurs, car ils réussissent à se faire si plats en apparence qu'on dédaigne de les écraser et que rien ne semble aussi facile que d'en obtenir ce qu'on désire.
Sa résolution une fois arrêtée, Matadiez prit tout à coup une physionomie si souriante et si aimable que l'officier américain, ne sachant à quoi attribuer ce changement subit, et que rien ne motivait en apparence, lui jeta un regard soupçonneux dont le Mexicain, du reste, ne sembla aucunement se préoccuper.
—Caray! s'écria-t-il d'une voix joyeuse, que la Sainte-Vierge de la Guadalupe soit mille fois bénie!
—Je n'y vois aucun inconvénient, répondit sérieusement le jeune homme; mais pour quel motif, s'il vous plaît?
—Oh! pour une raison bien simple, caballero; c'est que si vous me cherchiez, de mon côté je vous cherchais, moi aussi, et que c'est sûrement à son intervention toute-puissante que je dois de vous avoir rencontré.
—Trêve de verbiage, et venez au fait, je vous prie: je suppose que les événements qui se sont passés n'ont rien qui doive vous engager à témoigner une si grande joie de notre rencontre.
—J'ignore à quels événements vous faites allusion, caballero.
—Comment, vous l'ignorez! Allons donc, vous vous jouez audacieusement de moi, mon maître; Pour quelle raison aurais-je poussé une pointe aussi loin des avant-postes américains et me serais-je aventuré au milieu d'une population hostile dont j'ai tout à redouter; si ce n'est pour essayer de réparer votre maladresse de cette nuit.
Le señor Matadiez esquissa un sourire charmant sur ses lèvres minces.
—Bon, nous voilà retombés dans les énigmes, dit-il; à votre aise, caballero, j'ai le temps de vous écouter.
—Prenez garde, maître coquin! s'écria rudement le jeune homme en lui jetant un regard de travers, je n'aime pas servir de plastron aux mauvais plaisants; ne vous jouez pas de moi, car sur mon âme, avant cinq minutes vous serez branché, je vous en avertis; il y a des arbres magnifiques aux environs.
—Je les ai vus, répondit froidement le Mexicain; mais bien qu'ils soient nombreux, il n'y en a pas un seul parmi eux qui puisse me servir.
—C'est ce que nous verrons, si vous ne vous expliquez pas, reprit le jeune homme en frappant du pied avec colère; voyons, oui ou non, n'avez-vous pas été surpris par les rancheros au Voladero del Macho?
—Je dois convenir qu'il y a du vrai dans ce que vous dites, caballero.
—Pardieu, je l'ai traversé il y a deux heures, et j'ai vu, déjà à demi dévorés par les coyotes, les cadavres de tous vos compagnons.
—Pauvres amis, dit hypocritement le Mexicain, ce que c'est que de nous, tous gaillards solides, choisis par moi avec un soin extrême; mais parmi ces cadavres, vous n'avez pas vu le mien, je suppose.
—Raillez-vous, cuerpo del Cristo, mon maître?
Le bandit prit une pose majestueuse.
—Nullement, Seigneurie; seulement j'admire avec quelle facilité vous vous laissez tromper par les apparences, et combien est mince la confiance que vous mettez dans l'esprit des gens que vous employez. Où sommes-nous ici?
—Pardieu! vous le savez aussi bien que moi, au Pueblo del Miaz.
—Eh bien! n'est-ce pas ici ou aux environs que vous deviez nous attendre une fois l'expédition terminée?
—Oui, cela avait été convenu ainsi. Malédiction, pourquoi suis-je arrivé une demi-heure trop tard au voladero, ces rancheros damnés auraient trouvé à qui parler, et les choses se seraient passées autrement.
—Peut-être vaut-il mieux qu'il n'en soit pas ainsi, puisque me voilà.
—Oui, mais seul.
—Allons donc, reprit en riant le Mexicain; est-ce que Votre Seigneurie me ferait l'injustice de me prendre pour un imbécile, par hasard?
—Que voulez-vous dire? s'écria le jeune homme haletant d'impatience.
—Je veux dire, caballero, que tout est pour le mieux; mes compagnons sont morts, il est vrai; eh bien, le cas échéant, ce sont des témoins qui ne seront plus à craindre.
—Que m'importe cela? dit-il avec dédain.
—Bon, il ne faut rien négliger en affaires à quoi m'étais-je engagé envers vous, caballero?
—A me livrer la jeune fille, demonios!
—Eh bien! si je vous la livre?
—Oui, mais quand? Voilà la question; elle est maintenant sur ses gardes, une occasion comme celle de cette nuit ne se retrouvera peut-être jamais.
—Bah! il ne s'agit pas de cela; je reprends donc. Je me suis engagé de vous livrer la jeune fille, n'est-ce pas?
—Oui, mille fois oui, misérable!
—Pas de gros mots, Seigneurie; les épithètes malsonnantes n'avancent jamais les choses; de votre côté, vous vous êtes engagé à me compter une certaine somme.
—Certes, et le moment venu de le faire je n'hésiterai pas.
—Eh bien! j'attends.
—Vous attendez quoi!
—Canarios! j'attends que vous me comptiez la somme convenue, puisque j'ai enlevé la jeune fille.
Le jeune homme, à cette exclamation subite, demeura un instant comme foudroyé.
—Vous? murmura-t-il.
—Dame, qui donc? Ce n'est pas vous, probablement, Seigneurie.
—Ainsi?
—Elle est ici.
—Dans ce village?
—A deux pas.
—Courons! s'écria-t-il avec explosion.
—Un instant, dit le Mexicain, en le retenant par le bras. Les affaires sont les affaires; terminons d'abord les nôtres. Où est mon argent?
Le jeune homme s'arrêta.
—Vous ne supposez point, n'est-ce pas, que je porte sur moi une pareille somme.
—C'est vrai; mais alors, comment me payerez-vous? Je ne vous connais pas, moi, Seigneurie.
—Vous avez raison; écoutez, je suis homme d'honneur, vous m'accompagnerez jusqu'au quartier général, et là, je vous solderai.
Le Mexicain hocha la tête d'un air mécontent.
—Hum! c'est bien chanceux, dit-il.
—Comment, drôle, vous doutez de la parole d'un gentleman?
—D'abord, cette parole, vous ne me l'avez pas donnée; ensuite, si bonne que soit une parole échangée entre caballeros, en affaires elle ne signifie pas grand-chose.
—Que voulez-vous?
Matadiez feignit de réfléchir.
—En finirez-vous? s'écria le jeune homme avec colère.
—Ne nous fâchons pas, Seigneurie, vous avez des tablettes quelconques, n'est-ce pas? Eh bien, déchirez une feuille de papier et faites-moi une reconnaissance de la somme que vous me devez en stipulant, en toutes lettres, quelle a été la dette contractée envers moi; signez cette reconnaissance de votre nom, cela me suffira.
Le jeune officier fixa sur le Mexicain un regard soupçonneux.
—A quoi bon? répondit-il.
—A me faire payer, pas autre chose, répondit l'autre avec une simplicité si bien jouée, que le jeune homme s'y trompa.
—Soit, dit-il au bout d'un instant.
Et retirant un portefeuille de sa poitrine, il libella en langue espagnole la reconnaissance que lui demandait le bandit, pendant que celui-ci lisait par-dessus son épaule.
Cette reconnaissance était ainsi conçue:
« A présentation, je paierai au señor don Pedro « de Arizona, dit Matadiez, la somme de vingt « mille piastres fortes, pour avoir enlevé, d'après « mon ordre exprès, la señora doña Anna Prescott, « au Voladero del Macho.
«El Miaz, le 14 février 1847.
«WILLIAMS STUART DE CLAIRFONTAINE,
« Capitaine commandant un escadron de volontaires dans « l'armée des États-Unis. »
—Est-ce bien ainsi, dit-il, en présentant le papier au Mexicain.
—Très bien, seigneurie; seulement, je vous serai obligé de m'en faire un double en anglais: on ne sait ce qui peut arriver.
Le jeune homme haussa les épaules, mais il s'exécuta.
—Bon, reprit le Mexicain, en pliant les deux papiers et les serrant soigneusement dans sa poche, c'est plaisir de traiter avec vous, Seigneurie; maintenant, veuillez me donner un sauf-conduit.
—Pourquoi faire?
—Dame! pour que je ne sois pas arrêté comme espion, lorsque je me présenterai aux avant-postes de votre armée en allant réclamer mon argent.
—C'est juste. Et il écrivit le sauf-conduit; cette reconnaissance vous est inutile, ma parole était plus que suffisante, ajouta-t-il. Si une intention de trahison vous a engagé à me la demander, ce papier ne vous servira guère, je vous en avertis; je n'ai rien à redouter de qui que ce soit au monde.
Matadiez serra sans répondre le sauf-conduit, aussi précieusement qu'il avait précédemment enfermé la reconnaissance.
—Maintenant que vous avez rempli votre engagement; Seigneurie, dit-il, à moi de remplir le mien, suivez-moi.
Il marcha droit au rancho, dont il ouvrit la porte.
—Voilà la jeune fille, dit-il froidement, en montrant miss Anna debout et inquiète au milieu de la chambre.
—Ciel! s'écria-t-elle en reculant avec épouvante devant le jeune officier qui entrait paisiblement dans le rancho. Cet homme ici! je suis perdue!
Et elle s'affaissa à demi évanouie dans les bras d'Anita, qui s'était élancée pour la soutenir.
—Enfin! murmura l'Américain avec un mauvais sourire, je la tiens donc en mon pouvoir.
La Prisonnière.
L'officier américain, sans paraître remarquer l'émotion causée à la jeune fille par son entrée si imprévue, demeurait calme et froid devant elle, attendant paisiblement qu'elle eût repris assez de connaissance, non pas pour causer avec lui, il ne se flattait pas d'obtenir dans les circonstances présentes la faveur d'un entretien avec sa cousine, mais qu'elle pût répondre à ses questions.
Miss Anna était une nature vaillante, un cœur brave. Par un effort suprême de volonté, elle comprima en dedans d'elle-même l'émotion terrible qui lui tordait si douloureusement le cœur, et au bout de quelques minutes à peine, écartant du geste la jeune Indienne qui lui prodiguait les soins les plus délicats, elle se redressa majestueuse et sombre devant son cousin, qu'elle écrasa d'un dédaigneux sourire.
—Très bien, mon cousin, dit-elle avec une expression impossible à rendre, vous êtes homme d'imagination, car vous avez trouvé un merveilleux moyen d'obtenir de moi une entrevue.
—Le moment serait mal choisi et le lieu peu convenable, ma cousine, répondit-il en s'inclinant avec une ironique courtoisie.
—Cependant, continua-t-elle comme si elle ne l'eût pas entendu, peut-être aurait-il été plus digne de vous et de moi de me faire prévenir de votre arrivée dans ce pueblo, afin de me laisser le temps de me préparer à une aussi agréable visite; les dames n'aiment pas à être surprises; vous ne l'ignorez pas, sans doute.
—Vous m'excuserez, ma cousine, répondit le jeune homme sur le même ton, j'arrive à l'instant et j'avais une hâte si grande de vous voir...
—Que vous avez oublié les convenances, fit-elle avec amertume; soit, je vous excuse; maintenant, un mot, s'il vous plaît.
—Parlez, ma cousine.
—En quelle qualité vous présentez-vous devant moi?
—Je ne vous comprends pas, ma cousine.
—Cela m'étonne, mon cousin, que vous, dont l'esprit est si subtil, vous ne saisissiez pas ainsi ma pensée au premier mot; cependant, s'il le faut absolument, je m'expliquerai.
—J'en serai heureux, ma cousine.
—Vous savez que j'ai pour habitude de toujours marcher droit au but.
Le jeune homme s'inclina silencieusement.
—Donc je réitère ma question, et, pour plus de clarté, je la complète: en quelle qualité vous présentez-vous chez moi, est-ce comme parent ou comme vainqueur?
Et après lui avoir parlé ainsi d'une voix ferme et vibrante, la vaillante jeune fille le regarda bien en face.
M. de Clairfontaine ne put s'empêcher de rougir en se voyant si bien deviné et si nettement mis en demeure; cependant, après quelques secondes d'hésitation, il se résolut à accepter le combat que miss Anna lui offrait si franchement, et il répondit d'une voix un peu sèche, bien que l'accent en fût toujours respectueux:
—Vous seule, ma cousine, déciderez cette question, car de vous seule dépendra que je sois pour vous un parent ou un vainqueur; d'ailleurs, n'êtes-vous pas Mexicaine, tandis que moi, au contraire, je suis citoyen des États-Unis.
—Bien, fit-elle avec un sourire dédaigneux, votre franchise égale la mienne; je préfère cela, au moins notre position réciproque sera bientôt nettement dessinée. Ainsi, vous faites la guerre aux dames; cela est peu galant, mon cousin.
—Nous faisons la guerre à tous nos ennemis, quels qu'ils soient.
—De mieux en mieux. Allons il paraît que vous me rangez au nombre de vos ennemis; je vous remercie, mon cousin.
Le jeune homme se mordit les lèvres avec colère; il comprit qu'il s'était laissé entraîner sur un terrain où il lui serait impossible de lutter avec avantage; le dépit le rendit brutal.
—Trêve de raillerie, ma cousine, dit-il, aussi bien mieux vaut-il en finir. Provisoirement considérez-vous comme étant ma prisonnière et veuillez en conséquence vous préparer à me suivre au quartier général de l'armée.
—Il paraît que vous êtes devenu, de gentleman, bandit. Je n'insisterai pas davantage; je ne vous connais plus, Monsieur; la seule prière que je vous adresse est de me traiter avec les égards que mérite une femme de mon rang.
—Les égards ne vous manqueront pas, autant du moins, ajouta-il avec intention, qu'ils n'entraveront pas la surveillance active dont vous serez l'objet.
—C'est un si redoutable ennemi qu'une femme! mais rassurez-vous, puisque ceux sur le dévouement desquels je comptais m'ont lâchement abandonnée, je n'essaierai point de vous échapper.
Ces dernières paroles, accompagnées d'un regard foudroyant, s'adressaient évidemment à Matadiez; il le comprit et baissa les yeux avec confusion.
—Maintenant, Monsieur, continua-t-elle, veuillez me laisser; je serai prête à vous suivre à votre première injonction.
—Je vous obéis, madame, répondit-il avec un sourire railleur; mais comme j'ai de graves motifs pour n'avoir qu'une confiance médiocre en votre parole, je laisse ici cet homme. Il me répondra de vous.
Et il désigna du geste le Mexicain, toujours immobile auprès de la porte.
Miss Anna ouvrait la bouche pour répondre et probablement pour refuser cette sentinelle qu'on lui imposait si impérieusement, mais Matadiez lui fit un signe de prière d'une expression si douce et si touchante, qu'elle se tut et se borna à s'incliner avec dédain.
—A bientôt, señorita, reprit le jeune homme en lui lançant un regard furieux.
Et il sortit en repoussant avec force la porte derrière lui.
La jeune fille s'affaissa accablée sur un siège, cacha sa tête dans ses mains et fondit en larmes. L'excitation nerveuse qui l'avait soutenue pendant tout le temps qu'avait duré son entrevue avec son cousin l'avait abandonnée dès qu'elle s'était trouvée seule, et les sanglots si longtemps refoulés dans son cœur lui déchirèrent la poitrine et éclatèrent subitement.
La pauvre enfant connaissait depuis longtemps le caractère implacable de l'homme aux mains duquel elle était livrée; elle était seule, loin des êtres qui l'aimaient. Le désespoir la prit, car elle se sentit bien réellement perdue; la pensée de la mort traversa son esprit comme le seul refuge qui lui restât.
A peine l'officier américain eût-il quitté le rancho, que Matadiez s'élança vers la porte, la ferma solidement en dedans, puis il vint s'agenouiller devant miss Anna.
—Señorita, lui dit-il d'une voix humble avec l'accent de la plus vive affliction, ne m'adressez ni reproches, ni récriminations; je ne vous ai pas trahie, ainsi que vous le supposez; je vous suis fidèle, et je donnerais avec joie ma vie pour vous. Les circonstances ont été plus fortes que ma volonté; j'ai été contraint de me courber sous le poids de la nécessité. Vos larmes me brûlent le cœur; croyez à mon dévouement à toute épreuve, j'ai juré de vous sauver et je vous sauverai; comment, je l'ignore; mais, dussé-je payer votre liberté de ma vie, vous serez libre.
La jeune fille releva doucement la tête, et fixant sur lui ses yeux avec une expression impossible à rendre:
—Et pourtant vous m'avez trahie, lui dit-elle d'une voix entrecoupée par les sanglots.
—En apparence, oui, señorita reprit-il vivement, mais pour vous sauver plus tard. Que pouvais-je faire seul contre deux cents soldats qui se sont emparés du village et sont maîtres de toutes les routes? La force m'aurait perdu, et vous avec moi: sans espoir, j'ai agi de ruse et feint de vous abandonner; vous doutez encore? Voulez-vous que je me fasse tuer à cette porte pour vous défendre quand votre ennemi viendra vous intimer l'ordre de le suivre? dites un mot, et vous serez obéie.
Anita, qui pleurait, elle aussi, auprès de la jeune fille que déjà elle considérait comme sa maîtresse, lui prit les mains, et les baisant avec une respectueuse tendresse:
—Ayez foi en lui, señorita, lui dit-elle avec prière; quel intérêt aurait-il à vous tromper en ce moment? Il vous est réellement dévoué, j'en suis convaincue.
Miss Anna hocha tristement la tête comme si l'espoir avait à jamais fui de son cœur.
—Quel est votre projet? murmura-t-elle d'une voix languissante.
—Je veux vous sauver, señorita, répondit-il avec énergie, et je vous répète que je vous sauverai! Quant aux moyens que j'emploierai pour réussir, je l'ignore encore, mon cœur est bourrelé, je cherche en vain une idée raisonnable, mais ayez confiance en moi.
—Eh bien soit; je me fie à vous, mon ami; d'ailleurs, n'êtes-vous pas la seule personne qui paraissez vous intéresser à ma douleur; j'accepte le dévouement que vous m'offrez.
—Merci, señorita, répondit le Mexicain avec émotion; je saurai vous prouver que je suis digne de votre confiance.
—Que faut-il faire?
—Rien, en ce moment; la partie est perdue pour vous. Nous allons en engager une seconde, et celle-là, croyez-le bien, nous la gagnerons, quoi qu'il arrive; feignez d'être résignée à votre sort, essuyez vos larmes, ne montrez aucune faiblesse, suivez sans observation cet homme où il lui plaira de vous conduire; essayer de lutter contre lui serait tout perdre; s'il vous est possible de surmonter votre juste indignation contre votre ennemi, parlez-lui doucement et sans amertume.
—J'essaierai de me conformer à vos recommandations, mon ami; mais cela me sera bien difficile.
—Il le faut cependant, señorita; il est de la plus haute importance pour vous de le tromper en lui donnant le change sur vos intentions et en lui laissant supposer que vous renoncez à lutter plus longtemps contre lui.
—Hélas! murmura-t-elle douloureusement.
—De plus, quoi que vous me voyiez faire ou m'entendiez dire, ne vous étonnez pas, et surtout ne soupçonnez point mon dévouement; si je demeure près de vous, ce qui est possible, mais ce que je tâcherai d'éviter, traitez-moi avec dureté, feignez surtout pour moi la plus grande répulsion; il ne faut pas qu'on puisse soupçonner la plus légère entente entre nous; je passe auprès de votre cousin pour vous avoir enlevée à votre père, et cela d'après les ordres qu'il m'a donnés lui-même à Potosí; donc, je suis et dois être votre ennemi.
—Je n'oublierai rien de ce que vous me dites; mais, hélas! je crains que tout ce que vous tenterez pour me sauver ne soit inutile.
—Señorita, ayez confiance en Dieu, il ne vous abandonnera pas, lui dit doucement la jeune Indienne.
—Dieu, chère mignonne, répondit-elle avec accablement; hélas! il est mon seul refuge, maintenant que je suis abandonnée de tous.
—Ne voulez-vous donc plus que je vous suive, señorita?
—Quoi! tu consentirais encore à m'accompagner et à partager ma mauvaise fortune?
—Ah! señorita, en auriez-vous douté?
—Non, tu as raison, je suis folle, chère enfant, tu es bonne et tu m'aimes, ce sera une immense consolation de sentir ton cœur ami battre près du mien. Tu ne me quitteras pas.
—Que je vous remercie, señorita, de consentir à me garder avec vous.
—Sans compter, reprit Matadiez, que par l'entremise de cette enfant, il me sera facile, señorita, de vous faire passer les renseignements dont, sans doute, vous aurez besoin, pour être prête lorsque le moment sera venu, et aider de votre côté à votre délivrance en secondant mes efforts.
—C'est juste; peut-être ne tardera-t-on pas à venir. Un dernier service, mon ami.
—Parlez, señorita, que désirez-vous?
—Donnez-moi votre navaja.
—Ma navaja, s'écria-t-il avec étonnement, et qu'en voulez-vous faire, santa Virgin?
—Oh! rassurez-vous, répondit-elle avec un sourire triste; je ne vous la demande que comme défense au cas où il me faudrait me protéger moi-même contre l'homme qui m'a si audacieusement enlevée et dont j'ignore encore les projets sur moi, ajouta-t-elle avec amertume.
—C'est bien, señorita, répondit-il en lui présentant la navaja, voici ce que vous me demandez, Dieu veuille que vous ne soyez pas contrainte de vous en servir.
La jeune fille se saisit de l'arme avec un mouvement de joie fébrile, et après l'avoir examinée avec une curiosité douloureuse elle la cacha dans sa ceinture.
—Maintenant, murmura-t-elle les sourcils froncés et les lèvres tremblantes d'une émotion intérieure; je n'ai plus rien à redouter, je saurai me sauvegarder, quoi qu'il arrive. Merci, mon ami; si les efforts que vous tenterez pour ma délivrance ne réussissent point, vous pouvez cependant compter sur ma reconnaissance éternelle, car vous m'avez fait le seul présent que j'ambitionnais. Depuis quelques moments, les bruits du dehors s'étaient augmentés; plusieurs appels de trompettes s'étaient fait entendre; le détachement américain se préparait, selon toute probabilité, à abandonner le village et à se replier en arrière.
Tout à coup plusieurs chevaux passèrent au galop dans la rue, des cris s'élevèrent et plusieurs coups de feu éclatèrent avec un crépitement sinistre.
—Eh! eh! fit Matadiez, nos amis arriveraient-ils? Les choses se simplifieraient singulièrement, si cela était.
—Nos amis! Que voulez-vous dire? s'écria la jeune fille avec anxiété.
—Don Pablo de Zúñiga est campé avec ses rancheros à quelques lieues d'ici à peine; il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ce fût lui qui arrivât.
Au même moment on frappa fortement à la porte du rancho.
—Au nom du ciel, s'écria Matadiez, soyez prudente, señorita.
Et il alla ouvrir la porte.
M. de Clairfontaine entra; plusieurs cavaliers le suivaient.
—Vous me pardonnerez de vous déranger si brusquement, señora, dit-il avec une politesse ironique, mais les circonstances m'y obligent; êtes-vous prête à me suivre?
—Ordonnez, Monsieur, répondit-elle avec soumission.
—Fort bien; il paraît que vous avez réfléchi et que vous comprenez l'inutilité de résister davantage. Je vous sais gré de ce changement heureux dans votre humeur. Nous partons à l'instant; votre cheval et celui de votre suivante sont sellés. Venez, je vous prie.
La jeune fille se leva sans répondre, s'enveloppa dans son rebozo et se dirigea vers la porte, suivie par Anita, dont les préparatifs de départ avaient été terminés en quelques minutes.
Les paysans mexicains sont en général si pauvres, que rien ne les attache au sol qui les a vus naître, et que c'est avec la plus complète indifférence qu'ils abandonnent leurs misérables chaumières où rien ne les retient.
Les cavaliers américains étaient à cheval et rangés en bon ordre dans la rue; un détachement d'une vingtaine d'hommes formant l'arrière-garde gardait l'extrémité du village, tiraillant contre un ennemi invisible encore.
Miss Anna et la jeune Indienne se mirent en selle. Matadiez avait quitté, lui aussi, le rancho et était monté sur son cheval.
—Pardon, señor, dit-il à M. de Clairfontaine, qu'il salua respectueusement, je crois que vous n'avez plus besoin de moi, maintenant.
—Pourquoi cette question? répondit brusquement le jeune homme.
—Parce que, comme vous quittez le pueblo, pour vous replier, selon toute probabilité, sur vos avant-postes, je vous demanderai la permission de m'en aller à mes affaires.
—Vous feriez mieux de nous accompagner jusqu'au camp, afin de toucher la somme que je vous dois, dit-il en fixant sur lui un regard perçant.
—Parlez-vous sérieusement? s'écria le Mexicain avec un vif mouvement de joie; s'il en est ainsi, j'accepte et je vais avec vous.
Malgré toute sa perspicacité, le jeune homme fut dupe du feint empressement du bandit, qui, sans insister davantage, avait déjà fait ranger son cheval auprès du sien; il se rapprocha de lui.
—Écoutez, lui dit-il, pouvez-vous être fidèle!
—C'est selon répondit-il nettement.
—Question de prix, n'est-ce pas?
—Vous avez deviné.
Les coups de feu se rapprochaient de plus en plus; plusieurs cavaliers avaient été démontés.
—Au galop! cria M. de Clairfontaine.
Les Américains s'élancèrent à toute bride dans la direction de San Nicolas, qui était le côté par lequel ils étaient arrivés.
Les deux femmes avaient été placées à l'avant-garde, entre six cavaliers chargés de veiller expressément sur elles. On sortit du village.
M. de Clairfontaine se haussa sur ses étriers et regarda en arrière.
L'arrière-garde opérait assez paisiblement sa retraite, suivie à longue distance par des cavaliers mexicains qui ne semblaient avancer qu'avec précaution. Le jeune homme sourit et, s'adressant de nouveau à Matadiez, qui était resté auprès de lui:
—Je vous ai demandé, reprit-il, si vous pouviez être fidèle?
—Et je vous ai répondu: « C'est selon, » dit froidement le bandit.
—Il est probable alors que nous nous entendrons.
—Je ne demande pas mieux.
—J'ai un marché à vous proposer.
—Un autre, alors, car nous en avons déjà un ensemble.
—Un autre, oui.
—Voyons ce marché.
—Vous avez reconnu sans doute les cavaliers qui tiraillent notre arrière-garde.
—Parfaitement.
—Quels sont ces cavaliers?
—Les rancheros de don Pablo de Zúñiga; des démons incarnés.
—Vous connaissez don Pablo de Zúñiga?
—Un peu.
—Ah! fit-il avec un regard soupçonneux, vous l'avez rencontré.
—Une fois, oui.
—Et...
—Et il a voulu me faire pendre.
—Cependant il ne vous a pas pendu?
—C'est vrai, mais j'ai eu la corde au cou, et il ne s'en est fallu que de bien peu que tout fût fini pour moi.
—Quel motif l'a fait changer d'avis si heureusement pour vous?
Le Mexicain sourit avec amertume.
—Après avoir enlevé doña Anna, séparé de mes compagnons, tués pour la plupart d'après ses ordres...
—Oui, j'ai vu leurs cadavres.
Le bandit s'inclina.
—Ne sachant trop à quel saint me vouer, reprit-il, je cachai la jeune fille dans une caverne où je l'enfermai après l'avoir bâillonnée et solidement attachée, et j'allai à la découverte pour chercher un passage. Ma mauvaise étoile voulut que, au moment où j'y pensais le moins, je donnasse juste au milieu de la troupe de don Pablo. Mon procès ne fut pas long, il me condamna immédiatement à être pendu.
—Très bien, mais tout cela ne me dit pas pourquoi vous ne l'avez point été.
—Parce que, reprit le bandit, dont le visage prit une expression d'astuce et de duplicité extraordinaire, voyant auprès de lui le señor Prescott, je devinai aussitôt le motif qui l'avait poussé à attaquer ma troupe; la crainte de la mort rend clairvoyant et surtout inventif; je fis comprendre à don Pablo que j'étais sûr de découvrir les traces de miss Anna, et que je la lui ramènerais.
—Il a accepté?
—Vous voyez, puisque je suis ici.
—C'est juste.
Tout cela avait été débité par le bandit sans sourciller, avec un aplomb et une assurance qui ne s'étaient pas une seconde démentis. Malgré toute sa finesse, M. de Clairfontaine s'y laissa prendre.
—Allons! c'est bien joué, dit-il.
—Vous êtes connaisseur, répondit le bandit en s'inclinant avec un respect ironique.
—Revenons à notre marché.
—Soit.
—Il faut nous quitter, couper à travers champs, tourner les rancheros et vous présenter à eux.
—Très bien! mais dans quel but?
—Dans celui de leur donner le change sur la direction suivie par miss Anna, et le lieu où elle se trouve.
—Bon! je comprends, mais cette fois, je suis certain d'être pendu.
—Bah! qui est-ce qui est pendu?
—Mais, beaucoup de monde, par le temps qui court.
—Enfin, c'est à prendre ou à laisser. Et il lui présenta une bague ornée d'un brillant magnifique.
—Je prends, répondit le bandit en passant la bague à un de ses doigts, Dieu me protégera!
—Espérons-le, dit le jeune homme; ainsi c'est convenu?
—Convenu.
—Mais pas de trahisons?
—Pour qui me prenez-vous; et mon argent?
—Vous viendrez le chercher ensuite au camp.
Le Mexicain fit un mouvement, mais se ravisant.
—Il me faudrait, pour donner plus de créance à mon histoire, dit-il, quelque chose qui eût appartenu à la jeune fille.
—Allons je vois que vous êtes un drôle intelligent.
—On le dit, répondit-il modestement.
M. de Clairfontaine s'approcha de miss Anna.
—Veuillez me remettre ce collier, ma cousine, lui dit-il.
—La jeune fille le regarda avec étonnement, mais elle obéit sans répondre, détacha le riche collier qu'elle portait au cou et le lui présenta.
—Merci. Tenez, dit-il à Matadiez, cette preuve suffira.
—Oui, répondit le Mexicain avec intention, don Pablo de Zúñiga reconnaîtra ce collier, j'en suis sûr.
La jeune fille tressaillit, et échangea à la dérobée un regard avec Matadiez. Dix minutes plus tard, ainsi que cela avait été convenu, à un tournant de la route, le bandit se jeta sous le couvert, où il ne tarda pas à disparaître.
Les Américains continuèrent leur retraite au galop.
Matadiez avait dit la vérité à M. de Clairfontaine, les cavaliers qui harcelaient l'arrière garde du détachement américain étaient réellement les rancheros de la cuadrilla de don Pablo de Zúñiga.
Voici ce qui s'était passé:
Après avoir fait subir au bandit l'interrogatoire dont nous avons rendu compte dans un précédent chapitre, interrogatoire qui s'était terminé pour Matadiez d'une manière beaucoup plus agréable qu'il n'avait osé s'en flatter, don Pablo, succombant enfin à la fatigue qui l'accablait, après s'être assuré que les sentinelles faisaient bonne garde, s'était roulé dans son zarapé, avait fermé les yeux et était enfin parvenu à s'endormir.
Le jeune homme dormit ainsi d'un sommeil fiévreux et agité, mille fois plus fatigant que la veille, pendant deux ou trois heures environ; cependant vers le matin, son esprit plus calme et ses nerfs détendus commençaient à lui permettre de jouir enfin d'un repos qui lui était si nécessaire, lorsqu'il fut brusquement réveillé par l'officier qui sous ses ordres commandait le détachement.
Cet officier était un jeune homme riche, dévoué corps et âme à don Pablo, avec lequel il avait été élevé et qui s'était décidé à faire cette campagne en qualité de volontaire, d'abord pour ne pas se séparer de son ami, et, de plus, parce qu'il avait senti son patriotisme s'exalter en voyant l'étranger envahir les frontières de son pays; il se nommait don Diego de Jalas, et il était Indien de pure race, descendant d'une ancienne famille de rancheros établie depuis de longues années sur la frontière comanche, à l'extrême limite des possessions mexicaines.
Don Pablo, réveillé en sursaut, fut debout en un instant.
—Que se passe-t-il donc de nouveau? demanda-t-il à son ami d'un ton assez maussade; ne pouvais-tu pas me laisser dormir une heure encore? Que le bon Dieu te bénisse de m'avoir réveillé ainsi!
—Merci, répondit en riant don Diego, tu n'as pas le sommeil caressant ce matin; mais ne m'en veux pas, ami, de ce que j'en fais, j'ai attendu autant que cela m'a été possible, et ce n'a été que lorsqu'il l'a fallu absolument que je me suis enfin décidé à troubler ton sommeil.
—Je ne t'en veux pas, mon cher don Diego, reprit-il en étouffant un bâillement, mais je dormais si bien, et puis tu le sais, ajouta-t-il avec tristesse, quand on dort, on oublie.
—C'est vrai, pauvre ami.
—Enfin, voilà qui est fait, maintenant je suis tout à toi, parle. Je t'écoute, la chose doit être grave.
—Je l'ignore encore; nos sentinelles ont aperçu un fort détachement de cavalerie qui s'avançait en bon ordre de notre côté.
—Ah! ceci est grave, en effet; et ce détachement, qu'est-il devenu?
—Il a fait halte à deux portées de fusil de nos avant-postes à peu près; il semble de son côté se méfier autant de nous que nous nous méfions de lui.
—Il fallait l'envoyer reconnaître par des batteurs d'estrade.
—Je n'y ai pas manqué; mais comme ils ne tarderont pas, selon toute probabilité, à rentrer, et que leur rapport peut être grave, je me suis décidé à t'éveiller afin que tu les interroges toi-même.
—Tu as bien fait, et je te remercie, d'autant plus que nous approchons de l'ennemi, et que nous ne savons point qui nous pouvons avoir pour voisins ainsi dans les ténèbres. Et M. Prescott est-il plus calme?
—Oui; il a beaucoup pleuré, ce qui l'a soulagé, en empêchant la douleur de l'abattre complètement. Maintenant, il dort sous un jacal que je lui ai fait préparer par quelques-uns de nos cavaliers.
—Fort bien; laissons-le dormir, c'est autant de gagné pour lui sur la souffrance; Pauvre père! Ah! pourquoi n'ai-je point réussi à sauver sa fille!
—La fatalité ne l'a point voulu; mais pourquoi désespérer?
—Hélas! perdue ainsi seule dans le désert, au milieu des ténèbres, que sera devenue la malheureuse enfant?
—C'est horrible! Si jeune, si belle! Courage mon ami.
—Eh! ce n'est point le courage qui me manque; j'ai l'habitude de la souffrance; mais mon cœur se brise en voyant la douleur de ce vieillard, douleur d'autant plus grande qu'elle est concentrée et qu'il ne la laisse pas s'épancher au dehors. Ces Anglais sont des natures de bronze que rien ne saurait dompter et qui ne tombent que foudroyés. Leur orgueil intraitable n'accepte ni les consolations ni les moindres marques d'intérêt. Maintenant que le coup lui a été porté, et Dieu sait s'il a été rude, tu verras en s'éveillant M. Prescott aussi froid et aussi calme en apparence que si rien ne s'était passé; et pourtant il aura la mort dans le cœur.
—Que faire alors?
—Rien quant à présent, mon ami, sinon se conformer à son humeur, et attendre que Dieu nous révèle ce qu'est devenue sa malheureuse fille.
Tout en causant ainsi entre eux, les deux jeunes gens s'étaient avancés jusqu'à la limite du camp; le jour commençait à se lever, les ténèbres étaient moins épaisses, et leurs regards pouvaient plonger assez loin dans la campagne.
—Je crois que voici nos batteurs d'estrade, dit don Diego en indiquant du doigt à son ami une petite troupe de cavaliers qui accouraient vers eux au grand trot.
—Ce sont eux évidemment, répondit don Pablo; mais ils me paraissent venir bien tranquillement.
—En effet, ils n'ont nullement l'air d'hommes qui rentrent d'une reconnaissance sérieuse; ils ont la lance au crochet, ne gardent point leurs rangs et marchent comme s'ils étaient, non pas en rase campagne, mais dans une ville.
—Ce qui me semble plus extraordinaire encore, c'est que leur nombre est au moins doublé; j'avais expédié une dizaine d'hommes, et ceux-ci sont plus de vingt-cinq. Que signifie cela?
—Nous ne tarderons pas à être renseignés à ce sujet; dans un quart d'heure ils seront ici; mais il est toujours bon d'être prudent et de se tenir sur ses gardes, fais sonner le boute-selle et prendre les armes; quoi qu'il arrive, cela vaudra mieux.
Don Diego laissa son chef continuer à examiner les arrivants, et il se hâta de faire exécuter l'ordre qu'il avait reçu.
Cinq minutes plus tard, les rancheros étaient en selle et rangés en bon ordre derrière leur commandant, auquel on avait amené son cheval, et ils se tenaient prêts à tout événement.
Cependant les cavaliers approchaient rapidement. Bientôt ils arrivèrent à portée de voix. Sur un signe de don Pablo, don Diego s'avança quelques pas au-devant d'eux, leur intima l'ordre de s'arrêter et échangea avec eux les mots d'ordre et de ralliement. Mais à la première réponse qui lui fut faite, tous les doutes furent levés; ces cavaliers étaient bien les batteurs d'estrade expédiés en reconnaissance; mais la troupe qui avait été signalée, non seulement était mexicaine, mais encore se composait du reste de la cuadrilla de don Pablo de Zúñiga, que celui-ci avait laissée au camp lorsqu'il s'était résolu à escorter M. Prescott et sa fille, bien qu'en se tenant assez loin derrière l'irascible Anglais pour que celui-ci ne soupçonnât pas cette protection occulte, qu'il avait si péremptoirement refusée lorsqu'elle lui avait été offerte par don Pablo à Potosí.
Mais si le jeune homme était satisfait de voir toute sa cuadrilla, forte de plus de deux cents cavaliers, réunie sous ses ordres et mise ainsi à sa disposition au moment où il le désirait le plus, il ignorait encore comment ses soldats se trouvaient ainsi auprès de lui et par quel hasard ils lui arrivaient à l'improviste.
Aussi avait-il grande impatience d'obtenir des renseignements positifs à cet égard; sa curiosité ne fut pas mise à une longue épreuve, car cinq minutes plus tard, les batteurs d'estrade et les compagnons qu'ils avaient rencontrés en chemin entrèrent dans le camp.
Les nouvelles qu'ils apportaient avaient une grave importance. En voici le résumé en quelques mots:
Les forces mexicaines concentrées à Potosí par le président de la République avaient quitté cette ville et marchaient à la rencontre de l'armée américaine, commandée par le général Taylor.
Les Mexicains paraissaient remplis d'enthousiasme; ils étaient convaincus que les Américains, malgré le gain de trois batailles successives, ne tiendraient pas devant eux, et qu'ils parviendraient facilement, à la première rencontre, à les rejeter en désordre de l'autre côté de la frontière.
Santa-Anna avait été averti par des transfuges que, dans le but de renforcer le corps expéditionnaire du général Scott, cinq mille hommes de la division de volontaires du général Patterson avaient été enlevés à l'armée du général Taylor, dont les forces se trouvaient ainsi dans des conditions d'infériorité écrasantes en face de l'armée mexicaine, qui se montait à plus de vingt-cinq mille hommes.
Le président de la République, voulant profiter de cet avantage que lui donnait si bénévolement l'ennemi, avait quitté en toute hâte San Luis de Potosí et s'avançait à marche forcée à la rencontre des Américains.
Tout en se réservant le commandement en chef de l'armée, le président Santa-Anna avait confié la direction de l'avant-garde au général Ampudia, un des meilleurs officiers de l'armée mexicaine.
Le général Ampudia s'était fait précéder dans sa marche par les rancheros de don Pablo de Zúñiga, dont il avait été à même, dans plusieurs occasions, d'apprécier les qualités comme éclaireurs.
Les cavaliers aperçus par les sentinelles de don Pablo et reconnus par les batteurs d'estrade n'étaient donc que des éclaireurs.
En effet une demi-heure s'était à peine écoulée lorsqu'ils parurent; don Pablo reprit immédiatement le commandement de sa cuadrilla et expédia son lieutenant don Diego de Jalas au général Ampudia, qui marchait à une courte distance en arrière avec le gros de l'avant-garde pour l'avertir de sa jonction avec le reste de sa cuadrilla.
La marche, un moment interrompue lors de la rencontre des deux parties de la cuadrilla, recommença presque aussitôt, et les rancheros se dirigèrent au grand trot sur el Miaz, qu'ils étaient loin de supposer occupé par les Américains.
Vers neuf heures du matin, la cuadrilla se trouva en vue du pueblo. Par excès de prudence, bien qu'il se crût en pays ami, à deux portées de fusil environ du village, don Pablo arrêta sa troupe et détacha une trentaine d'hommes en avant, sous les ordres de don Diego, de retour auprès de lui depuis quelque temps déjà; les éclaireurs mexicains furent, à leur grande surprise, reçus à coups de carabine par les sentinelles américaines postées à l'entrée du village, et furent ramenés; don Pablo les fit soutenir par une cinquantaine de cavaliers; cependant, comme il ignorait à quels ennemis il avait affaire, s'ils étaient nombreux et en position de résister avantageusement, il ne voulut pas s'engager à la légère, et se contenta d'escarmoucher, pour tenir l'ennemi en haleine jusqu'à ce qu'il eût reçu l'ordre du général Ampudia. Cette mollesse dans l'attaque, si impérieusement commandée par la prudence, donna le temps aux Américains d'évacuer le Miaz sans coup-férir, et lorsque l'ordre arriva enfin d'enlever le village, il était trop tard pour arrêter l'ennemi, qui, déjà, s'était mis en pleine retraite.
Les rancheros traversèrent le pueblo au galop et se lancèrent à la poursuite des Américains, mais ceux-ci avaient une grande avance sur eux, avance qui s'augmentait encore à chaque instant, leurs chevaux étant reposés tandis que ceux des rancheros avaient déjà fourni une longue traite et commençaient à être fatigués. D'ailleurs les Mexicains, satisfaits d'avoir chassé l'ennemi du village et de le voir se retirer devant eux, se contentaient d'échanger de loin quelques coups de fusil sans essayer d'en venir à l'arme blanche en chargeant à fond de train.
La cuadrilla avait dépassé d'une lieue ou deux déjà le village, lorsqu'un cavalier, sortant tout à coup des fourrés qui bordaient la route, vint se jeter à l'improviste au milieu d'elle en agitant une faja blanche et en criant merci.
Ce cavalier, immédiatement entouré, fut aussitôt, sur sa réclamation, conduit à don Pablo, qui, à sa grande surprise, reconnut Matadiez, auquel, quelques heures auparavant, il avait si généreusement rendu la liberté.
—Eh quoi! s'écria-t-il, tu es ici, drôle?
—Oui, répondit le Mexicain, et depuis une heure au moins je vous attends, caché sous le couvert.
—Est-ce une nouvelle trahison? fit le jeune homme en fronçant le sourcil.
Le bandit haussa dédaigneusement les épaules.
—Voilà comme juge le monde, dit-il. Au lieu de perdre votre temps, comme vous l'avez fait, et de le perdre encore en ce moment à m'adresser d'inutiles insultes, vous feriez bien mieux de donner des ailes à vos chevaux et d'atteindre les misérables qui vous enlèvent la señorita.
—Que veux-tu dire? Explique-toi en deux mots, et, sur ta vie, prends garde à tes paroles.
—Ma fille, ma pauvre enfant, où est-elle? s'écria M. Prescott, qui se tenait au côté de don Pablo.
—Là! répondit le Mexicain en étendant les bras dans la direction des Américains, dont les derniers cavaliers disparaissaient derrière un pli de terrain; je vous le répète, hâtez-vous si vous ne voulez point qu'elle soit à jamais perdue pour vous.
Alors il raconta ce qui s'était passé et comment miss Anna avait été faite prisonnière par M. de Clairfontaine.
Don Pablo et M. Prescott écoutèrent le récit du Mexicain avec une angoisse extrême; ils comprirent toute la portée de l'audacieuse expédition en avant, tentée par M. de Clairfontaine, dans le seul but de s'emparer de la jeune fille; ils frémirent de douleur de savoir la malheureuse enfant au pouvoir d'un pareil homme.
—Que faire? s'écria M. Prescott avec désespoir.
—La sauver à tout prix dit énergiquement le jeune homme.
—Comment atteindre ces ravisseurs? reprit le pauvre père; ils ont sur nous une avance que nous ne parviendrons jamais à faire disparaître, montés sur des chevaux fatigués comme les nôtres.
—Bah! fit gaiement Matadiez, ce n'est pas pour rien que depuis dix ans j'écume toutes les routes de la république; si vous voulez, je me charge, moi, non seulement de vous faire atteindre ces hérétiques mais encore de les dépasser si cela est nécessaire.
—Oh! si tu fais cela, s'écria don Pablo avec explosion.
—Pas de promesses, caballero; j'ai juré de sauver miss Anna, il ne dépendra pas de moi que cela ne se réalise; plus tard, si vous jugez que je mérite une récompense, eh bien! vous me la donnerez, je ne m'y oppose pas; en ce moment, nous avons autre chose à faire.
—Parle.
—Ces gringos se dirigent tout droit sur San Nicolas, qui est le seul pueblo où ils peuvent espérer trouver les approvisionnements dont ils ont besoin pour eux et leurs chevaux; voulez-vous arriver avant eux à San Nicolas?
—Tu le demandes?
—C'est bien; laissez-moi vous servir de guide.
—Marche, nous te suivons.
—A quelque pas d'ici, sur la droite, nous rencontrerons un sentier étroit qui coupe à travers terres; ce sentier, presque inconnu même des habitants du pays, nous fera gagner cinq lieues sur les neuf qui nous séparent de San Nicolas: voulez-vous le prendre?
—Sers-nous de guide, ainsi que tu nous l'as promis.
—C'est bien, venez. Ah! à propos, don Pablo, prenez ceci, que miss Anna m'a remis pour vous.
Et retirant le collier de la jeune fille de son dolman, il le présenta à don Pablo, mais M. Prescott s'empara du collier et le porta à ses lèvres.
—Laissez-le moi, dit-il avec prière. Le jeune homme étouffa un soupir.
—Partons, dit-il à Matadiez.
On se remit en marche.
Ainsi que l'avait annoncé le Mexicain, on ne tarda pas à découvrir le chemin qu'il avait indiqué; c'était en effet un sentier étroit et qui paraissait presque infranchissable, mais sur un mot de leur chef, les rancheros s'y engagèrent sans hésiter. Qu'importait à ces centaures que le chemin fût bon ou mauvais, il leur suffisait que leurs chevaux pussent y tenir pied pour qu'ils fussent certains de le franchir sans encombre.
Ce fut du reste ce qui arriva: le sentier s'élargit peu à peu, devint meilleur, et en résumé, au bout d'une demi-heure à peine, ils galopaient comme s'ils se fussent trouvés sur la meilleure route de la république. D'après l'avis de Matadiez, et sur l'assurance qu'il donna à don Pablo que rien ne pressait et qu'on arriverait à San Nicolas bien avant les Américains, la cuadrilla fit une halte d'une heure, pendant laquelle les chevaux mangèrent leur provende de maïs et d'alfalfa. Ce repos, si court qu'il eût été, rendit cependant à ces nobles animaux toute leur ardeur.
Un peu avant midi, la cuadrilla arriva en vue de San Nicolas, misérable village situé sur le versant d'une colline et habité par de pauvres peones rongés de fièvre et dévorés par la plus affreuse misère.
Tout paraissait calme dans le village; la plus complète solitude régnait aux environs.
On fit halte.
Don Pablo expédia deux cavaliers en avant.
Ces cavaliers revinrent au bout de quelques minutes.
Les Américains n'avaient pas encore paru; on n'en avait pas de nouvelles; ils avaient traversé la veille au soir le pueblo sans s'y arrêter; depuis on ne les avait pas revus.
Matadiez avait strictement tenu sa promesse; non seulement on avait atteint l'ennemi, mais encore on l'avait tourné. Il n'y avait donc plus qu'à l'attendre, et en l'attendant, prendre ses mesures, de manière à l'envelopper si bien qu'il lui fût impossible d'échapper, soin dont s'occupa don Pablo avec une ardeur fiévreuse et sans perdre un instant.
A peine les rancheros avaient-ils terminé leurs préparatifs, que les trompettes américaines résonnèrent avec force à l'entrée du village et l'ennemi parut.
Il arrivait au grand trot, marchant en bon ordre et gardant bien ses approches.
Don Pablo le laissa s'engager dans le pueblo, puis tout à coup, les trompettes mexicaines sonnèrent la charge, et les Américains furent assaillis à la fois en tête et en queue, par les rancheros qui se ruèrent sur eux avec de grands cris.
La mêlée fut terrible; les Américains surpris par l'attaque furieuse et imprévue des rancheros, eurent un moment de désordre et de panique; les rangs se mêlèrent, se rompirent, quelques-uns tournèrent bride, mais bientôt reconnaissant que la retraite était coupée, ils se résolurent à faire leur devoir en braves gens et se groupèrent autour de leur chef, qui, lui, n'avait pas reculé d'un pouce.
La pensée d'une trahison s'était immédiatement présentée à l'esprit de M. de Clairfontaine et il avait exploré d'un regard perçant les rangs des rancheros pressés autour de lui afin de découvrir Matadiez.
Mais le digne Mexicain était trop adroit et partant trop rusé, pour se compromettre ainsi auprès d'un homme auquel il espérait soutirer une grosse somme d'argent; dès que son devoir de guide avait été accompli, il avait fait comprendre à don Pablo que le cas échéant où le coup de main qu'il tentait ne réussirait pas, mieux valait que sa présence parmi les rancheros fût ignorée des Américains, ce qui plus tard lui laisserait la liberté de s'introduire dans leur camp; puis il avait tourné bride et s'était abrité dans un épais fourré, demeurant tranquillement spectateur invisible de l'escarmouche. Aussi M. de Clairfontaine le chercha-t-il vainement, ses soupçons s'évanouirent, et il ne songea plus qu'à sortir à son honneur de la fausse position dans laquelle il était placé.
Cependant le combat devenait sérieux. Resserrés dans un espace fort étroit, les Américains ne réussissaient qu'avec peine à faire exécuter à leurs chevaux les manœuvres nécessaires pour se dégager un peu, les longues lances des rancheros les atteignaient de tous côtés, les reatas et les lassos s'abattaient sur eux comme la foudre, enlevant le cavalier de selle, l'étranglant et le mutilant horriblement.
La situation devenait vraiment critique, deux charges désespérées exécutées en personne par M. de Clairfontaine, avaient été repoussées par don Pablo, que sans cesse il rencontrait devant lui.
Les deux ennemis s'acharnaient avec rage l'un contre l'autre, sachant bien que d'eux seuls dépendait le succès du combat.
M. Prescott, continuellement aux côtés du ranchero, faisait le coup de pistolet avec cette colère froide qui distingue sa nation; chacun de ses coups abattait un homme.
Les rangs des Américains s'éclaircissaient de plus en plus, les cadavres s'entassaient dans cet espace déjà si étroit où avait lieu cette lutte terrible. Miss Anna voyait à quelques pas d'elle seulement son père et son cousin, et oubliant le soin de sa sûreté, bravant la mort à chaque seconde, elle s'élançait vers eux en les appelant à grands cris; mais à chacune de ces tentatives, M. de Clairfontaine faisait bondir son cheval et la repoussait en arrière.
Enfin les choses en arrivèrent à ce point où la défaite complète des Américains devint évidente; il fallait en finir à tout prix. M. de Clairfontaine le sentit: rassemblant autour de lui les quelques cavaliers déterminés qui lui restaient encore, il saisit par la bride le cheval de miss Anna et essaya de l'entraîner. Mais la jeune fille qui sentait qu'elle allait être libre, résista avec l'énergie du désespoir et essaya de se jeter à bas de son cheval en appelant Anita à son secours afin de joindre ses efforts aux siens. La jeune Indienne obéit et se cramponna résolument aux vêtements de sa jeune maîtresse.
Il y eut entre M. de Clairfontaine et les deux femmes une lutte désespérée de quelques instants.
Don Pablo, M. Prescott et plusieurs rancheros entendant les cris de douleur de miss Anna accoururent en toute hâte, sabrant et renversant tout ce qui s'opposait à leur passage.
M. de Clairfontaine se sentit perdu, par un effort inouï il enleva la jeune fille et la jeta en travers sur le cou de son cheval, en même temps, sortant un pistolet de ses fontes, il fracassa le crâne de la malheureuse Indienne, qui roula sur le sol en lâchant les vêtements de sa maîtresse que jusque-là elle avait tenus serrés dans ses mains crispées.
—Morte ou vive nul ne me l'enlèvera, hurla M. de Clairfontaine avec un rugissement de tigre.
Et enlevant son cheval, il lui fit faire un bond énorme en avant et passa comme un ouragan au milieu des rancheros dont plusieurs furent renversés par ce choc irrésistible.
En vain don Pablo, M. Prescott et leurs cavaliers se ruèrent à la poursuite de M. de Clairfontaine, les Américains se jetèrent entre, eux, et en se faisant tuer avec cette sombre énergie du désespoir qui tient du fanatisme et fait les dévouements, ils donnèrent à leur chef le temps de se mettre hors d'atteinte.
Plus des deux tiers du détachement américain avaient succombé pendant cette sanglante escarmouche, qui cependant n'avait duré qu'une demi-heure à peine; les quelques cavaliers qui avaient échappé à la mort fuyaient épouvantés dans toutes les directions.
Don Pablo avait vaincu, mais, hélas! cette victoire était stérile pour lui, puisque celle pour laquelle il avait si bravement combattu lui échappait.
Ainsi que nous l'avons dit, le président Santa-Anna, trompé par les rapports de transfuges infidèles, et négligeant les avis des personnes bien informées et surtout prudentes de son entourage, s'était, pour le malheur de son pays, arrêté au plan de campagne le plus absurde que jamais eût conçu un général américain, et cependant la plupart des généraux des anciennes colonies espagnoles semblent à plaisir lutter entre eux d'ignorance en fait de tactique militaire. En effet, au lieu d'essayer de couvrir la Veracruz, qu'il savait très sérieusement menacée par le gros des forces américaines, et dont la prise devait inévitablement amener des malheurs irréparables, et peut-être compromettre le succès de la guerre en mettant du premier coup l'ennemi au centre du pays et lui permettant de s'y établir solidement, il quitta Potosí avec toutes ses troupes, s'élevant à plus de vingt mille hommes, tourna le dos à la Veracruz et se dirigea vers la Sierra Madre, se lançant à corps perdu à la poursuite du général Taylor, dont il espérait triompher facilement; sa petite armée ayant été réduite à un très faible effectif, et ce général, peu désireux d'engager une action contre des troupes décuples des siennes, manœuvrant prudemment pour se maintenir dans ses positions sans se laisser entamer.
On ne pourrait croire à une pareille incurie de la part d'un général qui passait alors pour le meilleur manœuvrier de l'armée mexicaine, si les documents historiques n'étaient pas là pour prouver la conception et l'exécution de ce plan insensé.
D'ailleurs, pendant toute cette campagne si glorieuse pour les Américains, les Mexicains semblèrent pris de vertige et firent fautes sur fautes. La fatalité était sur eux, ils étaient condamnés et devaient succomber, et cependant leur cause était juste, ils combattaient pour l'intégrité de leur territoire. Ce fut l'échec éprouvé par le détachement de M. de Clairfontaine qui avertit le général Taylor du mouvement offensif de l'armée mexicaine contre lui et lui révéla le plan du président Santa-Anna.
Lorsque les fuyards rejoignirent l'armée américaine et vinrent en aveugles se jeter dans ses grand-gardes, celle-ci était campée à Agua Nueva, position mauvaise qui pouvait être facilement tournée.
Le général Taylor, reconnaissant la difficulté de la situation, et ne voulant pas y risquer un engagement dont toutes les chances lui seraient contraires, évacua Agua Nueva, après l'avoir incendié, afin d'empêcher les Mexicains de s'y fortifier, et il se retira en bon ordre dans la plaine voisine et s'établit solidement à une lieue environ de l'hacienda de Buena Vista.
Cette fois, la position était choisie avec le tact et le coup d'œil infaillible d'un soldat expérimenté.
L'hacienda de Buena Vista est bâtie presqu'au centre d'une large vallée, comprise entre deux chaînons parallèles de la Sierra Madre; à un mille environ de l'hacienda, les montagnes forment, en se rapprochant, la passe étroite d'Angostura. Cette vallée, d'un accès très difficile, et qui n'a pas plus de deux milles de longueur, est, de plus, coupée dans tous les sens par des ravines profondes.
La position était formidable. Comme la retraite était impossible, l'armée américaine était ainsi placée par son chef dans l'obligation de vaincre ou de mourir.
Les forces du général Taylor considérablement diminuées, ainsi que nous l'avons dit, pour augmenter l'armée du général Scott, ne se composaient plus, en troupes régulières, que de quatre cents hommes d'infanterie, deux cents dragons et quatre batteries d'artillerie, auxquels étaient venus se joindre des volontaires mal exercés encore, mais pleins d'ardeur, dont nous avons vu précédemment quelques-uns aux prises avec les rancheros. Ces différents corps formaient un effectif de quatre mille trois cent cinquante hommes au plus.
C'était avec des forces aussi inférieures que le général Taylor avait résolu d'en venir aux mains avec les vingt mille hommes du président Santa-Anna, si celui-ci essayait de s'emparer des formidables positions dans lesquelles il s'était si bravement retranché.
Le vingt-deux février,—date qui sera à jamais célèbre dans les fastes de l'histoire des États-Unis,—vers sept heures du matin, un cavalier mexicain, monté sur un fort cheval rouan, se présenta aux avant-postes américains et demanda à être conduit à M. de Clairfontaine, commandant des volontaires. Ce cavalier montra un sauf-conduit signé par M. de Clairfontaine.
Le sauf-conduit fut minutieusement examiné, et comme, en somme, il fut reconnu bon, on conduisit le cavalier sous bonne escorte, non pas à la tente de M. de Clairfontaine, mais à l'hacienda de Buena Vista, qui servait de quartier général, et dans laquelle, en ce moment, étaient réunis tous les officiers supérieurs de l'armée américaine; ils tenaient conseil, sous la présidence du général Taylor, afin de convenir des dernières mesures de défense à prendre au cas probable où ils seraient attaqués par les forces mexicaines, qu'ils savaient s'avancer rapidement à leur rencontre.
Ce cavalier était Matadiez, l'ancienne connaissance, du lecteur; le digne Mexicain, peu confiant dans les résultats des manœuvres stratégiques du président Santa-Anna, et, grâce à son astucieuse nature flairant une débâcle affreuse, avait jugé prudent d'utiliser le sauf-conduit que M. de Clairfontaine lui avait signé et de se présenter au plus tôt à lui, afin d'encaisser les sommes qui lui étaient si légitimement dues.
Cependant, comme Matadiez était honnête à sa manière, et qu'il avait fait le serment solennel de sauver miss Anna, il avait résolu de profiter de sa présence au camp américain, pour prendre certains renseignements indispensables sur la jeune fille. Aussi fut-il assez peu satisfait des mesures de précaution que les soldats jugèrent prudent d'employer à son égard. La surveillance attentive dont il était l'objet le contrariait fort. Cette méfiance qu'il inspirait lui semblait blessante pour son honneur de caballero. Il ne consentit donc que d'un air maussade, et parce qu'il craignait d'y être contraint par la force, à se rendre au quartier général.
Arrivé à la porte de l'hacienda, on lui fit mettre pied à terre.
—Et mon cheval? demanda-t-il.
—On en prendra soin, répondit un soldat d'une voix goguenarde.
Il ne dit rien, hocha la tête et entra dans l'hacienda, toujours entouré de son escorte.
—Attendez ici, lui dit un Américain en lui désignant une espèce d'escabeau et l'invitant à s'asseoir.
—Je suis venu pour parler à M. de Clairfontaine; voulez-vous, oui ou non, me conduire auprès de lui? reprit-il d'un ton bourru.
—Il est ici, mais il ne peut vous recevoir en ce moment.
—Patience donc, murmura le Mexicain avec résignation. Il tordit une cigarette, l'alluma, et comme son parti était pris, il parut ne plus conserver la moindre inquiétude sur ce que sa position avait de dangereux pour lui.
Une demi-heure s'écoula; Matadiez continuait à fumer, impassible comme un dieu indien.
—Venez, lui dit un soldat.
Il se leva, jeta sa cigarette et suivit son guide; celui-ci ouvrit une porte et s'effaça pour le laisser passer devant lui.
Matadiez entra, il jeta un regard autour de lui et reconnut qu'il se trouvait dans une salle assez vaste dont le centre était occupé par une table recouverte d'un drap vert, sur laquelle du papier, des plumes, des plans et des cartes étaient jetés pêle-mêle dans un désordre apparent. Huit ou dix officiers assis autour de cette table discutaient entre eux tout en consultant les plans.
A l'entrée du Mexicain:
—Est-ce là l'homme, demanda un officier âgé d'une cinquantaine d'années, aux traits fins et à la physionomie ouverte et bienveillante, qui paraissait avoir un grade supérieur.
—Oui, général, répondit le soldat qui avait servi d'introducteur à Matadiez.
—C'est bien, retirez-vous, répondit le général Taylor, car cet officier était en effet le commandant de l'armée américaine.
Le soldat sortit en refermant la porte derrière lui.
Le Mexicain avait respectueusement retiré son sombrero et attendait immobile qu'il plût au général de lui adresser la parole.
L'œil perçant du Mexicain avait distingué M. de Clairfontaine parmi les officiers assis autour de la table, et son visage, un peu sombre jusqu'à ce moment, s'était aussitôt rasséréné.
Le général, après avoir attentivement examiné pendant deux ou trois minutes le visage renfrogné du bandit, hocha la tête d'un air de mécontentement et lui adressa enfin la parole.
—Qui êtes-vous? lui demanda-t-il en assez bon castillan, mais avec un accent anglais très prononcé.
—Mexicain, répondit-il laconiquement.
—Appartenez-vous à l'armée, à quelque titre que ce soit?
Matadiez hésita une seconde ou deux.
—Tout Mexicain est soldat quand l'étranger foule le territoire de la République, dit-il enfin évasivement.
Le général Taylor fronça le sourcil.
—Que savez-vous des mouvements de votre armée? reprit-il.
—Je ne suis pas un espion, mais un caballero, répondit-il avec hauteur, je n'ai aucun renseignement à vous donner.
—Drôle! s'écria un officier avec un geste de menace.
—Arrêtez! dit vivement le général, cet homme a raison; il est fidèle à sa cause comme nous le sommes à la nôtre; et il reprit en s'adressant au Mexicain: Comment vous êtes-vous présenté aux avant-postes de mon armée?
—J'étais porteur d'un sauf-conduit signé par M. de Clairfontaine, l'un de vos officiers supérieurs; demandez-lui si je dis vrai.
—En effet, cet homme est porteur d'un sauf-conduit signé par moi; nous avons une affaire particulière à régler ensemble, fit M. de Clairfontaine. Vous savez, général, que j'ai à plusieurs reprises habité le Mexique.
—Je ne veux ni ne dois m'immiscer dans vos affaires, Monsieur, répondit poliment le général, il suffit que vous répondiez de cet homme pendant le temps qu'il demeurera dans le camp.
—J'en réponds, général, d'autant plus que je ne le perdrai pas de vue un instant; maintenant, puisque le conseil est terminé, je vous prie de me permettre de me retirer.
—Allez, Monsieur, vous êtes libre, répondit le général. Il se tourna vers le Mexicain et lui tendit sa bourse: Tenez, mon ami, lui dit-il, vous boirez à ma santé.
Matadiez, au lieu de prendre la bourse, la repoussa par un geste dédaigneux.
—Je n'accepte pas d'argent que je n'ai pas gagné, général, dit-il d'un ton bourru; quant à boire à la santé d'un ennemi de mon pays, jamais je ne le ferai!
—Orgueilleux comme un Castillan, murmura le général; il y aurait pourtant quelque chose à faire de cette race rude et énergique, si on voulait. Et après avoir congédié le Mexicain d'un geste bienveillant, il baissa sa tête pensive sur sa poitrine.
M. de Clairfontaine et Matadiez quittèrent la salle.
Ils montèrent à cheval à l'entrée de l'hacienda et se dirigèrent au galop vers l'endroit où campaient les volontaires commandés par M. de Clairfontaine. Au centre s'élevait un rancho abandonné, qui avait été réparé tant bien que mal par les soldats et servait en ce moment d'habitation au jeune homme.
Le trajet de l'hacienda au rancho fut parcouru en moins de dix minutes; bien que les deux hommes galopassent côte à côte, ils n'échangèrent pas une parole pendant tout le temps qu'il dura.
M. de Clairfontaine réfléchissait, Matadiez, lui, regardait curieusement autour de lui et semblait noter soigneusement dans sa mémoire tout ce qu'il supposait digne d'intéresser soit lui-même, soit les personnes qui lui avaient confié cette mission d'argus.
—Nous voici arrivés, dit M. de Clairfontaine en s'arrêtant devant le rancho et mettant pied à terre en même temps.
Matadiez l'imita.
—Il paraît, ajouta le jeune homme avec un sourire narquois, que si vous ne voulez rien nous dire des mouvements de votre armée, vous ne seriez pas fâché de vous renseigner sur la position de la nôtre.
—C'est possible, répondit le Mexicain en riant faux.
—Oh! mon Dieu, regardez, ne vous gênez pas, reprit l'officier américain en haussant dédaigneusement les épaules; cela nous est bien égal, allez. Avez-vous fini? ajouta-t-il après un instant.
—Quant à présent, oui, répondit Matadiez.
—Alors, veuillez me suivre; j'attends votre bon plaisir.
—Je suis à vos ordres.
Ils pénétrèrent alors dans le rancho, dont l'officier referma avec soin la porte derrière lui; il ne se souciait pas sans doute qu'on sût ce qu'il allait faire avec son étrange compagnon.
Matadiez, en le voyant ainsi fermer la porte, sourit d'un air qui eût donné beaucoup à réfléchir à M. de Clairfontaine s'il l'avait aperçu; mais comme en ce moment il tournait le dos au Mexicain, il ne se douta pas de la joie insolite qu'il avait subitement montrée et n'eut pas à en chercher les motifs.
Lorsque l'officier se retourna, il vit son compagnon tranquillement assis sur un équipal, les jambes croisées l'une sur l'autre et occupé à tordre une cigarette avec ce soin et cette minutieuse attention que les hommes de race espagnole apportent toujours à cette importante occupation.
—Çà, dit M. de Clairfontaine, réglons nos comptes sans plus tarder.
—Je ne demande pas mieux, car c'est pour ce seul motif que je suis venu ici, comme bien vous pensez, répondit le Mexicain en allumant paisiblement sa cigarette.
Le jeune homme ouvrit un porte-manteau négligemment jeté sur une table et en sortit un portefeuille en chagrin noir fermé à clef.
—Vous connaissez la maison Beckers Sons and Co de México?
—Certes, c'est une des maisons des plus solides de toute l'Amérique.
—Bon, vous comprenez bien que je ne puis porter en or, sur moi, étant en campagne, une somme aussi forte que celle que je me suis engagé à vous payer.
—Cela me semble parfaitement juste.
—En conséquence, vous ne refuserez pas des traites tirées sur MM. Beckers Sons and Co, et payables à vue?
—Caray! je le crois bien; c'est de l'or que des traites sur ces messieurs; il est bien entendu que les dites traites sont acceptées par eux?
—Eh! eh! vous vous entendez aux choses de commerce, dit en riant le jeune homme.
—Dame! señor, répondit avec bonhomie le Mexicain, les affaires sont les affaires.
—Vous avez raison; mais rassurez-vous, les traites que je compte vous remettre sont acceptées.
—Oh! alors, vous pouvez m'en donner pour la somme qu'il vous plaira. Si forte qu'elle soit, j'accepterai avec reconnaissance.
—Tout beau, mon maître, je vous payerai ce que je vous dois, rien de plus.
—Cela suffira.
Le jeune homme ouvrit alors le portefeuille, au moyen d'une petite clef qu'il portait suspendue à son cou par une chaîne d'acier, et il en retira plusieurs papiers qu'il étala avec complaisance sur la table et fit miroiter aux yeux du Mexicain; mais celui-ci demeura impassible et froid.
—Nous disons que je vous dois...?
—Vingt mille piastres.
—C'est cela, voici deux traites de cinq mille piastres et une de dix mille, ce qui fait juste votre compte.
—Parfaitement.
—Mais vous le savez, donnant donnant.
—Je ne comprends pas.
—C'est cependant limpide! en recevant ces traites que je vais passer à votre ordre, vous m'en signerez un reçu.
—Ah! oui, excusez-moi, je n'avais pas saisi; mais, ajouta-t-il en retirant un papier caché dans sa faja, vous voyez que je suis de bonne foi, j'avais si grande confiance dans votre parole de gentleman, que j'avais préparé le reçu d'avance, le voilà.
—En effet, dit le jeune homme, en examinant le papier. De plus, je vois que vous avez prévu que je réglerais avec vous avec des traites tirées sur la maison Beckers, Sons and Co. Voilà une étrange coïncidence, convenez-en, ajouta-t-il en fronçant le sourcil.
—Pourquoi donc, caballero? c'est vous-même qui, lorsque j'eus l'honneur de vous voir à Potosí, m'avez parlé de cette maison, dans laquelle, m'avez-vous dit, des sommes considérables avaient été déposées par vous.
—Je ne me le rappelle pas.
—C'est cependant ainsi; comment l'aurais-je deviné?
—Hum, cela n'est pas clair. C'est égal, finissons-en. Voici vos traites.
—Et voilà votre reçu.
—L'autre papier que je vous ai signé, pourquoi ne me le remettez-vous pas aussi?
—A quoi bon? répondit-il en serrant précieusement les traites dans son dolman.
—Parce que je désire l'anéantir.
—Je comprends cela, mais moi, je tiens à le conserver.
—Hein?
—C'est ainsi; je le garde; oh! Rassurez-vous, je ne vous réclamerai pas une seconde fois cette dette; je suis homme d'honneur à ma manière.
—D'ailleurs, peu m'importe, reprit le jeune homme, avec un sourire sardonique, je n'ai rien à redouter d'un misérable de votre espèce.
—Pas de gros mots, je vous prie, cela n'avance pas les affaires et souvent les envenime.
—Grâce à Dieu, nos affaires sont maintenant terminées, veuillez donc me laisser, je vous prie.
Le Mexicain ne bougea pas.
—M'avez-vous entendu? reprit-il avec un commencement d'impatience.
—Je ne suis pas sourd. Eh bien, je reste.
—Vous restez?
—Oui.
—Vous restez?
—Vous le voyez bien, il me semble. Vos affaires sont terminées, j'en conviens, avec Matadiez le bandit; vous lui avez généreusement, très généreusement même soldé le rapt fait par lui à votre profit. Mais j'ai, moi aussi, des comptes à régler avec vous... et des comptes terribles!
—Vous? s'écria-t-il avec étonnement. Qui donc êtes-vous?
—Je vois que mon déguisement était bon, puisque j'ai réussi à vous tromper si complètement C'est un succès dont je suis fier.
D'un mouvement rapide comme la pensée, il enleva la perruque qui couvrait sa tête, arracha ses faux favoris et passa un mouchoir sur son visage.
—Regardez-moi, Monsieur de Clairfontaine; me reconnaissez-vous, maintenant?
—Don Pablo de Zúñiga! s'écria le jeune homme en se reculant avec épouvante et portant instinctivement la main à la poignée de son sabre.
—Oui, Monsieur, don Pablo de Zúñiga, votre ennemi mortel, répondit fièrement le ranchero en marchant sur lui un revolver de chaque main; pas un mot, pas un geste; à votre premier cri vous êtes mort. Si brave qu'il fût, l'officier américain sentit un frisson de terreur glacer son sang dans ses veines.
—Voulez-vous donc m'assassiner? murmura-t-il.
—Peut-être! Cela dépendra de ce qui va se passer entre nous. Jetez votre sabre, Monsieur.
Le jeune homme obéit machinalement.
—C'est bien! reprit-il avec un sourire amer, maintenant, asseyez-vous et causons.
En parlant ainsi, don Pablo, après avoir jeté le sabre dans un coin, se remit sur l'équipal qui jusqu'alors, lui avait servi de siège.
—Vous jouez gros jeu, Monsieur; dit l'Américain avec une feinte assurance; prenez garde! je ne suis peut-être pas aussi seul que vous le supposez.
—Cela m'est égal, Monsieur; seulement souvenez-vous de ceci: j'ai fait le sacrifice de ma vie, donc je suis maître de la vôtre.
Il y eut un moment de silence.
Les deux hommes s'examinaient avec une attention étrange. Don Pablo avait remis sa perruque et rattaché sa barbe postiche.
—Maintenant que vous m'avez reconnu, car vous m'avez bien reconnu, n'est-ce pas? dit-il, il est bon que vous seul sachiez qui je suis. L'officier américain sourit dédaigneusement.
—Causons, dit don Pablo, sans paraître se préoccuper de ce sourire.
—De quoi causerons-nous? fit le jeune homme.
—De ce que vous voudrez; par exemple de miss Anna, votre prisonnière, de la façon dont elle est traitée par vous et de ce que vous comptez exiger d'elle.
—Par malheur, ce sujet de conversation qui, sans doute, vous plairait, répondit-il avec ironie, pour des motifs que sans doute vous apprécierez ne m'agrée pas; donc nous ne causerons point.
—Soit, vous garderez le silence, si cela vous plaît, je causerai alors et pour vous et pour moi, le mutisme de l'un de nous sera compensé par la loquacité de l'autre, et, je l'espère, le résultat sera le même.
—Je ne crois pas.
—Moi, j'en suis sûr; vous ne tarderez pas à être de mon avis; veuillez donc m'écouter.
En ce moment il se fit un grand bruit de clairons et de trompettes au dehors.
—Qu'est cela? s'écria le jeune officier en se levant précipitamment.
—Moins que rien, Monsieur, selon toute probabilité, les troupes mexicaines se préparent à attaquer vos retranchements.
—Les troupes mexicaines!
—Je ne les précédais que d'une heure au plus.
—Laissez-moi, Monsieur, me rendre où l'honneur et mon devoir m'appellent.
—Non Monsieur, vous ne sortirez pas.
—Mais je suis perdu, déshonoré à jamais, si je demeure seulement cinq minutes de plus ici.
—Qu'est-ce que cela me fait, à moi, Monsieur.
Tout à coup on frappa à coups redoublés à la porte du rancho.
—Entendez-vous? on m'appelle. Passage, Monsieur, passage!
—Non, répondit péremptoirement don Pablo en le saisissant à la gorge et lui appuyant le canon d'un revolver sur la poitrine.
—Eh bien! soit, tuez-moi, je préfère cela.
—Je vous tuerai probablement, mais cette vengeance ne me suffit pas; c'est votre déshonneur que je veux, Monsieur, votre déshonneur complet et public. Écoutez bien ceci: aussi bien il est temps d'en finir. En ce moment un parlementaire mexicain se présente aux avant-postes de votre armée, c'est le général Ampudia; il est chargé d'une lettre confidentielle pour votre commandant en chef. Vous connaissez la loyauté proverbiale du général Taylor, n'est-ce pas? Eh bien, cette lettre renferme le billet écrit par vous, signé de votre main, billet que vous avez remis à Matadiez, et dans lequel vous vous reconnaissez pour un misérable et pour un infâme.
—Ah! mon Dieu! s'écria le jeune homme avec épouvante, quel démon vous a soufflé une si odieuse vengeance?
—Celui de la haine; cependant je vous offre un marché: il en est temps encore; rendons-nous au quartier général; ordonnez que miss Anna soit remise au général Taylor.
—Après, après? s'écria-t-il haletant de rage et d'impuissance, car il se sentait vaincu par son implacable ennemi.
—Après; la lettre demeurera cachetée entre les mains du général, qui ne l'ouvrira que sur la permission verbale que je lui en donnerai moi-même demain, si pendant la bataille vous ne m'avez pas tué; je veux bien vous offrir cette chance d'un combat loyal et d'une vengeance honorable. Moi vivant, vous mort, miss Anna sera remise à son père. Acceptez-vous?
—J'accepte, démon, puisque je suis entre vos mains.
—Votre parole alors?
—Sur Dieu et mon honneur, je vous la donne.
—C'est bien; reprenez votre sabre et partons, le temps presse. Je mets bas ce déguisement, qui désormais me devient inutile. C'est don Pablo de Zúñiga que vous devez présenter au général.
—C'est l'homme que je hais le plus au monde! s'écria-t-il avec rage. Ah! la vengeance! la vengeance!
—Bientôt nous nous trouverons face à face; Dieu jugera entre nous!
Ils s'élancèrent hors du rancho, montèrent à cheval et se dirigèrent à toute bride vers le quartier général.
Tout était en rumeur dans le camp américain.
Pendant que don Pablo de Zúñiga et M. de Clairfontaine étaient enfermés dans le rancho, où en bons parents qu'ils étaient, ils causaient si amicalement de leurs affaires, de graves événements s'étaient accomplis au dehors et avaient en un instant modifié la situation, en la faisant entrer dans une phase critique dont les Mexicains et les Américains ne pouvaient plus sortir que par une catastrophe, c'est-à-dire une bataille.
Constatons tout de suite que cette bataille, tous deux la désiraient avec ardeur, bien que pour des motifs entièrement différents.
Le général Santa-Anna se croyait sûr du succès; quant au général Taylor, il s'était juré à lui-même qu'il tomberait mort dans ses positions, ou qu'il en sortirait vainqueur.
Vers neuf heures du matin, l'armée mexicaine avait fait son apparition dans la plaine, refoulant devant elle les batteurs d'estrade et les grand-gardes.
Les colonnes nombreuses se déployèrent et prirent position de manière à enserrer complètement l'armée américaine, excepté du côté des hauts pitons de la Sierra Madre, dont les pentes avaient été reconnues infranchissables.
La situation du général Taylor se trouvait être ainsi, en apparence du moins, excessivement critique, puisque avec moins de cinq mille hommes, dont un tiers au plus de soldats aguerris au rude métier des armes, il se voyait tout à coup enveloppé par plus de vingt mille Mexicains commandés par le président de la République en personne, et qui, placés ainsi sous les yeux d'un chef qu'ils idolâtraient, feraient sans doute bravement leur devoir.
Lorsque l'armée mexicaine eut été placée en bataille et que ses profondes colonnes d'attaque furent arrivées à deux portées de fusil au plus des lignes américaines, un officier supérieur se détacha du groupe de l'état-major mexicain, et, précédé d'un trompette tenant en main un drapeau blanc, il s'avança au trot vers les avant-postes américains.
Cet officier était le général Ampudia, envoyé en parlementaire au général Taylor, et porteur d'une lettre de Santa-Anna pour le commandant en chef des forces américaines.
Le général Ampudia fut reçu avec courtoisie par l'officier commandant les avant-postes, et après qu'on lui eut bandé les yeux, suivant les usages de la guerre, il fut, sur sa demande, conduit au quartier général.
Le général Taylor, après avoir pris ses dernières mesures pour la bataille, se préparait à monter à cheval pour aller se placer à la tête de ses troupes au moment où le général Ampudia arriva à l'hacienda de Buena Vista.
Le général américain ordonna que le parlementaire fût introduit dans la salle du conseil, où il le précéda après avoir expédié des aides de camp à ses officiers supérieurs pour leur donner l'ordre de se rendre auprès de lui.
Dès qu'il fut entré dans la salle du conseil, le commandant américain ordonna qu'on enlevât le bandeau qui aveuglait le parlementaire, et le saluant avec une exquise politesse:
—Qui ai-je l'honneur de recevoir, Monsieur? lui demanda-t-il.
—Général, répondit-il avec non moins de courtoisie, je suis le général Ampudia.
—Son Excellence le président de la République mexicaine ne pouvait choisir, pour intermédiaire entre lui et moi, un officier qui fût plus digne de le représenter; j'ai l'honneur de connaître depuis longtemps déjà votre Seigneurie de réputation, général.
—Votre Excellence me rend confus, général, un tel éloge dans votre bouche est sans prix à mes yeux.
Cependant les officiers américains arrivaient les uns après les autres; bientôt ils furent tous réunis dans la salle du conseil.
—Messieurs, le général Ampudia, un des plus brillants officiers de l'armée mexicaine, dit le général Taylor en présentant le parlementaire à son état-major.
Les officiers américains s'inclinèrent poliment.
—Son Excellence le président de la République mexicaine, continua le général Taylor, avant d'attaquer nos lignes, a jugé convenable de nous adresser le général Ampudia. Sa Seigneurie a, m'a-t-on dit, de graves communications à nous faire; veuillez, messieurs, écouter attentivement ces communications. Général, ajouta-t-il en saluant le général Ampudia, veuillez nous expliquer la mission dont vous êtes chargé près de moi, nous vous écoutons. Et, d'un geste qui compléta sa pensée, il montra ses officiers groupés autour de lui.
Le général Ampudia salua profondément et, mis ainsi en demeure, il prit la parole.
—Général, dit-il, je vous supplie de pardonner ce qu'il y aura, à mon insu, d'un peu dur dans mes paroles, je ne fais que vous transmettre la pensée de mon chef et ne suis par conséquent qu'un écho.
—Parlez sans détour, général, quoi que vous ayez à nous dire, nous saurons l'entendre, répondit en souriant le général Taylor.
—Général, reprit après s'être incliné le général Ampudia, Son Excellence le général don Antonio López de Santa-Anna, président de la République mexicaine, me charge de vous dire, à vous, commandant des forces des États-Unis, que, sans motifs plausibles, sans casus belli reconnu, vous avez indûment envahi les frontières de la République, brûlé les villages, détruit les moissons, tué les paysans sans défense, enfin causé au Mexique tous les maux que la guerre traîne à sa suite, et cela sans que le gouvernement de la République se soit rendu coupable d'aucune offense contre vos nationaux ou leurs propriétés; le président dispose de forces imposantes, ces forces, qui vous entourent et vous cernent de toutes parts, sont en mesure de vous écraser. Cependant, désireux d'éviter s'il est possible l'effusion du sang mexicain, qui n'a déjà que trop coulé dans cette agression injuste d'une puissance étrangère, qui prétend par la force s'imposer dans notre pays et nous dicter des lois, droit que nous ne reconnaissons à personne au monde, et est en dehors du droit des gens et des nations civilisées, Son Excellence le président de la République mexicaine, dis-je, voulant user de clémence, consent à ne pas vous écraser et à vous laisser sortir de la mauvaise position dans laquelle vous êtes placé et qu'il vous est impossible de défendre avec la poignée d'hommes dont vous disposez, à la condition expresse que vous mettrez à l'instant bas les armes, et que vous vous rendrez à sa merci; vos troupes ne seront point considérées comme prisonnières de guerre, elles rentreront par étapes dans leur pays, sous l'escorte de soldats mexicains; vos officiers conserveront seuls leurs armes.
—Est-ce tout, général? demanda le général Taylor, toujours souriant.
—Je n'ai plus que quelques mots à ajouter, général.
—Fort bien; continuez.
—Cette mission, dont Son Excellence le président m'a fait l'honneur de me charger, je l'ai accomplie, je crois, telle que me l'ordonnait mon devoir de soldat; mais, ne voulant pas assumer sur moi seul la responsabilité de faits qui n'ont pas entièrement mon approbation, j'ai prié Son Excellence de mettre par écrit les conditions qu'il vous propose par ma bouche; Son Excellence a daigné consentir à rédiger une sommation, et cette sommation, j'ai l'honneur de la remettre entre vos mains.
Il retira alors un large pli cacheté de son uniforme et le présenta au général.
Il avait fallu tout le respect qu'ils avaient pour leur chef et la puissance de volonté qu'ils possédaient sur eux-mêmes pour que les officiers américains eussent écouté, sans l'interrompre à chaque mot, la hautaine sommation du président Santa-Anna.
Le général Taylor seul était demeuré calme et souriant. Il prit des mains du général Ampudia le pli que celui-ci lui présentait, et, sans même jeter les yeux sur la suscription, il le déchira et en laissa tomber les morceaux à ses pieds.
Un murmure d'admiration parcourut comme une commotion électrique les rangs des officiers auxquels en ce moment venait de se joindre M. de Clairfontaine, aux côtés duquel se tenait don Pablo de Zúñiga, assez gêné de se voir ainsi sans autorisation mêlé à un conseil de guerre. Le général Ampudia échangea un sourire amical avec don Pablo, lui fit signe d'approcher et le présenta au général Taylor, à qui il dit en deux mots quel était son rang dans l'armée mexicaine.
—Je suis heureux de l'arrivée du colonel de Zúñiga, répondit le général; qu'il demeure parmi nous; il ne saurait y avoir trop de personnes présentes pour entendre la réponse que je vais faire à la sommation de S. Exc. le président de la République mexicaine.
Don Pablo s'inclina respectueusement et se plaça auprès du général Ampudia.
Après un silence de quelques secondes, le général reprit la parole; mais, cette fois, d'une voix haute, fière et accentuée:
—Général, dit-il, je répondrai à la sommation dont vous êtes porteur, point par point, et dans la forme que vous me l'avez adressée vous-même: je n'ai pas à discuter, quels qu'ils soient, les griefs de mon gouvernement, je ne suis qu'un soldat qui obéit sans discuter aux ordres qu'il reçoit. Depuis que j'ai posé le pied sur le sol mexicain j'ai, autant qu'il a dépendu de moi, protégé les habitants et sauvegardé leurs propriétés, en évitant autant que possible l'effusion du sang. Malheureusement la guerre a des exigences pénibles devant lesquelles j'ai souvent, malgré moi, été contraint de me courber; mais, cette justice me sera rendue que je n'ai jamais autorisé ni le vol, ni l'incendie, ni l'assassinat.
Les deux officiers mexicains s'inclinèrent en signe d'approbation.
—J'arrive maintenant au second point, continua le général, c'est-à-dire à la sommation elle-même, dont vous m'avez transmis les termes hautains, en les adoucissant, j'en suis convaincu, général, autant que cela vous a été possible.
—Le président de la République mexicaine dispose de forces considérables,—vingt ou vingt-cinq mille hommes, je crois, tandis que moi je n'en ai tout au plus que quatre mille.—Cette différence numérique, si considérable en apparence, ne signifie rien, et vous le savez mieux que personne, général, au point de vue de la guerre, ce ne sont pas les plus gros bataillons qui remportent les victoires. Dans la circonstance actuelle, cette différence est complètement annulée, grâce à la forte position que j'occupe; mais, au lieu de vingt mille hommes, votre président en eût-il cent mille, cela ne l'autorisait en aucune façon à faire des propositions déshonorantes à de braves gens, qui sont résolus à se faire tuer, s'il le faut, jusqu'au dernier plutôt que de reculer d'un pouce. Un général américain peut entendre une sommation comme celle que vous m'avez adressée; dans aucun cas, il ne doit la lire. Retournez auprès de votre chef, général, et dites-lui bien ceci: je n'attaquerai pas le premier, mais je ne refuse pas la bataille, et s'il ose essayer de forcer mes lignes, il trouvera à qui parler; les soldats américains ignorent comment on opère une retraite devant l'ennemi.
A ces nobles paroles qui traduisaient si nettement leur pensée, les officiers américains se laissèrent emporter par leur enthousiasme et éclatèrent en cris joyeux.
M. de Clairfontaine profita de l'espèce de désordre causé par cet élan patriotique pour s'approcher du général, auquel il dit quelques mots à voix basse. Le général répondit par un geste d'assentiment muet, puis, s'adressant aux officiers:
—Retournez à vos postes, messieurs, dans quelques minutes le parlementaire sera reconduit aux avant-postes, et peu d'instants après la bataille commencera; je n'ai pas de recommandations à vous faire, je sais que chacun de vous fera son devoir.
Les officiers s'inclinèrent respectueusement et se retirèrent.
Le général Taylor, dès qu'il se vit seul avec les deux officiers mexicains et M. de Clairfontaine, reprit la parole; son accent était bref, son visage sévère.
—Señor don Pablo, je savais votre présence au camp, dit-il; si je n'ai témoigné aucune surprise en vous voyant dans cette salle, c'est que je savais déjà le motif sacré qui vous amenait parmi nous. Un de mes officiers a failli, señor; il ne s'est pas conduit en gentleman, mais il réparera, je l'espère, sa faute pendant la bataille qui va se livrer.
Les deux officiers mexicains, pas plus que M. de Clairfontaine, ne comprenaient rien aux paroles si obscures du général. Il posa le doigt sur le timbre, un soldat parut.
—Faites entrer la jeune dame, dit-il. Au bout d'un instant, miss Anna entra. Elle était pâle et tremblante.
—Rassurez-vous, madame, lui dit le général en la conduisant à un fauteuil; vous avez réclamé ma protection, elle vous est acquise; général Ampudia, le père de cette jeune dame se trouve dans votre armée, voulez-vous la conduire à son père?
—Je serai heureux d'accomplir cette mission de confiance, général.
—Merci. Et, s'adressant à M. de Clairfontaine qui, le visage pâle, les traits contractés, voulait prendre la parole pour essayer peut-être de se disculper: Pas un mot, Monsieur, lui dit-il durement, pas un geste, je sais tout; votre conduite est inqualifiable, il ne vous reste plus qu'à vous faire tuer.
—Oh! oui, s'écria le jeune homme avec rage, la mort plutôt qu'une telle honte!
Et il s'élança vers la porte. Don Pablo l'arrêta.
—Souvenez-vous de votre parole? lui dit-il.
Il le regarda d'un air égaré et se précipita dehors sans répondre.
—Laissez-le sortir, dit le général à don Pablo d'une voix douce et affectueuse qui tranchait avec le ton que jusqu'à ce moment il avait affecté; le malheureux est fou; vous n'avez rien à réapprendre, don Pablo; pardonnez à cet homme, le mal qu'il a voulu faire retombe sur lui. Et se tournant vers la jeune fille:
—Madame, lui dit-il, je vous remercie de la confiance que vous avez mise en moi; maintenant, adieu, messieurs; quoi qu'il arrive, si je ne puis être votre ami, je serai votre serviteur; señorita, je vous guiderai moi-même jusqu'aux avant-postes.
On quitta l'hacienda; quelques minutes plus tard miss Anna et les deux officiers mexicains dépassaient les lignes américaines et prenaient congé du général Taylor, non point comme d'un ennemi, mais au contraire comme du plus affectueux ami, malgré ce qu'il avait cru devoir leur dire.
Nous ne dirons rien de la réunion du père et de la fille: il y a des élans du cœur qu'on ne saurait raconter.
Don Pablo exigea que miss Anna et M. Prescott se retirassent sur les derrières de l'armée: il prévoyait que la bataille serait rude et ne voulait pas qu'ils fussent exposés aux coups de l'ennemi. A deux heures de l'après-dînée, la bataille s'engagea. Les Mexicains tirèrent les premiers coups de canon.
Cette bataille fut nommée: Bataille de Buena Vista. Nous n'en ferons qu'un récit sommaire. La lutte fut sanglante et acharnée pendant, toute la journée, surtout sur l'aile gauche des Américains, que le général Ampudia, soutenu par les rancheros de don Pablo, attaquait avec des forces considérables.
Vers le soir les Mexicains demeuraient maîtres des hauteurs sur le flanc gauche de la position; la nuit seule fit cesser le carnage et sépara les combattants.
Les deux armées, attendant le lever du soleil pour reprendre le combat, bivouaquèrent en, présence l'une de l'autre. Par une fatalité étrange, malgré tous leurs efforts, don Pablo et M. de Clairfontaine, bien qu'ils eussent continuellement combattu en face l'un de l'autre pendant toute la journée, n'étaient point parvenus à se rencontrer.
Le lendemain, au petit point du jour, la bataille recommença toujours du côté de l'aile gauche, que Santa-Anna fit soutenir par une nouvelle division, pendant qu'une forte colonne, composée d'infanterie et de cavalerie ayant avec elle de l'artillerie, attaquait, mais sans succès, le centre de la position américaine.
Profitant du désordre causé dans les rangs des Américains par l'artillerie mexicaine et apercevant M. de Clairfontaine à la tête des volontaires, don Pablo poussa avec ses rancheros une si rude charge en avant que les volontaires, saisis d'une peur panique, se replièrent en désordre derrière la ferme de Buena Vista, cherchant dans les ravins un refuge contre le feu de l'ennemi.
—A moi, don Pablo; à moi, cria M. de Clairfontaine en s'élançant à la rencontre de son ennemi.
—Me voilà, répondit le jeune homme.
Le choc fut terrible entre les deux ennemis, mais soudain un flot de combattants se jeta entre eux et les sépara. Cette panique des volontaires faillit compromettre la journée, mais, sur l'ordre du général Taylor, une partie des troupes de l'aile droite vint les ramener au combat; alors, reprenant l'offensive et guidés par leur chef exaspéré de voir son ennemi lui échapper encore, ils s'élancèrent en avant et regagnèrent le terrain perdu.
Santa-Anna manœuvrait pour se prolonger sur les derrières de l'armée américaine, mais tout à coup il se trouva en présence des tirailleurs du Mississippi qui l'arrêtèrent net et le forcèrent à reculer.
La bataille était devenue générale, l'acharnement inouï. Des deux côtés on faisait des prodiges de valeur: c'était en vain que les Mexicains essayaient d'entamer le petit corps du général Taylor; ainsi qu'il l'avait juré, il demeurait ferme comme un mur de granit.
Les rancheros poussaient des charges désespérées, que les Américains repoussaient constamment.
Le président de la république, effrayé d'une résistance aussi héroïque, lui qui comptait sur une si facile victoire, résolut de tenter un effort suprême: réunissant toutes ses réserves il les engagea à la fois.
Cette attaque fut si vigoureusement exécutée que l'infanterie américaine fut forcée de se replier précipitamment en abandonnant trois pièces de canon.
Les rancheros s'élancèrent alors à sa poursuite, guidés par don Pablo; le combat s'engagea corps à corps et la mêlée devint horrible.
Mexicains et Américains savaient qu'ils jouaient la partie suprême de la journée, aussi leur acharnement était extrême. M. de Clairfontaine comprit qu'à cette heure allaient se décider les destinées de la bataille. Résolu à racheter par une mort héroïque les fautes qu'il avait commises, il réunit ses volontaires et exécutant un mouvement de flanc il se jeta à corps perdu sur les rancheros.
Ceux-ci soutinrent le choc en braves gens, sans être ébranlés, mais au même instant l'artillerie américaine les prit en écharpe et commença à creuser de profonds sillons dans leurs rangs; alors l'indécision se mit parmi eux.
Tout à coup don Pablo et son ennemi se trouvèrent face à face; comme d'un commun accord, ils se ruèrent l'arme haute l'un sur l'autre, les lèvres serrées et sans prononcer un mot; leurs sabres étincelèrent au-dessus de leur tête et s'abattirent en même temps. Chacun d'eux cherchait à tuer son adversaire sans songer à se défendre.
Don Pablo, grièvement blessé, chancela sur sa selle, perdit un étrier, et se renversa en arrière.
—Enfin, s'écria l'officier américain avec un ricanement de tigre, tu vas mourir! Elle ne sera ni à moi ni à toi... Tiens! je...
Il n'acheva pas. Au moment où il pointait son sabre pour achever son ennemi, il fut brusquement enlevé de son cheval par une secousse terrible et renversé sur le sol.
Un lasso s'était abattu sur ses épaules, s'était serré autour de son cou et l'étranglait. Vainement il essaya de couper le lasso, il fut emporté dans une course folle. Lorsque le cavalier qui l'emportait à sa suite s'arrêta enfin, le malheureux était mort; son cadavre, horriblement mutilé par les pierres sur lesquelles on l'avait traîné, était hideux à voir.
—Je ne sais pas si don Pablo en reviendra, dit Matadiez en coupant froidement le lasso qu'il avait si adroitement lancé; mais, quant à celui-ci, son compte est réglé désormais; miss Anna n'a plus rien à craindre de lui, j'ai tenu mon serment! Ah ça! pourvu que mes traites soient payées, maintenant qu'il est mort.
Après avoir prononcé cette singulière oraison funèbre, le bandit se rejeta dans la mêlée, dans le but de rechercher le corps de don Pablo.
Il le trouva, en effet, et sans prendre la peine de s'assurer si le ranchero était mort ou vivant, il le mit en travers sur le cou de son cheval et tourna bride sans plus songer à la bataille.
Du reste, elle était définitivement perdue pour les Mexicains; l'audacieuse offensive prise par M. de Clairfontaine, en permettant aux Américains de se reconnaître, leur avait rendu leur première ardeur; d'un autre côté, les rancheros, déjà démoralisés par l'attaque imprévue des volontaires en voyant tomber don Pablo, avaient perdu pied et avaient fini par fuir en désordre.
M. de Clairfontaine était mort, mais cette mort avait été utile pour son pays, puisque elle avait décidé la victoire en faveur des Américains.
Pendant la nuit, Santa-Anna se mit en retraite sur Incarnación, où il arriva avec des troupes complètement débandées.
Le 14 septembre, 1847, c'est-à-dire moins de sept mois après la bataille de Buena Vista, l'armée américaine fit son entrée à México, qu'elle occupa pendant près d'une année et qu'elle n'évacua qu'après le traité de Guadalupe, qui coûta au Mexique ses plus belles provinces; il est vrai que le gouvernement mexicain toucha, à titre d'indemnité, quinze millions de piastres de la part des États-Unis.
Un mois avant l'entrée des Américains à México, don Pablo de Zúñiga, complètement guéri de ses blessures, avait épousé miss Anna Prescott. Malgré son ardent amour pour sa cousine, l'implacable ranchero refusa de reconnaître le traité de Guadalupe et, fidèle à sa haine pour l'étranger, il continua, jusqu'au dernier moment, la guerre de partisan sur la frontière américaine; ce ne fut que lorsque le dernier soldat des États-Unis eut abandonné le territoire mexicain qu'il consentit à déposer les armes.
Matadiez, devenu riche grâce aux beaux bénéfices réalisés par lui pendant la guerre, s'est retiré des affaires; il est aujourd'hui un des citoyens les plus considérés de México; il ne tardera probablement pas à se marier et à faire ainsi souche d'honnêtes gens.
| I | Le duel. | |
| II | La clairière. | |
| III | Le pronunciamiento. | |
| IV | Tepatitlan. | |
| V | Deux profils de coupe-jarrets. | |
| VI | L'invitation. | |
| VII | Le Cabildo. | |
| VIII | Le départ. | |
| IX | Le Voladero del Macho. | |
| X | Le guet-apens. | |
| XI | Miss Anna. | |
| XII | Dans les serres du vautour. | |
| XIII | La prisonnière. | |
| XIV | La poursuite. | |
| XV | Fin contre fin. | |
| XVI | Bataille de Buena Vista. |
End of Project Gutenberg's Les chasseurs mexicains, by Gustave Aimard
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES CHASSEURS MEXICAINS ***
***** This file should be named 58069-h.htm or 58069-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/8/0/6/58069/
Produced by Camile Bernard & Marc D'Hooghe at Free Literature
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.