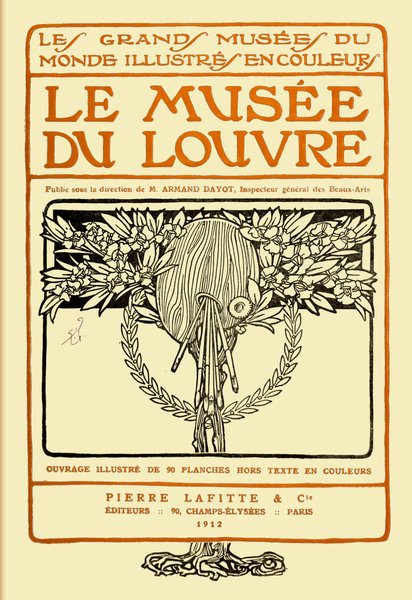
Project Gutenberg's Le musée du Louvre, tome 1 (of 2), by Armand Dayot This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Le musée du Louvre, tome 1 (of 2) Author: Armand Dayot Release Date: January 24, 2016 [EBook #51023] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE MUSÉE DU LOUVRE, TOME 1 (OF 2) *** Produced by Claudine Corbasson, Hans Pieterse and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
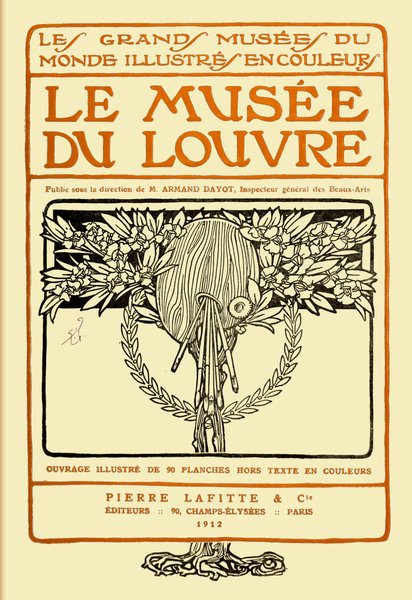
LES GRANDS MUSÉES DU
MONDE ILLUSTRÉS EN COULEURS
Publié sous la direction de M. ARMAND DAYOT, Inspecteur général des Beaux-Arts
OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 90 PLANCHES HORS TEXTE EN COULEURS
PIERRE LAFITTE & Cie
ÉDITEURS :: 90, CHAMPS-ÉLYSÉES :: PARIS
1912
COPYRIGHT 1912
BY PIERRE LAFITTE & Cie
NOTRE étonnement est toujours aussi grand, en parcourant notre admirable musée du Louvre, de le voir si peu fréquenté. Trop souvent le bruit des pas y résonne comme en un temple sans fidèles. Dans ce merveilleux sanctuaire d’art où, siècle par siècle, «l’idéal de tous les peuples» s’est, en quelque sorte, cristallisé en d’incomparables chefs-d’œuvre, bien rares sont les fervents qui viennent porter leur hommage et purifier leur goût. Parfois, sous la conduite d’un employé d’agence, des étrangers le parcourent et l’animent d’une rumeur passagère. Quant au Parisien, ne l’y cherchez pas: on l’y voit si peu!
Par la facilité même qu’il a d’entrer au Louvre à tout instant il remet toujours au lendemain la visite projetée... De même du provincial, venu à Paris pour ses affaires ou ses plaisirs. Il aura la plupart du temps tout vu, les promenades, les cabarets, les hippodromes, les théâtres, tout, sauf notre grand musée national.
A quoi tient cette indifférence de nos compatriotes pour les musées? Serait-ce inaptitude à apprécier les œuvres d’art? Je ne le pense pas, le Français ayant d’instinct le goût du Beau, d’ailleurs certifié par les merveilles d’art de notre pays. Alors? J’accuserais plus volontiers l’insuffisance actuelle de l’enseignement artistique dans les écoles, insuffisance qui permet à un jeune homme, d’ailleurs pourvu de parchemins, d’ignorer l’existence 6 d’un Velazquez ou d’un Rembrandt. Que ce bon élève, un jour, pénètre dans le Louvre, il sera dès l’abord ahuri, confondu par l’entassement de ces peintures auxquelles il ne comprend rien, dont il ignore tout, l’origine, l’époque et jusqu’au nom de l’auteur. Et ces notions élémentaires qui lui manquent, s’il lui prend fantaisie de les chercher, il ne les trouvera qu’en d’énormes volumes de critique, alourdis de considérations savantes et dont il ne pourra pas dégager la substance. Mais le guide précis, clair, facile à suivre, qui le renseignera brièvement sur la valeur d’une œuvre, la vie de son auteur, les traits essentiels de son talent, où se le procurer? Inutile de le chercher dans les bibliothèques, il n’y existe pas. Il est encore à faire.
Ou, plutôt, il était encore à faire car, si la vanité ne nous aveugle pas, nous croyons pouvoir affirmer qu’il est fait maintenant et c’est ce guide nécessaire que nous vous présentons.
La pensée directrice de cet ouvrage, c’est de propager le goût du Beau, de développer le sens artistique par la constante contemplation des plus admirables chefs-d’œuvre de la peinture. Posséder les musées chez soi, à portée de la main à toute heure, à tout instant, quelle heureuse fortune! Le musée chez soi, c’est-à-dire évoquer la fidèle image de la toile qu’on aime, faire revivre et prolonger à son gré l’émotion ressentie devant les œuvres admirées jadis et qu’on ne reverra peut-être plus! Quel précieux privilège de pouvoir contempler ainsi tous les tableaux célèbres, épars dans les musées les plus lointains, à Madrid, à Amsterdam, à Saint-Pétersbourg, à Rome!
Et quel concours miraculeux nous fournit la science moderne!
La photographie noire, sans lumière, uniforme de tons, a désormais vécu pour faire place à la photographie des couleurs. Ah! l’admirable découverte, en vérité! Grâce à elle, la peinture 7 nous est restituée tout entière; c’est le tableau lui-même qui revit sous nos yeux. Regardez, tout s’y trouve, exactement rendu, le velouté des chairs, le chatoiement des étoffes, le scintillement des bijoux, la transparente légèreté des ciels, la profondeur lumineuse des ombres. Les nuances les plus fines, les frottis les moins appuyés y sont traduits avec la même précision que les plus forts empâtements. Cela n’est-il pas merveilleux, et n’est-il pas juste de dire que, possédant un tel ouvrage, on possède réellement le musée chez soi?
Quelques lecteurs s’étonneront peut-être de rencontrer dans une sorte de désordre des œuvres très différentes d’époque, d’école et de genre. Mais cette apparente confusion n’est pas involontaire. Elle est le résultat de considérations faciles à justifier.
L’ouvrage que nous présentons au public n’est pas, en effet, purement didactique, au sens étroit du mot. Il est fait, certes, pour instruire, mais pour instruire sans ennui. Un volume d’enseignement, en matière d’art, implique généralement une classification soit par époques, soit par écoles, classification d’où se dégage toujours une certaine monotonie. Donner tout d’une traite l’école flamande, par exemple, c’est la redite obligatoire et continue des scènes d’intérieur et des scènes de cabaret, fatigantes à la longue, quelle que soit d’ailleurs la valeur intrinsèque de l’œuvre, de même que l’œil se fatiguerait aussi d’une suite ininterrompue de Madones italiennes ou de Descentes de Croix, fussent-elles signées des plus grands noms.
Ici, au contraire, la fantaisie seule nous a guidés comme seule, dans un musée, elle guide les pas du promeneur qui s’arrête à son gré devant la toile qui l’attire, portrait, allégorie, scène d’histoire ou peinture de genre.
Pareil à ce visiteur, nous n’avons prétendu faire qu’une libre promenade à travers le Louvre, promenade intéressante au plus 8 haut point, toujours pleine d’imprévu, où chaque pas amène une surprise et une émotion nouvelles, fixant au passage les œuvres glorieuses qui rayonnent dans notre grand musée. N’est-ce point là la meilleure méthode et la plus attrayante? Nous l’avons pensé et c’est elle que nous avons adoptée dans la présentation de ce volume.
Au hasard de la course, les époques, les écoles, les nationalités vont se confondre. L’école flamande voisinera souvent avec l’école française, un Hollandais avec un Espagnol, un romantique avec un primitif comme les fleurs les plus diverses dans un merveilleux jardin. Sans plus d’égards pour les genres, portraits, allégories, sujets religieux, paysages, tableaux mythologiques alterneront au cours de ces pages, l’un nous reposant de l’autre et nous permettant de les mieux goûter tous. Ainsi conduite, la promenade est sans fatigue; elle s’égaie de rencontres inattendues; elle puise le meilleur de son charme dans son infinie variété.
Variété qui n’enlève rien, d’ailleurs, à la portée éducative de l’ouvrage, bien au contraire, chaque planche étant accompagnée d’une notice explicative. Cette notice, nous l’avons voulue claire, précise, documentaire, débarrassée de considérations générales et dégagée des querelles d’école, assez courte pour n’être pas fatigante, assez longue pour être complète. Sur chaque œuvre reproduite elle dira tout ce qu’on en peut dire sous une forme résumée: l’événement qui en amena l’exécution, les qualités qui la distinguent, les particularités de la composition, du dessin ou du coloris, le tout fortifié par l’opinion autorisée d’un critique éminent. Du peintre lui-même nous saurons, dès le premier contact, ce qu’il importe d’en savoir, son caractère, son histoire, les anecdotes intéressantes de sa vie, les traits essentiels de son talent. Et lorsque le lecteur rencontrera plus loin un autre tableau du même peintre, il le reconnaîtra de lui-même avant d’avoir lu le nom, sur 9 la physionomie générale de l’œuvre, comme on reconnaît de loin un ami dans la rue avant même de distinguer les traits de son visage. Par la diversité des artistes et des œuvres, les similitudes et les différences de chacun d’eux se fixeront dans son esprit, et les classifications s’opéreront automatiquement, sans effort. Et, peu à peu, par une lente progression, sans même qu’il s’en aperçoive, il aura meublé son esprit et formé son goût.
Un tel résultat suffirait à justifier cet ouvrage, ou plutôt cette série d’ouvrages, puisque, au Louvre, succéderont les Offices et le Palais Pitti de Florence, la National Gallery de Londres, l’Académie de Venise, le Prado de Madrid, les musées d’Allemagne et d’Autriche, etc.
Puissions-nous, par cette publication à la fois séduisante et éducative, avoir contribué à faire pénétrer dans le public français, d’une sensibilité artistique si grande, mais, cependant, il faut bien le reconnaître, trop souvent ignorant des merveilles qui peuplent nos musées nationaux et ceux de l’étranger, le goût de l’éternelle Beauté et le désir d’en pénétrer le mystère.

Inspecteur général des Beaux-Arts.

BOUCHER, affirme le Nécrologe de 1771, «possédait à un degré supérieur toutes les grandes parties de l’art de la peinture et il eût pu s’essayer et se distinguer dans tous les genres; mais né sensible, aimable et voluptueux, il se vit presque toujours entraîné vers les Grâces dont il fut généralement appelé le peintre.» Sensible, aimable et voluptueux: en ces trois termes se résume la physionomie du XVIIIe siècle tout entier, avec son élégance spirituelle et son dévergondage raffiné; dans ces trois mots également s’enferme tout l’art de Boucher, peintre des fêtes galantes et des mythologies gracieuses. Ses conceptions personnelles s’adaptaient merveilleusement au goût de l’époque. Il devait réussir dans une cour brillante et libertine dont Mme de Pompadour était la reine; il en devint bientôt le peintre officiel. Aussi bon courtisan qu’artiste habile, il employa le meilleur de son talent à célébrer Vénus, la déesse d’amour et de beauté, délicat hommage à la favorite royale, sa protectrice, souveraine toute-puissante dans le fastueux Olympe de Versailles. Par goût naturel, il aime d’ailleurs à faire jouer la lumière sur les chairs roses et nacrées des femmes; son œuvre entière est un hymne permanent à la jeunesse, à la beauté et à l’amour.
Parmi ces toiles allégoriques, celle que nous donnons ici est l’une des plus belles. A droite du tableau, Vulcain, assis sur une peau de tigre, tend à la déesse les armes qu’il vient de forger. Portée sur un nuage et appuyée sur une de ses nymphes, Vénus à demi nue les 14 examine négligemment. Son corps nonchalamment étendu est une merveille de grâce aisée et de beauté indolente. Au premier plan, on aperçoit le char de la divinité, attelé de colombes. Sur le devant de la toile, un Amour tresse des guirlandes de roses. Dans le ciel baigné d’une lumière diaphane, d’autres Amours se poursuivent en jouant.
S’il obtint les suffrages unanimes de ses contemporains, l’art de Boucher éprouva les rigueurs de la postérité. De l’engouement exagéré on en vint sans transition à l’absolu mépris. On lui reprochait la mollesse de son dessin, l’incorrection de ses anatomies, le conventionnel de sa peinture. Malgré la part de vérité contenue dans ces critiques, il faut avouer que nous sommes très mal placés aujourd’hui pour juger Boucher, qui fut surtout et avant tout décorateur. Pour asseoir un jugement équitable, il faudrait voir ses œuvres dans le cadre pour lequel elles avaient été peintes, panneaux sculptés où courent des guirlandes, trumeaux ouvragés et précieux, tympans dorés et festonnés d’arabesques; on leur trouve aussitôt toute leur signification esthétique et toute leur harmonie. Dépouillées de ce soutien nécessaire, les toiles de Boucher ressemblent à des diamants qu’on aurait dessertis de leur alvéole d’orfèvrerie.
«Son œuvre est prodigieuse sous son aspect léger, prodigieuse par la fécondité de l’effort qu’elle représente, et prodigieuse aussi par la facilité d’expression qu’on y découvre, facilité, il faut bien le dire, plus rare chez ceux qui s’obstinent à pénétrer le mystère de la nature que chez ceux dont la faculté d’observation s’arrête à la surface des choses. Et telle était cette incroyable facilité, qui constituait le fond du talent de Boucher que ce dernier traita avec la même assurance, sinon avec le même bonheur, tous les sujets, depuis les sujets de sainteté jusqu’aux grivoiseries les plus déshabillées, caressant avec une égale aisance de pinceau les voiles de la Vierge dans ses tableaux de Nativité et les splendeurs nacrées de Miss Murphy voluptueusement étendue au milieu des draperies bouleversées de l’alcôve.» (Armand Dayot.)
15 Ce qu’on ne peut, sans injustice, contester à Boucher, c’est l’harmonieuse beauté de sa composition, l’incomparable fluidité de sa couleur, la clarté de ses atmosphères et surtout cette élégance parfaite, un peu maniérée mais exquise, où se matérialisent à nos yeux, en quelque sorte, l’esprit et le goût de la Régence et du règne de Louis XV.
David le savait bien, lui qui avait travaillé plus que tout autre à réagir contre cet art. Un jour qu’il entendait certains de ses élèves tourner en dérision le peintre des Bergeries et des Boudoirs, il alla vers eux, fort en colère, et leur cria: «N’est pas Boucher qui veut!»
On peut en croire David; il était bon juge. Boucher est resté inimitable dans un genre qu’il a créé et dont aucun peintre après lui n’a pu retrouver le secret. Ses élèves s’évertuèrent à le continuer, et n’y réussirent point. Sous leur pinceau, l’habileté du maître devint du procédé, sa grâce de l’afféterie, son tour galant de la fadeur.
On est aujourd’hui revenu de l’injustice dont a longtemps souffert l’art de Boucher. Sans le classer au rang des grands maîtres on s’accorde à le reconnaître comme un peintre délicat et charmant, parfois incorrect mais jamais banal, dont on regarde toujours les œuvres avec plaisir et intérêt, parce qu’elles sont élégantes, spirituelles, brillantes comme la société dont elles reflètent les goûts, les qualités et les défauts.
Vulcain présentant les armes d’Énée à Vénus figura au Salon de 1757. Il y obtint un grand succès. Il fut acquis par le roi Louis XV pour être reproduit en tapisserie par la manufacture royale des Gobelins. Plus tard, il passa du Garde-Meuble au Musée du Louvre, qu’il n’a plus quitté. On le voit aujourd’hui dans la salle du XVIIIe siècle.

IL y a quelques mois à peine, ce magnifique portrait de Raphaël voisinait encore, au Salon Carré, avec la fameuse Joconde de Vinci, récemment enlevée à l’admiration du monde par une main criminelle. Côte à côte, les deux tableaux rayonnaient d’un éclat incomparable dans cette salle illustre, dans ce Saint des Saints de l’Art, qui ne renferme cependant que des chefs-d’œuvre. A la place laissée vide par la Mona Lisa—et qu’elle ne reprendra peut-être plus—Balthazar Castiglione trône aujourd’hui et son fin sourire de diplomate succède à la troublante énigme des yeux et des lèvres de la Joconde.
A contempler l’impeccable perfection de ce portrait, on devine que Raphaël mit toute son âme à l’exécuter. Castiglione fut, en effet, son ami le plus cher et son conseiller le plus sûr. C’est à lui que le grand artiste écrivait: «Je vous dirai que, pour peindre une beauté féminine, j’ai besoin de vous avoir avec moi pour choisir la plus belle.»
Castiglione méritait cet honneur. La nature l’avait orné des dons les plus brillants. Son extérieur était séduisant, son visage agréable, ses manières affables et courtoises. Il aimait les arts avec passion, les comprenait et les encourageait. D’un savoir et d’une intelligence remarquables, à la fois soldat et lettré, il maniait l’épée comme un Sforza et la plume comme Machiavel. De même que celui-ci écrivit le Livre du Prince, Castiglione laissa au monde cet immortel monument de l’esprit de la Renaissance: le Livre du Courtisan. Du courtisan il fut lui-même le type accompli, sans bassesse comme sans effort, par la souplesse de 20 son esprit et la sincérité de son attachement à ses princes. Il guerroya d’abord dans l’armée du duc d’Urbin et le servit ensuite comme diplomate. Puis il passa successivement au service du pape Clément VII et de l’empereur Charles-Quint. Léon X le créa cardinal. Charles-Quint lui donna le titre d’évêque d’Avila. Soldat, littérateur, diplomate, évêque, cardinal, Castiglione, avec ses qualités multiples, réalise la plus complète et la plus brillante personnification du grand seigneur cultivé de la Renaissance italienne.
Il se montra toujours très attaché à Raphaël, qu’il avait connu très jeune et dont il avait deviné le génie. Très en faveur auprès des princes et à la cour pontificale, il contribua à faciliter ses débuts. C’est à son influence que le jeune peintre dut ses premières commandes. Raphaël ne se montra pas ingrat. Devenu riche et parvenu au faîte de la gloire, il ne cesse de voir un bienfaiteur dans ce patricien qui ne se pose qu’en ami. Il sait d’ailleurs quelle science, quel goût sûr, quelle hauteur d’esprit se dissimulent sous les dehors élégants du grand seigneur. Lorsqu’il est embarrassé sur un point quelconque d’histoire ou s’il hésite dans la composition d’un groupe ou d’un ensemble, c’est au jugement de Balthazar Castiglione qu’il fait appel. Quand Jules II confia à Raphaël la décoration de ses appartements au Vatican, le rude pontife décréta la destruction des fresques précédemment peintes, et dont certaines étaient signées des grands noms de Pérugin et de Sodoma. Désolé de cette profanation, Raphaël s’en ouvrit à Castiglione qui l’encouragea à résister aux desseins du pape. Fort de cet appui, le peintre se présenta devant Jules II, essuya sa colère, mais réussit à sauver les œuvres menacées. Chargé de peindre des figures allégoriques dans la Chambre de la Signature, Raphaël, peu cultivé malgré ses facultés d’assimilation, trouva un guide toujours prêt, un conseil toujours autorisé auprès de Balthazar Castiglione, et l’harmonie ordonnée, l’unité de conception dans la variété infinie des motifs indiquent bien l’importante contribution documentaire que celui-ci fournit au peintre.
21 Tel nous le dépeint l’histoire, tel nous le voyons dans le portrait du Louvre. Les yeux vifs et pénétrants disent l’intelligence, les lèvres minces la finesse; Raphaël, dont l’amitié conduisait le pinceau, a su embellir le personnage d’une aristocratique distinction. L’ensemble du tableau est dans une tonalité grise, atténuée, peu habituelle aux peintres de cette époque et qu’on ne retrouvera qu’un siècle plus tard chez un autre artiste de génie, Vélazquez. Tout s’harmonise admirablement dans ce tableau, le vêtement, le visage, le fond même, comme si l’ensemble baignait dans une lumière uniforme, très douce et tamisée par un écran.
Cette manière, dont Raphaël lui-même n’usa que très rarement, démontre la prodigieuse souplesse de son art, qui s’adaptait à tous les genres et se transformait complètement suivant le sujet à traiter, tour à tour aimable ou grandiose, plein de suavité ou de puissance et toujours égal par le génie.
Cette œuvre est l’une des dernières de Raphaël. Il la peignit en 1517, trois ans avant sa mort.
Après la mort de Castiglione, le tableau passa au duc de Mantoue, à qui Charles Ier d’Angleterre l’acheta. On le retrouve plus tard dans la collection d’un amateur hollandais, Van Asselin, chez lequel Rembrandt et Rubens le copièrent. A l’époque où Mazarin l’acquit, ce portrait était estimé 3.000 francs. A la mort du cardinal-ministre, il entra, grâce à Louis XIV, dans le domaine national. Primitivement peint sur bois, il a été transporté sur toile.

PIERRE-PAUL RUBENS est un des peintres les plus puissants et les plus féconds dont fasse mention l’histoire de l’art. Son œuvre est immense; il n’est pas un grand musée d’Europe qui ne possède plusieurs toiles signées de lui, et cela s’explique si l’on songe que, de son vivant, il travailla beaucoup en Italie, en Espagne, en France et que les princes étrangers, lors de la vente qui suivit sa mort, se disputèrent à prix d’or les tableaux demeurés dans son atelier. Le Louvre est particulièrement riche en œuvres du grand peintre; celle que nous donnons ici compte parmi les plus belles.
Elle représente Hélène Fourment, seconde femme de Rubens, avec deux de ses enfants. La jeune femme est assise tenant un de ses enfants dans ses bras tandis que l’autre, une fillette, placée devant elle, relève son tablier en un geste gracieux. Entre les deux enfants, on aperçoit un oiseau qui s’envole.
Rubens s’était marié deux fois, d’abord le 3 octobre 1609, avec Isabelle Brandt, fille de Jean Brandt, secrétaire de la Régence, peu après son retour à Anvers, lorsqu’il eut quitté le service du duc de Mantoue. Il avait à cette époque trente-deux ans, sa jeune épouse dix-huit. Elle lui donna deux fils dont les portraits figurent aujourd’hui à la galerie Lichtenstein, à Vienne. Elle mourut à l’âge de trente-cinq ans et Rubens éprouva, de cette perte, un profond chagrin. «En vérité, écrit-il, j’ai perdu une excellente compagne; elle n’avait aucun des défauts de son sexe; point d’humeur chagrine, point de ces faiblesses de 26 femme, mais rien que de la bonté et de la délicatesse. Une semblable perte me paraît bien sensible et puisque le seul remède à tous les maux est l’oubli qu’engendre le temps, il faudra sans doute espérer de lui mon secours, mais qu’il me sera difficile de séparer la douleur que me cause sa mort du souvenir que je dois garder toute ma vie à cette femme chérie et vénérée!»
L’apaisement se fit plus vite que ne l’avait espéré Rubens. Quatre ans après, le 6 décembre 1630, il épousait, à l’âge de cinquante-quatre ans, la jolie Hélène Fourment, nièce de sa première femme, qui n’avait que seize ans. On connaît d’elle, outre le tableau reproduit ici, un autre portrait aussi célèbre, généralement désigné sous le titre du Chapeau de paille.
Le portrait d’Hélène Fourment avec ses enfants est une merveille de légèreté et de transparence. «Ce ne sont, écrit Gautier, que frottis pénétrés de lumière, que touches lâchées et jetées comme au hasard mais qui expriment ce qu’elles veulent dire mieux que le travail le plus poussé. Dans cette toile d’une fraîcheur délicieuse, Rubens a tempéré sa rouge ardeur. Il est blond, argenté, nacré comme le satin et la lumière.»
Rubens n’avait que soixante-trois ans quand il mourut, en pleine puissance de son génie, sans avoir subi cette déchéance qui, bien souvent, gâte la fin des plus grands artistes. Il fut enterré dans le caveau de messire Fourment, son beau-père. «Ces messieurs, relate le registre mortuaire de la paroisse, ont contribué tous ensemble aux dépens de transport et la quête a produit 9 gros 10 sous. Le convoi a eu lieu avec 60 flambeaux ornés de croix de satin rouge et la musique de Notre-Dame. Nous avons chanté le Miserere avant la messe, puis le Dies iræ et d’autres psaumes. Il a été exposé avec 6 cierges. Les frais de l’église, fixés d’abord à 6 livres, se sont montés à 69 gros 3 sous qui ont été payés.» Sa veuve, Hélène Fourment, fit construire derrière le chœur de l’église Saint-Jacques une chapelle où fut transportée sa dépouille. 27 Sur l’autel se trouve le Saint Georges où l’artiste, dit-on, s’était représenté avec ses deux femmes, Isabelle Brandt en Vierge Marie, Hélène Fourment en Marie-Madeleine.
La succession de Rubens s’élevait à 700.000 florins. La veuve et les fils du premier lit, Albert et Nicolas Rubens, se firent adjuger, en plus des portraits qui leur revenaient, un certain nombre de toiles. Le reste fut vendu aux enchères publiques. Cette vente, qui ne comprenait pas moins de trois cent quatorze toiles ou dessins, eut lieu, le 17 mars 1642, dans une auberge d’Anvers, au Souci d’or, dont la tenancière, la veuve Sagers, reçut de la famille 474 florins pour prix des rafraîchissements servis aux agents et amateurs, parmi lesquels se trouvaient, avec l’envoyé du roi d’Espagne, les représentants de l’empereur d’Allemagne, de l’électeur de Bavière, du roi de Pologne (Gustave Geffroy). Les dessins et une grande quantité de tableaux furent acquis par le banquier Jabach qui, plus tard, revendit une partie de sa collection à Louis XIV.
Quant au portrait d’Hélène Fourment, il appartenait vers le milieu du XVIIe siècle, à M. de La Live de Jully; à la vente de ce collectionneur, M. Randon de Boisset l’acheta 20.000 livres; quelques années après, en 1777, il passe dans la collection du comte de Vaudreuil qui le paye 18.000 livres. Il est enfin acquis, pour 20.000 livres, par la Couronne, en 1784. Il figure aujourd’hui dans la partie de la grande galerie du Louvre réservée à la peinture flamande.

DAVID est peut-être, de tous les peintres, celui qui a été le plus glorifié et le plus honni. Porté aux nues par ses contemporains, il fut traîné aux gémonies par la génération suivante. L’accord s’est fait aujourd’hui sur son œuvre, grâce au recul du temps qui éteint les haines d’écoles et de partis. David, peintre d’histoire, ne jouit plus que d’une estime modérée et toute notre admiration s’adresse désormais à David portraitiste. Ce jugement de la postérité aurait surpris et surtout irrité le peintre, s’il avait pu le deviner. A ses yeux, la peinture d’histoire, inspirée de l’antique, comptait seule; il s’en était servi comme instrument pour abattre le maniérisme et la fadeur du XVIIIe siècle; il lui devait son titre de chef d’école. Quant aux portraits, il les considérait comme un délassement de ses grands travaux et comme un art inférieur, bon tout au plus à procurer un revenu sûr et immédiat. A Mme de Verninac, sœur de Delacroix, dont il a fait un délicieux portrait et qui désirait le voir figurer au Salon de l’an VIII, il écrit: «Il serait ridicule qu’un artiste comme moi exposât simplement un portrait tel bon qu’il soit.» Et pour adoucir son refus, il ajoute: «Je suis occupé en ce moment à faire encore une autre belle femme, Mme Récamier. C’est un tout autre genre de beauté. Je pense qu’elle voudra que son portrait soit exposé; alors j’aurai l’honneur de vous en prévenir et de vous prier en même temps d’y joindre le vôtre.»
C’est en 1800 que David commença le portrait de Jeanne-Françoise-Julie-Adélaïde Bernard, femme du richissime banquier Récamier. Sa 32 grande fortune, sa réputation de beauté et d’esprit la faisaient rechercher dans les salons de l’époque; elle y brillait sans efforts, par la seule vertu de son charme et de sa bonté. Cette femme célèbre chargea David, alors dans toute sa gloire, de fixer ses traits. Le peintre aborda ce portrait avec enthousiasme, certains disent avec amour; il s’était adjoint, pour dessiner les accessoires, un jeune artiste nommé Ingres, qui devait à son tour devenir illustre.
David avait placé son modèle dans une pose charmante. A demi-couchée sur un lit de repos, Mme Récamier tourne vers la droite son joli visage. Elle porte une robe légère de linon blanc, d’où sortent ses pieds nus croisés l’un sur l’autre. Un ruban noir maintient la chevelure bouclée.
Le portrait si bien commencé ne fut jamais fini. Un beau jour, David apprit que Mme Récamier le quittait pour se faire peindre par Gérard, son élève. Il en conçut du dépit et abandonna son ouvrage. Le portrait demeura à l’état d’ébauche, mais quelle ébauche! Devant cette œuvre magistrale, où la couleur est simplement indiquée par des frottis légers qui la rendent transparente, lumineuse, on se réjouit presque du hasard qui empêcha David d’appliquer la pâte épaisse, souvent terne et lourde, de son pinceau. Tel qu’il nous est parvenu, ce portrait est un véritable chef-d’œuvre, autant par la maîtrise de l’exécution que par la sobriété, la distinction et l’harmonie des lignes.
Gérard, dans son portrait de Mme Récamier, ne fut pas moins heureux que son maître. Comme lui, il réussit à produire un chef-d’œuvre. On peut comparer les deux toiles qui se trouvent au Louvre. Celle de Gérard a peut-être plus de fraîcheur et de séduction, on y devine le souci du peintre à flatter son modèle; celle de David se distingue par plus d’harmonie dans l’ensemble, par plus de fermeté, par plus de vérité aussi. Rien ne ressemble moins à David peintre d’histoire que David portraitiste: devant la nature vivante tombait sa froideur systématique; il l’attaquait avec une absolue sincérité, ne cherchant ni à l’interpréter 33 ni à l’orner; sur les traits mobiles du modèle, à force d’étude et de précision, il saisissait l’âme et la fixait. Il doit à cette probité scrupuleuse une gloire de bon aloi que ses meilleures et ses plus vastes compositions d’histoire n’auraient pu lui assurer. «Il ne reculait même pas devant l’horreur, malgré son amour de la beauté classique. Ce qui fait la gloire de David, c’est sa grande science du dessin fortifiée par l’étude incessante du modèle, anoblie et comme ramenée au type général par la familiarité de l’antique. Sans doute les personnages de ses tableaux se figeaient parfois en statues, mais jamais ses portraits. Pendant une longue période, l’autorité de David fut immense, incontestée, sans rivale. Il s’était emparé, en maître despotique, du domaine de l’art. Ces dominations ne s’acquièrent pas sans une rare puissance et, pourquoi ne pas dire le mot, sans génie.» (Théophile Gautier.)
Le portrait de Mme Récamier, n’ayant pas été achevé, demeura la propriété de l’artiste qui l’oublia dans un coin de son atelier. Il le suivit dans son exil à Bruxelles sans trouver acheteur. Il fut acquis par l’État en 1826, à la vente posthume du peintre, pour la somme de 6.180 francs. On le mit au Louvre, d’où il ne sortit qu’une fois, en 1889, pour figurer à la centennale de l’Exposition universelle. Il est placé aujourd’hui dans la salle connue sous le nom de Salle du Sacre, où se trouvent réunies les œuvres les plus célèbres du grand peintre.

GIORGIO BARBARELLI, plus connu sous le nom de Giorgione, marque la transition entre la manière un peu sèche et naïve de l’art gothique et la géniale éclosion de l’art des Titien, des Tintoret et des Véronèse. Il naquit en 1477, la même année que Titien; mais tandis que celui-ci portait durant un siècle le sceptre de la peinture, Giorgione mourait à trente-trois ans dans la plénitude de son génie. Giorgione fut surtout un peintre de fresques. Venu tout jeune à Venise, il fut employé par les procurateurs de la Sérénissime et par les riches particuliers à décorer les palais officiels ou privés de la ville. Il avait commencé par peindre l’extérieur de sa propre maison de compositions fantaisistes, et bientôt cela devint une mode à Venise, si bien qu’avec le Titien, il fut chargé d’orner la façade du Fondaco dei Tedeschi, sorte d’hôtel consulaire des commerçants allemands, reconstruit en 1508 sur les rives du Grand-Canal. Giorgione fit preuve, dans le choix de ses compositions de la plus extraordinaire fantaisie et revêtit le tout d’un merveilleux coloris dont l’action corrosive de la lagune et du temps n’a pu complètement étouffer l’éclat.
Cette originalité et cette splendeur de palette, disciplinées par beaucoup de science, on les retrouve entières dans les tableaux de Giorgione et notamment dans ce Concert champêtre, qui est une des merveilles du Salon Carré. «Il fut un des premiers qui fit preuve d’une véritable indépendance en osant ce qui n’avait pas été fait avant lui; il révéla à l’art vénitien son véritable tempérament en une forme amoureuse 38 que la morale religieuse avait jusque-là empêchée, mais que l’esprit dévergondé de la Renaissance encouragea. Dans ses œuvres les chairs palpitent, les carnations savoureuses et fermes se modèlent dans de mystérieuses pénombres, sa couleur est dans une gamme chaude extrêmement harmonieuse. Nul mieux que lui ne donna à la peinture cette richesse de tons et cette solidité d’exécution, avec autant de souplesse, d’humour et de vie.» (Pierre Gusman.)
A propos du Concert champêtre, nous ne saurions mieux faire que de citer la belle page de critique que lui consacre Théophile Gautier:
«Au milieu d’un de ces paysages d’une richesse de ton étouffée et chaude dont Titien s’est souvenu plus d’une fois, de jeunes seigneurs font de la musique: l’un joue du luth et l’autre semble l’écouter. Au premier plan, une jeune femme nue, vue de dos, et assise sur un épais gazon d’un vert doré, approche de ses lèvres une flûte. A la gauche, une autre jeune femme, qui n’a d’autre vêtement qu’un bout de draperie blanche glissant de la hanche sur la cuisse, s’appuie sur le bord d’une espèce d’auge en marbre et y plonge, pour l’emplir, une bouteille de verre. Les deux jeunes seigneurs ont d’élégants costumes vénitiens dans le goût de ceux de Vittore Carpaccio; ils ne semblent nullement se préoccuper du contraste que présentent leurs riches habits avec la nudité de leurs compagnes. Le peintre, dans cette suprême indifférence artistique qui ne songe qu’à la beauté, n’a vu là qu’une heureuse opposition de belles étoffes et de belles chairs, et en effet il n’y a que cela. Le torse de la femme penchée sur la vasque, le dos de celle qui joue de la flûte, sont deux morceaux de peinture magnifiques. Jamais coloris plus blond, plus chaud, plus moelleux et d’une consistance plus riche ne revêtit d’opulentes formes féminines.
«Le Concert champêtre de Giorgione, ce tableau sans sujet et sans anecdote, n’attire peut-être pas beaucoup la foule, mais soyez sûr que tous ceux qui cherchent les secrets de la couleur s’y arrêtent longuement, et, sans pousser le fétichisme comme sir David Wilkie à 39 l’égard de Los Borrachos de Vélazquez jusqu’à en étudier un pouce carré seulement chaque jour, en font des pochades, des études, des copies complètes qu’ils gardent sur le mur de leur atelier comme le plus sûr étalon de coloris qu’un artiste puisse consulter. C’est Giorgione, on peut le dire, qui a fait la palette de Venise. Titien, Bonifazio, Tintoret, Paris Bordone, Palma vieux et jeune, Paul Véronèse, les plus illustres et les moins connus, y ont largement puisé. On peut dire à la gloire de Giorgione que Titien l’égala, mais ne le surpassa point.»
Les œuvres authentiques de Giorgione sont très rares, ses fresques ayant presque complètement disparu, sous l’action du temps. Beaucoup de tableaux qui lui furent attribués ont été reconnus comme étant dus à Lorenzo Lotto, Palma Vecchio ou Sebastiano del Piombo. Mais outre le Concert champêtre du Louvre, il faut citer de lui deux œuvres maîtresses: La Famille de Giorgione, au palais Giovanelli, à Venise, et Apollon et Daphné, au Séminaire patriarcal de la même ville.
Le Concert champêtre fit longtemps partie des collections des ducs de Mantoue, puis il fut acheté par le roi d’Angleterre Charles Ier. Il passa ensuite aux mains du riche banquier Jabach, grand amateur de peinture. Mais Louis XIV, ayant vu ce tableau, manifesta le désir de le posséder et l’acheta au banquier. C’est ainsi que ce chef-d’œuvre, ainsi que nombre d’autres, entra dans notre patrimoine national.

LE nom de Rembrandt brille d’un tel éclat au ciel de l’art que l’on peut se demander si l’immortel auteur de la Ronde de Nuit n’est pas le plus grand peintre que le monde ait connu. Ce qui surprend surtout, c’est qu’il ait pu rester toujours lui-même, c’est-à-dire génial, au milieu des traverses et des infortunes qui marquèrent son existence. Les splendeurs et la misère s’opposent dans sa vie comme la lumière et l’ombre dans ses tableaux; on semble même reconnaître, dans les œuvres de la période malheureuse, une fougue, une puissance, une sorte de fureur exaspérée qui se traduisent sur la toile en traits de feu.
Le portrait d’Heindrickje Stoffels que nous donnons ici ne remonte pas à la période fastueuse de l’artiste, il ne date pas non plus des années de misère totale. Rembrandt a déjà connu la douleur en perdant sa femme adorée Saskia; mais il a trouvé une consolatrice et une amie dévouée en Heindrickje Stoffels, sa servante. Certains biographes ont fait grief au grand artiste de cette liaison, jugée par eux indigne d’un génie comme le sien. Une censure de cet ordre n’a que faire ici. Heindrickje Stoffels vient à Rembrandt au temps de ses plus grands ennuis et le sert fidèlement jusqu’à sa mort. Avec l’énergie et la clairvoyance d’un cœur aimant, elle s’applique à relever la fortune de son maître: elle entreprend la vente des collections du peintre, espérant ramener l’aisance. Cette vente ne produit guère que 5.000 florins. Rembrandt ne peut plus être sauvé; il ne peut plus payer sa maison de la 44 Joden Breestraat, achetée à tempérament; les emprunts s’accumulent, aggravant sa détresse et bientôt il est déclaré en banqueroute. Heindrickje succombe à la peine, à l’âge de trente-six ans. Elle avait donné à Rembrandt deux enfants qui moururent jeunes.
Rembrandt aimait profondément Heindrickje Stoffels; sa mort ouvrit une plaie nouvelle dans ce cœur qui saignait déjà par tant de blessures. Cette fidélité de la servante a reçu sa récompense; son nom survit, à l’ombre de celui du maître, et celui-ci a immortalisé son beau visage en de nombreuses toiles. On connaît plusieurs portraits de Heindrickje Stoffels; le musée de Berlin en possède un, mais celui du Louvre est le plus beau.
Écoutons Théophile Gautier nous parler de cette peinture: «C’est une jeune fille de vingt-cinq ans à peu près, avec des traits réguliers un peu forts, des yeux bruns, des lèvres épaisses et vermeilles, des cheveux abondants et crêpelés d’un marron tirant sur le roux, une physionomie tranquille, avenante et douce. Une casaque bordée de fourrures lui couvre les épaules et laisse voir son col gras et souple, sa poitrine rebondie que couvre à demi une chemisette plissée. On ne saurait imaginer l’incroyable puissance de vie que Rembrandt a su prêter à cette figure baignée dans l’or fluide d’un coloris magique. Les ombres des joues, le clair-obscur du sol, le ton blond du linge, le bitume chaleureux et transparent de la fourrure et des cheveux dont le brun semble pénétré de soleil, la lumière du front et du nez, le travail étonnant de la brosse qui, avec son martelage, rend le grain de la peau et la solidité de la chair, font de ce portrait un des chefs-d’œuvre de l’art, une peinture sans rivale. Titien lui-même n’a pas cette force profonde de couleur et cette intensité de lumière. Son ambre pâlit un peu à côté de cet or.»
Rembrandt a laissé aussi de nombreux portraits de sa première femme Saskia, qui était la parente d’Hendrick van Uylemborch, le marchand de tableaux d’Amsterdam. Jeune fille, elle avait posé 45 souvent devant lui; elle lui servit plusieurs fois de modèle durant son mariage. Dans la toile qui est actuellement à Dresde, elle est représentée assise sur les genoux de son mari qui tient un verre en main: cette composition fut sévèrement jugée, on l’assimila méchamment à une scène de débauche. Le Musée Brera, à Milan, possède un beau portrait de Saskia, qui est d’une ravissante tonalité blonde. Sur les dernières effigies de la jeune femme figure le fameux collier de perles acheté pour elle par Rembrandt, et dont le prix fabuleux, ajouté à d’autres prodigalités, avait commencé la ruine du grand artiste. Saskia mourut à trente ans, après huit années d’une union heureuse. Des trois enfants qu’elle avait donnés à Rembrandt, un seul vécut, Titus, qui devait plus tard unir ses efforts à ceux de Heindrickje Stoffels pour essayer d’arrêter son père sur le chemin de la banqueroute.
Mais une dernière douleur était réservée à Rembrandt; ce fils qu’il aimait tant mourut à son tour, le laissant seul au monde. Il ne tarda pas à le suivre dans la tombe, le destin ayant épuisé contre lui toutes ses cruautés. L’enterrement du génial et fastueux Rembrandt coûta 13 florins, comme celui d’un matelot du port.
Le magnifique portrait d’Heindrickje Stoffels, qui se trouvait autrefois dans le Salon carré, figure aujourd’hui à l’extrémité de la Grande galerie, dans la partie affectée à l’École hollandaise et dont les œuvres de Rembrandt, abondamment représentées au Louvre, occupent tout un panneau.

ON raconte que Philippe III, roi d’Espagne, voyant des fenêtres de son palais un homme qui riait, dit gravement: «Ou cet homme est fou, ou il lit Don Quichotte.» On s’informa, l’homme lisait Don Quichotte.
C’est de cette Cour austère, encore assombrie sous le règne suivant, que le génial Velazquez fut le peintre officiel. Il n’y jouit guère, à l’origine, que de l’amitié personnelle de Philippe IV, dont il a si souvent reproduit les traits. Le reste de la Cour l’estimait peu, le plaçait à peine au-dessus des bouffons et des fous chargés de dérider les tristes hôtes des palais royaux. N’était considéré comme artiste, à cette époque, que le peintre dont le talent était exclusivement consacré à l’Église. Velazquez reçoit huit livres pour trois portraits dont l’un est perdu et dont les deux autres, Philippe IV et le comte d’Olivarès, sont en Espagne. Un peu plus tard, on le gratifie d’un présent de trois cents ducats et d’une pension de même valeur, avec un logement. En 1644, le roi le nomme Inspecteur des Bâtiments, puis Maréchal du Palais, avec de forts appointements et un logis dans la maison du Trésor.
Avec quelle joie le grand artiste devait-il saisir l’occasion de peindre les jeunes infants et infantes de la Cour! Ces figures fraîches, ces mines avenantes étaient le seul rayon dans ces palais d’où la joie et le rire étaient bannis. Toute la lumière de sa couleur, tous les chatoiements de sa palette se dépensent avec amour dans les nombreux portraits de l’infant don Balthazar Carlos, dans ceux des infants Philippe Prosper 50 et don Fernand d’Autriche et surtout dans le célèbre tableau de Las Meninas qui est un morceau de vie transposé avec un bonheur inexprimable et une plénitude de moyens et d’effets qui n’ont jamais été surpassés.
Parmi ces œuvres gracieuses il en est une que le Louvre a l’heureuse fortune de posséder; c’est le portrait de la mignonne infante Marie-Marguerite, qui devait devenir plus tard la femme de l’Empereur d’Allemagne Léopold Ier.
Devant cette peinture, l’admiration est unanime. «Voyez, s’écrie Raffaelli, le portrait de l’infante Marguerite, dans son harmonieuse et forte couleur, vraie perle de coloriste, où les tons passent les uns dans les autres sans jamais dire comment ni où, comme ils le font dans la nacre. Les gris-argent, le noir, le rose et le blond des petites filles forment toute l’harmonie du tableau de la reine-enfant.»
Léon Bonnat n’est pas moins enthousiaste: «Ah! l’adorable infante, la pâle infante aux yeux bleus! Elle est debout dans son costume d’apparat, les bras écartés, étalés sur ses énormes paniers et elle tient à la main une rose pâle comme sa frêle personne. Est-elle assez malheureuse, la royale princesse, dans sa splendeur et ses atours, d’être ainsi astreinte à l’étiquette rigoureuse de la Cour! Ne la plaignons pas trop toutefois. Elle passe à la postérité grâce au génie du grand maître. Peut-on, en effet, voir un portrait plus ravissant que le sien? Ces tons gris, rosés, argentins, ces cheveux d’un blond cendré, ces nœuds, ces rubans, le tout se détachant sur des tentures rouges, carmin, violacées, que sais-je? Peut-on voir un plus heureux assemblage de tons délicats et n’est-ce pas vraiment d’une tendresse exquise?»
Avant eux Théophile Gautier avait déjà célébré ce tableau: «Quelle délicieuse créature que cette petite infante Marguerite, avec son nœud rose dans ses cheveux blonds, et sa robe de taffetas gris de perle galonnée de dentelles noires! A travers la naïveté de l’enfance, on sent dans cette mignonne figure la dignité consciente de sa 51 position. C’est une petite fille, mais une fille de roi, qui sera reine un jour.»
Dans ce tableau comme dans tous ceux de Velazquez, le gris joue un rôle considérable. De bonne heure l’artiste avait été amené à constater que le gris était la base harmonique par excellence dans la nature, le lien subtil et souple qui permettait aux colorations les plus délicates de chanter et de vibrer dans les ondes de l’air, que cette nature, qu’on n’interroge jamais en vain, avait elle-même horreur du noir, qu’elle savait à merveille user du gris pour tempérer les oppositions de la lumière et amortir l’éclat trop entier ou trop vif des couleurs. Velazquez en vint donc à user largement du gris pour en faire l’étoffe de ses préparations et la caresse définitive de ses glacis; il a proclamé dans ses plus admirables chefs-d’œuvre la vertu souveraine du gris, ce gris divin de van der Meer et de Corot. Si quelque maître avait soupçonné cette vérité avant lui, témoin le Balthazar Castiglione de Raphaël, personne n’en avait formulé avec cette largeur d’initiative les principes féconds.
Le portrait de l’Infante Marguerite fut peint par Velazquez en 1659, la même année que le portrait en pied envoyé par Philippe IV à l’empereur d’Allemagne. Théophile Gautier, parcourant le Louvre en 1830, regrettait que l’on n’eût pas ménagé une place dans le «radieux cénacle» du Salon carré, à la délicieuse petite infante. Son vœu est aujourd’hui réalisé: l’œuvre charmante de Velazquez y figure maintenant, entre Véronèse et Raphaël, et sollicite l’admiration des visiteurs, par la grâce puérile du modèle et la prestigieuse beauté de l’exécution.
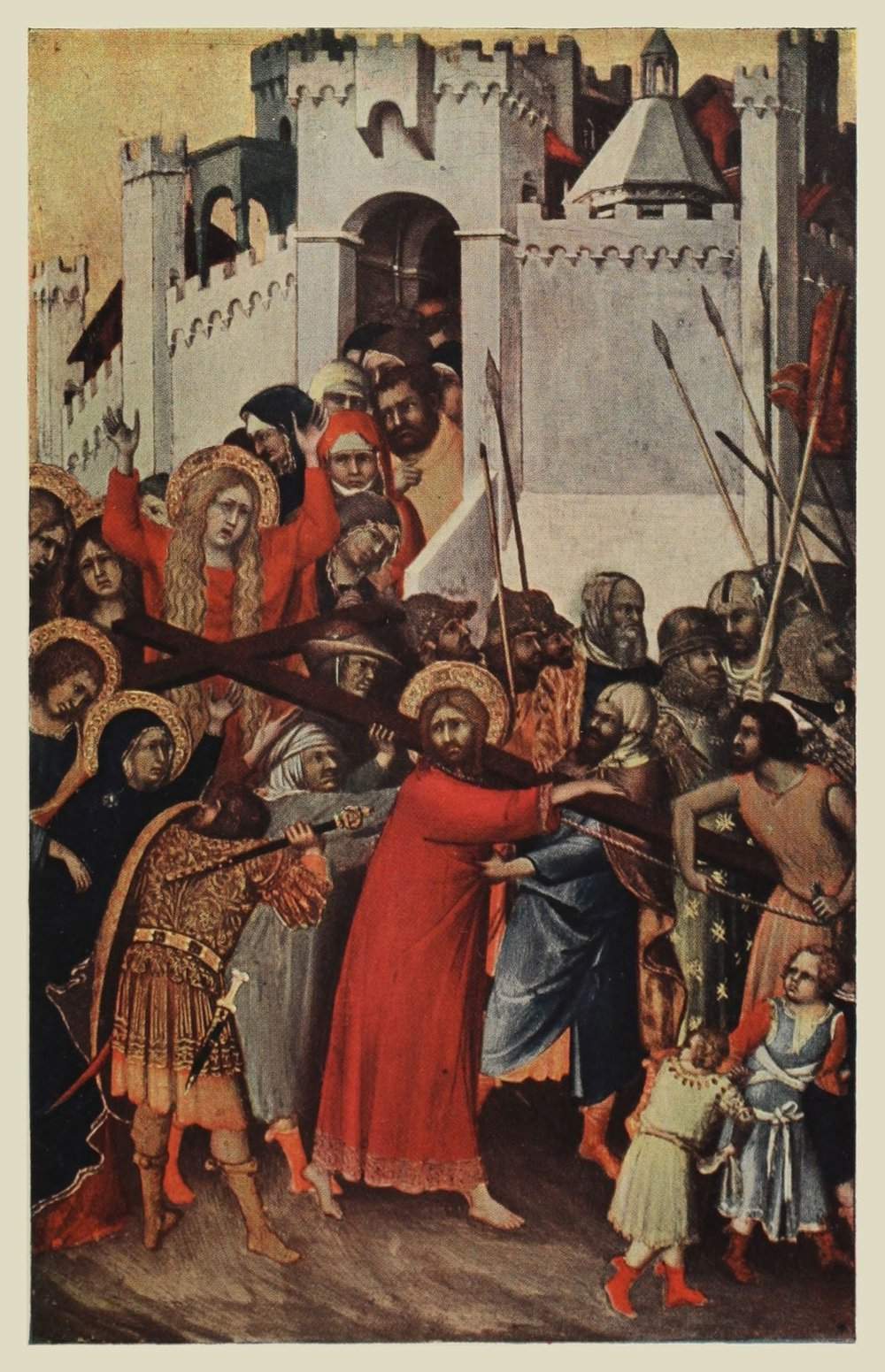
EN Avignon, vers l’an 1330. Sur l’écran bleu d’un ciel d’été se profile en vigueur, à travers un réseau d’échafaudages, une masse énorme de murailles et de tours. C’est le Palais des Papes qui s’élève, sous l’active impulsion de Jean XXII. Non loin de là, sur la terrasse d’une riche demeure, trois personnes sont assemblées, deux hommes et une femme. Le plus jeune des deux hommes semble rêver devant le grandiose spectacle en écoutant le grondement du Rhône au pied du mur. Tout près de lui se tient, dans une pose étudiée, une jeune fille admirablement belle, au visage sérieux et pensif, dont le regard s’arrête fréquemment sur le troisième personnage. Celui-ci, d’âge mur, est assis devant un chevalet et son pinceau fixe sur la toile les traits de son modèle, Laure de Noves, immortalisée par l’amour de Pétrarque, le poète rêveur qui se tient immobile à ses côtés. Le peintre, c’est Simone de Martini, plus connu dans l’histoire de l’art sous le nom de Memmi.
Le portrait de Laure n’est pas parvenu jusqu’à nous et c’est dommage si l’on en juge d’après les sonnets célèbres où Pétrarque glorifie cette peinture: «Certes, écrit-il, mon cher Simone a été dans le Paradis, d’où cette noble dame est venue; c’est là qu’il l’a vue et qu’il l’a peinte sur le papier pour faire connaître ici-bas son beau visage.»
Vasari prétend que les sonnets de Pétrarque ont plus fait pour la renommée de Memmi que ses œuvres propres; il lui reconnaît cependant une valeur considérable. Cette valeur est d’ailleurs attestée par la 56 faveur dont il jouit de son vivant et par les peintures, trop rares, que nous connaissons de lui.
Memmi était né à Sienne, vers 1284. Il fut, croit-on, l’élève de Giotto. En tout cas, s’il ne travailla pas dans l’atelier du grand peintre florentin, il collabora avec lui à plusieurs ouvrages de grande importance, notamment à la décoration de l’église Saint-Pierre à Rome.
Ces travaux lui avaient valu une grande réputation dont le bruit parvint jusqu’à Jean XXII, qui désira s’attacher Memmi. Celui-ci lui fut amené par le cardinal Annibal da Ceccano qui se rendait de Rome en France. Le pape accueillit le peintre avec honneur et lui confia la décoration de ses appartements privés, des salles du Conclave et de la chapelle pontificale. Il n’en reste malheureusement rien, cette partie du palais s’étant écroulée, un siècle plus tard, durant le siège qu’y soutint Pierre de Luna, l’antipape Benoît XIII.
Les œuvres de Simone Memmi sont donc très rares. Il existe toutefois des fresques de lui au palais des Papes, mais elles sont ensevelies sous le badigeon criminel des chambrées militaires, installées là. On trouve quelques-uns de ses tableaux dans les musées de Florence, de Naples, de Munich, de Berlin. Ils suffisent, malgré leur petit nombre, à assurer la gloire du grand peintre de Sienne. N’oublions pas qu’il s’agit d’un artiste du XIVe siècle à son début, c’est-à-dire d’une époque où l’art ne s’était pas encore dégagé de la tradition byzantine, hiératique et froide. On peut dire de cet art qu’il constitue la période glaciaire de la peinture. Avec un beau courage, bien secondé d’ailleurs par Giotto, Memmi s’efforça de secouer ce joug, d’assouplir cette rigidité, d’animer les visages par la tendresse de l’expression, en un mot d’introduire la vie dans des corps jusque-là sans âme et sans mouvement. Les œuvres de Memmi se distinguent par une grâce un peu maniérée et par un goût très marqué pour la finesse de la décoration et la préciosité ornementale; elles sont de véritables ouvrages d’orfèvrerie.
Cette manière toute personnelle se retrouve dans le Christ marchant 57 au Calvaire que nous donnons ici et dont les proportions réelles ne sont pas sensiblement supérieures à celles de notre reproduction.
Le Christ, vêtu d’une robe rouge, porte sa croix et s’avance vers la droite, entraîné par les bourreaux. Son corps est légèrement incliné, et sa tête se retourne à demi vers un soldat qui, derrière lui, écarte la Vierge et les saintes Femmes. Au fond, la Madeleine, vêtue d’une robe rouge, se dresse en gémissant, les cheveux épars. Elle est suivie d’une foule qui traverse un pont. A l’horizon, se profilent les remparts d’une ville.
Memmi séjourna à Avignon durant de longues années. C’est là qu’il connut Pétrarque dont la famille, inféodée aux Gibelins, avait dû s’exiler de Florence. Une véritable amitié se noua, nous l’avons vu, entre le peintre et le poète. Memmi fut en grande faveur à la cour pontificale, d’abord auprès de Jean XXII, puis auprès de Benoît XII et surtout de Clément VI, le plus magnifique et le plus artiste des Papes d’Avignon, Memmi ne put collaborer aux grands travaux que le pontife rêvait d’entreprendre, car il mourut en 1344, deux ans à peine après l’avènement de Clément VI.
Le Christ marchant au Calvaire est une toile collée sur panneau et plâtrée. Il est impossible de suivre sa destinée durant le cours des siècles. Nous la trouvons en 1834 dans la collection de M. Saint-Denis. Elle fut acquise pour le compte de Louis-Philippe, au prix de 200 francs. Cet admirable petit tableau figure aujourd’hui dans la Salle des Primitifs, avec les peintures de l’École de Sienne.
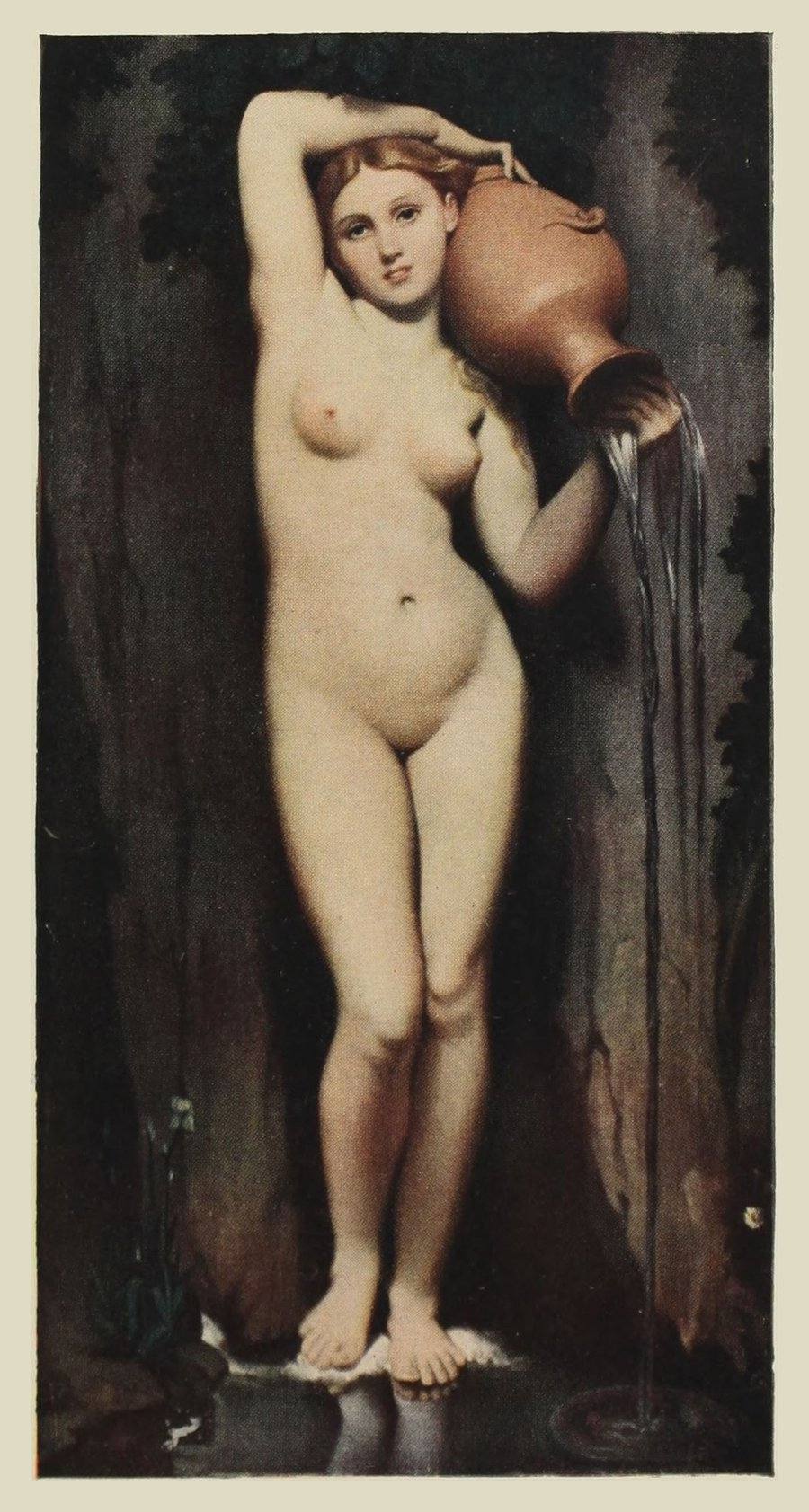
INGRES, grand amateur de formules lapidaires, émit un jour cet axiome: «Le dessin est la probité de l’art.» Inébranlable dans son culte de la forme, puisé d’abord dans l’atelier de David mais surtout à l’école de Raphaël, Ingres ne sacrifia jamais le dessin à la couleur. De celle-ci il ne s’inquiétait pas. Elle venait toujours, sûre, sobre et modeste. Elle suivait le dessin en esclave docile qui doit escorter son maître et marcher du même pas, mais à distance. «La couleur, disait-il, ajoute des ornements à la peinture, mais elle n’en est que la dame d’atours.»
Dans aucune de ses œuvres peut-être, autant que dans la Source, l’admirable artiste n’a poussé aussi loin la science du dessin et la perfection de la forme. Avant d’arriver à l’exécution définitive, que de croquis, que de recherches, que d’études! Les mains, les jambes, la tête, les pieds, la position de l’amphore furent l’objet de longs essais, de remaniements sans nombre dont la trace se retrouve dans les cartons du peintre et qui attestent une défiance de soi que connurent seuls les maîtres supérieurs. A l’époque où il préparait la Source, raconte Théodore de Banville, Ingres, avec un carton sous le bras comme un écolier, s’abandonnait à une colère furibonde à la porte d’un musée qu’il trouvait fermé. Un de ses anciens élèves l’aborde et, cherchant à le calmer:—Oui, monsieur Ingres, le musée est fermé, mais qu’y allez-vous donc faire?—Apprendre à dessiner, répondit le grand homme, avec sa naïveté de conquérant têtu; car, en effet, il n’avait pas 62 d’autre idée que celle-là et elle lui suffisait. Or, à ce moment-là, Ingres était un vieillard couvert de gloire; il avait produit ses plus beaux chefs-d’œuvre, et pour peindre la Source, il voulait encore apprendre à dessiner! Quelle belle et profitable leçon pour les fa presto vaniteux dont notre peinture contemporaine offre de si nombreux exemples! Qu’ils étudient, pour leur confusion, cet adorable corps de jeune fille, si frais, si chaste, si parfait, dont Charles Blanc a dit qu’elle était la plus belle peinture de l’école française.
Cette jeune fille aux cheveux blonds épars sur les épaules se tient de face, nue, appuyée contre un rocher que couronnent de légères ramures; de son bras droit arrondi elle soutient sur son épaule gauche un vase d’argile dont l’ouverture, inclinée vers le sol et maintenue par sa main gauche, laisse s’échapper l’eau qui tombe dans le bassin en filtrant à travers ses doigts. Les jambes de l’enfant, une merveille de finesse et de gracilité, se reflètent dans le cristal de la source.
Ingres aima toujours peindre les femmes; l’Odalisque, la Baigneuse, le Bain turc, l’Age d’or sont d’un artiste qui n’était pas insensible aux fascinations de la chair. «Il fut, écrit M. Henry Lapauze, un adorateur de la beauté féminine. Il la décrivit en des traits inimitables, d’un pinceau fervent, mais ses confessions restent toujours chastes, ses transports toujours contenus; il ne tombe jamais dans des matérialisations trop sensuelles.»
De cette affirmation la Source nous fournit une éclatante preuve. Ce corps charmant et délicat, dépourvu de tout voile, n’éveille cependant en nous aucun autre sentiment qu’une profonde admiration pour son idéale beauté; les sens demeurent en repos devant cette nudité si adorablement pudique.
La vue de ce tableau permet encore une autre constatation; elle démontre à l’évidence l’injustice des détracteurs d’Ingres qui lui contestent ses qualités de coloriste. Est-il possible de peindre des chairs de femme avec plus de chaleur et de vérité? Au surplus, Ingres avait, sur 63 le coloris, des opinions arrêtées que les plus violentes attaques ne purent jamais ébranler. Il était, aussi bien que tout autre, mieux même que bien d’autres, maître de son pinceau comme de son crayon. «Mais composer une toile pour un effet, choisir un motif aigu ou puissant et le faire dominer dans une symphonie de tons, lui semblait un procédé indigne de l’art. Utiliser la couleur comme une matière plastique, peindre ce que l’on appelle «en pleine pâte», avec des rehauts, des surcharges, des glacis, des touches visibles et grumeleuses, lui apparaissait blasphématoire. Animer la peinture d’une chaleur sensuelle, prodiguer la splendeur criarde des étoffes éclatantes, la lourde somptuosité des brocarts, des damas, des velours, des orfèvreries, étaler des chairs nues et grasses, avec des reliefs trop voluptueux, des roseurs sanguines trop ardentes, des plis et des taches trop véridiques, excitaient son indignation et sa répugnance.» (Henry Lapauze.) Il n’en était pas moins un traducteur fidèle et passionné de la nature, on pourrait presque dire un réaliste. Nous aurons certainement l’occasion de l’examiner sous cet aspect dans certains de ses magnifiques portraits du Louvre, dont la place est naturellement indiquée dans cette galerie d’œuvres célèbres.
On pourrait dire d’Ingres que, si d’autres peintres furent de plus brillants coloristes, aucun ne le surpassa pour l’impeccable correction du dessin. Cet amour passionné de la forme, il le tenait des grands artistes de la Renaissance et surtout de Raphaël. Quand on se réclame de tels maîtres, on peut attendre avec assurance le jugement de la postérité.
La Source fut léguée au Louvre par Mme la comtesse Duchatel.

INTÉRIEUR de riches bourgeois hollandais. Dans un fauteuil est assise une femme dont le visage exprime la souffrance. Agenouillée près d’elle et lui tenant la main, sa fille la regarde en pleurant. Derrière le siège une servante est penchée sur la malade et lui tend une cuiller contenant un remède. Au premier plan, debout, un médecin présente à la lumière de la fenêtre un flacon dont il examine attentivement le contenu.
Mercier, dans son Journal de Paris, analyse ainsi cette scène: «C’est un drame dont le sujet, quoiqu’il ne soit qu’un événement de la vie privée, captive tous les suffrages. Vrai, simple, pittoresque et touchant, il produit un tout du plus bel accord par la concordance des parties et la grâce des positions.»
D’après Théophile Gautier «il y a, dans la Femme hydropique, le chef-d’œuvre de Gérard Dow, du sentiment et une expression douloureuse et sympathique bien rendue, quoique l’artiste n’ait pas l’habitude de chercher le drame dans sa peinture, si calme, si polie, si soignée».
La patience, la propreté hollandaises poussées aux dernières limites, voilà la caractéristique du talent de Gérard Dow.
Abandonnons pour un instant la Femme hydropique aux soins de son entourage et examinons la chambre où se déroule ce drame domestique. Tout y est d’une netteté admirable, les moindres détails y sont notés avec une minutieuse précision. Devant la fenêtre dont toutes les vitres sont exactement encadrées dans leur alvéole de 68 plomb, un rideau est tiré à demi dont on pourrait compter les plis et les anneaux. Le livre, posé sur le trépied, laisse voir les feuillets à demi soulevés et sur la tranche rouge on lit la signature de l’artiste et la date du tableau: G. DOV. OVT 65 JAER. Sur les plis de la lourde tenture relevée à droite, les plus fines arabesques du dessin se trouvent reproduites avec une prodigieuse exactitude. Et le lustre, cette petite merveille de clair-obscur, dont on aperçoit les branches, les anneaux, les bobêches, de quelle recherche du fini ne témoigne-t-il pas!
Recherche d’autant plus extraordinaire chez Gérard Dow qu’il avait été durant plusieurs années l’élève de Rembrandt, le peintre des oppositions vigoureuses, des reliefs puissants et qui ne s’attardait pas au travail de marqueterie des accessoires.
Mais on ne travaille pas avec un tel maître sans en retirer quelque fruit.
A son école, il apprit le secret du clair-obscur dont nous voyons, dans la Femme hydropique précisément, qu’il savait fort bien user. Mais il tourna vers le précieux et le fini. Chacune de ses œuvres était soignée, fouillée, ciselée comme une pièce d’orfèvrerie. Rien ne lui semblait négligeable dans un tableau: le moindre accessoire avait à ses yeux autant d’importance que le sujet principal. Ces accessoires, il les multipliait même volontiers pour pouvoir satisfaire son goût de la minutie et du détail, témoin cette pendulette, dans le tableau qui nous occupe, dont on aperçoit les plus minces particularités et jusqu’au contrepoids pendant au bout de la double chaînette. Si l’on en croit Sandrard, il mettait parfois cinq jours pour peindre une main, mais, quand elle était finie, on en pouvait dénombrer les rides et les plis. Il peignait à la loupe, comme Breughel de Velours; c’est aussi à la loupe qu’il faut examiner ses tableaux: alors apparaît nettement le prodigieux labeur que représente chaque pouce carré de sa peinture.
Sa minutie était proverbiale; on citait son atelier comme une 69 merveille d’ordonnance et de netteté. Chaque jour, il le faisait nettoyer de fond en comble, afin qu’aucune parcelle de poussière ne vînt se poser sur les toiles en cours d’exécution. Il confectionnait lui-même ses pinceaux et broyait ses couleurs avec le plus grand soin. C’est à cela sans doute que ses tableaux doivent d’avoir traversé les siècles sans rien perdre de la fraîcheur de leur coloris.
Loin de lui nuire, son goût pour la peinture orfévrie contribua à sa fortune. Ce genre plaisait à la Hollande méticuleuse, soignée, qui voyait dans ces intérieurs rangés et brillants comme une glorification de ses vertus domestiques. Gérard Dow exécutait de petits portraits qui étaient très recherchés et qu’il vendait fort cher. La Compagnie des Indes lui paya 4.000 florins pour un tableau qu’elle voulait offrir à Charles II, roi d’Angleterre.
L’Électeur palatin, paya 30.000 florins la Femme hydropique et en fit don au prince Eugène de Savoie. Le tableau demeura dans la famille de Savoie, à Turin, jusqu’en 1800. A cette époque, le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel IV, dont les États étaient occupés par les armées républicaines, offrit ce tableau au lieutenant-général Clausel, depuis maréchal de France, qui s’empressa d’en faire hommage à la nation. On le plaça au Louvre où il figure aujourd’hui dans la partie de la Grande galerie réservée aux peintres hollandais.

SI Quentin La Tour fut un admirable pastelliste et un grand magicien de la couleur, la nature l’avait moins heureusement doté sous le rapport du caractère. Il était habituellement quinteux et fantasque. Très avancé dans les doctrines des Encyclopédistes, il affectait avec les grands une désinvolture frisant l’impertinence. On le voit reprocher au Dauphin que ses enfants sont fort mal élevés et qu’il se laisse duper par des fripons. Le roi lui-même doit subir ses boutades: pendant une séance de pose, il fatigue Louis XV par un éloge outré des étrangers:
—Mais je vous croyais Français, lui dit le roi surpris.—Non, sire, répond hargneusement La Tour, je suis Picard, de Saint-Quentin.
L’exécution du portrait de Mme de Pompadour, notamment, est marquée de péripéties et d’incidents sans nombre. Quentin La Tour n’aime pas la favorite. De premières ouvertures lui sont faites en 1750, il les repousse; prié de se rendre à Versailles auprès de la marquise, il se contente de répondre à l’envoyé:
—Dites à Madame que je ne vais pas peindre en ville.
Mme de Pompadour, dépitée, en écrit à son frère, le marquis de Marigny, qui est lié avec l’artiste. Son intervention amène un rapprochement et La Tour jette sur le papier deux préparations de son tableau. Puis il reste deux ans sans y travailler; tous les prétextes lui sont valables pour se dérober. A Marigny qui le presse il écrit qu’il se sent en proie «à un abattement, à un anéantissement qui lui font craindre la fièvre», et il 74 veut essayer «si l’air lui fera du bien». Marigny se fâche alors, mais sans plus de résultat. Mme de Pompadour, qui tient à son portrait, essaye de la douceur: «Je suis, lui mande-t-elle, à peu près dans le même embonpoint où vous m’avez vue à la Muette et je crois qu’il serait à propos de profiter du moment pour finir ce que vous avez si bien commencé. Si vous pouvez venir demain, je serai libre et avec si peu de monde que vous voudrez. Vous connaissez, Monsieur, le cas que je fais de vous et de vos admirables talents.»
Vaincu par tant d’insistance, La Tour cède enfin et se rend à Versailles, sur la promesse qu’aucun fâcheux ne viendra interrompre le travail. Mais, en bon philosophe, il est bien résolu à «donner une leçon à ces gens-là». Dès que la marquise est installée, il se met à son aise, enlève les boucles de ses escarpins, son col, sa perruque, ses jarretières et se coiffe d’un bonnet de taffetas. Survient le roi:
—Vous aviez promis, madame que votre porte serait fermée.
—Je ne vous dérangerai pas, fait le roi souriant; je vais rester là bien tranquille. Continuez.
—Il ne m’est pas possible d’obéir à Votre Majesté; je reviendrai lorsque madame sera seule: je n’aime point à être interrompu.
Et il s’en fut.
Enfin, après trois ans d’efforts et de mécomptes, le portrait fut achevé et figura au Salon de 1855. Malgré l’évidente mauvaise volonté mise par La Tour à peindre la favorite royale, les témoignages du temps s’accordent à reconnaître qu’il mit de la galanterie à l’embellir. Combien différente et plus véridique est la «préparation» du tableau, qui se trouve aujourd’hui au musée de Saint-Quentin!
Mais, en dépit de son exécution volontairement flatteuse, ce portrait n’en est pas moins une œuvre de premier ordre, l’une des meilleures de La Tour. Sainte-Beuve lui a consacré une de ses pages les plus brillantes:
«C’est la personne même, écrit-il, qui est de tout point merveilleuse 75 de finesse, de dignité suave et d’exquise beauté. Tenant en main le cahier de musique avec légèreté et négligence, elle est tout à coup distraite. Elle semble avoir entendu du bruit et retourne la tête. Est-ce bien le roi qui vient et qui va entrer? Elle a l’air d’attendre avec certitude et d’écouter avec sourire. Sa tête ainsi détournée laisse voir le profil du cou dans toute sa grâce et ses petits cheveux très courts, délicieusement ondés, dont les boucles s’étagent et dont le blond se devine encore sous la demi-poudre qui les couvre à peine. La tête nage dans un fond bleuâtre qui, en général, est celui de tout le tableau. L’œil est partout satisfait et caressé; c’est de la mélodie plus encore que de l’harmonie... Il n’est rien dans ce boudoir enchanté qui ne semble faire sa cour à la déesse. Elle-même a les chairs et le teint d’un blanc lilas, légèrement azuré. Ce sein, ces rubans, cette robe, tout cet ensemble se marie harmonieusement. Tout dans la physionomie, dans l’attitude, exprime la grâce, le goût suprême, l’affabilité et l’aménité plutôt que la douceur, un air de reine qu’il a fallu prendre, mais qui se trouve naturel et se soutiendra sans trop d’efforts.»
Mme de Pompadour se déclara satisfaite du pastel, mais quand vint l’heure du règlement, les difficultés recommencèrent. La Tour ne demandait rien moins que quarante-huit mille livres! Après bien des pourparlers et des tiraillements, il dut se contenter de la moitié de cette somme, mais il ressentit de cette déconvenue une colère qui fut très longue à s’apaiser.
Le portrait de Mme de Pompadour passa, on ne sait comment, entre les mains du comte de Lespinasse d’Arlet, puis fut acquis, en 1797, par le Muséum des Arts. Il resta dans la poussière des réserves nationales jusqu’en 1838, date à laquelle il fut transféré au Louvre, où il figure aujourd’hui dans la salle des Pastels.

SUR la terrasse d’un parc majestueux, dans le goût de celui de Versailles, avec fontaines, balustrades, escaliers de marbre, divinités marines, une jeune princesse toute gracieuse est représentée. Une abondante chevelure blonde encadre son joli visage. Joufflue, potelée, de proportions déjà bien dessinées, la fillette conserve dans l’attitude éveillée et mutine cette native distinction qui trahit la race. Quelle fut cette princesse et quel nom laissa-t-elle dans l’histoire? Nous l’ignorons et cela n’enlève rien au charme de cette mignonne enfant. En un geste plein de naturel, sa main gauche tient une tige fleurie qu’elle se dispose à fixer dans un vase placé devant elle. La main droite retrousse légèrement la robe pourpre en forme de tablier pour maintenir la cueillette de fleurs dont certaines se sont déjà échappées et gisent à terre. Le mouvement qui soulève la robe laisse apercevoir d’élégants dessous en dentelle et la naissance d’une jambe agréablement tournée. Devant elle, sur la console de marbre qui supporte le vase, un perroquet au plumage multicolore est posé, tandis qu’à ses pieds un petit chien blanc et noir paraît jouer.
Autant les personnages sont gracieux, autant le décor est grandiose. Dans le jardin, de grands arbres d’un vert sombre forment l’écran sur lequel se profile en vigueur le blond visage de la princesse. Des groupes de femmes en riche toilette traversent, au loin, les allées du parc.
L’ensemble est très harmonieux dans son arrangement un peu 80 apprêté, et la composition très habilement disposée pour laisser tout l’intérêt au portrait de l’enfant, objet unique de l’œuvre.
Ce qu’il convient de remarquer dans ce tableau, peint par un Hollandais, c’est l’absence complète des caractères essentiels de la peinture hollandaise. A sa manière on devine qu’une révolution s’est accomplie, qu’une influence étrangère a pénétré l’art de Ter Borch et de Nicolas Maës. C’en est fait des scènes intimes, des réunions de cabaret, des joyeuses tablées de buveurs et de fumeurs. L’art n’a certes pas grandi—mais il s’est haussé de ton, il s’est orienté vers le pseudo-classicisme de l’art français, régenté par Le Brun. La France est alors à son apogée; la gloire du Roi-Soleil a conquis l’Europe et derrière ses armées victorieuses, c’est la langue française, la poésie française, la peinture française, le goût français qui franchissent les frontières et captivent les peuples. Un peu partout, à l’image de la France, on cherche à faire grand et si l’on ne parvient pas à égaler la majesté que Louis XIV imprime à tout, on s’efforce d’y atteindre; si la peinture hollandaise est mal préparée à imiter les solennelles et vastes compositions de Le Brun, du moins elle s’évertue à se grandir aussi.
Les deux Netzcher, Gaspard et Constantin, le père et le fils, firent les premiers pas dans cette voie nouvelle. Gaspard Netzcher, d’ailleurs, bien qu’ayant travaillé dans l’atelier de Ter Borch à Deventer, ne se cachait pas d’affinités françaises. Tout jeune, il était venu en France et avait séjourné à Bordeaux, où il s’était marié. Dans son voyage de retour aux Pays-Bas, il s’était arrêté à Paris et les splendeurs entrevues l’avaient ébloui et conquis. L’art hollandais, si pittoresque dans son intime et rustique simplicité, lui parut dès lors inférieur ou tout au moins sans noblesse. Il résolut de ne pas le continuer et d’adopter un genre moins familier. Phénomène étrange, son pays ne lui tint pas rigueur de cet abandon de la tradition. Au contraire, Gaspard Netzcher jouit d’une vogue générale et acquit une fortune considérable. Les plus riches personnages d’Amsterdam et de La Haye se disputèrent la 81 faveur de poser devant lui; il fit même plusieurs fois le portrait de Guillaume III. Peintre souple et brillant, il revêtait ses personnages d’une élégance un peu mignarde, plus agréable que vraie, mais qui devait séduire et flatter les bourgeois un peu lourds de Hollande.
Bien qu’ayant rompu avec la tradition, Gaspard Netzcher traita parfois le tableau de genre et s’y montra supérieur. Ses scènes intimes n’ont pas le pittoresque de celles de Ter Borch, mais elles témoignent d’une habileté consommée et d’une science parfaite de la composition. On pourrait citer comme des modèles La leçon de Basse viole et la Leçon de Chant qui sont au Louvre, et sa Dame donnant à manger à un perroquet.
Aussi habile que son père, Constantin Netzcher accentua davantage encore sa manière et, sans posséder ses brillantes qualités, il n’en donna pas moins bon nombre de portraits bien venus, méthodiquement ordonnés, placés dans un cadre un peu théâtral mais agréable. Il eut, pour le servir, une palette heureuse, chargée d’un coloris toujours frais, pimpant, et il savait mettre ses modèles dans la pose qui les faisait valoir le mieux. A ces dons de virtuose il ne joignait pas à un égal degré la vision exacte ni l’expression réelle de la vie. Il n’est pas moins un des plus charmants de ces «petits maîtres» hollandais qui nous ont laissé de si délicieux chefs-d’œuvre.
La Jeune Princesse est entrée au Louvre avec tous les tableaux de la Collection La Caze, dont elle faisait partie.

VOICI une de ces scènes dans lesquelles la peinture hollandaise s’est toujours exercée avec bonheur. On y retrouve réunies toutes les qualités de cet art, si charmant dans sa vulgarité, à la fois jovial et précis, qui traite avec la même méticuleuse précision les épisodes religieux et les kermesses débraillées, avec le même réalisme la face exsangue du Christ mort et les trognes enluminées des buveurs.
La scène représentée ici se passe probablement dans quelque estaminet de Leyde, peut-être même dans la propre maison de van Steen, qui fut, en même temps que peintre, cabaretier de son état et ivrogne endurci. Nous y voyons, dans le désordre consécutif aux séances de débauche, un type de paysan aisé, à la tête alourdie de vin, les yeux appesantis par l’ivresse, qui fait un effort pour ramasser sa pipe tombée à terre. On devine que le moindre faux mouvement lui fera perdre tout équilibre et qu’il tombera de sa chaise, ivre-mort, sur le sol. A côté de lui, sur un siège à haut dossier, une belle et robuste jeune femme—sans doute sa compagne d’orgie—esquisse de la main un mouvement de retrait de ses jupes comme pour éviter d’être heurtée par la chute inévitable de l’ivrogne. Sa figure a quelque chose de bestial, comme celle du buveur quelque chose de naïvement hébété. Et tandis que le triste fêtard somnole, insouciant de tout, les bonnes pièces qui l’entourent s’entendent à merveille pour le dévaliser. Debout à sa gauche, une deuxième femme, servante de l’auberge apparemment, explore les poches du dormeur, en retire sa montre qu’elle remet à une 86 vieille usurière, dissimulée dans l’ombre, qui versera le prix du vol. Au deuxième plan, dans un fond de la pièce, un homme assis fume tranquillement sa pipe pendant qu’un musicien debout continue de jouer, pour couvrir le bruit du marchandage et tous deux contemplent la scène en riant.
Ce tableau, l’un des meilleurs de van Steen, se recommande par le souci du détail épisodique, particulier à l’école hollandaise. Rien n’y est oublié de ce qui peut ajouter à l’intérêt de la scène. Avec un art supérieur, van Steen a prodigué tous les accessoires susceptibles d’aider à la compréhension parfaite de son œuvre. Peintre de genre de premier ordre, il nous décrit ce qu’il voit, comme il le voit, avec l’unique préoccupation de faire vrai. Par contre, les conceptions morales le laissent indifférent. S’il peint une scène d’orgie, ce n’est pas afin de montrer les effets de la débauche ni pour nous la faire détester. Tant de philosophie n’entre pas dans ses vues. Ce qu’il a jeté sur la toile, c’est l’épisode quotidien de l’ivresse qui chavire les cervelles et abrutit les corps. Aucun enseignement ne s’en dégage. Dans la disposition des personnages, on devine même que van Steen s’amuse de la mésaventure de son ivrogne et que la filouterie dont il est victime lui paraît un bon tour aimablement joué.
Quoi qu’il en soit, l’œuvre est charmante de naturel et de malice.
Jan Steen est le plus habile et le plus spirituel des maîtres hollandais au XVIIe siècle, celui qui porta au plus haut point de perfection la peinture de genre. Il est observateur attentif, minutieux et, dans chaque objet qui sollicite son attention, l’acuité de son regard lui fait découvrir le côté comique, ridicule, sur lequel pourra s’exercer sa verve.
Compatriote et contemporain de Gérard Dow et de Terborch, il n’a ni la manière large de celui-ci, ni la méticuleuse minutie de celui-là. Terborch est supérieur à Jan Steen par la correction merveilleuse de son dessin et l’harmonieuse fraîcheur de son coloris, mais van Steen 87 l’emporte incontestablement par sa fantaisie, sa verve narquoise, sa vivacité joviale. Chacun d’ailleurs s’est enfermé dans un genre spécial: Terborch s’est fait le peintre des intérieurs riches et les personnages dont il peuple ses tableaux sont des gens de bonne compagnie, de mise correcte et de manières élégantes. Gérard Dow semble avoir choisi ses modèles dans la classe moyenne, et ses toiles finies, polies, orfévrées devaient plaire à la soigneuse bourgeoisie hollandaise. Jan Steen, lui, cherche ses sujets de tableau dans les cabarets et les lieux de plaisir. Le millier de toiles qui compose son œuvre est entièrement consacré à la peinture des ripailles, des orgies, des noces paysannes et des scènes burlesques. C’est le milieu qu’il préfère, c’est celui où il vit quotidiennement et il dépense à le traduire une fantaisie débordante, une gaîté énorme et un talent de premier ordre.
Jan Steen avait d’ailleurs de qui tenir. Il avait travaillé longtemps à Haarlem dans l’atelier de van Ostade, puis à La Haye, dans celui de van Goyen, dont il épousa la fille. On n’a pas de renseignements très précis sur la vie de cet artiste qui semble avoir laissé à Leyde, sa ville natale, une fâcheuse réputation d’ivrogne et de débauché; ses peintures n’en étaient pas moins très goûtées, à cause de leur spirituelle drôlerie.
De l’œuvre considérable de Jan Steen, le Louvre ne possède que trois tableaux: la Fête dans l’intérieur d’une auberge, le Repas de famille, et la Mauvaise compagnie.
Ce dernier tableau fit partie de la collection Charles Cope de Londres. Il fut vendu 2250 florins à la vente Taylor et le Ministère des Beaux-Arts l’acquit, en 1881, pour la somme de 4750 francs. Il figure aujourd’hui à la salle Jan Steen.

HANS HOLBEIN est, sans nul doute, la plus grande figure de l’art allemand et son illustre contemporain Albert Dürer doit lui céder la première place. Il a pratiqué l’art sous toutes ses formes avec une égale maîtrise; qu’on le considère comme dessinateur, décorateur, peintre de fresques, portraitiste, architecte, modeleur, orfèvre, illustrateur, miniaturiste, il nous révèle toujours une merveilleuse personnalité. Mais, chez lui, c’est avant tout le peintre de portraits qui reste incomparable.
Jamais la physionomie humaine n’a été rendue avec autant de précision, avec autant de pénétration, et cela sans artifices de couleurs, par la seule netteté du trait, par le rigorisme de la ligne, par la géographie des rides. Il n’y a plus que la vérité du modèle immobile devant le peintre, l’âme même est exprimée, le portrait devient une révélation, presque une indiscrétion; il est toute une biographie. Pas de décor, pas d’embellissement, aucune flatterie, la nature est prise sur le fait, et cet art demeure unique, inégalé. Sa sécheresse lui est une qualité de plus: Holbein a cette sincérité implacable, cette conviction intransigeante, cette impassibilité merveilleuse que personne n’a possédées comme lui, et qui font de son œuvre une chose à part, un trésor spécial, qui porte sa marque indélébile. On dit: un Holbein, et cette simple appellation évoque de suite une galerie d’effigies remarquables, ayant toutes le même intérêt, la même haute valeur, qu’il s’agisse de Henri VIII, de la reine Jane Seymour, d’Édouard VI, de 92 l’archevêque de Cantorbery, de Christine de Danemark, de Nicolas Kratzer, d’Érasme, du bourgmestre Jacques Meier, du docteur Jean Chambure ou de tant d’autres dont on ignore les noms.
Le portrait d’Érasme, que nous donnons ici, est un des plus beaux du maître. Il n’est pas le seul toutefois, Holbein ayant à plusieurs reprises peint les traits du célèbre érudit et philosophe bâlois, qui était son ami.
Érasme est représenté de profil, assis devant son pupitre et écrivant. Il est vêtu d’une lourde houppelande de couleur sombre, aux larges manches garnies de fourrure. Sa tête est couverte d’un large bonnet de même étoffe et de même couleur. Le fond du tableau se compose d’une tapisserie à ramages que le peintre a volontairement noyée d’ombre, comme la toque et le costume, afin de ne mettre en lumière que la tête et les mains de son modèle: la tête du penseur, la main de l’écrivain. Tout l’intérêt, toute la vie du tableau sont concentrés sur ces deux taches claires, avec une intensité et une perfection que seul un artiste comme Holbein pouvait atteindre.
Le dessin de la figure est merveilleux avec l’œil attentif baissé sur le papier, le nez effilé, les lèvres pincées, les plis du menton et des joues. Toute l’attitude de cette tête sérieuse trahit l’application, la volonté et en même temps cette finesse narquoise qui fut la marque distinctive de la philosophie légèrement sceptique d’Érasme. La main gauche, ornée de bagues, maintient le papier sur le pupitre, tandis que la droite trace des lignes. Le modelé de ces mains est admirable et, s’agissant d’Holbein, il est à peine nécessaire d’ajouter que ce portrait est un chef-d’œuvre.
Holbein avait connu Érasme à Bâle, où il était venu tout jeune avec ses parents en 1515, et où il passa la plus grande partie de sa vie. Bâle, à cette époque, était un foyer intellectuel très actif, où bouillonnaient même les idées réformatrices dont Martin Luther commençait à secouer l’Allemagne. Parmi les humanistes ballottés dans les 93 remous de ce torrent, émergeait une figure railleuse de savant et de philosophe qui paraissait assister au grand drame de la Réforme en spectateur amusé plus qu’en acteur: c’était Érasme. Entré tout jeune dans les ordres, il avait pris son grade de docteur en théologie, mais il s’était vite fatigué de la vie monastique et avait obtenu du pape d’être relevé de ses vœux. Holbein et Érasme, dès qu’ils se connurent, se lièrent d’amitié et quand le philosophe, appelé en Angleterre par Henri VIII, se fixa à Londres, il songea à Holbein, dont il appréciait le talent, et l’engagea à venir le rejoindre, lui promettant de le patronner à la cour. Holbein quitta Bâle et passa en Angleterre. Fidèle à sa promesse, Érasme le recommanda à Thomas More, chancelier du royaume, et pour servir plus efficacement son ami, il lui envoya le magnifique portrait reproduit ici. C’était la plus sûre des recommandations. Thomas More vit le portrait, le trouva admirable et fit à Holbein l’honneur de poser devant lui avec toute sa famille, ce qui fournit au peintre l’occasion de réaliser un nouveau chef-d’œuvre. Ce portrait consacra la réputation d’Holbein en Angleterre. A partir de ce jour, tout ce que la cour et la ville renfermaient de personnages considérables défila dans son atelier. Il fut même le peintre officiel de Henri VIII qui le chargea plusieurs fois de faire son portrait et celui des différentes femmes qu’il épousa successivement.
Le beau portrait d’Érasme appartint plus tard à Charles Ier qui, après l’avoir conservé quelque temps, le donna à Louis XIII en échange du Saint Jean-Baptiste, de Léonard de Vinci, qu’il désirait posséder. Depuis lors, Érasme est demeuré propriété nationale, il figure dans la Grande galerie, à la travée d’art allemand.

ON raconte que Corrège, âgé de dix-sept ans, vint à Mantoue et y vit la Victoire de Mantegna. Devant l’œuvre du maître padouan son âme d’artiste tressaillit, il sentit remuer en lui les bouillonnements de son futur génie et, transporté d’enthousiasme, il s’écria: Ed anch’io son pittore! (Moi aussi, je suis peintre!)
Peintre, Corrège le fut dans l’acception la plus étendue et la plus élevée de ce terme. Il est de ces artistes dont la gloire rayonne souverainement et ne connaît pas de détracteurs, car il possède au suprême degré tous les dons du génie: une originalité charmante, une grâce ineffable, une palette d’un coloris magique et une science qui le classe, avec Michel-Ange, comme le premier dessinateur du monde.
Fresques, mythologies, scènes de genre, sujets profanes ou religieux, il a tout traité avec une égale perfection; et dans toutes ses œuvres se retrouvent cette souplesse, cette fantaisie, cette grâce qui nous font adorer sa peinture.
Le Mariage de sainte Catherine, notamment, nous montre Corrège dans l’épanouissement complet de son génie.
La Vierge, presque de profil, tient l’Enfant Jésus sur ses genoux. Agenouillée devant elle, sainte Catherine livre sa main au divin Enfant qui s’apprête à passer à son doigt l’anneau, symbole de leur union. «Cela forme le plus délicieux bouquet de mains que jamais peintre ait groupées au centre d’un tableau. On dirait qu’elles sont faites de la pulpe des lis, tant elles sont pures, délicates et nobles avec leurs doigts 98 amincis en fuseaux et relevés du bout.» L’expression d’extase amoureuse de la sainte qui épouse de toute son âme et pour l’éternité l’insouciant bambino, est admirablement rendue. Derrière la sainte se tient debout un saint Sébastien d’une beauté merveilleuse et à qui les flèches, symbole de son martyre, qu’il tient à la main, donnent une apparence d’Amour.
Dans les profondeurs de la perspective, à gauche, le peintre a eu l’idée ingénieuse de montrer le saint et la sainte livrés à leurs bourreaux. Mais ces épisodes sont de petites dimensions, esquissés légèrement, noyés d’ombres et traités de manière à ne pas distraire l’attention du sujet principal. Pour les voir, il faut les chercher bien loin, au dernier plan, et l’œil, amoureusement attaché sur les figures délicieuses de la Vierge, de sainte Catherine et de l’Enfant Jésus, ne s’en détourne pas volontiers.
«Celui, écrit Charles Blanc, qui a vu, étudié, admiré cette page d’un sentiment si délicat, n’est pas loin de comprendre toutes les perfections de Corrège. L’idée seule du tableau révèle un peintre dont l’esprit abonde en inventions charmantes. Sainte Catherine, unie au divin Maître par le martyre souffert en son nom, s’appelle, en langage mystique, l’épouse du Christ. La poésie, l’imagination acceptent cette désignation symbolique. Mais comment mettre sous les yeux du chrétien ce mariage du Christ avec une vierge pure et belle? Corrège le sait. Ce n’est pas le Christ devenu homme, le Christ descendant de la croix et placé à la droite de son père qui présente l’anneau à la vierge martyre, c’est l’Enfant né à Bethléem, encore sur les genoux de sa mère. Invention naïve et ingénieuse à la fois! Le mythe s’explique sans effort: cet Enfant ne peut être l’époux de cette femme; cette union, impossible dans ce monde, est un mystère qui s’accomplit dans le ciel! La physionomie de la mère exprime cette inépuisable complaisance, ce dévouement sans limites, cet amour parti des entrailles dont nul autre peintre n’a eu le sentiment au même degré que Corrège. 99 L’innocence de la vierge se mêle à la béatitude de la sainte sur la figure de sainte Catherine. Quant à l’exécution, elle est merveilleuse de finesse, d’éclat dans les chairs et de transparence dans les ombres.»
Peintre délicat et attendri de la beauté féminine, Corrège donne à ses têtes de femmes et de vierges une grâce presque enfantine et, chez lui, les têtes, plus jeunes que les corps arrivés à tout leur développement, gardent un air d’innocence et d’étonnement candide. Rien de plus piquant que ce contraste, ménagé d’ailleurs avec un art infini. Dans le Mariage de sainte Catherine, en particulier, la Vierge a cette fleur d’extrême jeunesse et la sainte n’est guère plus âgée.
Théophile Gautier écrit: «Sous le léger voile d’ambre que le temps a jeté sur ce tableau, on y sent une fraîcheur argentée, des reflets bleuis, des tons de nacre, et toute cette gamme de nuances charmantes endormies dans le mystère du clair-obscur, où Corrège est resté sans rival.»
On dit que Corrège peignit ce tableau à l’occasion du mariage de sa sœur, qui s’appelait Catherine. Il n’est pas sûr que l’artiste en ait fait don à la jeune femme; en tout cas, elle ne le conserva pas longtemps, car on le trouve vers la même époque, en 1525, en la possession d’un ami de Corrège, le médecin Grilenzoni. Après avoir décoré le cabinet de la comtesse Santa Fiora, cette peinture passa chez le cardinal Sforza, qui la possédait en 1614, et ensuite chez le cardinal Barberini, qui en fit don à Mazarin. Louis XIV l’acheta aux héritiers du cardinal en 1661. Depuis cette époque, le Mariage de sainte Catherine n’a plus quitté les collections nationales et il figure aujourd’hui au Salon carré, dont il est un des plus précieux joyaux.

LANCRET! Quelle charmante époque et que de jolies choses abolies évoque ce nom! Parler de Lancret nous reporte aux beaux jours de Trianon et de Versailles, au temps où ces fastueuses résidences abritaient la cour, où les allées solennelles du parc s’animaient au babillage des groupes ou couvraient de leur ombre les tendres aveux murmurés tout bas. C’est tout un passé d’élégance, de frivolité, d’esprit, d’enjouement, de politesse, c’est tout un monde qui revit dont le seul but semble avoir été le plaisir, et l’intrigue amoureuse la seule occupation. Plus même que Boucher, Lancret est le fidèle historiographe de ce temps en ce qu’il ne couvre pas comme lui ses personnages sous le voile anonyme de l’allégorie. Ses modèles, il les prend dans la vie même, autour de lui, et il les peint comme il les voit, avec leurs vrais ajustements et dans leurs attitudes familières. Voyez cette pimpante marquise qui se hâte le long du bassin de Neptune, rougissante et jolie, courant sans doute à quelque rendez-vous et retroussant une jupe bruissante afin d’aller plus vite: c’est un Lancret qui passe. C’est un Lancret aussi, ce jeune page à la mine éveillée qui semble attendre, à l’ombre d’un bosquet, l’aventure promise.
C’est également un Lancret, et des plus charmants, le jeune couple conversant au pied d’un arbre que nous montre la planche reproduite ici. Assise sous le feuillage sombre, la jeune femme semble écouter les galants propos murmurés tout près de son oreille par un cavalier 104 appuyé sur un pan de mur. Elle écoute, mais le sourire des yeux et des lèvres laisse entendre que le marivaudage de son amoureux l’amuse sans la convaincre. Quelle exquise créature que cette femme et quel charme dans ce délicat visage encadré d’un diadème blond! Sur ses épaules nues un léger manteau en voile bleu est négligemment jeté; autour du cou un collier de perles s’enroule et descend le long de la gorge dont on aperçoit les rondeurs par l’échancrure du corsage. Une jupe de soie d’un jaune éteint se drape gracieusement autour du corps en plis souples qui descendent jusqu’au sol. La main gauche est posée sur les genoux; la main droite, admirablement modelée, tient un masque de velours noir. Cet attribut de comédie cadre parfaitement avec le costume du personnage placé près de la jeune femme et qui a toute l’apparence d’un acteur de troupe italienne.
Cette délicate fantaisie est peinte avec un art supérieur. Lancret y a prodigué ces tons moirés, veloutés qui donnent une élégance de plus à ce tableau. Tout y est équilibré et charmant: le bleu, le rouge, le jaune, bien que disposés en masses compactes et distinctes, s’harmonisent et se fondent pour former un ensemble d’une adorable douceur.
Lancret est, avec Watteau, le peintre le plus représentatif du siècle des boudoirs, des fêtes champêtres et des galantes intrigues.
Tout jeune, il avait connu le grand artiste. Celui-ci, ému de l’admiration que lui témoignait le jeune Lancret, lui donna des conseils et l’élève étudia si bien la manière du maître qu’il en arriva à se l’approprier complètement. Ce fut au point qu’un jour, dans une Exposition, deux œuvres de Lancret furent prises pour des Watteau. Il en résulta entre les deux peintres une brouille qui dura pendant de longues années.
Malgré la similitude des genres, un œil averti ne peut cependant confondre les deux artistes. Lancret n’a pas la poésie mélancolique de son grand rival ni sa brillante imagination. Dans les paysages un peu conventionnels que l’un et l’autre emploient comme fond de leurs 105 tableaux, Watteau place des personnages maniérés sans doute, mais plus vivants que ceux de Lancret; de même sa couleur est plus chaude, plus vibrante. Un peu plus froid, légèrement figé, Lancret n’en a pas moins une grâce charmante; son art est souriant et ses personnages délicats font songer à des bibelots précieux et frêles. Lancret eut une vogue considérable. Ses œuvres, assez généralement de petite dimension, étaient appréciées et se vendaient très bien. A la fortune s’ajoutèrent les honneurs. En 1719, il est nommé à l’Académie royale de peinture, avec le titre de «peintre des fêtes galantes» qu’il partageait avec Watteau.
Lorsque Lancret apprit que Watteau était sérieusement malade, il demanda à se réconcilier avec ce maître qu’il avait tant admiré et aimé. Les deux peintres se pardonnèrent leurs torts réciproques: ils avaient tous les deux une assez belle part de gloire pour oublier toute rancune.
La gloire de Lancret, sans égaler celle de Watteau, reste enviable. Élégant et spirituel, il est bien le peintre de la société de son temps: libre sans grossièreté, délicat, charmant, il n’évoque que des images riantes ou des scènes aimables. Ses Scènes champêtres, ses Conversations, ses Concerts, ses allégories décoratives sont des sujets peu renouvelés mais qu’il sait rendre aimables par l’abandon gracieux des attitudes, par l’agrément des fonds de paysage, par l’ingéniosité piquante des détails.
Le musée de Berlin possède 26 Lancret; moins riche, le Louvre n’en a que 12.
La Conversation est entrée dans notre grand musée national avec la collection La Caze.

SUR un métier de dentellière, une jeune femme est penchée, attentive, et fait courir dans ses doigts agiles les fuseaux et les fils de soie. Sa blonde tête, couronnée de cheveux bien peignés et roulés en tresse vers la nuque, est d’une robuste beauté septentrionale. Les traits sont réguliers, fortement accusés, un peu vulgaires et trahissent l’origine plébéienne du modèle. Sur la table, à côté de la diligente ouvrière, on aperçoit un coussin bleu et un gros livre, dont elle lit sans doute quelques passages aux intervalles de repos.
Ce tableau, à peine plus grand que la planche reproduite ici, rentre dans la catégorie des peintures de genre dans lesquelles excellèrent les artistes hollandais du XVII siècle, ceux qu’on appela «les petits maîtres».
Van der Meer fut un des meilleurs, peut-être le meilleur, de ces petits maîtres et cependant, par une bizarre injustice de la Destinée, nous voyons son œuvre et sa personnalité tomber dans l’oubli pendant deux siècles. Vingt ans après sa mort on ne sait rien de lui dans son propre pays. Son nom même est dénaturé. De Vermeer, qui était son nom véritable, on a fait Van der Meer, ce qui a permis de le confondre avec la dynastie des Jan van der Meer de Haarlem, et avec le Jan van der Meer d’Utrecht. Pis que cela, ses toiles ont été attribuées successivement à Peter de Hoogh, à Metsu ou à d’autres encore. Aucun autre peintre n’a connu cette disgrâce complète dans laquelle tout sombre, l’œuvre et le nom.
110 Vermeer était digne d’un autre sort car il fut véritablement un grand peintre. Il possédait une invention très riche, une harmonie supérieure dans l’arrangement des couleurs, une gradation parfaite dans les teintes, une touche énergique, large, solide, des empâtements très fins. Ses scènes de la vie domestique sont remarquables par le pittoresque de la composition, et surtout par la beauté de ses effets de lumière dont le visage de La Dentellière nous offre un éloquent exemple. La dominante de son coloris, dans la plupart de ses tableaux, consiste en une tonalité bleuâtre, extrêmement douce, encore affinée par la légèreté de ses frottis.
De son vivant, Vermeer comptait parmi les meilleurs peintres de Delft. Il était encore tout jeune que déjà Dirk van Bleyswijck, historiographe de la cité, le signalait avec éloges. On conduisait les étrangers de marque à son atelier. Il était entré comme apprenti, suivant l’usage d’alors, à l’âge de quinze ans, dans l’atelier d’un peintre de Delft, probablement Léonard Bramer. Six ans après, il passe maître-peintre dans la guilde de Saint-Luc. Mais il est pauvre et n’a pas les six florins exigés pour l’entrée dans la corporation: il ne peut verser qu’un florin dix sols et s’acquitte du reste par acomptes. Mais son mérite ne tarde pas à s’imposer, il gagne rapidement l’estime de ses compatriotes et de ses confrères, et on le trouve à plusieurs reprises doyen de la guilde de Delft.
Vermeer ne fut jamais riche et quand il mourut, à l’âge de quarante-deux ans, il ne laissait à sa femme et à ses huit enfants vivants que des dettes criardes. Il devait notamment 600 florins à son boulanger. Sa veuve donna deux tableaux pour les payer, et comme elle avait pour le talent de son mari une admiration profonde, elle stipula qu’elle pourrait les racheter par versements annuels de 50 florins.
Après une éclipse de deux siècles, le nom de Vermeer se reprit à briller, comme ces astres réputés perdus qui soudain reparaissent au firmament. En 1809, un expert le qualifie de «très grand peintre 111 dans la manière de Metsu». Reynolds mentionne sa Femme transvasant du lait parmi les tableaux qui l’ont le plus frappé pendant son voyage en Hollande. Plus tard Maxime du Camp, Théophile Gautier, Paul Mantz, Clément de Ris contribuèrent à le faire connaître, mais c’est à Burger-Thoré que revient l’honneur de sa complète réhabilitation.
On s’est inquiété de savoir à quelle école Vermeer avait acquis les notions premières de son art. Certains commentateurs ont insinué que peut-être il avait travaillé dans l’atelier de Rembrandt. La chose paraît assez peu vraisemblable car, outre que Vermeer était trop pauvre pour se rendre à Amsterdam où vivait Rembrandt, rien dans la manière aimable et mesurée de Vermeer ne rappelle la facture puissante et grandiose du grand maître hollandais. M. Henry Havard, dans la savante étude qu’il a consacrée à Vermeer, le démontre de façon lumineuse et péremptoire. Il n’est pas plus certain qu’il ait été l’élève de Fabritius, qui était à peu près de son âge, ce qui semble exclure l’idée que l’un d’eux ait été le maître de l’autre. Nous nous rangerions plus volontiers à l’opinion de M. Henri Havard qui incline à croire que Vermeer étudia avec Léonard Bramer, ami et allié de sa famille.
La Dentellière avait figuré dans une vente faite en 1816 à Amsterdam, où elle fut adjugée 28 florins. Depuis elle avait été vendue 84 francs à la vente de Muilman (1813), 501 francs à la vente Laperière (1817), 265 florins à la vente Nagel (1851). En dernier lieu, elle appartenait à M. Blokhuysen, de Rotterdam. Elle fut acquise en 1870 pour 1.200 francs par l’État. Elle figure aujourd’hui dans la salle Jan Steen.

LE portrait de Charles Ier d’Angleterre, que possède le Louvre, est un chef-d’œuvre légendaire.
Le poing sur la hanche, du côté de l’épée, la main droite appuyée sur une haute canne, le roi tourne légèrement sa tête fine et blonde, encadrée d’un grand chapeau. Il regarde avec calme, avec assurance, et toute son attitude est celle d’un homme habitué à commander. Sa veste de soie grise est traversée du baudrier qui soutient l’épée. Au-dessous de la culotte rouge et laissant voir les bas de soie, des bottes souples en cuir fauve, garnies d’éperons, emprisonnent une jambe nerveuse et élégante. Un peu en arrière, le cheval favori du roi piaffe, impatient, maintenu par un écuyer vêtu de rouge qui représente le chevalier d’Hamilton; un autre serviteur, plus loin, porte le manteau du souverain. Le tertre où sont placés les personnages est ombragé par la ramure épaisse d’un arbre et, sur les plans éloignés, s’étend une plaine au-dessus de laquelle des nuages gris floconnent dans le ciel bleu.
Ce tableau, d’une admirable composition, rend à merveille l’élégante silhouette de Charles Ier, le plus beau des Stuarts. L’œuvre se présente avec une noblesse contenue, une richesse sourde et éclatante tout à la fois, une somptuosité discrète qui impressionnent, où l’on retrouve quelque chose de la manière de Rubens, mais tempérée, assagie, comme disciplinée.
Van Dyck avait d’ailleurs longtemps travaillé avec Rubens, qui 116 l’appelait «le meilleur de ses élèves». Son amitié lui fut aussi profitable que ses leçons. C’est lui qui le recommanda à la cour des Stuarts. Charles Ier, influencé par les éloges de Rubens pour son élève et ravi du portrait de Nicolas Lanière, son maître de chapelle, peint par Van Dyck, invita celui-ci à se rendre auprès de lui.
Van Dyck arriva à Londres et se présenta au roi qu’il conquit dès la première entrevue. Il avait une beauté fine, assez semblable à celle de Charles Ier, des manières aisées, une certaine grâce cavalière et l’air vif et dégagé d’un homme du monde accompli. Sa conversation n’était pas moins agréable que sa personne; il avait la parole abondante et brillante, alimentée par un savoir profond et disciplinée par un tact infini. Le roi se plaisait beaucoup en sa compagnie; il se rendait fréquemment à son atelier et, dépouillant avec lui toute contrainte d’étiquette, ils s’entretenaient ensemble de mille sujets pendant que Van Dyck travaillait à son portrait. De cette époque datent les nombreuses effigies du roi et de la reine.
En récompense de son talent, Van Dyck reçut le titre de principal peintre ordinaire de Leurs Majestés, fut créé chevalier et eut son logement à Blackfriars.
Dans son portrait de Charles Ier, Van Dyck s’était révélé portraitiste de génie et il n’est pas étonnant que, voulant suivre l’exemple du souverain, toute la noblesse enviât l’honneur de poser devant le grand artiste flamand. Bientôt, il ne put suffire aux commandes, il dut prendre des collaborateurs chargés de peindre les accessoires, se réservant seulement les têtes et les mains. Le succès venu, il eut toute liberté d’augmenter ses prix et gagna des sommes considérables qu’il dépensait largement. Sa maison était montée sur un pied magnifique, il possédait un équipage nombreux et élégant et offrait si bonne chère que peu de princes étaient aussi visités et aussi bien servis que lui.
En 1639, il épousa Mary Ruthven, demoiselle d’honneur de la reine, petite-fille de lord Ruthven, dont il eut une fille. Sa femme ne 117 lui apportait pas de dot, mais elle était considérée comme une des plus merveilleuses beautés de son temps. Cette union fut de courte durée. Sa vie de travail et de plaisirs avait miné la santé de Van Dyck et malgré que Charles Ier eût promis trois cents livres au médecin s’il le sauvait, le grand peintre mourut à Blackfriars, le 9 décembre 1641, âgé seulement de quarante-deux ans.
«Non moins coloriste que Rubens, écrit Théophile Gautier, mais plus fin, plus élégant que son maître, Van Dyck semble créé pour peindre les rois, les princes, les duchesses, tout ce monde de la haute vie, fin de race, aristocratique d’allure, d’une magnificence héréditaire et marchant au-dessus de la multitude comme les dieux marchent sur les nuages. Il a peint d’une touche aisée et noble, avec une couleur brillante mais vigoureuse et une pénétration rapide du caractère, des têtes qu’on ne reverra plus, des masques dont le moule est brisé, des expressions d’existences à jamais évanouies.»
Le portrait de Charles Ier entra dans le domaine national d’assez curieuse façon. A la vente du comte de Thiers, qui en était possesseur, la comtesse Du Barry l’acheta pour une somme de 24.000 livres. Et comme on lui demandait pourquoi elle avait choisi ce tableau de préférence aux autres de la collection qui semblaient devoir mieux lui convenir, elle répondit que c’était un portrait de famille, car elle prétendait tenir de la maison des Stuarts. Plus tard, elle le céda au même prix à M. d’Angivillers, pour le compte du Roi.
Ce tableau occupe aujourd’hui au Louvre la salle Van Dyck qui précède la nouvelle salle des Rubens.

QUEL chef-d’œuvre que le portrait d’Élisabeth d’Autriche, reine de France, femme de Charles IX! On ne saurait pousser plus loin la finesse, l’exactitude et la perfection du dessin; sur ce délicat linéament s’étale une couleur d’une suavité pâle, plus vraie que les tapages de tons des peintres dits coloristes, et qu’on sent être l’expression même de la nature: quoique le modèle de ce délicieux portrait ne soit plus qu’une pincée de cendre, si même cette cendre existe, on en peut affirmer la ressemblance. Oui, c’est bien Élisabeth, femme de Charles IX. Elle vit tout entière dans son petit cadre: les mains posées l’une sur l’autre avec un mouvement plein de grâce, sont des merveilles, fluettes, transparentes, tendres comme des pétales de lis, des mains vraiment royales! Le costume, d’une élégance et d’une richesse compliquées, est constellé de perles, de joyaux, de boutons émaillés, de pierreries qui font presque disparaître le corsage de brocart d’or damassé d’argent, avec sa fraise godronnée; et la chemisette de gaze à bouillons semble porter défi aux Blaise Desgoffes de l’avenir.»
(Théophile Gautier.)
C’est en 1570 que la jeune archiduchesse, petite-fille de Charles-Quint, épousa Charles IX, à l’âge de seize ans. Son royal époux n’en avait que vingt. Ce ménage d’enfants, trop jeunes pour avoir une volonté, ne fut qu’un triste jouet politique entre les mains de la reine-mère, l’astucieuse Catherine de Médicis. Leur union fut d’ailleurs très courte. Charles IX mourait cinq ans après et quand Élisabeth, veuve à 122 vingt et un ans, l’âme encore épouvantée des massacres de la Saint-Barthélemy, eut regagné son pays natal, elle s’enferma dans un couvent de Clarisses pour y pleurer son court bonheur et y oublier les horreurs du passé. Elle y mourut de consomption, à l’âge de trente-huit ans.
A cette époque Clouet, que les écrits contemporains appellent Janet, jouissait d’une grande réputation: il avait succédé à son père, Jean Clouet, comme peintre de la Cour et, confirmé successivement dans sa charge par François Ier, Henri II et Charles IX, il bénéficiait d’une pension de 240 livres sur la cassette royale.
C’est peu de temps après l’arrivée en France de la jeune reine Élisabeth que François Clouet exécuta son magnifique portrait. On a cru longtemps que ce tableau fut peint directement d’après nature. La découverte, en 1825, du cahier des crayons de l’artiste—cahier qui est conservé au cabinet des estampes—démontre que Clouet, comme tous les artistes de l’époque, exécutait d’abord ses portraits au crayon, rapidement, afin de ne pas lasser la patience de ses modèles. L’œuvre était ensuite reportée à l’huile sur panneau, corrigée, amplifiée, finie. Il en fut de même pour le portrait d’Élisabeth d’Autriche, qui se trouve à l’état de préparation, dans le cahier de Clouet, avec tous ses détails. En marge figurent les indications qui doivent lui servir ultérieurement pour sa peinture, la couleur des plumes, des soies, des passements, les nuances diverses du costume, les erreurs de proportions dans le croquis qu’il se propose de rectifier sur le panneau définitif.
Ce crayon, comme tous ceux de Clouet, est admirable; dans le panneau reproduit ici, s’ajoutent encore ce coloris délicat et vigoureux à la fois et cette vérité dans l’expression qui ont permis d’attribuer à Holbein maintes œuvres de notre vieux maître français. Très longtemps, on a presque ignoré ce délicieux artiste et cette sorte d’indifférence rend encore aujourd’hui les critiques hésitants dans l’attribution à Clouet 123 de tableaux où tout accuse sa manière. Que lui a-t-il manqué pour tenir dans la postérité le rang qui lui est dû? Un biographe, un Vasari qui aurait transmis aux générations suivantes son nom et la nomenclature de ses œuvres.
Et cependant quel maître charmant que François Clouet! Un Holbein fin, gracieux, élégant, avec toutes les qualités françaises. Rien de plus délicat que sa manière de peindre, qui ferait paraître grossières les miniatures les plus achevées. Sa couleur est claire, ses ombres sont d’une légèreté extrême, comme s’il craignait d’y dérober quelque détail intéressant; mais dans cette pâleur, quand l’œil s’y est habitué, quelle recherche du modelé, quel rendu et quelle précision! Et quel soin, quel goût, quel fini, quelle fidélité dans les costumes, les ajustements, les armes et les joyaux des illustres personnages, princes ou princesses qu’il représente! Aucun sacrifice, aucune partie cachée, et pourtant, de ce monde de détails, rien ne se détache et ne trouble l’harmonie. C’est bien le peintre des Valois, ces rois artistes, parés et coquets comme des femmes. Mieux que cela, par la qualité prodigieuse de son talent, Clouet est le précurseur des portraitistes modernes et, s’il revenait de nos jours, il n’aurait rien à modifier dans sa technique pour se placer au niveau des plus grands peintres de portraits.
Le portrait d’Élisabeth d’Autriche appartient à l’ancienne collection royale; il n’a jamais cessé d’appartenir à la Couronne ou aux galeries nationales. Il figure aujourd’hui à la salle XI, l’une des deux salles consacrées aux Primitifs français.

SOUS un ciel noir, strié de lueurs sanglantes, le Phlégéton roule ses eaux chargées de flammes. Dans ce décor d’épouvante, Virgile conduit le Dante vers l’Enfer. Debout dans la barque qui les porte, les deux poètes ont des attitudes opposées; Virgile, enveloppé dans un grand manteau rouge, ne semble pas ému; de sa main droite, il maintient le poète florentin dont le geste et le visage trahissent la terreur. Autour de la barque, dirigée par un nautonnier athlétique, les damnés émergent du flot noir, convulsés, titaniques, la face ravagée, et essayent de s’agripper à l’esquif; l’un d’eux s’accroche à la poupe dans un mouvement furieux et la mord avec rage. Ce grouillement de torses, ces chairs livides se débattant dans la nuit spectrale donnent bien l’impression d’une scène d’enfer. Il y a tant de dramatique puissance dans cette œuvre, tant de violence farouche dans le rendu et en même temps tant d’habile souplesse dans la composition, que l’on éprouve à regarder La Barque du Dante la même frayeur dont frissonne l’auteur de La Divine Comédie.
Parlant de ce tableau à l’époque où il fut exposé, Thiers le vante en termes enthousiastes. «Aucune œuvre, écrit-il, ne révèle mieux l’avenir d’un grand peintre que ce tableau. L’auteur y jette ses figures, les groupe, les plie à volonté avec la hardiesse de Michel-Ange et la fécondité de Rubens.»
Écoutons Paul de Saint-Victor: «On comprend l’effet que dut produire, au milieu de la fade peinture de l’époque, cette toile ardente 128 et sombre, éclairée d’un jour infernal. La Barque du Dante, avec son Phlégias titanique et les damnés qui l’enlacent, parmi les flots d’écume noire, de leurs replis tortueux de chairs et de muscles, serait digne de voguer sur le fleuve qui roule au bas du Jugement dernier de Michel-Ange.»
Faire songer ainsi, d’un accord unanime, au prodigieux talent de Michel-Ange, n’est-ce pas porter en soi quelque chose de sa puissance et de son génie? Et cependant, à l’époque où paraît cette magnifique toile, Delacroix n’a que 24 ans; non seulement il est un inconnu, mais il n’a pas eu de maître, il n’a fait que passer dans l’atelier de Guérin dont la technique glaciale le révoltait. Un peintre, cependant, exerça une influence réelle sur Delacroix: c’est Géricault, son camarade d’atelier, qui venait de peindre le Radeau de la Méduse. Son exemple le décida à rompre ouvertement avec la tradition davidienne et le réalisme intense de cette œuvre le détourna à jamais de la manière académique de l’école précédente.
Sa Barque du Dante est le premier acte de cette lutte acharnée qu’il poursuivra toute sa vie. Du premier coup, il se pose en adversaire de l’école de David. Aujourd’hui, nous nous étonnons que cette œuvre de couleur si sobre, si sculpturalement plastique dans les modelés du corps humain, ait pu être considérée comme révolutionnaire et mériter tant de violentes injures; mais si l’on se reporte à l’époque, on comprend la hardiesse de la nouveauté de Delacroix. Il osa apporter de la passion et une expression dramatique intense dans un sujet tiré de la littérature; il osa choisir un poète du Moyen-Age au lieu de s’inspirer de l’antiquité classique.
Ce jeune artiste de vingt-quatre ans bouleverse toutes les notions du Beau, établies par David et si mal interprétées par ses élèves. Au surplus, Delacroix ne prétend pas contester le génie de David ni méconnaître l’influence heureuse de sa réaction contre la décadence de l’art au XVIIIe siècle, mais il affirme son droit de choisir à son gré 129 les sujets de ses toiles et il pose en principe que l’antiquité n’est pas seule inspiratrice de la Beauté et qu’on trouve celle-ci partout, dans la vie moderne, autour de soi et qu’il suffit pour y atteindre d’avoir une âme sincère et une vision nette.
Fait curieux, Delacroix ne fut pas un enfant prodige; il ne montra pas, dès ses jeunes années, ces dispositions artistiques que les biographes se plaisent à constater dans la vie des grands maîtres. Lorsqu’il quitta le lycée impérial, à l’âge de dix-sept ans, pour entrer dans l’atelier de Guérin, il songea sérieusement à embrasser la carrière militaire, comme ses frères. Ce fut donc en vivant dans un milieu artistique que se révéla son âme de peintre et qu’il prit décidément le goût d’une carrière qu’il devait illustrer d’un tel éclat.
Une passion immense, doublée d’une volonté formidable, tel était l’homme. Et quelle puissance d’imagination! «Ardente comme les chapelles ardentes, elle brille de toutes les flammes et de toutes les pourpres, tout ce qu’il y a de douleur dans la passion le passionne; tout ce qu’il y a de splendeur dans l’Église l’illumine. Il verse tour à tour sur ses toiles inspirées, le sang, la lumière et les ténèbres.» (Baudelaire.)
La Barque du Dante a beaucoup perdu de son éclat primitif; la couleur s’en est assombrie jusqu’à noyer les personnages dans une nuit presque absolue. Cette détérioration regrettable est imputable à l’emploi exagéré du bitume que Delacroix abandonna, fort heureusement, plus tard.
Quoi qu’on ait dit sur l’injustice dont fut victime Delacroix, il eut, dès ses débuts, les encouragements officiels; les peintres seuls lui furent hostiles. L’État acquit la Barque du Dante pour 1.200 francs et la plaça au Luxembourg. Elle est passée depuis au Louvre où elle figure, avec ses autres œuvres, dans la salle des Peintres français modernes.

LE roi Ferdinand est représenté debout, revêtu d’une armure et portant sur la tête une couronne d’or. Les bras nus sortent du brassard d’acier. De la main droite, il tient la main de justice et de la gauche légèrement inclinée vers le sol, le sceptre royal surmonté de la fleur de lis. Sur l’armure est jeté un manteau de pourpre négligemment drapé. Près du monarque, un jeune page, le col orné d’une fraise de dentelle, porte le casque du souverain.
L’auteur du portrait du roi Ferdinand s’appelait Dominico Théotocopuli. On le surnomma «le Greco» à cause de son origine. Il était né dans l’île de Crète, vers l’an 1548. Tout jeune il manifesta de merveilleuses dispositions pour la peinture et il n’eut d’autre pensée que de venir sur le continent pour y satisfaire son goût. Au XVIe siècle, Venise était reine des mers et faisait un actif commerce avec l’Orient; ses navires visitaient toutes les îles de la Méditerranée et y apportaient l’écho des merveilles de la Sérénissime. Par les voyageurs et les marchands on savait, dans les îles, qu’à Venise florissait une pléiade incomparable de peintres, les premiers du monde. L’esprit du jeune Théotocopuli était hanté de ces récits. Son âme ardente s’exaltait et quand il mit le pied sur la rive des Esclavons, il ne songea pas à aller plus loin, il se fixa à Venise.
Il entra à l’atelier du Titien, c’est du moins ce qu’atteste une lettre écrite de Rome par l’enlumineur Clovio, en 1570, pour demander au cardinal Farnèse d’accorder un logement dans son palais de Rome «à 134 un jeune Candiote, élève du Titien et qui est un bon peintre». Il ne faut rien moins que cette affirmation pour clore le débat; car, si l’on juge d’après ses œuvres de la première manière, on y retrouve plus certainement l’influence de Tintoret ou même de Jacopo da Ponte que celle du Titien.
En 1570, il alla à Rome pour s’y pénétrer de l’œuvre des grands maîtres. Après cinq ou six ans de séjour dans la ville pontificale, il passa en Espagne et se fixa à Tolède. La première de ses œuvres, exécutée dans cette ville, porte la date de 1577. Le Greco ne devait plus quitter l’Espagne qu’il avait définitivement adoptée comme patrie.
Dès son arrivée dans la péninsule, l’art du Greco subit une transformation dont on ne trouve peut-être aucun autre exemple dans l’histoire. Sa manière se modifie complètement. Toute influence italienne disparaît. Désormais son œuvre ne rappelle plus ni le Titien, ni le Tintoret; il est Espagnol ou pour mieux dire il est Greco, il est lui-même, c’est-à-dire un peintre qui ne s’apparente à aucun autre et qui puise sa personnalité dans son seul génie.
Ce qui le distingue c’est la qualité particulière de sa couleur un peu froide mais toujours harmonieuse et distinguée. Une autre caractéristique de son talent, c’est sa prédilection marquée pour l’ascétisme. Il donne volontiers à ses personnages des visages sévères, allongés, maigres, émaciés, des corps d’anachorètes dont l’ossature semble dépourvue de chair. A contempler certaines de ses toiles on éprouve une sensation de malaise que l’art supérieur de l’artiste ne parvient pas toujours à dissiper. Mais ses figures vivent d’une vie intense, prodigieuse. Jamais peintre n’a traduit avec une telle puissance la flamme intérieure qui vient de l’âme et les extases passionnées de la ferveur. Quelque laid que soit son modèle, il l’illumine d’une clarté surhumaine qui le poétise et l’embellit. A ce titre, il se classe comme un des meilleurs peintres religieux dont l’histoire de l’art fasse mention. C’est Tolède qui possède ses plus belles toiles.
135 Grâce à ce don merveilleux d’évocation, il fut également un portraitiste de premier ordre et l’on ne trouve guère que Velazquez à mettre au-dessus de lui. S’il lui est parfois inférieur au point de vue de l’exécution, il l’égale et parfois le dépasse par son intense pouvoir de pénétration, par l’incomparable faculté qu’il possède de fixer en traits de feu la vie intérieure de son modèle.
On l’a appelé «le peintre des âmes». Aucun titre ne pouvait mieux lui convenir, aucun maître n’était plus digne que lui de le porter.
M. Maurice Barrès, dans son beau livre sur le Greco, écrit: «Le voilà parti pour être un peintre de l’âme, et de l’âme la plus passionnée: l’espagnole du temps de Philippe II. Il laisse à d’autres de représenter les martyrs affreux, les gesticulations violentes, toutes ces inventions bizarres ou cruelles qui plaisaient à un peuple de mœurs dures, mais il gardera ce qui vit de fierté et de feu au fond de ces excès. Ils valent pour ramener toujours les esprits au point d’honneur et aux vénérations religieuses. Et, dans son œuvre, Greco manifestera ce qui est le propre de l’Espagne, la tendance à l’exaltation des sentiments.»
Greco ne fut pas seulement un grand peintre, il était encore architecte, sculpteur, écrivain. Sous ses trois aspects, on ne peut malheureusement le juger aujourd’hui, ses sculptures et ses écrits ayant disparu.
Le Roi Ferdinand, d’acquisition récente, figure dans la Grande Galerie, à la travée de la peinture espagnole.

ON connaît la légende évangélique: deux disciples du Christ, peu de temps après sa mort, cheminent de compagnie sur les routes brûlantes de la Galilée. Chemin faisant, ils évoquent la grande figure du Maître disparu et se remémorent la longue suite de ses miracles, l’horreur de son supplice, le prodige de sa résurrection. Harassés de fatigue, ils frappent à la porte d une hôtellerie et demandent à manger. A leur lassitude se mêle un peu de découragement. Que deviendront-ils, maintenant que le Maître est parti? Le reverront-ils encore? Ils ne croient pas que le miracle soit possible et, dans leur douleur, ils se lamentent. Et voilà, que soudain, à cette table où ils se trouvent, une lueur jaillit et le Christ apparaît, assis entre eux, avec son majestueux et doux visage, comme au temps où il vivait au milieu de ses disciples.
C’est cette scène, d’une touchante poésie, que Rembrandt a traitée dans le tableau reproduit ici. Le peintre a choisi le moment où le miracle vient de s’accomplir. Le Christ est apparu et autour de lui flotte encore cette clarté céleste qui a précédé sa venue.
Devant une table en X, couverte d’une nappe posée sur un tapis, le Christ est assis, ayant à côté de lui les deux Pèlerins d’Emmaüs. Un serviteur debout s’apprête à poser sur la table un plat chargé de mets. L’Homme-Dieu est vêtu d’une longue robe qui laisse apercevoir, sous la table, les jambes et les pieds. Sa tête, nimbée d’une auréole, est légèrement inclinée à droite; les longues boucles de sa chevelure blonde 140 retombent de chaque côté des épaules. Entre ses mains, il tient le pain qu’il rompt et bénit. L’attitude et les expressions de visage des pèlerins trahissent l’amour, la surprise heureuse, l’adoration des disciples reconnaissant en leur hôte leur Maître bien-aimé. D’une haute fenêtre qu’on ne voit pas tombe une lumière délicate qui jette une lueur dorée sur cet épisode évangélique; tout l’éclat en est concentré, avec un art supérieur, sur la table où vient de s’accomplir le miracle. Maître incomparable dans le maniement du clair-obscur, Rembrandt a animé ses ombres les plus profondes d’une chaude luminosité qui les rend transparentes.
Rembrandt n’est pas seulement un alchimiste de la couleur, un magicien de la lumière, un faiseur de tours de force pyrotechniques tirant, comme on dit, des coups de pistolets dans les caves; il possède au plus haut degré le sentiment humain, religieux et pathétique. Avec des formes parfois communes, triviales, manquant de noblesse comme dessin, car sa couleur est toujours d’une rare distinction, il parvient à exprimer les nuances les plus délicates de l’âme. Quelle onction, quelle majestueuse douceur, quelle tendresse dans ce visage du Christ, quelle profondeur de pensée dans son regard! Et comme l’admiration est traduite magnifiquement sur les traits un peu vulgaires de ses disciples!
Peu de sujets ont été aussi fréquemment interprétés que la scène légendaire des Pèlerins d’Emmaüs. Les plus grands maîtres l’ont abordée, notamment les Vénitiens, et parmi eux, Titien et Véronèse.
Avec cette liberté vénitienne qui se permettait tous les anachronismes, Titien ne craignit pas d’introduire dans son tableau des personnages considérables de son époque. Véronèse, lui, y fait figurer sa propre femme, des enfants qui jouent, des épagneuls qui gambadent.
Il ne saurait être question ici de comparer des œuvres si différentes. Celle de Titien a de la gravité, sa composition est admirable et son coloris tel qu’on peut l’attendre de ce prestigieux artiste; dans le 141 tableau de Véronèse, tout est charmant, gracieux, d’une harmonie et d’une fantaisie adorables.
Mais chez les peintres de Venise, le sentiment religieux n’est jamais très profond; on devine qu’une renaissance d’idées et d’impressions a soufflé sur ce coin de terre. Pour être réellement chrétienne, leur âme est trop éprise des splendeurs orientales amenées par les felouques musulmanes dans le grand port de l’Adriatique.
Dans les pays du Nord, au contraire, la foi reste très vive; le tempérament septentrional ressent plus profondément la poésie des symboles chrétiens; la grisaille du ciel, la tristesse des jours brumeux favorise les longs rêves et incite aux pensées pieuses. Aussi est-ce dans le Nord que les scènes religieuses ont trouvé leurs plus sincères, sinon leurs plus éloquents interprètes.
Et lorsque, par miracle, cette ferveur mystique guide une main puissante comme celle de Rembrandt, lorsqu’elle saisit une âme de cette trempe, un génie de cette envergure, l’œuvre qui naît de cet accord atteint aussitôt à la sublimité.
Les Pèlerins d’Emmaüs appartenaient, vers le milieu du XVIIIe siècle, au bourgmestre Six, d’Amsterdam. A la vente qui suivit sa mort, le tableau fut adjugé 170 florins. Il fut acheté ensuite, en 1770, par Louis XVI, à la vente du fermier général Randon de Boisset, pour une somme de 10.500 livres. Il figure aujourd’hui dans la grande galerie du Louvre, à la travée réservée aux œuvres de Rembrandt.

AU pied d’un arbre au feuillage d’un vert sombre, se détachant en vigueur sur l’azur du ciel, un berger et une bergère sont assis. Berger et bergère à figure fine, aux vêtements soignés, paysans de convention tels que les comprenait le XVIIIe siècle élégant et pomponné, bien faits pour plaire à la société d’alors, monde de cour qui ne connaissait de la campagne que les majestueux ombrages de Versailles. Le berger est assis sur un tertre de gazon; l’un de ses bras, passé autour du cou de la jeune fille, s’appuie sur son épaule; sa main droite joue avec un oiseau apprivoisé, dont on aperçoit la cage ouverte à droite du tableau. Sur ses jambes chaussées de bleu est jetée négligemment la veste rouge dont il s’est dévêtu. Elle, tout près de lui, un coude appuyé sur le genou de son compagnon, tresse une couronne de feuillage, mais toute son attention se porte vers les ébats de l’oiselet et peut-être plus encore vers le joli visage de l’ami tendrement penché sur elle. Quelle ravissante figure de femme, fine, délicate, rosée et combien joliment encadrée par le double réseau de ses tresses blondes! N’est-ce bien pas plutôt une élégante marquise de la Cour qui joue pour s’amuser un rôle de bergère? On le croirait vraiment à voir ses mains blanches finement attachées à des bras bien tournés et ses pieds menus, parfaits, d’une pureté de lignes qui trahit la race. Et quel costume pour une simple paysanne! Un corsage de couleur tendre largement échancré sur la poitrine et une jupe que l’on jurerait être en satin. Entre eux, une corbeille remplie de roses semble indiquer que 146 ce couple charmant a des loisirs et que la surveillance du troupeau ne l’absorbe guère. Leurs moutons sont particulièrement dociles; on les aperçoit, à gauche de la toile, très sagement couchés dans l’herbe, laissant aux jeunes amoureux toute licence de se conter fleurette.
Quelle charmante fraîcheur dans ce tableau où tout est combiné pour la joie du regard, et quelle prodigieuse habileté dans cet art de Boucher qui joue avec les couleurs comme un vrai magicien! Rien de heurté, rien de choquant: le vert, le bleu, le rouge se marient dans une harmonie parfaite. Et quelle science de la composition! Tout l’intérêt de la scène se concentre bien sur les deux jeunes gens, mais laisse à l’esprit assez de liberté pour lui permettre de goûter la beauté du paysage et la fantaisie du détail.
Boucher aimait peindre les pastorales. On trouve dans son œuvre quantité de sujets empruntés à la vie champêtre, ou du moins à cette vie conventionnelle des champs où les bergères ont des houlettes garnies de rubans et des robes à paniers. Convention qui ne trompe personne, mais que chacun accepte volontiers parce que la vie d’alors ne se conçoit pas sans élégance et que l’on trouve haïssable tout ce qui n’est pas joli et parfumé. Et ces bergeries, ces contrefaçons de pastorales, l’engouement de la Cour et de la ville les consacre, la mode s’en mêle, et bientôt nous verrons s’élever, sur les pelouses de Trianon, des fermes en miniature où des duchesses et des reines viendront par jeu jouer à la paysanne et baratter le beurre.
En réalité, Boucher n’a été que le traducteur de l’état d’âme d’une époque et, pour le juger équitablement, il faut se reporter à cette époque, en connaître les aspirations, les goûts, la voir avec les yeux de ceux qui la vécurent. Alors, toute prévention disparaît et l’on est en état d’admirer sans réticence ses fantaisistes paysanneries; alors apparaît dans toute son ampleur le prestigieux talent de l’artiste.
«Les Pastorales de Boucher, écrit Théophile Gautier, vous font entrer dans ce monde idyllique inventé par lui à l’usage du XVIIIe 147 siècle, le moins champêtre des siècles, en dépit de ses prétentions bocagères. Les moutons sont savonnés, les bergères ont des corsets à échelles de rubans et des teints qui ne se sentent pas du hâle campagnard, et les bergers ressemblent à des danseurs d’Opéra. Mais tout cela est d’une séduction irrésistible et d’un mensonge plus aimable que la vérité.»
Boucher avait un véritable tempérament de peintre, d’une invention inépuisable, d’une facilité prodigieuse et d’une exécution qui est toujours celle d’un artiste, même dans les œuvres les plus lâchées. Sans doute il abusa de ces dons précieux, mais la prodigalité n’est permise qu’aux riches, et pour jeter de l’or par les fenêtres il faut en avoir. Boucher a suffi, sans descendre jamais au-dessous de lui-même, au plus effroyable gaspillage de talent pendant une longue carrière d’artiste. Faire le catalogue de son œuvre est presque impossible. Boucher a peint des plafonds, des dessus de porte, des trumeaux, des portraits, des mythologies, des bergerades, des paysages, des décorations d’Opéra, des modèles de tapisseries; il a orné des clavecins, des paravents, des cabinets, des chaises à porteurs, des voitures de gala. Son pinceau facile était prêt à tout et, quoi qu’il fît, il y mettait une grâce, un charme, une fleur de coloris que personne ne possédait à ce degré.
La Pastorale fut exécutée en 1763. Après avoir passé en différentes mains, elle fut acquise sous Louis XVI pour le compte de la Couronne. Elle entra par la suite au Louvre, qu’elle n’a plus quitté et elle y figure dans la magnifique salle du XVIIIe siècle où se trouve la plus grande partie des œuvres de Boucher.

LA scène se passe dans une maison de Bruges, sur la place du Saint-Sang dont on aperçoit, par les fenêtres ouvertes, les constructions gothiques. La table du festin, qui occupe la salle presque entière, est couverte de plats, de coupes et de fruits. Il ne semble pas, cependant, que les convives se préoccupent beaucoup de leur nourriture; leur attitude grave, recueillie, leur donne plutôt l’air de fidèles priant dans un temple. L’artiste a sans doute voulu peindre ses personnages à la minute solennelle où va s’opérer le miracle. Tous, en effet, paraissent tourner leur attention vers le premier plan, où les serviteurs constatent que les brocs et les jarres ne contiennent plus de vin. A la porte de la salle, un jeune page se presse, portant un gâteau sur un plat, mais nul n’y prend garde, dans l’anxieuse attente de l’événement.
Au centre de la table se trouve la mariée, blonde Flamande aux traits réguliers, couverte de joyaux, qui baisse modestement les yeux et croise ses mains sur sa robe pourpre d’épousée. A côté d’elle et autour de la table, les convives, presque tous des femmes, sont rangés et leur attitude est aussi composée que la sienne. A deux rangs à droite de la mariée, la Vierge, les mains jointes, la tête illuminée d’une auréole, se penche vers son Fils et semble le prier d’accomplir le miracle. Le Christ l’écoute, les yeux baissés. Son visage est celui que la peinture flamande a adopté, à la suite de Jean van Eyck: une figure longue, émaciée, terminée par une courte barbe à deux pointes et 152 encadrée d’une large chevelure blonde divisée sur le front en deux bandeaux.
Le Christ a levé la main dans la direction des jarres vides. C’est la minute décisive: le légendaire prodige va se réaliser.
En dehors des convives, le miracle aura d’autres témoins: à gauche, au premier plan, agenouillé sur les dalles, le donateur du tableau; il porte l’habit rouge et le manteau noir doublé de fourrures des prévôts de la confrérie du Saint-Sang; derrière lui, on aperçoit son jeune fils, agenouillé également et les mains jointes. De l’autre côté de la toile et dans la même attitude se trouve la donatrice. Par une fenêtre de la salle, un moine suit d’un œil intéressé les péripéties de la scène.
Il y a loin de ce repas de noces à celui de Paul Véronèse, si débordant de lumière, de vie, de mouvement et si somptueux de décoration. Les pays sont différents, les époques aussi. La Renaissance est encore loin, nous sommes devant l’œuvre d’un Primitif et d’un Flamand. C’est la période gothique de la peinture, celle où la composition est encore malhabile, le dessin hiératique, les anatomies imprécises. On y peut relever quelques fautes, comme les bras de la jeune fille placée à la droite du Christ, bras évidemment trop courts pour la longueur du corps. Mais, en balance de ces erreurs minimes, quel art déjà dans le groupement des personnages qui permet à l’artiste de situer, sur une toile de dimensions restreintes, dix-neuf figures et un paysage! Chacun des personnages est très exactement à sa place et, si, au premier abord, la toile semble manquer de perspective, il n’en faut accuser que la tache vive de la nappe, qui tend à confondre les plans.
Ce qu’il convient d’admirer surtout dans ce tableau, c’est la vérité des attitudes et l’expression supérieurement rendue des physionomies. Chez les peintres flamands de l’époque primitive, le plus implacable réalisme s’allie à la recherche de l’expression dramatique. Même dans les sujets religieux, ils voient avec leurs yeux bien plus qu’avec leur 153 âme. Ils copient la nature, mais sans l’idéaliser: leur seul objectif est de faire vrai et ne va pas au delà.
Dans le tableau de Gérard David, cependant, on devine un effort marqué vers l’idéalisation. Ses figures de femmes ne sont ni belles ni exemptes de vulgarité, mais l’artiste a su imprimer à leurs traits une onction, une sereine poésie qui fait oublier leur laideur.
Et que dire de la couleur? Gérard David possédait à un degré rare le don d’allier les couleurs les plus vives, les tonalités les plus violentes sans les faire se heurter. Les rouges ardents et les verts aveuglants se marient avec des jaunes qui flamboient. En des mains inhabiles, ces rutilances entraîneraient la cacophonie: sous sa palette prestigieuse, tout se fond, tout s’harmonise en des ensembles équilibrés et chatoyants.
Gérard David, contemporain de Van der Weyden, jouit, de son vivant, d’une grande réputation, mais sa mémoire souffrit, comme celle de tous les Flamands, du discrédit où tomba, dans les générations suivantes, ce qu’on appelait dédaigneusement l’art gothique. Et lorsque arriva l’heure de la réhabilitation, beaucoup d’œuvres du grand artiste, qui n’étaient pas signées, furent attribuées tour à tour à Jean Van Eyck, à Rogier Van der Weyden, à Thierry Bouts et plus fréquemment à Memling. C’est évidemment à ce dernier que s’apparente le plus l’art de Gérard David, par sa grâce, sa poésie et sa tendance vers l’idéal.
Les Noces de Cana furent longtemps attribuées à l’illustre peintre de la Châsse de sainte Ursule, et c’est sous le nom de Memling que nous voyons ce tableau désigné dans les inventaires de l’Empire.
Ce tableau avait été acheté par Louis XIV, pour 15.000 livres, au banquier Jabach. Depuis cette époque, il n’a pas quitté les galeries nationales. Il figure aujourd’hui au Louvre, dans la Salle Van Eyck.

DEVANT une draperie relevée et fixée à une colonne, Mlle de Lambesc est assise sur un fauteuil rocaille. Son corps est de trois quarts, légèrement tourné vers la droite et son beau visage, au regard impérieux, est vu de face. Elle porte un costume mythologique, suivant la mode usitée dans les portraits de cette époque: un grand manteau bleu couvre le bas du corps, et son corsage blanc décolleté est maintenu autour de la taille par un corselet à mailles d’or; sur son épaule gauche est jetée une peau de tigre. Les bras et le cou sont d’un admirable modelé; sortant des plis de la robe, un petit pied nu apparaît tout rose sous les cordons de l’étroite sandale. De la main droite, elle maintient un casque sur ses genoux, pendant que de la gauche elle achève de boucler la cuirasse de son jeune frère, le comte de Brionne. Celui-ci, très bel enfant à figure poupine, se tient de face, la tête légèrement inclinée: sous la cuirasse il porte un justaucorps jaune, sur lequel passe une écharpe blanche qui supporte l’épée. La main gauche avancée tient la hampe d’un étendard rouge. A gauche sont disposés des attributs militaires, symboles de la noble carrière des armes et de la gloire promise au jeune héros. Sur la peau d’un tambour, posé à droite, on lit l’inscription: Nattier pinxit, 1732.
Mlle de Lambesc appartenait à la maison de Lorraine qui avait en quelque sorte accaparé Nattier au moment où s’affirma sa vogue. Celui-ci peignit plusieurs fois les divers membres de cette puissante 158 famille. Sa réputation de portraitiste attira sur lui l’attention royale. Louis XV, ravi de cet art chatoyant et gracieux, lui fit peindre successivement la reine, ses maîtresses, ses filles et lui-même. Dans toutes ces œuvres, Nattier apporta le même souci d’embellir ses modèles et de les parer de tous les attributs capables de les flatter. Il excellait d’ailleurs à peindre les femmes; la finesse de son dessin, la délicatesse de son coloris se prêtaient admirablement à traduire la grâce des belles épaules nues et la somptuosité des ajustements de cour.
Mlle de Lambesc et le comte de Brionne date de la belle époque du peintre qui était dans la pleine maturité de son talent. Cette œuvre n’est pas seulement un superbe portrait, d’un gracieux agencement et d’un harmonieux coloris, elle nous révèle en même temps les goûts du monde aristocratique que Nattier s’appliqua toujours à flatter.
«Il s’attacha, écrit M. Pierre de Nolhac dans sa belle étude sur Nattier, à ce que l’on appelait «le portrait historique», arrangement parfois puéril, souvent ingénieux par quoi on transforme un modèle grâce au costume et aux accessoires, en héros de la Fable, en divinité ou en figure allégorique. Depuis longtemps, l’art français avait admis cette idéalisation du portrait. Elle était étrangère, sans doute, au crayon comme au pinceau des Clouet, de Corneille de Lyon, de Dumonstier, fidèles observateurs de la nature, qui rend les parements d’un habit avec le même scrupule que les traits du visage; mais la manie d’apothéose dont le Grand Roi fut atteint dès sa jeunesse, s’étendit à tout son entourage. Le fameux tableau de Nocret où toute la famille royale jouait ses rôles dans un Olympe dont Louis XIV était le Jupiter, avait été imité, réduit, transposé à l’usage des plus modestes modèles. Les femmes surtout, avec leur goût coutumier de l’artificiel, sollicitaient des peintres cette flatterie que leur prodiguaient les poètes. Alors que les dévotes adoptaient pour leur image le costume d’une sainte de leur choix, la plupart des femmes de qualité se faisaient peindre en Diane, en Minerve, en Cérès, n’osant toujours arborer 159 orgueilleusement la ceinture étincelante de Vénus. Saint-Simon dit parfois, du ton le plus naturel du monde, que telle duchesse occupait «un rang dans les nues»; il s’agit des nues glorieuses de l’Olympe de Versailles que le peintre avait mission de figurer réellement par son pinceau.»
Scrupuleux observateur de la mode, Nattier plaça tous ses modèles «dans les nues», et les peignit avec les attributs des divinités olympiennes. Mlle de Lambesc est représentée en Minerve, Louise-Henriette de Bourbon en Hébé, Mme de Châteauroux en Point du Jour, Mme de Flavacourt en Silence. L’allégorie alterne avec la mythologie. Chargé de peindre les quatre filles de Louis XV, il choisit pour les personnifier les quatre éléments: la Terre, c’est Mme Infante; le Feu, Mme Henriette; l’Air, Mme Adélaïde; l’Eau, Mme Victoire.
Par un de ces revirements étranges que les fluctuations de la mode peuvent seules expliquer, Nattier, après avoir joui d’une grande vogue, tomba soudain dans le discrédit le plus complet et connut la misère. Cette défaveur le suivit jusque dans la mort et c’est à notre siècle que revient l’honneur d’avoir rendu justice à celui que Gresset appelait «le peintre des Grâces et de la Beauté».
Bien que peint en 1732, le portrait de Mlle de Lambesc figura au premier Salon du Louvre qui s’ouvrit aux artistes, en septembre 1737. Il portait comme titre: Mlle de Lambesc, de la maison de Lorraine, sous la figure de Minerve, armant et destinant M. le comte de Brionne, son frère, au métier de la guerre.
Ce tableau, par une heureuse fortune que ne connurent pas tant d’autres œuvres de Nattier aujourd’hui disparues, trouva en M. La Caze un amateur éclairé qui le sauva des aventures en l’achetant. Il est entré au Louvre avec les autres toiles de cette incomparable collection.

JEANNE D’ARAGON était fille de Ferdinand d’Aragon, duc de Montalte et petite-fille de Ferdinand Ier, roi de Naples. Sa beauté était célèbre dans toute l’Italie, son esprit ne l’était pas moins; les poètes chantèrent l’un et l’autre en strophes enflammées. On disait couramment, en parlant d’elle, la diva signora, et de fait, elle réalisait le type le plus parfait de l’élégance et de la grâce féminines au XVIe siècle. Toute jeune, elle épousa le prince Ascanio Colonna, qui fut grand connétable de Naples. Ce grand seigneur était bien différent de sa jeune femme: autant Jeanne d’Aragon était fine et cultivée, autant son époux avait de rudesse et d’ignorance. Soldat avant tout, ses agréments extérieurs déguisaient mal son âme de condottière; il était emporté, brutal, et, comme chez tous les hommes de son temps, il y avait en lui quelque chose du reître batailleur. L’histoire l’accuse de s’être montré d’une excessive dureté pour sa femme et ses enfants, qu’il tyrannisait et traitait de façon odieuse. Aussi rusé que violent, il passa sa vie à intriguer, à conspirer, à trahir ses maîtres. Il finit par subir la peine de ses fautes et il mourut en 1577, après de longues années d’une captivité très dure. L’un de ses fils, Marc Antonio, soldat comme son père, se couvrit de gloire à la bataille de Lépante.
Dans le portrait que nous donnons ici, Jeanne d’Aragon est représentée à la période heureuse de son existence. Elle est dans tout l’éclat de sa royale beauté et de sa triomphante jeunesse. Le malheur n’a pas 164 encore éteint le sourire qui flotte sur ses lèvres, sourire de jeune femme qui aime et est aimée.
La splendeur du modèle était digne du génie du peintre. En aucun de ses portraits, Raphaël n’a égalé la puissance de séduction ni la maîtrise prodigieuse que l’on constate en celui-ci. Autour de ce charmant visage, il a accumulé les accessoires luxueux, les pierreries, les brocarts et les velours, de même que dans les temples on entoure les idoles d’ornements précieux. Et telle est la prestigieuse habileté de l’artiste qu’il a su laisser dans une demi-pénombre tous ces détails, et les fondre, pour ainsi dire, dans une sorte de nuage pourpre sur lequel se détache, en relief, la délicate et ravissante image.
Quand on aborde un génie comme Raphaël, quelle que soit l’œuvre, les mots sont impuissants pour traduire l’impression éprouvée. Quelque genre qu’il ait traité, fresques, peintures mythologiques, madones ou portraits, on le retrouve toujours égal à lui-même, c’est-à-dire supérieur à tous les autres. Il reste incontestablement le prince de la peinture de tous les temps.
Le portrait de Jeanne d’Aragon a inspiré des pages enthousiastes aux critiques de tous les pays. Nous ne citerons ici que Théophile Gautier:
«Le portrait de Jeanne d’Aragon, écrit-il, est une de ces œuvres qui, outre leur mérite d’art, ont un attrait de fascination. Il est impossible, à qui l’a vu une fois, de l’oublier. Jeanne d’Aragon reste dans le souvenir comme un de ces types de la perfection féminine qu’on rêve et qu’on désespère de rencontrer en cette vie. La princesse est représentée de trois quarts, coiffée d’un chaperon de velours incarnadin constellé de pierreries, vêtue d’une robe de même étoffe et de même couleur, une main posée sur le genou et l’autre repoussant un pli de fourrure qui lui couvre l’épaule. Le fond est une salle de riche architecture ouvrant sur les jardins. La tête, encadrée de longs cheveux blonds ondés et bouffants, se distingue par la finesse aristocratique et 165 l’élégance patricienne du type. C’est une beauté princière dans toute la force du mot et l’imagination placerait à côté d’elle un blason royal, quand même on ne saurait pas qu’on a devant les yeux Jeanne d’Aragon, fille de Ferdinand d’Aragon et mariée au prince Ascanio Colonna, connétable de Naples. Heureux Ascanio, d’avoir possédé l’original d’une telle copie! Les mains, d’une pureté de race extrême, sont les plus belles qu’on puisse voir et la chaude richesse du velours fait encore valoir leur blancheur.»
On raconte que Raphaël n’aurait pas peint son modèle d’après nature et qu’il aurait envoyé un de ses élèves à Naples pour y préparer le portrait; il n’en aurait d’ailleurs exécuté de sa propre main que la tête. Le reste aurait été achevé par Jules Romain, d’après le carton du maître. Mais le temps a passé son pouce harmonieux sur l’ensemble et il est bien difficile aujourd’hui de distinguer l’œuvre du maître de celle du disciple. Jules Romain est lui-même un peintre de premier ordre et lorsque, par dévouement d’élève, il s’absorbe dans la personnalité de Raphaël, croyez qu’il n’y gâte rien. Au surplus, il n’est pas téméraire d’affirmer que Raphaël dut surveiller lui-même tout le détail de l’exécution.
Ce magnifique portrait, peint vers 1518, fut offert à François Ier par le cardinal Bibienna, qui le fit porter à Fontainebleau. Il fut placé dans la galerie d’Apollon, sous Henri III. Il figure aujourd’hui dans la grande galerie du Louvre, réservée aux œuvres de Raphaël.

LA scène se passe en pleine campagne flamande, devant une de ces auberges voisines du village dont on aperçoit le clocher, là-bas, à travers les arbres. Haltes pour les rouliers qui sillonnaient les routes au temps jadis, ces auberges servaient également de but de promenade, le dimanche, aux paysans qui venaient s’y gorger de victuailles et de bière; on y célébrait aussi les noces villageoises, autour de tables disposées en plein air où pouvait s’épanouir à l’aise la grosse joie des goinfreries.
C’est bien une noce de village qu’a voulu représenter Rubens; c’est le titre primitif de son tableau, que l’on a, par la suite, appelé la Kermesse. Ce genre de peinture a toujours sollicité les artistes flamands, par son pittoresque, sa jovialité. Beaucoup d’entre eux, comme Teniers, van Steen, van Ostade s’y sont spécialisés et y ont gagné une gloire durable. Rubens n’a abordé ce sujet que par hasard, mais, sous sa main puissante, l’épisode vulgaire prend des allures d’épopée, la gaîté devient du délire, le mouvement de la frénésie; on est séduit, saisi, entraîné dans la ronde folle des maritornes et des buveurs.
Au centre, un paysan à la face allumée embrasse une femme renversée sur l’herbe; à côté, un couple semble se disputer un pot de bière. Sur des bottes de paille, des mères donnent le sein à leurs nourrissons, et une vieille femme donne à boire à un jeune enfant. A gauche, devant l’auberge, des convives avinés sont assis autour des tables; l’un d’eux, terrassé par l’ivresse et le sommeil, est affalé devant 170 son verre, tandis que les autres gesticulent et crient. Deux paysans cherchent à s’arracher un broc de bière; un autre, émoustillé par la boisson, lutine deux plantureuses commères. A droite se trouve une mare sur laquelle nagent deux canards, un tonneau vide y flotte aussi; sur le bord, un baquet qu’un chien explore activement, dans l’espoir d’y trouver des reliefs. Au fond, entraînée par deux musiciens montés sur une table, se déroule une ronde échevelée, délirante, cohue d’un mouvement prodigieux où l’œil effaré n’aperçoit que torses tendus, croupes bondissantes, jambes levées, jupes envolées.
Rubens seul était capable de faire une œuvre de génie avec des éléments aussi vulgaires. Dans cette composition où s’agite une multitude de personnages, chacun d’eux est une petite merveille d’observation et de naturel. Toute la Flandre campagnarde, exubérante et jouisseuse, y est peinte magistralement, avec un art qui ne le cède en rien à celui de la Descente de Croix ou de la Vie de Marie de Médicis. Et dans cette toile, quelle splendeur de coloris! Rubens y a dépensé toute la fougue de sa flamboyante palette: c’est le plus prodigieux assemblage de trognes vermillonnées, de chairs colorées, de costumes disparates fondant leurs teintes violentes dans la frénésie de la ronde et aussi dans l’harmonieuse chaleur du paysage.
Ce chef-d’œuvre a inspiré à Théophile Gautier, qu’il faut toujours citer en matière d’art, l’éloquente page suivante:
«La Kermesse, c’est le génie même de Rubens, débarrassé de toute contrainte allégorique ou mythologique et s’ébattant en pleine liberté dans la joie et l’ivresse flamandes. Mais n’ayez pas peur qu’accoudé près du pot où mousse la bière, il devienne un paisible et flegmatique Teniers. Quand Rubens s’amuse, il a de formidables gaîtés de Titan, et sa puissance est la même pour une précipitation d’anges ou de damnés que pour une ronde de buveurs. Devant la porte du cabaret, il a pris la foule chancelante et il l’a nouée en une immense guirlande qui tourne, comme un zodiaque ivre, dans une ronde folle, les bras 171 enlacés, les mains se retenant aux mains, avec une incroyable variété d’attitudes et de torsions, les pieds lourds battant le rythme et soulevant une chaude brume de poussière. Quelle vie, quelle turbulence, quelle explosion de joyeuse bestialité! Comme la santé crève sur les joues rouges de ces commères rebondies! Avec quelle ardeur ces robustes garçons fourragent les opulents appas de ces grosses femelles! Il faut que tout entre dans la danse, même les vieilles, et la ronde tourne à perdre haleine à travers les cris, les huées, les chants. C’est ignoble et c’est superbe, car c’est la bacchanale du génie.»
La Kermesse appartenait, vers le milieu du XVIIe siècle, au marquis d’Hauterive. Louis XIV l’avait vue et l’admirait beaucoup. Malgré ses préférences pour la peinture noble, qui lui faisaient traiter dédaigneusement de «magots» les personnages de Teniers, le grand Roi discernait fort bien l’incomparable valeur de cette toile. Aussi, lorsqu’eut lieu, en 1665, la vente du marquis d’Hauterive, s’empressa-t-il de l’acquérir pour 3.850 livres. Depuis cette époque, la Kermesse n’a plus quitté le patrimoine national: elle figure aujourd’hui dans la grande galerie du Louvre, à la travée des peintres flamands.

MONSIEUR et Madame Angerstein se tiennent sur une terrasse d’où l’on aperçoit les arbres du jardin avec, au fond, une échappée sur la campagne. Mme Angerstein est assise dans une chaise de rotin: son fin visage, dont la beauté fut célèbre en Angleterre, est coiffé d’un turban d’étoffe légère, d’où s’échappent les boucles d’une chevelure cendrée. Sa robe est faite de linon blanc, presque vaporeux, croisé sur la poitrine en forme de châle, suivant la mode du temps. Une ceinture rouge serre sa taille; sur ses genoux est négligemment jetée une écharpe de gaze noire dont l’extrémité pend jusqu’au sol. A côté d’elle, et un peu en arrière, M. Angerstein se tient debout, la main gauche appuyée au dossier du fauteuil. Sur la blancheur de sa haute cravate et de son gilet de casimir, son habit rouge, boutonné à l’anglaise, fait une tache vive; il porte une culotte de velours, des bas blancs et des souliers à boucles. La jambe droite est légèrement portée en avant.
Lawrence avait peint plusieurs fois les divers membres de la famille Angerstein, d’abord un délicieux profil de Mme Angerstein avec ses blonds cheveux ébouriffés sur sa tête fine, puis M. Angerstein seul, solide et encore élégant malgré l’envahissement de l’embonpoint, et enfin le magnifique portrait que nous venons de décrire.
Parcourir l’œuvre de Lawrence, c’est faire défiler devant soi tous les personnages illustres ou considérables de l’Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe. Son extraordinaire habileté 176 lui valut de bonne heure les faveurs du roi et de la cour. A l’âge où d’autres étudient encore, il est déjà célèbre; à vingt-deux ans, il est reçu membre associé de l’Académie de peinture et titularisé deux ans plus tard. En 1792, la mort de Reynolds le laisse seul représentant de l’art du portrait en Angleterre; il recueille sa succession officielle et devient portraitiste ordinaire du roi. Tout ce que Londres compte d’éminent tient à se faire peindre par lui; les plus grandes dames du Royaume-Uni défilent dans son atelier. Le fils du pauvre cabaretier de Bristol est comblé d’honneurs, ses toiles se vendent à prix d’or; une ordonnance royale l’anoblit et le crée baronnet.
Sa renommée a franchi le détroit; il jouit d’une réputation européenne. En 1815, quand le désastre de Waterloo a rendu la confiance à l’Europe terrifiée, le Régent envoie Lawrence sur le continent pour portraiturer tous les personnages, diplomates ou généraux, qui ont le plus contribué à la chute de Napoléon. Lawrence se rend à Aix-la-Chapelle, où siège le Congrès européen. De là, il va à Rome pour y peindre Pie VII, l’illustre pontife qui fut le prisonnier du conquérant. Il reste plusieurs années en Italie et, le jour même où il rentre à Londres, en 1820, il est nommé président de l’Académie royale de peinture.
Avec le recul du temps, l’étonnante fortune de Lawrence nous paraît avoir dépassé la réelle valeur du peintre. On ne peut s’empêcher de le comparer à Reynolds, et ce parallèle, il faut bien l’avouer, n’est pas à l’avantage de Lawrence. Il n’a pas la facture puissante de Reynolds ni son ferme dessin. Peut-être à cause de sa facilité, qui était prodigieuse, sa composition manquait de vigueur, sa couleur de solidité. Influencé sans doute par la manière de Boucher, exagérée encore par ses disciples et ses imitateurs, il tombe fréquemment dans l’afféterie et la fadeur.
Il n’en reste pas moins un peintre d’une grande valeur dont le plus grand défaut fut d’être trop bien doué et de ne s’être pas assez défié 177 de sa facilité. Aucun de ses portraits n’est médiocre; ce prodigieux gaspilleur de talent eut parfois des éclairs de génie: plusieurs de ses tableaux sont des chefs-d’œuvre.
Quoique surfait, Lawrence n’a pas connu le discrédit de certains peintres, beaucoup trop admirés de leur vivant et remis par la postérité dans une place plus conforme à leur talent réel. C’est qu’il possède des qualités de premier ordre et qui sont de tous les temps. Il demeure comme le peintre modèle des élégances patriciennes. Il charmera et séduira toujours par sa finesse, par son raffinement de distinction, par la légèreté de la touche, la subtilité du ton, la grâce expressive et spirituelle des physionomies et des attitudes. Comme Nattier et Tocqué en France, il nous fait aimer cette époque charmante de la fin du XVIIIe siècle dont il semble avoir complaisamment souligné la délicate élégance et la précieuse beauté. Il ne faut donc pas hésiter à le classer, malgré ses quelques défauts, parmi les maîtres de l’école anglaise.
Le portrait de M. et Mme Angerstein compte parmi les meilleurs du grand artiste et le Louvre s’honore de le posséder. Il figure dans la grande galerie, à la travée de peinture anglaise.

SOUS le soleil qui darde ses rayons, la plaine s’étend à l’infini, plate, uniforme, sans un vallonnement. Là-bas, tout près des meules qui se dressent, toute une équipe de travailleurs s’active à lier les gerbes, sous la surveillance d’un fermier à cheval. Mais on les devine plutôt qu’on ne les voit. Le drame n’est pas là, mais au premier plan, et ses protagonistes sont trois femmes qui, d’un geste anxieux et pressé, se courbent vers la terre pour ramasser les épis oubliés. Cette récolte demeurera leur salaire, et, sous la chaleur torride, la tête abritée sous une sorte de bonnet, elles se hâtent et continueront ainsi jusqu’à la fin du jour. Elles mettent leur maigre cueillette dans leur tablier noué en poche devant elles. L’une des femmes, debout, scrute le sol, pour y découvrir un épi à glaner; les deux autres, pliées à terre, ramassent les tiges qu’elles viennent d’apercevoir. C’est de la tristesse dans de la lumière et ces misérables silhouettes ont une émouvante grandeur. Cet épisode, banal en soi, de la vie des champs s’ennoblit d’une sorte de psychologie sociale où nous découvrons tout un côté de la misère humaine, celle du paysan, la plus dure peut-être parce qu’elle ne s’éclaire d’aucune joie et qu’elle se traîne dans l’éternelle et âpre lutte contre la terre.
Les Glaneuses figurèrent au Salon de 1857. Elles y firent sensation. Exalté par les uns, ce tableau fut décrié par le plus grand nombre. On voulut y voir un plaidoyer contre la misère du peuple. 182 «Ce sont, écrivait Paul de Saint-Victor, les Parques du paupérisme.» Tant de sévérité nous confond aujourd’hui; c’est en vain que nous cherchons dans l’œuvre de Millet cet appel à la haine que certains y ont voulu voir, et nous n’apercevons, dans la sérénité de cette toile, que la résignation muette qui est la vertu du paysan.
Nous possédons d’ailleurs une lettre de Millet à son ami Sensier, qui explique éloquemment la mélancolie générale de son œuvre: «Je vous avouerai, lui écrit-il, que c’est le côté humain qui me touche le plus en art, et si je pouvais faire ce que je voudrais ou tout au moins le tenter, je ne ferais rien qui ne fût le résultat d’une impression reçue par l’aspect de la nature, soit en paysages, soit en figures. Ce n’est jamais le côté joyeux qui m’apparaît, je ne sais pas où il est, je ne l’ai jamais vu. Ce que je connais de plus gai, c’est le calme, le silence dont on jouit si délicieusement dans les forêts ou dans les champs; vous m’avouerez que c’est toujours très rêveur, et d’une rêverie triste, quoique bien délicieuse. Dans les endroits labourés, et parfois dans des pays peu labourables, vous voyez des figures bêchant, piochant. Vous en voyez une de temps en temps, se redressant les reins et s’essuyant le front avec l’envers de sa main. «Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.» Est-ce là ce travail gai, folâtre, auquel certaines gens voudraient nous faire croire? C’est cependant là que se trouve pour moi la vraie humanité, la grande poésie.»
Millet aimait le paysan, il en connaissait les gestes, les attitudes, il comprenait l’obscure mélancolie de son âme sans cesse rivée aux mêmes spectacles et aux mêmes pensées. Il l’aimait d’autant mieux qu’il était de sa race, fils de paysans lui-même, ayant bêché et labouré une terre ingrate, là-bas, sur la lande de Gréville, près de la mer. Et il s’est fait l’éloquent interprète des forçats de la terre, il les a peints à toutes les heures de leur morne existence, mais sans aucune arrière-pensée de révolte, avec l’unique souci de faire vrai.
183 Millet aurait pu, comme bien d’autres, chercher ailleurs ses modèles et flatter le goût de son époque; héroïquement, il s’est obstiné dans cette voie où le public refusait de le suivre. Le paysan! Quelle beauté pouvaient trouver aux travaux de la terre les bourgeois amateurs de 1850, et quel espoir qu’ils orneraient leurs galeries des misérables fendeurs de bois ou des batteurs de sarrasin? Aussi Millet, dont les toiles devaient atteindre plus tard des prix si fabuleux, eut-il à se débattre toute sa vie contre la misère. Dans sa pauvre demeure de Barbizon, il n’y eut pas toujours de quoi manger. Pendant une de ces périodes de détresse, son voisin et ami Théodore Rousseau lui acheta, sous un nom d’emprunt, son Paysan greffant un arbre, pour lui permettre de donner un peu de pain à sa famille. Un jour il écrit à un ami: «Il n’y a pas quarante sous à la maison, et voilà vingt ans que cela dure.» Contraint par la nécessité, il passe avec des marchands des traités désastreux: pour mille francs par mois, il abandonne tous les tableaux et dessins qu’il produira pendant trois ans. Et certains de ces tableaux se vendent aujourd’hui des centaines de mille francs.
Millet est mort sans avoir pu assister à ce retour de gloire. Au surplus, sa haute figure n’est pas mieux comprise de la masse du public, mais on parle de lui avec le respect qu’inspirent toujours des chiffres très élevés.
Le tableau des Glaneuses fut acheté 2.000 francs par M. Binder. Il fut vendu très cher par M. Bichoffsheim à Mme Pomery, de Reims, qui le légua au Louvre en 1881. Il y figure dans la salle des Peintres modernes.
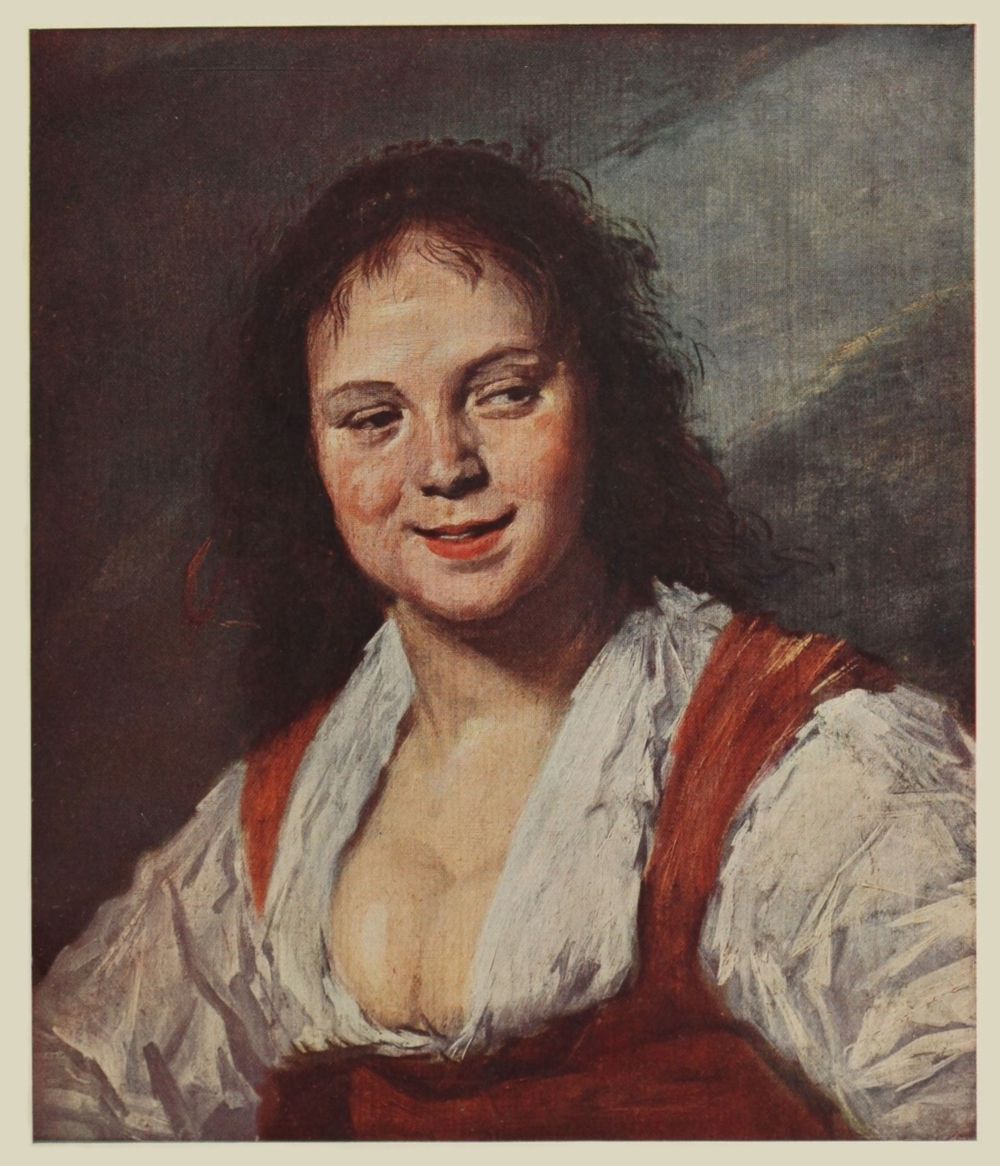
CE tableau devrait s’appeler plus exactement la Fille au marché; il est, en effet, le portrait d’une marchande de poissons de Haarlem, qui posa très souvent dans l’atelier de Hals. La jeune femme est représentée à mi-corps. Elle est vêtue d’une robe rouge dont on n’aperçoit que la taille et les brides qui la maintiennent aux épaules. La chemise largement ouverte laisse apercevoir la poitrine et une partie des seins. Le visage, encadré d’une chevelure très opulente mais peu soignée, est d’une belle vulgarité paysanne qui ne manque pas de charme; la jovialité bien portante des filles du peuple s’y épanouit magnifiquement en un rire qui découvre les dents, anime les joues, bride les yeux. On a souvent épilogué sur la signification de ce sourire, où certains ont voulu voir de la cruauté ou du cynisme. A le regarder attentivement, on n’y aperçoit que la joie de vivre chez une créature saine et belle, expression traduite par le peintre d’une manière supérieure.
Franz Hals fut d’ailleurs le peintre de la Hollande joyeuse et bien vivante. «Après Rembrandt, Franz Hals! La rayonnante gaîté après la mélancolie la plus profonde; le rire après la douleur... Ici, nous sommes en pleine Hollande heureuse et triomphante et la joie du triomphe s’épanouit dans l’œuvre du maître de Haarlem. Comme se déploie le ciel du printemps sur les campagnes fleuries de sa ville natale.....» (Armand Dayot).
S’il exécuta de nombreux portraits de personnages graves, des 188 réunions de confréries ou de sociétés, il affectionnait peindre les visages rubiconds de buveurs, les faces épanouies des servantes d’auberge. Les modèles ne lui manquaient pas dans les estaminets où il fréquentait, car il était lui-même grand buveur et bien souvent ses élèves devaient le ramener, le soir, en état d’ébriété complète.
Mais telle était sa facilité de travail que, malgré les déréglements de sa vie, il a laissé une œuvre considérable. Franz Hals appartient à cette glorieuse famille des peintres de la Flandre occidentale qui compte Rubens, Van Dyck, Jordaens, Teniers; ces grands noms sont évocateurs de couleur puissante, de force, de réalisme, d’observation humaine. Hals les égale par l’intensité de vie qu’il donne à ses personnages et par la verve débordante dont il les anime. Pour sa facilité, elle était proverbiale et pouvait se comparer à celle de Rubens. Il exécutait, quand il était en verve, un portrait en quelques heures.
Van Dyck, étant venu d’Angleterre en Flandre, voulut voir Franz Hals dont il appréciait les œuvres et dont il avait entendu vanter l’habileté d’exécution. Il se présenta chez l’artiste; on dut l’aller chercher au cabaret. Très mécontent d’être dérangé, Hals ne se presse pas; il ignore d’ailleurs le nom du visiteur. Quand il arrive, Van Dyck demande à être portraituré; Hals refuse d’abord, et il ne faut pas moins que la promesse d’une somme importante pour le décider. De fort mauvaise humeur, il prend une vieille toile, des pinceaux et, deux heures après, il tend à son modèle un portrait merveilleux d’exécution et de ressemblance. Van Dyck remercie, paie la somme convenue, puis demande à l’artiste s’il pourrait à son tour essayer de lui faire son portrait. Hals fut étonné de l’offre, et plus surpris encore en voyant son hôte travailler. Il devina alors:
—Mais qui diable êtes-vous donc? Antoine Van Dyck, certainement!
Presque toujours ses élèves ramenaient Franz Hals ivre, et le 189 couchaient. Une fois dans son lit, le peintre bredouillait une prière qui se terminait invariablement par ces mots: «Mon Dieu, recevez-moi au Ciel!» Ses élèves, conduits par Brauwer, résolurent de lui faire une farce. Ils percèrent quatre trous au plafond, par lesquels on descendit des cordes qu’ils attachèrent aux quatre pieds du lit. Quand Franz Hals, ivre comme de coutume, prononça sa phrase habituelle, le lit, tiré par des mains invisibles, quitta le sol et monta vers le plafond. Épouvanté de voir sa prière exaucée le peintre s’empressa de crier: «Pas encore, Seigneur, pas encore!»
Mais avec l’âge, son penchant à la boisson ne fait que grandir; ses stations à la taverne deviennent plus prolongées. Son talent ne diminue pas mais sa production se ralentit. La gêne vient, puis la misère. Il doit à tout le monde. Il paye son boucher en lui offrant un de ses plus beaux chefs-d’œuvre: Le joyeux trio. Comme il est resté fier, des sociétés de bienfaisance dissimulent la charité qu’elles lui font en lui commandant deux tableaux qu’il exécute, sans aucune défaillance de pinceau, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
On ne sait rien de ses dernières années et de sa mort. Il fut inhumé dans le chœur de la Groote Keerke de Saint-Bavon. Pour tout mausolée, une simple pierre tombale, avec les lettres F. H.
Sa veuve lui survécut quelques années, dans une pauvreté extrême. Elle obtint de la ville, comme secours, une aumône de quatorze sous par semaine.
La Bohémienne fut vendue 301 livres, en 1782, à la vente Menars. Elle passa plus tard dans la collection La Caze. Elle figure aujourd’hui au Louvre dans la salle hollandaise, derrière la grande salle des Rubens.

LA scène se passe vraisemblablement dans la tour du clocher d’une église de village, un jour de fête carillonnée. C’est le moment d’annoncer l’office: l’enfant de chœur a déjà revêtu le surplis blanc et la soutane écarlate. A la corde qui met la cloche en branle, quatre vigoureux paysans sont accrochés et tirent de toute la force de leurs bras. Une partie de cette ardeur, ils l’ont sans doute puisée dans les bouteilles qu’on aperçoit jonchant le sol, à côté d’un monceau d’habits. Dans le feu de l’action, l’un d’eux a laissé choir sa pantoufle et ses bas, tirés par l’effort, descendent et tirebouchonnent sur ses jambes maigres. Tous ces gaillards ont l’air de joyeux drilles pour qui la sonnerie dominicale des cloches semble être l’occasion de vider quelque bouteille. Le peintre n’a pas situé son épisode; sans doute est-ce une réminiscence de son séjour dans le Midi. En tous cas, nous sommes dans un pays où le vin est en honneur. Tout près de la fenêtre à vitraux, on aperçoit le sacristain qui, le verre en main et avec une évidente béatitude, fait raison à un jeune homme assis devant lui dans l’embrasure. L’enfant de chœur lui-même, près de la porte, tient un flacon qu’il se dispose à aller boire en cachette, dans quelque coin.
Ce petit tableau est d’une fantaisie charmante; l’effort musculaire des sonneurs y est traduit avec une vérité, un réalisme parfaits. Par la minime importance de l’épisode, par l’abondance du détail et la minutie de l’exécution, cette œuvre se place parmi les meilleures de 194 cette forme d’art qu’on appelle la peinture de genre, et dans laquelle excella Decamps.
«A cette peinture, écrit M. Charles Clément, manquent en tout ou en partie les grandes qualités de l’art, l’importance et l’élévation du sujet, la force, la noblesse de la composition, la beauté des types, des gestes, des ajustements, mais elle rachète son infériorité par la vérité des détails, l’habileté de la facture, l’agrément de la couleur, la justesse de la pantomime, l’arrangement, en un mot, par l’excellence de ce qui dépend avant tout de l’observation et de l’exécution. Un peintre de genre a de l’esprit, du savoir-faire, du talent. Il étonne, intéresse, séduit; il n’émeut pas, il n’est pour rien dans ces nombreuses et admirables créations du génie qui, de siècle en siècle, peuplent l’imagination de ceux qui savent et qui pensent.»
A cet égard, Decamps est beaucoup mieux qu’un peintre de genre. S’il n’était que le plus brillant et le plus amusant de nos anecdotiers, on ne comprendrait pas l’unanime admiration dont bénéficie son œuvre. Mais il ennoblit la plus vulgaire de ses compositions par une admirable compréhension de la lumière. Peu de peintres ont possédé à un aussi haut degré le don de capter le soleil et d’en illuminer ses toiles. Ce fut son étude constante et la plupart de ses tableaux n’ont pas de sujet, ils ne sont qu’un prétexte pour lui de jouer en virtuose avec les rayons et les ombres. Il a porté l’art du clair-obscur à une perfection qui l’apparente aux plus grands maîtres. On en trouve précisément la preuve dans les Sonneurs où vibre une lumière intense qui anime les coins les plus sombres de la toile.
Decamps rêva toute sa vie d’être autre chose qu’un peintre de genre. Il s’essaya dans la peinture de style et y montra de réelles qualités. On pourrait citer, parmi ces œuvres d’un ordre plus haut La Pêche miraculeuse, la Défaite des Cimbres, et surtout le Christ au Prétoire. Il songea même à peindre à fresque: «L’esprit d’invention ne me manquait pas, écrivait-il, et j’aurais tiré parti de l’idée la plus 195 saugrenue, si l’on m’eût accordé une salle quelconque. Ce que j’eusse produit eût été fort attaquable, j’en conviens; enfin organisé d’une manière particulière, ce que j’eusse produit fût un peu sorti de ce système de plafonnage usé... J’ai la conviction que la nécessité où je me suis trouvé de ne produire que des tableaux de chevalet m’a totalement détourné de ma voie naturelle...»
Il est peut-être heureux, pour la gloire de Decamps, qu’il n’ait pu donner sa mesure dans la peinture murale: il avait trop la passion du détail pour se plier aux nécessités de la fresque qui sacrifient précisément le détail à la masse; en outre, la fresque exige une teinte claire, vive, légère et Decamps peignit toujours dans une gamme sombre où domine le clair-obscur. Enfin, la fresque n’est abordable qu’aux dessinateurs impeccables; or, trop souvent, faute d’étude, le dessin de Decamps manque de sûreté.
Mais qu’importe ce qu’il eût pu ou voulu être? Ce n’est pas un mérite si mince de trouver matière à un tableau dans un minuscule épisode de la vie intime et de nous y intéresser à force d’esprit, de fantaisie, d’humour et aussi de science.
Pour bien juger Decamps, il faut songer qu’il se forma tout seul, sans maître sinon sans étude. Mais faute de maître, son étude fut incomplète. Il n’est presque jamais irréprochable, mais ses défauts, qui sont incontestables, ne peuvent faire oublier ses éminentes et rares qualités. Il plait et charme par la saveur un peu âpre de son talent, et par l’originalité de son invention, et le pittoresque soutenu de ses anecdotes.
Les Sonneurs furent achetés par M. Tomy-Thierry; ils figurent au Louvre dans les salles du deuxième étage, réservées à la riche collection du donateur.

QUI croirait, à contempler cette placide figure de femme, qu’on a devant les yeux une des nombreuses épouses de Henri VIII, le terrible monarque anglais! Rien n’indique, dans son attitude, qu’elle redoute la fin tragique de l’une de ses devancières, Anne de Boleyn, décapitée sur l’ordre de son époux. Elle nous apparaît, au contraire, infiniment tranquille, avec un bon visage d’Allemande sans passions qui nous la ferait prendre pour une religieuse, n’était le costume somptueux dont elle est revêtue.
Lorsque Holbein fit le portrait d’Anne de Clèves, elle n’était pas encore la femme de Henri VIII, ce qui explique peut-être son beau calme. Elle ne connaissait pas le roi sanguinaire qui allait devenir son époux. Celui-ci, ayant jeté ses vues sur elle, avait dépêché Holbein sur le continent avec mission de peindre la jeune princesse qu’il n’avait jamais vue. La flatterie dans le portrait était le moindre défaut du grand peintre d’Augsbourg. Cette fois, cependant, il s’efforça au rôle de courtisan. Anne de Clèves n’était pas belle, il nous la montre, sinon jolie, du moins suffisamment agréable. Au surplus, sa coiffure, malgré la richesse des broderies et des perles, n’est pas faite pour l’avantager: collée au front et sur les joues elle supprime complètement la chevelure, cet ornement naturel des visages féminins. En dépit de traits irréguliers et un peu vulgaires, la physionomie n’est pas sans agréments; les yeux ont de la bonté, la bouche de la douceur. On se surprend à plaindre la malheureuse 200 princesse qui dut à ce portrait de devenir l’épouse d’un tel homme.
On ne saurait rien deviner des grâces de la jeune femme sous le riche mais inélégant costume qui l’emprisonne. La robe est d’un velours aux grands plis raides. Largement échancré en carré, le corsage laisse voir la poitrine à travers une guimpe de dentelles; il est garni d’un ample galon bordé de perles et orné de cabochons sertis de gemmes; le cou est encerclé d’un collier de pierreries où pend une croix en grenats. La ceinture, la jupe et les manches sont également soutachées d’ornements d’or recouverts de pierreries. De l’ampleur des manches sortent les mains, des mains fuselées et baguées, que la princesse tient croisées devant elle.
Ce portrait d’Anne de Clèves, merveilleuse symphonie de pourpre et d’or, est un incomparable chef-d’œuvre. Quand il le vit, Henri VIII en fut enthousiasmé. Le modèle lui plut, puisqu’il l’épousa, mais il ne se montra pas moins satisfait du talent de l’artiste. «Je pourrais, disait-il, faire six pairs avec six laboureurs, mais de six pairs je ne ferais pas un Holbein.»
Plus heureuse qu’Anne Boleyn, Anne de Clèves eut la chance de mourir de sa belle mort. Quand elle eut cessé de plaire, Henri VIII ne la fit pas décapiter; il se contenta de la répudier. Mais on devine quelle dut être son existence auprès de son royal époux et, plus d’une fois, son doux et tranquille visage se voila de larmes et se contracta dans les affres de la peur. Celle qui lui succéda, Catherine Howard, eut moins de bonheur. Après quelques années, Henri VIII lui faisait trancher la tête.
Ce gros homme balourd avait l’apparence d’un rustre et la férocité d’un Néron. Son règne ne fut qu’une longue suite de perfidies et de crimes. Comme tous les tyrans, il avait l’âme inquiète, soupçonneuse, et quiconque avait attiré sa défiance était marqué pour l’échafaud. Il a figuré, dans une époque de chevalerie, comme un monstrueux anachronisme, et il a souillé l’histoire d’Angleterre d’une page sanglante. 201 Quand il était las de ses femmes, ce Barbe-Bleue couronné les livrait tranquillement au bourreau.
Après la mort de l’infortunée Jeanne Seymour, Henri VIII songea, avant de se tourner vers Anne de Clèves, à épouser Christine de Danemark, duchesse de Milan. Cette princesse, qui n’avait que seize ans, était déjà veuve, et sa réputation de beauté étant parvenue jusqu’au roi d’Angleterre, celui-ci lui fit offrir la couronne. C’est Holbein qui fut chargé de la négociation et, suivant l’usage, il devait peindre la jeune femme qu’il convoitait. Mais l’ambassade de l’artiste échoua piteusement. Dès les premières ouvertures, la princesse se récria:
—Je n’ai qu’une tête, répliqua-t-elle, et je tiens à la garder sur mes épaules.
Christine de Danemark devint plus tard duchesse de Lorraine.
Malgré son échec, Holbein, nous l’avons vu, ne perdit pas la confiance de son terrible maître. Aussi, malgré les offres brillantes du bourgmestre de Bâle qui l’invitait à revenir dans cette ville où il avait si longtemps vécu, il refusa de quitter l’Angleterre. Il y mourut de la peste, en 1544, âgé seulement de quarante-six ans.
Le portrait d’Anne de Clèves est peint sur vélin collé sur toile; il faisait partie de la collection de Louis XIV. Protecteur des arts comme il l’était des lettres, le Grand Roi a donné à la France les plus beaux tableaux de ses musées. Celui-ci figure au Louvre dans la Grande Galerie, à la travée de peinture allemande.

LA légende mythologique de Psyché est bien connue: Psyché était une jeune fille d’une si idéale beauté que l’Amour lui-même s’en éprit et l’enleva. C’est ce gracieux épisode que Prud’hon a traité dans son magnifique chef-d’œuvre.
Le tableau représente la scène de l’enlèvement. La jeune Psyché, portée par des Amours ailés, est mollement étendue entre les bras de ses ravisseurs. Sa tête charmante, inclinée à droite, ne trahit aucune crainte ni aucune colère; le regard aigu qui filtre sous les paupières baissées, les lèvres entr’ouvertes pour le sourire, l’abandon complet de tout le corps disent, au contraire, l’enivrement voluptueux, la complaisante acceptation de l’aventure. Un de ses bras est négligemment replié sur l’épaule; l’autre, relevé d’un geste plein de grâce au-dessus de la tête, maintient du bout des doigts l’extrémité d’un voile de gaze qui flotte et bouillonne autour d’elle. Il n’est rien de plus idéalement beau que la chaste nudité de ce corps de vierge dont les chairs blondes semblent pétries de lumière. Ses jambes fines reposent sur le cou d’un jeune Amour à figure rieuse et aux cheveux ébouriffés. Les deux autres maintiennent le buste de la jeune fille; l’un d’eux, celui du premier plan, à demi ployé sous le charmant fardeau, lève les yeux vers la blonde Psyché, qu’il contemple d’un air d’adoration. Au-dessous d’eux Zéphyr, le vent complice du rapt, déchaîne un tourbillon de nuées qui facilite l’envol du groupe vers l’azur.
Cet admirable tableau, l’un des plus beaux de l’école française, est 206 surtout remarquable par sa conception et sa traduction spéciales de l’antique, très différentes de celles en honneur dans l’école de David. A cette école Prud’hon n’emprunte rien, sinon le goût des sujets puisés dans l’antiquité païenne.
Mais avec quelle grâce supérieure il l’interprète! La beauté n’est pas pour lui un laborieux assemblage de lignes impeccables, ayant le poli et la rigidité du marbre. Sous son pinceau prestigieux, la froide statue s’anime, les chairs vivent, un sang généreux circule; sur l’épiderme de ses créations, il épand ce je ne sais quoi d’indéfinissable et d’insaisissable dont seuls Léonard de Vinci et Corrège possédaient le secret. Aussi bien, Prud’hon n’est-il pas de son siècle; il a de la beauté le sens profond et idéal des grands peintres de la Renaissance. J’ai nommé Vinci et Corrège: c’est jusqu’à ceux-là qu’il faut remonter pour trouver un terme de comparaison avec le talent du maître français. Ils sont d’ailleurs ses modèles préférés, pendant la durée de son séjour à Rome. Passionnément, il les étudie, scrutant leurs procédés, cherchant à deviner leur technique, à s’attribuer leur coloris. Corrège surtout l’éblouit et l’enchante. Il se désespère devant la transparence de ses chairs, la fluidité de ses ombres, l’audace de ses raccourcis. A force d’étude, il pénètre les arcanes de cet art admirable; il en comprend l’élévation, la beauté; il le fait sien à son tour et, sur ses toiles, nous retrouvons toute la grâce et la volupté païennes du grand maître parmesan. Et l’on peut dire de lui sans exagération qu’il a été le Corrège français.
«Au milieu de son temps, écrit Théophile Gautier, Prud’hon est un fait imprévu. Il a créé une grâce nouvelle et trouvé une veine de beauté inconnue. Sa manière de comprendre l’antique diffère complètement de celle de ses contemporains. Les statues que les élèves de David dessinent avec une sécheresse sculpturale, il semble les voir au clair de lune, argentées de molles lumières, baignées d’ombres et de reflets, ondoyantes, effumées sur les contours, enveloppant et noyant 207 leurs lignes dans une vague brume. A la mythologie de l’empire il applique le flou du Corrège. Il a la vapeur, le mystère, la rêverie, et aussi un divin sourire qui n’appartient qu’à lui. Mais n’allez pas croire à un talent efféminé; Prud’hon sait, quand il le faut, être mâle, sérieux et grand. Quoi de plus tragique que La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime?»
Nous avons dit ce que fut son séjour dans la Ville Éternelle: un perpétuel enchantement, une admiration sans limite pour les chefs-d’œuvre de la Renaissance, une fervente adoration pour Corrège et Vinci.
A son retour, il est un maître et bientôt ses toiles font sensation. L’Empire a escamoté la Révolution. Napoléon favorise les arts; il ne tarde pas à distinguer Prud’hon. Il lui confie le portrait de l’impératrice, que le peintre a représentée assise dans les jardins de la Malmaison.
A ce chef-d’œuvre, Prud’hon en ajoute un autre: L’Enlèvement de Psyché que nous donnons ici. Bientôt, il est célèbre, on se dispute ses toiles, ses portraits, il est de l’Institut et il meurt couvert de gloire.
L’Enlèvement de Psyché figura au Salon de 1808. Il fut payé 15.450 francs en 1839; il atteindrait aujourd’hui un chiffre fantastique s’il était remis en vente. La duchesse de Sommariva, qui possédait cette magnifique toile, la légua, en 1888, au musée du Louvre, qui l’a mise en belle place dans la Salle des Sept Cheminées, également appelée Salle du Sacre, où se trouvent les œuvres de David et des autres peintres du début du XIXe siècle.

PHILIPPE DE CHAMPAIGNE! Une noble figure d’homme et de peintre. Son admirable existence s’est partagée entre la pratique de toutes les vertus chrétiennes et le culte fervent et passionné de l’art. Il réalise le type accompli de «l’honnête homme», tel qu’on le concevait au XVIIe siècle.
Bien que né à Bruxelles, Philippe de Champaigne peut être revendiqué par la France où s’écoula toute sa vie. Peu de temps après son arrivée à Paris, il eut l’heureuse fortune de se voir employé par Duchesne, premier peintre de Marie de Médicis, à la décoration du Luxembourg, entreprise par la reine-mère. Peu de temps après, Duchesne mourait; le jeune artiste héritait de sa charge, de son logement dans le palais et il épousait sa fille.
A cette époque, Marie de Médicis n’était pas encore brouillée avec Richelieu. Elle lui recommanda son peintre, dont elle était charmée. Le cardinal, qui faisait embellir à ce moment ses châteaux de Richelieu et de Bois-le-Vicomte, employa fréquemment Philippe de Champaigne. Bientôt survint la guerre entre la reine-mère et le cardinal-ministre: ce fut pour Marie de Médicis la persécution, l’internement et l’exil. Le peintre, très dévoué à sa bienfaitrice, ressentit une véritable douleur du traitement indigne que lui faisait subir Richelieu. Il ne l’aima jamais. Chargé des travaux de Bois-le-Vicomte et du palais Cardinal, il laissait traîner les travaux, imaginant toutes sortes de prétextes pour ne pas les continuer. Le jeu 212 était d’autant plus dangereux que le rude ministre devinait bien les motifs de ce mauvais vouloir. Mais il aimait le talent de Philippe de Champaigne; il employa les procédés les plus flatteurs pour le ramener à lui. Il lui envoya son confident, Le Boutilhier de Chavigny, pour lever ce qui lui resterait de rancune. Champaigne s’obstina. Peu habitué à la résistance, Richelieu s’indigna. Rencontrant un jour le peintre, il lui dit sur un ton courroucé: «Vous ne voulez pas être à moi, parce que vous êtes à la reine-mère.»
Mais le cardinal avait l’âme trop grande pour ne pas comprendre la dignité d’un tel caractère. Il l’en estima davantage et affecta, en plusieurs rencontres, de lui en donner publiquement des marques. Un jour, voulant le regagner tout à fait, il lui fit dire par Des Bournais, son valet de chambre, qu’il pouvait demander ce qu’il lui plairait pour l’avancement de sa fortune et des siens. Mais Champaigne répondit:
—Si Monsieur le Cardinal peut me rendre plus habile peintre que je ne suis, c’est la seule chose que je demanderai à Son Éminence; sinon, je me tiens pour satisfait de l’honneur de ses bonnes grâces.
Cette réponse fut rapportée à Richelieu et ne l’offensa point, précisément parce qu’il y vit une hauteur d’âme à laquelle les gens de cour ne l’avaient sans doute pas accoutumé.
Néanmoins Philippe de Champaigne ne refusa pas de travailler pour le cardinal. S’il ne recherchait pas les commandes, il ne croyait pas devoir blesser gratuitement le ministre qu’il n’aimait pas, mais qu’il savait lui vouloir du bien.
Plusieurs fois il eut l’occasion de peindre l’Éminence rouge, comme on disait alors, tantôt dans des compositions allégoriques, tantôt seule avec sa barrette sur la tête. La National Gallery, de Londres, possède trois beaux portraits du cardinal, l’un de face, les deux autres de profil, exécutés par Philippe de Champaigne pour le sculpteur Mocchi, chargé d’exécuter le buste du grand homme d’État.
Mais le plus beau est sans contredit celui que possède le Louvre. 213 Félibien raconte que, pendant les séances de pose, le cardinal s’entretenait familièrement avec le peintre, l’interrogeant sur son art, s’informant de sa famille et déployant pour lui plaire toutes les grâces de sa vaste intelligence et de son grand esprit.
Richelieu est représenté debout, revêtu de son costume cardinalice. Par-dessus la soutane rouge, on aperçoit le surplis de dentelle qui jette une note claire dans cette pourpre symphonie. Sur les épaules est jeté l’ample manteau rouge, dont les plis, drapés avec un art admirable, descendent jusqu’à terre. Un large ruban de moire bleue supporte la croix du Saint-Esprit. Du col empesé émerge la tête fine et volontaire du cardinal; une soyeuse chevelure encadre le front haut derrière lequel bouillonne l’un des plus puissants cerveaux des temps modernes; l’œil est vif, scrutateur, la lèvre serrée et prompte à marquer la colère. La moustache relevée et la barbe taillée en pointe donnent une allure martiale à ce prélat qui déposait volontiers la robe pour endosser le harnais de guerre. La main droite tient la barrette cardinalice, pendant que la main gauche, avec son index tendu, semble donner un ordre. L’ensemble du personnage est élégant, la silhouette est élancée, car le cardinal de Richelieu est gentilhomme. Le portrait se détache en rouge vif sur un fond de draperie sombre qui donne tout son relief à la belle effigie du grand ministre de Louis XIII.
Le portrait de Richelieu appartient à l’ancienne collection et provient de l’hôtel de Toulouse. Il figure dans la Grande Galerie du Louvre, à la travée réservée aux peintres flamands. Philippe de Champaigne n’en reste pas moins l’une des plus pures gloires de l’art français.

DANS un paysage de verdure où se mêlent les teintes d’or de l’automne, un joyeux pique-nique se déroule sur l’herbe. Le cadre de cette fête champêtre est délicieux. Un clair soleil illumine le ciel et projette sa clarté sur la campagne, dont on aperçoit les vallonnements et les parties boisées escaladant les collines qui ferment l’horizon. C’est l’époque des vendanges, la récolte joyeuse par excellence; du laborieux essaim des vendangeuses fusent des rires et des chansons. On les voit ici, sur la gauche du tableau, s’affairant à la cueillette des grappes, mais à leur attitude on devine que les langues fonctionnent au moins autant que les faucilles. Le groupe du premier plan ne paraît s’intéresser que fort peu au travail de la vendange; il semble se préoccuper davantage de faire honneur au plantureux dîner étalé sur une serviette, dans l’herbe épaisse. Des deux femmes qui prennent part au repas, l’une est presque entièrement étendue à terre et, s’appuyant sur le coude, s’incline sur une assiette bien garnie; l’autre, assise, a sans doute apaisé sa faim, car elle regarde devant elle dans l’attitude du repos. En face d’elles, un convive emplit son assiette. A côté de la nappe, se trouve un flacon de dimension respectable et le panier d’où ont été extraits les comestibles. Derrière ce groupe couché, se tient une jeune femme, son panier de vendangeuse à la main; à gauche, un âne et son conducteur sont placés, attendant que la cueillette vienne garnir le double faix destiné à recevoir le raisin. A droite, un paysan, le verre 218 en main, conte fleurette à une jeune fille assise qui, le panier passé dans le bras, semble l’écouter avec intérêt.
Tout l’art gracieux de Lancret s’épanouit dans cette toile charmante. La composition en est habile et parfaitement distribuée, peut-être même avec un peu trop de symétrie. Avec des dons de premier ordre, Lancret a plus de savoir-faire que de spontanéité; il ordonne ses toiles avec un soin minutieux qui rappelle la manière des petits maîtres hollandais. Élève de Watteau, il ne possédait pas la souplesse, l’imprévu, ni surtout l’inspiration du maître, mais il a du brillant et de la virtuosité. Parfois ses personnages sont figés, ils ressemblent un peu trop à de jolies figurines de Saxe embarrassées dans leurs atours de porcelaine ramagée, mais ils sont si pimpants, si frais qu’on éprouve à les regarder un plaisir qui ne se lasse pas. En cela, Lancret est bien de son siècle. Il semble avoir vu le monde et les choses de son temps à travers un voile de gaze rose qui teinterait tout de couleurs tendres et aimables. Il naquit et vécut à l’époque la plus superficielle mais aussi la plus brillante de l’histoire du monde, époque charmante qui faisait dire à Talleyrand que ceux qui ne l’ont pas connue ne savent pas ce qu’est la joie de vivre. Jamais l’esprit ne fut plus fin, la politesse plus raffinée, l’élégance plus exquise; la vertu ne se parait pas d’austérité, le vice lui-même revêtait des dehors aimables. A la cour et à la ville le ton et les manières étaient toujours du meilleur aloi: on causait, on intriguait, on madrigalisait, toujours avec esprit; les femmes les moins instruites écrivaient des billets galants en un style adorable dont le secret est à jamais perdu. Et, en faveur de tant de jolies qualités, on se sent plein d’indulgence pour la frivolité qu’elles masquaient si bien.
De ce siècle délicieux et futile, Lancret fut un des peintres les plus caractéristiques. Chez lui, non plus, il ne faut pas chercher la profondeur, l’élévation des idées, mais il posséda au plus haut degré l’art de plaire, un art qui n’est pas à la portée de tous. Qu’il 219 peigne des marquises ou des paysannes, on sent toujours flotter autour des jupes et des corsages un capiteux parfum de poudre à la maréchale; qu’il représente les bosquets de Versailles ou les arbres d’une campagne villageoise, c’est toujours la même nature soignée, jolie, sans poussières ni boues. Regardez son tableau de l’Automne: ne vous semble-t-il pas que ces vendangeuses penchées sur les ceps ont des bonnets bien empesés et des corsages bien brillants pour la dure besogne à laquelle elles se livrent? Quant aux jolies gourmandes du premier plan, paysannes elles aussi, on les prendrait plutôt, sinon pour de grandes dames, du moins pour des soubrettes plus accoutumées à évoluer dans le boudoir de leur maîtresse qu’à manier le panier et la faucille du vendangeur.
Mais à quoi bon insister sur ces invraisemblances? Au XVIIIe siècle, la campagne n’existait pas, elle se bornait tout entière dans les limites des parcs royaux. Cette époque de raffinement exigeait l’élégance jusque dans les hardes du paysan.
Il ne faut donc pas juger les tableaux de Lancret avec les mêmes yeux qui ont vu les toiles poignantes et rudes de Millet. Les temps ne sont plus les mêmes, ni les goûts. Et l’admiration que nous avons pour les uns ne doit pas nous rendre injustes pour les autres. On ne saurait nier, en effet, que l’œuvre de Lancret ne soit charmante. S’il était nécessaire d’en prouver la valeur, il nous suffirait de rappeler que bien des peintres, après lui, ont essayé de ressusciter le genre sans y parvenir. L’élégance et la grâce ne s’acquièrent pas; elles sont un don de nature. Ne les possède pas qui veut.
L’Automne faisait partie d’une série des quatre saisons peinte par Lancret pour le château de la Muette. Il fut exposé au Salon de 1738; il figure aujourd’hui au Louvre, dans la salle du XVIIIe siècle.

LA jeune Mme Seriziat est à demi assise sur un coin de table dont le tapis rouge fait ressortir la blancheur de la robe. Elle porte un vêtement de campagne, et la gerbe qu’elle tient dans sa main semble indiquer qu’elle rentre d’une promenade dans les champs. Un large chapeau de paille doublé de dentelle, encadre sa jolie tête blonde et y est maintenu par un ruban de velours vert noué sous le menton. La taille est serrée par une ceinture à gros nœud de même couleur. La robe n’a pas de prétentions à l’élégance. Largement échancrée sur la poitrine, elle laisse apercevoir une chemisette par l’ouverture de laquelle apparaît un coin d’épaule nue. La main droite, tombant le long du corps, tient un bouquet de fleurs des champs où domine la note écarlate du coquelicot; la main gauche, appuyée contre la table, serre la menotte d’un tout jeune enfant, son fils, qui tourne de trois-quarts sa bonne figure joufflue.
Tout est simplicité dans ce tableau charmant: simplicité dans l’attitude et simplicité dans l’exécution. Quant au visage de Mme Seriziat, il est tout bonnement exquis: sans être absolument régulier, il attire et séduit par la grâce même des lignes et surtout par le sourire des yeux et des lèvres. C’est un poème de jeunesse heureuse et de printanière fraîcheur.
C’est dans des œuvres de ce genre qu’il convient de juger David, bien plus que dans les grandes compositions inspirées de l’antique. Là, il dépouille complètement son personnage un peu froid de chef 224 d’école pour se souvenir seulement qu’il est peintre et un grand peintre.
En présence de la nature vivante, il ne songe plus qu’à la scruter, à la comprendre, à l’exprimer; il va chercher l’âme au fond des yeux. Cet impeccable dessinateur, si souvent accusé de froideur, anime ses portraits d’une chaleur vibrante qui les fait respirer, penser, vivre. Que de portraits de David on pourrait citer, comme celui de Mme Chalgrin, du pape Pie VII, dans les yeux desquels se lisent comme en un livre ouvert les sentiments intérieurs! Est-il possible d’exprimer avec plus d’éloquence et de vérité la tranquille beauté et le souriant bonheur de la jolie Mme Seriziat? Et quel sens de l’harmonie! Tout est composé, charpenté pour la satisfaction des yeux et l’équilibre de l’ensemble: les couleurs y sont choisies avec un art incomparable, l’une faisant valoir l’autre, et assemblées discrètement, sans tapage ni outrance. Pour ses portraits de femmes, David semble avoir à dessein éclairci les couleurs de sa palette; plus de bitume, plus de tonalités moroses, la couleur est claire, transparente; elle vibre, elle chante sur les épidermes délicats et les chevelures ondoyantes.
«Peindre sans arrière-pensée, voilà le plaisir unique qu’offre à David le portrait. Il n’a même plus à s’occuper de composition, de perspective et, de fait, il ne se met guère en frais pour camper ses personnages; il les asseoit simplement sur une chaise ou dans un fauteuil, les installe devant leur bureau. S’il peint un groupe, il ne cherche pas davantage; il procède avec le laisser-aller d’un photographe... Qu’il peigne des jeunes filles ou des femmes séduisantes par leur beauté ou par leur grâce, ou simplement par le charme de leur âge, il met à les peindre une ingénuité, une aisance dépourvue de toute espèce d’affectation qui séduit immédiatement le cœur.» (Léon Rosenthal.) Devant un portrait, David ne se surveille plus. N’attribuant à ces travaux, dans son œuvre, qu’une importance très minime, il oublie toute contrainte d’école et s’abandonne.
225 Mme Seriziat, «la bonne Émilie» comme on l’appelait dans la famille de David, était la belle-sœur du peintre. Celui-ci avait exécuté ce portrait pendant son incarcération à la prison du Luxembourg, après le 9 thermidor. Quand il figura au salon de l’An IV, son auteur était encore gardé à vue dans sa maison.
On sait, en effet, que David, conventionnel exalté, s’était lié d’amitié avec Robespierre et qu’il avait voté les motions les plus révolutionnaires de la farouche Assemblée.
On l’accuse même d’avoir gouaillé au passage de la charrette qui conduisait la reine à l’échafaud. Quoi qu’il en soit, le caractère de David ne fut jamais égal à son génie. Quand, Robespierre abattu, il fut lui-même décrété d’accusation, il monta à la tribune pour se défendre. «Il était pâle, écrit un témoin oculaire, et la sueur qui tombait de son front roulait de ses vêtements jusqu’à terre, où elle imprimait de larges taches.» Il renia lâchement Robespierre, l’accusant de l’avoir «trompé par ses sentiments hypocrites». Ce n’est pas à cette bassesse mais à son génie seul qu’il dut de ne pas porter à son tour sa tête sous le couperet de Samson.
Acquis par l’État en 1902, le portrait de Mme Seriziat figure dans la Salle des Sept Cheminées, appelée aussi Salle du Sacre, avec la plupart des autres œuvres de David.
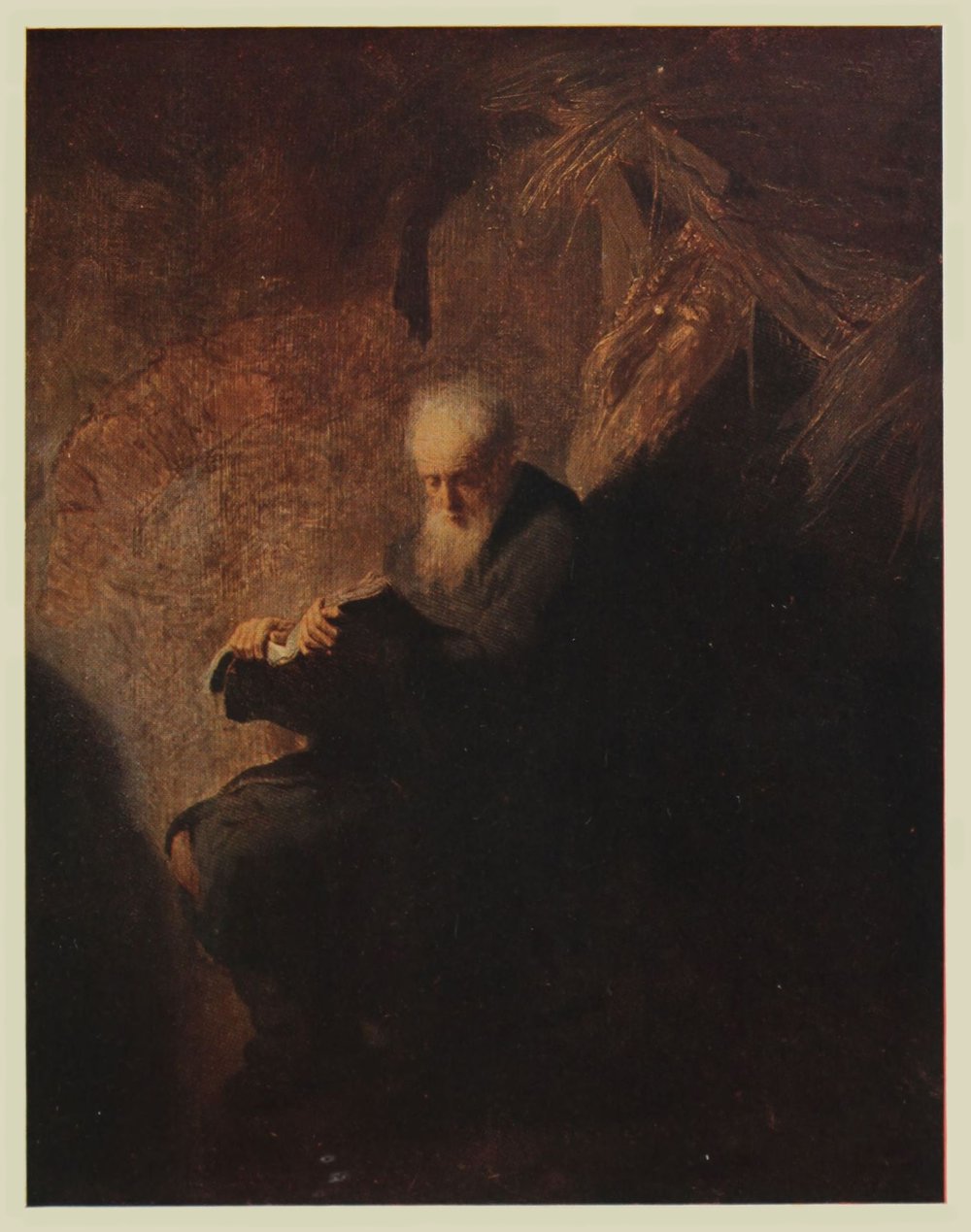
DEVANT une hutte au toit de chaume, un vieillard est assis tenant un gros livre et lisant. Quel personnage a voulu représenter Rembrandt? Est-ce un de ces ermites qui fuyaient le monde, aux premiers temps de la chrétienté, et se réfugiaient dans le désert pour s’y consacrer à la pénitence, à la prière et à l’étude? N’est-il pas plutôt une pure fantaisie de l’artiste qui, trouvant à peindre une tête caractéristique de vieillard, lui a donné la figure et les attributs d’un Saint-Jérôme? Quoi qu’il en soit des intentions du peintre, il a déployé dans ce tableau sa coutumière supériorité. Sous son pinceau, la moindre ébauche s’éclaire de traits fulgurants. Dans ce Vieillard lisant, de proportions si médiocres, il y a autant de génie d’exécution que dans sa grande toile de la Ronde de Nuit. Examinons cette tête d’homme: le large front dégarni, dont quelques mèches argentées précisent le contour et que des rides sillonnent, semble lourd de pensées; sous les sourcils broussailleux les yeux baissés dénotent l’attention que l’homme apporte à sa lecture. Bien que fripée par l’âge, la tête est belle, de cette beauté vigoureuse et intelligente dont Rembrandt ennoblit toutes ses créations. Une superbe barbe blanche, qui laisse entier le modelé d’une bouche parfaite, achève de donner du caractère à cette figure de savant. L’in-folio que le liseur tient devant lui est maintenu d’aplomb par deux mains osseuses qui sont deux merveilles d’exécution. Le vêtement, de couleur sombre, est comme noyé dans une sorte de pénombre qui laisse toute leur 230 valeur à la tête et aux mains, les jambes enveloppées de haillons troués restant dans la pénombre.
Dans ce tableau se manifeste dans tout son éclat cette science du clair-obscur que Rembrandt a portée aux dernières limites de la perfection. L’ombre et les clartés se distribuent et s’opposent avec une habileté que les plus grands peintres, après lui, ont vainement essayé d’atteindre. On a dit de Rembrandt qu’il est un magicien de la lumière: nulle part, mieux qu’en ce petit tableau, on n’en trouve une plus éclatante preuve. Nous sommes en présence d’un homme qui lit: les deux choses vraiment importantes sont la tête et le livre et c’est à cela seul que l’artiste s’attache. Qu’importe le vêtement, qu’importent les accessoires si la tête pense et si le livre est en pleine lumière! Or, la tête vit d’une vie intense, éclairée par des reflets qui se projettent en vigueur sur le visage, accusant les rides et faisant éclater toute la pensée des yeux et du front.
Quand on songe aux essais de rénovation entrepris de nos jours et si l’on contemple les œuvres de Rembrandt, on s’aperçoit que nos contemporains n’ont rien inventé; ils ont seulement tenté de restaurer des traditions trop négligées et de ramener l’art à la noblesse de la grande peinture. Quoi qu’on essaye aujourd’hui, c’est toujours à l’un ou l’autre des glorieux ancêtres qu’on doit remonter, mais l’art de Rembrandt plane à des hauteurs tellement sublimes que les plus vigoureux des peintres modernes ont dû renoncer à gravir ce lumineux Thabor.
Rembrandt est peut-être le génie le plus complet et le plus divers que l’histoire de l’art ait jamais connu. Dans sa peinture se trouvent réalisés, devançant l’œuvre des siècles, tous les efforts, toutes les conquêtes péniblement et fragmentairement acquises par la suite. Les classiques amoureux de la forme ne peuvent le renier, car il fut un des plus prodigieux dessinateurs connus; les coloristes lui ont emprunté les plus brillants effets de leur palette. Quant aux impressionnistes, 231 ils peuvent le réclamer comme leur maître, comme leur précurseur. Bien avant eux, il avait découvert la division des tons, leur juxtaposition et l’effet lumineux que l’on peut en tirer. Je ne veux pas dire qu’il avait inventé cette division puisque les mosaïstes de Byzance la pratiquaient déjà, mais ce n’est pas du tout le même travail; l’idée n’était pas nouvelle, mais l’application à la peinture n’avait jamais été faite. Il emploie d’ailleurs cette division avec une sagacité consommée; tantôt par épaisseur ou demi-pâtes, tantôt par glacis et tous ces travaux sont enchevêtrés à tel point que l’œil le plus exercé peut à peine suivre les variations du travail. Ses figures sont des êtres vivants qui nous regardent à travers trois siècles, dont les bouches parlent et dont l’épiderme remue; la transposition est telle que, si l’on s’approche, on ne voit, les unes à côté des autres ou superposées, que des couleurs crues et heurtées. Et cependant, avec ces superpositions, le génie de Rembrandt a su faire un ensemble, créer une harmonie et charpenter de ces toiles où les tonalités les plus violentes se fondent, se pénètrent dans la plus délicate et la plus intime cohésion.
Rembrandt, comme Shakespeare, a tout vu de l’humanité, il en a tout étudié. Toutes les émotions, toutes les passions sont inscrites dans son œuvre. Mais c’est surtout la lumière qui est son triomphe, il en sait toutes les ressources, il la distribue en ondées blondes, il en caresse les visages, il en ouate l’atmosphère, elle s’épand partout, elle dore même l’ombre de ce ton qui est la marque inimitable du Maître.
Le Vieillard lisant a été légué au Louvre par M. Kaempfen, ancien directeur des Musées nationaux; il figure aujourd’hui dans la grande galerie, à la travée d’art hollandais.

UN jour, racontait Corot, je me suis permis de faire quelque chose «de chic», laissant ma brosse aller à sa volonté; lorsque ce fut terminé, je fus pris de remords et ne pus fermer les yeux de toute la nuit. Aussitôt qu’il fit jour, je courus à ma toile et, avec rage, je grattai avec mes ongles tout mon travail de la veille. A mesure que mes fioritures disparaissaient, je sentais ma conscience devenir plus calme, et une fois que le sacrifice fut accompli, je respirai plus librement, car je me sentais réhabilité à mes propres yeux.»
Tout Corot est dans cette anecdote qui nous le montre tel qu’il était, ayant voué à l’art un culte exclusif, peignant les arbres avec la même émotion religieuse que les primitifs italiens mettaient à peindre, dans la calme retraite du cloître, leurs idéales Madones; chacune de ses peintures est un hymne vibrant à la nature. C’est cette qualité qui fait son œuvre supérieure.
Un Corot n’éblouit pas pour attirer l’attention; mais quand une fois on l’a vu, on ne peut plus s’en détacher et l’entour devient vulgaire. On pénètre avec lui dans un sanctuaire, d’où la foule bruyante est exclue, on écoute le silence, on jouit d’une quiétude adorable.
Corot savait saisir les moindres beautés de ce qui s’offrait à sa vue. Là où ses camarades ne trouvaient rien à peindre, il discernait des paysages insoupçonnés et brossait des toiles magnifiques. Il possédait une incomparable faculté de vision. «La nature, aimait-il à dire, est 236 une éternelle beauté». Nul peintre, dans aucun temps, ne porta aussi haut l’art d’exprimer cette beauté souveraine des choses.
«La peinture de Corot est douce, sans chocs ni contrastes éclatants, le mariage des tons y est poussé si loin que le ton pur s’y affaiblit en nuances infinies dans une harmonie parfaite, mais presque monochrome et légèrement voilée. Ces tableaux ne sautent pas vivement aux yeux; une espèce de fumée grise, vapeurs ou poussière, rampe sur les terrains, enveloppe les arbres, passe lentement au-dessus des eaux, émousse les rayons lumineux. Déchirons ce léger voile: d’immenses profondeurs où tout se baigne dans les ombres transparentes et les tièdes clartés s’ouvrent à nos yeux ravis, ce qui fait dire à l’artiste: «Pour bien entrer dans ma peinture, il faut avoir au moins la patience de laisser fuir le brouillard, on n’y pénètre que lentement, et quand on y est on doit s’y plaire.» (Théophile Sylvestre.)
Cette description fidèle du paysage de Corot s’applique à la lettre à la belle toile que nous donnons ici et qui porte le titre: Souvenir de Mortefontaine.
Sur le bord d’un lac aux eaux transparentes, reflétant comme un miroir les frondaisons et les collines, l’artiste a placé la masse imposante d’un grand arbre dont les branches vigoureuses et touffues emplissent le paysage. Dans la sérénité de cette nature exquise, se profilent, minuscules atomes dans cette immensité, des enfants qui cherchent des fleurs dans l’herbe ou détachent les feuilles basses d’un tronc d’arbre. Mais ces personnages ne jouent qu’un rôle épisodique; le vrai protagoniste de la toile, c’est le colosse vigoureux dont la majestueuse ampleur domine tout et c’est sur lui qu’il faut admirer l’art prestigieux du peintre. A travers le feuillage épais, la lumière filtre et se répand en ondes claires, diaphanes, d’une adorable teinte gris de perle.
Corot est «l’homme des gris», le peintre du crépuscule. Cela ne veut pas dire que son art soit étroitement limité. Les deux aurores, 237 comme les Égyptiens les appelaient, Isis et Nephtys, l’aurore du jour et l’aurore de la nuit, se révélèrent à Corot sans réserve; il savait traduire en impressions subtiles et cependant très lisibles, la tranquillité, la fraîcheur, le tremblotement indescriptible de la vie qui s’éveille, l’éloignement indécis des choses familières, tout le mystère et la magie de cet instant délicieux. Il invoquait la déesse pour ses tableaux, et ce ne fut jamais en vain. «Lorsque le soleil se couche, disait-il, le soleil de l’art se lève.»
Le gris d’aurore, le mot avait une signification froide et sombre avant la venue de Corot, lui qui sut rendre le frisson charmant de la fraîcheur du matin. Aussi beaux que l’aurore dont ils sont nés, apparaissent ses fins gris-perle, et sa palette semble en contenir une infinité, d’une égale délicatesse et s’harmonisant magnifiquement. Ces peintures d’aurore sont exquises, et elles sont vraies; elles portent en elles la certitude de l’absolue réalité, parce que, chez l’artiste, l’intensité du sentiment ne nuisait jamais à l’acuité de la vision. «Je prie tous les jours le bon Dieu, disait-il, qu’il me rende enfant, c’est-à-dire qu’il me fasse voir la nature et la rendre comme un enfant, sans parti-pris.» Sa prière a été exaucée, ses paysages, il les a vus et exprimés comme il voulait; ils gardent une impérissable jeunesse.
Le musée du Louvre possède de nombreux chefs-d’œuvre de Corot. Le Souvenir de Mortefontaine est un des plus beaux. Il figure dans la Salle des États, réservée à la peinture moderne.

CE portrait, connu sous le nom de la Belle Ferronnière, ne représente pas, comme on le croit communément, la maîtresse de François Ier, mais bien Lucrezia Crivelli, aimée de Louis Sforce duc de Mantoue.
Cette jeune femme posée de trois quarts tourne la tête presque de face. On n’aperçoit que le haut de son buste émergeant derrière une balustrade de fenêtre. Les cheveux, très exactement divisés en bandeaux sur le haut de la tête, s’appliquent sur les tempes, bordant les yeux et se relevant vers les oreilles qu’ils dissimulent entièrement: sur cette chevelure bien lissée est posée, comme un mince diadème, une chaînette d’or fermée, au milieu du front, par un de ces cabochons ouvrés qu’on appelait alors et qu’on appelle encore une ferronnière. D’où le nom sous lequel est connu ce tableau. Le visage est d’un ovale légèrement arrondi; les traits, réguliers, sont d’une beauté que ne parvient pas à diminuer le disgracieux agencement de la coiffure. L’ensemble de cette femme a quelque chose de robuste et d’énergique. Le cou est cerclé d’un collier à trois rangs de perles: bien que d’une ligne très pure, il a plus de vigueur que de finesse; ce n’est pas le col effilé des patriciennes florentines de Botticelli. Les épaules tombantes et la poitrine développée s’enferment dans un corsage de velours rouge ouvert en carré, et orné aux épaules de crevés maintenus par des rubans.
Dans cette figure, comme dans toutes celles de Vinci, il y a 242 quelque chose d’énigmatique et de troublant. Examinez ces yeux scrutateurs et profonds, qui rappellent ceux de la Joconde: quelles mystérieuses pensées se cachent derrière ce regard, quels secrets enferment ces lèvres minces, étroitement closes? Cette femme est une femme de la Renaissance: elle vit à une époque étrange, à la fois policée et barbare, où les intrigues se dénouent fréquemment par le poison, où les amours se terminent par le poignard. Elle est la maîtresse de Ludovic Sforza, prince magnifique mais violent, dont la tendresse est aussi dangereuse que la colère et qui gouverne ses États par la terreur. Et c’est bien de la peur qui se lit dans les yeux grands ouverts de Lucrezia Crivelli, comme à l’attente de la disgrâce de son terrible maître. Sur ce point, l’énigme demeure entière; ce que nous savons de cette femme ne peut nous aider à la déchiffrer, mais le génie du peintre a traduit magnifiquement l’angoisse de ce regard se révélant sous le calme apparent de l’attitude.
Est-il bien nécessaire d’insister sur la beauté de cette œuvre? En parlant de Vinci, quels mots trouver pour exprimer l’admiration qu’il suscite? Aucun peintre n’a poussé si loin l’art d’animer une figure et de la charger de pensées; il a le don miraculeux d’amener l’âme dans les yeux et il semble que l’on va entendre parler le personnage.
Léonard de Vinci est l’un des plus étonnants artistes dont l’histoire nous ait transmis le nom, en même temps qu’un des plus vastes esprits du monde. Comme peintre il occupe la même place que les rois au-dessus de leurs sujets; il domine l’art de tous les siècles, comme un Jupiter dans l’Empyrée. Michel-Ange et Raphaël, ces deux étonnants génies, ne sont que des princes dans cette cour dont il est le souverain. Comme intelligence, il est universel.
Raffaëlli, dans ses Promenades d’un artiste au musée du Louvre, écrit sur Léonard de Vinci cette page: «Grand, beau cavalier, élégant, de jolie figure, pratiquant tous les sports, tous les exercices du corps, musicien consommé, improvisateur, chanteur doué d’une 243 belle voix et capable de s’accompagner sur la lyre, et construisant, au besoin, un luth d’argent de toutes pièces: grand ordonnateur de fêtes, peintre, sculpteur, ingénieur, écrivain, esthète, savant en toutes choses, mécanicien, inventeur d’une machine volante, de la scie circulaire, de pièces automatiques, etc.»
L’auteur de la Joconde devança beaucoup d’hommes de science dans leurs recherches, et trouva la théorie de Copernic sur le mouvement de la terre, la classification de Lamarck en vertébrés et invertébrés, les lois du frottement, de la respiration, de la gravitation, les ondes de la lumière et de la chaleur, l’emploi de la vapeur comme force motrice dans la navigation, les aéroplanes, la chambre obscure, l’attraction magnétique, le canon se chargeant par la culasse, etc.
C’est à la cour de Ludovic Sforza qu’il peignit vers 1496, le portrait de Lucrezia Crivelli, suivante de la duchesse Béatrice d’Este, dont le duc était devenu amoureux. Lucrezia succédait, dans les faveurs du prince, à Cecilia Gallerani, une femme célèbre par sa beauté et que le duc dut éloigner sur la plainte de son épouse outragée, la duchesse Béatrice. L’histoire ne dit pas si celle-ci fut plus enchantée de voir monter au rang de favorite sa propre demoiselle d’honneur. En tout cas la liaison ne fut pas de longue durée. Ludovic dut se mettre à la tête de ses troupes pour combattre les Français, qu’il avait appelés en Italie, puis trahis. Vaincu à Novare, il fut fait prisonnier et enfermé au château de Loches, où il mourut (1510).
Ce magnifique tableau, acheté par Louis XIV, figure dans la Grande Galerie, à la travée des peintres italiens.

LA course frénétique des chasseurs nous a conduits dans ce coin pittoresque de la plaine algérienne où la verdure d’une herbe courte s’oppose à la grisaille des rochers brûlés de soleil. La solitude s’emplit de mouvement et de clameurs, une foule bariolée s’agite; les vêtements des cavaliers, les harnais des chevaux, les armes damasquinées scintillent et mêlent leurs notes claires et violentes. C’est la fin de la chasse. Guidés par le vol des faucons, les Arabes, au triple galop de leurs montures, ont forcé le lièvre qui gît sur le sol. Les rapaces, difficilement maintenus par des valets, se jettent à la curée. Adossés contre le rocher et dressés sur leur selle marquetée d’argent, le vieux chef arabe et sa suite, faucon au poing, assistent à la scène. Au deuxième plan, des chevaux tenus en bride et encore écumants de la course fournie, piaffent et s’impatientent. Hommes et bêtes forment un ensemble chatoyant, vibrant, qui papillote sous l’azur du ciel d’Afrique. Tout cela est dans une gamme claire, chantante, d’un coloris brillant qui donne bien l’impression d’un Orient lumineux et pittoresque.
Eugène Fromentin restera, dans l’histoire de l’art, le peintre de l’Algérie, du moins un des premiers qui la découvrirent pour la faire aimer. Non l’Algérie du Sud, égarée dans la fournaise du soleil et dans les sables, mais l’Algérie accessible à tous, celle des Arabes, des cités paisibles parmi des ruines, des palmeraies fraîches oubliées, comme des corbeilles de fête, au bord du désert, l’Algérie des 248 fantasias cérémonieuses et brillantes, des mosquées, des champs de bataille encore fumants, des tribus vagabondes. On peut regretter qu’il se soit borné à voir l’Arabe hors de sa tente, dans la lumière des sables et du ciel et qu’il n’ait pas osé, au lieu de ne l’étudier que dans les manifestations extérieures de sa vie, se pencher jusqu’à son foyer, dans la familiarité de ses mœurs.
Jules Claretie constate très justement que Marilhat avait rapporté d’Orient des paysages empreints d’une mélancolie profonde, Decamps des scènes étincelantes, Delacroix de grandioses spectacles, et qu’à son tour Fromentin a trouvé sur cette terre lumineuse une note personnelle que ses prédécesseurs y eussent vainement cherchée, puisqu’il la portait en lui. La gamme de Fromentin est douce, ses tons favoris sont les demi-teintes.
Devant cette terre splendide, toute décorée de noblesse par des siècles d’histoire, Fromentin demeure cependant un Parisien de pure race. Ses Arabes ont de l’esprit jusque dans les plis de leurs burnous. Il n’aimait pas voir le laid: il le transformait à travers les mailles d’or de son imagination. Dans ses tableaux qui n’ont pas la vibration hardie du désert, la sensation de son étendue monotone, le désert pourtant ne perd rien de sa grandeur; car l’intelligence du poète, plus infinie que l’espace des dunes, dépassait par son effort l’horizon qui n’est vide, comme celui de la mer, que pour le passant incapable de s’émouvoir et de comprendre. Ses yeux retiennent la configuration des choses aussi profondément que son âme pénètre les âmes. Son observation toujours attentive ne néglige rien de la vie: aussi l’exactitude de ses travaux, pareille à celle des documents d’une histoire, est affirmée par tous les voyageurs.
Dès qu’il a mis les pieds sur la terre d’Afrique, il est séduit, conquis pour toujours et il exhale son enthousiasme en pages éloquentes. Car Fromentin est aussi bon écrivain qu’habile artiste. Il est l’auteur presque célèbre de Dominique, un roman loué par 249 tous les contemporains et dont la lecture est toujours agréable; il collabore à la Revue de Paris et à la Revue des Deux-Mondes. S’il n’avait recherché la gloire dans la peinture, il l’aurait certainement trouvée dans les belles-lettres. «Tout ici m’intéresse, écrit-il. Plus j’étudie cette nature, plus je crois que, malgré Marilhat et Decamps, l’Orient reste encore à faire. Pour ne parler que des hommes, ceux qu’on vous fait sont des bourgeois. Le vrai peuple arabe, en haillons et plein de vermine, avec ses ânes misérables et teigneux, ses chameaux en guenilles passant, noirs et rougis par le soleil, devant ces horizons splendides, cette grandeur dans les attitudes, cette beauté antique dans les plis de tous ces haillons, voilà ce que nous ne connaissons pas. Somme toute, au point de vue du travail, je n’ai point à me plaindre et, du train dont je vais, je promets de vous rapporter un album assez intéressant.»
Il rapporte mieux qu’un simple album: il rapporte deux volumes d’impressions et les motifs de nombreuses toiles: c’est toute l’Algérie, lumineuse et chatoyante qu’il ramène dans ses bagages et qu’il détaillera sans relâche de son pinceau brillant. Il a mieux vu l’Algérie que Marilhat, Decamps et Delacroix; il l’a vue en poète et en psychologue. Et comme exécutant, il les égale par le charme de ses arrangements sombres et clairs, par la précision d’un style désireux de dire, au delà des formes, l’âme des êtres et des choses.
La Chasse au faucon fut exposée au Salon de 1863 et acquise par Thomy-Thiery qui la légua au Louvre ainsi que toute sa collection. Elle figure au deuxième étage, dans la salle qui porte le nom du donateur.
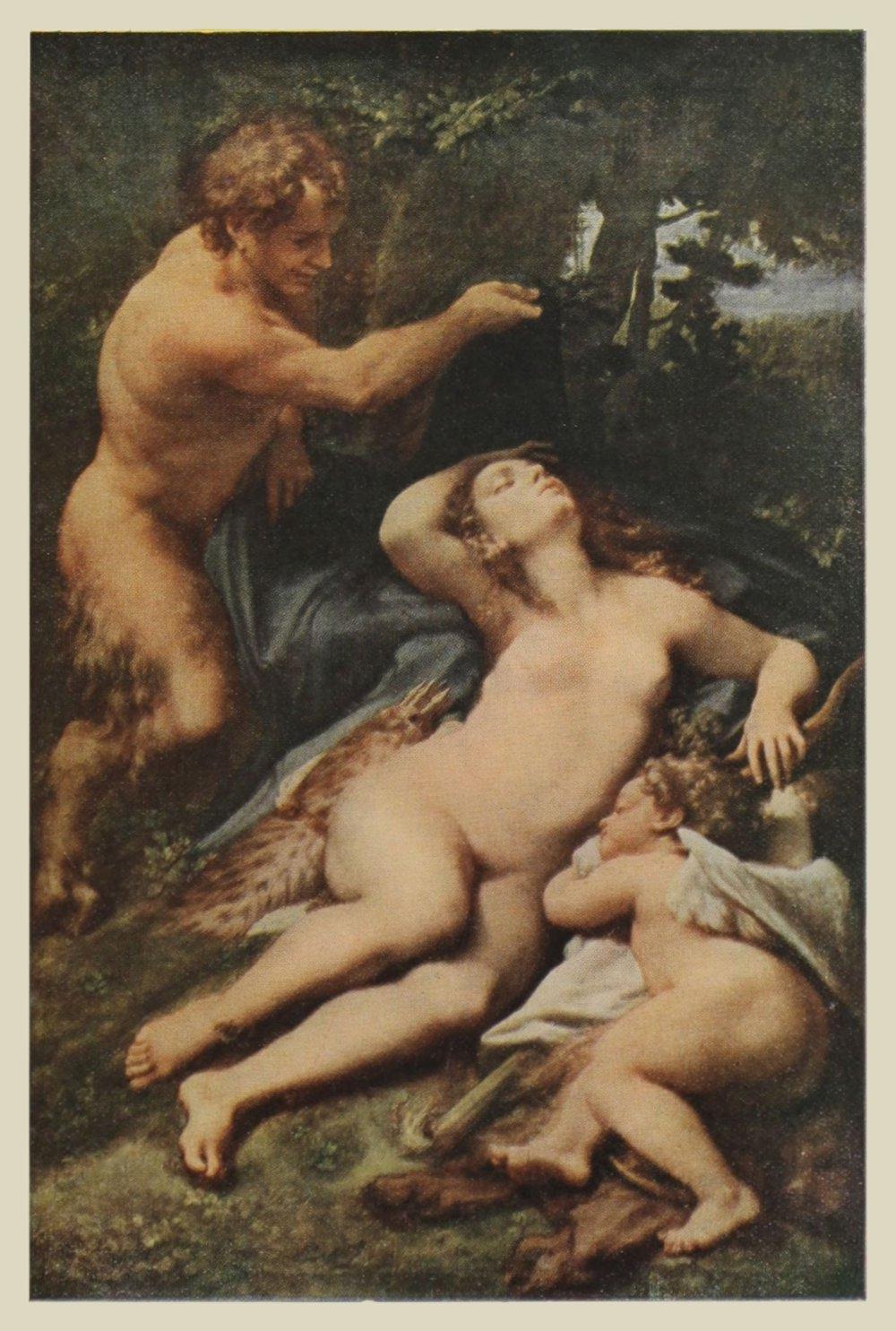
ANTIOPE, nonchalamment couchée sur une draperie bleue, un bras arrondi au-dessus de la tête, dort sans se douter que le secret de ses charmes est trahi et que Jupiter, sous la forme d’un satyre, mais conservant encore, malgré ce déguisement, sa majestueuse beauté d’Olympien, a soulevé le voile qui les cachait d’une main libertine et curieuse. Penché vers la nymphe, le dieu contemple ce beau corps assoupli par l’abandon du sommeil. Dans sa blancheur tiède et blonde, baignée de demi-teintes qui en noyent les contours et lui donnent les rondeurs de la vie, sous ce torse d’une grâce si molle et si tendre, on suit pourtant les détails d’anatomie perdus dans la masse par une science qui se dissimule sous le charme; car il ne faut pas oublier que Corrège est, avec Michel-Ange, un des plus savants dessinateurs du monde. Aux pieds de l’Antiope, l’Amour, ayant près de lui son carquois, fait semblant de dormir, couché sur le gazon, dans une pose d’insouciance enfantine; mais croyez bien qu’il ne dort que d’un œil, voit tout le manège et le favorise. Un riche paysage, étouffé et sourd, avec des tons de velours fauve, sert de fond à cette voluptueuse scène mythologique et fait admirablement ressortir la blancheur dorée de l’Antiope, foyer de lumière du tableau. Bien qu’elle ait la beauté d’une Nymphe, Antiope reste une femme. Ce n’est pas un morceau de marbre, elle vit, elle palpite et le gonflement de la respiration soulève sa souple poitrine.
On demeure stupéfait d’admiration devant la grâce voluptueuse 254 de Corrège qui créa tout un monde charmant de formes ondoyantes, de divins sourires, de lumières argentées, d’ombres transparentes et de reflets magiques. Corrège, s’il n’inventa pas absolument le clair-obscur, en tira du moins des harmonies nouvelles et des effets inconnus. Son entente du raccourci et de la perspective des corps lui permet, par l’inattendu des aspects, les courbes imprimées aux lignes, les têtes qui plafonnent ou se penchent en avant, les poses hardiment projetées, de changer l’aspect habituel des figures et des groupes, car ce gracieux, ce délicat, ce tendre est aussi un homme d’une science profonde; il possède la force comme il possède la grâce et les Apôtres géants du dôme de Parme sont là pour le prouver. Personne, pas même Michel-Ange, n’a dessiné d’un style plus grand et plus fier. De plus, son dessin est enveloppé d’une couleur admirable. Corrège est peut-être le plus original des peintres. Il se forma tout seul et tira tout de lui-même. Quelques recherches qu’on ait faites, on n’a pu retrouver avec certitude le nom d’aucun de ses maîtres et il ne paraît pas qu’il soit jamais sorti de son pays natal. Ses prétendus voyages à Rome, à Florence, ne sont rien moins que prouvés. Il ne doit rien qu’à son génie et à la nature qui l’avait si heureusement doué. Cette perfection, il l’acquit tout de suite et comme sans effort. A vingt ans à peine, il était déjà en possession complète de son talent. A peine si, dans ses deux ou trois premiers tableaux, on aperçoit quelque sécheresse et quelque symétrie qui les rattachent à l’école antérieure. Comme Raphaël, dans une vie assez courte, il parcourut le cycle tout entier de l’art, avec cette différence qu’il travaillait seul et n’avait pas, pour prêter des mains à sa pensée, une armée d’élèves enthousiastes et respectueux, pour la plupart grands peintres eux-mêmes. Sans avoir été pauvre, comme le racontent des biographes plus amis du pathétique que du vrai, il n’eut pas cette vie éclatante, bienheureuse, protégée des dieux et des hommes, qui fut la récompense du peintre d’Urbino. Quoiqu’il 255 n’épargnât rien pour en éterniser la durée, qu’il employât les couleurs les plus chères, les toiles les plus soigneusement préparées, ses chefs-d’œuvre furent payés, de son vivant, des prix médiocres. Mais la postérité, séduite par le charme enivrant de ses Vierges et de ses Nymphes, lui a donné un trône d’ivoire parmi les dieux de l’art, dans l’Olympe de la peinture. (Théophile Gautier.)
Corrège n’est pas, comme Rubens, un praticien par excellence pour lequel la peinture consiste surtout dans le maniement du pinceau; c’est un vrai poète qui peint pour exprimer des idées et des sentiments. Dans tous les arts, les hommes les plus puissants n’ont pas de procédés. Les instruments sont les mêmes pour tout le monde; pour apprendre à les manier avec génie, il faut en avoir. Inépuisable dans ses inventions ingénieuses, toujours nouveau dans ses souriantes mythologies, Corrège a ajouté aux symboles antiques la séduction d’une jeunesse immortelle. Véritable poète de la Renaissance italienne par le charme souverain de sa fantaisie, il reste, par la douce émotion de son cœur, un homme de tous les pays et de tous les temps. D’autres, peut-être, ont été plus majestueux et plus austères; nul n’a mieux exprimé la beauté dans son sourire, la vie dans sa grâce.
Le Sommeil d’Antiope a longtemps fait partie de la galerie des ducs de Mantoue. Acheté d’abord par Charles Ier, il passa ensuite dans le cabinet du banquier Jabach, puis dans celui de Mazarin. Les héritiers du cardinal le vendirent à Louis XIV. Il est aujourd’hui l’un des plus beaux joyaux du Salon Carré.

QUOIQU’IL n’ait peint que des fêtes galantes et des sujets tirés de la comédie italienne, Antoine Watteau est un grand maître. Il a créé un aspect nouveau de l’art et vu la nature à travers un prisme particulier. Son dessin, sa couleur, ses types, ses agencements lui appartiennent. Il est original. Il a la grâce, l’élégance, la désinvolture et son art est sérieux si son genre peut sembler frivole. Son œuvre est une fête perpétuelle. Ce sont des concerts, des bals, des entretiens galants, des rendez-vous de chasse, des décamérons dans les grands parcs à terrasses, à statues et à fontaines mythologiques, des Mezzetins donnant des sérénades à des Isabelles, des Colombines jouant de l’éventail et de la prunelle avec des Léandres, des cavaliers relevant de belles dames assises sur l’herbe: tout ce qu’une imagination heureuse peut inventer de plus riant et de plus aimable. En voyant ces toiles si gaies, si spirituelles, si claires de ton, où les lointains bleuissent comme les paradis de Breughel de Velours, on serait tenté de croire, chez l’artiste, à une bonne humeur inaltérable et à un joyeux éblouissement de la vie. Ce serait se tromper. Watteau était valétudinaire, mélancolique, voyait tout en noir et n’avait de rose que sur sa palette.
La plupart des tableaux de Watteau sont à Berlin. Le Louvre n’en possède qu’un petit nombre, mais il a l’heureuse fortune de pouvoir montrer son chef-d’œuvre l’Embarquement pour Cythère.
Au bord d’une mer dont l’azur vague se confond avec celui du 260 ciel et des lointains, près d’un bouquet d’arbres aux branches légères comme des plumes, se dresse une statue de Vénus ou plutôt un buste de la déesse terminé en gaine à la façon des Termes et des Hermès. Des guirlandes de fleurs s’y suspendent: un arc et un carquois y sont attachés. Non loin de la déesse, sur un banc, une jeune femme jouant de l’éventail, semble hésiter à partir pour l’île de Cythère. Un pèlerin agenouillé près d’elle lui chuchote à l’oreille de galantes raisons pour la convaincre et un petit Amour, le camail sur les épaules, la tire par le pan de sa robe. Il doit être du voyage sans doute. A côté de ce groupe, un cavalier prend par les mains, pour l’aider à se lever, une jeune beauté assise sur le gazon. Un autre emmène sa belle, qui ne résiste plus, et dont il entoure du bras le fin corsage. Au second plan, trois groupes d’amoureux, le camail au dos, le bourdon à la main, se dirigent vers la barque où sont déjà arrivés deux groupes de pèlerins de la tournure la plus svelte et la plus coquette. Avec quelle élégance la femme qui va entrer dans l’esquif relève par derrière, d’un petit tour de main, la traîne de sa robe! Il n’y a que Watteau pour saisir au vol ces mouvements féminins. La barque est sculptée, dorée et porte à sa proue une chimère ailée, cambrant son torse et renversant sa tête dans une coquille à cannelures. Des rameurs demi-nus la manœuvrent, et de petits Amours en déploient la tente. Au-dessus de l’esquif, dans des tourbillons de légères vapeurs, pareilles à des gazes d’argent, volent, se roulent et jouent des Cupidons enfants, dont l’un agite une torche.
Voilà bien à peu près les principaux linéaments de la composition et la place des personnages. Mais quels mots pourraient exprimer ce coloris tendre, vaporeux, idéal, si bien choisi pour un rêve de jeunesse et de bonheur, noyé de frais azur et de brume lumineuse dans les lointains, réchauffé de blondes transparences sur les premiers plans, vrai comme la nature et brillant comme une apothéose d’Opéra! Rubens et Véronèse reconnaîtraient Watteau pour un des 261 leurs. L’auteur de l’Embarquement pour Cythère est assurément le plus coloriste des peintres de l’école française. (Théophile Gautier.)
«Si Watteau, écrivent les Goncourt, a fait une nature plus belle que la nature, il le doit au poète dont est doublé le peintre. Regardez dans tous ces berceaux, ces bocages, dans toute cette ombre feuillue, regardez les trous, les jours, les percées, qui mènent toujours l’œil à du ciel, à des perspectives, à des horizons, à du lointain, à de l’infini, à de l’espace lumineux et vide qui fait rêver. L’ennoblissement dont il revêt son paysage, à lui, c’est la poésie du peintre-poète, poésie avec laquelle il surnaturalise, pour ainsi dire, le coin de nature que peint son pinceau. Des paysages idéalisés, des paysages atteignant, dans leur composition poétique, un certain surnaturel, auquel l’art matériel de la peinture ne semble pas pouvoir monter, voilà le caractère du paysage de Watteau.»
Watteau composa une réplique légèrement réduite mais d’une facture plus poussée de son Embarquement; cette toile orne aujourd’hui l’un des salons de l’ambassade française à Berlin, mais pour le charme et la fluidité des lointains, la séduction de l’ensemble, le tableau du Louvre l’emporte de beaucoup sur celui de Berlin.
Celle toile valut à Watteau son admission à l’Académie de peinture, en 1770. Elle figure aujourd’hui dans la Salle du XVIIIe siècle.

L’INTÉRIEUR d’une élégante au XVIIIe siècle. On est au petit matin, ou, pour mieux dire, au petit matin des jolies femmes pour qui le jour commence alors que le soleil est depuis longtemps levé. Rien n’est plus salutaire à la conservation du teint qu’un sommeil prolongé, dans la molle tiédeur du lit. Aussi l’agréable personne représentée ici, dans son déshabillé charmant, offre un visage reposé et des joues délicates dont l’épiderme, pour employer le style de l’époque «semble pétri de lis et de roses». Une demi-obscurité règne dans la pièce; la lumière trop vive du dehors pourrait incommoder la belle paresseuse. Elle est assise devant sa toilette, jolie table garnie de dentelles couverte de boîtes de poudre à la maréchale, de pâtes d’amande et de mouches. Dans le miroir dressé devant elle, elle surveille le détail compliqué de sa coiffure, à laquelle s’occupe activement une soubrette. Une matinée très élégante est jetée sur ses épaules, laissant apercevoir une gorge fort avenante et les bras les plus jolis du monde. En tous temps, l’ajustement d’une élégante a été une affaire d’importance: on s’en aperçoit au nombreux personnel qui s’y emploie ici. Pendant qu’une femme de chambre seconde la coiffeuse, d’autres s’occupent à diverses tâches; l’une, près de la cheminée, fait chauffer la chemise de fine toile, une autre approche du feu un récipient contenant l’eau pour les ablutions. Une fillette, placée là on ne sait pourquoi, suit d’un œil intéressé toutes les phases de la toilette. Il en est une, cependant, qui ne semble apporter qu’une 266 attention médiocre à ce qui se passe autour d’elle: cachée derrière le miroir et courbée sur sa chaise, son regard mutin paraît faire des signes d’intelligence à un personnage qu’on ne voit pas. Comme il arrive invariablement dans les tableaux de cette époque, l’artiste n’a pas manqué d’y ajouter la note libertine destinée à pimenter l’anecdote. Caché derrière une tenture qu’il soulève à demi, un jeune abbé de cour passe une tête curieuse et s’absorbe dans la contemplation de la maîtresse du logis.
Tout est charmant dans cette composition, où l’aimable et spirituel talent de Pater a prodigué les détails. Comme Watteau et Lancret, il excelle dans cet art coquet, libertin et gracieux du XVIIIe siècle, dont l’idéal était le joli et la fonction d’orner les petites maisons des grands seigneurs et les boudoirs des marquises. Quelles jolies têtes de femmes, quelles sveltes tournures, quels élégants costumes galamment portés! Comme tout cela a bon air et vit aisément dans cette atmosphère de luxe et de plaisir! Comme on sent bien qu’en peignant ces élégances d’alcôve et de ruelles, l’artiste exprime exactement le goût, la fantaisie et le caprice de son siècle! De même que le siècle précédent, solennel et pompeux, avait engendré des peintres comme Poussin ou Lebrun, de même la Régence jouisseuse et le règne frivole qui suivit suscitèrent d’aimables talents, tels que Lancret, Watteau, Hilair, Pater, Boucher, qui surgirent spontanément de cette atmosphère galante, comme Vénus de l’écume des flots. Avec le même goût de la peinture gracieuse et libertine, ils eurent tous le don précieux de la mesure, ce goût inné qui les empêcha de convertir le marivaudage en grossièreté. Quelque osé que puisse être le sujet traité, il se rachète toujours par une élégance de bonne compagnie, par un tour spirituel et malicieux qui frôle sans insister, qui fait sourire et jamais rougir.
A ces qualités rares, ils ajoutèrent—et Pater plus que les autres—une science du coloris qui les fait reconnaître au premier 267 regard. A aucune époque, la peinture n’a trouvé de teintes aussi délicates ni aussi précieuses. En considérant la Toilette, de Pater, on est aussitôt conquis et ravi par cette adorable symphonie de tons où le bleu et le rose forment les dominantes. Et qu’on ne dise pas que c’est là un art facile: la savante disposition des valeurs révèle au contraire une maîtrise supérieure. Quelle délicatesse, par exemple, dans le rose tendre de la robe que porte la soubrette assise devant le feu et comme elle se fond harmonieusement avec le rouge plus sombre de la femme inclinée devant elle. Rien de heurté, ni de banal, dans ces associations qui, sous le pinceau d’artistes moins habiles, deviendraient si facilement vulgaires.
Pater peut être considéré comme l’un des meilleurs de nos «petits maîtres» français. Tandis que Watteau plaçait de préférence ses personnages dans le plein air de la campagne, avec des lointains roses et des ciels merveilleux, Pater cherchait plus volontiers ses sujets dans les intérieurs luxueux et coquets. Il a été surtout le peintre des boudoirs et des chambres à coucher du XVIIIe siècle. Par son genre, il rappelle Terburg, le plus aristocratique des Hollandais: il possède autant de finesse et d’esprit que lui, mais il l’emporte par la délicatesse et l’élégance. Et s’il n’a pas acquis, malgré ses belles qualités, la gloire d’un Watteau ou d’un Fragonard, il en faut accuser son dessin qui n’est pas toujours irréprochable.
La Toilette fut souvent appelée la Toilette de la mariée; on l’a également reproduite sous le titre: Le Désir de plaire. Ce minuscule tableau peut être considéré comme un des plus charmants bijoux que nous ait légués le XVIIIe siècle, pourtant si fertile en jolies œuvres.
La Toilette fut donnée au Louvre par M. La Caze et figure dans la salle qui porte le nom du célèbre collectionneur.

SUR un balustre de fenêtre, un jeune garçon est appuyé. Son corps porte tout entier son poids sur le coude droit et la jolie tête repose sur la main ouverte. De son toquet de velours s’échappent de longues boucles blondes qui donnent une sorte de mièvrerie féminine à cette figure d’adolescent. Le visage est d’une parfaite pureté de lignes; le nez, la bouche, le menton sont d’un dessin délicat et charmant. Quant aux yeux, largement ouverts, ils révèlent tout à la fois l’heureuse insouciance de l’âge et une réflexion très appliquée; bien que paraissant fixés sur un point déterminé, quelque chose de vague, de flou y flotte, comme s’ils suivaient attentivement un rêve passionnant.
Toute la grâce de Raphaël est transcrite sur cette image et tout son art se révèle dans la pose abandonnée et pensive du modèle. Quel est ce jeune homme; quel nom porta-t-il dans le monde de la Renaissance; joua-t-il plus tard un rôle quelconque dans l’histoire? On ne sait pas. Certains commentateurs, séduits par la beauté du modèle et se rappelant que celle du peintre lui avait valu le nom de divin Raphaël, ont cru pouvoir affirmer que c’était le portrait même du maître. La date du tableau détruit cette légende: à cette époque Raphaël avait dépassé l’âge de cette toile et n’aurait pu se peindre que de mémoire. Or, il y a trop de vie dans cette tête pour admettre que le grand artiste aurait peint «de chic» une œuvre si parfaite.
D’autres affirment avec moins d’énergie que ce portrait n’est pas 272 l’œuvre de Raphaël, mais celle d’un certain Francesco Ubertini, surnommé Bacchiacca. Comme rien ne démontre ce dire et que d’ailleurs la toile en cause est un chef-d’œuvre, comme d’autre part, l’insinuation est toute récente, rien n’oblige à l’accepter; tout, au contraire, invite à l’attribuer à Raphaël plutôt qu’à un inconnu. Au surplus tout, dans cette toile, trahit la main de Raphaël; c’est la même technique que l’on retrouve dans son propre portrait du musée des Offices; c’est celle de tous ses autres portraits, avec la même grâce, la même onctueuse habileté, les mêmes clartés de palette.
Il n’est pas jusqu’au coloris où l’on ne retrouve le faire habituel du grand maître d’Urbino. C’est la même tonalité discrète, presque neutre qui a fait dire aux romantiques, acharnés à détruire sa gloire, que Raphaël était un médiocre coloriste. Certes, il fut moins coloriste que les Vénitiens, mais si parfois sa couleur était froide elle avait toujours cette distinction parfaite par où se révèlent les grands maîtres.
Raphaël a connu cette disgrâce de voir contester son génie; certaines écoles, dans les temps modernes, se sont laissé entraîner à cette aberration de honnir Raphaël comme l’inspirateur du culte de l’antique. Rien de plus injuste et de plus faux. Le grand artiste ne s’inspira jamais de l’antiquité qu’il connaissait à peine. Au surplus, toute polémique est aujourd’hui éteinte; Raphaël a reconquis sa splendide royauté.
Le Portrait de jeune homme figure au Louvre dans la Grande Galerie, à la travée réservée aux œuvres de Raphaël.
| Pages. | |
| Préface | 5 |
| Vulcain présentant à Vénus les armes d’Énée, par F. Boucher | 13 |
| Balthazar, comte de Castiglione, par Raphaël | 19 |
| Hélène Fourment et ses enfants, par Rubens | 25 |
| Madame Récamier, par Louis David | 31 |
| Le Concert champêtre, par Giorgione | 37 |
| Portrait d’Heindrickje Stoffels, par Rembrandt | 43 |
| Portrait de l’Infante Marguerite, par Vélasquez | 49 |
| Jésus-Christ marchant au Calvaire, par Simone Memmi | 55 |
| La Source, par Ingres | 61 |
| La Femme hydropique, par Gérard Dow | 67 |
| Madame de Pompadour, par Quentin La Tour | 73 |
| Une Jeune Princesse, par Constantin Netzcher | 79 |
| La Mauvaise Compagnie, par Jan Steen | 85 |
| Érasme, par Hans Holbein | 91 |
| Le Mariage de sainte Catherine, par Corrège | 97 |
| Conversation, par Lancret | 103 |
| La Dentellière, par Jan van der Meer (Vermeer) | 109 |
| Charles Ier d’Angleterre, par Van Dyck | 115 |
| Élisabeth d’Autriche, femme de Charles IX, par F. Clouet | 121 |
| La Barque du Dante, par Delacroix | 127 |
| Le Roi Ferdinand, par le Greco | 133 |
| Les Pèlerins d’Emmaüs, par Rembrandt | 139 |
| Sujet pastoral, par F. Boucher | 145 |
| Les Noces de Cana, par Gérard David | 151 |
| Mademoiselle de Lambesc et le comte de Brionne, par Nattier | 157 |
| Jeanne d’Aragon, par Raphaël | 163 |
| La Kermesse, par P.-P. Rubens | 169 |
| Monsieur et Madame Angerstein, par Sir Thomas Lawrence | 175 |
| Les Glaneuses, par J.-F. Millet | 181 |
| La Bohémienne, par Franz Hals | 187 |
| Les Sonneurs, par Decamps | 193 |
| Anne de Clèves, par Holbein | 199 |
| L’Enlèvement de Psyché, par P. Prud’hon | 205 |
| Le Cardinal de Richelieu, par Ph. de Champaigne | 211 |
| L’Automne, par Lancret | 217 |
| Madame Seriziat, par Louis David | 223 |
| Vieillard lisant, par Rembrandt | 229 |
| Paysage (souvenir de Mortefontaine), par Corot | 235 |
| La Belle Ferronnière, par Léonard de Vinci | 241 |
| Chasse au Faucon en Algérie, par Eugène Fromentin | 247 |
| Le Sommeil d’Antiope, par le Corrège | 253 |
| L’Embarquement pour Cythère, par Watteau | 259 |
| La Toilette, par Pater | 265 |
| Portrait de jeune homme, par Raphaël | 271 |
| Pages. | ||
| PRÉFACE | 5 | |
| BOUCHER | Vulcain présentant à Vénus les armes d’Énée | 13 |
| —— | Sujet pastoral | 145 |
| CHAMPAIGNE (de) | Le Cardinal de Richelieu | 211 |
| CLOUET (François) | Élisabeth d’Autriche, femme de Charles IX | 121 |
| CORRÈGE (LE) | Le Mariage de sainte Catherine | 97 |
| —— | Le Sommeil d’Antiope | 253 |
| COROT | Paysage (souvenir de Mortefontaine) | 235 |
| DAVID (Louis) | Madame Récamier | 31 |
| —— | Madame Seriziat | 223 |
| DECAMPS | Les Sonneurs | 193 |
| DELACROIX | La Barque du Dante | 127 |
| DOW | La Femme hydropique | 67 |
| FROMENTIN | Chasse au faucon en Algérie | 247 |
| GÉRARD DAVID | Les Noces de Cana | 151 |
| GIORGIONE | Le Concert champêtre | 37 |
| GRECO (LE) | Le Roi Ferdinand | 133 |
| HALS | La Bohémienne | 187 |
| HOLBEIN | Érasme | 91 |
| —— | Anne de Clèves | 199 |
| INGRES | La Source | 61 |
| LANCRET | Conversation | 103 |
| —— | L’Automne | 217 |
| LAWRENCE | Monsieur et Madame Angerstein | 175 |
| L. DE VINCI | La Belle Ferronnière | 241 |
| MEMMI | Jésus-Christ marchant au Calvaire | 55 |
| MILLET | Les Glaneuses | 181 |
| NATTIER | Mademoiselle de Lambesc et le comte de Brionne | 157 |
| NETZCHER | Une Jeune Princesse | 79 |
| PATER | La Toilette | 265 |
| PRUD’HON | L’Enlèvement de Psyché | 205 |
| QUENTIN LA TOUR | Madame de Pompadour | 73 |
| RAPHAËL | Balthazar, comte de Castiglione | 19 |
| —— | Jeanne d’Aragon | 163 |
| —— | Portrait de jeune homme | 271 |
| REMBRANDT | Portrait d’Heindrickje Stoffels | 43 |
| —— | Les Pèlerins d’Emmaüs | 139 |
| —— | Vieillard lisant | 229 |
| RUBENS | Hélène Fourment et ses enfants | 25 |
| —— | La Kermesse | 169 |
| STEEN (Jan) | La Mauvaise Compagnie | 85 |
| VAN DER MEER | La Dentellière | 109 |
| VAN DYCK | Charles Ier d’Angleterre | 115 |
| VÉLASQUEZ | Portrait de l’Infante Marguerite | 49 |
| WATTEAU | L’Embarquement pour Cythère | 259 |
Au lecteur.
Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original, et l’orthographe d’origine a été conservée, y compris dans les noms propres. Seules quelques erreurs typographiques évidentes ont été corrigées. La liste de ces corrections se trouve ci-après.
La ponctuation a également fait l’objet de quelques corrections mineures.
Corrections.
End of Project Gutenberg's Le musée du Louvre, tome 1 (of 2), by Armand Dayot
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE MUSÉE DU LOUVRE, TOME 1 (OF 2) ***
***** This file should be named 51023-h.htm or 51023-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/1/0/2/51023/
Produced by Claudine Corbasson, Hans Pieterse and the
Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
(This file was produced from images generously made
available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.