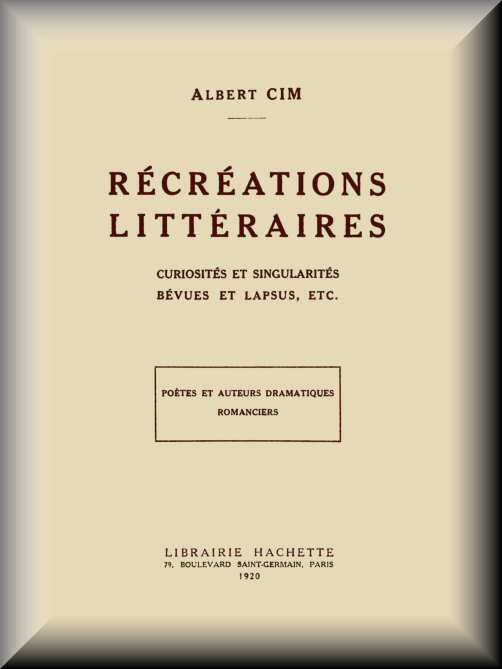
The Project Gutenberg EBook of Récréations littéraires, by Albert Cim
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Récréations littéraires
Curiosités et singularités, bévues et lapsus, etc.
Author: Albert Cim
Release Date: January 14, 2016 [EBook #50926]
Language: French
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK RÉCRÉATIONS LITTÉRAIRES ***
Produced by Ramon Pajares Box, Laurent Vogel and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)
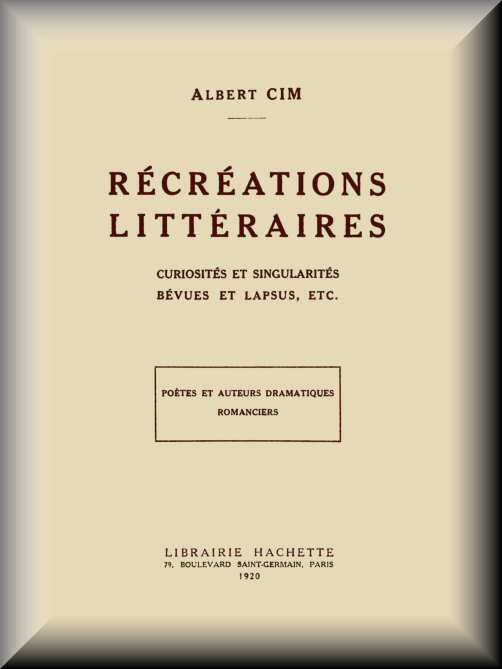
[p. 1]
[p. 2]
DU MÊME AUTEUR:
| Ouvrages bibliographiques | ||
| Une Bibliothèque, l’Art d’acheter les livres, de les classer, de les conserver et de s’en servir (Couronné par l’Académie française) | 1 | vol. |
| Amateurs et Voleurs de livres | 1 | — |
| Le Livre, Historique, Fabrication, Achat, Classement, Usage et Entretien (Couronné par l’Académie française) | 5 | — |
| Petit Manuel de l’Amateur de livres | 1 | — |
| Mystifications littéraires et théâtrales | 1 | — |
| Les Femmes et les Livres | 1 | — |
| Ouvrages pour la jeunesse (Librairie Hachette) | ||
| Spectacles enfantins | 1 | vol. |
| Mes Amis et Moi (Couronné par l’Académie française) | 1 | — |
| Entre Camarades | 1 | — |
| Fils Unique | 1 | — |
| Grand’Mère et Petit-Fils (Couronné par l’Académie française) | 1 | — |
| Mademoiselle Cœur d’Ange | 1 | — |
| Contes et Souvenirs de mon Pays | 1 | — |
| Mes Vacances | 1 | — |
| Le Petit Léveillé | 1 | — |
| Les Quatre fils Hémon | 1 | — |
| La Revanche d’Absalon | 1 | — |
| Disparu! Histoire d’un enfant perdu | 1 | — |
| Le Gros Lot | 1 | — |
| Deux Cousins | 1 | — |
[p. 3]
Albert Cim
RÉCRÉATIONS
LITTÉRAIRES
CURIOSITÉS ET SINGULARITÉS
BÉVUES ET LAPSUS, ETC.
«Ubi plura nitent...» (Horace.)
«Les choses singulières me réjouissent toujours.»
(Madame de Sévigné.)
POÈTES ET AUTEURS DRAMATIQUES
ROMANCIERS
LIBRAIRIE HACHETTE
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS
1920
[p. 4]
Tous droits de traduction, de reproduction
et d’adaptation réservés pour tous pays.
Copyright par Librairie Hachette, 1920.
[p. 5]
MON CHER MAÎTRE
HENRY MARTIN
ADMINISTRATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL
dont l’obligeance et la science m’ont toujours été d’un si précieux secours dans mes travaux bibliographiques.
Albert Cim.
[p. 7]En réunissant les curiosités et singularités, les bévues, lapsus, etc., rencontrés par moi dans mes lectures, je n’ai obéi à aucun sentiment hostile à nos grands écrivains, Corneille, Racine, Molière, Hugo, Balzac, Flaubert, Daudet, Zola, Michelet, Sainte-Beuve, etc., dont, autant que personne, je goûte, savoure et admire les œuvres. J’ai voulu me divertir, rien de plus.
«Les choses singulières me réjouissent toujours,» avouait Mme de Sévigné à sa fille (Lettre du 26 juin 1680).
Elles produisent sur moi le même effet, et ce sont bien là exactement des Récréations littéraires que j’offre au public. Puisse-t-il prendre, à lire ces anecdotes, ces bons mots, saillies et drôleries, autant de plaisir que j’ai eu à les rassembler!
Comme nul n’est obligé, en bibliographie surtout, de croire autrui sur parole, j’ai eu soin d’indiquer, autant que je l’ai pu, les sources où j’ai puisé toutes les provenances de mon butin.
A mon tour, maintenant, je prie le lecteur de vouloir bien excuser les erreurs, bévues et lapsus que j’ai dû commettre et ai commis dans mon travail. Errare humanum est.
A. C.
[p. 9]
Des bévues et non-sens littéraires, leurs causes les plus fréquentes. — Emploi irréfléchi de locutions courantes et de lieux communs. — Pléonasmes. — Inadvertances et ignorances. — Locutions vicieuses. Littré, son dictionnaire, sa compétence «universellement reconnue» (F. Sarcey). — Manques de goût et de sens critique. — Alliance de pensées disparates. — Style figuré. — Réminiscences mythologiques. — Marinisme, gongorisme, euphuïsme. — Un vœu de P.-L. Courier.
Les bévues et non-sens échappés à la plume des écrivains ont pour origine l’ignorance, l’inattention ou le manque de goût, le manque de jugement et de sens critique.
L’emploi irréfléchi de certaines locutions courantes, lieux communs et métaphores usuelles, engendre facilement de disparates associations de pensées ou de mots, et donne ainsi lieu à des bizarreries de style.
Prenons, par exemple, les locutions: le char de l’État, sur un volcan, en herbe, de main de maître, mettre le pied, de pied ferme, fouler aux pieds, couper ou fendre un cheveu en quatre, figure humaine, pierre de touche, poule aux œufs d’or, — nous obtiendrons des phrases de ce genre:
«Le char de l’État navigue sur un volcan.» (Style de Joseph Prudhomme, dit la Revue bleue, 7 avril 1900, p. 429.)
«Cette débutante est véritablement une étoile en herbe qui chante de main de maître.» (Cité par Armand Silvestre, Les Farces de mon ami Jacques, p. 289.[1])
«Nous pénétrâmes dans une de ces forêts vierges où la main de l’homme n’a jamais mis le pied.»
«Ce cœur... attend de pied ferme toutes les rigueurs de son infortune.» (La France galante, dans Bussy-Rabutin, Histoire amoureuse des Gaules, t. II, p. 106; Delahays, 1858.)
«Les droits des Canadiens-Français ont été foulés aux pieds par des mains sacrilèges.» (Extrait d’un journal anglais, dans La Presse de Montréal, 16 janvier 1913.)
[p. 10]
Et cette attestation d’une autre feuille canadienne, L’Avenir du Nord, de Terrebonne, 24 janvier 1913:
«L’Action Sociale a d’abord écrit qu’elle détestait le libéralisme, mais non les libéraux; aujourd’hui, elle se défend d’aimer les libéraux. Ces subtils castors fendent les cheveux en quatre pour échapper à la logique des faits et cacher leur couleur politique.»
«Son chapeau bosselé, déchiré, n’avait plus figure humaine.»
«La sauce blanche est la pierre de touche des cordons bleus.» (L’Opinion, 25 juillet 1885.)
«L’étalon brabançon sera la poule aux œufs d’or de la Belgique.» (M. Bruyn, ministre de l’Agriculture en Belgique, dans L’Indépendance de l’Est, 21 février 1900.)
Les pléonasmes, suites d’inadvertances, ne sont pas rares non plus:
«Le vieux médecin exultait d’allégresse». (Claude Tillier, L’Oncle Benjamin, chap. 10, p. 133; Bertout, 1906.)
«Les souvenirs du passé se réveillant...» (Octave Feuillet, M. de Camors, p. 293; C. Lévy, 1888.)
Ou encore: «Les souvenirs rétrospectifs...», qui vont de pair avec «Les prévoyants de l’avenir».
«Chacun, surpris à l’improviste...» (Émile Souvestre, Un Philosophe sous les toits, p. 49; M. Lévy, 1857.)
Panacée universelle est un des pléonasmes les plus communs, panacée, à lui seul, signifiant remède universel, qui guérit tout (du grec, πᾶν, tout; ἄκος, remède).
«Ceux qui donnent la réalisation de leurs idées comme une panacée universelle...» (Louis Blanc, Organisation du travail, p. 264.)
«Il avait trouvé la panacée universelle...» (H. de Balzac, Maître Cornelius, dans le volume intitulé Les Marana, p. 289; Librairie nouvelle, 1858.)
«C’était sa panacée universelle.» (George Sand, Histoire de ma vie, t. IV, p. 220; M. Lévy, 1856.)
«Il croyait avoir découvert la panacée universelle.» (Émile Zola, Le Docteur Pascal, p. 42.)
«Cette panacée universelle...» (Alphonse Daudet, Port-Tarascon, p. 187; Marpon et Flammarion, s. d.)
«Voilà la panacée universelle.» (J. Barbey d’Aurevilly, Polémiques d’hier, p. 245; Savine, 1889.)
[p. 11]
Voici quelques autres exemples d’inadvertances:
«Il portait un veston et un gilet à carreaux avec un pantalon de même couleur.» (Léopold Stapleaux, dans L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 20 décembre 1897, col. 772.)
«Il avait soixante-dix ans et paraissait le double de son âge.» (Id., ibid.)
«Les deux adversaires furent placés à égale distance l’un de l’autre.»
«D’une main elle lui caressa les cheveux, et, de l’autre, elle lui dit...»
«Je t’embrasse, en attendant que je puisse le faire de vive voix.»
«Nous espérions vous serrer la main de vive voix», s’amuse à écrire Jules de Goncourt à son ami Philippe Burty. (Lettres, p. 149, novembre 1859.)
Un pompier, de service à l’Opéra, s’aperçoit que son casque, qu’il avait posé dans un coin, a été rempli d’ordures: «Si je connaissais celui qui a fait cela, s’écrie-t-il furieusement et à bout d’expressions, je lui prouverais le contraire!» (Cité par H. de Villemessant, Mémoires, t. V, p. 163.)
Un brave cocher, rentrant le soir chez lui, fatigué et harassé, s’exclame avec conviction: «Je voudrais être sûr d’avoir autant de pièces de quarante sous que je vais dormir dans une heure!» (Id., ibid.)
«Ce village est situé au centre du triangle obtus que forment les trois villes de Dijon, Châtillon-sur-Seine et Langres», écrit le romancier Émile Richebourg (La Petite Mionne, t. I, p. 3), oubliant que, s’il y a des angles obtus, il n’existe pas de triangles ainsi qualifiés.
Fautes commises par ignorance:
«Ce vieillard impotent et ingambe ne quittait plus son fauteuil.» Comme si ingambe signifiait sans jambes (in privatif).
«... La guérison merveilleuse d’un officier de marine, ingambe depuis neuf mois, guéri après quatorze jours de traitement.» (Le Journal, 21 septembre 1910.)
Compendieusement (compendium, abrégé) «exprime si bien le contraire de ce qu’il signifie, que bien des gens y sont pris et lui donnent le sens de longuement», a remarqué Géruzez (dans Littré, art. Compendieusement).
Un exemple entre mille: «... Il se livre longuement et[p. 12] compendieusement à la composition des...» (Goncourt, Journal, année 1862, t. II, p. 58.)
L’adjectif valétudinaire (qui est souvent malade, de valetudo, santé, mauvaise santé) a été, nous conte Tallemant des Réaux, rattaché au mot valet et pris dans une singulière acception: «Mme de Rohan estoit fort jolie... née à l’amour plus que personne du monde... Pour des valets, elle a toujours dit en riant qu’elle n’estoit point valétudinaire (on appelle valétudinaires celles qui se donnent à des valets)...» (Tallemant des Réaux, Les Historiettes, Mmes de Rohan, t. III, p. 77-78; Techener, 1862.)
Vêtissait pour vêtait, imparfait de l’indicatif de vêtir, est une faute qu’on rencontre fréquemment, même chez des écrivains de premier ordre et connaissant admirablement leur langue, comme Paul-Louis Courier: «Elle prenait sa robe et se la vêtissait.» (Pastorales de Longus, ou Daphnis et Chloé, livre I, p. 361; Œuvres; Didot, 1865; in-18.)
Jean-Jacques Rousseau, qui écrit inventaire pour éventaire: «Une petite qui avait sur son inventaire une douzaine de pommes» (Cf. Littré, art. Éventaire), emploie un même mot dans une même phrase à la fois comme adjectif et comme substantif: «Je suis toujours malade et chagrin; on dit que la philosophie guérit ce dernier.» (Lettre à Mme d’Épinay, août 1757; Œuvres complètes, t. VII, p. 75; Hachette, 1864.) A la maréchale de Luxembourg, il écrit: «Je vois avec peine, madame la maréchale, combien vous vous en donnez pour réparer mes fautes.» (Lettre du lundi 10 août 1761, p. 175.) Ce qui rappelle le jeu de mot de Lope de Vega, à propos d’un aveugle ivrogne: «Il n’y voit goutte, quoiqu’il la prenne à chaque instant.» (Dans Émile Deschanel, Le Romantisme des Classiques, t. V, Boileau, p. 145, note 1.)
Les pronoms, comme le prouvent ces derniers exemples, sont souvent cause de bizarreries de langage. Régulièrement, «un pronom ne peut tenir la place que d’un nom déterminé, c’est-à-dire précédé de l’article ou d’un adjectif déterminatif». On ne dira donc pas: Le condamné a demandé grâce et l’a obtenue; mais: Le condamné a demandé sa grâce et l’a obtenue. Dans sa Recherche de l’Absolu (p. 199; Librairie nouvelle, 1858), Balzac cite cette phrase grotesque: «Monsieur Pierquin-Claës..., chevalier de la Légion d’honneur, aura celui de se rendre...» Et Henri Rochefort a dit plaisamment, dans un numéro de sa Lanterne (nº 1, 23 mai 1868, p. 4; réimpression de Victor-Havard, 1886): «J’envoyai chercher une feuille de[p. 13] papier ministre et j’écrivis à celui de l’Intérieur pour lui demander...»
Et bi-hebdomadaire, bi-mensuel, dans le sens de deux fois par semaine, deux fois par mois[2];
Dans le but de, pour dans le dessein de, dans l’intention de[3];
Remplir un but[4];
Ces chapeaux ont coûté vingt francs chaque, — pour chacun[5];
Être à court d’argent, pour être court d’argent[6];
[p. 14]
Éviter quelque chose à quelqu’un, au lieu de le lui épargner;
Fortuné, dans le sens de riche, qui possède de la fortune[7];
Fixer quelqu’un, pour regarder quelqu’un, fixer les yeux sur lui[8];
Le plus infime[9];
Invectiver quelqu’un, au lieu de contre quelqu’un;
Vendre la mèche, au lieu de l’éventer;
Naguère, pour il y a longtemps;
Partir à la campagne, au lieu de pour la campagne;
Une rue passagère, au lieu de passante;
Il n’y a pas que lui qui... au lieu de: il n’est pas le seul qui...[10];
[p. 15]
Soi-disant, locution adverbiale invariable, qui ne doit jamais s’appliquer aux êtres inanimés[11];
Sous le rapport de...[12].
Et tant d’autres locutions illogiques et incorrectes.
Mais, d’une façon à peu près absolue, nous laisserons ici de côté les hérésies grammaticales, barbarismes et solécismes, pour ne considérer que le sens de la phrase ou les erreurs de faits.
Voici d’autres exemples de singularités de style, dues à l’alliance de pensées absolument différentes ou disparates:
«Il avait reçu deux graves blessures, l’une à la jambe, et l’autre à Waterloo.»
«Cette fête tombe au printemps et en désuétude.»
«Le lapin est un animal timide et nourrissant.»
«Nous sommes trop heureuses de n’avoir plus qu’à prendre patience et de la rhubarbe...» (Mme de Sévigné, lettre au Président de Moulceau, 4 février 1696; Lettres, t. X, p. 357; édit. des Grands Écrivains.)
[p. 16]
«Force jeunes gens de robe et de Paris étaient allés à la suite...» (Saint-Simon, Mémoires, t. I, p. 277; Hachette, 1871.)
«Une multitude de gens à pied suivaient en cheveux gras et en silence.» (Voltaire, La Princesse de Babylone, chap. II.)
«La truite aime à être mangée vive; le brochet préfère attendre,» proclame Le Cuisinier français (dans Toussenel, L’Esprit des bêtes, p. 279; Hetzel, s. d.)
Dans son article «Figure, Style figuré[13]» du Dictionnaire philosophique, Voltaire mentionne plusieurs exemples d’incohérences de style empruntés principalement aux poètes de son époque. «C’est le goût, remarque-t-il très justement, qui fixe les bornes qu’on doit donner au style figuré dans chaque genre. Balthazar Gratian[14] dit que «les pensées partent des vastes côtes de la mémoire, s’embarquent sur la mer de l’imagination, arrivent au port de l’esprit, pour être enregistrées à la douane de l’entendement». C’est précisément le style d’Arlequin. Il dit à son maître: «La balle de vos commandements a rebondi sur la raquette de mon obéissance». Avouons que c’est là souvent le style oriental qu’on tâche d’admirer.»
Cyrano de Bergerac (1620-1655) se plaît fréquemment à écrire dans ce style «figuré» et singulier: «... Je prévois que, de votre courtoisie (ma belle maîtresse), je suis prédestiné à mourir aveugle. Oui, aveugle, car votre ambition ne se contenterait pas que je fusse simplement borgne. N’avez-vous pas fait deux alambics de mes deux yeux, par où vous avez trouvé l’invention de distiller ma vie, et de la convertir en eau toute claire? En vérité, je soupçonnerais... que vous n’épuisez ces sources d’eau, qui sont chez moi, que pour[p. 17] me brûler plus facilement», etc. (Œuvres comiques, Lettres satiriques, V, p. 181; Delahays, 1858.)
Cyrano avait pu emprunter ses alambics et ses distillations au poète Philippe Desportes (1545-1606), qui célèbre ainsi son amour:
Mon amour sert de feu, mon cœur sert de fourneau,
Le vent de mes soupirs nourrit sa véhémence,
Mon œil sert d’alambic par où distille l’eau.
Et d’autant que mon feu est violent et chaud,
Il fait ainsi monter tant de vapeurs en haut,
Qui coulent par mes yeux en si grande abondance.
(Philippe Desportes, Poésies, Diane, I, 49, p. 33; Delahays, 1858.)
Et Desportes était si satisfait de ces brûlantes comparaisons qu’il a récidivé (p. 54):
Il fit...
De mon cœur son fourneau, ses charbons de mes veines,
Mes poumons ses soufflets, de mes yeux ses fontaines.
Qui, sans jamais tarir, coulent incessamment.
L’Arétin (1492-1557) aussi et surtout est célèbre par son style «figuré» et ampoulé: «Aiguiser l’imagination par la lime de la parole... Pêcher, avec la ligne de la réflexion, dans le lac de la mémoire... Mettre le pied de la maturité dans le chemin de la jeunesse... Réfréner la bouche des passions avec le mors de la réflexion... Joindre le bois de la courtoisie au feu de la politesse... Planter le coin de l’affection au nom de l’amitié... Ensevelir l’espérance dans l’urne des promesses menteuses...» Etc. (Arétin, Œuvres choisies, traduction P.-L. Jacob, p. XLIII; Gosselin, 1845.)
Et le Maître Jacques de L’Avare de Molière (V, 2): «Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c’est la faute de monsieur votre intendant, qui m’a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie.»
«Ne cessez de frapper avec le marteau de la réflexion sur l’enclume de la méditation!» s’écriait un jour un de nos députés, pour recommander à ses électeurs de ne jamais manquer de réfléchir avant d’agir.» (L’Écho de l’Est, 23 novembre 1913.)
Les réminiscences mythologiques ont engendré parfois[p. 18] d’étranges phrases, celle-ci, par exemple: «Les femmes ne haïssent pas les mortels qui s’appuient sur le bâton de Plutus pour entrer dans les bocages d’Amathonte». (Mme Giroust de Morency [XVIIIe siècle], dans Mary Summer, Aventures d’une femme galante au XVIIIe siècle, p. 234.)
Ce qui veut tout simplement dire que les femmes ne haïssent pas les hommes qui ont recours à l’argent (dont Plutus est le dieu) pour obtenir leurs bonnes grâces (Vénus avait à Amathonte, ville de Chypre, un temple célèbre, entouré de bosquets de myrtes).
C’est ce style maniéré, tortillé et alambiqué, toujours fécond en pointes ou concetti, ce style faux, si apprécié et renommé au seizième siècle, qui a été connu en Italie sous le nom de marinisme (du poète italien Marini ou cavalier Marin), de gongorisme ou cultisme en Espagne (du poète Gongora), d’euphuïsme en Angleterre, et de style ou esprit précieux en France. (Cf. Émile Deschanel, Le Romantisme des classiques, t. V, Boileau, p. 140; C. Lévy, 1888.)
Pour conclure, n’oublions pas le sage avertissement et le vœu suprême de Paul-Louis: «Dieu, délivre-nous du malin et du langage figuré!» (P.-L. Courier, Pamphlet des pamphlets, Œuvres, p. 240; Didot, 1865; in-18.)
[p. 19]
Pierre Corneille. Concetti, Cacophonies et Calembours. Galimatias simple et Galimatias double. Vers de Corneille qu’on rencontre dans Nicole et dans Godeau. Épître à la Montauron: éloges outrés. Traduction de l’Imitation de Jésus-Christ. — Thomas Corneille. Le plus grand succès dramatique de tout le dix-septième siècle.
Rotrou. — Théophile de Viau. — Dumonin. — Pierre Du Ryer. — Jean Claveret: l’unité de lieu. — «Mourra-t-il ou Ne mourra-t-il pas?» — Napoléon Ier et A.-V. Arnault. — Crébillon le Tragique, Corneille et Racine.
Racine. Critiqué par Chapelain. Réminiscence. Remarque de Méry. Le mot «diligence». Changement de visage. Cacophonies. Un auteur de sept ans. Athalie lue par pénitence. Racine déclaré «grossier et immodeste», «ni poète ni chrétien», etc. Mort et enterrement de Racine.
Molière. Son style. Acceptions des mots flamme, cœur, main, etc. Singularités de prosodie. Anachronismes. Cacophonies. Locutions favorites de Molière. Vers de Molière qu’on rencontre dans Corneille et dans La Fontaine. L’Avare de Molière. Remarque de Sainte-Beuve.
Chez nos plus grands écrivains, on rencontre des négligences ou inadvertances de style: errare humanum est.
Tout le monde connaît la turlupinade commise, bien à son insu, par Corneille (1606-1684) dans Polyeucte (I, 1), qu’aurait enviée Tabarin, et dont je me borne à rappeler les premiers mots:
Et le désir s’accroît quand...
Non moins connu est ce pléonasme du grand Corneille (Pompée, II, 3):
Il en coûta la vie et la tête à Pompée.
Dans Mélite (I, 4), Philandre dit à Cloris, sa maîtresse:
Regarde dans mes yeux, et reconnais qu’en moi
On peut voir quelque chose aussi parfait que toi.
Et Cloris de répondre:
C’est sans difficulté, m’y voyant exprimée.
[p. 20]
Philandre reprend:
... Mon cœur...
Afin de te mieux voir, s’est mis à la fenêtre.
Dans Clitandre (IV, 1 et 2), comédie d’intrigue très embrouillée, nous voyons Dorise «crever, avec son aiguille», l’œil de Pymante, son «amoureux dédaigné», et, au lieu d’appeler au secours et de se faire soigner, Pymante se met, comme si de rien n’était, à nous débiter une tirade de deux pages, pleine de pathos et de concetti:
Où s’est-elle cachée? où l’emporte sa fuite?...
La tigresse m’échappe...
Il est de Corneille encore (Pompée, I, 2) ce vers à calembour:
Car c’est ne régner pas qu’être deux à régner,
qui a trouvé de l’écho dans un hémistiche attribué, mais à tort, paraît-il, au vicomte d’Arlincourt (1789-1856):
... On l’appelle à régner[15].
C’est à tort également, et par une erreur persistante, disons-le en passant, que nombre d’ouvrages (par exemple: Staaff, La Littérature française, t. II, p. 1046; — Gustave Merlet, Tableau de la littérature française, 1800-1815, t. I, p. 524; — Larousse, art. Arlincourt; — etc.) attribuent audit vicomte et à sa tragédie Le Siège de Paris, représentée au Théâtre-Français en 1826, les alexandrins suivants:
Mon père, en ma prison, seul à manger m’apporte.
J’habite la montagne, et j’aime à la vallée.
Ou bien, il faudrait admettre que le texte de cette tragédie a subi des remaniements avant l’impression, contrairement à ce qui est dit dans l’avant-propos du volume.
Voici ce qu’on lit dans une lettre jointe à cet avant-propos (p. X et XI):
«... On m’avait annoncé que la tragédie de M. d’Arlincourt[16] était constamment sifflée, et la salle absolument déserte: j’ai vu, à toutes les représentations où j’ai assisté, la tragédie vivement applaudie et la salle toute pleine. On m’avait soutenu que[p. 21] l’ouvrage n’offrait aucun intérêt: j’ai remarqué que, pendant les cinq actes, l’auditoire était constamment ému...
«D’après ce que j’avais lu dans les gazettes, je m’attendais à voir une héroïne dans les fers, mourant de faim, et s’écriant avec douleur:
Mon pauvre père, hélas! seul à manger m’apporte.
«L’appétit de ce pauvre père mangeant la porte d’une prison m’eût singulièrement amusé. Quel a été mon désappointement! Point d’héroïne dans les fers! Point de porte à dévorer! Point de situation à laquelle puisse convenir le vers cité! Et je viens d’apprendre que cette plaisanterie a été faite, il y a quelque douzaine (sic) d’années, sur une tragédie de M. Le Mierre.
«... J’avais appris par cœur d’autres vers de la pièce; on m’avait particulièrement désigné ceux-ci comme ayant été sifflés à la première représentation:
Mystérieux par goût, sauvage par système,
Mon cœur est un abîme, et mon âme un problème.
...................
Voilà ces chevaliers que l’on nomme les preux! (lépreux).
...................
On l’appelle à régner (araignée).
...................
Ton nom connu te perd, ton inconnu te sauve.
...................
Rien sur ses plans secrets ne peut être éclairci.
...................
J’habite la montagne, et j’aime à la vallée (à l’avaler).
...................
Enfoncé dans le crime on n’en saurait surgir.
...................
Pour chasser loin des murs les farouches Normands,
Le roi Louis s’avance avec vingt mille Francs (francs).
«Et beaucoup d’autres dans ce genre. J’ai acquis la certitude qu’ils n’ont jamais été dans l’ouvrage: est-il une seule personne raisonnable qui ait pu le penser?»
Voici, à cette occasion, quelques autres vers, cités souvent comme exemples de cacophonie, d’ambiguïté et d’étrangeté:
Dans son ode A la postérité (IV, 6, p. 362; Œuvres de Malherbe, de J.-B. Rousseau, etc., Didot, 1858), J.-B. Rousseau (1671-1741) interpelle ladite postérité et la qualifie de «Vierge non encor née»:
Vierge non encor née, en qui tout doit renaître,
vers dont le premier hémistiche est resté célèbre.
[p. 22]
Célèbre aussi et maintes fois cité, ce vers de Voltaire (1694-1778):
Non, il n’est rien que Nanine n’honore,
qui, dans les éditions posthumes, fut remplacé par celui-ci:
Non, il n’est rien que sa vertu n’honore.
(Nanine, III, 8.)
De Voltaire encore, cet autre, moins connu, mais non moins dépourvu d’euphonie:
Tout art est étranger; combattre est ton partage.
(Brutus, I, 1.)
Cet autre, encore de Voltaire:
Tu t’en vantais tantôt; tu te tais, tu frémis,
qui se trouvait dans la tragédie d’Ériphyle (V, 2), a disparu. (Cf. le Journal de la Jeunesse, Supplément, 7 juillet 1888.)
L’abbé Pellegrin (1663-1745), originaire de Marseille, avait composé une tragédie intitulée Loth, qui, dès le premier vers, tomba sous les éclats de rire des spectateurs. Le principal personnage débutait par cette touchante déclaration:
L’amour a vaincu Loth! (vingt culottes).
«Il devrait bien en donner une à l’auteur!» interrompit un plaisant, qui connaissait toute la misère de l’abbé[17].
[p. 23]
Malheureusement, l’histoire est apocryphe, assure-t-on. (Cf. B. Jullien, Thèses d’histoire, p. 412 et suiv.; et Larousse, art. Pellegrin.)
A propos de l’abbé Pellegrin, qui
Déjeunait de l’autel et soupait du théâtre,
on raconte que, comme il venait de faire représenter sa tragédie de Pélopée, et se promenait, avec un de ses amis, dans le jardin du Luxembourg, il vit à ses pieds une feuille de papier, que l’ami ramassa. Elle était remplie, du haut en bas, de la même lettre: la majuscule P y était tracée nombre de fois.
«Devinez, dit à Pellegrin son compagnon, ce que signifient toutes ces lettres?
— C’est, répondit l’abbé sans hésiter, une page d’écriture qu’un maître a donné à faire à l’un de ses élèves, et que le vent a emportée.
— Pas du tout, réplique l’autre; ces lettres sont toutes des initiales, et en voici le sens: Pélopée, pièce pitoyable, par Pellegrin, poète, pauvre prêtre provençal».
Voici encore quelques autres exemples de cacophonies et amphibologies:
Dans le récit de la prise d’une ville et du carnage qui s’ensuit:
Sur le sein de l’épouse on écrase l’époux,
nous dit l’auteur d’une tragédie jadis jouée à l’Odéon. (Cf. L’Écho de la semaine, 6 octobre 1895.)
Dans un drame espagnol (Ibid.), où l’on essaie de détourner le roi de son amitié pour un indigne favori, le duc d’Alcala, un des arguments présentés par l’auteur est celui-ci:
Jamais à ton secours Alcala vola-t-il?
Ce qui nous remémore les fameux vers d’une autre pièce dont l’action se passe aussi en Espagne, Don Japhet d’Arménie (II, 2), de Scarron (1610-1660):
Don Zapata Pascal,
Ou Pascal Zapata! Car il n’importe guère
Que Pascal soit devant, ou Pascal soit derrière;
et aussi ce vers crépitant de la tragédie de Manco-Capac, de Leblanc de Guillet (1730-1799):
Crois-tu d’un tel forfait Manco-Capac capable?
qui a aussi disparu du texte définitif. (Cf. Bachaumont, Mémoires secrets, juin 1763, p. 76, note 1; Delahays, 1859.)
[p. 24]
Et celui-ci, attribué au critique Geoffroy (1743-1814) (Encyclopédiana, p. 194; Garnier, s. d.):
Vous, ministres sacrés, non d’un Dieu, mais d’un homme.
Puis:
O Rémus, dominez sur la ville éternelle.
(Dans Quitard, Dictionnaire de rimes, p. 173.)
La vache paît en paix dans ces gras pâturages,
nous apprend le poète académicien Tissot (1768-1854), traducteur des Bucoliques (dans Tenant de Latour, Mémoires d’un bibliophile, p. 219), cacophonie qu’il supprima, pour ne plus laisser (dans la première églogue) que
Le cerf léger paîtra.
Et Viennet (1777-1868):
Sous son casque, Arbogaste avait un esprit vaste.
(Cf. Larousse mensuel, octobre 1912, p. 538.)
Et dans La Franciade du même poète (Cf. Staaff, La Littérature française, t. II, p. 606, note):
Les paysans fuyaient en emportant leurs lares.
Le Télémaque, ou du moins un fragment de ce livre, Télémaque dans l’île de Calypso, a été mis en vers par un poète du nom d’Eugène Mathieu (1821-?), qui s’est amusé, dans cette parodie, «à plier la langue française à toute sorte d’excentricités». Ainsi Calypso, reprochant au fils d’Ulysse sa froideur à son égard et sa terreur de Mentor, lui dit:
Tu te tais, tant te tient ton tuteur tortueux,
Dans d’odieux dédains des doux dons d’un des dieux!
(Cf. Staaff, ibid., t. III, p. 863.)
Nous verrons plus loin, en parlant de Victor Hugo, cette drolatique locution «comme un vieillard en sort», qui lui est faussement attribuée.
Revenons à Corneille. C’est à propos de lui que Boileau disait qu’il y avait deux espèces de galimatias: le galimatias[p. 25] simple, où l’auteur, entendant ce qu’il avait voulu dire, n’a pas suffisamment éclairci l’expression de sa pensée; et le galimatias double, où l’auteur ne s’entend pas plus lui-même qu’il n’est entendu de ses lecteurs ou auditeurs. Et, comme exemple de ce dernier genre de galimatias, Boileau racontait ce qui advint à propos des quatre vers suivants de la tragédie de Tite et Bérénice (I, 2) de Corneille, prononcés par Domitian, frère de Tite et amant de Domitie:
Faut-il mourir, madame? et, si proche du terme,
Votre illustre inconstance est-elle encor si ferme
Que les restes d’un feu que j’avais cru si fort
Puissent dans quatre jours se promettre ma mort.
Baron, qui étudiait le rôle de Domitian, se trouva embarrassé par ces quatre vers dont le sens ne lui paraissait pas très intelligible. Il alla prier Molière, qui habitait dans la même maison que lui, de vouloir bien les lui expliquer. Après les avoir lus et relus, Molière lui avoua qu’il ne les comprenait pas non plus.
«Mais attends, dit-il à Baron; M. Corneille doit venir dîner avec nous aujourd’hui, tu lui en demanderas l’explication.»
Dès que Corneille arrive, le jeune Baron lui saute au cou, selon son habitude, car il l’aimait beaucoup, et lui soumet ensuite les quatre vers dont le sens lui échappait.
Corneille les examine durant quelques instants, puis:
«Ma foi, dit-il, j’avoue que je ne les entends pas trop bien non plus; mais récite-les tout de même: tel qui ne les entendra pas les admirera.» (Cf. le Musée des familles, 1er août 1897; et Edmond Guérard, ouvrage cité, t. I, p. 504.)[18]
De même Klopstock, dans sa vieillesse, ne comprenait plus bien tous les vers de sa Messiade:
«Il faut que je commence un chant pour le comprendre, déclarait-il un jour. Si je le prends dans le courant, je ne retrouve plus le sens, et je suis obligé de remonter, pour ressaisir mon idée.» (Cf. Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire, t. II, p. 182, note 1.)
Et n’a-t-on pas attribué à Victor Hugo cette plaisante réponse:
«Lorsque j’ai écrit ces vers, il n’y avait que Dieu et moi pour les comprendre. Aujourd’hui, il n’y a plus que Dieu.» (Cf. Émile Deschanel, Le Romantisme des classiques, t. I, p. 226).
[p. 26]
Ce beau vers qu’on lit dans Tite et Bérénice (V, 1):
Chaque instant de la vie est un pas vers la mort,
se trouve textuellement dans les Essais de morale de Nicole (Cf. Corneille, Œuvres complètes, t. IV, p. 371, note 1; Hachette, 1864), et ces autres, qui se trouvent dans Polyeucte (IV, 2):
... Et, comme elle a l’éclat du verre,
Elle en a la fragilité,
sont, textuellement aussi, empruntés à Godeau, l’évêque de Grasse, qui lui-même les avait traduits de Publius Syrus:
Fortuna vitrea est: tum, quum splendet, frangitur.
(Cf. Montaigne, Essais, I, 40; t. I, p. 405, note 1, édit. Louandre.)
Voici un enjambement ou rejet rencontré dans Corneille (Le Menteur, II, 5), dont la hardiesse ne laisse pas de surprendre:
Il monte à son retour, il frappe à la porte: elle
Transit, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle.
Ajoutons qu’on cite comme exemple d’éloges outrés et de platitude la dédicace d’Horace au cardinal de Richelieu, ainsi que celle de Cinna à M. de Montauron (d’où le nom d’Épître à la Montauron donné depuis à ces flatteries exagérées et intéressées: cf. Honoré Bonhomme, Grandes Dames et Pécheresses, p. 253-254; Charavay, 1883), et que le discours de réception de Corneille à l’Académie «est un chef-d’œuvre de mauvais goût, de plate louange et d’emphase commune». (Sainte-Beuve, Portraits littéraires, t. I, p. 44; nouvelle édit., Garnier, s. d.)
De tous les ouvrages de Pierre Corneille, c’est sa traduction de l’Imitation de Jésus-Christ, dont il se fit de la première partie seulement trente-deux éditions, qui lui rapporta le plus d’argent. Lui-même nous l’apprend; il racontait que son Imitation lui avait plus valu que la meilleure de ses comédies, et qu’il avait reconnu, par le gain considérable qu’il en avait tiré, «que Dieu n’est jamais ingrat envers ceux qui travaillent pour lui». (Cf. Jules Levallois, Corneille inconnu, p. 288.)
Rappelons, à ce propos, que Thomas Corneille (1625-1709), le frère de Pierre, est, de tous les auteurs dramatiques du dix-septième siècle, celui qui obtint les plus grands succès au théâtre et y gagna le plus d’argent. Sa tragédie de[p. 27] Timocrate, jouée en 1656, et que personne ne connaît plus aujourd’hui, «fut le plus éclatant succès dramatique de tout le dix-septième siècle». (Paul Stapfer, Des Réputations littéraires, t. II, p. 252 et 286.)
«Timocrate eut quatre-vingts représentations, dit de son côté Laharpe (Lycée ou Cours de littérature, t. II, p. 273-274; Verdière, 1817): les comédiens se lassèrent de le jouer avant que le public se lassât de le voir; et ce qui n’est pas moins extraordinaire, c’est que depuis ils n’aient jamais essayé de le reprendre. Quand on essaye de le lire, on ne peut imaginer ce qui lui procura cette vogue prodigieuse... Le héros de la pièce joue un double personnage: sous le nom de Timocrate, il est l’ennemi de la reine d’Argos, et l’assiège dans sa capitale; sous celui de Cléomène, il est son défenseur et l’amant de sa fille. Il est assiégeant et assiégé; il est vainqueur et vaincu. Cette singularité, qui est vraiment très extraordinaire, a pu exciter une sorte de curiosité qui peut-être fit le succès de la pièce... Il y a peu d’auteurs dont la lecture soit plus rebutante que celle de Thomas Corneille, conclut Laharpe».
Dans une de ses pièces, sa tragi-comédie de Céliane, Rotrou (1609-1650) met en scène un amant qui se demande (II, 2); sa belle lui ayant laissé le choix de ses faveurs:
Que dois-je donc choisir, puissant maître des dieux,
De la bouche, du sein, de la joue ou des yeux?
Il choisit le sein, et, devant le public, appuie ses lèvres sur ce sein, pendant que sa maîtresse repose, étendue sur son lit. (Cf. La Fontaine, édit. des Grands Écrivains, t. IV, p. 438, note 5.)
Dans une autre pièce de Rotrou, Saint Genest (II, 2 ou 3), la comédienne Marcelle, si férue de sa beauté et de ses charmes, s’écrie:
Je foule autant de cœurs que je marche de pas.
Les beaux vers, les vers devenus proverbes, abondent chez Rotrou, particulièrement dans sa tragédie de Venceslas:
Qui veut vaincre est déjà bien près de la victoire.
(II, 2.)
L’ami qui souffre seul fait une injure à l’autre.
(III, 2.)
[p. 28]
Je dérobe au sommeil, image de la mort,
Ce que je puis du temps...
Ce que j’ôte à mes nuits je l’ajoute à mes jours.
(IV, 4.)
Etc., etc.
C’est dans Venceslas (IV, 5 ou 6) que se trouve ce vers prononcé par la duchesse Cassandre, en même temps qu’«elle tire un poignard de sa manche»:
Voyez, voyez le sang dont ce poignard dégoutte!
Ce qui rappelle le fameux cri de la Thisbé de Théophile de Viau (1590-1626):
Ah! voilà le poignard qui du sang de ton maître
S’est souillé lâchement. Il en rougit, le traître!
Citons aussi ce grotesque distique de la tragédie d’Orbecce de Dumonin (1557-1586) (Dans Philarète Chasles, Études sur le seizième siècle, p. 178):
Orbecce fréricide, Orbecce méricide!
Tu seras péricide, ainsi que fillicide!
Et cet autre distique de Pierre Du Ryer (1606-1658), dans sa tragédie de Scévole:
Ce peuple pour sa gloire, ennemi de la vôtre,
Se nourrira d’un bras et combattra de l’autre.
«Quel est le sens de ces deux vers? se demande Laharpe (Ouvrage cité, t. II, p. 272). Junie veut-elle dire que les Romains mangeront et combattront en même temps, ou bien qu’ils mangeront un de leurs bras et combattront avec l’autre? Les vers ont également ces deux sens, et sont très mauvais dans tous les deux.»
Afin de respecter l’unité de lieu, un auteur du dix-septième siècle, Jean Claveret (1590-1666), s’avisa du stratagème suivant. Dans sa tragédie Le Ravissement (l’Enlèvement) de Proserpine, où la scène est tour à tour au Ciel, en Sicile et aux Enfers, il dit que «le lecteur peut se représenter une certaine unité de lieu, en la concevant comme une ligne perpendiculaire du Ciel aux Enfers; bien entendu que cette verticale doit passer par la Sicile». Les trois «théâtres de l’action», Ciel, Sicile et Enfers, se trouvent ainsi situés dans le même plan, le même «lieu». (Cf. Sainte-Beuve, Tableau de la Poésie française au seizième siècle, p. 253; Charpentier, 1869.)
Plus tard, Rivarol (1753-1801) réduisit la tragédie à la[p. 29] simple position et solution de cette question: Mourra-t-il ou ne mourra-t-il pas? Question qui fluctue ainsi:
1er acte: il mourra.
2e acte: il ne mourra pas.
3e acte: il mourra.
4e acte: il ne mourra pas.
5e acte: il mourra.
(Cf. Staaff, La Littérature française, t. III, p. 1243.)
Napoléon était aussi d’avis que le cinquième acte d’une tragédie devait se terminer par la mort du héros. «Il faut que le héros meure! Tuez-le!» C’est le conseil qu’il donnait à A.-V. Arnault, pour sa tragédie Les Vénitiens. Le héros, Montcassin, fut donc mis à mort par ordre de l’empereur, mais la tragédie n’en valut ni plus ni moins. (Cf. Staaff, ibid., t. II, p. 386, note 1.)
A propos de la tragédie, rappelons le mot de Crébillon père relativement à son goût pour le genre terrible: «Je n’ai pas eu le choix; Corneille avait pris le ciel; Racine, la terre; il ne me restait plus que l’enfer». (Note du Gil Blas de Lesage, édit. Saint-Marc Girardin, p. 137; Charpentier, 1865.)
Lorsque Racine (1639-1699), fort jeune encore, composa l’ode La Nymphe de la Seine, à l’occasion du mariage du roi, il alla consulter Chapelain, qui releva quelques fautes dans ce poème, «entre autres, celle d’avoir mis en eau douce des tritons, divinités essentiellement salées, ce qui est une énorme incongruité mythologique». (Théophile Gautier, Les Grotesques, p. 250-251; M. Lévy, 1859.)
On cite souvent ce vers étrange d’Andromaque (I, 4), où Pyrrhus emploie le mot feux dans deux acceptions toutes différentes:
Brûlé de plus de feux que je n’en allumai.
C’est-à-dire: brûlé de plus d’amour, de passion, que je n’allumai d’incendies dans les guerres que j’ai soutenues et notamment «devant Troie». Cette pointe, selon la remarque d’Émile Deschanel (Le Romantisme des classiques, Racine, t. I, p. 110), est une réminiscence du roman grec de l’évêque Héliodore, Théagène et Chariclée, que Racine adolescent s’était tant complu à lire et à relire.
D’après le poète et romancier Joseph Méry, Racine s’est[p. 30] servi cent soixante-cinq fois du mot œil ou yeux dans cette tragédie d’Andromaque. «Vous pouvez les compter,» ajoute-t-il, (La Croix de Berny, lettre XXII, p. 219; Librairie nouvelle, 1859; où Méry se cache sous le pseudonyme de Roger de Monbert.)
Dans Les Plaideurs (I, 6), nous trouvons cet enjambement, dont plus tard les romantiques pourront s’autoriser:
Mais j’aperçois venir madame la comtesse
De Pimbesche. Elle vient pour affaire qui presse.
Racine a employé le substantif diligence (zèle, soin, promptitude) dans des vers qu’on s’est plu à interpréter comiquement:
Prince, que tardez-vous? Partez en diligence.
(Britannicus, V, 2.)
C’est-à-dire partez sans tarder, et non dans une de ces voitures publiques dites diligences.
Ah! quittez d’un censeur la triste diligence!
(Britannicus, I, 2.)
Je vais faire venir ma fille en diligence.
(Les Plaideurs, III, 1.)
Mais, comme vous savez, malgré ma diligence,
Un long chemin sépare et le camp et Byzance.
(Bajazet, I, 1.)
Déjà Corneille avait dit, dans Polyeucte (IV, 1):
Si vous me l’ordonnez, j’y cours en diligence.
Et Molière:
J’ai d’Ithaque en ces lieux fait voile en diligence.
(La Princesse d’Élide, I, 1.)
L’auteur dramatique Charles-Guillaume Étienne(1778-1845) dira de même, dans sa comédie L’Intrigante (I, 7):
Vous m’avez demandé,
J’accours en diligence.
Dans La Thébaïde ou les Frères ennemis (IV, 3), on trouve ce singulier vers:
L’un ni l’autre ne veut s’embrasser le premier,
que Littré (art. Embrasser) relève avec raison: «On s’em[p. 31]brasse l’un l’autre, mais on n’est pas le premier à s’embrasser l’un l’autre».
Épargnez votre sang, j’ose vous en prier,
Sauvez-moi de l’horreur de l’entendre crier,
lit-on dans Phèdre (IV, 4).
Le sang de nos rois crie, et n’est point écouté,
lit-on encore dans Athalie (I, 1).
Entendre le sang crier est une locution biblique que nous rencontrons dans la Genèse (IV, 10), et placée dans la bouche de Dieu même, à propos du meurtre d’Abel par Caïn: «Le sang de ton frère crie vers moi».
Dans cette même pièce de La Thébaïde (IV, 1), Racine suppose que les frères ennemis, Etéocle et Polynice, se haïssaient avant leur naissance et se battaient déjà dans le sein de leur mère:
Nous étions ennemis dès la plus tendre enfance:
Que dis-je? nous l’étions avant notre naissance.
Triste et fatal effet d’un sang incestueux!
Pendant qu’un même sein nous renfermait tous deux,
Dans les flancs de ma mère une guerre intestine
De nos divisions lui marqua l’origine.
La comtesse de Boufflers ayant un jour une lettre d’excuse à adresser à la duchesse de Polignac, au sujet d’un engagement qu’elle ne pouvait pas tenir, termina cette missive par les vers suivants, qu’elle emprunta sans le dire, et à peu près textuellement, au Britannicus de Racine (II, 3):
Tout ce que vous voyez conspire à vos désirs;
Vos jours toujours sereins coulent dans les plaisirs;
La Cour en est pour vous l’inépuisable source,
Ou si quelque chagrin en interrompt la course,
Tout le monde, soigneux de les entretenir,
S’empresse à l’effacer de votre souvenir.
«Grimm nous apprend que ces vers, lus dans la société de Mme de Polignac, furent généralement trouvés détestables: des jours toujours sereins, mauvaise consonance; — en interrompt la course, est-ce la course des plaisirs ou la course de la source? — les entretenir est bien loin du mot plaisirs, de même que l’effacer est un peu loin du mot chagrin; — et tous ces que, qui, etc. Si Mme de Boufflers avait voulu mystifier son monde, elle ne s’y serait pas prise plus adroi[p. 32]tement.» (Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, t. IV, p. 227.)
Racine écrit dans Mithridate (III, 1):
Doutez-vous que l’Euxin ne me porte en deux jours
Aux lieux où le Danube y vient finir son cours?
«Oui, assurément, j’en doute!» interrompit un soir tout haut, paraît-il, un vieux militaire qui avait guerroyé dans ces contrées-là. «Il n’avait pas tort, ajoute Laharpe (Ouvrage cité, t. II, p. 160). Aujourd’hui même que la navigation est tout autrement perfectionnée qu’elle ne l’était alors, il serait de toute impossibilité d’aller en deux jours du détroit de Caffa, qui est l’ancien Bosphore Cimmérien, à l’embouchure du Danube, qui est à l’autre extrémité de la mer Noire. C’est un trajet de près de deux cents lieues d’une navigation difficile.» D’après l’abbé Du Bos (dans Émile Deschanel, ouvrage cité, t. I, p. 310), cette objection et interruption aurait été faite par le prince Eugène en personne.
Dans Mithridate encore (III, 5) se trouve ce vers dit par Monime à Mithridate:
Nous nous aimions... Seigneur, vous changez de visage.
A une représentation de cette tragédie, où le rôle de Monime était rempli par la célèbre Adrienne Lecouvreur, et celui de Mithridate par son camarade Beaubourg, connu par sa laideur, des spectateurs, en entendant cette phrase: «Vous changez de visage», s’avisèrent de crier: «Laissez-le donc faire!» (Cf. Lorédan Larchey, L’Esprit de tout le monde [ou L’Esprit d’autrefois], Première série, p. 269.)
A propos de ce vers d’Iphigénie (V, 6):
Le soldat étonné dit que, dans une nue,...
Génin, dans ses Récréations philologiques (t. II, p. 427, note 1; Chamerot, 1858), conte avoir «entendu à la Comédie-Française déclamer ce vers de manière à faire douter s’il ne s’agissait pas plutôt d’une nourrice de Molière que d’un soldat d’Agamemnon», et il conseille de «préférer un hiatus au ridicule d’une prononciation rigoureusement exacte».
O le plus grand poltron qui jamais ait été!
s’écrie à son tour un personnage de Scarron (Jodelet, IV, 7), poltron qui peut être rapproché du susdit soldat étonné.
En 1684, le duc du Maine, âgé de quatorze ans, fils de[p. 33] Louis XIV et de Mme de Montespan, et de qui l’on publia, en 1678, les Œuvres diverses d’un auteur de sept ans, voulut faire partie de l’Académie française, et Racine fut chargé de lui transmettre, au nom de l’Académie, cette incroyable réponse:
«Lors même qu’il n’y aurait pas de place vacante, Monseigneur, il n’y a pas un académicien qui ne soit ravi de mourir pour vous en faire une».
Louis XIV eut plus de bon sens et se rebiffa devant tant d’abnégation; il déclara que le duc était trop jeune pour songer à l’Académie, et que, par conséquent, il ne fallait tuer personne pour lui en procurer l’accès. (Cf. Le Magasin pittoresque, 1835, p. 354.)
Qui croirait qu’Athalie, ce chef-d’œuvre, a été tellement mal accueilli à ses débuts, qu’on le donnait à lire par pénitence? «Dans plusieurs sociétés, on avait établi, par forme de plaisanterie, de donner pour pénitence la lecture d’un certain nombre de vers d’Athalie... Un jeune officier, condamné à lire la première scène, lut toute la pièce, et la relut sur-le-champ une seconde fois; ensuite il remercia la compagnie de lui avoir donné un plaisir auquel il ne s’attendait guère. Ce petit événement, qui fit du bruit par sa singularité,» ajoute Laharpe (Ouvrage cité, t. II, p. 241-242), amena peu à peu un changement d’opinion, et, en 1716, le Régent donna ordre de jouer Athalie, qui, cette fois, «fut applaudie avec transport».
Racine, qui est considéré chez nous comme l’emblème de la délicatesse, de l’élégance et de la pureté, a pourtant été jugé si hardi, si grossier et immodeste, que certains ont éprouvé le besoin de l’épurer. Au lieu de ces deux vers d’Alexandre le Grand (V, 3):
Aimez, et possédez l’avantage charmant
De voir toute la terre adorer votre amant,
ces pudibonds censeurs ont mis:
Aimez, et possédez l’avantage si doux
De voir toute la terre adorer votre époux.
Dans Les Plaideurs (II, 9), ils n’ont pas manqué de supprimer le mot bâtard et de le remplacer par fils:
Monsieur, je suis le fils de votre apothicaire.
Dans Esther (I, 1), au lieu de:
[p. 34]
Lorsque le roi, contre elle enflammé de dépit,
La chassa de son trône ainsi que de son lit,
estimant le mot lit trop suggestif, ils ont écrit:
Lorsque le roi, contre elle enflammé sans retour,
La chassa de son trône ainsi que de sa cour.
(Cf. Edmond Texier, Les Choses du temps présent, p. 202-204; Hetzel, 1862.)
Il y a eu mieux encore. On s’est avisé, au dix-septième siècle, de se demander si Racine était vraiment poète et s’il était vraiment chrétien, et la réponse fut deux fois négative. «Les Jésuites... en 1673, soumirent à un examen le génie et la religion de Racine. Il fut question de savoir s’il était poète et chrétien: le public fut invité à cette discussion, et des enfants dressés par le jésuite Soucié (ou Souciet) la terminèrent en décidant que l’auteur immortel de Phèdre et d’Athalie n’était ni poète ni chrétien, nec poeta nec christianus.» (Vie de Voltaire, chap. II, p. 17-18, en tête de ses Œuvres, édit. de Kehl.)
Il est vrai que, plus tard, il a été traité de «polisson» et de «vieille botte»: le premier de ces qualificatifs lui a été donné, paraît-il, par Frédéric Soulié (Cf. Le Temps, 1er décembre 1912, art. signé Paul Zahori; — cf. aussi Théophile Gautier, Les Jeunes-France, Daniel Jovard, p. 90; Charpentier, 1879: «Ce polisson de Racine, si je le rencontrais, je lui passerais ma cravache à travers le corps»); — la seconde épithète est d’Auguste Vacquerie (Profils et Grimaces, p. 17: «... Les bottes neuves gênent le pied, les idées neuves gênent l’intelligence. Le drame est tout neuf, Racine est une vieille botte.»)
Terminons par cette plaisante remarque d’un contemporain de Racine. Celui-ci, comme on sait, était «grand courtisan, détestait les jésuites, et évitait cependant d’en dire du mal par précaution. Lorsqu’il mourut et qu’on sut qu’il avait demandé à être enterré chez les solitaires de Port-Royal, le comte de Roussy dit aussitôt: «Racine ne s’y serait certainement pas fait enterrer de son vivant». (Cf. l’abbé de Voisenon, Anecdotes littéraires, p. 36; Librairie des bibliophiles, 1880; — et Eugène Muller, Curiosités historiques et littéraires, p. 264; Delagrave, 1897.)
Les bizarreries de style et les vers négligés ou étranges et aussi les cacophonies abondent chez Molière (1622-1673), à tel point que Théophile Gautier s’amusait à dire que «comme tapissier, le Poquelin avait peut-être quelque mérite, mais, comme poète, c’est un pleutre que nous aurions sifflé s’il eût apparu en 1830». (Cf. Le National, 9 janvier 1887.)
Et Flaubert de lui riposter sur le même ton:
«Je te trouve sévère. Je conviens que Molière a des torts, mais il y a, dans Le Malade imaginaire (acte II, 2e intermède), une phrase de génie, qui fait de lui un écrivain de vaste envergure: Plusieurs Égyptiens et Égyptiennes, vêtus en Mores, font des danses mêlées de chansons. Ça, c’est un diamant!» (Ibid.)
Théophile Gautier a d’ailleurs manifesté plusieurs fois, et en termes véhéments ou très crus, sa profonde antipathie pour Molière: «Mon opinion sur Molière et Le Misanthrope? Eh bien, ça me semble infect. Je vous parle très franchement: c’est écrit comme un c...!» Etc. (Goncourt, Journal, année 1857, t. I, p. 170.)
Fénelon, La Bruyère, Vauvenargues se sont également montrés peu tendres pour Molière:
«En pensant bien, il parle souvent mal; il se sert des phrases les plus forcées et les moins naturelles. Térence dit en quatre mots, avec la plus élégante simplicité, ce que celui-ci ne dit qu’avec une multitude de métaphores qui approchent du galimatias», etc. (Fénelon, Lettre sur les occupations de l’Académie, VII, p. 70-71; édit. Despois.)
«Il n’a manqué à Molière que d’éviter le jargon et le barbarisme et d’écrire purement.» (La Bruyère, Caractères, Des ouvrages de l’esprit, p. 22; édit. Hémardinquer.)
«On trouve dans Molière tant de négligences et d’expressions bizarres et impropres, qu’il y a peu de poètes, si j’ose le dire, moins corrects et moins purs que lui.» (Vauvenargues, Œuvres choisies, p. 312; Didot, 1858, in-18.)
Le critique Edmond Scherer a publié, dans le journal Le Temps du 19 mars 1882 (Cf. Georges Lafenestre, Molière, p. 173; — Robert de Bonnières, Mémoires d’aujourd’hui, 2e série, p. 67 et suiv.; — La Gazette anecdotique du 31 mars 1882; — etc.), un article demeuré célèbre, portant pour titre Une Hérésie littéraire, et des plus durs pour Molière. Ce[p. 36] qu’il y a de plus curieux peut-être, c’est qu’en reprochant à Molière de mal écrire, Scherer tombe dans le même défaut. Voici la conclusion de son article, qui a été souvent citée comme exemple de mauvais style et de drôlerie: «Il n’y a pas moyen de se dérober à la conviction que notre grand comique est aussi mauvais écrivain qu’on peut l’être, lorsqu’on a, du reste, les qualités de fond qui dominent tout.» Un fond qui domine tout? Scherer cite nombre de passages obscurs de Molière, ces phrases de Célimène, entre autres (Le Misanthrope, IV, 3):
Et, puisque notre cœur fait un effort extrême
Lorsqu’il peut se résoudre à confesser qu’il aime,
Puisque l’honneur du sexe, ennemi de nos feux,
S’oppose fortement à de pareils aveux,
L’amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle,
Doit-il impunément douter de cet oracle?
Mais ne peut-on admettre que l’obscurité de ces vers (qui, antérieurement au Misanthrope, se trouvent dans Garcie de Navarre, III, 1) est voulue, et que c’est ainsi que la coquette Célimène doit et entend exprimer sa pensée?
Il ne faut pas oublier non plus que Molière n’est pas un auteur de cabinet, travaillant tranquillement, à son aise et à ses heures; il improvisait souvent, allait plus vite qu’il ne l’aurait voulu, et sa prose comme ses vers sont faits pour être débités sur la scène, plutôt que lus et savourés à loisir.
Il ne paraît pas se préoccuper des répétitions de mots. Ainsi, dans Le Misanthrope, la préposition pour se trouve à certain endroit (III, 5 ou 7), répétée cinq fois en cinq vers:
Pour moi, je voudrais bien que, pour vous montrer mieux,
Une charge à la cour vous pût frapper les yeux.
Pour peu que d’y songer vous nous fassiez les mines,
On peut, pour vous servir, etc...
D’autres vers de Molière nous arrêtent encore, voire nous déconcertent; ceux-ci de Tartuffe (V, 3), par exemple:
Je voudrais, de bon cœur, qu’on pût entre vous deux
De quelque ombre de paix raccommoder les nœuds.
Et ceux-ci, encore de Tartuffe (V, scène dernière):
Et par un doux hymen couronner en Valère
La flamme d’un amant généreux et sincère.
Couronner une flamme est certainement pour nous une singulière locution; mais nous trouvons, au dix-septième siècle,[p. 37] et même plus tard, le mot flamme accouplé à bien des verbes qui ne lui conviendraient plus aujourd’hui:
Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme,
Ou de vivre en infâme.
(Corneille, Le Cid, I, 7.)
Vous savez pour la paix quels vœux a faits ma flamme.
(Id., Horace, I, 2.)
Qu’est-ce-ci, mes enfants? écoutez-vous vos flammes?
Et perdez-vous encor le temps avec des femmes?
(Id., ibid., II. 7.)
Mais ces chaînes du ciel qui tombent sur nos âmes
Décidèrent en moi le destin de leurs flammes.
(Molière, Don Garcie de Navarre, I, 1.)
Des chaînes qui décident un destin?
Seigneur, il est trop vrai qu’une flamme funeste
A fait parler ici des feux que je déteste.
(Crébillon, Rhadamiste et Zénobie, I, 2.)
Une flamme qui fait parler des feux?
On lit dans Le Misanthrope (V, 7):
Pourvu que votre cœur veuille donner les mains
Au dessein que j’ai fait de fuir tous les humains.
Un cœur qui donne les mains: voilà encore un étrange style, mais dont nous trouvons plus d’un exemple antérieur au dix-neuvième siècle:
«La gloire n’est due qu’à un cœur qui sait... fouler aux pieds les plaisirs.» (Fénelon, Télémaque, I, p. 6; édit. Colincamp.)
«Tel est l’homme, ô mon Dieu, entre les mains de ses seules lumières.» (Massillon, Sermon pour le 4e dimanche de l’Avent; dans Molière, édit des Grands Écrivains, t. V, p. 549, note 2.)
Ne lit-on pas d’ailleurs dans la Bible (Proverbes, XVIII, 21): «La mort et la vie sont aux mains de la langue»?
Du temps de Molière aussi bien que de Massillon, les acceptions du mot main étaient bien plus étendues qu’aujourd’hui (Cf. Littré). Gaston Boissier, si imbu de l’antiquité et qui connaissait si bien nos classiques, a écrit (Dans Le XIXe Siècle, 28 janvier 1894): «Un grand écrivain laisse après lui quelque[p. 38] chose de plus durable que ses écrits mêmes, c’est la langue dont il s’est servi, qu’il a assouplie et façonnée à son usage, et qui, même maniée par d’autres mains, garde toujours quelque trace du pli qu’il lui a donné».
De Molière encore (Les Précieuses ridicules, sc. 9):
«Cathos. — Votre cœur crie avant qu’on l’écorche.
Mascarille. — Il est écorché depuis la tête jusqu’aux pieds.»
Métaphore ou catachrèse qu’on peut rapprocher de celle de Marivaux: «Frappez fort, mon cœur a bon dos.» (Cf. Molière, édit. des Grands Écrivains, t. II, p. 98, note 1)[19].
«On ne peut néanmoins douter, dit très justement une note de l’édition de Molière des Grands Écrivains (t. VIII, p. 284, note 2, a), que parfois, dans l’emploi de ces locutions mêmes, l’incohérence des termes rapprochés était cherchée et rendue fort sensible pour produire un effet plaisant, témoin cette phrase de Sganarelle: «Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu’il n’en paye les pots cassés» (Le Médecin malgré lui, III, 1), et ces vers de Benserade, adressés, dans le Ballet des Muses, à Mlle de la Vallière:
Je baise ici les mains à vos beaux yeux
Et ne veux point d’un joug comme le vôtre.»
Dans Psyché (I, 1):
Un souris (sourire) chargé de douceurs
Qui tend les bras à tout le monde,
Et ne vous promet que faveurs.
Dans Le Dépit amoureux (I, 4):
... Ma langue, en cet endroit,
A fait un pas de clerc dont elle s’aperçoit.
Dans Le Sicilien (sc. 2): «Il fait noir comme dans un four.[p. 39] Le ciel s’est habillé ce soir en Scaramouche, et je ne vois pas une étoile qui montre le bout de son nez».
Dans le prologue du Malade imaginaire: «Le théâtre représente un lieu champêtre, et néanmoins fort agréable». Ce néanmoins nous prouve combien la campagne et les beautés de la nature étaient alors peu appréciées.
Voici encore quelques bizarres tournures de phrases de Molière:
Le poids de sa grimace, où brille l’artifice,
Renverse le bon droit, et tourne la justice.
(Le Misanthrope, V, 1.)
Qu’un cœur de son penchant donne assez de lumière,
Sans qu’on nous fasse aller jusqu’à rompre en visière.
(Ibid., V. 2.)
Et leur langue indiscrète, en qui l’on se confie,
Déshonore l’autel où leur cœur sacrifie.
(Le Tartuffe, III, 4.)
Etc., etc.
Les fautes ou singularités de prosodie sont fréquentes aussi chez Molière. Il ne se fait aucun scrupule, par exemple, de ne pas élider les e muets et de les compter pour une syllabe: sans doute on n’était pas, de son temps, aussi strict sur ce point qu’on l’est devenu depuis:
Anselme, mon mignon, crie-t-elle à toute heure.
(L’Étourdi, I, 5.)
La partie brutale alors veut prendre empire.
(Le Dépit amoureux, IV, 2.)
Et tout le changement que je trouve à la chose,
C’est d’être Sosie battu.
(Amphitryon, I, 2.)
Ici, au contraire, l’e muet n’est pas compté:
A la queue de nos chiens, moi seul avec Drécar.
(Les Fâcheux, II, 6 ou 7.)
Dans Sganarelle (sc. 21), le mot honneur rime avec lui-même:
Guerre, guerre mortelle à ce larron d’honneur
Qui sans miséricorde a souillé notre honneur.
[p. 40]
Dans la même pièce (sc. 23), trois rimes féminines se suivent:
... La promesse accomplie
Qui vous donna l’espoir de l’hymen de Clélie,
Très humble serviteur à Votre Seigneurie.
Il est vrai que ces trois rimes sont ici «très expressives» et font fort bon effet à la scène. (Cf. Molière, édit. des Grands Écrivains, t. II, p. 214, note 4.)
Dans le prologue d’Amphitryon, presque au début, nous rencontrons deux rimes masculines de suite: venir et pas, las.
Notons ce curieux anachronisme dans Amphitryon (II, 5): Sosie et son épouse Cléanthis, bien que en contact avec Jupiter et Mercure, nous parlent «du diable» à plusieurs reprises:
Nous donnerions tous les hommes au diable.
Et (III, 10):
Et je ne vis de ma vie
Un dieu plus diable que toi.
Etc., etc.
Comme exemples de cacophonie chez Molière, nous citerons:
Ce sont soins superflus.
(L’Étourdi, IV, 3.)
... Une affaire aussi qui m’embarrasse assez.
(Le Dépit amoureux, II, 1.)
Et plusieurs qui tantôt ont appris...
(Sganarelle, sc. 16.)
Tout ce que son cœur sent, sa main a su l’y mettre.
(L’École des Femmes, III, 4.)
Je suis assez adroit...
(Le Misanthrope, III, 1.)
Et suis huissier à verge...
(Le Tartuffe, V, 4.)
Qui le rend en tout temps si content...
(Les Femmes savantes, I, 3.)
D’être baissé sans cesse aux soins matériels.
(Ibid., II, 7.)
Parmi les locutions favorites de Molière, nous signalerons:
Plaisant: «Je vous trouve plaisant de...». (Le Misanthrope,[p. 41] IV, 3; — Les Femmes savantes, I, 2; V, 2; — Le Malade imaginaire, III, 3 et 4; — Etc.)
Impertinent, e: «C’est un impertinent, une impertinente... Voilà une coutume bien impertinente;» — Etc. (La Critique de l’École des Femmes, sc. 5 et 7; — Le Médecin malgré lui, I, 2; II, 9; — Le Malade imaginaire, I, 9; II, 6 et 7; III, 3; — Etc.)
Pendard, pendarde: «Ces pendardes-là.» (Les Précieuses ridicules, sc. 4.) «Comment, pendard, vaurien...» (Les Fourberies de Scapin, I, 4 et 6; II, 5, 7, 11; III, 3, 6, 7; — Le Malade imaginaire, II, 2; — Etc.)
Le plus... du monde: «La plus belle personne du monde... La plus amoureuse du monde...» Etc. (La Critique de l’École des Femmes, sc. 1, 2 et 3; — Le Médecin malgré lui, I, 5; III, 1 et 11: «La plus grande joie du monde»; — Le Bourgeois gentilhomme, III, 7, 9, 19; IV, 5; — Le Malade imaginaire, II, 6; — Etc.)
Etc., etc.
Ce vers de L’École des Femmes (II, 6):
Je suis maître, je parle; allez, obéissez,
se trouve textuellement dans Corneille (Sertorius, V, 6), et cet autre de Tartuffe (III, 3):
Ah! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme,
se retrouve encore, sauf un seul mot, dans la même pièce de Corneille (IV, 1):
Ah! pour être Romain, je n’en suis pas moins homme.
Cet autre vers de Tartuffe (V, 3):
Je l’ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu,
ressemble beaucoup à celui-ci de La Fontaine (Fables, IX, 1):
Mais enfin je l’ai vu, vu de mes yeux, vous dis-je.
Le sonnet de l’abbé Cotin, que Molière a introduit dans Les Femmes savantes (III, 2), débute par un vers:
Votre prudence est endormie,
qui se rapproche de près de ce vers de Corneille (Nicomède, III, 2):
Ma prudence n’est pas tout à fait endormie.
[p. 42]
Les personnes qui estiment que le théâtre peut corriger les mœurs: castigat ridendo... auraient été bien déçues si elles avaient entendu ce grippe-sou dont nous parle Laharpe (Ouvrage cité, t. II, p. 300), qui, au sortir d’une représentation de L’Avare, déclarait, et en toute bonne foi, «qu’il y avait beaucoup à profiter dans cet ouvrage, et qu’on en pouvait tirer d’excellents principes d’économie».
Sainte-Beuve, dans ses Nouveaux Lundis (t. V, p. 275-276), fait une curieuse remarque, à propos d’une pièce de Molière. «Sait-on, demande-t-il, quelle est la pièce en cinq actes, avec cinq personnages principaux, trois surtout qui reviennent perpétuellement, dans laquelle deux d’entre eux, les deux amoureux, qui s’aiment, qui se cherchent, qui finiront par s’épouser, n’échangent pas, durant la pièce, une parole devant le spectateur, et n’ont pas un seul bout de scène ensemble, excepté à la fin pour le dénouement? Si l’on proposait la gageure à l’avance, elle semblerait presque impossible à tenir. Cette gageure, Molière l’a remplie et gagnée dans L’École des Femmes, et probablement sans s’en douter. Horace et Agnès ne se rencontrent en scène qu’au cinquième acte.»
«Il y a, ajoute Sainte-Beuve en note, une autre pièce très connue, où les amoureux ne se rencontrent aussi qu’à la fin: c’est Le Méchant de Gresset.»
[p. 43]
Ronsard. — Desmarets de Saint-Sorlin. — Du Bartas. Sa gloire «sans rivale». — Malherbe. Une ode qui arrive trop tard. — Scudéry.
La Fontaine. Ses inadvertances. Emploi du mot femme. Dédicaces hyperboliques. Libertés scéniques. Irrégularités de prosodie. Cacophonies. Fréquence de la rime hommes et nous sommes. Orthographe de La Fontaine.
Boileau. — Regnard. Ses emprunts à Molière. — Crébillon le Tragique. La cheville «en ces lieux». — L’abbé Desfontaines. — Piron. Un acteur qui se poignarde d’un coup de poing. — La Chaussée.
Afin de procéder autant que possible, mais cela ne se pourra pas toujours, par ordre chronologique, nous allons rétrograder quelque peu et remonter à Ronsard (1524-1585), qui, comme on sait, se plaisait aux accouplements de mots, qualifiait la toux de ronge-poumon, Apollon de porte-perruque, Bacchus de nourri-vigne et aime-pampre, etc.
Ces juxtapositions ont d’ailleurs été fréquentes au seizième siècle et même plus tard. «Votre esprit aime-vers... Cyprine dompte-cœur...», écrit, dans sa comédie Le Visionnaire (II, 4), Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676), qui, en plus d’un endroit, a imité Ronsard.
Dans la préface de son poème La Franciade, Ronsard (Œuvres complètes, t. III, p. 31, édit. Blanchemain) recommande d’employer de préférence certaines lettres: «Je veux t’avertir, lecteur, de prendre garde aux lettres; et feras jugement de celles qui ont le plus de son, et de celles qui en ont le moins. Car A, O, U et les consonnes M, B, et les SS finissant les mots, et sur toutes les RR, qui sont les vraies lettres héroïques, sont une grande sonnerie et batterie aux vers.»
Le poète du Bartas (1544-1590), qui, de son vivant, a joui de la plus grande réputation, d’«une gloire sans rivale», dont les œuvres ont été traduites dans presque toutes les langues de[p. 44] l’Europe (Cf. La Grande Encyclopédie, art. Du Bartas), est peut-être celui qui, après nos décadents, symbolistes et naturistes, nous fournirait le plus de vers bizarres et drolatiques. On sait que, pour exprimer le galop du cheval, il commençait par galoper lui-même dans sa chambre[20]:
Le champ plat bat, abat, destrape, grape, attrape
Le vent qui va devant...
Il recherche, avant tout, l’harmonie imitative; redouble, au besoin, certaines syllabes, écrit pé-pétiller, ba-battre, flo-flottant, au lieu de pétiller, battre, flottant. Le soleil est pour lui le duc des chandelles; les vents sont les postillons d’Éole. Sa muse, comme celle de Ronsard et encore plus, «en français parle grec et latin»:
Apollon porte-jour; Herme guide-navire;
Mercure échelle-ciel, invente-art, aime-lyre...
La guerre vient après, casse-lois, casse-mœurs,
Rase-forts, verse-sang, brûle-autels, aime-pleurs.
Etc., etc.
On connaît sa curieuse description de l’alouette et de son gazouillement:
La gentille alouette, avec son tire-lire,
Tire l’ire à l’iré, et tire-lirant tire
Vers la voûte du ciel, etc.
(Cf. Sainte-Beuve, Tableau de la poésie française au seizième siècle, p. 99 et passim; et Philomneste [Gabriel Peignot], Le Livre des singularités, p. 344).
Dans Malherbe (1555-1628), pourtant si minutieux et si difficile, nous relevons ces métaphores disparates (Ode au roi Louis XIII, 1627):
[p. 45]
Prends ta foudre, Louis, et va comme un lion
Donner le dernier coup à la dernière tête
De la rébellion.
Malherbe écrit à Racan (Œuvres de Malherbe, p. 180; Didot, 1858, in-18): «... Je ne trouvais que deux belles choses au monde, les femmes et les roses, et deux bons morceaux, les femmes et les melons. C’est un sentiment que j’ai eu dès ma naissance...»
«Dès ma naissance» est sans doute exagéré.
Malherbe avait le travail très difficile; il disait que quand on avait écrit cent vers ou deux feuilles de prose, il fallait se reposer dix ans. Il «barbouilla» une fois une demi-rame de papier pour corriger une seule stance (une des stances de l’ode à M. le duc de Bellegarde, celle qui commence par ce vers: Comme en cueillant une guirlande). Il consacra trois ans à l’ode destinée à consoler le premier président de Verdun de la mort de sa femme, et, quand il eut terminé et lui apporta ce bijou, le président était remarié. (Cf. Tallemant des Réaux, Les Historiettes, t. I, p. 183; Techener, 1862.)
Entre autres rodomontades et drôleries du poète tragi-comique Scudéry (1601-1667), on cite ces phrases de sa première comédie Lygdamon, où, pour s’excuser des fautes de style qu’il a pu commettre, il écrit: «J’ai compté plus d’années parmi les armes que d’heures dans mon cabinet; j’ai usé plus de mèches en arquebuses qu’en chandelles, et sais mieux ranger les soldats que les paroles... Je suis sorti d’une maison où l’on n’avait jamais eu de plume qu’au chapeau... Je veux apprendre à écrire de la main gauche, afin d’employer la droite plus noblement.» Dans cette pièce de Lygdamon, un amoureux dit tendrement à sa belle:
Pouvez-vous voir de l’eau sans penser à mes larmes?
et affirme que le vent de ses soupirs courbe les arbres de la contrée. (Cf. Émile Deschanel, Le Romantisme des classiques, t. I, p. 144; — et Larousse, art. Scudéry.)
La Fontaine (1621-1695), parlant, dans la Vie d’Ésope le Phrygien qu’il a placée en tête de ses fables, de la Vie d’Ésope écrite par le moine Planude, dit que cette biographie doit être crue, parce que Planude était à peu près contemporain d’Ésope:[p. 46] «Planude vivait dans un siècle où la mémoire des choses arrivées à Ésope ne devait pas être encore éteinte». Or, entre Ésope, mort 500 ans avant J.-C., et le moine Planude, qui vivait au quatorzième siècle, on voit qu’il y a un intervalle de plus de dix-huit siècles. (Cf. La Fontaine, édit. des Grands Écrivains, t. I, p. 29.)
Plusieurs fables de La Fontaine renferment des inadvertances et sont entachées d’erreurs.
Dans la première de ces fables, La Cigale et la Fourmi (imitée d’Ésope), il y a, pour ainsi dire, autant de lapsus ou de bévues que de mots. «La fourmi n’amasse aucune provision pour l’hiver, ni mil, ni vermisseau, attendu qu’elle n’en a pas besoin, et qu’elle passe sagement cette saison à dormir, comme l’ours et la marmotte; partant, elle n’a jamais rien eu à refuser à la cigale, qui d’ailleurs ne lui a jamais rien demandé, attendu qu’il n’y a pas de cigales en hiver, et que la cigale n’attend pas pour disparaître que la bise soit venue.» (Toussenel, Le Monde des oiseaux, chap. 2, t. I, p. 62; édit. de 1853.)
A deux reprises (Le Chat et le Rat, VIII, 22; et Les Souris et le Chat-Huant, XI, 9), La Fontaine a fait du hibou «l’époux de la chouette», lorsque, selon les zoologistes, le hibou désigne un oiseau d’une espèce tout autre que la chouette (Cf. La Fontaine, édit. des Grands Écrivains, t. II, p. 326, note 13; et t. III, p. 162, note 5.)
Ailleurs (La Souris métamorphosée en Fille, IX, 7), le rat devient le mari, le mâle, de la souris.
Ce qui n’a pas empêché Chateaubriand de déclarer que La Fontaine était «notre plus grand naturaliste». (Cf. Eugène Noël, La Vie des fleurs, p. 71; Hetzel, s. d.)
Dans la fable La Chatte métamorphosée en Femme (II, 18), l’auteur nous dit que la chatte «ayant changé de figure», étant devenue femme,
Les souris ne la craignaient point,
les souris ne se sauvaient pas en l’apercevant. Ce qui est manifestement faux, les souris s’enfuyant à l’approche de qui que ce soit, au moindre bruit.
Dans Le Meunier, son Fils et l’Ane (III, 1), au lieu d’avoir la peine de marcher, et
Afin qu’il fût plus frais et de meilleur débit,
l’âne est d’abord suspendu par les pieds, à un bâton sans doute, et, la tête en bas, porté «comme un lustre», ce qui[p. 47] devait être passablement mais très sûrement incommode pour lui, et ne devrait pas lui permettre de dire «qu’il goûtait fort cette façon d’aller».
Le Lièvre et la Perdrix (V, 17):
Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte.
Pourquoi mourir? Ce lièvre, poursuivi par les chiens, est fatigué, essoufflé, recru: ce n’est pas une raison pour mourir.
La femme du lion mourut,
écrit La Fontaine, dans Les Obsèques de la Lionne (VIII, 14), pour désigner la femelle du lion, et cette locution apparaît ailleurs encore sous la plume du grand fabuliste (même fable, plus bas; et II, 2). Et
Deux coqs vivaient en paix...
Il (ce coq) eut des femmes en foule.
(Les Deux Coqs, VII, 13.)
La même métaphore se retrouve dans Chateaubriand (Voyage en Amérique, volume intitulé Atala, p. 346; Didot, 1871): «Le castor est jaloux, et tue quelquefois sa femme pour cause ou soupçon d’infidélité».
Et Mérimée, dans une de ses Lettres à Panizzi (t. II, p. 225): «Mme de Montebello se promenait un jour au bois de Boulogne avec une chienne de chasse non muselée. Un des gardes veut confisquer sa bête, qui était en contravention. Mme de Montebello lui dit, avec les yeux tendres que vous lui connaissez: «Ah! monsieur, mais c’est la femme du chien de l’empereur!»
De même La Fontaine nous parle des doigts du chat, pour ses griffes (IX, 17); un rossignol tombe dans les mains d’un milan (IX, 18); le rat prend l’œuf entre ses bras (X, 1); etc. «Le bonhomme» humanise ainsi tout ce dont il nous entretient, finit par confondre tout à fait la nature animale avec la nature humaine.
Les Deux Pigeons (IX, 2): On peut se demander pourquoi le pigeon, qui aime tant son camarade et se désole si fort de le voir partir, ne s’en va pas avec lui, puisque
L’absence est le plus grand des maux,
et que rien ne le retient au logis.
Voltaire (Dictionnaire philosophique, art. Calebasse; Œuvres complètes, t. I, p. 208, édit. du journal Le Siècle) et Diderot (Jacques le Fataliste, p. 281; édit. Jannet-Picard) ont[p. 48] montré tout ce qu’il y avait de faux dans la fable Le Gland et la Citrouille (IX, 4; imitée de Tabarin). Garo, qui, chez nous, semble avoir tort de trouver que la citrouille serait mieux pendue
A l’un des chênes que voilà,
aurait eu raison dans les contrées tropicales où d’énormes noix de coco poussent sur de très grands arbres.
Il ne faut jamais dire aux gens:
«Écoutez un bon mot, oyez une merveille.»
Savez-vous si les écoutants
En feront une estime à la vôtre pareille?
(Les Souris et le Chat-huant, XI, 9.)
Très sage précepte, mais que notre fabuliste n’a pas toujours observé, et auquel du reste il n’est pas toujours facile de s’astreindre. Voici...
Une histoire des plus gentilles...
(Testament expliqué par Ésope, II, 20.)
Dans ses dédicaces aux puissants de la terre, ou quand il s’adresse à eux, La Fontaine, à l’exemple d’ailleurs de la plupart des écrivains de son temps, use et abuse des plus hyperboliques adulations:
«Nous n’avons plus besoin de consulter ni Apollon ni les Muses, ni aucune des divinités du Parnasse, écrit-il au duc de Bourgogne, alors âgé de douze ans: elles se rencontrent toutes dans les présents que vous a faits la nature, et dans cette science de bien juger les ouvrages de l’esprit, à quoi vous joignez déjà celle de connaître toutes les règles qui y conviennent.» (Fables, livre XII, Dédicace à Mgr le duc de Bourgogne.)
Je voudrais pouvoir dire en un style assez haut
Qu’ayant mille vertus vous n’avez nul défaut.
(Philémon et Baucis, in fine),
déclare-t-il au duc de Vendôme, un cynique débauché.
Et cet «encens» néanmoins, si grossier qu’il fût, notre poète estimait «qu’il avait le secret de le rendre exquis». (Fables, Daphnis et Alcimadure, XII, 26.)
Nous avons vu, dans Rotrou, un acteur baiser le sein de sa maîtresse sur la scène; les mêmes libertés de gestes se retrouvent dans le théâtre de La Fontaine, où, à plus d’une[p. 49] reprise (L’Eunuque, IV, 1, 8, etc.), nous lisons des jeux de scène comme ceci:
«Chrémès, lui voulant mettre la main au sein...
«Pythie, se retirant, et repoussant sa main...»
Et je vous fais grâce du texte.
Voyez aussi, de La Fontaine, Clymène, comédie en un acte (vers la fin), et Ragotin ou le Roman comique, comédie en cinq actes, où des scènes des plus grossières, des plus ordurières (II, 11; III, 7; etc.) rappellent absolument Tabarin et les anciennes farces de la foire. Rien ne démontre mieux que ces hardiesses, ces «inconvenances», combien nos mœurs diffèrent de celles du grand siècle.
Lorsque La Fontaine fit représenter sa comédie Le Florentin, que Voltaire place cependant «au-dessus de la plupart des petites pièces de Molière», il ne laissait pas, raconte-t-on, de demander, dans la salle même du théâtre, — mais était-ce sérieusement ou en plaisantant? «Quel est donc le malotru qui a fait cette rapsodie?» (Cf. La Fontaine, édit. des Grands Écrivains, t. VII, p. 400; — et Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, livre I, chap. 3; t. I, p. 40; Hachette, 1858.)
Nous retrouvons, chez La Fontaine, des incorrections de prosodie analogues à celles que nous avons signalées chez Molière. Dans la fable Le Vieillard et ses enfants (IV, 18), on rencontre, presque au début, trois rimes masculines qui se suivent (enfants, appelait, parlait). Dans la fable Les Lapins (X, 14 ou 15), guides (au pluriel: certaines éditions mettent le singulier, quoique le sens de la phrase exige le pluriel, employé par La Fontaine) rime avec solide (au singulier). Dans la fable Le Corbeau, la Gazelle, etc. (XII, 15), quatre rimes masculines se suivent: imparfaitement, infiniment, autrement, firmament; et un peu plus loin, dans la même fable, nous rencontrons encore trois rimes du même genre: tourmentant, instant et comment.
Les cacophonies sont assez fréquentes chez La Fontaine comme chez Molière:
«... Je suis sourd, les ans en sont la cause.» (Fables, VII, 16.)
«... Tous sont de son domaine.» (VIII, 1.)
«... Parcourant sans cesser ce long cercle de peines.» (X, 2.).
«... Ayant au haut cet écriteau.» (X, 14.)
«Ces soins sont superflus.» (XII, 8.)
«Quand il en aurait eu, ç’aurait été tout un.» (XII, 12.)
[p. 50]
«Là, tout l’Olympe en pompe eût été vu.» (XII, 15.)
Etc., etc.
Pour les nécessités de la mesure ou de la rime, La Fontaine écrit tartufs (tartuffes), respec (respect), circonspec (circonspect) (IX, 14; — X, 8 et 12); etc.
Dans L’Abbesse malade (Contes, IV, 2) se trouve un e muet non élidé, qui ne compte pas pour une syllabe:
A moins enfin qu’elle n’ait à souhait
Compagnie d’homme. Hippocrate ne fait
Choix de ses mots...
«C’est prendre avec la prosodie une liberté bien grande», remarque ici l’édition des Grands Écrivains (t. V, p. 309, note 1).
Notons enfin que La Fontaine, comme nombre de poètes d’ailleurs, Victor Hugo, par exemple, se plaît à faire rimer hommes avec sommes (nous sommes, dans le siècle où nous sommes): quand l’un de ces mots apparaît à la fin d’un vers, on est à peu près certain que l’autre ne va pas tarder à se montrer:
Mais ne bougeons d’où nous sommes:
Plutôt souffrir que mourir,
C’est la devise des hommes.
(Fables, I, 16.)
...............
Peut servir de leçon à la plupart des hommes.
Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes.
(II, 13.)
De tout temps les chevaux ne sont nés pour les hommes,
Et l’on ne voyait point, comme au siècle où nous sommes,
...................
(IV, 13.)
.................
Souvent pour des sujets même indignes des hommes:
Il semble que le ciel sur tous tant que nous sommes
.................
(VIII, 5.)
... et, tous tant que nous sommes,
..............
Et l’on ne peut l’apprendre aux hommes.
(VIII, 7.)
[p. 51]
Souffrir ce défaut aux hommes!
Mais que tous, tant que nous sommes,
.............
(IX, 1.)
Et X, 1, 2, et 10; — XII, 13,15; — Etc.
«C’est un malheur de notre poésie, a dit Chamfort (dans La Fontaine, édit. des Grands Écrivains, t. III, p. 249, note 7), que, dès qu’on voit le mot hommes à la fin d’un vers, on puisse être sûr de voir arriver à la fin de l’autre vers, où nous sommes ou bien tous tant que nous sommes. L’habileté de l’écrivain consiste à sauver cette misère de la langue par le naturel et l’exactitude de la phrase où ces mots sont employés.»
On trouvera dans l’édition des Grands Écrivains (t. VII, p. 596 et suiv.), dans la tragédie d’Achille, où l’orthographe de La Fontaine a été respectée, un spécimen de cette orthographe, qui diffère très fréquemment de la nôtre: vanger (venger), quiter (quitter), soufrir (souffrir), rampart (rempart), flater (flatter), fidelle (fidèle), guarent (garant), etc.
Boileau (1636-1711), si rigoureux et sévère, nous parle de reculer en arrière, comme si l’on pouvait reculer en avant:
Pégase s’effarouche et recule en arrière.
(Épître IV, Le Passage du Rhin.)
Son île escarpée et sans bords:
L’honneur est comme une île escarpée et sans bords
(Satire X, Les Femmes.)
lui a été maintes fois reprochée: qu’est-ce qu’une île qui n’aurait pas de bords?
Le Français, né malin, forma le vaudeville;
Agréable indiscret, qui, conduit par le chant,
Passe de bouche en bouche et s’accroît en marchant.
(L’Art poétique, chant II.)
Un indiscret qui passe de bouche en bouche et s’accroît en marchant?
Et son feu, dépourvu de sens et de lecture,
S’éteint à chaque pas faute de nourriture.
(Ibid., chant III.)
Un feu, dépourvu de sens et de lecture, qui s’éteint à chaque pas?
[p. 52]
Images bien incohérentes, surtout pour un législateur du Parnasse.
Et cet anachronisme commis par Boileau dans sa satire IX (A son esprit), où il fait de Juvénal le contemporain de l’abbé Cotin:
Avant lui Juvénal avait dit en latin
Qu’on est assis à l’aise aux sermons de Cotin.
Je ne sais plus où j’ai lu que le Traité du Sublime de Longin, traduit par Boileau, fut un jour mis en vente sous le titre — dû à l’imprimeur ou au relieur, les livres autrefois se vendant presque toujours reliés — de Traité du Sublimé, c’est-à-dire du calomel, sel de mercure, et classé dans les ouvrages de chimie.
Ce qui frappe le plus, et en quelque sorte à première vue, dans les comédies de Regnard (1656-1710), c’est la quantité de vers qu’il emprunte, plus ou moins textuellement, à Molière. «Tu prenais ton bien où bon te semblait, eh bien, je fais comme toi, et c’est toi que je pille,» paraît-il dire à son maître.
Dans vos brusques humeurs je ne puis vous comprendre.
(Regnard, Le Distrait, I, 1.)
Dans vos brusques chagrins je ne puis vous comprendre.
(Molière, Le Misanthrope, I, 1.)
J’étais fort serviteur de monsieur votre père.
(Regnard, Le Distrait, II, 7.)
Et j’étais serviteur de monsieur votre père.
(Molière, Le Tartuffe, V, 4.)
A peine pouvons-nous dire comme il se nomme.
(Regnard, Les Ménechmes, IV, 2.)
A peine pouvez-vous dire comme il se nomme.
(Molière, Le Misanthrope, I, 1.)
Et ne me rompez pas la tête plus longtemps.
(Regnard, Les Ménechmes, IV, 3.)
[p. 53]Et ne me rompez pas davantage la tête.
(Molière, Le Misanthrope, IV, 3.)
Voilà, je le confesse, un homme abominable.
(Regnard, Les Ménechmes, V, 5.)
Voilà, je vous l’avoue, un abominable homme.
(Molière, Le Tartuffe, IV, 6.)
Est-ce à moi, s’il vous plaît, que ce discours s’adresse?
(Regnard, Le Légataire universel, III, 8.)
C’est à vous, s’il vous plaît, que ce discours s’adresse.
(Molière, Le Misanthrope, I, 2.)
C’est à vous de sortir et de passer la porte.
La maison m’appartient...
(Regnard, Le Légataire universel, III, 2.)
C’est à vous d’en sortir, vous qui parlez en maître.
La maison m’appartient...
(Molière, Le Tartuffe, IV, 7.)
Etc., etc.
Une des locutions les plus habituelles à Molière: «Je vous trouve plaisant», n’est pas rare non plus chez Regnard:
Je vous trouve plaisant! Au gré de mes souhaits...
(Le Distrait, V, 9.)
Je vous trouve plaisant de disposer de moi.
(Les Ménechmes, V, 6.)
Je vous trouve plaisant et vous avez raison...
(Le Légataire universel, II, 11.)
Je vous trouve plaisant de parler de la sorte.
(Ibid., III, 2.)
Etc., etc.
Crébillon le Tragique (1674-1762), dont nous avons cité le mot (p. 29): «Corneille avait pris le ciel; Racine, la terre;[p. 54] il ne me restait plus que l’enfer», «a fondé presque toutes ses pièces, selon la remarque de Laharpe (Lycée ou Cours de littérature, t. III, 1re partie, p. 563-564; Verdière, 1817), sur le déguisement des principaux personnages. A commencer par Rhadamiste, Zénobie y paraît sous le nom d’Isménie; dans Électre, Oreste est caché sous celui de Tydée; Pyrrhus, dans la pièce de ce nom, l’est sous celui d’Hélénus; Ninias, dans Sémiramis, sous celui d’Agénor; le fils de Thyeste, sous celui du fils d’Atrée; Sextus, dans Le Triumvirat, sous celui de Clodomir»; etc.
Sémiramis ayant découvert que celui qu’elle aime, Agénor, n’est autre que son fils Ninias, continue à l’aimer, comme si de rien n’était:
Ingrat, je t’aime encore avec trop de fureur...
Et Ninias de s’écrier, non sans raison:
O ciel! vit-on jamais dans le cœur d’une mère
D’aussi coupables feux éclater sans mystère?
(Cf. Laharpe, ibid., p. 553-554.)
Laharpe remarque encore combien Crébillon abuse de cette cheville «en ces lieux»: on la voit «à tout moment» au bout de ses vers, dit-il; «et ce qu’il y a de pis, ajoute-t-il (Ibid., p. 528), c’est que ce mot est presque partout inutile, et quelquefois employé à contre-sens»:
Oui, je veux que ce fruit d’un amour odieux
Signale quelque jour ma fureur en ces lieux...
Je ne suis en effet descendu dans ces lieux...
Et nous n’avons d’appui que de vous en ces lieux...
Quel déplaisir secret vous chasse de ces lieux...
Cachez-nous au tyran qui règne dans ces lieux...
Je tremble à chaque pas que je fais en ces lieux...
Sans appui, sans secours, sans suite dans ces lieux...
J’en crains plus du tyran qui règne dans ces lieux...
Il doit être déjà de retour en ces lieux...
M’accorder un vaisseau pour sortir de ces lieux...
Gardes, faites venir l’étranger en ces lieux...
Et votre voix, Seigneur, a rempli tous ces lieux...
Etc., etc.
Voltaire abuse aussi de cette locution «en ces lieux», «dans ces lieux», si commode d’ailleurs pour la versification. Dans sa tragédie d’Oreste notamment, elle apparaît très fréquemment (I, 2, 3, 4, 5; II, 1, 2, 5; etc.):
«... Oreste est en ces lieux.» (II, 7.)
[p. 55]
«... Qu’osiez-vous faire en ces lieux écartés?» (III, 6.)
Etc., etc.
A la première représentation de cette pièce, à certain endroit, sans doute modifié depuis par l’auteur, Oreste s’écriait:
«Suivez-moi!
— Où? demandait Clytemnestre.
— Aux lieux...», commençait à répondre Oreste.
Mais on ne le laissa pas achever, et toute la salle se mit à rire. (Cf. Lorédan Larchey, L’Esprit de tout le monde, 1re série, p. 269.)
Nous reparlerons de Voltaire tout à l’heure et plus amplement.
L’abbé Desfontaines (1685-1745), fameux par ses disputes avec Voltaire, commet la balourdise, au début de son Ode à la reine, de prendre, non le Pirée pour un homme, mais le Permesse, rivière de Béotie, où les Muses aimaient à se baigner, pour une montagne, de confondre, en d’autres termes, Permesse avec Parnasse. Piron ne manqua pas de relever la bévue:
Il croyait le Permesse un mont,
Or c’est un fleuve très profond;
Etc., etc.
Mais ce qu’il y a de plus drôle ici, c’est que Piron (1689-1773), à son tour, commet ou semble commettre la même erreur dans L’Amitié médecin, où il demande aux Muses de faire retentir les «échos du Permesse». (Cf. Paul Chaponnière, Piron, p. 304-305.)
A propos de Piron, n’oublions pas le très malencontreux et risible incident qui fut cause en grande partie de la chute de sa tragédie de Callisthène (1730). Le poignard avec lequel le héros de la pièce, le philosophe Callisthène, se donne la mort au dernier acte était en si mauvais état qu’il se désarticula entre ses mains: lame, poignée, garde, manche, tout était disjoint et comme en paquet, si bien que l’acteur, l’infortuné Callisthène, dut se poignarder non avec un poignard, mais «d’un héroïque coup de poing», et après avoir envoyé au diable, au milieu d’une folle hilarité, les quatre tronçons de son glaive. (Id., ibid., p. 61.)
[p. 56]
Ce vers de La Chaussée (1692-1754), qui se trouve dans sa comédie Le Préjugé à la mode (II, 3):
Devine, si tu peux, et choisis, si tu l’oses,
figure textuellement dans la tragédie d’Héraclius de Corneille (IV, 4).
[p. 57]
Voltaire. Son théâtre: anecdotes diverses. Georges Avenel et son édition des œuvres de Voltaire. La petite-nièce de Corneille. Abus des mots horreur, fatal, affreux. Les tragédies de Voltaire jugées par Victor Hugo. Orthographe de Voltaire.
L’abbé d’Allainval. — Saurin. — Alexandre de Moissy. Une pièce pour sages-femmes.
Sedaine. Ses répétitions de mots. Ses incorrections. — Lemierre. Le vers du siècle.
Beaumarchais. L’adjectif sensible au dix-huitième siècle. Termes de prédilection.
Dorat. — Chamfort. La Charité romaine. — Desforges. Phrases inachevées. — Florian.
Voltaire (1694-1778) — «Le Français suprême, l’écrivain qui a été le plus en harmonie avec sa nation... Voltaire, c’est le plus grand homme en littérature de tous les temps; c’est la création la plus étonnante de l’Auteur de la nature,» a proclamé Gœthe (Conversations avec Eckermann, t. II, p. 77, note; Charpentier, 1863; — et cité dans Voltaire, Œuvres complètes, t. VIII, p. 1126, édit. du journal Le Siècle); «Le vrai représentant de l’esprit français dans ce que j’appelle un congrès européen serait Voltaire,» déclare, de son côté, Sainte-Beuve (Causeries du lundi, t. XV, p. 210, note 1) — Voltaire confond, dans une de ses tragédies, L’Orphelin de la Chine (I, 3), alfange (sorte de cimeterre) avec phalange (troupe d’infanterie), et il écrit:
De nos honteux soldats les alfanges errantes,
A genoux, ont jeté leurs armes impuissantes.
Ce qui a été corrigé depuis par divers éditeurs, qui ont mis phalanges à la place d’alfanges.
Dans la même pièce (II, 6), nous relevons ce vers singulier:
Où mon front avili n’osa lever les yeux.
On a souvent rapproché ce vers de Voltaire (Rome sauvée, I, 7):
Faisons notre devoir: les dieux feront le reste,
[p. 58]
de ce vers de Corneille (Horace, II, 8):
Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux...
Ce vers:
Ce monstre à voix humaine, aigle, femme et lion,
se trouve à la fois et mot pour mot dans l’Œdipe de Corneille (I, 3) et dans l’Œdipe de Voltaire (I, 1), où nous rencontrons également (I, 1) cet autre vers devenu proverbe:
L’amitié d’un grand homme est un bienfait des dieux.
Nombre de vers des pièces de théâtre de Voltaire, tout comme de Corneille et de Racine, sont d’ailleurs restés dans la mémoire:
A tous les cœurs bien nés que la patrie est chère!
(Tancrède, III, 1.)
Le premier qui fut roi fut un soldat heureux;
Qui sert bien son pays n’a pas besoin d’aïeux.
(Mérope, I, 3.)
Les mortels sont égaux; ce n’est point la naissance,
C’est la seule vertu qui fait leur différence.
(Mahomet, I, 4.)
Remarquons, en passant, qu’un des personnages de cette tragédie de Mahomet, l’esclave Séide, a laissé son nom dans la langue pour signifier un sectateur fanatique.
Chacun baise en tremblant la main qui nous enchaîne.
(La Mort de César II, 1.)
... Tu dors, Brutus, et Rome est dans les fers.
(Ibid.)
Etc., etc.
Georges Avenel, dans sa bonne et intéressante édition populaire des œuvres complètes de Voltaire (Paris, aux bureaux du journal Le Siècle, 1867-1870, 8 vol. in-4)[21], a eu le soin d’imprimer en italique tous ces vers «sensationnels» ou demeurés célèbres.
Rappelons que cette phrase, qu’on cite d’ordinaire comme un vers:
Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux,
[p. 59]a été écrite comme prose par Voltaire; elle se trouve vers la fin de la préface de L’Enfant prodigue, comédie en cinq actes (t. III, p. 286, édit. du journal Le Siècle).
La Mort de César est, assure-t-on, la première pièce de théâtre, «parmi celles qui méritent d’être connues», où aucune femme ne figure parmi les personnages. Elle réalise ainsi le vœu du prédicateur Pierre de Villiers (1648-1728) qui voulait retrancher des tragédies «tout ce qui est amour». (Cf. Émile Deschanel, Le Romantisme des classiques, Voltaire, p. 125, et Racine, t. II, p. 33, note 1.)
Une mésaventure analogue à celle des abbés Pellegrin et Abeille et à la chute de leurs pièces (Cf. ci-dessus, chap. 1, p. 22), survint à Voltaire, lorsqu’il fit représenter sa tragédie d’Adélaïde du Guesclin, où se trouve, à la scène dernière, cet hémistiche:
Es-tu content, Coucy?
«Couci, couci!» répliquèrent plusieurs mauvais plaisants, — ce qui, comme bien on pense, ne contribua pas à la réussite de l’œuvre. (Cf. Georges Avenel, ouvrage cité, t. III, p. 215 et 229.)
Dans Zaïre, «la plus touchante de toutes les tragédies qui existent» (Laharpe, Lycée ou Cours de littérature, t. III, 1re partie, p. 222; Verdière, 1817), un autre hémistiche:
... Soutiens-moi, Chatillon,
(II, 3),
a été et est souvent encore employé par plaisanterie, burlesquement.
De même, à la première représentation de Mariamne, dans le moment où Mariamne, qui s’empoisonnait et expirait sur la scène, prenait la coupe et la portait à ses lèvres, le parterre s’écria: «La reine boit! La reine boit!» On était justement la veille, ou non loin de la fête des Rois, et cette plaisanterie amena l’interruption puis la chute de la pièce. (Cf. Georges Avenel, ibid., p. 112.)
C’est dans Zaïre, où une croix fait reconnaître à Lusignan sa fille, que nous voyons apparaître pour la première fois cet accessoire, «la croix de ma mère», dont le théâtre a tant abusé depuis. (Cf. Zaïre, II, 3; — et Émile Deschanel, ouvrage cité, Théâtre de Voltaire, p. 100.)
Pendant qu’on répétait Mérope, Voltaire accablait les acteurs de corrections, suivant son usage. Ayant passé la nuit à revoir sa pièce, il réveilla son laquais à trois heures du matin, et lui[p. 60] remit une correction à porter à l’acteur Paulin, chargé du rôle du tyran Polyphonte. «Mais, à cette heure, tout le monde dort, monsieur, objecte le domestique. Je ne pourrai pas pénétrer chez M. Paulin. — Va, cours! répond gravement Voltaire. Les tyrans ne dorment jamais.» (Cf. Émile Deschanel, ouvrage cité, p. 193, note 1.)
Voltaire fatiguait et ennuyait tellement ses interprètes avec ses incessantes corrections, qu’une actrice, Mlle Desmares, lui ferma un jour sa porte, et, comme il lui glissait encore des rectifications par le trou de la serrure, elle boucha ce trou. Alors Voltaire s’avisa de ce stratagème. Ayant appris que Mlle Desmares donnait un grand dîner, il fit faire, pour ce jour-là, un superbe pâté de perdrix qu’il lui envoya. En ouvrant ce pâté, on découvrit douze perdrix tenant dans leur bec plusieurs billets où étaient inscrits les vers qu’il fallait ajouter ou changer dans le rôle de Mlle Desmares. (Cf. Lucien Perey et Gaston Maugras, La Vie intime de Voltaire aux Délices et à Ferney, p. 252, note 2; — et Émile Deschanel, ibid., p. 235.)
Deux vers de la tragédie de Mahomet (II, 5) ont été employés, dans une plaisante circonstance, par l’acteur Lekain, d’autres disent Larive. Lekain ou Larive chassait un jour sur les terres du prince de Condé, lorsqu’un garde-chasse l’interpella et lui demanda de quel droit il chassait sur les propriétés de son maître; et l’autre de lui répondre aussitôt majestueusement et fièrement:
«Du droit qu’un esprit vaste et ferme en ses desseins
A sur l’esprit grossier des vulgaires humains.
— Ah! monsieur, c’est différent! Excusez-moi!» bégaya le garde-chasse tout interloqué et ahuri, et en s’inclinant jusqu’à terre. (Cf. La Semaine des familles, 22 septembre 1860, p. 820; — et Larousse, art. Droit, p. 1276, col. 4.)
A propos de ce vers de Corneille (Cinna, III, 4):
Je vous aime, Émilie, et le ciel me foudroie,
on trouve, dans une lettre de Voltaire à M. de Mairan, datée de Ferney, 16 auguste (août) 1761, une fort peu édifiante, mais très probablement peu véridique anecdote, relative à la petite-nièce de Corneille, que Voltaire avait recueillie chez lui. Je me borne à signaler cette plaisanterie, qui, comme il advient fréquemment avec le patriarche de Ferney, n’est pas du meilleur goût.
[p. 61]
Dans une notice de Voltaire sur L’Encyclopédie (1774; Œuvres complètes de Voltaire, t. VI, p. 381; édit. du journal le Siècle), on lit cette phrase: «Il (Louis XV) avait été averti que les vingt et un volumes in-folio (de L’Encyclopédie) qu’on trouvait sur la toilette de toutes les dames...»
Vingt et un volumes in-folio sur une table de toilette! Il fallait que ces toilettes fussent à la fois très grandes et remarquablement solides.
Laharpe (Ouvrage cité, t. III, 1re partie, p. 153, 183 et 363) constate que Voltaire, dans ses tragédies, prodigue trop les mots horreur, fatal, affreux surtout. Voir, par exemple, la tragédie d’Œdipe, acte IV, scène 1, où l’épithète affreux se trouve répétée sept fois:
Sur mes destins affreux ne soit trop éclairé...
Et que tous deux unis par ces liens affreux...
Etc., etc.
Et dans Mérope (II, 2):
Celle de qui la gloire et l’infortune affreuse...
On rencontre aussi dans Mérope (IV, 2) ce vers peu harmonieux:
Quoi! de pitié pour moi tous vos sens sont saisis?
Nous avons signalé plus haut (p. 22) la fameuse dissonance, rectifiée depuis:
Non, il n’est rien que Nanine n’honore.
Ajoutons que, malgré ces défectuosités et ces tares, on ne peut s’empêcher de trouver exagérée cette sentence de Victor Hugo (Actes et Paroles, Avant l’exil, t. I, p. 234; Hetzel-Quantin, s. d.): «Je range les tragédies de Voltaire parmi les œuvres les plus informes que l’esprit humain ait jamais produites». Sentence draconienne, ultra-méprisante, d’autant plus curieuse que, comme le démontre Émile Deschanel (Ouvrage cité, p. 212, 228, 311, 356: «Tancrède, le héros amoureux et proscrit, n’est-ce pas déjà Hernani?» etc.), le théâtre de Victor Hugo offre plus d’une analogie avec celui de Voltaire. L’auteur d’Hernani, nous le verrons plus loin, dans le chapitre qui lui est consacré, n’a d’ailleurs pas toujours eu la même opinion sur Voltaire et ses tragédies.
[p. 62]
L’orthographe de Voltaire, comme celle du reste de tous les écrivains de son temps et, à plus forte raison, des temps antérieurs, est très différente de la nôtre. Dans une lettre, rédigée entièrement de sa main, et signée: Voltaire, chambelan du roy de Prusse, il écrit ainsi les mots: nouvau, touttes, nourit, souhaitté, baucoup, ramaux, le fonds de mon cœur, andidote, crétien, etc., etc. (Cf. G.-A. Crapelet, Études pratiques et littéraires sur la typographie, p. 345, note).
Et dans sa tragédie de Tancrède (IV, 2), on lit:
Oui, j’ai tout fait pour elle...
Et l’eussé-je aimé moins, comment l’abandonner?
(aimé pour aimée).
On a même prétendu — c’est l’abbé Galiani (Lettres, t. II, p. 281; édit. Eugène Asse) — que «D’Olivet n’avait jamais pu parvenir à enseigner l’orthographe à Voltaire».
L’abbé d’Allainval ou Soulas d’Allainval (1700-1753), qui, au milieu d’une vie de misère, n’ayant ni feu ni lieu, couchant dans les chaises à porteurs remisées alors au coin des rues, — et qui devait bientôt mourir à l’Hôtel-Dieu, — nous présente une singulière particularité, un étrange contraste: durant son extrême indigence, ne s’avise-t-il pas d’écrire une pièce sur L’Embarras des richesses? Et cette pièce est «un de ses meilleurs ouvrages... pièce bien conduite et bien dénouée et qui ne manque pas d’intérêt». (Chefs-d’œuvre des Auteurs comiques, t. III, Notice sur d’Allainval; Didot, 1872.) Ce qui prouve, une fois de plus, comme l’a si bien déclaré Beaumarchais après Voltaire (Cf. Le Mariage de Figaro, V, 3; et le Dictionnaire philosophique, article Argent), qu’«il n’est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner», et qu’«il est plus aisé d’écrire sur l’argent que d’en avoir».
Dans une pièce de Saurin (1706-1781), Les Mœurs du temps, nous voyons, à la scène deuxième, un des personnages, Julie, arriver «tenant un livre ouvert», ce qui n’empêche pas une autre dame, Cidalise, qui n’est cependant pas aveugle, de s’exclamer presque aussitôt: «Je vous dirais bien, moi, de quoi ce livre vous aurait entretenue, si vous l’aviez ouvert».
Ils sont de Saurin, si oublié aujourd’hui, et de sa tragédie[p. 63] Blanche et Guiscard, qu’on ne joue plus et qu’on ne lit plus, ces beaux vers fréquemment cités:
Qu’une nuit paraît longue à la douleur qui veille!...
Longtemps on aime encore, en rougissant d’aimer...
La loi permet souvent ce que défend l’honneur...
(Cf. Notice sur Saurin, Chefs-d’œuvre tragiques, t. I, p. 270; Didot, 1869.)
Comme exemple des ridicules indications de personnages dans certains mélodrames, on cite la distribution d’une pièce d’Alexandre de Moissy (1712-1777), — qui en a écrit bien d’autres, plus ou moins grotesques, — La Vraie Mère, «drame didacti-comique en trois actes». Voici cette distribution textuelle (Cf. l’Almanach de la Littérature, du Théâtre et des Beaux-Arts, 1867, p. 93):
«Mme Félibien, accouchée depuis sept mois et nourrissant son enfant.
«M. Félibien, son mari, négociant.
«Mme de Villepreux, sa sœur, femme enceinte et presque à terme.
«M. de Villepreux, son mari.
«Mme des Aulnes, femme d’un marchand de drap, relevée de couches depuis neuf mois et demi.
«L’enfant de Mme Félibien, âgé de sept mois.
«L’enfant de Mme des Aulnes, âgé de dix mois.
«Mme Londais, sage-femme.
«Mme Léveillé, garde de femmes en couches.»
Sedaine (1719-1797) a une manie, un tic, pour ainsi parler: c’est de redoubler les locutions qu’il emploie. «Bonjour, monsieur, bonjour!» «Conte-moi ça, conte-moi ça!» «Tu viens, n’est-ce pas, tu viens?» Ce redoublement lui semblait donner plus de naturel au dialogue, et aussi plus de force, équivaloir à un superlatif. C’est du reste la remarque de François Génin, dans ses Récréations philologiques (t. I, p. 42): «La manière primitive et la plus naturelle de former un superlatif c’est de répéter le positif. Les enfants n’y manquent pas; ils vous diront Un grand, grand, grand homme! — Il était petit, petit! C’est l’origine du bonbon et du bobo.»
Voici quelques-uns de ces redoublements de Sedaine:
«Va-t’en, va-t’en: écoute...» (Le Philosophe sans le savoir, IV, 7.)
[p. 64]
«Monsieur, monsieur, un gentilhomme...» (Ouvrage cité, IV, 9.)
«Vos pistolets, vos pistolets; vous m’avez vu...» (Ibid.)
«Hier au soir, j’y vais, j’y vais.» (Ibid., V, 2.)
«A l’instant! prenez, prenez, monsieur.» (Ibid., V, 4.)
«Monsieur, monsieur, voilà de l’honnêteté.» (Ibid.)
«Ah! monsieur, monsieur, c’est fait de mes vingt louis. — Je n’hésite pas, madame, je n’hésite pas, vous le voyez, un instant, un instant.» (La Gageure imprévue, sc. 23.)
«Ah! madame, madame! c’est battre un homme à terre.» (Ibid.)
«Madame, madame, j’en suis charmé.» (Ibid.)
«Ah! les hommes, les hommes nous valent bien.» (Ibid., sc. 25.)
«C’est la réponse à la vôtre, c’est la réponse à la vôtre: c’est...» (Rose et Colas, sc. 8.)
«Elle est sage, elle est sage, ah! très sage.» (Ibid.)
«Et moi, et moi, n’ai-je pas...» (Ibid.)
«Oui, pour dire à ton père, pour dire à ton père qu’il y a plus d’aveugles que de clairvoyants.» (Ibid., sc. 15.)
«Folle! folle! je vais te faire voir...» (Ibid.)
«C’est bien naturel, c’est bien naturel. Tenez...» (Ibid., sc. 16.)
Arrêtons-nous: les exemples de ces répétitions sont innombrables dans le théâtre de Sedaine, on dirait des doublons typographiques.
Sedaine estimait que «tout ce qui n’est pas suffisamment développé», dans un récit ou un dialogue, ne produit qu’une impression médiocre; et quand on trouvait des longueurs dans ses ouvrages, il était rare qu’il ne répondît pas: «J’allongerai». (Notice sur Sedaine, Chefs d’œuvre des auteurs comiques, t. VII, p. 2; Didot, 1861.)
Son style, outre les susdites répétitions continuelles, est souvent négligé et incorrect: — «Alexis laisse tomber sa tête sur son estomac» (Le Déserteur, I, 6), — et l’on raconte, à ce sujet, l’anecdote suivante, dont je ne garantis pas l’authenticité: «... Sedaine, qui écrivait aussi mal en vers qu’en prose, et qui en convenait sans peine, ayant entendu le discours de réception d’un de ses nouveaux collègues (à l’Académie), se jeta au cou du récipiendaire, et lui dit avec effusion: «Ah! monsieur, depuis vingt ans que j’écris du galimatias, je n’ai encore rien dit de pareil.» (Curiosités littéraires, Académies, p. 299; Paulin, 1845.)
[p. 65]Lemierre (1723-1793), à qui l’on doit ce vers si connu et qualifié «le vers du siècle»:
Le trident de Neptune est le sceptre du monde,
qui se trouve dans son poème Le Commerce, a, dans sa première tragédie, Hypermnestre, marié en un seul jour cinquante filles d’un même père à cinquante fils du frère de ce père. C’est une intrigue empruntée, il est vrai, à la mythologie, l’histoire des Danaïdes, mais, ainsi transportée au théâtre, elle n’est pas banale. (Cf. Laharpe, ouvrage cité, t. III, 1re partie, p. 596.)
«Déposez vos douleurs dans le sein d’un homme sensible», dit un des personnages de La Mère coupable (III, 2) de Beaumarchais (1732-1799).
Ce qualificatif sensible et le substantif sensibilité, nous les retrouvons à profusion chez nombre d’écrivains, poètes ou prosateurs, du dix-huitième siècle, chez Jean-Jacques Rousseau notamment, chez Florian: «Il ne me reste qu’un cœur sensible» (Gonzalve de Cordoue, livre VI, t. II, p. 74, — et p. 28, 114, 139, 162, 164, 168, 169... édit. de la Bibliothèque nationale); etc.[22].
«Chaque siècle a son terme favori dont il use et abuse, et qui traduit sa préoccupation dominante. Au dix-huitième siècle, c’était le mot sensibilité», a remarqué, à ce propos, Paul Stapfer (Racine et Victor Hugo, p. 64).
Et l’on peut dire aussi, et non moins justement, que chaque écrivain a ses termes de prédilection, «chaque auteur a son dictionnaire et sa manière», selon la sentence de Joubert (Pensées, Du style, t. II, p. 285), et selon celle de Sainte-Beuve également: «Chaque écrivain, a-t-il dit, a son mot de prédilection, qui revient fréquemment dans le discours, et qui trahit, par mégarde, chez celui qui l’emploie, un vœu secret ou un faible.» (Cf. Charles Monselet, le journal La Vie littéraire, 9 novembre 1876.) Nous avons cité déjà plus d’une de ces[p. 66] «locutions favorites», — qui ne trahissent pas toujours et inévitablement un vœu ou un faible, — et nous continuerons, chemin faisant et à l’occasion, d’en mentionner.
Rappelons qu’un chœur de paysans de l’opéra de Tarare, chœur que Beaumarchais a fait disparaître de son œuvre, a été «cité longtemps comme un chef-d’œuvre de ridicule»:
Notre amour est pour la pâture,
Et tous nos soins
Sont pour nos foins.
(Cf. L.-S. Auger, Notice sur Beaumarchais, Théâtre de Beaumarchais, p. xx; Didot, 1863.)
Et cette indication scénique dans La Mère coupable (II, 2): «Bégearss... se mord le doigt avec mystère».
Encore une phrase à relever dans Beaumarchais (Mémoires, Addition au Supplément, p. 157; Garnier, 1859): «Présentant aux juges sa liste d’une main, et faisant la révérence de l’autre, Mme Goëzman a dit...»
Une jolie locution, empruntée à ces mêmes Mémoires (p. 111): «Courir comme chat sur braise».
Pour dire que des danseurs qui représentaient les vents et jouaient mal ont été hués et chassés de la scène par les spectateurs du parterre, Dorat (1734-1780) écrit:
Et le parterre enfin renvoie, avec justice,
Ces petits vents honteux souffler dans la coulisse.
(Cf. Laharpe, ouvrage cité, t. III, 1re partie, p. 100.)
«Ces petits vents honteux» ont été parfois mal interprétés.
Chamfort (1741-1794), dans une strophe où il rappelait la fameuse scène baptisée La Charité romaine, fréquemment représentée en peinture, et qui nous montre une jeune femme allaitant un vieillard, — l’aventure de Péra et de son père Cimon, que l’on confond parfois avec Éponine et son mari Sabinus, — s’exprime en ces termes drolatiques:
De son lait!... Se peut-il? Oui, de son propre père
Elle devient la mère!
(Cf. Laharpe, ouvrage cité, t. III, 2e partie, p. 445; — et Larousse, art. Charité romaine.)
La comédie de Desforges (Choudard-Desforges: 1746-1806), Le Sourd ou l’Auberge pleine, qui eut jadis tant de succès, est[p. 67] certainement une des plus incorrectes, des plus négligemment écrites qui aient paru.
«Oui, je m’en rappelle!» dit un des personnages. (III, 3.)
Et un autre, D’Oliban, comme l’action se passe en 1793, n’ose prononcer le mot tyran, et s’arrête juste au milieu du mot:
«... Donner ma fille au plus ridicule des maris, et de père devenir tyr... Je n’ose achever.» (III, 5.)
Déjà le vieux poète Jacques de la Taille (1543-1562) avait usé du même procédé dans sa tragédie de Daire (Darius), où, dans la dernière scène, les suprêmes paroles que Darius adresse de loin à Alexandre en expirant sont ainsi rapportées:
O Alexandre...
Ma mère et mes enfants aye en recommanda... (tion)
Il ne put achever, car la mort l’en garda (l’empêcha).
(Cf. Sainte-Beuve, Tableau de la poésie française au seizième siècle, p. 207.)
Ce même genre de réticence, ce même truc, se retrouve chez Florian (1755-1794). Dans son roman Gonzalve de Cordoue (livre X, t. II, p. 180; édit. de la Bibliothèque nationale), très belle épopée en prose qui mérite d’être relue, un personnage, Alamar, ennemi furieux de Gonzalve, s’écrie, en s’armant pour aller le combattre: «Je cours punir, exterminer le «détestable...» Il ne peut achever, sa colère ne lui permet pas de prononcer le nom qu’il abhorre.»
Ailleurs (livre IV, t. II, p. 36), c’est, comme tout à l’heure, pour le Darius de Jacques de la Taille, la mort qui coupe la parole à l’orateur: «Que le Dieu du ciel me pardonne! et que les Zegris, profitant du terrible exemple...» Il n’achève pas; l’impitoyable mort le saisit.»
[p. 69]
Le culte de la périphrase. Périphrases courantes. — Écouchard Lebrun et le «périphrastique». — Delille. Locution favorite de Delille. Ses succès. Sa mémoire prodigieuse.
Chateaubriand. Il préférait ses vers à sa prose. Sa tragédie de Moïse. — Prédilections particulières de certains écrivains et artistes: «Le violon d’Ingres». — Singuliers jugements et vœux de Chateaubriand. «Tuer le mandarin». — La gloire littéraire.
«Rien n’est si beau que de ne pas appeler les choses par leur nom», déclare Voltaire, dans ses Conseils à Helvétius (Œuvres complètes, t. IV, p. 601, note r; édit. du journal Le Siècle).
Et Buffon, de son côté, recommande «de ne nommer les choses que par les termes les plus généraux»; c’est ce qui fait le style noble. (Cf. Eugène Despois, Dialogues sur l’éloquence par Fénelon, p. 212, note 1.)
D’accord avec ces principes, proclamés vers le milieu du dix-huitième siècle, l’emploi de la périphrase s’étend de plus en plus à partir de cette époque jusqu’à la Restauration.
Nombre de périphrases sont même devenues de véritables lieux communs.
«J’ai voulu me jeter aux pieds des auteurs de mes jours», écrit à Saint-Preux la Julie de Rousseau. (La Nouvelle Héloïse, I, 4; Œuvres complètes de J.-J. Rousseau, t. III, p. 139; Hachette, 1856.)
«Quoi! je pourrais expirer d’amour et de joie entre un époux adoré et les chers gages de sa tendresse!» écrit encore la même héroïne. (Ibid., II, 4; t. III, p. 253.)
«Je porte dans mon sein un gage de mon amour... le gage de notre union.» (Florian, Le Bon Ménage, sc. 3 et 18, Fables et autres œuvres, p. 423 et 434; Didot, 1858.)
Et si ce tour vieilli peut peindre un jeune objet...
Églé sera longtemps comparée à la rose.
(Delille, L’Imagination, I; Œuvres, t. I, p. 336; Lefèvre, 1844.)
Les auteurs de mes jours, les gages de ma tendresse, un gage de mon amour, un jeune objet (pour dire une jeune fille ou une[p. 70] jeune femme) sont ou ont été des périphrases des plus courantes.
Écouchard Lebrun dit Lebrun-Pindare (1729-1807), et surtout Jacques Delille (1738-1813), le «périphrastique» Delille, comme on l’a baptisé, ont particulièrement cultivé la périphrase.
Ce sont très souvent de véritables énigmes que Lebrun donne à déchiffrer à ses lecteurs. Voyez cette strophe de l’ode sur Le Triomphe de nos paysages (Dans le volume Malherbe, J.-B. Rousseau, É. Lebrun, Œuvres, p. 514; Didot, 1858):
La colline qui, vers le pôle,
Borne nos fertiles marais,
Occupe les enfants d’Éole
A broyer les dons de Cérès.
Vanvres, qu’habite Galatée,
Sait du lait d’Io, d’Amalthée,
Épaissir les flots écumeux;
Et Sèvres, d’une pure argile,
Compose l’albâtre fragile
Où Moka nous verse ses feux.
«Tout cela, note Sainte-Beuve (Portraits littéraires, t. I, p. 152, note 1), pour dire: «Au nord de Paris, Montmartre et ses moulins à vent; de l’autre côté, Vanvres (Vanves), son beurre et ses fromages; et la porcelaine de Sèvres! «Je ne crois pas, écrivait Ginguené au rédacteur du journal Le Modérateur (22 janvier 1790), que nous ayons beaucoup de vers à mettre au-dessus de cette strophe.» Et Andrieux, l’Aristarque, n’en disconvenait pas; il avouait que si tout avait été aussi beau, il aurait fallu rendre les armes. Aujourd’hui, conclut Sainte-Beuve, il n’est pas un écolier qui n’en rie. On rencontre dans le goût, aux diverses époques, de ces veines bizarres.»
Ailleurs, dans l’ode Mes Souvenirs ou les Deux Rives de la Seine (Œuvres, même édition., p. 526), Lebrun nous décrit ses jeux au collège, et ce sont encore autant d’énigmes:
Là, dans sa vitesse immobile,
Le buis semblait dormir, agité par mon bras;
Là, je triplais le cercle agile
Du chanvre envolé sous mes pas.
Là, frêle émule de Dédale,
Un liège, sous mes coups, se plut à voltiger;
Là, dans une course rivale,
J’étais Achille au pied léger.
Là, j’élevais jusqu’à la nue
Ce long fantôme ailé, qu’un fil dirige encor
A travers la route inconnue
Qu’Éole ouvre à son vague essor.
[p. 71]
Ce qui signifie qu’au collège il jouait à la toupie, à la corde, au volant, à la course ou aux barres, et au cerf-volant.
Et Jacques Delille, qui a joui, de son vivant, d’une renommée sans égale, d’une gloire comparable à celle de Victor Hugo, que de railleries lui ont été et lui sont encore décochées pour ses innombrables périphrases! Ce qu’il y a de plus curieux, ce qui paraît incroyable, c’est que c’était malgré lui, en quelque sorte, et uniquement pour se conformer au goût du jour, qu’il les employait; personnellement et par principes, il y était opposé: nous le verrons tout à l’heure.
Pour Delille, le cochon est
... l’animal qui s’engraisse de glands.
(Les Géorgiques, III; Œuvres, t. II, p. 353; Lefèvre, 1844.)
Et Victor Hugo de riposter (Les Contemplations, I, 7, Réponse à un acte d’accusation, t. I, p. 30; Hachette, 1882):
Je nommai le cochon par son nom: pourquoi pas?
Guichardin a nommé le Borgia...
Les diamants sont, pour Delille:
... Ces cailloux brillants que Golconde nous donne.
(L’Imagination, I; t. I, p. 457.)
L’araignée:
Un insecte aux longs bras, de qui les doigts agiles
Tapissaient ces vieux murs de leurs toiles fragiles.
(Ibid., VI; t. I, p. 466.)
Les baleines:
Ces monstres qui, de loin, semblent un vaste écueil.
(L’Homme des champs, II; t. I, p. 169.)
La cigogne:
L’ennemi des serpents vient, après les frimas,
Retrouver les beaux jours dans nos riants climats.
(Les Géorgiques, II; t. II, p. 332.)
Le taon:
... insecte affreux, que Junon autrefois,
Pour tourmenter Io, déchaîna dans les bois.
(Ibid., III; t. II, p. 343.)
[p. 72]
Le chat:
L’animal traître et doux, des souris destructeur.
(Dans Paul Stapfer, Racine et Victor Hugo, p. 262.)
Le paon:
L’oiseau sur qui Junon sema les yeux d’Argus.
(Ibid.)
L’oie:
L’aquatique animal, sauveur du Capitole.
(Ibid.)
La poule:
Cet oiseau diligent dont le chant entendu
Annonce au laboureur le fruit qu’il a pondu.
(Ibid.)
Delille n’a pas manqué de nous décrire de même, au milieu d’ingénieuses circonlocutions, le cidre, la bière, le vin de Champagne, la vigne, le thé, le café, etc.; et l’imprimerie, l’horlogerie, la gravure, les tapisseries... tout ce qu’on peut imaginer.
Comme on ne prête qu’aux riches, on lui a même attribué plus d’une périphrase qu’on chercherait en vain dans son œuvre, cette définition de la seringue, par exemple:
Ce tube tortueux d’où jaillit la santé,
que je rencontre dans La Chronique médicale (1er février 1913, p. 77).
Encore une drolatique périphrase: elle est de Marmontel, celle-là, et je la trouve dans la Correspondance de Gustave Flaubert (t. II, p. 99-100; Charpentier, 1889): «Nous lisions quelquefois, pour nous faire rire, des tragédies de Marmontel, et ça a été une excellente étude. Il faut lire le mauvais et le sublime, pas de médiocre... Que dis-tu de ceci... pour dire noblement qu’une femme gravée de la petite vérole ressemble à une écumoire:
D’une vierge par lui (le fléau), j’ai vu le doux visage,
Horrible désormais, nous présenter l’image
De ce meuble vulgaire, en mille endroits percé,
Dont se sert la matrone, en son zèle empressé,
Lorsqu’aux bords onctueux de l’argile écumante
Frémit le suc des chairs en sa mousse bouillante?»
[p. 73]
Et Grimod de la Reynière, le fameux gourmet, baptisant le brochet «l’Attila des mers», et le cochon «l’animal encyclopédique par excellence». (Le Temps, 23 mai 1912.)
Etc., etc.
(Voir d’autres exemples de curieuses périphrases dans la Revue bleue, 31 octobre 1885, p. 568-569; — Gustave Merlet, Tableau de la littérature française, 1800-1815, t. I, p. 510; — etc.)
Dans sa préface de Cromwell (p. 34; Hachette, 1862), Victor Hugo assure que «l’homme de la description et de la périphrase, ce Delille, dit-on, vers sa fin, se vantait, à la manière des dénombrements d’Homère, d’avoir fait douze chameaux, quatre chiens, trois chevaux, y compris celui de Job, six tigres, deux chats, un jeu d’échecs, un trictrac, un damier, un billard, plusieurs hivers, beaucoup d’étés, force printemps, cinquante couchers de soleil et tant d’aurores qu’il se perdait à les compter».
Pour s’excuser de son système et l’expliquer, Delille écrit dans le Discours préliminaire de sa traduction des Géorgiques (t. II, p. 290-291): «... Parmi nous, la barrière qui sépare les grands du peuple a séparé leur langage; les préjugés ont avili les mots comme les hommes, et il y a eu, pour ainsi dire, des termes nobles et des termes roturiers[23]. Une délicatesse superbe a donc rejeté une foule d’expressions et d’images. La langue, en devenant plus décente, est devenue plus pauvre; et comme les grands ont abandonné au peuple l’exercice des arts, ils lui ont aussi abandonné les termes qui peignent leurs opérations. De là la nécessité d’employer des circonlocutions timides, d’avoir recours à la lenteur des périphrases; enfin d’être long, de peur d’être bas; de sorte que le destin de notre langue ressemble assez à celui de ces gentilshommes ruinés, qui se condamnent à l’indigence de peur de déroger.»
Relativement aux périphrases, Sainte-Beuve émet ces intéressantes et très justes considérations (Portraits contemporains, Lebrun, t. III, p. 173): «On a récemment blâmé la[p. 74] périphrase; on n’oublie qu’une chose: en 1820, à la scène, dans une tragédie, le mot propre pour les objets familiers était tout simplement une impossibilité; il ne devint une difficulté que quelques années plus tard. Cinq ans après, dans Le Cid d’Andalousie (de Pierre-Antoine Lebrun: 1785-1873), le mot chambre excitait des murmures à la première représentation; Le Globe (5 mars 1825, article de M. Trognon) était obligé de remémorer aux ultra-classiques le vers d’Athalie:
De princes égorgés la chambre était remplie.
«Depuis, il faut en convenir, on a terriblement enfoncé la porte de cette chambre; on a été d’un bond jusqu’à l’alcôve. Mais, avant 1830, chaque mot simple en tragédie voulait un combat...»
Un mot revient très fréquemment sous la plume de Delille, c’est le verbe embellir:
Ma muse des jardins embellit le séjour.
(Les Jardins, III; Œuvres, t. I, p. 75.)
Quel charme embellira vos douces promenades?
(L’Homme des champs, II; ibid., p. 148.)
... Multiplie, agrandit, embellit la nature.
(L’Imagination, I; ibid., p. 333.)
Tout ce que la nature embellit de sa main.
(Ibid., III; ibid., p. 369.)
Un air d’aisance encore embellit la déesse.
(Ibid., III; ibid., p. 371.)
Oh! que l’homme sait bien embellir l’univers!
(Ibid., IV; ibid., p. 392.)
Etc., etc.
«Les livres de Delille, nous apprend Sainte-Beuve (Portraits littéraires, t. II, p. 94), se tiraient d’ordinaire à 20 000 exemplaires pour la première édition. L’Énéide, par exception, se publia à 50 000 exemplaires. Elle fut achetée à l’auteur 40 000 francs d’abord, bien grande somme pour le temps.»
Dans la notice qu’elle a consacrée à Delille, Mme Woillez conte que, revenant d’Athènes sur un petit vaisseau qui fut «poursuivi par deux forbans, Delille donna, dans cette circonstance, des marques de sang-froid et même de gaieté dont toutes les gazettes parlèrent dans le temps: «Ces coquins-là,[p. 75] dit-il, ne s’attendent pas à l’épigramme que je ferai contre eux». (Notice, Œuvres de J. Delille, t. I, p. 7; Lefèvre, 1844.)
Delille, raconte-t-on encore, était doué d’une mémoire prodigieuse, et il serait mort emportant dans sa tête un long poème entièrement composé: «... Ce poème contenait au moins six mille vers, et quels vers! (s’exclamait un jour la veuve du poète). Il n’avait jamais rien fait de si beau. Mais vous savez son indolence... Je lui disais tous les jours: «Monsieur Delille, ne vous fiez pas à votre mémoire, dictez-moi ces vers-là; je veux les écrire pour qu’ils ne soient pas perdus.» Eh bien, monsieur, il ne m’a pas écoutée, il est mort, il a emporté dans la tombe son superbe poème. Je m’étais déjà arrangée avec un libraire, qui m’en donnait un prix considérable; mais voilà M. Delille ad patres, et l’ouvrage aussi. C’est dix mille francs qu’il m’enlève, monsieur, dix mille francs!» (Charles Brifaut, Récits d’un vieux parrain à son jeune filleul, dans Charles Rozan, Petites Ignorances historiques et littéraires, p. 371, note 1.) Mais l’anecdote paraît très suspecte: cf. Sainte-Beuve, Portraits littéraires, Delille, t. II, p. 103 et suiv.
Chateaubriand (1768-1848) avait, rapporte Henri de Latouche (dans Henri Monnier, Mémoires de M. Joseph Prudhomme, t. II, p. 92; Librairie nouvelle, 1857), «l’infirmité de faire des vers et de les préférer à sa prose; il ne veut pas admettre, ajoute Latouche, qu’il y ait d’autre poète en France que lui, dont personne cependant ne parle en cette qualité». C’est ce qui nous permet, dans la présente étude, de classer l’auteur d’Atala et des Martyrs parmi les poètes.
«Les vers! Faites des vers! disait un jour Chateaubriand au jeune Victor Hugo, l’enfant sublime. C’est la littérature d’en haut... Le véritable écrivain, c’est le poète. Moi aussi, j’ai fait des vers, et je me repens de n’avoir pas continué. Mes vers valaient mieux que ma prose. Savez-vous que j’ai écrit une tragédie? Tenez, il faut que je vous en lise une scène...» Et il se fit apporter le manuscrit de Moïse. (Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, 1818-1821, p. 237; Hetzel-Quantin, s. d., in-16.)
«Prosateur magnifique, faible rimeur, Chateaubriand polit et repolit pendant vingt ans son Moïse. Il préférait ce faux chef-d’œuvre à toutes ses œuvres.» (Adolphe Brisson, Le Temps, 26 mai 1913, Chronique théâtrale.)
[p. 76]
De même Gœthe considérait «comme son plus beau titre de gloire» sa Théorie des couleurs, «que les savants refusaient de prendre au sérieux», et qui est un de ses plus mauvais ouvrages, sinon son plus mauvais. (Cf. Édouard Rod, Essai sur Gœthe, p. 14; Perrin, 1898.)
De même Sainte-Beuve se montrait fier de ses vers, souvent si ternes et si lourds, bien plus fier que de ses admirables études critiques; et le meilleur moyen de lui plaire était de lui vanter ses poésies et de les savourer avec lui.
De même encore Lamartine se croyant «un grand économiste, un grand vigneron et un grand architecte», et disant un jour au fils d’un de ses amis: «Jeune homme, regardez-moi bien là, au front, et dites-vous que vous venez de voir le premier financier du monde». (Ernest Legouvé, Soixante ans de souvenirs, t. IV, p. 199; Hetzel, s d.) «La gloire de Victor Hugo n’offusquait pas Lamartine, continue Legouvé; mais le titre de premier viticulteur de France, accordé à M. Duchâtel, le taquinait. «Ce n’est qu’un amateur, disait-il; moi, je suis un cep de nos collines.» Enfin, à Saint-Point, montrant avec complaisance à un visiteur un petit portique affreux, enluminé d’un coloris criard, et formé de deux colonnes appartenant à tous les ordres: «Mon cher, lui dit-il, dans cinquante ans, on viendra ici en pèlerinage; mes vers seront oubliés, mais on dira: «Il faut avouer que ce gaillard-là bâtissait bien!» (Ernest Legouvé, ibid.; — et Louis Ulbach, La Vie de Victor Hugo, p. 111-112; Émile Testard, 1886.)
Et Molière, «si excellent auteur pour le comique, et ayant un faible pour la couronne tragique». (Sainte-Beuve, Portraits littéraires, t. II, p. 55; nouvelle édit, Garnier, s. d.)
Et Jean-Jacques Rousseau se glorifiant avant tout de sa musique et de son Devin du village (Cf. Id., ibid., t. II, p. 125), et préférant son Lévite d’Éphraïm à tous ses ouvrages (Les Confessions, II, XI; t. VI, p. 136; Hachette, 1864).
L’admirable pastelliste Maurice-Quentin de La Tour, «enthousiaste des philosophes, bâtissait lui-même des systèmes, et se montrait humilié quand on lui parlait de ses pastels». (Cf. Marmontel, Mémoires, livre VI; t. II, p. 103; Jouaust, 1891; — et Antoine Guillois, Le Salon de Mme Helvétius, p. 28; C. Lévy, 1894.)
Girodet-Trioson préférait ses vers (qui d’ailleurs ne sont pas sans mérite) à ses dessins et à ses tableaux (Sainte-Beuve, ibid.);
Alfieri se piquait d’être fort en grec (Id., ibid.);
Byron d’être le premier nageur du Bosphore (Id., ibid.);
[p. 77]
Le célèbre compositeur Cherubini d’être un grand peintre (Sainte-Beuve, Portraits littéraires, t. II, p. 125).
Le sculpteur Canova avait, de son côté, la manie de peindre, et ses tableaux, «dont la médiocrité allait presque jusqu’au ridicule», il les préférait à ses superbes marbres. (Revue Napoléonienne, avril 1911, p. 108.)
Et Ingres et son violon, qui est le prototype du genre;
Et le grand peintre anglais Gainsborough entiché, lui aussi, de sa musique (Cf. Ernest Chesneau, L’Art et les Artistes modernes, p. 61; Didier, 1864);
Et Rossini et Alexandre Dumas père se croyant l’un et l’autre, ce qui était peut-être vrai, d’ailleurs, d’excellents cuisiniers (Cf. le journal Le Voleur, 1864, p. 349; et 1865, p. 462);
Et l’humoristique et génial dessinateur Gavarni, qui avait la passion des mathématiques, finit par s’y vouer entièrement, et «voulait refaire, selon sa chimère, la mécanique céleste et bouleverser les lois de la pesanteur». (Eugène Forgues, Les Artistes célèbres, Gavarni, p. 49, 54, 58; Rouam, s. d.)
Etc., etc.
Revenons à Chateaubriand.
Voici un singulier jugement porté par lui sur le général Bonaparte:
«... Sa gloire militaire? Eh bien! il en est dépouillé. C’est, en effet, un grand gagneur de batailles; mais, hors de là, le moindre général est plus habile que lui... On a cru qu’il avait perfectionné l’art de la guerre, et il est certain qu’il l’a fait rétrograder vers l’enfance de l’art.» (Chateaubriand, De Bonaparte et des Bourbons, dans le volume Mélanges politiques et littéraires, p. 183; Didot, 1868.)
Et ce vœu, non moins bizarre, exprimé par Chateaubriand, dans ses Mémoires d’outre-tombe (t. VI, p. 331; édit. Biré): «Les vieilles gens se plaisent aux cachotteries, n’ayant rien à montrer qui vaille. En exceptant mon vieux roi, je voudrais qu’on noyât quiconque n’est plus jeune, moi tout le premier, avec douze de mes amis.» Les douze amis ont-ils été consultés?
Dans les mêmes Mémoires, pour s’excuser de ses nombreuses citations, Chateaubriand émet ce curieux «avis au lecteur» (t. IV, p. 437): «Lecteur, si tu t’impatientes de ces citations, de ces récits, songe d’abord que tu n’as peut-être pas lu mes[p. 78] ouvrages, et qu’ensuite je ne t’entends plus; je dors dans la terre que tu foules; si tu m’en veux, frappe sur cette terre, tu n’insulteras que mes os».
Et ces phrases hyperboliques et étranges:
«Salut, ô mer, mon berceau et mon image! Je te veux raconter la suite de mon histoire: si je mens, tes flots, mêlés à tous mes jours, m’accuseront d’imposture chez les hommes à venir!» (Ouvrage cité, t. I, p. 64.)
«Il ne manque rien à la gloire de Julie (sœur de Chateaubriand): l’abbé Carron a écrit sa vie; Lucile (autre sœur de l’auteur) a pleuré sa mort.» (Ibid., t. I, p. 180.)
Chateaubriand raconte qu’on lisait, durant la Révolution, sur la loge du concierge de Ginguené, rue de Grenelle-Saint-Germain, cette inscription: «Ici on s’honore du titre de citoyen, et on se tutoie. Ferme la porte, s’il vous plaît.» (Ibid., t. II, p. 238.)
Ailleurs (t. V, p. 606), une note nous apprend que la mort du conseiller d’État Persil (1785-1870), ancien pair de France, fut annoncée en ces termes par le journal La Mode: «M. Persil est mort pour avoir mangé du perroquet».
On demande souvent quel est l’auteur de la locution tuer le mandarin; on l’a attribuée, entre autres, à Jean-Jacques Rousseau: c’est l’opinion de Balzac (Le Père Goriot, p. 150; Librairie nouvelle, 1859), du Grand Dictionnaire Larousse, etc. On la trouve, ainsi formulée, dans Le Génie du christianisme (livre VI, chap. 2, Du remords et de la conscience, t. I, p. 155; Didot, 1865): «O conscience! ne serais-tu qu’un fantôme de l’imagination, ou la peur des châtiments des hommes? Je m’interroge; je me fais cette question: Si tu pouvais, par un seul désir, tuer un homme à la Chine et hériter de sa fortune en Europe, avec la conviction surnaturelle qu’on n’en saurait jamais rien, consentirais-tu à former ce désir?» Etc.
Il ne messied pas de ranger au nombre des bévues et drôleries littéraires certaines outrecuidantes déclarations de Chateaubriand, dont, selon le mot de Sainte-Beuve (Causeries du lundi, t. I, p. 434), «la vanité persistante et amère, à la longue devient presque un tic».
«Mes écrits de moins dans mon siècle, proclame-t-il dans ses Mémoires d’outre-tombe (t. II, p. 179; édit. Biré), y aurait-il eu quelque chose de changé aux événements et à l’esprit de ce siècle?»[24].
[p. 79]
«Ce que le monde aurait pu devenir... (sans moi) se présentait à mon esprit.» (Ouvrage cité, t. VI, p. 226.)
«Si Napoléon en avait fini avec les rois, il n’en avait pas fini avec moi.» (Ibid., t. III, p. 3.)
«La paix que Napoléon n’avait pas conclue avec les rois, ses geôliers, il l’avait faite avec moi.» (Ibid., t. IV, p. 115.)
«C’est au moment dont je parle que j’arrivai au plus haut point de mon importance politique. Par la guerre d’Espagne, j’avais dominé l’Europe... après ma chute, je devins à l’intérieur le dominateur avoué de l’opinion...» (Ibid., t. IV, p. 342.)
«Je suis saisi du désir de me vanter: les grands hommes qui pullulent à cette heure démontrent qu’il y a duperie à ne pas proclamer soi-même son immortalité.» (Ibid., t. IV, p. 207)[25].
C’est ce que s’est dit et ce que nous dit Edmond de Goncourt, avec une bien enfantine et comique naïveté, dans son Journal (année 1888, t. VII, p. 277): «L’idée que la planète la Terre peut mourir, peut ne pas durer toujours, est une idée qui me met parfois du noir dans la cervelle. Je serais volé, moi qui n’ai fait de la littérature que dans l’espérance d’une gloire à perpétuité. Une gloire de dix mille, de vingt mille, de cent mille années seulement, ça vaut-il le mal que je me suis donné, les privations que je me suis imposées?» Etc.[26].
Comme si, en dépit du Musa vetat mori, et de la fière attestation de Malherbe:
Ce que Malherbe écrit dure éternellement
[p. 80]
(Cf. Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe, t. II, p. 184), le culte de la littérature et la connaissance de l’histoire ne devaient pas nous inspirer plus de bon sens, plus de raison, et surtout plus de modestie[27]! Comme si l’amour des Lettres ne suffisait pas à nous donner par lui-même la plus certaine et la meilleure des récompenses! Si le nom des Goncourt surnage quelque temps encore, c’est grâce, non pas à leurs écrits, qu’on ne lit déjà plus guère, mais à leur fortune, qui leur a permis de fonder une Académie gentiment rétribuée.
[p. 81]
Lamartine. Ses étourderies et incohérences. La phrase du chapeau, de l’académicien Patin, et autres phrases de longue haleine. Toujours de l’à peu près chez Lamartine. Le Lac. Lamartine accusé d’indécence. Jugements de Lamartine sur Rabelais, etc. Lamartine jugé par Flaubert.
Alfred de Vigny. — Auguste Barbier. Le substantif Centaure. — Gérard de Nerval.
Alfred de Musset. — Théophile Gautier. Bizarreries et inadvertances. Emploi des termes techniques.
Leconte de Lisle. — Théodore de Banville.. — Henri de Bornier. — Sully Prudhomme. — François Coppée. — Catulle Mendès. — Clovis Hugues.
Lamartine (1790-1869) a pris avec la grammaire des licences aussi fréquentes qu’exagérées. Il écrit, par exemple, vêtissait, au lieu de vêtait, non seulement dans ses vers, où il pouvait être gêné par le rythme, mais en prose: «Le soleil qui le vêtissait de son auréole de rayons.» (Le Tailleur de pierres de Saint-Point, III, p. 24; Hachette, 1899.)
Il a des inadvertances de ce genre:
Ah! qu’il pleure, celui dont les mains acharnées,
S’attachant comme un lierre aux débris des années,
Voit avec l’avenir...
(Nouvelles Méditations, V, p. 44; Hachette, 1858.)
Pour fournir une rime à lune, il crée l’incohérente locution l’une après l’une (au lieu de l’une après l’autre):
Deux vagues, que blanchit le rayon de la lune,
D’un mouvement moins doux viennent l’une après l’une
Murmurer et mourir.
(Ibid., XXIV, p. 152.)
Ou bien il fait rimer ténèbres avec cèdres:
Quelques-uns d’eux, errant dans ces demi-ténèbres,
Étaient venus planer sur les cimes des cèdres.
(La Chute d’un ange, 1re vision, p. 47; Gosselin, 1849.)
[p. 82]
Ou encore jour avec amours:
Treize ans pour une vierge étaient ce qu’en nos jours
Seraient dix-huit printemps pleins de grâce et d’amour.
(Ouvrage cité, p. 55.)
Plus tard, Lamartine a corrigé, a mis amours au pluriel, ce qui donne à la phrase un sens bizarre et grotesque.
Pour les besoins de la rime encore, il fait le mot orbite du masculin:
Ces astres suspendus dans le vide des airs
Croisant, sans se heurter, leurs orbites divers.
(Nouvelles Méditations, Réflexion, p. 228; — et Recueillements, Réflexion, p. 316; Hachette, 1902.)
... Jeune ami dont la lèvre,
Que le fiel a touché, de sourire se sèvre.
(Recueillements, XI, A M. Guillemardet, p. 46.)
Pour touchée.
Il dit à une femme (Nouvelles Méditations, XXIV, p. 158):
Souviens-toi de l’heure bénie
Où les dieux, d’une tendre main,
Te répandirent sur ma vie
Comme l’ombre sur le chemin.
Comme si l’on pouvait répandre quelqu’un.
Dans le même recueil (XV, Les Préludes, p. 99-100), il nous décrit en ces termes «un lugubre silence»:
... Et sur la foule immense
Plane, avec la terreur, un lugubre silence:
On n’entend que le bruit de cent mille soldats
Marchant, comme un seul homme, au-devant du trépas,
Le roulement des chars, les coursiers qui hennissent,
Les ordres répétés qui dans l’air retentissent,
Ou le bruit des drapeaux soulevés par les vents...
... Des sons discords que rendent chaque sens.
(La Mort de Socrate, p. 333; Hachette, 1860.)
Lamartine avait même d’abord mis: chaques avec une s
... que rendent chaques sens.
(Cf. Littré, Dictionnaire, art. Chaque.)
Il écrit dans Jocelyn (Prologue, p. 30; Hachette, 1858):
Comme luttent entre eux, dans la sainte agonie,
L’immortelle espérance et la nuit de la vie.
[p. 83]
Plus loin (Jocelyn, 1re époque, p. 46):
Des présents de l’époux les fragiles merveilles
Etalés sur le lit...
Au lieu d’étalées, qui gênait le vers.
Dans Jocelyn encore (4e époque, p. 158):
Que m’importe...
Ton travail en ce monde, et le pain dont tu vive,
pour rimer avec suive.
Dans Jocelyn toujours (9e époque, p. 334), il use de cette singulière périphrase:
Le sol boit au hasard la moelle de nos yeux.
C’est-à-dire nos larmes.
Il parle de la presque éternité des astres:
Astres, rois de l’immensité!
Insultez, écrasez mon âme
Par votre presque éternité!
(Harmonies, II, 20, p. 205; Hachette, 1856),
sans songer qu’on est éternel ou qu’on ne l’est pas du tout, qu’ici il n’y a pas de milieu ni de presque.
L’enfance et la vieillesse
Sont amis du Seigneur,
(Ibid., XIII, La Retraite, p. 287),
au lieu d’amies.
Dans Toussaint Louverture, «tragédie nègre qui parut, en 1843, dans la Revue des Deux-Mondes» (Cf. Le Journal, 12 février 1899), nous trouvons cet étrange distique:
Vous, semblables en tout à ce que fait la bête,
Reptiles dont je suis et la main et la tête.
«Une larme m’était montée au cœur», écrit Lamartine dans Graziella (p. 162; Hachette, 1865). D’ordinaire, c’est aux yeux que montent les larmes.
Dans Raphaël (p. 134; Hachette, 1859), cette phrase qu’on pourrait rapprocher de la fameuse phrase du chapeau[28], de[p. 84] l’académicien Patin: «C’était un de ces moments où l’âme a besoin de cette glace que l’accent d’un sage jette sur l’incendie du cœur pour retremper le ressort d’une énergique résolution».
Dans Raphaël encore (p. 6) et dans Les Confidences (p. 169 et 221; M. Lévy, 1855), Lamartine se plaît à faire manger du pain aux hirondelles, qui, affirment les encyclopédies et dictionnaires d’histoire naturelle, Larousse, par exemple, «sont exclusivement insectivores».
Dans son Histoire des Girondins, Lamartine, par une singulière inadvertance, fait de Drouet, le maître de poste de[p. 85] Sainte-Menehould, et du général Drouet d’Erlon, un seul et même personnage. (Cf. Ernest Beauguitte, L’Ame meusienne, p. 248, note 1)[29].
Dans son Histoire de la Restauration (t. IV, livre 34), il assure que l’évasion de La Valette ne fut pas étrangère à la sévérité du jugement qui atteignit le maréchal Ney. Or, le héros de La Moskowa fut fusillé le 7 décembre, et ce ne fut que le 20 décembre — treize jours plus tard — que le comte de la Valette parvint à s’évader. (Cf. Le Flambeau, 18 décembre 1915, p. 874.)
A d’autres endroits du même ouvrage, Lamartine place Marie-Joseph Chénier, mort en 1811, et Mme Cottin, morte en 1807, au rang des écrivains de la Restauration. Il confond Annibal avec Alcibiade, etc. (Cf. Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. IV, p. 406-407.)
«Il se glisse de l’à-peu-près dans tout ce que fait M. de Lamartine», a remarqué Sainte-Beuve (Ibid., p. 397 et suiv.) «... Ses livres d’histoire ne sont et ne seront jamais que de vastes et spécieux à-peu-près...»
Et cette phrase, extraite de la Préface générale des œuvres complètes de Lamartine, préface, d’ailleurs, très émouvante et fort belle: «Si j’avais à recommencer la vie, sachant ce que je sais, je n’y chercherais pas le bonheur, parce que je sais qu’il n’y est pas, mais j’y chercherais soigneusement l’obscurité et le silence, ces deux divinités domestiques qui gardent le seuil des heureux»; — comment l’interpréter? Puisqu’il n’y a pas de bonheur sur terre, comment peut-il y avoir des heureux, des mortels en possession du bonheur?
Le célèbre hémistiche du Lac, qui est dans toutes les mémoires:
O temps, suspends ton vol!
forme le début d’une strophe de l’académicien Thomas (1732-1785):
O temps, suspends ton vol, respecte ma jeunesse...
(Cf. Laharpe, Lycée ou Cours de littérature, t. III, 2e partie, p. 443.)
Qui se douterait que le chaste chantre du Lac et de Jocelyn a été, tout comme Racine (Cf. ci-dessus, p. 33), accusé d’indécence,[p. 86] disons le mot, d’obscénité? «Nous croyons rêver aujourd’hui, quand nous apprenons par sa Correspondance (de Lamartine) que la critique de 1823 accusa l’auteur des Nouvelles Méditations d’être à lui tout seul plus «obscène» que Catulle, Horace et l’Arioste ensemble, écrit Ferdinand Brunetière (Histoire et Littérature, t. III, p. 251)... Il faudrait dire alors qu’en 1823 la critique avait peu lu l’Arioste, et encore moins Catulle.» On voit, d’après une telle accusation, combien tout est relatif ici-bas.
Les jugements littéraires portés par Lamartine ont été fréquemment cités comme des prototypes d’inexactitude et de paralogisme. «Le sens critique lui fera si absolument défaut (à Lamartine) qu’il ne cessera d’étonner ses contemporains par l’étrangeté de ses appréciations littéraires», — ainsi s’exprime Raoul Rosières, dans un article très soigné et amplement documenté paru dans la Revue bleue (8 août 1891, p. 184). «Rabelais, dira-t-il, n’est qu’«un pourceau», La Fontaine rebute avec «ses vers boiteux, disloqués, inégaux, sans symétrie ni dans l’oreille ni sur la page» et «leur philosophie dure, froide et égoïste d’un vieillard»; Ossian, «ce Dante septentrional aussi grand, aussi majestueux, aussi surnaturel que le Dante de Florence, est plus sensible que lui»; Rousseau est «un cuistre»; André Chénier semble «un reflet de la Grèce, mais n’est pas un rayon». Lamartine aimera mieux une strophe de Byron ou de Sapho que «Molière, La Fontaine et Béranger»; il déclarera Ponsard «parfois supérieur à Corneille». Etc. On peut conclure, en somme, que Rabelais, La Fontaine, Molière, ces auteurs si français, ont été lettres closes pour le chantre du Lac.
A maint endroit de sa Correspondance, Flaubert se montre très dur pour Lamartine, écrivain «faux» par excellence (Cf. t. II, p. 93-95; Charpentier, 1889); «ses phrases n’ont ni muscles ni sang» (t. II, p. 221); «... Lamartine est un robinet» (t. II, p. 319); etc.
Devenu vieux, dans son chalet de Passy, Lamartine avait parfois de telles amnésies qu’entendant un jour un de ses amis lui lire la mort de Laurence, dans Jocelyn, il eut des larmes d’émotion et demanda: «De qui sont ces beaux vers?» (Mémorial de la librairie française, 3 avril 1913, p. 211.)
Ce qui est tout le contraire de La Fontaine demandant, lors de la première représentation de sa comédie Le Florentin: «Quel est donc le malotru qui a commis cette rapsodie?» (Cf. ci-dessus, p. 49).
Alfred de Vigny (1797-1863), tout comme Jacques Delille, cultive parfois volontiers la périphrase. Dans son poème Dolorida (Poésies complètes, p. 107; Charpentier, 1882), il nous parle de la chemise de son héroïne en ces termes, qu’on pourrait rapprocher de ceux de Racine, dans Britannicus (II, 2: «dans le simple appareil d’une beauté,» etc.):
Dolorida n’a plus que ce voile incertain,
Le premier que revêt le pudique matin,
Et le dernier rempart que, dans sa nuit folâtre,
L’Amour ose enlever d’une main idolâtre.
Et plus loin (Le Bal, p. 156), à propos d’un piano:
Sur l’instrument mobile, harmonieux ivoire,
Vos mains auront perdu la touche blanche et noire.
Ce vers d’Alfred de Vigny, si souvent cité,
J’aime le son du cor, le soir, au fond des bois
(Le Cor, p. 149),
se rapproche de très près d’un vers de Victor Hugo, dans Hernani (V, 3), prononcé par Dona Sol:
Ah! que j’aime bien mieux le cor au fond des bois!
Dans Stello (p. 342; Charpentier, 1882), Vigny nous montre une charrette, — gigantesque, sûrement, — «une charrette... chargée de plus de quatre-vingts corps vivants. Ils étaient tous debout, pressés l’un contre l’autre. Toutes les tailles, tous les âges...»
Dans ses Iambes (L’Idole, p. 37, 38; Dentu, 1882; et Larousse, art. Iambes et Poèmes), Auguste Barbier (1805-1882); détournant de son acception originaire le mot centaure (monstre fabuleux, moitié homme et moitié cheval) et l’employant dans le sens de «bon cavalier», «homme toujours à cheval», avait d’abord écrit, à propos de Bonaparte:
O Corse à cheveux plats! que ta France était belle
Au grand soleil de messidor!
C’était une cavale indomptable et rebelle,
.................
Tu parus, et sitôt que tu vis son allure,
Ses reins si souples et dispos,
Centaure impétueux, tu pris sa chevelure,
Tu montas botté sur son dos.
[p. 88]
Il va de soi qu’un centaure, d’après la définition même de ce mot, ne peut pas, botté ou non, monter à cheval. Aussi Auguste Barbier fit-il plus tard disparaître ce terme et modifia-t-il ainsi son vers:
Dompteur audacieux, tu pris sa chevelure.
Le même sens abusif du mot centaure se retrouve dans les Mémoires d’Alexandre Dumas (chap. 72; t. III, p. 122): «Ces Numides, cavaliers terribles, centaures maigres et ardents comme leurs coursiers...»
Et Gustave Chadeuil, dans Le Siècle (Cf. Larousse, art. Bévue, p. 663, col. 2): «L’hippodrome a repris son rang dans la série des plaisirs parisiens. Des chevaux courent dans la vaste arène, valsent et polkent, montés par des centaures».
Et Timothée Trimm, dans Le Petit Journal (même source): «Rigolo (un mulet) a vingt manières de lancer son prétendu dompteur dans l’espace, il rue, il allonge le cou, il se tient tout droit, il se couche au besoin. Un centaure y perdrait ses éperons».
Un centaure avec des éperons!
«Les chevaux ont été inventés pour l’agrément des jolies femmes, et si les hommes étaient des centaures, ça n’en vaudrait que mieux,» estime bien singulièrement un personnage de Paul de Kock (La Mare d’Auteuil, p. 79; Rouff, s. d., in-4).
Ajoutons qu’un écrivain grec, «ayant à parler d’un centaure, l’appelle un homme à cheval sur lui-même». (J.-J. Barthélemy, Voyage du jeune Anarcharsis, t. IV, chap. 58, p. 478; Didot, an XII.)
Un article du Figaro (9 décembre 1874) nous apprend que nombre des devises figurant autrefois sur les mirlitons:
Je vous aime ardemment,
C’est ce qui fait mon tourment;
Etc., etc.,
sont de Gérard de Nerval (1808-1855), qui en livra un jour cinq cents pour 50 francs.
Alfred de Musset (1810-1857), dans Les Marrons du feu (Premières Poésies, p. 63; Charpentier, 1861), nous montre un poisson qui regarde en silence, comme si les poissons avaient[p. 89] coutume de regarder autrement, et avaient jamais reçu le don de la parole:
L’esturgeon monstrueux soulève de son dos
Le manteau bleu des mers, et regarde en silence
Passer l’astre des nuits...
Ce qui rappelle le fameux vers de l’original et fantaisiste Saint-Amant (1594-1661):
Les poissons ébahis les regardent passer.
(Cf. Théophile Gautier, Les Grotesques, p. 180; M. Lévy, 1859.)
Plus loin (L’Andalouse, p. 87), Musset nous demande si nous ayons vu dans Barcelone, qui appartient à la Catalogne,
Une Andalouse au sein bruni.
Rien n’empêcherait, en effet, une Andalouse d’habiter la Catalogne; mais, comme le remarque très justement M. Maurice Donnay, dans la première de ses Conférences sur Alfred de Musset (p. 3; édit. des Lectures pour tous), «une Andalouse dans Barcelone, c’est, pour fixer les idées, une Provençale en Amiens. Cela peut se trouver, mais on préférerait en Avignon».
Dans Venise (Premières Poésies, p. 98), le poète avait d’abord écrit:
Dans Venise la rouge
Pas un cheval qui bouge.
Un cheval à Venise! Dans l’édition de 1840, Musset remplaça son intempestif cheval par un bateau:
Pas un bateau qui bouge.
«Mais, en 1830, c’est une impression vénitienne vue du perron de Tortoni.» (Maurice Donnay, ibid.)
Dans sa Nuit de mai (Poésies nouvelles, p. 48; Charpentier, 1864), Musset prétend que
La bouche garde le silence
Pour écouter parler le cœur,
et que (Ibid., p. 49)
... le vent d’automne
... se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau...
Il nous assure, dans le même poème (p. 44), que
... la bergeronnette, en attendant l’aurore,
Aux premiers buissons verts commence à se poser;
[p. 90]
oubliant que la bergeronnette se pose sur le sol, sur les pierres, sur les toits, sur un tronc d’arbre, «sur un saule cultivé en têtard», mais non sur les branches, ni sur les buissons, surtout quand ils sont garnis de feuilles, quand ils sont «verts». (Cf. Brehm, L’Homme et les Animaux, Les Oiseaux, t. III, p. 750-752.)
... Si je doute des larmes
C’est que je t’ai vu pleurer,
écrit Musset dans La Nuit d’octobre (Poésies nouvelles, p. 70), en s’adressant:
... à toi qui la première
M’as appris la trahison.
Vu pour vue.
Ces vers de Rolla (Ibid., p. 6) ont souvent été déclarés incompréhensibles, «n’ayant aucun sens» (Cf. L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 10 septembre 1901, col. 335):
Jacque était grand, loyal, intrépide et superbe.
L’habitude, qui fait de la vie un proverbe,
Lui donnait la nausée. Heureux ou malheureux,
Il ne fit rien comme elle, et garda pour ses dieux
L’audace et la fierté, qui sont ses sœurs aînées.
Les sœurs aînées de qui?
Dans Namouna (I, 47; Premières Poésies, p. 323), on trouve un vers de treize syllabes:
Jamais confessionnal ne vit de chapelet
Comparable en longueur...
L’expression «beau comme le génie», qui se lit dans le même poème (II, 25, p. 340):
Pensif comme l’amour, beau comme le génie,
a été employée par Mirabeau dans son portrait de Frédéric II: «Brillant de toutes les qualités physiques et morales, fort comme sa volonté, beau comme le génie...» (Mirabeau, De la monarchie prussienne; Œuvres, t. II, p. 12; édit. Vermorel.)
Dans ce même poème de Namouna (II, 35, p. 343), ce vers:
Rend haine contre haine, et dédain pour dédain,
existe dans Corneille (Pertharite, II, 1):
Rendre haine pour haine, et dédain pour dédain.
[p. 91]
Enfin l’idée exprimée par ces vers de Rolla (V, Poésies nouvelles, p. 20):
Ah! comme les vieux airs qu’on chantait à douze ans
Frappent droit dans le cœur aux heures de souffrance!
Comme ils dévorent tout! comme on se sent loin d’eux!
Comme on baisse la tête en les trouvant si vieux!
se retrouve dans Les Confessions de J.-J. Rousseau (Partie I, livre I; Œuvres complètes, t. V, p. 318; Hachette, 1864): «... Je me surprends quelquefois à pleurer comme un enfant en marmottant ces petits airs d’une voix déjà cassée et tremblante. Il y en a un surtout qui m’est bien revenu», etc.
Théophile Gautier (1811-1873) avait d’abord mis au début de la strophe LXV de son poème Albertus (Poésies, p. 28; Charpentier, 1858):
Le papier que la belle, avec un air d’angoisse,
Dès la strophe 36 de ce poème froisse...
36 en chiffres arabes. Un ami lui ayant fait observer que trente-six a trois syllabes:
«Je le sais bien, répondit Gautier; aussi est-ce pour cela que j’ai exprimé le nombre par des chiffres».
Il se ravisa cependant, et modifia ainsi son second vers:
Dans sa petite main aux ongles roses froisse.
(Cf. La République française, 2 juillet 1898.)
Cette strophe n’a d’ailleurs pas eu de chance, car on y trouve cette grossière faute (p. 29, même édition):
... l’écriture et le tour
Ont quelque chose en soi qui trahissent la femme.
Pour trahisse.
Et cette cacophonie (même page, strophe LXVI):
Le papier se tordit comme un damné du Dante
En dardant...
Du Dante, pour de Dante, puisqu’on ne doit pas dire Le Dante, l’article, en italien, se mettant devant le nom (l’Alighieri) et non devant le prénom (Dante pour Durante): cf. Larousse.
[p. 92]
Dans le même recueil (Paysages, VIII, p. 81), le martinet est confondu avec l’hirondelle:
Le martinet, sentant l’orage, près du sol,
Afin de l’éviter, rabat son léger vol.
C’est l’hirondelle qui rase le sol aux approches de l’orage; le martinet, lui, grâce à l’extrême rapidité de son vol, s’empresse de quitter la région orageuse.
Page 210 du même recueil (Les Vendeurs du temple, III) se trouve un verbe des plus rares, le verbe retuer, tuer une seconde fois:
Ils joignaient (des damnés, des spectres), pour prier, leurs deux mains de squelette,
Mais tu les retuais, sans plus sentir d’effroi
Que pour guillotiner un véritable roi.
Voltaire, dans Candide (Cf. Littré) a aussi employé retuer: «Je te retuerais si j’en croyais ma colère!»
Plus loin (p. 334, Sérénade), un amant demande à sa maîtresse, qui se trouve sur un balcon, de vouloir bien défaire son peigne, dénouer ses cheveux et les pencher vers lui, pour qu’il puisse s’en servir comme d’échelle et aller la rejoindre:
... Défais ton peigne,
Penche sur moi tes cheveux longs,
............
Aidé par cette échelle étrange,
Légèrement je gravirai,
Etc., etc.
Bien étrange échelle, en effet, et dont on ne se servirait pas sans faire hurler de douleur la señora, et très probablement la faire choir à terre.
Et ces amusantes phrases, dans Mademoiselle de Maupin:
«La vieille Égypte bordait ses routes d’obélisques, comme nous les nôtres de peupliers; elle en portait des bottes sous ses bras, comme un maraîcher porte ses bottes d’asperges» (Préface, p. 27; Charpentier, 1866).
«Le rubis rougirait de plaisir de briller au bout vermeil de son oreille délicate» (p. 101).
«Il était cinq heures du matin lorsque j’entrais dans la ville. Les maisons commençaient à mettre le nez aux fenêtres» (p. 343).
Et l’auteur a trouvé cette dernière locution tellement à son goût qu’il l’a employée à plusieurs reprises: «Ses diables de vers (poésies) lui grouillaient dans la poche, et faisaient tous leurs[p. 93] efforts pour mettre le nez à la fenêtre.» (Les Jeunes-France, p. 132; Charpentier, 1879.) «...Son mouchoir mettant le nez hors de sa poche...» (Ibid., p. 180.)
Et cette affirmation que Le Cri de Paris (27 septembre 1908, p. 11) dit avoir rencontrée aussi dans Mademoiselle de Maupin: «Il faut avoir un pavé dans le ventre, au lieu de cœur».
Dans Mademoiselle de Maupin encore, un des personnages s’écrie (p. 207-208): «Mon cœur a sauté dans ma poitrine comme saint Jean dans le ventre de sainte Anne, lorsqu’elle fut visitée par la Vierge». Phénomène extraordinaire, puisque la mère de saint Jean est, non pas sainte Anne, mais sainte Élisabeth.
Dans Les Jeunes-France (p. 127), il est question de l’écriture anglaise «penchée de gauche à droite», ce qui est tout le contraire: la pente de l’écriture anglaise va de droite à gauche.
Les médaillons littéraires réunis par Théophile Gautier sous le titre de Les Grotesques (Didot, 1844, 2 vol.) contiennent de nombreuses inadvertances que Sainte-Beuve a relevées, en partie, dans un de ses articles (Portraits contemporains, t. V, p. 125 et suiv.), et que l’auteur n’a pas pris soin de corriger, car on les retrouve dans l’édition publiée par Michel Lévy en 1859. «M. Théophile Gautier nous dira en un endroit (t. II, p. 315) que Mme de Sévigné et sa coterie étaient pour Pradon contre Racine; c’est sans doute Mme des Houlières qu’il a voulu dire... Le poète nous cite (t. I, p. 156) comme le plus charmant endroit et comme le plus adorable morceau de Théophile une page de prose qui devient parfaitement inintelligible telle qu’il la transcrit, et dans laquelle des lignes indispensables au sens (ligne 16, p. 57) ont été omises. Dans l’histoire abrégée du sonnet qu’il retrace d’après Colletet (t. II, p. 43), nous croirions, d’après lui, que Pontus de Thiard a eu pour maîtresse poétique Panthée, tandis que c’est Pasithée qu’il faut lire; Olivier de Magny n’a pas célébré non plus Eustyanire, mais bien Castianire; de même aussi que, tout à côté de là (p. 31), les Isis nuagères ne sauraient être que des Iris. Mais, continue Sainte-Beuve, par quel bouleversement de chiffres Chapelain a-t-il pu naître, selon notre auteur, en 1569, c’est-à-dire en plein seizième siècle?» Etc.
A propos du brillant et savant style de Théophile Gautier, Émile Faguet, dans ses Études littéraires sur le dix-neuvième siècle (p. 323), a émis les très judicieuses considérations suivantes:
«... Ce style a ses défauts pourtant. Il est quelquefois pénible. L’emploi du terme technique est une très bonne chose; il n’est[p. 94] que le scrupule du terme propre. Il est certain toutefois qu’il ne faut pas en abuser jusqu’à rendre l’usage du dictionnaire indispensable à un lecteur lettré. Le style d’un bon auteur est avant tout le style d’une conversation entre «honnêtes gens» convenablement instruits. Il y a affectation à nous parler dans un roman la langue d’un traité d’architecture. Est-il vrai que Gautier disait en riant: «Il faut, dans chaque page, une dizaine de mots que le bourgeois ne comprend pas. C’est ce qui relève pour lui la saveur du morceau?[30]» J’ai peur qu’il n’ait un peu donné dans ce moyen trop facile, et qui n’est pas sans charlatanisme, de piquer l’attention.
«Notez que, poussé à une certaine outrance, ce moyen va contre le but. Le but légitime, ici, c’est de renouveler la langue, de verser dans l’usage un certain nombre de mots absolument justes, précisément parce qu’ils n’ont pas encore été déformés par l’usage courant. En introduire quelques-uns, bien accompagnés, rendus clairs par le contexte, c’est les faire adopter; les prodiguer, c’est réussir à les faire oublier à mesure qu’on les enseigne, et ne produire qu’un effet de papillotage bien frivole, jeter de la poudre aux yeux, sous ombre d’être clair.»
Leconte de Lisle (1820-1894) n’a cessé d’hésiter sur l’orthographe du nom de Caïn, le meurtrier d’Abel, qu’il a si magnifiquement chanté. Dans la première édition de ses Poèmes barbares, «il avait écrit avec un K, Kaïn, le nom du déshérité qu’il réhabilitait. Dans la réédition de ces poèmes, il modifia cette orthographe parce qu’on lui fit observer que le premier-né selon la Genèse avait été nommé par Ève «Celui qui est acquis». Du verbe hébraïque qoûn, acquérir, serait dérivé qaïn[31]. Mais je ne sais quel savant entreprit de lui démontrer que la forme[p. 95] consacrée par tant de siècles, la forme Caïn, avec un C, est la meilleure.» (Fernand Calmettes, Leconte de Lisle et ses amis, p. 328.)
La belle strophe qui termine le Dies iræ des Poèmes antiques de Leconte de Lisle (fin du recueil):
Et toi, divine Mort, où tout rentre et s’efface,
Accueille tes enfants dans ton sein étoilé,
Affranchis-nous du temps, du nombre et de l’espace,
Et rends-nous le repos que la vie a troublé,
forme comme l’écho d’un vers de Pongerville, dans sa traduction de Lucrèce: Cette nature, par qui tout être,
Dans son premier asile à sa voix rappelé,
Retrouve le repos que la vie a troublé.
(Pongerville, Notice sur Millevoye, en tête des Poésies de Millevoye, p. 18; Charpentier, 1851.)
Théodore de Banville (1823-1891) écrit, dans ses Odes funambulesques (Une vieille lune, p. 69; Charpentier, 1883):
Un corset un peu juste, une étroite chaussure
Ont-ils égratigné d’une rose blessure
Tes beaux pieds frissonnants...
Un corset qui égratigne des pieds?
Dans ses Idylles prussiennes (Sabbat, p. 415, même volume), Banville fait d’une urne qui n’a plus d’anse un modèle de folie:
Germania mène la danse,
Plus folle qu’un cheval sans mors
Ou qu’une urne qui n’a plus d’anse,
Sur la colline où sont les morts.
Pour l’inauguration du buste de François Ponsard à l’Académie, Henri de Bornier (1825-1901) composa une pièce de vers qui fut imprimée la veille de la cérémonie et distribuée aux journaux. Dans cet éloge funèbre, le poète, s’adressant à l’auteur d’Agnès de Méranie, s’écriait:
Tu mourus en pleine lumière,
Et la victoire coutumière
T’accompagna jusqu’au tombeau.
Quelles ne furent pas la stupeur et la douleur de Bornier en lisant le lendemain, dans un grand journal:
[p. 96]
Tu mourus en pleine lumière,
Et Victoire, ta couturière,
T’accompagna jusqu’au tombeau!
(Cf. L’Avenir de la Meuse, 22 mars 1885.)
On lit, dans La Fille de Roland (I, 4) du même poète:
... Chrétienne,
Ma générosité doit répondre à la tienne.
Et dans Corneille, Le Cid (III, 4), le même vers:
De quoi qu’en ta faveur notre amour m’entretienne,
Ma générosité doit répondre à la tienne.
Henri de Bornier s’occupait autant sinon plus de viticulture que de poésie; il possédait, dans le midi de la France, un cru renommé, et «était plus fier peut-être de son vin que de ses vers».
«Et comme il a raison!» concluait l’auteur des Corbeaux, le féroce Henry Becque. (Cf. Le Journal, 9 août 1898.)
Le grand poète et profond penseur Sully Prudhomme (1839-1907) estime que
Le vrai de l’amitié, c’est de sentir ensemble.
(Les Vaines Tendresses, p. 5.)
Et dans son poème Le Gué (Poésies, t. I, p. 237), il déclare que
... tous, même les morts, ont fui jusqu’au dernier.
Ce qui rappelle cette phrase du romancier Gustave Aimard (Les Rois de l’Océan, t. I, chap. 5, p. 112; Roy, 1891): «Ils se trouvèrent à plusieurs milles de ces deux cadavres, dont l’un était plein de vie.»
François Coppée (1842-1908), qui a si bien chanté la vie et les souffrances des petits et des humbles, tombe fréquemment et pour ainsi dire forcément dans la banalité et la vulgarité. Son Petit Épicier (Poésies, t. II, p. 15 et suiv.; Lemerre, s. d., in-12) est célèbre par son prosaïsme:
C’était un tout petit épicier de Montrouge,
Et sa boutique sombre, aux volets peints en rouge,
Exhalait une odeur fade sur le trottoir.
.......... des tonneaux
[p. 97]De harengs saurs ou bien des caisses de pruneaux.
.................
Il partage le lit d’une femme insensible,
Et tous les deux ils ont froid au cœur, froid aux pieds.
..................
.......... Il trouve
La colle et le fromage ignobles à toucher.
.......... il oublie,
Et, lent, casse son sucre avec mélancolie.
Et ailleurs:
Le dimanche, ils allaient souvent se promener
Ensemble au Luxembourg, donnaient du pain aux cygnes,
Et revenaient.
(Un Fils, Poésies, t. II, p. 22.)
Ils songent à l’avance aux lessives futures,
Et, vers le temps des fruits, ils font des confitures.
(Petits Bourgeois, ibid., p. 33.)
Sur la berge, là-bas, la foule est assemblée,
Et la gendarmerie est en pantalon blanc.
(Au bord de la Marne, ibid., p. 164.)
Je pris le bateau-mouche au bas du Pont-Royal,
Et sur un banc, devant le public trivial,
Je vis un ouvrier avec sa connaissance
Qui se tenaient les mains...
(En bateau-mouche, ibid., p. 195.)
Et, ce qui ne laisse pas de déconcerter et d’étonner, dans le même tome II de ses Poésies (Le Cahier rouge, Prologue, p. 218), Coppée fait cette déclaration:
... J’ai l’horreur du banal.
Il est vrai qu’il faudrait s’entendre sur le sens du mot «banal».
Dans L’Indépendance de l’Est du 21 février 1900, je rencontre cette phrase de Coppée: «Elle venait de s’asseoir entre ses deux filles, deux jumelles âgées l’une et l’autre de dix-huit ans».
Suivant l’exemple de Lamartine, que nous avons vu écrire l’une après l’une, au lieu de l’une après l’autre, et pour obtenir une rime à lune (Cf. ci-dessus, p. 81), Catulle Mendès[p. 98] (1843 ou 1841-1909) crée la locution l’autre et l’une, au lieu de l’une et l’autre:
Et tandis que, claire lacune,
S’ouvre en la nuit brune la lune,
Pâmez-vous d’amour l’autre et l’une.
(Catulle Mendès, Poésies, L’hymnaire des amants, t. III, p. 256; Charpentier, 1892.)
Elle a parfois de terribles exigences, la rime!
Clovis Hugues (1851-1907), qui était de Marseille, il est vrai, a découvert un jour qu’il y avait trois moitiés dans un tout:
Quoi! parce qu’un coquin qui s’avance en rampant,
Moitié tigre, moitié chacal, moitié serpent.
(Cf. L’Écho de la semaine, 24 octobre 1897, article signé Le Chercheur.)
La même découverte a été faite par le romancier François de Nion, dans un feuilleton intitulé Pendant la guerre (dans Le Journal, 17 mai 1915, in fine): «Moitié plâtre, moitié briques, moitié bois, ces maisons servaient d’habitations à des rentiers d’Aix-la-Chapelle.»
[p. 99]
Victor Hugo. Ses erreurs, inadvertances, réminiscences, énumérations de termes rares, obscurités, jeux de mots, drôleries, etc. Caractéristique de Victor Hugo: force, puissance, amour pour les petits et les humbles; éloge de la bonté. Discours et lettres: abus de l’antithèse. Locutions favorites. Particularités orthographiques, etc.
On peut professer pour un écrivain la plus profonde admiration, sans pour cela se dissimuler ses fautes, et fermer les yeux sur ses inadvertances, ses singularités et bizarreries. C’est d’ailleurs le précepte d’Horace (Art poétique, 351): Ubi plura nitent in carmine...
Victor Hugo (1802-1885), dans son ode Sur le rétablissement de la statue de Henri IV (Odes et Ballades, I, 6, p. 51; Hachette, 1859), confond Ivry-la-Bataille (Eure) avec Ivry-sur-Seine, près de Paris, «faute énorme», qu’il reconnaît d’ailleurs avec bonne grâce à la fin du volume (p. 376).
Dans Le Dernier Chant et Le Génie (Ibid., II, 10, et IV, 6, p. 123 et 195), nous nous heurtons à deux vers bien rugueux et malsonnants:
Fait parler le pardon par la voix des douleurs,
et
Au sénat parla par ta voix.
Mais ces cacophonies sont rares chez notre poète.
Rapprochons ce vers de la même ode Le Dernier Chant (p. 124):
L’éclair remonte au ciel sans avoir foudroyé,
de ce passage de Namouna d’Alfred de Musset (I, 48; Premières Poésies, p. 346; Charpentier, 1861):
Tu n’es pas remonté, comme l’aigle en son aire
Sans avoir sa pâture, ou comme le tonnerre
Dans sa nue aux flancs d’or, sans avoir foudroyé.
[p. 100]
Dans Le Sacre de Charles X (Odes et Ballades, III, 4, p. 144) figure le mot hébreu Sabaoth, qui signifie «des armées» (Cf. Littré), et que le poète emploie ainsi:
Vous êtes Sabaoth, le Dieu de la victoire.
c’est-à-dire: «Vous êtes des armées», ce qui ne s’explique guère.
La même expression, ou une expression encore plus obscure et plus mauvaise, se trouve dans Les Châtiments (I, 6, Le Te Deum... p. 28; Hetzel, s. d.):
... Te Deum! nous vous louons, Dieu fort,
Sabaoth des armées!
Autrement dit: «Des armées des armées», ce qui n’offre aucun sens.
Dans Le Sacre de Charles X encore (Odes et Ballades, même page), le poète formule ainsi notre ancien cri de guerre:
Montjoye et Saint-Denis!
qu’on retrouve d’ailleurs, avec cette même conjonction et, chez plusieurs de nos poètes:
Montjoie et Saint-Denis! Dunois, à nous les chances!
(Casimir Delavigne, Louis XI, III, 13.)
Montjoie et Saint-Denis! Charles à la rescousse!
(Alexandre Dumas, Charles VII, IV, 4.)
Voir aussi François Coppée et Armand d’Artois, La Guerre de cent ans, prologue, sc. 10, et II, 8.
Ainsi présentée, cette locution «ne signifie rien», déclare Littré.
Le vrai cri de guerre de nos pères était Mont-joie, ou bien Mont-joie Saint-Denis. «La Mont-joie Saint-Denis, ou, simplement, la Mont-joie, était le nom de la colline près Paris où saint Denis subit le martyre; ainsi dite, parce qu’un lieu de martyre était un lieu de joie pour le saint qui recevait sa récompense. La Mont-joie Saint-Denis signifie la Mont-joie de saint Denis, selon l’ancienne règle qui rendait le génitif latin par le cas oblique.» Etc. (Littré, art. Mont-joie). Ce sont les nécessités de notre prosodie, l’élision de l’e final de Mont-joie, qui a contraint les poètes à vicier cette locution et à en faire un non-sens.
En parlant de Napoléon, dans Les Deux Iles (Odes et Bal[p. 101]lades, III, 6, p. 154), le poète émet cette curieuse réflexion ou supposition, que Dieu a fait naître et mourir Napoléon sur «deux îles isolées»,
Afin qu’il pût venir au monde
Sans qu’une secousse profonde
Annonçât son premier moment,
Et que sur son lit militaire,
Enfin sans remuer la terre,
Il pût expirer doucement.
Ce vers:
Naître, vivre et mourir dans le champ paternel
(Odes et Ballades, V, 3, Au vallon de Cherizy, p. 240),
fait songer au début d’un poème de Sainte-Beuve (Poésies, Les Consolations; VIII, à Ernest Fouinet, p. 225; Charpentier, 1890):
Naître, vivre et mourir dans la même maison.
Mon esprit de Pathmos connut le saint délire
(Odes et Ballades, V, 14, Actions de grâces, p. 264).
D’où peut-être le mot «féroce» de Louis Veuillot sur Victor Hugo: «C’est Jocrisse à Pathmos». (Cf. Émile Faguet, Études littéraires sur le dix-neuvième siècle, p. 165.)
Dans les jolis vers du Pas d’armes du roi Jean (Odes et Ballades, ballade XII, p. 346), le monarque annonce à son grison: «Je te baille, pour ripaille, plus de paille, plus de son, qu’un gros frère ne peut faire de grimaces en priant;» ce qui ne peut guère indiquer quelle est ou quelle sera cette quantité de paille et de son.
Dans les Odes et Ballades encore (Ballade XIII, La Légende de la nonne, p. 351), le grand poète prétend que, tout comme «la nonne aima le brigand»,
On voit des biches qui remplacent
Leurs beaux cerfs par des sangliers.
Mais il omet de nous dire où s’est jamais vu pareil accouplement.
Passons aux Orientales.
Dans Le Feu du ciel (I, 8, p. 20; Hachette, 1858), Victor Hugo décrit un îlot qui fond et s’efface
Comme un glaçon froid.
Un glaçon est-il jamais chaud?
[p. 102]
Dans Canaris (II, p. 23), le terme de marine ancre est employé au masculin et avec le sens de grappin, ce qui est doublement étrange:
... Son ancre noir s’abat
Sur la nef qu’il foudroie.
Une ancre ne se jette jamais sur les nefs; c’est le grappin qu’on lance dans ce cas. L’erreur a du reste été rectifiée dans l’édition Hetzel-Quantin.
Dans La Bataille perdue (XVI, p. 78); «ce champ meurtrier» (au singulier) rime avec les étriers (au pluriel), faute qui n’a été corrigée qu’après la mort de Victor Hugo, dans l’édition de l’Imprimerie Nationale, où on lit:
... ces champs meurtriers.
Plus loin (XIX, Sara la Baigneuse, p. 83), le poète nous peint Sara battant
... d’un pied timide
L’onde humide,
comme si l’onde n’était pas toujours humide.
Plus loin encore, dans le même recueil (XXXI, Grenade, p. 114), il dit qu’
Alicante aux clochers mêle les minarets,
lorsque, observe le Guide Joanne (Espagne et Portugal, 1909, p. 295), il n’y a aucun minaret à Alicante.
Dans Navarin (V, 6, p. 45-47), de très nombreuses sortes de bateaux sont énumérées: brûlots, chébecs, yachts, galères, caïques, tartanes, sloops, jonques, goélettes, barcarolles, frégates, caravelles, dogres, bricks, brigantines, balancelles, lougres,
Galéasses énormes,
Vaisseaux de toutes formes,
Vaisseaux de tous climats,
yoles, mahonnes, prames, felouques, polacres, chaloupes, lanches, bombardes, caraques, gabarres, etc.
J’ignore si le grand poète en a oublié quelqu’une, mais on sait combien il se complaisait dans ces kyrielles de termes techniques. On en retrouve chez lui quantité d’exemples, notamment dans La Légende du beau Pécopin (Le Rhin, t. II, chap. 8, p. 69 et suiv.; Hetzel-Quantin, s. d., in-18), où,[p. 103] entre autres listes de mots rares, on voit paraître ou reparaître, parmi les embarcations, les frégatons, felouques, polaques ou polacres, caracores, etc.
La pièce Les Djinns (Les Orientales, XXVIII, p. 103 et suiv.) est un poème des plus curieux, dont les quinze strophes, de huit vers chacune, vont, comme quantité métrique, d’abord crescendo, puis decrescendo. Le poème débute par une strophe dont chaque vers a deux syllabes seulement:
Murs, ville
Et port,
Asile
De mort,
.....
Puis vient une strophe de vers de trois syllabes:
Dans la plaine
Naît un bruit,
C’est l’haleine
De la nuit.
......
Puis quatre syllabes:
La voix plus haute
Semble un grelot.
......
Ensuite une strophe de vers de cinq syllabes, puis une de six, une de sept, une de huit, et une de dix. Arrivés là, nous rétrogradons: une strophe de huit, puis de sept, de six, de cinq, de quatre, de trois et de deux syllabes. C’est un vrai tour de force.
La pièce Lazzara (Ibid., XXI, p. 88-90) a été drôlement parodiée dans le roman de Louis Reybaud, Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des Républiques (chap. 28, Les Infortunes d’une Égérie, p. 270-272; M. Lévy, 1861), où cette Lazzara représente une sorte de Muse du romantisme.
Voici quelques fragments du texte de Victor Hugo:
Comme elle court! Voyez...
Elle est grande, elle est svelte...
Ce n’est point un pacha, c’est un klephte à l’œil noir
Qui l’a prise, et qui n’a rien donné pour l’avoir,
Car la pauvreté l’accompagne;
Un klephte a pour tous biens l’air du ciel, l’eau des puits,
Un bon fusil bronzé par la fumée, et puis
La liberté sur la montagne.
[p. 104]
Et dans Louis Reybaud:
Voyez comme elle engraisse...
Elle est ample, elle est vaste...
Ce n’est pas le bourgeois, c’est le peuple aux faubourgs
Qui l’a prise, et qui n’a rien donné pour débours;
Car la pauvreté l’accompagne.
Le peuple a pour tous biens le vin bleu, l’eau des puits,
Une blouse percée aux deux coudes, et puis
Quelques amis sur la Montagne.
Qu’est-ce que le «nard cher aux époux» dont parle Victor Hugo dans La Prière pour tous (Les Feuilles d’automne, XXXVII, 7, p. 123; Hachette, 1861)?
O myrrhe! ô cinname!
Nard cher aux époux!
Eugène Noël, le savant naturaliste et lettré, ancien bibliothécaire de Rouen, répond à cette question dans sa Vie des fleurs (LXXI, p. 203; Hetzel, s. d.): «L’ancienne médecine, écrit-il, n’a pas connu de plante plus précieuse que la valériane: de quelle maladie n’a-t-elle pas guéri?... De ses racines on tirait autrefois le nard, tant célébré par les poètes...»
Virgile est un des auteurs latins les plus familiers à Victor Hugo, qui, aux approches de la vieillesse, en savait encore par cœur, dit-on, des centaines et centaines de vers. On retrouve trace de cet amour de Victor Hugo pour Virgile dans nombre de ses volumes; — dans Les Feuilles d’automne (38, Pan, p. 130):
Où le chevreau lascif mord le cytise en fleurs;
dans Les Chants du Crépuscule (XXVI, à Mlle J..., p. 233; Hachette, 1861):
Et la haine monte à mon œuvre
Comme un bouc au cytise en fleur;
vers qui rappellent plusieurs passages des Bucoliques (I, 79; II, 63):
... capellæ,
Florentem cytisum et salices carpetis amaras...
Florentem cytisum sequitur lasciva capella.
O Virgile! ô poète! ô mon maître divin!
s’écrie Victor Hugo au début d’une pièce des Voix intérieures[p. 105] (VII, p. 56; Hachette, 1859) consacrée tout entière à Virgile.
Et plus loin (Ouvrage cité, XVIII, p. 80):
Dans Virgile parfois, dieu tout près d’être un ange,
Le vers porte à sa cime une lueur étrange.
«La Bible est son livre. Virgile et Dante sont ses divins maîtres», déclare notre poète, en parlant de lui, dans la préface de Les Rayons et les Ombres (p. 145; Hachette, 1859).
Prenez ce vieux Virgile où tant de fois j’ai lu!...
Lisez mon doux Virgile...
(Ibid., VIII, à M. le D. de ***, p. 183.)
La fin de cette même pièce VIII (p. 184):
Car les temps sont venus qu’a prédits le poète!
Aujourd’hui, dans ces champs, vaste plaine muette,
Parfois le laboureur, sur le sillon courbé,
Trouve un noir javelot qu’il croit des cieux tombé,
Puis heurte pêle-mêle, au fond du sol qu’il fouille,
Casques vides, vieux dards qu’amalgame la rouille,
.................
n’est que la traduction d’un célèbre passage des Géorgiques (I, 493 et suiv.):
Scilicet et tempus veniet, quum finibus illis
Agricola, incurvo terram molitus aratro,
Exesa inveniet scabra robigine pila,
...............
Et «les chiens obscènes» mentionnés dans Luna des Châtiments (VI, 7; p. 198, Hetzel, s. d.) ne sont non plus que la traduction des obscenæque (ou obscenique) canes des Géorgiques (I, 470).
Ces vers des Chants du crépuscule (V, p. 173; Hachette, 1861):
Vous pouvez, ô mon capitaine,
Barrer la Tamise hautaine,
rappellent ceux de Lebrun-Pindare (Odes: Qu’il est un légitime orgueil..., p. 511; Didot, 1858):
En vain la Tamise hautaine
Croit voir aux fastes de la Seine...
Dans Les Rayons et les Ombres (XIX, Ce qui se passait aux Feuillantines..., p. 210; Hachette, 1859):
Nous sommes la nature et la source éternelle
Où toute soif s’épanche.
[p. 106]
Ou s’étanche?
L’édition Hetzel-Quantin in-16 donne aussi s’épanche.
Et de sa petitesse étalant l’ironie,
Son pied charmant semblait rire à côté du mien!
(Les Rayons et les Ombres, XXXIV, Tristesse d’Olympio, p. 253.)
Théodore de Banville (Odes Funambulesques, La Tristesse d’Oscar, p. 98; Charpentier, 1883), exagérant cette vision, écrit:
Et qu’enfin ses souliers...
Laissant à chaque pas des morceaux de talon,
Poussaient de grands éclats de rire.
Et Émile Zola, dans ses Contes à Ninon (Le Carnet de danse, p. 52; Charpentier, 1879): «Elle aperçut son pied qui riait dans un rayon de soleil.»
Ses petits pieds semblaient chuchoter avec l’herbe,
écrit ailleurs Victor Hugo (Les Contemplations, t. I, x, Amour, p. 219; Hachette, 1882).
Toutes les passions s’éloignent avec l’âge,
lit-on dans Tristesse d’Olympio (Les Rayons et les Ombres, XXXIV, p. 256).
Toutes les passions s’éteignent avec l’âge,
a dit Voltaire (Stances et quatrains pour tenir lieu de ceux de Pibrac; Œuvres complètes, t. VI, p. 527; édit. du journal Le Siècle).
La pièce XXXV de Les Rayons et les Ombres, Que la Musique date du seizième siècle (p. 265), se termine par ce vers que certains jugent discutable ou énigmatique:
La musique montait, cette lune de l’art!
Ces vers des Châtiments (Nox, VII, p. 10; Hetzel, s. d.)
Toutes les eaux de ton abîme,
Hélas! passeraient sur ce crime,
O vaste mer, sans le laver!
rappellent ceux d’Alfred de Musset (Premières Poésies, La Coupe et les Lèvres, IV, I; p. 252; Charpentier, 1861):
... La mer y passerait sans laver la souillure,
Car l’abîme est immense, et la tache est au fond.
[p. 107]
Dans Les Châtiments encore (Toulon, p. 20):
... Le bandit
.................
Vient, et trouve une main, froide comme un verrou.
Ce verrou fait songer à celui de Ponson du Terrail (Dans le journal La Journée, 14 janvier 1903): «Cet homme est un verrou incarné» (?).
... Ces innocents aux regards de colombe.
(Ibid., Joyeuse Vie, p. 96.)
Des regards de colombe?
Nous retrouvons la même locution dans le volume Le Pape (Un champ de bataille, p. 56; Hetzel-Quantin, s. d., in-16):
... Des petits (enfants) aux regards de colombe.
L’histoire a pour égout des temps comme le nôtre.
(Les Châtiments, III, 13, p. 106.)
Voltaire, en parlant de son époque, a dit, lui aussi: «...Dans ce siècle, l’égout des siècles...» (Relation de la maladie... du jésuite Berthier; Œuvres complètes, t. VI, p. 318; édit. du journal Le Siècle).
Pour attirer les sots qui donnent tête-bêche
Dans tous les vils panneaux...
(Les Châtiments, A un journaliste de robe courte, p. 118.)
Ou tête baissée?
... prendre pour nourricier
Le Crédit mobilier ou le Crédit foncier.
(Ibid., Le Parti du crime, p. 208.)
Vers qui rappelle celui du poète auvergnat Gabriel Marc (Sonnet sur la Frégate amarrée près du pont Royal, dans le volume de M. de Lescure sur François Coppée, p. 372; Lemerre, 1889):
Ta proue est enchaînée, et ta hune contemple
La Caisse des Dépôts et Consignations.
Il y aurait de nombreuses singularités à relever dans le tome I des Contemplations (Autrefois), et aussi beaucoup d’obscurités dans le tome II (Aujourd’hui), qui passe pour[p. 108] un des recueils les plus abstrus de Victor Hugo. Voici quelques emprunts faits à ces deux volumes:
Une eau courait, fraîche et creuse
Sur les mousses de velours.
(Ouvrage cité, t. I, Vieille chanson, p. 78; Hachette, 1882 et 1858.)
Une eau creuse?
Les vieux antres pensifs, dont rit le geai moqueur,
Clignent leurs gros sourcils et font la bouche en cœur.
(Ibid., t. I, Premier mai, p. 113.)
Des antres qui clignent leurs sourcils et font la bouche en cœur?
Dans le poème Saturne (Ibid., t. I, p. 202), le poète place l’enfer dans la planète Saturne:
Ceux-là, Saturne, un globe horrible et solitaire,
Les prendra pour le temps où Dieu voudra punir...
Est-ce bien sûr, et Satan n’aurait-il pas établi son domaine dans un autre astre?
A l’heure où sur le mont lointain
Flamboie et frissonne l’aurore,
Crête rouge du coq matin.
(Ibid., t. I, Magnitudo parvi, p. 302.)
Dans le tome II du même recueil, nous voyons (Pasteurs et Troupeaux, p. 159) la fauvette qui
... met de travers son bonnet.
Plus loin (Ibid., Pleurs dans la nuit, p. 224):
Le cadavre, lié de bandelettes blanches,
Grelotte, et, dans sa bière, entend les quatre planches
Qui lui parlent tout bas.
Un cadavre qui grelotte et qui entend?
Une jeune fille morte dans sa robe d’innocence, c’est une
Ame qui n’a dormi que dans le lit de Dieu.
(Ibid., Claire, p. 244.)
Dans ce poème, Pleurs dans la nuit, déjà mentionné, presque toutes les strophes seraient à citer comme exemples d’obscurités:
L’espace voit sans fin croître la branche Nombre,
Et la branche Destin, végétation sombre,
Emplit l’homme effaré.
(Ibid., p. 234.)
[p. 109]
De même, dans Ce que dit la bouche d’ombre, tout serait à citer, et force est de nous restreindre:
L’homme, comme la brute, abreuvé du néant,
Vide toutes les nuits le verre noir du somme.
(Les Contemplations, t. II, p. 366.)
La profondeur disant à la hauteur: Je t’aime!
(Ibid., p. 382.)
Voir aussi, dans ce volume, les pièces intitulées Horror, Dolor, Hélas! tout est sépulcre, Les Mages, etc.
La Légende des siècles, que Théodore de Banville qualifie d’«impeccable» et déclare «la Bible et l’Évangile de tout versificateur français» (Petit Traité de Poésie française, p. 30 et 2), est un des recueils où, dans ses quatre tomes, Victor Hugo a réuni le plus de termes rares, le plus de ces énumérations de vocables étranges, de noms de personnages peu connus ou inconnus, et que le critique Émile Faguet assure qu’il puisait surtout dans le vieux dictionnaire de Moreri. «Moreri est la mine où Victor Hugo descend tous les jours et plusieurs fois par journée. Moreri lui donne l’histoire, qu’il se charge de rendre pittoresque, surtout les noms propres bizarres, étranges, inquiétants, qui réveillent l’attention et la tirent à eux, comme une couleur éclatante tire à elle les yeux.» (Le Temps, 16 juillet 1911, Feuilleton.)
Qu’est-ce que la colline «Callichore»? (La Légende des siècles, La Terre, t. I, p. 24; Hetzel-Quantin, s. d., in-16.)
Et Anax, le géant de Tyrinthe; et Kothos, et
Rhoetus, Porphyrion, Mégatlas, Evonyme;
et Titlis, et Scrops, et Dronte,
Coebès, Géreste, Andès, Béor, Cédalion,
Jax, qui dormait le jour ainsi que le lion.
(Ibid., Le Titan, t. I, p. 86, 87.)
Mais je ne puis songer à relever tous ces vocables perdus dans le fond ou le tréfonds de l’histoire; d’autant plus qu’il en est, semble-t-il, que le poète forge de toutes pièces, invente à plaisir, celui de Jérimadeth, par exemple, qu’on lit dans Booz endormi. «Le rimeur, chez Victor Hugo, écrit Paul Stapfer (Racine et Victor Hugo, p. 301, note 1), pousse la plaisanterie jusqu’à fabriquer des noms propres de lieux et d’hom[p. 110]mes qui n’ont jamais existé. Ce beau vers harmonieux de Booz endormi:
Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth,
a enrichi la géographie biblique d’une ville entièrement inconnue de tous les hébraïsants.»
Pour tout dire à ce sujet, il paraîtrait que le poète ayant besoin d’une rime à demandait:
... et Ruth se demandait,
avait écrit en marge de sa copie «rime à dait» ou «à det», et que ce serait l’imprimeur, le compositeur, qui aurait commis la bourde, introduit ce «rime à det», transformé en «Jérimadeth», dans le vers précédent: voilà du moins ce qu’on raconte. (Renseignement verbal.)
Remarquons, sans en citer d’exemples, — ils seraient innombrables, — que Victor Hugo manque rarement de faire rimer hommes autrement qu’avec nous sommes, ombre autrement qu’avec sombre ou nombre, abîme autrement qu’avec sublime ou cime; nue rime presque toujours avec venue ou inconnue, ténèbres avec funèbres, âme avec flamme, horrible avec terrible, insondable avec formidable, etc.; et ces mots: hommes, ombre, sombre, abîme, sublime, etc., coulent sans cesse de sa plume.
Certaines de ses épithètes ont déconcerté plus d’un lecteur:
L’ombre était nuptiale, auguste et solennelle,
(La Légende des siècles, Booz endormi, t. I, p. 53.)
Son lit fut formidable...
(Ibid., Les Sept Merveilles du monde, t. I, p. 268.)
Dans Booz endormi encore (Ibid., t. I, p. 52), Victor Hugo nous représente la terre, à cette époque,
... encor mouillée et molle du déluge.
Si l’on admet que le déluge a eu lieu en l’an 3296 avant Jésus-Christ, ou même 2482, et que Booz vivait vers l’an 1200 (Cf. Bouillet, Atlas universel d’histoire et de géographie, Tables chronologiques, p. 79 et 384; — et Victor Duruy, Histoire sainte, chap. I, p. 6; Hachette, 1846), on conclura que la terre a mis bien longtemps à sécher.
Dans la Première Rencontre du Christ avec le tombeau (Ibid., t. I, p. 58), Victor Hugo dit:
Or, de Jérusalem, où Salomon mit l’arche,
Pour gagner Béthanie, il faut trois jours de marche.
[p. 111]
«Chacun de ces vers renferme une grosse erreur, constate M. Jules Hoche (Revue bleue, 16 juin 1894, p. 760). Car la Bible nous apprend que c’est David qui fit transporter l’arche de l’alliance à Jérusalem, et saint Jean dit que Béthanie était à quinze stades de Jérusalem, ce qui est bien la distance de la moderne Béthanie, un pauvre village de fellahs portant le nom arabe d’El-Azarié, et qui est situé à une petite lieue à peine de la Ville Sainte.» On va de Jérusalem à Béthanie «en trois quarts d’heure», dit, de son côté, M. Jean Sigaux, dans L’Intermédiaire des chercheurs et curieux (20 septembre 1911, col. 771).
Signalons aussi ce supplice réservé aux réprouvés, aux damnés:
Ils auront des souliers de feu dont la chaleur
Fera bouillir leur tête ainsi qu’une chaudière.
(La Légende des siècles, L’An neuf de l’hégire, t. I, p. 200.)
Tu rêves, dit le roi, comme un clerc en Sorbonne.
(Ibid., Aymerillot. t. I, p. 229.)
Le roi qui parle ainsi est Charlemagne, mort en 814, et la Sorbonne n’a été fondée qu’en 1253.
Le vide s’est fait spectre et rien s’est fait géant.
(Ibid., Eviradnus, t. II, p. 70.)
Vers qui rappelle certaine description d’un immense hall tracée jadis par le chroniqueur Charles Chincholle (Cf. La Gazette anecdotique, 15 septembre 1890, p. 150): «Un vide ayant cinq étages de haut».
On s’est amusé (Le Cri de Paris, 10 octobre 1909, p. 11) à faire ressortir la singulière amphibologie de ce passage:
Je dédaigne et je hais les hommes, et mon pied
Sent le mou de la fange en marchant sur leurs nuques.
(Ibid., Zim-Zim, t. II, p. 100.)
Dans Les Quatre Jours d’Elciis (IV, ibid., t. II, p. 250), nous trouvons ce vers:
Les yeux sous les sourcils, l’empereur très clément...
N’est-ce pas la place ordinaire des yeux de se trouver sous les sourcils?
... L’hiver se tenait les côtes sur le pôle,
[p. 112]
nous dit le poète (Ouvrage cité, Le Satyre, t. III, p. 10), qui a toujours eu un grand faible pour les jeux de mots et calembours.
Ce vers de La Rose de l’Infante (Ibid., t. III, p. 43):
Dont chaque ovige semble au soleil une mitre,
a donné lieu à bien des recherches. C’est une simple coquille: lisez ogive et non ovige. (Cf. l’édit. Hachette, 1862, 1re série, p. 183.)
Dans Le Lapidé (Ibid., t. III, p. 180), on lit:
Ce mage a cet amas d’affreux cailloux pour lit,
Qui le tua vivant et mort l’ensevelit.
Nous verrons plus loin (p. 148) un personnage d’Eugène Scribe se glorifier, à propos d’un lièvre, d’avoir pu, lui aussi, «le tuer vivant».
La Vision de Dante (Ibid., t. IV, p. 139 et suiv.) est encore un des poèmes les plus abstrus, les plus sibyllins qui soient sortis de la toute-puissante imagination de Victor Hugo:
... L’ombre hideuse, ignorée, insondable,
De l’invisible Rien vision formidable,
Sans forme, sans contour, sans plancher, sans plafond,
Où dans l’obscurité l’obscurité se fond,
Etc, etc.
C’est dans Les Chansons des rues et des bois qu’apparaît peut-être le mieux la prodigieuse maîtrise de Victor Hugo, cette aisance et cette souplesse acquises en partie à force de travail et de pratique, cette FORCE, cette PUISSANCE, qui est sa caractéristique.
Lamartine ignorant qui ne sait que son âme,
Hugo puissant et fort, Vigny, soigneux et fier,
a très exactement dit Sainte-Beuve (Poésies complètes, Pensées d’août, A M. Villemain, p. 377-378; Charpentier, 1890).
C’est aussi dans Les Chansons des rues et des bois que notre poète s’est le plus volontiers livré à sa passion pour les jeux de mots, les concetti, plaisanteries et drôleries, fréquents mélanges de Dante et de Turlupin.
... j’irai
Faire expliquer aux hochequeues
Le latin du Dies Iræ?
(Les Chansons des rues et des bois, p. 39; Hetzel-Quantin, s. d., in-16.)
On entendait Dieu dès l’aurore
Dire: As-tu déjeuné, Jacob?
(Ibid., p. 57.)
[p. 113]
Saint Roch, et son chien saint Roquet.
(Ouvrage cité, p. 100.)
Je m’appelle Bouteille à l’encre;
Je suis métaphysicien.
(Ibid., p. 115.)
Toute la nef, d’aube baignée,
Palpitait d’extase et d’émoi.
— Ami, me dit une araignée,
La grande rosace est de moi.
(Ibid., p. 202.)
Le mouton disait: Notre Père,
Que votre sainfoin soit béni!
(Ibid., p. 202.)
Un oiseau vient boire l’eau tombée dans une feuille, il
Prit la goutte d’eau qui brilla:
La plus belle feuille du monde
Ne peut donner que ce qu’elle a.
(Ibid., p. 205.)
Etc., etc.
Une autre caractéristique de Victor Hugo, c’est son amour pour les petits, les humbles, les faibles, les vaincus, — la bonté, en d’autres termes. Nous trouvons maintes traces de ce sentiment dans L’Année terrible.
Faible, à ceux qui sont forts j’ose jeter le gant.
Je crie: Ayez pitié!
(Page 203; Hetzel-Quantin, s. d., in-16.)
Ceux qu’on accable, ceux qu’on frappe et qu’on foudroie
M’attirent; je me sens leur frère...
(Page 231.)
Fréquemment, Victor Hugo a fait l’éloge, le plus grand éloge de la bonté. Voyez sa célèbre pièce Le Crapaud (dans La Légende des siècles, t. IV, p. 135):
Quiconque est bon voit clair dans l’obscur carrefour;
Quiconque est bon habite un coin du ciel. O sage,
La bonté, qui du monde éclaire le visage,
La bonté, ce regard du matin ingénu,
La bonté, pur rayon qui chauffe l’inconnu,
Etc., etc.
[p. 114]
Et dans Le Pape (p. 86; Hetzel-Quantin, s. d., in-16):
La haine est un vent sombre et pestilentiel;
Aimez, aimez, aimez, aimez, — soyez des frères.
J’ai vécu; j’ai penché ma tête
Sur les souffrants, sur les petits.
(Les Quatre Vents de l’esprit, t. II, Le Livre lyrique, p. 50; Hetzel-Quantin, s. d., in-16.)
«Pour nous, dans l’histoire, où la bonté est la perle rare, qui a été bon passe presque avant qui a été grand.» (Les Misérables, 4e partie, livre I, chap. 3; t. IV, p. 22; Hachette, 1881.)
«Il n’y a sous le ciel qu’une chose devant laquelle on doive s’incliner, le génie, — et qu’une chose devant laquelle on doive s’agenouiller, la bonté.» (Choses vues, 1877, p. 366, in fine; Charpentier, 1888.)
De L’Année terrible, où (p. 244) le général Trochu est qualifié de:
Participe passé du verbe Tropchoir,
rappelons cette magnifique apostrophe (p. 273):
Nous n’avons pas encor fini d’être Français;
Le monde attend la suite et veut d’autres essais;
Nous entendrons encor des ruptures de chaînes,
Et nous verrons encor frissonner les grands chênes.
Et sur les brigandages des Allemands en 1870 (p. 84):
En somme, on dévalise un peuple au coin d’un bois.
On détrousse, on dépouille, on grinche, on rafle, on pille.
Peut-être est-il plus beau d’avoir pris la Bastille.
Encore des badinages et de plaisantes saillies:
Qui chante là? Le rossignol.
Les chrysalides sont parties.
Le ver de terre a pris son vol
Et jeté le froc aux orties...
Le bourdon, aux excès enclin,
Entre en chiffonnant sa chemise;
Etc., etc.
(L’Art d’être grand-père, p. 19; Hetzel-Quantin, s. d.)
... Il vous semble
Que l’alphabet lui-même entre vos pattes tremble,
Que l’F et que le B vont se prendre de bec,
Que l’O tourne sa roue aux cornes de l’Y,
[p. 115]Horreur! et qu’on va voir le point, bille fatale,
Tomber enfin sur l’I, ce bilboquet tantale!
(L’Ane, p. 119; Hetzel-Quantin, s. d.)
L’homme dans son miroir se fait de grand saluts,
Le miroir les lui rend, mais, dans son âme obscure,
Il rit, et sait le fond de l’homme, étant mercure.
(Ibid., p. 147.)
Dans Les Quatre Vents de l’esprit, qui, dans certaines parties, offrent plus d’une analogie avec Les Châtiments, et où nous revoyons défiler Veuillot, Planche, Nisard, Mérimée, etc.:
J’ai violé la nuit pour lui faire une étoile.
(Tome I, p. 111; Hetzel-Quantin, s. d., in-16.)
Puis ces quatre vers, dont le troisième est singulièrement prosaïque, qui signifient qu’il faut bien peu de chose pour rendre un homme moribond et amener sa conversion:
Il suffit d’un cheval emporté, d’un gravier
Dans le flanc, d’une porte entr’ouverte en janvier,
D’un rétrécissement du canal de l’urètre,
Pour qu’au lieu d’une fille on voie entrer un prêtre.
(Ibid., p. 132.)
Monsieur, je suis un diable et vous êtes un ange;
Mais quand vous vous fâchez de la gaîté que j’ai,
Je rêve que quelqu’un vous a pris votre g.
(Ibid., p. 158.)
Et ce souvenir de Racine, à propos de certaines «saintes nitouches»:
Leur croupe se recourbe en replis vertueux.
(Ibid., p. 172.)
La Fin de Satan, encore un des livres les plus compliqués, les plus nébuleux et apocalyptiques de Victor Hugo. On y trouve des vers de ce genre:
On entendait suinter le néant goutte à goutte.
.................
... Le visage irrité des décombres,
Le blanchissement vague et difforme des ombres,
Se hérissaient, montrant des aspects foudroyés,
Tous les renversements en arrière, effrayés,
Se dressaient; etc.
(Ouvrage cité, Hors de la terre, III, p. 304, 305, Charpentier, 1888.)
[p. 116]
Vlad regarde mourir ses neveux prétendants,
Et rit de voir le pal leur sortir par la bouche,
écrit Victor Hugo dans Toute la lyre (t. I, p. 22; Charpentier, 1889).
Ce Vlad et beaucoup d’autres noms propres qui le précèdent ou le suivent: Zam, Phur, Stramire, Zeb, Abbas, etc., font partie de ces énumérations bizarres coutumières à l’auteur.
Et maintenant, Seigneur, expliquons-nous tous deux.
(Ibid., t. I, p. 34.)
Vers devenu plus que célèbre, proverbial, où le poète se représente en tête à tête avec Dieu et traitant avec lui de pair à compagnon.
C’est dans Toute la lyre (t. II, p. 57, Ave, Dea, et p. 90, Roman en trois sonnets) que se trouvent les seuls sonnets sortis de la plume de Victor Hugo.
Signalons aussi dans ce même tome II (p. 163) le petit poème La Blanche Aminte, qui porte cette épigraphe:
— Ça, dit-il, que t’en semble,
Écho? si nous faisions une chanson ensemble?
Cette pièce ou chanson se compose, en effet, de vers «en écho», comme de précédents livres du maître nous en offrent déjà des modèles, jeux et tours de force affectionnés par lui:
En chasse! — Le maître en personne
Sonne.
Fuyez! voici les paladins,
Daims.
(Odes et Ballades, La Chasse du Burgrave, p. 334.)
Pourquoi fais-tu tant de vacarme,
Carme?
.............
Pourquoi fais-tu tant de tapage,
Page?
.............
C’est surtout quand la dame abbesse
Baisse
Les yeux, que son regard charmant
Ment.
(Cromwell, III, 1, et V, 7.)
Nous voici arrivés au théâtre de Victor Hugo.
Remarquons d’abord combien, dans la célèbre préface de[p. 117] Cromwell, véritable manifeste littéraire, comme on sait, le poète nous parle de la Bible, qui a toujours été, avec Homère, Virgile, Dante et Shakespeare, un de ses livres préférés.
Dans une note relative à l’acte III de ce drame de Cromwell (t. II, p. 163; Hachette, 1862), Victor Hugo fait dire à Mme de Staël qu’elle regrette, près du lac de Genève, «le ruisseau de la rue Saint-Honoré».
Comme, avant son exil, Mme de Staël demeurait rue de Grenelle-Saint-Germain, près de la rue du Bac, c’était au ruisseau de cette rue que s’adressaient ses regrets: «Oh! le ruisseau de la rue du Bac!» s’écriait-elle quand on lui montrait le miroir du Léman.» (Sainte-Beuve, Portraits de femmes, Mme de Staël, p. 143.)
A propos du premier vers d’Hernani et de cet enjambement souvent cité:
Serait-ce déjà lui? C’est bien à l’escalier
Dérobé...
le poète et professeur Andrieux, dans une de ses leçons au Collège de France, faisait un jour observer à son auditoire que les romantiques n’avaient pas inventé «le vers haché et la coupe originale», les «rejets» audacieux, témoin, disait-il, ce vieux distique:
Enfin dans le palais nous arrivâmes, car
La porte était ouverte et nous passâmes par.
(Cf. Mary-Lafon, Cinquante ans de vie littéraire, p. 40.)
Nous avons rencontré d’ailleurs, chez Corneille et chez Racine, des rejets ou enjambements non moins hardis.
Lors de la première représentation d’Hernani, au moment où Hernani apprend de Ruy Gomez que celui-ci a confié sa fille au roi don Carlos, il s’écrie (acte III, sc. 7):
... Vieillard stupide, il l’aime!
«M. Parseval de Grandmaison, qui avait l’oreille un peu dure, entendit: «Vieil as de pique, il l’aime!», et, dans sa naïve indignation, il ne put retenir un cri: «Ah! pour cette fois, dit-il, c’est trop fort! — Qu’est-ce qui est trop fort, monsieur? demanda Lassailly, qui était à sa gauche, et qui avait bien entendu ce qu’avait dit M. Parseval de Grandmaison, mais non ce qu’avait dit Firmin (l’acteur). — Je dis, monsieur, reprit l’académicien, je dis qu’il est trop fort d’appeler[p. 118] un vieillard respectable comme l’est Ruy Gomez de Silva, vieil as de pique! — Comment! c’est trop fort? — Oui, vous direz tout ce que vous voudrez, ce n’est pas bien, surtout de la part d’un jeune homme comme Hernani. — Monsieur, répondit Lassailly, il en a le droit, les cartes étaient inventées. Les cartes ont été inventées sous Charles VI, monsieur l’académicien... Bravo pour le vieil as de pique! bravo, Firmin! bravo, Hugo!» (Alexandre Dumas, Mémoires, t. VI, p. 17.)
Et cette fin du monologue de don Carlos (Hernani, IV, 5) devant le tombeau de Charlemagne:
Je t’ai crié: Par où faut-il que je commence?
Et tu m’as répondu: Mon fils, par la clémence.
«Parle à Clémence!» ont interprété quelques loustics, en ajoutant qu’il manquait un nom dans la liste des personnages de ce drame, le nom de cette dame Clémence.
On rencontre dans Lucrèce Borgia (I, 3) certaine apostrophe de dona Lucrezia à Gubetta, «son vieux complice», qui a été parfois cavalièrement interprétée, et que je me contente d’indiquer.
Ce vers de Ruy Blas (I, 2):
Dormir la tête à l’ombre et les pieds au soleil,
se trouve dans le poème de Pierre Lebrun, Les Catacombes de Paris:
Assis, la tête à l’ombre
Et les pieds au soleil.
(Cf. Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, t. VI, p. 134.)
Et fut-il descendu d’Annibal qui prit Rome.
(Ruy Blas, IV, 3.)
Annibal n’a jamais pris Rome.
Un journaliste d’origine espagnole, Angel de Miranda, a jadis relevé (dans Le Gaulois, février 1872; article reproduit dans Le Voleur, 1er mars 1872, p. 139-140) un assez grand nombre d’erreurs et de bévues commises par Victor Hugo dans son Ruy Blas. Comme ces critiques sont très spéciales et relatives seulement à la vie et aux usages ibériens, je me borne à signaler cet article, rédigé sous forme de lettre à l’insigne maestro.
Dans Les Burgraves (I, 2), la barbe de l’empereur Frédéric Barberousse ne laisse pas de nous émerveiller:
Sa barbe, d’or jadis, de neige maintenant,
Faisait trois fois le tour de la table de pierre.
[p. 119]
C’est par erreur qu’on a attribué à Victor Hugo et à ses Burgraves ce drolatique hémistiche:
... Il sortit de la vie
Comme un vieillard en sort.
Victor Hugo était le premier à rire de cette plaisanterie, et, quand elle survenait, ne manquait jamais de riposter:
Tout en faisant des vers comme un vieillard en f’rait.
C’est du moins ce que contait le géographe Onésime Reclus. (Renseignement verbal.)
Dans le Théâtre en liberté (La Forêt mouillée, scène 4), nous rencontrons ces, à peu près, parodies de vers bien connus:
J’ai trop marché, j’ai mal à mon cor...
— Le pied qu’on veut avoir gâte celui qu’on a.
................
Des vieux que nous servons connais la différence,
dit l’aimable petite Balminette à sa compagne Mme Antioche «actrice à Bobino»;
Le tien donne un chapeau, le mien donne un coupé.
Je vais avoir salon, cocher et canapé.
Etc., etc.
Dans le roman Han d’Islande (chap. 12, p. 116; Hetzel-Quantin, s. d., in-16) on rencontre un singulier quiproquo provenant — chose fréquente dans notre langue — de l’emploi d’un pronom:
«Il se fit un moment de silence. Ordener, qui s’était levé de table, prêt à défendre le prêtre, le rompit le premier.»
Le silence, et non le prêtre (substantif immédiatement précédent), j’imagine.
«Tous les bossus vont tête haute, tous les bègues pérorent, tous les sourds parlent bas,» assure Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris (Livre VI, chap. 1; t. I, p. 232; Hachette, 1858).
Un des personnages de ce même roman, la Rémoise Mahiette, estime que «vingt ans, c’est la vieillesse pour les femmes amoureuses» (Livre VI, chap. 3; t. I, p. 249); ce qu’on ne laissera pas, même à Reims, de trouver quelque peu exagéré.
«J’ai le bonheur de passer toutes mes journées, du matin[p. 120] au soir, avec un homme de génie qui est moi, et c’est fort agréable», nous déclare plaisamment plus loin (Livre X, chap. 1; t. II, p. 190), le poète Pierre Gringoire.
Gœthe, que Sainte-Beuve, à maintes reprises, proclame «le roi de la critique», «le plus grand des critiques» (Causeries du lundi, t. III, p. 42; t. XV, p. 368; etc.), ne pouvait — chose étrange et qui ne fait pas honneur à sa judiciaire, — souffrir Notre-Dame de Paris. «Il ne m’a pas fallu peu de patience pour supporter les tortures que m’a données cette lecture, avoue-t-il à son disciple Eckermann (Conversations de Gœthe, t. II, p. 303; Charpentier, 1863). C’est le livre le plus affreux qui ait jamais été écrit.» Etc. Ce chef-d’œuvre le déroutait complètement; c’était trop différent d’Homère et des anciens.
Nous avons vu d’autre part (p. 61) Victor Hugo se montrer aussi peu mesuré et aussi peu équitable envers Voltaire, dont il rangeait les tragédies «parmi les œuvres les plus informes que l’esprit humain ait jamais produites». Ici, Gœthe s’est, non moins injustement, chargé de la réplique. Mais il convient d’ajouter que Victor Hugo a plus d’une fois varié d’opinion sur Voltaire, et même sur les tragédies de Voltaire: voir notamment, dans Littérature et Philosophie mêlées, l’étude Sur Voltaire, datée de décembre 1823, où on lit (p. 294, édit. Hachette, 1859): «... Quant à ses tragédies, où il se montre réellement grand poète, où il trouve souvent le trait du caractère, le mot du cœur», où il a «tant d’admirables scènes», etc.
«Il se leva debout», lit-on dans Les Misérables (1re partie, II, 10; t. I, p. 135; Hetzel-Quantin, s. d., in-16).
Dans le même admirable ouvrage (2e partie, III, 4; t. II, p. 119; et 6, p. 128; Hachette, 1881), une messe de minuit se célèbre ou semble se célébrer, non pas la veille de Noël, mais le jour même de Noël: «Dans l’après-midi de cette même journée de Noël...»
La locution bien connue, le nombril du monde, employée par Victor Hugo pour désigner Paris: «Paris est un malstroëm où tout se perd, et tout disparaît dans ce nombril du monde comme dans le nombril de la mer» (Les Misérables, 2e partie, V, 10; t. II, p. 240), et qu’on peut rapprocher de celle-ci, que nous lisons dans La Légende du beau Pécopin (Chap. 11, dans le volume Le Rhin, t. II, p. 84; Hetzel-Quantin, s. d.): «... le gouffre Maelstron (sic), qui est le Tartare des anciens et le nombril de la mer», — a originairement servi à Eschyle, qui l’a appliquée au temple de Delphes, «qui est le nombril de la terre...[p. 121] le nombril du monde». (Théâtre, L’Orestie, Les Choéphores, p. 287, et Les Euménides, p. 293; traduction Pierron.)
Dans la quatrième partie des Misérables (XV, 2; t. II, p. 482), je cueille cette amusante phrase: «Nous ne sommes pas comme dans le grand monde, où il y a des lions qui envoient des poulets à des chameaux».
Encore dans Les Misérables (5e partie, I, 22; t. V, p. 113): «Enjolras se pencha et baisa cette main vénérable (du vieillard Mabeuf), de même que, la veille, il avait baisé le front. C’étaient les deux seuls baisers qu’il eût donnés dans sa vie.»
Deux baisers seulement dans toute sa vie, et encore tout à la fin de sa vie! C’est vraiment peu. «Pauvre garçon!» s’écrie Flaubert à ce sujet (Correspondance, 1862, t. III, p. 228).
Dans Les Travailleurs de la mer (1re partie, V, 1; t. I, p. 184; Hetzel-Quantin, s. d., in-16): «Il (un vieux capitaine au long cours) décrétait le temps qu’il fera demain. Il auscultait le vent; il tâtait le pouls à la marée. Il disait au nuage: Montre-moi ta langue. C’est-à-dire l’éclair. Il était le docteur de la vague», etc.
«Savez-vous ce que c’est qu’un revolver? — C’est un pistolet qui recommence la conversation,» lit-on un peu plus loin dans le même ouvrage (V, 2; t. I, p. 189).
«Gilliatt avait trouvé cela, bien qu’il n’eût connu ni Vitruve qui n’existait plus, ni Weston, qui n’existait pas encore.» (Ibid., 2e partie, II, 3; t. II, p. 67.)
[Dans une tempête]: «Ces clartés aidaient Gilliatt et le dirigeaient. Une fois il se tourna et dit à l’éclair: Tiens-moi la chandelle.» (Ibid., 2e partie, III, 6; t. II, p. 129.)
Dans Quatre-vingt-treize (2e partie, III, 1; t. I, p. 172; Hetzel-Quantin, s. d., in-16): «... Lause-Duperret, qui, traité de scélérat par un journaliste, l’invita à dîner en disant: «Je sais que scélérat veut simplement dire l’homme qui ne pense pas comme nous». La même remarque se trouve dans Paul-Louis Courier (2e lettre particulière; Œuvres, p. 92; Didot, 1865, in-18): «Il m’appelle jacobin, révolutionnaire, plagiaire, voleur, empoisonneur, faussaire, etc. Je vois ce qu’il veut dire; il entend que lui et moi sommes d’avis différent; peut-être se trompe-t-il.»
Une bien belle réflexion ou hypothèse dans ce même roman (3e partie, III, 1; t. II, p. 104): «... Le bégaiement de l’âme humaine sur les lèvres de l’enfance. Ce chuchotement confus d’une pensée qui n’est encore qu’un instinct contient on ne sait quel appel inconscient à la justice éternelle; peut-être[p. 122] est-ce une protestation sur le seuil avant d’entrer, protestation humble et poignante; cette ignorance souriant à l’infini compromet toute la création dans le sort qui sera fait à l’être faible et désarmé. Le malheur, s’il arrive, sera un abus de confiance.»
A divers endroits de son ouvrage Littérature et Philosophie mêlées (p. 146, 150; Hachette, 1859), Victor Hugo parle d’un écrivain du nom de P. Mathieu, un de nos plus grands écrivains, de sa «langue admirable, qui sera plus tard celle de Molière et de La Fontaine», et le place sur la même ligne que Jean-Jacques Rousseau et Corneille. On ne sait plus guère aujourd’hui ce que c’est que ce Pierre Mathieu — ou Matthieu (1563-1621), — à qui de si chaleureux éloges sont décernés.
D’après un passage du William Shakespeare de Victor Hugo (p. 88; Hetzel-Quantin, s. d., in-16), l’alchimiste Arnaud de Villeneuve (1240-1313), «qui trouva l’alcool et l’huile de térébenthine», fut accusé du «crime bizarre d’avoir essayé la génération humaine dans une citrouille».
Dans Napoléon le Petit (p. 23; Hetzel-Quantin, s. d., in-16), le 6 janvier est présenté comme étant la veille du 10 janvier: «Le lendemain 10, un second décret...»
Une jolie anecdote dans l’Histoire d’un crime (t. II, p. 34; Hetzel-Quantin, s. d., in-16): «... Le fond de Canrobert était l’incertitude. Pélissier, l’homme hargneux et bourru, disait: «Fiez-vous donc aux noms des gens! Je m’appelle Amable, Randon (qui était très craintif) s’appelle César, et Canrobert s’appelle Certain.»
Un jeu de mot ou quiproquo (Ibid., t. II, p. 72): «...Espinasse répondit: «J’irai jusqu’au bout.» Jusqu’au bout. Cela peut s’écrire jusqu’aux boues.»
Et à la fin de ce même ouvrage (t. II, p. 240), encore une superbe déclaration et un magnifique éloge de la France: «... L’avenir est à Voltaire, et non à Krupp. L’avenir est au livre, et non au glaive. L’avenir est à la vie, et non à la mort... La France se sait aimée, parce qu’elle est bonne; et la plus grande de toutes les puissances, c’est d’être aimée. La Révolution française est pour tout le monde.» Etc.
Dans le volume sur Paris (p. 110-111; Hetzel-Quantin, s. d., in-16) et aussi dans Les Misérables (3e partie, I, 7; t. III, p. 14; Hachette, 1884), Victor Hugo réclame la paternité du mot gamin, qui «fut imprimé pour la première fois et arriva de la langue populaire dans la langue littéraire en 1834. C’est dans un opuscule intitulé Claude Gueux que ce mot fit son apparition. Le scandale fut vif. Le mot a passé.»
[p. 123]
Dans Le Rhin (t. I, p. 101, lettre 9; Hetzel-Quantin, s. d., in-16), encore des calembours:
«... Il me montrait les stalles (dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle) en me disant avec gravité: — Voici les places des chamoines. — Ne pensez-vous pas que cela doive s’écrire chats-moines?»
«... Quant au capitaine Lasoupe, je lui suppose quelque parenté avec le duc de Bouillon.» (Ibid.)
«... L’excellent vin de Moselle qu’un Français appelait du vin de demoiselle.» (Ibid., t. I, p. 111, lettre 10.)
«... Un commis marchand, colporteur d’étoffes, déclarant avec un gros rire que, comme il n’avait pu placer ses échantillons, il voyageait en vins (en vain).» (Ibid., t. III, p. 81-82, lettre 32.)
Dans divers endroits de son ouvrage Le Rhin, Victor Hugo se déclare l’adversaire du système décimal: «... Ce pied de roi, ce pied de Charlemagne, que nous venons de remplacer platement par le mètre, sacrifiant ainsi d’un seul coup l’histoire, la poésie, et la langue à je ne sais quelle invention dont le genre humain s’était passé six mille ans et qu’on appelle système décimal.» (Ibid., t. I, p. 93; lettre 9; — voir aussi t. II, p. 2; lettre 20.)
Dans La Légende du beau Pécopin (Le Rhin, t. II, p. 43-107; lettre 21), déjà mentionnée par nous (p. 102), nous retrouvons plusieurs de ces longues énumérations de termes rares et bizarres, chères à Victor Hugo: énumération d’oiseaux: «le rosmar, le râle-noir, le solendguse, les garagians semblables à des aigles de mer, les queues de jonc,» etc. (Ibid., t. II, p. 70); — énumération de chiens (Ibid., t. II, p. 77), puis de chasseurs célèbres et de boissons: arack, pamplis, pechmez, etc. (Ibid., t. II. p. 90.)
Dans le tome III (p. 56, lettre 29): «A Ligny-en-Barrois... petite ville ravissante à voir... il y a une jolie rivière et deux belles tours en ruine.» L’auteur a vu double: il n’y a, à Ligny, qu’une seule tour en ruine, la tour dite de Luxembourg.
«La cathédrale de Bâle... badigeonnée en gros rouge (sic), non seulement à l’intérieur, ce qui est de droit, mais à l’extérieur, ce qui est infâme.» (Ibid., t. III, p. 86, lettre 33.) Il est à remarquer que beaucoup d’églises de cette région (Vosges, Alsace et Suisse du Nord) sont construites «en grès rouge» (Guide Joanne, Les Vosges, p. 294; Hachette, 1887): ce rouge est leur couleur naturelle.
«Il y avait... les trois îles Baléares.» (Ibid., t. III, p. 157, Conclusion). Les îles Baléares sont au nombre de six au[p. 124] moins: Majorque, Minorque, Formentera, Iviça, Cabrera et Conejera.
Et cette conclusion du Rhin (XVII, t. III, p. 234): «La paix perpétuelle a été un rêve jusqu’au jour où le rêve s’est fait chemin de fer et a couvert la terre d’un réseau solide, tenace et vivant. Watt est le complément de l’abbé de Saint-Pierre.» Hélas! jusqu’à présent, l’avenir a donné un terrible démenti à ce beau et généreux pronostic. Au lien de servir la paix, de la fortifier et de la consacrer, chemins de fer, télégraphie avec ou sans fil, aérostats, avions, automobiles, etc., toutes les découvertes de la chimie et de la mécanique, toutes les inventions scientifiques, tous les progrès n’ont fait que travailler pour la guerre et la rendre plus sanglante et plus abominable. Mais nous espérons bien qu’il n’en sera pas toujours ainsi, et que ce règne de la barbarie aura une fin.
Dans un de ses récits de Voyages (Pyrénées, Autour de Pasages [Pasajes], p. 214; Charpentier, 1891), Victor Hugo dépeint «trois jeunes filles, les jambes dans l’eau jusqu’aux genoux... L’une d’elles, continue-t-il, est une vieille femme. Les deux autres...», etc.
Dans son volume Choses vues (p. 10; Charpentier, 1888), Victor Hugo nous raconte que, durant les émeutes d’avril 1834, comme il passait devant un poste de garde nationale et avait sur lui un volume des Mémoires du duc de Saint-Simon, il fut l’objet d’une étrange et, peu s’en fallut, tragique confusion: «J’ai été signalé comme un saint-simonien, et j’ai failli être massacré.»
Nombre de discours et surtout de lettres de Victor Hugo ont fait sensation en leur temps et même sont demeurés célèbres, d’ordinaire par leurs antithèses redoublées, par leurs formules concises et lapidaires, et le plus souvent par leurs exagérations et leur emphase.
«... Après avoir bu jusqu’à la lie toutes les agonies de la proscription...», lit-on dans le discours prononcé par Victor Hugo à Jersey, sur la tombe de Jean Bousquet. (Actes et Paroles, Pendant l’exil, 1853-1861, p. 60.)
«... Mais vos polices vous rassurent. Le coup d’État a dans sa poche le vieil œil de Vidocq et voit le fond des choses avec ça.» (Ibid., Lettre à Louis Bonaparte, p. 155.)
[p. 125]
Tel que l’exécuteur frappant à votre porte,
Le tonnerre demande à parler à quelqu’un.
(Actes et Paroles, Pendant l’exil, 1862-1870, Mentana, p. 125.)
«Certes, nous sommes bien accablés, écrit Victor Hugo aux femmes de Cuba en 1870 (Ibid., p. 191-192); vous n’avez plus que votre voix, et je n’ai plus que la mienne; votre voix gémit, la mienne avertit. Ces deux souffles, chez vous le sanglot, chez moi le conseil, voilà tout ce qui nous reste. Qui sommes-nous? La faiblesse. Non, nous sommes la force. Car vous êtes le droit, et je suis la conscience. La conscience est la colonne vertébrale de l’âme,» etc.
Et aux marins de la Manche (Ibid., p. 214): «... L’océan est inépuisable et vous êtes mortels, mais vous ne le redoutez pas; vous n’aurez pas son dernier ouragan, et il aura votre dernier souffle,» etc.
Aux rédacteurs du journal La Renaissance (1872) (Actes et Paroles, Depuis l’exil, 1871-1876, p. 37): «Courage! vous réussirez. Vous n’êtes pas seulement des talents, vous êtes des consciences; vous n’êtes pas seulement de beaux et charmants esprits, vous êtes de fermes cœurs.»
Aux obsèques de George Sand (1876) (Ibid., p. 151): «Je pleure une morte, et je salue une immortelle. Je l’ai aimée, je l’ai admirée, je l’ai vénérée; aujourd’hui, dans l’auguste sérénité de la mort, je la contemple. Je la félicite parce que ce qu’elle a fait est grand, et je la remercie parce que ce qu’elle a fait est bon.» Etc.
Aux obsèques de Louis Blanc (1882) (Ibid., 1881-1885, p. 27): «Honorons sa dépouille, saluons son immortalité. De tels hommes doivent mourir, c’est la loi terrestre; et ils doivent durer, c’est la loi céleste. La nature les fait, la république les garde. Historien, il enseignait; orateur, il persuadait; philosophe, il éclairait. Il était éloquent, et il était excellent.» Etc.
Au banquet du 81e anniversaire de la naissance de Victor Hugo (Ibid., p. 35): «... Je vous remercie tous, mes chers confrères. Et dans le mot confrères il y a frères.»
C’est au banquet du Cinquantenaire d’Hernani que Victor Hugo fut, pour la première fois, salué du nom de Père (père intellectuel). C’est Émile Augier qui porta ce toast: «Au Père» (Ibid., 1876-1880, p. 129), et ce nom a été repris plus d’une fois et appliqué au grand poète, notamment par Jules Claretie, aux obsèques de Victor Hugo: «... Le monde célèbre et pleure l’Immortel, la littérature française le Maître, la Société des[p. 126] gens de lettres le Père.» (Actes et Paroles, Depuis l’exil, 1881-1885, p. 119.)
«J’applaudis des deux mains,» lit-on dans une lettre de Victor Hugo, mentionnée dans Le Voleur du 28 février 1879 (p. 141). «Je voudrais bien savoir, demande le rédacteur en chef de ce journal, comment M. Victor Hugo s’y prendrait pour applaudir d’une seule main.»
«Vous ne vous nommez pas Bataille, mais Victoire!» écrit notre grand poète au romancier et auteur dramatique Charles Bataille (1831-1868), qui venait de faire jouer sa pièce L’Usurier de Village. A quoi Bataille, prenant mal le compliment, répliqua poste pour poste: «Vous vous trompez, cher Maître; c’est ma cuisinière qui se nomme Victoire.» (Jules Levallois, Mémoires d’un critique, p. 200; — et Lucien Rigaud, Dictionnaire des lieux communs, p. 325.)
En acceptant la présidence d’honneur des funérailles de Garibaldi, Victor Hugo télégraphie à la famille du défunt: «C’est plus qu’une mort, c’est une catastrophe! Ce n’est pas l’Italie qui est en deuil, ce n’est pas la France, c’est l’humanité. La grande nation pleure le grand patriote, séchons les larmes. Il est bien où il est. S’il y a un autre monde, ce qui est deuil pour nous est fête pour lui.» Etc. (Le Voleur, 9 juin 1882, p. 366-367.)
Et, à un candidat à la députation, ce laconique billet, que La Palisse aurait pu signer: «Mon cher X..., vous voilà sur les rangs: c’est bien. Vous serez nommé: c’est mieux.» (Revue bleue, 24 février 1883, p. 249.)
Au critique et styliste Paul de Saint-Victor (1827-1881): «... Devant Eschyle, vous êtes Grec; devant Dante, vous êtes Italien; et, avant tout, vous êtes homme...» (Cf. Alidor Delzant, Paul de Saint-Victor, p. 115.)
Au même, plus loin (p. 118):
«... Une page de vous est un cordial. Il y a, entre vous et moi, un mystérieux va-et-vient d’âme à âme. Vous me dites: «Courage!» et je vous dis: «Merci!»
A une poétesse, Mme Clara-Francia Mollard, qui lui avait soumis son volume Grains de sable, publié en 1840 et composé de pitoyables vers, Victor Hugo répond: «... Votre esprit est composé de gravité et de candeur, comme l’esprit de tous les vrais poètes: vous parlez de tout comme un sage, et vous rêvez sur tout comme un enfant. Imprimez vos vers, madame, on les lira. On les lira parce qu’ils sont nobles, on les lira parce qu’ils sont tendres, on les lira parce qu’ils sont beaux, on les lira parce que, etc. Je crois donc à la fortune de votre livre, madame.[p. 127] Et puis, après tout, que vous importe le succès? Je refuse aux poètes le droit de se plaindre quand les hommes leur font défaut: n’ont-ils pas la nature et Dieu? Hé! madame, il y aura au printemps prochain des fleurs, des feuilles, des prés verts, des ruisseaux joyeux et murmurants, des arbres qui frissonneront et des oiseaux qui chanteront dans un rayon de soleil. Que vous importe le reste? Que vous fait la célébrité? N’avez-vous pas la poésie[32]? Que vous fait le misérable sou vert-de-grisé, sans effigie et sans empreinte? N’avez-vous pas le sequin d’or?» (Le Voleur, 10 juillet 1840, p. 28.)
A une autre poétesse, la belle et galante Louise Colet, Victor Hugo écrit: — et l’on croirait vraiment qu’il se moque de cette fière et encombrante Junon... ou Vénus: «Femme et poète, vous êtes admirable... Vous avez la touche vraie, grave, forte, et en même temps douce. Osez, osez tout! C’est votre droit et votre devoir. Vous êtes Muse et Déesse: ne craignez pas d’aller nue... Vous faites l’épopée de votre sexe. Dédaignez le monde et rayonnez au-dessus de lui, tantôt femme comme Vénus, tantôt étoile comme Vénus aussi... Planez, c’est votre devoir d’aigle.» (Dans le Larousse mensuel, octobre 1913, p. 848.)
Dans son roman L’Insurgé (p. 91; Charpentier, 1885), Jules Vallès a comiquement pastiché le style épistolaire de Victor Hugo, à qui il attribue la missive suivante, en réponse à une prétendue lettre relative au chapitre sur Cambronne des Misérables: «Frère, l’Idéal est double: idéal-pensée, idéal-matière; envolement de l’âme vers le sommet, chute de l’excrément vers le gouffre; gazouillements en haut, borborygmes en bas, — sublimité partout!»
Nous avons signalé, parmi les rimes les plus fréquemment[p. 128] employées par Victor Hugo, les mots hommes, sommes; ombre, sombre, nombre; ténèbres, funèbres; âme, flamme; abîme, sublime, etc. Il est une locution qui revient sans cesse sous sa plume, principalement dans ses préfaces. Pour se désigner, il ne manque jamais, ou presque jamais, d’user de cette périphrase: «Celui qui écrit ces lignes» (Cf. Cromwell, préface, p. 38 et 40; — Le Dernier jour d’un condamné et Littérature et Philosophie mêlées [un même volume: Hachette, 1859], p. 10, 141, 352, 354, 396...; — Histoire d’un crime, t. I, p. 24, 100; t. II, p. 125, 144 [Hetzel-Quantin, s. d.]; etc.). Ou bien encore: «L’auteur de ce livre» (Cf. Les Orientales, préface, p. 4 et 5; — Les Feuilles d’automne, préface, p. 3, 4, 7 [Hachette, 1861]; etc.)
Remarquons aussi les fréquents témoignages de modestie de Victor Hugo, ses très humbles déclarations, à ses débuts aussi bien que plus tard, en pleine gloire: «L’auteur de ces Odes... croit fort peu à son talent...» (Odes et Ballades, préface de 1824, p. 8; Hachette, 1859.) «... L’auteur de ce drame... quoiqu’il soit le moindre d’entre eux (de ces poètes).» (Marion Delorme, préface, p. 102; Hachette, 1858.) «Si l’on ne considère que le peu d’importance de l’ouvrage et de l’auteur dont il est ici question...» (Le Roi s’amuse, préface, p. 16; Hachette, 1861.) «L’auteur de ce drame... lui, chétif poète... sent combien il est peu de chose...» (Lucrèce Borgia, préface, p. 6; Hachette, 1858.) «Lui (l’auteur) qui n’est rien...» (La Esmeralda, préface, p. 130; Hetzel-Quantin, s. d.) «L’auteur se dit, sans se dissimuler le peu qu’il est et le peu qu’il vaut...» (Les Burgraves, préface, p. 190; Hachette, 1861.) «L’auteur de ce livre, si peu de chose qu’il soit...» (William Shakespeare, p. 239; Hetzel-Quantin, s. d.) Etc., etc.
N’en est-il pas un peu de cette invariable et excessive humilité comme de la petitesse et l’aplatissement des souverains pontifes s’intitulant «Serviteurs des serviteurs de Dieu»?
En terminant, nous rappellerons sommairement les règles orthographiques que Victor Hugo avait adoptées, tout au moins dans la seconde partie de sa vie, — sa marche typographique.
Il n’aime pas les majuscules et écrit avec des initiales minuscules ou bas de casse les noms des peuples, les français, les anglais, les chinois, les parisiens, etc. (Cf. Les Misérables, t. IV, p. 435, et passim; t. V, p. 125, 146, 280, etc.; Hachette, 1881; etc.); — «Et français, anglais, belges, allemands, russes, slaves, européens, américains, qu’avons-nous à faire...?» (Actes et Paroles, Avant l’exil, 1849-1851, p. 155; Hetzel[p. 129]-Quantin, s. d.) Ce qui est un tort, car, sans la majuscule, comment distinguer Francs (peuple) de francs (monnaie)?
Le roi Louis s’avance avec vingt mille Francs.
(Cf. ci-dessus, p. 21.)
«Que deviendrait l’état...» (au lieu de l’État) (L’Homme qui rit, t. II, p. 8; Hetzel-Quantin, s. d.); — sa majesté (au lieu de Sa Majesté) (Ibid., p. 17, 20, 55, 81...); — l’olympe (au lieu de l’Olympe) (Ibid. p. 195); — «Je ferai observer à votre honneur...» (au lieu de Votre Honneur) (Ibid., t. III, p. 79). Etc., etc.
Enfin, Victor Hugo écrit toujours quatrevingts en un mot sans trait d’union (Cf. L’Homme qui rit, t. I, p. 172; — et le roman Quatrevingt-treize).
[p. 131]
Poètes symbolistes ou décadents, humoristes, etc. — Paul Verlaine. — René Ghil. — Stéphane Mallarmé. — Jean Moréas. — Jules Laforgue. Suppression de la ponctuation. «Le commun des hommes admire ce qu’il n’entend pas.» (La Bruyère.)
Arthur Rimbaud et son Sonnet des voyelles. Riposte de René Ghil. — Le clavecin oculaire du Père Castel.
Autres singularités à propos des couleurs et des lettres de l’alphabet. — Ernest d’Hervilly. Les couleurs appliquées aux prénoms féminins. — Le chevalier de Piis et son Harmonie imitative. — Auguste Barthélemy. — Victor Hugo et sa description des lettres de l’alphabet.
Curiosités poétiques.
Dans un sonnet de Paul Verlaine (1844-1896) il est parlé, au début (Poèmes saturniens, Vœu, dans le Choix de poésies, p. 9; Charpentier, 1891), des «premières maîtresses», de l’une d’entre elles, et de
L’or des cheveux, l’azur des yeux, la fleur des chairs;
puis, à la fin, cette femme — mais est-ce bien la même? — nous est représentée
Douce, pensive et brune, et jamais étonnée!
De Verlaine encore, cette rime quelque peu étrange:
Prince et princesses, allez, élus,
En triomphe, par la route où je
Trime d’ornières en talus.
Mais, moi, je vois la vie en rouge.
Comme si l’on prononçait où j’. (Cf. Clair Tisseur, Modestes Observations sur l’art de versifier, p. 168; Lyon, Bernoux, 1893.)
Et ce calembour:
Le bonneteau fleurit «dessur» la berge;
La bonne tôt s’y déprave, tant pis
Pour elle...
(Paul Verlaine, dans Clair Tisseur, ibid., p. 276.)
[p. 132]
Je serai forcément bref en ce qui concerne les poètes dits symbolistes ou symboliques, décadents, déliquescents, etc.; il y aurait trop à citer; tout, parfois même, serait à citer comme singularité, charabia ou plaisanterie. Ces prétendus vers, ainsi que le remarque très bien Jules Lemaître, dans une patiente et minutieuse étude sur Paul Verlaine (Revue bleue, 7 janvier 1888, p. 2-14), ressemblent «à des rébus fallacieux ou des charades dont le mot n’existerait pas».
Et il donne cet exemple, pris au hasard dans un recueil symboliste (René Ghil [1862-....], Écrits pour l’art, 7 février 1887, p. 20):
En ta dentelle où n’est notoire
Mon doux évanouissement,
Taisons pour l’âtre sans histoire
Tel vœu de lèvres résumant.
Toute ombre hors d’un territoire
Se teinte itérativement
A la lueur exhalatoire
Des pétales de remuement.
Une vraie charade, une énigme sans clef, un pur imbroglio.
La véritable et souveraine règle de tout écrivain nous semble avoir été posée et ainsi formulée par Fénelon, dans sa Lettre sur les occupations de l’Académie française (V, p. 38-39; édit. Despois):
«La singularité est dangereuse en tout... Quand un auteur parle au public, il n’y a aucune peine qu’il ne doive prendre pour en épargner à son lecteur; il faut que tout le travail soit pour lui seul, et tout le plaisir avec tout le fruit pour celui dont il veut être lu. Un auteur ne doit laisser rien à chercher dans sa pensée; il n’y a que les faiseurs d’énigmes qui soient en droit de présenter un sens enveloppé.»
«Le génie de notre langue est la clarté et l’ordre», a, de son côté, proclamé Voltaire. (Dictionnaire philosophique, art. Langues; et cf. Paul Stapfer, Récréations grammaticales, p. 85.)
Et Victor Hugo (Odes et Ballades, Préface de 1826, p. 23; Hachette, 1859) a formulé cette sentence lapidaire: «Le style est comme le cristal; sa pureté fait son éclat».
Diderot (Salons, J.-J. Bachelier; dans Larousse, art. Charité romaine) pensait sans doute à nos futurs décadents et symbolistes, lorsqu’il émettait cet aphorisme: «Le goût de l’extraordinaire est le caractère de la médiocrité».
Voilà des principes émanant de grands maîtres, de maîtres incontestés, principes qui ne ressemblent guère à la théorie[p. 133] professée par Baudelaire (Notice sur Edgar Poe, Histoires extraordinaires, p. 11) que «l’étrangeté est une des parties intégrantes du beau».
Longtemps auparavant, Lucien de Samosate (Œuvres complètes, trad. Talbot, t. I, p. 8: A un homme qui lui avait dit...), philosophe et critique qui ne manquait pas de goût, et que l’on considère comme un ancêtre de Voltaire, nous a prévenus qu’«une œuvre n’en est que plus laide, quand elle n’a pour tout mérite que son étrangeté».
A propos des bizarreries de style, des fréquentes charades et énigmes d’un des chefs de l’École dite «décadente», de Stéphane Mallarmé (1842-1898), M. Adolphe Brisson conte, dans une de ses chroniques (Cf. La République française, 13 septembre 1898), l’anecdote suivante:
«J’ai connu un amateur de Copenhague, qui, se trouvant de passage à Paris, rendit visite à Stéphane Mallarmé, et fut ravi par la douceur et l’exquise politesse de ses paroles. L’entrevue se termina tout naturellement par le don de quelques vers, humblement sollicités et accordés avec bonne grâce. Le poète daigna transcrire, sur l’album que lui tendait le riche Danois, le sonnet suivant:
Dame, sans trop d’ardeur à la fois enflammant
La rose qui cruelle ou déchirée, et lasse
Même du blanc habit de pourpre, le délace
Pour ouïr dans sa chair pleurer le diamant.
Oui, sans ces crises de rosée et gentiment
Ni brise quoique, avec, le ciel orageux passe
Jalouse d’apporter je ne sais quel espace
Au simple jour le jour très vrai du sentiment
Ne te semble-t-il pas, disons, que chaque année
Dont sur ton front renaît la grâce spontanée
Suffise selon quelque apparence et pour moi
Comme un éventail frais dans la chambre s’étonne
A raviver du peu qu’il faut ici d’émoi
Toute notre native amitié monotone.
(Textuellement reproduit d’après La République française du 13 septembre 1898; — voir aussi la Revue encyclopédique, 1896, p. 189.)
«Le Danois enchanté, continue M. Adolphe Brisson, emporta ce chef-d’œuvre et commença à s’en repaître. Mais il crut y[p. 134] découvrir des obscurités qu’il attribua, avec modestie, à la connaissance insuffisante qu’il avait de notre langue. Pour dissiper ces doutes, il le copia et le communiqua à trois aèdes de la nouvelle école, imitateurs et disciples de Stéphane Mallarmé, en priant chacun d’eux de lui faire une glose du sonnet et de lui en indiquer la signification précise.
«Jugez de mon étonnement! raconta-t-il à M. Adolphe Brisson. J’obtins trois traductions différentes, parmi lesquelles il me fut impossible de fixer mon choix. J’aurais dû m’adresser à Mallarmé en personne, au lieu de m’adresser à ses élèves. Mais je n’osai pas risquer une démarche qu’il eût sans doute jugée indiscrète.»
Autre singularité et excentricité de Stéphane Mallarmé. Il rédigeait en vers les adresses de certaines de ses lettres, — et quels vers! Au lieu, par exemple, d’écrire sur l’enveloppe, comme chacun de nous aurait fait: «Monsieur Henri de Régnier, rue Boccador, 6, Paris,» il recourait à son luth et en tirait ce quatrain qui servait de suscription à la missive, et devait diantrement déconcerter le facteur de la poste:
Adieu l’orme et le châtaignier!
Malgré ce que leur cime a d’or,
S’en revient Henri de Régnier
Rue, au 6 même, Boccador.
(Cf. L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 20-30 décembre 1917, col. 418, où se trouvent cités plusieurs autres de ces quatrains postaux.)
Voici le début du recueil de Jean Moréas (1856-1910), Le Pèlerin passionné (Agnès, p. 3):
Il y avait des arcs où passaient des escortes
Avec des bannières de deuil et du fer
Lacé (?), des potentats de toutes sortes
— Il y avait — dans la cité au bord de la mer.
Les places étaient noires, et bien pavées, et les portes,
Du côté de l’est et de l’ouest, hautes; et comme en hiver
La forêt, dépérissaient les salles de palais, et les porches,
Etc., etc.
On voit qu’il n’y a plus là ni hémistiches, ni rythme régulier, ni aucune de nos règles de prosodie.
Ajoutons que, le tapage fait, la notoriété conquise, Jean Moréas renia les décadents et ses dieux, et s’assagit.
De Jules Laforgue (1860-1887), qui s’écriait:
Ah! que la vie est quotidienne!
[p. 135]
nous citerons ces deux vers ou ces deux lignes, extraites de son poème (?) Pan et la Syrinx:
O Syrinx! Voyez et comprenez la Terre et la merveille de cette matinée et la circulation de la vie.
Oh! vous là! et moi ici! Oh, vous! Oh, moi! Tout est dans Tout!
(Cf. Max Nordau, Dégénérescence, t. I, p. 237.)
Un autre, «futuriste, fantaisiste, hermétique et peut-être un peu mystificateur», a imaginé, lui, nous conte encore M. Adolphe Brisson (Le Temps, 6 août 1913), de supprimer la ponctuation.
Un autre sans doute s’évertuera à écrire à rebours.
Un autre...
«Les passants ne regardent les chiens que quand ils aboient, et on veut être regardé,» a observé Voltaire. (Dialogues et Entretiens philosophiques, XI, M. l’intendant des menus... Œuvres complètes, t. VI, p. 76; édit. du journal Le Siècle.)
Les décadents ont été généralement jugés comme des farceurs, des «fumistes», — c’est le mot employé, — qui, ne sachant comment attirer l’attention du public, se sont avisés de le mystifier. Ils n’ont, pour ainsi dire, fait que mettre en pratique les conseils ou remarques de nombre de philosophes ou de moralistes:
«Obscurcissez! Obscurcissez!» répétait sans relâche à ses disciples un sophiste de l’antiquité. Et il n’était content d’eux que lorsqu’il ne comprenait rien à leurs compositions». (Cf. Dussault, dans Gustave Merlet, Tableau de la littérature française [1800-1815], t. III, p. 61.)
«Ils (les lecteurs) concluront la profondeur de mon sens, par l’obscurité.» (Montaigne, Essais, III, 9; t. IV, p. 135, édit. Louandre.)
«Rien ne persuade tant les gens qui ont peu de sens, que ce qu’ils n’entendent pas.» (Cardinal de Retz, Mémoires, t. II, p. 522; édit. des Grands Écrivains.)
«Le commun des hommes... admire ce qu’il n’entend pas.» (La Bruyère, Caractères, De la chaire, p. 404; édit. Hémardinquer[33].)
[p. 136]«Quand je lis quelque chose et que je ne l’entends pas, je suis toujours dans l’admiration.» (Destouches, La Fausse Agnès, I, 2.)
«Un écrivain n’est réputé sérieux qu’à la condition d’ennuyer, et beaucoup doivent leur réputation à ceci: qu’on aime mieux les admirer que les lire.» (Alexandre Dumas fils, La Vie à vingt ans, p. 65; M. Lévy, 1856.)
Etc., etc.
Nul, mieux que les décadents, symbolistes, déliquescents, évanescents, etc., n’a justifié la sentence de Frayssinous (Défense du christianisme, t. II, p. 459; Le Mans, Dehallais, 1859): «Il est des novateurs audacieux qui cherchent dans la folie de leurs opinions une célébrité qu’ils ne sauraient attendre de la médiocrité de leurs talents.»
Mais la ruse a été vite éventée.
Jules Tellier (Nos Poètes, p. 230-231) traite à peu près tout crûment Mallarmé de «fumiste»: «Ses vers sont dépourvus de sens autant que d’harmonie, absurdes également pour l’oreille et pour l’esprit.»
Paul Stapfer (Des Réputations littéraires, t. I, p. 157) déclare que «M. Stéphane Mallarmé est purement absurde. Ses vers ne seront pas plus lisibles ni plus intelligibles pour la postérité que pour nous,» etc.
«... On a reconnu le symbolisme pour ce qu’il est: de la folie ou du charlatanisme, écrit de son côté M. Max Nordau (Dégénérescence, t. I, p. 208 et suiv.). Paul Verlaine lui-même, un des inventeurs du symbolisme, accommode de cette façon, dans un moment de sincérité, ses disciples: «Ce sont des pieds plats qui ont chacun leur bannière où il y a écrit: Réclame!»... «M. Gabriel Vicaire qualifie leurs productions de pures fumisteries de collégiens.» (Ibid., p. 210.)
Et Edmond de Goncourt (Journal, année 1889, t. VIII, p. 16): «Après la génération des simples, des gens naturels, qui est bien certainement la nôtre, et qui a succédé à la génération des romantiques, qui étaient un peu des cabotins, des gens de théâtre dans la vie privée, voici que recommence, chez les décadents, une génération de chercheurs d’effets, de poseurs, d’étonneurs de bourgeois».
L’excellent conseil donné par le vieux poète Maynard (1582-1646: Œuvres de François de Maynard, t. III, p. 139; Lemerre, 1888):
Si ton esprit veut cacher
Les belles choses qu’il pense,
[p. 137]Dis-moi, qui peut t’empêcher
De te servir du silence?
convient, en somme, surtout aux écrivains décadents et symbolistes.
L’un de ces singuliers et ténébreux novateurs, qui fut l’intime compagnon de Verlaine, Arthur Rimbaud (1854-1891), a composé un sonnet resté célèbre, Le Sonnet des voyelles (dans le recueil intitulé Reliquaire, p. 108; Genonceaux, 1891), sonnet très irrégulier, dont voici le texte littéralement et scrupuleusement reproduit, — ce qui ne le rend pas plus limpide:
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes.
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombillent autour des puanteurs cruelles,
Golfe d’ombre: E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;
U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux;
O, suprême Clairon plein de strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
— O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux!
«Mais pas du tout! riposte un autre adepte du symbolisme, M. René Ghil. I n’est aucunement rouge: qui ne voit qu’I est bleu? Et n’est-ce point péché de trouver de l’azur dans la voyelle O? O est rouge comme le sang. Pour l’U, c’est jaune qu’il eût fallu écrire, et Rimbaud n’est qu’un âne (sic) ayant voulu peindre U en vert.»
Un troisième, au contraire, déclare qu’il voit A blanc, U bleu ou vert, E brun, O rouge, etc.
Ce qui prouve que ces messieurs ne voient pas tous de la même façon, et qu’il n’est pas facile de s’entendre.
Et M. René Ghil, ajoutant aux couleurs des voyelles des associations ou comparaisons musicales, prétendait que «A, lui rappelait les orgues; E, les harpes; I, les violons; O, les cuivres; U, les flûtes». (Cf. La Chronique médicale, 1er octobre 1916, p. 306-308; et 1er avril 1918, p. 119-122: très intéressants articles; — et la Revue encyclopédique, 1892, p. 7-10.)
[p. 138]
Dans le même ordre d’idées, les sensations musicales, on se rappelle le Clavecin oculaire, à la construction duquel le Père Castel (1688-1757) consacra une grande partie de sa vie. A l’aide de cet instrument, nommé aussi Clavecin chromatique, l’ingénieux et savant jésuite prétendait, en variant les couleurs, affecter l’organe de la vue, tout comme le clavecin ordinaire, le piano, affecte l’organe de l’ouïe par la variété des sons, réaliser, en d’autres termes, le phénomène de l’«audition colorée». Imaginez une symphonie de Lulli ou de quelque autre maestro exécutée par une succession et combinaison de couleurs. Diderot a plusieurs fois parlé du Père Castel et du Clavecin oculaire (Cf. Lettre sur les sourds et muets, Œuvres choisies, p. 20 et suiv.; Lemerre, 1888; — et le Rêve de d’Alembert, Chefs-d’œuvre de Diderot, t. II, p. 207, 260; E. Picard, s. d.). Il est aussi question du Père Castel et de son invention dans Les Confessions de J.-J. Rousseau (Partie II, livre 7; t. V. p. 511, 515; Hachette, 1864); dans Le Livre du promeneur, de Lefèvre-Deumier, p. 271 (Amyot, 1854); et, avec plus de détails, dans La Chronique médicale, 1er avril 1919, p. 120-124, article du Dr Foveau de Courmelles.
Le grand ornithologiste Toussenel (1803-1885), dans son Monde des oiseaux (t. II, p. 362; Dentu, 1859), nous dit aussi quelques mots des couleurs et de leurs «dominantes passionnelles»: «le jaune est symbolique du familisme, le noir d’égoïsme concentré; le bleu pâle argentin annonce un essor faussé d’affective (sic).»
Dans l’histoire littéraire, ces fantaisies — appliquer des couleurs à des sentiments et autres choses abstraites — ne sont pas absolument rares. On connaît la Symphonie en blanc majeur de Théophile Gautier (elle se trouve dans le volume Émaux et Camées, p. 33; Charpentier, 1911). Léon Gozlan (1803-1866) a écrit, sur ce même sujet, une page caractéristique (reproduite dans la revue Le Penseur, janvier 1913, p. 25): «Comme je suis un peu fou, j’ai toujours rapporté, je ne sais trop pourquoi, à une couleur ou à une nuance les sensations diverses que j’éprouve. Ainsi, pour moi, la pitié est bleu tendre; la résignation est gris-perle, la joie est vert-pomme, la satiété est café-au-lait, le plaisir rose velouté, le sommeil est fumée-de-tabac, la réflexion est orange, la douleur est couleur de suie, l’ennui est chocolat. La pensée pénible d’avoir un billet à payer est mine-de-plomb, l’argent à recevoir est rouge chatoyant ou diablotin. Le jour du terme est couleur de Sienne, — vilaine couleur! Aller à un premier[p. 139] rendez-vous, couleur thé léger; à un vingtième, thé chargé. Quant au bonheur... couleur que je ne connais pas!»
Et les couleurs appliquées aux prénoms féminins, système imaginé par l’humoriste Ernest d’Hervilly (1839-1911):
«Les noms blancs très purs sont: Bérénice, Marie, Claire, Ophélie, Iseult.
«Le rose vif est évoqué par Rose (naturellement!), Colette, Madeleine, Gilberte.
«Le gris est fourni par Jeanne, Gabrielle, Germaine.
«Le bleu tendre serait Céline, Virginie, Léonie, Élise.
«Le noir absolu serait Lucrèce, Diane, Rachel, Irène, Rébecca.
«Le jaune violent n’apparaît qu’aux noms de Pulchérie, Gertrude, Léocadie.»
Ernest d’Hervilly affirmait, en outre, qu’«Hélène est gris-perle, et qu’Adrienne, Ernestine et Fanchette doivent être rangées dans la catégorie des prénoms qui rappelle un semis de fleurs sur une étoffe blanche!» (La Chronique médicale, 1er octobre 1916, p. 307.)
Quant aux lettres de l’alphabet interprétées comme nous le voyions tout à l’heure, matérialisées, colorées ou animées, on en trouve une longue série d’exemples dans le célèbre poème du chevalier de Piis (1755-1832), Harmonie imitative de la langue française, dont le premier chant est consacré à chacun de nos caractères alphabétiques:
A l’aspect du Très-Haut sitôt qu’Adam parla,
Ce fut apparemment l’A qu’il articula.
..................
Le B balbutié par le bambin débile
Semble bondir bientôt sur sa bouche inhabile;
Son babil par le b ne peut être contraint,
Et d’un bobo, s’il boude, on est sûr qu’il se plaint.
Mais du bègue irrité la langue embarrassée
Par le b qui la brave est constamment blessée.
Le C, rival de l’S avec une cédille,
Sans elle, au lieu du Q, dans tous nos mots fourmille.
De tous les objets creux il commence le nom;
Une cave, une cuve, une chambre, un canon,
Une corbeille, un cœur, un coffre, une carrière,
Une caverne, enfin, le trouvent nécessaire.
Partout en demi-cercle il court demi-courbé.
..................
En voilà, je pense, assez pour vous donner envie de lire le[p. 140] reste. Vous trouverez de nombreux fragments du très original poème du chevalier de Piis dans le Grand Dictionnaire de Larousse, au début de chaque lettre. (Voir aussi, dans le même ouvrage, les articles Harmonie et Piis; — Eugène Muller, Curiosités historiques et littéraires, p. 93; — Etc.)
Le poète marseillais Auguste Barthélemy (1796-1867) a aussi composé des vers sur ce même sujet: les lettres de l’alphabet.
Dans un chapitre de son volume Voyages (p. 65-67; Charpentier, 1891), Victor Hugo les passe également toutes en revue une à une, et en fait une très pittoresque description:
«La société humaine, le monde, l’homme tout entier est dans l’alphabet. La maçonnerie, l’astronomie, la philosophie, toutes les sciences ont là leur point de départ, imperceptible, mais réel; et cela doit être. L’alphabet est une source.
«A, c’est le toit, le pignon avec sa traverse, l’arche, arx; ou c’est l’accolade de deux amis qui s’embrassent et qui se serrent la main;
«D, c’est, le dos;
«B, c’est le D sur le D, le dos sur le dos, la bosse;
«C, c’est le croissant, c’est la lune;
«E, c’est le soubassement, le pied-droit, la console et l’étrave, l’architrave, toute l’architecture à plafond dans une seule lettre;
«F, c’est la potence, la fourche, furca;
«G, c’est le cor;
«H, c’est la façade de l’édifice avec ses deux tours;
«I (i), c’est la machine de guerre lançant le projectile;
«J, c’est le soc et c’est la corne d’abondance;
«K, c’est l’angle de réflexion égal à l’angle d’incidence, une des clefs de la géométrie;
«L, c’est la jambe et le pied;
«M, c’est la montagne, ou c’est le camp, les tentes accouplées;
«N, c’est la porte fermée avec sa barre diagonale;
«O, c’est le soleil;
«P, c’est le portefaix debout avec sa charge sur le dos;
«Q, c’est la croupe avec la queue;
«R, c’est le repos, le portefaix appuyé sur son bâton;
«S, c’est le serpent;
«T, c’est le marteau;
«U, c’est l’urne;
«V, c’est le vase (de là vient que l’u et le v se confondent souvent);
«X, ce sont les épées croisées, c’est le combat; qui sera le[p. 141] vainqueur? on l’ignore; aussi les hermétiques ont-ils pris X pour le signe du destin, les algébristes pour le signe de l’inconnu;
«Y, c’est un arbre; c’est l’embranchement de deux routes, le confluent de deux rivières; c’est aussi une tête d’âne ou de bœuf; c’est encore un verre sur son pied, un lys sur sa tige, et encore un suppliant qui lève les bras au ciel;
«Z, c’est l’éclair, c’est Dieu.»
Parmi les épîtres en vers que reçut l’impératrice Eugénie lors de sa grossesse, il en était une dont Mérimée ne pouvait parler «sans rire aux larmes», conte Gustave Claudin dans ses Souvenirs (p. 160). Elle débute ainsi:
Madame,
Dans vos bras amoureux quand vous pressez un homme,
Qui vous fait concevoir... peut-être un roi de Rome,
Votre cœur vous dit-il, etc.
Citons encore, comme curiosités littéraires, ces trois distiques anonymes (Cf. Le Figaro, 9 décembre 1881; — L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 10 avril 1898, col. 513; — et Paul Stapfer, Racine et Victor Hugo, p. 310, note 1, qui attribue les deux premiers de ces distiques à Marc Monnier), distiques fantaisistes, à la rime somptueuse, dont le second vers reproduit le premier sous une forme différente, et qui offrent ou résument en quelque sorte trois poèmes, — et quels poèmes!
Gall, amant de la reine, alla, tour magnanime,
Galamment de l’arène à la tour Magne, à Nîme.
Laurent Pichat, virant, coup hardi! bat Empis;
Lors Empis, chavirant, couard, dit: Bah! tant pis!
Dans ces meubles laqués, rideaux et dais moroses,
Danse, aime, bleu laquais! Ris d’oser des mots roses!
C’est-à-dire: Laquais à la livrée bleue, danse, aime, ne te gêne pas, etc.
Et cette fantaisie inspirée au pince-sans-rire Alphonse Allais (1854-1905) par je ne sais quel incident de coulisses, et dédiée à son ami Adhémar de Kelke:
De Kelke, préférons qu’orale, à part se rie
De quelque préfet rond, Cora Laparcerie.
(Cf. L’Opinion, 1er juin 1912.)
[p. 142]
Puis ces vers d’Orphée à sa chère Eurydice, où il lui rappelle les dix années de bonheur conjugal qu’ils peuvent faire revivre, si Pluton le permet:
Eurydice! Pluton! Dix ans! Vainc la mort, fée!
Euh! Ris! Dis? Se plut-on, dis? En vain clame Orphée.
(Cf. Le Journal, 30 juin 1912.)
Pour terminer, rappelons ce début d’un compliment en vers adressé à Alexandre Dumas père, lors d’un de ses passages à Lyon, début probablement ainsi conçu:
O vous dont le nom brille au sommet du Parnasse.
Des jeunes filles étaient venues offrir un bouquet à l’illustre romancier, et la plus jolie commença, d’une voix timide, mal assurée:
O vous dont le nom bril... le nom bril...
Et elle hésitait, ânonnait.
«Pardon, mademoiselle, vous parlez là de quelque chose que vous n’avez jamais vu,» finit par lui objecter Dumas en souriant. (Cf. Clair Tisseur, Modestes Observations sur l’art de versifier, p. 134, note.)
[p. 143]
Auteurs dramatiques. — Collin d’Harleville. — Andrieux. — Flins des Oliviers. Une douleur qui s’exprime en chantant. — Le soleil en pleine nuit. — Luce de Lancival. — M.-J. Chénier et la locution «Briller par son absence». — Théâtre de la Révolution.
Nicolas Brazier. Un singulier bibliothécaire. Palinodies littéraires.
Eugène Scribe. — Saint-Georges et Leuven. — Canevas d’opéra-comique et scénario de tragédie.
Casimir Delavigne. Anachronismes et incorrections. Prodiges de mémoire. Une comparaison doublement blessante.
Duvert et Lauzanne. Facéties et pasquinades. — Henri Rochefort. La Lanterne.
Ernest Legouvé, et son père J.-B. Gabriel Legouvé. La passion de l’inexactitude. Encore les périphrases. — François Ponsard. Vers prosaïques. — Émile Augier. — Camille Doucet.
Eugène Labiche. — Auguste Vacquerie. — Théodore Barrière.
Curiosités théâtrales. Fernand Desnoyers. — Villiers de l’Isle-Adam. — Contrepetteries, facéties, drôleries théâtrales, etc.
Revenons aux auteurs dramatiques.
Chez Collin d’Harleville (1755-1806), plus encore que chez son fidèle ami et biographe Andrieux (1759-1833), on trouve un très fréquent usage, un véritable abus de l’interjection. Bon! redoublée au besoin (Bon! Bon!) pour parfaire la mesure du vers.
Des remerciements? Bon! Il ne m’en est point dû.
(Collin d’Harleville, Les Châteaux en Espagne, I, 10.)
Voir aussi même comédie: I, 1, 2, 4, 5, 8; — II, 1, 3, etc.; et les autres pièces de l’auteur, Les Riches notamment, où l’interjection Bon! se rencontre à peu près à chaque page.
Et Andrieux:
Bon! Bon! Songe plutôt au plaisir qu’il aura.
(Les Étourdis, I, 2.)
Voir aussi même pièce: I, 3, 10; II, 8; III, 6, etc.
Chez Collin d’Harleville, aussi bien que chez Andrieux, les pensées délicates, judicieuses ou piquantes, sont nombreuses:
[p. 144]
Je suis fait pour l’amour, mais très peu pour l’hymen...
Quand on sent que l’on plaît, on en est plus aimable...
Il est si doux de voir les heureux qu’on a faits!
(Collin d’Harleville, Les Châteaux en Espagne, II, 3; II, 10; V, 1.)
La raison est un fruit de l’arrière-saison.
(Id., Les Mœurs du jour, I, 10.)
Nous n’avions pas le sou, mais nous étions contents;
Nous étions malheureux; c’était là le bon temps.
(Id., Poésies fugitives, Mes souvenirs; Théâtre complet et Poésies... de Collin d’Harleville, t. IV, p. 40; H. Nicolle, s. d.)
Aux travers de l’esprit aisément on fait grâce
Mais les fautes du cœur, jamais on ne les passe.
(Andrieux, Les Étourdis, III, 16.)
On ne devrait jamais se quitter quand on s’aime.
(Id., Le Rêve du mari, I, 1.)
Etc., etc.
Dans une pièce intitulée Le Réveil d’Épiménide ou Les Étrennes de la Liberté, par Flins des Oliviers (1757-1806)[34], jouée vers 1790, un abbé entre en scène en chantant sur l’air J’ai perdu mon Eurydice:
J’ai perdu mes bénéfices,
Rien n’égale ma douleur.
Sur quoi, Épiménide fait la réflexion suivante, qui est toujours de circonstance et qu’on pourrait appliquer à nombre de solos, duos et ritournelles:
Puisqu’elle s’exprime en chantant,
Sa douleur n’est pas bien amère.
(Cf. Revue bleue, 1er mars 1879, p. 816.)
Déjà, au dix-septième siècle, Saint-Évremond avait fait les remarques suivantes: «... Il y a une autre chose, dans les opéras, tellement contre la nature, que mon imagination en est blessée: c’est de faire chanter toute la pièce depuis le commencement jusqu’à la fin, comme si les personnes qu’on représente s’étaient ridi[p. 145]culement ajustées pour traiter en musique et les plus communes et les plus importantes affaires de leur vie. Peut-on s’imaginer qu’un maître appelle son valet, ou qu’il lui donne une commission en chantant; qu’un ami fasse, en chantant, une confidence à son ami; qu’on délibère, en chantant, dans un conseil; qu’on exprime avec du chant les ordres qu’on donne, et que mélodieusement on tue les hommes à coups d’épée et de javelot dans un combat... Les Grecs faisaient de belles tragédies, où ils chantaient quelque chose; les Italiens et les Français en font de méchantes, où ils chantent tout.» (Saint-Évremond, Œuvres choisies, Sur les opéras, p. 341-343; édit. Gidel.)
Quelques années avant la Révolution, un opéra, consacré à la louange du gouverneur de la province, fut joué à Limoges. La scène, lisons-nous dans le Musée des Familles (1er décembre 1894, p. 352), représentait une nuit semée d’étoiles, et la pièce débutait par ce vers étrange:
Soleil, vis-tu jamais une pareille nuit?
Luce de Lancival (1764-1810) termine sa tragédie d’Hector (V, 5) par le récit d’un combat d’homme à homme, du meurtre d’Hector par Achille, dont quelques vers rappellent le récit de Théramène de Racine:
Ses coursiers, qui, toujours dociles à sa voix,
Refusent d’obéir pour la première fois.
Et Racine (Phèdre, V, 6):
Ses superbes coursiers, qu’on voyait autrefois
Pleins d’une ardeur si noble obéir à sa voix.
La locution briller par son absence apparaît — peut-être pour la première fois en français — dans la tragédie de Tibère (I, 1), de Marie-Joseph Chénier (1764-1811):
Entre tous les héros qui, présents à nos yeux,
Provoquaient la douleur et la reconnaissance,
Brutus et Cassius brillaient par leur absence.
Cette expression est d’ailleurs textuellement tirée de Tacite, qui, rapportant, dans ses Annales (III, 76), les mêmes circonstances, dit: «Sed præfulgebant Cassius atque Brutus...»
Dans une note de sa Lanterne aux Parisiens, Camille Desmoulins rappelle aussi cette absence des portraits de Brutus et de Cassius, et cite la susdite phrase de Tacite: cf. Œuvres[p. 146] de Camille Desmoulins, t. II, p. 26; édit. de la Bibliothèque nationale.
Nous avons mentionné déjà, en parlant de Choudard-Desforges (p. 66-67), un exemple des bizarreries qu’offre le théâtre de la Révolution. En voici quelques autres, et il y en aurait quantité à citer, car la mine est quasiment inépuisable.
Dans la pièce La Vraie Républicaine, on trouve ce couplet:
Puisse bientôt la France entière
Se soumettre aux lois de l’hymen!
On est toujours mauvais républicain
Quand on reste célibataire (bis).
(Dans Ferdinand Brunetière, Nouvelles Études critiques... p. 334; Hachette, 1882.)
Dans une autre pièce, jouée en janvier 1794, La Reprise de Toulon, un représentant du peuple s’adresse en ces termes aux soldats français: «Courage! mes amis! il pleut, il vente, nous sommes trempés! Quel temps superbe pour se battre! Les éléments se déchaînent en vain pour troubler nos fêtes ou nous arracher au combat. Le ciel est toujours beau pour des républicains!» (Ibid., p. 335.)
Dans la pièce Au plus brave la plus belle, le volontaire Victor annonce à sa fille Victoire qu’il l’a promise par avance au plus brave. «O mon père! s’écrie Victoire, pourquoi m’exposer à épouser un inconnu? — Un inconnu, ma fille! riposte le papa Victor; sache bien que le bon républicain n’est un inconnu pour personne.» (Ibid., p. 336.)
Dans La Reprise de Toulon encore, un représentant du peuple s’adresse aux «intrépides galériens, âmes pures et sensibles, et sans doute plus malheureux que coupables.» (Ibid.)
Etc., etc.
Le chansonnier et vaudevilliste Nicolas Brazier (1783-1838), à qui appartient cette calinotade si souvent citée:
En vous voyant sous l’habit militaire,
J’ai deviné que vous étiez soldat
(L’Enfant du régiment; dans Larousse, art. Bévue).
[p. 147]
publia, en 1824, sous le titre de Souvenirs de dix ans, un recueil de chansons en l’honneur des Bourbons, dont une pièce inspirée par la naissance du duc de Bordeaux avait servi naguère à célébrer la naissance du roi de Rome. Louis XVIII prit la chose en riant et gratifia le poète d’un emploi de «bibliothécaire du Château». Mais, en allant faire sa visite à son chef, à Antoine-Alexandre Barbier, le savant auteur du Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, qui avait le titre d’administrateur des bibliothèques particulières du roi, Brazier eut la maladresse et l’impudence de lui dire: «Vous pensez bien, monsieur, que cette place ne m’a été donnée que pour récompenser mon dévouement à la dynastie, et nullement pour m’astreindre à un travail quelconque». Barbier, qui était, lui, le travailleur par excellence, répliqua qu’il ne l’entendait pas ainsi, qu’il avait besoin de collaborateurs sérieux et effectifs, et non d’amateurs et de flâneurs. Un conflit s’ensuivit, mais l’affaire s’arrangea: Brazier donna sa démission, et reçut une modeste pension.
Attaqué, en 1815, par Le Nain jaune, qui raillait l’orthographe fantaisiste de Brazier, celui-ci rédigea ab irato une réponse fulminante, que le journal s’empressa de publier. Cette épître commençait par le mot Jamais écrit J’amais, et cette malheureuse apostrophe, mise en tête d’une lettre destinée à prouver que Brazier savait l’orthographe, excita la risée universelle. (Cf. Gustave Merlet, Tableau de la littérature française [1800-1815], t. I, p. 531; et Larousse, art. Brazier.)
Une palinodie analogue à celle de Nicolas Brazier fut commise par le vicomte d’Arlincourt (1789-1856), de plaisante mémoire. Son poème épique sur Charlemagne, La Caroléide, composé d’abord en partie pour célébrer Napoléon, fut modifié selon les circonstances, et parut, en 1818, consacré à l’éloge de Louis XVIII et des Bourbons. (Cf. Ludovic Lalanne, Dictionnaire historique de la France.)
On pourrait encore citer, comme exempte de transformations littéraires sous le premier Empire, une tragédie d’Abraham qui avait été d’abord Le Divorce de Napoléon: l’Empereur devint Abraham; l’Impératrice Joséphine, Sarah (la femme stérile); Marie-Louise, Agar; et le jeune Ismaël, son fils, devint le petit roi de Rome; — et le Don Sanche de Brifaut, interdit en 1814: l’auteur change alors ses Espagnols en Assyriens, et Don Sanche en Ninus II. Etc. (Cf. Émile Deschanel, Le Théâtre de Voltaire, p. 206, note 1.)
Nous passerons rapidement sur Eugène Scribe (1791-1861), dont plusieurs écrivains se sont amusés à recueillir les inadvertances et bévues: voir notamment Charles de Boigne, Petits Mémoires de l’Opéra, chap. 23, p. 281-295; H. de Villemessant, Mémoires d’un Journaliste, t. V, p. 158-164, etc.
Tout le monde connaît le vieux soldat de Michel et Christine, qui
... sait souffrir et se taire
Sans murmurer;
et le lièvre de L’Héritière, qu’un personnage de la pièce se glorifie
D’avoir pu (le) tuer vivant.
A propos de ce vers de Michel et Christine, maintes fois cité:
Aux quatre coins de la machine ronde,
remarquons cette locution usuelle «le coin d’une assiette», qui a donné lieu à la riposte suivante:
«Mon enfant, disait une mère à son petit garçon assis à table à côté d’elle, je t’ai déjà recommandé de ne pas mettre sur la nappe les noyaux de tes cerises; on les dépose sur le coin de son assiette.
— Mais, maman, je ne peux pas le trouver, le coin de mon assiette!» (Le journal La Nation, 31 octobre 1890.)
Mentionnons encore le reproche bien immérité adressé à Molière par Eugène Scribe, dans son discours de réception à l’Académie française, et qu’aucun des Immortels ne releva:
«La comédie de Molière nous instruit-elle des grands événements du siècle de Louis XIV? Nous dit-elle un mot des erreurs, des faiblesses ou des fautes du grand roi? Nous parle-t-elle de la révocation de l’Édit de Nantes?»
Comment Molière, mort en 1673, eût-il pu parler de la révocation de l’Édit de Nantes qui eut lieu en 1685, c’est-à-dire douze ans après sa mort? (Cf. Gustave Flaubert, Dossier de la bêtise humaine, dans Guy de Maupassant, Étude sur Gustave Flaubert, en tête des Lettres de Gustave Flaubert à George Sand, p. XLIV.)
Villemessant, qui, comme nous venons de le dire, a parlé, dans ses Mémoires, des bévues d’Eugène Scribe, mentionne, en ce même endroit, ces deux gentils quatrains extraits de[p. 149] l’opéra-comique Jaguarita l’Indienne, par Saint-Georges et Leuven:
Glissons-nous dans l’herbe
Comme le serpent,
Qui, fier et superbe,
S’avance en rampant.
La dent de la panthère,
Le ventre du boa,
Voilà, sur cette terre,
Voilà le sort qu’on a!
Alfred de Musset et son frère Paul, un soir qu’on venait de jouer, sur un théâtre de société, un vaudeville de Scribe, annoncèrent qu’ils allaient représenter un opéra-comique de leur cru, improvisé séance tenante.
Cette saynète résumait plaisamment les procédés de composition et de facture chers à Eugène Scribe et à son école.
Celui des deux frères qui remplissait le rôle de l’amoureux commençait par chanter:
Oui, j’entrerai dans ce château!
Et l’autre, le valet et confident, de roucouler ensuite:
Il entrera dans ce château!
Puis tous deux de chanter en chœur:
Espérance et courage!
Notre sort sera beau,
Et bientôt, je le gage,
Nous aurons l’avantage
D’entrer dans ce château,
D’entrer (bis) dans ce château.
C’était la fin du premier acte.
Le second acte ne se compose que du même vers, modifié de mille façons:
Vous entrerez dans ce château.
Le tyran, déguisé en basse-taille, beugle:
Ils sortiront de ce château!
Voilà le nœud de la pièce.
Et voici le dénouement:
| CHŒUR FINAL. | ||
| Espérance et courage! | ||
| Notre sort | } | est bien beau. |
| Oui, leur sort | ||
| [p. 150]Nous avons | } | l’avantage |
| Ils ont eu | ||
| D’être installés dans ce château! | ||
«Combien d’opéras-comiques sont brodés sur un canevas tout aussi simplet!» conclut le chroniqueur auquel j’emprunte cette anecdote. (Montécourt [pseudonyme], La République française, 7 décembre 1898.)
Ajoutons qu’on pourrait rapprocher ce minuscule canevas d’opéra-comique du très laconique scénario de tragédie proposé par Rivarol (Cf. ci-dessus, p. 29):
1er acte: il mourra.
2e acte: il ne mourra pas.
3e acte: il mourra.
Etc., etc.
Nous trouvons chez Casimir Delavigne (1793-1843), dans ses Enfants d’Édouard (II, 3), plusieurs anachronismes commis coup sur coup. Tyrrel, la future âme damnée de Glocester, raconte ainsi son ancienne vie joyeuse:
... Je fus quatre fois riche.
Nous étions beaux à voir autour d’un bol en feu,
Buvant sa flamme, en proie aux bourrasques du jeu,
Quand il faisait rouler, sous nos mains forcenées,
Le flux et le reflux des piles de guinées.
Or, cette tragédie des Enfants d’Édouard se passe en Angleterre, sous Richard III (1452-1485), c’est-à-dire vers la fin du quinzième siècle. A cette époque, l’eau-de-vie et le sucre étaient connus sans doute, mais surtout comme produits pharmaceutiques, et sans être entrés dans la consommation courante. Quant au punch, il était inconnu, et les premières guinées ne furent frappées que sous Charles II (1630-1685), avec de l’or importé de Guinée: d’où leur nom. (Cf. le Journal de la Jeunesse, 17 mai 1902, Supplément, Couverture.)
Dans cette même tragédie, nous rencontrons plusieurs fois la locution «A revoir», formule d’adieu exprimant l’espoir qu’on se reverra bientôt, condamnée par Littré, au lieu de «Au revoir». «A revoir, bon neveu!» (I, 2 et 9; et III, 2.)
Nous avons relevé, dans le chapitre consacré à Victor Hugo (p. 100), la mauvaise locution «Montjoie et Saint-Denis» (Louis XI, III, 13), pour «Montjoie Saint-Denis», cri de guerre[p. 151] de nos ancêtres. L’élision de l’e final de Montjoie contraint presque toujours les poètes à faire suivre ce mot de la conjonction et, ce qui enlève tout sens à la phrase, Montjoie Saint-Denis signifiant la Montjoie (le lieu de martyre ou de joie) de saint Denis.
Comme Piron, «qui faisait toutes ses tragédies de tête, et les récitait de mémoire aux comédiens» (Sainte-Beuve, Nouveaux lundis, t. X, p. 61), comme Delille, dont nous avons précédemment rappelé la prodigieuse mémoire, Casimir Delavigne composait tous ses ouvrages «par cœur», et avait coutume de ne les coucher sur le papier que quand ils étaient terminés dans sa tête. On dit même qu’il a emporté ainsi en mourant une tragédie à peu près achevée. (Cf. Sainte-Beuve, Portraits contemporains, t. V, p. 180; et Nouveaux Lundis, t. X, p. 61.)
On a plus d’une fois comparé Casimir Delavigne au peintre Paul Delaroche, Alexandre Dumas, entre autres, dans ses Mémoires (t. V, p. 145). Une plaisante anecdote court à ce sujet: Théophile Gautier ayant écrit dans un de ses feuilletons: «Casimir Delavigne est le Delaroche de la littérature, comme Delaroche est le Casimir Delavigne de la peinture», reçut le lendemain deux lettres, l’une de Delavigne, l’autre de Delaroche, qui, toutes deux, lui disaient la même chose: «Vous avez été un peu sévère pour moi» (Cf. le journal Le Télégraphe, 8 septembre 1884.)
L’œuvre des vaudevillistes Duvert (1795-1876) et Lauzanne (1805-1877) fourmille de facéties et de pasquinades. En voici quelques échantillons, extraits d’un article signé E. S. (Edmond Stoullig?), dans le journal La Tribune, 26 octobre 1876:
«Nous voyons, dans Riche d’amour, Arnal s’écrier: «Je l’ai revue, je l’ai retrouvée, celle que j’aime — ou plutôt celui que j’aime, — car c’est un ange, et l’ange est essentiellement masculin. (Avec indignation:) Masculin! Oh! les gueux de grammairiens![35]»
Plus tard, se demandant s’il ne trouverait pas un peu d’argent chez lui: «C’est que, chez moi, ajoute-t-il, je ne suis pas bien sûr de trouver de l’argent, vu qu’à n’y avait pas un sou quand[p. 152] je suis sorti, et j’ai la clef. J’ai la clef! Il est douteux que des voleurs se soient introduits chez moi avec effraction et y aient oublié leur bourse. Ces événements-là sont si peu communs!»
Et ce couplet:
Quelle infortune est égale à la mienne?
Du lansquenet déplorable martyr,
J’ai beau forer ma poche artésienne,
Pas un centime, hélas! n’en peut jaillir!
................
Et mon gousset, moins heureux que les Gaules,
Appelle en vain l’invasion des Francs!
Nous avons rencontré précédemment, à propos du vicomte d’Arlincourt (p. 21), ce vers:
Le roi Louis s’avance avec vingt mille Francs,
qui pourrait devenir amphigourique, avons-nous dit aussi (p. 129), si l’on écrivait francs avec une initiale minuscule, selon l’orthographe de Victor Hugo.
Les personnages de Duvert et Lauzanne ne se parlent pas à l’oreille: «Ils se glissent deux mots dans la trompe d’Eustache». Un homme, rencontrant dans une cave l’ombre de celui qu’il croit avoir tué, s’écriera: «Cette ombre est étrange; elle sent le coke!» Un autre, à qui l’on demande son âge, répondra: «J’ai l’âge qu’aurait la comète de 1811, si elle vivait encore!»
Etc., etc.
«Ne reconnaît-on point là, remarque Jules Claretie (dans le journal La Tribune, même date), le style ou le procédé d’Henri Rochefort? La Lanterne procède directement de Duvert et Lauzanne, et le fils du vaudevilliste (le vaudevilliste Amand de Rochefort-Luçay: 1790-1871) a dû s’imprégner de ces phrases bizarres, curieuses, dont l’étrangeté fait la force, et qui se gravent, par leur drôlerie même, dans la mémoire.
«Dans un vaudeville de Rochefort et de Pierre Véron, il était question de «ces femmes dont les cheveux sont frisés comme les chicorées, avec cette différence qu’elles ne sont pas sauvages».
C’est tout à fait Arnal, dans L’Homme blasé, parlant de «ces femmes charmantes» qui l’ont ruiné:
«Oui. Et je me regarderais comme un grossier si je les comparais à des sangsues...
— Ah!
— ... Dont elles n’ont d’ailleurs ni la forme...
— Je crois bien!
[p. 153]
— Ni l’utilité!»
(Le journal La Tribune, même date.)
Anticipant sur le chapitre consacré aux journalistes et chroniqueurs, nous citerons ici, pour corroborer la remarque de Jules Claretie, quelques-uns des jeux de mots et des drôleries de La Lanterne d’Henri Rochefort (1830-1913).
«La France contient, dit l’Almanach impérial, trente-six millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement.» (Samedi, 23 mai 1868, p. 1; réimpression de Victor Havard, 1886; un vol. in-18.)
«J’envoyai chercher une feuille de papier ministre, et j’écrivis à celui de l’Intérieur...» (Page 4.) (Phrase déjà citée dans notre Préambule, p. 12-13.)
«La discussion du budget n’est pas encore entamée, mais le budget l’est déjà depuis longtemps.» (Page 203.)
«Toute la suite du prince Napoléon à Constantinople vient d’être décorée par le sultan. — Comment! pas un n’a échappé au désastre?» (Page 238.)
«... Cette belle machine administrative que l’Europe nous envie. (Avez-vous remarqué que l’Europe nous envie énormément de choses, mais qu’elle ne nous prend jamais rien?)» (Page 274.)
«... La cour des Tuileries, ainsi nommée parce que c’est de là que nous arrivent les tuiles.» (Page 286.)
«Les décorés du 15 août devraient être obligés d’aller chercher eux-mêmes la croix en haut du mât de Cocagne de l’esplanade des Invalides. Nous serions sûrs au moins qu’ils auraient fait quelque chose pour l’avoir.» (Page 349.)
Etc., etc.
Peu d’ouvrages ont autant vieilli que La Lanterne; la plupart des allusions qu’elle renferme sont devenues obscures pour nous, et quantité de ses plaisanteries ont perdu leur sel. «Quand on feuillette aujourd’hui la collection de La Lanterne (et c’est de quoi peu de gens s’avisent), on se rend difficilement compte de l’immense succès obtenu par ce pamphlet, écrit le sagace critique Jules Levallois (De la Restauration à nos jours, p. 380). Ni Paul-Louis Courier, ni Cormenin, dans leurs meilleurs jours, n’ont ému à ce point l’opinion publique. De ces pages sarcastiques, que l’on s’arrachait alors si avidement, quelques-unes, les premières surtout, subsistent seulement. Ce qui fit la vogue de ce pamphlet, lorsqu’il parut, c’était un indomptable esprit de révolte, mêlé à ce qu’il faut bien appeler de son nom vulgaire, la blague.»
On peut dire d’Ernest Legouvé (1807-1903) ce qu’on a dit de Jules Janin, dont nous parlerons plus loin, qu’il a eu la passion de l’inexactitude. Il ne peut en quelque sorte citer un seul vers sans le tronquer, et, dans son Art de la lecture comme dans sa Lecture en action, il en cite presque à chaque page.
Même les vers de Corneille, de Racine, de La Fontaine, de Molière, les plus répandus et les plus ressassés, il les estropie. Il s’imaginait sans doute les posséder ad unguem, et ne prenait pas la peine de les vérifier lors de l’impression.
Corneille écrit dans Cinna (V, 1):
Tiens ta langue captive, et si ce grand silence
A ton émotion fait quelque violence;
Legouvé (La Lecture en action, p. 168) met: et si ce long silence, et: fait trop de violence.
Sur ce point seulement contente mon désir,
dit Corneille.
Jusque-là seulement, — dit Legouvé (Ibid.).
Aujourd’hui même encor mon âme irrésolue.
(Corneille.)
Legouvé (Ibid., p. 172): Ce matin même encor...
Bien plus, ce même jour je te donne Émilie.
(Corneille.)
Enfin ce même jour (Legouvé, ibid.).
Et qu’ont mise si haut mon amour et mes soins.
(Corneille.)
Et qu’ont porté si haut (Legouvé, ibid.),
Notez bien qu’ici, comme il s’agit d’une femme, d’Émilie, il faudrait portée au féminin. «Et qu’ont portée si haut...» Legouvé a mieux aimé fausser l’orthographe que le vers et a écrit porté.
Approchez-vous, Néron, et prenez votre place,
dit Racine (Britannicus, IV, 2).
Asseyez-vous, Néron, — dit Legouvé (Ibid., p. 169).
Etc., etc.
[p. 155]
Dans sa comédie Autour d’un berceau (Théâtre, Comédies en un acte, p. 323), Ernest Legouvé met dans la bouche d’un de ses personnages le petit poème si connu, Le Vase brisé, de Sully Prudhomme (Poésies, t. I, p. 11; Lemerre, 1882), et il ne manque pas de le dénaturer et le massacrer.
Son eau fraîche a fui goutte à goutte,
dit Sully Prudhomme.
Son eau pure, — dit Legouvé.
Souvent aussi la main qu’on aime
Effleurant le cœur le meurtrit.
(Sully Prudhomme.)
Ainsi parfois la main qu’on aime.
(Legouvé.)
Ce qui est impardonnable pour un membre de l’Académie française, il confond, en prosodie française, le mot pied avec le mot syllabe: un pied, pour lui, c’est une syllabe: un alexandrin de douze pieds (Cf. La Lecture en action, p. 258), tandis qu’il n’avait qu’à consulter Littré, et il aurait lu (art. Pied, 26o): «Un pied, deux syllabes; ainsi notre alexandrin, qui a douze syllabes, est un vers de six pieds».
Il demande excuse, au lieu de demander pardon (Cf. Louise de Lignerolles, I, 8; Théâtre, Comédies et Drames, p. 22).
Il forge des vers de onze syllabes, destinés à rimer avec des vers de douze:
Et pourriez-vous, sans peur comme sans emphase,
Entendre froidement cette petite phrase.
(Un jeune homme qui ne fait rien, sc. 11; Théâtre, Comédies en un acte, p. 370.)
Il change le genre des substantifs, met le féminin pour le masculin: «Tant de jeunes et charmants talents qui ont illustré et enchanté la scène française... sont toutes des élèves de M. Samson.» (L’Art de la lecture, Quatrième partie, I, p. 264.)
Enfin comment comprendre cette sentence, qui termine un chapitre de La Lecture en action (XVII, p. 204): «Lire les poètes tout bas, c’est devenir leur ami; les lire tout haut, c’est devenir leur intime?» Pourquoi intime quand on les lit tout haut?
[p. 156]
Et, à propos d’Ernest Legouvé, le sens d’un vers de son père (Jean-Baptiste-Gabriel Legouvé: 1764-1812), ce vers si fréquemment cité:
Tombe aux pieds de ce sexe à qui tu dois ta mère,
le dernier et comme le résumé du poème Le Mérite des Femmes, a été parfois discuté.
«Il faut avouer, écrit l’auteur anonyme des Curiosités littéraires (p. 279; Paulin, 1845), que le malheureux que l’on voudrait forcer de tomber aux pieds du sexe auquel il doit sa mère, se trouverait dans un cruel embarras; et Legouvé est bien coupable de n’avoir pas indiqué en note la conduite à suivre en pareille occurrence. Avant lui, on avait cru généralement que le concours des deux sexes était nécessaire pour procréer des garçons ou des filles; mais son vers est venu nous détromper, et il est constant maintenant, quelque incroyable que cela puisse paraître, que, quant aux filles, le sexe féminin suffit seul à la besogne.»
Au nombre des périphrases célèbres, — trois coup sur coup, — figurent les quatre vers suivants de Legouvé père. Pour faire prononcer à Henri IV son mot fameux: «Je voudrais que le plus pauvre paysan de mon royaume pût au moins avoir la poule au pot le dimanche», il écrit:
Je veux enfin qu’au jour marqué pour le repos
L’hôte laborieux des modestes hameaux
Sur sa table moins humble ait, par ma bienfaisance,
Quelques-uns de ces mets réservés à l’aisance.
(Cf. Paul Stapfer, Racine et Victor Hugo, p. 263.)
C’était, comme nous l’avons vu, le temps des périphrases, si chères à Jacques Delille et à ses disciples ou émules.
Quand la borne est franchie, il n’est plus de limites,
estime, non M. de la Palisse, mais François Ponsard (1814-1867), dans L’Honneur et l’Argent (III, 5); et, dans Le Lion amoureux (I, 1, et IV, 6) il nous dépeint le salon d’une grande dame, où
chaque parti se touche;
[p. 157]
et l’un des personnages émet ce vœu, passablement difficile à réaliser:
Que ne puis-je saisir mon cœur dans ma poitrine,
L’écraser contre terre, et fouler sa ruine.
On a souvent cité, comme exemple de prosaïsme, ces vers de Ponsard:
Notre ami, possesseur d’une papeterie,
A fait, avec succès, appel à l’industrie.
(L’Honneur et l’Argent, V, 2.)
En voici deux autres de la même râtelée, appartenant à l’académicien Charles-Guillaume Étienne (1777-1845):
Il est depuis un an dans ses manufactures,
Il y fait établir de vastes filatures.
(L’Intrigante, I, 1.)
Et celui-ci, qui est de Sainte-Beuve (Pensées d’août, Poésies complètes, p. 295; Charpentier, 1890), qu’on ne s’attendait guère à voir apparaître sous sa plume:
Il tenait, comme on dit, un cabinet d’affaires.
Précédemment (p. 107), nous avons cité ce vers de Victor Hugo:
Le Crédit mobilier ou le Crédit foncier,
et celui de Gabriel Marc:
La Caisse des Dépôts et Consignations.
L’École dite «du bon sens», dont François Ponsard et Émile Augier (1820-1889) ont été les grands chefs, nous fournirait à foison de ces vers prosaïques:
Quand le printemps fleurit, il faut que je me purge.
(Émile Augier, Gabrielle, I, 1.)
Fais-lui faire, tu sais, ce machin au fromage.
— Ne vous mêlez donc pas des choses du ménage.
(Id., ibid., I, 2.)
Mais que c’est donc joli tout ce que nous disons!
— Oui, nous n’avons pas l’air d’une troupe d’oisons.
(Id., Philiberte, I, 8.)
[p. 158]
... Quand j’ai dîné,
J’ai besoin de causer à cœur déboutonné.
(Émile Augier, Philiberte, II, 1.)
Ma spécialité, hormis un cas extrême,
Aux jeux qu’on joue à quatre est de faire un cinquième.
(Id., ibid., II, 2.)
Ce dernier vers pourrait être rapproché de cette phrase de Victor Hugo (Correspondance, dans la Revue bleue, 7 novembre 1896, p. 586): «Si les faiseurs d’ordre public essayaient d’une exécution politique, et que quatre hommes de cœur voulussent faire une émeute pour sauver les victimes, je serais le cinquième.»
Et demander excuse pour demander pardon:
... Je me sens si confuse,
Monsieur, que j’ai voulu vous demander excuse.
(Émile Augier, ibid., II, 7.)
Une humoristique et amusante fin de lettre d’Émile Augier, pour en terminer avec lui:
«Mille compliments,
«Mille amitiés,
«Et mille
«Augier.»
(Cf. le journal Le Gaulois, novembre 1889.)
Le fin et charmant lettré que fut Camille Doucet (1812-1895) est rendu responsable aussi de bien étranges vers:
Va, mon fils, de chemin, suis ton petit bonhomme.
Considération! Considération!
Ma seule passion! ma seule passion!
(Cf. Clair Tisseur, Modestes Observations sur l’art de versifier, p. 257; — et Revue bleue, 26 août 1871, p. 198.)
Et ce distique encore, pastiche de Camille Doucet, attribué à l’avocat Ferdinand Duval, ancien préfet de la Seine (Renseignement verbal):
Et pour te témoigner ma satisfaction,
Je te mène au Jardin d’Acclimatation.
Le théâtre d’Eugène Labiche (1815-1888) abonde en jeux de mots, drôleries, incohérences voulues, pataquès fabriqués à dessein, ad risum.
[p. 159]
«... J’ai fait sa connaissance dans un omnibus... Son premier mot fut un coup de pied.» (Un Chapeau de paille d’Italie, I, 4.)
«... Je n’aurai pas même une chaise à offrir à ma femme pour reposer sa tête.» (Ibid., III, 4.)
«C’est un moment bien doux pour un père, que celui où il se sépare de sa fille chérie, l’espoir de ses vieux jours, le bâton de ses cheveux blancs.» (Ibid., IV, 6.)
«Laissez-moi contempler ce profil... ce nez renouvelé des Grecs! ces yeux fendus en amandes... douces! oh! très douces!» (Le Misanthrope et l’Auvergnat, 11.)
«Saint-Germain (domestique). Madame la baronne est attelée! — La Baronne. Comment, je suis attelée? — Saint-Germain. Pardon, je veux dire: la voiture...» (La Fille bien gardée, 1.)
«Ne trempons pas notre plume dans nos larmes!» (Ibid., p. 16.)
«A Bordeaux, quand on aime, quand on distingue une jeune fille au spectacle, on ne s’informe ni de son rang, ni de son nom, ni de son sexe.» (Un jeune homme pressé, 1.)
«Je vais me marier en Amérique; n’ayant pas eu d’enfants dans ce monde, j’ai des chances pour en avoir dans l’autre.» (Ibid., 4.)
«J’avise une affiche: Vins à vendre sur pied. — Comment! des vins sur pied? — Oui, la récolte.» (Ibid., 4.)
«Ah! dame, vous savez [dans cette maison, si gaie qu’elle soit], il y a des jours de souffrance. — Qu’est-ce qui n’a pas ses jours de souffrance!» (Deux papas très bien, 8.)
«... Vous nourrissiez déjà l’espoir... — Et je le nourris toujours, monsieur; je le nourris plus que jamais aujourd’hui,... sans savoir, hélas! si j’en serai plus gras!» (Ibid., 10.)
«... Voici la note: ...un bonnet de femme, un soulier du même sexe et un tour en cheveux, etc.» (L’Affaire de la rue de Lourcine, 21.)
«Tiens! il est sourd, notre correspondant? C’est donc pour ça qu’il ne répond jamais à nos lettres.» (Le Voyage de M. Perrichon, II, 9.)
«(Célimare présentant Vernouillet à Bocardon:) Monsieur Vernouillet... mon meilleur ami! (Présentant Bocardon à Vernouillet:) Monsieur Bocardon... mon meilleur ami!» (Célimare le bien-aimé, I, 10.)
«Est-ce que ça se mange, les poissons rouges? — Pourquoi pas? On mange bien des écrevisses.» (Ibid., III, 1.)
«J’ai voulu leur emprunter de l’argent... — L’éteignoir de l’amitié.» (Ibid., III, 12.)
[p. 160]
«Soit dit sans vous fâcher, mon cher, vous prenez du ventre! — Pourvu que je ne prenne pas le vôtre!» (Un Monsieur qui prend la mouche, 9.)
«Cécile! Je ne vous dis pas adieu... Nous nous reverrons peut-être cet hiver... dans un monde meilleur... au bal, à Paris.» (Ibid., 19.)
«(Vancouver prenant la valise de Dardenbœuf:) Permettez que je vous dévalise!» (Mon Isménie, 11.)
«Montaudoin à sa fille: ...Tu ignores les mystères de la vie parisienne! Tu ne sais pas qu’il y a des tigres qui viennent déposer leurs œufs dans le ménage des colombes! — Fernande: Mais, papa, les tigres n’ont pas d’œufs! — Montaudoin: Ces reptiles ne devraient pas en avoir, mais ils en ont!» (Les 37 sous de M. Montaudoin, 16.)
«Les femmes aiment à s’appuyer sur un bras qui porte une épée à sa ceinture.» (Le plus heureux des trois, II, 2.)
«Il paraît qu’un jour, à sa fête, vous lui aviez composé un petit compliment? — Un quatrain... huit vers seulement.» (La Sensitive, I, 1.)
«Retenez bien ceci: plus un peuple a de lumières, plus il est éclairé. — C’est comme les salles de bal. — Et plus il est éclairé... — Plus il a de lumières.» (29 degrés à l’ombre, 1.)
«Voulez-vous me permettre de faire son portrait à l’huile... et à l’œil?» (La Main leste, 10.)
«Me croyant poète, j’ai commis des vers, et, généralement, quand on commet des vers, on désire les lire à quelqu’un... Peu de poètes ont le courage du vers solitaire!» (La Chasse aux corbeaux, I, 4.)
«Le mariage est un contrat synallagmatique... Article 146... Les époux doivent être libres, français, et de sexe différent.» (Un Monsieur qui a brûlé une dame, 3.)
«Je me perce moi-même... comme Cléopâtre. — Permettez! Cléopâtre... d’abord, c’est un aspic! elle s’est poignardée avec un aspic!» (Les Noces de Bouchencœur, I, 6.)
«Je veux lui plonger dans le cœur un fer rouge... un fer rouge qui s’appellera le remords... un fer rouge qui le poursuivra partout, qui lui rongera le foie... comme un vautour... et dont le miroir implacable lui représentera son crime, en lui criant: «Misérable! tu as trompé ton ami!» (Le Prix Martin, III, 8.)
Presque dès ses débuts, alors qu’il exerçait «le sacerdoce de la critique» au rez-de-chaussée de L’Événement, AUGUSTE VACQUERIE (1819-1895) se rendit célèbre par une énorme bévue, qui, dit Balathier de Bragelonne (Le Voleur, 13 mai 1859, p. 31, et 29 mai 1874, p. 350), «frappa d’étonnement le monde des lettres et des artistes». Il prit le nom d’une île pour un nom d’homme, attribua la Vénus de Milo au «grand sculpteur Milo».
Dans le chapitre des «Romanciers», nous verrons cette même Vénus donner lieu à d’autres quiproquos.
En revanche, on a parfois pris le nom de l’ébéniste Boule (1642-1732) pour un nom commun: «des meubles de boule», «des meubles en boule».
La rime a souvent de cruelles exigences. Auguste Vacquerie l’a éprouvé dans Tragaldabas (III, 2):
Et je vais donc connaître enfin ce paradis
D’être appelé mon chien et mon petit radis.
Il y a d’étranges images, d’ahurissantes métaphores dans Profils et Grimaces, un recueil d’articles du même auteur. Exemples:
«Il en est de l’esprit comme du corps: les bottes neuves gênent le pied, les idées neuves gênent l’intelligence. Le drame est tout neuf, Racine est une vieille botte. Nous comprenons sans les imiter, ceux qui se chaussent de tragédies éculées.» (Page 17.)
«Il y a des enfants qui viennent rachitiques, goitreux, sourds, muets, aveugles; et il y a de fiers et vigoureux oiseaux qui vivent dans les montagnes et dans les tempêtes, superbes, causant avec le tonnerre, souffletant l’orage à coups d’aile et faisant baisser les yeux au soleil... Une ode est un aigle; un vaudeville est un cul-de-jatte.» (Page 140.)
«L’Odéon... c’est la crèche des talents tout petits, des pièces qui vagissent, des comédiens qui ne marchent pas encore, des comédies qui font leurs dents.» (Page 208.)
Elle est de Vacquerie également cette phrase (Ibid., p. 305-306) qui évoque le souvenir de pensées chères à Victor Hugo[36]: «Je suis le bon Samaritain des crapauds... Je suis l’ami[p. 162] intime des colimaçons et le galant des araignées... J’ai envie de dire au chacal: «Mon frère, embrassons-nous!»
Et celle-ci encore (Profils et Grimaces, p. 308-309): «Lorsque je réfléchis à tous les services que les choses nous rendent, j’en veux aux maçons qui chargent trop un vieux mur, et je ne ferais pas de mal à une allumette. Je plains les clous rouillés, je bénis les charrues, je remercie avec effusion les chenets qui se mettent dans le feu pour nous, j’admire les chaudrons.» Etc.
Le toast de Desgenais, dans Les Parisiens (I, 14) de Théodore Barrière (1823-1877) a été plus d’une fois cité comme modèle de pathos: «Je bois aux parasites qui déjeunent de la flatterie et soupent de la bassesse... Je bois à la prudence qui ne relève pas le gant qu’on lui jette, et qui porte crânement un outrage sur l’oreille...»
Et ces métaphores et hyperboles extraites de la même pièce:
«Oh! comme ce pauvre petit baiser a froid! — Oui, ses baisers grelottent au foyer conjugal.» (II, 1.)
«Enfin, monsieur, en supposant que vos rêves brodés au collet ne se réalisent pas...» (II, 1.)
Autres singularités théâtrales.
Fernand Desnoyers (1828-1869), l’auteur de la fameuse pièce de vers relative à Casimir Delavigne et adressée aux
Habitants du Havre, Havrais!
............
Il est des morts qu’il faut qu’on tue!
écrivit en vers le scénario de sa pantomime Le Bras noir (1856, in-18), précaution qu’on aurait volontiers jugée inutile, puisqu’il s’agissait d’une pantomime et qu’aucun de ces vers ne devait être prononcé, et il fut si fier de cette innovation qu’il se mit à joindre à son nom, sur les couvertures de ses volumes, cette mention: «Auteur du Bras noir». C’est par scrupule sans doute ou par modestie qu’il n’ajouta pas: «pantomime en vers». (Cf. Alphonse Daudet, Trente ans de Paris, p. 245; et Larousse, 2e suppl.)
Villiers de l’Isle-Adam (1833-1889) composa un drame en «un acte, une scène et une phrase», et qui avait pour titre La Méprise. Au lever du rideau, dans une demi-obscurité, un[p. 163] couple causait à voix basse et tranquillement de ses petites affaires. Tout à coup, un homme, le jaloux, armé d’un revolver, émergeait de l’ombre, et, sans mot dire, foudroyait le couple à bout portant. Alors la scène s’éclairait. Le justicier se penchait sur les cadavres pour les reconnaître, puis se redressait vivement, stupéfait, ahuri, et déclarait: «Il y a erreur! Je me suis trompé!» (Cf. Émile Bergerat, Le Journal, 3 juillet 1894.)
Il y a aussi des incohérences et drôleries théâtrales qui proviennent des acteurs et non des auteurs. Ce sont, le plus souvent, des contrepetteries. Celle-ci, par exemple, contée par Voltaire (lettre à M. de Bellay, 6 juillet 1767): Au moment de simuler un assaut, et au lieu de commander: «Sonnez, trompettes! En avant!», l’acteur s’écria: «Trompez, sonnettes! En avant!»
La langue fourcha de même, un soir, à une actrice du Théâtre-Français, qui, au lieu de dire: «Ma suivante Lisette», prononça: «Ma suivette Lisante.» (L’Opinion, 19 août 1885.)
L’acteur Febvre, malgré son talent, raconte encore le journal L’Opinion (même date), commit plusieurs de ces pataquès. Au lieu de: «Je vous bénis et je vous vénère», — «je vous vernis et je vous bénère», articula-t-il un soir, sans que, paraît-il, aucun spectateur y prît garde. Ailleurs, au lieu de cette phrase: «J’ai toujours été malheureux: ma mère est morte en me mettant au monde; mon père, un vieux soldat...», il s’écria, avec du reste une profonde expression de mélancolie: «J’ai toujours été malheureux; mon père est mort en me mettant au monde; ma mère, un vieux soldat...»
«D’honneur, mon cher bal, votre comte est superbe!» déclara un soir un acteur qui voulait dire: «Mon cher comte, votre bal est superbe.» (Paul De Kock, Le Petit Isidore, p. 27; Rouff, s. d., in-4.)
Justin Bellanger (1833-1917), qui fut acteur, avant d’être poète et bibliothécaire de la ville de Provins, raconte, dans ses «Souvenirs de jeunesse» (La Vie de théâtre, p. 48-49; Lemerre, 1905) que, jouant le rôle de Francesco dans Gaspardo[p. 164] le Pêcheur de Bouchardy, et ayant lu la lettre dont la première phrase est ainsi conçue: «Je n’étais pas ton père, Francesco!», au lieu de s’écrier ensuite: «Oh! je n’étais pas son fils!» articula un soir avec conviction ces burlesques paroles: «Oh! je n’étais pas son père!» qui provoquèrent un fou rire dans toute la salle.
Et cet autre, ce «grand comédien» s’écriant, au milieu d’une scène fort pathétique et avec la plus superbe conviction: «Un mou de veau, et je suis sauvé!» (Pour: un mot de vous). (A. de Chambure, A travers la presse, p. 489; Ferth, 1914.)
Nous avons vu, dans le chapitre consacré à Victor Hugo (p. 117), qu’à la première représentation d’Hernani le cri d’Hernani à l’adresse de Ruy Gomez: «Vieillard stupide» avait été entendu Vieil as de pique par certains spectateurs.
Voici d’autres confusions du même genre:
Dans la tragédie d’Azémire, de Marie-Joseph Chénier, conte Henri Welschinger (Les Almanachs de la Révolution, p. 144; Jouaust, 1884), comme un des personnages s’écrie: «Que dira ton vieux père?» les beaux esprits de la cour entendirent ou feignirent d’entendre: «Que dira Dieu le Père?» D’où mille pasquinades qui contribuèrent à la chute de la pièce.
Au dernier acte des Funérailles de l’honneur d’Auguste Vacquerie, l’acteur Rouvière ayant à dire: «Je ne suis pas venu ici comme vous, madame, incognito», la moitié de la salle entendit: en coquelicot! Et il paraît que de passionnés romantiques jugèrent cela «très fort, — un trait de génie». (Le Rappel, 4 décembre 1874.)
Un acteur, nommé Paul Laba, à sa sortie du Conservatoire, débuta dans le rôle de Damis, de Tartuffe, et obtint un succès de fou rire, grâce à la manière dont il disait les deux vers:
J’en prévois une suite, et qu’avec ce pied plat,
Il faudra que j’en vienne à quelque grand éclat.
(I, 1.)
L’expression pied plat vise Tartuffe, «mais le comédien crut faire mieux en montrant son pied, — ce pied plat, — indiquant par une pantomime vive et animée l’usage qu’il entendait en faire, ce qui provoqua un effet de gaieté irrésistible». (Félix Duquesnel, Le Temps, 8 novembre 1913.)
[p. 165]
On trouve dans Les Comédiens de Casimir Delavigne (I, 6) ces deux vers:
Le public, dont l’arrêt punit ou récompense,
S’informe comme on joue et non pas comme on pense.
En lançant ce dernier vers, certain acteur amateur, qui cherchait sans doute à produire un effet nouveau, se frappait sur la joue à la fin du premier hémistiche, et sur le ventre en terminant le second. (Le Figaro, 14 décembre 1875.)
Dans une autre pièce du même auteur, sa tragédie Les Vêpres siciliennes, un des personnages, Lorédan, termine l’acte II par cette solennelle et vibrante déclaration:
Du dernier des tyrans ces murs seront purgés.
Et nous n’y rentrerons que vainqueurs et vengés!
Ce que l’un des interprètes de ce rôle modifiait en ces termes:
Du dernier des tyrans ces murs seront vengés.
Et nous n’y rentrerons que vainqueurs et purgés!
(Musée des Familles, 1er janvier 1897, p. 26.)
De même ces deux vers de Corneille (Théodore, I, 2):
Un bienfait perd sa grâce à le trop publier;
Qui veut qu’on s’en souvienne il le doit oublier.
se sont trouvés ainsi transformés par un acteur:
Un bienfait perd sa grâce à le trop oublier;
Qui veut qu’on s’en souvienne, il le doit publier.
Dans La Tour de Nesle, d’Alexandre Dumas et Gaillardet, un acteur, un figurant plutôt, jouant un rôle de messager, avait, en entrant en scène, à prononcer cette simple phrase: «Lettres patentes du roi au capitaine Buridan». Au lieu de cela, ledit messager accourt en s’écriant d’une voix de stentor:
«Lettres épatantes du roi,» etc.
Toute la salle d’éclater de rire.
«Qu’est-ce qu’ils ont donc, ces daims-là? Qu’est-ce qu’il y a de risible? demande le comparse à l’un de ses voisins sur la scène.
— Dame, tu as dit épatantes...
— Eh bien?»
(La République française, 28 février 1899.)
[p. 166]
Un souffleur de la Comédie-Française «s’obstinait à appeler la tragédie de Pertinax, d’Arnault, Le Père Tignace». (Alexandre Dumas, Mémoires, t. VIII, p. 290.)
«Elle a débuté dans Le Cidre (Le Cid) de Corneille; elle a fait Chimène.» (Paul de Kock, Nouvelles, Les Bords du canal, p. 14, Rouff, s. d., in-4.)
Alphonse Karr, dans ses Guêpes (juin 1841, t. II, p. 307), parle d’une affiche théâtrale annonçant une représentation prochaine et portant, faute de musiciens, cet avertissement: «Un dialogue vif et spirituel remplacera la musique, qui nuit à l’action».
Il y eut un soir, dans je ne sais quelle bourgade de Bretagne ou d’ailleurs, un commencement d’incendie au théâtre, où l’on venait de jouer un bon vieux drame, qui se terminait par un bombardement. Le lendemain, l’imprésario n’eut rien de plus pressé que de faire afficher cet avis:
«Désormais, afin d’éviter tout accident, le bombardement se fera à l’arme blanche.» (Cf. Alphonse Lafitte, le journal Le Corsaire, 27 mai 1876.)
Dans une autre petite ville, une troupe de comédiens ambulants venait de jouer Le Misanthrope. L’acteur qui avait rempli le rôle d’Alceste, et qui l’avait joué de moitié avec le souffleur, s’avance sur la scène, après la représentation, s’incline et dit:
«Mesdames et Messieurs, nous aurons l’honneur de vous donner, demain soir, et pour notre clôture définitive, une pièce de Sedaine, Le Philosophe sans le savoir...
— Non pas! non pas! interrompt le maire, qui se trouvait justement dans la salle. Vous venez de jouer Le Misanthrope sans le savoir, et vous saurez demain, s’il vous plaît, Le Philosophe pour le jouer.» (Cf. ID, ibid., 31 mai 1876.)
Sous la Révolution, le citoyen et imprésario Léger ayant fait afficher, dans une ville de province, qu’il donnerait prochainement en représentation Amphitryon, comédie en vers libres de Molière, la municipalité de l’endroit, sur le seul vu de l’affiche, et soucieuse de la bienséance, interdit la représentation. (Cf. Henri Welschinger, Les Almanachs de la Révolution, p. 171.)
[p. 167]
L’anecdote suivante, que je rencontre encore dans ce dernier ouvrage (p. 35), bien qu’en dehors de mon sujet, me semble assez intéressante pour être glissée ici. Dans la ville de Beaune, l’épouse du maire ayant accouché le jour même où son mari était «élevé à la mairie», un bel esprit beaunois salua ce double événement par ce joyeux distique:
Notre choix l’a fait maire, et l’amour le fait père;
Quel triomphe pour nous de le voir père et maire!
Comme exemple des drôleries de la censure théâtrale, n’oublions pas cette anecdote contée par Aurélien Scholl, et dont Planté, «le censeur légendaire», fut le héros (L’Opinion, 30 octobre 1885):
«C’était dans une petite pièce de Siraudin et Delacour. Au lever du rideau, une femme de chambre était occupée à coudre: «Allons, bon! disait-elle, voilà encore mon fil qui vient de casser... C’est pourtant du fil d’Écosse!»
«Planté écrivit en marge: «Choisir une autre qualité de fil pour ne pas altérer nos bons rapports avec l’Angleterre».
[p. 169]
Scarron. — Charles Perrault. — Lesage. — J.-J. Rousseau. Encore l’adjectif sensible. — Florian. — Sterne. — Charles Dickens. — Marmontel. Suppression des incidentes dit-il, dit-elle. — Pigault-Lebrun. — Ducray-Duminil. — Charles Nodier. Tirage à la ligne. — Stendhal. — Henri de Latouche. — Paul de Kock. — Méry. — Topffer. Mots détournés de leur signification.
Scarron (1610-1660), qui écrit avec tant d’esprit et en un bon style, plein de naturel et d’aisance, abondant en expressions originales et idiotismes de terroir, annonce, dans son Roman comique (chap. 15, p. 103; Garnier, s. d.), qu’après certaine sérénade, «on entendit la voix de quelqu’un qui parlait bas le plus haut qu’il pouvait».
De même, dans les Contes de Charles Perrault (p. 106, édit. André Lefèvre), la femme de Barbe-bleue appelant sa sœur Anne «criait tout bas: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?»
Remarquons que ce titre: Roman comique ne signifie pas, comme on le croit généralement, roman plaisant et drolatique, mais roman relatif à la comédie, roman qui peint les mœurs des comédiens. Ce n’est que par extension que l’adjectif comique a pris le sens de plaisant, qui fait rire.
On sait quelles difficultés présente souvent «l’art des transitions». Chamfort en cite une, de transition, celle-ci, aussi brusque que plaisante, qu’il croit pouvoir attribuer à Scarron: «Des aventures de ce jeune prince à l’histoire de ma vieille gouvernante il n’y a pas loin: car nous y voilà». (Dans La Fontaine, Œuvres, t. III, p. 252, note 23; édit. des Grands Écrivains.)
L’anachronisme est un des procédés les plus fréquemment employés par les écrivains burlesques et notamment par Scarron, dans son Virgile travesti, pour dérider le lecteur. En maint endroit, il tire de l’anachronisme des effets amusants par leur imprévu et leur extravagance, comme, par exemple, quand Didon, voyant Énée sortir d’un nuage, fait, de saisis[p. 170]sement, le signe de la croix; quand elle commence par dire son Benedicite en se mettant à table; quand Pygmalion tue, d’un coup d’arquebuse à rouet, Sichée, en train de réciter son bréviaire; Mézence, contemptor divum, ne va jamais à confesse, etc. (Cf. Scarron, Virgile travesti, p. XXXVI et passim, édit. Victor Fournel.)
Les Contes de Charles Perrault (1628-1703), que nous citions il y a un instant, ont été longtemps et sont encore volontiers donnés en lecture à la jeunesse, et cependant il est de ces contes qui sont des plus scabreux, Peau d’Ane, par exemple, où il est question d’un inceste, d’un père amoureux de sa fille:
Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser...
Dites-lui qu’il faut qu’il vous donne,
Pour rendre vos désirs contents,
Avant qu’à son amour votre cœur s’abandonne,
Une robe qui soit, etc.
Notez que Peau d’Ane, malgré cette scandaleuse passion qui forme le fond du récit, a joui de la plus grande vogue dans les familles, durant tout le règne de Louis XIV particulièrement. La petite Louison du Malade imaginaire (II, 11) nous le montre: «Mon papa, je vous dirai si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Peau d’Ane.»
Et ce début du Petit Poucet, le trouvez-vous très édifiant? «Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons; l’aîné n’avait que dix ans, et le plus jeune n’en avait que sept. On s’étonnera que le bûcheron ait eu tant d’enfants en si peu de temps; mais c’est que sa femme allait vite en besogne, et n’en faisait pas moins de deux à la fois.»
Singulière littérature, n’est-ce pas, pour ce que nous appelons des «petites oies blanches»?
Lesage (1668-1747), qui, lui aussi, possède une excellente langue, a singulièrement abusé du passé défini au début du chapitre deuxième du livre VI de Gil Blas (p. 366; Charpentier, 1865): «Nous allâmes toute la nuit, selon notre louable coutume; et nous nous trouvâmes, au lever de l’aurore... nous quittâmes volontiers le grand chemin... nous aperçûmes au pied d’une colline... nous ne jugeâmes pas à propos... nous trouvâmes que ces saules... nous résolûmes... nous mîmes...[p. 171] nous débridâmes nos chevaux... nous nous couchâmes sur l’herbe... nous nous y reposâmes... nous achevâmes... Nous nous amusâmes...» Tout cela dans l’espace de quatorze lignes.
En général, les Français du nord emploient l’imparfait ou le passé indéfini plus volontiers que le passé défini; seuls, les Méridionaux font ainsi usage, à jet continu, de ce dernier temps.
Nous rencontrons chez Lesage, dans son Diable boiteux (t. II, p. 110 et suiv.; édit. de la Bibliothèque nationale), un phénomène qui n’est pas rare chez les romanciers. C’est un moribond qui tient des discours interminables. Don Fadrique vient d’être blessé en duel, il a le poumon transpercé, ordre absolu lui est donné de se taire, et il trouve la force et le moyen de pérorer pendant plusieurs pages.
De J.-J. Rousseau (1712-1778), dans La Nouvelle Héloïse (Partie I, lettre 64; Œuvres complètes, t. III, p. 238; Hachette, 1856): «Jamais les larmes de mon amie n’arroseront le nœud qui doit nous unir», écrit Claire à M. d’Orbe.
«Quel supplice, auprès d’un objet chéri, de sentir que la main nous embrasse, et que le cœur nous repousse!» (Ibid., III, 18; p. 366.)
Dans Les Confessions (I, 1; t. V, p. 314) Jean-Jacques écrit, en parlant des amours d’enfance de son père et de sa mère: «Tous deux, nés tendres et sensibles, n’attendaient que le moment de trouver dans un autre la même disposition; ou plutôt ce moment les attendait eux-mêmes, et chacun d’eux jeta son cœur dans le premier qui s’ouvrit pour le recevoir».
Phrase singulière, fortement tirée par les cheveux, comme on dit, et où nous rencontrons, en outre, cette locution, nés tendres et sensibles, si fréquente au dix-huitième siècle, ainsi que nous l’avons vu déjà (p. 65), et que Jean-Jacques, si impressionnable et sensible lui-même, qu’on a très justement comparé à un derme à nu, à un écorché, emploie plus que personne.
«Je crois que jamais individu de notre espèce n’eut naturellement moins de vanité que moi», déclare Jean-Jacques un peu plus loin (p. 320). Et, quelques pages auparavant, tout au début du livre (p. 313), il s’est adressé, en ces termes, à l’«Être éternel»: «Rassemble autour de moi l’innombrable foule de mes semblables; qu’ils écoutent mes confessions... et puis[p. 172] qu’un seul te dise, s’il l’ose: Je fus meilleur que cet homme-là». Ailleurs, dans une lettre à M. de Malesherbes, datée du 4 janvier 1762 (t. VII, p. 212), il écrit tout crûment et modestement: «Je mourrai... très persuadé que, de tous les hommes que j’ai connus en ma vie, aucun ne fut meilleur que moi». «Je partirais avec défiance, si je connaissais un homme meilleur que moi», dit-il encore, dans une lettre du 1er août 1763 (p. 378). Comment concilier le premier de ces aveux: personne n’a moins de vanité que moi, avec les suivants: personne n’est meilleur que moi?
Rousseau — on a souvent signalé cette particularité — a employé le féminin, généralement évité, du mot amateur: «Cette capitale (Paris) est pleine d’amateurs et surtout d’amatrices.» (Émile, livre III, t. I, p. 582; Hachette, 1862.)
Voici une remarque de Rousseau, à propos des dramaturges de son temps; elle peut s’appliquer à ceux du nôtre et à nos feuilletonistes: «Je ne saurais concevoir quel plaisir on peut prendre à imaginer et composer le personnage d’un scélérat, à se mettre à sa place tandis qu’on le représente, à lui prêter l’éclat le plus imposant. Je plains beaucoup les auteurs de tant de tragédies pleines d’horreurs, lesquels passent leur vie à faire agir et parler des gens qu’on ne peut écouter ni voir sans souffrir. Il me semble qu’on devrait gémir d’être condamné à un travail si cruel: ceux qui s’en font un amusement doivent être bien dévorés du zèle de l’utilité publique. Pour moi, j’admire de bon cœur leurs talents et leurs beaux génies; mais je remercie Dieu de ne me les avoir pas donnés.» (J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse, VI, 13, note finale; t. III, p. 640.)
Tout le monde connaît Le Vœu ou Rêve de bonheur si admirablement décrit par Jean-Jacques Rousseau: il figure dans toutes les anthologies: «Sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j’aurais une petite maison rustique, une maison blanche avec des contrevents verts... J’aurais un potager pour jardin, et pour parc un joli verger», etc. (Émile, IV; t. II, p. 144; Hachette, 1863). Florian (1755-1794), — dont nous avons déjà parlé dans un des chapitres consacrés aux poètes, — a formé le même souhait et presque dans les mêmes termes: «Quand pourrai-je vivre au village? Quand serai-je le possesseur d’une petite maison entourée de cerisiers? Tout auprès seraient un jardin, un verger, une prairie et des ruches; un ruisseau bordé de noisetiers environnerait mon empire; et mes désirs ne passeraient jamais ce[p. 173] ruisseau.» Etc. (Galatée, II; Fables et autres œuvres, p. 229; Didot, 1858.)
De Florian encore ces singulières phrases:
«Il fit un soupir: je soupirai aussi; il me serra la main: je ne crois pas le lui avoir rendu.» (Galatée, I, p. 224.)
«... J’ai tout avoué (à mon père); je lui ai dit que je portais dans mon sein le gage de notre union, que cet enfant était le sien, et qu’il lui demandait, par ma voix, la permission de naître pour l’aimer.» (Le Bon Ménage, scène 18, p. 434.)
Nous lisons, dans La Vie et les Opinions de Tristram Shandy de Sterne (1713-1768) (t. III, p. 60; édit. de la Bibliothèque nationale, 1885; trad. M. D. L. B.) — que nous citons ici exceptionnellement, comme le suivant, puisque nous ne nous occupons que des écrivains français: «... Que serait son livre?... Un recueil d’impertinences des (sic) vieilles femmes des deux sexes.» La même inadvertance se trouve dans un autre auteur anglais, Charles Dickens (1812-1870), La Petite Dorrit (t. I, p. 202, chap. 17; Hachette 1869; trad. P. Lorain): «... plusieurs autres vieilles dames des deux sexes».
C’est à Marmontel (1723-1799) qu’on doit la suppression des incidentes dit-il et dit-elle dans les conversations écrites. A la fin de la préface de ses Contes moraux (t. I, p. x; La Haye, s. n. d’éditeur, 1761), il se félicite de cette innovation: «Je proposai, il y a quelques années, dans l’article Dialogue de l’Encyclopédie, de supprimer les dit-il et dit-elle du dialogue vif et pressé. J’en ai fait l’essai dans ces Contes, et il me semble qu’il a réussi. Cette manière de rendre le récit plus rapide n’est pénible qu’au premier instant; dès qu’on y est accoutumé, elle fait briller le talent de bien lire.»
«En reconnaissance de cette découverte, dit un des personnages de l’abbé Dulaurens, dans l’Arretin (sic) moderne (t. II, p. 76; Baillière et Messager, 1884), les auteurs devaient (devraient?) se cotiser pour ériger une statue de terre glaise à ce grand homme, la placer à la porte de l’Académie avec cette inscription[37]:
J’ai banni du français les dit-il, les dit-elle.»
[p. 174]
Marmontel ne se doutait guère de quels expédients s’aviseraient ses successeurs, et par quoi seraient remplacés ces dit-il et dit-elle. Au lieu d’écrire: «Il dit en bâillant» ou «Elle s’écria en rougissant» ou «Je te maudis! cria-t-il en s’élançant», certains romanciers usent volontiers des abréviations suivantes: «Ah! bâilla-t-il.» «Oh! rougit-elle...» «Je te maudis! s’élança-t-il.» Etc. On peut affirmer que tous les verbes de la langue française y passent ou y ont passé.
«Que faites-vous ici, monsieur? brusqua Nicole.» (Alexandre Dumas, Joseph Balsamo, chap. 74.)
«Ah ça! le vieux, pouilla-t-il, réjouissons-nous.» (Léon Cladel, Les Va-nu-pieds, p. 115, Les Auryentys; Lemerre, 1884.) (Pouiller, dire des pouilles, des injures.)
«Hé! rauqua-t-il, pépère Lenfumé, du fort et du meilleur!» (Id., ibid., p. 205, Un Noctambule.)
Un conteur en prose et en vers, qui ne manquait pas de talent, Auguste Saulière (1845-1887), l’auteur des Leçons conjugales, des Histoires conjugales, etc., a particulièrement, dans ce cas, varié ses formules. En voici des exemples empruntés à son roman Les Guerres de la Paroisse (Lemerre, 1880):
«Bandit? Je n’ai encore volé ni tué personne, se redressa le petit musicien avec dignité.» (Page 176.)
«Toi, va te promener avec ton pistolet! se renfrogna le père.» (Page 211.)
«J’appartiens à la famille, moi! se campa le petit sacripant.» (Page 211.)
«Tiens, papa, se retourna Lexandrou...» (Page 211.)
«Peuh! se dandina M. Couffignol...» (Page 230.)
«Eh! sourit le curé, il ne dira pas la messe, lui!» (Page 261.)
«Oh! papa, se signa Lexandrou...» (Page 349.)
«Il nous arrivera malheur, papa, si tu continues, tremblait Antonine...» (Page 349.)
Etc., etc.
Pigault-Lebrun (1753-1835), qui trace un parallèle des Anglais et des Français, dans son roman L’Enfant du Carnaval (t. I, p. 67; édit. de la Bibliothèque nationale), s’exprime en ces termes:
«Le Français passe sa vie aux pieds de ses maîtresses... Mais ses maîtresses le trompent.
— Les Anglais ne le sont-ils jamais?»
Ce qui veut dire: Les Anglais ne sont-ils jamais trompés?
Les phrases étranges, amphigouriques, grotesques et cocasses, abondent chez le romancier Ducray-Duminil (1761-1819), qui a joui jadis de tant de vogue. Voici quelques échantillons de ce pathos et galimatias, extraits de Victor ou l’Enfant de la forêt, qui passe pour le chef-d’œuvre de cet écrivain:
«Un pays raboteux, hérissé de vieilles tours, de masures, de coteaux boisés, de prairies et de ruisseaux... Une petite porte, percée dans un des créneaux de la muraille, et qui donnait de plain-pied sur la campagne.» (Tome I, p. 17; 10e édit., Belin-Leprieur, 1821.)
«Il examine l’enfant, qui entre dans la carrière tortueuse de la vie.» (Tome I, p. 30.)
«Il avait besoin encore longtemps de cette nourriture céleste dont la nature a rendu les femmes dépositaires, et qui est le premier aliment de tous les hommes.» (Tome I, p. 196[38].)
«Ce siècle, comme la trombe foudroyante qui, après avoir démâté les vaisseaux, s’avance sur le rivage pour entraîner dans sa course les arbres et les masures du laborieux agriculteur, ce siècle, dit de lumière, a moissonné les vertus sociales et privées; il a émoussé la délicatesse, absorbé les jouissances de l’âme, et tué le sentiment.» (Tome II, p. 53.)
«Cette lettre fit sur nous l’effet de la grêle qui détruit l’espoir du laboureur.» (Tome III, p. 220.)
«Victor lui-même sait que ce silence absolu de la nature l’invite à céder aux pavots que le dieu du sommeil verse sur ses paupières.» (Tome IV, p. 16.)
«Mon père, s’écrie-t-elle en versant un torrent de larmes, oh! serrez encore votre fille dans vos bras paternels!» (Tome IV, p. 63.)
[p. 176]
Ducray-Duminil use fréquemment d’une amusante précaution oratoire, il s’identifie en quelque sorte avec ses personnages:
«Je frémis, Victor, moi qui suis ton historien, et je tremble encore qu’il ne t’arrive un jour de plus grands malheurs.» (Tome III, p. 55.)
«Quels nouveaux malheurs vont encore flétrir ta jeunesse? J’en prévois de cruels, d’inattendus (pauvre Victor!) que je n’aurai peut-être pas la force de raconter à mes lecteurs... Mais que dis-je? si tu as eu le courage de les supporter, je dois avoir celui de les transporter à l’histoire...» (Tome III, p. 271.)
Que de choses il y aurait encore à citer dans ce curieux livre, si démodé et oublié aujourd’hui!
«Clémence soupire et chante à son tour les couplets suivants, qu’elle improvise, ainsi qu’il est très aisé de le voir par le ton plus simple que poétique qui en fait le charme:
Ce fut dans ce lieu solitaire
Qu’un jour un amant malheureux
Fit à celle qui lui fut chère
Les plus tendres aveux.»
(Tome IV, p. 130.)
Etc., etc.
L’auteur de Victor ou l’Enfant de la forêt abuse des je frémis, il frémit, et il abuse aussi, comme sa contemporaine Mme de Staël, ainsi que nous le verrons plus loin, des syncopes et évanouissements.
Ducray-Duminil avait débuté par le journalisme: il rédigeait, dans Les Petites Affiches, les comptes rendus des représentations théâtrales, et, «doué d’un caractère essentiellement bénin, lorsqu’il se voyait chargé d’enregistrer la chute d’une pièce, il ne manquait jamais d’ajouter à son article cette phrase consolante: L’auteur est un homme d’esprit qui prendra sa revanche.» (Staaff, La Littérature française, t. II, p. 1043.)
Charles Nodier (1780-1844), qui s’est plu souvent, dans ses écrits pseudo-historiques, à mystifier ses lecteurs[39], répondait un jour à quelqu’un qui lui reprochait les longs adverbes dont il émaillait sa prose: «Un mot de huit syllabes fait une ligne, et[p. 177] chaque ligne m’est payée vingt sous.» (Cf. P.-J. Proudhon, Les Majorats littéraires, III, § 8, p. 119.)
Aussi nombre de romanciers, — de feuilletonistes surtout, — délayent-ils leur prose le plus possible, et s’efforcent-ils, comme on dit, de «tirer à la ligne». Alexandre Dumas père nous offrira prochainement quelques exemples de ce procédé tout mercantile.
Stendhal (1783-1842), dans une de ses nouvelles, Le Philtre (Chroniques et Nouvelles, p. 299 et 309; Librairie nouvelle, 1856), vieillit instantanément de dix années un de ses personnages: «J’ai trente ans de plus que vous, ma chère Léonor... — Vous n’avez que dix-neuf ans et lui cinquante-neuf...» Ce qui fait quarante ans.
Ailleurs, à propos de Mme de Staal-Delaunay, Stendhal fait cette déclaration et ce pléonasme: «Je dirai qu’une femme ne doit jamais écrire que des œuvres posthumes à publier après sa mort.» (De l’amour, II, chap. 55, p. 192; M. Lévy, 1857.)
On sait quel était «l’idéal du style» pour Stendhal. «Dans sa haine pour l’emphase contemporaine, il disait que l’idéal du style, pour lui, c’était le Code civil. Il en lisait une page tous les matins.» (Émile Deschanel, Le Romantisme des classiques, t. I, p. 28.)
Je ne crois pas que ce système lui ait parfaitement réussi.
Ferdinand Brunetière a crûment qualifié La Chartreuse de Parme de «chef-d’œuvre d’ennui prétentieux» (Cf. la Revue critique des idées et des livres, 10 mars 1913, p. 656); mais il est à remarquer que c’est Stendhal lui-même et tout le premier et maintes fois qui a fait l’aveu de cet ennui et demandé pardon au lecteur de la fatigue qu’il lui cause.
«Le lecteur trouve bien longs sans doute les récits de toutes ces démarches... Le lecteur trouve cette conversation longue... Le lecteur est peut-être un peu las de tous ces détails...» (La Chartreuse de Parme, p. 200, 292 et 436-437; Librairie nouvelle, 1855.)
«Nous craignons de fatiguer le lecteur du récit des mille infortunes de notre héros... Tout l’ennui de cette vie sans intérêt que menait Julien est sans doute partagé par le lecteur...» (Le Rouge et le Noir, p. 187 et 409; M. Lévy, 1862.)
On voit combien Stendhal appréhendait l’effet qu’il pouvait et devait produire sur son public.
Henri de Latouche (1785-1851), l’éditeur d’André Chénier, l’ermite de la Vallée aux loups, écrit, dans son roman[p. 178] Fragoletta (p. 119; M. Lévy, 1867), cette phrase, qui se ressent un peu trop de l’influence romantique: «On eût dit cette espèce de couleur meurtrie,... ces teintes livides partant en étoile de la lame d’un poignard quand il a été laissé trois jours dans les flancs d’un cadavre.»
Paul de Kock (1794-1871), dont le nom a jadis été si populaire, nous montre, dans son roman Le Petit Isidore (p. 96; Rouff, s. d., in-4) une vieille moustache qui s’essuye les yeux: «La vieille moustache lit, en s’arrêtant quelquefois pour s’essuyer les yeux...» Vous devinez que ladite moustache appartient à un brave troupier, un vieux grognard. Louis Reybaud, dans son Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des républiques (chap. 35, p. 350; M. Lévy, 1862), a fait usage de la même métaphore ou synecdoque: «Pour supporter d’un œil sec un tableau pareil, il faut être de la trempe des vieilles moustaches qui firent, avec l’Empereur, le tour de l’Europe, et laissèrent sur les bords de la Bérésina un nez ou un orteil.» Et Balzac (Melmoth réconcilié, dans le volume La Recherche de l’absolu, p. 263; Librairie nouvelle, 1858): «Une vieille moustache comme moi, s’enjuponner, s’acoquiner à une femme!»
«La jeune fille détourna la tête pour cacher des larmes qui tombaient de ses yeux», écrit Paul de Kock, dans Un jeune homme charmant (p. 12; Rouff, s. d.; in-4). En effet, c’est d’ordinaire des yeux que tombent les larmes.
«Le mélèze aux larges feuilles», dit-il encore dans le même roman (p. 10). Or, les feuilles du mélèze, du «pin mélèze», ne sont que des «aiguilles»: «Mélèze, feuilles étroites et très allongées» (Gaston Bonnier, Les Noms des fleurs, p. 268, art. 1056).
Ailleurs, dans une nouvelle intitulée Les Plaisirs de la pêche (Paul de Kock, Nouvelles, p. 45; Rouff, s. d., in-4), il nous dit que «M. Bertrand, grand amateur de pêche, passait le temps de sa récréation, soit à guetter le poisson, soit à chercher dans la terre de l’asticot». Non, ce n’était pas dans la terre que M. Bertrand cherchait «de l’asticot»; dans la terre, il savait bien ne trouver que des vers gris ou rouges; les asticots, il se les procurait autrement.
Dans L’Amour qui passe et l’Amour qui vient (p. 14; Rouff, s. d., in-4), Paul de Kock nous dépeint un vieux garçon pratiquant les amours ancillaires, et à qui de jeunes marmitons, ses[p. 179] voisins, font concurrence, et il emploie cette amusante locution: «Pourquoi ne pas fuir cette maison peuplée de marmitons qui lui coupent les bonnes sous le pied?»
«Mme Durand soupire en disant: «C’est bien heureux!» Et ses jeunes voisins en poussent aussi [sans doute des soupirs], mais sans rien dire.» (Jean, p. 10; Rouff, s. d., in-4.)
«Jean pleurait ou trépignait des pieds.» (Ibid., p. 12.)
«Dès qu’on est deux, je forme un quadrille.» (Ibid., p. 14.)
«Remettez-vous, monsieur, dit le notaire à Adolphe en souriant de son étonnement. Onze cent mille francs, c’est une jolie fortune, sans doute, mais enfin vous ne serez pas encore millionnaire.» (Monsieur Dupont, chap. 29, p. 60; Rouff, s. d., in-4.) Que lui faut-il donc, à ce tabellion, pour faire un millionnaire?
«Elle portait dans son sein un nouveau gage de l’amour de son époux.» (Paul de Kock, L’Homme aux trois culottes, chap. 14, p. 44; Rouff, s. d., in-4.) «Elle porte dans son sein un gage de sa faiblesse.» (Id., Sanscravate, chap. 30, p. 79; Charlieu, s. d., in-4.) Nous avons déjà vu (p. 69 et 173) des exemples de cette très fréquente périphrase.
Ne quittons pas Paul de Kock sans rapporter cette plaisante anecdote contée par les Goncourt, dans leur Journal (année 1865, t. II, p. 312): «Le maire d’ici (de Bar-sur-Seine?) est lié avec Paul de Kock, lui envoie du cochon et du boudin, et a reçu en échange son portrait. Sa femme, un jour de Fête-Dieu, pour orner son reposoir, avait donné tout ce que le ménage avait d’artistique, et le portrait de Paul de Kock était exposé à la vénération des fidèles, au beau milieu du reposoir.»
Dans La Croix de Berny (lettre II, p. 17; Librairie nouvelle, 1859), l’un des auteurs, le poète et romancier Joseph Méry (1798-1866), sous le pseudonyme de Roger de Monbert, donne «des épaulettes à ces trois illustres généraux, César, Alexandre et Annibal».
Le romancier genevois Rodolphe Topffer (1799-1846) fait un usage fréquent — ce qui se comprend de reste — de certains idiotismes suisses qui déconcertent et détonnent en français. Non seulement il emploie, comme son compatriote Jean-Jacques Rousseau, la mauvaise locution causer à quelqu’un pour causer avec quelqu’un: «Pendant qu’il me causait... J’aime que vous me causiez...» (Le Presbytère, p. 8 et 52;[p. 180] Hachette, 1907), mais il crée des mots comme empléter (acheter, faire des emplettes: peut-être usité en Suisse): «J’ai fait une course à Genève pour empléter des articles» (Le Presbytère, p. 449); ou bien, ce qui est plus grave, ce qui trouble la clarté de la phrase et risque de la rendre incompréhensible, il change l’acception des termes, ou, plus exactement sans doute, il les emploie avec l’acception qu’ils ont à Genève. Notre vieux mot idoine, qui veut dire apte ou propre à quelque chose (idoneus), a, chez Topffer, le sens d’inepte, d’idiot: «... Son idoine de mari, qui a plus soif que faim...» (Ibid., p. 149.) Gabegie, terme populaire signifiant fraude, supercherie (Cf. Littré), devient chez lui le synonyme de tracas, de souci: «Qu’auras-tu avancé là en te leurrant de pronostics, de lourdeurs et de gabegies?» (Ibid., p. 395.)
N’avons-nous pas lu jadis à Reims (vers 1895), sur des devantures de restaurateurs et de marchands de vin, le mot asperges, «asperges tous les jours», signifiant, selon les uns, «tripes à la mode de Caen», selon d’autres, «tripes à la sauce blanche»?
[p. 181]
Honoré de Balzac. Obscurités voulues et bizarreries et tares involontaires. Anachronismes. Locutions fréquentes.
Philarète Chasles. — Henri Monnier. — Louis Reybaud. — Frédéric Soulié. Confusion qui règne dans ses romans. — Stéphen de la Madelaine. — Mérimée.
Nous avons vu les poètes dits symbolistes s’efforcer de se rendre obscurs et incompréhensibles pour attirer l’attention et l’admiration du public. Honoré de Balzac (1799-1850) ne dédaignait pas d’user de cet antique procédé, et il n’en faisait pas mystère. Le dessinateur Bertall, qu’un éditeur avait chargé des illustrations de La Comédie humaine, se trouvant embarrassé, dans cette tâche, par des phrases plus ou moins ténébreuses, eut recours à l’auteur et l’interrogea. Bertall lui-même rapporte ainsi cette conversation (Cf. le journal Le Soleil, 12 avril 1882):
«Mon cher maître, voici un passage que je ne comprends pas très bien.»
Balzac prit le livre, lut l’endroit désigné et se mit à rire.
«En effet, dit-il, c’est du galimatias... Mais c’est voulu!
— Comment, voulu?
— Parfaitement. Vous entendez bien, mon cher Bertall, que si le public n’était pas arrêté de temps à autre par quelque phrase bien enchevêtrée ou quelque mot très hérissé, il se croirait aussi malin que l’auteur qu’il lit. Tout ce qui est clair lui paraît trop facile. Il se figure, le naïf, qu’il en ferait autant! Il ignore, ce satané public, que ce qu’il y a de plus difficile, c’est d’être simple. C’est pourquoi je saupoudre quelquefois mes romans d’une bonne petite obscurité afin que le bon lecteur se prenne la tête à deux mains et dise: «Je ne comprends pas du tout![p. 182] Ça me dépasse! Sapristi! tout de même, comme ce Balzac est fort[40]!»
Mais, à côté de ces imbroglios voulus, on rencontre, chez Balzac, plus d’une tare ou d’une bizarrerie involontaires.
Dans Splendeurs et Misères des courtisanes (p. 253; Librairie nouvelle, 1856), il nous montre, chose merveilleuse sans doute, un priseur qui prend son tabac par le nez: «... le faux officier de paix en achevant de humer sa prise par le nez».
Dans La Cousine Bette (p. 259; Librairie nouvelle, 1856), un commissaire de police répond silencieusement: «Elle n’est point folle». Mais ce n’est là sans doute qu’une faute d’impression, et il faut lire: sentencieusement.
Dans le même roman, le critique Émile Faguet (Études littéraires sur le dix-neuvième siècle, p. 450) relève cette phrase et la cite comme un exemple de métaphores à la fois vulgaires et prétentieuses: «La bienfaitrice trempa le pain de l’exilé dans l’absinthe des reproches.»
«Le Lys dans la vallée, ajoute Émile Faguet (Ibid.), est un prodige de pathos et de phœbus.»
Encore du pathos et de l’amphigouri: «En achevant d’embrasser, par sa profonde intuition, les misères que réveilla cette idée mélancolique, il (le meurtrier) jeta sur Hélène un regard de serpent, et remua dans le cœur de cette singulière jeune fille un monde de pensées encore endormi...» (La Femme de trente ans, p. 142; Librairie nouvelle, 1859.)
Et cette drôlerie dans l’Histoire des treize (Ferragus, p. 149; Librairie nouvelle, 1856): «... Jules, seul dans une calèche de voyage lestement menée par la rue de l’Est, déboucha sur l’esplanade de l’Observatoire...»
Dans le même ouvrage, nous voyons une jeune fille qui ignore l’art de se teindre, et dont cependant les cheveux changent de couleur: ils sont tantôt «cendrés» (p. 352), tantôt «noirs» (p. 383).
Et «ces yeux qui semblent avoir des oreilles», dans L’Envers de l’histoire contemporaine (p. 221, Librairie nouvelle, 1860).
Tout à l’heure Balzac nous a fait voir un individu lançant[p. 183] sur une femme «un regard de serpent»; dans Les Chouans (p. 110, Librairie nouvelle, 1859), il nous montre un de ses personnages qui «jette sur sa maîtresse un coup d’œil aussi noir que l’aile d’un corbeau».
Dans le même roman, — qui date de la jeunesse de l’auteur et est fréquemment mal agencé et obscur (Cf. Marcel Barrière, L’Œuvre de H. de Balzac, p. 290 et suiv.), — nous voyons (p. 311) l’héroïne, Marie de Verneuil, sortir d’une affreuse chaumière, d’un taudis où gens et bestiaux vivent en commun; puis, par une singulière inadvertance, ce taudis se trouve subitement, dans la même page, et quelques lignes plus bas, transformé en salon. «Tout à coup, Mlle de Verneuil rentra dans le salon...»
Et (Les Chouans, p. 277) cet amoureux qui, pour prouver à sa maîtresse combien est violente sa passion, saisit, dans le foyer, un bout de tison, un charbon ardent, le garde et le serre dans sa main, sans paraître souffrir de cette brûlure, sans même s’en occuper ni s’en soucier: «Mais jetez donc ce feu! Vous êtes fou! Ouvrez votre main, je le veux!» lui crie sa maîtresse, qui réussit enfin à ouvrir cette main. Je sais bien que Mucius Scævola et d’autres ont accompli cet exploit... N’importe!
Dans La Muse du Département (p. 154-155; Librairie nouvelle, 1857), Balzac met en scène une soubrette qui, à l’aide d’un mouchoir, bande solidement les yeux à l’un des personnages, de façon qu’il ne puisse voir où elle va le conduire, et lui fait ensuite cette étrange recommandation: «Veillez bien sur vous-même! Ne perdez pas de vue un seul de mes signes!»
Inadvertance à peu près comparable à celle que nous offre John Lemoinne, dans le Journal des Débats (cité par Le National, 2 novembre 1884): «Le roi de Hanovre aveugle et souffrant de voir son royaume incorporé dans la Prusse», voir avec les yeux de l’esprit, il est vrai; — et à celle aussi que nous rencontrons chez Émile Pouvillon (Pécaïre, dans le volume Les Petites Ames, p. 172 et 180), où «Ginibre, un honnête aveugle,... envoie un regard mélancolique à une bouteille vide».
Au lieu d’un aveugle qui voit clair, c’est quelquefois un muet qui prend la parole: «M. le grand rabbin de France Isidor, qu’une récente attaque de paralysie condamne au mutisme, a voulu, en cette occasion, mêler sa voix aux prières adressées à Dieu à l’intention de Mosès Montefiore.» (Cité par Le National, 2 novembre 1884.)
La dédicace de la courte étude de Balzac intitulée La Bourse[p. 184] débute ainsi: «N’avez-vous pas remarqué, mademoiselle, qu’en mettant deux figures en adoration aux côtés d’une belle sainte, les peintres ou les sculpteurs du moyen âge n’ont jamais manqué de leur imprimer une ressemblance filiale?» Comme les figures ainsi placées aux côtés des saints et des saintes, ces figures de «donateurs», sont d’ordinaire celles d’un père et de ses fils, d’une mère et de ses filles, cette ressemblance est toute naturelle et de rigueur en quelque sorte, et les artistes ne pouvaient manquer de l’exprimer.
Dans Le Cousin Pons (p. 37-38; Librairie nouvelle, 1856), Balzac parle d’un admirable éventail, «divin chef-d’œuvre que Louis XV a bien certainement commandé pour Mme de Pompadour... Watteau s’est exterminé à composer cela!» ajoute-t-il par la bouche du vieux Pons. Or, Watteau est mort en 1721, l’année même où la belle marquise venait au monde.
«Un rossignol vint se poser sur l’appui de la fenêtre», prétend Balzac dans La Peau de chagrin (p. 255; Librairie nouvelle, 1857). Un rossignol qui se pose sur une fenêtre, — cela ne se voit pas tous les jours ni même toutes les nuits de mai.
«Quel plaisir d’arriver couvert de neige dans une chambre éclairée par des parfums!» lit-on dans le même roman (p. 110).
Et dans la Physiologie du mariage (p. 301; Librairie nouvelle, 1876): «Nous sommes amoureux à vingt ans... et nous cessons de l’être à cinquante. Pendant ces vingt années...»
Dans les Petites Misères de la vie conjugale (p. 135; Librairie nouvelle, 1862), une amusante phrase que je me borne à indiquer: «Le diable aime surtout à mettre sa queue...»
Alphonse Karr, qui était très ferré sur l’horticulture, qui a même exercé la profession de jardinier-fleuriste à Nice et à Saint-Raphaël, a plus d’une fois relevé, dans ses Guêpes, les erreurs commises par les romanciers, ses confrères, dans leurs descriptions des fleurs. Ainsi il reproche à Balzac ses «azalées qui grimpent et tapissent les maisons» (Ibid., août 1843, t. V, p. 6 et 10); — à Jules Janin son «œillet bleu» (Ibid., janvier 1844, t. V, p. 86); — à George Sand ses «chrysanthèmes bleus» (Ibid.); — etc.
Les Contes drolatiques passent, et peut-être avec raison, pour le chef-d’œuvre purement littéraire de Balzac; c’était l’avis de Barbey d’Aurevilly (Cf. Romanciers d’hier et d’avant-hier, p. 15 et 37), et l’opinion de Balzac lui-même: malgré l’insuccès complet de ces Contes lors de leur apparition, «il croyait qu’à défaut de ses autres œuvres, ils suffiraient pour le sauver de l’oubli» (Mme Surville, Balzac, p. 145). Or, si habile et si[p. 185] savant que soit le style archaïque de ces Contes, il est des endroits qui trahissent l’époque moderne, celui-ci, par exemple: «Ce grand et noble curé n’estoit pas fort que de là» (Premier dixain, Le Curé d’Azay, p. 279; Librairie nouvelle, 1859). Ne pas que, dans le sens actuel, — «n’était pas fort seulement que de là», — est une locution illogique, fautive et moderne: elle n’apparaît, dans notre langue, que vers la fin du dix-huitième siècle: voir ci-dessus, Préambule, p. 14-15, note; et Littré, article Que, Remarque 1.: «Ne pas que ou ne point que, anciennement, équivalait à ne... que, le mot pas ou point étant explétif.
Et ne l’auront point vue obéir qu’à son prince
(Corneille, Horace, III, 6)
signifie: Et ne l’auront vue obéir qu’à son prince, et non: Et ne l’auront point vue obéir seulement à son prince.»
Une particularité qui a droit de surprendre les lecteurs de La Comédie humaine, particularité étonnante chez un écrivain qui s’est tant occupé d’affaires litigieuses et de questions judiciaires, c’est que Balzac, bien qu’il eût débuté par être clerc d’avoué, n’avait, en 1845, à l’âge de quarante-six ans, jamais entendu plaider, jamais, donc, serait-on en droit d’inférer, assisté à une séance de tribunal: «Je n’avais jamais entendu plaider, et je suis resté pour entendre Crémieux, qui a fort bien parlé.» (Lettre à Mme Hanska, 14 décembre 1845; Correspondance, t. II, p. 188.) Et cependant nous lisons, dans une Notice sur la fondation et le but de la Société des gens de lettres (p. 2; Paris, imprimerie Charles Blot, s. d. ni nom d’édit.), que «le premier procès mémorable (engagé par la Société des gens de lettres contre les journaux ayant illicitement reproduit des feuilletons) fut plaidé à Rouen par Honoré de Balzac. Le grand romancier s’improvisa l’avocat de ses confrères... Et cela par une délégation, que lui avait donnée le Comité, du 11 octobre 1839. M. Honoré de Balzac obtint gain de cause...»
Signalons, en passant, l’abus excessif que fait Balzac de la conjonction car; nous la voyons répétée souvent trois ou quatre fois dans la même page (Cf. Ursule Mirouet, Librairie nouvelle, 1857, passim et notamment p. 15, 16, 19... 166, 217, etc.; — L’Envers de l’histoire contemporaine, Librairie nouvelle, 1860, passim, principalement p. 161, 163, 171... 203, 221; — etc.); — et aussi une formule, précaution oratoire, très fréquente chez Balzac, et dont la tournure seule varie, souvent même fort peu: «Maintenant, il est nécessaire d’expliquer... Ici peut-être est-il nécessaire de faire observer... Ces menus détails sont[p. 186] indispensables pour comprendre... Avant d’aller plus loin, il est utile de raconter... Peut-être n’est-il pas superflu d’ajouter...», etc. (Cf. La Cousine Bette, Librairie nouvelle, 1856, p. 32, 33, 67, 106, 126, etc.; — Ursule Mirouet, Librairie nouvelle, 1857, p. 22, 72, 87, etc.; — Les Paysans, Librairie nouvelle, 1857, p. 51, 93, 97, etc.; — Les Chouans, Librairie nouvelle, 1859, p. 6, 15, 179, 194, 349, etc.)
Philarète Chasles (1799-1873), dans ses très curieux Souvenirs d’un médecin (traduits de Samuel Warren; Librairie nouvelle, 1855, p. 51), nous montre des gens rassemblés le soir au coin du feu, vidant leur tasse de thé «sans mot dire, et se retirant après une heure de cet innocent entretien».
«Ce sabre est le plus beau jour de ma vie!»
Cette solennelle et célèbre déclaration de Joseph Prudhomme a son pendant dans une autre phrase que l’historien de Joseph Prudhomme, Henri Monnier (1799-1877), attribue à un maire de village, nouvellement élu:
«Mes amis, jamais je n’oublierai l’honneur que vous avez fait à mes cheveux blancs en les mettant à votre tête!» (Cf. Le Rappel, 10 janvier 1877.)
A un mari dont la femme a mis au monde plusieurs filles et qui vient enfin d’accoucher d’un garçon, un personnage du Coq du Clocher (chap. 3, p. 26; M. Lévy, 1856) de Louis Reybaud (1799-1879) adresse ses félicitations en ces termes:
«A la bonne heure! Vous avez eu la main heureuse cette fois!»
Frédéric Soulié (1800-1847) se vantait d’écrire ses romans sans préparer de plan, de «jeter la plume au vent et suivre le chemin où elle mène» (Le Magnétiseur, p. 74; Librairie nouvelle, 1857). On ne s’aperçoit que trop de ce manque de préparation et de soin à l’incohérence et la confusion qui règnent dans nombre de ses récits. Et ce qu’il y a de plus drôle, c’est que souvent, de son propre aveu ou par la bouche de ses personnages, l’auteur reconnaît et proclame le gâchis.
«Vous ne me comprenez pas! s’écria le général, et moi-même, dans ce chaos d’événements, de doutes, d’incertitudes, je ne sais si je me comprends.» (Le Magnétiseur, p. 154.)
[p. 187]
«Les événements de la vie de Justine expliquent suffisamment, du moins je le pense, la brutalité et l’incohérence de ses confidences... Qu’on veuille donc bien lire ce qui va suivre avec le souvenir de ce que je viens de dire, et on s’expliquera peut-être cette incohérence d’opinions, ce chaos de principes opposés jeté à travers cette narration.» (Les Drames inconnus, t. I, p. 367 et 369; Librairie nouvelle, 1857.)
«C’est un enchevêtrement du diable (que cette intrigue, reprit Molinos), je vous prie d’y faire attention.» (Ibid., t. IV, p. 244.)
«Écoute, maître, dit le Diable, si tu me fais mêler toutes ces histoires l’une avec l’autre, non seulement nous n’y comprendrons rien, mais encore nous n’en finirons pas.» (Les Mémoires du Diable, t. III, p. 274; M. Lévy, 1877.)
En effet, comment voulez-vous vous y retrouver dans un imbroglio de ce genre:
«... Il nous avoua que cette correspondance n’avait d’autre but que de cacher celle qu’il avait directement avec une novice du nom de Juliette. Ce fut dans ce même souper qu’un certain comédien, nommé Gustave, m’apprit que cette Juliette n’était autre que la fille de Mariette, laquelle Mariette se cachait à Auterive sous le nom de Mme Gelis, tandis que Jeannette avait pris celui de Juliette.» (Ibid., p. 262.) Et notez que nous n’avons là qu’un faible fragment de l’intrigue générale, et que «toutes ces histoires ne font que se mêler l’une avec l’autre».
Voici quelques phrases bizarres de Frédéric Soulié:
«Son œil, à demi fermé, vibrait et haletait, pour ainsi dire, lançant autour d’elle des regards trempés de volupté.» (Ibid., p. 296.)
«Ce n’était plus ce jeune sous-lieutenant décoré sur le champ de bataille, changeant d’épaulettes à chaque campagne; un de ces soldats intrépides qui, si vite qu’ils montent, pourraient planter chaque échelon de leur fortune dans un trou de blessure.» (Le Magnétiseur, p. 215.)
«Celui-là qui s’épuise à scalper les fibres les plus tendres du cœur humain pour dire le secret de ses plus imperceptibles mouvements...» (La Lionne, p. 221; Librairie nouvelle, 1856.)
«Une main infernale et impitoyable s’est étendue sur votre destinée. Cette main sait préparer le poison de la calomnie comme elle sait pousser ses esclaves au crime.» (Ibid., p. 351.)
«C’était une figure de reine et une taille de nymphe qui par[p. 188]lait ainsi.» (Diane et Louise, dans le volume Le Maître d’école, p. 298; Librairie nouvelle, 1859.)
Je ne sais plus qui disait, sans doute après avoir lu ces phrases: «Frédéric Soulié? Il écrit comme ma savate!»
Frédéric Soulié place Aix-les-Bains, non en Savoie, mais dans les Pyrénées (Les Mémoires du Diable, t. II, p. 189; M. Lévy, 1863), et il nous parle de Rome, qu’il avait l’intention d’«aller voir», mais qu’il n’a jamais vue, de la plus fantaisiste façon: il plante des arbres, «des arbres grillés» sur le Corso, qui n’est bordé que de maisons, et la place Navone ne cesse pas pour lui d’être la place Nivone. (Le Magnétiseur, p. 39, 40, 42, 45, 48...)
A l’exemple de la pelle qui vitupère le fourgon, Soulié, qui a tant écrit de romans-feuilletons où défilent des personnages de toute catégorie, fait, par allusion à Eugène Sue, mais sans le nommer, ni lui ni ses Mystères de Paris, une acerbe critique de ce genre d’ouvrages: «Il se créera bientôt une littérature consacrée à l’histoire de la loge, de la mansarde, du cabaret; les héros en seront des portiers, des marchands d’habits, des revendeuses à la toilette; la langue sera un argot honteux, les mœurs des vices de bas étage, les portraits des caricatures stupides...» (Les Mémoires du Diable, t. I, p. 285; M. Lévy, 1861.)
Dans son roman Le Secret d’une renommée, suivi de La Tache originelle (Librairie nouvelle, 1859), Stéphen de la Madelaine (1801-1868) ne se contente pas de faire souffler en Lorraine le méridional et méditerranéen sirocco: «A Metz,... on dirait que le vent de sirocco, qui souffle des montagnes environnantes pendant dix mois de l’année...» (p. 169), il abuse de ces métaphores astronomiques:
«Cet homme était une étoile détachée du firmament de la célébrité; peut-être la plus radieuse de toutes.» (Page 125.)
«Bernard Cadussias, ci-devant marquis de Rochebrune..., l’une des étoiles de la littérature française, était installé chez le patron en qualité de garde forestier.» (Page 156.)
«Il était, comme tout le monde le savait, marquis de Rochebrune,... un astre tombé du firmament littéraire. Mais l’étoile qui avait caché ses feux sous la bruyère des montagnes ne voulait plus remonter à l’empyrée», etc. (Page 159.)
Mérimée (1803-1870), si réputé cependant pour la pureté de son style, écrit à plusieurs reprises: le Dante, du Dante[p. 189] (Colomba, p. 30; Charpentier, 1862), et, dans ce même roman (p. 31), nous rencontrons cette phrase bizarre: «Colomba poussa un soupir,... enfin, mettant la main sur ses yeux, comme ces oiseaux qui se rassurent et croient n’être point vus quand ils ne voient point eux-mêmes, chanta, ou plutôt déclama...»
[p. 191]
Alexandre Dumas père. Rôle des serpents et autres animaux dans ses romans. Anachronismes, étourderies et drôleries. Abus du dialogue.
Charles de Bernard. A quel âge est-on un vieillard? — Eugène Sue. — Émile Souvestre.
Alexandre Dumas père (1803-1870), qui a tant écrit, ou tant publié, est, par suite, le romancier chez qui l’on découvrirait peut-être le plus de bévues, d’anachronismes et de drôleries. Les Mohicans de Paris, notamment, renferment quantité de descriptions et de remarques étonnantes, stupéfiantes, et il y a des chapitres (le cinquante-cinquième, par exemple, intitulé To die, to sleep) qui serait à citer à peu près in extenso: «Devant Dieu, vers lequel nous allons monter, nous tenant par la main, je jure de t’aimer, ô Colomban! à travers les mondes inconnus! Dussé-je, en franchissant le seuil de ce monde, être plongée avec toi dans la fournaise ardente que la religion catholique promet à ses damnés... je jure de t’aimer au milieu des flammes des fournaises! Dussé-je...», etc.
«Le cœur du jeune Breton que nous avons appelé Colomban était un pur diamant à quatre facettes: la bonté, la douceur, l’innocence et la loyauté.» (Chap. 40.)
«... Et sans doute eussent-ils passé la journée ensemble à presser les mamelles de cette féconde Isis qu’on appelle l’Amour, si le nom de Colomban, deux fois répété par une voix fraîche, n’eût retenti dans l’escalier.» (Ibid.)
«Salvator déposa sur le front de la jeune fille un baiser aussi chaste que le rayon de lune qui l’éclairait...» (Chap. 136.)
«Le comte eût voulu résister sans doute, mais il était dominé par la grandeur d’aspect de la jeune femme. Il jeta sur elle un regard de serpent forcé de fuir, et, les mâchoires serrées, les poings crispés... — Eh bien, soit, madame, dit-il; adieu!» (Chap. 142.)
Remarquons à ce propos que les comparaisons avec les serpents, vipères et aspics sont très fréquentes chez Dumas:
[p. 192]
«Cette reine sentait, comme on sent un serpent sortir des bruyères où votre pied l’a réveillé...» (Ange Pitou, t. II, p. 4; C. Lévy, s. d.)
«A cette seule idée qui la brûlait comme la morsure dévorante de l’aspic, Marie-Antoinette s’étonnait...» (Ibid.)
«Andrée, tressaillant comme si une vipère l’eût mordue au cœur...» (Ibid., t. II, p. 75.).
«Danton se sentit perdu, perdu comme le lion qui aperçoit à deux doigts de ses lèvres la tête hideuse du serpent.» (Ibid., t. II, p. 186.)
«On eût dit qu’il avait marché sur un aspic.» (Ibid., t. II, p. 283.)
«L’amour-propre est une vipère endormie, sur laquelle il n’est jamais prudent de marcher.» (Ibid., t. II, p. 326.)
Les comparaisons avec les autres animaux ne sont pas rares non plus:
«Villefort n’était plus cet homme dont son exquise corruption faisait le type de l’homme civilisé; c’était un tigre blessé à mort qui laisse ses dents brisées dans sa dernière blessure» (sic) (Le Comte de Monte-Cristo, t. VI, p. 184; chap. 14, Expiation; C. Lévy, s. d.)
«Villefort... se traîna vers le corps d’Édouard (un enfant), qu’il examina encore une fois avec cette attention minutieuse que met la lionne à regarder son lionceau mort.» (Ibid., t. VI, p. 184.)
«Danglars ressemblait à ces bêtes fauves que la chasse anime, puis qu’elle désespère, et qui, à force de désespoir, réussissent parfois à se sauver.» (Ibid., t. VI, p. 255, chap. 19, Le pardon.)
Dans ce même roman de Monte-Cristo (t. VI, p. 188, chap. 14), on lit cette phrase amusante: «Villefort sentit ses pieds prendre racine, ses yeux se dilatèrent à briser leurs orbites..., les veines de ses tempes se gonflèrent d’esprits bouillants qui allèrent soulever la voûte trop étroite de son crâne et noyèrent son cerveau dans un déluge de feu.»
Remarquer que cette sentence ou prière que Monte-Cristo avait inscrite sur les murs de son cachot, au château d’If (t. VI, p. 216, chap. 16, Le Passé): «Mon Dieu! Conservez-moi la mémoire!» est textuellement la même que celle qui termine le Conte de Noël, Le Possédé, de Dickens (in fine): «Seigneur, conservez-moi la mémoire!»
Dans Les Trois Mousquetaires, le même billet, l’attestation remise à Milady par Richelieu, reparaît à trois endroits du récit, mais avec des changements de texte et des dates[p. 193] différentes. Dans le chapitre 15 (2e partie), Scène conjugale, ledit papier est daté du 3 décembre 1627; — dans le chapitre 17, Le Conseil des Mousquetaires, il est daté du 5 décembre 1627; — et dans la Conclusion du roman, il porte la date du 5 août 1628, et il a perdu en route tout un membre de phrase.
«Montalais sentit le rouge lui monter au visage en flammes violettes,» lisons-nous dans Le Vicomte de Bragelonne (t. III, p. 379; chap. 38, Fin de l’histoire d’une naïade...; C. Lévy, s. d.)
«Saint Louis avait eu pour ministre un prêtre, le digne abbé Suger», prétend Dumas dans Les Compagnons de Jéhu (p. 52). Or, Suger est mort en 1152 et saint Louis ne naquit qu’en 1215.
Autres anachronismes.
Dans La Tulipe noire (Chap. 20, Ce qui s’était passé...), dont l’action se déroule en Hollande, au dix-septième siècle, du temps des frères de Witt, un des personnages, oubliant que Lavoisier n’a pas encore déterminé la composition de l’eau et ne naîtra qu’au siècle suivant, nous annonce, par une miraculeuse divination, que «l’eau est composée de trente-trois parties d’oxygène et de soixante-six parties d’hydrogène».
Dans Le Chevalier d’Harmental, dont l’action se passe en 1718, un des personnages, le bonhomme Buvat, apprend au cardinal Dubois que sa pupille «peint comme Greuze», — qui devait naître seulement sept ans plus tard, en 1725. Et, de sa chambre, le même Buvat aperçoit l’illumination des galeries du Palais-Royal, — galeries qui ne seront construites que soixante ou soixante-dix ans plus tard, par Philippe-Égalité. (Cf. Le Journal, 9 mars 1899.)
«Holà, mon bonhomme! cria d’Artagnan à un paysan qui travaillait son champ de pommes de terre.» (Les Trois Mousquetaires, dans le journal Le Voleur, 7 mars 1889, p. 155.) D’Artagnan naquit en 1611, mourut en 1673, et la culture de la pomme de terre ne s’est propagée en France qu’au dix-huitième siècle, avec Parmentier (1737-1813).
«Vous êtes, dit Colbert, aussi spirituel que M. de Voltaire.» (Le Vicomte de Bragelonne, même source.) Colbert: 1619-1683; Voltaire: 1694-1778. Colbert a peut-être voulu dire: que M. de Voiture (1598-1648).
Dans San Felice, apparaît un accoucheur, tenant un mouchoir entre ses dents, dans lequel pèse le nouveau-né de tout son poids (six livres et demie), et ledit accoucheur tient un pis[p. 194]tolet dans chaque main. Dans cette position, aussi dramatique qu’embarrassante, il fondit tête baissée au milieu de la population en criant, les dents serrées: «Place à l’enfant de la morte!» Même en italien, ajoute le journal à qui j’emprunte cet extrait, la phrase dut être bien difficile à prononcer.» (Le Courrier Saïgonnais, Saïgon, 10 décembre 1912.)
Dans Le Collier de la Reine (t. II, p. 51), don Manoel discute avec le joaillier Boehmer, et, pour bien exprimer la surprise qu’éprouva le noble étranger aux explications du marchand, Dumas écrit: «Ah! ah! dit don Manoel en portugais».
«Le cardinal devina qu’il était tombé dans le piège de cette infernale oiseleur», au dire de Dumas dans le même roman (chap. 30), et en parlant de l’astucieuse Mme de la Motte.
Et ces vers du drame de Christine:
Comme au haut d’un grand mont le voyageur lassé
Part tout brûlant d’en bas, puis arrive glacé,
Sans qu’un éclair de joie un seul instant y brille,
User à le rider son front de jeune fille,
Sentir une couronne en or, en diamant,
Prendre place, à ce front, d’une bouche d’amant.
«Un voyageur, dit Louis de Loménie, qui, au haut d’un grand mont, part tout brûlant d’en bas; une couronne qui prend place à un front d’une bouche, voilà, certes, un atroce jargon.» (Cf. Eugène de Mirecourt, Alexandre Dumas, p. 40.)
Dans ses Mémoires surtout, souvent si intéressants et si vivants, dont les premiers volumes, consacrés à l’enfance et à la jeunesse de l’auteur passées à Villers-Cotterets, sont particulièrement captivants, Alexandre Dumas s’abandonne volontiers à ses intempérances, négligences, hâbleries et singularités de langage.
A l’île Saint-Domingue, nous assure-t-il (t. I, p. 14), «l’air est si pur, qu’aucun reptile venimeux n’y saurait vivre. Un général, chargé de reconquérir Saint-Domingue, qui nous avait échappé, eut l’ingénieuse idée, comme moyen de guerre, de faire transporter de la Jamaïque à Saint-Domingue toute une cargaison de reptiles, les plus dangereux que l’on pût trouver. Des nègres charmeurs de serpents furent chargés de les prendre sur un point et de les déposer sur l’autre. La tradition veut qu’un mois après, tous ces serpents eussent péri, depuis le premier jusqu’au dernier.»
«Mon père avait eu un cheval tué sous lui; un second (cheval) avait été enterré par un boulet.» (Tome I, p. 92 et 96.)
«... Non, cher abbé,... je ne fus point l’homme de la pratique[p. 195] religieuse. Il y a même plus, cette fois où je m’approchai de la sainte table fut la seule; mais... quand la dernière communion viendra à moi comme j’ai été à la première, quand la main du Seigneur aura fermé les deux horizons de ma vie, en laissant tomber le voile de son amour entre le néant qui précède et le néant qui suit la vie de l’homme, il pourra, de son regard le plus rigoureux, parcourir l’espace intermédiaire, il n’y trouvera pas une pensée mauvaise, pas une action que j’aie à me reprocher.» (Tome II, p. 31.)[41]
«... Au caillou qui s’approche de la rose, et à qui il reste le parfum de la reine des fleurs.» (Tome II, p. 298.)
«En moins de dix minutes, le renard avait étranglé dix-sept poules et deux coqs. Dix-neuf fois homicide!» (Tome III, p. 72.)
«Ernest s’empressa de nous apporter la cire tout allumée (pour cacheter des lettres)... Je pris la cire d’une façon si gauche, je l’allumai d’une manière si naïve...» qu’il oublie qu’Ernest vient, à l’instant même, de la lui apporter tout allumée. (Tome III, p. 207.) A moins que la cire ne se soit éteinte, et qu’il ait fallu la rallumer.
«... Cette fatalité qui pousse les hommes vers le lieu où il est écrit d’avance qu’ils doivent mourir.» Fatalité bien singulière. (Tome IV, p. 192.)
Dans le tome VII (p. 272), Alexandre Dumas cite la phrase suivante empruntée à une description de la bataille d’Austerlitz, dont il ne nomme pas l’auteur: «Vingt-cinq mille Russes étaient rangés en bataille sur un vaste étang gelé; Napoléon ordonna que le feu fût dirigé contre cet étang. Les boulets brisèrent la glace, et les vingt-cinq mille Russes mordirent la poussière.»
Tome X, p. 112, il attribue à Chateaubriand cette étrange phrase: «J’ai marché sans le vouloir, comme un rocher que le torrent roule; et maintenant voilà que je me trouve plus près de vous que vous de moi.»
Il raconte (t. VIII, p. 8) qu’un aéronaute de ses amis, du nom de Petin, s’imaginait avoir résolu, de la façon suivante, le grand problème de la navigation aérienne: «Petin raisonnait ainsi: La terre tourne; dans ce mouvement de rotation sur elle-même, elle présente successivement tous les points de sa surface déserte ou habitée. Or, quelqu’un qui s’élèverait jusqu’aux[p. 196] dernières couches de l’air ambiant, et qui trouverait le moyen de s’y fixer, descendrait en ballon sur la ville du globe où il lui plairait de toucher terre; il n’aurait qu’à attendre que cette ville passât sous ses pieds; il irait de la sorte aux antipodes en douze heures, et, cela, sans fatigue aucune, puisqu’il ne bougerait pas de sa place, et que ce serait la terre qui marcherait pour lui.» Ce brave Petin oubliait que la terre, dans son mouvement de rotation, l’entraînerait forcément avec elle, et que, si haut qu’il s’élevât, il lui serait impossible d’échapper à ce mouvement et de demeurer immobile.
Dans un autre ouvrage publié par Alexandre Dumas, et qui porte son nom, «Impressions de voyage, De Paris à Sébastopol, par le docteur Félix Maynard, publié par Alexandre Dumas» (Librairie nouvelle, 1855), on trouve, dans l’Avant-propos (p. 3), la plus singulière, la plus abracadabrante théorie de la télégraphie électrique qu’il soit possible d’imaginer. L’auteur se figure que, pour transmettre une dépêche télégraphique, on commence par la faire dissoudre dans le liquide de la pile... «Une batterie électrique (?) est établie là-bas auprès des batteries de siège. Nos généraux font dissoudre leurs dépêches dans le liquide de cette pile, puis des fils métalliques s’imprègnent de ce liquide, charrient les pensées et les mots qu’il contient à travers les profondeurs de la mer Noire et les plaines du continent...»
Avec Ponson du Terrail, dont nous parlerons bientôt, Alexandre Dumas père est un des romanciers qui ont le plus délayé le dialogue et tiré à la ligne. Un de leurs trucs habituels, à tous deux, est de faire répéter, par un ou plusieurs des interlocuteurs, la question posée. Exemples:
«... J’étais bien sûr que vous ne vouliez pas la guerre par les mêmes motifs que moi!
— Alors, voyons les vôtres!
— Les miens? demanda le roi.
— Oui, répondit Marie-Antoinette, les vôtres.»
(Ange Pitou, t. I, p. 326.)
«Je le quitte.
— Qui cela?
— Dame! quelqu’un de votre connaissance.
— De ma connaissance, à moi?
— Oui.
— Et comment...»
(Ibid., t. I, p. 336.)
[p. 197]
«Son prétendu sommeil magnétique est un crime.
— Un crime!
— Oui, un crime, continua la reine...»
(Ange Pitou, t. II, p. 19.)
«J’appelle aristocrates des personnes de votre connaissance.
— De ma connaissance?
— De notre connaissance? dit la mère Billot.
— Mais qui donc cela? insista Catherine.
— M. Berthier de Sauvigny, par exemple.
— M. Berthier de Sauvigny?
— Qui vous a donné...
— Eh bien?
— Eh bien, j’ai vu...»
(Ibid., t. II, p. 230-231.)
Terminons en racontant, d’après le journal Le National (16 mars 1885), que l’auteur des Trois Mousquetaires «avait une cuisinière étonnante: elle était arrivée à écrire son nom de Sophie, sans employer une seule des lettres composant ce mot. Elle l’orthographiait ainsi: Çaufy. Son patron restait en admiration devant cette trouvaille. Il y avait de quoi[42]».
Charles de Bernard (1804-1850), que l’on a qualifié, à tort ou à raison, de disciple ou d’imitateur de Balzac, emploie parfois à satiété le mot vieillard, et l’applique même à des personnages qui n’ont pas atteint soixante ans. Voir, par exemple, Le Nœud gordien (M. Lévy, 1858), où ce mot reparaît continuellement: Pages 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, etc. Dans Le Gentilhomme campagnard (t. II, p. 264; M. Lévy, 1857), nous trouvons même vieillard au féminin: «la vieillarde avait raison».
Les romans de Charles de Bernard nous offrent çà et là quelques termes tombés en désuétude, ou supprimés et remplacés par d’autres mots: billets de visite, pour cartes de visite: «Il tira d’une poche de son gilet un de ses billets de visite... La femme de chambre entra en tenant à la main un billet de visite...» (Les Ailes d’Icare, p. 188 et 270; M. Lévy, 1857); — surtout, pour pardessus ou manteau: «Il portait, par-dessus des[p. 198] habits de deuil, un surtout de peau de bique» (Un Beau-Père, t. I, p. 195; M. Lévy, 1859); surtout, avec cette acception, a été employé par Voltaire, Saint-Simon, etc. (Cf. Littré); — cigarite, pour cigarette: «Il semblait exclusivement occupé de la confection d’une cigarite» (La Chasse aux amants, dans La Peau du lion, p. 296; M. Lévy, 1860).
Et cette plaisante phrase du même romancier: «Sans état (sans fortune)... ne possédant de terre que ce qu’en peuvent contenir les vases de fleurs de leur salon, ces parias vivent en pachas.» (Les Ailes d’Icare, p. 65.)
«Ah! vous vous êtes dit, s’écrie un des personnages d’Eugène Sue (1804-1857): «Je m’en vais mettre les fers au feu pour tirer les vers du nez de Mme Barbançon, afin de voir ce qu’elle a dans le ventre!» (L’Orgueil, t. I, p. 94; Marpon, s. d.) Et plus loin (p. 199), le même écrivain nous apprend que «le seuil de la porte d’Erminie était vierge des pas d’un homme».
Autres métaphores, dues, celles-ci, à Émile Souvestre (1806-1854): «Le souvenir de Cécile venait bien, de loin en loin, combattre ces amertumes, mais je l’écartais alors brusquement, comme on écarte la main d’un ami au moment du désespoir; ou bien, tournant la coupe du côté de l’absinthe, je cherchais dans ce souvenir lui-même un nouveau motif de mépriser les hommes... Mon cœur ressemblait à un nid de vipères, dressant contre le monde leurs gueules gonflées de venin.» (Deux Misères, p. 80-81; M. Lévy, 1859.)
Dans Un Philosophe sous les toits (p. 49; M. Lévy, 1857), Souvestre, comme nous l’avons noté déjà (Préambule, p. 10), dit qu’«il semble que chacun, surpris à l’improviste, perde le caractère...» Quand on est surpris, c’est généralement à l’improviste. C’est ce que Molière aussi a oublié dans Don Garcie de Navarre (V, 6):
...cette gaieté
Surprend au dépourvu toute ma fermeté.
[p. 199]
Alphonse Karr. Abus du tiret. — Galoppe d’Onquaire. — Jules Sandeau. Fréquentes comparaisons avec les animaux. — Barbey d’Aurevilly, jugé par Flaubert, par Champfleury.
Amédée Achard. Encore les comparaisons avec les serpents et autres animaux. — Eugène Fromentin. — Octave Feuillet. Le qualificatif adorable.
L’emploi très fréquent, presque à chaque ligne, du tiret ou moins (en langage typographique), et autrement que pour indiquer un changement d’interlocuteurs dans le dialogue, est une des singularités de style d’Alphonse Karr (1808-1890). Voyez, par exemple, son roman Raoul (M. Lévy, 1859): «On porte le cadavre dans sa chambre — on le met dans son lit; — Marguerite — s’assied près du lit, — reste les yeux fixés sur lui, — et ne prononce plus une parole, — n’entend rien, — ne répond à rien; elle est anéantie, — elle ne s’occupe de rien de ce qui se passe. — Le maire et un médecin viennent constater le décès, — on veut lui adresser quelques paroles de condoléance, — on ne les achève pas, tant il est visible qu’elle n’entend pas; — il semble qu’il y ait deux morts dans cette chambre.» (Page 313.) «... La douleur de Marguerite est calme, — elle attend; — elles n’évitent ni l’une ni l’autre de parler de Raoul; — loin de là, — elles s’entourent de tout ce qui le rappelle, — et en parlent sans cesse.» (Page 318.)
Et tout le volume et maints autres ouvrages d’Alphonse Karr sont ainsi émaillés de tirets inutiles.
On trouve dans Alphonse Karr (Les Guêpes, t. II, p. 68; octobre 1840; M. Lévy, 1883) le mot restaurant dans le sens de restaurateur: «Le restaurant de la prison est un homme fort zélé...» De même, jadis, le mot roman a été employé dans le sens de romancier. «Vous voyez ici les romans, qui sont des espèces de poètes, et qui outrent également le langage de l’esprit et celui du cœur.» (Montesquieu, Lettres persanes, 137, t. II, p. 105 et 165; édit. André Lefèvre.)
Je cueille dans Les Guêpes (t. II, p. 287; juin 1841) cette anecdote:
[p. 200]
«Cela me rappelle un pauvre diable que l’on mit une fois en route pour l’Italie. — Après lui avoir persuadé que la végétation était, sur cette terre bénie, toute différente de ce qu’elle est dans les autres pays, que les arbres y produisent naturellement une foule d’objets qui ne naissent en France qu’à force de travail et de main-d’œuvre: «Tu y verras, lui disait-on, — le saucissonnier, c’est-à-dire l’arbre qui produit des saucissons, — la variété à l’ail est fort rare; — tu y verras le bretellier, c’est-à-dire l’arbre à bretelles: elles sont mûres vers la fin de septembre; — tu m’en rapporteras une paire; — mais ne va pas prendre des bretelles sauvages qui ne durent rien». — Toujours est-il qu’il en devint fou.»
Et, encore dans Les Guêpes (t. VI, p. 269, mai 1848), cette phrase drolatique: «Non seulement ce parti (le parti républicain) a commis d’intolérables excès, mais encore il a ouvert la porte à sa queue, qu’il a en vain essayé de rompre, — mais cette queue, comme celle du serpent, se réunit au corps malgré lui ou veut le percer comme celle du scorpion; — elle professe le pillage et prône la guillotine; — » etc.
«Un dimanche d’automne, j’étais en chasse avec un de mes amis», écrit, dans Le Diable boiteux au village (p. 165; Librairie nouvelle, 1860), le romancier Galoppe d’Onquaire (1810-1867), un fin et spirituel lettré, qui a eu son temps de vogue.
Cette locution, qui n’a d’ailleurs rien d’incorrect, se retrouve dans La Louve (Prologue, IV), de Paul Féval (1817-1887); — dans La Fiammina (I, 2) de Mario Uchard (1824-1893); — dans la nouvelle Hautot père et fils de Guy de Maupassant (1850-1893) (dans le volume intitulé La Main gauche, p. 68); — dans Chante-Pleure (p. 142), d’Émile Pouvillon (1840-1906): «Roger était en chasse depuis le matin; Mademoiselle à son piano...»; — etc.
Tout comme Alexandre Dumas père dans Ange Pitou, et Amédée Achard dans Belle-Rose, que nous verrons tout à l’heure, Jules Sandeau (1811-1883), dans son roman Catherine (M. Lévy, 1859), se plaît à comparer ses personnages à tel ou tel animal:
«Catherine bondit sur sa chaise comme un faon sur les vertes pelouses.» (Page 15.)
«La petite fée se prit à bondir comme un chevreau.» (Page 33.)
«Claude gémissait comme un hibou dans son trou solitaire.» (Page 85.)
«Tout d’un coup, s’échappant comme une gazelle, Catherine[p. 201] descendit quatre à quatre les marches de l’escalier...» (Page 99.)
«Claude, rasant la muraille comme une chauve-souris...» (Page 101.)
«Claude, doux et résigné comme un mouton qu’on mène à la boucherie...» (Page 103.)
«La petite fée tressaillit et dressa les oreilles, comme au fond des bois une biche...» (Page 161.)
«Ainsi qu’une colombe atteinte dans son vol... la petite vierge...» (Page 162.)
«Robineau se retira,... en jetant un regard d’hyène au jeune vicomte.» (Page 238.)
Etc., etc.
Ce qui n’empêche pas Jules Sandeau de commettre parfois de grosses erreurs à propos des animaux qu’il mentionne, comme lorsqu’il qualifie les carpes de «cétacés». (Catherine, p. 60.)
Gustave Flaubert ne pouvait souffrir Barbey d’Aurevilly (1811-1889), qui, comme lui, était Normand, et, comme lui, avait la passion du style. «... Lisez donc Fromont et Risler de mon ami Daudet, et Les Diaboliques de mon ennemi Barbey d’Aurevilly, écrit-il à George Sand (Lettre du 2 décembre 1874; Correspondance, t. IV, p. 207). C’est à se tordre de rire. Cela tient peut-être à la perversité de mon esprit, qui aime les choses malsaines, mais ce dernier ouvrage m’a paru extrêmement amusant; on ne va pas plus loin dans le grotesque involontaire.»
Et dans une lettre à Maupassant (sans date, t. IV, p. 380): «Te souviens-tu que tu m’avais promis de te livrer à des recherches dans Barbey d’Aurevilly (département de la Manche). C’est celui-là qui a écrit sur moi cette phrase: «Personne ne pourra donc persuader à M. Flaubert de ne plus écrire?[43]» Il serait temps de se mettre à faire des extraits dudit sieur. Le besoin s’en fait sentir.»
Longtemps avant cette lettre, classée, dans la Correspondance de Flaubert, sous la rubrique de 1880, Champfleury avait commencé à faire et à publier de ces extraits. Dans son dernier chapitre du Réalisme (p. 286-320; M. Lévy, 1857), il s’est plu[p. 202] à relever tout ce qui l’avait choqué dans les deux volumes d’Une Vieille Maîtresse, et la liste de ses critiques occupe plus de trente pages. Je me contenterai d’une citation empruntée à cette copieuse étude: «Mme de Mendoze avait la lèvre roulée que la maison de Bourgogne apporta en dot, comme une grappe de rubis, à la maison d’Autriche. Issue d’une antique famille du Beaujolais, dans laquelle un des nombreux bâtards de Philippe le Bon était entré, on reconnaissait au liquide cinabre de sa bouche les ramifications lointaines de ce sang flamand qui moula pour la volupté la lèvre impérieuse de la lymphatique race allemande, et qui, depuis, coula sur la palette de Rubens. Ce bouillonnement d’un sang qui arrosait si mystérieusement ce corps flave et qui trahissait tout à coup sa rutilance sous le tissu pénétré des lèvres... était le sceau de pourpre d’une destinée.» (Une Vieille Maîtresse, t. I, p. 50; Lemerre, 1886.)
Dans un autre volume de Barbey d’Aurevilly, L’Amour impossible et La Bague d’Annibal (Lemerre, 1884), je rencontre deux phrases dignes également, et pour des motifs différents, d’être mentionnées:
«Il fut probablement décidé aussi par la beauté de cette blanche personne... Et comment n’eût-il pas plongé sa lèvre avec un certain frémissement dans l’écume légère et savoureuse de ce sorbet virginal?» (Page 93.)
«Sur bien des points, quoique sensibles, ces hommes se rapprochent des opinions de ce faux et abominable Prophète (Mahomet) qui n’eut sur les femmes que des idées dignes d’un conducteur de chameaux.» (Page 244.)
Dans Romanciers d’hier et d’avant-hier (Paul Féval, p. 115; Lemerre, 1904), Barbey d’Aurevilly écrit, avec sa hardiesse coutumière: «Beaumarchais avait dans le bec et dans l’esprit une vibrante paire de castagnettes, plus mordante que celles de toutes les mauricaudes de l’Espagne...»
Nous aurons occasion plus loin, dans le chapitre consacré aux Ecclésiastiques, de reparler de Barbey d’Aurevilly, à propos d’un jugement porté par lui sur Lacordaire.
Dans son roman Belle-Rose (librairie nouvelle, 1856), roman de cape et d’épée, qui, en son temps, a obtenu grand succès, Amédée Achard (1814-1875) abuse, lui aussi, des comparaisons empruntées à la faune terrestre.
[p. 203]
«M. de Charny recule lentement comme un tigre vaincu.» (Page 446.)
«Il (un poulain) est doux mais farouche comme une chevrette.» (Page 477.)
«M. de Charny bondit vers lui comme un tigre.» (Page 495.)
«M. de Charny lui jeta un regard de vipère.» (Page 496.) Qu’est-ce qu’un regard de vipère? Nous avons déjà, du reste, rencontré plusieurs fois cette locution sous la plume de nos romanciers. «Un regard de serpent», nous a dit Balzac; — «... de serpent forcé de fuir», a ajouté Alexandre Dumas père (Cf. ci-dessus, p. 182 et 191), et nous verrons plus loin Ponson du Terrail nous parler de «la main froide d’un serpent».
«M. de Louvois tressaillit comme un lion surpris dans son antre», continue Amédée Achard dans Belle-Rose. (Page 540.)
«Pourquoi l’avez-vous laissé fuir? s’écria-t-il. — Cet homme est une anguille, vous le savez, monseigneur.» (Page 542.)
«M. de Charny guettait dans l’antichambre comme un chat avide et patient.» (Page 544.)
«(Dans un duel)... leurs épées, rapides et flexibles, s’entrelaçaient comme des serpents lumineux.» (Page 558.)
Il serait facile aussi de relever, dans Belle-Rose, quantité de ces phrases emphatiques propres à nos romans-feuilletons, dont nous parlerons d’ailleurs plus loin avec plus de détails:
«Vous pardonner! dit-il; je ne suis pas votre juge, et je ne puis pas vous haïr. Geneviève tendit ses bras vers le ciel: Merci, mon Dieu! dit-elle; il ne m’a pas repoussée.» (Page 223.)
«Oh! vous ne l’avez jamais aimé! — Je ne l’ai pas aimé! s’écria Suzanne, qui se tordait les mains de désespoir; mais savez-vous que, depuis mon enfance, ce cœur n’a pas eu un battement qui ne soit à lui, que sa pensée est tout ensemble ma consolation et mon tourment, que je n’existe que par son souvenir, que...» (Page 269.)
«Voyez, mère de Dieu, j’assiste aux funérailles de mon cœur; je suis pleine d’angoisse, et mon âme crie vers vous dans cette solitude où je pleure. Qu’il soit heureux, sainte mère du Christ, et qu’elle soit heureuse, lui comme elle, elle comme lui, unis tous deux dans ma prière; elle est honnête, pure et radieuse comme l’un de vos anges...» (Page 293.)
Etc., etc.
Eugène Fromentin (1820-1876), l’auteur de ce gracieux roman, Dominique, qui conserve toujours ses fidèles et ses admi[p. 204]rateurs, n’aime pas la précision et pousse la discrétion jusqu’à l’énigme et à l’obscur.
«Elle quitta Paris pour aller à des bains d’Allemagne.» (Dominique, p. 263; Hachette, 1863.) Quels bains?
«Il habitait une maison isolée sur la limite d’un village.» (Page 286.) Quel village?
«... Hier, en me montrant dans un lieu public...» (Page 293.) Quel lieu public?
Cette extrême réserve a parfois de curieuses conséquences.
«Je vais ce soir au théâtre,» dit, au chapitre 15 (p. 309), Madeleine à Dominique, toujours sans préciser ni nommer le théâtre. Néanmoins nous voyons, «à huit heures et demie, Dominique entrer dans sa loge», etc.; mais il oublie de nous apprendre comment il a deviné le nom de ce théâtre.
D’Eugène Fromentin encore cette amusante phrase: «Menant son équipage d’une main, de l’autre il fumait une cigarette...» (Une Année dans le Sahel, p. 41; Plon, 1859.)
D’Octave Feuillet (1821-1890): «Sibylle, jouant de la harpe, était généralement adorable... Le mot ange venait aux lèvres en la regardant.» (Sibylle, p. 146; M. Lévy, 1863.)
Ce qualificatif adorable, si banal et insignifiant, et si fréquemment employé: — «Une adorable paire de pantoufles» (Alexandre Dumas fils, Diane de Lys, p. 62; Librairie nouvelle, 1855); — «Un adorable petit chapeau rond» (Edmond de Goncourt, La Faustin, p. 222; Charpentier, 1882); — «La beauté de Mlle de Beaulieu était devenue adorable... Le corsage, demi-montant dans le dos, laissait voir l’adorable naissance des épaules...» (Georges Ohnet, Le Maître de Forges, p. 107 et 348; Ollendorff, 1886); — «... Sa bouche adorable semblait sourire» (Alexis Bouvier, La Grande Iza, p. 46; Rouff, s. d.); etc.; — ce qualificatif adorable a soulevé plus d’une fois de véhémentes objections: «Locution vulgaire qui appartient à la littérature des barcarolles, au vocabulaire des prospectus, et que l’on ne devrait pas rencontrer sous la plume d’un académicien,» déclare le critique Jules Levallois (La Piété au dix-neuvième siècle, Le Roman dévot, p. 57; M. Lévy, 1864), à propos justement d’Octave Feuillet.
D’autres adjectifs méritent d’être rangés dans la même catégorie qu’adorable; par exemple: délicieux, exquis, ravissant: «Des moments délicieux... Une exquise beauté... Cette ravissante fillette...», épithètes répandues à profusion dans nos romans, et qui, à les examiner de près, ne signifient rien,[p. 205] tant elles sont hyperboliques. Paul de Kock, au cours d’un de ses amusants récits (Un Homme à marier, p. 9, col. 2; Rouff, s. d., in-4), fait répliquer à l’un de ses personnages: «Ces demoiselles sont ravissantes! Ravissantes! Tu vas tout de suite nous chercher ces mots dont on se sert dans le monde lorsqu’on veut mentir! Elles sont gentilles, et, de plus, feront de bonnes ménagères, voilà l’essentiel.»
[p. 207]
Champfleury et Henry Murger.
Champfleury (1821-1889), le père de l’école réaliste, et son frère d’armes Henry Murger (1822-1861), le chantre de la bohème, nous fournissent l’un et l’autre une ample moisson de pathos et de drôleries. Avec eux, avec Champfleury surtout, qui a bien plus écrit que Murger, nous n’avons que l’embarras du choix.
«Les quelques soirées que passa Mme de la Borderie dans cette société lui parurent glaciales comme la peau d’un serpent. Le venin du Club des femmes malades ne trouvait plus de proie... Rien que l’arrivée de Mme de la Borderie rompait le fil électrique empoisonné qui servait de conducteur à l’esprit de la société...» (Les Amoureux de Sainte-Périne, p. 55; Librairie nouvelle, 1859.) Le fil électrique empoisonné!
«M. Perdrizet sautillait de loge en loge et semblait un pinson à lunettes d’or.» (Ibid., p. 75.)
«Les dames chuchotèrent en se regardant avec des bouches souriantes et des roucoulements d’yeux qu’eût enviés une actrice pour jouer des rôles de Marivaux.» (Ibid., p. 150.) Pour: «des roulements d’yeux» sans doute.
«... Une main froide, longue et amaigrie, s’empara de son crâne... Ces terribles doigts prenaient leur force de ce que les pouces des deux mains s’accrochant dans les embrasures des oreilles de faune de M. Perdrizet, les autres (?) se rejoignaient sur le sommet du crâne, qui, malgré son poli, était pris comme par huit étaux allongés.» (Ibid., p. 208.)
«Longtemps les médecins seuls ont écrit sur les maladies mentales; mais leurs travaux... ne pouvaient et ne devaient pas sauter le fossé qui sépare le monde des savants du monde des curieux...» (Les Excentriques, Berbiguier, p. 102; M. Lévy, 1856.)
«... Les charbons de la curiosité n’en étaient que plus attisés.» (Ibid., Cadamour, p. 242.)
[p. 208]
«L’abbé Châtel s’intitule socialiste. Veut-on savoir comment le traitent les socialistes sérieux, à la tête desquels marche le satirique P.-J. Proudhon, qui a été le premier à montrer aux partis que les savants seuls et les têtes fortes servaient à faire avancer des idées, et non ce vil troupeau, cette écume, cette lie qu’on rencontre à la queue d’une école, espérant en manger la tête un jour!» (Les Excentriques, L’abbé Châtel p. 297.) Quel galimatias!
Dans le même volume (p. 341, Miette), Champfleury nous parle d’un individu qui confond plaisamment un dictionnaire de poche avec les dictionnaires de Boiste, de Wailly, de Napoléon Landais, etc. Il fait de Poche un nom propre.
«Les modernes alchimistes de nos jours qui ont découvert mieux que l’or...» (La Mascarade de la vie parisienne, p. 3; Librairie nouvelle, 1860.)
«Le peuplier dresse sa tête vers le ciel, et se plaît dans cette belle attitude fière et simple.» (Ibid., p. 7.)
«Elle... ne put détacher ses regards de cet horizon enflammé où les femmes nageaient dans la musique, les bijoux, la danse et l’amour.» (Ibid., p. 26.)
«C’était une fête qui se renouvelait souvent, non pas tant pour fêter la femme que pour se livrer à des boissons considérables.» (Ibid., p. 62.)
«Tout était or et glace dans cet appartement; l’or semblait heureux de se mirer dans les glaces, et les glaces renvoyaient ses reflets sans vouloir les garder.» (Ibid., p. 193.)
«Comme les chanteurs, elles (des femmes galantes) ont passé douze ans à lutter, à dépenser leur jeunesse, qu’elles exploitent plus tard et qu’elles servent sous le masque de l’adresse.» (Les Souffrances du professeur Delteil, p. 158; M. Lévy, 1857.)
«A une portée de la ville, on aperçoit une immense tour...» (Ibid., p. 190.) A une portée de quoi? De fusil?
«Le dandy... a passé un pouce déhanché dans son gilet pour en dégager les revers...» (Les Demoiselles Tourangeau, p. 67; M. Lévy, 1864.)
«Paris a le beau côté d’ouvrir toutes les portes à une réputation naissante.» (Ibid., p. 243.)
«Elle prit à tâche d’entrer dans les idées de cet enfant décousu pour mieux pénétrer dans son cœur.» (Fanny Minoret, p. 30; Dentu, 1882.)
«... Une pauvre veuve qui n’avait qu’un fils unique.» (La Pasquette, p. 218; Charpentier, 1876). Il est certain que si elle avait eu «deux fils uniques», ç’aurait été bien plus curieux.
[p. 209]
«L’amour du bien répandait ses harmonies dans des cœurs qui battaient à l’unisson. L’appel aux habitants du village était une chaîne descendant de la montagne à la vallée, et qu’on pouvait espérer tendre sur tout le territoire.» (La Pasquette, p. 270.)
La Pasquette donne une bague à l’un des personnages (Ibid., p. 198), et un peu plus tard (p. 281) cette bague se trouve transformée en médaille.
«La porte des Funambules était particulièrement attirante par un parfum de miroton qui jetait sa note intense dans le concert des odeurs désastreuses s’échappant...» (La Petite Rose, p. 10; Dentu, 1877.)
«L’étudiant regarda le battant de la porte dont un des côtés venait d’être ouvert à l’endroit du genou.» (Ibid., p. 87.)
«Le pépin du mécontentement était semé dans une terre fertile et allait donner en peu de temps un arbre touffu.» (Monsieur de Boisdhyver, p. 12; Poulet-Malassis, 1861[44].)
«Elle bravait l’air froid, la gelée, la neige d’hiver.» (Ibid., p. 96.) Comme s’il y avait de la neige d’été.
«Le docteur Richard, à cinquante ans, était plus jeune que ses confrères de trente ans... Ce vieillard à la physionomie spirituelle...» (Ibid., p. 105-106.) Est-on un vieillard à cinquante ans, surtout lorsqu’on est plus jeune que des hommes de trente ans? Nous avons déjà vu cette même question se poser dans un chapitre précédent, à propos du romancier Charles de Bernard.
«Si un peu d’or peut faire un heureux d’un malheureux, ne le ménagez pas» (l’or). (Ibid., p. 126.)
«Sa tête, qu’elle baissait, servait d’excuse à la pourpre qui inondait sa figure et qui lui enlevait la faculté de s’occuper sérieusement de sa tapisserie.» (Ibid., p. 133.)
«Si je n’ai pas péché, je ne dois pas en inventer.» (Ibid., p. 187.)
«La physionomie de la jeune fille était si pure, si calme et si chaste que la moindre peine s’y inscrivait comme la peau du lézard sur le sable.» (Ibid., p. 328.)
[p. 210]
«Le soleil pénètre par échappées à travers les branches... et dépose un baiser lumineux sur le ventre rose des pommes.» (Monsieur de Boisdhyver, p. 418.)
Dans Les Amoureux de Sainte-Périne encore (p. 22 et 99), Champfleury laisse invariables certains adjectifs: «Ces détails, je ne les connus qu’un à un, après divers visites...» — tout comme Lamartine: «leurs orbites divers»: cf. ci-dessus, p. 82, — «En entendant ces traîtres inductions...»
Arrêtons-nous; il faudrait tout citer, et ce serait à n’en plus finir.
Le chef de l’école réaliste a d’ailleurs été jadis renommé pour son style négligé, incorrect, et ses nombreuses incongruités de langage; Louis Veuillot, entre autres, dans ses Odeurs de Paris (p. 273; Palmé, 1867), le tance vertement à ce sujet et lui reproche notamment son barbarisme: décourageateur, — «Béranger, sans s’en douter, jouait le rôle d’un décourageateur» — engendrant le verbe décourageater.
Ce qu’il y a d’étonnant, c’est que Champfleury revoyait et corrigeait avec beaucoup d’application non seulement ses épreuves, mais les diverses éditions de ses ouvrages: «J’ai appris peu à peu à me défier de la facilité de la plume; je me suis enfermé cinq ans, lisant, réfléchissant... Toute dépense m’a paru inutile, qui ne regardait ni les lettres ni les arts... Que de temps passé à revoir mes œuvres anciennes pour en enlever les négligences et les longueurs! Mes livres, quand je les revois à distance, ressemblent à de vieilles villes dans lesquelles une bonne administration fait des percées pour les assainir, leur donner du jour et de la lumière... Tout livre que j’ai publié dans une revue ou un journal n’a été pour moi qu’une sorte de première épreuve...» (Champfleury, Souvenirs et Portraits de jeunesse, Notes intimes, p. 252 et 292; Dentu, 1872.) Et tout cela est scrupuleusement exact; il suffit, pour s’en convaincre, de comparer entre elles les diverses éditions des romans de Champfleury: Les Bourgeois de Molinchart, par exemple, édition de 1855, Librairie nouvelle; et édition de 1859, M. Lévy; Les Souffrances du professeur Delteil, édition de 1857, M. Lévy; et édition de 1886, Dentu; etc.; il y a des variantes à chaque page, presque à chaque ligne, et parfois même des modifications sont apportées à l’intrigue du roman; mais les dernières versions ne valent souvent pas mieux et parfois même valent moins que les premières.
Croirait-on que Flaubert s’est alarmé de la publication faite en feuilletons, en 1854, des Bourgeois de Molinchart, qui offrent,[p. 211] en effet, certaines analogies de situation avec Madame Bovary, qu’il était en train d’écrire? Mais... «Quant au style, pas fort, pas fort!» (Gustave Flaubert, lettre à Louis Bouilhet, 5 août 1854; Correspondance, t. III, p. 2.)
Passons à Henry Murger; et tout d’abord cette drôlerie:
«Un soir, en traversant le boulevard, Marcel aperçut à quelques pas de lui une jeune dame qui, en descendant de voiture, laissait voir un bout de bas blanc... — Parbleu, fit Marcel, voilà une jolie jambe: j’ai bien envie de lui offrir mon bras.» (Scènes de la vie de bohème, p. 176; M. Lévy, 1861.)
«Je m’appelle Fanny, j’ai dix-huit ans et je suis une des dix femmes de Paris pour qui les hommes les plus considérables marcheraient à deux pieds sur tous les articles du code pénal, déclare une des héroïnes des Scènes de la vie de jeunesse (p. 85; M. Lévy, 1859) du même romancier. La porte par où l’on sort de mon boudoir ouvre sur le bagne ou sur le cimetière, et, pour y pénétrer, il y a des pères qui ont vendu leurs filles, il y a des fils qui ont ruiné leurs pères. Si je voulais, je pourrais marcher pendant cent pas sur un chemin de cadavres, et pendant une lieue sur un chemin pavé d’or...»
«... Le nommez-vous mon frère?... Mais, en vous appelant ainsi de ces noms fraternels, ne savez-vous point que vous semez tout simplement de la graine d’inceste dans le terrain de l’adultère?» (Ibid., p. 160.)
«Sa tête était de plomb, et il avait un enfer dans l’estomac.» (Ibid., p. 177.)
«Au fond de sa poitrine, et flottant dans un océan de larmes, son cœur assassiné par la souffrance se débattait en criant au secours.» (Ibid., p. 191.)
«... Il entendait toujours ces mêmes mots, dont les syllabes lui perçaient le cœur comme les dards d’une couvée de serpents.» (Ibid., p. 194.)
«... Dégagée de toute préoccupation qui eût pu jeter de l’ombre sur son plaisir, chaussant pour la dernière fois le soulier des promenades buissonnières, elle comptait courir d’un pied libre et léger à ce dernier rendez-vous donné par elle-même à son insouciance enfantine, qui avait si peu duré, que son dernier jouet avait été brisé tout neuf sous le pied du malheur, quand il avait renversé la fortune paternelle. Jetant aux buissons de la route les façons d’être un peu sérieuses, qui raidissent[p. 212] les attitudes, immobilisent le visage, règlent la voix dans le registre d’une gamme monotone, et sont pour ainsi dire le costume moral de sa profession, elle espérait retrouver, débarrassée de cette défroque du pédantisme scolaire, cette pétulance, cette vivacité qui faisait d’elle», etc. (Les Buveurs d’eau, p. 203; M. Lévy, 1857.)
«C’est qu’il est telles discussions où la colère arme la bouche de mots qui font balle, et que toute balle fait trou.» (Ibid., p. 276.)
«Un langage onctueux et parfumé comme un sirop de fleurs de rhétorique.» (Les Vacances de Camille, p. 27; M. Lévy, 1859.)
Pour dire qu’à Londres les bars ou cabarets ne sont pas fréquents: «On est quelquefois obligé de marcher pendant une heure avant de rencontrer un endroit où l’on puisse se livrer tranquillement à l’antithèse de la soif.» (Propos de ville et propos de théâtre, Notes de voyage, p. 229; M. Lévy, 1858.)
«La plus belle attitude d’une créature dans l’humanité est celle de l’homme qui se penche sur son œuvre pour rester debout devant lui-même.» (Henry Murger, dans Poitevin, La Grammaire, les Écrivains et les Typographes, p. 221.) Cette phrase se trouve dans Le Sabot rouge de Murger (p. 46; C. Lévy, s. d.), mais corrigée: le dernier membre de phrase a été supprimé.
«Il faut mettre une rallonge à la patience et une à tes robes, quand elles seront usées; car l’horizon est d’un noir à faire de l’encre avec.» (Henry Murger, dans Poitevin, ibid., p. 225.)
A propos de Murger, n’oublions pas cette comique révélation de son historiographe et ami Schaunard (Alexandre Schanne, Souvenirs de Schaunard, p. 175; Charpentier, 1887): «Banville et Murger ont vu Mimi avec les yeux de l’artiste. La vérité est que, sans s’être trompés d’une façon absolue, ils ne l’ont aperçue qu’au travers d’une lorgnette trempée dans l’eau de jouvence.»
[p. 213]
Gustave Flaubert. Ses erreurs, barbarismes et solécismes. — Jules et Edmond de Goncourt. Drôleries et mots tronqués. Abus du verbe mettre. — Alphonse Daudet. — Émile Zola. — J.-K. Huysmans. La musique des liqueurs. Encore l’abus du verbe mettre.
Dans Madame Bovary (t. I, p. 30; 1re édition, Michel Lévy, 1857), Gustave Flaubert (1821-1880) nous dit que «le père Rouault vint apporter à Charles le paiement de sa jambe remise, soixante-quinze francs en pièces de quarante sous». 75 francs en pièces de 2 francs, problème qui paraît insoluble.
Plus loin (p. 141), nous lisons: «Il reçut pour sa fête une belle tête phrénologique, toute marquetée de chiffres jusqu’au thorax et peinte en bleu.» Une tête qui va jusqu’au thorax, encore une énigme difficile à déchiffrer.
Le costume de conseiller de préfecture décrit par Gustave Flaubert, dans un autre chapitre de Madame Bovary (t. I, chap. 8, p. 197, Fête des Comices): «Alors on vit descendre du carrosse un monsieur vêtu d’un habit court à broderies d’argent... Il était, lui, un conseiller de préfecture... M. le conseiller, appuyant contre sa poitrine son petit tricorne noir...», ce costume serait, d’après une lettre adressée au Figaro (numéro du 13 mars 1919) par «Un ancien conseiller de préfecture», tout à fait inexact: «Jamais, sous aucun régime, les conseillers de préfecture n’ont eu de broderies d’argent, mais des broderies bleues de deux nuances et un bicorne...»
Dans Bouvard et Pécuchet (p. 126; 1re édition, Lemerre, 1881), cette singulière peinture: «De couleur vert-pomme, sa chasuble, que des fleurs de lis agrémentaient, était bleu-ciel[45]».
[p. 214]
Pages 299-300 du même ouvrage, Flaubert fait célébrer la messe de minuit «le soir du 26 décembre», c’est-à-dire le lendemain de Noël au lieu de la veille.
«Je voudrais que les gouttes de mon sang jaillissent jusqu’aux étoiles, fissent craquer mes os, découvrir mes nerfs.» (La Tentation de saint Antoine, p. 44; Charpentier, 1882.)
Des gouttes de sang qui font craquer les os, etc.?
Et que dites-vous de cette gentille petite phrase, cueillie dans une lettre adressée à Mme X... (Mme Louise Colet: Correspondance de Gustave Flaubert, t. II, p. 176): «Adieu, toi qui es l’édredon où mon cœur se pose, et le pupitre commode où mon esprit s’entrouvre»?
Il faut bien le reconnaître, malgré son très grand talent et ses minutieux et maladifs scrupules d’écrivain, et aussi malgré toute l’admiration qu’il nous inspire, les fautes de français (barbarismes et solécismes) abondent chez Gustave Flaubert. A l’époque de sa jeunesse, on étudiait mal ou plutôt on n’étudiait pas du tout notre langue dans les collèges et les lycées; on était censé l’apprendre à l’aide des versions latines, et Flaubert, sans s’en douter le moins du monde, garda toute sa vie et dans tous ses écrits des traces de cette ignorance.
Émile Faguet en a, de son côté, fait la remarque: «Flaubert n’était pas très sûr de sa langue. Il est resté un certain nombre de solécismes et de provincialismes dans Madame Bovary (Revue bleue, 3 juin 1899, p. 697).
Voici quelques exemples à l’appui de ces assertions:
Flaubert confond sans cesse de suite avec tout de suite: «Il eut un tel regard qu’elle s’empourpra, comme à la sensation d’une caresse brutale; mais de suite, en s’éventant avec son mouchoir: «Vous avez manqué le coche...» (Bouvard et Pécuchet, 1re édition, p. 368, et passim.) «Réponds-moi de suite...» (pour immédiatement, tout de suite) (Correspondance, t. I, p. 108.) «Tu vas avoir de suite plus de lecteurs que tu n’en aurais eu...» (Ibid., t. II, p. 170.) Etc.
Il évite quelque chose à quelqu’un, au lieu de le lui épargner, ou de le lui faire éviter: «Pour lui éviter du mal, il se levait de bonne heure...» (Bouvard et Pécuchet, p. 237.) «Vous m’éviterez une course.» (Correspondance, t. IV, p. 214.) Etc.
Il se rappelle d’une chose, il s’en rappelle, au lieu de se la rappeler: «La première lecture n’est pas si loin qu’ils ne s’en soient rappelés.» (Correspondance, t. II, p. 236.) «Remercie de ma part Mme Robert qui a bien voulu se rappeler de moi.» (Lettres à sa nièce Caroline, p. 2.) Etc.
[p. 215]
Il cause à quelqu’un, au lieu de causer avec lui: «On trouve toujours dans cette ville-là des gens à qui causer.» (Correspondance, t. III, p. 193.) «Je n’aurais plus personne à qui causer.» (Lettres à sa nièce Caroline, p. 359.) Etc.
Il se dispute avec quelqu’un, au lieu de disputer (sans pronom) avec lui, de se quereller avec lui («Se disputer, dans le sens d’avoir une querelle, locution qui n’a en sa faveur ni la grammaire ni l’autorité des écrivains»: Littré, art. Disputer, Rem.): «Il vit Arnoux qui se disputait...» (L’Éducation sentimentale, p. 29; Charpentier, 1880.) «C’était le chevalier et le postillon qui se disputaient.» (Ibid., p. 153.) «... à me disputer avec mes éditeurs.» (Correspondance, t. I, p. 101.) Etc.
Il observe quelque chose à quelqu’un, au lieu de le lui faire observer: «Il est possible, comme tu me l’observes, que je lise trop...» (Correspondance, t. I, p. 170.)
Ne soupçonnant pas qu’invectiver est un verbe neutre, il écrit toujours: invectiver quelqu’un, au lieu d’invectiver contre ce quelqu’un: «Il invectivait Charles Ier.» (L’Éducation sentimentale, p. 214.) «Sa femme l’invectivait.» (Ibid., p. 401.) «Il ne pouvait se retenir de les invectiver.» (Ibid., p. 411.) Etc.
Toujours aussi il écrit: nous nous sommes en allés, au lieu de: nous nous en sommes allés (de même qu’on dit: nous nous en sommes flattés, nous nous en sommes vantés, — et non en flattés, en vantés): «Nous nous sommes en allés.» (Correspondance, t. I, p. 85.) «Il s’est en allé tranquillement.» (Ibid., t. I, p. 308.) «Avec Louis-Philippe s’est en allé quelque chose qui ne reviendra pas.» (Ibid., t. II, p. 12.) Etc.
Il donne à la locution prépositive à l’encontre de, qui signifie en s’opposant à, à l’opposite de, en face de, etc. (Cf. Littré), le sens, qu’elle n’a jamais eu, de relativement à, à propos de: «Il avait des remords à l’encontre du jardin.» (Bouvard et Pécuchet, p. 37.)
Sous le rapport de: cette locution, qui n’est pas exacte, car une chose n’est pas sous un rapport, mais en rapport avec une autre, «n’est pas bonne à employer, dit Littré (art. Rapport, Rem.); ceux qui écrivent avec pureté doivent l’éviter». Flaubert l’emploie couramment: «... Quoique d’une fidélité fort exacte sous le rapport des descriptions...» (Correspondance, t. I, p. 196.) «Tâche de me dire ce qui se passe dans ma maison sous tous les rapports possibles.» (Ibid., t. I, p. 278.) «Nous allons bien sous le rapport sanitaire.» (Ibid., t. II, p. 35.) Etc.
Il part à Paris, au lieu de partir pour Paris. «Dans une quinzaine, il part à Paris.» (Correspondance, t. II, p. 321.)
[p. 216]
Il écrit le Dante, au lieu de Dante sans article («Durante Alighieri, dit Dante, par une abréviation familière aux Italiens, et non le Dante, comme on dit trop souvent en français, les Italiens ne plaçant l’article que devant le nom propre et non devant les prénoms»: Larousse, art. Dante): «La chape de plomb que le Dante promet aux hypocrites...» (Correspondance, t. II, p. 283.)
Il écrit les de Goncourt (Ibid., t. III, p. 391), au lieu de les Goncourt. (Cf. Littré, art. Nobiliaire.)
Oubliant que pire est un adjectif et non un adverbe, il écrit: «Je vais pire» (Ibid., t. IV, p. 263), comme si l’on pouvait dire: Je vais meilleur, au lieu de: Je vais mieux, je vais pis.
Il dit que «rien n’est plus embêtant comme la campagne». (Lettres à sa nièce Caroline, p. 77.)
«Écris-moi-le» (Ibid., p. 153), pour: écris-le-moi.
Dans ce but, locution qui ne s’explique pas et «qui doit être évitée», dit Littré. «Mme Lapierre m’a écrit, dans ce but, un billet fort aimable.» (Ibid., p. 389.)
«La pluie qui n’arrête pas me comble de joie.» (Ibid., p. 163.)
Soi-disant «ne se dit jamais des choses», remarque Littré, et ne peut logiquement s’appliquer qu’aux personnes. «A force de patauger dans les choses soi-disant sérieuses...», écrit Flaubert. (Ibid., p. 434.)
Enfin, on a, non sans raison, blâmé ces phrases de Flaubert:
«Son mari, sachant qu’elle aimait à se promener en voiture, trouva un boc d’occasion, qui, ayant une fois des lanternes neuves... ressembla presque à un tilbury.» (Madame Bovary, t. I, p. 48.)
«Les marchands de vins étaient ouverts; on allait de temps à autre y fumer une pipe.» (L’Éducation sentimentale, p. 352.)
«Il fallait relever le principe d’autorité, qu’elle s’exerçât au nom de n’importe qui, qu’elle vînt de n’importe où...» (Ibid., p. 475.)
«Le matin, on s’encombrait au bureau de la poste.» (Bouvard et Pécuchet, p. 196.) Pour: on se pressait au bureau, ou: on encombrait le bureau.
«Il était venu avec une charrette de fumier, et l’avait jetée tout à vrac au milieu de l’herbe.» (Ibid., p. 206.) Au lieu de: en vrac. (Cf. Littré.)
«Il assista peut-être à des choses que tu lui jalouserais, si tu pouvais les voir.» (Ibid., p. 349.)
Flaubert, qui aimait tant à relever les incorrections grammaticales chez ses confrères (Cf. Correspondance, t. II, p. 148 et 200,[p. 217] où il reproche à Stendhal d’écrire mal, à Lamartine de n’avoir pas suffisamment étudié le français; et t. IV, p. 344, 354, 355, 362, etc.), et qui nous informe quelque part (Correspondance, t. III, p. 237) qu’il a, pour un certain laps de temps, huit ou quinze jours, le Dictionnaire de l’Académie sur sa table, et qu’il «couche avec la Grammaire des Grammaires», eût été diantrement étonné si on lui eût montré combien sa langue était en désaccord avec la langue de l’Académie, avec la langue de Littré, et surtout avec celle de Girault-Duvivier, son sévère et vieillot compagnon de lit[46].
Des Goncourt (Edmond de Goncourt: 1822-1896; Jules de Goncourt: 1830-1876): «Sur le siège, le dos du cocher était étonné d’entendre pleurer si fort.» (Germinie Lacerteux, chap. 64, p. 254; Charpentier, 1864.)
Dans le même roman (p. 244), les deux écrivains inventent le verbe rasseyer, rasseoir ne leur suffisant pas: «Il fallait que mademoiselle la rasseyât de force», — et (p. 85) ils écrivent des affutiots, qui n’existe pas en français: «... avec des affutiots comme elles s’en mettent», au lieu d’affûtiaux (bagatelle, brimborion, affiquet).
«Ce qui lui manquait et lui faisait défaut, c’était une absence d’aliment à des appétits nouveaux...» (Madame Gervaisais, p. 216.)
Dans Idées et Sensations (p. 155), les Goncourt nous font entendre des rossignols en hiver: «Au mois de décembre... j’aime à entendre la lisière toute gazouillante et rossignolante du sautillant bonsoir des oiseaux au soleil.» Les rossignols, aussi bien d’ailleurs que les autres oiseaux, ne chantent guère en hiver, d’autant que la plupart des oiseaux chanteurs sont migrateurs et nous ont quittés: «Le rossignol arrive chez nous vers la fin de mars... et émigre dans les premiers jours d’août» (Larive et Fleury, Dictionnaire des mots et des choses)[47].
[p. 218]
Et dans Les Frères Zemganno (p. 11), nous assistons à ce phénomène: un hérisson, qui, au lieu de se rouler bien vite sur lui-même et se mettre en boule, se débat contre son ravisseur: «... Le jeune homme, portant enfermé dans sa vareuse un animal qui se débattait... Le hérisson vivant...»
Autres phénomènes: une femme croque des noisettes avec des dents qu’elle n’a pas; un jeune homme imberbe rit dans sa barbe: «Ce soir, au dessert, en croquant des noisettes avec des dents absentes, la sœur nous raconte...» (Goncourt, Journal, année 1871, t. IV, p. 349.) «Le jeune Léon rit dans sa barbe future.» (Id., ibid., année 1882, t. VI, p. 177.)
Et ce discours «applaudi par deux larmes coulant sur la figure de l’amiral Jauréguiberry». (Id., ibid., année 1886, t. VII, p. 136.)
Puis des phrases entortillées et alambiquées comme celles-ci: «Charmée nerveusement, avec de petits tressaillements derrière la tête, Mme Gervaisais demeurait, languissamment navrée sous le bruit grave de cette basse balançant la gamme des mélancolies, répandant ces notes qui semblaient le large murmure d’une immense désolation, suspendues et trémolantes des minutes entières sur des syllabes de douleur dont les ondes sonores», etc. (Madame Gervaisais, p. 83.)
«Et, tout à coup, dans ce qu’il regardait, une page fleurissante semblait un herbier du mois de mai, une poignée du printemps, toute fraîche arrachée, aquarellée dans le bourgeonnement et la jeune tendresse de sa couleur.» Etc. (Manette Salomon, p. 173.)
«Et elle travaillait avec la fumée d’une bougie recueillie sur un plat d’argent, elle travaillait laborieusement, par-dessus le délicat charme de ses traits charmants, à la composition d’un visage aphrodisiaque et cadavéreux, où il y avait de l’échappée de l’hôpital, mêlée à une espèce de génisse inquiétante et fantasque», etc. (Chérie, p. 237.) Quel charabia! Et qu’est-ce que tout cela signifie?
De même ceci:
«Et la morne désolation de ce lendemain n’était pas le nuage qui met au front de la femme une contrariété de la vie, et qui se dissipe dans un peu de nervosité batailleuse, mais était un sombre et momentané désenchantement de l’existence, le repliement lassé d’une créature sur elle-même, avec ce temps d’arrêt du travail sourieur de la cervelle et de l’enfantement continu des projets et des châteaux en Espagne, qui ne cesse[p. 219] que dans cette sorte d’ennui et dans le sentiment de la mort.» (La Faustin, p. 172-173.)
«Parmi les gens à imagination, je suis étonné combien il leur manque le sens de l’art, la vue compréhensive des beautés plastiques, et, parmi ceux qui ont cela, je suis étonné combien il leur manque l’invention, la création...» (Goncourt, Journal, 7 mai 1878; t. VI, p. 22.)
«Les vrais connaisseurs en art sont ceux que la chose, que tout le monde trouvait laide, ont fait accepter comme belle...» (Id., ibid., 30 juin 1881, t. VI, p. 154.)
«... Cette danse n’a rien de gracieux, de voluptueux, de sensuel; elle consiste tout entière dans des désarticulations de poignets, et elle est exécutée par des femmes dont la peau semble de la flanelle pour les rhumatismes, et qui sont grasses d’une vilaine graisse de rats nourris d’anguilles d’égouts.» (Id., ibid., 24 mai 1889; t. VIII, p. 55.)
Et cet homme «maigre et long», qui a des «jambes de pétrin phtisique». (Les Frères Zemganno, p. 151.)
Nul peut-être plus que les Goncourt n’a abusé du verbe mettre appliqué à un objet immatériel ou inanimé:
«Une lampe allumée mettait un brasier de feu d’or...» (Madame Gervaisais, p. 164.)
«... Le visage de la Faustin se détacha avec une toute petite touche carrée de vive lumière sur le front, avec une petite ligne de lumière humide au bord de la paupière inférieure et mettant un éclair mouillé dans le bas de la prunelle, avec une cédille de lumière...» (La Faustin, p. 174.)
«Des lampes... mettent un peu de rougeoiement sur la table.» (La Fille Élisa, p. 6.)
«La lampe de l’escalier mettait sur l’humidité des murs un ruissellement rougeoyant.» (Ibid., p. 94.)
«Les ombres des arbres mettaient de grandes taches diffuses...» (Les Frères Zemganno, p. 10.)
«Un rayon, filtrant par une fente mal jointe, mettait une danse poussiéreuse...» (Ibid., p. 49.)
Etc., etc.
Au lieu de mettre, des écrivains emploient volontiers, dans ce cas, le verbe jeter: «Une cravate en soie rouge jette une note grave sur la blancheur de la flanelle.» (Cf. Revue bleue, 10 mars 1883, p. 315.) Nous avons vu, dans le chapitre consacré à Champfleury (p. 209), «un parfum de miroton qui jetait sa note intense...»
Peu d’écrivains, tout en croyant avoir grand souci de la[p. 220] langue, ont plus mal écrit que les Goncourt, plus émaillé leur prose de barbarismes et de pataquès. «L’épithète rare, voilà la marque de l’écrivain,» assurent-ils. (Journal, t. III, p. 32.) Aussi font-ils peu de cas du style de Flaubert: «Au grand jamais il (Flaubert) n’a pu décrocher une de ces osées, téméraires et personnelles épithètes; il n’a jamais eu que les épithètes excellemment bonnes à tout le monde.» (Ibid., t. VI, p. 289.)[48]
Les Goncourt, eux, l’un ou l’autre ou l’un et l’autre, écrivent:
«Ce coquetage, qui m’insupportait autrefois...» (Ibid., t. IV, p. 163.)
«La canonnade qui ne décesse pas... La fusillade ne décesse pas...» (Ibid., t. IV, p. 171 et 313.) («Décesser, barbarisme populaire qui se dit au lieu de cesser, et qui est une grosse faute.» Littré.)
«Le mot dont il s’est toujours rappelé...» (Ibid., t. VII, p. 87.) Pour qu’il s’est toujours rappelé.
«Brébant me cause de mon livre.» (Ibid., t. VI., p. 314.) «Daudet me cause de la misère...» (Ibid., t. VII, p. 205.) Pour: me parle ou cause avec moi.
«Il a vu payer 90 francs chaque les deux derniers fauteuils...» (Ibid., t. VII, p. 316.) Pour: chacun. («Chaque ne doit pas se confondre avec chacun; chaque doit toujours se mettre avec un substantif auquel il a rapport... C’est une faute de dire: ces chapeaux ont coûté vingt francs chaque.» Etc. — Littré.)
«Les étudiants peu fortunés» (qui n’ont pas assez d’argent pour aller souvent au théâtre) (Ibid., t. VIII, p. 8.) Pour: peu riches, qui n’ont pas beaucoup d’argent. («Fortuné ne doit pas être employé pour «riche»; c’est une faute...» Littré.)
Les Goncourt tronquent quantité de mots, écrivent éplafourdi (Ibid., t. I, p. 51; t. IV, p. 193, etc.) pour éplapourdi (participe passé d’éplapourdir, signifiant abasourdir); — dérayer (Ibid., t. IV, p. 28), pour dérailler; — «la morsure des taxia» (Ibid., t. VII, p. 23), pour des thapsia; — le hantement (Ibid., t. VII, p. 240), qui n’existe pas et est inutile puisque hantise existe; — ils donnent au mot dunkerque (étagère, petit meuble, cf. Littré) un sens qu’il ne paraît pas comporter:[p. 221] «Des vitrines pleines de dunkerques...» (Journal, t. II, p. 69); — etc., etc.
«Je n’admire que les modernes... envoyant promener mon éducation littéraire,» déclare Edmond de Goncourt (Ibid., t. VII, p. 31). C’est-à-dire je supprime tout ce qui m’a précédé, et le monde ne commence qu’à moi.
Avant de quitter les Goncourt, remarquons que l’expression «document humain», si fréquemment employée dans ces derniers temps, a été revendiquée comme sienne par Edmond de Goncourt (La Faustin, préface, p. 11, note 1): «Cette expression... j’en réclame la paternité, la regardant, cette expression, comme la formule définissant le mieux et le plus significativement le mode nouveau de travail de l’école qui a succédé au romantisme: l’école du document humain.»
Alphonse Daudet (1840-1897), dans Tartarin de Tarascon (p. 198, Lemerre, 1886), attribue aux Arabes des mâchoires phénoménales: «Quatre mille Arabes couraient derrière (un chameau), pieds nus, gesticulant, riant comme des fous, et faisant luire au soleil six cent mille dents blanches». Ce qui fait tout juste 150 dents par Arabe.
Dans Les Rois en exil (p. 167 et 229; Lemerre, 1887), un même personnage, l’amant de Séphora, nous est d’abord présenté comme septuagénaire, puis se trouve rajeuni plus loin et devient sexagénaire.
Dans L’Évangéliste (p. 205, Dentu, 1883), Daudet peint un instituteur «aux yeux ardents, d’un bleu globuleux et fanatique».
Dans Le Petit Chose (p. 106; Lemerre, 1884): «Dès l’aube, on s’emplit tous, élèves et maîtres, dans de grandes tapissières pavoisées», etc. Pour: on s’empile.
Alphonse Daudet, qui reconnaissait lui-même tout le premier l’impureté de son style: — «Les gens nés au delà de la Loire ne savent pas écrire la prose française», disait-il (Cf. Journal des Goncourt, t. VI, 1878, p. 24)[49], — abuse des néologismes inutiles[p. 222] et présente fréquemment des tournures de phrases inusitées ou fautives:
«Cette ironie de son fils l’appelant: Maître, cher maître, pour moquer ce titre dont on le flattait généralement...» (L’Immortel, p. 6; 1re édit., Lemerre, 1888.)
«Le nâvrement (sic) de la bouche et du regard signifiait...» (Ibid., p. 12.)
«Longuement réflexionné là-dessus en battant les Champs-Élysées...» (Ibid., p. 59.)
«Les facticités du dessert.» (Ibid., p. 115.) Pour signifier les menus plats de la fin d’un dîner.
«Dans ce frénétisme de vivats...» (Ibid., p. 132.) Frénésie, qui est français, suffirait peut-être.
«Il s’activait autour de la table.» (Ibid., p. 184.) Pour: il s’agitait, se remuait.
«Elle tombe à genoux sur un prie-Dieu, s’y prostre...» (Ibid., p. 186.) C’est-à-dire s’y prosterne.
«Il avait ouvert démesurément la bouche pour exploser sa colère.» (Ibid., p. 221.)
Dans Port-Tarascon (Flammarion, s. d.), Daudet confond auvents avec volets (p. 281); il fait effluves du féminin (p. 78).
Dans Le Petit Chose (Lemerre, 1884), il emploie fixer pour regarder (p. 163); il évite volontiers quelque chose à quelqu’un (p. 192 et 388); part d’ordinaire à son travail (Études et Paysages, Mœurs parisiennes, Le Singe, p. 272; Lemerre, 1885), ou en Auvergne (Jack, t. I, p. 142; Lemerre, 1885), au lieu de pour. Etc., etc.
Émile Zola (1840-1902) donne, dans son roman La Faute de l’abbé Mouret, de curieux détails concernant les prescriptions et habitudes du clergé régulier ou séculier, détails extraits sans doute de quelque traité de discipline ecclésiastique: «Lorsqu’il (l’abbé Mouret) remontait à sa chambre, il ne gravissait (l’escalier) qu’une marche à la fois, ainsi que le recommandent saint Bonaventure et saint Thomas d’Aquin» (p. 115; Charpentier, 1884); «...arrivant à se croire damné pour avoir oublié la veille au soir de baiser les deux images de son scapulaire, ou pour s’être endormi sur le côté gauche; fautes abominables, qu’il aurait voulu racheter en usant jusqu’au soir ses genoux...» (Page 116.) Mais il est regrettable que Zola n’ait pas mieux précisé la source de ces citations.
Dans le même roman (p. 266), l’auteur nous montre «de[p. 223] grands lézards [qui] couvaient leurs œufs». Or, si l’on s’en rapporte au Dictionnaire des mots et des choses de Larive et Fleury (t. II, p. 319, col. 2, art. Lézard), les lézards ne couvent pas leurs œufs: «la femelle ne s’en occupe point, et ils éclosent sans incubation». Une autre espèce de lézards est ovovivipare, c’est-à-dire que «les œufs éclosent dans le corps de la mère, et que les petits viennent au monde tout vivants».
Dans Son Excellence Eugène Rougon (p. 339; Charpentier, 1883), un personnage nous est représenté «assis avec dignité sur son séant». En effet, c’est généralement sur son séant qu’on s’assoit.
Plus loin (p. 394), nous voyons une dame Bouchard qui, «avec le goût pervers des femmes pour les hommes chauves, regarde passionnément le crâne nu» d’un de ses voisins. Est-ce là un goût bien répandu chez les femmes?
«Et combien y a-t-il de Besançon ici? — Dix-sept heures de chemin de fer, répondit Trouche, en montrant sa bouche vide de dents... Oui, oui, on doit être très à son aise, dit Trouche entre ses dents.» (La Conquête de Plassans, chap. 10, p. 138 et 140; Charpentier, 1885.) Voilà des dents qui ont repoussé vite.
«Des femmes montraient leurs... C’était plein de bonhomie, un dortoir au grand air, des braves gens en famille qui se mettent à l’aise... Justement on était à la nouvelle lune...» (La Fête à Coqueville, dans le volume Le Capitaine Burle, p. 284; Charpentier, 1883.)
«On n’entendait jamais un mot plus haut l’un que l’autre.» (Pot-Bouille, chap. 4, p. 78; Charpentier, 1882.) Il faudrait au moins deux mots, pour que l’un pût être plus haut que l’autre.
Dans Lourdes (p. 238; Charpentier, 1894): «Oui, oui, nous partons, dit Pierre, qui se détourna, cherchant son chapeau, pour s’essuyer les yeux.»
Émile Zola, au dire du moins d’Edmond de Goncourt (Journal des Goncourt, 15 juillet 1891; t. VIII, p. 257), estimait que «la clarinette est l’instrument qui représente l’amour sensuel, tandis que la flûte représente tout au plus l’amour platonique».
Les mots saleté, sale, salir, se retrouvent souvent dans les livres d’Émile Zola, regardé comme le chef de l’école naturaliste. «Cette chose laide et sale qui se nomme la politique.» (Une Campagne, p. 318.) «Elle se croyait salie d’une tache si ineffaçable...» (Madeleine Férat, p. 210; Charpentier, 1892.) «Tu ne dois pas salir nos tendresses.» (Ibid., p. 221.) «... Pour[p. 224] y trouver un sale plaisir...» (Madeleine Férat, p. 224.) «... Un besoin de sales débauches...» (Ibid., p. 236.) «... La salir de sa bave...» (Ibid., p. 261.) «Elle comptait que ses saletés suffiraient.» (Ibid., p. 268.) «Ah! que de saletés!» (Ibid., p. 390.) Etc.
«Je suis une force», cette fière et habituelle déclaration de plusieurs personnages d’Émile Zola, de Saccard (Cf. Renée, pièce en cinq actes, p. 47, 49...), de Rougon (Cf. Son Excellence Eugène Rougon, p. 85, 86...), est aussi une des expressions fréquentes du maître romancier. (Cf. Naïs Micoulin p. 67, 125...)
Nous avons cité le fameux sonnet des voyelles d’Arthur Rimbaud (p. 137):
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles,
Etc., etc.
On pourrait rapprocher de ces vers la musique des liqueurs de J.-K. Huysmans (1848-1907), les comparaisons faites par son héros Des Esseintes (A rebours, p. 63; Charpentier, 1884), des alcools et liqueurs avec les divers instruments de musique:
«Chaque liqueur correspondait, selon lui (Des Esseintes), comme goût, au son d’un instrument. Le curaçao sec, par exemple, à la clarinette, dont le chant est aigre et velouté — le kummel, au hautbois, dont le timbre sonore nasille; — la menthe et l’anisette, à la flûte, tout à la fois sucrée et poivrée, piaulante et douce; tandis que, pour compléter l’orchestre, le kirsch sonne furieusement de la trompette; le gin et le whisky emportent le palais avec leurs stridents éclats de pistons et de trombones, l’eau-de-vie de marc fulmine avec les assourdissants vacarmes des tubas, pendant que roulent les coups de tonnerre de la cymbale et de la caisse frappés à tour de bras, dans la peau de la bouche, par les rakis de Chio et les mastics.
«Il pensait aussi que l’assimilation pouvait s’étendre, que des quatuors d’instruments à cordes pouvaient fonctionner sous la voûte palatine, avec le violon représentant la vieille eau-de-vie, fumeuse et fine, aiguë et frêle; avec l’alto simulé par le rhum plus robuste, plus ronflant, plus sourd; avec le vespétro déchirant et prolongé, mélancolique et caressant comme un violoncelle; avec la contre-basse, corsée, solide et noire comme un pur et vieux bitter. On pouvait même, si l’on voulait former une quintette, adjoindre un cinquième instrument, la harpe,[p. 225] qu’imitait, par une vraisemblable analogie, la saveur vibrante, la note argentine, détachée et grêle du cumin sec.
«La similitude se prolongeait encore; des relations de tons existaient dans la musique des liqueurs; ainsi, pour ne citer qu’une note, la bénédictine figure, pour ainsi dire, le ton mineur de ce ton majeur des alcools que les partitions commerciales désignent sous le signe de chartreuse verte.»
Les phrases bizarres, peu claires, entortillées et alambiquées, ne sont pas rares chez Huysmans.
«Éclairés par des becs de gaz, allumés de loin en loin, des murs frappaient des coups crus dans l’ombre.» (En ménage, p. 2; Charpentier, 1881.)
Comme les Goncourt, comme Zola et la plupart des écrivains «naturalistes», Huysmans applique fréquemment le verbe mettre à des objets inanimés:
«Dissimulée derrière la couverture (d’un livre), la tresse noire rejoignait la tresse rose qui mettait comme un souffle de veloutine, comme un soupçon de fard japonais moderne, comme un adjuvant libertin, sur l’antique blancheur, sur la candide carnation du livre, et elle l’enlaçait, nouant, en une légère rosette, sa couleur sombre à la couleur claire, insinuant un discret avertissement de ce regret, une vague menace de cette tristesse qui succèdent aux transports éteints», etc. (A rebours, p. 262.)
«Les assiettes mettaient sur le blanc de craie de la nappe des ronds d’un blanc plus jaune...» (En ménage, p. 314.)
Etc., etc. (Cf. ci-dessus, à propos des Goncourt, abus du verbe mettre, p. 219.)
[p. 227]
Gustave Claudin. — Alfred Assollant. — Edmond About. Un hasard providentiel. — Jules Verne. — Victor Cherbuliez. — Ferdinand Fabre. — Alexandre Dumas fils. — Gustave Droz. — André Theuriet.
Jules Vallès. Une gaffe macabre. — Léon Cladel. Phrases interminables et autres bizarreries de style.
Jules Claretie. — Charles Chincholle. — Anatole France. — Léon Duvauchel. — Jean Lorrain. — Paul Magueritte. — Remy Saint-Maurice.
Dans son volume Point et Virgule (p. 50; Librairie nouvelle, 1860), Gustave Claudin (1823-1896) nous offre cette amusante comparaison: «Le brouillard, s’épaississant peu à peu, se transforma bientôt en pluie, et fit pousser sur les trottoirs des myriades de champignons verts et bleus qu’on appelle des parapluies.»
Alfred Assollant (1827-1886) indique un singulier moyen de faire concurrence aux cornets acoustiques. Ayant mis en scène des joueurs de billard, il nous les représente qui se rapprochent, «tenant leur queue à la main pour mieux entendre». (Dans Le Journal, 27 août 1897.)
«Victorine continua sa lecture en fermant les yeux», prétend Edmond About (1828-1885), dans Les Mariages de Paris (Le buste, p. 180; Hachette, 1882).
Le même écrivain s’est plu à critiquer, non sans raison, le qualificatif providentiel ajouté au mot hasard: «Il avait entendu mes gémissements par un hasard providentiel (comme on dit dans les feuilles publiques)...» (Madelon, p. 551; Hachette, 1885).
«Un hasard providentiel» est, en effet, un lieu commun qui ne s’explique guère, et qu’on rencontre aussi dans Flaubert (Bouvard et Pécuchet, p. 129; Lemerre, 1881): «Par un hasard providentiel, ils déterrèrent,» etc.
Dans son volume Le Mot et la Chose (chap. 20, p. 191-199; Ollendorff, 1882) Francisque Sarcey étudie et discute en[p. 228] détail cette locution. «Ces deux mots, hasard et Providence, ne peuvent être accouplés l’un à l’autre, écrit-il; ils jurent ensemble... Providentiel est un méchant mot, qui, comme tous les faux pavillons, couvre toutes sortes de marchandises. Nous ferons bien de nous en défaire, et surtout de ne pas le joindre au terme de hasard dont il gâte le sens très précis.»
De Jules Verne (1828-1905): «Les doigts du capitaine couraient alors sur le clavier de l’instrument (un orgue); je remarquai qu’il n’en frappait que les touches noires, ce qui donnait à ses mélodies une couleur essentiellement écossaise.» (Vingt mille lieues sous les mers, chap. 22, p. 173; Hetzel, s. d., in-8.)
De Victor Cherbuliez (1829-1899), dans Miss Rovel (p. 220; Hachette, 1911): «Raymond avait senti la foudre tomber sur lui; il avait été consumé, anéanti, ou peu s’en faut. Il rassembla péniblement ses morceaux. Il achevait de les recoudre, de se reconstituer dans son intégrité...»
De Ferdinand Fabre (1830-1898), dans Barnabé (p. 381; Charpentier, 1885): «L’étoffe, trop vivement ramassée, poussa un cri» (en se déchirant, sans doute).
On pourrait rapprocher cette sorte de prosopopée des vers suivants d’Alexandre Dumas fils (1824-1895) (dans son roman La Dame aux perles, p. 119; Librairie nouvelle, 1855), vers adressés à une élégante Parisienne:
... Vos jupons,
Dentelés et brodés, se donnaient cette joie
De rire avec la boue en battant vos talons.
Encore quelques phrases énigmatiques ou singulières de Dumas fils:
«Anaïs... avait la bouche petite, les dents blanches. Ses bandeaux noirs dénotaient une nature ardente.» (Ce que l’on voit tous les jours, dans le volume La Boîte d’argent, p. 182; M. Lévy, 1867.)
«J’ai bu le lait de l’insubordination dans le shako de mon père, le plus mauvais garde national connu.» (Un Cas de rupture, dans le volume Le Docteur Servans, p. 190; Librairie nouvelle, 1856.)
De Gustave Droz (1832-1895): «Sur l’honneur, je sentis une larme qui me montait à la gorge.» (Monsieur, Madame[p. 229] et Bébé, p. 149; Hetzel, 1866.) Nous avons vu précédemment (p. 83) Lamartine nous avouer que ses larmes n’allaient pas si haut, qu’une larme lui était montée au cœur.
«Si j’avais eu un couteau, je lui aurais brûlé la cervelle!» s’écrie, en plaisantant, un autre personnage de Gustave Droz. (Entre nous, p. 275.) Ce qui rappelle la fameuse complainte du Sire de Framboisy:
Il lui trancha la tête
D’un’ ball’ de son fusil.
D’André Theuriet (1833-1907) qui, mieux que personne, a célébré les splendeurs et «les enchantements» de nos forêts: «Les fraises sont moins rouges que ses désirs.» (Dans Le Journal, 17 mai 1902.)
Jules Vallès (1833-1885) nous parle de son style en ces termes: «J’ai fait mon style de pièces et de morceaux que l’on dirait ramassés, à coups de crochet, dans des coins malpropres et navrants. On en veut tout de même, de ce style-là! Et voilà pourquoi je bouscule de mon triomphe ceux qui, jadis, me giflaient de leurs billets de cent francs et crachaient sur mes sous.» (L’Insurgé, p. 59-60; Charpentier, 1886.)
Voici quelques exemples de ce style très imagé et ampoulé, rude et brutal, où l’antithèse surgit fréquemment:
«... Ils vont (dans des crèmeries) se faire tremper la soupe et attaquer un bœuf — nature ou aux pommes — qui m’effrayerait moins, vivant et furieux, dans les arènes de Madrid.» (Les Réfractaires, p. 11; Charpentier, 1881.)
«... Tout homme de lettres porte en lui de douze à quinze mètres de ver solitaire. Il ne rend le dernier centimètre que le jour où il est arrivé. Les bonnes femmes nourrissent le leur avec du lait, nous tuons le nôtre avec de l’encre.» (Ibid., p. 203.)
«On voit, dit publiquement le doyen, non seulement que vous avez été bercé sur les genoux d’une tête universitaire, mais encore que vous vous êtes abreuvé aux grandes sources...» (L’Enfant, chap. 24, p. 372; Charpentier, 1881.)
Dans L’Insurgé (p. 207), Vallès raconte que, en 1871, durant la Commune, il fut chargé de prononcer un discours sur la tombe d’un combattant. «Je m’avance, et j’adresse un dernier[p. 230] salut à celui qui a été frappé au milieu de nous... «Adieu, Bernard!» Des murmures s’élèvent... Je me sens tiré par les basques: «Il ne s’appelle pas Bernard, mais Lambert», me disent les parents à voix basse.» Vallès resta «déconcerté, un peu ému», et c’est cette émotion même qui le sauva du ridicule de la situation: «Combien plus profond, reprit-il, doit être notre respect devant ces cercueils d’inconnus tombés sans gloire, exposés à recevoir un hommage qui ne s’adresse point à leur personnalité, restée modeste dans le courage et la peine, mais à la grande famille du peuple...» N’importe! La «gaffe» était commise, et la famille Lambert ne digéra pas le quiproquo.
A propos de la phrase du chapeau, de l’académicien Patin, nous avons cité (p. 84) une rugueuse et interminable phrase de Léon Cladel (1834-1892), qui est d’ailleurs coutumier du fait. Si laborieux et méticuleux qu’a été cet écrivain, si épris qu’il fut des qualités du style, il n’en a pas moins commis — lui qui a tant peiné sur sa prose — quantité de lourdes, rocailleuses et surtout très longues phrases, que je ne puis évidemment songer à reproduire ici: ce serait trop fastidieux pour le lecteur, et ces phrases grossiraient démesurément mon volume. Je me borne à en indiquer quelques-unes:
Dans Raca (Paul des Blés, nouvelle, p. 163-164): «D’un geste très net, très résolu, tranchant comme un glaive, il me marqua combien grande était, contre les classes dirigeantes, moins jalouses, selon lui, de trouer les rangs...» (40 lignes.)
Même ouvrage (même nouvelle, p. 146-147): «Et pendant les trois ou quatre hivers qui précédèrent celui de 1870-71, dont les frileux ont gardé la mémoire et les autres aussi, c’est lui, que...» (26 lignes.)
Dans Les Va-nu-pieds (p. 210-211; Charpentier, 1881): «Ici, des bouts de papiers gras, effilochés...» (41 lignes.)
Même ouvrage (p. 288-289): «Aller, apprenti, la canne à la main et la besace au dos...» (27 lignes.)
Dans Quelques Sires (Histrion, nouvelle, p. 289-290): «Kalgrèsbi, le dernier Pierrot, qui tant de fois aux Funambules...» (22 lignes.)
Dans Kerkadec, garde-barrière (dédicace, p. 3-8; Delille et Vigneron, 1884), une phrase qui n’a pas moins de cinq pages, 85 lignes tout d’une traite.
Etc., etc.
[p. 231]
Voici maintenant quelques plaisantes rencontres de mots de Léon Cladel:
«... Six jours après cet entretien, la belle lumière (c’est par cette métaphore qu’un interlocuteur désigne sa propre fille) qui, pendant vingt années, avait été toute ma joie, s’éteignit en donnant le jour à un fils qui ne la précéda que de quelques minutes en la nuit éternelle.» (Quelques Sires, Œil pour œil, p. 77.)
«... Ce renard, qui s’était approché de mon observatoire à pas de loup, ne mangera jamais plus de pain.» (Urbains et Ruraux, Griffe de fer, p. 155.)
Dans Gueux de marque (Zachario, nouvelle, p. 279) un homme qui vient d’être écrasé et qui va rendre l’âme, qui se meurt («...son front où perlaient déjà les sueurs de l’agonie»), trouve le moyen et la force de prononcer une harangue qui dure pendant plus de vingt-cinq pages. (Pages 279-307.) C’est là du reste un tour de force qu’on retrouve de temps à autre chez les romanciers, et dont Lesage, l’auteur du Diable boiteux, nous a jadis (p. 171) offert un exemple.
Dans Quelques Sires (Quasi-jeunes, p. 315-316) nous voyons des noces de diamant se célébrer après soixante-quinze ans de mariage, — au lieu de soixante ans, ce qui est déjà fort beau. (Cf. Larousse, Grand Dictionnaire, 1er suppl., art. Noce.)
«Qu’apercevois-je!» s’écrie Cladel dans sa Kyrielle de chiens (Monsieur Touche, p. 273); et auparavant (p. 154) il nous fait cet aveu: «Je rouai comme un paon».
«Une foule tumultueuse entrait et sortait de la Morgue.» (Quelques Sires, Maugrabins, p. 47.)
Dans Titi Foyssac IV (p. 156, Lemerre, 1886; et autres éditions) il crée le verbe s’excrimer, pour s’escrimer: «Ils s’excrimèrent à vomir un torrent d’imprécations...» Il se sert (p. 31) de la mauvaise locution en agir, pour en user. Il écrit (p. 233): «Aujourd’hui, c’est fête! Elle se changerait en deuil...»
Etc., etc.
Léon Cladel, le patient et acharné prosateur[50], a fait, je crois,[p. 232] très peu de vers, et c’est, j’en suis persuadé, très heureux pour sa mémoire. Je n’ai rencontré de lui que cette strophe d’un poème qu’il a composé en l’honneur de Victor Hugo (Cf. le journal Le Voleur, 21 décembre 1877, p. 813):
En l’an mil huit cent deux, naquit un homme
A Besançon, Franche-Comté.
Nous l’aimons tous ici, c’est Hugo qu’on le nomme,
Victor Hugo La Bonté.
Quand il parut sur cette grande terre,
On vit poindre un nouveau soleil.
Et, jaloux, tout en haut, l’antique solitaire,
Lors clignant son œil vermeil:
«Fétu, dit-il à son cadet terrestre,
Suivrais-tu mon vol hasardeux?
Tu n’es qu’un va-nu-pieds, et, seul, je suis équestre!»
Mais l’enfant: «Nous serons deux!»
Lus par l’auteur à un banquet offert à la presse par Victor Hugo, le 11 décembre 1877, pour fêter la reprise d’Hernani, ces vers ont été jugés si étranges, qu’ils ne figurent pas dans le compte rendu détaillé de ce banquet. (Cf. Victor Hugo, Actes et Paroles, Depuis l’exil, 1876-1880, p. 53-59.)
De Jules Claretie (1840-1913):
Dans une description d’une salle de théâtre et des spectateurs qui s’y trouvaient: «... Le gilet échancré jusqu’à l’abdomen, — qui naîtra plus tard, — le camélia blanc à la boutonnière, les cheveux séparés en deux, les jeunes gens sont autour d’Anna Deschiens...» (Une Femme de proie, p. 156; Dentu, 1881.)
«Elle (une courtisane) traînait son boulet, qui pesait tout aussi lourd, malgré ses dorures. Elle le traînait avec des éclats de rire d’une gaieté épileptique, et quand elle le sentait à son pied, — ce qui lui arrivait rarement, car elle ne pensait pas, — ah bah! elle le plongeait dans le champagne.» (Ibid., p. 269.)
«Le soleil perçait le feuillage, se roulait sur la mousse et[p. 233] gaminait parmi les herbes.» (Robert Burat, p. 287; Lemerre, 1886.)
«Chaque fois que tu m’as crié famine, j’ai su t’en tirer.»
(Charles Chincholle [1843 ou 1845-1902], La Plume au vent, La Paille et la Poutre, p. 167; Courniol, 1865.)
Dans son roman Le Vieux Général (p. 54; Marpon et Flammarion, s. d.), Chincholle orthographie toujours: «Empommé, le général, empommé... Il empommera le ministère...» (au lieu de: empaumer, de paume et non de pomme).
A propos d’un vers de Victor Hugo, nous avons vu (p. 111) le chroniqueur Charles Chincholle nous parler, dans la description d’un immense hall, d’«un vide ayant cinq étages de haut». (Cf. La Gazette anecdotique, 15 septembre 1890, p. 150.)
De M. Anatole France (1844-....): «Son nez vaste et charnu, ses lèvres épaisses apparaissaient comme de puissants appareils pour pomper et pour absorber, tandis que son front fuyant, sous de gros yeux pâles, trahissait la résistance à toute délicatesse morale.» (L’Orme du mail, chap. 8, p. 112.) Un front fuyant sous de gros yeux pâles, qui trahit la résistance à toute délicatesse?
«Tu vois, dans les eaux de Crète, la République nager parmi les Puissances, comme une pintade dans une compagnie de goélands.» (Le Mannequin d’osier, chap. 10, p. 184.) Les pintades ne nagent pas plus que les poules.
Pour dire qu’une jeune fille garde le silence et ne laisse rien deviner de ce qui se passe en elle, Léon Duvauchel (1850-1902), le poète et conteur forestier, écrit, dans son roman M’zelle (p. 217), qu’elle «restait toujours impénétrable, boutonnée»; que son cœur était toujours «en robe montante».
Dans son roman Les Lépillier (p. 32; Giraud, 1885), Jean Lorrain (1855-1906) emploie le mot ingambe dans le sens de lourd, pesant, qui a de mauvaises jambes, c’est-à-dire dans un sens absolument contraire à celui de cet adjectif: «La mère Hormidas se faisait un peu vieille, bien ingambe surtout pour faire une parfaite servante.».
Ailleurs, dans M. de Bougrelon, il croit que nonante (neuf dizaines, quatre-vingt-dix) signifie simplement neuf, et il écrit: «A nonante heures, comme il l’avait dit la veille, M. de Bougrelon fut à notre hôtel» (Le Journal, 5 juillet 1901; dans la Revue universelle Larousse, 1903, p. 136); erreur qui, il est vrai,[p. 234] a été corrigée lorsque ce roman a paru en volume (p. 47; Édouard Guillaume, éditeur, 1897).
De Paul Margueritte (1860-1919): «...Une mère présente ses enfants: un petit garçon de trois ans et une petite fille de deux ans et demi, marqués à l’empreinte du père...» (L’Embusqué, p. 12.)
De Remy Saint-Maurice (1865-1918): «Thérèse touchait agréablement du violon et de l’aquarelle.» (Tartuffette, p. 26; La Renaissance du Livre, s. d.)
[p. 235]
Romanciers populaires. — Ponson du Terrail. Lapsus et bévues. Encore les serpents. Anachronismes.
Adolphe Dennery. — Gustave Aimard. — Albert Blanquet. — Gontran Borys. — Paul Saunière. — Léopold Stapleaux. — La Vénus de Milo. — Alexis Bouvier.
Incohérences et drôleries diverses commises par les feuilletonistes. — Noms à donner aux personnages des romans afin d’éviter les réclamations. Système d’Eugène Chavette.
Passons à des écrivains moins préoccupés du style et de la forme, aux romanciers dits populaires, aux feuilletonistes.
Un des plus célèbres d’entre eux, Ponson du Terrail (1829-1871), qui, durant sa courte existence, a trouvé moyen de pondre tant de passionnants romans, plus de cent volumes[51], est, encore à présent, demeuré légendaire par ses lapsus, coq-à-l’âne, calembredaines, drôleries de toutes sortes.
«Elle avait la main froide d’un serpent.» (Cité dans Le Soleil, 11 septembre 1897.) Quel rôle les serpents jouent dans les romans, quelle place ils y occupent! Nous en avons vu des exemples à propos de Balzac, d’Alexandre Dumas père, d’Amédée Achard, etc.
«Cet homme est un verrou incarné.» (?!) (Cité dans La Journée, 14 janvier 1903.)
«Le général, les bras croisés et lisant son journal...» (Dans Larousse, art. Ponson du Terrail.)
«Melchior n’avait pas cessé de boire durant toute la route et n’avait point desserré les dents.» (Id., ibid., et art. Bévue.)
«La jeune fille se précipita dans les bras du pauvre invalide», écrit le brave Ponson, après nous avoir appris que ledit pauvre invalide est manchot. (Id., art. Bévue.)
[p. 236]
Ponson du Terrail se plaisait à invoquer les anges dans ses romans. Nous lisons, dans un de ses plus dramatiques feuilletons, Les Compagnons de l’Épée, suivis de La Dame au gant noir, des phrases comme celles-ci:
«Marguerite, dit enfin Gontran, vous êtes un ange, et vous demeurerez ange jusqu’à l’heure où Dieu, par les mains d’un prêtre, aura fait de vous ma femme: regardez-moi comme votre frère.» (Les Compagnons de l’Épée, 1re partie, chap. 32; dans le journal Le Voleur, 1er avril 1859, p. 339, col. 2.)
«Vous êtes bonne, dit-il, noble et bonne comme les anges, Dieu vous récompensera.» (Ibid., 2e partie, chap. 1; ibid., 8 avril 1859, p. 355, col. 2.)
«Ah! enfant, murmura-t-il, Dieu m’est témoin que je vous aime aussi ardemment que les anges peuvent aimer Dieu.» (Ibid., 3e partie, Épilogue; ibid., 5 août 1859, p. 213, col. 3.)
«Et tandis qu’au fond de son âme il adressait à Dieu une dernière prière... il prit dans ses bras l’ange de la réconciliation, dont la voix pure et virginale,» etc. (Ibid., p. 214, col. 1.)
«J’admets donc que vous m’aimez... — Ah! dit-il, comme les anges aiment Dieu!» (La Dame au gant noir, 2e partie, chap. 6; ibid., 17 février 1860, p. 244, col. 2.)
Dans ce même roman, Les Compagnons de l’Épée (1re partie, chap. 22; Le Voleur, 4 mars 1859, p. 277, col. 2), nous trouvons de jolies phrases comme celle-ci: «Un sourire infernal passa sur les lèvres du chevalier, et M. de Lacy frissonna jusqu’à la moelle des os, et sentit ce sourire lui pénétrer au fond du cœur comme la lame glacée d’un stylet napolitain.»
«Le baron de Mort-Dieu habitait la terre dont il portait le nom, et qui était située au fond du Berry, entre la Châtre et Châteauroux... M. le baron de Mort-Dieu était assis au coin du feu du grand salon de sa belle demeure normande...» (Ibid., 2e partie, chap. 1; ibid., 8 avril 1859, p. 354, col. 3.) Normande dans le Berry?
Les anachronismes — c’était à présumer — ne sont pas rares chez Ponson du Terrail.
Dans Les Escholiers de Paris, dont l’action se passe sous François II (1559-1560), figure un moine «qui sait son Molière par cœur» (déjà!), qui s’écrie:
Il est avec le ciel des accommodements,
ou encore:
Ah! pour être dévot on n’en est pas moins homme.
[p. 237]
Ce même moine, toujours en avance, jure par saint Ignace de Loyola, — qui ne fut canonisé que longtemps après, en 1622. (Cf. Larousse, art. Ponson du Terrail.)
Dans La Jeunesse du roi Henri (même source), une des œuvres les plus reproduites de Ponson du Terrail, un certain Godolphin, égaré par une nuit sombre, a d’assez bons yeux cependant pour reconnaître qu’il se trouve devant la façade du Louvre, la colonnade de Perrault, — construite seulement deux cents ans plus tard.
D’Adolphe Dennery (1811-1899), encore plus connu comme dramaturge que comme feuilletoniste, et l’un des ancêtres du genre, cette sensationnelle découverte, relative à l’un de ses héros: «Plusieurs fois il serait mort de faim ou de soif...» (Dans le journal L’Opinion, 19 août 1885.)
De Gustave Aimard (1818-1883), l’illustre auteur — illustre en son temps — des Trappeurs de l’Arkansas: «Bientôt les navires se trouvèrent à plusieurs milles de ces deux cadavres, dont l’un était plein de vie» (Les Rois de l’Océan, t. I, chap. 5, p. 112; Roy, 1891), phrase déjà citée par nous à propos d’un vers de Sully Prudhomme (p. 96).
«...Peu d’instants après, une voiture les emportait au trot de deux bons chevaux lancés au galop», écrit Albert Blanquet (1826-1875), dans son roman Le Parc-aux-Cerfs. (Dans Larousse, art. Bévue.)
«Mme Haveril est morte de saisissement», nous apprend Gontran Borys (pseudonyme d’Eugène Berthoud: 1828-1872), dans son récit d’aventures Le Beau Roland (dernier chapitre). «On lui avait annoncé sans précaution que son frère Paul Mérel, à qui elle ne pensait plus, était trépassé en léguant à Diane vingt-quatre millions. Cette nouvelle l’a tuée roide.»
Décès qui nous rappelle celui-ci: «La princesse Zélie se fâcha avec le prince. Elle mourut à la suite de ce refroidissement.» (Le journal La Nation, 3 août 1892.)
De Paul Saunière (1829-1894):
«Il se dirigeait vers un bosquet de verdure.» (Une Fille des Pharaons, p. 35.) Sans doute pour: un cabinet de verdure.
«Il (Maurice) se mit à table... La bouche de Bridet, en le servant, s’élargissait d’un énorme sourire.» (Ibid., p. 42.)
[p. 238]
«Il tomba dans une mélancolie noire.» (Ouvrage cité, p, 69.) (Mélancolie: mélas, noire; chole, bile.)
Le romancier belge Léopold Stapleaux (1831-1891), qui, comme écrivain, selon l’expression d’Aurélien Scholl (Les Ingénues de Paris, p. 335 et 341), «équivalait à un marchand de marrons», était coutumier des plus singulières inadvertances. Nous avons déjà cité ces phrases célèbres perpétrées par lui (Cf. ci-dessus, Préambule, p. 11): «Il portait un veston et un gilet à carreaux avec un pantalon de même couleur... Il avait soixante-dix ans et paraissait le double de son âge». Dans son roman Les Amours d’une horizontale (p. 318; Dentu, 1885), Stapleaux écrit sans s’émouvoir: «De même que celles du firmament, les étoiles parisiennes... ont gagné longuement et péniblement leurs chevrons, et l’abus du fard a laissé sur leur front de précoces rides, et sur leurs joues ces tons blafards», etc.
Plus d’une fois la Vénus de Milo — statue de Vénus, à laquelle manquent les bras, trouvée en 1820 dans l’île grecque de Milos ou Milo — a donné lieu à d’amusantes bévues. Nous avons vu (p. 161) Auguste Vacquerie prendre le nom de Milo pour un nom d’homme, le nom d’un illustre sculpteur; d’autres écrivains ont suivi sa trace:
«La vraie merveille, c’était elle-même, avec... son cou ferme et solide, sa superbe poitrine, ses hanches fortes et sa prestance, avec laquelle Milo, l’artiste dont la renommée a traversé les siècles, aurait donné un pendant à son immortelle statue.» (Charles Mérouvel [1832-....], Millions, Amour et Cie, dans Le Petit Parisien, 1er février 1911.)
Un autre romancier, Amédée de Bast (1795-1864), nous annonce qu’un de ses héros, «Joseph de Plumard, mit un genou en terre et déposa sur cette main blanche et potelée comme celle de la Vénus de Milo, le plus respectueux des baisers.» (Le journal Le Voleur, 31 janvier 1879, p. 80.)
Et M. Jules de Gastyne (1848-....):
«... Elle dit, soulevant son bras blanc, modelé comme le bras de la Vénus de Milo, étincelant comme du carrare», etc. (Chair à plaisir, dans La Nation, 19 juillet 1889.)[52]
[p. 239]
Dans le même feuilleton (cité dans La Nation, même date), M. Jules de Gastyne écrit: «Eh bien! vrai, ce n’est pas trop tôt!» soupira le nègre. Le commissaire, qui s’attendait à voir son prisonnier pâlir...»
Elle est de M. Charles Mérouvel encore cette perle enchâssée dans son roman Jenny Fayelle (p. 28): «Cette femme avait... une taille svelte et souple qu’une main d’homme eût emprisonnée dans ses dix doigts.»
D’Alexis Bouvier (1836-1892), dans La Princesse saltimbanque (chap. 4, dans Le Radical, 7 juillet 1885): «... Et il prit sa petite fiole; l’enfant la repoussant, il lui saisit brutalement la tête, lui en vida le contenu dans la bouche, et l’enfant retomba suffoqué.» Il y avait de quoi!
La Grande Iza (Rouff, s. d.), un des romans les plus en renom d’Alexis Bouvier, nous présente un même personnage ayant, à une même époque, des âges différents, ici trente-cinq ans, là plus de quarante-cinq (Cf. p. 28 et 310); et la même lettre insérée en deux endroits du livre (p. 118 et suiv. et 262 et suiv.) dans des termes dissemblables.
Une erreur, une ligne omise, dans une reproduction de ce roman a donné lieu à un plaisant quiproquo. On lit page 32:
«(Un canotier)... se mettant à son aise pour barboter dans le bateau, c’est-à-dire retirant son paletot, son gilet, ses chaussettes, restant nu-pieds et le pantalon relevé jusqu’aux genoux, les manches de chemise relevées jusqu’aux coudes, il détacha le bateau...»
Un journal qui reproduisait ce roman en feuilletons a sauté la ligne «jusqu’aux genoux, les manches de chemise relevées», en sorte qu’on lisait: «le pantalon relevé jusqu’aux coudes...», malencontreuse omission qui a valu à l’auteur plus d’un brocard. (Cf. Fantasio, 1er avril 1918, p. 454.)
Dans un roman-feuilleton mentionné par Le Radical (22 juillet 1884): «C’est par une froide nuit de décembre que Paul, après avoir causé à sa mère d’horribles souffrances, vit le jour pour la première fois.»
Ce qui, soit dit en passant, se trouve déjà dans Virgile (Énéide, X, 703, 704):
... una quem nocte Theano
In lucem genitori Amyco dedit...
(... Un fils que, dans la nuit, Théano donna [mit] au jour à son père Amycus); et peut aussi se rapprocher de cette annonce, cueillie dans le journal La Nation (12 juin 1890): «La femme Antoinette Marchand a donné le jour à un enfant aveugle», et d’une phrase de Léon Cladel citée ci-dessus, p. 231.
Et ces autres incohérences et drôleries de divers feuilletonistes, citées par M. Marcel France dans L’Indépendance de l’Est du 21 février 1900:
«Daniel ne répondit pas. C’était la première fois qu’il parlait ainsi à son père.»
«Ils ronflaient, comme seuls ronflent les cœurs innocents.» Et l’on prétend que le sommeil du juste est paisible!
«Qu’aurais-tu dit, si ce mari trahi t’avait tué? Ne l’aurais-tu pas accusé de barbarie?...»
Et celles-ci encore:
«La marquise allait prendre la parole, quand la porte, en s’ouvrant, lui ferma la bouche.»
«Les réverbères, qui n’étaient pas encore inventés, rendaient la nuit plus obscure.»
Etc., etc.
Les romanciers et auteurs dramatiques sont fréquemment en butte aux réclamations de gens ayant rencontré leurs noms parmi ceux des personnages d’un livre ou d’une pièce de théâtre, et qui se prétendent pour cela outragés, déshonorés, etc. Ces pudibonds et pointilleux bourgeois n’hésitent pas parfois à intenter un procès à l’auteur, et à demander, comme dommages-intérêts, la forte somme.
Un jour que l’auteur des Courbezon, Ferdinand Fabre, était assis au bord d’une route des environs de Bédarieux, son[p. 241] pays, il vit venir un homme qui lui dit, embarrassé et tournant entre ses doigts son grand chapeau rond:
«Vous êtes monsieur Ferdinand?
— Oui, mon ami. Que me voulez-vous?
— Voilà: il paraît que vous avez fait un livre à Paris, et qu’il y a dans ce livre que, moi Pancol, j’ai tué M. l’abbé Courbezon. Je vous jure que ce n’est pas vrai. J’ai porté un lièvre chez votre frère (le gibier est rare dans cette région) pour que vous cessiez d’être animé contre moi. Car enfin, je ne l’ai pas tué!
— Mais non, mon ami.
— Je n’ose plus passer devant la gendarmerie quand je vais à Bédarieux vendre mes pauvres châtaignes. Et les mauvais gars du pays répètent comme ça qu’on va m’arrêter un beau matin.
— Mais non. D’abord votre curé ne s’appelait pas M. Courbezon; je m’en souviens, c’était M. Montrosier. Et puis, Justin Pancol ne le tue pas...»
Impossible de convaincre le vieux paysan. En vain Ferdinand Fabre l’emmena-t-il manger sa part de son lièvre; pendant tout le dîner, il se tint sur le bord de sa chaise, marmottant: «Je ne l’ai pas tué». Il fallut lui promettre, puisqu’il ne s’appelait pas Justin, de dire que c’était un autre Pancol qui avait fait le coup, un prénommé et prétendu Justin Pancol.
Ce n’est pas la seule réclamation qu’aient suscitée les romans de Ferdinand Fabre, continue la Revue bleue (13 novembre 1886, p. 639), à qui j’emprunte ces détails. Dans Mademoiselle de Malavieille, Ferdinand Fabre met en scène un notaire, M. Forestier, dont la femme est très dévote et dit chaque soir son chapelet sur l’oreiller conjugal. Quelle fut la surprise du romancier, quand il reçut d’un M. Forestier, notaire en province, une lettre furieuse: «Mais c’est infâme! Comment avez-vous pu pénétrer ainsi dans ma vie? Comment savez-vous?...» — Ferdinand Fabre avait inventé trop juste.
A l’origine, Tartarin de Tarascon se nommait «Barbarin»; Alphonse Daudet dut modifier le nom de son héros pour éviter les réclamations, — une croisade qui s’annonçait contre lui. «Il y avait justement à Tarascon une vieille famille de Barbarin qui me menaça de papier timbré, si je n’enlevais son nom au plus vite de cette outrageante bouffonnerie. Ayant des tribunaux et de la justice une sainte épouvante, je consentis à remplacer Barbarin par Tartarin sur les épreuves déjà tirées, qu’il fallut reprendre ligne à ligne dans une minutieuse chasse aux B. Quelques-uns ont dû m’échapper à tra[p. 242]vers ces trois cents pages; et l’on trouve, dans la première édition, des Bartarin, Tarbarin, et même tonsoir pour bonsoir.» (Alphonse Daudet, Trente ans de Paris, p. 155; Marpon et Flammarion, 1888.)
Pareille mésaventure faillit arriver à Louis Ulbach pour son roman Françoise, où un conseiller d’État, du nom de Berthelin, créé de toutes pièces par l’auteur, correspondait trait pour trait et par un pur hasard à un conseiller à la Cour, portant le même nom de Berthelin, demeurant pareillement rue Tronchet, ayant le même jour de réception que son imaginaire homonyme, etc. (Cf. Revue bleue, 4 février 1882, p. 154; art. de Louis Ulbach.)
De même pour Émile Zola et son roman Pot-Bouille, où figurait un personnage baptisé Duverdy, nom d’un conseiller à la Cour d’appel, qui s’empressa de protester et jeter les hauts cris. (Cf. Revue bleue, ibid.)
C’est pour éviter ces inconvénients, se garer de ces plaintes et assignations, qu’Eugène Chavette (1827-1902), de joyeuse mémoire, s’avisa de l’expédient suivant:
«... Pour mon roman L’Oreille du cocher, écrit-il à son éditeur Dentu, je me suis fait un devoir de n’employer que des noms de gens ayant été guillotinés. Si ceux-là réclament!!!» (Lettre publiée par le journal La République, 20 mai 1902.)
Effectivement, tous les personnages de L’Oreille du cocher portent des noms de suppliciés de marque: Dumollard, Tropmann, Avinain, Papavoine, etc.
Eh bien, malgré cela, il y en eut un, paraît-il, un homonyme, un certain Dumollard, simple plaisant peut-être, qui grommela et montra les dents. C’était vraiment jouer de malheur.
[p. 243]
| PRÉAMBULE | |
| Pages. | |
| Des bévues et non-sens littéraires, leurs causes les plus fréquentes. | 9 |
| Emploi irréfléchi de locutions courantes et de lieux communs (Armand Silvestre, Bussy-Rabutin, Bruyn). | 9 |
| Pléonasmes (Claude Tillier, Octave Feuillet, Émile Souvestre, Louis Blanc, H. de Balzac, George Sand, Émile Zola, Alphonse Daudet, Barbey d’Aurevilly). — Inadvertances et ignorances (Léopold Stapleaux, Jules de Goncourt, H. de Villemessant, Émile Richebourg, Géruzez, Tallemant des Réaux, P.-L. Courier, J.-J. Rousseau, Lope de Vega, H. de Balzac, Henri Rochefort). | 10 |
| Locutions vicieuses (Littré, son dictionnaire, sa compétence «universellement reconnue» [Francisque Sarcey], Sainte-Beuve, Voltaire, Émile Deschanel, Émile Faguet, etc.). | 11 |
| Manques de goût et de sens critique. — Alliance de pensées disparates (Mme de Sévigné, Saint-Simon, Voltaire, Toussenel). | 15 |
| Style figuré (Voltaire, Balthazar Gracian, Cyrano de Bergerac, Alexandre Dumas père, Dr Félix Maynard, Philippe Desportes, L’Arétin, Molière, etc.). — Réminiscences mythologiques (Mme Giroust de Morency). — Marinisme, gongorisme (le cavalier Marin, Gongora), euphuïsme. — Un vœu de P.-L. Courier. | 16 |
| I. — POÈTES ET AUTEURS DRAMATIQUES I |
|
| Pierre Corneille. Concetti, Cacophonies et Calembours (vicomte d’Arlincourt, Alexandre Dumas père, Lemierre, J.-B. Rousseau, Voltaire, l’abbé Pellegrin, l’abbé[p. 244] Abeille, B. Jullien, Racine, Scarron, Leblanc de Guillet, Geoffroy, Tissot, Viennet, Eugène Mathieu, Victor Hugo). Galimatias simple et Galimatias double (Boileau, l’acteur Baron, Molière, Klopstock, Victor Hugo). Vers de Corneille qu’on rencontre dans Nicole et dans Godeau. Épître à la Montauron: éloges outrés. Traduction de l’Imitation de Jésus-Christ (Jules Levallois). «Dieu n’est jamais ingrat envers ceux qui travaillent pour lui.» — Thomas Corneille. Le plus grand succès dramatique de tout le dix-septième siècle (Paul Stapfer, Laharpe). | 19 |
| Rotrou. — Théophile de Viau. — dumonin. — Pierre du Ryer. — Jean Claveret et l’unité de lieu. — La tragédie réduite à cette question: «Mourra-t-il ou Ne mourra-t-il pas?» (Rivarol). Napoléon Ier et A.-V. Arnault. Crébillon le Tragique, Corneille et Racine. | 27 |
| Racine. Critiqué par Chapelain. Réminiscence du romancier grec Héliodore. Remarque de Méry. Le mot diligence (Corneille, Molière, Ch.-G. Étienne). Des vers de Racine jugés «détestables» (la comtesse de Boufflers, Grimm, Mme de Polignac). Une erreur de distance. Changement de visage (Adrienne Lecouvreur, l’acteur Beaubourg). Cacophonies. Un auteur de sept ans (le duc du Maine): «Pas un académicien qui ne soit ravi de mourir pour vous faire une place.» Athalie lue par pénitence. Racine déclaré «grossier et immodeste», «ni poète ni chrétien» (le jésuite Soucié), traité de «polisson», etc. (Frédéric Soulié, Théophile Gautier, Auguste Vacquerie). Mort et enterrement de Racine (le comte de Roussy). | 29 |
| Molière. Son style (Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Goncourt, Fénelon, La Bruyère, Vauvenargues). L’article d’Edmond Scherer sur Molière (Georges Lafenestre, Robert de Bonnières). Acceptions des mots flamme, cœur, main, etc. (Corneille, Crébillon, Fénelon, Massillon, Gaston Boissier, Marivaux, Tallemant des Réaux, Jules Sandeau, Benserade, etc.). Singularités de prosodie chez Molière. Anachronismes. Cacophonies. Locutions favorites de Molière. Vers de Molière qu’on rencontre dans Corneille et dans La Fontaine. L’Avare de Molière offre d’excellents principes d’économie (Laharpe). Remarque de Sainte-Beuve. | 35 |
| II | |
| Ronsard. — Desmarets de Saint-Sorlin. — Du Bartas. Sa gloire sans rivale (Gabriel Naudé, Sainte-Beuve, la princesse Palatine, Richelieu). — Malherbe. Une ode[p. 245] qui arrive trop tard (le duc de Bellegarde, le président de Verdun, Tallemant des Réaux). — Scudéry. | 43 |
| La Fontaine. Ses inadvertances (Planude, Ésope, Toussenel, Chateaubriand). Emploi du mot femme: la femme du lion (Chateaubriand, Mérimée, Mme de Montebello). Autres particularités (Voltaire, Diderot). Dédicaces hyperboliques (le duc de Bourgogne, le duc de Vendôme). Libertés scéniques de La Fontaine (Rotrou, Tabarin). Irrégularités de prosodie. Cacophonies. Fréquence de la rime hommes et nous sommes (Victor Hugo, Chamfort). Orthographe de La Fontaine. | 45 |
| Boileau (Juvénal, l’abbé Cotin, Longin). — Regnard. Ses emprunts à Molière. — Crébillon le Tragique. La cheville «en ces lieux» (Laharpe, Voltaire). — L’abbé Desfontaines. — Piron. Un acteur qui se poignarde d’un coup de poing. — La Chaussée (Corneille). | 51 |
| III | |
| Voltaire, «le plus grand homme en littérature de tous les temps» (Gœthe), «le vrai représentant de l’esprit français» (Sainte-Beuve). Théâtre de Voltaire: anecdotes diverses (Corneille; Georges Avenel, son édition des œuvres de Voltaire; Pierre de Villiers, Émile Deschanel; l’acteur Paulin, Mlle Desmares, Lekain, Larive). Voltaire et la petite-nièce de Corneille. Les vingt et un volumes de L’Encyclopédie. Abus des mots horreur, fatal, affreux (Laharpe). Les tragédies de Voltaire jugées par Victor Hugo. Orthographe de Voltaire (Galiani, d’Olivet). | 57 |
| L’abbé d’Allainval (Beaumarchais, Voltaire). — Saurin. — Alexandre de Moissy. Une pièce pour sages-femmes. | 62 |
| Sedaine. Ses répétitions de mots. Ses redoublements de locutions en guise de superlatif (François Génin). «J’allongerai». Ses incorrections. — Lemierre. Le vers du siècle. | 63 |
| Beaumarchais. L’adjectif sensible au dix-huitième siècle (J.-J. Rousseau, Florian, Michelet, les Goncourt). «Chaque siècle a son terme favori» (Paul Stapfer), et chaque écrivain a ses termes de prédilection (Joubert et Sainte-Beuve). | 65 |
| Dorat. — Chamfort. «La Charité romaine». — Desforges. Phrases inachevées (Jacques de la Taille). — Florian. Autres phrases interrompues. | 66 |
| IV | |
| Le culte de la périphrase (Voltaire, Buffon). Périphrases courantes: les auteurs de mes jours, les gages de ma tendresse,[p. 246] un jeune objet, etc. (J.-J. Rousseau, Florian). — Écouchard Lebrun et le «périphrastique» Delille (Sainte-Beuve, Ginguené, Andrieux, Victor Hugo, Marmontel, Gustave Flaubert, Grimod de la Reynière, Pierre-Antoine Lebrun, etc.) Locution favorite de Delille. Ses succès. Sa mémoire prodigieuse. (Charles Brifaut, Charles Rozan, Sainte-Beuve). | 69 |
| Chateaubriand. Il préférait ses vers à sa prose. Sa tragédie de Moïse (Henri de Latouche, Victor Hugo, Henri Monnier, Adolphe Brisson). Prédilections particulières de certains écrivains et artistes: «Le violon d’Ingres» (Gœthe, Sainte-Beuve, Lamartine, Molière, J.-J. Rousseau, Quentin de La Tour, Girodet-Trioson, Alfieri, Byron, Cherubini, Canova, Ingres, Gainsborough, Rossini, Alexandre Dumas père, Gavarni). Singuliers jugements et vœux de Chateaubriand (Bonaparte, les sœurs de Chateaubriand, l’abbé Carron, Ginguené, Persil). La locution Tuer le mandarin (J.-J. Rousseau, Balzac). La gloire littéraire (Chateaubriand, Sainte-Beuve, Napoléon, Edmond de Goncourt, Malherbe, Andersen, Edgar Quinet, Montaigne, Cicéron, Salluste, Montesquieu, Benjamin Constant, Alfred de Vigny, Huet, Remy de Gourmont, etc.). | 75 |
| V | |
| Lamartine. Ses étourderies et incohérences. La phrase du chapeau, de l’académicien Patin, et autres phrases de longue haleine (Léon Cladel, Ferdinand Brunetière). Autres étourderies de Lamartine (Drouet d’Erlon, La Valette, maréchal Ney, M.-J. Chénier, Mme Cottin, Annibal confondu avec Alcibiade, etc.). Toujours de l’à peu près chez Lamartine (Sainte-Beuve). Le Lac et l’académicien Thomas. Lamartine accusé d’indécence. Jugements de Lamartine sur Rabelais, La Fontaine, Molière, Ossian, J.-J. Rousseau, André Chénier, Ponsard, etc. Flaubert très dur pour Lamartine. «De qui sont ces beaux vers?» (Lamartine, La Fontaine). | 81 |
| Alfred de Vigny. — Auguste Barbier. Le substantif Centaure (Alexandre Dumas père, Gustave Chadeuil, Timothée Trimm, Paul de Kock, J.-J. Barthélemy). — Gérard De Nerval. | 87 |
| Alfred de Musset (Saint-Amant, Maurice Donnay, Mirabeau, Corneille, J.-J. Rousseau). — Théophile Gautier. Ses bizarreries et ses inadvertances, particulièrement dans son livre Les Grotesques (Sainte-Beuve). «Dante» et non[p. 247] «Le Dante». Emploi des termes techniques (Émile Faguet). «Il faut, dans chaque page, une dizaine de mots que le bourgeois ne comprend pas» (Théophile Gautier). | 88 |
| Leconte de Lisle (Pongerville, Alexandre Dumas père). — Théodore De Banville. — Henri de Bornier (François Ponsard, Corneille, Henry Becque). — Sully Prudhomme (Gustave Aimard). — François Coppée. — Catulle Mendès. — Clovis Hugues (François de Nion). | 94 |
| VI | |
| Victor Hugo. Ses erreurs, inadvertances, réminiscences, énumérations de termes rares, obscurités, jeux de mots, drôleries, etc. Caractéristiques de Victor Hugo: force, puissance, amour pour les petits et les humbles; éloge de la bonté. Discours et lettres: abus de l’antithèse. Locutions favorites. Particularités orthographiques, etc. | |
| [«Sabaoth». «La Montjoie Saint-Denis» (Casimir Delavigne, Alexandre Dumas père, etc.). — Sainte-Beuve. — «Jocrisse à Pathmos» (Louis Veuillot). — Louis Reybaud: Pastiche ou parodie de Victor Hugo. — Le «nard cher aux époux». — Eugène Noël. — Virgile familier à Victor Hugo. — Théodore de Banville, Émile Zola, Voltaire, Alfred de Musset, Ponson du Terrail. — Des regards de colombe. — Voltaire, Gabriel Marc. — L’Enfer situé dans la planète Saturne. La Légende des siècles, «la Bible et l’Évangile de tout versificateur français» (Théodore de Banville). — «Moreri, la mine où puise Victor Hugo» (Émile Faguet). — «Jérimadeth». (Paul Stapfer. — Bouillet, Victor Duruy, Jules Hoche, Jean Sigaux, Charles Chincholle. Eugène Scribe, Lamartine, Alfred de Vigny, Sainte-Beuve; le général Trochu). — Souvenir de Racine. — Livres préférés de Victor Hugo. — Mme de Staël et son ruisseau (Sainte-Beuve). — Enjambements (Andrieux, Mary-Lafon, etc.). — «Vieil as de pique» (Parseval de Grandmaison, Lassailly, Alexandre Dumas père). — «Parle à Clémence». — Pierre Lebrun. — Angel de Miranda. — «Comme un vieillard en sort» (Onésime Reclus). — «Notre-Dame de Paris, le livre le plus affreux qui ait été écrit» (Gœthe). — Pierre Gringoire. — Voltaire. — «Paris, le nombril du monde.» — Eschyle. — Gustave Flaubert. — «Scélérat, l’homme qui ne pense pas comme nous» (P.-L. Courier). — Pierre Mathieu. — Arnaud de Villeneuve et sa citrouille. — Canrobert, Pélissier et Randon. — Éloge de la France. — Le mot gamin créé par Victor Hugo. — Victor Hugo adversaire du système décimal. — La paix perpétuelle. — Un saint-simonien[p. 248]. — Discours de Victor Hugo (George Sand, Louis Blanc). «Dans confrères il y a frères». — Victor Hugo salué du nom de père. (Émile Augier, Jules Claretie). — «Applaudir des deux mains». — Lettres de Victor Hugo (Charles Bataille, Garibaldi, Paul de Saint-Victor, Mme Mollard, Edmond Haraucourt, Julien Larroche, Mme Louise Colet). — Pastiche de Victor Hugo par Jules Vallès. — Rimes fréquentes chez Victor Hugo. Etc. etc.] | 99 |
| VII | |
| Poètes symbolistes ou décadents, humoristes, etc. — Paul Verlaine. — René Ghil. — «La clarté est le génie de notre langue» (Voltaire). — «Le style est comme le cristal: sa pureté fait son éclat» (Victor Hugo). — «Le goût de l’extraordinaire, signe de médiocrité.» (Diderot). (Baudelaire, Lucien de Samosate). | 131 |
| Stéphane Mallarmé (Adolphe Brisson). — Jean Moréas. — Jules Laforgue. — Suppression de la ponctuation. — Voltaire. — «Le commun des hommes admire ce qu’il n’entend pas» (La Bruyère; — et Montaigne, le cardinal de Retz, Corneille, Théophile Gautier, Balzac, Destouches, Alexandre Dumas fils, Frayssinous). — Critique des décadents (Jules Tellier, Paul Stapfer, Max Nordau, Paul Verlaine, Gabriel Vicaire, Edmond de Goncourt, Maynard). | 133 |
| Arthur Rimbaud et son Sonnet des voyelles. Riposte de René Ghil. — Le clavecin oculaire du Père Castel (Diderot, J.-J. Rousseau, Lefèvre-Deumier, Dr Foveau de Courmelles). | 137 |
| Autres singularités à propos des couleurs et des lettres de l’alphabet (Toussenel, Théophile Gautier et sa Symphonie en blanc majeur, Léon Gozlan). — Ernest d’Hervilly. Les couleurs appliquées aux prénoms féminins. — Le chevalier de Piis. Son poème sur l’Harmonie imitative de la langue française et sur nos caractères alphabétiques. — Auguste Barthélemy et les lettres de l’alphabet. — Victor Hugo et sa description des lettres de l’alphabet. | 138 |
| Curiosités poétiques: Épître à l’impératrice Eugénie (Mérimée, Gustave Claudin). — Distiques de Marc-Monnier, Fantaisie d’Alphonse Allais, Début d’un compliment en vers adressé à Alexandre Dumas père. | 141 |
| VIII | |
| Auteurs dramatiques. — Collin d’Harleville. — Andrieux. — Flins des Oliviers (Lebrun-Pindare). Une[p. 249] douleur qui s’exprime en chantant (Saint-Évremond). — Le soleil en pleine nuit. — Luce de Lancival. — M.-J. Chénier et la locution Briller par son absence (Tacite, Camille Desmoulins). — Théâtre de la Révolution (Ferdinand Brunetière). | 143 |
| Nicolas Brazier. Un singulier bibliothécaire. Le savant Antoine-Alexandre Barbier. Palinodies littéraires (vicomte d’Arlincourt, Brifaut, etc.). | 146 |
| Eugène Scribe. Le coin d’une assiette. Anachronisme. (Molière). — Saint-Georges et Leuven (Villemessant). — Canevas d’opéra-comique (Alfred et Paul de Musset) et scénario de tragédie (Rivarol). | 148 |
| Casimir Delavigne. Anachronismes et incorrections. Prodiges de mémoire (Piron, Delille). Une comparaison doublement blessante (Théophile Gautier, Casimir Delavigne et le peintre Paul Delaroche). | 150 |
| Duvert et Lauzanne. Ange-femme (Alfred de Vigny). Facéties et pasquinades (vicomte d’Arlincourt.) — Henri Rochefort. La Lanterne (Jules Claretie, Pierre Véron, Jules Levallois, etc.). | 151 |
| Ernest Legouvé et son père J.-B.-Gabriel Legouvé. La passion de l’inexactitude. (Corneille, Racine, Sully Prudhomme, etc.) Encore les périphrases. — François Ponsard. — Vers prosaïques. Ch.-G. Étienne, Sainte-Beuve, Victor Hugo, Gabriel Marc. — Émile Augier. — Camille Doucet. — Etc. | 154 |
| Eugène Labiche. — Auguste Vacquerie (La Vénus de Milo, l’ébéniste Boule, etc.). — Théodore Barrière. | 158 |
| Curiosités théâtrales: Fernand Desnoyers et sa pantomime en vers; Villiers de l’Isle-Adam et son drame en un acte, une scène et une phrase. — Contrepetteries, facéties, drôleries théâtrales (Voltaire, l’acteur Febvre, Paul de Kock, Justin Bellanger, Victor Hugo, M.-J. Chénier, A. de Chambure, Auguste Vacquerie, l’acteur Rouvière, l’acteur Paul Laba, Félix Duquesnel, Casimir Delavigne, Corneille, Alexandre Dumas père et Gaillardet, Arnault, Alphonse Karr, Alphonse Lafitte, Molière, Sedaine, l’imprésario Léger, Henri Welschinger, Aurélien Scholl, le censeur Planté, Siraudin et Delacour, etc.). | 162 |
| [p.
250]II. — ROMANCIERS I |
|
| Scarron. L’adjectif comique. L’art des transitions (Chamfort), Les anachronismes dans le burlesque. — Charles Perrault. Singuliers contes pour les enfants. — Lesage. Abus du passé défini. Moribonds qui parlent trop. | 169 |
| J.-J. Rousseau. Encore l’adjectif sensible. «Aucun homme ne fut meilleur que moi.» Rêve de bonheur. — Florian. — Sterne. — Charles Dickens. | 171 |
| Marmontel. Suppression des incidentes dit-il, dit-elle, et drolatiques remplacements de ce verbe (Alexandre Dumas père, Léon Cladel, Auguste Saulière). Marmontel candidat académique (Moncrif): il est difficile de contenter tout le monde. | 173 |
| Pigault-Lebrun. — Ducray-Duminil. (Chateaubriand, Mme de Staël, Staaff). «L’auteur est un homme d’esprit qui prendra sa revanche.» | 175 |
| Charles Nodier. Tirage à la ligne (P.-J. Proudhon, Alexandre Dumas père). — Stendhal. Son idéal du style (Mme de Staal-Delaunay, Émile Deschanel, Ferdinand Brunetière). — Henri de Latouche. | 176 |
| Paul de Kock (Louis Reybaud, H. de Balzac). Portrait de Paul de Kock sur un reposoir (Goncourt). — Méry. — Topffer. Mots détournés de leur signification. | 178 |
| II | |
| Honoré de Balzac. Obscurités voulues et bizarreries et tares involontaires (Bertall, Émile Faguet, Théophile Gautier, Destouches, Montaigne, cardinal de Retz, La Bruyère, etc.). Un regard de serpent. Inadvertances (Marcel Barrière). Aveugles qui voient clair (John Lemoinne, Émile Pouvillon, etc.). Anachronismes, etc. Erreurs commises à propos des fleurs (Alphonse Karr, H. de Balzac, Jules Janin, George Sand). Les Contes drolatiques (Barbey d’Aurevilly, Mme Surville, etc.). Abus de la conjonction car. Une précaution oratoire fréquente chez Balzac. | 181 |
| Philarète Chasles. — Henri Monnier. — Louis Reybaud. | 186 |
| Frédéric Soulié. Confusion qui règne dans ses romans. Critique décochée à Eugène Sue. — Stéphen de la Madelaine. — Mérimée. | 186 |
| [p. 251]III | |
| Alexandre Dumas père. Encore un regard de serpent. Rôle des serpents et autres animaux dans les romans de Dumas père. Anachronismes, étourderies et drôleries. Encore «le meilleur des hommes» (J.-J. Rousseau). Une phrase de Chateaubriand. L’aéronaute Petin. Singulière théorie de la télégraphie électrique. Abus du dialogue et tirage à la ligne. (Ponson du Terrail). La cuisinière Çaufy (Sophie: le docteur Véron). | 191 |
| Charles de Bernard. A quel âge est-on un vieillard? Mots tombés en désuétude (Voltaire, Saint-Simon). — Eugène Sue. — Émile Souvestre (Molière). | 197 |
| IV | |
| Alphonse Karr. Abus du tiret. Le mot restaurant dans le sens de restaurateur; roman signifiant romancier (Montesquieu). Arbres merveilleux. — Galoppe d’Onquaire (Paul Féval, Mario Uchard, Guy de Maupassant, Émile Pouvillon). — Jules Sandeau. Fréquentes comparaisons avec les animaux. | 199 |
| Barbey d’Aurevilly. Flaubert ne l’aimait pas, et qualifiait ses œuvres de grotesques: «On ne va pas plus loin dans le grotesque involontaire». Jugements draconiens. Barbey d’Aurevilly jugé par Champfleury. Beaumarchais et ses castagnettes. | 201 |
| Amédée Achard. Encore les comparaisons avec les serpents et autres animaux (H. de Balzac, Alexandre Dumas père, Ponson du Terrail). Style emphatique des romans-feuilletons. — Eugène Fromentin. — Octave Feuillet. Le qualificatif adorable (Alexandre Dumas fils, Edmond de Goncourt, Georges Ohnet, Alexis Bouvier, Jules Levallois). Autres adjectifs hyperboliques: délicieux, exquis, ravissant (Paul de Kock). | 202 |
| V | |
| Champfleury et Henry Murger. Ils abondent tous les deux en pathos et drôleries. (L’abbé Châtel, P.-J. Proudhon.) Dictionnaires de Boiste, de Wailly... et de Poche (Poitevin, Hippolyte Babou, Louis Veuillot). Un vieillard de cinquante ans. Flaubert s’alarmant de la publication des Bourgeois de Molinchart. — Comment, d’après Schanne dit Schaunard, Murger et Banville ont vu Mimi. | 207 |
| [p. 252]VI | |
| Gustave Flaubert. Ses erreurs, ses barbarismes et solécismes (Mme Louise Colet, Émile Faguet). Il reproche à Stendhal d’écrire mal, et à Lamartine de ne pas bien savoir le français. (Le grammairien Girault-Duvivier). | 213 |
| Jules et Edmond de Goncourt. Les rossignols pendant l’hiver; mœurs des oiseaux (Berquin). Drôleries et charabia. Abus du verbe «mettre» (Champfleury). Les Goncourt font peu de cas du style de Flaubert (Flaubert et son drame sur Louis XI); — tronquent quantité de mots. L’école du document humain. | 217 |
| Alphonse Daudet. Les Méridionaux «ne savent pas écrire la prose française» (Alphonse Daudet; — J.-J. Rousseau). | 221 |
| Émile Zola. Citations curieuses, mais imprécises et douteuses (saint Bonaventure, saint Thomas d’Aquin). Goût des femmes pour les hommes chauves. La nouvelle lune. La clarinette et la flûte (Edmond de Goncourt). «Saleté, sale, salir», termes fréquents chez Zola. «Je suis une force.» | 222 |
| J.-K. Huysmans. La musique des liqueurs de Des Esseintes comparée au Sonnet des voyelles de Rimbaud. Encore l’abus du verbe «mettre» (Goncourt, Zola, etc.). | 224 |
| VII | |
| Gustave Claudin. — Alfred Assollant. — Edmond About. Un hasard providentiel (Gustave Flaubert, Francisque Sarcey). — Jules Verne. — Victor Cherbuliez. — Ferdinand Fabre. — Alexandre Dumas fils. — Gustave Droz (Lamartine). — André Theuriet. | 227 |
| Jules Vallès. Une gaffe macabre. — Léon Cladel. Phrases interminables et autres bizarreries de style. Encore un moribond dont la langue est infatigable. Léon Cladel jugé par Camille Lemonnier et comparé à Baudelaire. Ses vers à Victor Hugo. | 229 |
| Jules Claretie. — Charles Chincholle. — Anatole France. — Léon Duvauchel. — Jean Lorrain. — Paul Margueritte. — Remy Saint-Maurice. | 232 |
| VIII | |
| Romanciers populaires. — Ponson Du Terrail (Aurélien Scholl, Gustave Flaubert). Lapsus et bévues. La main froide d’un serpent. Rôle des serpents dans les romans (Balzac, Alexandre Dumas père, Amédée Achard). Rôle des anges dans les romans de Ponson du Terrail. Anachronismes (Molière, Ignace de Loyola). | 235 |
| [p. 253]Adolphe Dennery. — Gustave Aimard (Sully Prudhomme). — Albert Blanquet. — Gontran Borys. — Paul Saunière. — Léopold Stapleaux (Aurélien Scholl). — La Vénus de Milo: Auguste Vacquerie, Charles Mérouvel, Amédée de Bast, Jules de Gastyne, etc. — Alexis Bouvier. | 237 |
| Incohérences et drôleries diverses commises par les feuilletonistes. (M. Marcel France). — Noms à donner aux personnages des romans afin d’éviter les réclamations (Ferdinand Fabre, Alphonse Daudet, Louis Ulbach, Émile Zola; système d’Eugène Chavette). | 240 |
| Table analytique des matières. | 243 |
[p. 254]
2345-20. — CORBEIL. IMPRIMERIE CRÉTÉ.
NOTES
[1] En règle générale, je n’indique le nom de l’éditeur et la date de publication que pour les ouvrages ayant eu plusieurs éditions différentes, et je ne mentionne le lieu de publication que pour les ouvrages édités ailleurs qu’à Paris.
[2] «Bi-hebdomadaire, adj. Qui se fait, qui paraît toutes les deux semaines. C’est à tort que l’on prend bi-hebdomadaire comme signifiant qui se fait, se publie deux fois par semaine. Il faut dire en ce sens: semi-hebdomadaire.
«Bimensuel, elle, adj. Qui se fait, qui paraît tous les deux mois, par opposition à semi-mensuel, qui s’applique à ce qui se fait, qui paraît deux fois par mois. — C’est une erreur de prendre bimensuel pour exprimer deux fois par mois. Bisannuel signifie non pas deux fois par an, mais qui se fait tous les deux ans, qui dure deux ans. Bimensuel ne veut pas plus dire deux fois par mois que trimestriel ne veut dire trois fois par mois.» (Littré, Dictionnaire, Supplém.)
C’est toujours à Littré que je me réfère de préférence, en raison de son indulgence et de sa judicieuse logique, et surtout parce que, chez lui, ce ne sont pas les grammairiens, mais nos grands écrivains, qui tranchent les difficultés et prononcent les arrêts. «Le Dictionnaire de Littré... Cette œuvre immortelle renferme, sur le judicieux emploi de chaque terme, sur le sens et l’histoire de chaque mot, des explications et des exemples qui sont une mine inépuisable pour le grammairien. On ne saurait trop admirer et pratiquer ce prodigieux dictionnaire, dont les ressources, presque infinies, ne seront jamais assez connues ni assez appréciées du public.» (A. Brachet et J. Dussouchet, Grammaire française, Cours supérieur, Préface, p. VIII; Hachette, 1888.) «... Littré, dont la compétence est universellement reconnue.» (Francisque Sarcey, L’Estafette, 22 juin 1886.)
[3] «Cette locution, dans le but de, est très usitée présentement, mais elle n’est pas aisée à justifier. On n’est pas dans un but, car si on y était, il serait atteint... Dans n’a pas le sens de pour... Cette locution ne pouvant s’expliquer... doit être évitée; et, en place, on se servira de: dans le dessein, dans l’intention, à l’effet de, etc.» (Littré.)
[4] «Locution qu’on entend et qu’on lit tous les jours, mais qui est vicieuse; car on atteint un but, on ne le remplit pas... Cette faute doit être évitée soigneusement.» (Littré.)
[5] «Chaque ne doit pas se confondre avec chacun; chaque doit toujours se mettre avec un substantif auquel il a rapport; chacun, au contraire, s’emploie absolument et sans substantif. C’est une faute de dire: ces chapeaux ont coûté vingt francs chaque; il faut vingt francs chacun.» (Littré.) En d’autres termes, chaque est un adjectif, et chacun est un pronom.
[6] «Être court d’argent, et non être à court d’argent, qui est une locution fautive, puisque rien n’y justifie la préposition à.» (Littré, art. Court, Remarque 3.)
[7] «Fortuné ne doit pas être employé pour riche; c’est une faute née de ce que fortune, entre autres significations, a celle de richesse. Dans la logique du peuple, un homme fortuné est nécessairement un homme riche; c’est un barbarisme très commun dans la langue, et qui provient d’une erreur très commune dans la morale.» (Charles Nodier, dans Littré.) Fortuné dérive du latin fortuna, sort, destin, succès, etc., et, de même qu’un homme infortuné peut être riche, un homme fortuné peut être très pauvre; le premier subit des malheurs, des infortunes; le second a du bonheur, de la chance, etc. Fortuné ne signifie pas plus qui a de la fortune, que successif ne signifie qui a du succès.
[8] «Quelques Gascons hasardèrent de dire: J’ai fixé cette dame, pour: Je l’ai regardée fixement, j’ai fixé mes yeux sur elle. De là est venue la mode de dire: Fixer une personne. Alors vous ne savez point si on entend par ce mot: J’ai rendu cette personne moins incertaine, moins volage; ou si on entend: Je l’ai observée, j’ai fixé mes regards sur elle.» (Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. Langue française; Œuvres complètes, t. I, p. 406, édit. de journal Le Siècle.)
[9] «Infime n’admet ni plus, ni moins; il est le superlatif d’inférieur.» (Littré.)
[10] «A Rome, il n’y avait pas que les esclaves qui fissent le métier de gladiateurs. Construction barbare, bien que fort usitée aujourd’hui. On n’en trouverait pas un seul exemple dans toute la littérature française avant la fin du dix-huitième siècle, dit Émile Deschanel... Grammaticalement, cette construction signifie précisément le contraire de ce qu’on veut lui faire dire quand on l’emploie aujourd’hui... Voici d’où vient la confusion: certains s’imaginent que cette tournure il n’y a pas que est l’opposé de il n’y a que; tandis qu’au fond, soit grammaticalement, soit logiquement, ces deux tournures ne sont qu’une... En effet, en ajoutant simplement le mot pas à la tournure il n’y a que, on croit ajouter une seconde négation à la première, ce qui serait nécessaire pour que l’une des tournures signifiât le contraire de l’autre; mais, en réalité, on n’y ajoute rien du tout, si ce n’est le mot pas, mot purement explétif, qui, soit qu’on le mette, soit qu’on l’omette, fait virtuellement partie de la première négation, et ne saurait, à lui tout seul, en constituer une seconde... Ne tout seul, ou, à volonté, ne pas n’est qu’une seule et même négation... (Émile Deschanel, Journal des Débats, 23 août 1860, dans Littré, art. Que, Remarque 1.) En place de la construction vicieuse: Il n’y a pas que lui qui ait fait cela, ajoute Littré (Ibid.), on dira: Il n’y a pas seulement lui qui a fait cela, ou mieux: Il n’est pas le seul qui ait fait cela. Je n’ai pas vu que lui; dites: Il n’est pas le seul que j’aie vu.» «Ce solécisme est de nos jours très répandu, dit de son côté Émile Faguet (Revue encyclopédique, 1897, p. 965). On s’imagine qu’il n’y a pas que est le contraire d’il n’y a que; c’est absurde: pas n’étant qu’un mot de renforcement, il n’y a que et il n’y a pas que signifient absolument la même chose.»
[11] «Soi-disant ne se dit jamais des choses. C’est une grosse faute que de dire: accorder de soi-disant faveurs; s’étayer de soi-disant titres.» (Littré.) Cette faute, Sainte-Beuve la commet fréquemment: «Des idées soi-disant nouvelles.» (Portraits littéraires, t. I, p. 51; nouvelle édit; Garnier, s. d.) «Style soi-disant gaulois.» (Portraits contemporains, t. III, p. 228; C. Lévy, 1882.) «La soi-disant bienséance sociale.» (Nouveaux Lundis, t. I, p. 278; C. Lévy, 1885.) Etc.
[12] «Sous le rapport de est une locution qui est devenue très commune. Elle est fort lourde et n’est pas exacte en soi. Une chose est en rapport avec une autre, est dans un certain rapport, a rapport avec; mais elle n’est pas sous un rapport; si elle était sous un rapport ou sur un rapport, elle serait en dehors du rapport; et, au fond, en s’en servant, on s’exprime inexactement. Elle ne paraît donc pas bonne à employer, et ceux qui écrivent avec pureté doivent l’éviter.» (Littré.)
[13] «Style figuré par les expressions métaphoriques qui figurent les choses dont on parle, et qui les défigurent quand les métaphores ne sont pas justes.» (Voltaire, Dictionnaire philosophique, Œuvres complètes, t. I, p. 390.)
Les Orientaux ont toujours affectionné le style «figuré»: «Le jour est sur ton visage et la nuit dans tes cheveux», écrit un Arabe à sa maîtresse, qui avait le teint blanc et les cheveux noirs. (Voltaire, Articles de journaux, IX, Œuvres complètes, t. IV, p. 626.) «Lorsque la flèche des arrêts divins est lancée par l’arc du destin, elle ne peut plus être repoussée par le bouclier de la précaution.» (Proverbe oriental, cité par Alexandre Dumas et Dr Félix Maynard, Impressions de voyage, De Paris à Sébastopol, p. 175.)
[14] Il s’agit très probablement de Balthazar Gracian (1584-1658), jésuite espagnol, «qui fut en prose ce que Gongora avait été en vers». (Larousse).
[15] Et Alexandre Dumas (Mémoires, t. VII, p. 8): «Je ne demande qu’une chose, c’est, si Dieu m’appelle à régner sur la France...»
[16] Le Siège de Paris, tragédie en cinq actes, par M. le vicomte d’Arlincourt, représentée pour la première fois sur le Théâtre-Français le 8 avril 1826 (Paris, Leroux et Constant Chantepie, 1826).
[17] Ajoutons, en note tout au moins, qu’un autre abbé, l’abbé Gaspard Abeille (1648-1718), fut victime d’une mésaventure analogue, et aussi sujette à caution d’ailleurs que celle de son confrère Pellegrin. Lors de la première représentation d’une des tragédies de l’abbé Abeille, l’actrice qui faisait le rôle d’une princesse et, au début, prononçait cet alexandrin:
Vous souvient-il, ma sœur, du feu roi notre père?
s’étant arrêtée court, ou bien la réplique tardant à venir, un loustic du parterre lança de sa plus belle voix cette riposte, désastreuse pour le succès de la pièce:
Ma foi, s’il m’en souvient, il ne m’en souvient guère!
(Edmond Guérard, Dictionnaire encyclopédique d’anecdotes, t. I, p. 13.)
Racine, qui avait, comme on sait, un talent spécial pour les épigrammes, a utilisé ce mot dans son épitaphe de l’abbé Abeille:
Ci-gît un auteur peu fêté,
Qui crut aller tout droit à l’immortalité,
Mais sa gloire et son corps n’ont qu’une même bière;
Et lorsque Abeille on nommera,
Dame Postérité dira:
«Ma foi, s’il m’en souvient, il ne m’en souvient guère!»
(Racine, Œuvres complètes, Poésies diverses, t. II, p, 215; Hachette, 1864.)
[18] On a appliqué aussi cette anecdote à d’autres vers de Corneille, à un passage de sa tragédie d’Héraclius: cf. Émile Deschanel, ouvrage cité, t. I, p. 225-226; et même ouvrage, 2e série, Racine, t. I, p. 241.
[19] Nous trouvons dans Tallemant des Réaux (Les Historiettes, t. VI, p. 282 et 318; Techener, 1862), les anecdotes suivantes, relatives à des femmes qui appelaient couramment et tendrement leurs maris Mon Cœur: «Une vieille madame Mousseaux... avoit espousé un jeune homme nommé Saint-André qui, pour n’estre pas avec elle, alloit le plus souvent qu’il pouvoit à la campagne; elle en enrageoit et escrivoit sur son almanach: «Un tel jour mon cœur est parti; un tel jour mon cœur est revenu...» Un nommé du Mousset, trésorier de France à Châlons, reçut un soufflet sur l’œil en jouant; sa femme s’écria: «Ah! mon Dieu, mon cœur est borgne». Une autre, racontant la maladie de son mari, disoit: «Je lui disois quelquefois: «Mon cœur, tirez la langue». — Dans La Croix de Berny (lettre IV, p. 44; Librairie nouvelle, 1859), l’un des auteurs, Jules Sandeau, sous le pseudonyme de Raymond de Villiers, mentionne une inscription gravée sur une roche et ainsi conçue: «Le 25 juillet 1831, deux tendres cœurs se sont assis à cette place».
[20] «Du Bartas, auparavant que de faire cette belle description du cheval, s’enfermait quelquefois dans une chambre, et, se mettant à quatre pattes, soufflait, hennissait, gambadait, tirait des ruades, allait l’amble, le trot, le galop, à courbette, et tâchait par toutes sortes de moyens à bien contrefaire le cheval.» (Gabriel Naudé, dans Sainte-Beuve, Tableau de la poésie française au seizième siècle, p. 100, note, et 397; Charpentier, 1869.) A en croire la princesse Palatine (Correspondance, t. I, p. 240; Charpentier, 1869), le cardinal de Richelieu, sans avoir l’excuse d’une description littéraire, faisait de même: «Il se figurait quelquefois qu’il était un cheval; il sautait alors autour d’un billard, en hennissant et faisant beaucoup de bruit pendant une heure, et en lançant des ruades à ses domestiques; ses gens le mettaient ensuite au lit, le couvraient bien pour le faire suer, et, quand il s’éveillait, il n’avait aucun souvenir de ce qui s’était passé.»
[21] Le nom d’Émile de la Bédollière figure bien dans le titre de l’ouvrage, au moins sur les quatre premiers tomes de cette édition; mais à peu près pour la forme uniquement, et en raison de l’importante situation que La Bédollière occupait alors au journal Le Siècle.
[22] Sur l’abus de l’adjectif sensible au dix-huitième siècle, voir Michelet, Histoire de France, tome XIX, p. 287 (Marpon et Flammarion, 1879): «C’était (la seconde moitié du dix-huitième siècle) un temps ému et de larmes faciles. La langue en témoignait. A chaque phrase, on lit sensible et sensibilité.» Etc. Et Edmond et Jules de Goncourt, La Femme au dix-huitième siècle, p. 439 (Charpentier, 1890): «Sensible, c’est cela seul que la femme veut être; c’est la seule louange qu’elle envie (à cette époque)...»
[23] Remarquons que Victor Hugo n’a pas dit autre chose dans sa Réponse à un acte d’accusation, déjà citée par nous tout à l’heure, à propos de «l’animal qui s’engraisse de glands»:
un mot
Était un duc et pair, ou n’était qu’un grimaud.
Mais la conclusion diffère: Delille s’incline et se soumet, Hugo s’insurge:
Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire.
Plus de mot sénateur! plus de mot roturier!
[24] Ce que Sainte-Beuve a traduit en ces termes: «Mes écrits de moins dans le siècle, qu’aurait-il été sans moi?» (Causeries du lundi, t. I, p. 450.) Peut-être était-ce là d’ailleurs une première version lue par Sainte-Beuve dans lesdits mémoires.
Le poète et romancier danois Andersen (1805-1875) nous offre aussi un des plus frappants exemples de la vanité humaine. «Il est vrai que je suis le plus grand homme de lettres actuellement vivant, disait-il, mais ce n’est pas moi qu’il faut louer, c’est Dieu, qui m’a fait ainsi.» (Revue bleue, 20 septembre 1879, p. 273.)
[25] «La gloire veut qu’on l’aide auprès des hommes; elle n’aime pas les modestes.» (Edgar Quinet, La Révolution, t. II, p. 343, Librairie internationale, 1869; in-18.)
[26] Ailleurs (La Faustin, p. 287), Edmond de Goncourt, mieux inspiré, dit ou fait dire à l’un de ses personnages: «Au fond, la gloire, ça pourrait bien être tout simplement des bêtises: une exploitation de notre bonheur par une vanité imbécile». Et encore (Journal des Goncourt, année 1883, t. VI, p. 269): «C’est chez moi une occupation perpétuelle à me continuer après ma mort, à me survivre, à laisser des images de ma personne, de ma maison. A quoi sert?»
C’est le cas de rappeler la judicieuse réflexion de Montaigne (Essais, I, 46; t. II, p. 8-9, édit. Louandre): «O la courageuse faculté que l’espérance, qui, en un subject mortel, et en un moment, va usurpant l’infinité, l’immensité, l’éternité, et remplissant l’indigence de son maistre de la possession de toutes les choses qu’il peult imaginer et désirer, autant qu’elle veult! Nature nous a là donné un plaisant jouet!»
[27] Voir, par exemple, ce que dit Cicéron dans Le Songe de Scipion, livre VI, chap. XIV, XV et XVIII, sur la gloire humaine: «... Quelle gloire digne de tes vœux peux-tu acquérir parmi les hommes? Tu vois quelles rares et étroites contrées ils occupent sur le globe terrestre... Retranche toutes les contrées où ta gloire ne pénétrera pas, et vois dans quelles étroites limites», etc.
Et Salluste (Catilina, VIII): «De faire que les actions (et les œuvres) soient connues, c’est le pur ouvrage du hasard (fortuna); c’est lui, c’est son caprice qui nous dispense ou la gloire, ou l’oubli...»
Et Montesquieu (Pensées diverses: Œuvres complètes, t. II, p. 433; Hachette, 1866): «A quoi bon faire des livres pour cette petite terre, qui n’est guère plus grande qu’un point?»
Et Benjamin Constant (dans Sainte-Beuve, Portraits littéraires, t. III, p. 263, note 2): «... Le sentiment profond et constant de la brièveté de la vie me fait tomber le livre ou la plume des mains, toutes les fois que j’étudie. Nous n’avons pas plus de motifs pour acquérir de la gloire, pour conquérir un empire ou pour faire un bon livre, que nous n’en avons pour faire une promenade ou une partie de whist.»
Alfred de Vigny (Journal d’un poète, p. 183; Charpentier, 1882) a très justement comparé le sort d’un livre à celui d’une bouteille jetée à la mer avec cette inscription: «Attrape qui peut!»
«Ah! que le sage Huet (l’évêque d’Avranches) avait raison quand il démontrait presque géométriquement quelle vanité et quelle extravagance c’est de croire qu’il y a une réputation qui nous appartienne après notre mort!» (Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. II, p. 164). «... Nous ressemblons tous à une suite de naufragés qui essaient de se sauver les uns les autres, pour périr eux-mêmes l’instant d’après.» (Id., Portraits littéraires, t. III, p. 128.) «... Un peu plus tôt, un peu plus tard, nous y passerons tous. Chacun a la mesure de sa pleine eau. L’un va jusqu’à Saint-Cloud, l’autre va jusqu’à Passy.» (Id., Nouvelle Correspondance, p. 157.)
Sur l’aléa et l’inanité de la gloire littéraire, voir, dans le Mercure de France de novembre 1900, un article abondamment documenté et des plus judicieux de Remy de Gourmont.
[28] Parmi les curiosités ou les monstruosités littéraires, la phrase du chapeau, de l’académicien Patin (1793-1876), est légitimement célèbre. «C’est, a dit Robert de Bonnières (Mémoires d’aujourd’hui, 2e série p. 88), le plus mémorable exemple du plus joyeux galimatias.» Voici cette perle:
«Disons-le en passant, ce chapeau fort classique, porté ailleurs par Oreste et Pylade, arrivant d’un voyage, dont Callimaque a décrit les larges bords dans des vers conservés, précisément à l’occasion du passage qui nous occupe, par le scoliaste, que chacun a pu voir suspendu au cou et s’étalant sur le dos de certains personnages de bas-reliefs, a fait de la peine à Brumoy qui l’a remplacé par un parasol.» (Patin, Études sur les tragiques grecs, t. I, p. 114; édit. de 1842.)
«Cette phrase du chapeau était jusqu’à présent réputée comme typique et inimitable, lit-on dans la Revue encyclopédique du 15 mars 1892 (col. 473); Léon Cladel (1834-1902) l’a de beaucoup surpassée dans la suivante, qui sert de début à l’un de ses contes, Don Peyrè (dans le volume de Léon Cladel, Urbains et Ruraux, p. 107 et suiv.; Ollendorff, 1884):
«A peine eut-elle débouché des gorges de Saint-Yrieix sur le plateau marneux qui les surplombe et d’où l’on découvre, à travers l’immense plaine s’étendant du dernier chaînon des Cévennes aux assises des Pyrénées, ces montagnes dont la beauté grandiose arracha jadis des cris d’enthousiasme au peu sensible Béarnais, déjà roi de Navarre, et faillit le rendre aussi troubadour que bien longtemps avant lui l’avait été Richard Cœur de Lion, alors simple duc du Pays des Eaux, où l’on trouve encore quelques vestiges des monuments érigés en l’honneur de ce descendant de Geoffroy, comte d’Anjou, lequel seigneur, aucun historien n’a su pourquoi ni comment, ornait en temps de paix sa toque, en temps de guerre son haubert d’une branche de genêt, habitude qui lui valut le surnom de Plantagenet, porté plus tard par toute la famille française à laquelle le trône anglo-saxon, après la mort d’Étienne de Blois, le dernier héritier de Guillaume de Normandie, avait été dévolu, ma monture prit peur et manqua de me désarçonner.»
Patin s’était contenté d’égayer çà et là sa phrase de quelques incidentes bizarres; «dans celle de Léon Cladel, ajoute la Revue encyclopédique, entre le sujet et le verbe, qui n’arrive qu’au bout d’une vingtaine de lignes, se trouve intercalée une bonne partie de l’histoire de France et d’Angleterre! C’est un véritable tour de force.»
Le Larousse mensuel (juin 1913, Petite correspondance, col. 3) reproduit une phrase de Ferdinand Brunetière (1849-1907), digne pendant des précédentes, et dont je me borne à citer le début: «Il n’en est pas de même des Mémoires de Mme de Caylus, ni des Lettres de cette bonne Mme de Sévigné, dont on aurait pourtant tort de croire qu’elles doivent l’une et l’autre nous inspirer une entière confiance, étant donné d’une part, en ce qui concerne Mme de Sévigné, que nous avons affaire à une femme dont il est vrai de dire qu’encore que ses lettres, qui sont d’un de nos bons écrivains, contiennent de précieux renseignements sur les événements de la cour de Louis XIV, néanmoins peu d’auteurs ont été plus légers dans leurs informations, plus superficiels dans leurs jugements, et plus médisants à cœur-joie qu’elle ne l’a été pour le plus vif plaisir de son grand malicieux de cousin, Bussy, comte de Rabutin, et de sa pimbêche de fille, la comtesse de Grignan,» etc. Je m’arrête, n’étant pas encore arrivé à la moitié de la phrase.
[29] C’est à propos de l’Histoire des Girondins qu’Alexandre Dumas père disait de Lamartine: «Il a élevé l’histoire à la hauteur du roman». C’est bien le même Dumas qui disait: «Qu’est-ce que l’histoire? C’est un clou auquel j’accroche mes tableaux». (Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. XI, p. 463.)
[30] Théophile Gautier se plaisait à la lecture des dictionnaires (Cf. Les Jeunes-France, préface, p. 11), et emmagasinait quantité de termes techniques, rarissimes et incompréhensibles «aux bourgeois» et à tout le monde, et les glissait dans ses écrits. Voir, par exemple, son roman Partie carrée (Charpentier, 1889), dont plusieurs épisodes se déroulent, il est vrai, dans les Indes: surmé, gorotchana, siricha (p. 187); — apsara, malica, amra (p. 198); — tchampara, kesara, ketoca, bilva, cokila, tchavatraka (p. 199), etc. Dans Mademoiselle de Maupin (Charpentier, 1866): stymphalide (p. 32); smorfia (p. 150); une robe de byssus (p. 200); nagassaris, angsoka (p. 246), etc.
[31] Comparer cette orthographe Qaïn à celle d’Yaqoub, un des personnages du drame de Charles VII d’Alexandre Dumas père, qui écrit toujours Yaqoub et non Yacoub. (Cf. Théâtre complet d’Alexandre Dumas, t. II, p. 231 et suiv., Michel Lévy, 1873.)
[32] Je rencontre les mêmes pensées ou des pensées analogues dans une très belle lettre de M. Edmond Haraucourt adressée à M. Julien Larroche, le 30 novembre 1907, en tête du recueil de vers Les Voix du tombeau, par Julien Larroche (Lemerre, 1908): «... Ni dithyrambes ni réclames ne valent cette paix sereine qui se devine au fond de vous. Gardez-la comme le trésor unique, et n’enviez personne, même si le silence des critiques accueille vos poèmes: vos poèmes vous ont réjoui ou consolé, n’attendez rien de plus, et dites-vous qu’au temps où nous sommes les poètes dont on redit le nom et ceux dont on ne parle pas sont, en dépit des apparences, confondus fraternellement dans le même dédain des foules, car on ne lit les vers ni des uns ni des autres.» N’empêche que poètes et poétesses, tout comme leurs confrères en prose d’ailleurs, ne se montrent pas, d’ordinaire, si philosophes et ne se désintéressent pas aussi facilement du succès et de la célébrité.
[33] Voir ci-dessus (p. 25) Corneille disant, à propos de certains de ses vers peu intelligibles: «Tel qui ne les entendra pas les admirera»; — et (p. 94) Théophile Gautier à qui l’on attribue cette sentence: «Il faut que, dans chaque page, il y ait une dizaine de mots que le bourgeois ne comprend pas». C’était aussi, comme nous le verrons plus loin (p. 181), l’opinion de Balzac.
[34] Il s’appelait Claude-Marie-Louis-Emmanuel Carbon de Flins des Oliviers, et la multiplicité de ses noms lui attira cette épigramme de Lebrun-Pindare:
Carbon de Flins des Oliviers
A plus de noms que de lauriers.
(Cf. Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, t. I, p. 219, note 1; édit. Biré.)
[35] Aussi des poètes, voire de plus illustres, n’ont-ils pas hésité à faire ange du féminin:
C’est une femme aussi, c’est une ange charmante.
(Alfred de Vigny, Éloa, Poésies complètes, p. 14; Charpentier, 1882.)
[36] Cf. Victor Hugo, La Pitié suprême, XIV, p. 150 (Hetzel-Quantin, s. d. in-16):
Être le guérisseur, le bon Samaritain
Des monstres, ces martyrs ténébreux du destin,
Etc., etc.
[37] Une curieuse et amusante aventure arriva à Marmontel, précisément comme il briguait les suffrages académiques. «... Désirant avec ardeur une place à l’Académie, Marmontel prit le parti de louer, dans sa Poétique française, presque tous les académiciens vivants dont il comptait se concilier la bienveillance et obtenir la voix pour la première place vacante. Il se fit presque autant de tracasseries qu’il avait fait d’éloges; personne ne se trouva assez loué, ni loué à son gré. Il avait cité de Moncrif un couplet avec les plus grands éloges; Moncrif prétendit qu’il fallait citer et transcrire la chanson tout entière ou ne point s’en mêler.» (Correspondance de Grimm, t. I, p. 337-338; Buisson, 1812.)
[38] Cf. Chateaubriand (Génie du christianisme, VI, 5; t. I, p. 169; Didot, 1865): «L’enfant naît, la mamelle est pleine; la bouche du jeune convive n’est point armée, de peur de blesser la coupe du banquet maternel.»
[39] Sur les mystifications commises par Charles Nodier, voir mon ouvrage Mystifications littéraires et théâtrales, p. 89 et suiv. (Fontemoing, 1913).
[40] Nous avons vu aussi (p. 94 et 135) le même système préconisé plus ou moins sérieusement par Théophile Gautier: «Il faut, dans chaque page, une dizaine de mots que le bourgeois ne comprend pas», etc. Et (déjà cité p. 136) Destouches (La Fausse Agnès, I, 2): «La baronne. Cet endroit-ci n’est pas clair, mais c’est ce qui en fait la beauté. — Le baron. Assurément. Quand je lis quelque chose, et que je ne l’entends pas, je suis toujours dans l’admiration.» Cf. aussi Montaigne, le cardinal de Retz, La Bruyère, etc., cités par nous p. 135-136.
[41] J.-J. Rousseau, nous l’avons vu (Cf. ci-dessus, p. 172), a encore été bien plus loin, lui: «... Moi qui me suis cru toujours et qui me crois encore, à tout prendre, le meilleur des hommes...» (Les Confessions, II, x; t. VI, p. 85; Hachette, 1864.)
[42] La même anecdote a été appliquée à une autre Sophie, cuisinière du docteur Véron.
[43] Barbey aimait ces verdicts draconiens et sans appel. De même qu’il voulait condamner Flaubert à ne plus écrire, il déclarait qu’«à dater des Contemplations, M. Hugo n’existe plus». C’est fini de lui. (Le Larousse mensuel, octobre 1912, p. 539.) Voir aussi Barbey d’Aurevilly, Dernières Polémiques, Un Poète prussien, p. 43-48; Savine, 1891.
[44] Cette phrase comique a été souvent citée, mais parfois altérée et amplifiée. Poitevin (La Grammaire, les Écrivains et les Typographes, p. 225) la donne ainsi: «Le pépin du mécontentement n’allait pas tarder à pousser dans son cœur.» Hippolyte Babou (La Vérité sur le cas de M. Champfleury, p. 31) ajoute tout un membre de phrase qui rend la métaphore plus grotesque: «Le pépin du mécontentement devait produire un arbre touffu sous lequel s’abriteraient les mauvaises langues.»
[45] Voici le texte complet de cette phrase, avec sa ponctuation, tel qu’on le trouve dans la première édition de Bouvard et Pécuchet, établie d’après le manuscrit même de Flaubert. Ce texte a été modifié dans des éditions suivantes: «Mais le plus beau, c’était dans l’embrasure de la fenêtre, une statue de saint Pierre! Sa main droite couverte d’un gant serrait la clef du Paradis. De couleur vert-pomme, sa chasuble, que des fleurs de lis agrémentaient, était bleu-ciel, et sa tiare très jaune, pointue comme une pagode.»
[46] Girault-Duvivier, qui est loin d’avoir l’esprit large, tolérant, éclairé et judicieux de Littré, condamne, en effet et bien entendu, et l’Académie pareillement, les locutions de Flaubert citées ci-dessus: cf. la Grammaire des Grammaires, principalement les «Remarques détachées», t. II, p. 1051-1291 (Cotelle, 1859).
[47] Berquin (1749-1791) commet, lui, une autre erreur, à propos des rossignols: il en fait chanter deux ensemble et tout près l’un de l’autre, ce qui n’a jamais lieu. «Deux rossignols allèrent se percher près de là, sur le sommet d’un berceau de verdure, pour la réjouir (une jeune fille) de leurs chansons de l’aurore.» (L’Ami des enfants, Clémentine et Madelon, p. 28; Lehuby, s. d.)
[48] A propos de Gustave Flaubert, on lit, dans le Journal des Goncourt (t. V, p. 79), que le futur auteur de Madame Bovary avait composé, étant encore au collège, un drame sur Louis XI, où un malheureux s’exprimait en ces termes: «Monseigneur, nous sommes obligés d’assaisonner nos légumes avec le sel de nos larmes.»
[49] Jean-Jacques Rousseau, né à Genève et dont le français n’était pas très pur, allait plus loin encore et englobait toute la province dans cet ostracisme: «Il y a une certaine pureté de goût et une correction de style qu’on n’atteint jamais dans la province, quelque effort qu’on fasse pour cela.» (Lettre à M. Vernes, 4 avril 1757: Œuvres complètes de J.-J. Rousseau, t. VII, p. 67; Hachette, 1864.) Mais ce qui était vrai du temps de Rousseau ne l’est plus, ou du moins plus autant, de nos jours.
[50] Camille Lemonnier, dans la préface de Héros et Pantins (p. xiii-xiv), apprécie en ces termes le labeur littéraire de Léon Cladel: «... Il va jusqu’à épuiser l’artifice des plus subtiles rhétoriques, en variant incessamment la tournure des phrases et le choix des mots, en ne permettant pas qu’un même vocable reparaisse dans tout le cours d’un livre, et d’autres fois en prohibant même, en tête des alinéas, le retour d’une même lettre initiale. C’est encore là le secret de ces terribles phrases kilométriques dont se gaussent fort impertinemment des stylistes sans haleine, las et pantois au bout de dix mots, et qui, enchevêtrées d’incidentes, avec des circonlocutions nombreuses et des arabesques emmêlées comme les sinuosités d’un labyrinthe, rampent à la façon des ronces ou se dressent à la façon des chênes, touffue végétation du style, où chantent, et sifflent, et chuchotent les idées, ces oiseaux de l’esprit.» On pourrait d’ailleurs dire de Léon Cladel ce que lui-même a dit de Baudelaire, dans la dédicace de La Fête votive (p. 6; Lemerre, 1882): «Un mot le préoccupait au point de l’empêcher de dormir pendant huit nuits consécutives, une phrase le persécutait un mois durant, telle page des années; et c’est ainsi qu’au prix des plus cruels sacrifices, il forma... ligne à ligne sa prose».
[51] Glissons, en bas de page, cette savoureuse anecdote relative à l’illustre créateur de Rocambole. Ponson du Terrail fit un jour, «contre Aurélien Scholl, le pari que, dans toutes les petites villes, dans tous les villages où ils iraient ensemble, ils ne trouveraient personne qui n’eût lu ses ouvrages, tandis qu’à peine un petit nombre de lettrés connaîtraient le nom de Flaubert». Et Ponson gagna le pari. (Paul Stapfer, Des Réputations littéraires, t. II, p. 249.)
[52] Bien des anecdotes et plaisanteries ont été contées à propos de la Vénus de Milo; en voici quelques-unes:
Un concierge déménage une Vénus de Milo en plâtre et la brise. Fureur du locataire. «Il n’y a pas tant de mal, riposte le concierge: elle avait déjà les bras cassés». (Le National, 29 janvier 1885.)
A l’hôtel Drouot, un garçon novice pose sur la table une terre cuite représentant la fameuse Vénus de Milo, et, s’essuyant les mains, il dit sans malice au public: «Si l’on trouve les bras, on les donnera.» (L’Opinion, 13 octobre 1885.)
Un habitant de San Francisco avait commandé à Paris une statue de la Vénus de Milo. Elle lui fut expédiée. Le destinataire a intenté un procès à la Central Pacific Company sous le prétexte que la Vénus lui était parvenue sans bras, c’est-à-dire mutilée. Le plus fort, dit-on, c’est que le juge a condamné la Compagnie à payer une indemnité à ce destinataire. (Le Radical, 19 mars 1887.)
Note de transcription
End of the Project Gutenberg EBook of Récréations littéraires, by Albert Cim
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK RÉCRÉATIONS LITTÉRAIRES ***
***** This file should be named 50926-h.htm or 50926-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/0/9/2/50926/
Produced by Ramon Pajares Box, Laurent Vogel and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.