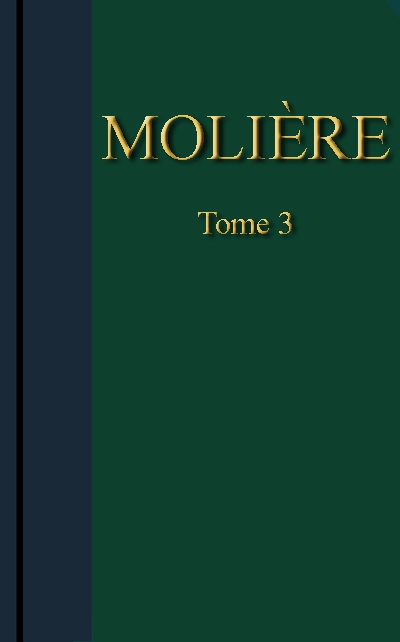
Project Gutenberg's Molière, by Jean-Baptiste Poquelin and Philarète Chasles
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Molière
Oeuvres complètes de J.-B. Poquelin
Author: Jean-Baptiste Poquelin
Philarète Chasles
Release Date: October 10, 2015 [EBook #50173]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MOLIÈRE ***
Produced by Claudine Corbasson and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by The
Internet Archive/Canadian Libraries)
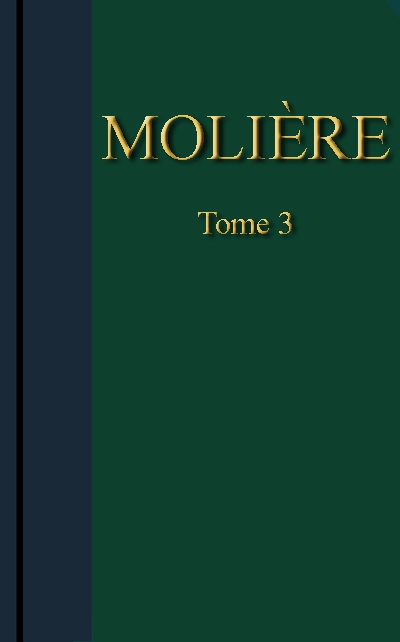
NOUVELLE ÉDITION
PAR
M. PHILARÈTE CHASLES
PROFESSEUR AU COLLÉGE DE FRANCE
«Chaque homme de plus qui sait lire est un lecteur de plus pour Molière».
Sainte-Beuve.
TOME TROISIÈME

PARIS
CALMANN LÉVY, ÉDITEUR
ANCIENNE MAISON MICHEL LÉVY FRÈRES
3, RUE AUBER, 3
1887
Droits de reproduction et de traduction réservés
E. Colin.—Imprimerie de Lagny.
TROISIÈME ÉPOQUE
1664-1666
DRAME PHILOSOPHIQUE ET SATIRIQUE
| XV. | 1664. | TARTUFFE[1]. |
| XVI. | 1665. | DON JUAN, OU LE FESTIN DE PIERRE. |
| XVII. | 1665. | L'AMOUR MÉDECIN. |
| XVIII. | 1666. | LE MISANTHROPE. |
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS, A PARIS, SUR LE THÉATRE DU PALAIS-ROYAL, LE 15 FÉVRIER 1665.
Plus d'un déboire avait accueilli Molière à la cour, et sa vie domestique n'était pas de nature à le consoler. Depuis environ deux années il avait travaillé à peu près exclusivement pour les plaisirs du monarque et sacrifié à cette mission, qui était pour lui une sauvegarde, une partie 4 tragique qu'aujourd'hui. Selon le moine Tellez (et cette idée règne dans toutes ses pièces), qui trompe les femmes est nécessairement puni dans ce monde et damné dans l'autre. Il ne pardonne pas à cet abus de la puissance, de l'esprit de la richesse. Quant à ses victimes, ce sont de vraies Espagnoles, et non les tendres Allemandes de Mozart; elles ouvrent au séducteur un enfer anticipé, en attendant l'autre enfer; terribles personnes auxquelles nul don Juan n'estimerait prudent de se jouer.
Ce beau sujet, qui non-seulement a couru tous les théâtres de l'Europe, mais qui, sous la main de Molière et de Byron, a créé un nouveau type moderne, le «don Juan,» et enrichi d'un personnage symbolique la vaste galerie qui contient déjà Lovelace, Panurge, Tartuffe, Falstaff et Patelin, a inspiré à Tirso des scènes admirables et plus d'un trait de génie. Lorsque don Juan, un flambeau à la main, veut reconduire la statue et l'accompagner dans les ténèbres:
«Ne m'éclaire pas, dit le mort! Je suis en état de grâce.»
Le dénoûment de l'œuvre espagnole, où se joue une libre et puissante imagination est d'un effet dramatique extraordinaire et peut-être sans égal dans les annales dramatiques. Poursuivi par les familles offensées de Séville, Tenorio se réfugie dans la cathédrale. C'est là qu'il trouve le tombeau et la statue de celui qu'il a tué. Il soupe dans l'église, en face de l'autel, sous les grandes voûtes gothiques, parmi les statues des saints et pendant la nuit. Là le Gracioso, type du Sganarelle de Molière et du Leporello de Mozart, met la table par ordre du «moqueur» son maître. Du haut des degrés de marbre blanc, sous la clarté de la lune perçant les vitraux, le vieux gentilhomme mort descend pour répondre à la railleuse invitation du mauvais sujet entre deux vins; car, nous l'avons dit, le don Juan de Tellez n'est qu'un débauché ingénu, poursuivi 5 par la justice, forcé de souper quelque part, invité d'ailleurs par la statue; s'il fait dresser sa table dans l'église où il s'est réfugié, rien de plus naturel, rien qui ressorte mieux du point de vue catholique; rien de plus dramatique et de plus profond que cette frivolité enivrée qui raille Dieu, éveille les cadavres, appelle son propre châtiment, et à laquelle répondent, du fond des tombeaux, le sérieux de la mort inévitable et de la vie éternelle.
Le côté populaire de cette création, qui appartient réellement au prieur de la Merci, s'empara tellement des imaginations méridionales en Espagne et en Italie, que de mauvaises imitations, d'abord italiennes, puis françaises, toutes ornées de l'inévitable statue du commandeur et de son cheval, la plupart écrites d'un style misérable et surchargées de grotesques lazzi, eurent la vogue à travers toute l'Europe. El Combibado di piedra, le second titre du drame de Tirso, transformé par quelque Italien ignorant en «Festin de Pierre,» occupa l'attention publique de 1650 à 1660. La vraie traduction du titre espagnol est «le Convive-statue,» qui devint le Festin de Pierre, «Pietro,» soit que le premier arrangeur ne sût pas l'espagnol ou qu'il fît allusion à don Pierre, nom du commandeur assassiné. Dans toutes les hypothèses, il ne s'agirait pas «du Festin de Pierre,» puisque tout festin appartient à la fois à celui qui le donne et à celui qui le reçoit.
A Lyon, en 1658, le comédien Dorimont fit représenter son «Festin de Pierre,» calqué sur la farce italienne et non sur l'original espagnol, œuvre très-bien accueillie malgré son peu de mérite et qui fut imprimée dans la même ville, l'année suivante. Un autre comédien, de Villiers, qui se piquait de littérature, et qui, à ce titre, se range parmi les ennemis de Molière, trouvant que l'homme et le cheval, il s'exprime ainsi dans sa préface, faisaient de l'argent, et que l'argent fait subsister le théâtre, 6 prit la peine de versifier de nouveau le canevas italien et jeta dans son œuvre un peu plus de verve que Dorimont, et infiniment plus de mauvais goût. Voici comment de Villiers reproduit la scène comique inventée par le moine de la Merci, scène burlesquement développée par l'imitateur italien, et dont Mozart a fait un chef-d'œuvre d'élégance et de gaieté musicale. Pour consoler une nouvelle victime de son maître, le valet de don Juan déroule à ses yeux la liste de ses victimes antérieures (mille e tre):
Tel était le style des ennemis de Molière. Le grand comique, qui sans doute n'a pas lu Tirso, s'empare du sujet et du personnage; après avoir commencé, on sait avec quel succès, son attaque contre le savoir sans pensée, la politesse sans simplicité, la moralité bourgeoise sans vérité et la dévotion sans piété, il ouvre une nouvelle campagne contre la noblesse de race sans vertu.
Comme il n'a pu faire jouer son Tartuffe, dont les trois premiers actes ont effrayé le roi, il crée un Tartuffe courtisan, plus redoutable encore, car celui-ci n'a rien de repoussant et de hideux; il est le type suprême de l'élégance et de la grâce. Molière laisse sur le second plan les femmes, dont la passion ardente occupe chez Tirso le devant de la scène, et laisse éclater la triste pensée que nous avons vue poindre dans l'Étourdi, l'honnête homme malheureux en ce monde malgré son honneur; le favori de la fortune et du sort bravant tout, grâce à la forme extérieure et à l'hypocrisie. Notre gentilhomme, qui ne croit à rien, triompherait de tout si Dieu ne se manifestait par un coup de foudre: c'est l'idée même de Machiavel.
Tous les sévères et tous les honnêtes, mais aussi tous les médiocres, s'insurgèrent à la fois, depuis le prince de Conti devenu janséniste, jusqu'à Saint-Évremond, le libre-penseur. Pour les uns, c'était détruire la base chrétienne de la morale; pour les autres, c'était révéler trop hardiment la plaie secrète et incurable de l'humanité. Dès la seconde représentation il fallut supprimer cette effrayante «scène du pauvre,» qui résume, par le contraste du scélérat triomphant et de l'honnête homme sans pain et sans asile, ce que l'on peut alléguer de plus fort et de plus douloureux sur les sociétés humaines. Non-seulement les dévots modérés, mais les gens du monde, furent tellement épouvantés de la lumière lugubre jetée par cette œuvre rapide et profonde, qu'il fallut la retirer de la scène après treize représentations. On n'osa l'imprimer que dix-huit ans plus tard, en 1682 d'abord, puis en 1683; encore dut-on y faire des «cartons,» c'est-à-dire des altérations qui portèrent spécialement sur la «scène du pauvre.»
Les grands compliments, les embrassades et les vaines paroles des courtisans, l'art de séduire et d'éconduire, les puériles controverses pour et contre le tabac et l'émétique, la bouffonnerie doctorale que Molière n'a jamais 8 épargnée et qu'il attribue ici au valet Sganarelle devenu médecin, complètent le champ d'ironie et de satire que ce grand esprit a parcouru dans son Don Juan, la plus personnelle peut-être de toutes ses œuvres, bien qu'elle prétende être imitée de l'espagnol.
On vit une attaque à la religion là où se trouvait une attaque à l'homme de cour, et le goût général pour la décence et le noble langage porta les beaux esprits à blâmer Molière d'avoir écrit son œuvre en prose, surtout d'avoir fait parler sur la scène de vrais paysans comme les paysans parlent. Disons-le à l'honneur de Louis XIV: Molière, en butte à une meute d'ennemis furieux et assiégé de toutes parts, reçut, après Don Juan, le titre de comédien du roi; sa pension fut doublée.
| PERSONNAGES. | ACTEURS. | ||
| DON JUAN, fils de don Louis. | La Grange. | ||
| SGANARELLE. | Molière. | ||
| ELVIRE, femme de don Juan. | Mlle du Parc. | ||
| GUSMAN, écuyer d'Elvire. | |||
| DON CARLOS, | } | frères d'Elvire. | |
| DON ALONSE, | |||
| DON LOUIS, père de don Juan. | Béjart. | ||
| FRANCISQUE, pauvre. | |||
| CHARLOTTE, | } | paysannes. | Mlle Molière. |
| MATHURINE, | Mlle de Brie. | ||
| PIERROT, paysan. | Hubert. | ||
| La Statue du Commandeur. | |||
| LA VIOLETTE, | } | valets de don Juan. | |
| RAGOTIN, | |||
| 9M. DIMANCHE, marchand. | Du Croisy. | ||
| LA RAMÉE, spadassin. | De Brie. | ||
| Suite de don Juan. | |||
| Suite de don Carlos et de don Alonse, frères. | |||
| Un Spectre. | |||
| La scène est en Sicile. | |||
ACTE PREMIER
Un palais.
SCÈNE I.—SGANARELLE, GUSMAN.
SGANARELLE, tenant une tabatière.
Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac: c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non-seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve? On n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens; tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que done Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruit, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là.
GUSMAN.
Et la raison encore? Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui 10 peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus, et t'a-t-il dit qu'il eût pour nous quelque froideur qui l'ait obligé à partir?
SGANARELLE.
Non pas; mais, à vue de pays, je connois à peu près le train des choses, et, sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerois presque que l'affaire va là. Je pourrois peut-être me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières.
GUSMAN.
Quoi! ce départ si peu prévu seroit une infidélité de don Juan? Il pourroit faire cette injure aux chastes feux de done Elvire?
SGANARELLE.
Non, c'est qu'il est jeune encore, et qu'il n'a pas le courage...
GUSMAN.
Un homme de sa qualité feroit une action si lâche!
SGANARELLE.
Eh! oui, sa qualité! La raison en est belle; et c'est par là qu'il s'empêcheroit des choses!
GUSMAN.
Mais les saints nœuds du mariage le tiennent engagé.
SGANARELLE.
Eh! mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est don Juan.
GUSMAN.
Je ne sais pas, de vrai, quel homme il peut être, s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie; et je ne comprends point comme, après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressans, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de sermens réitérés, tant de transports enfin, et tant d'emportemens qu'il a fait paroître, jusqu'à forcer, dans sa passion, l'obstacle sacré d'un couvent, pour mettre done Elvire en sa puissance; je ne comprends pas, dis-je, comme, après tout cela, il auroit le cœur de pouvoir manquer à sa parole.
SGANARELLE.
Je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi; et, si tu 11 connoissois le pèlerin, tu trouverois la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentimens pour done Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que, par son ordre, je partis avant lui; et, depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu; mais, par précaution, je t'apprends, inter nos, que tu vois, en don Juan mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un Turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute; un pourceau d'Épicure, un vrai Sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire, et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse; crois qu'il auroit plus fait pour sa passion, et qu'avec elle il auroit encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter; il ne se sert point d'autres piéges pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui; et, si je te disois le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce seroit un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours; ce n'est là qu'une ébauche du personnage, et, pour en achever le portrait, il faudroit bien d'autres coups de pinceau. Suffit[2] qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelque jour; qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreurs, que je souhaiterois qu'il fût déjà je ne sais où; mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose; il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en aie; la crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentimens, et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais, séparons-nous. Écoute au moins; je t'ai fait cette confidence avec franchise et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche; mais, s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirois hautement que tu aurois menti.
SCÈNE II.—DON JUAN, SGANARELLE.
DON JUAN.
Quel homme te parloit là? Il a bien de l'air, ce me semble, du bon Gusman de done Elvire?
SGANARELLE.
C'est quelque chose aussi à peu près de cela.
DON JUAN.
Quoi! c'est lui?
SGANARELLE.
Lui-même.
DON JUAN.
Et depuis quand est-il en cette ville?
SGANARELLE.
D'hier au soir.
DON JUAN.
Et quel sujet l'amène?
SGANARELLE.
Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter.
DON JUAN.
Notre départ, sans doute?
SGANARELLE.
Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandoit le sujet.
DON JUAN.
Et quelle réponse as-tu faite?
SGANARELLE.
Que vous ne m'en aviez rien dit.
DON JUAN.
Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire?
SGANARELLE.
Moi! Je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête.
DON JUAN.
Tu le crois?
SGANARELLE.
Oui.
DON JUAN.
Ma foi, tu ne te trompes pas, et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée.
SGANARELLE.
Eh! mon Dieu! je sais mon don Juan sur le bout du doigt, et connois votre cœur pour le plus grand coureur du monde; il se plaît à se promener de liens en liens, et n'aime guère à demeurer en place.
DON JUAN.
Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte?
SGANARELLE.
Eh! monsieur...
DON JUAN.
Quoi? Parle.
SGANARELLE.
Assurément que vous avez raison si vous le voulez; on ne peut pas aller là contre. Mais, si vous ne le vouliez pas, ce seroit peut-être une autre affaire.
DON JUAN.
Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentimens.
SGANARELLE.
En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites.
DON JUAN.
Quoi! tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'ait plus d'yeux pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux! Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules; toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la 14 trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont[3] elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres; je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable; et, dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avois dix mille, je les donnerois tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire, par cent hommages, le cœur d'une jeune beauté; à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait; à combattre, par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes; à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose; à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais, lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter; tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayans d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne; et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérans, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs; je me sens un cœur à aimer toute la terre, et, comme Alexandre, je souhaiterois qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.
SGANARELLE.
Vertu de ma vie! comme vous débitez! Il semble que vous ayez appris cela par cœur, et vous parlez tout comme un livre.
DON JUAN.
Qu'as-tu à dire là-dessus?
SGANARELLE.
Ma foi, j'ai à dire... Je ne sais que dire; car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous ayez raison; et cependant il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire; une autre fois, je mettrai mes raisonnemens par écrit, pour disputer avec vous.
DON JUAN.
Tu feras bien.
SGANARELLE.
Mais, monsieur, cela seroit-il de la permission que vous m'avez donnée, si je vous disois que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez?
DON JUAN.
Comment! quelle vie est-ce que je mène?
SGANARELLE.
Fort bonne. Mais, par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites!
DON JUAN.
Y a-t-il rien de plus agréable?
SGANARELLE.
Il est vrai. Je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderois assez, moi, s'il n'y avoit point de mal; mais, monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré, et...
DON JUAN.
Va, va, c'est une affaire entre le ciel et moi, et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine.
SGANARELLE.
Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin.
DON JUAN.
Holà, maître sot! Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances.
SGANARELLE.
Je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde! Vous savez ce que vous faites, vous; et, si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons: mais il y a de certains petits impertinens 16 dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien, et, si j'avois un maître comme cela, je lui dirois fort nettement, le regardant en face: Osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel, et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes? C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes (je parle au maître que j'ai dit), c'est bien à vous à vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes révèrent! Pensez-vous que, pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré, et des rubans couleur de feu (ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre), pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis, et qu'on n'ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que...
DON JUAN.
Paix!
SGANARELLE.
De quoi est-il question?
DON JUAN.
Il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur, et qu'entraîné par ses appas, je l'ai suivie jusqu'en cette ville.
SGANARELLE.
Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a six mois?
DON JUAN.
Et pourquoi craindre? ne l'ai-je pas bien tué?
SGANARELLE.
Fort bien, le mieux du monde; et il auroit tort de se plaindre.
DON JUAN.
J'ai eu ma grâce de cette affaire.
SGANARELLE.
Oui; mais cette grâce n'éteint pas peut-être le ressentiment des parens et des amis, et...
DON JUAN.
Ah! n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle y vient épouser; et le hasard me fit voir ce couple d'amans trois ou quatre jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu deux personnes être si contentes l'une de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion; j'en fus frappé au cœur, et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble; le dépit alluma mes désirs, et je me figurai un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenoit offensée; mais jusques ici tous mes efforts ont été inutiles, et j'ai recours au dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler[4] sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans t'en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour, et j'ai une petite barque et des gens, avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle.
SGANARELLE.
Ah! monsieur...
DON JUAN.
Hein?
SGANARELLE.
C'est fort bien fait à vous, et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien tel en ce monde que de se contenter.
DON JUAN.
Prépare-toi donc à venir avec moi, et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes, afin que... (Apercevant done Elvire.) Ah! rencontre fâcheuse! Traître! tu ne m'avois pas dit qu'elle étoit ici elle-même.
SGANARELLE.
Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé.
DON JUAN.
Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit, et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne?
SCÈNE III.—DONE ELVIRE, DON JUAN, SGANARELLE.
DONE ELVIRE.
Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnoître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté?
DON JUAN.
Madame, je vous avoue que je suis surpris, et que je ne vous attendois pas ici.
DONE ELVIRE.
Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas; et vous êtes surpris, à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérois; et la manière dont vous le paroissez me persuade pleinement ce que je refusois de croire. J'admire ma simplicité, et la foiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmoient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même, et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons, pour excuser[5] à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyoit en vous; et je me suis forgé exprès cent sujets légitimes d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusoit. Mes justes soupçons chaque jour avoient beau me parler, j'en rejetois la voix qui vous rendoit criminel à mes yeux, et j'écoutois avec plaisir mille chimères ridicules, qui vous peignoient innocent à mon cœur; mais enfin cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçue m'apprend bien plus de choses que je ne voudrois en savoir. Je serois bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier.
DON JUAN.
Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti.
SGANARELLE, bas, à don Juan.
Moi, monsieur. Je n'en sais rien, s'il vous plaît.
DONE ELVIRE.
Eh bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ses raisons.
DON JUAN, faisant signe à Sganarelle d'approcher.
Allons, parle donc à madame.
SGANARELLE, bas, à don Juan.
Que voulez-vous que je dise?
DONE ELVIRE.
Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt.
DON JUAN.
Tu ne répondras pas?
SGANARELLE, bas, à don Juan.
Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur.
DON JUAN.
Veux-tu répondre, te dis-je!
SGANARELLE.
Madame...
DONE ELVIRE.
Quoi?
SGANARELLE, se tournant vers son maître.
Monsieur...
DON JUAN, en le menaçant.
Si...
SGANARELLE.
Madame, les conquérans, Alexandre et les autres mondes, sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire.
DONE ELVIRE.
Vous plaît-il, don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères?
DON JUAN.
Madame, à vous dire la vérité...
DONE ELVIRE.
Ah! que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses! J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne 20 me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis; qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assurée que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible; qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme? Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes.
DON JUAN.
Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisque enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir; non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisois. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobée à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageoient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'étoit qu'un adultère déguisé, qu'il nous attireroit quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin je devois tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée, et que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras; que par...
DONE ELVIRE.
Ah! scélérat, c'est maintenant que je te connois tout entier; et, pour mon malheur, je te connois lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connoissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera 21 pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie.
DON JUAN.
Sganarelle, le ciel!
SGANARELLE.
Vraiment oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres!
DON JUAN.
Madame...
DONE ELVIRE.
Il suffit. Je n'en veux pas ouir davantage, et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte; et, sur de tels sujets, un noble cœur, au premier mot, doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures; non, non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais; et, si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée!
SCÈNE IV.—DON JUAN, SGANARELLE.
SGANARELLE, à part.
Si le remords le pouvoit prendre!
DON JUAN, après un moment de réflexion.
Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse.
SGANARELLE, seul.
Ah! quel abominable maître me vois-je obligé de servir!
ACTE II
Une campagne au bord de la mer.
SCÈNE I.—CHARLOTTE, PIERROT.
CHARLOTTE.
Notre dinse[6], Piarrot, tu t'es trouvé là bien à point!
PIERROT.
Parguienne, il ne s'en est pas fallu l'époisseur d'une éplingle qu'il ne s'ayant nayés tous deux.
CHARLOTTE.
C'est donc le coup de vent d'à matin qui les avoit renvarsés dans la mar?
PIERROT.
Aga[7], quien, Charlotte, je m'en vas te conter tout fin drait comme cela est venu; car, comme dit l'autre, je les ai le premier avisés, avisés le premier je les ai. Enfin donc j'étions sur le bord de la mar, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tarre que je nous jesquions à la tête; car, comme tu sais bian, le gros Lucas aime à batifoler, et moi, par fouas, je batifole, je batifole itou. En batifolant donc, pisque batifoler y a, j'ai aparçu de tout loin queuque chose qui grouilloit dans gliau, et qui venoit comme envars nous par secousse. Je voyois cela fixiblement, et pis tout d'un coup je voyois que je ne voyois plus rian. Eh! Lucas, ç'ai-je fait, je pense que v'là des hommes qui nageant là-bas. Voire, ce m'a-t-il fait, t'as été au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble[8]. Palsanguienne, ç'ai-je fait, je n'ai point la vue trouble, ce sont des hommes. Point du tout, ce m'a-t-il fait, t'as la barlue. Veux-tu gager, ç'ai-je fait, que je n'ai point la barlue, ç'ai-je fait, et que ce sont deux hommes, ç'ai-je fait, qui nageant droit ici, ç'ai-je fait? Morguienne, ce m'a-t-il fait, je gage que non. Oh ça! ç'ai-je fait, veux-tu gager dix sous que si? Je le veux bian, ce m'a-t-il fait, et, pour le montrer, v'là argent au jeu, ce m'a-t-il fait. Moi, je n'ai point été ni fou, ni étourdi; j'ai bravement bouté à tarre quatre pièces tapées, et cinq sous en doubles, jerniguienne, aussi hardiment que si j'avois avalé un varre de vin; car je sis hasardeux, moi, et je vas à la débandade. Je savois bian ce que je faisois pourtant. Queuque gniais! Enfin donc, je n'avons pas plutôt eu gagé, que j'avons vu les deux hommes tout à plain, qui nous faisiant signe de les aller querir; et moi de tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, ç'ai-je dit, tu vois 23 bian qu'ils nous appelont; allons vite à leu secours. Non, ce m'a-t-il dit, ils m'ont fait perdre. Oh! donc, tanquia qu'à la parfin, pour le faire court, je l'ai tant sarmonné, que je nous sommes boutés dans une barque, et pis j'avons tant fait cahin caha, que je les avons tirés de gliau, et pis je les avons menés cheux nous auprès du feu, et pis ils se sant dépouillés tout nus pour se sécher, et pis il y en est venu encore deux de la même bande, qui s'équiant sauvés tout seuls; et pis Mathurine est arrivée là, à qui l'en a fait les doux yeux. V'là justement Charlotte, comme tout ça s'est fait.
CHARLOTTE.
Ne m'as-tu pas dit, Piarrot, qu'il y en a un qu'est bien pu mieux fait que les autres?
PIERROT.
Oui, c'est le maître. Il faut que ce soit queuque gros, gros monsieu, car il a du dor à son habit tout depis le haut jusqu'en bas; et ceux qui le servont sont des monsieux eux-mêmes; et stapandant, tout gros monsieu qu'il est, il seroit par ma fiqué[9] nayé si je n'aviomme été là.
CHARLOTTE.
Ardez[10] un peu!
PIERROT.
Oh! parguienne, sans nous il en avoit pour sa maine de fèves[11].
CHARLOTTE.
Est-il encore cheux toi tout nu, Piarrot?
PIERROT.
Nannain, ils l'avont rhabillé tout devant nous. Mon Guieu, je n'en avois jamais vu s'habiller. Que d'histoire et d'engingorniaux[12] boutont[13] ces messieux-là les courtisans! Je me pardrois là dedans, pour moi; et j'étois tout ébobi de voir ça. Quien, Charlotte, ils avont des cheveux qui ne tenont point à leu tête; et ils boutont ça, après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ant des chemises qui ant des 24 manches où j'entrerions tout brandis[14], toi et moi. En glieu d'haut-de-chausse, ils portont un garde-robe[15] aussi large que d'ici à Pâques: en glieu de pourpoint de petites brassières, qui ne leu venont pas jusqu'au brichet[16]; et, en glieu de rabat, un grand mouchoir de cou à réziau, aveuc quatre grosses houppes de linge qui leu pendont sur l'estomaque. Ils avont itou d'autres petits rabats au bout des bras, et de grands entonnois de passement aux jambes, et, parmi tout ça, tant de rubans, tant de rubans que c'est une vraie piquié. Ignia pas jusqu'aux souliers qui n'en soyont farcis tout depis un bout jusqu'à l'autre; et ils sont faits d'une façon que je me romprois le cou aveuc.
CHARLOTTE.
Par ma fi, Piarrot, il faut que j'aille voir un peu ça.
PIERROT.
Oh! acoute un peu auparavant, Charlotte. J'ai queuque autre chose à te dire, moi.
CHARLOTTE.
Eh bian, dis, qu'est-ce que c'est?
PIERROT.
Vois-tu, Charlotte? il faut, comme dit l'autre, que je débonde mon cœur. Je t'aime, tu le sais bian, et je sommes pour être mariés ensemble; mais, marguienne, je ne suis point satisfait de toi.
CHARLOTTE.
Quement, qu'est-ce que c'est donc qu'iglia?
PIERROT.
Iglia que tu me chagraines l'esprit, franchement.
CHARLOTTE.
Et quement donc?
PIERROT.
Tétiguienne, tu ne m'aimes point.
CHARLOTTE.
Ah! ah! n'est-ce que çà?
PIERROT.
Oui, ce n'est que ça, et c'est bian assez.
CHARLOTTE.
Mon Guieu, Piarrot, tu me viens toujou dire la même chose.
PIERROT.
Je te dis toujou la même chose, parce que c'est toujou la même chose; et, si ce n'étoit pas toujou la même chose, je ne te dirois pas toujou la même chose.
CHARLOTTE.
Mais qu'est-ce qu'il te faut? que veux-tu?
PIERROT.
Jerniguienne! je veux que tu m'aimes.
CHARLOTTE.
Est-ce que je ne t'aime pas?
PIERROT.
Non, tu ne m'aimes pas; et si[17] je fais tout ce que je pis pour ça. Je t'achète, sans reproche, des rubans à tous les marciers qui passont; je me romps le cou à t'aller dénicher des marles; je fais jouer pour toi les vielleux quand ce vient ta fête, et tout ça comme si je me frappois la tête contre un mur. Vois-tu, ça n'est ni biau ni honnête de n'aimer pas les gens qui nous aimont.
CHARLOTTE.
Mais, mon Guieu, je t'aime aussi.
PIERROT.
Oui, tu m'aimes d'une belle dégaîne!
CHARLOTTE.
Quement veux-tu donc qu'on fasse?
PIERROT.
Je veux que l'en fasse comme l'en fait, quand l'en aime comme il faut.
CHARLOTTE.
Ne t'aimé-je pas aussi comme il faut?
PIERROT.
Non. Quand ça est, ça se voit, et l'en fait mille petites singeries aux parsonnes quand on les aime du bon cœur. Regarde la grosse Thomasse, comme alle est assottée du 26 jeune Robain; alle est toujou autour de li à l'agacer, et ne le laisse jamais en repos. Toujou al li fait queuque niche, ou li baille queuque taloche en passant; et l'autre jour qu'il étoit assis sur un escabiau, al fut le tirer de dessous li, et le fit choir tout de son long par tarre. Jarni, v'là où l'en voit les gens qui aimont; mais toi tu ne me dis jamais mot, t'es toujou là comme eune vraie souche de bois; et je passerois vingt fois devant toi, que tu ne te grouillerois pas pour me bailler le moindre coup, ou me dire la moindre chose. Ventreguienne! ça n'est pas bian, après tout; et t'es trop froide pour les gens.
CHARLOTTE.
Que veux-tu que j'y fasse? C'est mon himeur, et je ne me pis refondre.
PIERROT.
Ignia himeur qui quienne. Quand on a de l'amiquié pour les parsonnes, l'on en baille toujou queuque petite signifiance.
CHARLOTTE.
Enfin, je t'aime tout autant que je pis; et, si tu n'es pas content de ça, tu n'as qu'à en aimer queuque autre.
PIERROT.
Eh bian, v'là pas mon compte? Tétigué, si tu m'aimois, me dirois-tu ça?
CHARLOTTE.
Pourquoi me viens-tu aussi tarabuster l'esprit?
PIERROT.
Morgué! queu mal te fais-je? Je ne te demande qu'un peu d'amiquié.
CHARLOTTE.
Eh bien, laisse faire aussi, et ne me presse point tant. Peut-être que ça viendra tout d'un coup sans y songer.
PIERROT.
Touche donc là, Charlotte.
CHARLOTTE, donnant sa main.
Eh bien, quien.
PIERROT.
Promets-moi donc que tu tâcheras de m'aimer davantage.
CHARLOTTE.
J'y ferai tout ce que je pourrai; mais il faut que ça vienne de lui-même, Piarrot, est-ce là ce monsieu?
PIERROT.
Oui, le v'là.
CHARLOTTE.
Ah! mon Guieu, qu'il est genti, et que ç'auroit été dommage qu'il eût été nayé!
PIERROT.
Je revians tout à l'heure; je m'en vas boire chopaine, pour me rebouter tant soit peu de la fatigue que j'ais eue.
SCÈNE II.—DON JUAN, SGANARELLE, CHARLOTTE, dans le fond de la cour.
DON JUAN.
Nous avons manqué notre coup, Sganarelle, et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait; mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur, et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnoit le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe, et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir[18] longtemps de pousser des soupirs.
SGANARELLE.
Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. A peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours cr... (Don Juan prend un air menaçant.) Paix, coquin que vous êtes! Vous ne savez ce que vous dites, et monsieur sait ce qu'il fait. Allons.
DON JUAN, apercevant Charlotte.
Ah! ah! d'où sort cette autre paysanne, Sganarelle? As-tu rien vu de plus joli? et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre?
SGANARELLE.
Assurément (A part.) Autre pièce nouvelle.
DON JUAN, à Charlotte.
D'où me vient, la belle, une rencontre si agréable? Quoi! dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes?
CHARLOTTE.
Vous voyez, monsieu.
DON JUAN.
Êtes-vous de ce village?
CHARLOTTE.
Oui, monsieu.
DON JUAN.
Et vous y demeurez?...
CHARLOTTE.
Oui, monsieu.
DON JUAN.
Vous vous appelez?
CHARLOTTE.
Charlotte, pour vous servir.
DON JUAN.
Ah! la belle personne! et que ses yeux sont pénétrans!
CHARLOTTE.
Monsieu, vous me rendez toute honteuse.
DON JUAN.
Ah! n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah! que cette taille est jolie! Haussez un peu la tête, de grâce. Ah! que ce visage est mignon! Ouvrez vos yeux entièrement. Ah! qu'ils sont beaux! Que je voie un peu vos dents, je vous prie. Ah! qu'elles sont amoureuses, et ces lèvres appétissantes! Pour moi, je suis ravi, et je n'ai jamais vu une si charmante personne.
CHARLOTTE.
Monsieu, cela vous plaît à dire, et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi.
DON JUAN.
Moi, me railler de vous? Dieu m'en garde! Je vous aime trop pour cela, et c'est du fond du cœur que je vous parle.
CHARLOTTE.
Je vous suis bien obligée, si ça est.
DON JUAN.
Point du tout, vous ne m'êtes point obligée de tout ce que je dis; et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable.
CHARLOTTE.
Monsieu, tout ça est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre.
DON JUAN.
Sganarelle, regarde un peu ses mains.
CHARLOTTE.
Fi! monsieu, elles sont noires comme je ne sais quoi.
DON JUAN.
Ah! que dites-vous là! Elles sont les plus belles du monde; souffrez que je les baise, je vous prie.
CHARLOTTE.
Monsieu, c'est trop d'honneur que vous me faites; et, si j'avois su ça tantôt, je n'aurois pas manqué de les laver avec du son.
DON JUAN.
Eh! dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée, sans doute?
CHARLOTTE.
Non, monsieu; mais je dois bientôt l'être avec Piarrot, le fils de la voisine Simonnette.
DON JUAN.
Quoi! une personne comme vous seroit la femme d'un simple paysan! Non, non, c'est profaner tant de beautés, et vous n'êtes pas née pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune; et le ciel, qui le connoît bien, m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage, et rendre justice à vos charmes: car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur, et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu, et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est 30 bien prompt, sans doute; mais quoi! c'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté, et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'en feroit une autre en six mois.
CHARLOTTE.
Aussi vrai, monsieu, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise, et j'aurois toutes les envies du monde de vous croire; mais on m'a toujou dit qu'il ne faut jamais croire les monsieux, et que vous autres courtisans êtes des enjoleux, qui ne songez qu'à abuser les filles.
DON JUAN.
Je ne suis pas de ces gens-là.
SGANARELLE, à part.
Il n'a garde.
CHARLOTTE.
Voyez-vous, monsieu? il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne; mais j'ai l'honneur en recommandation, et j'aimerois mieux me voir morte que de me voir déshonorée.
DON JUAN.
Moi, j'aurois l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous? Je serois assez lâche pour vous déshonorer? Non, non, j'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur; et, pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt quand vous voudrez; et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne.
SGANARELLE.
Non, non, ne craignez point. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez.
DON JUAN.
Ah! Charlotte, je vois bien que vous ne me connoissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres; et, s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre, et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi; et puis votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes 31 de craintes; vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse; et pour moi, je l'avoue, je me percerois le cœur de mille coups, si j'avois eu la moindre pensée de vous trahir.
CHARLOTTE.
Mon Dieu! je ne sais si vous dites vrai, ou non; mais vous faites que l'on vous croit.
DON JUAN.
Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice assurément, et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas, et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme?
CHARLOTTE.
Oui, pourvu que ma tante le veuille.
DON JUAN.
Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part.
CHARLOTTE.
Mais au moins, monsieu, ne m'allez pas tromper, je vous prie; il y aurait de la conscience à vous, et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi.
DON JUAN.
Comment! il semble que vous doutiez encore de ma sincérité! Voulez-vous que je fasse des sermens épouvantables? Que le ciel...
CHARLOTTE.
Mon Dieu! ne jurez point! je vous crois.
DON JUAN.
Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole.
CHARLOTTE.
Oh! monsieu, attendez que je soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez.
DON JUAN.
Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez! abandonnez-moi seulement votre main, et souffrez que, par mille baisers, je lui exprime le ravissement où je suis...
SCÈNE III.—DON JUAN, SGANARELLE, PIERROT, CHARLOTTE.
PIERROT, poussant don Juan qui baise la main de Charlotte.
Tout doucement, monsieu; tenez-vous, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop, et vous pourriez gagner la puresie.
DON JUAN, repoussant rudement Pierrot.
Qui m'amène cet impertinent?
PIERROT, se mettant entre don Juan et Charlotte.
Je vous dis qu'ous vous tegniez, et qu'ous ne caressiais point nos accordées.
DON JUAN, repoussant encore Pierrot.
Ah! que de bruit!
PIERROT.
Jerniguienne! ce n'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens.
CHARLOTTE, prenant Pierrot par le bras.
Eh! laisse-le faire aussi, Piarrot.
PIERROT.
Quement! que je le laisse faire? Je ne veux pas, moi.
DON JUAN.
Ah!
PIERROT.
Tétiguienne! parce qu'ous êtes monsieu, ous viendrez caresser nos femmes à notre barbe! Allez-v's-en caresser les vôtres!
DON JUAN.
Heu!
PIERROT.
Heu. (Don Juan lui donne un soufflet.) Tétigué! ne me frappez pas. (Autre soufflet.) Oh! jerniguié! (Autre soufflet.) Ventregué! (Autre soufflet.) Palsangué! morguienne! ça n'est pas bian de battre les gens, et ce n'est pas là la récompense de v's avoir sauvé d'être nayé.
CHARLOTTE.
Piarrot! ne te fâche point.
PIERROT.
Je me veux fâcher; et t'es une vilaine, toi, d'endurer qu'on te cajole.
CHARLOTTE.
Oh! Piarrot, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieu veut m'épouser, et tu ne dois pas te bouter en colère.
PIERROT.
Quetement? Jerni! tu m'es promise.
CHARLOTTE.
Ça n'y fait rien, Piarrot. Si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien aise que je devienne madame?
PIERROT.
Jerniguié! non. J'aime mieux te voir crevée que de te voir à un autre.
CHARLOTTE.
Va, va, Piarrot, ne te mets point en peine. Si je sis madame, je te ferai gagner queuque chose, et tu apporteras du beurre et du fromage cheux nous.
PIERROT.
Ventreguienne! je gni en porterai jamais, quand tu m'en payerois deux fois autant. Est-ce donc comme ça que t'écoutes ce qu'il te dit? Morguienne, si j'avois su ça tantôt, je me serois bien gardé de le tirer de gliau, et je gli aurois baillé un bon coup d'aviron sur la tête.
DON JUAN, s'approchant de Pierrot pour le frapper.
Qu'est-ce que vous dites?
PIERROT, se mettant derrière Charlotte.
Jerniguienne! je ne crains parsonne.
DON JUAN, passant du côté où est Pierrot.
Attendez-moi un peu.
PIERROT, repassant de l'autre côté.
Je me moque de tout, moi.
DON JUAN, courant après Pierrot.
Voyons cela.
PIERROT, se sauvant encore derrière Charlotte.
J'en avons bian vu d'autres!
DON JUAN.
Ouais!
SGANARELLE.
Eh! monsieur, laissez là ce pauvre misérable. C'est conscience de le battre. (A Pierrot, en se mettant entre lui et don 34 Juan.) Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi, et ne lui dis rien.
PIERROT, passant devant Sganarelle, et regardant fièrement don Juan.
Je veux lui dire, moi!
DON JUAN, levant la main pour donner un soufflet à Pierrot.
Ah! je vous apprendrai...
Pierrot baisse la tête et Sganarelle reçoit le soufflet.
SGANARELLE, regardant Pierrot.
Peste soit du maroufle!
DON JUAN, à Sganarelle.
Te voilà payé de charité.
PIERROT.
Jarni! je vas dire à sa tante tout ce ménage-ci.
SCÈNE IV.—DON JUAN, CHARLOTTE, SGANARELLE.
DON JUAN, à Charlotte.
Enfin, je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes, et je ne changerois pas mon bonheur contre toutes les choses du monde. Que de plaisirs quand vous serez ma femme, et que...
SCÈNE V.—DON JUAN, MATHURINE, CHARLOTTE, SGANARELLE.
SGANARELLE, apercevant Mathurine.
Ah! ah!
MATHURINE, à don Juan.
Monsieu, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi?
DON JUAN, bas, à Mathurine.
Non. Au contraire, c'est elle qui me témoignoit une envie d'être ma femme, et je lui répondois que j'étois engagé à vous.
CHARLOTTE, à don Juan.
Qu'est-ce que c'est donc que vous veut Mathurine?
DON JUAN, bas, à Charlotte.
Elle est jalouse de me voir vous parler, et voudroit bien que je l'épousasse; mais je lui dis que c'est vous que je veux.
MATHURINE.
Quoi! Charlotte.
DON JUAN, bas, à Mathurine.
Tout ce que vous lui direz sera inutile; elle s'est mis cela dans la tête.
CHARLOTTE.
Quement donc! Mathurine....
DON JUAN, bas, à Charlotte.
C'est en vain que vous lui parlerez; vous ne lui ôterez point cette fantaisie.
MATHURINE.
Est-ce que...
DON JUAN, bas, à Mathurine.
Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison.
CHARLOTTE.
Je voudrois...
DON JUAN, bas, à Charlotte.
Elle est obstinée comme tous les diables.
MATHURINE.
Vraiment...
DON JUAN, bas, à Mathurine.
Ne ne lui dites rien, c'est une folle.
CHARLOTTE.
Je pense...
DON JUAN, bas, à Charlotte.
Laissez-la là, c'est une extravagante.
MATHURINE.
Non, non, il faut que je lui parle.
CHARLOTTE.
Je veux voir un peu ses raisons.
MATHURINE.
Quoi!...
DON JUAN, bas, à Mathurine.
Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser.
CHARLOTTE.
Je...
DON JUAN, bas, à Charlotte.
Gageons qu'elle vous soutiendra que je lui ai donné parole de la prendre pour femme.
MATHURINE.
Holà! Charlotte, ça n'est pas bian de courir su le marché des autres.
CHARLOTTE.
Ça n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieu me parle.
MATHURINE.
C'est moi que monsieu a vue la première.
CHARLOTTE.
S'il vous a vue la première, il m'a vue la seconde, et m'a promis de m'épouser.
DON JUAN, bas, à Mathurine.
Eh bien, que vous ai-je dit?
MATHURINE, à Charlotte.
Je vous baise les mains; c'est moi, et non pas vous, qu'il a promis d'épouser.
DON JUAN, bas, à Charlotte.
N'ai-je pas deviné?
CHARLOTTE.
A d'autres, je vous prie; c'est moi, vous dis-je.
MATHURINE.
Vous vous moquez des gens; c'est moi, encore un coup.
CHARLOTTE.
Le v'là qui est pour le dire, si je n'ai pas raison.
MATHURINE.
Le v'là qui est pour me démentir, si je ne dis pas vrai.
CHARLOTTE.
Est-ce, monsieu, que vous lui avez promis de l'épouser?
DON JUAN, bas, à Charlotte.
Vous vous raillez de moi.
MATHURINE.
Est-il vrai, monsieu, que vous lui avez donné parole d'être son mari?
DON JUAN, bas, à Mathurine.
Pouvez-vous avoir cette pensée?
CHARLOTTE.
Vous voyez qu'al le soutient.
DON JUAN, bas, à Charlotte.
Laissez-la faire.
MATHURINE.
Vous êtes témoin comme al l'assure.
DON JUAN, bas, à Mathurine.
Laissez-la dire.
CHARLOTTE.
Non, non, il faut savoir la vérité.
MATHURINE.
Il est question de juger ça.
CHARLOTTE.
Oui, Mathurine, je veux que monsieu vous montre votre bec jaune[19].
MATHURINE.
Oui, Charlotte, je veux que monsieu vous rende un peu camuse[20].
CHARLOTTE.
Monsieu, videz la querelle, s'il vous plaît.
MATHURINE.
Mettez-nous d'accord, monsieu.
CHARLOTTE, à Mathurine.
Vous allez voir.
MATHURINE, à Charlotte.
Vous allez voir vous-même.
CHARLOTTE, à don Juan.
Dites.
MATHURINE, à don Juan.
Parlez.
DON JUAN.
Que voulez-vous que je dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femmes. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qui en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas, en elle-même, de quoi se moquer des discours de l'autre, et doit-elle se mettre en peine, pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les 38 discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire; et les effets décident mieux que les paroles. Aussi n'est-ce rien que par là que je vous veux mettre d'accord; et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. (Bas, à Mathurine.) Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. (Bas, à Charlotte.) Laissez-la se flatter dans son imagination. (Bas, à Mathurine.) Je vous adore. (Bas, à Charlotte.) Je suis tout à vous. (Bas, à Mathurine.) Tous les visages sont laids auprès du vôtre. (Bas, à Charlotte.) On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vue. (Haut.) J'ai un petit ordre à donner, je viens vous retrouver dans un quart d'heure.
SCÈNE VI.—CHARLOTTE, MATHURINE, SGANARELLE.
CHARLOTTE, à Mathurine.
Je suis celle qu'il aime, au moins.
MATHURINE, à Charlotte.
C'est moi qu'il épousera.
SGANARELLE, arrêtant Charlotte et Mathurine.
Ah! pauvres filles que vous êtes, j'ai pitié de votre innocence, et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi l'une et l'autre: ne vous amusez point à tous les contes qu'on vous fait, et demeurez dans votre village.
SCÈNE VII.—DON JUAN, CHARLOTTE, MATHURINE, SGANARELLE.
DON JUAN, dans le fond du théâtre, à part.
Je voudrois bien savoir pourquoi Sganarelle ne me suit pas.
SGANARELLE.
Mon maître est un fourbe; il n'a dessein que de vous abuser, et en a bien abusé d'autres; c'est l'épouseur du genre humain, et... (Apercevant don Juan.) Cela est faux; et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain, il n'est point fourbe, il n'a pas dessein de vous tromper, et 39 n'en a point abusé d'autres. Ah! tenez, le voilà; demandez-le plutôt à lui-même.
DON JUAN, regardant Sganarelle, et le soupçonnant d'avoir parlé.
Oui!
SGANARELLE.
Monsieur, comme le monde est plein de médisans, je vais au-devant des choses; et je leur disois que, si quelqu'un leur venoit dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire, et ne manquassent pas de lui dire qu'il en auroit menti.
DON JUAN.
Sganarelle!
SGANARELLE, à Charlotte et à Mathurine.
Oui, monsieur est homme d'honneur; je le garantis tel.
DON JUAN.
Hon!
SGANARELLE.
Ce sont des impertinens.
SCÈNE VIII.—DON JUAN, LA RAMÉE, CHARLOTTE, MATHURINE, SGANARELLE.
LA RAMÉE, bas, à don Juan.
Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous.
DON JUAN.
Comment?
LA RAMÉE.
Douze hommes à cheval vous cherchent, qui doivent arriver ici dans un moment; je ne sais par quel moyen ils peuvent vous avoir suivi; mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé, et auquel ils vous ont dépeint. L'affaire presse; et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur.
SCÈNE IX.—DON JUAN, CHARLOTTE, MATHURINE, SGANARELLE.
DON JUAN, à Charlotte et à Mathurine.
Une affaire pressante m'oblige de partir d'ici; mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai 40 donnée, et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain au soir.
SCÈNE X.—DON JUAN, SGANARELLE.
DON JUAN.
Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagème et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Sganarelle se revête de mes habits; et moi...
SGANARELLE.
Monsieur, vous vous moquez. M'exposer à être tué sous vos habits, et...
DON JUAN.
Allons vite, c'est trop d'honneur que je vous fais; et bien heureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître.
SGANARELLE.
Je vous remercie d'un tel honneur. (Seul.) O ciel! puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point pris pour un autre!
ACTE III
Une forêt.
SCÈNE I.[21]—DON JUAN, en habit de campagne, SGANARELLE, en médecin.
SGANARELLE.
Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison, et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier 41 dessein n'étoit point du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire.
DON JUAN.
Il est vrai que te voilà bien; et je ne sais où tu as été déterrer cet attirail ridicule.
SGANARELLE.
Oui. C'est l'habit d'un vieux médecin, qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris, et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération; que je suis salué des gens que je rencontre, et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme?
DON JUAN.
Comment donc?
SGANARELLE.
Cinq ou six paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies.
DON JUAN.
Tu leur as répondu que tu n'y entendois rien?
SGANARELLE.
Moi? point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit; j'ai raisonné sur le mal, et leur ai fait des ordonnances à chacun.
DON JUAN.
Et quels remèdes encore leur as-tu ordonnés?
SGANARELLE.
Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper, j'ai fait mes ordonnances à l'aventure, et ce seroit une chose plaisante si les malades guérissoient, et qu'on m'en vînt remercier.
DON JUAN.
Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurois-tu pas les mêmes priviléges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès; et tu peux profiter, comme eux, du bonheur du malade, et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature.
SGANARELLE.
Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine?
DON JUAN.
C'est une des grandes erreurs qui soient parmi les hommes.
SGANARELLE.
Quoi! vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique.
DON JUAN.
Et pourquoi veux-tu que j'y croie?
SGANARELLE.
Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant vous voyez depuis un temps, que le vin émétique fait bruire ses fuseaux[22]. Ses miracles ont converti les plus incrédules esprits; et il n'y a pas trois semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux.
DON JUAN.
Et quoi!
SGANARELLE.
Il y avoit un homme qui, depuis six jours, étoit à l'agonie; on ne savoit plus que lui ordonner, et tous les remèdes ne faisoient rien; on s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique.
DON JUAN.
Il réchappa, n'est-ce pas?
SGANARELLE.
Non, il mourut.
DON JUAN.
L'effet est admirable.
SGANARELLE.
Comment! il y avoit six jours entiers qu'il ne pouvoit mourir, et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace?
DON JUAN.
Tu as raison.
SGANARELLE.
Mais laissons là la médecine où vous ne croyez point, et parlons des autres choses; car cet habit me donne de l'esprit, 43 et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes, et que vous ne me défendez pas les remontrances.
DON JUAN.
Eh bien?
SGANARELLE.
Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel?
DON JUAN.
Laissons cela.
SGANARELLE.
C'est-à-dire que non. Et à l'enfer?
DON JUAN.
Eh!
SGANARELLE.
Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît?
DON JUAN.
Oui, oui.
SGANARELLE.
Aussi peu. Ne croyez-vous point à l'autre vie?
DON JUAN.
Ah! ah! ah!
SGANARELLE.
Voilà un homme que j'aurai bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu; «le moine bourru[23], qu'en croyez-vous, eh?
DON JUAN.
»La peste soit du fat!
SGANARELLE.
«Et voilà ce que je ne puis souffrir; car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferois pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose «dans le monde.» Qu'est-ce «donc» que vous croyez?
DON JUAN.
Ce que je crois?
SGANARELLE.
Oui.
DON JUAN.
Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit.
SGANARELLE.
La belle croyance «et les beaux articles de foi» que voilà! Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique? Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes, et que, pour avoir bien étudié, on est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne sauroit se vanter de m'avoir jamais rien appris; mais avec mon petit bon sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que les livres, et je comprends fort bien que tout ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrois bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre, et ce ciel là-haut, et si tout cela s'est bâti de lui-même. Vous voilà, vous, par exemple, vous êtes là: est-ce que vous vous êtes fait tout seul, et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ces nerfs, ces os, ces veines, ces artères, ces... ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là, et qui... Oh! dame, interrompez-moi donc, si vous voulez. Je ne saurois disputer, si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès, et me laissez parler par belle malice.
DON JUAN.
J'attends que ton raisonnement soit fini.
SGANARELLE.
Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauroient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense cent choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu'elle veut? Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer 45 les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner...
Il se laisse tomber en tournant.
DON JUAN.
Bon! voilà ton raisonnement qui a le nez cassé.
SGANARELLE.
Morbleu! je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous; croyez ce que vous voudrez; il m'importe bien que vous soyez damné!
DON JUAN.
Mais, tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà là-bas, pour lui demander le chemin.
SCÈNE II.—DON JUAN, SGANARELLE, UN PAUVRE.
SGANARELLE.
«Holà! oh! l'homme! oh! mon compère! oh! l'ami! un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville.
LE PAUVRE.
»Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt; mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que, depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour.
DON JUAN.
»Je te suis obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur.
LE PAUVRE.
»Si vous vouliez me secourir, monsieur, de quelque aumône.
DON JUAN.
»Ah! ah! ton avis est intéressé, à ce que je vois.
LE PAUVRE.
»Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis dix ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toute sorte de biens.
DON JUAN.
»Eh! prie le ciel qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres.
SGANARELLE.
»Vous ne connoissez pas monsieur bonhomme; il ne croit qu'en deux et deux sont quatre, et quatre et quatre sont huit.
DON JUAN.
»Quelle est ton occupation parmi ces arbres?
LE PAUVRE.
»De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose.
DON JUAN.
»Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise.
LE PAUVRE.
»Hélas! monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde.
DON JUAN.
»Tu te moques: un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut manquer d'être bien dans ses affaires.
LE PAUVRE.
»Je vous assure, monsieur, que le plus souvent je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents.
DON JUAN.
»Voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah! ah! je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer.
LE PAUVRE.
»Ah! monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché?
DON JUAN.
»Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or, ou non: en voici un que je te donne, si tu jures. Tiens: il faut jurer.
LE PAUVRE.
»Monsieur...
DON JUAN.
»A moins de cela, tu ne l'auras pas.
SGANARELLE.
»Va, va, jure un peu; il n'y a pas de mal.
DON JUAN.
»Prends, le voilà; prends, te dis-je; mais jure donc!
LE PAUVRE.
»Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim.
DON JUAN.
»Va, va, je te le donne pour l'amour de l'humanité.» (Regardant dans la forêt.) Mais que vois-je là? Un homme attaqué par trois autres? La partie est trop inégale, et je ne dois pas souffrir cette lâcheté.
Il met l'épée à la main, et court au lieu du combat.
SCÈNE III.—SGANARELLE.
Mon maître est un vrai enragé d'aller se présenter à un péril qui ne le cherche pas. Mais, ma foi, le secours a servi, et les deux ont fait fuir les trois.
SCÈNE IV.—DON JUAN, DON CARLOS, SGANARELLE, au fond du théâtre.
DON CARLOS, remettant son épée.
On voit, par la fuite de ces voleurs, de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâces d'une action si généreuse, et que...
DON JUAN.
Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait en ma place. Notre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures; et l'action de ces coquins étoit si lâche, que c'eût été y prendre part que de ne pas s'y opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains?
DON CARLOS.
Je m'étois, par hasard, égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite; et, comme je cherchois à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs, qui d'abord ont tué mon cheval, et qui, sans votre valeur, en auroient fait autant de moi.
DON JUAN.
Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville?
DON CARLOS.
Oui, mais sans y vouloir entrer; et nous nous voyons 48 obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se sacrifier, eux et leur famille, à la sévérité de leur honneur, puisque enfin le plus doux succès en est toujours funeste, et que, si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume; et c'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureuse, de ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et toute l'honnêteté de sa conduite, d'être asservi par les lois de l'honneur au déréglement de la conduite d'autrui, et de voir sa vie, son repos et ses biens, dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire une de ces injures pour qui un honnête homme doit périr.
DON JUAN.
On a cet avantage, qu'on fait courir le même risque et passer mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne seroit-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire?
DON CARLOS.
La chose en est aux termes de n'en plus faire de secret; et, lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance, et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent, et que l'auteur de cette offense est un don Juan Tenorio, fils de don Louis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours, et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet, qui nous a dit qu'il sortoit à cheval, accompagné de quatre ou cinq, et qu'il avoit pris le long de cette côte; mais tous nos soins ont été inutiles, et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu.
DON JUAN.
Le connoissez-vous, monsieur, ce don Juan dont vous parlez?
DON CARLOS.
Non, quant à moi; je ne l'ai jamais vu, et je l'ai seulement 49 ouï dépeindre à mon frère; mais la renommée n'en dit pas force bien, et c'est un homme dont la vie...
DON JUAN.
Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis, et ce seroit à moi une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal.
DON CARLOS.
Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout; et c'est bien la moindre chose que je vous doive, après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connoissez, lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal; mais, quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action, et ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance.
DON JUAN.
Au contraire, je vous y veux servir, et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de don Juan, je ne puis pas m'en empêcher; mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes, et je m'engage à vous faire faire raison par lui.
DON CARLOS.
Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures?
DON JUAN.
Toute celle que votre honneur peut souhaiter; et, sans vous donner la peine de chercher don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez, et quand il vous plaira.
DON CARLOS.
Cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés; mais, après ce que je vous dois, ce me seroit une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie.
DON JUAN.
Je suis si attaché à don Juan, qu'il ne sauroit se battre que je ne me batte aussi; mais enfin j'en réponds comme de moi-même, et vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paroisse et vous donne satisfaction.
DON CARLOS.
Que ma destinée est cruelle! Faut-il que je vous doive vie, et que don Juan soit de vos amis?
SCÈNE V.—DON ALONSE, DON CARLOS, DON JUAN, SGANARELLE.
DON ALONSE, parlant à ceux de sa suite, sans voir don Carlos ni don Juan.
Faites boire là mes chevaux, et qu'on les amène après nous; je veux un peu marcher à pied. (Les apercevant tous deux.) O ciel! que vois-je ici? Quoi! mon frère, vous voilà avec notre ennemi mortel?
DON CARLOS.
Notre ennemi mortel?
DON JUAN, mettant la main sur la garde de son épée.
Oui, je suis don Juan moi-même; et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom.
DON ALONSE, mettant l'épée à la main.
Ah! traître, il faut que tu périsses, et...
Sganarelle court se cacher.
DON CARLOS.
Ah! mon frère, arrêtez. Je lui suis redevable de la vie; et, sans le secours de son bras, j'aurois été tué par des voleurs que j'ai trouvés.
DON ALONSE.
Et voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme; et, s'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnoissance, mon frère, est ici ridicule; et, comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est ne devoir rien proprement que d'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur.
DON CARLOS.
Je sais la différence, mon frère, qu'un gentilhomme doit toujours mettre entre l'un et l'autre; et la reconnoissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure; mais souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, 51 que je m'acquitte sur-le-champ de la vie que je lui dois, par un délai de notre vengeance, et lui laisse la liberté de jouir, durant quelques jours, du fruit de son bienfait.
DON ALONSE.
Non, non, c'est hasarder notre vengeance que de la reculer, et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici, c'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est blessé mortellement, on ne doit point songer à garder aucunes mesures; et, si vous répugnez à prêter votre bras à cette action, vous n'avez qu'à vous retirer, et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice.
DON CARLOS.
De grâce, mon frère...
DON ALONSE.
Tous ces discours sont superflus: il faut qu'il meure.
DON CARLOS.
Arrêtez, vous dis-je, mon frère. Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ses jours; et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit, et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée; et, pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez.
DON ALONSE.
Quoi? vous prenez le parti de votre ennemi contre moi; et, loin d'être saisi à son aspect des mêmes transports que je sens, vous faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur!
DON CARLOS.
Mon frère, montrons de la modération dans une action légitime, et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur dont nous soyons les maîtres, une valeur qui n'ait rien de farouche, et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison, et non point par le mouvement d'une aveugle colère. Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi, et je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins éclatante; au contraire, elle en tirera de l'avantage; et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paroître plus juste aux yeux de tout le monde.
DON ALONSE.
O l'étrange foiblesse, et l'aveuglement effroyable, de hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique!
DON CARLOS.
Non, mon frère, ne vous mettez pas en peine. Si je fais une faute, je saurai bien la réparer, et je me charge de tout le soin de notre honneur; je sais à quoi il nous oblige, et cette suspension d'un jour, que ma reconnoissance lui demande, ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de le satisfaire. Don Juan, vous voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous, et vous devez par là juger du reste, croire que je m'acquitte avec même chaleur de ce que je dois, et que je ne serai pas moins exact à vous payer l'injure que le bienfait. Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments, et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connoissez assez la grandeur de l'offense que vous nous faites, et je vous fais juge vous-même des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire, il en est de violents et de sanglants; mais enfin, quelque choix que vous fassiez, vous m'avez donné parole de me faire raison par don Juan. Songez à me la faire, je vous prie, et vous ressouvenez que, hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur.
DON JUAN.
Je n'ai rien exigé de vous, et vous tiendrai ce que j'ai promis.
DON CARLOS.
Allons, mon frère; un moment de douceur ne fait aucune injure à la sévérité de notre devoir.
SCÈNE VI.—DON JUAN, SGANARELLE.
DON JUAN.
Holà! hé! Sganarelle!
SGANARELLE, sortant de l'endroit où il étoit caché.
Plaît-il!
DON JUAN.
Comment! coquin, tu fuis quand on m'attaque!
SGANARELLE.
Pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif, et que c'est prendre médecine que de le porter.
DON JUAN.
Peste soit l'insolent! Couvre au moins ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie!
SGANARELLE.
Moi? non.
DON JUAN.
C'est un frère d'Elvire.
SGANARELLE.
Un...
DON JUAN.
Il est assez honnête homme, il en a bien usé, et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui.
SGANARELLE.
Il vous seroit aisé de pacifier toutes choses.
DON JUAN.
Oui; mais ma passion est usée pour done Elvire, et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurois me résoudre à renfermer mon cœur entre quatre murailles. Je te l'ai dit vingt fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles, et c'est à elles à le prendre tour à tour, et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres?
SGANARELLE.
Vous ne le savez pas?
DON JUAN.
Non, vraiment.
SGANARELLE.
Bon! c'est le tombeau que le commandeur faisoit faire lorsque vous le tuâtes.
DON JUAN.
Ah! tu as raison. Je ne savois pas que c'étoit de ce côté-ci qu'il étoit. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet 54 ouvrage, aussi bien que de la statue du commandeur, et j'ai envie de l'aller voir.
SGANARELLE.
Monsieur, n'allez point là.
DON JUAN.
Pourquoi?
SGANARELLE.
Cela n'est pas civil, d'aller voir un homme que vous avez tué.
DON JUAN.
Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité, et qu'il doit recevoir de bonne grâce, s'il est galant homme. Allons, entrons dedans.
Le tombeau s'ouvre, et l'on voit la statue du commandeur.
SGANARELLE.
Ah! que cela est beau! les belles statues! le beau marbre! les beaux piliers! ah! que cela est beau! Qu'en dites-vous, monsieur?
DON JUAN.
Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort; et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire.
SGANARELLE.
Voici la statue du commandeur.
DON JUAN.
Parbleu! le voilà bon, avec son habit d'empereur romain!
SGANARELLE.
Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie, et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feroient peur si j'étois tout seul, et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir.
DON JUAN.
Il auroit tort, et ce seroit mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi.
SGANARELLE.
C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois.
DON JUAN.
Demande-lui, te dis-je.
SGANARELLE.
Vous moquez-vous! Ce seroit être fou que d'aller parler à une statue.
DON JUAN.
Fais ce que je te dis.
SGANARELLE.
Quelle bizarrerie! Seigneur commandeur... (A part.) Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me la fait faire. (Haut.) Seigneur commandeur, mon maître don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. (La statue baisse la tête.) Ah!
DON JUAN.
Qu'est-ce? qu'as-tu? dis donc! Veux-tu parler?
SGANARELLE, baissant la tête comme la statue.
La statue...
DON JUAN.
Eh bien, que veux-tu dire, traître?
SGANARELLE.
Je vous dis que la statue...
DON JUAN.
Eh bien, la statue? Je t'assomme, si tu ne parles.
SGANARELLE.
La statue m'a fait signe.
DON JUAN.
La peste! le coquin!
SGANARELLE.
Elle m'a fait signe, vous dis-je; il n'est rien de plus vrai. Allez-vous-en lui parler vous-même pour voir. Peut-être...
DON JUAN.
Viens, maraud, viens. Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Prends garde. Le seigneur commandeur voudroit-il venir souper avec moi?
La statue baisse encore la tête.
SGANARELLE.
Je ne voudrois pas en tenir dix pistoles[24]. Eh bien, monsieur?
DON JUAN.
Allons, sortons d'ici.
SGANARELLE, seul.
Voilà de mes esprits forts, qui ne veulent rien croire!
ACTE IV
Le théâtre représente l'appartement de don Juan.
SCÈNE I.—DON JUAN, SGANARELLE, RAGOTIN.
DON JUAN, à Sganarelle.
Quoi qu'il en soit, laissons cela; c'est une bagatelle, et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue.
SGANARELLE.
Eh! monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'est rien de plus véritable que ce signe de tête; et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre, et pour vous retirer de...
DON JUAN.
Écoute. Si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un nerf de bœuf, te faire tenir par trois ou quatre, et te rouer de mille coups. M'entends-tu bien?
SGANARELLE.
Fort bien, monsieur, le mieux du monde. Vous vous expliquez clairement; c'est ce qu'il y a de bon en vous, que vous n'allez point chercher de détours: vous dites les choses avec une netteté admirable.
DON JUAN.
Allons, qu'on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Une chaise, petit garçon.
SCÈNE II.—DON JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE, RAGOTIN.
LA VIOLETTE.
Monsieur, voilà votre marchand, monsieur Dimanche, qui demande à vous parler.
SGANARELLE.
Bon! voilà ce qu'il nous faut, qu'un compliment de créancier. De quoi s'avise-t-il de nous venir demander de l'argent? et que ne lui disois-tu que monsieur n'y est pas?
LA VIOLETTE.
Il y a trois quarts d'heure que je lui dis; mais il ne veut pas le croire, et s'est assis là dedans pour attendre.
SGANARELLE.
Qu'il attende tant qu'il voudra.
DON JUAN.
Non, au contraire, faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire celer aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose; et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double[25].
SCÈNE III.—DON JUAN, MONSIEUR DIMANCHE, SGANARELLE, LA VIOLETTE, RAGOTIN.
DON JUAN.
Ah! monsieur Dimanche, approchez. Que je suis ravi de vous voir, et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord! J'avois donné ordre qu'on ne me fît parler à personne; mais cet ordre n'est pas pour vous, et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi.
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur, je vous suis fort obligé.
DON JUAN, parlant à Violette et à Ragotin.
Parbleu! coquins, je vous apprendrai à laisser monsieur Dimanche dans une antichambre, et je vous ferai connoître les gens!
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur, cela n'est rien.
DON JUAN, à M. Dimanche.
Comment! vous dire que je n'y suis pas! à monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis!
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur, je suis votre serviteur. J'étois venu...
DON JUAN.
Allons, vite un siége pour monsieur Dimanche.
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur, je suis bien comme cela.
DON JUAN.
Point, point, je veux que vous soyez assis contre moi.
MONSIEUR DIMANCHE.
Cela n'est point nécessaire.
DON JUAN.
Otez ce pliant, et apportez un fauteuil.
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur, vous vous moquez, et...
DON JUAN.
Non, non, je sais ce que je vous dois; et je ne veux point qu'on mette de différence entre nous deux.
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur...
DON JUAN.
Allons, asseyez-vous.
MONSIEUR DIMANCHE.
Il n'est pas besoin, monsieur, et je n'ai qu'un mot à vous dire. J'étois...
DON JUAN.
Mettez-vous là, vous dis-je.
MONSIEUR DIMANCHE.
Non, monsieur, je suis bien. Je viens pour...
DON JUAN.
Non, je ne vous écoute point si vous n'êtes assis.
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur, je fais ce que vous voulez. Je...
DON JUAN.
Parbleu! monsieur Dimanche, vous vous portez bien?
MONSIEUR DIMANCHE.
Oui, monsieur, pour vous rendre service. Je suis venu...
DON JUAN.
Vous avez un fonds de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs.
MONSIEUR DIMANCHE.
Je voudrois bien...
DON JUAN.
Comment se porte madame Dimanche, votre épouse?
MONSIEUR DIMANCHE.
Fort bien, monsieur, Dieu merci.
DON JUAN.
C'est une brave femme.
MONSIEUR DIMANCHE.
Elle est votre servante, monsieur. Je venois...
DON JUAN.
Et votre petite fille Claudine, comment se porte-t-elle?
MONSIEUR DIMANCHE.
Le mieux du monde.
DON JUAN.
La jolie petite fille que c'est! je l'aime de tout mon cœur.
MONSIEUR DIMANCHE.
C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Je vous...
DON JUAN.
Et le petit Collin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour?
MONSIEUR DIMANCHE.
Toujours de même, monsieur. Je...
DON JUAN.
Et votre petit chien Brusquet gronde-t-il toujours aussi fort, et mord-il toujours bien aux jambes les gens qui vont chez vous?
MONSIEUR DIMANCHE.
Plus que jamais, monsieur; et nous ne saurions en chevir[26].
DON JUAN.
Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt.
MONSIEUR DIMANCHE.
Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Je...
DON JUAN, lui tendant la main.
Touchez donc là, monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis?
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur, je suis votre serviteur.
DON JUAN.
Parbleu! je suis à vous de tout mon cœur.
MONSIEUR DIMANCHE.
Vous m'honorez trop. Je...
DON JUAN.
Il n'y a rien que je ne fisse pour vous.
MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi.
DON JUAN.
Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire.
MONSIEUR DIMANCHE.
Je n'ai point mérité cette grâce, assurément. Mais, monsieur...
DON JUAN.
Oh çà, monsieur Dimanche, sans façon, voulez-vous souper avec moi?
MONSIEUR DIMANCHE.
Non, monsieur; il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Je...
DON JUAN, se levant.
Allons, vite un flambeau pour conduire monsieur Dimanche, et que quatre ou cinq de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter.
MONSIEUR DIMANCHE, se levant aussi.
Monsieur, il n'est pas nécessaire, et je m'en irai bien tout seul. Mais...
Sganarelle ôte les siéges promptement.
DON JUAN.
Comment! Je veux qu'on vous escorte, et je m'intéresse 61 trop à votre personne. Je suis votre serviteur, et de plus votre débiteur.
MONSIEUR DIMANCHE.
Ah! monsieur...
DON JUAN.
C'est une chose que je ne cache pas, et je le dis à tout le monde.
MONSIEUR DIMANCHE.
Si...
DON JUAN.
Voulez-vous que je vous reconduise?
MONSIEUR DIMANCHE.
Ah! monsieur, vous vous moquez! Monsieur...
DON JUAN.
Embrassez-moi donc, s'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous, et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service.
Il sort.
SCÈNE IV.—MONSIEUR DIMANCHE, SGANARELLE.
SGANARELLE.
Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien.
MONSIEUR DIMANCHE.
Il est vrai; il me fait tant de civilités et tant de complimens, que je ne saurois jamais lui demander de l'argent.
SGANARELLE.
Je vous assure que toute sa maison périroit pour vous; et je voudrois qu'il vous arrivât quelque chose, que quelqu'un s'avisât de vous donner des coups de bâton, vous verriez de quelle manière...
MONSIEUR DIMANCHE.
Je le crois; mais, Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent.
SGANARELLE.
Oh! ne vous mettez pas en peine, il vous payera le mieux du monde.
MONSIEUR DIMANCHE.
Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier.
SGANARELLE.
Fi! ne parlez pas de cela.
MONSIEUR DIMANCHE.
Comment! Je...
SGANARELLE.
Ne sais-je pas bien que je vous dois?
MONSIEUR DIMANCHE.
Oui. Mais...
SGANARELLE.
Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer.
MONSIEUR DIMANCHE.
Mais mon argent?
SGANARELLE, prenant M. Dimanche par le bras.
Vous moquez-vous?
MONSIEUR DIMANCHE.
Je veux...
SGANARELLE, le tirant.
Eh!
MONSIEUR DIMANCHE.
J'entends...
SGANARELLE, le poussant vers la porte.
Bagatelles!
MONSIEUR DIMANCHE.
Mais...
SGANARELLE, le poussant encore.
Fi!
MONSIEUR DIMANCHE.
Je...
SGANARELLE, le poussant tout à fait hors du théâtre.
Fi! vous dis-je.
SCÈNE V.—DON JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE
LA VIOLETTE, à don Juan.
Monsieur, voilà monsieur votre père.
DON JUAN.
Ah! me voici bien! Il me falloit cette visite pour me faire enrager.
SCÈNE VI.—DON LOUIS, DON JUAN, SGANARELLE.
DON LOUIS.
Je vois bien que je vous embarrasse, et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. A dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un l'autre, et, si vous êtes las de me voir, je suis bien las aussi de vos déportemens. Hélas! que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées! J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles; je l'ai demandé sans relâche avec des transports incroyables; et ce fils, que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux, est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyois qu'il devoit être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes, dont on a peine, aux yeux du monde, d'adoucir le mauvais visage; cette suite continuelle de méchantes affaires, qui nous réduisent à toute heure à lasser les bontés du souverain, et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis? Ah! quelle bassesse est la vôtre? Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité, et qu'avez-vous fait, dans le monde, pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'en porter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble, lorsque nous vivons en infâmes? Non, non, la naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Aussi nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler; et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leur vertu, si nous voulons être estimés leurs véritables descendans. Ainsi 64 vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes né; ils vous désavouent pour leur sang, et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage; au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature; que la vertu est le premier titre de noblesse; que je regarde bien moins au nom qu'on signe qu'aux actions qu'on fait, et que je ferois plus d'état du fils d'un crocheteur qui seroit honnête homme que du fils d'un monarque qui vivroit comme vous!
DON JUAN.
Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler.
DON LOUIS.
Non, insolent, je ne veux point m'asseoir ni parler davantage, et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme; mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions; que je saurai, plus tôt que tu ne penses, mettre une borne à tes déréglemens, prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver, par ta punition, la honte de t'avoir fait naître.
SCÈNE VII.—DON JUAN, SGANARELLE.
DON JUAN, adressant encore la parole à son père, quoiqu'il soit sorti.
Eh! mourez le plus tôt que vous pourrez, c'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour, et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils.
Il se met dans un fauteuil.
SGANARELLE.
Ah! monsieur, vous avez tort.
DON JUAN, se levant.
J'ai tort!
SGANARELLE, tremblant.
Monsieur...
DON JUAN.
J'ai tort!
SGANARELLE.
Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous 65 a dit, et vous le deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils, et lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme, et cent autres sottises de pareille nature! Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, qui savez comme il faut vivre? J'admire votre patience, et, si j'avois été en votre place, je l'aurois envoyé promener. (Bas, à part.) O complaisance maudite! à quoi me réduis-tu?
DON JUAN.
Me fera-t-on souper bientôt?
SCÈNE VIII.—DON JUAN, SGANARELLE, RAGOTIN.
RAGOTIN.
Monsieur, voici une dame voilée qui vient vous parler.
DON JUAN.
Que pourroit-ce être?
SGANARELLE.
Il faut voir.
SCÈNE IX.—DONE ELVIRE, voilée, DON JUAN, SGANARELLE.
DONE ELVIRE.
Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changée de ce que j'étois ce matin. Ce n'est plus cette done Elvire qui faisoit des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetoit que menace et ne respiroit que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentois pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportemens d'un amour terrestre et grossier, et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi, et ne se met en peine que de votre intérêt.
DON JUAN, bas à Sganarelle.
Tu pleures, je pense?
SGANARELLE.
Pardonnez-moi.
DONE ELVIRE.
C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel, et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, don Juan, je sais tous les déréglemens de votre vie; et ce même ciel, qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égaremens de ma conduite, m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous, par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâces au ciel, de toutes mes folles pensées; ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite, et mériter, par une austère pénitence, le pardon de l'aveuglement où m'ont plongée les transports d'une passion condamnable. Mais, dans cette retraite, j'aurois une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devînt un exemple funeste de la justice du ciel; et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation; ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes; et, si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels.
SGANARELLE à part.
Pauvre femme!
DONE ELVIRE.
Je vous ai aimé avec une tendresse extrême, rien au monde ne m'a été si cher que vous; j'ai oublié mon devoir pour vous; j'ai fait toutes choses pour vous; et toute la récompense 67 que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, don Juan, je vous le demande avec larmes; et, si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher.
SGANARELLE, à part, regardant don Juan.
Cœur de tigre!
DONE ELVIRE.
Je m'en vais après ce discours, et voilà tout ce que j'avois à vous dire.
DON JUAN.
Madame, il est tard, demeurez ici. On vous y logera le mieux qu'on pourra.
DONE ELVIRE.
Non, don Juan, ne me retenez pas davantage.
DON JUAN.
Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure.
DONE ELVIRE.
Non, vous dis-je; ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller, ne faites aucune instance pour me conduire, et songez seulement à profiter de mon avis.
SCÈNE X.—DON JUAN, SGANARELLE.
DON JUAN.
Sais-tu bien que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle, que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre, et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint?
SGANARELLE.
C'est-à-dire que ses paroles n'ont fait aucun effet sur vous.
DON JUAN.
Vite à souper!
SGANARELLE.
Fort bien.
SCÈNE XI.—DON JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE, RAGOTIN.
DON JUAN, se mettant à table.
Sganarelle, il faut songer à s'amender, pourtant.
SGANARELLE.
Oui-da?
DON JUAN.
Oui, ma foi, il faut s'amender. Encore vingt ou trente ans de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous.
SGANARELLE.
Oh!
DON JUAN.
Qu'en dis-tu?
SGANARELLE.
Rien. Voilà le souper.
Il prend un morceau d'un des plats qu'on apporte et le met dans sa bouche.
DON JUAN.
Il me semble que tu as la joue enflée: qu'est-ce que c'est? Parle donc. Qu'as-tu là?
SGANARELLE.
Rien.
DON JUAN.
Montre un peu. Parbleu! c'est une fluction qui lui est est tombée sur la joue. Vite une lancette pour percer cela! Le pauvre garçon n'en peut plus, et cet abcès le pourroit étouffer. Attends; voyez voyez comme il étoit mûr! Ah! coquin que vous êtes!
SGANARELLE.
Ma foi, monsieur, je voulois voir si votre cuisinier n'avoit point mis trop de sel ou trop de poivre.
DON JUAN.
Allons, mets-toi là et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soupé. Tu as faim, à ce que je vois.
SGANARELLE, se mettant à table.
Je le crois bien, monsieur, je n'ai point mangé depuis ce matin. Tâtez de cela, voilà qui est le meilleur du monde.(A Ragotin, qui, à mesure que Sganarelle met quelque chose sur son69 assiette, la lui ôte dès que Sganarelle tourne la tête.) Mon assiette, mon assiette! Tout doux s'il vous plaît! Vertubleu! petit compère que vous êtes habile à donner des assiettes nettes! Et vous, petit la Violette, que vous savez présenter à boire à propos!
Pendant que la Violette donne à boire à Sganarelle, Ragotin ôte encore son assiette.
DON JUAN.
Qui peut frapper de cette sorte?
SGANARELLE.
Qui diable nous vient troubler dans notre repas?
DON JUAN.
Je veux souper en repos, au moins, et qu'on ne laisse entrer personne.
SGANARELLE.
Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même.
DON JUAN, voyant venir Sganarelle effrayé.
Qu'est-ce donc? qu'y a-t-il?
SGANARELLE, baissant la tête comme la statue.
Le... qui est là.
DON JUAN.
Allons voir, et montrons que rien ne me sauroit ébranler.
SGANARELLE.
Ah! pauvre Sganarelle, où te cacheras-tu?
SCÈNE XII.—DON JUAN, LA STATUE DU COMMANDEUR, SGANARELLE, LA VIOLETTE, RAGOTIN.
DON JUAN, à ses gens.
Une chaise et un couvert. Vite donc! (Don Juan et la statue se mettent à table. A Sganarelle.) Allons, mets-toi à table.
SGANARELLE.
Monsieur, je n'ai plus faim.
DON JUAN.
Mets-toi là, te dis-je. A boire. A la santé du commandeur! Je te la porte, Sganarelle. Qu'on lui donne du vin!
SGANARELLE.
Monsieur, je n'ai pas soif.
DON JUAN.
Bois, et chante ta chanson, pour régaler le commandeur.
SGANARELLE.
Je suis enrhumé, monsieur.
DON JUAN.
Il m'importe; allons! (A ses gens.) Vous autres, venez, accompagner sa voix.
LA STATUE.
Don Juan, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage?
DON JUAN.
Oui, j'irai, accompagné du seul Sganarelle.
SGANARELLE.
Je vous rends grâce, il est demain jeûne pour moi.
DON JUAN, à Sganarelle.
Prends ce flambeau.
LA STATUE.
On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel.
ACTE V
Le théâtre représente une campagne.
SCÈNE I.—DON LOUIS, DON JUAN, SGANARELLE.
DON LOUIS.
Quoi! mon fils, seroit-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? ne m'abusez-vous point d'un faux espoir, et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion?
DON JUAN.
Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs; je ne suis plus le même d'hier au soir, et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et désillé mes yeux; et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les 71 désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations, et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps, et n'a pas vingt fois, sur ma tête, laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes, et je prétends en profiter comme je dois, faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par là le scandale de mes actions passées, et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler; et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein, et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer.
DON LOUIS.
Ah! mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir! Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue; je jette des larmes de joie; tous mes vœux sont satisfaits, et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils, et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais, tout de ce pas, porter l'heureuse nouvelle à votre mère, partager avec elle les doux transports du ravissement où je suis, et rendre grâces au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer.
SCÈNE II.—DON JUAN, SGANARELLE.
SGANARELLE.
Ah! monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti! Il y a longtemps que j'attendois cela; et voilà, grâces au ciel, tous mes souhaits accomplis.
DON JUAN.
La peste le benêt!
SGANARELLE.
Comment, le benêt?
DON JUAN.
Quoi! tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire, et tu crois que ma bouche étoit d'accord avec mon cœur?
SGANARELLE.
Quoi! ce n'est pas... Vous ne... Votre... (A part.) Oh! quel homme! quel homme! quel homme!
DON JUAN.
Non, non, je ne suis point changé, et mes sentiments sont toujours les mêmes.
SGANARELLE.
Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante?
DON JUAN.
Il y a bien quelque chose là dedans que je ne comprends pas; mais, quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable, ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme; et, si j'ai dit que je voulois corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre, pour ménager un père dont j'ai besoin, et me mettre à couvert, du côté des hommes, de cent fâcheuses aventures qui pourroient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses.
SGANARELLE.
Quoi! vous ne croyez rien du tout, et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien?
DON JUAN.
Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde!
SGANARELLE, à part.
Ah! quel homme! quel homme!
DON JUAN.
Il n'y a plus de honte maintenant à cela: l'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertus. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de 73 tous les personnages qu'on puisse jouer. Aujourd'hui la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée; et, quoiqu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement; mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lie, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti. Qui en choque un se les attire tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connoît pour être véritablement touchés, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres; ils donnent bonnement dans le panneau des grimaciers, et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connoisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se font un bouclier du manteau de la religion, et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchans hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues et les connoître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens, et quelque baissement de tête, un soupir mortifié et deux roulemens d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes; mais j'aurai soin de me cacher, et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale[27], et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrai. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel, et, sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété et saurai déchaîner 74 contre eux des zélés indiscrets, qui, sans connaissance de cause, crieront en public après eux; qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des foiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle.
SGANARELLE.
O ciel! qu'entends-je ici? il ne vous manquoit plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point; et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte, et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qu'il vous plaira; battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez; il faut que je décharge mon cœur, et qu'en valet fidèle je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise; et, comme dit fort bien cet auteur que je ne connois pas, l'homme est, en ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche; la branche est attachée à l'arbre; qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes; les bons préceptes valent mieux que les belles paroles; les belles paroles se trouvent à la cour; à la cour sont les courtisans; les courtisans suivent la mode; la mode vient de la fantaisie; la fantaisie est une faculté de l'âme; l'âme est ce qui nous donne la vie; la vie finit par la mort; la mort nous fait penser au ciel; le ciel est au-dessus de la terre; la terre n'est point la mer; la mer est sujette aux orages; les orages tourmentent les vaisseaux; les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote; un bon pilote a de la prudence; la prudence n'est pas dans les jeunes gens; les jeunes gens doivent obéissance aux vieux; les vieux aiment les richesses; les richesses font les riches; les riches ne sont pas pauvres; les pauvres ont de la nécessité; la nécessité n'a point de loi; qui n'a pas de loi vit en bête brute, et, par conséquent, vous serez damné à tous les diables.
DON JUAN.
O le beau raisonnement!
SGANARELLE.
Après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous.
SCÈNE III.—DON CARLOS, DON JUAN, SGANARELLE.
DON CARLOS.
Don Juan, je vous trouve à propos, et suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous, pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde, et que je me suis, en votre présence, chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le cèle point, je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur; et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie, et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme.
DON JUAN, d'un ton hypocrite.
Hélas! je voudrois bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez; mais le ciel s'y oppose directement; il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie, et je n'ai point d'autres pensées maintenant que de quitter entièrement tous les attachemens du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, et de corriger désormais, par une austère conduite, tous les déréglemens criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse.
DON CARLOS.
Ce dessein, don Juan, ne choque point ce que je dis; et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire.
DON JUAN.
Hélas! point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris; elle a résolu sa retraite, et nous avons été touchés tous deux en même temps.
DON CARLOS.
Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille; et notre honneur demande qu'elle vive avec vous.
DON JUAN.
Je vous assure que cela ne se peut. J'en avois, pour moi, toutes les envies du monde, et je me suis même encore aujourd'hui 76 conseillé[28] au ciel pour cela; mais, lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devois point songer à votre sœur, et qu'avec elle assurément je ne ferois point mon salut.
DON CARLOS.
Croyez-vous, don Juan, nous éblouir par ces belles excuses?
DON JUAN.
J'obéis à la voix du ciel.
DON CARLOS.
Quoi! vous voulez que je me paye d'un semblable discours?
DON JUAN.
C'est le ciel qui le veut ainsi.
DON CARLOS.
Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite?
DON JUAN.
Le ciel l'ordonne de la sorte.
DON CARLOS.
Nous souffrirons cette tache en notre famille?
DON JUAN.
Prenez-vous-en au ciel.
DON CARLOS.
Et quoi! toujours le ciel!
DON JUAN.
Le ciel le souhaite comme cela.
DON CARLOS.
Il suffit, don Juan, je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre, et le lieu ne le souffre pas; mais, avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver.
DON JUAN.
Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur, et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent; mais je vous déclare, pour moi, que ce n'est point moi qui me veux battre: 77 le ciel m'en défend la pensée; et, si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera.
DON CARLOS.
Nous verrons, de vrai, nous verrons.
SCÈNE IV.—DON JUAN, SGANARELLE.
SGANARELLE.
Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pis que le reste, et je vous aimerois bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérois toujours de votre salut; mais c'est maintenant que j'en désespère; et je crois que le ciel, qui vous a souffert jusques ici, ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur.
DON JUAN.
Va, va, le ciel n'est pas si exact que tu penses; et, si toutes les fois que les hommes...
SCÈNE V.—DON JUAN, SGANARELLE, UN SPECTRE, en femme voilée.
SGANARELLE, apercevant le spectre.
Ah! monsieur, c'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne.
DON JUAN.
Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende.
LE SPECTRE.
Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel; et, s'il ne se repent ici, sa perte est résolue.
SGANARELLE.
Entendez-vous, monsieur?
DON JUAN.
Qui ose tenir ces paroles? Je crois connoître cette voix.
SGANARELLE.
Ah! monsieur, c'est un spectre, je le reconnois au marcher.
DON JUAN.
Spectre, fantôme, ou diable, je veux voir ce que c'est.
Le spectre change de figure et représente le Temps avec sa faux à la main.
SGANARELLE.
O ciel! Voyez-vous, monsieur, ce changement de figure?
DON JUAN.
Non, non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur; et je veux éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit.
Le spectre s'envole dans le temps que don Juan veut le frapper.
SGANARELLE.
Ah! monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir!
DON JUAN.
Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi!
SCÈNE VI.—LA STATUE DU COMMANDEUR, DON JUAN, SGANARELLE.
LA STATUE.
Arrêtez, don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi.
DON JUAN.
Oui. Où faut-il aller?
LA STATUE.
Donnez-moi la main.
DON JUAN.
La voilà.
LA STATUE.
Don Juan, l'endurcissement au péché trame une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre.
DON JUAN.
O ciel! que sens-je? un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent! Ah!
Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur don Juan. La terre s'ouvre et l'abîme, et il sort de grands feux de l'endroit où il est tombé.
SCÈNE VII.—SGANARELLE.
Ah! mes gages! mes gages! Voilà, par sa mort, un chacun satisfait. Ciel offensé, lois violées, filles séduites, familles déshonorées, parens outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le monde est content; il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages, mes gages, mes gages!
FIN DU FESTIN DE PIERRE.
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS A VERSAILLES, LE 15 SEPTEMBRE 1665 ET A PARIS, SUR LE THÉATRE DU PALAIS-ROYAL, LE 22 DU MÊME MOIS.
Trois mois après la représentation du Festin de Pierre, Louis XIV ayant demandé à Molière un divertissement nouveau, lui donna cinq jours pour l'inventer, l'écrire, le faire apprendre et le faire jouer.
C'est de cet impromptu en trois actes, divisés par des danses, que Molière fit ensuite un seul acte en supprimant les ballets dont Lulli avait composé la musique. C'est un chef-d'œuvre en son genre que cette esquisse improvisée.
Il y avait peu de temps que Bacon avait recommandé l'étude de la nature, l'observation et l'expérience. Les médecins tenaient encore au moyen âge. C'étaient des grands-prêtres ou plutôt des sorciers qui employaient les amulettes, les pierres de sympathie et les chiffres magiques, parlaient latin, grec et hébreu, enseignaient les propriétés merveilleuses des chiffres et des nombres, et couraient la ville, montés sur leurs mules, affublés d'énormes manteaux et de chapeaux pointus, cachés sous de longues perruques, ensevelis dans le satin et la fourrure. Ces personnages astrologiques, représentants de la superstition sans la foi, déjà criblés des flèches de Rabelais et de Montaigne, et qui n'avaient pour se défendre ni l'autorité de la Sorbonne ni les dogmes de l'Église, s'étaient donnés récemment en spectacle ridicule. La bouffonnerie de leurs querelles particulières, les 81 procès intéressés entre apothicaires et médecins, provoquaient le mépris public et annonçaient la mort prochaine de l'empirisme. On avait vu, près du lit de mort de Mazarin, Desfougerais, Vallot, Brayer et Guénaud, se réunir à Vincennes et s'enquérir gravement de sa maladie. Vallot plaçait la maladie au poumon, Brayer à la rate, Desfougerais au mésentère, et Guénaud au foie. Ce dernier eut le dessus et emporta le malade.
«Laissons passer M. le docteur, s'écriait un jour un charretier parisien qui voyait venir à lui la mule de Guénaud: c'est lui qui nous a fait la grâce de tuer le cardinal;» tant le mépris de la médecine était devenu une opinion populaire. Guy-Patin et Gassendi avaient soulevé contre eux et leur hypocrisie doctorale l'indignation des classes élevées; Boileau et Pascal marchaient contre eux. Ce n'était pas à la médecine, mais au mensonge du savoir, que l'on en voulait; «déniaisés, désabusés,» esprits forts, tous ceux qui, comme Guy-Patin, s'étaient «débarrassés du sot,» prenaient parti avec Molière contre l'empirisme. Ce fut Boileau qui créa les noms grecs sous lesquels Molière ridiculisa, dans sa nouvelle farce, les quatre premiers médecins de la cour: vive jouissance pour le vieux Guy-Patin; s'il faut même l'en croire, on fabriqua des masques comiques représentant le visage des quatre empiriques sacrifiés.
Il faut reléguer parmi les fables ces anecdotes apocryphes d'après lesquelles Molière aurait vengé sur la Faculté les querelles particulières de deux femmes de la troupe. Les motifs du grand écrivain étaient plus profonds et plus naturels. Ses passions et ses études avaient altéré sa santé. Il travaillait beaucoup, souffrait infiniment; sa poitrine était attaquée, et, forcé de demander secours aux Hippocrates du temps, vivant de régime, mais mourant de ses passions, il ne tarda pas à découvrir le néant de leur art et le vide de leurs prétentions. Il venait d'éprouver qu'il était difficile d'attaquer les courtisans et dangereux d'attaquer la Sorbonne; il retomba sur les médecins, et leur fit éprouver toute la force de son génie.
AU LECTEUR
Ce n'est ici qu'un simple crayon, un petit impromptu dont le roi a voulu se faire un divertissement. Il est le plus précipité de tous ceux que Sa Majesté m'ait commandés; et, lorsque je dirai qu'il a été proposé, fait, appris et représenté en cinq jours, je ne dirai que ce qui est vrai. Il n'est pas nécessaire de vous avertir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées, et je ne conseille de lire celle-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir, dans la lecture, tout le jeu du théâtre. Ce que je vous dirai, c'est qu'il seroit à souhaiter que ces sortes d'ouvrages pussent toujours se montrer à vous avec les ornemens qui les accompagnent chez le roi. Vous les verriez dans un état beaucoup plus supportable; et les airs et les symphonies de l'incomparable M. Lulli mêlés à la beauté des voix et à l'adresse des danseurs, leur donnent sans doute des grâces dont ils ont toutes les peines du monde à se passer.
| PERSONNAGES DU PROLOGUE. | ||
| LA COMÉDIE. | ||
| LA MUSIQUE. | ||
| LE BALLET. |
||
| PERSONNAGES DE LA COMÉDIE. | ||
| SGANARELLE, père de Lucinde. | ||
| LUCINDE, fille de Sganarelle. | ||
| CLITANDRE, amant de Lucinde. | ||
| AMINTE, voisine de Sganarelle. | ||
| LUCRÈCE, nièce de Sganarelle. | ||
| LISETTE, suivante de Lucinde. | ||
| M. GUILLAUME, marchand de tapisseries. | ||
| M. JOSSE, orfévre. | ||
| M. TOMÈS, | médecins[29]. | |
| M. DESFONANDRÈS, | ||
| M. MACROTON, | ||
| M. BAHIS, | ||
| M. FILERIN. | ||
| UN NOTAIRE. | ||
| CHAMPAGNE, valet de Sganarelle. |
||
| PERSONNAGES DU BALLET. | ||
| PREMIÈRE ENTRÉE. | ||
| CHAMPAGNE, valet de Sganarelle, dansant. | ||
| QUATRE MÉDECINS, dansants. | ||
| DEUXIÈME ENTRÉE. | ||
| UN OPÉRATEUR, chantant. | ||
| TRIVELINS et SCARAMOUCHES, dansants, de la suite de l'opérateur. | ||
| TROISIÈME ENTRÉE. | ||
| LA COMÉDIE. | ||
| LA MUSIQUE. | ||
| LE BALLET. | ||
| JEUX, RIS, PLAISIRS, dansants. | ||
| La scène est à Paris. | ||
LA COMÉDIE.
TOUS TROIS ENSEMBLE.
LA MUSIQUE.
LE BALLET.
TOUS TROIS ENSEMBLE.
ACTE PREMIER
SCÈNE I.—SGANARELLE, AMINTE, LUCRÈCE, M. GUILLAUME, M. JOSSE.
SGANARELLE.
Ah! l'étrange chose que la vie! et que je puis bien dire, avec ce grand philosophe de l'antiquité, que qui terre a guerre a, et qu'un malheur ne vient jamais sans l'autre! Je n'avais qu'une seule femme, qui est morte.
M. GUILLAUME.
Et combien donc en voulez-vous avoir?
SGANARELLE.
Elle est morte, monsieur Guillaume, mon ami. Cette perte m'est très-sensible, et je ne puis m'en ressouvenir sans pleurer. Je n'étois pas fort satisfait de sa conduite, et nous avions le plus souvent dispute ensemble; mais enfin la mort rajuste toutes choses. Elle est morte; je la pleure. Si elle étoit en vie, nous nous querellerions. De tous les enfans que le ciel m'avoit donnés, il ne m'a laissé qu'une fille, et cette fille est toute ma peine; car enfin je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde, dans une tristesse épouvantable, dont il n'y a pas moyen de la retirer, et dont je ne saurois même apprendre la cause. Pour moi, j'en perds 85 l'esprit, et j'aurois besoin d'un bon conseil sur cette matière. (A Lucrèce.) Vous êtes ma nièce (à Aminte); vous, ma voisine (à M. Guillaume et à M. Josse); et vous, mes compères et mes amis; je vous prie de me conseiller tous ce que je dois faire.
M. JOSSE.
Pour moi, je tiens que la braverie[30] et l'ajustement est la chose qui réjouit le plus les filles; et, si j'étois que de vous, je lui achèterois, dès aujourd'hui, une belle garniture de diamans, ou de rubis, ou d'émeraudes.
M. GUILLAUME.
Et moi, si j'étois en votre place, j'achèterois une belle tenture de tapisserie de verdure, ou à personnages, que je ferois mettre à sa chambre, pour lui réjouir l'esprit et la vue.
AMINTE.
Pour moi, je ne ferois pas tant de façons, et je la marierois fort bien, et le plus tôt que je pourrois, avec cette personne qui vous la fit, dit-on, demander il y a quelque temps.
LUCRÈCE.
Et moi, je tiens que votre fille n'est point du tout propre pour le mariage. Elle est d'une complexion trop délicate et trop peu saine, et c'est la vouloir envoyer bientôt en l'autre monde, que de l'exposer, comme elle est, à faire des enfans. Le monde n'est point du tout son fait, et je vous conseille de la mettre dans un couvent, où elle trouvera des divertissemens qui seront mieux de son humeur.
SGANARELLE.
Tous ces conseils sont admirables, assurément; mais je les tiens un peu intéressés, et trouve que vous me conseillez fort bien pour vous. Vous êtes orfèvre, monsieur Josse; et votre conseil sent son homme qui a envie de se défaire de sa marchandise. Vous vendez des tapisseries, monsieur Guillaume, et vous avez la mine d'avoir quelque tenture qui vous incommode. Celui que vous aimez, ma voisine, a, dit-on, quelque inclination pour ma fille; et vous ne seriez pas fâchée de la voir la femme d'un autre. Et quant à vous, ma chère nièce, ce n'est pas mon dessein, comme on sait, de marier ma fille avec qui que ce soit, et j'ai mes raisons 86 pour cela; mais le conseil que vous me donnez de la faire religieuse est d'une femme qui pourroit bien souhaiter charitablement d'être mon héritière universelle. Ainsi, messieurs et mesdames, quoique tous vos conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon, s'il vous plaît, que je n'en suive aucun. (Seul.) Voilà de mes donneurs de conseils à la mode!
SCÈNE II.—LUCINDE, SGANARELLE.
SGANARELLE.
Ah! voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas, Elle soupire; elle lève les yeux au ciel. (A Lucinde.) Dieu vous garde! Bonjour, ma mie. Eh bien, qu'est-ce? Comme vous en va? Eh quoi! toujours triste et mélancolique comme cela, et tu ne veux pas me dire ce que tu as? Allons donc, découvre-moi ton petit cœur! Là, ma pauvre mie, dis, dis, dis tes petites pensées à ton petit papa mignon. Courage! veux-tu que je te baise? Viens. (A part.) J'enrage de la voir de cette humeur-là. (A Lucinde.) Mais, dis-moi, me veux-tu faire mourir de déplaisir, et ne puis-je savoir d'où vient cette grande langueur? Découvre-m'en la cause, et je te promets que je ferai toutes choses pour toi. Oui, tu n'as qu'à me dire le sujet de ta tristesse; je t'assure ici, et te fais serment qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire; c'est tout dire. Est-ce que tu es jalouse de quelqu'une de tes compagnes que tu voies plus brave que toi? et seroit-il quelque étoffe nouvelle dont tu voulusses avoir un habit? Non. Est-ce que ta chambre ne te semble pas assez parée, et que tu souhaiterois quelque cabinet[31] de la foire Saint-Laurent? Ce n'est pas cela. Aurois-tu envie d'apprendre quelque chose, et veux-tu que je te donne un maître pour te montrer à jouer du clavecin? Nenni. Aimerois-tu quelqu'un, et souhaiterois-tu d'être mariée?
Lucinde fait signe que oui.
SCÈNE III.—SGANARELLE, LUCINDE, LISETTE.
LISETTE.
Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille: avez-vous su la cause de sa mélancolie?
SGANARELLE.
Non. C'est une coquine qui me fait enrager.
LISETTE.
Monsieur, laissez-moi faire; je m'en vais la sonder un peu.
SGANARELLE.
Il n'est pas nécessaire; et, puisqu'elle veut être de cette humeur, je suis d'avis qu'on l'y laisse.
LISETTE.
Laissez-moi faire, vous dis-je! Peut-être qu'elle se découvrira plus librement à moi qu'à vous. Quoi! madame, vous ne nous direz point ce que vous avez, et vous voulez affliger ainsi tout le monde? Il me semble qu'on n'agit point comme vous faites, et que, si vous avez quelque répugnance à vous expliquer à un père, vous n'en devez avoir aucune à me découvrir votre cœur. Dites-moi, souhaitez-vous quelque chose de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu'il n'épargneroit rien pour vous contenter. Est-ce qu'il ne vous donne pas toute la liberté que vous souhaiteriez? et les promenades et les cadeaux[32] ne tenteroient-ils point votre âme? Eh! avez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un? Eh! n'auriez-vous point quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous mariât? Ah! je vous entends; voilà l'affaire. Que diable! pourquoi tant de façons? Monsieur, le mystère est découvert, et...
SGANARELLE.
Va, fille ingrate, je ne te veux plus parler, et je te laisse dans ton obstination.
LUCINDE.
Mon père, puisque vous voulez que je vous dise la chose...
SGANARELLE.
Oui, je perds toute l'amitié que j'avois pour toi.
LISETTE.
Monsieur, sa tristesse...
SGANARELLE.
C'est une coquine qui me veut faire mourir.
LUCINDE.
Mon père, je veux bien...
SGANARELLE.
Ce n'est pas la récompense de t'avoir élevée comme j'ai fait.
LISETTE.
Mais, monsieur...
SGANARELLE.
Non, je suis contre elle dans une colère épouvantable.
LUCINDE.
Mais, mon père...
SGANARELLE.
Je n'ai plus aucune tendresse pour toi.
LISETTE.
Mais...
SGANARELLE.
C'est une friponne!
LUCINDE.
Mais...
SGANARELLE.
Une ingrate!
LISETTE.
Mais...
SGANARELLE.
Une coquine, qui ne me veut pas dire ce qu'elle a.
LISETTE.
C'est un mari qu'elle veut.
SGANARELLE, faisant semblant de ne pas entendre.
Je l'abandonne.
LISETTE.
Un mari!
SGANARELLE.
Je la déteste!
LISETTE.
Un mari.
SGANARELLE.
Et la renonce pour ma fille!
LISETTE.
Un mari.
SGANARELLE.
Non, ne m'en parlez point!
LISETTE.
Un mari.
SGANARELLE.
Ne m'en parlez point.
LISETTE.
Un mari.
SGANARELLE.
Ne m'en parlez point!
LISETTE.
Un mari, un mari, un mari!
SCÈNE IV.—LUCINDE, LISETTE.
LISETTE.
On dit bien vrai, qu'il n'y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent point entendre.
LUCINDE.
Eh bien, Lisette, j'avois tort de cacher mon déplaisir, et je n'avois qu'à parler pour avoir tout ce que je souhaitois de mon père! Tu le vois.
LISETTE.
Par ma foi, voilà un vilain homme; et je vous avoue que j'aurois un plaisir extrême à lui jouer quelque tour. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici vous m'avez caché votre mal?
LUCINDE.
Hélas! de quoi m'auroit servi de te le découvrir plus tôt? et n'aurois-je pas autant gagné à le tenir caché toute ma vie? Crois-tu que je n'aie pas bien prévu tout ce que tu vois maintenant, que je ne susse pas à fond tous les sentimens de mon père, et que le refus qu'il a fait porter à celui 90 qui m'a demandée par un ami n'ait pas étouffé dans mon âme toute sorte d'espoir?
LISETTE.
Quoi! c'est cet inconnu qui vous fait demander, pour qui vous...?
LUCINDE.
Peut-être n'est-il pas honnête à une jeune fille de s'expliquer si librement; mais enfin je t'avoue que, s'il m'étoit permis de vouloir quelque chose, ce seroit lui que je voudrois. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation, et sa bouche ne m'a point déclaré la passion qu'il a pour moi; mais, dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards et ses actions m'ont toujours parlé si tendrement, et la demande qu'il a fait faire de moi m'a paru d'un si honnête homme, que mon cœur n'a pu s'empêcher d'être sensible à ses ardeurs; et, cependant, tu vois où la dureté de mon père réduit toute cette tendresse.
LISETTE.
Allez, laissez-moi faire. Quelque sujet que j'aie de me plaindre de vous du secret que vous m'avez fait, je ne veux pas laisser de servir votre amour; et, pourvu que vous ayez assez de résolution...
LUCINDE.
Mais que veux-tu que je fasse contre l'autorité d'un père? Et s'il est inexorable à mes vœux...
LISETTE.
Allez, allez, il ne faut pas se laisser mener comme un oison, et, pourvu que l'honneur n'y soit pas offensé, on peut se libérer un peu de la tyrannie d'un père. Que prétend-il que vous fassiez? N'êtes-vous pas en âge d'être mariée? et croit-il que vous soyez de marbre? Allez, encore un coup, je veux servir votre passion; je prends, dès à présent, sur moi tout le soin de ses intérêts, et vous verrez que je sais des détours... Mais je vois votre père. Rentrons, et me laissez agir.
SCÈNE V.—SGANARELLE.
Il est bon quelquefois de ne point faire semblant d'entendre les choses qu'on n'entend que trop bien; et j'ai fait sagement 91 de parer la déclaration d'un désir que je ne suis pas résolu de contenter. A-t-on jamais rien vu de plus tyrannique que cette coutume où l'on veut assujettir les pères, rien de plus impertinent et de plus ridicule que d'amasser du bien avec de grands travaux, et d'élever une fille avec beaucoup de soin et de tendresse, pour se dépouiller de l'un et de l'autre entre les mains d'un homme qui ne nous touche de rien? Non, non; je me moque de cet usage, et je veux garder mon bien et ma fille pour moi.
SCÈNE VI.—SGANARELLE, LISETTE.
LISETTE, courant sur le théâtre et feignant de ne pas voir Sganarelle.
Ah! malheur! ah! disgrâce! Ah! pauvre seigneur Sganarelle! où pourrai-je te rencontrer?
SGANARELLE, à part.
Que dit-elle là?
LISETTE, courant toujours.
Ah! misérable père! que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle?
SGANARELLE, à part.
Que sera-ce?
LISETTE.
Ma pauvre maîtresse!
SGANARELLE, à part.
Je suis perdu!
LISETTE.
Ah!
SGANARELLE, courant après Lisette.
Lisette!
LISETTE.
Quelle infortune!
SGANARELLE.
Lisette!
LISETTE.
Quel accident!
SGANARELLE.
Lisette!
LISETTE.
Quelle fatalité!
SGANARELLE.
Lisette!
LISETTE, s'arrêtant.
Ah! monsieur!
SGANARELLE.
Qu'est-ce?
LISETTE.
Monsieur!
SGANARELLE.
Qu'y a-t-il?
LISETTE.
Votre fille...
SGANARELLE.
Ah! ah!
LISETTE.
Monsieur, ne pleurez donc point comme cela, car vous me feriez rire.
SGANARELLE.
Dis donc vite!
LISETTE.
Votre fille, toute saisie des paroles que vous lui avez dites, et de la colère effroyable où elle vous a vu contre elle, est montée vite dans sa chambre, et, pleine de désespoir, a ouvert la fenêtre qui regarde sur la rivière.
SGANARELLE.
Eh bien?
LISETTE.
Alors, levant les yeux au ciel: «Non, a-t-elle dit, il m'est impossible de vivre avec le courroux de mon père; et, puisqu'il me renonce pour sa fille, je veux mourir.»
SGANARELLE.
Elle s'est jetée?
LISETTE.
Non, monsieur. Elle a fermé tout doucement la fenêtre, et s'est allée mettre sur son lit. Là, elle s'est prise à pleurer amèrement; et tout d'un coup son visage a pâli, ses yeux se sont tournés, le cœur lui a manqué, et elle m'est demeurée entre les bras.
SGANARELLE.
Ah! ma fille! [Elle est morte?
LISETTE.
Non, monsieur][33]. A force de la tourmenter, je l'ai fait revenir; mais cela lui reprend de moment en moment, et je crois qu'elle ne passera pas la journée.
SGANARELLE.
Champagne! Champagne! Champagne!
SCÈNE VII.—SGANARELLE, CHAMPAGNE, LISETTE.
SGANARELLE.
Vite, qu'on m'aille quérir des médecins, et en quantité. On n'en peut trop avoir dans une pareille aventure. Ah! ma fille! ma pauvre fille!
PREMIÈRE ENTRÉE.
SCÈNE VIII.
Champagne, valet de Sganarelle, frappe, en dansant, aux portes de quatre médecins.
SCÈNE IX.
Les quatre médecins dansent et entrent avec cérémonie chez Sganarelle.
ACTE II
SCÈNE I.—SGANARELLE, LISETTE.
LISETTE.
Que voulez-vous donc faire, monsieur, de quatre médecins? N'est-ce pas assez d'un pour tuer une personne?
SGANARELLE.
Taisez-vous. Quatre conseils valent mieux qu'un.
LISETTE.
Est-ce que votre fille ne peut pas bien mourir sans le secours de ces messieurs-là?
SGANARELLE.
Est-ce que les médecins font mourir?
LISETTE.
Sans doute; et j'ai connu un homme qui prouvoit, par bonnes raisons, qu'il ne faut jamais dire: Une telle personne est morte d'une fièvre et d'une fluxion sur la poitrine; mais: Elle est morte de quatre médecins et de deux apothicaires.
SGANARELLE.
Chut! n'offensez pas ces messieurs-là.
LISETTE.
Ma foi, monsieur, notre chat est réchappé depuis peu d'un saut qu'il fit du haut de la maison dans la rue; et il fut trois jours sans manger et sans pouvoir remuer ni pied ni patte; mais il est bien heureux de ce qu'il n'y a point de chats médecins, car ses affaires étoient faites, et il n'auroit pas manqué de le purger et de le saigner.
SGANARELLE.
Voulez-vous vous taire, vous dis-je! Mais voyez quelle impertinence! Les voici.
LISETTE.
Prenez garde, vous allez être bien édifié. Ils vous diront en latin que votre fille est malade.
SCÈNE II.—MM. TOMÈS, DESFONANDRÈS, MACROTON, BAHIS, SGANARELLE, LISETTE.
SGANARELLE.
Eh bien, messieurs?
M. TOMÈS[34].
Nous avons vu suffisamment la malade, et sans doute qu'il y a beaucoup d'impuretés en elle.
SGANARELLE.
Ma fille est impure?
M. TOMÈS.
Je veux dire qu'il y a beaucoup d'impuretés dans son corps, quantité d'humeurs corrompues.
SGANARELLE.
Ah! je vous entends.
M. TOMÈS.
Mais... Nous allons consulter ensemble.
SGANARELLE.
Allons, faites donner des siéges.
LISETTE, à M. Tomès.
Ah! monsieur, vous en êtes!
SGANARELLE, à Lisette.
De quoi donc connoissez-vous monsieur?
LISETTE.
De l'avoir vu l'autre jour chez la bonne amie de madame votre nièce.
M. TOMÈS.
Comment se porte son cocher?
LISETTE.
Fort bien. Il est mort.
M. TOMÈS.
Mort?
LISETTE.
Oui.
M. TOMÈS.
Cela ne se peut.
LISETTE.
Je ne sais pas si cela se peut, mais je sais bien que cela est.
M. TOMÈS.
Il ne peut pas être mort, vous dis-je.
LISETTE.
Et moi, je vous dis qu'il est mort et enterré.
M. TOMÈS.
Vous vous trompez.
LISETTE.
Je l'ai vu.
M. TOMÈS.
Cela est impossible. Hippocrate dit que ces sortes de maladies 96 ne se terminent qu'au quatorze ou au vingt-un; et il n'y a que six jours qu'il est tombé malade.
LISETTE.
Hippocrate dira ce qu'il lui plaira; mais le cocher est mort.
SGANARELLE.
Paix, discoureuse! allons, sortons d'ici! Messieurs, je vous supplie de consulter la bonne manière. Quoique ce ne soit pas la coutume de payer auparavant, toutefois, de peur que je l'oublie, et afin que ce soit une affaire faite, voici...
Il leur donne de l'argent, et chacun, en le recevant, fait un geste différent.
SCÈNE III.—MM. DESFONANDRÈS, TOMÈS, MACROTON, BAHIS, ils s'asseyent et toussent.
M. DESFONANDRÈS[35].
Paris est étrangement grand, et il faut faire de longs trajets quand la pratique donne un peu.
M. TOMÈS.
Il faut avouer que j'ai une mule admirable pour cela, et qu'on a peine à croire le chemin que je lui fais faire tous les jours.
M. DESFONANDRÈS.
J'ai un cheval merveilleux, et c'est un animal infatigable.
M. TOMÈS.
Savez-vous le chemin que ma mule a fait aujourd'hui? J'ai été, premièrement, tout contre l'Arsenal; de l'Arsenal, au bout du faubourg Saint-Germain, du faubourg Saint-Germain, au fond du Marais; du fond du Marais, à la porte Saint-Honoré; de la porte Saint-Honoré, au faubourg Saint-Jacques; du faubourg Saint-Jacques, à la porte de Richelieu[36]; de la porte de Richelieu, ici; et d'ici je dois aller encore à la place Royale.
M. DESFONANDRÈS.
Mon cheval a fait tout cela aujourd'hui; et de plus j'ai été à Ruel voir un malade.
M. TOMÈS.
Mais, à propos, quel parti prenez-vous dans la querelle des deux médecins Théophraste et Artémius? car c'est une affaire qui partage tout notre corps.
M. DESFONANDRÈS.
Moi, je suis pour Artémius.
M. TOMÈS.
Et moi aussi. Ce n'est pas que son avis, comme on a vu, n'ait tué le malade, et que celui de Théophraste ne fût beaucoup meilleur assurément; mais enfin il a tort dans les circonstances, et il ne devoit pas être d'un autre avis que son ancien. Qu'en dites-vous?
M. DESFONANDRÈS.
Sans doute. Il faut toujours garder les formalités, quoi qu'il puisse arriver.
M. TOMÈS.
Pour moi, j'y suis sévère en diable, à moins que ce soit entre amis; et l'on nous assembla, un jour, trois de nous autres, avec un médecin de dehors, pour une consultation où j'arrêtai toute l'affaire, et ne voulus point endurer qu'on opinât, si les choses n'alloient dans l'ordre. Les gens de la maison faisoient ce qu'ils pouvoient, et la maladie pressoit; mais je n'en voulus point démordre, et la malade mourut bravement pendant cette contestation.
M. DESFONANDRÈS.
C'est fort bien fait d'apprendre aux gens à vivre et de leur montrer leur bec jaune[37].
M. TOMÈS.
Un homme mort n'est qu'un homme mort, et ne fait point de conséquence; mais une formalité négligée porte un notable préjudice à tout le corps des médecins.
SCÈNE IV.—SGANARELLE, MM. TOMÈS, DESFONANDRÈS, MACROTON, BAHIS.
SGANARELLE.
Messieurs, l'oppression de ma fille augmente; je vous prie de me dire vite ce que vous avez résolu.
M. TOMÈS, à M. Desfonandrès.
Allons, monsieur.
M. DESFONANDRÈS.
Non, monsieur; parlez, s'il vous plaît.
M. TOMÈS.
Vous vous moquez.
M. DESFONANDRÈS.
Je ne parlerai pas le premier.
M. TOMÈS.
Monsieur...
M. DESFONANDRÈS.
Monsieur...
SGANARELLE.
Eh! de grâce, messieurs, laissez toutes ces cérémonies, et songez que les choses pressent.
Ils parlent tous quatre à la fois.
M. TOMÈS.
La maladie de votre fille...
M. DESFONANDRÈS.
L'avis de tous ces messieurs tous ensemble...
M. MACROTON[38].
A-près a-voir bi-en con-sul-té.
M. BAHIS[39].
Pour raisonner...
SGANARELLE.
Eh! messieurs, parlez l'un après l'autre, de grâce.
M. TOMÈS.
Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille, et mon avis, à moi, est que cela procède d'une grande chaleur de sang: ainsi je conclus à la saigner le plus tôt que vous pourrez.
M. DESFONANDRÈS.
Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d'humeurs causée par une trop grande réplétion; ainsi je conclus à lui donner de l'émétique.
M. TOMÈS.
Je soutiens que l'émétique la tuera.
M. DESFONANDRÈS.
Et moi, que la saignée la fera mourir.
M. TOMÈS.
C'est bien à vous de faire l'habile homme!
M. DESFONANDRÈS.
Oui, c'est à moi; et je vous prêterai le collet[40] en tout genre d'érudition.
M. TOMÈS.
Souvenez-vous de l'homme que vous fîtes crever ces jours passés.
M. DESFONANDRÈS.
Souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée en l'autre monde il y a trois jours.
M. TOMÈS, à Sganarelle.
Je vous ai dit mon avis.
M. DESFONANDRÈS, à Sganarelle.
Je vous ai dit ma pensée.
M. TOMÈS.
Si vous ne faites saigner tout à l'heure votre fille, c'est une personne morte.
Il sort.
M. DESFONANDRÈS.
Si vous la faites saigner, elle ne sera pas en vie dans un quart d'heure.
Il sort.
SCÈNE V.—SGANARELLE, MM. MACROTON, BAHIS.
SGANARELLE.
A qui croire des deux? et quelle résolution prendre sur des avis si opposés? Messieurs, je vous conjure de déterminer mon esprit, et de me dire, sans passion, ce que vous croyez le plus propre à soulager ma fille.
M. MACROTON.
Mon-si-eur, dans ces ma-ti-è-res-là, il faut pro-cé-der a-vec-que cir-con-spec-tion, et ne ri-en fai-re, com-me on dit, à la vo-lé-e, d'au-tant que les fau-tes qu'on y peut fai-re sont, se-lon no-tre maî-tre Hip-po-cra-te, d'u-ne dange-reu-se con-sé-quen-ce.
M. BAHIS, bredouillant.
Il est vrai, il faut bien prendre garde à ce qu'on fait; car ce ne sont pas ici des jeux d'enfant; et, quand on a failli, il n'est pas aisé de réparer le manquement, et de rétablir ce qu'on a gâté: experimentum periculosum. C'est pourquoi il s'agit de raisonner auparavant comme il faut, de peser mûrement les choses, de regarder le tempérament des gens, d'examiner les causes de la maladie, et de voir les remèdes qu'on y doit apporter.
SGANARELLE, à part.
L'un va en tortue, et l'autre court la poste.
M. MACROTON.
Or, mon-si-eur, pour ve-nir au fait, je trou-ve que vo-tre fil-le a u-ne ma-la-di-e chro-ni-que, et qu'el-le peut pé-ri-cli-ter, si on ne lui don-ne du se-cours, d'au-tant que les symp-tô-mes qu'el-le a sont in-di-ca-tifs d'u-ne va-peur fu-li-gi-neu-se et mor-di-can-te qui lui pi-co-te les mem-bra-nes du cer-veau. Or cet-te va-peur, que nous nom-mons en grec at-mos, est cau-sé-e par des hu-meurs pu-tri-des, te-na-ces et con-glu-ti-neu-ses, qui sont con-te-nu-es dans le bas-ven-tre.
M. BAHIS.
Et, comme ces humeurs ont été là engendrées par une longue succession de temps, elles s'y sont recuites, et ont acquis cette malignité qui fume vers la région du cerveau.
M. MACR0T0N.
Si bi-en donc que, pour ti-rer, dé-ta-cher, ar-ra-cher, ex-pul-ser, é-va-cu-er les-di-tes hu-meurs, il fau-dra u-ne pur-ga-ti-on vi-gou-reu-se. Mais, au pré-a-la-ble, je trou-ve à pro-pos, et il n'y a pas d'in-con-vé-ni-ent, d'u-ser de pe-tits re-mè-des a-no-dins, c'est-à-di-re, de pe-tits la-ve-mens ré-mol-li-ents et dé-ter-sifs, de ju-leps et de si-rops ra-fraî-chis-sants qu'on mê-le-ra dans sa ti-sa-ne.
M. BAHIS.
Après, nous en viendrons à la purgation et à la saignée, que nous réitérerons s'il en est besoin.
M. MACROTON.
Ce n'est pas qu'a-vec-que tout ce-la vo-tre fil-le ne puis-se mou-rir; mais au moins vous au-rez fait quel-que cho-se, et vous au-rez la con-so-la-ti-on qu'el-le se-ra mor-te dans les for-mes.
M. BAHIS.
Il vaut mieux mourir selon les règles que de réchapper contre les règles.
M. MACROTON.
Nous vous di-sons sin-cè-re-ment no-tre pen-sée.
M. BAHIS.
Et nous avons parlé comme nous parlerions à notre propre frère.
SGANARELLE, à M. Macroton, en allongeant ses mots.
Je vous rends très-hum-bles grâ-ces. (A M. Bahis, en bredouillant.) Et vous suis infiniment obligé de la peine que vous avez prise[41].
SCÈNE VI.—SGANARELLE.
Me voilà justement un peu plus incertain que je n'étois auparavant. Morbleu! il me vient une fantaisie; il faut que j'aille acheter de l'orviétan[42] et que je lui en fasse prendre. L'orviétan est un remède dont beaucoup de gens se sont bien trouvés. Holà!
DEUXIÈME ENTRÉE.
SCÈNE VII—SGANARELLE, UN OPÉRATEUR.
SGANARELLE.
Monsieur, je vous prie de me donner une boîte de votre orviétan, que je m'en vais vous payer.
L'OPÉRATEUR, chante.
SGANARELLE.
Monsieur, je crois que tout l'or du monde n'est pas capable de payer votre remède; mais pourtant voici une pièce de trente sous que vous prendrez, s'il vous plaît.
L'OPÉRATEUR, chante.
SCÈNE VIII.
Plusieurs trivelins et plusieurs scaramouches, valets de l'opérateur, se réjouissent en dansant.
ACTE III
SCÈNE I.—MM. FILERIN, TOMÈS, DESFONANDRÈS.
M. FILERIN[43].
N'avez-vous point de honte, messieurs, de montrer si peu de prudence, pour des gens de votre âge, et de vous être querellés comme de jeunes étourdis? Ne voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde? et n'est-ce pas assez que les savans voient les contrariétés et les dissensions qui sont entre nos auteurs et nos anciens maîtres, sans découvrir encore au peuple, par nos débats et nos querelles, la forfanterie de notre art[44]? Pour moi, je ne comprends rien du tout à cette méchante politique de quelques-uns de nos gens; et il faut confesser que toutes ces contestations nous ont décriés depuis peu d'une étrange manière, et que, si nous n'y prenons garde, nous allons nous ruiner nous mêmes. Je n'en parle pas pour mon intérêt; car, Dieu merci! j'ai déjà établi mes petites affaires. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle, ceux qui sont morts sont morts, et j'ai de quoi me passer des vivants; mais enfin toutes ces disputes ne valent 104 rien pour la médecine. Puisque le ciel nous fait la grâce que, depuis tant de siècles, on demeure infatué de nous, ne désabusons point les hommes avec nos cabales extravagantes, et profitons de leurs sottises le plus doucement que nous pourrons. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous savez, qui tâchons à nous prévaloir de la faiblesse humaine. C'est là que va l'étude de la plupart du monde, et chacun s'efforce de prendre les hommes par leur foible, pour en tirer quelque profit. Les flatteurs, par exemple, cherchent à profiter de l'amour que les hommes ont pour les louanges, en leur donnant tout le vain encens qu'ils souhaitent; et c'est un art où l'on fait, comme on voit, des fortunes considérables. Les alchimistes tâchent à profiter de la passion que l'on a pour les richesses, en promettant des montagnes d'or à ceux qui les écoutent; et les diseurs d'horoscopes, par leurs prédictions trompeuses, profitent de la vanité et de l'ambition des crédules esprits. Mais le plus grand foible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie; et nous en profitons, nous autres par notre pompeux galimatias, et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. Conservons-nous donc dans le degré d'estime où leur foiblesse nous a mis, et soyons de concert auprès des malades, pour nous attribuer les heureux succès de la maladie, et rejeter sur la nature toutes les bévues de notre art. N'allons point, dis-je, détruire sottement les heureuses préventions d'une erreur qui donne du pain à tant de personnes (et, de l'argent de ceux que nous mettons en terre, nous fait élever de tous côtés de si beaux héritages.)
M. TOMÈS.
Vous avez raison en tout ce que vous dites: mais ce sont chaleurs de sang, dont parfois on n'est pas le maître.
M. FILERIN.
Allons donc, messieurs, mettez bas toute rancune, et faisons ici votre accommodement.
M. DESFONANDRÈS.
J'y consens. Qu'il me passe mon émétique pour la malade dont il s'agit, et je lui passerai tout ce qu'il voudra pour le premier malade dont il sera question.
M. FILERIN.
On ne peut pas mieux dire, et voilà se mettre à la raison.
M. DESFONANDRÈS.
Cela est fait.
M. FILERIN.
Touchez donc là. Adieu. Une autre fois, montrez plus de prudence.
SCÈNE II.—MM. TOMÈS, DESFONANDRÈS, LISETTE.
LISETTE.
Quoi! messieurs, vous voilà, et vous ne songez pas à réparer le tort qu'on vient de faire à la médecine?
M. TOMÈS.
Comment! Qu'est-ce?
LISETTE.
Un insolent, qui a eu l'effronterie d'entreprendre sur votre métier, et qui, sans votre ordonnance, vient de tuer un homme d'un grand coup d'épée au travers du corps.
M. TOMÈS.
Écoutez, vous faites la railleuse; mais vous passerez par nos mains quelque jour.
LISETTE.
Je vous permets de me tuer lorsque j'aurai recours à vous.
SCÈNE III.—CLITANDRE, en habit de médecin, LISETTE.
CLITANDRE.
Eh bien, Lisette, [que dis-tu de mon équipage? Crois-tu qu'avec cet habit je puisse duper le bonhomme?] Me trouves-tu bien ainsi?
LISETTE.
Le mieux du monde; et je vous attendois avec impatience. Enfin le ciel m'a fait d'un naturel le plus humain du monde, et je ne puis voir deux amans soupirer l'un pour l'autre qu'il ne me prenne une tendresse charitable et un désir ardent de soulager les maux qu'ils souffrent. Je veux, à quelque prix que ce soit, tirer Lucinde de la tyrannie où elle est, et la mettre en votre pouvoir. Vous m'avez plu 106 d'abord, je me connois en gens, et elle ne peut pas mieux choisir. L'amour risque des choses extraordinaires, et nous avons concerté ensemble une manière de stratagème qui pourra peut-être nous réussir. Toutes nos mesures sont déjà prises: l'homme à qui nous avons affaire n'est pas des plus fins de ce monde; et, si cette aventure nous manque, nous trouverons mille autres voies pour arriver à notre but. Attendez-moi là seulement, je reviens vous quérir.
Clitandre se retire dans le fond du théâtre.
SCÈNE IV.—SGANARELLE, LISETTE.
LISETTE.
Monsieur, allégresse! allégresse!
SGANARELLE.
Qu'est-ce?
LISETTE.
Réjouissez-vous.
SGANARELLE.
De quoi?
LISETTE.
Réjouissez-vous, vous dis-je.
SGANARELLE.
Dis-moi donc ce que c'est, et puis je me réjouirai peut-être.
LISETTE.
Non. Je veux que vous vous réjouissiez auparavant; que vous chantiez, que vous dansiez.
SGANARELLE.
Sur quoi?
LISETTE.
Sur ma parole.
SGANARELLE.
Allons donc! (Il chante et danse.) La lera la, la, la, lera, la. Que diable!
LISETTE.
Monsieur, votre fille est guérie!
SGANARELLE.
Ma fille est guérie!
LISETTE.
Oui. Je vous amène un médecin, mais un médecin d'importance, qui fait des cures merveilleuses, et qui se moque des autres médecins.
SGANARELLE.
Où est-il?
LISETTE.
Je vais le faire entrer.
SGANARELLE, seul.
Il faut voir si celui-ci fera plus que les autres.
SCÈNE V.—CLITANDRE, en habit de médecin, SGANARELLE, LISETTE.
LISETTE, amenant Clitandre.
Le voici.
SGANARELLE.
Voilà un médecin qui a la barbe bien jeune.
LISETTE.
La science ne se mesure pas à la barbe, et ce n'est pas par le menton qu'il est habile.
SGANARELLE.
Monsieur, on m'a dit que vous aviez des remèdes admirables pour faire aller à la selle.
CLITANDRE.
Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils ont l'émétique, les saignées, les médecines et les lavements; mais moi, je guéris par des paroles, par des sons, par des lettres, par des talismans et par des anneaux constellés.
LISETTE.
Que vous ai-je dit?
SGANARELLE.
Voilà un grand homme!
LISETTE.
Monsieur, comme votre fille est là tout habillée dans une chaise, je vais la faire passer ici.
SGANARELLE.
Oui, fais.
CLITANDRE, tâtant le pouls à Sganarelle.
Votre fille est bien malade.
SGANARELLE.
Vous connoissez cela ici?
CLITANDRE.
Oui, par la sympathie qu'il y a entre le père et la fille[45].
SCÈNE VI.—SGANARELLE, LUCINDE, CLITANDRE, LISETTE.
LISETTE, à Clitandre.
Tenez, monsieur, voilà une chaise auprès d'elle. (A Sganarelle). Allons, laissez-les là tous deux.
SGANARELLE.
Pourquoi? Je veux demeurer là.
LISETTE.
Vous moquez-vous? Il faut s'éloigner. Un médecin a cent choses à demander qu'il n'est pas honnête qu'un homme entende.
Sganarelle et Lisette s'éloignent.
CLITANDRE, bas, à Lucinde.
Ah! madame, que le ravissement où je me trouve est grand! et je ne sais par où vous commencer mon discours. Tant que je ne vous ai parlé que des yeux, j'avois, ce me sembloit, cent choses à vous dire; et, maintenant que j'ai la liberté de vous parler de la façon que je souhaitois, je demeure interdit, et la grande joie où je suis étouffe toutes mes paroles.
LUCINDE.
Je puis vous dire la même chose; et je sens, comme vous, des mouvements de joie qui m'empêchent de pouvoir parler.
CLITANDRE.
Ah! madame, que je serois heureux s'il étoit vrai que vous sentissiez tout ce que je sens, et qu'il me fût permis de juger de votre âme par la mienne! Mais, madame, puis-je au moins croire que ce soit à vous à qui je doive la pensée 109 de cet heureux stratagème qui me fait jouir de votre présence?
LUCINDE.
Si vous ne m'en devez pas la pensée, vous m'êtes redevable au moins d'en avoir approuvé la proposition avec beaucoup de joie.
SGANARELLE, à Lisette.
Il me semble qu'il lui parle de bien près.
LISETTE, à Sganarelle.
C'est qu'il observe sa physionomie et tous les traits de son visage.
CLITANDRE, à Lucinde.
Serez-vous constante, madame, dans ces bontés que vous me témoignez?
LUCINDE.
Mais vous, serez-vous ferme dans les résolutions que vous avez montrées?
CLITANDRE.
Ah! madame, jusqu'à la mort. Je n'ai point de plus forte envie que d'être à vous, et je vais le faire paroître dans ce que vous m'allez voir faire.
SGANARELLE, à Clitandre.
Eh bien, notre malade? Elle me semble un peu plus gaie.
CLITANDRE.
C'est que j'ai déjà fait agir sur elle un de ces remèdes que mon art m'enseigne. Comme l'esprit a grand empire sur le corps, et que c'est de lui bien souvent que procèdent les maladies, ma coutume est de courir à guérir les esprits avant que de venir aux corps. J'ai donc observé ses regards, les traits de son visage et les lignes de ses deux mains; et, par la science que le ciel m'a donnée, j'ai reconnu que c'étoit de l'esprit qu'elle étoit malade, et que tout son mal ne venoit que d'une imagination déréglée, d'un désir dépravé de vouloir être mariée. Pour moi, je ne vois rien de plus extravagant et de plus ridicule que cette envie qu'on a du mariage.
SGANARELLE, à part.
Voilà un habile homme!
CLITANDRE.
Et j'ai eu et aurai pour lui toute ma vie une aversion effroyable.
SGANARELLE.
Voilà un grand médecin!
CLITANDRE.
Mais, comme il faut flatter l'imagination des malades, et que j'ai vu en elle de l'aliénation d'esprit, et même qu'il y avoit du péril à ne lui pas donner un prompt secours, je l'ai prise par son foible, et lui ai dit que j'étois venu ici pour vous la demander en mariage. Soudain son visage a changé, son teint s'est éclairci, ses yeux se sont animés; et, si vous voulez, pour quelques jours, l'entretenir dans cette erreur, vous verrez que nous la tirerons d'où elle est.
SGANARELLE.
Oui-da, je le veux bien.
CLITANDRE.
Après, nous ferons agir d'autres remèdes pour la guérir entièrement de cette fantaisie.
SGANARELLE.
Oui, cela est le mieux du monde. Eh bien, ma fille, voilà monsieur qui a envie de t'épouser, et je lui ai dit que je le voulois bien.
LUCINDE.
Hélas! est-il possible?
SGANARELLE.
Oui.
LUCINDE.
Mais tout de bon?
SGANARELLE.
Oui, oui.
LUCINDE, à Clitandre.
Quoi! vous êtes dans les sentiments d'être mon mari?
CLITANDRE.
Oui, madame.
LUCINDE.
Et mon père y consent?
SGANARELLE.
Oui, ma fille.
LUCINDE.
Ah! que je suis heureuse, si cela est véritable!
CLITANDRE.
N'en doutez point, madame. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime et que je brûle de me voir votre mari. Je ne suis venu ici que pour cela; et, si vous voulez que je vous dise nettement les choses comme elles sont, cet habit n'est qu'un pur prétexte inventé, et je n'ai fait le médecin que pour m'approcher de vous, et obtenir [plus facilement] ce que je souhaite.
LUCINDE.
C'est me donner des marques d'un amour bien tendre, et j'y suis sensible autant que je puis.
SGANARELLE, à part.
O la folle! ô la folle! ô la folle!
LUCINDE.
Vous voulez donc bien, mon père, me donner monsieur pour époux?
SGANARELLE.
Oui. Çà, donne-moi ta main. Donnez-moi un peu aussi la vôtre, pour voir.
CLITANDRE.
Mais, monsieur...
SGANARELLE, étouffant de rire.
Non, non, c'est pour... pour lui contenter l'esprit. Touchez là.. Voilà qui est fait.
CLITANDRE.
Acceptez, pour gage de ma foi, cet anneau que je vous donne. (Bas, à Sganarelle.) C'est un anneau constellé, qui guérit les égaremens d'esprit.
LUCINDE.
Faisons donc le contrat, afin que rien n'y manque.
CLITANDRE.
Hélas! je le veux bien, madame. (Bas, à Sganarelle.) Je vais faire monter l'homme qui écrit mes remèdes, et lui faire croire que c'est un notaire.
SGANARELLE.
Fort bien.
CLITANDRE.
Holà! faites monter le notaire que j'ai amené avec moi.
LUCINDE.
Quoi! vous aviez amené un notaire?
CLITANDRE.
Oui, madame.
LUCINDE.
J'en suis ravie.
SGANARELLE.
O la folle! ô la folle!
SCÈNE VII.—LE NOTAIRE, CLITANDRE, SGANARELLE, LUCINDE, LISETTE.
Clitandre parle bas au notaire.
SGANARELLE, au notaire.
Oui, monsieur, il faut faire un contrat pour ces deux personnes-là. Écrivez. (A Lucinde.) Voilà le contrat qu'on fait. (Au notaire.) Je lui donne vingt mille écus en mariage. Écrivez.
LUCINDE.
Je vous suis bien obligée, mon père.
LE NOTAIRE.
Voilà qui est fait. Vous n'avez qu'à venir signer.
SGANARELLE.
Voilà un contrat bientôt bâti.
CLITANDRE, à Sganarelle.
[Mais] au moins, [monsieur]...
SGANARELLE.
Eh! non, vous dis-je. Sait-on pas bien... (Au notaire.) Allons, donnez-lui la plume pour signer, (A Lucinde.) Allons, signe, signe, signe. Va, va, je signerai tantôt, moi.
LUCINDE.
Non, non, je veux avoir le contrat entre mes mains.
SGANARELLE.
Eh bien, tiens. (Après avoir signé.) Es-tu contente?
LUCINDE.
Plus qu'on ne peut s'imaginer.
SGANARELLE.
Voilà qui est bien, voilà qui est bien.
CLITANDRE.
Au reste, je n'ai pas eu seulement la précaution d'amener un notaire; j'ai eu celle encore de faire venir des voix et des instrumens [et des danseurs] pour célébrer la fête et pour nous réjouir. Qu'on les fasse venir. Ce sont des gens que je mène avec moi, et dont je me sers tous les jours pour pacifier avec leur harmonie [et leurs danses] les troubles de l'esprit.
TROISIÈME ENTRÉE.
SCÈNE VIII.—SGANARELLE, LUCINDE, CLITANDRE, LISETTE.
LA COMÉDIE, LE BALLET, LA MUSIQUE, JEUX, RIS, PLAISIRS.
Pendant que les Jeux, les Ris et les Plaisirs dansent, Clitandre emmène Lucinde.
SCÈNE IX.—SGANARELLE, LISETTE, LA COMÉDIE, LA MUSIQUE, LE BALLET, JEUX, RIS, PLAISIRS.
SGANARELLE.
Voilà une plaisante façon de guérir! Où est donc ma fille et le médecin?
LISETTE.
Ils sont allés achever le reste du mariage.
SGANARELLE.
Comment! le mariage?
LISETTE.
Ma foi, monsieur, la bécasse est bridée[46], et vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité.
SGANARELLE.
Comment diable! (Il veut aller après Clitandre et Lucinde; les danseurs le retiennent.) Laissez-moi aller, laissez-moi aller, vous dis-je! (Les danseurs le retiennent toujours.) Encore! (Ils veulent faire danser Sganarelle de force.) Peste des gens[47]!
FIN DE L'AMOUR MÉDECIN.
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS, A PARIS, SUR LE THÉATRE DU PALAIS-ROYAL, LE 4 JUIN 1666.
La société française s'avance dans la route splendide et sévère que le règne de Louis XIV lui a tracée. Les grandes guerres d'Allemagne et de Hollande n'ont pas commencé encore. Recherché par le prince de Condé et les grands seigneurs, admis dans la société intime de Boileau, de la Fontaine, de Racine, et de son ancien ami Chapelle; continuant à élever l'édifice de sa fortune par une sage économie et un ordre parfait, Molière offrait un exemple frappant de cette double vie mêlée de splendeurs et de tristesses, de gloires et de douleurs qui est souvent le partage des hommes de génie. Son ménage était détruit; les calomnies de Monfleury, son rival, qui l'accusait d'inceste, avaient fait quelque impression sur le public: les pédants de toutes les classes ne perdaient pas une occasion de lui nuire. Le jeune Racine abandonnait son protecteur et son bienfaiteur, lui enlevait la belle Duparc, qu'il faisait passer à l'hôtel de Bourgogne, c'est-à-dire dans l'armée ennemie, et se plaignait même que Monfleury ne fût pas écouté à la cour. La protectrice de Molière, Anne d'Autriche, venait de mourir.
Toujours épris de l'infidèle Armande, à laquelle il avait sans cesse pardonné, il s'était vu forcé de se séparer d'elle, et, de temps à autre, retiré à Auteuil, quittant les tracas de son théâtre, les embarras de sa direction, il allait, comme il l'avoue, pleurer sans contrainte, tantôt dans les bras de son ami Chapelle, auquel il avouait toute sa faiblesse. «Ah! lui disait-il, j'ai beau faire, je ne 116 peux l'oublier, elle m'a toujours trompé, je le sais; elle est indifférente à tout ce qui me concerne. Je suis le plus malheureux et le plus insensé des hommes, mais rien ne peut me détacher de ses grâces et des transports qu'elle me cause. Je l'aime en un tel point, que je vais jusqu'à entrer avec compassion dans ses intérêts; et, quand je considère combien il m'est impossible de vaincre ce que je sens pour elle, je me dis en même temps qu'elle a peut-être la même difficulté à détruire le penchant qu'elle a d'être coquette, et je me trouve plus de disposition à la plaindre qu'à la blâmer. Toutes les choses du monde ont du rapport avec elle dans mon cœur. Quand je la vois, une émotion et des transports qu'on ne sauroit exprimer m'ôtent l'usage de la réflexion. C'est là le dernier point de la folie. Je n'ai plus d'yeux pour ses défauts, il m'en reste seulement pour ce qu'elle a d'aimable.»
Cette conversation, reproduite exactement d'après Chapelle, son interlocuteur, nous permet de lire dans l'âme passionnée de Molière. Il avait le tempérament du génie: sérieux, ardent, accessible aux émotions et les recevant à la fois vives et profondes. L'exercice même des facultés supérieures de l'artiste et du poëte accroît leur susceptibilité et les rend moins aptes à la résignation et à la douleur; la plus légère influence atmosphérique détruit la santé du cheval de course, tant sa nature s'est transformée, tant la délicatesse exquise et morbide a remplacé les conditions vulgaires de la vie. «Je suis bilieux comme tous les diables,» disait Molière, qui se soumettait volontiers à un examen sévère. Il exigeait des siens, dans l'administration de sa maison, la plus extrême régularité, et disait, comme Jourdain de son Bourgeois gentilhomme: «Il n'y a pas de morale qui tienne! Je veux me mettre en colère.»
Les deux enfants qu'il avait eus d'Armande grandissaient 117 dans sa maison, mais non sous les yeux de leur mère, tout occupée de M. de Lauzun et du comte de Guiche. Le plus léger, le plus fin, le plus ironique des marquis, M. le comte de Guiche était probablement l'objet le plus cher au cœur d'Armande. D'une aimable figure, vêtu avec une rare élégance, sans autre prétention que celle de plaire, il convenait parfaitement à cette jeune femme, «qui ne pensait (dit Molière encore) qu'à jouir agréablement de la vie, allant toujours devant elle, et plus sage que je ne suis.» Jusqu'à quel point les grands yeux noirs, la belle taille, le visage rond et le teint magnifique de M. de Guiche l'emportaient dans l'esprit d'Armande sur la silencieuse hardiesse, l'impertinent éclat et la fatuité résolue de Lauzun, que les femmes tiraient au sort, et qui ne leur accordait pas toujours ses faveurs, c'est ce que personne ne peut savoir. Elle seule aurait pu nous révéler ce secret, si une créature aussi légère, le caprice même et l'inconstance en personne, eût pensé à autre chose qu'à son plaisir. Ce qui est certain, c'est qu'un personnage sévère, simple, ardent, prenant tout au sérieux, demandant à la vie plus qu'elle ne peut donner, à l'amour une complète abnégation, à l'existence conjugale une félicité parfaite, aux rapports sociaux une franchise absolue, à l'humanité enfin une perfection sévère, manquait de proportion, détruisait l'harmonie des choses et devenait ridicule.
Telle était la situation de Molière lui-même. Valet de chambre du roi et homme de génie, d'un âge mûr et amoureux comme un enfant, directeur et auteur, philosophe et plein d'une violence passionnée, tout était contraste et douleur dans sa vie.
Il sent le ridicule de sa situation, il s'observe, sonde la plaie, se blâme lui-même, veut se punir et se venger, élève et idéalise tous les personnages du drame dont il est le centre, ne se ménage point lui-même, fait de sa 118 jalousie invincible, de son inévitable passion, le ressort de l'œuvre tout entière; des vanités et des légèretés d'Armande, le type de la coquetterie féminine; de sa propre exagération dans la recherche du bien, le caractère du Misanthrope; de Lauzun et du comte de Guiche, deux marquis de nuances diverses, tous deux du meilleur ton et de la fatuité la plus triomphale; des révolutions intérieures de son ménage, l'intrigue même de sa pièce, où l'on voit paraître de nouveau «tout son domestique,» jusqu'à l'indulgent et spirituel Chapelle, devenu Philinte, jusqu'à la bonne demoiselle Debrie, devenue Éliante, et prête à consoler par l'amitié celui que l'amour repousse et torture.
Ainsi éclôt au sein des douleurs une œuvre qui me semble unique dans toutes les littératures. Drame sans action, satire animée, tableau de boudoir plein de vigueur, création où les élans douloureux d'une âme énergique et d'un esprit pénétrant font éruption, pour ainsi dire, du sein de la politesse des cours et des raffinements extrêmes. Alceste est un janséniste, Alceste est même un révolutionnaire. Pour détruire tout ce qu'il blâme, il faut renverser de fond en comble l'édifice de la société française: politesse trompeuse, grands seigneurs ensevelis sous les rubans, petits faiseurs de vers, gentilshommes impertinents, beaux discours et cérémonies extravagantes, toutes les superfétations nées des rapports sociaux d'une société factice.
On crut reconnaître mille gens de cour, et l'on inculpa Molière. Mais plus tard, lorsque l'idée révolutionnaire, c'est-à-dire celle qui voulait la destruction de la monarchie, s'annonça par l'organe de J.-J. Rousseau, et se développa violemment de 1789 à 1795, Molière ne fut plus accusé d'avoir été trop sévère pour les marquis, mais d'avoir été trop dur pour le Misanthrope et de l'avoir fait ridicule. Double et contraire accusation qui prouve la hauteur de son génie.
L'effet produit sur le public par cette création si élevée, si passionnée, si délicate, dut être complexe, et a fort embarrassé les commentateurs. On trouva d'abord la pièce sage, belle, estimable, bien assaisonnée. Telles sont les expressions de Robinet:
«On diroit, mon benoît lecteur,
»Qu'on entend un prédicateur.»
Les contemporains avouèrent que jamais Molière ne s'était élevé si haut; cependant la masse du public demeurait froide. Molière n'était pas sûr de son succès; Boileau eut besoin de le rassurer, et quelques-uns vont jusqu'à prétendre que la pièce tomba d'abord. Rien de plus facile que de concilier deux traditions qui semblent se détruire l'une l'autre. Le vulgaire, la bourgeoisie peu lettrée, n'étaient pas attirés par une œuvre de cet ordre. La vogue populaire qui s'était attachée à la statue du commandeur de Don Juan et ce costume extravagant du marquis de Mascarille faisaient défaut au Misanthrope, œuvre trop grande et trop profonde pour être comprise à sa naissance, et qui obtint plutôt un succès d'estime qu'un succès de mode. On y admirait surtout la charmante coquetterie de la belle Armande, à laquelle son mari avait assigné le rôle dont elle était le type original.
«O justes dieux! qu'elle a d'appas!»
s'écrie un contemporain, écho du public lui-même;
Vingt et une représentations successives prouvent suffisamment que l'ouvrage ne fut pas repoussé absolument. Mais, après la vingt et unième, il fallut en suspendre la représentation. Ce ne fut qu'au mois de septembre, un mois et demi plus tard, que la reprise du Misanthrope eut lieu, et il fallut la soutenir par le Médecin malgré lui qui avait déjà onze représentations. Il est facile d'en conclure que le monument le plus sérieux et le plus exquis que Molière ait laissé après lui n'était apprécié que des connaisseurs, non du parterre.
A peine les plus grands critiques et les meilleurs philosophes s'accordent-ils sur le vrai sens de l'œuvre et de sa légitimité. A peine les acteurs eux-mêmes, héritiers de la tradition dramatique, peuvent-ils s'entendre sur le caractère du héros, dont les uns font un bourru quinteux, les autres un homme hypocondriaque et maladif, quelques-uns simplement un personnage mal élevé.
Le Misanthrope ne sera jamais bien exécuté sur la scène que si l'on réalise et reproduit tout l'intérieur domestique du grand monde sous Louis XIV; si l'on fait reparaître vivants, avec leurs costumes mêmes, dans le salon orné de meubles qu'avait choisis Ninon, l'éclatant Lauzun, l'aimable de Guiche, Arsinoé, qui sera madame de Maintenon, et Molière lui-même, l'homme «aux rubans verts,» véhément, sérieux, méditatif, le philosophe dans le monde, celui qui ne sait pas se modérer dans le désir du bien.
Qui non retinuit ex sapientia modum.
| PERSONNAGES. | ACTEURS. | ||
| ALCESTE, amant de Célimène. | Molière. | ||
| PHILINTE, ami d'Alceste. | La Thorillière. | ||
| ORONTE, amant de Célimène. | Du Croisy. | ||
| CÉLIMÈNE. | Arm. Béjart. | ||
| ÉLIANTE, cousine de Célimène. | Mlle Debrie. | ||
| ARSINOÉ, amie de Célimène. | Mlle Duparc. | ||
| ACASTE, | } | marquis. | La Grange. |
| CLITANDRE, | |||
| BASQUE, valet de Célimène. | |||
| UN GARDE de la maréchaussée de France. | Debrie. | ||
| DUBOIS, valet d'Alceste. | Béjart. | ||
| La scène est à Paris, dans la maison de Célimène. | |||
ACTE PREMIER
SCÈNE I.—PHILINTE, ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE, assis.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE, se levant brusquement.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
SCÈNE II.—ORONTE, ALCESTE, PHILINTE.
ORONTE, à Alceste.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE, lit.
PHILINTE.
ALCESTE, bas, à Philinte.
ORONTE.
PHILINTE.
ALCESTE, à Philinte.
ORONTE.
PHILINTE.
ALCESTE, bas à part.
PHILINTE.
ALCESTE, bas, à part.
ORONTE, à Philinte.
PHILINTE.
ALCESTE, bas, à part.
ORONTE, à Alceste.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
PHILINTE, se mettant entre deux.
ORONTE.
ALCESTE.
SCÈNE III.—PHILINTE, ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ACTE II
SCÈNE I.—ALCESTE, CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
SCÈNE II.—CÉLIMÈNE, ALCESTE, BASQUE.
CÉLIMÈNE.
BASQUE.
CÉLIMÈNE.
SCÈNE III.—CÉLIMÈNE, ALCESTE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
SCÈNE IV.—ALCESTE, CÉLIMÈNE, BASQUE.
BASQUE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
SCÈNE V.—ÉLIANTE, PHILINTE, ACASTE, CLITANDRE, ALCESTE, CÉLIMÈNE, BASQUE.
ÉLIANTE, à Célimène.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CLITANDRE[59].
CÉLIMÈNE.
ACASTE[61].
CÉLIMÈNE.
ÉLIANTE, à Philinte.
CLITANDRE.
CÉLIMÈNE.
ACASTE.
CÉLIMÈNE.
CLITANDRE.
CÉLIMÈNE.
ACASTE.
CÉLIMÈNE.
CLITANDRE.
CÉLIMÈNE.
ÉLIANTE.
CÉLIMÈNE.
PHILINTE.
CÉLIMÈNE.
PHILINTE.
CÉLIMÈNE.
ACASTE.
CLITANDRE, à Célimène.
ALCESTE.
CLITANDRE.
ALCESTE.
PHILINTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ÉLIANTE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
CLITANDRE ET ACASTE.
ALCESTE.
ACASTE.
CLITANDRE.
CÉLIMÈNE, à Alceste.
ALCESTE.
SCÈNE VI.—ALCESTE, CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ACASTE, PHILINTE, CLITANDRE, BASQUE.
BASQUE, à Alceste.
ALCESTE.
BASQUE.
CÉLIMÈNE, à Alceste.
SCÈNE VII.—ALCESTE, CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ACASTE, PHILINTE, CLITANDRE, UN GARDE DE LA MARÉCHAUSSÉE.
ALCESTE, allant au-devant du garde.
LE GARDE.
ALCESTE.
LE GARDE.
ALCESTE.
LE GARDE.
ALCESTE.
PHILINTE, à Alceste.
CÉLIMÈNE, à Philinte.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
ACTE III
SCÈNE I.—CLITANDRE, ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE.
SCÈNE II.—CÉLIMÈNE, ACASTE, CLITANDRE.
CÉLIMÈNE.
CLITANDRE.
CÉLIMÈNE.
CLITANDRE.
SCÈNE III.—CÉLIMÈNE, ACASTE, CLITANDRE, BASQUE.
BASQUE.
CÉLIMÈNE.
BASQUE.
CÉLIMÈNE.
ACASTE.
CÉLIMÈNE.
SCÈNE IV.—ARSINOÉ, CÉLIMÈNE, CLITANDRE, ACASTE.
CÉLIMÈNE.
ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
SCÈNE V.—ARSINOÉ, CÉLIMÈNE.
ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
SCÈNE VI.—ALCESTE, CÉLIMÈNE, ARSINOÉ.
CÉLIMÈNE.
SCÈNE VII.—ALCESTE, ARSINOÉ.
ARSINOÉ.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
ACTE IV
SCÈNE I.—ÉLIANTE, PHILINTE.
PHILINTE.
ÉLIANTE.
PHILINTE.
ÉLIANTE.
PHILINTE.
ÉLIANTE.
PHILINTE.
ÉLIANTE.
PHILINTE.
ÉLIANTE.
PHILINTE.
SCÈNE II.—ALCESTE, ÉLIANTE, PHILINTE.
ALCESTE.
ÉLIANTE.
ALCESTE.
ÉLIANTE.
ALCESTE.
ÉLIANTE.
ALCESTE.
ÉLIANTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
ÉLIANTE.
ALCESTE.
ÉLIANTE.
ALCESTE.
ÉLIANTE.
ALCESTE.
SCÈNE III.—CÉLIMÈNE, ALCESTE.
ALCESTE, à part.
CÉLIMÈNE, à part[83].
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE, à part.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
SCÈNE IV.—CÉLIMÈNE, ALCESTE, DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
DUBOIS.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
DUBOIS, après avoir longtemps cherché le billet.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
ACTE V
SCÈNE I.—ALCESTE, PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
SCÈNE II.—CÉLIMÈNE, ORONTE, ALCESTE.
ORONTE.
CÉLIMÈNE.
ORONTE.
ALCESTE, sortant du coin où il étoit.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
CÉLIMÈNE.
SCÈNE III.—ÉLIANTE, PHILINTE, CÉLIMÈNE, ORONTE, ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ÉLIANTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
ORONTE.
ALCESTE.
SCÈNE IV.—ARSINOÉ, CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ALCESTE, PHILINTE, ACASTE, CLITANDRE, ORONTE.
ACASTE, à Célimène.
CLITANDRE, à Oronte et à Alceste.
ARSINOÉ, à Célimène.
ACASTE.
CLITANDRE.
ACASTE, à Oronte et à Alceste.
«Vous êtes un étrange homme, de condamner mon enjouement, et de me reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n'y a rien de plus injuste; et, si vous ne venez bien vite me demander pardon de cette offense, je ne vous la pardonnerai de ma vie. Notre grand flandrin de vicomte...»
Il devroit être ici.
«... Notre grand flandrin de vicomte, par qui vous commencez vos plaintes, est un homme qui ne sauroit me revenir; et, depuis que je l'ai vu, trois quarts d'heure durant, cracher dans un puits pour faire des ronds, je n'ai pu jamais prendre bonne opinion de lui. Pour le petit marquis...»
C'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité.
«... Pour le petit marquis, qui me tint hier longtemps la main, je trouve qu'il n'y a rien de si mince que toute sa personne; et ce sont de ces mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme aux rubans verts...»
A Alceste.
A vous le dé, monsieur.
«... Pour l'homme aux rubans verts, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries et son chagrin bourru; mais il est cent momens où je le trouve le plus fâcheux du monde. Et pour l'homme à la veste...»
A Oronte.
Voici votre paquet.
«... Et pour l'homme à la veste, qui s'est jeté dans le bel esprit, et veut être auteur malgré tout le monde, je ne puis me donner la peine d'écouter ce qu'il dit, et sa prose me fatigue autant que ses vers. Mettez-vous donc en tête que je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez; que je vous trouve à dire[91] plus que je ne voudrois dans toutes les parties où l'on m'entraîne; et que c'est un 187 merveilleux assaisonnement aux plaisirs qu'on goûte, que la présence des gens qu'on aime.»
CLITANDRE.
Me voici maintenant, moi.
«Votre Clitandre, dont vous me parlez, et qui fait tant le doucereux, est le dernier des hommes pour qui j'aurois de l'amitié. Il est extravagant de se persuader qu'on l'aime; et vous l'êtes de croire qu'on ne vous aime pas. Changez, pour être raisonnable, vos sentimens contre les siens; et voyez-moi le plus que vous pourrez, pour m'aider à porter le chagrin d'en être obsédée.»
ACASTE.
SCÈNE V.—CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ARSINOÉ, ALCESTE, ORONTE, PHILINTE.
ORONTE.
SCÈNE VI.—CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ARSINOÉ, ALCESTE, PHILINTE.
ARSINOÉ, à Célimène.
ALCESTE.
ARSINOÉ.
SCÈNE VII.—CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ALCESTE, PHILINTE.
ALCESTE, à Célimène.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
CÉLIMÈNE.
ALCESTE.
SCÈNE VIII.—ÉLIANTE, ALCESTE, PHILINTE.
ALCESTE, à Éliante.
ÉLIANTE.
PHILINTE.
ALCESTE.
PHILINTE.
FIN DU MISANTHROPE.
QUATRIÈME ÉPOQUE
1666-1667
ŒUVRES ÉCRITES POUR LA COUR ET DIVERTISSEMENTS
| XIX. | 1666. | LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. |
| XX. | 1666. | MÉLICERTE. |
| XXI. | 1666. | LA PASTORALE COMIQUE. |
| XXII. | 1667. | LE SICILIEN OU L'AMOUR PEINTRE. |
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS A PARIS, SUR LE THÉATRE DU PALAIS-ROYAL, LE 9 AOÛT 1666.
Le Misanthrope, le chef-d'œuvre comique non-seulement de la scène française, mais de la scène noble et de bon ton en Europe, faisait peu d'argent. La farce du Médecin malgré lui, qui succéda immédiatement à ce bel ouvrage, fut évidemment composée pour relever les intérêts financiers du théâtre, et pour compenser, au moyen d'une vogue populaire, la froide estime inspirée par le chef-d'œuvre.
L'idée d'un médecin pour rire, devant son crédit et sa réputation à de grands mots, à une robe et à un bonnet, avait depuis longtemps pris possession de l'esprit de Molière: on la retrouve déjà dans le Médecin volant. L'idée collatérale et l'invention comique de cette femme qui, pour se venger d'un mari, l'indique comme excellent 193 médecin, mais ne livrant ses ordonnances que sous le bâton, est venue renforcer la donnée première, à laquelle toutes les querelles ridicules de la Faculté et des apothicaires, leurs grands combats sur l'antimoine et l'émétique, prêtèrent un corps plus solide.
De là cette délicieuse comédie du Fagoteux ou Fagotier, à laquelle Molière avait rêvé depuis sa jeunesse, de là le plus burlesque et le plus philosophique ensemble, un long éclat de rire aux dépens de la formule pédantesque et de l'antique empirisme. On a peine à croire aujourd'hui que Boileau, cet homme d'un goût si sûr, et qui aimait Molière, lui ait encore reproché, à ce propos, sérieusement, le langage patois qu'il a prêté à ses paysans, tant le sentiment de la décence et de l'élégance convenue dominait alors, tant les meilleurs esprits avaient peu de goût pour la vraie peinture du caractère et la reproduction fidèle de la personnalité humaine. Il n'y avait qu'un pas à franchir pour arriver aux bergers enrubanés de Fontenelle et de Lamothe.
Molière fut récompensé par un succès étourdissant, succès bourgeois et roturier, aussi net, aussi durable que le succès élégant et classique du Misanthrope.
Ce fut, dit-on, dans un conte plaisant, dont Louis XIV avait ri, que Molière trouva sa fable, qui se rapporte à la vieille légende ainsi résumée par Anguilbert: «Quædam mulier percussa a viro suo ivit ad castellanum infirmum, dicens virum suum esse medicum, sed non mederi cuique nisi forte percuteretur, et sic eum fortissime percuti procuravit.» (Mensa philosophica, cap. XVIII, de Mulieribus, in fine, fol. 58.)—«Une certaine femme, frappée par son mari, alla chez son seigneur malade, disant que son mari était médecin, mais qu'il ne guérissait que ceux qui le battaient bien; et par là elle le fit rosser de la bonne manière.» Cet Anguilbert, qui avait, comme beaucoup de moines et de savants du moyen âge, recueilli, pour en garnir son Festin philosophique, toutes les miettes anecdotiques ayant cours de son temps, accorde trois lignes à ce vieux conte, que l'on retrouve dans le fabliau du Vilain mire ou du 194 Manant médecin, et que sans doute Molière avait entendu répéter sous une forme ou sous une autre à la cour de Louis XIV.
On le voit, Molière ne lâche pas sa proie; la guerre commencée à la porte de Nesle dans le Médecin volant, la lutte contre l'empirisme et la crédulité, ne finira qu'avec le Malade imaginaire et avec sa vie.
| PERSONNAGES. | |||
| GÉRONTE, père de Lucinde. | |||
| LUCINDE, fille de Géronte. | |||
| LÉANDRE, amant de Lucinde. | |||
| SGANARELLE, mari de Martine. | |||
| MARTINE, femme de Sganarelle. | |||
| M. ROBERT, voisin de Sganarelle. | |||
| VALÈRE, domestique[95] de Géronte. | |||
| LUCAS, mari de Jacqueline. | |||
| JACQUELINE, nourrice chez Géronte, et femme de Lucas. | |||
| THIBAUT, père de Perrin, | } | paysans. | |
| PERRIN, | |||
| La scène est à la campagne.—Le théâtre représente une forêt. | |||
ACTE PREMIER
SCÈNE I.—SGANARELLE, MARTINE.
SGANARELLE.
Non, je te dis que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître.
MARTINE.
Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines.
SGANARELLE.
Oh! la grande fatigue que d'avoir une femme, et qu'Aristote 195 a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon!
MARTINE.
Voyez un peu l'habile homme, avec son benêt d'Aristote!
SGANARELLE.
Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi six ans un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur.
MARTINE.
Peste du fou fieffé!
SGANARELLE.
Peste de la carogne!
MARTINE.
Que maudits soient l'heure et le jour où je m'avisai d'aller dire oui!
SGANARELLE.
Que maudit soit le bec cornu[96] de notaire qui me fit signer ma ruine!
MARTINE.
C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire! Devrois-tu être un seul moment sans rendre grâces au ciel de m'avoir pour ta femme? et méritois-tu d'épouser une personne comme moi?
SGANARELLE.
Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces! Eh! morbleu, ne me fais point parler là-dessus: je dirois de certaines choses...
MARTINE.
Quoi? que dirois-tu?
SGANARELLE.
Baste[97]! laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver.
MARTINE.
Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme 196 qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai!...
SGANARELLE.
Tu as menti! j'en bois une partie.
MARTINE.
Qui me vend, pièce à pièce, tout ce qui est dans le logis!
SGANARELLE.
C'est vivre de ménage.
MARTINE.
Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avois!...
SGANARELLE.
Tu t'en lèveras plus matin.
MARTINE.
Enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison!...
SGANARELLE.
On en déménage plus aisément.
MARTINE.
Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire!
SGANARELLE.
C'est pour ne me point ennuyer.
MARTINE.
Et que veux-tu, pendant ce temps, que je fasse avec ma famille?
SGANARELLE.
Tout ce qu'il te plaira.
MARTINE.
J'ai quatre pauvres petits enfants sur les bras...
SGANARELLE.
Mets-les à terre.
MARTINE.
Qui me demandent à toute heure du pain.
SGANARELLE.
Donne-leur le fouet: quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit soûl dans ma maison.
MARTINE.
Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même?
SGANARELLE.
Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît.
MARTINE.
Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches?
SGANARELLE.
Ne nous emportons point, ma femme.
MARTINE.
Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir?
SGANARELLE.
Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon.
MARTINE.
Je me moque de tes menaces!
SGANARELLE.
Ma petite femme, ma mie, votre peau vous démange, à votre ordinaire.
MARTINE.
Je te montrerai bien que je ne te crains nullement.
SGANARELLE.
Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose[98].
MARTINE.
Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles?
SGANARELLE.
Doux objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles.
MARTINE.
Ivrogne que tu es!
SGANARELLE.
Je vous battrai.
MARTINE.
Sac à vin!
SGANARELLE.
Je vous rosserai.
MARTINE.
Infâme!
SGANARELLE.
Je vous étrillerai.
MARTINE.
Traître! insolent! trompeur! lâche! coquin! pendard! gueux! bélître! fripon! maraud! voleur!
SGANARELLE.
Ah! vous en voulez donc?
Sganarelle prend un bâton et bat sa femme.
MARTINE, criant.
Ah! ah! ah! ah!
SGANARELLE.
Voilà le vrai moyen de vous apaiser.
SCÈNE II.—M. ROBERT, SGANARELLE, MARTINE.
M. ROBERT.
Holà! holà! holà! Fi! Qu'est ceci? Quelle infamie! Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme!
MARTINE, à M. Robert.
Et je veux qu'il me batte, moi!
M. ROBERT.
Ah! j'y consens de tout mon cœur.
MARTINE.
De quoi vous mêlez-vous?
M. ROBERT.
J'ai tort.
MARTINE.
Est-ce là votre affaire?
M. ROBERT.
Vous avez raison.
MARTINE.
Voyez un peu cet impertinent, qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes!
M. ROBERT.
Je me rétracte.
MARTINE.
Qu'avez-vous à voir là-dessus?
M. ROBERT.
Rien.
MARTINE.
Est-ce à vous d'y mettre le nez?
M. ROBERT.
Non.
MARTINE.
Mêlez-vous de vos affaires!
M. ROBERT.
Je ne dis plus mot.
MARTINE.
Il me plaît d'être battue.
M. ROBERT.
D'accord.
MARTINE.
Ce n'est pas à vos dépens.
M. ROBERT.
Il est vrai.
MARTINE.
Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire.
Elle lui donne un soufflet.
M. ROBERT, à Sganarelle.
Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez comme il faut votre femme; je vous aiderai, si vous le voulez.
SGANARELLE.
Il ne me plaît pas, moi.
M. ROBERT.
Ah! c'est une autre chose.
SGANARELLE.
Je la veux battre, si je le veux; et ne la veux pas battre si je ne le veux pas.
M. ROBERT.
Fort bien.
SGANARELLE.
C'est ma femme, et non pas la vôtre.
M. ROBERT.
Sans doute.
SGANARELLE.
Vous n'avez rien à me commander.
M. ROBERT.
D'accord.
SGANARELLE.
Je n'ai que faire de votre aide.
M. ROBERT.
Très-volontiers.
SGANARELLE.
Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui! Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt il ne faut point mettre l'écorce.
Il bat M. Robert et le chasse.
SCÈNE III.—SGANARELLE, MARTINE.
SGANARELLE.
Oh çà! faisons la paix nous deux. Touche là.
MARTINE.
Oui, après m'avoir ainsi battue!
SGANARELLE.
Cela n'est rien. Touche.
MARTINE.
Je ne veux pas.
SGANARELLE.
Eh?
MARTINE.
Non.
SGANARELLE.
Ma petite femme!
MARTINE.
Point!
SGANARELLE.
Allons, te dis-je.
MARTINE.
Je n'en ferai rien.
SGANARELLE.
Viens, viens, viens!
MARTINE.
Non! je veux être en colère.
SGANARELLE.
Fi! c'est une bagatelle. Allons, allons.
MARTINE.
Laisse-moi là.
SGANARELLE.
Touche, te dis-je.
MARTINE.
Tu m'as trop maltraitée.
SGANARELLE.
Eh bien, va, je te demande pardon; mets là ta main.
MARTINE.
Je te pardonne. (Bas, à part.) Mais tu le payeras.
SGANARELLE.
Tu es une folle de prendre garde à cela: ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié; et cinq ou six coups de bâton, entre gens qui s'aiment, ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois, et je te promets aujourd'hui plus d'un cent de fagots.
SCÈNE IV.—MARTINE.
Va, quelque mine que je fasse, je n'oublierai pas mon ressentiment, et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu m'as donnés. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari; mais c'est une punition trop délicate pour mon pendard: je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir; et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue.
SCÈNE V.—VALÈRE, LUCAS, MARTINE.
LUCAS, à Valère, sans voir Martine.
Parguienne! j'avons pris là tous deux une guèble de commission, et je ne sais pas, moi, ce que je pensons attraper.
VALÈRE, à Lucas, sans voir Martine.
Que veux-tu, mon pauvre nourricier? il faut bien obéir à notre maître: et puis nous avons intérêt, l'un et l'autre, à 202 la santé de sa fille, notre maîtresse; et, sans doute son mariage, différé par sa maladie, nous vaudra quelque récompense. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne; et, quoique elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre.
MARTINE, rêvant à part, se croyant seule.
Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger?
LUCAS, à Valère.
Mais quelle fantaisie s'est-il boutée[99] là dans la tête, puisque les médecins y avont tous perdu leur latin?
VALÈRE, à Lucas.
On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent en de simples lieux...
MARTINE, se croyant toujours seule.
Oui, il faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne les saurois digérer; et... (Heurtant Valère et Lucas.) Ah! messieurs, je vous demande pardon; je ne vous voyois pas, et cherchois dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse.
VALÈRE.
Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver.
MARTINE.
Seroit-ce quelque chose où je vous puisse aider?
VALÈRE.
Cela se pourroit faire; et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier, qui pût donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle; mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers, qui font le plus souvent ce que les autres n'ont pu faire, et c'est ce que nous cherchons.
MARTINE, bas, à part.
Ah! que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendard! (Haut.) Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez; et nous avons un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées.
VALÈRE.
Eh! de grâce, où pouvons-nous le rencontrer?
MARTINE.
Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà qui s'amuse à couper du bois.
LUCAS.
Un médecin qui coupe du bois!
VALÈRE.
Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire?
MARTINE.
Non; c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela, fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paroître ignorant, tient sa science renfermée, et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talens qu'il a eus du ciel pour la médecine.
VALÈRE.
C'est une chose admirable, que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelque petit grain de folie mêlé à leur science.
MARTINE.
La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battu pour demeurer d'accord de sa capacité; et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin, s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton, et ne le réduisiez, à force de coups, à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui.
VALÈRE.
Voilà une étrange folie!
MARTINE.
Il est vrai; mais, après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles.
VALÈRE.
Comment s'appelle-t-il?
MARTINE.
Il s'appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connoître. C'est un homme qui a une large barbe noire, et qui porte une fraise, avec un habit jaune et vert.
LUCAS.
Un habit jaune et vart! C'est donc le médecin des parroquets?
VALÈRE.
Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites?
MARTINE.
Comment! c'est un homme qui fait des miracles. Il y a six mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins: on la tenoit morte il y avait déjà six heures, et l'on se disposoit à l'ensevelir, lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayant vue, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et, dans le même instant, elle se leva de son lit, et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre, comme si de rien n'eût été.
LUCAS.
Ah!
VALÈRE.
Il falloit que ce fût quelque goutte d'or potable.
MARTINE.
Cela pourroit bien être. Il n'y a pas trois semaines encore qu'un jeune enfant de douze ans tomba du haut du clocher en bas, et se brisa sur le pavé la tête, les bras, et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme, qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire; et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds, et courut jouer à la fossette.
LUCAS.
Ah!
VALÈRE.
Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle.
MARTINE.
Qui en doute?
LUCAS.
Tétigué! v'là justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher.
VALÈRE.
Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites.
MARTINE.
Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné.
LUCAS.
Eh! morguenne! laissez-nous faire: s'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous.
VALÈRE, à Lucas.
Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre, et j'en conçois, pour moi, la meilleure espérance du monde.
SCÈNE VI.—SGANARELLE, VALÈRE, LUCAS.
SGANARELLE, chantant derrière le théâtre.
La, la, la...
VALÈRE.
J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois.
SGANARELLE, entrant sur le théâtre avec une bouteille à sa main, sans apercevoir Valère ni Lucas.
La, la, la... Ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. (Après avoir bu.) Voilà du bois qui est salé comme tous les diables.
Il chante.
Allons, morbleu! il ne faut point engendrer de mélancolie.
VALÈRE, bas, à Lucas.
Le voilà lui-même.
LUCAS, bas, à Valère.
Je pense que vous dites vrai, et que j'avons bouté le nez dessus.
VALÈRE.
Voyons de près.
SGANARELLE, embrassant sa bouteille.
Ah! ma petite friponne! que je t'aime, mon petit bouchon!
Il chante. Apercevant Valère et Lucas qui l'examinent, il baisse la voix.
Voyant qu'on l'examine de plus près.
Que diable! à qui en veulent ces gens-là?
VALÈRE, à Lucas.
C'est lui assurément.
LUCAS, à Valère.
Le v'là tout craché comme on nous l'a défiguré.
Sganarelle pose la bouteille à terre, et Valère se baissant pour le saluer, comme il croit que c'est à dessein de la prendre, il la met de l'autre côté; Lucas faisant la même chose que Valère, Sganarelle reprend sa bouteille, et la tient contre son estomac, avec divers gestes qui font un jeu de théâtre.
SGANARELLE, à part.
Ils consultent en me regardant. Quel dessein auroient-ils?
VALÈRE.
Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle?
SGANARELLE.
Eh! quoi?
VALÈRE.
Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle?
SGANARELLE, se tournant vers Valère, puis vers Lucas.
Oui et non, selon ce que vous lui voulez.
VALÈRE.
Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons.
SGANARELLE.
En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle.
VALÈRE.
Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressés à vous pour ce que nous cherchons; et nous venons implorer votre aide, dont nous avons besoin.
SGANARELLE.
Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépende de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service.
VALÈRE.
Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais, monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît; le soleil pourroit vous incommoder.
LUCAS.
Monsieur, boutez dessus.
SGANARELLE, à part.
Voici des gens bien pleins de cérémonies. (Il se couvre.)
VALÈRE.
Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous; les habiles gens sont toujours recherchés, et nous sommes instruits de votre capacité.
SGANARELLE.
Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme de monde pour faire des fagots.
VALÈRE.
Ah! monsieur!...
SGANARELLE.
Je n'y épargne aucune chose, et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire.
VALÈRE.
Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question.
SGANARELLE.
Mais aussi je les vends cent dix sous le cent.
VALÈRE.
Ne parlons point de cela, s'il vous plaît.
SGANARELLE.
Je vous promets que je ne saurois les donner à moins.
VALÈRE.
Monsieur, nous savons les choses.
SGANARELLE.
Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela.
VALÈRE.
Monsieur, c'est se moquer que...
SGANARELLE.
Je ne me moque point, je n'en puis rien rabattre.
VALÈRE.
Parlons d'autre façon, de grâce.
SGANARELLE.
Vous en pourrez trouver autre part à moins; il y a fagots et fagots; mais pour ceux que je fais...
VALÈRE.
Eh! monsieur, laissons là ce discours.
SGANARELLE.
Je vous jure que vous ne les auriez pas, s'il s'en falloit un double.
VALÈRE.
Eh! fi!
SGANARELLE.
Non, en conscience; vous en payerez[100] cela. Je vous parle sincèrement, et ne suis pas homme à surfaire.
VALÈRE.
Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte! qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes veuille se déguiser aux yeux du monde, et tenir enterrés les beaux talens qu'il a!
SGANARELLE, à part.
Il est fou.
VALÈRE.
De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous.
SGANARELLE.
Comment?
LUCAS.
Tout ce tripotage ne sert de rian; je savons ceu que je savons.
SGANARELLE.
Quoi donc? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous?
VALÈRE.
Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin.
SGANARELLE.
Médecin vous-même! je ne le suis point, et je ne l'ai jamais été.
VALÈRE, bas.
Voilà sa folie qui le tient. (Haut.) Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage, et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités.
SGANARELLE.
A quoi donc?
VALÈRE.
A de certaines choses dont nous serions marris[101].
SGANARELLE.
Parbleu! venez-en à tout ce qu'il vous plaira; je ne suis point médecin, et ne sais ce que vous me voulez dire.
VALÈRE, bas.
Je vois bien qu'il faut se servir de remède. (Haut.) Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes.
LUCAS.
Eh! tétigué! ne lantiponez[102] point davantage, et confessez à la franquette que v's êtes médecin.
SGANARELLE, à part.
J'enrage!
VALÈRE.
A quoi bon nier ce qu'on sait?
LUCAS.
Pourquoi toutes ces fredaines-là? A quoi est-ce que ça vous sart?
SGANARELLE.
Messieurs, en un mot autant qu'en deux mille, je vous dis que je ne suis point médecin.
VALÈRE.
Vous n'êtes point médecin?
SGANARELLE.
Non.
LUCAS.
V' n'êtes point médecin?
SGANARELLE.
Non, vous dis-je.
VALÈRE.
Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre.
Ils prennent chacun un bâton et le frappent.
SGANARELLE.
Ah! ah! ah! messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira.
VALÈRE.
Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence?
LUCAS.
A quoi bon nous bailler la peine de vous battre?
VALÈRE.
Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde.
LUCAS.
Par ma figué! j'en sis fâché, franchement.
SGANARELLE.
Que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce pour rire, ou si tous deux vous extravaguez, de vouloir que je sois médecin?
VALÈRE.
Quoi! vous ne vous rendez pas encore, et vous vous défendez d'être médecin.
SGANARELLE.
Diable emporte si je le suis!
LUCAS.
Il n'est pas vrai qu'ous sayez médecin?
SGANARELLE.
Non, la peste m'étouffe! (Ils recommencent à le battre.) Ah! ah! Eh bien, messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin, je suis médecin; apothicaire encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer.
VALÈRE.
Ah! voilà qui va bien, monsieur; je suis ravi de vous voir raisonnable.
LUCAS.
Vous me boutez la joie au cœur, quand je vous vois parler comme ça.
VALÈRE.
Je vous demande pardon de toute mon âme.
LUCAS.
Je vous demandons excuse de la libarté que j'avons prise.
SGANARELLE, à part.
Ouais, seroit-ce bien moi qui me tromperois, et serois-je devenu médecin sans m'en être aperçu?
VALÈRE.
Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes, et vous verrez assurément que vous en serez satisfait.
SGANARELLE.
Mais, messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-mêmes? Est-il bien assuré que je sois médecin?
LUCAS.
Oui, par ma figué!
SGANARELLE.
Tout de bon?
VALÈRE.
Sans doute.
SGANARELLE.
Diable emporte si je le savois!
VALÈRE.
Comment! vous êtes le plus habile médecin du monde.
SGANARELLE.
Ah! ah!
LUCAS.
Un médecin qui a gari je ne sais combien de maladies.
SGANARELLE.
Tudieu!
VALÈRE.
Une femme étoit tenue pour morte il y avoit six heures; elle étoit prête à ensevelir, lorsque avec une goutte de 212 quelque chose vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre.
SGANARELLE.
Peste!
LUCAS.
Un petit enfant de douze ans se laissit choir du haut d'un clocher, de quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés; et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds, et s'en fut jouer à la fossette.
SGANARELLE.
Diantre!
VALÈRE.
Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous, et vous gagnerez ce que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener.
SGANARELLE.
Je gagnerai ce que je voudrai?
VALÈRE.
Oui.
SGANARELLE.
Ah! je suis médecin, sans contredit. Je l'avois oublié; mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? où faut-il se transporter?
VALÈRE.
Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole.
SGANARELLE.
Ma foi! je ne l'ai pas trouvée.
VALÈRE, bas à Lucas.
Il aime à rire. (A Sganarelle.) Allons, monsieur.
SGANARELLE.
Sans une robe de médecin?
VALÈRE.
Nous en prendrons une.
SGANARELLE, présentant sa bouteille à Valère.
Tenez cela, vous; voilà où je mets mes juleps. (Puis se tournant vers Lucas en crachant.) Vous, marchez là-dessus, par ordonnance du médecin.
LUCAS.
Palsanguenne; v'là un médecin qui me plaît; je pense qu'il réussira, car il est bouffon.
ACTE II
Le théâtre représente une chambre de la maison de Géronte.
SCÈNE I.—GÉRONTE, VALÈRE, LUCAS, JACQUELINE.
VALÈRE.
Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait; et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde.
LUCAS.
Oh! morguenne! il faut tirer l'échelle après ceti-là; et tous les autres ne sont pas daignes de li déchausser ses souliers.
VALÈRE.
C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses.
LUCAS.
Qui a gari des gens qui étiant morts.
VALÈRE.
Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit; et parfois il a des momens où son esprit s'échappe, et ne paroît pas ce qu'il est.
LUCAS.
Oui, il aime à bouffonner; et l'an diroit parfois, ne v's en déplaise, qu'il a quelque petit coup de hache à la tête.
VALÈRE.
Mais, dans le fond, il est toute science, et bien souvent il dit des choses tout à fait relevées.
LUCAS.
Quand il s'y boute, il parle tout fin drait comme s'il lisoit dans un livre.
VALÈRE.
Sa réputation s'est déjà répandue ici, et tout le monde vient à lui.
GÉRONTE.
Je me meurs d'envie de le voir; faites-le-moi vite venir.
VALÈRE.
Je le vais querir.
SCÈNE II.—GÉRONTE, JACQUELINE, LUCAS.
JACQUELINE.
Par ma fi, monsieu, ceti-ci fera justement ce qu'ant fait les autres. Je pense que ce sera queussi queumi[103]; et la meilleure médeçaine que l'an pourroit bailler à votre fille, ce seroit, selon moi, un biau et bon mari, pour qui alle eût de l'amiquié.
GÉRONTE.
Ouais! nourrice, ma mie, vous vous mêlez de bien des choses!
LUCAS.
Taisez-vous, notre minagère Jacquelaine; ce n'est pas à vous à bouter là votre nez.
JACQUELINE.
Je vous dis et vous douze que tous ces médecins n'y feront rian que de l'iau claire; que votre fille a besoin d'autre chose que de rhibarbe et de séné, et qu'un mari est un emplâtre qui garit tous les maux des filles.
GÉRONTE.
Est-elle en état maintenant qu'on s'en voulût charger avec l'infirmité qu'elle a? Et, lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés?
JACQUELINE.
Je le crois bian: vous li vouliez bailler eun homme qu'alle n'aime point. Que ne preniais-vous ce monsieur Liandre, qui li touchoit au cœur? Alle auroit été fort obéissante; et 215 je m'en vas gager qu'il la prendroit, li, comme alle est, si vous la li vouillais donner.
GÉRONTE.
Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut; il n'a pas du bien comme l'autre.
JACQUELINE.
Il a eun oncle qui est si riche, dont il est hériquié!
GÉRONTE.
Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce qu'on tient, et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers, et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un.
JACQUELINE.
Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ant cette maudite couteume de demander toujours: Qu'a-t-il? et Qu'a-t-elle? et le compère Piarre a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quarquié de vaigne qu'il avoit davantage que le jeune Robin, où alle avoit bouté son amiquié; et v'là que la pauvre criature en est devenue jaune comme un coing, et n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieu. On n'a que son plaisir en ce monde, et j'aimerois mieux bailler à ma fille eun bon mari qui li fût agréable, que toutes les rentes de la Biausse.
GÉRONTE.
Peste! madame la nourrice, comme vous dégoisez! Taisez-vous, je vous prie; vous prenez trop de soin, et vous échauffez votre lait.
LUCAS, frappant, à chaque phrase qu'il dit, sur l'épaule de Géronte.
Morguié! tais-toi, t'es eune impertinente. Monsieu n'a que faire de tes discours, et il sait ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à teter à ton enfant, sans tant faire la raisonneuse. Monsieu est le père de sa fille, et il est bon et sage pour voir ce qu'il li faut.
GÉRONTE.
Tout doux! Oh! tout doux!
LUCAS, frappant encore sur l'épaule de Géronte.
Monsieu, je veux un peu la mortifier, et li apprendre le respect qu'alle vous doit.
GÉRONTE.
Oui. Mais ces gestes ne sont pas nécessaires.
SCÈNE III.—VALÈRE, SGANARELLE, GÉRONTE, LUCAS, JACQUELINE.
VALÈRE.
Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre.
GÉRONTE, à Sganarelle.
Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi, et nous avons grand besoin de vous.
SGANARELLE, en robe de médecin avec un chapeau des plus pointus.
Hippocrate dit... que nous nous couvrions tous deux.
GÉRONTE.
Hippocrate dit cela?
SGANARELLE.
Oui.
GÉRONTE.
Dans quel chapitre, s'il vous plaît?
SGANARELLE.
Dans son chapitre... des chapeaux[104].
GÉRONTE.
Puisque Hippocrate le dit, il le faut faire.
SGANARELLE.
Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses...
GÉRONTE.
A qui parlez-vous, de grâce?
SGANARELLE.
A vous.
GÉRONTE.
Je ne suis pas médecin.
SGANARELLE.
Vous n'êtes pas médecin?
GÉRONTE.
Non, vraiment.
SGANARELLE.
Tout de bon?
GÉRONTE.
Tout de bon. (Sganarelle prend un bâton et frappe Géronte.) Ah! ah! ah!
SGANARELLE.
Vous êtes médecin maintenant: je n'ai jamais eu d'autres licences.
GÉRONTE, à Valère.
Quel diable d'homme m'avez-vous là amené?
VALÈRE.
Je vous ai bien dit que c'étoit un médecin goguenard.
GÉRONTE.
Oui; mais je l'enverrois promener avec ses goguenarderies.
LUCAS.
Ne prenez pas garde à ça, monsieu, ce n'est que pour rire.
GÉRONTE.
Cette raillerie ne me plaît pas.
SGANARELLE.
Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise.
GÉRONTE.
Monsieur, je suis votre serviteur.
SGANARELLE.
Je suis fâché...
GÉRONTE.
Cela n'est rien.
SGANARELLE.
Des coups de bâton...
GÉRONTE.
Il n'y a pas de mal.
SGANARELLE.
Que j'ai eu l'honneur de vous donner.
GÉRONTE.
Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie.
SGANARELLE.
Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi, et je souhaiterois de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir.
GÉRONTE.
Je vous suis obligé de ces sentimens.
SGANARELLE.
Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle.
GÉRONTE.
C'est trop d'honneur que vous me faites.
SGANARELLE.
Comment s'appelle votre fille?
GÉRONTE.
Lucinde.
SGANARELLE.
Lucinde! Ah! beau nom à médicamenter! Lucinde!
GÉRONTE.
Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait.
SGANARELLE.
Qui est cette grande femme-là?
GÉRONTE.
C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai.
SCÈNE IV.—SGANARELLE, JACQUELINE, LUCAS.
SGANARELLE, à part.
Peste! le joli meuble que voilà! (Haut.) Ah! nourrice! charmante nourrice, ma médecine est la très-humble esclave de votre nourricerie, et je voudrois bien être le petit poupon fortuné qui tetât le lait de vos bonnes grâces. (Il lui porte la main sur le sein.) Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service, et...
LUCAS.
Avec votre permission monsieu le médecin, laissez là ma femme, je vous prie.
SGANARELLE.
Quoi! elle est votre femme?
LUCAS.
Oui.
SGANARELLE.
Ah! vraiment je ne savois pas cela, et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre.
Il fait semblant de vouloir embrasser Lucas, et embrasse la nourrice.
LUCAS, tirant Sganarelle, et se remettant entre lui et sa femme.
Tout doucement, s'il vous plaît.
SGANARELLE.
Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble: et la félicite d'avoir un mari comme vous; et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si sage, et si bien faite comme elle est.
Faisant encore semblant d'embrasser Lucas, qui lui tend les bras, il passe dessous, et embrasse encore la nourrice.
LUCAS, le tirant encore.
Eh! tétigué! point tant de complimens, je vous supplie.
SGANARELLE.
Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage?
LUCAS.
Avec moi tant qu'il vous plaira; mais, avec ma femme, trêve de sarimonie.
SGANARELLE.
Je prends part également au bonheur de tous deux: et, si je vous embrasse pour vous témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi.
Il continue le même jeu.
LUCAS, le tirant pour la troisième fois.
Ah! vartigué, monsieu le médecin, que de lantiponage[105]!
SCÈNE V.—GÉRONTE, SGANARELLE, LUCAS, JACQUELINE.
GÉRONTE.
Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener.
SGANARELLE.
Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine.
GÉRONTE.
Où est-elle?
SGANARELLE, se touchant le front.
Là dedans.
GÉRONTE.
Fort bien.
SGANARELLE.
Mais, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice, et que je visite son sein.
Il s'approche de Jacqueline.
LUCAS, le tirant et lui faisant faire la pirouette.
Nannain, nannain; je n'avons que faire de ça.
SGANARELLE.
C'est l'office du médecin de voir les tetons des nourrices.
LUCAS.
Il gnia office qui quienne, je sis votre serviteur.
SGANARELLE.
As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là!
LUCAS.
Je me moque de ça!
SGANARELLE, en le regardant de travers.
Je te donnarai la fièvre.
JACQUELINE, prenant Lucas par le bras, et lui faisant faire aussi la pirouette.
Ote-toi de là aussi; est-ce que je ne sis pas assez grande pour me défendre moi-même, s'il me fait queuque chose qui ne soit pas à faire?
LUCAS.
Je ne veux pas qu'il te tâte, moi.
SGANARELLE.
Fi! le vilain, qui est jaloux de sa femme!
GÉRONTE.
Voici ma fille.
SCÈNE VI.—LUCINDE, GÉRONTE, SGANARELLE, VALÈRE, LUCAS, JACQUELINE.
SGANARELLE.
Est-ce là la malade?
GÉRONTE.
Oui. Je n'ai qu'elle de fille; et j'aurois tous les regrets du monde si elle venoit à mourir.
SGANARELLE.
Qu'elle s'en garde bien! Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin.
GÉRONTE.
Allons, un siége.
SGANARELLE, assis entre Géronte et Lucinde.
Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante, et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderoit assez.
GÉRONTE.
Vous l'avez fait rire, monsieur.
SGANARELLE.
Tant mieux: lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. (A Lucinde.) Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez?
LUCINDE, portant sa main à sa bouche, à sa tête et sous son menton.
Han, hi, hon, han.
SGANARELLE.
Hé! que dites-vous?
LUCINDE, continue les mêmes gestes.
Han, hi, hon, hon, han, hi, hon.
SGANARELLE.
Quoi?
LUCINDE.
Han, hi, hon.
SGANARELLE.
Han, hi, hon, han, ha. Je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là?
GÉRONTE.
Monsieur, c'est là sa maladie, elle est devenue muette, sans que jusques ici on en ait pu savoir la cause; et c'est un accident qui a fait reculer son mariage.
SGANARELLE.
Et pourquoi?
GÉRONTE.
Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses.
SGANARELLE.
Et qui est ce sot-là, qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie! je me garderois bien de la vouloir guérir.
GÉRONTE.
Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal.
SGANARELLE.
Ah! ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu: ce mal l'oppresse-t-il beaucoup?
GÉRONTE.
Oui, monsieur.
SGANARELLE.
Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs?
GÉRONTE.
Fort grandes.
SGANARELLE.
C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez?
GÉRONTE.
Oui.
SGANARELLE.
Copieusement?
GÉRONTE.
Je n'entends rien à cela.
SGANARELLE.
La matière est-elle louable?
GÉRONTE.
Je ne me connois pas à ces choses.
SGANARELLE, à Lucinde.
Donnez-moi votre bras. (A Géronte.) Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette.
GÉRONTE.
Eh! oui, monsieur, c'est là son mal; vous l'avez trouvé tout du premier coup.
SGANARELLE.
Ah! ah!
JACQUELINE.
Voyez comme il a deviné sa maladie!
SGANARELLE.
Nous autres grands médecins, nous connoissons d'abord les choses. Un ignorant auroit été embarrassé, et vous eût été dire: C'est ceci, c'est cela; mais moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre fille est muette.
GÉRONTE.
Oui; mais je voudrois bien que vous me puissiez dire d'où cela vient.
SGANARELLE.
Il n'est rien de plus aisé: cela vient de ce qu'elle a perdu la parole.
GÉRONTE.
Fort bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole?
SGANARELLE.
Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue.
GÉRONTE.
Mais encore, vos sentimens sur cet empêchement de l'action de sa langue?
SGANARELLE.
Aristote, là-dessus, dit... de fort belles choses.
GÉRONTE.
Je le crois.
SGANARELLE.
Ah! c'étoit un grand homme!
GÉRONTE.
Sans doute.
SGANARELLE.
Grand homme tout à fait... (Levant le bras depuis le coude.) un homme qui étoit plus grand que moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs, qu'entre nous autres savans nous appelons humeurs peccantes; c'est-à-dire... humeurs peccantes, d'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant... pour ainsi dire... à... Entendez-vous le latin?
GÉRONTE.
En aucune façon.
SGANARELLE, se levant brusquement.
Vous n'entendez point le latin?
GÉRONTE.
Non.
SGANARELLE, avec enthousiasme.
Cabricias, arci thuram, catalamus, singulariter, nominativo, hæc musa, la muse, bonus, bona, bonum. Deus sanctus, est-ne oratio latinas? Etiam, oui. Quare, pourquoi? Quia substantivo, et adjectivum, concordat in generi, numerum, et casus.
GÉRONTE.
Ah! que n'ai-je étudié!
JACQUELINE.
L'habile homme que v'là!
LUCAS.
Oui, ça est si biau, que je n'y entends goutte.
SGANARELLE.
Or ces vapeurs dont je vous parle venant à passer, du côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin armyan, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin lesdites 225 vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate; et parce que lesdites vapeurs... comprenez bien ce raisonnement, je vous prie...; et parce que lesdites vapeurs ont certaine malignité... écoutez bien ceci, je vous conjure.
GÉRONTE.
Oui.
SGANARELLE.
Ont une certaine malignité qui est causée... soyez attentif, s'il vous plaît.
GÉRONTE.
Je le suis.
SGANARELLE.
Qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, il arrive que ces vapeurs... Ossabundus, nequeis, nequer, potarinum, quipsa milus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette.
JACQUELINE.
Ah! que ça est bian dit, notre homme!
LUCAS.
Que n'ai-je la langue aussi bian pendue!
GÉRONTE.
On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué: c'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont; que le cœur est du côté gauche, et le foie du côté droit.
SGANARELLE.
Oui, cela étoit autrefois ainsi; mais nous avons changé tout cela, et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle.
GÉRONTE.
C'est ce que je ne savois pas, et je vous demande pardon de mon ignorance.
SGANARELLE.
Il n'y a point de mal; et vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous.
GÉRONTE.
Assurément. Mais, monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie?
SGANARELLE.
Ce que je crois qu'il faille faire?
GÉRONTE.
Oui.
SGANARELLE.
Mon avis est qu'on la remette sur son lit, et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin.
GÉRONTE.
Pourquoi cela, monsieur?
SGANARELLE.
Parce qu'il y a dans le vin et le pain, mêlés ensemble, une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre chose aux perroquets, et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela?
GÉRONTE.
Cela est vrai. Ah! le grand homme! Vite, quantité de pain et de vin.
SGANARELLE.
Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera.
SCÈNE VII.—GÉRONTE, SGANARELLE, JACQUELINE.
SGANARELLE, à Jacqueline.
Doucement, vous. (A Géronte.) Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes.
JACQUELINE.
Qui? moi? Je me porte le mieux du monde!
SGANARELLE.
Tant pis, nourrice, tant pis! Cette grande santé est à craindre, et il ne sera pas mauvais de vous faire quelque petite saignée amiable, de vous donner quelque petit clystère dulcifiant.
GÉRONTE
Mais, monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi s'aller faire saigner quand on n'a point de maladie?
SGANARELLE.
Il n'importe, la mode en est salutaire; et, comme on boit 227 pour la soif à venir, il faut aussi se faire saigner pour la maladie à venir.
JACQUELINE, en s'en allant.
Ma fi, je me moque de ça, et je ne veux point faire de mon corps une boutique d'apothicaire.
SGANARELLE.
Vous êtes rétive aux remèdes, mais nous saurons vous soumettre à la raison.
SCÈNE VIII[106].—GÉRONTE, SGANARELLE.
SGANARELLE.
Je vous donne le bonjour.
GÉRONTE.
Attendez un peu, s'il vous plaît.
SGANARELLE.
Que voulez-vous faire?
GÉRONTE.
Vous donner de l'argent, monsieur.
SGANARELLE, tendant sa main par derrière, tandis que Géronte ouvre sa bourse.
Je n'en prendrai pas, monsieur.
GÉRONTE.
Monsieur.
SGANARELLE.
Point du tout.
GÉRONTE.
Un petit moment.
SGANARELLE.
En aucune façon.
GÉRONTE.
De grâce!
SGANARELLE.
Vous vous moquez.
GÉRONTE.
Voilà qui est fort.
SGANARELLE.
Je n'en ferai rien.
GÉRONTE.
Eh!
SGANARELLE.
Ce n'est pas l'argent qui me fait agir.
GÉRONTE.
Je le crois.
SGANARELLE, après avoir pris l'argent.
Cela est-il de poids?
GÉRONTE.
Oui, monsieur.
SGANARELLE.
Je ne suis pas un médecin mercenaire.
GÉRONTE.
Je le sais bien.
SGANARELLE.
L'intérêt ne me gouverne point.
GÉRONTE.
Je n'ai pas cette pensée.
SGANARELLE, seul, regardant l'argent qu'il a reçu.
Ma foi, cela ne va pas mal, et pourvu que...
SCÈNE IX.—LÉANDRE, SGANARELLE.
LÉANDRE.
Monsieur, il y a longtemps que je vous attends; et je viens implorer votre assistance.
SGANARELLE, lui tâtant le pouls.
Voilà un pouls qui est fort mauvais.
LÉANDRE.
Je ne suis point malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous.
SGANARELLE.
Si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc?
LÉANDRE.
Non. Pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle 229 Léandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter; et comme, par la mauvaise humeur de son père, toute sorte d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie.
SGANARELLE.
Pour qui me prenez-vous? Comment! oser vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour, et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature!
LÉANDRE.
Monsieur, ne faites point de bruit.
SGANARELLE, en le faisant reculer.
J'en veux faire, moi! Vous êtes un impertinent!
LÉANDRE.
Eh! monsieur, doucement!
SGANARELLE.
Un malavisé!
LÉANDRE.
De grâce!
SGANARELLE.
Je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela, et que c'est une insolence extrême...
LÉANDRE, tirant une bourse.
Monsieur...
SGANARELLE.
De vouloir m'employer... (Recevant la bourse.) Je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme, et je serois ravi de vous rendre service: mais il y a de certains impertinens au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et je vous avoue que cela me met en colère.
LÉANDRE.
Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté que...
SGANARELLE.
Vous vous moquez. De quoi est-il question?
LÉANDRE.
Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous 230 voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut; et ils n'ont pas manqué de dire que cela procédoit, qui[107] du cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie; mais il est certain que l'amour en est la véritable cause, et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle étoit importunée. Mais, de crainte qu'on ne nous voie ensemble retirons-nous d'ici, et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous.
SGANARELLE.
Allons, monsieur; vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable, et j'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous.
ACTE III
Le théâtre représente un lieu voisin de la maison de Géronte.
SCÈNE I.—LÉANDRE, SGANARELLE.
LÉANDRE.
Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire; et, comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux.
SGANARELLE.
Sans doute.
LÉANDRE.
Tout ce que je souhaiterois seroit de savoir cinq ou six grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme.
SGANARELLE.
Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire; il suffit de l'habit, et je n'en sais pas plus que vous.
LÉANDRE.
Comment!
SGANARELLE.
Diable emporte si j'entends rien en médecine! Vous êtes honnête homme, et je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi.
LÉANDRE.
Quoi! vous n'êtes pas effectivement...
SGANARELLE.
Non, vous dis-je; ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étois jamais mêlé d'être si savant que cela; et toutes mes études n'ont été que jusqu'en sixième. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue; mais, quand j'ai vu qu'à toute force ils vouloient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Cependant vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous côtés; et, si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous; car, soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos, et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne sauroit gâter un morceau de cuir qu'il n'en paye les pots cassés; mais ici l'on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde, et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué[108].
LÉANDRE.
Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière.
SGANARELLE, voyant des hommes qui viennent à lui.
Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. (A Léandre.) Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse.
SCÈNE II.—THIBAUT, PERRIN, SGANARELLE.
THIBAUT.
Monsieur, je venons vous chercher, mon fils Perrin et moi.
SGANARELLE.
Qu'y a-t-il?
THIBAUT.
Sa pauvre mère, qui a nom Parrette, est dans un lit malade il y a six mois.
SGANARELLE, tendant la main comme pour recevoir de l'argent.
Que voulez-vous que j'y fasse?
THIBAUT.
Je voudrions, monsieur, que vous nous baillissiez queuque petite drôlerie pour la garir.
SGANARELLE.
Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade.
THIBAUT.
Alle est malade d'hypocrisie, monsieu.
SGANARELLE.
D'hypocrisie?
THIBAUT.
Oui, c'est-à-dire qu'alle est enflée partout; et l'an dit que c'est quantité de sériosités qu'alle a dans le corps, et que son foie, son ventre, ou sa rate, comme vous voudrais l'appeler, au glieu de faire du sang, ne fait plus que l'iau. Alle a, de deux jours l'un, la fièvre quotiguienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les mufles des jambes. On entend dans sa gorge des fleumes qui sont tout prêts à l'étouffer; et parfois il li prend des syncoles et des conversions, que je crayons qu'alle est passée. J'avons dans notre village un apothicaire, révérence parler, qui li a donné je ne sais combien d'histoires; et il m'en coûte plus d'eune 233 douzaine de bons écus en lavements, ne v's en déplaise, en aposthumes qu'on li a fait prendre, en infection de jacinthe et en portions cordales. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que de l'onguent miton-mitaine. Il veloit li bailler d'eune certaine drogue qu'on appelle du vin amétile, mais j'ai-z-eu peur franchement que ça l'envoyit a patres; et l'an dit que ces gros médecins tuont je ne sais combien de monde avec cette invention-là.
SGANARELLE, tendant toujours la main.
Venons au fait, mon ami, venons au fait.
THIBAUT.
Le fait est, monsieu, que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fassions.
SGANARELLE.
Je ne vous entends point du tout.
PERRIN.
Monsieu, ma mère est malade; et v'là deux écus que je vous apportons pour nous bailler queuque remède.
SGANARELLE.
Ah! je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement, et qui s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade d'hydropisie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre, avec des douleurs dans les jambes, et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire, des évanouissements?
PERRIN.
Eh! oui, monsieu, c'est justement ça.
SGANARELLE.
J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant, vous me demandez un remède?
PERRIN.
Oui, monsieu.
SGANARELLE.
Un remède pour la guérir?
PERRIN.
C'est comme je l'entendons.
SGANARELLE.
Tenez, voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre.
PERRIN.
Du fromage, monsieu?
SGANARELLE.
Oui; c'est un fromage préparé, où il entre de l'or, du corail et des perles, et quantité d'autres choses précieuses.
PERRIN.
Monsieu, je vous sommes bien obligé, et j'allons li faire prendre ça tout à l'heure.
SGANARELLE.
Allez. Si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez.
SCÈNE III.—JACQUELINE, SGANARELLE, LUCAS, dans le fond du théâtre.
Le théâtre change, et représente, comme au second acte, une chambre de
la maison de Géronte.
SGANARELLE.
Voici la belle nourrice. Ah! nourrice de mon cœur, je suis ravi de cette rencontre, et votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné, qui purgent toute la mélancolie de mon âme.
JACQUELINE.
Par ma figué! monsieu le médecin, ça est trop bian dit pour moi, et je n'entends rian à tout votre latin.
SGANARELLE.
Devenez malade, nourrice, je vous prie; devenez malade pour l'amour de moi. J'aurois toutes les joies du monde de vous guérir.
JACQUELINE.
Je sis votre servante; j'aime bian mieux qu'an ne me garisse pas.
SGANARELLE.
Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez!
JACQUELINE.
Que velez-vous, monsieu? C'est pour la pénitence de mes fautes; et là où la chèvre est liée, il faut bian qu'alle y broute.
SGANARELLE.
Comment! un rustre comme cela! un homme qui vous observe toujours, et ne veut pas que personne vous parle!
JACQUELINE.
Hélas! vous n'avez rian vu encore, et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise himeur.
SGANARELLE.
Est-il possible! et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous! Ah! que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendroient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petons! Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de pareilles mains? et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot... Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari...
JACQUELINE.
Eh! monsieu, je sais bian qu'il mérite tous ces noms-là.
SGANARELLE.
Oui, sans doute, nourrice, il les mérite; et il mériteroit encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête, pour le punir des soupçons qu'il a.
JACQUELINE.
Il est bian vrai que si je n'avois devant les yeux que son intérêt, il pourroit m'obliger à queuque étrange chose.
SGANARELLE.
Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un; c'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela; et, si j'étois assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour...
Dans le temps que Sganarelle tend les bras pour embrasser Jacqueline, Lucas passe sa tête par-dessous, et se met entre eux deux. Sganarelle et Jacqueline regardent Lucas, et sortent chacun de leur côté.
SCÈNE IV.—GÉRONTE, LUCAS.
GÉRONTE.
Holà! Lucas, n'as-tu point vu ici notre médecin?
LUCAS.
Eh oui, de par tous les diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi.
GÉRONTE.
Où est-ce donc qu'il peut être?
LUCAS.
Je ne sais; mais je voudrois qu'il fût à tous les guébles.
GÉRONTE.
Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille.
SCÈNE V.—SGANARELLE, LÉANDRE, GÉRONTE.
GÉRONTE.
Ah! monsieur, je demandois où vous étiez.
SGANARELLE.
Je m'étois amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade?
GÉRONTE.
Un peu plus mal depuis votre remède.
SGANARELLE.
Tant mieux, c'est signe qu'il opère.
GÉRONTE.
Oui; mais en opérant je crains qu'il ne l'étouffe.
SGANARELLE.
Ne vous mettez pas en peine, j'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l'attends à l'agonie.
GÉRONTE, montrant Léandre.
Qui est cet homme-là que vous amenez?
SGANARELLE, faisant des signes avec la main pour montrer que c'est un apothicaire.
C'est...
GÉRONTE.
Quoi?
SGANARELLE.
Celui...
GÉRONTE.
Eh?
SGANARELLE.
Qui...
GÉRONTE.
Je vous entends.
SGANARELLE.
Votre fille en aura besoin.
SCÈNE VI.—LUCINDE, GÉRONTE, LÉANDRE, JACQUELINE, SGANARELLE.
JACQUELINE.
Monsieu, v'là votre fille qui veut un peu marcher.
SGANARELLE.
Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâter un peu son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. (Sganarelle tire Géronte dans un coin du théâtre, et lui passe un bras sur les épaules pour l'empêcher de tourner la tête du côté où sont Léandre et Lucinde.) Monsieur, c'est une grande et subtile question, entre les docteurs, de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui: et moi je dis que oui et non; d'autant que l'incongruité des humeurs opaques, qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes, étant cause que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive, on voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la lune; et, comme le soleil, qui darde ses rayons sur la concavité de la terre, trouve...
LUCINDE, à Léandre.
Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment.
GÉRONTE.
Voilà ma fille qui parle! O grande vertu du remède! ô 238 admirable médecin! Que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse! et que puis-je faire pour vous après un tel service?
SGANARELLE, se promenant sur le théâtre et s'éventant avec son chapeau.
Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine!
LUCINDE.
Oui, mon père, j'ai recouvré la parole; mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace.
GÉRONTE.
Mais...
LUCINDE.
Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise.
GÉRONTE.
Quoi!...
LUCINDE.
Vous m'opposerez en vain de belles raisons.
GÉRONTE.
Si...
LUCINDE.
Tous vos discours ne serviront de rien.
GÉRONTE.
Je...
LUCINDE.
C'est une chose où je suis déterminée.
GÉRONTE.
Mais...
LUCINDE.
Il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi.
GÉRONTE.
J'ai....
LUCINDE.
Vous avez beau faire tous vos efforts.
GÉRONTE.
Il...
LUCINDE.
Mon cœur ne sauroit se soumettre à cette tyrannie.
GÉRONTE.
La...
LUCINDE.
Et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point.
GÉRONTE.
Mais...
LUCINDE, avec vivacité.
Non. En aucune façon. Point d'affaires. Vous perdez le temps. Je n'en ferai rien. Cela est résolu.
GÉRONTE.
Ah! quelle impétuosité de paroles! Il n'y a pas moyen d'y résister. (A Sganarelle.) Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette.
SGANARELLE.
C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez[109].
GÉRONTE.
Je vous remercie. (A Lucinde.) Penses-tu donc...
LUCINDE.
Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme.
GÉRONTE.
Tu épouseras Horace dès ce soir.
LUCINDE.
J'épouserai plutôt la mort.
SGANARELLE, à Géronte.
Mon Dieu! arrêtez-vous, laissez-moi médicamenter cette affaire; c'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il y faut apporter.
GÉRONTE.
Seroit-il possible, monsieur, que vous pussiez aussi guérir cette maladie d'esprit?
SGANARELLE.
Oui; laissez-moi faire, j'ai des remèdes pour tout, et 240 notre apothicaire nous servira pour cette cure. (A Léandre.) Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père; qu'il n'y a point de temps à perdre; que les humeurs sont fort aigries; et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal, qui pourroit empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez comme il faut avec deux dragmes de matrimonium en pilules. Peut-être fera-t-elle quelque difficulté à prendre ce remède; mais, comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre, et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire faire un petit tour de jardin, afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père; mais surtout ne perdez point de temps. Au remède, vite, au remède spécifique!
SCÈNE VII[110].—GÉRONTE, SGANARELLE.
GÉRONTE.
Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommer.
SGANARELLE.
Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes.
GÉRONTE.
Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne?
SGANARELLE.
Les filles sont quelquefois un peu têtues.
GÉRONTE.
Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre.
SGANARELLE.
La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits.
GÉRONTE.
Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille renfermée.
SGANARELLE.
Vous avez fait sagement.
GÉRONTE.
Et j'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble.
SGANARELLE.
Fort bien.
GÉRONTE.
Il seroit arrivé quelque folie, si j'avois souffert qu'ils se fussent vus.
SGANARELLE.
Sans doute.
GÉRONTE.
Et je crois qu'elle auroit été fille à s'en aller avec lui.
SGANARELLE.
C'est prudemment raisonné.
GÉRONTE.
On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler.
SGANARELLE.
Quel drôle!
GÉRONTE.
Mais il perdra son temps.
SGANARELLE.
Ah! ah!
GÉRONTE.
Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie.
SGANARELLE.
Il n'a pas affaire à un sot, et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête.
SCÈNE VIII.—LUCAS, GÉRONTE, SGANARELLE.
LUCAS.
Ah! palsanguenne, monsieu, vaici bian du tintamarre; votre fille s'en est enfuie avec son Liandre. C'étoit lui qui étoit l'apothicaire, et v'là monsieu le médecin qui a fait cette belle opération-là.
GÉRONTE.
Comment! m'assassiner de la façon! Allons, un commissaire 242 et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah! traître, je vous ferai punir par la justice!
LUCAS.
Ah! par ma fi, monsieu le médecin, vous serez pendu, ne bougez de là seulement.
SCÈNE IX.—MARTINE, SGANARELLE, LUCAS.
MARTINE, à Lucas.
Ah! mon Dieu! que j'ai eu de la peine à trouver ce logis! Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné.
LUCAS.
Le v'là qui va être pendu.
MARTINE.
Quoi! mon mari pendu! Hélas! et qu'a-t-il fait pour cela?
LUCAS.
Il a fait enlever la fille de notre maître.
MARTINE.
Hélas! mon cher mari, est-il bien vrai qu'on te va pendre?
SGANARELLE.
Tu vois. Ah!
MARTINE.
Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens?
SGANARELLE.
Que veux-tu que j'y fasse?
MARTINE.
Encore, si tu avois achevé de couper notre bois, je prendrois quelque consolation.
SGANARELLE.
Retire-toi de là; tu me fends le cœur!
MARTINE.
Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort, et je ne te quitterai point que je ne t'aie vu pendu.
SGANARELLE.
Ah!
SCÈNE X.—GÉRONTE, SGANARELLE, MARTINE.
GÉRONTE, à Sganarelle.
Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous.
SGANARELLE, à genoux.
Hélas! cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton?
GÉRONTE.
Non, non; la justice en ordonnera. Mais que vois-je?
SCÈNE XI.—GÉRONTE, LÉANDRE, LUCINDE, SGANARELLE, LUCAS, MARTINE.
LÉANDRE.
Monsieur, je viens faire paroître Léandre à vos yeux, et remettre Lucinde en votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite nous deux, et de nous aller marier ensemble; mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort, et que je suis héritier de tous ses biens[111].
GÉRONTE.
Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde.
SGANARELLE, à part.
La médecine l'a échappé belle!
MARTINE.
Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin; car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur.
SGANARELLE.
Oui! c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton!
LÉANDRE, à Sganarelle.
L'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment.
SGANARELLE.
Soit. (A Martine.) Je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé: mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence, et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire.
FIN DU MEDECIN MALGRE LUI.
REPRÉSENTÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS, A SAINT-GERMAIN EN LAYE DEVANT LA COUR, DANS LE BALLET DES MUSES, LE 2 DÉCEMBRE 1666.
Fatigué de sa vie conjugale, Molière, qui avait écrit le Tartuffe sans pouvoir le jouer, et fait représenter le Misanthrope, jouissait, à Auteuil, dans une maison qu'il louait à très-haut prix, d'une aisance considérable et de l'amitié de Boileau, de Chapelle, de la Fontaine. Il faisait du bien, disposait généreusement de sa fortune, protégeait les jeunes talents et se consolait ainsi. Le hasard lui envoya un jeune enfant en haillons, fils de comédien, né parmi les bohèmes, d'une beauté rare, d'une vive intelligence, d'une grande aptitude à tout comprendre et à tout imiter. Molière le retira chez lui, lui apprit l'histoire, cultiva ses qualités d'esprit, l'adopta et le produisit auprès de ses amis. Baron (c'était son nom) devait traverser la fin du dix-septième et la première moitié du dix-huitième siècle en triomphateur, adoré des femmes, le premier comédien de son siècle. Molière l'avait formé de ses propres mains.
Lorsqu'il reçut du roi l'ordre de composer une pastorale et une comédie nouvelle pour le Ballet des Muses, que disposait Benserade, et où devait danser le roi lui-même à Saint-Germain, le 2 décembre 1666, le rôle principal fut réservé au jeune enfant que le poëte protégeait. Objet des innocentes caresses et des préférences de trois ou quatre 246 jeunes femmes de la troupe de Molière, cet enfant, d'une beauté rare et d'une grâce parfaite, placé comme l'Indien Crichna au milieu des bergères ou gopis, offrait un spectacle neuf, charmant, naïf, intéressant, digne de la Pastorale, et dont le tact pittoresque de l'artiste se plut à s'emparer pour orner de ses couleurs les plus fraîches les contours délicats du tableau. Mademoiselle Duparc, mademoiselle Debrie, avaient rivalisé de complaisances et d'amabilités pour l'enfant choisi, et Molière mit en scène ce riant ensemble. C'est Mélicerte.
Mais depuis longtemps Armande, perle étincelante, étoile adorée de ce petit monde, concentrait tous les hommages. Elle trouva mauvais que ce jeune enfant l'éclipsât. Sa vanité de femme et d'actrice en fut blessée. S'il faut en croire la tradition, elle prodigua les mauvais traitements à l'enfant et le mit en fuite. En vain Molière essaya de le retenir. Baron osa se présenter lui-même à Louis XIV, et lui demander de quitter la troupe de son bienfaiteur, permission que le roi lui accorda. Baron consentit seulement à jouer son rôle dans Mélicerte, dont Molière, arrêté sans doute par tant de contrariétés irritantes, ne termina que les deux premiers actes.
Fraîcheur de sentiment, grâce de détail, un ton élégiaque et lyrique, rare chez Molière, distinguent ce charmant débris, ce fragment précieux et léger, imitation souvent heureuse de la pastorale italienne et espagnole, qui ne trouva place que dans la troisième entrée du Ballet des Muses. De la Pastorale comique, qui suivait Mélicerte, il ne nous reste que les paroles, les airs mis en musique par Lulli, airs que rien ne rattache l'un à l'autre; amas confus de ruines poétiques à travers lesquelles on entrevoit quelques traces des inventions pittoresques et la profonde perturbation d'esprit que ressentit Molière, privé de tout ce que son cœur aimait, désirait ou protégeait. Ces fragments, qui sont dans le goût du Pastor fido et des Loas, de Calderon, ou lui parurent indignes d'être conservés, ou lui rappelèrent de trop douloureux souvenirs de cette époque de sa vie, car il les brûla de sa main.
| PERSONNAGES. | ACTEURS. |
| MÉLICERTE, bergère. | MlleDuparc. |
| DAPHNÉ, bergère. | MlleDebrie. |
| ÉROXÈNE, bergère. | MlleMolière. |
| MYRTIL, amant de Mélicerte. | Baron. |
| ACANTHE, amant de Daphné. | La Grange. |
| TYRÈNE, amant d'Éroxène. | Du Croisy. |
| LYCARSIS, pâtre, cru père de Myrtil. | Molière. |
| CORINNE, confidente de Mélicerte. | Mad.Béjart. |
| NICANDRE, berger. | |
| MOPSE, berger, cru oncle de Mélicerte. | |
| La scène est en Thessalie, dans la vallée de Tempé. | |
ACTE PREMIER
SCÈNE I.—DAPHNÉ, ÉROXÈNE, ACANTHE, TYRÈNE.
ACANTHE.
TYRÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
ACANTHE, à Daphné.
TYRÈNE, à Éroxène.
DAPHNÉ, à Acanthe.
ÉROXÈNE, à Tyrène.
ACANTHE.
TYRÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
ACANTHE.
TYRÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
ACANTHE.
TYRÈNE.
ACANTHE.
TYRÈNE.
SCÈNE II.—DAPHNÉ, ÉROXÈNE.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE, mettant les deux portraits l'un à côté de l'autre.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
SCÈNE III.—LYCARSIS, MOPSE, NICANDRE.
NICANDRE, à Lycarsis.
LYCARSIS.
MOPSE.
LYCARSIS.
NICANDRE.
MOPSE.
NICANDRE.
LYCARSIS.
MOPSE.
LYCARSIS.
NICANDRE.
LYCARSIS.
MOPSE.
LYCARSIS.
NICANDRE.
LYCARSIS.
MOPSE.
LYCARSIS.
NICANDRE.
LYCARSIS.
MOPSE.
LYCARSIS.
MOPSE.
SCÈNE IV.—ÉROXENE, DAPHNÉ, LYCARSIS.
LYCARSIS, se croyant seul.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
LYCARSIS.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
LYCARSIS.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
LYCARSIS.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
LYCARSIS.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
LYCARSIS.
SCÈNE V.—ÉROXÈNE, DAPHNÉ et LYCARSIS, dans le fond du théâtre, MYRTIL.
MYRTIL, se croyant seul, et tenant un moineau dans une cage.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
MYRTIL.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
MYRTIL.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
LYCARSIS.
DAPHNÉ.
ÉROXÈNE.
MYRTIL.
ÉROXÈNE.
DAPHNÉ.
MYRTIL.
LYCARSIS.
ACTE II
SCÈNE I.—MÉLICERTE, CORINNE.
MÉLICERTE.
CORINNE.
MÉLICERTE.
CORINNE.
MÉLICERTE.
CORINNE.
MÉLICERTE.
CORINNE.
MÉLICERTE.
CORINNE.
MÉLICERTE.
CORINNE.
MÉLICERTE.
CORINNE.
MÉLICERTE.
CORINNE.
MÉLICERTE.
SCÈNE II.—MÉLICERTE
SCÈNE III.—MYRTIL, MÉLICERTE.
MYRTIL.
MÉLICERTE.
MYRTIL.
MÉLICERTE.
MYRTIL.
MÉLICERTE.
MYRTIL.
MÉLICERTE.
MYRTIL.
MÉLICERTE.
MYRTIL.
MÉLICERTE.
MYRTIL.
MÉLICERTE.
MYRTIL.
SCÈNE IV.—LYCARSIS, MYRTIL, MÉLICERTE.
LYCARSIS.
MÉLICERTE, à part.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
MÉLICERTE.
SCÈNE V.—LYCARSIS, MYRTIL.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS, à part.
MYRTIL, se jetant aux genoux de Lycarsis.
LYCARSIS, à part.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
LYCARSIS.
MYRTIL.
SCÈNE VI.—ACANTHE, TYRÈNE, MYRTIL.
ACANTHE.
TYRÈNE.
ACANTHE.
TYRÈNE.
MYRTIL.
ACANTHE.
TYRÈNE.
MYRTIL.
ACANTHE, à Tyrène.
TYRÈNE, à Acanthe.
SCÈNE VII.—NICANDRE, MYRTIL, ACANTHE, TYRÈNE.
NICANDRE.
MYRTIL.
NICANDRE.
MYRTIL.
NICANDRE.
MYRTIL.
NICANDRE.
MYRTIL.
ACANTHE.
FIN DE MÉLICERTE.
| PERSONNAGES DE LA PASTORALE. | |
| IRIS, jeune bergère. | MlleDebrie. |
| LYCAS, riche pasteur, amant d'Iris. | Molière. |
| PHILÈNE, riche pasteur, amant d'Iris. | Estival. |
| CORYDON, jeune berger, confident de Lycas, amant d'Iris. | La Grange. |
| UN PATRE, ami de Philène. | |
| UN BERGER. | |
| PERSONNAGES DU BALLET. | |
| MAGICIENS dansans. | |
| MAGICIENS chantans. | |
| DÉMONS dansans. | |
| PAYSANS. | |
| UNE ÉGYPTIENNE chantante et dansante. | |
| ÉGYPTIENS dansans. | |
| La scène est en Thessalie, dans un hameau de la vallée de Tempé. | |
SCÈNE I.—LYCAS, CORYDON.
SCÈNE II.—LYCAS, MAGICIENS chantans et dansans, DÉMONS.
PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.
Deux magiciens commencent, en dansant, un enchantement pour embellir Lycas; ils frappent la terre avec leurs baguettes, et en font sortir six démons, qui se joignent à eux. Trois magiciens sortent aussi de dessous terre.
TROIS MAGICIENS CHANTANS.
UN MAGICIEN, seul.
LES TROIS MAGICIENS CHANTANS.
DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.
Les six démons dansans habillent Lycas d'une manière ridicule et bizarre.
LES TROIS MAGICIENS CHANTANS.
TROISIÈME ENTRÉE DE BALLET.
Les magiciens et les démons continuent leurs danses, tandis que les trois magiciens chantans continuent à se moquer de Lycas.
LES TROIS MAGICIENS CHANTANS.
Les trois magiciens chantans s'enfoncent dans la terre, et les magiciens dansans disparoissent.
SCÈNE III.—LYCAS, PHILÈNE.
PHILÈNE, sans voir Lycas, chante.
LYCAS, sans voir Philène.
Ce pasteur, voulant faire des vers pour sa maîtresse, prononce le nom d'Iris assez haut pour que Philène l'entende.
PHILÈNE, à Lycas.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
SCÈNE IV.—IRIS, LYCAS.
SCÈNE V.—LYCAS, UN PATRE.
Un pâtre apporte à Lycas un cartel de la part de Philène.
SCÈNE VI.—LYCAS, CORYDON.
SCÈNE VII.—PHILÈNE, LYCAS.
PHILÈNE, chante.
LYCAS.
PHILÈNE.
SCÈNE VIII.—PHILÈNE, LYCAS, PAYSANS.
Les paysans viennent pour séparer Philène et Lycas.
QUATRIÈME ENTRÉE DE BALLET.
Les paysans prennent querelle en voulant séparer les deux pasteurs, et dansent en se battant.
SCÈNE IX.—CORYDON, LYCAS, PHILÈNE, PAYSANS.
Corydon, par ses discours, trouve moyen d'apaiser la querelle des paysans.
CINQUIÈME ENTRÉE DE BALLET.
Les paysans réconciliés dansent ensemble.
SCÈNE X.—CORYDON, LYCAS, PHILÈNE.
SCÈNE XI.—IRIS, CORYDON.
SCÈNE XII.—PHILÈNE, LYCAS, IRIS, CORYDON.
Lycas et Philène, amans de la bergère, la pressent de décider lequel des deux aura la préférence.
PHILÈNE, à Iris.
SCÈNE XIII.—PHILÈNE, LYCAS.
PHILÈNE chante.
LYCAS chante.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE, tirant son javelot.
LYCAS, tirant son javelot.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
LYCAS.
PHILÈNE.
SCÈNE XIV.—UN BERGER, LYCAS, PHILÈNE.
LE BERGER chante.
SCÈNE XV.—UNE ÉGYPTIENNE, ÉGYPTIENS dansans.
L'ÉGYPTIENNE.
SIXIÈME ENTRÉE DE BALLET.
Douze Égyptiens, dont quatre jouent de la guitare, quatre des castagnettes, quatre des gnacares[119], dansent avec l'Égyptienne aux chansons qu'elle chante.
L'ÉGYPTIENNE.
FIN DE LA PASTORALE COMIQUE.
| NOMS DES PERSONNES QUI RÉCITOIENT, CHANTOIENT ET DANSOIENT DANS LA PASTORALE. |
| IRIS, mademoiselle Debrie. |
| LYCAS, le sieur Molière. |
| PHILÈNE, le sieur Estival. |
| CORYDON, le sieur la Grange. |
| UN BERGER, le sieur Blondel. |
| UN PATRE, le sieur de Chateauneuf. |
| 281 MAGICIENS dansans, les sieurs la Pierre, Favier. |
| MAGICIENS chantans, les sieurs le Gros, Don, Gaye. |
| DÉMONS dansans, les sieurs Chicanneau, Bonnard, Noblet le cadet, Arnald, Mayeu, Foignard. |
| PAYSANS, les sieurs Dolivet, Desonets, du Pron, la Pierre, Mercier, Pesan, le Roy. |
| ÉGYPTIENNE dansante et chantante, le sieur Noblet l'aîné. |
| ÉGYPTIENS dansans: quatre jouant de la guitare, les sieurs Lulli, Beauchamp, Chicanneau, Vaigart; quatre jouant des castagnettes, les sieurs Favier, Bonnard, Saint-André, Arnald; quatre jouant des gnacares, les sieurs la Marre, Des-Airs second, du Feu, Pesan. |
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS, A SAINT-GERMAIN EN LAYE, DEVANT LA COUR, DANS LE BALLET DES MUSES, LE 6 JANVIER 1667, ET A PARIS, SUR LE THÉATRE DU PALAIS-ROYAL, LE 10 JUIN SUIVANT.
Molière n'était satisfait ni de sa Pastorale comique ni de Mélicerte. Le départ du jeune Baron renouvelait l'amertume de ses chagrins intérieurs. Dans le Sicilien, charmante esquisse, d'un coloris plus chaud que la plupart de ses œuvres, et qui devait trouver sa place dans la seconde représentation du Ballet des Muses, il revint avec bonheur à cette fantaisie délicate qui lui avait dicté l'Étourdi et l'Amour médecin, délicieux ouvrage où Beaumarchais a trouvé presque tous les jeux de scènes de son Barbier de Séville, et où le génie et les instincts de l'artiste dominent sans partage. La danse, la musique, les sérénades, la douce joie, la jeune gaieté, la folâtre ruse, voltigent autour de la coquetterie et de l'amour. Rien d'excessif, de licencieux ou de guindé; rien de galant ou de fade. Une lumière harmonieuse l'éclaire: c'est le soleil naissant sur la mer sicilienne; tout est d'accord, localités, auteur, sujet du drame. La prose elle-même est rhythmée et marche légère comme l'oiseau.
Molière essaya pour la première fois ici l'initiation de cette lingua franca qui devait lui fournir de si grotesques ressources dans le Bourgeois gentilhomme et le Malade imaginaire. Ce fut le Sicilien ou l'Amour peintre qui remplaça Mélicerte et la Pastorale comique dans le Ballet des Muses, où cette fois le roi, Madame, et mademoiselle de la Vallière dansèrent avec plusieurs seigneurs de la cour.
| PERSONNAGES DE LA COMÉDIE. | |
| DON PÈDRE, gentilhomme sicilien. | Molière. |
| ADRASTE, gentilhomme françois, amant d'Isidore. | La Grange. |
| ISIDORE, Grecque, esclave de don Pèdre. | MlleDebrie. |
| ZAIDE, jeune esclave. | MlleMolière. |
| UN SÉNATEUR. | Du Croisy. |
| HALI, Turc, esclave d'Adraste. | La Thorillière. |
| DEUX LAQUAIS. | |
| PERSONNAGES DU BALLET. | |
| MUSICIENS. | |
| ESCLAVE chantant. | |
| ESCLAVES dansans. | |
| MAURES et MAURESQUES dansans. | |
SCÈNE I[120].—HALI, MUSICIENS.
HALI, aux musiciens.
Chut! N'avancez pas davantage, et demeurez dans cet endroit, jusqu'à ce que je vous appelle.
SCÈNE II.—HALI.
Il fait noir comme dans un four: le ciel s'est habillé ce soir en Scaramouche[121], et je ne vois pas une étoile qui montre le bout de son nez. Sotte condition que celle d'un esclave, de ne vivre jamais pour soi, et d'être toujours tout entier aux passions d'un maître, de n'être réglé que par ses humeurs, et de se voir réduit à faire ses propres affaires de tous les soucis qu'il peut prendre! Le mien me fait ici épouser ses inquiétudes; et, parce qu'il est amoureux, il faut que nuit et jour je n'aie aucun repos. Mais voici des flambeaux, et, sans doute, c'est lui.
SCÈNE III.—ADRASTE, DEUX LAQUAIS, portant chacun un flambeau; HALI.
ADRASTE.
Est-ce toi, Hali?
HALI.
Et qui pourroit-ce être que moi? A ces heures de nuit, hors vous et moi, monsieur, je ne crois pas que personne s'avise de courir maintenant les rues.
ADRASTE.
Aussi ne crois-je pas qu'on puisse voir personne qui sente dans son cœur la peine que je sens. Car, enfin, ce n'est rien d'avoir à combattre l'indifférence ou les rigueurs d'une beauté qu'on aime, on a toujours au moins le plaisir de la plainte, et la liberté des soupirs; mais ne pouvoir trouver aucune occasion de parler à ce qu'on adore, ne pouvoir savoir d'une belle si l'amour qu'inspirent ses yeux est pour lui plaire ou lui déplaire, c'est la plus fâcheuse, à mon gré, de toutes les inquiétudes; et c'est où me réduit l'incommode jaloux qui veille, avec tant de souci, sur ma charmante Grecque, et ne fait pas un pas sans la traîner à ses côtés.
HALI.
Mais il est, en amour, plusieurs façons de se parler; et il me semble, à moi, que vos yeux et les siens, depuis près de deux mois, se sont dit bien des choses.
ADRASTE.
Il est vrai qu'elle et moi souvent nous nous sommes parlé des yeux; mais comment reconnoître que, chacun de notre côté, nous ayons, comme il faut, expliqué ce langage? Et que sais-je, après tout, si elle entend bien tout ce que mes regards lui disent, et si les siens me disent ce que je crois parfois entendre?
HALI.
Il faut chercher quelque moyen de se parler d'autre manière.
ADRASTE.
As-tu là tes musiciens?
HALI.
Oui.
ADRASTE.
Fais-les approcher. (Seul.) Je veux jusques au jour les faire ici chanter, et voir si leur musique n'obligera point cette belle à paroître à quelque fenêtre.
SCÈNE IV.—ADRASTE, HALI, MUSICIENS.
HALI.
Les voici. Que chanteront-ils?
ADRASTE.
Ce qu'ils jugeront de meilleur.
HALI.
Il faut qu'ils chantent un trio qu'ils me chantèrent l'autre jour.
ADRASTE.
Non. Ce n'est pas ce qu'il me faut.
HALI.
Ah! monsieur, c'est du beau bécarre.
ADRASTE.
Que diantre veux-tu dire avec ton beau bécarre?
HALI.
Monsieur, je tiens pour le bécarre. Vous savez que je m'y connois. Le bécarre me charme; hors du bécarre, point de salut en harmonie. Écoutez un peu ce trio.
ADRASTE.
Non. Je veux quelque chose de tendre et de passionné, quelque chose qui m'entretienne dans une douce rêverie.
HALI.
Je vois bien que vous êtes pour le bémol; mais il y a moyen de nous contenter l'un et l'autre. Il faut qu'ils vous chantent une certaine scène d'une petite comédie que je leur ai vu essayer. Ce sont deux bergers amoureux, tout remplis de langueur, qui, sur bémol, viennent séparément faire leurs plaintes dans un bois, puis se découvrent l'un à l'autre la cruauté de leurs maîtresse; et là-dessus vient un berger joyeux avec un bécarre admirable, qui se moque de leur foiblesse.
ADRASTE.
J'y consens. Voyons ce que c'est.
HALI.
Voici, tout juste, un lieu propre à servir de scène, et voilà deux flambeaux pour éclairer la comédie.
ADRASTE.
Place-toi contre ce logis, afin qu'au moindre bruit que l'on fera dedans je fasse cacher les lumières.
FRAGMENT DE COMÉDIE
Chanté et accompagné par les musiciens qu'Hali a amenés.
SCÈNE I.—PHILÈNE, TIRCIS.
PREMIER MUSICIEN, représentant Philène.
DEUXIÈME MUSICIEN, représentant Tircis.
PHILÈNE.
TIRCIS.
PHILÈNE.
TIRCIS.
PHILÈNE.
TOUS DEUX ENSEMBLE.
SCÈNE II.—PHILÈNE, TIRCIS, UN PATRE.
TROISIÈME MUSICIEN, représentant un pâtre.
PHILÈNE ET TIRCIS, ensemble.
HALI.
ADRASTE.
SCÈNE V.—DON PÈDRE, ADRASTE, HALI.
DON PÈDRE, sortant de sa maison, en bonnet de nuit et en robe de chambre, avec une épée sous son bras.
Il y a quelque temps que j'entends chanter à ma porte; et sans doute cela ne se fait pas pour rien; il faut que, dans l'obscurité, je tâche à découvrir quelles gens ce peuvent être.
ADRASTE.
Hali!
HALI.
Quoi?
ADRASTE.
N'entends-tu plus rien?
HALI.
Non.
Don Pèdre est derrière eux, qui les écoute.
ADRASTE.
Quoi! tous nos efforts ne pourront obtenir que je parle un moment à cette aimable Grecque! et ce jaloux maudit, ce traître de Sicilien, me fermera toujours tout accès auprès d'elle!
HALI.
Je voudrois, de bon cœur, que le diable l'eût emporté, pour la fatigue qu'il nous donne, le fâcheux, le bourreau qu'il est! Ah! si nous le tenions ici, que je prendrois de joie à venger, sur son dos, tous les pas inutiles que sa jalousie nous fait faire!
ADRASTE.
Si[122] faut-il bien, pourtant, trouver quelque moyen, quelque invention, quelque ruse, pour attraper notre brutal. J'y suis trop engagé pour en avoir le démenti; et, quand j'y devrois employer...
HALI.
Monsieur, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais la porte est ouverte; et, si vous le voulez, j'entrerai doucement pour découvrir d'où cela vient.
Don Pèdre se retire sur sa porte.
ADRASTE.
Oui, fais; mais sans faire de bruit. Je ne m'éloigne pas de toi. Plût au ciel que ce fût la charmante Isidore!
DON PÈDRE, donnant un soufflet à Hali.
Qui va là?
HALI, rendant le soufflet à don Pèdre.
Ami.
DON PÈDRE.
Holà! Francisque, Dominique, Simon, Martin, Pierre, Thomas, Georges, Charles, Barthélemy. Allons, promptement mon épée, ma rondache, ma hallebarde, mes pistolets, mes mousquetons, mes fusils. Vite, dépêchez! Allons, tue! point de quartier!
SCÈNE VI.—ADRASTE, HALI.
ADRASTE.
Je n'entends remuer personne. Hali, Hali!
HALI, caché dans un coin.
Monsieur!
ADRASTE.
Où donc te caches-tu?
HALI.
Ces gens sont-ils sortis?
ADRASTE.
Non. Personne ne bouge.
HALI, sortant d'où il étoit caché.
S'ils viennent, ils seront frottés.
ADRASTE.
Quoi! tous nos soins seront donc inutiles! Et toujours ce fâcheux jaloux se moquera de nos desseins!
HALI.
Non. Le courroux du point d'honneur me prend: il ne sera pas dit qu'on triomphe de mon adresse; ma qualité de fourbe s'indigne de tous ces obstacles, et je prétends faire éclater les talens que j'ai eus du ciel.
ADRASTE.
Je voudrois seulement que, par quelque moyen, par un billet, par quelque bouche, elle fût avertie des sentiments qu'on a pour elle, et savoir les siens là-dessus. Après, on peut trouver facilement les moyens...
HALI.
Laissez-moi faire seulement. J'en essayerai tant de toutes les manières, que quelque chose enfin nous pourra réussir. Allons, le jour paroît; je vais chercher mes gens, et venir attendre, en ce lieu, que notre jaloux sorte.
SCÈNE VII.—DON PÈDRE, ISIDORE.
ISIDORE.
Je ne sais pas quel plaisir vous prenez à me réveiller si matin. Cela s'ajuste assez mal, ce me semble, au dessein que vous avez pris de me faire peindre aujourd'hui; et ce n'est guère pour avoir le teint frais et les yeux brillans que se lever ainsi dès la pointe du jour.
DON PÈDRE.
J'ai une affaire qui m'oblige à sortir à l'heure qu'il est.
ISIDORE.
Mais l'affaire que vous avez eût bien pu se passer, je crois, de ma présence; et vous pouviez, sans vous incommoder, me laisser goûter les douceurs du sommeil du matin.
DON PÈDRE.
Oui. Mais je suis bien aise de vous voir toujours avec moi. Il n'est pas mal de s'assurer un peu contre les soins des surveillants; et, cette nuit encore, on est venu chanter sous nos fenêtres.
ISIDORE.
Il est vrai. La musique en étoit admirable.
DON PÈDRE.
C'étoit pour vous que cela se faisoit?
ISIDORE.
Je le veux croire ainsi puisque vous me le dites.
DON PÈDRE.
Vous savez qui étoit celui qui donnoit cette sérénade?
ISIDORE.
Non pas; mais, qui que ce puisse être, je lui suis obligée.
DON PÈDRE.
Obligée?
ISIDORE.
Sans doute, puisqu'il cherche à me divertir.
DON PÈDRE.
Vous trouvez donc bon qu'il vous aime?
ISIDORE.
Fort bon. Cela n'est jamais qu'obligeant.
DON PÈDRE.
Et vous voulez du bien à tous ceux qui prennent ce soin?
ISIDORE.
Assurément.
DON PÈDRE.
C'est dire fort net ses pensées.
ISIDORE.
A quoi bon de dissimuler? Quelque mine qu'on fasse, on est toujours bien aise d'être aimée. Ces hommages à nos appas ne sont jamais pour nous déplaire. Quoi qu'on en puisse dire, la grande ambition des femmes est, croyez-moi, d'inspirer de l'amour. Tous les soins qu'elles prennent ne sont que pour cela, et l'on n'en voit point de si fière qui ne s'applaudisse en son cœur des conquêtes que font ses yeux.
DON PÈDRE.
Mais, si vous prenez, vous, du plaisir à vous voir aimée, savez-vous bien, moi qui vous aime, que je n'y en prends nullement?
ISIDORE.
Je ne sais pourquoi cela; et, si j'aimois quelqu'un, je n'aurois point de plus grand plaisir que de le voir aimé de tout le monde. Y a-t-il rien qui marque davantage la beauté du choix que l'on fait? Et n'est-ce pas pour s'applaudir que ce que nous aimons soit trouvé fort aimable?
DON PÈDRE.
Chacun aime à sa guise, et ce n'est pas là ma méthode. Je serai fort ravi qu'on ne vous trouve point si belle, et vous m'obligerez de n'affecter point tant de la paroître à d'autres yeux.
ISIDORE.
Quoi! jaloux de ces choses-là?
DON PÈDRE.
Oui, jaloux de ces choses-là, mais jaloux comme un tigre, et, si vous voulez, comme un diable. Mon amour vous veut tout à moi. Sa délicatesse s'offense d'un souris, d'un regard qu'on vous peut arracher; et tous les soins qu'on me voit prendre ne sont que pour fermer tout accès aux galants, et m'assurer la possession d'un cœur dont je ne puis souffrir qu'on me vole la moindre chose.
ISIDORE.
Certes, voulez-vous que je dise? vous prenez un mauvais parti; et la possession d'un cœur est fort mal assurée, lorsqu'on prétend le retenir par force. Pour moi, je vous l'avoue, si j'étois galant d'une femme qui fût au pouvoir de quelqu'un, je mettrois toute mon étude à rendre ce quelqu'un jaloux, et l'obliger à veiller nuit et jour celle que je voudrois gagner. C'est un admirable moyen d'avancer ses affaires, et l'on ne tarde guère à profiter du chagrin et de la colère que donne à l'esprit d'une femme la contrainte et la servitude.
DON PÈDRE.
Si bien donc que si quelqu'un vous en contoit, il vous trouveroit disposée à recevoir ses vœux?
ISIDORE.
Je ne vous dis rien là-dessus. Mais les femmes, enfin, n'aiment pas qu'on les gêne; et c'est beaucoup risquer que de leur montrer des soupçons et de les tenir renfermées.
DON PÈDRE.
Vous reconnoissez peu ce que vous me devez; et il me semble qu'une esclave que l'on a affranchie, et dont on veut faire sa femme...
ISIDORE.
Quelle obligation vous ai-je, si vous changez mon esclavage en un autre beaucoup plus rude, si vous ne me laissez jouir d'aucune liberté, et me fatiguez, comme on voit, d'une garde continuelle?
DON PÈDRE.
Mais tout cela ne part que d'un excès d'amour.
ISIDORE.
Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr.
DON PÈDRE.
Vous êtes aujourd'hui dans une humeur désobligeante; et je pardonne ces paroles au chagrin où vous pouvez être de vous être levée matin.
SCÈNE VIII.—DON PÈDRE, ISIDORE, HALI, habillé en Turc, faisant plusieurs révérences à don Pèdre.
DON PÈDRE.
Trêve aux cérémonies. Que voulez-vous?
HALI, se mettant entre don Pèdre et Isidore.
Il se tourne vers Isidore à chaque parole qu'il dit a don Pèdre, et lui fait des signes pour lui faire connoître le dessein de son maître.
Signor (avec la permission de la signore), je vous dirai (avec la permission de la signore) que je viens vous trouver (avec la permission de la signore), pour vous prier (avec la permission de la signore) de vouloir bien (avec la permission de la signore)....
DON PÈDRE.
Avec la permission de la signore, passez un peu de ce côté.
Don Pèdre se met entre Hali et Isidore.
HALI.
Signor, je suis un virtuose.
DON PÈDRE.
Je n'ai rien à donner.
HALI.
Ce n'est pas ce que je demande. Mais, comme je me mêle un peu de musique et de danse, j'ai instruit quelques esclaves qui voudroient bien trouver un maître qui se plût à ces choses, et, comme je sais que vous êtes une personne considérable, je voudrois vous prier de les voir et de les entendre, pour les acheter, s'ils vous plaisent, ou pour leur enseigner quelqu'un de vos amis qui voulût s'en accommoder.
ISIDORE.
C'est une chose à voir, et cela nous divertira. Faites-les-nous venir.
HALI.
Chala bala... Voici une chanson nouvelle, qui est du temps. Ecoutez-bien! Chala bala.
SCÈNE IX.—DON PÈDRE, ISIDORE, HALI, ESCLAVES, TURCS.
UN ESCLAVE CHANTANT, à Isidore.
L'esclave turc, après avoir chanté, craignant que don Pèdre ne vienne à comprendre le sens de ce qu'il vient de dire et à s'apercevoir de sa fourberie, se tourne entièrement vers don Pèdre, et, pour l'amuser, lui chante en langage franc ces paroles: (Livre du Ballet des Muses.)
PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.
Danse des esclaves.
L'ESCLAVE, à Isidore.
DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.
Les esclaves recommencent leur danse.
DON PÈDRE chante.
Oh! oh! quels égrillards! (A Isidore.) Allons, rentrons ici: j'ai changé de pensées; et puis le temps se couvre un 296 peu. (A Hali qui paroit encore). Ah! fourbe! que je vous y trouve!
HALI.
Eh bien, oui, mon maître l'adore. Il n'a point de plus grand désir que de lui montrer son amour; et, si elle y consent, il la prendra pour femme.
DON PÈDRE.
Oui, oui; je la lui garde.
HALI.
Nous l'aurons malgré vous.
DON PÈDRE.
Comment! coquin!...
HALI.
Nous l'aurons, dis-je, en dépit de vos dents.
DON PÈDRE.
Si je prends...
HALI.
Vous avez beau faire la garde, j'en ai juré, elle sera à nous.
DON PÈDRE.
Laisse-moi faire, je t'attraperai sans courir.
HALI.
C'est nous qui vous attraperons. Elle sera notre femme, la chose est résolue. (Seul.) Il faut que j'y périsse ou que j'en vienne à bout.
SCÈNE X.—ADRASTE, HALI, DEUX LAQUAIS.
ADRASTE.
Eh bien, Hali, nos affaires s'avancent-elles?
HALI.
Monsieur, j'ai déjà fait quelque petite tentative; mais je...
ADRASTE.
Ne te mets point en peine; j'ai trouvé, par hasard, tout ce que je voulois, et je vais jouir du bonheur de voir chez elle cette belle. Je me suis rencontré chez le peintre Damon, qui m'a dit qu'aujourd'hui il venoit faire le portrait de cette adorable personne; et, comme il est depuis longtemps de mes plus intimes amis, il a voulu servir mes feux, 297 et m'envoie à sa place, avec un petit mot de lettre pour me faire accepter. Tu sais que, de tout temps, je me suis plu à la peinture, et que parfois je manie le pinceau, contre la coutume de France, qui ne veut pas qu'un gentilhomme sache rien faire: ainsi j'aurai la liberté de voir cette belle à mon aise. Mais je ne doute pas que mon jaloux fâcheux ne soit toujours présent, et n'empêche tous les propos que nous pourrions avoir ensemble; et, pour te dire vrai, j'ai, par le moyen d'une jeune esclave, un stratagème pour tirer cette belle Grecque des mains de son jaloux, si je puis obtenir d'elle qu'elle y consente.
HALI.
Laissez-moi faire, je veux vous faire un peu de jour à la pouvoir entretenir. (Il parle bas à l'oreille d'Adraste.) Il ne sera pas dit que je ne serve de rien dans cette affaire-là. Quand allez-vous?
ADRASTE.
Tout de ce pas, et j'ai déjà préparé toutes choses.
HALI.
Je vais, de mon côté, me préparer aussi.
ADRASTE.
Je ne veux point perdre de temps. Holà! il me tarde que je ne goûte le plaisir de la voir.
SCÈNE XI.—DON PÈDRE, ADRASTE, DEUX LAQUAIS.
DON PÈDRE.
Que cherchez-vous, cavalier, dans cette maison?
ADRASTE.
J'y cherche le seigneur don Pèdre.
DON PÈDRE.
Vous l'avez devant vous.
ADRASTE.
Il prendra, s'il lui plaît, la peine de lire cette lettre...
DON PÈDRE.
«Je vous envoie, au lieu de moi, pour le portrait que vous savez, ce gentilhomme françois, qui, comme curieux d'obliger les honnêtes gens, a bien voulu prendre ce soin, sur la proposition que je lui en ai faite. Il est, 298 sans contredit, le premier homme du monde pour ces sortes d'ouvrages, et j'ai cru que je ne vous pouvois rendre un service plus agréable que de vous l'envoyer, dans le dessein que vous avez d'avoir un portrait achevé de la personne que vous aimez. Gardez-vous bien surtout de lui parler d'aucune récompense; car c'est un homme qui s'en offenseroit, et qui ne fait les choses que pour la gloire et la réputation.»
Seigneur François, c'est une grande grâce que vous me voulez faire, et je vous suis fort obligé.
ADRASTE.
Toute mon ambition est de rendre service aux gens de nom et de mérite.
DON PÈDRE.
Je vais faire venir la personne dont il s'agit.
SCÈNE XII.—ISIDORE, DON PÈDRE, ADRASTE, DEUX LAQUAIS.
DON PÈDRE, à Isidore.
Voici un gentilhomme que Damon nous envoie, qui se veut bien donner la peine de vous peindre. (Adraste, qui embrasse Isidore en la saluant.) Holà! seigneur François, cette façon de saluer n'est point d'usage en ce pays.
ADRASTE.
C'est la manière de France.
DON PÈDRE.
La manière de France est bonne pour vos femmes; mais pour les nôtres elle est un peu trop familière.
ISIDORE.
Je reçois cet honneur avec beaucoup de joie. L'aventure me surprend fort; et, pour dire le vrai, je ne m'attendois pas d'avoir un peintre si illustre.
ADRASTE.
Il n'y a personne, sans doute, qui ne tînt à beaucoup de gloire de toucher à un tel ouvrage. Je n'ai pas grande habileté; mais le sujet, ici, ne fournit que trop de lui-même, et il y a moyen de faire quelque chose de beau sur un original fait comme celui-là.
ISIDORE.
L'original est peu de chose; mais l'adresse du peintre en saura couvrir les défauts.
ADRASTE.
Le peintre n'y en voit aucun; et tout ce qu'il souhaite est d'en pouvoir représenter les grâces aux yeux de tout le monde aussi grandes qu'il les peut voir.
ISIDORE.
Si votre pinceau flatte autant que votre langue, vous allez me faire un portrait qui ne me ressemblera pas.
ADRASTE.
Le ciel, qui fit l'original, nous ôte le moyen d'en faire un portrait qui puisse flatter.
ISIDORE.
Le ciel, quoi que vous en disiez, ne...
DON PÈDRE.
Finissons cela, de grâce. Laissons les compliments, et songeons au portrait.
ADRASTE, aux laquais.
Allons, apportez tout. (On apporte tout ce qu'il faut pour peindre Isidore.)
ISIDORE, à Adraste.
Où voulez-vous que je me place?
ADRASTE.
Ici. Voici le lieu le plus avantageux, et qui reçoit le mieux les vues favorables de la lumière que nous cherchons.
ISIDORE, après s'être assise.
Suis-je bien ainsi?
ADRASTE.
Oui. Levez-vous un peu, s'il vous plaît; un peu plus de ce côté-là; le corps tourné ainsi; la tête un peu levée, afin que la beauté du cou paroisse; ceci un peu plus découvert, (Il découvre un peu plus sa gorge.) Bon; là; un peu davantage; encore tant soit peu.
DON PÈDRE, à Isidore.
Il y a bien de la peine à vous mettre. Ne sauriez-vous vous tenir comme il faut?
ISIDORE.
Ce sont ici des choses toutes neuves pour moi; et c'est à monsieur à me mettre de la façon qu'il veut.
ADRASTE, assis.
Voilà qui va le mieux du monde, et vous vous tenez à merveille. (La faisant tourner un peu vers lui.) Comme cela, s'il vous plaît. Le tout dépend des attitudes qu'on donne aux personnes qu'on peint.
DON PÈDRE.
Fort bien.
ADRASTE.
Un peu plus de ce côté. Vos yeux toujours tournés vers moi, je vous prie; vos regards attachés aux miens.
ISIDORE.
Je ne suis pas comme ces femmes qui veulent, en se faisant peindre, des portraits qui ne sont point elles, et ne sont point satisfaites du peintre s'il ne les fait toujours plus belles qu'elles ne sont. Il faudroit, pour les contenter, ne faire qu'un portrait pour toutes; car toutes demandent les mêmes choses, un teint tout de lis et de roses, un nez bien fait, une petite bouche, et de grands yeux vifs, bien fendus; et surtout le visage pas plus gros que le poing, l'eussent-elles d'un pied de large. Pour moi, je vous demande un portrait qui soit moi, et qui n'oblige point à demander qui c'est.
ADRASTE.
Il seroit malaisé qu'on demandât cela du vôtre; et vous avez des traits à qui fort peu d'autres ressemblent. Qu'ils ont de douceurs et de charmes, et qu'on court de risque à les peindre!
DON PÈDRE.
Le nez me semble un peu trop gros.
ADRASTE.
J'ai lu, je ne sais où, qu'Apelles peignit autrefois une maîtresse d'Alexandre d'une merveilleuse beauté, et qu'il en devint, la peignant, si éperdument amoureux, qu'il fut près d'en perdre la vie; de sorte qu'Alexandre, par générosité, lui céda l'objet de ses vœux. (A don Pèdre.) Je pourrois faire ici ce qu'Apelles fit autrefois; mais vous ne feriez pas, peut-être, ce que fit Alexandre. (Don Pèdre fait la grimace.)
ISIDORE, à don Pèdre.
Tout cela sent la nation; et toujours messieurs les François ont un fonds de galanterie qui se répand partout.
ADRASTE.
On ne se trompe guère à ces sortes de choses, et vous avez l'esprit trop éclairé pour ne pas voir de quelle source partent les choses qu'on vous dit. Oui, quand Alexandre seroit ici, et que ce seroit votre amant, je ne pourrois m'empêcher de vous dire que je n'ai rien vu de si beau que ce que je vois maintenant, et que...
DON PÈDRE.
Seigneur François, vous ne devriez pas, ce me semble, tant parler; cela vous détourne de votre ouvrage.
ADRASTE.
Ah! point du tout. J'ai toujours coutume de parler quand je peins; et il est besoin, dans ces choses, d'un peu de conversation, pour éveiller l'esprit et tenir les visages dans la gaieté nécessaire aux personnes que l'on veut peindre.
SCÈNE XIII.—HALI, vêtu en Espagnol; DON PÈDRE, ADRASTE, ISIDORE.
DON PÈDRE.
Que veut cet homme-là? Et qui laisse monter les gens sans nous en venir avertir?
HALI, à don Pèdre.
J'entre ici librement; mais, entre cavaliers, telle liberté est permise. Seigneur, suis-je connu de vous?
DON PÈDRE.
Non, seigneur.
HALI.
Je suis don Gilles d'Avalos; et l'histoire d'Espagne vous doit avoir instruit de mon mérite.
DON PÈDRE.
Souhaitez-vous quelque chose de moi?
HALI.
Oui, un conseil sur un fait d'honneur. Je sais qu'en ces matières il est malaisé de trouver un cavalier plus consommé que vous; mais je vous demande, pour grâce, que nous nous tirions à l'écart.
DON PÈDRE.
Nous voilà assez loin.
ADRASTE, à don Pèdre qui le surprend parlant bas à Isidore.
J'observois de près la couleur de ses yeux[126].
HALI, tirant don Pèdre, pour l'éloigner d'Adraste et d'Isidore.
Seigneur, j'ai reçu un soufflet. Vous savez ce qu'est un soufflet lorsqu'il se donne à main ouverte, sur le beau milieu de la joue. J'ai ce soufflet fort sur le cœur, et je suis dans l'incertitude si, pour me venger de l'affront, je dois me battre avec mon homme, ou bien le faire assassiner.
DON PÈDRE.
Assassiner, c'est le plus sûr et le plus court chemin. Quel est votre ennemi?
HALI.
Parlons bas, s'il vous plaît. (Hali tient don Pèdre en lui parlant, de façon qu'il ne peut voir Adraste.)
ADRASTE, aux genoux d'Isidore, pendant que don Pèdre et Hali parlent bas ensemble.
Oui, charmante Isidore, mes regards vous le disent depuis plus de deux mois, et vous les avez entendus. Je vous aime plus que tout ce que l'on peut aimer, et je n'ai point d'autre pensée, d'autre but, d'autre passion, que d'être à vous toute ma vie.
ISIDORE.
Je ne sais si vous dites vrai; mais vous persuadez.
ADRASTE.
Mais vous persuadé-je jusqu'à vous inspirer quelque peu de bonté pour moi?
ISIDORE.
Je ne crains que d'en trop avoir.
ADRASTE.
En aurez-vous assez pour consentir, belle Isidore, au dessein que je vous ai dit?
ISIDORE.
Je ne puis encore vous le dire.
ADRASTE.
Qu'attendez-vous pour cela?
ISIDORE.
A me résoudre.
ADRASTE.
Ah! quand on aime bien, on se résout bientôt.
ISIDORE.
Eh bien, allez; oui, j'y consens.
ADRASTE.
Mais consentez-vous, dites-moi, que ce soit dès ce moment même?
ISIDORE.
Lorsqu'on est une fois résolu sur la chose, s'arrête-t-on sur le temps?
DON PÈDRE, à Hali.
Voilà mon sentiment, et je vous baise les mains.
HALI.
Seigneur, quand vous aurez reçu quelque soufflet, je suis aussi homme de conseil, et je pourrai vous rendre la pareille.
DON PÈDRE.
Je vous laisse aller sans vous reconduire; mais, entre cavaliers, cette liberté est permise.
ADRASTE, à Isidore.
Non, il n'est rien qui puisse effacer de mon cœur les tendres témoignages... (A don Pèdre, apercevant Adraste qui parle de près à Isidore.) Je regardois ce petit trou qu'elle a du côté du menton, et je croyois d'abord que ce fût une tache. Mais c'est assez pour aujourd'hui, nous finirons une autre fois. (A don Pèdre, qui veut voir le portrait.) Non, ne regardez rien encore; faites serrer cela, je vous prie. (A Isidore.) Et vous, je vous conjure de ne vous relâcher point, et de garder un esprit gai, pour le dessein que j'ai d'achever notre ouvrage.
ISIDORE.
Je conserverai pour cela toute la gaieté qu'il faut.
SCÈNE XIV.—DON PÈDRE, ISIDORE.
ISIDORE.
Qu'en dites-vous? ce gentilhomme me paroît le plus civil du monde; et l'on doit demeurer d'accord que les François ont quelque chose en eux de poli, de galant, que n'ont point les autres nations.
DON PÈDRE.
Oui; mais ils ont cela de mauvais qu'ils s'émancipent un peu trop, et s'attachent, en étourdis, à conter des fleurettes à tout ce qu'ils rencontrent.
ISIDORE.
C'est qu'ils savent qu'on plaît aux dames par ces choses.
DON PÈDRE.
Oui; mais, s'ils plaisent aux dames, ils déplaisent fort aux messieurs; et l'on n'est point bien aise de voir, sur sa moustache, cajoler hardiment sa femme ou sa maîtresse.
ISIDORE.
Ce qu'ils en font n'est que par jeu.
SCÈNE XV.—ZAIDE, DON PÈDRE, ISIDORE
ZAÏDE.
Ah! seigneur cavalier, sauvez-moi, s'il vous plaît, des mains d'un mari furieux dont je suis poursuivie. Sa jalousie est incroyable, et passe, dans ses mouvemens, tout ce qu'on peut imaginer. Il va jusques à vouloir que je sois toujours voilée; et, pour m'avoir trouvée le visage un peu découvert, il a mis l'épée à la main, et m'a réduite à me jeter chez vous, pour vous demander votre appui contre son injustice. Mais je le vois paroître. De grâce, seigneur cavalier, sauvez-moi de sa fureur!
DON PÈDRE, à Zaïde, lui montrant Isidore.
Entrez là dedans avec elle, et n'appréhendez rien.
SCÈNE XVI.—ADRASTE, DON PÈDRE.
DON PÈDRE.
Eh quoi! seigneur, c'est vous? Tant de jalousie pour un François? Je pensois qu'il n'y eût que nous qui en fussions capables.
ADRASTE.
Les François excellent toujours dans toutes les choses qu'ils font; et, quand nous nous mêlons d'être jaloux, nous le sommes vingt fois plus qu'un Sicilien. L'infâme croit avoir trouvé chez vous un assuré refuge; mais vous êtes trop raisonnable 305 pour blâmer mon ressentiment. Laissez-moi, je vous prie, la traiter comme elle mérite.
DON PÈDRE.
Ah! de grâce, arrêtez! L'offense est trop petite pour un courroux si grand.
ADRASTE.
La grandeur d'une telle offense n'est pas dans l'importance des choses que l'on fait. Elle est à transgresser les ordres qu'on nous donne; et, sur de pareilles matières, ce qui n'est qu'une bagatelle devient fort criminel lorsqu'il est défendu.
DON PÈDRE.
De la façon qu'elle a parlé, tout ce qu'elle en a fait a été sans dessein: et je vous prie enfin de vous remettre bien ensemble.
ADRASTE.
Eh quoi! vous prenez son parti, vous qui êtes si délicat sur ces sortes de choses?
DON PÈDRE.
Oui, je prends son parti; et, si vous voulez m'obliger, vous oublierez votre colère, et vous vous réconcilierez tous deux. C'est une grâce que je vous demande; et je la recevrai comme un essai de l'amitié que je veux qui soit entre nous.
ADRASTE.
Il ne m'est pas permis, à ces conditions, de vous rien refuser. Je ferai ce que voudrez.
SCÈNE XVII.—ZAIDE, DON PÈDRE, ADRASTE, caché dans un coin du théâtre.
DON PÈDRE, à Zaïde.
Holà! venez. Vous n'avez qu'à me suivre, et j'ai fait votre paix. Vous ne pouviez jamais mieux tomber que chez moi.
ZAÏDE.
Je vous suis obligée plus qu'on ne sauroit croire: mais je m'en vais prendre mon voile; je n'ai garde, sans lui, de paroître à ses yeux.
SCÈNE XVIII.—DON PÈDRE, ADRASTE.
DON PÈDRE.
Le voici qui s'en va venir; et son âme, je vous assure, a paru toute réjouie lorsque je lui ai dit que j'avais raccommodé tout.
SCÈNE XIX.—ISIDORE, sous le voile de Zaïde; ADRASTE, DON PÈDRE.
DON PÈDRE, à Adraste.
Puisque vous m'avez bien voulu abandonner votre ressentiment, trouvez bon qu'en ce lieu je vous fasse toucher dans la main l'un de l'autre, et que tous deux je vous conjure de vivre pour l'amour de moi, dans une parfaite union.
ADRASTE.
Oui, je vous le promets que, pour l'amour de vous, je m'en vais, avec elle, vivre le mieux du monde.
DON PÈDRE.
Vous m'obligez sensiblement, et j'en garderai la mémoire.
ADRASTE.
Je vous donne ma parole, seigneur don Pèdre, qu'à votre considération, je m'en vais la traiter du mieux qu'il me sera possible.
DON PÈDRE.
C'est trop de grâce que vous me faites. (Seul.) Il est bon de pacifier et d'adoucir toujours les choses. Holà! Isidore, venez!
SCÈNE XX.—ZAIDE, DON PÈDRE.
DON PÈDRE.
Comment! que veut dire cela?
ZAÏDE, sans voile.
Ce que cela veut dire? Qu'un jaloux est un monstre haï de tout le monde, et qu'il n'y a personne qui ne soit ravi de lui nuire, n'y eût-il point d'autre intérêt; que toutes les serrures et tous les verrous du monde ne retiennent point les personnes, et que c'est le cœur qu'il faut arrêter par la douceur 307 et par la complaisance; qu'Isidore est entre les mains du cavalier qu'elle aime, et que vous êtes pris pour dupe.
DON PÈDRE.
Don Pèdre souffrira cette injure mortelle! Non, non, j'ai trop de cœur, et je vais demander l'appui de la justice pour pousser le perfide à bout. C'est ici le logis d'un sénateur. Holà!
SCÈNE XXI.—UN SÉNATEUR, DON PÈDRE.
LE SÉNATEUR.
Serviteur, seigneur don Pèdre. Que vous venez à propos!
DON PÈDRE.
Je viens me plaindre à vous d'un affront qu'on m'a fait.
LE SÉNATEUR.
J'ai fait une mascarade la plus belle du monde.
DON PÈDRE.
Un traître de François m'a joué une pièce.
LE SÉNATEUR.
Vous n'avez, dans votre vie, jamais rien vu de si beau.
DON PÈDRE.
Il m'a enlevé une fille que j'avois affranchie.
LE SÉNATEUR.
Ce sont gens vêtus en Maures, qui dansent admirablement.
DON PÈDRE.
Vous voyez si c'est une injure qui se doive souffrir.
LE SÉNATEUR.
Les habits merveilleux, et qui sont faits exprès.
DON PÈDRE.
Je demande l'appui de la justice contre cette action.
LE SÉNATEUR.
Je veux que vous voyiez cela. On la va répéter pour en donner le divertissement au peuple.
DON PÈDRE.
Comment! de quoi parlez-vous là?
LE SÉNATEUR.
Je parle de ma mascarade.
DON PÈDRE.
Je vous parle de mon affaire.
LE SÉNATEUR.
Je ne veux point, aujourd'hui, d'autres affaires que de plaisir. Allons, messieurs, venez. Voyons si cela ira bien.
DON PÈDRE.
La peste soit du fou avec sa mascarade!
LE SÉNATEUR.
Diantre soit le fâcheux avec son affaire!
SCÈNE XXII.—UN SÉNATEUR, TROUPE DE DANSEURS.
ENTRÉE DE BALLET.
Plusieurs danseurs, vêtus en Maures, dansent devant le sénateur, et finissent la comédie.
FIN DU SICILIEN.
| NOMS DES PERSONNES QUI ONT DANSÉ ET CHANTÉ DANS LE SICILIEN.. |
| DON PÈDRE, le sieur Molière. |
| ADRASTE, le sieur la Grange. |
| ISIDORE, mademoiselle Debrie. |
| ZAIDE, mademoiselle Molière. |
| HALI, le sieur la Thorillière. |
| UN SÉNATEUR, le sieur du Croisy. |
| MUSICIENS chantans, les sieurs Blondel, Gaye, Noblet. |
| ESCLAVE TURC chantant, le sieur Gaye. |
| ESCLAVES TURCS dansans, les sieurs le Prêtre, Chicanneau, Mayeu, Pesan. |
| MAURES de qualité, le ROI, M. le Grand, les marquis de Villeroy et de Rassan. |
| MAURESQUES de qualité, MADAME, mademoiselle de la Vallière, madame de Rochefort, mademoiselle de Brancas. |
| MAURES nus, MM. Cocquet, de Souville, les sieurs Beauchamp, Noblet, Chicanneau, la Pierre, Favier et Des-Airs-Galand. |
| MAURES à capot, les sieurs la Mare, du Feu, Arnald, Vagnard et Bonnard. |
Représentée pour la première fois, à Versailles, devant la cour, dans les Plaisirs de l'Ile enchantée (1664).—Les trois premiers actes, sur le théâtre du Palais-Royal, le 5 août 1667; défendue le lendemain, et reprise sans interruption le 5 février 1669.
En 1664, comme nous l'avons dit, le 10 mai, les trois premiers actes d'une œuvre conçue depuis longtemps par Molière, et dès lors terminée si ce n'est corrigée, furent représentés comme essai pendant les fêtes de Versailles.
C'était à la fois une singulière audace et une grande habileté. L'œuvre était évidemment dirigée contre le jansénisme même et la rigidité extérieure. Le roi, dont les austères et les dévots contrariaient les amours et prétendaient régenter les plaisirs, allait-il prendre parti contre eux et reconnaître l'auteur dramatique pour premier ministre de ses vengeances et de ses plaisirs? ou bien imposerait-il silence à Molière et concéderait-il implicitement aux censeurs le droit de critiquer les préférences de son cœur et les voluptés de son trône?
Un puritanisme hypocrite, cherchant à se rendre maître du crédit, de l'autorité et de la fortune, plus vicieux en secret, plus sensuel en réalité que ceux dont il blâmait les penchants, occupait le centre de la composition nouvelle; et l'on peut croire que le comédien nomade, élève de Gassendi, traducteur de Lucrèce, lié avec Bernier, Chapelle et les libertins, eut exactement la même pensée qui dicta plus tard à Fielding son Tom Jones: la haine du pédant et des dehors hypocrites; une grande foi dans les penchants naturels de l'humanité, une grande répugnance pour les austérités affectées. La société anglaise de Fielding 310 et de Richardson, entre 1688 et 1780, vivait de décence et de formalisme comme la société de Louis XIV entre 1660 et 1710. Ce sont les œuvres parallèles, mais non égales en mérites, que l'École de la médisance et Tartuffe.
Au XVIe siècle, le même point de vue avait inspiré à Shakespeare l'admirable portrait de ce magistrat sévère qui, dans Measure for Measure (Un prêté pour un rendu), se laisse entraîner à sa passion, commet des crimes épouvantables et devient d'autant plus coupable que sa doctrine est plus rigide. Sheridan n'a pas imité Molière, Molière n'a pas imité Shakespeare. Tous trois ont pénétré l'extrême faiblesse humaine, sa pente facile vers l'excès, et la fragilité de nos vertus.
L'œuvre de Shakespeare est plus générale et plus philosophique; celle de Sheridan, plus légère et plus vive de ton; celle de Molière contient une leçon sociale plus puissante et plus forte. Un bourgeois simple et honnête, sans doute quelque conseiller de parlement, qui aura touché dans sa jeunesse aux troubles de la Fronde, et qui gouverne assez mal sa famille, donne accès chez lui à un dévot de robe courte, cheveux plats, ajustements simples mais élégants, homme de bien à ce qu'il dit lui-même et à ce que l'on croit, que le père de famille a rencontré dans une église, toujours en dévotes prières, poussant des hélas! mystiques et des soupirs affectés, et prouvant sa piété tendre par la componction la plus fervente et la plus humble. C'est M. Tartuffe. Notre bourgeois s'intéresse, s'informe, apprend que le personnage fait l'aumône aux pauvres, qu'il vit modestement, qu'il est gentilhomme, peu riche il est vrai, mais en passe de le devenir. C'est un saint. On le répète dans le quartier. Poussé du désir de sanctifier son logis magistral, d'inculquer le bon exemple à son jeune fils, de morigéner sa femme, jeune, belle, aimant, quoique sage, la parure et les divertissements 311 mondains, le père offre un asile au prétendu modèle de la perfection chrétienne, qui amène Laurent, son valet, dévot comme lui, portant soigneusement la haire et la discipline.
L'aspect extérieur de ce M. Tartuffe n'avait rien de redoutable. Un heureux embonpoint et une face riante, des yeux modestement baissés, un costume noir de la propreté la plus exquise, les mains jointes sur la poitrine, l'air béat et le sourire doucereux, il n'inspirait que bienveillante confiance. C'était le papelard de la Fontaine, et non le scélérat lugubre. Une voix moelleuse, caressante et mystique achevait ce personnage.
Dès que M. Tartuffe a pénétré dans la maison, il y fait son nid, il s'y incarne; sa sensualité se gorge des bons dîners de son hôte et s'endort voluptueusement dans la couche molle qu'on lui apprête. Pour exploiter la situation il n'a pas besoin de faire jouer d'autres ressorts que l'apparente sincérité de sa vie dévote; il prêche, il gourmande doucement les vices, il sert d'espion domestique. Son crédit augmente; sa grimace sacrée suffit pour l'enraciner dans ce lieu de délices. Comme Sganarelle, avec trois mots latins, guérit tout le monde;—Comme don Juan, avec des révérences et des politesses soutenues de son habit brodé, paye M. Dimanche;—M. Tartuffe n'a besoin que d'un rosaire et d'un scapulaire pour vivre gros et gras, s'emparer des esprits et monter au ciel. Il doit une partie de son succès à la doctrine qu'il prêche; doctrine d'apparences qui permet à un père l'égoïsme foncier et la cruauté réelle envers les siens, sous le voile de l'austérité dévote. Il peut affamer et déshériter sa famille sous prétexte de son propre salut, il ne doit compte qu'à Dieu; la formule le sauvera, qu'il soit mauvais père et méchant homme en sûreté de conscience.
Voilà M. Tartuffe maître et roi de la situation; sa santé prospère, son corps et son âme fleurissent, il est à la fleur 312 de l'âge, et, malgré son humilité, il aime à vivre. Voilà son écueil. La femme du maître est jolie et passe pour coquette. Attachée à son mari par devoir plus que par sentiment, cette situation la rapproche sans cesse de M. Tartuffe, et la tentation de la chair vient saisir le saint homme. L'amour sensuel s'empare de cette âme béate. Malgré lui il jette son masque, ou du moins le soulève et laisse entrevoir à la femme de son bienfaiteur, sous un spiritualisme de formules, le fond même de cette nature grossière et dissimulée, qui veut des réalités et qui s'en repaît; nature friande et onctueuse, brutale et subtile, lourde et intéressée, qui trompe le monde au moyen de quelques dehors, d'un rôle appris et d'une facile hypocrisie. Alors et sous le coup de ses mêmes vices qui éclatent, tout l'édifice du dévot s'écroule au moment même de son triomphe. Le père voulait lui donner sa fille, bien qu'il eût engagé sa parole à un autre prétendant; il lui avait même cédé la partie la plus nette de sa fortune et lui avait confié un secret d'État relatif à ses jeunes années, secret qui compromettait jusqu'à sa vie. Dénoncé par la famille, livré par la jeune femme, Tartuffe est renversé. Mais les armes que l'engouement lui a prêtées, il les emploie sans pitié, et le saint homme devient scélérat. L'autorité royale intervient, foudroie Tartuffe, rétablit la paix, et après ce grand enseignement remet Orgon au sein de sa famille.
Telle est cette admirable conception, méditée par Molière depuis le moment de son entrée à Paris, élaborée avec l'amour le plus persévérant pendant sept années, et qui, pour être enfin jouée, a coûté à son auteur autant de diplomatie, de démarches, de persévérance et d'adresse qu'il avait fallu de sagacité, de génie et de combinaison pour la créer. Ninon de Lenclos, le prince de Condé, les libres esprits, tous ceux qui préparaient l'ascendant futur des idées philosophiques, le groupe croissant des libertins 313 (comme on les nommait alors), encouragea, surveilla et protégea le développement de l'œuvre. C'était tout un monde que cette sphère des esprits forts; et Nicole avait raison de dire qu'il n'y avait déjà plus en 1660 d'hérétiques, mais des incrédules; à leur tête marchaient la Rochefoucauld, le prince de Condé, son amie madame Deshoulières, qui ne baptisa sa fille qu'à vingt-neuf ans; Retz et de Lyonne, la Palatine et Bourdelot, le bonhomme Rose, qui ne croyait à rien, Saint-Évremond et Saint-Réal, Desbarreaux l'athée, Milton l'esprit fort, l'aimable de Méré, Saint-Pavin, Lainé et Hénaut, enfin les anciens compagnons de Théophile, les nouveaux amis de la Fontaine.
Ninon prêta son salon pour la première lecture du Tartuffe.
Chapelle, Bernier, Boileau lui-même, qui étaient présents, applaudirent avec les jeunes seigneurs.
Mais comment parvenir à faire représenter l'œuvre? Tout se dirigeait vers l'ordre apparent, vers la décence extérieure. Louis XIV, en se livrant à ses amours, aimait que la dévotion régnât autour de lui. Il fallut marcher pas à pas à la conquête de la position, établir la sape et la tranchée, circonvenir le roi, se faire des appuis partout, choisir le moment où Paris était désert et s'armer d'une promesse verbale du monarque, qui venait de partir pour le camp devant Lille, pour faire jouer enfin le Tartuffe en 1667, sur le théâtre du Palais-Royal. Il y avait quelque chose de subreptice dans cette introduction de l'hypocrite, à qui Molière avait enlevé son nom de Tartuffe pour le nommer Arnolphe, et qu'il avait adouci sur plusieurs points. Malgré ces précautions, tout se souleva. Le premier président de Lamoignon ordonna la suspension de l'œuvre pour en référer au roi. Deux acteurs de la troupe, la Thorillière et la Grange, partirent avec un placet et allèrent supplier Louis XIV et le prier de lever ladite défense. 314 Bien reçus par le monarque, ils n'obtinrent qu'une réponse dilatoire et la promesse de faire examiner la pièce à son retour.
C'était la grande question morale du XVIIIe siècle qui se débattait déjà, celle de la religion contre la philosophie, celle de Bossuet contre Voltaire.
En 1660, on avait brûlé les Provinciales, satire redoutable de la fausse dévotion. D'une part, on essayait de resserrer violemment les liens de l'unité religieuse, et la révocation de l'édit de Nantes se préparait. D'une autre, le salon de Ninon de Lenclos, cette antichambre de Ferney, servait de rendez-vous et de point d'appui aux partisans et aux protecteurs du Tartuffe.
Pendant deux années, le combat eut lieu autour du Tartuffe. Enfin Molière eut le dessus.
Après deux années d'interdiction, le 5 février 1669, grâce aux efforts des amis de Molière et à la merveilleuse prudence de sa conduite, le symbole du mensonge dévot apparut enfin sur la scène. On s'y porta en foule; on se souvenait que deux ans auparavant, toutes les loges étant pleines pour la seconde représentation du Tartuffe, un ordre exprès était venu pour empêcher la représentation.
«J'eus de la peine, dit le journaliste Robinet, à voir Tartuffe, tant il y avoit de monde:
Armande était Elmire; du Croisy, dont la voix était douce et l'air compassé, jouait Tartuffe. Madeleine Béjart, cette femme amère et violente qui avait tourmenté sa jeune sœur et l'avait forcée à se rejeter dans les bras d'un 315 mari, représentait Dorine, la servante maîtresse, «forte en gueule et impertinente,» devenue la première autorité d'une maison mal conduite. Madame Pernelle, cette aïeule entêtée qui ouvre la scène d'une façon si admirable, était représentée par Béjart lui-même, et Molière s'était réservé le personnage du crédule Orgon.
Depuis ce temps Tartuffe représente le masque hypocrite et la formule du mensonge, non-seulement pour la France, mais pour l'Europe et l'avenir. Comme Patelin, Panurge, Figaro et Falstaff, comme Lovelace et Don Juan, il vit toujours, il est immortel.
Mais qu'est-ce que Tartuffe? Selon quelques commentateurs, ce serait le diable, der Tauffel, qui serait transformé en ter Teufel, puis enfin en Tartuffe. Selon d'autres, ce serait une allusion à ce personnage dévot qui, d'un ton contrit, onctueux et pieux, demandait sans cesse qu'on lui servît des «truffes.» Absurde étymologie. Tartuffe est simplement le Truffactor de la basse latinité, le «trompeur,» mot qui se rapporte à l'italien et à l'espagnol «truffa» combiné avec la syllabe augmentative «tra,» indiquant une qualité superlative et l'excès d'une qualité ou d'un défaut. Truffer, c'est tromper; «Tratruffar,» tromper excessivement et avec hardiesse. L'euphonie a donné ensuite «tartuffar,» puis Tartuffe. Il est curieux de retrouver cette dernière désignation appliquée aux «truffes» ou «tartuffes,» qui deviennent ainsi les trompeuses. Platina, dans son traité de Honesta voluptate, indique cette étymologie relevée par le Duchat et Ménage. Truffaldin, le fourbe vénitien, se rapporte à la même origine. Tartuffe, Truffactor, le Truffeur, est donc le roi des fourbes sérieux comme Mascarille est le roi des fourbes comiques; aussi toute manifestation de l'irritation française contre l'autorité de la formule, contre l'envahissement des simulacres, a-t-elle eu pour expression le mot Tartuffe. C'est Tartuffe que l'on a demandé, joué, applaudi, 316 toutes les fois que le mécontentement populaire s'est soulevé secrètement ou ouvertement contre le joug. Molière a été plus effectif dans le sens que nous indiquons que cent révolutionnaires.
Molière n'eut pas seulement à combattre les résistances des dévots, mais les coquetteries et les prétentions d'Armande, qui voulait jouer le rôle d'Elmire en grande coquette, se surcharger de diamants et de dentelles, et éblouir tout le monde de l'éclat de sa parure. Une telle splendeur eût effrayé M. Tartuffe, dont la finesse madrée n'aurait pas osé approcher d'une si brillante idole. Molière, au grand chagrin d'Armande, lui imposa un ajustement plus modeste et plus conforme à la situation sociale de son mari.
Quarante-quatre représentations attestèrent la conquête redoutable et indestructible de Molière.
Tout s'émut. Un curé, qui s'appelait Roulet, et qui avait le soin d'une petite église de Paris (Saint-Barthélemy), publia contre l'auteur un pamphlet furieux, digne des temps de la Ligue. Bourdaloue tonna en chaire, Bossuet exhorta les chrétiens à ne pas se laisser séduire par le comédien impie. Le prince de Conti, devenu janséniste, frappa d'anathème son ancien protégé. La Bruyère, qui tenait à Bossuet par des liens sévères et secrets, essaya de prouver que le vrai Tartuffe, plus homme du monde et plus raffiné, ne se montre jamais sous d'aussi grossières et d'aussi franches couleurs. Les jésuites, bien qu'attaqués dans les passages où la morale d'Escobar est raillée, pardonnèrent à Molière, dont le père Bouhours composa l'épitaphe laudative; Fénelon, leur ami, dont l'âme tendre se joignait à un esprit si fin, prit parti pour le critique de la fausse dévotion, «qui, disait-il, rendait service à la vraie piété;» enfin les comédiens ravis assurèrent double part à Molière dans les recettes de toutes les représentations qui suivirent.
Les commentateurs ont cherché avec un soin minutieux les diverses circonstances et les anecdotes qui ont pu 317 servir Molière dans la création de Tartuffe. Il a puisé dans tous les événements et tous les faits qui se sont manifestés entre 1660 et 1667: querelles du jansénisme et du molinisme; les Provinciales brûlées par le bourreau; les intrigues de l'austère duchesse de Navailles et d'Olympe de Mancini contre les amours du roi; la cassette de Fouquet et la chute de ce ministre; le personnage odieux de Letellier; toutes les manœuvres contradictoires des courtisans et des dévots; la fausse mysticité du père Lemoine; la rigidité affectée de quelques amis d'Arnauld; la morale relâchée d'Escobar; les arrestations arbitraires commandées par le roi; le personnage patelin et sensuel de cet abbé de Roquette, «qui prêchait les sermons d'autrui;» les anecdotes de la cour et de la ville; la disgrâce de la comtesse de Soissons; tout, jusqu'à la retraite sévère des Singlin et des Arnauld; l'époque entière vient se concentrer dans son œuvre. Il a même indiqué par le personnage de l'huissier «Loyal,» cet oiseau de proie si rempli de douceur, cet autre Patelin exerçant pieusement son triste office, l'existence d'une secte entière vouée à la componction la plus mielleuse et à une douceur de ton qui ne fait que s'accroître de l'inhumanité des actes. Les jésuites se turent. Les jansénistes sentirent le coup, et ne pardonnèrent pas à Molière.
Rabelais, Boccace, Pascal, Platon dans sa République, Scarron même dans sa nouvelle des Hypocrites, lui fournirent des couleurs et des détails. Il y a dans cette dernière nouvelle, imitée de l'espagnol, un «Montufar,» dont le nom, par parenthèse, n'est pas sans analogie avec «Tartuffe,» et qui échappe à la vengeance des lois par la même pénitence humiliée, par la même abjection chrétienne qui réussit à Tartuffe. Qui ne se souvenait alors des profondes hypocrisies du cardinal de Richelieu? Comme Tartuffe, il avait osé parler d'amour à la femme de son maître. Comme le héros de Molière, il s'était prosterné 318 aux pieds de l'ennemi dont il allait faire tomber la tête.
Tartuffe est le point culminant du génie et de la doctrine de Molière. Le genre humain, facilement dupe de l'apparence; l'engouement si naturel à la race française, préparant au charlatanisme une conquête facile; la formule religieuse, le masque de la piété, en simulant le suprême idéal comme offrant un danger terrible, telle est l'idée fondamentale développée avec génie par Molière. La victoire lui reste.
Il savait bien ce qu'il voulait.
Lisez cette admirable préface du Tartuffe, chef-d'œuvre d'un style qui se rapproche de celui de Rousseau et de Pascal, et qui s'élève pour la netteté de la discussion au niveau des plus belles pages de la langue française. Non-seulement il y défend la comédie et le théâtre en général, mais la nature humaine qu'il réhabilite. C'est l'unique fragment de ce penseur et de ce poëte où nous puissions contempler à nu pour ainsi dire sa doctrine philosophique, que nous ne discutons pas ici:
«Rectifier et adoucir les passions au lieu de les retrancher.»
PRÉFACE DU TARTUFFE
Voici une comédie dont on a fait beaucoup de bruit, qui a été longtemps persécutée[127]; et les gens qu'elle joue ont bien fait voir qu'ils étoient plus puissans en France que tous ceux que j'ai joués jusques ici. Les marquis, les précieuses, les cocus et les médecins, ont souffert doucement qu'on les ait représentés, et ils ont fait semblant de se divertir, avec tout le monde, des peintures que l'on a faites d'eux; mais les hypocrites n'ont point entendu raillerie; 319 ils se sont effarouchés d'abord, et ont trouvé étrange que j'eusse la hardiesse de jouer leurs grimaces, et de vouloir décrier un métier dont tant d'honnêtes gens se mêlent. C'est un crime qu'ils ne sauroient me pardonner; et ils se sont tous armés contre ma comédie avec une fureur épouvantable. Ils n'ont eu garde de l'attaquer par le côté qui les a blessés; ils sont trop politiques pour cela, et savent trop bien vivre pour découvrir le fond de leur âme. Suivant leur louable coutume, ils ont couvert leurs intérêts de la cause de Dieu; et le Tartuffe, dans leur bouche, est une pièce qui offense la piété. Elle est, d'un bout à l'autre, pleine d'abominations, et l'on n'y trouvera rien qui ne mérite le feu. Toutes les syllabes en sont impies; les gestes mêmes y sont criminels; et le moindre coup d'œil, le moindre branlement de tête, le moindre pas à droite ou à gauche, y cachent des mystères qu'ils trouvent moyen d'expliquer à mon désavantage.
J'ai eu beau la soumettre aux lumières de mes amis, et à la censure de tout le monde: les corrections que j'y ai pu faire; le jugement du roi et de la reine, qui l'ont vue; l'approbation des grands princes et de messieurs les ministres, qui l'ont honorée publiquement de leur présence; le témoignage des gens de bien, qui l'ont trouvée profitable, tout cela n'a de rien servi. Ils n'en veulent point démordre; et, tous les jours encore, ils font crier en public des zélés indiscrets, qui me disent des injures pieusement, et me damnent par charité.
Je me soucierois fort peu de tout ce qu'ils peuvent dire, n'étoit l'artifice qu'ils ont de me faire des ennemis que je respecte, et de jeter dans leur parti de véritables gens de bien, dont ils préviennent la bonne foi, et qui, par la chaleur qu'ils ont pour les intérêts du ciel, sont faciles à recevoir les impressions qu'on veut leur donner. Voilà ce qui m'oblige à me défendre. C'est aux vrais dévots que je veux me justifier sur la conduite de ma comédie; et je les conjure de tout mon cœur de ne point condamner les choses avant que de les voir, de se défaire de toute prévention, et de ne point servir la passion de ceux dont les grimaces les déshonorent.
Si l'on prend la peine d'examiner de bonne foi ma comédie, on verra sans doute que mes intentions y sont partout innocentes, et qu'elle ne tend nullement à jouer les choses que l'on doit révérer; que je l'ai traitée avec toutes 320 les précautions que me demandoit la délicatesse de la matière; et que j'ai mis tout l'art et tous les soins qu'il m'a été possible pour bien distinguer le personnage de l'hypocrite d'avec celui du vrai dévot. J'ai employé pour cela deux actes entiers à préparer la venue de mon scélérat. Il ne tient pas un seul moment l'auditeur en balance; on le connoît d'abord aux marques que je lui donne; et, d'un bout à l'autre, il ne dit pas un mot, il ne fait pas une action qui ne peigne aux spectateurs le caractère d'un méchant homme, et ne fasse éclater celui du véritable homme de bien que je lui oppose.
Je sais bien que pour réponse, ces messieurs tâchent d'insinuer que ce n'est point au théâtre à parler de ces matières; mais je leur demande, avec leur permission, sur quoi ils fondent cette belle maxime. C'est une proposition qu'ils ne font que supposer, et qu'ils ne prouvent en aucune façon; et, sans doute, il ne seroit pas difficile de leur faire voir que la comédie, chez les anciens, a pris son origine de la religion, et faisoit partie de leurs mystères; que les Espagnols, nos voisins, ne célèbrent guère de fête où la comédie ne soit mêlée; et que, même parmi nous, elle doit sa naissance aux soins d'une confrérie à qui appartient encore aujourd'hui l'hôtel de Bourgogne; que c'est un lieu qui fut donné pour y représenter les plus importans mystères de notre foi; qu'on en voit encore des comédies imprimées en lettres gothiques, sous le nom d'un docteur de Sorbonne; et, sans aller chercher si loin, que l'on a joué, de notre temps, des pièces saintes de M. Corneille[128], qui ont été l'admiration de toute la France.
Si l'emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas par quelle raison il y en aura de privilégiés. Celui-ci est, dans l'État, d'une conséquence bien plus dangereuse que tous les autres; et nous avons vu que le théâtre a une grande vertu pour la correction. Les plus beaux traits d'une sérieuse morale sont moins puissans, le plus souvent, que ceux de la satire; et rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. C'est une grande atteinte aux vices, que de les exposer à la risée de tout le monde. On souffre aisément des répréhensions; mais on ne souffre point la raillerie. 321 On veut bien être méchant; mais on ne veut point être ridicule.
On me reproche d'avoir mis des termes de piété dans la bouche de mon imposteur. Eh! pouvois-je m'en empêcher, pour bien représenter le caractère d'un hypocrite? Il suffit, ce me semble, que je fasse connoître les motifs criminels qui lui font dire les choses, et que j'en aie retranché les termes consacrés, dont on auroit eu peine à lui entendre faire un mauvais usage.—Mais il débite au quatrième acte une morale pernicieuse.—Mais cette morale est-elle quelque chose dont tout le monde n'eût les oreilles rebattues. Dit-elle rien de nouveau dans ma comédie? Et peut-on craindre que des choses si généralement détestées fassent quelque impression dans les esprits; que je les rende dangereuses en les faisant monter sur le théâtre; qu'elles reçoivent quelque autorité de la bouche d'un scélérat? Il n'y a nulle apparence à cela; et l'on doit approuver la comédie du Tartuffe, ou condamner généralement toutes les comédies.
C'est à quoi l'on s'attache furieusement depuis un temps; et jamais on ne s'étoit si fort déchaîné contre le théâtre. Je ne puis pas nier qu'il n'y ait eu des pères de l'Église qui ont condamné la comédie; mais on ne peut pas me nier aussi qu'il n'y en ait eu quelques-uns qui l'ont traitée un peu plus doucement. Ainsi l'autorité dont on prétend appuyer la censure est détruite par ce partage; et toute la conséquence qu'on peut tirer de cette diversité d'opinions en des esprits éclairés des mêmes lumières, c'est qu'ils ont pris la comédie différemment, et que les uns l'ont considérée dans sa pureté, lorsque les autres l'ont regardée dans sa corruption, et confondue avec tous ces vilains spectacles qu'on a eu raison de nommer des spectacles de turpitude.
Et, en effet, puisqu'on doit discourir des choses, et non pas des mots, et que la plupart des contrariétés viennent de ne se pas entendre, et d'envelopper dans un même mot des choses opposées, il ne faut qu'ôter le voile de l'équivoque, et regarder ce qu'est la comédie en soi, pour voir si elle est condamnable. On connoîtra sans doute que, n'étant autre chose qu'un poëme ingénieux qui, par des leçons agréables, reprend les défauts des hommes, on ne sauroit la censurer sans injustice; et, si nous voulons ouïr là-dessus le témoignage de l'antiquité, elle nous dira 322 que ses plus célèbres philosophes ont donné des louanges à la comédie, eux qui faisoient profession d'une sagesse si austère, et qui crioient sans cesse après les vices de leur siècle. Elle nous fera voir qu'Aristote a consacré des veilles au théâtre, et s'est donné le soin de réduire en préceptes l'art de faire des comédies. Elle nous apprendra que de ses plus grands hommes, et des premiers en dignité, ont fait gloire d'en composer eux-mêmes; qu'il y en a eu d'autres qui n'ont pas dédaigné de réciter en public celles qu'ils avoient composées; que la Grèce a fait pour cet art éclater son estime par les prix glorieux et par les superbes théâtres dont elle a voulu l'honorer; et que, dans Rome enfin, ce même art a reçu aussi des honneurs extraordinaires: je ne dis pas dans Rome débauchée, et sous la licence des empereurs, mais dans Rome disciplinée, sous la sagesse des consuls, et dans le temps de la vigueur de la vertu romaine.
J'avoue qu'il y a eu des temps où la comédie s'est corrompue. Et qu'est-ce que dans le monde on ne corrompt point tous les jours? Il n'y a chose si innocente où les hommes ne puissent porter du crime; point d'art si salutaire dont ils ne soient capables de renverser les intentions; rien de si bon en soi qu'ils ne puissent tourner à de mauvais usages. La médecine est un art profitable, et chacun la révère comme une des plus excellentes choses que nous ayons; et cependant il y a eu des temps où elle s'est rendue odieuse, et souvent on en a fait un art d'empoisonner les hommes. La philosophie est un présent du ciel: elle nous a été donnée pour porter nos esprits à la connoissance d'un Dieu, par la contemplation des merveilles de la nature; et pourtant on n'ignore pas que souvent on l'a détournée de son emploi, et qu'on l'a occupée publiquement à soutenir l'impiété. Les choses mêmes les plus saintes ne sont point à couvert de la corruption des hommes; et nous voyons des scélérats qui tous les jours abusent de la piété, et la font servir méchamment aux crimes les plus grands. Mais on ne laisse pas pour cela de faire les distinctions qu'il est besoin de faire: on n'enveloppe point dans une fausse conséquence la bonté des choses que l'on corrompt avec la malice des corrupteurs: on sépare toujours le mauvais usage d'avec l'intention de l'art; et, comme on ne s'avise point de défendre la médecine pour avoir été bannie de Rome, ni la philosophie 323 pour avoir été condamnée publiquement dans Athènes, on ne doit point aussi vouloir interdire la comédie pour avoir été censurée en de certains temps. Cette censure a eu ses raisons, qui ne subsistent point ici. Elle s'est renfermée dans ce qu'elle a pu voir; et nous ne devons point la tirer des bornes qu'elle s'est données, l'étendre plus loin qu'il ne faut, et lui faire embrasser l'innocent avec le coupable. La comédie qu'elle a eu dessein d'attaquer n'est point du tout la comédie que nous voulons défendre. Il se faut bien garder de confondre celle-là avec celle-ci. Ce sont deux personnes de qui les mœurs sont tout à fait opposées. Elles n'ont aucun rapport l'une avec l'autre que la ressemblance du nom; et ce seroit une injustice épouvantable que de vouloir condamner Olympe, qui est femme de bien, parce qu'il y a une Olympe qui a été une débauchée. De semblables arrêts, sans doute, feroient un grand désordre dans le monde. Il n'y auroit rien par là qui ne fût condamné; et, puisque l'on ne garde point cette rigueur à tant de choses dont on abuse tous les jours, on doit bien faire la même grâce à la comédie, et approuver les pièces de théâtre où l'on verra régner l'instruction de l'honnêteté.
Je sais qu'il y a des esprits dont la délicatesse ne peut souffrir aucune comédie; qui disent que les plus honnêtes sont les plus dangereuses; que les passions que l'on y dépeint sont d'autant plus touchantes qu'elles sont pleines de vertu, et que les âmes sont attendries par ces sortes de représentations. Je ne vois pas quel grand crime c'est que de s'attendrir à la vue d'une passion honnête; et c'est un haut étage de vertu que cette pleine insensibilité où ils veulent faire monter notre âme. Je doute qu'une si grande perfection soit dans les forces de la nature humaine; et je ne sais s'il n'est pas mieux de travailler à rectifier et adoucir les passions des hommes que de vouloir les retrancher entièrement. J'avoue qu'il y a des lieux qu'il vaut mieux fréquenter que le théâtre; et, si l'on veut blâmer toutes les choses qui ne regardent pas directement Dieu et notre salut, il est certain que la comédie en doit être, et je ne trouve point mauvais qu'elle soit condamnée avec le reste; mais, supposé, comme il est vrai, que les exercices de la piété souffrent des intervalles, et que les hommes aient besoin de divertissement, je soutiens qu'on ne leur en peut trouver un qui soit plus innocent 324 que la comédie. Je me suis étendu trop loin. Finissons par un mot d'un grand prince[129] sur la comédie du Tartuffe.
Huit jours après qu'elle eut été défendue, on représenta devant la cour une pièce intitulée Scaramouche ermite; et le roi, en sortant, dit au grand prince que je veux dire:
«Je voudrois bien savoir pourquoi les gens qui se scandalisent si fort de la comédie de Molière ne disent mot de celle de Scaramouche;» à quoi le prince répondit: «La raison de cela, c'est que la comédie de Scaramouche joue le ciel et la religion, dont ces messieurs-là ne se soucient point; mais celle de Molière les joue eux-mêmes; c'est ce qu'ils ne peuvent souffrir.»
PREMIER PLACET
PRÉSENTÉ AU ROI
Sur la comédie du Tartuffe, qui n'avoit pas encore été représentée
en public.
Sire,
Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que, dans l'emploi où je me trouve[130], je n'avois rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle; et, comme l'hypocrisie, sans doute, en est un des plus en usage, des plus incommodes et des plus dangereux, j'avois eu, Sire, la pensée que je ne rendrois pas un petit service à tous les honnêtes gens de votre royaume, si je faisois une comédie qui décriât les hypocrites, et mît en vue, comme il faut, toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries couvertes de ces faux monnoyeurs en dévotion, qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité sophistique.
Je l'ai faite, Sire, cette comédie, avec tout le soin, comme 325 je crois, et toutes les circonspections que pouvoit demander la délicatesse de la matière; et, pour mieux conserver l'estime et le respect qu'on doit aux vrais dévots, j'en ai distingué le plus que j'ai pu le caractère que j'avois à toucher. Je n'ai point laissé d'équivoque, j'ai ôté ce qui pouvoit confondre le bien avec le mal, et ne me suis servi, dans cette peinture, que des couleurs expresses et des traits essentiels qui font reconnoître d'abord un véritable et franc hypocrite.
Cependant toutes mes précautions ont été inutiles. On a profité, Sire, de la délicatesse de votre âme sur les matières de religion, et l'on a su vous prendre par l'endroit seul que vous êtes prenable, je veux dire par le respect des choses saintes. Les tartuffes, sous main, ont eu l'adresse de trouver grâce auprès de Votre Majesté; et les originaux enfin ont fait supprimer la copie, quelque innocente qu'elle fût, et quelque ressemblante qu'on la trouvât.
Bien que ce m'eût été un coup sensible que la suppression de cet ouvrage, mon malheur pourtant étoit adouci par la manière dont Votre Majesté s'étoit expliquée sur ce sujet; et j'ai cru, Sire, qu'elle m'ôtoit tout lieu de me plaindre, ayant eu la bonté de déclarer qu'elle ne trouvoit rien à dire dans cette comédie, qu'elle me défendoit de produire en public.
Mais, malgré cette glorieuse déclaration du plus grand roi du monde et du plus éclairé, malgré l'approbation encore de monsieur le légat, et de la plus grande partie de nos prélats, qui tous, dans les lectures particulières que je leur ai faites de mon ouvrage, se sont trouvés d'accord avec les sentiments de Votre Majesté; malgré tout cela, dis-je, on voit un livre composé par le curé de..., qui donne hautement un démenti à tous ces augustes témoignages. Votre Majesté a beau dire, et monsieur le légat et messieurs les prélats ont beau donner leur jugement, ma comédie, sans l'avoir vue[131], est diabolique, et diabolique mon cerveau; je suis un démon vêtu de chair et habillé en homme, un libertin, un impie digne d'un supplice exemplaire. Ce n'est pas assez que le feu expie en public mon offense, j'en serois quitte à trop bon marché; le zèle charitable de ce galant homme de bien n'a garde de demeurer là; il ne veut point que j'aie de miséricorde 326 auprès de Dieu, il veut absolument que je sois damné; c'est une affaire résolue.
Ce livre, Sire, a été présenté à Votre Majesté: et, sans doute, elle
juge bien elle-même combien il m'est fâcheux de me voir exposé tous les
jours aux insultes de ces messieurs; quel tort me feront dans le monde
de telles calomnies, s'il faut qu'elles soient tolérées; et quel intérêt
j'ai enfin à me purger de son imposture, et à faire voir au public que
ma comédie n'est rien moins que ce qu'on veut qu'elle soit. Je ne dirai
point, Sire, ce que j'aurois à demander pour ma réputation, et pour
justifier à tout le monde l'innocence de mon ouvrage: les rois éclairés
comme vous n'ont pas besoin qu'on leur marque ce qu'on souhaite; ils
voient, comme Dieu, ce qu'il nous faut, et savent mieux que nous ce
qu'ils nous doivent accorder. Il me suffit de mettre mes intérêts entre
les mains de Votre Majesté; et j'attends d'elle, avec respect, tout ce
qu'il lui plaira d'ordonner là-dessus.
SECOND PLACET
PRÉSENTÉ AU ROI
Dans son camp devant la ville de Lille en Flandre, par les sieurs la
Thorillière et la Grange, comédiens de Sa Majesté, et compagnons du
sieur Molière sur la défense qui fut faite, le 6 août 1667, de
représenter le Tartuffe jusques à nouvel ordre de Sa Majesté.
Sire,
C'est une chose bien téméraire à moi que de venir importuner un grand monarque au milieu de ses glorieuses conquêtes; mais, dans l'état où je me vois, où trouver, Sire, une protection qu'au lieu où je la viens chercher; et qui puis-je solliciter contre l'autorité de la puissance qui m'accable, que la source de la puissance et de l'autorité, que le juste dispensateur des ordres absolus, que le souverain juge et le maître de toutes choses?
Ma comédie, Sire, n'a pu jouir ici des bontés de Votre Majesté. En vain je l'ai produite sous le titre de l'Imposteur, et déguisé le personnage sous l'ajustement d'un homme du monde; j'ai eu beau lui donner un petit chapeau, 327 de grands cheveux, un grand collet, une épée, et des dentelles sur tout l'habit, mettre en plusieurs endroits des adoucissements, et retrancher avec soin tout ce que j'ai jugé capable de fournir l'ombre d'un prétexte aux célèbres originaux du portrait que je voulois faire, tout cela n'a de rien servi. La cabale s'est réveillée aux simples conjectures qu'ils ont pu avoir de la chose. Ils ont trouvé moyen de surprendre des esprits qui, dans toute autre matière, font une haute profession de ne se point laisser surprendre. Ma comédie n'a pas plutôt paru, qu'elle s'est vue foudroyée par le coup d'un pouvoir qui doit imposer du respect; et tout ce que j'ai pu faire en cette rencontre pour me sauver moi-même de l'éclat de cette tempête, c'est de dire que Votre Majesté avoit eu la bonté de m'en permettre la représentation, et que je n'avois pas cru qu'il fût besoin de demander cette permission à d'autres, puisqu'il n'y avoit qu'elle seule qui me l'eût défendue.
Je ne doute point, Sire, que les gens que je peins dans ma comédie ne remuent bien des ressorts auprès de Votre Majesté, et ne jettent dans leur parti, comme ils ont déjà fait, de véritables gens de bien, qui sont d'autant plus prompts à se laisser tromper qu'ils jugent d'autrui par eux-mêmes. Ils ont l'art de donner de belles couleurs à toutes leurs intentions. Quelque mine qu'ils fassent, ce n'est point du tout l'intérêt de Dieu qui les peut émouvoir, ils l'ont assez montré dans les comédies qu'ils ont souffert qu'on ait jouées tant de fois en public sans en dire le moindre mot. Celles-là n'attaquoient que la piété et la religion, dont ils se soucient fort peu; mais celle-ci les attaque et les joue eux-mêmes; et c'est ce qu'ils ne peuvent souffrir. Ils ne sauroient me pardonner de dévoiler leurs impostures aux yeux de tout le monde; et, sans doute, on ne manquera pas de dire à Votre Majesté que chacun s'est scandalisé de ma comédie. Mais la vérité pure, Sire, c'est que tout Paris ne s'est scandalisé que de la défense qu'on en a faite; que les plus scrupuleux en ont trouvé la représentation profitable; et qu'on s'est étonné que des personnes d'une probité si connue aient eu une si grande déférence pour des gens qui devroient être l'horreur de tout le monde, et sont si opposés à la véritable piété dont elles font profession.
J'attends avec respect l'arrêt que Votre Majesté daignera prononcer sur cette matière; mais il est très-assuré, 328 Sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire des comédies si les tartuffes ont l'avantage; qu'ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais, et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume.
Daignent vos bontés, Sire, me donner une protection contre leur rage
envenimée! et puissé-je, au retour d'une campagne si glorieuse, délasser
Votre Majesté des fatigues de ses conquêtes, lui donner d'innocens
plaisirs après de si nobles travaux, et faire rire le monarque qui fait
trembler toute l'Europe!
TROISIÈME PLACET
PRÉSENTÉ AU ROI, LE 5 FÉVRIER 1669.
Sire,
Un fort honnête médecin[132], dont j'ai l'honneur d'être le malade, me promet et veut s'obliger par-devant notaire de me faire vivre encore trente années, si je puis lui obtenir une grâce de Votre Majesté. Je lui ai dit, sur sa promesse, que je ne lui demandois pas tant, et que je serois satisfait de lui, pourvu qu'il s'obligeât de ne me point tuer. Cette grâce, Sire, est un canonicat de votre chapelle royale de Vincennes, vacant par la mort de...
Oserois-je demander encore cette grâce à Votre Majesté le propre jour de la grande résurrection de Tartuffe, ressuscité par vos bontés? Je suis, par cette première faveur, réconcilié avec les dévots: et je le serois, par cette seconde, avec les médecins. C'est pour moi, sans doute, trop de grâces à la fois; mais peut-être n'en est-ce pas trop pour Votre Majesté; et j'attends, avec un peu d'espérance respectueuse, la réponse de mon placet.
| PERSONNAGES. | ACTEURS. |
| MADAME PERNELLE, mère d'Orgon. | Béjart. |
| ORGON, mari d'Elmire. | Molière. |
| ELMIRE, femme d'Orgon. | MlleMolière. |
| DAMIS, fils d'Orgon. | Hubert. |
| MARIANE, fille d'Orgon et amante de Valère. | MlleDebrie. |
| VALÈRE. amant de Mariane. | La Grange. |
| CLÉANTE, beau-frère d'Orgon. | La Thorillière. |
| TARTUFFE, faux dévot. | Du Croisy. |
| DORINE, suivante de Mariane. | Mad. Béjart. |
| M. LOYAL, sergent[133]. | Debrie. |
| UN EXEMPT. | |
| FLIPOTE, servante de madame Pernelle. | |
| La scène est à Paris, dans la maison d'Orgon. | |
ACTE PREMIER
SCÈNE I.—MADAME PERNELLE, ELMIRE, MARIANE, CLÉANTE, DAMIS, DORINE, FLIPOTE.
MADAME PERNELLE.
ELMIRE.
MADAME PERNELLE.
ELMIRE.
MADAME PERNELLE.
DORINE.
MADAME PERNELLE.
DAMIS.
MADAME PERNELLE.
MARIANE.
MADAME PERNELLE.
ELMIRE.
MADAME PERNELLE.
CLÉANTE.
MADAME PERNELLE.
DAMIS.
MADAME PERNELLE.
DAMIS.
DORINE.
MADAME PERNELLE.
DAMIS.
DORINE.
MADAME PERNELLE.
DORINE.
MADAME PERNELLE.
DORINE.
MADAME PERNELLE.
DORINE.
MADAME PERNELLE.
CLÉANTE.
DORINE[140].
MADAME PERNELLE.
DORINE.
MADAME PERNELLE, à Elmire.
SCÈNE II.—CLÉANTE, DORINE.
CLÉANTE.
DORINE.
CLÉANTE.
DORINE.
SCÈNE III.—ELMIRE, MARIANE, DAMIS, CLÉANTE, DORINE.
ELMIRE, à Cléante.
CLÉANTE.
SCÈNE IV.—CLÉANTE, DAMIS, DORINE.
DAMIS.
DORINE.
SCÈNE V.—ORGON, CLÉANTE, DORINE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
SCÈNE VI.—ORGON, CLÉANTE.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON, s'en allant.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE, seul.
ACTE II
SCÈNE I.—ORGON, MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE, à Orgon, qui regarde dans un cabinet.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
SCÈNE II.—ORGON, MARIANE, DORINE, entrant doucement, et se tenant derrière Orgon, sans être vue.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
MARIANE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE, à part.
ORGON.
DORINE, à part.
ORGON.
DORINE, à part.
ORGON, à Dorine.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON, à part.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
DORINE, en s'enfuyant.
ORGON, après avoir manqué de donner un soufflet à Dorine.
SCÈNE III.—MARIANE, DORINE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
SCÈNE IV.—VALÈRE, MARIANE, DORINE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
DORINE, se retirant dans le fond du théâtre.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE, revenant.
MARIANE.
VALÈRE, revenant encore.
MARIANE.
VALÈRE, en sortant.
MARIANE.
VALÈRE, revenant encore.
MARIANE.
VALÈRE, se retournant lorsqu'il est prêt à sortir.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
VALÈRE.
MARIANE.
DORINE, à Mariane.
VALÈRE, feignant de résister.
DORINE.
VALÈRE.
DORINE.
VALÈRE.
DORINE.
MARIANE, à part.
DORINE, quittant Valère et courant après Mariane.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
VALÈRE, à part.
DORINE, quittant Mariane et courant après Valère.
VALÈRE, à Dorine.
MARIANE, à Dorine.
DORINE.
VALÈRE.
DORINE, à Mariane.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE, à Valère.
VALÈRE, à Mariane.
DORINE.
VALÈRE, en donnant sa main à Dorine.
DORINE, à Mariane.
MARIANE, en donnant aussi sa main.
DORINE.
VALÈRE, se tournant vers Mariane.
DORINE.
VALÈRE, à Mariane.
MARIANE.
DORINE.
MARIANE.
DORINE.
VALÈRE, à Mariane.
MARIANE, à Valère.
VALÈRE.
DORINE.
VALÈRE, revenant sur ses pas.
DORINE.
ACTE III
SCÈNE I.—DAMIS, DORINE.
DAMIS.
DORINE.
DAMIS.
DORINE.
DAMIS.
DORINE.
DAMIS.
DORINE.
DAMIS.
DORINE.
SCÈNE II.—TARTUFFE, DORINE.
TARTUFFE, parlant haut à son valet, qui est dans la maison, dès qu'il aperçoit Dorine.
DORINE, à part.
TARTUFFE.
DORINE.
TARTUFFE, tirant un mouchoir de sa poche.
DORINE.
TARTUFFE.
DORINE.
TARTUFFE.
DORINE.
TARTUFFE.
DORINE, à part.
Comme il se radoucit!TARTUFFE.
DORINE.
SCÈNE III.—ELMIRE, TARTUFFE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE, assis.
ELMIRE, assise.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE, prenant la main d'Elmire et lui serrant les doigts.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE, maniant le fichu d'Elmire.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
SCÈNE IV.—ELMIRE, DAMIS, TARTUFFE.
DAMIS, sortant du cabinet où il s'étoit retiré.
ELMIRE.
DAMIS.
ELMIRE.
DAMIS.
SCÈNE V.—ORGON, ELMIRE, DAMIS, TARTUFFE.
DAMIS.
ELMIRE.
SCÈNE VI.—ORGON, DAMIS, TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON, à son fils.
DAMIS.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
DAMIS.
ORGON.
DAMIS.
ORGON.
DAMIS.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON, à son fils.
TARTUFFE.
ORGON, se jetant aussi à genoux et embrassant Tartuffe.
DAMIS.
ORGON.
DAMIS.
ORGON.
DAMIS.
ORGON.
DAMIS.
ORGON.
DAMIS.
ORGON.
SCÈNE VII.—ORGON, TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON, courant tout en larmes à la porte par où il a chassé son fils.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
ACTE IV
SCÈNE I.—CLÉANTE, TARTUFFE.
CLÉANTE.
TARTUFFE.
CLÉANTE.
TARTUFFE.
CLÉANTE.
TARTUFFE.
CLÉANTE.
TARTUFFE.
CLÉANTE, seul.
SCÈNE II.—ELMIRE, MARIANE, CLÉANTE, DORINE.
DORINE, à Cléante.
SCÈNE III.—ORGON, ELMIRE, MARIANE, CLÉANTE, DORINE.
ORGON.
MARIANE, aux genoux d'Orgon.
ORGON, se sentant attendrir.
MARIANE.
ORGON.
DORINE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
ELMIRE, à Orgon.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE, à Dorine.
DORINE, à Elmire.
ELMIRE, à Dorine.
SCÈNE IV.—ELMIRE, ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
SCÈNE V.—TARTUFFE, ELMIRE, ORGON, sous la table.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE, après avoir toussé pour avertir son mari.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE, après avoir encore toussé et frappé sur la table.
TARTUFFE.
ELMIRE.
TARTUFFE.
ELMIRE.
SCÈNE VI.—ORGON, ELMIRE.
ORGON, sortant de dessous la table.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
SCÈNE VII.—TARTUFFE, ELMIRE, ORGON.
TARTUFFE, sans voir Orgon.
ORGON, arrêtant Tartuffe.
ELMIRE, à Tartuffe.
TARTUFFE, à Orgon.
ORGON.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
SCÈNE VIII.—ELMIRE, ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ELMIRE.
ORGON.
ACTE V
SCÈNE I.—ORGON, CLÉANTE.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
ORGON.
CLÉANTE.
SCÈNE II.—ORGON, CLÉANTE, DAMIS.
DAMIS.
ORGON.
DAMIS.
CLÉANTE.
SCÈNE III.—MADAME PERNELLE, ORGON, ELMIRE, CLÉANTE, MARIANE, DAMIS, DORINE.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
DORINE.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
ORGON.
DORINE, à Orgon.
CLÉANTE.
DAMIS.
ELMIRE.
CLÉANTE, à Oronte.
ORGON.
CLÉANTE.
ELMIRE.
ORGON, à Dorine, voyant entrer M. Loyal.
SCÈNE IV.—ORGON, MADAME PERNELLE, ELMIRE, MARIANE, CLÉANTE, DAMIS, DORINE. M. LOYAL.
M. LOYAL, à Dorine, dans le fond du théâtre.
DORINE.
M. LOYAL.
DORINE.
M. LOYAL.
DORINE, à Orgon.
CLÉANTE, à Orgon.
ORGON, à Cléante.
CLÉANTE.
M. LOYAL, à Orgon.
ORGON, bas, à Cléante.
M. LOYAL.
ORGON.
M. LOYAL.
ORGON.
M. LOYAL.
ORGON.
M. LOYAL.
DAMIS, à M. Loyal.
M. LOYAL, à Damis.
ORGON.
M. LOYAL.
DAMIS.
M. LOYAL, à Orgon.
DORINE, à part.
M. LOYAL.
ORGON.
M. LOYAL.
ORGON, à part.
CLÉANTE, bas à Orgon.
DAMIS.
DORINE.
M. LOYAL.
CLÉANTE, à M. Loyal.
M. LOYAL.
ORGON.
SCÈNE V.—ORGON, MADAME PERNELLE, ELMIRE, CLÉANTE, MARIANE, DAMIS, DORINE.
ORGON.
MADAME PERNELLE.
DORINE, à Orgon.
ORGON.
CLÉANTE, à Orgon.
ELMIRE.
SCÈNE VI.—VALÈRE, ORGON, MADAME PERNELLE, ELMIRE, CLÉANTE, MARIANE, DAMIS, DORINE.
VALÈRE.
CLÉANTE.
ORGON.
VALÈRE.
ORGON.
CLÉANTE.
SCÈNE VII.—TARTUFFE, UN EXEMPT, MADAME PERNELLE, ORGON, ELMIRE, CLÉANTE, MARIANE, VALÈRE, DAMIS, DORINE.
TARTUFFE, arrêtant Orgon.
ORGON.
TARTUFFE.
CLÉANTE.
DAMIS.
TARTUFFE.
MARIANE.
TARTUFFE.
ORGON.
TARTUFFE.
ELMIRE.
DORINE.
CLÉANTE.
TARTUFFE, à l'exempt.
L'EXEMPT.
TARTUFFE.
L'EXEMPT.
TARTUFFE.
L'EXEMPT.
DORINE.
MADAME PERNELLE.
ELMIRE.
MARIANE.
ORGON., à Tartuffe, que l'exempt emmène.
SCÈNE VIII.—MADAME PERNELLE, ORGON, ELMIRE MARIANE, CLÉANTE, VALÈRE, DAMIS, DORINE.
CLÉANTE.
ORGON.
FIN DU TARTUFFE.
~~~~~
[1] Joué en partie devant le roi, à Versailles, le 10 mai 1664, puis suspendu; joué ensuite à Paris, devant le public, le 5 août 1667, puis suspendu de nouveau, et repris le 5 février 1669.
[2] Pour: il suffit. Ellipse archaïque.
[3] Pour: par laquelle. Archaïsme très-fréquent chez Molière.
[4] Pour: donner le plaisir. Mot mis à la mode par les Espagnols.
[5] Pour: fournir une excuse à ma tendresse. Ellipse hardie et archaïque.
[6] Pour: notre dame. Mot de patois.
[7] Pour: age, mot latin, allons. Interjection patoise.
[8] Proverbe populaire fondé sur une ancienne superstition.
[9] Pour: ma foi. Mot patois.
[10] Pour: regardez. Abréviation populaire.
[11] Pour: mine de fèves, mesure; c'est-à-dire pour son compte.
[12] Pour: engins pour la gorge, parure, ornement. Mot patois.
[13] Pour: mettre, placer. Archaïsme populaire.
[14] Pour: tout entiers, droits comme une perche; du mot brand, rameau, bruyère.
[15] Pour: tablier. Archaïsme rustique.
[16] Pour: creux de l'estomac. Archaïsme populaire.
[17] Voyez plus haut, passim.
[18] Pour: permettre. Voyez plus haut.
[19] Pour: montre votre niaiserie. Les jeunes oiseaux, ou niais en termes de fauconnerie, ont presque tous le bec jaune.
[20] Pour: honteuse de votre défaite. Mot proverbial qui équivaut à «avoir le nez cassé.»
[21] Les deux premières scènes de cet acte, imprimées dans l'édition de 1682, faite sur les manuscrits de Molière, puis dans l'édition d'Amsterdam de 1683, furent supprimées comme impies dans les éditions subséquentes. Il paraît que l'édition de 1682 fut cartonnée, à l'exception de deux ou trois exemplaires, dont l'un, appartenant à M. de Lomenie, fut retrouvé par M. Beuchot. M. Simonin les publia intégralement en 1813. Quant à la seconde scène, elle fut supprimée à la seconde représentation.
[22] Pour: fait beaucoup de bruit. Métaphore populaire.
[23] Passages supprimés par la censure au temps de Louis XIV, comme tous les autres passages marqués ici par des guillemets.—Le moine bourru, spectre d'un moine, qui, selon la tradition populaire, battait les passants attardés.
[24] Pour: parier dix pistoles contre l'arrivée de la statue.
[25] Pour: deux deniers.
[26] Pour: venir à chef, achever, devenir maître. Archaïsme perdu, déjà suranné du temps de Molière, et qui s'était conservé dans la bourgeoisie.
[27] Pour: les jésuites, déjà poursuivis sous ce nom par Pascal.
[28] Pour: j'ai demandé conseil. L'emploi de ce verbe avec le pronom réfléchi est un archaïsme hors d'usage.
[29] Voyez ci-après les notes, pages 94, 96, 98 note 1, 98 note 2, 103.
[30] Voyez la note, tome Ier, page 273.
[31] Ce mot s'est conservé en anglais et dans le patois languedocien.
[32] Voyez la note troisième, tome Ier, page 268.
[33] Ce qui est renfermé entre des crochets n'existe point dans l'édition originale.
[34] Pour: le coupeur. Mot grec inventé par Despréaux. Il s'agit de Dacquin, chimiste, charlatan qui saignait beaucoup.
[35] Pour: le tueur d'hommes. Mot grec également inventé par Boileau. Il s'agit de Desfougerais, chimiste aussi, boiteux, partisan de l'antimoine, guérissant toutes les maladies avec de la poudre blanche, rouge et jaune, qu'il portait dans sa poche.
[36] Cette porte s'élevait à l'extrémité de la rue de Richelieu; elle fut démolie en 1701.
[37] Voyez plus haut la note première, page 37.
[38] Pour: le lent. Mot grec inventé aussi par Boileau. Il s'agit du fameux Guénaud, dont le cheval, dit Boileau, éclaboussait tout Paris; qui parlait par poids et mesures et faisait tout pour de l'argent.
[39] Pour: l'aboyeur. Mot grec inventé par Boileau. Il s'agit d'Esprit, médecin qui bredouillait.
[40] Pour: accepter le combat. Locution archaïque, par allusion au collet que saisissent et secouent les deux combattants.
[41] Scène imitée du Phormion de Térence, où le principal personnage consulte inutilement trois avocats.
[42] Électuaire apporté à Paris en 1647 par un charlatan d'Orviéto, ville d'Italie.
[43] Pour: φιλος ερεβεος, ami de la mort. Symbole de la médecine elle-même.
[44] Consulter, sur les disputes médicales de l'époque, l'Histoire de la découverte de la circulation du sang, par M. Flourens.
[45] Scène imitée du Medico volante, canevas italien que Molière avait traduit dans sa jeunesse. Voyez tome Ier, p. 17.
[46] Pour: la bête est prise au lacet; comme les bécasses, qui se brident et s'attrapent elles-mêmes.
[47] Ce dénoûment est emprunté au Pedant joué de Cyrano de Bergerac, ami de Molière.
[48] Mot qui, au dix-septième siècle, rimait encore avec joie.
[49] Pour: festin, plaisir. Archaïsme expressif et vulgaire.
[50] Pour: trouve. Archaïsme passé de mode, employé par la Fontaine.
[51] Pour: tempérament, caractère. Expression impropre.
[52] Pour: je n'ai passé. Terme de conversation impropre aujourd'hui.
[53] Voyez plus haut. Petit meuble destiné à serrer des papiers et des bijoux. Nous l'appelons aujourd'hui secrétaire. Les lecteurs du dix-neuvième siècle ne doivent pas s'arrêter au sens apparent que le vers de Molière semble leur offrir.
[54] Pour: gens qui vous courtisent. Mot qui a changé de sens, comme les mots prude, coquette, etc.
[55] Pour: bonheur. Archaïsme élégant et perdu.
[56] Mode de cette époque qui avait beaucoup de succès.
[57] De rhein graff, mode allemande; haut-de-chausses très-bouffant.
[58] Pour: se faisant. Ellipse hardie.
[59] Le comte de Guiche, à ce que prétendent les commentateurs.
[60] Au lever du roi.
[61] Le célèbre Lauzun, s'il faut en croire les commentateurs.
[62] Pour: personnage. Dans le sens anglais character.
[63] M. de Saint-Gilles, selon les commentateurs. C'était un original dont on riait à la cour, et dont la Bruyère s'est moqué.
[64] Pour: remue. Archaïsme très-usité du temps de Molière, et qui n'avait rien d'ignoble.
[65] Pour: c'est à sa table que. La répétition du datif à constitue une faute réelle qui ne passait pas pour telle du temps de Molière et de Boileau.
[66] Pour: ce dont. Ellipse énergique.
[67] Imitation d'un passage du IVe livre de Lucrèce, seul débris d'une traduction que Molière avait achevée, et dont il brûla le manuscrit.
[68] Petit coucher du roi.
[69] Uniforme des exempts des maréchaux.
[70] Le tribunal des maréchaux était institué pour juger les querelles d'honneur entre les gentilshommes.
[71] Détail de mœurs théâtrales de l'époque. Voyez tome Ier, p. 261.
[72] Archaïsme passé de mode. Il nous est resté: du meilleur de son cœur.
[73] Pour: tâcher de. C'est une faute plutôt qu'un archaïsme.
[74] Voyez plus haut, tome Ier, page 220.
[75] Pour: quelle chose faire. Ellipse populaire et énergique qui s'est conservée dans la langue.
[76] Pour: piéges. Bossuet l'emploie dans le même sens.
[77] Pour: lueurs, splendeurs. Emploi du participe que l'Académie française excluait alors.
[78] Pour: vous arrêter. L'emploi de ce mot dans le sens neutre est un archaïsme aujourd'hui perdu. La langue plus libre exprimait ou supprimait le pronom des verbes réfléchis.
[79] Au lieu de: pour. Voyez plus haut.
[80] Pour: et si cela arrivait que. Ellipse un peu obscure.
[81] Voyez plus haut la note, p. 157.
[82] Pour: se retrouver, rappeler ses forces. Archaïsme et ellipse.—Ces six derniers vers ont déjà été placés par Molière dans Don Garcie de Navarre; il se les est empruntés à lui-même. Voyez tome I, p. 358.
[83] Le motif et quelques vers de cette scène se retrouvent dans Don Garcie de Navarre, où Molière les a repris. Voyez tome Ier, p. 334.
[84] Dubois en habit de voyage.
[85] Allusion à un libelle attribué à Molière par ses ennemis.
[86] Pour: vanité. Expression archaïque encore usitée dans le patois du Languedoc: gloria.
[87] Pour: prétende à vous. C'est une licence plutôt qu'un archaïsme.
[88] Pour: vous que. La faute de français est évidente.
[89] Pour: témoignages. Expression impropre.
[90] Pour: arrangée de concert.
[91] Pour: que je trouve à vous désirer, regretter. Apocope archaïque, fréquente chez Montaigne.
[92] Allusion à Mademoiselle de Montpensier.
[93] Pour: résolue à trouver en moi. Ellipse et licence très-hardie et très-énergique.
[94] Annoncé aussi sous le nom du Fagotier.
[95] Pour: vivant dans la maison de Géronte. Du latin domesticus, attaché à la famille; sans doute un intendant ou un secrétaire.
[96] Voyez plus haut la note, t. II. p. 168.
[97] Pour: cela suffit. De l'italien basta.
[98] Pour: me forcer de donner, proverbe populaire.
[99] Voyez plus haut la note cinquième, p. 23.
[100] Pour: vous payerez cet argent des fagots (en), locution populaire et très-juste.
[101] Pour: affligés. Du latin, mærens. Archaïsme populaire.
[102] Pour: tourner autour des choses. Mot patois populaire.
[103] Pour: tout comme. Probablement du latin, quemadmodum.
[104] Imitation de Rabelais, liv. 1er, chap. VIII.
[105] Voyez plus haut la note, p. 209.
[106] Scène dont le fond se trouve chez Rabelais.
[107] Pour: les uns du cerveau, les autres du foie.
[108] Imitation d'une nouvelle de Cervantès: et Licenciado vidriera, que M. Aimé Martin a tort de traduire par «le Licencié de Vidriera,» et qui signifie le licencié de verre ou de cristal, c'est-à-dire le licencié affectant la délicatesse.
[109] Imitation de Rabelais.
[110] Imitation éloignée des Adelphes de Térence, acte III, scène IV.
[111] Dénoûment imité de la dernière scène de la Zélinde de Villiers, pièce satirique dirigée contre Molière lui-même.
[112] Ces deux mots rimaient ensemble.
[113] Pour: sur le ton de l'homme. Archaïsme vulgaire.
[114] Ancienne mesure grecque. Pour cent vingt-cinq pas géométriques.
[115] Trait évidemment dirigé par Molière contre sa femme, dont il était séparé, et qui rappelle les deux vers que Henri IV crayonna sur une guitare où se trouvait déjà écrit le distique suivant:
Henri IV acheva le quatrain par ce second distique:
[116] Scène qui se retrouve dans une comédie de Rotrou, intitulée la Sœur.
[117] Pour: la part de votre ennui.
[118] Couplets empruntés textuellement ou à peu près par les auteurs de l'opéra-comique le Postillon de Longjumeau, joué en 1837.
[119] Les gnacares étaient une espèce de cymbales. Le nom de cet instrument est italien: gnaccare ou gnachere.
[120] Molière n'a pas indiqué le lieu de la scène, qui se passe évidemment dans la rue.
[121] Scarra mucchia, personnage de la comédie italienne entièrement vêtu de noir, et scarra mazzo, baroque, bizarre.
[122] Pour: cependant.
[123] «Moi être bon Turc, moi avoir point d'argent. Vouloir vous acheter moi? Moi servir vous, si vous payer moi. Moi faire une bonne cuisine; moi lever matin. Moi faire marmite bouillir. Vous parler, acheter moi?». Imitation du patois barbare, mêlé d'italien et de turc, encore usité dans les Echelles du Levant.
[124] Le livre du Ballet des Muses indique ici le même jeu de théâtre que nous avons déjà indiqué à la fin du premier couplet.
[125] «Moi pas acheter toi; mais te bâtonner si toi pas en aller. Toi en aller, ou moi bâtonner toi.»
[126] Elle a les yeux bleus.
[127] Cette préface a été mise par Molière en tête de la première édition du Tartuffe, publiée en 1669, quelques mois après la seconde représentation de cet ouvrage, et plus de deux ans après la première.
[128] Polyeucte et Théodore, vierge et martyre.
[129] Le grand Condé.
[130] Cet emploi est celui de chef de la troupe du roi.
[131] Pour: sans qu'elle ait été vue. Faute de français.
[132] Mauvillain, médecin de Molière.
[133] Huissier.
[134] Pour: une famille de bohémiens. Proverbe archaïque et populaire. «Le roi Pétaud, dit Bret, est le chef que se choisissaient autrefois les mendiants, réunis en corporation. Ce nom vient du latin peto, je demande. Ce roi n'ayant pas plus de pouvoir que ses sujets, on donne par extension le nom de cour du roi Pétaud à une maison où tout le monde commande.»
[135] Pour: sous cape, sous le manteau. De l'espagnol capa.
[136] Pour: dans cette maison; du latin, hic intus, ci ens, ici dedans. Archaïsme expressif et perdu, ainsi que leans (illie intus, là ens, là dedans). Deux mots excellents d'une nuance distincte et que la langue ne possède plus.
[137] Pour: porter, engager; du latin, inducere.
[138] Voyez la note de la page précédente.
[139] Voyez la note, page 331.
[140] Cette tirade et la suivante avaient appartenu d'abord au rôle de Cléante, comme le prouvent le ton et le style employés par Molière. Il a craint, apparemment, de donner trop de valeur à ses portraits, et a pensé qu'ils passeraient plus aisément dans la bouche d'une suivante.
[141] Allusion à la comtesse de Soissons et à son mari, qui furent exilés. Voyez plus haut, page 317.
[142] La duchesse de Navailles. Voyez plus haut, page 317.
[143] Pour: rester béant. Du latin, beare, rester la bouche ouverte en regardant les corneilles.
[144] Pour: liberté excessive de l'esprit, licence de doctrine. Le mot a changé de sens.
[145] Voyez la note précédente.
[146] Pour faiseurs de façons, de petites mines. Du latin, facies, dont façon est le diminutif.
[147] Voyez plus haut la note, page 341.
[148] Pour: mari trompé. Expression proverbiale passée de mode.
[149] Voyez tome Ier, page 86, note quatrième.
[150] Pour: ne t'ai-je pas. Ellipse archaïque.
[151] Même observation.
[152] Voyez tome II, page 21, note deuxième.
[153] Pour: bonheur. Voyez tome Ier, p. 94, note quatrième.
[154] La grande troupe de musiciens.
[155] Le singe de la foire.
[156] Mot de l'invention de Molière.
[157] Pour: arriver. Voyez plus haut.
[158] Ici Molière a supprimé une scène dans laquelle la famille décidait qu'Elmire serait priée de faire à Tartuffe des remontrances sur le mariage projeté.
[159] Mot composé à la façon des Grecs et des Allemands.
[160] Voyez la note, tome Ier, page 64.
[161] Adroite rimait avec secrète. On prononçait adraite.
[162] Voyez tome Ier, page 58, note deuxième.
[163] Voyez tome Ier, page 58, note deuxième.
[164] Pour: prenez la part qui vous revient du discours. Expression proverbiale qui se retrouve dans l'écossais, scot-elot.
[165] Ici Molière, craignant qu'on ne dénaturât ses intentions, avait mis la note suivante: «C'est un scélérat qui parle.»
[166] Pour: de motifs légers. Archaïsme regrettable.
[167] Molière a supprimé la justification qu'il avait d'abord prêtée à Tartuffe.
[168] Voyez tome Ier, p. 58, note deuxième.
[169] Pour: prompt, actif. Du latin, habilitas.
[170] Pour: démarche. Archaïsme et licence considérable.
[171] Pour: a détesté sa lâche ingratitude envers vous. Inversion et apocope trop dures.
| TROISIÈME ÉPOQUE (1664-1666). | |||
| XV. | 1664. | Tartuffe, comédie. | |
| XVI. | 1665. | Don Juan, ou le Festin de pierre, comédie. | 1 |
| XVII. | 1665. | L'Amour médecin, comédie-ballet. | 80 |
| XVIII. | 1666. | Le Misanthrope, comédie. | 115 |
| QUATRIÈME ÉPOQUE (1666-1667). | |||
| XIX. | 1666. | Le Médecin malgré lui, comédie. | 192 |
| XX. | 1666. | Mélicerte, ballet. | 245 |
| XXI. | 1666. | La Pastorale comique, ballet. | 272 |
| XXII. | 1667. | Le Sicilien, ou l'Amour peintre, comédie-ballet | 282 |
| * Le Tartuffe, ou l'Imposteur, comédie | 309 | ||
FIN DE LA TABLE DU TROISIÈME VOLUME
E. Colin.—Imprimerie de Lagny.
~~~~~
Cette version électronique reproduit dans son intégralité la version originale.
La ponctuation n'a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures.
Ce texte contient quelques mots et expressions en Grec. Faites glisser votre souris sur le texte et la translittération en caractères latins apparaîtra.
L'orthographe a été conservée. Seuls quelques mots ont été modifiés. Ils sont soulignés par des tirets. Passer la souris sur le mot pour voir le texte original.
End of the Project Gutenberg EBook of Molière, by
Jean-Baptiste Poquelin and Philarète Chasles
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MOLIÈRE ***
***** This file should be named 50173-h.htm or 50173-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/0/1/7/50173/
Produced by Claudine Corbasson and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by The
Internet Archive/Canadian Libraries)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.