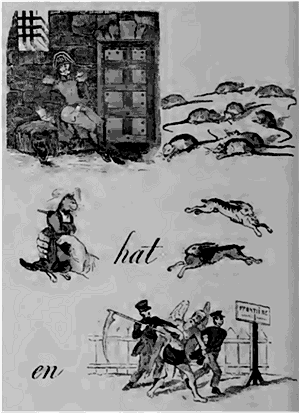L'ILLUSTRATION,
JOURNAL UNIVERSEL,
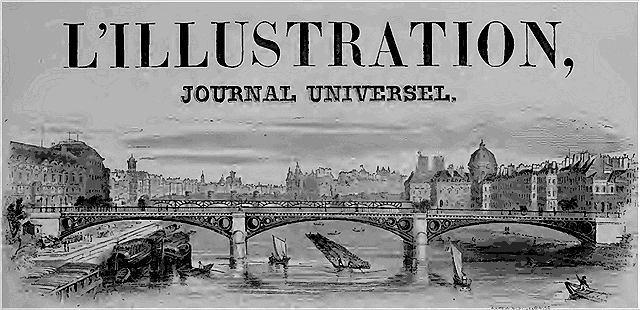
|
Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr. Prix de chaque N°. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75. |
N°70. Vol. III. |
Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. Ab. pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40 |
SOMMAIRE
Geoffroy-Saint-Hilaire. Buste de Geoffroy-Saint-Hilaire.--Histoire de la Semaine.--Prisonniers arabes en France. Portrait d'Ali ben-Aïssa; Iles Sainte-Marguerite; le Fort Brescou.--Un Voyage au long cours à travers la France et la Navarre, par A. Aubert. Chap. IV et V. Sept Gravures, par Bertall; la Tour de Montlhéry, par Champin.--Des Caisses d'Épargne.--Étuves de Néron ou Tripoli.--Vue intérieure des Étuves de Néron.--La Fête des Allemands à Rome. Une Gravure.--Courrier de Paris. Cour d'Assises de la Seine, procès d'Édouard Donon-Cadot et de Rousselet; Maison de Donon-Cadot; Arrestation de Rousselet; Plan de la Cour d'Assise.--Nouveau Système de Télégraphie. Une Gravure.--Exposition des produits de l'industrie. (Neuvième article.) Armes. Sept Gravures.--Bulletin bibliographique.--Mademoiselle Taglioni. Le Pas de l'Ombre.--Modes. Une Gravure.--Rébus.
Geoffroy-Saint-Hilaire.
Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire vient d'être enlevé à la science et à ses
amis. Il était ne à Étampes, le 15 avril 1772. Sa famille le destinait à
l'état ecclésiastique. Jeune encore, il vint à Paris pour y faire ses
études; mais au collège de Navarre, où il fut placé, Brisson professait
la physique. Le contraste des méthodes rigoureuses d'une science réelle
avec l'échafaudage sans fondement des hypothèses théologiques, frappa
vivement son esprit. Au sortir du collège, il se voua donc tout entier à
l'étude de la nature. Daubenton et Hany tournèrent ses idées vers la
minéralogie. Incarcéré à la suite des événements du mois d'août 1792,
Hany fut bientôt relâché sur la demande de l'Académie, et aussi grâce
aux démarches actives de son jeune élève. A son tour, le maître servit
le disciple, qui devint démonstrateur au cabinet d'histoire naturelle.
On était en 1793. La convention nationale organisait à la fois la
victoire au dehors et l'administration au dedans. Le jardin du Roi fut
transformé en Muséum d'Histoire naturelle, avec un enseignement complet
comprenant l'ensemble des sciences naturelles, A cette époque les
savants étaient rares; les hommes d'intelligence et d'énergie avaient
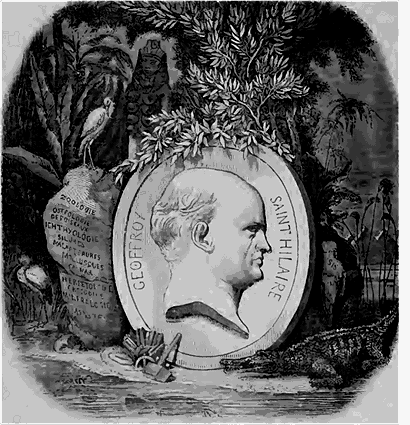
pris le parti des armes; mais la convention, qui voyait les grands
généraux sortir des rangs de l'armée, savait qu'il y a aussi des
naturalistes et des professeurs parmi les soldats de la science.
Daubenton, Desfontaines, Dolomieu, Rourcroy, Hany, Jussien, Lacépède,
Lamark, Latreille, Chouin, Vauquelin, furent appelés à enseigner les
sciences dont ils s'étaient occupés. La chaire de l'histoire naturelle
des animaux vertébrés restait seule vacante. La convention décida
qu'elle serait occupé par Geoffroy. Encouragé par Lakanal et Daubenton,
le jeune minéralogiste accepta, et on sait comme il a justifié depuis le
choix dont il fut honoré à cette époque. En peu de temps il se mit à la
hauteur de sa mission: non-seulement il étudiait et travaillait sans
cesse, mais encore il saisissait avidement toutes les occasions de
servir la science à laquelle il s'était dévoué. En voici la preuve. Il
connaissait l'agronome Tessier, son compatriote, celui-ci, réfugié en
Normandie, lui parle d'un travail sur l'anatomie des mollusques, fait
par le précepteur des enfants du comte d'Héricy. Geoffroy écrit au jeune
instituteur, qui lui répond: «Ces manuscrits, dont vous me demandez la
communication, ne sont qu'à mon usage, et ne comprennent sans doute que
des choses déjà ailleurs et mieux établies par les naturalistes de la
capitale; car ils sont faits sans le secours des livres et des
collections.» Geoffroy insiste, et reçoit le manuscrit accompagné
d'admirables dessins. A chaque pas il y découvre des faits nouveaux les
vues ingénieuses, le germe enfin d'une classification nouvelle. «Venez,
écrit-il au jeune précepteur, venez à Paris jouer parmi nous le rôle
d'un autre Linné, d'un législateur de l'histoire naturelle.» Que faut-il
le plus admirer dans ces lettres, la modestie de l'homme qui fut Cuvier,
ou l'empressement de Geoffroy à ouvrir la carrière à un naturaliste dont
il prophétisait la grandeur future? O noble simplicité de ces temps
d'enthousiasme et d'abnégation, combien vous êtes loin de nous!
Aujourd'hui, le savant lui-même est un calculateur ombrageux qui suppute
longtemps d'avance toutes les chances d'une rivalité probable!
Pendant deux ans, Cuvier et Geoffroy travaillèrent ensemble. Tout était commun entre eux, et l'heureuse alliance de l'imagination de l'un avec l'esprit lumineux de l'autre a jeté les fondements de la science zoologique actuelle, qui réunit la puissance de généralisation du génie allemand à la vigueur et à la clarté de l'intelligence française.
La campagne d'Égypte vint séparer les deux amis. Geoffroy partit avec Bonaparte, prit part à toute la campagne et à tous les travaux de l'Institut d'Égypte. C'est alors qu'il fit ses premières observations sur l'organisation si curieuse des crocodiles. Pendant que l'on canonnait Alexandrie, il étudiait l'anatomie du silure électrique, et utilisait au profit de ses découvertes, l'exaltation que produit le bruit du canon et l'agitation incessante des esprits au sein d'une ville assiégée, dont la reddition ne pouvait être que différée. Toutes les richesses scientifiques amassées par la commission d'Égypte allaient tomber entre les mains des Anglais, qui regardaient les collections et les manuscrits de nos savants comme un des trophées de leur conquête. Geoffroy, Savigny et Delille sont députés vers le général anglais, et lui déclarent que s'il persiste à vouloir les dépouiller des fruits de quatre ans de veilles et de travaux, ils les détruiront de leurs propres mains, et signaleront à l'Europe cet acte d'injustice et de barbarie. Leur fermeté imposa au chef de l'armée ennemie, qui s'abstint d'un acte de violence sans profit et partant sans but.
En 1808, Geoffroy était à Lisbonne, envoyé par Napoléon pour organiser l'instruction publique en Portugal. Dans ce voyage il n'avait pas oublié les intérêts du Muséum d'histoire naturelle. Chargé de nombreux échantillons, pris parmi les doubles de nos collections, il fit de nombreux échanges avec le musée d'Ajuda; mais au moment de quitter le Portugal un traité d'évacuation vint de nouveau le mettre en présenté des Anglais. Lord Proby et le général Beresford demandaient que les collections leur fussent livrées; Junot ne résistait que faiblement, mais Geoffroy ne faisait pas si bon marché de sa paisible conquête. Les conservateurs du musée d'Ajuda déclarèrent que ces collections étaient sa propriété particulière, et les Anglais insistant pour qu'on leur donnât au moins quatre caisses, Geoffroy leur abandonna ses effets et emporta sa collection. En 1815, M. de Richelieu s'empressa d'offrir au Portugal de lui restituer ces richesses; mais le ministre portugais répondit loyalement qu'il ne réclamait rien, car il n'y avait eu que des échanges sur le pied de la plus parfaite égalité.
Pendant les cent jours, Geoffroy fut le représentant de la ville d'Étampes, mais il renonça bientôt à ses fonctions politiques pour retourner à la science. Depuis cette époque, il s'est livré sans interruption à ses études favorites et a développé peu à peu les idées philosophiques sur l'organisation animale, qui feront sa gloire aux yeux de la postérité. Essayons d'en tracer l'esquisse sans être ennuyeux ou incompris.
Lorsque Linné parut, l'histoire naturelle n'était qu'un chaos; on décrivait, on enregistrait les animaux, mais ou ne les classait pas. Linné porta la lumière au milieu de ces ténèbres; il apprit à nommer, classer et caractériser les espèces: il fit voir comment l'homme devait dresser l'inventaire des richesses de la nature; distinguant et séparant sans cesse, il dut insister plus sur les dissemblances que sur les rapports. Tous les naturalistes subirent l'ascendant du grand homme et marchèrent dans la route qu'il avait tracée. Cependant quelques esprits synthétiques furent frappés des analogies qui existent entre les œuvres si variées de la nature. Ils reconnurent que tous les mammifères, par exemple, étaient construits sur le même plan. Geoffroy, qui s'était spécialement occupé de cette classe d'animaux, s'assura que ces analogies ne s'arrêtaient pas à une ressemblance générale, mais qu'on pouvait la poursuivre jusque dans ses moindres détails. Il reconnut que la main de l'homme et du singe, l'aile de la chauve-souris, la patte du chien, la griffe du chat, le pied fourchu du bœuf et du mouton, le sabot du cheval, la rame du phoque et la nageoire de la baleine se composent des même pièces. Mais les unes sont plus développées, les autres le sont moins, quelques-unes disparaissent presque en entier, tandis que d'autres grossissent démesurément.
Guidé par le sens de l'analogie, il prouva que la tête se compose toujours des mêmes os dans l'homme comme dans l'oiseau et le poisson. Il vit, en un mot, que la nature, fidèle au plan qu'elle s'est tracé, le varie, le modifie, mais ne le change jamais. Il en conclut que la création est soumise à des lois, à des nécessités qu'elle ne saurait enfreindre, et qu'elle n'est point l'acte arbitraire d'une volonté sans règles et sans bornes. La justesse de cette conclusion, il la vérifia dans ses moindres détails; ainsi les dents existent dans toute la classe des mammifères, tout à coup elles manquent dans celle des oiseaux, qui la suit immédiatement; n'était une infraction à la loi de l'unité d'organisation des animaux; mais cette infraction n'est qu'apparente. Geoffroy prouva que les dents existent chez les oiseaux dans le jeune âge, mais elles sont à peine formées et disparaissent bientôt arrêtées dans leur croissance par le développement des mâchoires qui constituent le bec. Ainsi donc le proverbe avait menti, et les poules ont des dents, mais elles ne les conservent pas.
Les animaux n'étant plus des créations séparées, mais seulement la transformation d'un seul type, la permanence des espèces devenait fort douteuse; en effet, les agents extérieurs, en modifiant un animal, ne peuvent-ils pas, avec l'aide du temps, le transformer au point qu'il ne ressemble plus à son type originel? Voyez les variétés de chiens, de chevaux, de moutons; pourquoi la nature serait-elle moins puissante que l'homme? Les preuves abondent, mais l'espace nous manque. Je n'en citerai qu'une seule. A mesure qu'on s'avance vers le Nord, la martre commune se modifie graduellement, et le prix de la fourrure s'accroît dans le même rapport. Enfin, en Sibérie, on trouve la martre zibeline, et le naturaliste suit toutes les transitions entre l'animal de France et celui de la Sibérie, qui, au premier abord, semble une espèce complètement distincte.
Les idées de Geoffroy sur l'unité organique renfermaient implicitement une autre vérité. Les appareils si variés dont se compose l'organisme humain, par exemple, ne seraient-ils point un seul et même organe diversement modifié? Tout le monde n'est-il pas frappé de l'analogie qui existe entre les membres supérieurs et les membres inférieurs? Cette analogie ne se borne pas là. Les os du bassin sont la répétition de ceux de l'épaule; ceux de la tête ne sont que des vertèbres modifiées, et le sternum n'est qu'une ébauche de la colonne épinière. Cette grande idée fermentait à la même époque chez plusieurs philosophes: Goethe l'avait conçue en 1791, Oken en 1807, Duméril en 1808, de Blainville en 1816 et Geoffroy en 1824; mais Goethe n'avait point publié sa pensée qui n'était qu'un aperçu, et ce sont les anatomistes que nous venons de citer qui l'ont élevée au rang de vérité.
La conséquence directe de toutes ces idées, c'est la mine de la doctrine des causes finales, à laquelle Bernardin de Saint-Pierre avait prêté tout le charme de son style et de son imagination. En effet, si la nature est astreinte, dans ses créations, à des règles déterminées dont elle ne s'écarte jamais même dans les animaux les plus bizarres en apparence, il en résulte qu'elle ne crée pas uniquement les organes pour qu'ils accomplissent certaines fonctions. De là l'existence des organes inutiles, véritables pierres d'attente, qui prouvent l'unité du plan de l'architecte même dans les parties de son travail qui sont inachevées. Ainsi, tel muscle très-peu développé chez l'homme, où il n'est d'aucun usage, remplit chez les animaux d'importantes fonctions; tels sont, par exemple, le muscle peaucier, à l'aide duquel les chevaux peuvent imprimer à leur peau des secousses brusques et répétées; et le plantaire grêle, agent principal du saut chez le lion, le tigre et le chat. Aussi le sage, pénétré de l'insuffisance de ses lumières, s'abstient-il de juger les œuvres de la création. Quand on accuse d'impiété les esprits difficiles qui les critiquent, il s'étonne en souriant de l'assurance de ceux qui, louant sans comprendre, substituent leurs courtes vues aux grands desseins de la nature. A mesure que la science marche, elle renverse leur petit échafaudage de causes filiales qu'ils recommencent incessamment sur de nouveaux frais. Et cependant la fourmi, perdue dans les fentes de l'escalier d'un palais immense et voulant raisonner sur la destination des diverses parties de l'édifice, n'est qu'une bien faible image de la petitesse et de l'insuffisance de l'homme qui prétend connaître les intentions de la nature dans l'ensemble de l'univers.
Après avoir trouvé l'organisme soumis à des lois invariables dans tous les êtres normaux, Geoffroy devait naturellement se demander si elle les viole complètement quand elle engendre des monstres. Déjà Montaigne avait dit: «Les monstres ne le sont pas à Dieu, qui voit dans l'immensité de son ouvrage l'infinité des formes qu'il y a comprises.» Geoffroy prouve que le sceptique disait vrai, et que les monstres étaient soumis aux mêmes lois que les êtres réguliers. Son fils a, depuis, confirmé, éclairci et développé ses idées dans son ouvrage sur la tératologie. C'est dans ce livre et dans les travaux de M. Serres qu'il faut chercher les principes qui ont guidé Geoffroy et les preuves sur lesquelles il s'appuyait, car lui-même ne les a que sommairement indiqués dans des mémoires et des fragments isolés et sans connexion apparente, mais dont le savant, auquel ces hautes questions sont familières, reconnaît aisément la filiation.
Les idées de Geoffroy ne pouvaient avoir l'approbation de Cuvier. Esprit lumineux et analytique, génie classificateur, amoureux des faits, curieux des détails et hostile aux généralisations hardies, il souleva une discussion au sein de l'Académie des Sciences en mars 1830. Dans cette lutte, tout l'avantage était de son côté; n'énonçant que des faits matériels, n'en tirant que les conclusions les plus directes, habitué aux émotions de la tribune, s'exerçant tous les jours à la dialectique au sein du conseil d'État, sa victoire parut complète à tous ceux qui ne s'étaient point occupés de ces grands problèmes. Un grand nombre de naturalistes en jugèrent autrement, et lorsque Geoffroy se retirait de la lutte, satisfait d'avoir allumé le flambeau de la discussion, Goethe prit la plume pour la dernière fois de sa vie, jugea le combat et les combattants, et s'associa hautement, avec l'Allemagne scientifique, à la défaite apparente de Geoffroy-Saint-Hilaire. Il fit voir que si Cuvier était le glorieux continuateur de Daubenton, Geoffroy était le digne successeur de Buffon, et que chacun d'eux travaillait suivant ses facultés et avec un égal succès aux progrès des sciences naturelles.
L'approbation admirative de l'homme qui fut aussi grand naturaliste que grand poète, causa une vive joie à Geoffroy-Saint-Hilaire, dont l'esprit, dégagé des préjugés de l'école, embrassait dans une même estime toutes les manifestations du génie. Quelques années plus tard, la traduction des œuvres d'histoire naturelle de Goethe permit au public français d'apprécier la hauteur de l'intelligence qu'il avait acceptée pour juge. Geoffroy fut heureux de voir que peu à peu les esprits venaient à lui et que l'histoire naturelle ne se bornerait pas à cataloguer les êtres vivants sans chercher à pénétrer le mystère de leur organisation et à interpréter la signification de ces organes.
Le noble vieillard avait donc rempli sa tâche; athlète éprouvé, il pouvait déposer le ceste après des efforts continués sans relâche pendant quarante ans. C'est alors qu'il se retira dans le sein de sa famille. Entouré des soins les plus tendres par sa femme et sa fille, dont l'admirable dévouement n'a pas failli un seul instant pendant une maladie de sept années, il s'est endormi paisiblement dans la conscience d'avoir bien fait. Plus heureux que Cuvier, il laisse un fils, héritier de ses desseins et de ses pensées. Père digne d'envie, il a pu le voir marcher d'un pas égal au sien dans la voie qu'il avait ouverte, et se dire comme de Candolle, qui fut aussi un naturaliste philosophe: «Je meurs tranquille, mon fils achèvera mon ouvrage.»
Ch. M.
Histoire de la Semaine.
La semaine dernière, nous éprouvions quelque embarras, nous cherchions des artifices de langage pour dire qu'à cinq jours de distance la Chambre nous semblait avoir émis deux votes contradictoires, celui par lequel elle avait voulu qu'une compagnie financière exécutât le chemin de Bordeaux, et celui qui était venu décapiter les conseils d'administration des compagnies financières. Nous croyons, ajoutions-nous, que le désaccord de ces résolutions aura pour conséquence de faire revenir immédiatement la Chambre au mode d'exécution complète par l'État. Nous sommes non moins embarrassé aujourd'hui pour dire que notre prévision s'était réalisée, mais qu'une contradiction nouvelle est venue immédiatement exposer la dignité de la Chambre aux mêmes accusations, et mettre le lundi à néant la détermination prise le samedi par nos législateurs.
Oui, le jour où a paru notre dernier bulletin, l'adoption d'un amendement de M. Gauthier de Rumilly avait donné raison à nos prédictions. Il avait été décidé que les fonds nécessaires, non seulement à l'exécution des travaux d'art et de terrassements, mais même à la pose des rails sur le chemin de Paris à Lyon, seraient mis à la disposition du ministre. Celui-ci ne pouvait être surpris par cet amendement, si c'était sérieusement qu'il avait écrit dans son propre projet que, dans le cas où, dans les deux mois, il ne tomberait pas d'accord avec une compagnie, il était autorisé à poursuivre et à exécuter lui-même pour le compte de l'État. A coup sur M. Dumon ne pouvait avoir inséré cet article sans avoir pris les mesures financières que nécessitait l'éventualité de son adoption. C'est cependant en faisant valoir que la Chambre le prenait au dépourvu et que son collègue des finances n'était pas plus prêt que lui, c'est par cette double confession que M. Dumon a cherché à agir sur la Chambre. Mais M. le ministre de l'intérieur a pensé qu'il fallait, pour obtenir une rétractation, une pesée plus forte et une déclaration plus menaçante. La question de cabinet s'est trouvée posée, et la Chambre, qui se complaît à égorgeter le ministère, comme fait Agnelet de ses moutons, mais qui ne se pardonnerait pas de le tuer brusquement, la Chambre a déclaré lundi quelle ne résoudrait que l'an prochain ce qu'elle semblait à tout le monde avoir résolu la surveille; c'est-à-dire qu'après avoir décrété le crédit, elle a sursis à l'ouvrir. En vain plusieurs membres de l'assemblée, qui avaient été opposés à l'amendement de M. Gauthier de Rumilly, mais qui ont à cœur la dignité de la Chambre, lui ont-ils fait observer qu'elle la compromettait à ce jeu, par ces ménagements, ces complaisances et ces retours; la majorité n'a pas voulu se montrer ferme jusqu'à ce que mort de ministère s'ensuivit: elle s'est déjugée.
Ainsi venait de faire, nous le disions il y a huit jours, la chambre des communes. L'exemple était cependant peu encourageant, car les plus rudes plaisanteries, les plus sanglants outrages étaient prodigués à l'assemblée anglaise à l'occasion de ses variations. Dans la séance du 19, dans la discussion d'un bill sur les assemblées des conseils de fabriques et communaux qui se tiennent dans les temples et donnent souvent lieu à des scènes peu en harmonie avec la sainteté du lieu, comme on demandait que des mesures fussent prises pour épargner ces profanations, M. Wakley a répondu: «Quelle niaiserie d'imaginer que des scènes scandaleuses profanent des murailles! Si cela était, dans quel état serait cette Chambre où nous nous rassemblons? Si ce qui se passe entre quatre murs pouvait les souiller, mais, en vérité, nous serions tous ici en danger de mort, car il n'y a pas de lieu où il se passe des scènes plus honteuses, plus hypocrites et plus immorales.» Le lendemain, 20, la scène a été encore plus vive, ou plutôt plus burlesque. La Chambre a voté définitivement le bill des droits sur le sucre. Les lois de finance portent toujours, pour préambule: «Nous, les fidèles communes de Votre Majesté, avons librement et volontairement voté ces droits, etc.» M. Duncombe a proposé de retrancher ces mots, par la raison que la majorité n'avait pas voté librement et qu'elle n'avait obéi qu'aux menaces du premier ministre: «Je suis loin, a-t-il dit, de blâmer sir Robert Peel de la manière dont il a traité ses partisans; ils n'ont eu absolument que ce qu'ils méritaient. Il y a deux mois, ils ont si bien reçu les coups de pied, qu'ils peuvent bien en recevoir encore un peu plus, et on fait bien de leur en donner. (Rires.) Je dois dire que jamais je n'ai vu une meute d'épagneuls si bien dressés et si soumis à leur maître. (Nouveaux rires.) Que voulez-vous donc qu'on pense de vous au dehors? Je vous déclare qu'il n'y a jamais eu en Angleterre une chambre des communes plus profondément détestée et méprisée que celle-ci. Je voudrais bien savoir pourquoi elle se laisse ainsi traîner dans la boue par les ministres... Je dis que le préambule qu'on veut mettre au bill est un mensonge, un mensonge positif, et je prie sir Robert Peel de ne pas ajouter encore l'insulte à la dégradation qu'il a infligée à cette Chambre.» Un autre représentant a cru devoir ajouter encore à l'humiliation que M. Duncombe avait voulu infliger aux membres de la majorité: «Je ne puis les comparer qu'à des chiens savants qui, au milieu de leurs évolutions, ne dansent pas toujours en mesure ou ne font pas les figures correctement. Mais le très-honorable gentleman n'a eu qu'à montrer le petit fouet qu'il porte dans sa poche pour les faire tourner au commandement sur leurs jambes de derrière.» La majorité a péniblement cherché à se débattre sous ces coups qui irritaient son orgueil. Le colonel Sibthorp a mis fin à ce débat fort peu parlementaire en disant «qu'il aimait mieux être un épagneul qu'un roquet mal élevé.» C'est une affaire de goût, mais il serait certainement de celui des représentés que leurs représentants s'arrangeassent pour pouvoir être comparés à autre chose qu'à telle ou telle espèce de race canine. Bien entendu que notre réflexion est uniquement relative à l'Angleterre.
Pour revenir à notre Chambre, dont nous nous trouvions à coup sûr bien éloigné, après le chemin de Lyon, elle a voté ou plutôt classé les chemins de Tours à Nantes et de Paris à Rennes; nous disons classé, car il n'y avait pas de compagnie à saisir, pas de cahier de charges par conséquent à discuter; il n'y avait qu'à voter des crédits si insignifiants que, d'ici à longtemps, pour le chemin de Rennes surtout, ils n'auront fait face aux terrassements et travaux d'art. La question de la pose des rails a donc pu, en cette occasion, être ajournée sans inconvénient. Il en est tout autrement pour le chemin du Nord, où cette opération est pour ainsi dire la seule qui reste à terminer. Le ministère l'a senti, aussi a-t-il demandé à la Chambre, voyant ses dispositions, de l'autoriser provisoirement à poser les rails, et même à exploiter là où les travaux seront terminés, sauf, à la session prochaine, à adopter définitivement, pour le chemin du Nord, le parti qu'on croira devoir prendre pour le chemin de Lyon, ces deux lignes devant être régies par le même mode.
La commission pour l'examen du projet de loi d'enseignement secondaire, avant d'avoir terminé sa délibération, a voulu désigner son rapporteur. Comme nous l'avions prévu, la majorité s'est prononcée en faveur de M. Thiers. M. Odilon Barrot, sur lequel se portaient les suffrages des partisans du droit commun, frappe sans doute de l'imprudence et du danger de nombreuses et récentes démarchés, a été le premier à voter pour le collègue auquel on l'opposait. Plusieurs membres de la commission, dont l'opinion favorable à l'enseignement de l'État s'est déjà produite, ont reçu des manifestations de reconnaissance de la part d'un nombre considérable de membres de l'université. M. Thiers, sans doute, avait droit à ces hommages, mais il était de toute justice que M. Cousin, qui, dans une autre enceinte, avait montré pour cette cause tant de dévouement, et avait mis à son service tant de talent, ne fût pas oublié dans ces témoignages sympathiques. La Sorbonne a vu se succéder les mêmes visiteurs que l'hôtel de la place Saint-Georges.
Nous avions eu l'occasion de dire que nous ne comprenions pas bien la distinction à établir entre la guerre de fait et la guerre de droit; ce qui se passe sur la frontière de l'Algérie et du Maroc doit nous aider à sortir d'embarras. La guerre de fait, telle que l'y voyons pratiquer, consiste à se laisser attaquer traîtreusement pendant des conférences, qui ne sont que des guets-apens, à ne pas riposter, comme a le soin de l'établir le dernier bulletin, à demander des satisfactions, mais à publier par avance qu'en aucun cas, c'est-à-dire alors même qu'elles nous seraient refusées, nous n'en tirerions prétexte pour nous faire justice nous-mêmes, et nous indemniser en prenant possession de quelqu'un des ports du Maroc. Ces assurances doivent donner confiance et servir d'encouragement à l'empereur. Elles ont également tranquillisé la Grande-Bretagne. D'abord le Times avait qualifié de dévastatrice la mission de M. le prince de Joinville, et il avait ajouté que «l'Angleterre était tenue, par ses anciennes relations d'amitié avec le Maroc, aussi bien que par ses intérêts commerciaux, de veiller à ce qu'aucune autorité étrangère ne s'établit sur la côte Nord-ouest de la Barbarie;» ce qui donnait fort clairement à entendre que, si la France cherchait une satisfaction légitime, l'Angleterre était disposée à se mettre de la partie et contre elle; mais, depuis les protestations de désintéressement complet et d'entière abnégation, publiées par le Journal des Débats, et attribuées par le Times à M. Guizot lui-même, la France n'est plus soupçonnée, et nous pourrons aller parader sur les côtes, ou faire une pointe intérieurement si nous y trouvons plaisir, et pourvu que nous ne fissions que toucher barre. La restauration, pour un coup d'éventail, pouvait s'emparer de toute l'Algérie; mais il nous serait interdit aujourd'hui, pour les agressions les plus sanglantes, d'écorner les États de l'empereur du Maroc. En vérité, une concession semblable témoignerait surabondamment de l'amour de notre cabinet pour la paix; après le rappel de l'amiral Dupetit-Thouars, cette preuve nouvelle est à coup sûr inutile aux yeux de l'Angleterre, et elle pourrait, chez nous, combler le mesure de la résignation nationale.--On comprend que de déclarations le la nature de celles que nous signalons ici sont un encouragement à qui veut nous attaquer. Ainsi annonce-t-on que les Tunisiens, de leur côté, et à l'autre extrémité de nos possessions, ont attaqué le camp des Chauffeurs, situé à une lieue de la Calle, et qu'ils ont tué quatre hommes et blessé le capitaine Brillant, des chasseurs d'Afrique.--A toutes les escadres que nous avons déjà énumérées à destination des côtes du Maroc, nous devons ajouter aujourd'hui une escadre hollandaise, sous le commandement du prince Henri.
Les nouvelles reçues de Montevideo sont encore plus déplorables que elles qui les avaient précédées. Le contre-amiral Lainé et le consul, M. Pichon, ont signifié le 10 avril au gouvernement oriental qu'il eût à contraindre les Français qui se trouvaient dans les murs de la ville à mettre bas les armes, et cela en vertu d'ordres qui venaient d'arriver de France; ajoutant que si dans l'espace de quarante-huit heures tous les Français n'avaient pas été amenés à se soumettre à ces ordres, les relations existant entre la France et le gouvernement oriental seraient rompues et qu'ils agiraient en conséquence. La légion française en masse a déposé ses armes, son drapeau, ses couleurs; mais, en masse aussi, plutôt que de laisser la ville qui lui avait donné l'hospitalité livrée aux fureurs de Rosas, elle a accepté la dénationalisation de M. Pichon, et elle a pris des armes et arboré les couleurs montévidéennes. Il paraît que l'envoi des ordres en vertu desquels MM. Lainé et Bichon ont agi et menacé en cette circonstance remonte au vole de l'adresse. Ils se trouvent en complet désaccord avec le résultat de la discussion dernière. M. Thiers a cru devoir le rappeler à M. le ministre des affaires étrangères dans un couloir de la Chambre, en présence d'un certain nombre de députés. M. Guizot a donné l'assurance que l'escadre française ne viendrait pas en aide à Rosas contre nos compatriotes. Dieu soit loué!
Le comte de Grey a donné sa démission de lord lieutenant d'Irlande. A en juger par l'embarras que sir Robert Peel interpellé à ce sujet dans la chambre des communes, a éprouvé à reconnaître que la résignation de ces fonctions était un acte consommé, le cabinet regarde comme une complication des difficultés de l'Irlande le choix qu'il est appelé à faire en ce moment, choix d'autant plus grave que les ministres ne sont pas d'accord sur la marche à suivre dans le royaume du rappel, et que tel choix qui pourrait agréer aux uns serait une cause de retraite pour les autres. En attendant, les démarches, les adresses, les meetings, les manifestations de toutes sortes en faveur d'O'Connell se renouvellent à chaque jour en Angleterre. Birmingham a vu dans ses murs une assemblée immense adopter les résolutions les plus sympathiques à la cause de l'illustre prisonnier de Dublin.--Une députation de la municipalité de cette ville est venue présenter à la reine une adresse dans le même esprit. La réception s'est faite avec une grande solennité. La reine était sur son trône, ayant nécessairement le prince Albert auprès d'elle et ses ministres à ses côtés. Sa réponse a été fort sèche; elle s'est bornée à dire que si la loi avait été mal appliquée, le recours était ouvert pour la révision de la sentence. Après quoi elle a donné sa main à baiser aux membres de la députation, et les a congédiés.
On parle beaucoup plus à Londres qu'à Madrid et à Barcelone du mariage de la jeune reine Isabelle. Les puissances du Nord voudraient la marier par un arrangement à cinq; l'Angleterre préférerait la marier toute seule, et reconstituer à cette occasion un parti anglais dans la Péninsule, pour remplacer l'appui que la chute d'Espartero lui a fait perdre. Quant à la France, à laquelle on n'avait jamais jusqu'ici! contesté le droit d'aider particulièrement l'Espagne de ses conseils, elle paraît destituée du rôle de négociatrice d'hyménée.
La Belgique, ayant besoin de recourir à un emprunt de 81 millions pour se libérer envers la Hollande, a eu le bon esprit de ne pas s'adresser à l'intermédiaire des banquiers. Des registres de souscriptions individuelles ont été ouverts, et les souscriptions ont été bientôt si nombreuses, que la cotisation offerte par chacun devra être réduite C'est un bon exemple à suivre pour l'émission des rentes dont le ministre des finances a encore à disposer.--La Hollande, de son côté, vient de convertir une partie de sa dette publique cinq pour cent.
La pacification de l'Albanie est complète, d'après les avi» officiels transmis par Rachid-Pacha, le général en chef de l'armée turque. Les nouvelles reçues à Constantinople à la date du 5 juin annonce que les rebelles ont fait leur soumission. Omer-Bacha est entré à Uskup, et les principaux chefs de l'insurrection ont imploré une amnistie qui leur a été accordée, mais sous la condition, toutefois, qu'ils seraient envoyés à Contantinople, où quatre-vingt quatorze d'entre eux étaient déjà arrivés le 1 juin, à bord du paquebot de Salonique. Cinq cents familles chrétiennes, qui avaient abandonné leurs foyers pour se soustraire aux atrocités des Albanais, sont rentrées paisiblement dans leur pays, et on assure même que le divan a l'intention de réparer en partie les dommages que les populations ont éprouvés. Rifaat-Pacha, qui est l'homme le plus avancé du ministère, comprend que ce serait là un puissant moyen de calmer l'opinion publique de l'Europe, qui s'est vivement émue au récit des atrocités commises par les Albanais contre les populations chrétiennes. Mais le ministre des finances et quelques autres de ses collègues s'inquiètent fort peu de ce que l'Europe pense d'eux, et contrarieront, s'ils le peuvent, les projets du maréchal du palais. Cependant les résultats obtenus en Albanie, et dont il ne manquera pas de s'attribuer l'honneur, donneront crédit à ses conseils. On croyait qu'il allait porter toute son attention sur les affaires de Syrie. La flotte ottomane, après avoir manœuvré sons les ordres du sultan, devait être dirigée vers ces parages.
La réduction excessive du salaire dans plusieurs provinces manufacturières de la Prusse a seule causé les soulèvements que nous avons annoncés. La Gazette de Dusseldorf assure que les autorités insisteront pour l'introduction d'un salaire fixe et suffisant, afin que les mêmes abus ne se renouvellent pas et ne ramènent pas les mêmes déchirements. Nous lisons encore dans la Gazette d'Augsbourg, du 19 juin, les nouvelles suivantes: «On nous écrit d'Ingolstadt qu'il y a eu dans cette ville des désordres qui ressemblent à ceux qui ont eu lieu naguère à Munich. Les brasseurs, bouchers et boulangers ont été assaillis par un grand nombre d'ouvriers, surtout par ceux qui travaillent à la forteresse. Ceux-ci étaient au nombre de quatre ou cinq mille. Les détails de l'affaire ne sont pas encore connus. Cependant la tranquillité est, dit-on, rétablie. La cause du désordre aurait été l'arrestation d'un ouvrier par un agent de police; cet ouvrier ayant résisté, l'agent aurait tiré son sabre et tué le malheureux ouvrier, ce qui aurait fait éclater l'émeute.»
Le duc de Nassau vient de prendre des mesures pour arrêter l'ivrognerie, qui fait de rapides progrès dans ses États.
Il est défendu, sous peine d'une amende de 130 fr., à tout cabaretier de vendre plus de deux petits verres d'eau-de-vie, dans la même journée, à la même personne, pour être consommés sur place. Tous ceux qui seront rencontrés en état d'ivresse seront mis à l'amende ou en prison, et leurs noms publiés à son de trompe. Il sera défendu de leur vendre ultérieurement des boissons spiritueuses. En France, on se borne à demander des lois contre les fraudeurs qui enivrent le peuple avec des vins frelatés; mais permis à chacun d'abuser des bons. L'ivresse sans mélange est irréprochable aux yeux de notre loi.
A Cluses, en Savoie, un incendie a détruit la ville entière à l'exception de l'église et de six maisons. Tous les habitants se sont enfuis à moitié nus, dans les champs, sans avoir pu rien sauver.--A Brenndorff, en Transylvanie, trois cent soixante-dix maisons ont été également réduites en cendres.
L'autorité judiciaire vient de se livrer à des perquisitions au domicile de M. le prince de Montmorency et de M. le duc d'Escars. Ces mesures ne sont guère de notre temps. Mais l'instruction fera sans doute connaître les motif» graves que la justice a dû avoir pour opérer ces descentes.
L'Académie de» Beaux-Arts a procédé samedi à la nomination du successeur de M. Berton. Les votant étaient au nombre de 31. M. Adolphe Adam, l'auteur du Chalet, du Postillon de Longjumeau et d'une foule d'autres opéras et de ballets, a réuni, au premier tour de scrutin, 17 voix, et a été proclamé membre de l'Institut, sauf l'approbation royale. Il avait pour concurrents M. Raton, qui a obtenu 9 suffrages, et M. Ambroise Thomas, qui en a recueilli 4.
La chambre dm députés vient encore de perdre un de ses membres; M. Mermilhod, élu par un des collèges de l'arrondissement du Havre, et avocat à la cour royale de Paris.--Le poète anglais, Thomas Campbell, auteur des Plaisirs de l'Espérance, est mort à Boulogne, où il était venu se fixer depuis un an, dans l'espoir que le changement d'air rétablirait sa santé. Le gouvernement anglais servait à Campbell une pension de 300 livres sterling.
Prisonniers arabes en France.
ILE SAINTE-MARGUERITE.--FORT BRESCOU.
Les îles de Lérins, appelées aussi les îles Sainte-Marguerite, sont au nombre de deux: celle de Saint-Honorat et celle de Sainte-Marguerite. Ces îles sont situées sur la mer Méditerranée, à l'extrémité sud-est du département du Var, entre le cap Roux et celui de la Guaroupe, vis-à-vis de la côte de Provence.
L'île Saint-Honorat, autrefois nommée Insula plana, Planasia, Lerina (Lérins), possédait, avant la révolution, l'abbaye la plus ancienne des Gaules; elle avait été fondée, vers l'an 408, par saint Honoré, originaire de Toul, d'où l'île a pris le nom de Saint-Honorat. Les restes d'antiquités qu'on y a trouvés font présumer qu'elle avait été habitée du temps des Romains. Elle fut pillée et ravagée plusieurs fois, dans les huitième et neuvième siècles, par les Sarrazins et les pirates africains. Les Espagnols s'en rendirent maîtres en 1635, y ruinèrent tous les jardins et les vignes; mais les Français la reprirent en 1737. Le 13 décembre 1746, une escadre anglaise s'en empara. Elle fut occupée de nouveau par le chevalier de Belle-Isle, le 25 mai 1747. Enfin, en 1815, les Anglais, sans autre but que celui d'insulter des ruines riches en souvenirs historiques, vinrent assez près de terre pour labourer de quelques boulets les flancs de la vieille abbaye, ou plutôt de la tour, seul débris qui sont resté debout, ainsi que quelques pans de murailles appartenant à l'ancienne église.
Située au midi de l'île Sainte-Marguerite, l'île Saint-Honorat n'en est séparée que par un bras de mer d'environ 600 mètres de largeur; sa longueur est de 1,600 mètres, et sa plus grande largeur de 460. Vendue, pendant la révolution, comme bien du clergé, elle fut achetée par mademoiselle Alziari, plus comme sous le nom de mademoiselle Sainval, moyennant 25,000 francs. L'actrice célèbre habita elle-même un des appartements de la tour, qu'elle fit installer d'après les idées modernes; et comme celui-ci a subi, de même que le reste de l'édifice, la loi du temps, les ruines frivoles et profanes du logement d'une femme du monde forment aujourd'hui un contraste étrange avec les ruines imposantes et majestueuses d'un monument religieux. L'île Saint-Honorat est en ce moment la propriété d'un ancien boucher de Cannes, comme nous l'apprend M. Prosper Mérimée, qui a consacré une notice spéciale aux îles de Lérins, dans ses Notes d'un voyage dans le midi de la France.
L'île Sainte-Marguerite, la plus considérable des îles de Lérins, fait partie de l'arrondissement de Grasse. Elle est à quatre kilomètres sud-est de Cannes, à neuf kilomètres sud-ouest d'Antibes, et à deux kilomètres de la terre ferme. Sa position au nord-ouest du golfe Juan lui donne l'avantage de concourir efficacement, par ses batteries, à la défense d'une partie de ce golfe, où, le 1er mars 1815, débarqua l'empereur Napoléon à son retour de file d'Elbe. La partie septentrionale est la plus élevée et la plus accessible; il y a néanmoins plusieurs petites anses par où l'on peut débarquer des troupes, et faire une descente. Cette île est plus grande que celle de Saint-Honorat; elle a environ trois kilomètres de longueur et deux kilomètres de largeur.
Les premières fortifications, suivant toute vraisemblance, furent construites par les religieux de Lérins et leurs tenanciers, pour se procurer un asile contre les pirates et les corsaires. En 1633 et 1634, ces ouvrages furent modifiés et considérablement augmentés par les ordres de Louis XIII. C'est de cette époque que date l'existence du fort Sainte-Marguerite. Sa position, isolée du continent, a souvent déterminé le gouvernement à y envoyer des prisonniers d'État de la plus grande considération.
Le plus célèbre, en effet, des prisonniers d'État détenus, sous la monarchie, au fort de l'île Sainte-Marguerite, fut l'homme au masque de fer.
A l'époque de la révocation de l'édit de Nantes, on renferma à l'île Sainte-Marguerite des ministres protestants. Lagrange-Chancel, après la publication de ses Philippiques, y fut envoyé, par le régent, comme prisonnier d'État. Plus tard on y détint des jeunes gens de famille, contre lesquels leurs parents eux-mêmes, pour raison d'inconduite, avaient obtenu des lettres de cachet. Sous l'empire, quelques personnages distingués y furent exilés, entre autres M. Omer de Talon, en 1803; madame la duchesse d'Escars, vers 1807; M. de Broglie, évêque de Gand, dans le courant du 1819. Sous la restauration, le fort de l'île Sainte Marguerite eut pour hôtes, de 1817 à 1821, deux cents Égyptiens, hommes, femmes et enfants, remis en liberté au bout de deux ans et demi, et dont quelques-uns habitent Marseille, où ils se sont établis et fixé.
Depuis trois années le fort a été rendu à sa destination primitive de prison d'État. En vertu d'un arrêté de M. le ministre de la guerre, du 30 avril 1844, les Arabes appartenant aux tribus insoumises de l'Algérie et saisis en état d'hostilité contre la France, sont dirigés sur l'île Sainte-Marguerite et renfermés dans le château sous la garde et la responsabilité du commandant de la garnison.
La première application de cet arrêté a été faite au cheikh de la partie insoumise de la tribu des Abd-el-Nour, dans la province de Constantine, le nommé Sadik-ben-Mochnach. Ce chef partisan prononcé d'Abd-el-Kader, fomentait incessamment des troubles. Arrêté vers le milieu de mars 1844 débarqué à Toulon le 4 avril, il a été transféré à Sainte-Marguerite le 8 août suivant.
Avec Ben-Mochnach fut écroué le même jour le fameux Ali-ben-Aïssa, Kabyle originaire de la tribu de» Beni-Fergan, qu'Ahmed-Bey avait élevé à la dignité de bach-hambah, et qui, exerçant près de son maître les fonctions de premier ministre ou plutôt de favori, était devenu le plus haut personnage de la province, après le pacha. Au bach-hambah, en effet, était confiée la direction de la monnaie; il était le chef de l'administration de la douane; il avait le commandement des fantassins kabyles qui suivaient le pacha dans les expéditions; il présidait aux arrestations politiques, aux exécutions secrètes, aux confiscations. On sait avec quelle énergie Ben-Aïssa soutint dans Constantine les deux sièges dirigés contre cette ville en 1836 et 1837. Il vint, au mois de mars 1838, à Alger faire sa soumission entre les mains du gouverneur général, qui, au mois d'octobre de la même année, le nomma khalifah du Sahel de Constantine, et réunit sous son administration toutes les tribus kabyles qui habitent les chaînons de l'Atlas compris entre le mont Edough et Djidjeli. Accusé, pendant ce commandement, du crime de fausse monnaie, il fut condamné, le 2 avril 1841, par un conseil de guerre, à vingt ans de travaux forcés, peine qui fut commuée, le 27 mai suivant, en celle de vingt ans de détention. Une décision royale du 18 mars 1812 lui accorda grâce entière, en l'assujettissant à la surveillance.
Bien qu'il eût pu aller sur-le-champ habiter la ville de Verdun, qui lui avait été d'abord assignée pour résidence, Ben-Aïssa aima mieux rester quelques mois de plus à l'île Sainte-Marguerite, jusqu'à l'arrivée de sa famille en France, et il n'en partit que dans les premiers jours d'octobre 1812 pour Montpellier, où il obtint la permission de résider de préférence à Verdun. Arrivé le 14 dans cette ville, il a continué d'y séjourner jusqu'à ce qu'une autorisation ministérielle du 31 décembre 1813 lui eût permis de retourner à Alger, qu'il habite en ce moment.
Au nombre des Arabes importants envoyés à l'île Sainte-Marguerite a figuré aussi le khalifah de Ferdjiouah, Ahmed-ben-el-Hamelaoui, investi de ce commandement par le gouverneur général en même temps que Ben-Aïssa, et qui avait sous sa dépendance immédiate toutes les tribus situées à l'ouest de Constantine, entre le Sahel, le pays de Sétif et le Belad-el-Djerid (pays des dattes). Condamné, le 14 juillet 1841, à vingt années de détention, pour crime de trahison, Ben-Hamelaoui est arrivé, le 28 août suivant, à l'île Sainte-Marguerite, en compagnie de Ben-Azouz, ex-khalifah d'Abd-el-Kader à Msilah. Grâces aux instances de sa femme, la première des femmes arabes de distinction qui soit venue à Paris, Ben-Hamelaoui a été gracié le 26 août 1842; il a successivement eu pour lieu de résidence Nogent-le-Rotrou, Meaux, et, en octobre 1841, Paris, qu'il n'a quitté qu'en juin 1843, après avoir obtenu, le 27 mai, l'autorisation d'aller à Tunis, où il réside. Depuis, Ben-Azouz a été également remis en liberté et renvoyé à Alger.
De nombreux travaux d'appropriation ont été successivement faits au château de l'île Sainte-Marguerite pour y recevoir, en juillet 1841, 40 prisonniers; en novembre 1841, 100; en novembre 1842, 350; en septembre 1843, 530.

Ali-ben-Aïssa.
Un premier tarif du 25 juin 1841 avait divisé les prisonniers arabes en deux classes, accordant, outre les rations en nature, à la première classe une solde journalière de soixante-quinze centimes, et de trente centimes à la seconde. Le dépôt des prisonniers ayant pris, en septembre 1843, un accroissement considérable, la division en deux classes fut jugée insuffisante, et par un tarif du 26 du même mois, les prisonniers ont été divisés en trois classes, la première comprenant les chefs et personnages influents sous les rapports politiques, militaires ou religieux; la deuxième, les individus de moindre importance, les serviteurs composant la maison des prisonniers de première classe, et les enfants de dix à quinze ans; la troisième, les domestiques et les enfants de deux à dix ans.
Le commandement du dépôt est confié à un officier supérieur. Un agent comptable est chargé de la gestion administrative, et la solde est payée aux prisonniers tous les cinq jours avec régularité.
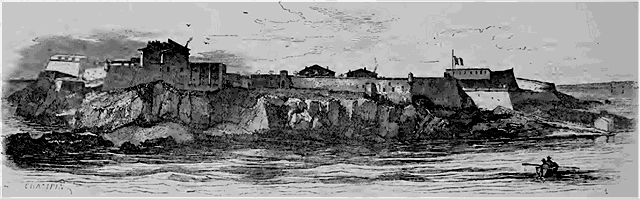
Vue de l'île Sainte-Marguerite.
Une infirmerie a été organisée pour le service des malades, et pourvue de tout le matériel et des médicaments nécessaires, expédiés de l'hôpital militaire du Toulon. Longtemps les malades arabes ont, par préjugé religieux, refusé de se rendre à l'infirmerie; ils préféraient être traités dans leurs chambres. On n'est parvenu à vaincre leur répugnance qu'en décidant deux de leurs compagnons de captivité à remplir auprès d'eux les fonctions d'infirmiers. Ils reçoivent d'ailleurs les soins empressés du docteur Bosio, médecin civil de Cannes, qui s'acquitte de ses devoirs avec zèle et humanité.
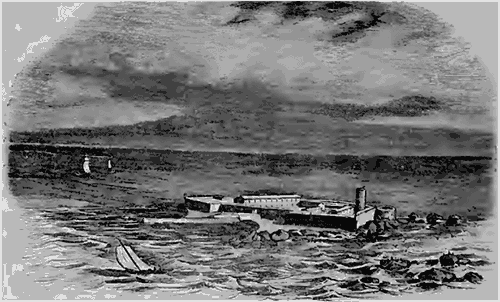
Vue du fort Brescou.
Le nombre croissant des prisonniers, surtout après la prise de la zmala d'Abd-el-Kader, a fait reconnaître la nécessité d'établir entre eux des catégories et de les renfermer dans des prisons séparées. Les prisonniers politiques et les prisonniers de guerre ont paru pouvoir demeurer réunis sans inconvénient; ils ont été laissés à l'île Sainte-Marguerite; Mais ceux qui, après avoir accepté notre domination, ont de nouveau pris les armes contre nous, ou abusé de leur autorité pour commettre des délits, ont dû être éloignés des premiers, et le fort Brescou, près d'Agde, dans le département de l'Hérault, a été affecté à cette nouvelle destination.
Le fort Brescou est situé sur un rocher isolé en mer, à 1,320 mètres en avant du cap d'Agde. Son enceinte a environ 300 mètres de développement: elle est bastionnée à la gorge du côté du nord, où se trouve un petit havre pour les bateaux de communication. La mer baigne les escarpes qui ont 9 à 10 mètres de hauteur. Le rocher sur lequel le fort est construit est à environ 3,000 mètres vers la pleine mer. Lors des guerres de religion qui affligèrent le Languedoc pendant plus de soixante ans, le maréchal de Joyeuse, l'un des plus zélés partisans de la ligue, s'empara, en 1589, du rocher de Brescou, dépendant de la ville d'Agde, et y lit élever un fort d'où il infestait toute la côte du Languedoc. Le due de Montmorency s'étant révolté contre Louis XIII, en embrassant le parti du duc d'Orléans, leva une armée dans le Languedoc, il fit, en 1632, de grandes améliorations au fort Brescou. D'autres furent faites encore en 1757. On y a réparé, en 1817, les dégradations occasionnées par la mer au pied des revêtements, ainsi que la petite jetée de débarquement, puis, en 1820 et 1821, le magasin aux farines et la manutention; car on est obligé de faire du pain dans le fort, lorsque la mer est grosse et empêche la communication avec le continent.
Au mois d'octobre 1843, M. le ministre de la guerre a donné des ordres pour l'installation de prisonniers arabes au fort Brescou. En décembre, les travaux étaient terminés pour recevoir 40 détenus, et en janvier 1844, pour 132, répartis dans quatorze chambres, indépendamment du commandant de la place, de 4 officiers et de 40 sous-officiers et soldats.
Au 1er juin 1844, le château de l'île Sainte-Marguerite renfermait 356 prisonniers arabes, et le fort Brescou, 60.
Des inspections extraordinaires ont lieu à l'île Sainte-Marguerite, par ordre du ministre de la guerre, pour s'assurer que les Arabes y sont traités aussi humainement que possible. Outre les visites du lieutenant général d'Hautpoul, commandant la huitième division militaire, et des généraux placés sous son commandement, les détenus ont reçu entre autres, en avril 1842, celle de M. Roudin, médecin en chef des salles militaires de l'Hôtel-Dieu de Marseille, et, en septembre 1843, celle de M. le docteur Warnier, membre de la commission scientifique d'Algérie, attaché, après le traité de la Tafna à la mission française de Mascara, et auquel un séjour de plus de deux années dans la capitale d'Abd-el-Kader a permis d'étudier à fond les intérêts, l'administration, les mœurs et les habitudes des populations arabes. La présence du docteur Warnier à l'île Sainte-Marguerite a été signalée par de nombreux adoucissements au sort des prisonniers.
Un Voyage au long cours à travers la France et la Navarre.
RÉCIT PHILOSOPHIQUE, SENTIMENTAL ET PITTORESQUE.
(Voir v. III, p. 249 et 263.)
CHAPITRE IV.
M. OTHON ROBINARD DE LA VILLEJOYEUSE.
«Ce diable d'Othon... disaient de lui ses intimes, par manière d'admiration, ce diable d'Othon!...»

Cependant le jeune Oscar avait
porté avec précaution...
M. Othon était le fils aîné et l'héritier présomptif de M. Hector Robinard de la Villejoyeuse, gentilhomme rural de l'Orléanais; mais, quoique le père eût tenu et tînt encore un rang distingué dans sa province, chacun s'accordait néanmoins à trouver que le fils effaçait la gloire paternelle.
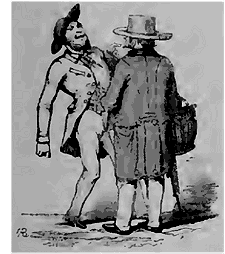
Othon lui mettait le doigt
à l'endroit malade, et se
répandait en éclats de rire
que M. Verdelet trouvait au
moins indécents
Sur les rives de la Haute-Loire, il n'y avait pas un gentilhomme taillé comme l'était le jeune Othon; et, s'il faisait toujours sensation lorsqu'il entrait dans un salon, si puissamment coulé dans ses habits que moule semblait prêt à craquer, les fariniers eux-mêmes et les forts de la rivière s'arrêtaient à le regarder marcher des épaules, et s'extasiaient sur le jeu terrible de ses reins et de sa croupe.
Il portait une veste de nankin serrée à la taille, et dont les basques s'écartaient par derrière comme les deux ailes d'un hanneton qui va prendre sa volée; un pantalon blanc était collé sur ses cuisses et ses jambes, collé sans un pli; collé de telle façon et si juste, qu'on se demandait, non pas comment M. Othon était entré dans son enveloppe, mais comment il pourrait en sortir. Il était coiffé d'un de ces chapeaux gris à larges bords, dits Béarnais, et il le portait si hardiment sur l'oreille que chacun regrettait de ne pas lui voir ajouter un panache à ce fier chapeau; enfin, le col de sa chemise était rabattu; sa cravate bleue, brochée d'or, se nouait négligemment autour du cou, de maniéré à laisser voir l'arête puissante de sa gorge, et les eux bouts en étaient, dans toute leur longueur, tressés d'une façon si serrée qu'ils se tenaient ensemble à un demi pied de la poitrine. La figure du personnage s'accordait au mieux avec son équipement; de gros yeux bleu-faïence à fleur de tête, de fortes couleurs sur les joues, un collier de barbe rousse, plus touffu qu'on puisse imaginer, et sur tout cela un sourire jovial et un contentement magnifique.

Othon mit sans gêne le bras de
la dame sous le sien.
M. Othon chassait comme Nembrod, pêchait comme les apôtres, grimpait aux arbres comme Chactas, buvait comme un fourrier et fumait comme un Turc; mais il n'avait point son pareil pour imiter le cri des animaux, et on l'invitait dans les meilleures maisons pour l'entendre, après un quadrille, contrefaire le chant du coq, l'aboiement du chien, le sifflement du merle, etc., même on citait de lui, à ce sujet, un trait fort amusant. Il avait eu l'idée, au milieu d'un bal, d'embrasser la paume de sa main, de cette façon que les chasseurs emploient pour appeler les geais, et qui ressemble si fort au bruit d'un baiser, que les mamans se retournèrent toutes ensemble avec effroi; elles s'imaginaient apparemment qu'on embrassait mesdemoiselles leurs filles; mais c'était mons. Robinard qui appelait les geais.--Car il ne le cédait à personne pour la bonne plaisanterie, et, quand il avait dit quelque mot piquant, il riait avec de si grands éclats, que personne ne pouvait s'empêcher de trouver sa facétie la plus risible du monde.

Touchez, disait Othon à
M. Verdelet, touchez.
M. Othon faisait lui-même toutes les serrures de sa maison; il s'entendait aussi en menuiserie, confectionnait de ses propres mains ses poires à poudre, et ne souffrait jamais qu'un ouvrier tailleur se mêlât de couper ou de coudre ses habits de plaisance ou de fantaisie.
Enfin, il ne dédaignait point d'entrer quelquefois dans la carrière du bel esprit, et, au dire de ses amis, il excellait à faire des fables!
Lorsque M. Othon eut fini de souffler dans sa trompe, sur le talus où nous l'avons aperçu, les premiers mots qu'il dit furent ceux-ci, qu'il accompagna de son plus beau rire: «Ma foi! je ferai une fable là-dessus.» Cependant le jeune Oscar avait porté avec précaution la jeune dame évanouie sur le bord de la route et s'efforçait de la faire revenir à elle, tandis que l'épais mari se lamentait vis-à-vis de ce douloureux spectacle.
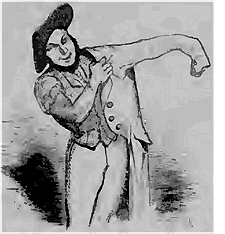
Cet Intermède fini, Othon remit
son habit.
«Ah! mon Dieu! la belle invention que ces maudits chemins de fer... et madame ma femme qui me traitait de pusillanime... pourvu quelle ne soit pas blessée... Ah! mon Dieu! j'ai le nez tout écorché...
--Parbleu! s'écria du haut du talus le beau Robinard, qui avait pris une riche pose sur son éminence et développait les avantages de sa taille aux yeux de la foule qu'il dominait, parbleu, n'est-ce pas ce cher monsieur Verdelet que je vois?»
Et ce disant il se laissait glisser sur la pente du talus avec une agilité surprenante.
«Ce cher monsieur Verdelet!» Et il embrassa le gros homme à l'étouffer. «Comment va madame Verdelet? Tiens, vous avez là une fameuse écorchure!» Il lui mettait le doigt à l'endroit malade, et se répandait en éclats de rire que M. Verdelet trouvait au moins indécents... «Ce cher monsieur Verdelet; ah! je ferai une fable là-dessus, par exemple? Et il recommençait à rire.
«Ma femme est évanouie par là, dit Verdelet en montrant le groupe qui s'était formé autour de la belle évanouie.
--Pas possible!» s'écria Othon; en même temps il fendit la foule, repoussa Oscar et l'abbé Ponceau, qui faisaient respirer des sels à la jeune dame, et se mit à lui taper dans les mains en criant à tue tête: «Madame Verdelet! madame Verdelet.»
Il paraît que la voix de M. Othon avait, en effet, une certaine puissance sur celle qu'il secourait; car tout à coup elle ouvrit les yeux, et apercevant le jeune fablier, elle rougit extrêmement, ce qui donna fort à penser à Oscar.
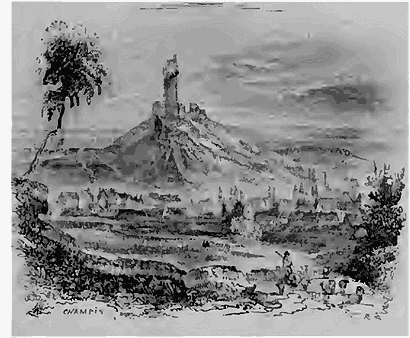
La Tour de Montlhéry.
«Est-ce que par hasard, se dit-il, un pareil bélître?...» Mais il n'acheva point pour le moment l'idée que le diable lui envoyait.
Othon mit, sans gêne, le bras de la dame sous le sien et s'avança, avec elle, vers M. Verdelet, qui était alors occupé à raconter le sinistre du 8 mai au mécanicien même du convoi. Le gros monsieur, apercevant sa femme, s'apprêtait à lui prouver victorieusement qu'il n'était point pusillanime, comme elle le disait, pour avoir eu peur des chemins de fer, lorsque Othon, le regardant fixement, recommença ses rires impertinents. M. Verdelet prenait, l'air fâché et grommelait; sa femme paraissait toute confuse; Oscar, par humanité, s'empressa de venir au secours des deux époux.
«Messieurs, dit-il au mari et à celui qui le molestait, les rails sont rompus, et nous sommes exposés à faire sur la route une station de plusieurs heures. Si madame ne se sentait plus de la commotion qu'elle a éprouvée, nous pourrions employer notre loisir forcé à faire une petite excursion dans la campagne; je crois que la tour de Montlhéry doit être de ce côté...
--La tour de Montlhéry, fit l'abbé Ponceau, qui arrivait clopin dopant; la tour de Montlhéry! serions-nous donc aussi près de cette fameuse ruine?
--Bah! répondit Othon en faisant claquer ses lèvres, une belle chose, sur ma parole; un grenier de hiboux et de rats.
--Vous en parlez à votre aise, monsieur, reprit le bon abbé d'un air entendu; mais savez-vous bien ce que disait, au sujet de cette tour que vous méprisez, le roi Philippe 1er à...
--Que diable me parlez-vous de rois, monsieur l'abbé, je suis républicain, moi!
--Quelle horreur!» s'écria en joignant les mains, M. Verdelet, qui avait entendu parler de 93.
Cependant l'avis d'Oscar prévalut; plusieurs voyageurs se joignirent à la société Verdelet, et l'on se mit en route à travers champs. Mais bientôt la jeune dame, mal remise de son émotion, fut prise d'une nouvelle défaillance, et l'on fit une halte sous de grands arbres qui bordaient un chemin vicinal.
Aussitôt que l'on fut arrêté, sans plus de cérémonie, M. Othon ôta sa veste de nankin, retroussa la manche de sa chemise, et tendant avec force son bras nu, musclé à faire envie à feu Milon le Crotoniate.
«Touchez! disait-il à M. Verdelet, touchez!
--Quoi toucher?
--Mon bras, parbleu! touchez!»
M. Verdelet toucha avec un visible ennui; puis ce fut au tour d'Oscar, de l'abbé Ponceau et des autres voyageurs.--Par bonheur, les dames avaient le dos tourné à cette singulière expérience, étant toutes empressées autour de madame Verdelet.
«Dur comme fer? n'est-ce pas? disait M. Robinard d'un air triomphant, dur comme fer!»
Enfin il rabattit la manche de sa chemise, et M. Verdelet s'apprêtait à aller rejoindre sa femme; mais Othon l'arrêta.
«Attendez, monsieur Verdelet; un moment, je vous prie.»
A ces mots, le jeune musculeux se renversa sur l'herbe, appuyé sur ses deux mains et relevant les genoux avec effort, de façon à ce que sa poitrine présentât une surface convexe. Sa tête pendait à terre, et il s'écriait:
«Montez! montez, monsieur Verdelet!
--Quelle plaisanterie! Où voulez-vous que je monte?
--Vous êtes le plus gros de la société; montez!
--Allons, monsieur, dit Oscar tout doucement au gros mari; montez sans peur; monsieur m'a l'air d'être assez fort pour en supporter de plus lourds que vous.»
M. Verdelet se résigna à monter, en murmurant, sur la poitrine de l'athlète; il y allait avec une extrême précaution.
«N'ayez pas peur! s'écriait Othon; vous pouvez vous promener là-dessus comme sur un trottoir de bitume.»
Et lorsque enfin le gros monsieur fut tout droit en équilibre sur la poitrine tendue:
«Dieu! mon cher Verdelet, dit en riant celui qui le supportait, quel nez écorché vous avez là! Certainement je ferai une fable là-dessus.»
Cet intermède était à peine fini... Mais il est temps de nous arrêter, et nous remettrons la suite de notre récit au chapitre suivant.
CHAPITRE V.
DEUX ALCIDES DE PROFESSION ET UN HERCULE DE BONNE COMPAGNIE.
L'intermède herculéen donné gratis par M. Othon à la société des voyageurs venait donc de finir, et Oscar regardait avec une curiosité croissante ce prodigieux baronnet, dont il s'applaudissait d'avoir fait la rencontre. L'abbé Ponceau donnait, pour sa part, peu d'attention à ce qui se passait autour de lui; le bonhomme était profondément occupé à recueillir ses souvenirs historiques sur la fameuse tour que l'on se proposait de visiter, et il pensait déjà, non sans un petit mouvement secret de vanité, aux grands yeux que ferait la société lorsqu'il leur apprendrait à tous, lui, l'abbé Ponceau, que la tour de Montlhéry, autrefois Montlhéry, avait été fortifiée en 999 par Thibaud, surnommé Fil Étoupe, sans doute à cause de ses cheveux blonds; et bien d'autres détails encore, dont l'exactitude eût été le moindre mérite, à coup sûr.

Les Alcides du Nord.
A ce moment, une longue voiture peinte en rouge et en vert vint à passer sur le chemin. M. Othon poussa un cri de joie;
«Le diable m'emporte! je crois que ce sont les alcides du Nord!»
Aussitôt il courut à la voiture, et annonça par de nouveaux cris qu'il ne s'était pas trompé dans sa conjecture.
C'étaient en effet deux alcides, fort connus dans toutes les foires de la Beauce et de la Brie, et qui même, si je ne trompe, ont l'honneur de travailler dans les Champs-Élysées, aux jours d'enthousiasme impossible à décrire. Les deux athlètes se rendaient en ce moment à Étampes, pour une grande foire qui devait avoir lieu, et ils emportaient avec eux leurs boulets de canon et leurs kilos de la plus grosse espèce, comme dit l'admirable Bilboquet. A titre de rival, ou simplement d'amateur, M. de la Villejoyeuse les connaissait, je ne dirai pas intimement, mais au moins particulièrement; et souvent, dans les foires, on l'avait vu s'entretenir avec eux, avant ou après leurs exercices. Il n'eut donc point de peine à leur persuader de faire une halte sur le chemin, et de déployer leurs talents devant l'honorable société qui campait sous les arbres.
Pendant que les alcides tiraient de la voilure leurs principaux instruments athlétiques, M. Othon s'empressait de faire une collecte dans son vaste chapeau, puis il courait aider les deux athlètes à dresser sur deux piquets une manière de tente, qui leur servait de coulisse. Le spectacle fut bientôt prêt. Les boulets et les kilos étaient déjà entassés sur le chemin, et M. Othon, sans avoir l'air de rien, soulevait ceux-ci de son petit doigt et faisait rouler ceux-là sur son bras tendu; et du coin de l'œil, il regardait la société Verdelet, pour voir si elle ne s'étonnait point de sa grande force musculaire.
«Rangez-vous donc, monsieur Robinard, s'écria le gros Verdelet, qui n'avait mis que deux sous dans le chapeau; rangez-vous donc; vous m'empêchez de voir.»
Les alcides étaient en train de grimper l'un sur l'autre et de former ce qu'on appelle, je crois, la pyramide humaine. Othon se retira de la scène, mais on ne tarda point à avoir de ses nouvelles; car, tandis que tout le monde regardait les exercices qui se faisaient dans le chemin, lui, s'en allant à quelques pas de là, par derrière, saisit à deux mains la grosse branche d'un chêne, et, par la force des poignets, il éleva tout son corps à la position horizontale.

Othon saisit à deux mains la
grosse branche d'un chêne, et
par la force du poignet, il
éleva tout son corps à la
position horizontale.
Par bonheur Oscar ne le perdait point de vue, et aussitôt que le baronnet fût parvenu à cette périlleuse position, il s'écria:
«Messieurs et dames, regardez donc M. Robinard!»
Tous les yeux de l'assemblée se détournèrent vers le chêne, où triomphait le troisième alcide, et chacun s'empressa d'applaudir. Oscar, à cet instant, épia madame Verdelet, et il eut le chagrin de voir que ses yeux brillaient d'une façon singulière, qu'on eût prise pour une admiration mêlée de tendresse, en regardant ce hardi corps d'homme supporté horizontalement par la branche de chêne. «Pauvre femme!» pensa-t-il avec autant de tristesse que de dépit. «Quel oison et quel charretier que ce Robinard!» ajouta-t-il intérieurement; puis il s'efforça de n'y plus penser.--Mais Oscar était un téméraire de juger ainsi sur les apparences toujours trompeuses; que nos lecteurs n'aillent pas tomber dans le même péché.
Les alcides ayant soulevé et resoulevé leurs kilos, leurs boulets et autres poids, plièrent bagage, et déjà les voyageurs parlaient, de continuer l'excursion projetée à la tour. Je crois que ce fut l'abbé Ponceau qui proposa le premier cette motion, à l'appui de laquelle il criait la fameuse phrase de Philippe Ier à son fils Louis; «Mon fils, garde bien ce château, qui m'a causé tant de peines et de tourments; car, par la perfidie et la méchanceté de son soigneur, j'ai passé ma vie entière à me défendre contre lui, et je suis arrivé à un état de vieillesse, sans en avoir pu obtenir ni paix ni repos.»
Mais il était écrit que l'abbé en serait pour ses frais de souvenirs et d'érudition préventive, car on vint annoncer à la société que le rail était déjà réparé et qu'une machine, arrivant d'Étampes, allait emmener le convoi. Chacun aussitôt se mit à courir vers le chemin de fer, et comme madame Verdelet tenait encore le petit chien entre ses bras, Oscar eut soin de s'élancer dans le wagon où elle entrait, au préjudice de M. Robinard, qui s'en vint pour monter quand toutes les places étaient déjà prises. Force lui fut de reprendre son premier poste sur l'impériale du wagon, et bientôt on l'entendit sonner une nouvelle fanfare dans sa trompe de chasse.
«Quel sot animal que cc Robinard!» disait M. Verdelet. Sa femme baissait les yeux; Oscar ne conservait plus aucun doute. Témérité! témérité!--L'abbé Ponceau regrettait tout haut que l'on n'eût pas eu le temps de pousser jusqu'à la fameuse tour, et comme nous voulons épargner ce juste regret à nos lecteurs, nous leur donnerons ici le dessin de ladite tour, avec les quatre vers du Lutrin qui s'y rapportent;
Ses murs, dont le sommet se dérobe à la vue.
Sur la cime d'un mont s'allongent dans la nue,
Et présentant de loin leur objet ennuyeux,
Du passant qui les fuit semblent suivre les yeux.
Et maintenant nous arrivons à Orléans.
(La suite à un prochain numéro.)
Albert Aubert.
Des Caisses d'Épargne.
L'Illustration a déjà (t. 1, p. 102) fait ressortir les bienfaits de l'institution des caisses d'épargne et de prévoyance. Aujourd'hui elle doit en constater les progrès nouveaux, et apprécier l'utilité de précautions réclamées par quelques-uns, dans l'intérêt de l'État et des dépositaires, déclarées inutiles par quelques autres.
Le 23 du mois dernier a été tenue l'assemblée générale annuelle des directeurs et administrateurs de la caisse d'épargne de Paris, et compte y a été rendu des opérations pendant l'année 1843. Ce rapport a été fait, comme les années précédentes, par M. Benjamin Delessert, un des fondateurs de la caisse.
En 1843, la caisse a reçu à divers titres 45,603,395 fr. 23 c.
Elle a remboursé par contre, 187,385 fr. 86 c.
Excédant des recettes sur les remboursements 9,416,009 fr. 37 c.
Lesquels ajoutés au solde de l'an née 1842 93,570,234 fr. 02 c.
Constituaient la caisse de Paris débitrice envers
les déposants de la somme totale de 104,786,213 fr. 59 c.
En 1841, il y a eu 34,303 nouveaux déposants
ayant versé 6,147,000 fr.
En 1842, -- 35,653 -- 6,459.000
En 1843, -- 35,743 -- 6,337,000
105,699,000
Sur les 35,743 nouveaux déposants de 1843, 27,554 sont des ouvriers et
des domestiques, soit les trois quarts, savoir:
Ouvriers Artisans patentés. 16,053 }
3,998 } 20,051
Domestiques 7,503
27,551
Depuis trois ans on a pris le soin, à la fin de chaque année, de classer par nature de professions ou de situations, les déposants nouveaux. On sait donc exactement aujourd'hui la répartition des 105,699 déposants de 1841, 1842 et 1843. En admettant, ce qui est très-vraisemblable, que les proportions fournies par le nombre des déposants de ces trois dernières années soit applicable à l'ensemble des déposants actuels, qui est de 161,843, on trouve, par cette évaluation, aussi juste que possible, qu'il y a en ce moment environ 90,000 personnes de la classe ouvrière et 34,000 domestiques, ensemble 124,000 individus, tant ouvriers et artisan! que domestiques, c'est-à-dire plus des trois quarts des 161,843 déposants.
Le nombre total des ouvriers et des domestiques des deux sexes, à Paris, peut être évalué à 400,000, dont 320,000 ouvriers et 80,000 domestiques. Si, sur les 320,000 ouvriers; 90 000 déposent à la caisse d'épargne, on peut donc estimer qu'elle a affaire à peu près au quart des ouvriers de Paris, et si, sur 80,000 domestiques, elle en compte 36,000 sur ses livrets, elle a atteint bien près de la moitié du nombre total. En d'autres termes, la caisse d'épargne de Paris compte, parmi ses déposants, environ 1 ouvrier sur 4 et 1 domestique sur 2.
M. B. Delessert a appelé particulièrement l'attention sur le développement pris par les caisses En effet, l'augmentation, pendant les cinq dernières années, a été de 59,000 déposants, déduction faite de ceux qui ont été remboursés intégralement, et l'augmentation, en somme, a été de 11 millions. La moyenne donne pour résultat un accroissement annuel de 12,000 livrets et une somme de 8 millions. Si cette progression continuait dans la même proportion pendant douze ans, le nombre total des déposants à la caisse d'épargne de Paris seulement se trouverait être de 300,000, auxquels il serait dû environ 200 millions.
L'accroissement des dépôts dans les caisses d'épargne des départements est dans une proportion plus forte encore que celle de Paris. Il a été, depuis cinq ans, de 160 millions, soit 31 millions par an, ce qui, avec les 8 millions de la caisse de Paris, donne une augmentation annuelle d'environ 40 millions pour toutes les caisses d'épargne de France. Au bout de douze années, si cet accroissement se maintenait dans cette même progression, la somme totale serait de 480 millions, lesquels ajoutés à 312 millions actuellement à la caisse des dépôts et consignations, porteraient probablement les sommes dues à cette époque à toutes les caisses d'épargne à plus de 800 millions. «Cette somme, ajoute M. B. Delessert, peut paraître bien forte; mais, loin de s'en alarmer, tous ceux qui apprécient les résultats de cette belle institution doivent s'en réjouir. La seule chose dont il soit nécessaire de s'occuper, c'est de prendre des mesures pour que des demandes de remboursement subites et trop considérables ne viennent donner quelque souci ou occasionner quelque embarras. Le gouvernement s'en occupe d'une manière sérieuse, et il a nommé une commission qui déjà s'est réunie plusieurs fois pour examiner cette question. Il faut espérer qu'on parviendra à une solution qui, en ne portant aucune atteinte au développement et à l'utilité des caisses d'épargne, mettra cependant le gouvernement à l'abri du danger que pourraient offrir, en cas de crise, des remboursements d'une trop grande importance.»
Rien de plus sage que ces observations et que ce vœu. Néanmoins, à M. B. Delessert a succédé un censeur, M. Poullain-Deladreue, lequel a déclaré ne pas partager un pareil souci, et admirer tant de sollicitude sans la concevoir. Il n'y a, à ses yeux, qu'un mauvais citoyen qui puisse, en temps de crise, aller retirer son dépôt de la caisse d'épargne; les bons, au contraire, profitent de ce moment pour lui confier leur avoir. «A l'époque de douloureuse mémoire où le choléra sévissait avec fureur au milieu de nous, n'avons-nous pas vu des milliers de déposants nous apporter le fruit de leurs économies?» C'est la reproduction de l'opinion et de l'argument mis précédemment en avant par M. le baron Charles Dupin, dans un volume publié par lui au mois de janvier dernier, sous le litre de Constitution, Histoire et Avenir des caisses d'épargne de France. Tant de quiétude fait l'éloge de ces messieurs; mais quand on crie au feu et quand on sent le brûlé dans une salle de spectacle, chacun se précipite vers les issues, les bons comme les mauvais citoyens. Sans nul doute il serait beaucoup plus sage de ne sortir qu'avec ordre et successivement; mais il y aurait dans les vestibules cent orateurs comme MM. Poullain-Deladreue et Charles Dupin, que leur éloquence ne viendrait probablement pas à bout de l'empressement, mal entendu, nous le voulons bien, des fuyards. Il en serait évidemment, au jour d'une crise un peu profonde, à la caisse d'épargne comme aux portes du théâtre menacé: la foule y ferait arriver la foule; les retraits se multiplieraient, et la crainte du mal amènerait le mal lui-même, la chambre des pairs s'en est montrée vivement préoccupée, dans sa discussion du budget des recettes pour l'exercice 1814; le gouvernement avait pris l'engagement de présenter dans la session actuelle un projet de loi qui garantit la sûreté du trésor. Nous désirons vivement que cette promesse ne demeure pas longtemps encore méconnue.
En attendant, la caisse des consignations a rendu au trésor ce dépôt chaque jour croissant dont elle ne trouvait plus l'emploi. Le trésor, qui en sert l'intérêt à 4 pour 100, en use sans doute pour se dispenser d'émettre des bons ou pour reculer l'époque de ses emprunts; mais ce sont là des applications dangereuses, et il est temps que la loi vienne les régulariser. Dans une brochure très-remarquable attribuée à M. Bonnardet, de Lyon, et dont nous avons déjà parlé, page 246, l'auteur propose d'appliquer les dépôts des caisses d'épargne à la collection des chemins de fer par l'État, en intéressant dans les produits de ces voies les déposants qui auront consenti à cette affectation. Un journal, le National, a adopté et reproduit cette idée: le désir manifesté par la chambre des députés de voir le gouvernement exécuter lui-même les chemins la recommande à l'examen du gouvernement, comme permettant d'atteindre le double but qu'on se propose.
Étuves de Néron, ou Tritoli.
M. le docteur Constantin James vient de publier la relation du voyage scientifique qu'il a exécuté en 1843 avec M. le docteur Magendie, et dont nous avons déjà donné un extrait dans notre numéro du 24 février. L'importance des observations faites par ces deux savants nous porte à publier la curieuse expérience qu'on va lire:
«A peu de distance de Pouzzoles, dit le docteur James, non loin du cap Misène, et de l'autre de la sibylle de Cumes, se trouvent les étuves de Néron, appelées anciennement Posidianæ, du nom d'un affranchi de Claude. Elles sont renfermées dans une excavation pratiquée sur le versant méridional de la montagne de Baies, à quinze mètres environ au dessus du niveau de la mer. On y accède par un sentier taillé dans le roc. Les flots baignent la base de la montagne, dont le sommet était autrefois couronné par un palais communiquant avec les étuves au moyen de splendides galeries. Il en reste encore plusieurs voûtes et quelques colonnes. C'est un des sites les plus beaux des environs de Naples. Devant vous apparaissent, au milieu de la mer, les débris du pont de Caligula, et, si vous promenez vos regards sur le golfe, vous rencontrez à l'horizon Ischia. Capree, Sorente et le Vésuve.
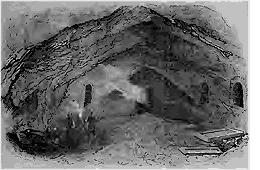
Vue intérieure des Étuves de Néron
«L'intérieur de la grotte est divisé en quatre salles disposées les unes à la suite des autres. La lumière y pénètre par des ouvertures qui font face à la mer. Dans chaque salle sont plusieurs tables en lave, creusées de manière à recevoir des matelas, sur lesquels on vient s'étendre pour respirer un air plus frais à la sortie du bain. Autrefois des statues, circulairement rangées, indiquaient le nom des maladies que ces étuves étaient réputées guérir. Nous ne vîmes plus que des niches vides et dégradées.
«La salle d'entrée est la pièce la plus spacieuse. Elle peut avoir dix mètres de long sur cinq de large. Dans le fond se trouve une ouverture semblable à la gueule d'un four. Il s'en échappe sans cesse un nuage de vapeur humide et brûlante. C'est l'orifice du couloir qui mène à la source où la vapeur se forme.
«Le gardien des étuves est un petit vieillard dont l'aspect fait mal. Son excessive maigreur, sa peau sèche et racornie, sa respiration sifflante n'indiquent que trop le pénible métier qu'il exerce journellement. En effet, sa seule industrie est de traverser une atmosphère embrumée pour aller puiser à la source un seau d'eau dans lequel les visiteurs s'amusent ensuite à plonger des œufs qui deviennent durs en moins de cinq minutes.
«Nous étions à peine entrés, que le gardien alluma de lui-même une grosse torche en résine pour éclairer sa descente dans l'étuve. Je fus curieux de l'accompagner. C'était pour moi une occasion favorable et intéressante de répéter quelques-unes des observations dont les travaux de M. Magendie sur la chaleur venaient récemment d'enrichir la science.
«Nous quittons, le gardien et moi, nos vêtements, et, après avoir pris, lui sa torche, moi mon thermomètre, nous pénétrons dans le conduit.
«La hauteur du couloir est de deux mètres, sa largeur d'un mètre environ. Température, 40° centig. en haut et 33° en bas. Aussi la chaleur paraît-elle étouffante ou supportable, suivant qu'on élève la tête ou qu'on la tient baissée. La différence est due à cette cause toute physique que la couche la moins échauffée étant la plus lourde, doit nécessairement occuper la partie inférieure.
«Cet air plus chaud et cet air plus froid constituent un double courant dans le sens de la sortie du premier et de l'entrée du second; de sorte que, si vous placez la torche près de la voûte, la flamme s'incline en dehors, et, près du sol, en dedans.
«Nous faisons quelques pas. Le couloir change brusquement de direction, puis il décrit des sinuosités. Je marchais accroupi, la tête courbée le plus possible; tandis que le gardien, vu sa petite taille et surtout ses habitudes d'incombustibilité, dédaignait ces précautions. Après avoir parcouru environ quarante mètres, nous arrivons à un point où le chemin se coude à angle presque droit. Les personnes qui vont prendre leur bain de vapeur, et elles sont aujourd'hui très-peu nombreuses, pénètrent rarement jusque-là. Elles s'arrêtent dès les premiers pas dans le couloir.
«Le gardien me fit remarquer en cet endroit l'orifice d'un des six autres conduits, qui ont été inutilement creusés dans le tuf avant qu'on parvint à la source.
«Le thermomètre marque 40° en haut et 37° en bas. Déjà je me sens fort incommodé de la chaleur. Mon pouls s'est élevé de 70 pulsations à 90.
«Après une halte de quelques instants, nous avançons. La température augmente; le couloir se rétrécit, et, au lieu du plan légèrement incliné que nous avions suivi, il n'offre plus qu'une pente très rapide. Le gardien lui-même marche avec une extrême difficulté. Je continue de le suivre; mais bientôt, afin de me maintenir la tête plus élevée, et d'empêcher le sang de s'y porter par son poids, je m'agenouille; puis, me retenant par les pieds et les mains aux aspérités d'un terrain humide, je me laisse péniblement glisser à reculons. Mes artères temporales battent avec force. Ma respiration est plaintive, courte, saccadée, haletante. Mon corps ruisselle. 120 pulsations. A chaque instant je m'arrête épuisé, pour appliquer ma bouche contre le sol, où j'aspire avidement la couche d'air la moins brûlante.
«Le courant supérieur indique 48°, l'inférieur 45. Nous sommes enveloppés d'une vapeur telle que la flamme de la torche, d'où s'exhale une fumée fétide, n'apparaît que comme un point brillant au milieu d'un anneau lumineux.
«Nous descendons toujours, l'atmosphère est de plus en plus étouffante. Il me semble que ma tête va se briser, et qu'autour de moi tout projette un éclat phosphorescent. J'ai à peine la conscience de mes sensations. Au moins, s'il me fallait du secours, ma voix pourrait-elle se faire entendre? J'appelle, puis j'écouto... rien, que le bruit de nos deux respirations.
«Cependant le terrain se redresse. Un léger bouillonnement indique que nous sommes près de la source, la voici. Mais la vapeur est si épaisse, qu'il faut que le gardien promène sa torche au-dessus des objets, pour les éclairer d'une manière distincte.
«Autant qu'il me fut possible de le reconnaître, l'eau se trouve répartie dans trois petits bassins, communiquant entre eux par une ouverture qu'on aperçoit à la base des cloisons de séparation. C'est dans le second bassin que jaillit la source. Celui du fond est percé d'un trou par où l'eau s'échappe en tournoyant. Sur le bord du premier bassin est une pierre où l'on pose le genou pour puiser l'eau.
«Je me traîne vers la source, tenant mon thermomètre à la main; mais j'avoue qu'à ce moment les forces me manquèrent. Le mercure indiquait 50°, sans différence entre les couches supérieures et les couches inférieures. Mon pouls battait tellement vite que je ne pouvais plus en compter les pulsations. Il me sembla que si je venais à me baisser, j'allais probablement tomber asphyxié. Ce fut donc le gardien qui plongea mon thermomètre dans la source. La température de l'eau est de 85°. il remplit ensuite le seau dans le premier bassin, dont j'évalue la profondeur à cinquante centimètres.
«Mon but était atteint. Je rassemblai toute mon énergie pour sortir de cette épouvantable fournaise où j'avais regretté plus d'une fois de m'être engagé Ayant à monter au lieu de descendre, je ne suis plus force de ramper à reculons. Aussi fumes nous bientôt hors de l'étuve.
«Le contact de l'air frais me fit éprouver un saisissement voisin de la syncope. J'y voyais à peine et chancelais comme un homme ivre. Mon front violacé, mes cheveux collés par la vapeur, mes bras, mes jambes, mon visage et toute la partie antérieure du tronc: salis par une poussière humide et noire, me donnaient un aspect effrayant. J'avais 150 pulsations. Heureusement le sang me jaillit par le nez. A mesure qu'il coule, je me trouve soulagé. Ma respiration est plus libre. Mes idées sont plus nettes.
«Nous étions restés près d'un quart d'heure dans l'étuve, dont le parcours total a une longueur de cent mètres environ. M. Magendie, inquiet de ne pas me voir revenir, m'avait appelé plusieurs fois; mais, bien que forte et sonore, sa voix, pas plus que la mienne, n'avait pu traverser le couloir.
«Le gardien, qui n'avait pas l'habitude d'y séjourner aussi longtemps, n'était pas beaucoup mieux que moi. Ses mouvements respiratoires s'accompagnaient d'un sifflement si bruyant qu'on l'aurait cru atteint d'un violent accès d'asthme.
«L'eau que nous venions de puiser à la source était parfaitement claire, limpide et inodore. Sa saveur âcre et salée rappelle celle de l'eau de Pullna, dont elle partage les propriétés purgatives. Elle n'est point gazeuse. Si elle exhalait de l'acide carbonique, on serait asphyxié dès les premiers pas dans l'étuve. Elle ne forme aucun dépôt en se refroidissant. Je l'ai fait analyser à Paris, et elle nous a offert des quantités considérables de sels de chaux, soude et magnésie.
«Pendant que j'étais occupé à faire disparaître les traces de ma visite souterraine, le guide que nous avions amené de Naples, fatigué sans doute de son rôle de muet observateur, nous raconta qu'un Français était mort, l'année précédente, en huit jours, des suites d'une semblable pérégrination. L'anecdote me parut plus intéressante qu'opportune.
«En quittant les étuves, nous allâmes visiter les bains de Néron. Abandonnés aujourd'hui, ils sont alimentés par la source des étuves que nous avons dit se perdre dans le troisième bassin, et qui vient ensuite sortir au pied de la montagne.
«De retour à Naples, je conservai 100 pulsations pendant toute la soirée. J'éprouvai une agitation fébrile, de l'étonnement, des tintements d'oreille, une sorte de fourmillement dans tous les membres. Mon sommeil fut cependant assez calme.
Le lendemain, je ne sentais plus que de la fatigue. M. Magendie remarqua que mes yeux restaient injectés par l'extravasation d'un peu de sang dans la conjonctive. Cette injection, qui n'était nullement douloureuse, se dissipa au bout de deux à trois jours.»
La Fête des Allemands à Rome.
FRAGMENT D'UNE LETTRE.
Rome, le 10 juin 1844.
... Pendant que le triste dénouement d'un drame sanglant s'accomplissait dans le nord des États de l'Église, une scène joyeuse se passait à quelques milles de Rome. Depuis huit jours une grande agitation régnait parmi les artistes allemands qui habitent Rome; leurs figures ouvertes, mais impassibles d'ordinaire, étaient rayonnantes et animées; leur conversation que malheureusement je ne comprenais pas avait quelque chose d'inaccoutumé. Enfin je connus le mot de l'énigme en recevant une lettre qui m'invitait à me rendre à la Cervara, petit village des environs de Rome. Mais une chose me parut singulière; bien que nous fussions au mois de mai, et que le carnaval fût enterré depuis longtemps, on m'invitait à prendre un costume de fantaisie, et à me rendre au village, monté sur un âne. Ces deux conditions étaient indispensables sous peine d'exclusion. Le gouvernement pontifical permet cette mascarade, pourvu que l'on se costume hors de la ville sainte; aussi, de grand matin, voit-on une immense foule environner la locanda, où chaque artiste va, d'un air très-grave, s'affubler du costume grotesque ou sérieux de quelque personnage réel ou imaginaire. Des qu'il en paraît un, ce sont des rires, des battements de mains, des joies inconnues en France. Une gaieté franche accueillait chaque déguisement, et l'accompagnait jusqu'à la plaine de la Carvara où la cavalcade aux longues oreilles se rangea à la voix d'un général. La musique se fit entendre au loin, et l'escadron asinien y répondit d'une manière comique. On vit alors s'avancer majestueusement un char traîné par deux bœufs précédés de bannières portant Bacchus sur un tonneau, et d'huissiers ayant sous le bras un parapluie, et sur leurs chapeaux les armes du roi de la fête, c'est-à-dire un compas en sautoir avec une fiole de gomme élastique (le roi était un architecte); enfin le cortège s'arrêta, et ce monarque d'un jour prononça un discours en allemand. Plusieurs fois l'orateur fut interrompu par des sons discordants que la baguette et le fouet des huissiers ne purent faire cesser que difficilement. Le discours terminé, le cortège se remit en marche et se rendit dans une caverne, où, après les invocations d'usage, la sibylle se montra aux yeux effrayés des spectateurs. Le roi la questionna d'abord sur le sort des arts pendant l'année; mais aussitôt la sibylle se couvrit la tête et s'enfuit. Evoquée de nouveau et à plusieurs reprises, elle ne reparut qu'après les vives instances du roi des Allemands. Enfin elle parla. Je crois qu'il est facile de deviner sa prédiction, qui peut se traduire par anarchie, égarement, mais grand talent. Sa harangue achevée, après quelques minutes, l'on vit passer dans l'ombre de la grotte Pietro, le modèle favori, Pietro, laissé aux artistes comme type de l'ancien Romain, et portant une tasse de café sur un plateau. La sibylle, ayant satisfait ses nombreux auditeurs, se retira près de Pietro, après avoir accepté l'invitation d'un repas au fond de l'antre consacré.
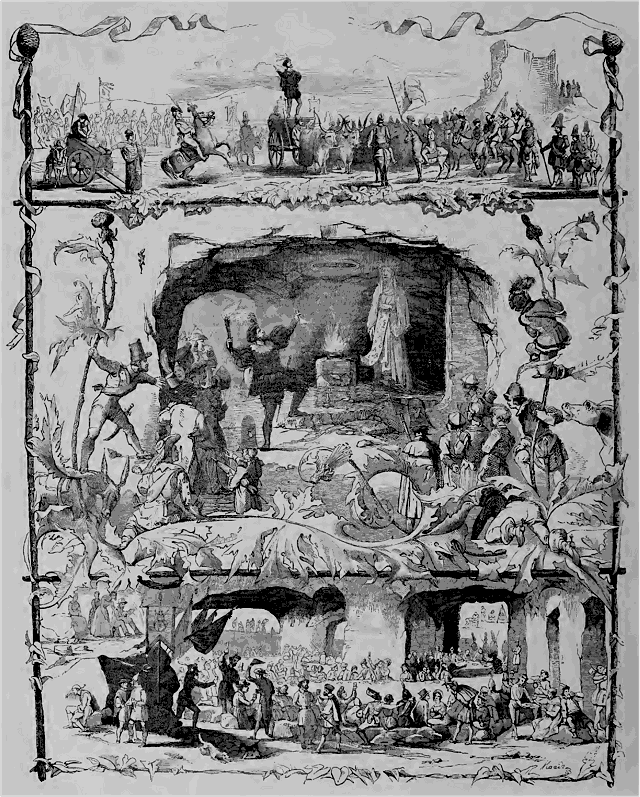
Fête des Allemands, à Rome, au mois de
Mai, dans les grottes de la Cervara.
Dans une grande salle taillée dans le roc, et soutenue par d'énormes massifs de pierre, se trouvaient des tables rangées en fer à cheval. Des pierres roulées à l'entour servaient de sièges. Chacun courut se placer suivant son bon plaisir; des tostes furent portés alternativement, et tous tendaient à l'union artistique des peuples, au développement, et au progrès des arts. En Italie, berceau des arts, aujourd'hui terrain neutre, on se visite volontiers; les arts se font au grand jour, et les ateliers sont ouverts à tous; c'est une confraternité générale. Il n'en est pas ainsi dans notre France, où l'on oublie bien vite les préceptes admirables de confiance mutuelle; ici on se cache, on travaille dans l'ombre. Peu d'amis ont le droit de pénétrer dans l'intimité de l'atelier; et cependant c'est là peut-être où les grandes questions politiques sont inconnues, où les spéculations financières sont regardées comme séchant le cœur, où enfin l'homme travaille à son art favori sans s'inquiéter de sa fortune.
Courrier de Paris.
Voici un temps qui n'est pas rafraîchissant du tout: le ciel est lourd et l'air brûlant; Paris ne ressemble plus à rien, si ce n'est à un four; on n'entend de tous côtés que des ouf! et des holà! on ne voit que des visages rouges et haletants, des regards mornes et des fronts qui s'essuient; que de gens ôtent leur chapeau et passent leurs doigts dans leurs cheveux humides; que d'autres enflent leurs joues et cherchent, tristes Borées, à faire un peu d'air et de fraîcheur! Heureux les Parisiens favorisés du ciel que leurs affaires ne forcent pas à mettre le pied, par ces jours de canicule, sur le pavé brûlant et l'asphalte calciné! Heureux ceux qui ne sont point condamnés à traverser, en plein midi, le quai du Louvre, la place Louis XV ou le Carrousel, immenses fournaises d'où les humains sortent dix fois plus rôtis qu'un poulet qu'on vient de tirer de la broche! Heureux, enfin, les rentiers et les fainéants qui peuvent s'étendre sur un divan recouvert d'une toile de Perse, toutes fenêtres closes, et au milieu de cette fraîche atmosphère que produit le demi-jour dans le boudoir de nos femmes élégantes et de nos raffinés.
S'il y a encore un Paris qui travaille et s'agite, on peut dire, sans exagération, qu'il y a aussi un Paris qui passe sa journée étendu, comme un mouton haletant à l'ombre des haies; s'il y a encore un Paris vêtu, il y en a un qui ne l'est guère. Arrivez à l'improviste chez votre voisine ou chez votre voisin, sans donner l'alarme par un coup de sonnette, vous les verrez, comme des ombres épouvantées, s'enfuir de porte en porte, dans ce simple appareil dont parle Néron, et que ne justifient que trop les fureurs caniculaires de la saison.
Les glaciers et les limonadiers triomphent et se rengorgent: la canicule fait leur bonheur et leur joie. Blanche est ravi, et Tortoni ne se sent pas d'aise. Le Paris aristocratique est voué au sorbet et à la coupe à la merise; le Paris bourgeois, au verre d'eau sucrée et à la limonade; le Paris populaire, à la bière et au cidre; chacun se rafraîchit comme il peut; toutes les soifs sont égales, mais l'inégalité règne dans les moyens et dans la façon de la satisfaire; et si Jean Jacques ressuscitait, quel beau chapitre il pourrait écrite sur cette matière, pour faire suite à son discours philosophique couronné par l'Académie de Dijon.
Cependant, les théâtres ne partagent pas l'avis de Tortoni et de Blanche; la canicule et les théâtres sont deux ennemis nés, qui ne s'entendront jamais ensemble. Dès que juin et juillet paraissent à l'horizon, au milieu des feux de leur soleil éclatant, les théâtres s'attristent et entrent en solitude. Peuplés tout à l'heure, et assiégés par la foule, ils se dépeuplent tout à coup et sont abandonnés; si vous aimez le désert, si vous voulez, comme Alceste, fuir l'approche des humains, louez une stalle ou une loge pendant les jours d'été, du 13 juin au 15 août; vous êtes sûr de pouvoir donner un libre cours à votre misanthropie, et de ne percevoir qu'à de rares intervalles cette espèce malfaisante qu'on appelle vulgairement l'espèce humaine.
Ces malheureux théâtres comprennent si bien leur infortune, qu'ils ne cherchent pas même à lutter contre elle, tant elle leur semble fatale et inévitable; résignés à leur sort, ils chantent, déclament et gambadent devant des loges vides, et des banquettes où quelques spectateurs égarés s étendent de long en large, sans craindre de rencontrer le bras, la jambe ou le dos d'un voisin. Aussi l'été est-il la saison stérile pour les champs dramatiques; tandis que ailleurs les fleurs et les fruits abondent, parent la surface de la terre et ornent les vergers et la cime des arbres, les théâtres ne donnent ni fleurs ni fruits; ils vivent tant bien que mal des restes de leur hiver et de quelques vaudevilles, comédies ou drames avariés, dont les fins gourmets n'auraient pas voulu dans une autre saison. Les mauvaises pièces, celles du moins dont on n'attend rien ou peu de chose, sont qualifiées, en style de direction théâtrale, de pièces d'été; on les met en réserve sous cette étiquette, et on les garde pour les mois étouffants. Il y a plus d'une raison pour que les théâtres en agissent, ainsi; d'abord, les bonnes pièces, ou plutôt celles qui ont la prétention d'être bonnes, font les reinchéries et refusent d'affronter les chances du mois de juillet ou du mois d'août; d'autre part, les mauvaises pièces se laissent faire; il est clair, en effet, que leur intérêt les engage à se produire dans une saison où les juges sont absents et les banquettes désertes; elles sont à peu près sûres d'être applaudies quand personne n'est là pour les siffler. De là cette abondance d'ouvrages détestables qui affligent l'été.
C'est aussi le temps où les acteurs un peu en crédit prennent leur congé; ils quittent Paris, qui va bientôt les quitter, pour aller chercher en province ou à l'étranger les succès, les bravos, la foule que la canicule leur enlève. Cette émigration a l'avantage de donner un grand attrait aux dernières représentations qui précèdent leur départ, et de faire oublier au public les ardeurs du thermomètre; sans compter qu'elle prépare à ces acteurs bien-aimés le triomphe d'un retour éclatant. Paris, qui s'est trouvé privé de leur talent pendant deux ou trois mois, les revoit plus tard avec transport; il n'y a rien de tel que l'absence pour aiguiser l'appétit; la possession sans relâche blase et fatigue les plus amoureux.
Nous allons donc perdre, pour quelques semaines, nos acteurs et nos chanteurs les plus renommés, mademoiselle Rachel à leur tête; ou plutôt, nous avons déjà perdu mademoiselle Rachel; elle a donné, l'autre jour, sa représentation d'adieu au milieu des bravos et des couronnes; c'est la Catherine II de M. Hippolyte Romand qui en a fait les honneurs. A l'heure où nous écrivons, mademoiselle Rachel est à Bruxelles, où elle jouera six fois pour les menus plaisirs de la Belgique; il est probable que Gand. Anvers, Mons et les autres villes accourront pour l'applaudir; les railways vont avoir fort à faire. Où ira ensuite mademoiselle Rachel? Personne ne le sait positivement; les uns parlent de l'Angleterre, les autres de l'Italie; les mieux informés pensent que mademoiselle Rachel, déposant pour quelque temps le sceptre et la couronne tragiques, se vouera au silence, au repos, à la solitude, et, laissant là Corneille et Racine, lira Berquin ou l'Ami des Enfants.
Nous disions qu'il était impossible d'avoir raison de la canicule: non certes... à moins qu'on ne s'appelle Marie Taglioni; juin a beau faire, il n'est pas le plus fort contre ce talent divin; les sept représentations données par la ravissante danseuse ont été, pour elle, autant de triomphes; en vain l'ingénieur Chevalier nous menaçait de ces vingt degrés au-dessus de zéro, la foule impatiente se disputait les places, au risque de l'asphyxie. Aujourd'hui samedi, Marie Taglioni a clos ces soirées magnifiques; elle se dérobe, le sourire sur les lèvres, à l'avalanche de couronnes et de fleurs amoncelées sous ses pas et sur sa tête, par l'enthousiasme du parterre. On avait annoncé,--nous avions annoncé nous-même,--que mademoiselle Taglioni était résolue à se retirer ensuite définitivement du monde des sylphides; Paris aurait reçu ainsi son suprême adieu. Il n'en est rien: mademoiselle Taglioni n'entend pas faire de jaloux; après Paris, elle ira successivement visiter les royaumes et les capitales qui l'ont admirée et fêtée pendant sa brillante carrière; à chacune d'elles, Marie Taglioni veut demander une dernière couronne et adresser un dernier sourire; ou a calculé que ce voyage de reconnaissance pourra durer à peu près deux ans et rapporter à mademoiselle Taglioni de trois à quatre cents mille francs; c'est sur ce lit d'or et de fleurs, et seulement après ces deux années mémorables, que Marie Taglioni compte se reposer sans retour.
Le vénérable Berton, l'auteur du Montano et d'Aline, est mort il y a quelques semaines, comme chacun sait; nous ne savons pas si l'habile compositeur a légué son génie musical à quelqu'un; jusqu'ici nous n'en avons rien vu; mais du moins son fauteuil académique ne restera pas sans héritier; l'Académie des Beaux-Arts en a fait sortir un de l'urne du scrutin; ce bienheureux élu est M. Adolphe Adam. Pourquoi pas? M. Adolphe Adam est un compositeur fécond et spirituel, et l'ombre du bonhomme Berton n'y trouvera rien à redire; Berton lui-même, de son vivant, avait donné trois ou quatre fois sa voix à Adolphe Adam, qu'il aimait beaucoup. On ne croit pas cependant qu'il ait poussé l'amitié jusqu'à mourir tout exprès pour lui laisser son fauteuil.
«Enfin le voilà! il a paru! ouvrez les oreilles et les yeux!
--Quoi donc? de qui parlez-vous? quelle est cette merveille?
--Ne le savez-vous pas? de quoi parle-t-on depuis six mois? quel est le prodige que Paris, que la France, que l'Europe, que le monde attend avec anxiété?--Ah! je comprend; le Juif Errant de M. Eugène Sue!--Précisément. Le Constitutionnel a commenté la fameuse publication; aussi l'abonné se rue-t-il aux portes; et il faut avouer qu'on n'a pas perdu pour attendre: les cinq premiers feuilletons qui sont comme l'avant-scène du livre, promettent monts et merveilles; le singulier y règne, la curiosité y est vivement excitée; et tout fait croire que les Mystères de Paris ont trouvé un frère puîné qui ne leur cédera en rien, ni pour l'originalité, ni pour la variété, ni pour la hardiesse, ni pour le plaisir, ni pour la terreur.
Mais voici un autre drame qui se déroule sous nos yeux; et malheureusement ce n'est plus d'un roman qu'il s'agit, mais d'une épouvantable réalité. On voit que nous voulons parler du crime qui jeta l'effroi dans la ville de Pontoise au mois de janvier dernier, c'est-à-dire de l'assassinat du banquier Donon-Cadot.
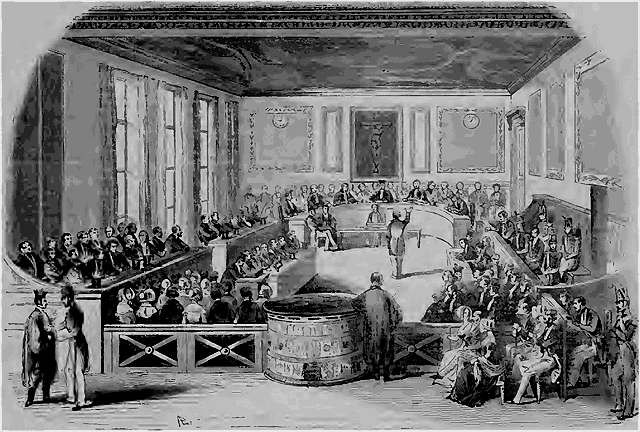
Cour d'assises de la Seine;-Audience du 27 juin
1844--Procès d'Édouard Donon-Cadot et de Rousselet, accusés
d'assassinat
sur la personne de Donon-Cadot, banquier Pontoise.
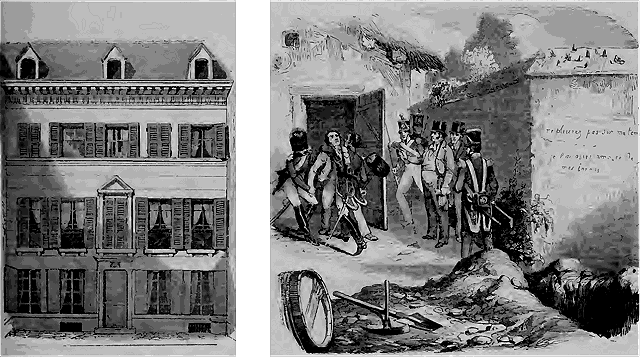
Maison de Donon-Cadot, rue Arrestation de Rousselet, assassin de Donon-Cadot.
Basse de la Tannerie, à Pontoise.
Donon-Cadot, ancien marchand de draps à Pontoise, avait abandonné ce commerce depuis 1837, et se livrait à des opérations d'escompte et de banque; il passait pour très-riche dans le pays, et aussi pour très-parcimonieux. Donon-Cadot habitait une des rues les plus fréquentées de Pontoise; une femme de ménage composait tout son domestique. Le riche banquier, continuellement occupé de ses nombreuses affaires, s'installait d'habitude, dès le matin, dans son bureau, situe au rez-de-chaussée et donnant sur la rue par une fenêtre ornée de longs rideaux verts; c'est là que le 15 janvier, vers quatre heures et demi du soir, le fils aîné, le gendre, la sœur, et la belle-fille de Donon-Cadot trouvèrent un cadavre gisant dans le sang et horriblement mutilé: c'était celui du malheureux vieillard. Des traces d'effraction annonçaient que le vol avait suivi l'assassinat; en effet, sur la déclaration du jeune Édouard, second fils de la victime, il fut constaté que l'assassin avait soustrait une somme d'argent s'élevant à peu près à 6,000 fr., et un portefeuille contenant pour plus de 600,000 francs de valeurs.
La justice fit pendant longtemps de vains efforts pour découvrir les traces du coupante; rien n'éclairait ses recherches: enfin, on apprit que plusieurs des billets soustraits chez Donon-Cadot avaient été présentés en paiement à différentes personnes; la justice remonta aux informations, épia, surveilla, se tint sur ses gardes, et enfin, le 15 février, elle opérait l'arrestation d'un jeune homme âgé de seize à dix-sept ans, qui se trouvait porteur d'un billet endossé par Donon-Cadot Ce jeune homme était le fils d'un nommé Rousselet, de Sannois; dès ce moment, tout fut dit; on tenait le coupable.
Le 18 février, Rousselet père était arrêté à Sannois à six heures du matin. Les gens de justice ne le trouvèrent pas chez lui, mais dans une cabane isolée et attenante à un petit jardin dont Rousselet était propriétaire; depuis quelques semaines, Rousselet avait quitté sa maison pour cette retraite solitaire; quand on l'y surprit, il avait un pistolet placé près de lui, mais il n'en fil pas usage pour se détendre; sur le mur de la cabane, près de la porte, on lisait ces inscriptions lugubres, récemment tracées à la pointe d'un couteau:
«Ma tombe est à trente mètres de cette porte, à un mètre du mur.
«Rousselet Père.
«Ne pleurez pas sur ma tombe, je l'ai arrosée de mes larmes en la fouillant.»
Une fosse était creusée, en effet, près de la porte.
D'abord Rousselet nia toute participation au crime; il déclara qu'il avait trouvé les billets dont il était nanti à l'embarcadère du chemin de fer, rue Saint-Lazare. Puis peu à peu, pressé de questions et vaincu par l'autorité des faits, il s'avoua coupable; c'était bien lui qui avait frappé, dans la matinée du 13 janvier, le malheureux Donon-Cadot!
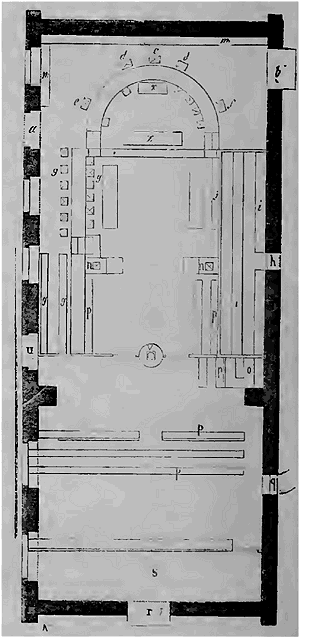
a. Porte conduisant à la chambre du jury.
b. Porte conduisant à la chambre du conseil.
c. Le président.
d. Les conseillers assesseurs.
e. Le procureur général ou son substitut.
f. Le greffier.
g. Le jury.
h. Porte conduisant à la Conciergerie.
i. Banc des accusés.
j. Banc des avocats.
m. Places réservées aux magistrats.
n. Huissiers.
o. Banc des sténographes.
p. Places réservées aux témoins.
q. Porte conduisant à la salle des témoins.
s. Enceinte publique.
t. Porte de l'enceinte publique.
Ce n'était pas assez; il fallait qu'un fait inattendu, douloureux, effrayant, vînt augmenter l'horreur de cette terrible et sanglante aventure; Rousselet avoua qu'il avait un complice; mais quel était ce complice? Après avoir fait planer quelque temps les soupçons sur le jardinier attaché à la maison de Donon-Cadot, Rousselet, abandonnant ce pauvre homme dont l'innocence, en effet, fut aisément constatée, désigna pour son complice... le fils de la victime elle-même, le jeune Édouard Donon-Cadot, âgé de dix-huit ans et sorti, depuis une année seulement, des bancs du collège. Rousselet accusa positivement ce jeune homme de lui avoir suggéré le premier la pensée du crime et de l'avoir poussé à l'accomplir par l'horrible appât d'une somme de cent mille francs.
Devant une pareille complicité, devant l'idée d'un forfait que certains législateurs de l'antiquité avaient déclaré impossible, tant il semble intervenir les lois divines et humaines, les magistrats s'arrêtèrent d'abord; et nous-mêmes, en écrivant ces lignes, nous avons hésité un instant à mêler le nom d'un fils à l'assassinat d'un père; mais nous ne sommes ici que les historiens de ce drame lugubre, et le fait de l'arrestation d'Édouard Donon-Cadot et de sa mise en jugement est plus fort que notre répugnance; comment se taire, en effet? A l'heure même où nous parlons, Édouard Donon-Cadot est assis sur les bancs de la cour d'assises, à côté de Rousselet, et Dieu veuille qu'il parvienne à prouver qu'il n'y a qu'un coupable dans cette sinistre et fatale affaire! Rousselet avoue et accuse; Édouard Donon-Cadot nie.
Quant à la justice, elle s'appuie, pour justifier l'arrestation du jeune Édouard et sa mise en jugement, d'abord sur les aveux formels et réitérés de Rousselet, puis sur les hésitations, les explications embarrassées et contradictoires du malheureux Édouard, et sur des circonstances fatales qui semblent l'accuser. Quand le crime a été commis, en effet, Édouard Donon-Cadot était dans la maison paternelle. Comment n'a-t-il pas entendu le cri épouvantable qu'a poussé la victime, et comment n'a-t-il pas volé à son secours? L'acte d'accusation argue d'aileurs de ce fait, qu'Édouard est resté toute la journée enfermé dans cette maison sanglante, disant à tous ceux qui venaient demander son père, qu'il était absent sans doute dès le malin. Ce ne fut qu'à quatre heures et demie du soir, près de sept heures après l'assassinat, qu'Édouard Donon-Cadot sortit enfin et alla prévenir son frère, non pas du crime, mais de l'inquiétude qu'il éprouvait en ne voyant pas son père, et de ses soupçons qu'il pouvait bien lui être arrivé quelque chose.
Arrêtons-nous là; les accusés sont devant leurs juges, et la vérité doit bientôt sortir du débat dramatique et terrible qui vient de s'engager. Laissons donc la vérité se faire jour dans cette nuit épouvantable, et ne hasardons pas davantage des conjectures et des faits que l'accusation fait peser, il est vrai, sur la tête d'Édouard Donon-Cadot, mais qui ont besoin, pour être démentis ou affirmés, que la voix équitable de la justice ait prononcé le non qui absout ou le oui terrible qui condamne.
C'est devant la cour d'assises de Paris que cette nouvelle cause célèbre est engagée; Me Chaix-d'Est-Ange prête à Édouard Donon-Cadot l'appui de sa vive éloquence. Rousselet est défendu par un jeune avocat de talent, Me Nogent-Saint-Laurent.
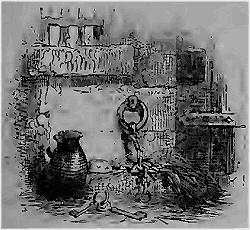
Nouveaux Systèmes de Télégraphie.
Un des caractères distinctifs de notre époque, c'est le désir d'abréger les distances, d'économiser le temps, de faciliter les communications d'homme à homme et de peuple à peuple. Dans ce but, on voit surgir à chaque instant des inventions nouvelles; tout est mis à contribution, la vapeur, l'électricité, la lumière, les gaz.--Un de ces jours on retrouvera la flèche d'Abaris ou le tapis merveilleux des Mille et une Nuits.
Tandis que, pour la plus grande promptitude, sinon pour la plus grande sécurité des voyages, une foule d'esprits inventifs cherchent à enrichir et à multiplier ces prodiges, qui eussent fait pâmer de surprise et d'effroi nos bons aïeux, et crier à la sorcellerie: les locomotives à vapeur, les locomotives électriques, les chemins de fer atmosphériques, etc., et qu'on tente même tous les jours la direction des aérostats, la télégraphie n'est pas restée en arrière. Cette magnifique invention, qui a permis de transporter la pensée et la parole à des distances énormes, presque avec la rapidité de la parole elle-même, paraît sur le point de recevoir de notables perfectionnements;--du moins beaucoup d'inventeurs se flattent d'y parvenir, et quels que soient le fondement de leurs espérances et la portée réelle de leurs tentatives, il n'en faut pas moins y applaudir; car tant d'efforts combinés ne peuvent manquer de produire quelque résultat utile.
Un reproche au système télégraphique actuellement en usage, et qui est reste à peu près tel que les frères Chappe l'ont créé, de n'être pas assez rapide, de ne pouvoir fonctionner la nuit, d'être interrompu par le brouillard et les autres accidents atmosphériques, de n'avoir pas une langue assez concise et assez variée pour tout ce qu'il doit exprimer. Les inventeurs contemporains ont cherché à remédier à ces divers défauts.
La tentative la plus radicale est celle qui consisterait à faire usage des courants électriques. Tous les appareils, toutes les combinaisons actuelles seraient renversées par l'emploi de ce nouvel agent. Rien ne se ferait à l'air libre, à découvert; ce moteur mystérieux, mille fois plus rapide que la parole, prompt comme la foudre et la pensée, retracerait, à des distances incommensurables, par des voies cachées à tous les regards, le message qui lui serait confié.
Mais s'il serait beau d'obtenir un pareil résultat, nous pensons que les inventeurs ne l'ont pas encore obtenu. L'électricité et le galvanisme forment tout un monde encore inconnu dans lequel nos Colombs physiciens posent à peine le pied, et jusqu'à présent la télégraphie électrique nous paraît à l'état de curiosité, sans grande application usuelle possible. Une ligne a cependant été établie par ce système, en Allemagne, je crois. Je ne sais trop si l'Angleterre n'a pas fait aussi son petit essai parallèle à un chemin de fer; mais tout cela n'est encore qu'à l'état d'étude, et ne constitue, s'il nous est permis de parler ainsi, qu'une télégraphie de laboratoire.
La France, mère de cet art ingénieux, a été plus prudente, et sans essayer des l'abord des innovations radicales et fabuleuses, elle s'est sagement tenue dans la voie des perfectionnements. Nous devons tout d'abord mentionner une sorte de télégraphie mobile appliquée à la tactique, que le ministère de la guerre paraissait avoir accueillie avec assez de faveur, et dont un ancien officier, M. Darel est inventeur; mais le télégraphe militaire n'a pas encore figuré, que nous sachions, sur les champs de bataille, et n'a pas même eu, comme l'aérostat de Fleurus, l'honneur de commencer sa carrière et de la terminer en même temps par une victoire.
Le plus grand inconvénient du télégraphe de Chappe consiste dans l'impossibilité de fonctionnel pendant la nuit et les brouillards, qui interrompent souvent ses plus intéressantes communications. Plusieurs systèmes ont été présentés pour y remédier. Deux se sont principalement trouvés en présence, et l'on peut dire qu'ils étaient opposés comme la lumière et l'obscurité; car, dans le premier, le télégraphe se dessine en ombre sur un fond éclairé; dans le second, le télégraphe se dessine en lignes éclairées sur l'ombre du fond. Le débat élevé entre les deux systèmes fut porté devant la chambre des députés à l'occasion d'une demande de crédit pour faire les expériences nécessaires. Le premier fut vivement défendu par M. Arago, le second non moins vivement protégé par M. Pouillet. Enfin un crédit fut voté pour les essais, et l'administration autorisa M. Guyot à établir une ligne, celle de Paris à Tours, je crois, suivant son système. Ce système consiste il éclairer les branches du télégraphe au moyen de feux de diverses couleurs, entretenus au moyen d'un gaz liquide particulier dont la composition était l'œuvre de M. Guyot.
On ne pouvait se dissimuler que la pose et l'entretien de ces feux dans des télégraphes isolés, par les temps d'hiver et d'orage, deviendraient difficiles, et parfois impossibles. Il était également à craindre que les combinaisons de couleurs inventées par M. Guyot ne vinssent échouer par suite des modifications qu'y apporteraient les brouillards et les réfractions atmosphériques.--Un nouvel inventeur se présenta qui crut avoir surmonté toutes ces difficultés. C'était M. Morice, qui, directeur depuis plusieurs années d'une ligne télégraphique, apportait au moins dans l'arène une longue pratique des services et des besoins de la télégraphie. Il proposa donc une nouvelle combinaison d'éclairage des branches du télégraphe, qu'il pensait plus facile, plus usuelle et moins dispendieuse que celle de M. le docteur Guyot. Les propositions du M. Morice ont été accueillies par l'administration. Une sorte de concours a été établi entre lui et M. Guyot, et tous deux ont été chargés d'établir une ligne, dont les résultats comparés formeront la base du jugement définitif.
Mais les inventeurs de télégraphie n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Voici M. Ennemond Gonon qui offre un système tout nouveau, fruit de vingt-cinq années d'études assidues. M. Guyot, et surtout M. Morice, conservant les combinaisons de Chappe, se proposent seulement de les rendre lisibles la nuit. M. Gonon modifie entièrement ces combinaisons, et en adopte de nouvelles qui lui permettraient d'expédier une dépêche dix fois plus vite qu'on ne peut le faire aujourd'hui.
D'après les calculs de M. Gonon, qui seraient appuyés sur de nombreuses expériences faites aux États-Unis, les avantages de son système comparé à celui de Chappe seraient considérables. Le télégraphe de Chappe ne produit qu'une centaine de signaux; celui de M. Gonon, quarante mille. Par le premier, il faut cinq et six fois plus de signaux qu'il n'y a de mots dans la dépêche à transmettre; par le second, il en faut cinq à six fois moins. Le télégraphe Chappe n'a jamais donné plus de trois cents mots par jour dans la saison la plus favorable; le télégraphe Gonon expédierait mille mots par heure; et cette rapidité tiendrait non-seulement à la combinaison de des signaux, mais encore à la facilité de ses mouvements.
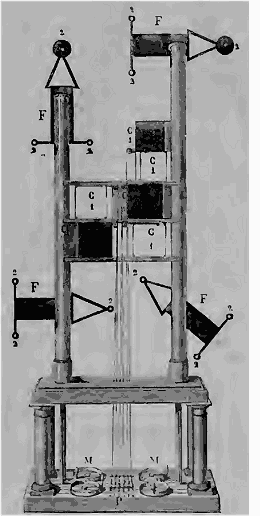
La gravure ci-jointe en fera comprendre le mécanisme. Il consiste en quatre cadrans à manivelle M, qui servent à faire mouvoir quatre flèches mobiles F, et en six touches ou pédales P, au moyen desquelles on ouvre et l'on ferme six croisées ou jalousies C. Pour le service de nuit, les flèches seraient éclairées par des feux mobiles; les croisées seraient éclairées par des feux fixes. Leurs différentes combinaisons forment, ainsi que nous l'avons dit, quarante mille signaux, qui composent le dictionnaire télégraphique général de M. Gonon. Ces signaux traduisent tous les mots usités dans la plupart des langues d'Europe et d'Amérique, et constituent ainsi une langue universelle; de plus, ils expriment à l'instant tous les termes nouveaux que l'on peut créer au besoin, les chiffes, les fractions, les signes de ponctuation les alinéas, les soulignés, etc., etc. Par suite de l'étude à laquelle il s'est livré, M. Gonon prétend avoir trouvé le secret de transmettre souvent par un seul signal cent ou deux cents mots parfaitement orthographiés; en outre, celui d'appliquer son dictionnaire français à toutes les langues qui sont écrites avec les mêmes caractères, et de plus encore, celui de rendre les dépêches avec une économie de vingt à cinquante signaux pour cent sur le nombre de mots qu'elles contiennent.
De semblables résultats, que M. Gonon assure avoir été vérifiés par de nombreuses expériences faites par la construction de trente-sept télégraphes, et sur une ligne établie aux frais du gouvernement américain, seraient en effet bien remarquables; aussi nous avons cru devoir nous étendre plus longuement sur cette nouvelle invention. Il serait même à désirer que l'administration étudiât ce système et en appréciât le mérite réel. On ne saurait trop encourager ces utiles tentatives: le pays en recueillerait les fruits; car, ainsi que nous l'avons dit en commençant, de tous ces efforts et ces recherches il ne peut sortir que des résultats avantageux.
Exposition des Produits de l'Industrie.
(9e article.--Voir t. III, p. 49, 133, 164, 180, 211, 128, 230 et 261.)
ARMES.
En parcourant la partie des galeries de l'exposition consacrée aux armes, en examinant les ingénieuses innovations dues à nos principaux arquebusiers, et l'invasion des arts, fruits de la paix, au milieu de ces produits destinés à la guerre, nous n'avons pu nous empêcher de nous reporter, par la pensée, à ces temps chevaleresques, où l'usage des armes à feu était inconnu, et où le combat corps à corps et les grands coups d'épée célébrés par les troubadours tenaient la place des batailles à portée de canon et des faits d'armes enregistrés dans les bulletins militaires. En remontant d'âge en âge, il nous eût semblé curieux de comparer les armes de ces siècles de bravoure personnelle et indépendante de tout ordre supérieur, à celles de nos batailles modernes, où l'obéissance passive tient trop souvent lieu de courage et de sang-froid. Mais, pour cela, il faudrait pénétrer avec nos lecteurs dans ces musées d'artillerie où se trouvent classés et numérotés les moyens imaginés depuis le commencement du monde, pour donner la mort à son semblable; et, quant à présent, nous devons nous en tenir aux produits de notre industrie moderne. Qu'on nous permette cependant une réflexion relative à la forme des aimes; elles sont toutes ou tranchantes ou contondantes, ou tout à la fois tranchantes et contondantes; ainsi la massue, le sabre, l'épée, la lance, la flèche et même le fusil, qui agit par un projectile contondant. Une remarque due à l'un de nos meilleurs officiers d'Afrique, c'est que l'on trouve dans la nature des armes analogues à presque toutes les nôtres, telles que la tête du bélier, la trompe de l'éléphant, les ailes de certains oiseaux, la queue du crocodile, le pied du cheval, le poing de l'homme, etc. Les boutoirs du sanglier sont considérés comme les seules armes tranchantes données aux animaux; l'autruche est citée parmi les animaux qui combattent au moyen de projectiles.
Nous avons remarqué avec satisfaction, cette année, la tendance de nos arquebusiers à introduire l'art dans leurs produits, et leurs efforts pour faire renaître le goût des belles armes, en harmonie du reste avec la richesse de nos ameublements. Tous les progrès sont parallèles! Ainsi les Lepage-Moutier, les Caron, les Jourjon, ont prouvé que la grâce de l'ornementation pouvait marcher de front avec la solidité et la force, et que la sculpture la plus fine et la plus recherchée s'alliait admirablement aux formes connues et définies de nos armes de chasse. Nous donnons à nos lecteurs les pièces les plus remarquables de cette exposition.
D'abord voici venir M. Lepage-Moutier qui se présente arme de pied en cap pour soutenir la vieille réputation de la maison Lepage. Il arrive avec les armes composées et exécutées par M. A. Lapret, qui s'est déjà fait un nom comme tous les amateurs de belles armes. C'est d'abord un sabre, dit de Judith. La lame de ce sabre est d'une rare beauté et est composée de platine et d'acier fabriqués d'après les procédés de M. le duc de Luynes, procédés dont nous dirons quelques mots tout à l'heure. Le sabre représente l'histoire de Judith: il est en fer ciselé pris sur pièce et orné d'incrustations d'or en relief. Le pommeau représente Holopherne parcourant la Judée, le fer et la flamme à la main, brûlant et massacrant, ravageant le pays. Un des côtés de la large garde nous montre Judith en prière. L'artiste n'a pas pensé qu'il dut lui donner le caractère d'audace effrontée sous lequel on la représente ordinairement; c'est une héroïne qui ne pense qu'à sauver les Hébreux! L'autre face de la garde nous fait assister à la rentrée de Judith dans Béthulie, la tête d'Holopherne à la main, et entourée des bénédictions de ceux qu'elle vient de soustraire à la mort. La poignée, en ivoire, est ornée d'un ruban sur lequel est écrit ce verset de la Bible: «Sine pollutione peccati revocavit me vobis:--le Seigneur m'a ramenée vers vous sans la souillure du péché.» Sur le fourreau, l'artiste a figuré les ancêtres de Judith, en les représentant d'après l'étymologie de leurs noms, telle que l'a donnée Hubert Étienne. La composition et l'exécution de ce sabre font le plus grand honneur à M. Lapret.
Après le sabre de Judith, vient une épée de commandement en fer ciselé et avec incrustation d'or, appartenant au général Gourgaud. L'artiste a figuré dans la coquille l'emblème de notre art militaire actuel: ce sont les sciences physiques et mathématiques enchaînant la force brutale représentée par un lion. Le pommeau offre d'un côté la Fortune et de l'autre saint Georges, patron des braves. Nous goûtons peu, nous l'avouons, l'alliance du sacré et du profane; nous sommes plus classique et aimons l'unité.
La petite épée de cour, également en fer ciselé et or, est plus conforme aux idées que nous venons d'énoncer. Une épée à la cour n'est qu'un ornement, un colifichet, et ne parle que de paix. Aussi sur cette épée, la Paix est assise tenant une corne d'abondance et éteignant le flambeau de la guerre. La Victoire la couvre de son bouclier; des chimères et des mascarons ornent le pommeau de ce joli jouet.
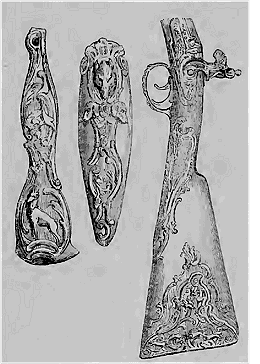
Fusil style Louis XV, exécuté par
M. Caron.--Aspect de la crosse et
développement du porte-baguette et
du dessous de crosse.
Le fusil, nouveau modèle renaissance, exposé par la même maison, montre les efforts intelligents de nos arquebusiers pour secouer le joug de l'imitation anglaise, imposée par la mode. La crosse de ce fusil, dont la forme est svelte, nous a surtout satisfait, parce qu'elle est éminemment susceptible d'une ornementation que ne comportent évidemment pas les formes lourdes et les lignes anguleuses de la mouture anglaise. Cette forme renaissance est le complément de la crosse adoptée aujourd'hui pour les bons pistolets de tir, dont la composition est due à M. Lapret, et est sortie également de la maison Lepage. Rien n'est plus gracieux et plus riche que cette forme, et les ornements du fusil exposé montrent jusqu'où peut aller un artiste aussi éminent que M. Lapret.
Parmi les fusils dont la crosse est ornée avec le plus de goût, nous avons remarqué le fusil style Louis XV, sorti des ateliers de M. Caron. Tous les ornements sont exécutés en acier; la composition et les dessins en sont dus à M. Gilbert. Sur la crosse sont la chasse au renard et la chasse au loup. Rien ne peut rendre le mouvement que l'artiste a su imprimer à toutes ces scènes; ou voit les meutes s'élancer et courir; on entend presque le son du cor, l'hallali et l'aboiement des chiens. Cà et là l'artiste a semé les épisodes; c'est bien le désordre d'une chasse, où chacun court à son but, cherchant à devancer l'autre. Sur la sous-garde sont des têtes de divers gibiers, et au milieu du ponté, la figure allégorique de l'amour de la chasse faisant un appel à ses aînés. Sur les chiens sont d'autres figures allégoriques admirablement exécutées. Honneur à l'artiste et à l'arquebusier qui ont mené à bonne fin une telle entreprise!
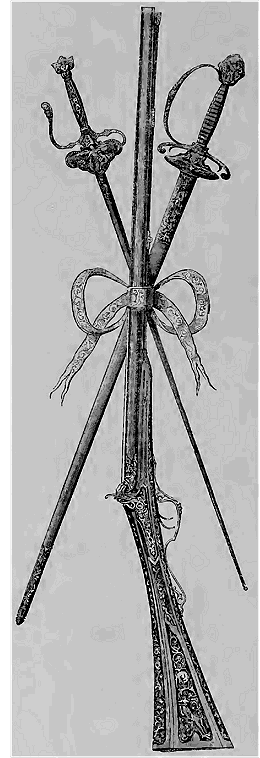
Exposition de l'industrie.--Amurerie.
Fusil et Épée de la fabrique de
M. Moutier-Lepage.
L'exposition de M. Caron se distingue aussi par quelques inventions d'une utilité incontestable. Ainsi, à l'époque des chasses, les journaux retentissent du récit de morts causées par l'imprudence ou l'imprévoyance des chasseurs qui ne désarment pas leur fusil pour sauter un fossé, pour pénétrer dans un bois ou pour charger un coup, ou dont le chien, quoique baissé, se relève par une cause accidentelle, et, en retombant sur la capsule, fait partir le coup de fusil. Eh bien, avec le nouveau chien de M. Caron, ces malheurs ne sont plus possibles. Le chien a une tête mobile et un épaulement. Il suffit de tourner cette partie mobile pour que l'épaulement vienne s'appuyer sur la coquille de la culasse, et empêche le fond du chien de presser sur la cheminée. Nous ne saurions trop recommander cette invention, qui doit, à notre sens, prévenir de grands malheurs. Les autres fusils exposés par M. Caron nous ont paru d'une grande élégance, et nous ne concevons pas l'anglomanie qui nous fait abandonner les industriels français pour ceux d'outre-Manche.
Signalons encore une carabine se chargeant par la culasse, et construite de façon qu'en levant la sous-garde, le canon bascule pour recevoir la cartouche, et le chien s'arme. Tout le mouvement peut parfaitement s'exécuter d'une seule main. Cette arme serait donc d'un excellent usage sur les navires. Enfin de charmants pistolets à quatre, six et huit coups, auxquels M Caron a adapté un système ingénieux, destiné également à prévenir les imprudences, complètent une des cases remarquables de l'exposition.
Mais voyez, non loin de là, cette modeste case où l'on ne remarque qu'un seul fusil avec ses accessoires! Pourquoi la foule s'arrête-t-elle avec tant d'empressement devant cette exhibition? Le nom de l'artiste est-il de ceux que la renommée s'est plu à entourer d'une auréole de gloire, ou le fusil exposé attire-t-il l'attention par la richesse de la matière d'ornementation? Non; l'artiste est à peine connu hors de sa ville natale, et cependant c'est un homme de génie qui peut rivaliser avec les ciseleurs les plus habiles. Son nom est Jourjon; il habite Rennes, consacrant tous ses moments à l'art, Heureux de son obscurité et fier du sentiment intime de sa valeur personnelle. Pour lui l'art est tout son amour; l'industrie n'est que l'accessoire. Aussi, admirez avec quel admirable soin sont traités tous les détails du fusil dont nous offrons les dessins à nos lecteurs. L'auteur a su résister à la mode en revenant à la coupe française élégante et légère, dont les lignes flexibles se prêtent toujours mieux à l'ornementation la plus riche comme la plus simple.
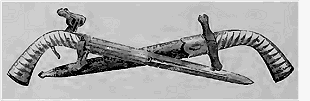
Couteau-Pistolet pour le voyage, par
M. Dumoutier, à
Roudan.
Qu'on nous permette de rappeler en peu de mots les droits du grand artiste de Rennes à la gloire et à la renommée. Les travaux de M. Jourjon datent de loin, et il faut remonter au commencement de ce siècle pour en trouver les premières traces. C'est en 1805 que l'artiste fait ses premières armes.
La crosse du fusil, donné en cadeau à un prince de Bavière, présentait un bas-relief dont le sujet était une bacchanale; les chiens, la platine, la sous-garde, s'étaient transformés en autant de figures de ronde-bosse délicatement sculptées et fouillées avec une persévérance et un art étonnant, dans le bois et dans le métal.

Fusil style Louis XV, exécuté par M.
Caron.--Développement de la batterie,
de la sous-garde et de la plaque de
crosse.
En 1822, la France avait choisi, pour offrir en cadeau au duc de Wellington, un fusil de Jourjon, véritable merveille de l'art. Ce fusil représentait les douze travaux d'Hercule. Plus tard, deux Français ont acquis de M. Jourjon deux fusils, dont l'un représente Actéon dévoré par ses chiens, et l'autre la figure allégorique de l'Envie. On parle bien encore d'un autre fusil, envoyé par l'artiste à Paris en 1830, et qui a disparu dans la tourmente révolutionnaire. On prétend qu'un Anglais habitant l'île Maurice l'a acquis à vil prix. Quoi qu'il en soit, M. Jourjon, qui est à la fois sculpteur, ciseleur, damasquineur et arquebusier, ne s'est pas découragé en perdant le fruit de plusieurs années de travail: il s'est remis à l'œuvre et, en terminant le fusil dont nous allons nous occuper, il a du, assure-t-on: «Exegi monumentum aere perennius.» L'art, en effet, est immortel, les hommes passent, le bois et l'airain disparaissent, la gloire attachée à un nom va seule à la postérité. Le dernier fusil de M. Jourjon, le monument, ne le cède à aucune antre pièce de l'exposition par la grâce et l'originalité de la composition et par le fini des détails; nous retrouvons là les mêmes tours de force de ciselure, la même fermeté de burin. Qu'on remarque les deux pistons; un sphinx se précipite les ailes déployées et la bouche ouverte, sur la capsule qui lui éclate entre les dents. Il est posé, comme un vampire, sur la poitrine d'un homme admirablement modelé qui sert de platine et reçoit, avec un calme héroïque, la détonation de la cheminée sous forme de cornet acoustique; la sous-garde est une figure sévère de Diane qui, un arc à la main et le croissant symbolique au front sort d'une touffe de feuillage.
C'est là, si l'on veut, l'allégorie de la chasse à l'affût. Dans la crosse est sculptée la statue du dieu du silence. Ce que nous venons de dire n'est qu'une description froide et incomplète: la parole ne peut rendre les mille recherches de la sculpture, les coquetteries sans nombre de ce travail précieux. L'étui du fusil, avec son moule à balles, son tournevis, sa fiole pour l'huile et tous ses autres accessoires, est aussi étonnant de recherches et de détails que le fusil lui-même. Tout cet ensemble, ciselures sur acier, gravures damasquinées, incrustations en or et sculpture sur bois, nous semble devoir attirer sur son auteur les récompenses du jury, comme il a déjà mérité l'attention et l'admiration de la foule.
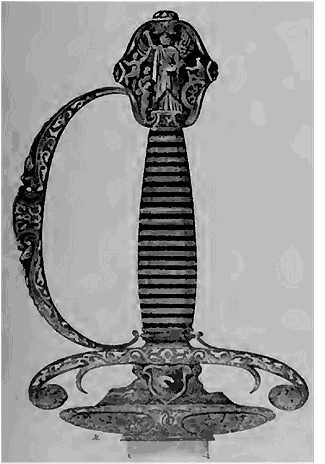
Poignée de l'Épée de la fabrique de
M. Moutier-Lepage.
MM. Dumonthier et Chartron, couteliers à Roudan, près Nantes, ont exposé un couteau-pistolet dont nous donnons le dessin. Ce couteau, d'une composition originale, nous a semblé pouvoir être d'un bon usage, soit pour la chasse à la bête fauve, soit en voyage. Nous le représentons sous deux aspects; au repos, avec sa gaine, et dégainé, le croisillon servant de chiens pour les deux pistolets qui sont de chaque côté de la lame, relevé et armé et prêt à faire feu. Pourtant disons franchement que nous n'avons pas une grande inclination pour ces armes à deux ou trois fins: l'une, à notre avis, doit nuire à l'autre. Quand nous voyons une de ces armes réputées terribles entre les mains d'un homme, il nous semble voir un de ces malheureux artistes ambulants, orchestre complet, jouant des timbales avec ses genoux, de la grosse caisse avec son coude, du chapeau chinois avec sa tête, du chalumeau avec la bouche, et tenant un violon entre ses mains. Ce pauvre homme peut posséder à fond un de ces instruments et être de première force sur la grosse caisse ou le chapeau chinois isolément: mais de tout cet ensemble résulte un charivari à faire aboyer tous les chiens du quartier. Loin de nous la pensée d'appliquer cette comparaison au couteau-pistolet dont nous venons de parler, mais notre conviction est que, pour bien faire une chose, il faut n'en faire qu'une à la fois.
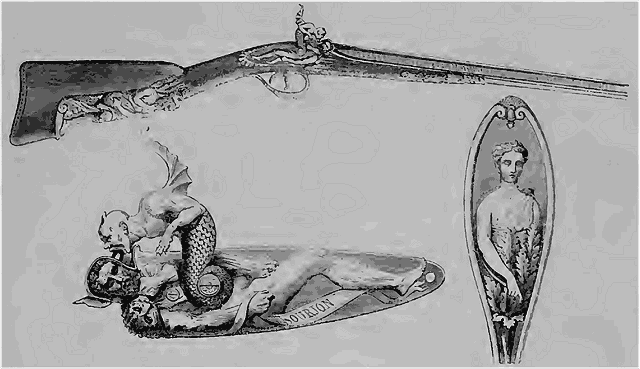
Fusil sculpté exécuté par M. Jourjon, armurier à Rennes,
Ile-et-Vilaine.
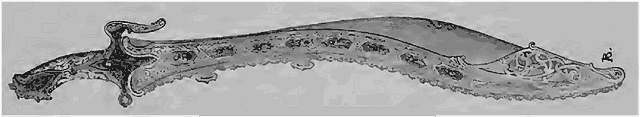
Développement du Coutelas du duc de Luynes.
L'exposition de M. Gastinne-Renette est une des plus remarquables pour l'exécution des armes et surtout la composition du métal des canons de fusil à rubans. Cet arquebusier a imaginé un nouveau procédé pour les façonner. On sait que le ruban qui compose ces canons est formé d'une lame plate roulée en hélice et soudée bord à bord; c'est toujours par le défaut de ces soudures que le fusil éclate. M. Gastinne-Renette a formé son ruban par la juxtaposition de deux prismes triangulaires superposés de façon que le sommet de l'un s'insère à la hase de l'autre. De cette façon les points de contact des soudures ainsi pratiquées dans des plans obliques à l'axe du canon se trouvent augmentés. L'inconvénient des travers, c'est-à-dire des défauts de soudure, est plus sûrement évité. Des canons ainsi confectionnés ont résisté à l'épreuve d'une charge de 50 grammes de poudre et de 8 balles de plomb. La charge ordinaire est de 3 à 4 grammes de poudre et de 10 grammes de plomb. M. Gastinne-Renette a un titre de plus à la reconnaissance du public. C'est lui qui a si habilement secondé de son zèle et de ses connaissances M. Delvigne dans les heureuses innovations que cet officier a introduites dans les armes de guerre. Nous voudrions pouvoir en entretenir nos lecteurs, mais les bornes de cet article ne nous le permettent pas. Le progrès fait dans ce sens est immense, et l'on éprouve en ce moment des carabines qui tiennent pour ainsi dire l'ennemi hors de la portée du canon. On prétend que ces carabines portent sûrement à 1,200 mètres.

Poignée du Coutelas du duc de Luynes.
Avant de terminer notre compte rendu, disons un mot des magnifiques lames en acier fondu et damassé fabriqué par M. le duc de Luynes. On sait quelle immense réputation avait acquise, après l'expédition des Français en Égypte, l'acier damassé de l'Inde et de la Perse. Les lames orientales étaient d'une beauté incomparable, et longtemps on chercha en France, mais en vain, à imiter leurs qualités et leur veine ronceuse.
On fit des essais les plus suivis pour y arriver, et quelques habiles chimistes obtinrent de très beaux résultats, soit par l'alliage' de différents métaux avec l'acier fondu, soit par le mélange de la fonte avec la fonte oxydée. Ce n'est que par l'analyse la plus savante et les recherches les plus patientes que M. de Luynes est parvenu à déterminer chimiquement la composition des lames et des culots venus d'Asie, et à établir une fabrication courante qui ne le cède en rien aux beaux aciers damassés dus au célèbre armurier Assad-Allah. Les aciers des Indes contiennent constamment certaines substances alliées au fer, mais en proportions variables. Ainsi le nickel, le tungstène, le manganèse, parfois, le cobalt, le fer et le carbone, tels sont les éléments des lames orientales. De plus, les culots imparfaitement fondus, ayant montré à leur partie supérieure des clous de différentes formes, dont les pointes étaient engagées et dont la tête faisait saillie en dehors, on en a conclu que les Orientaux fabriquaient d'abord une sorte de fonte très-fusible et très-dure à cause de sa grande carburation, qu'ensuite ils la ramenaient au degré convenable d'aciération, par l'addition de clous de fer. Des essais faits dans cette direction ont prouvé la sagesse de ces inductions et ont amené l'habile chimiste à la composition qu'il a adoptée pour ses lames damassées. La préparation sur laquelle nous ne pouvons entrer dans de grands détails ces des plus délicates. Il faut mélanger et combiner dans de certaines proportions le fer doux, le manganèse et la sciure de chêne qui fournit le carbone. Après la fusion on casse en petits morceaux la masse obtenue et on la remet au feu avec une certaine quantité de fer doux. C'est ainsi que M. de Luynes est parvenu à doter la France d'une industrie nouvelle et de produits qui soutiennent avantageusement la concurrence et la comparaison avec les beaux aciers damassés de l'Orient. Honneur à l'homme qui a su consacrer ses loisirs et sa fortune à cette œuvre toute nationale, et qui n'a pas craint que la fumée de ses creusets ternit son blason de grand seigneur!
Bulletin bibliographique.
Études sur l'Histoire romaine; par Prosper Mérimée. 2 vol. in-8.--Paris, 1844. Victor Magen. 15 fr.
Ceux de nos lecteurs qui ont étudié le procédé de composition de M. Mérimée, et à qui les ouvrages de cet écrivain remarquable sont familiers, n'éprouveront sans doute aucune surprise en le voyant renoncer aux œuvres de fantaisie pour se plier à la règle austère de l'histoire. L'auteur de Colomba possède en effet à un très-haut degré les qualités principales de l'histoire, une érudition vaste et intelligente, une rare sobriété d'esprit: une raison élevée qui trouve sa source dans la modération et l'expérience; enfin un tact parfait qui lui permet de retrouver toujours les passions de l'homme sous le masque dont elles se couvrent.
Dans ses travaux archéologiques, si exacts et si sévères, M. Mérimée a déjà montré que ses belles facultés de conteur n'exercent point sur son imagination une influence trop exclusive. Les quatre volumes qui composent cette œuvre consciencieuse ont exigé une assez forte dépense d'érudition, pour que les titres de l'inspecteur des monuments historiques soient aussi solides et aussi sérieux que ceux du charmant romancier. C'est donc sans effort, c'est donc avec une foule de préventions favorables que le public doit accueillir le nouvel ouvrage de M. Mérimée. Il y a entre les beaux récits de la Chronique du temps de Charles IX et les meilleures pages des Études, une relation facile à saisir et à suivre. Sous les arabesques du roman, comme sous la broderie rigoureuse de l'histoire, ou retrouve le même fond d'observation fine et profonde.
Les deux volumes que nous avons sous les yeux comprennent un essai sur la guerre sociale et une histoire de la conjuration de Catilina. Nous nous occuperons d'abord de l'essai sur la guerre sociale. Ce travail est divisé en trois parties. La première embrasse le cours des quarante années qui procèdent l'ouverture des hostilités. Ou y voit éclore et mûrir les causes de cette étonnante prise d'armes; on voit pour ainsi dire se former à l'horizon les nuages menaçants qui bientôt lanceront la foudre sur Rome. C'est le prélude de l'orage,--de vagues éclairs et un tonnerre lointain.--Mille rumeurs circulent rapidement dans la Péninsule; enfin, des mains inconnues ne cessent pas de jeter des ferments de haine au sein de ces populations d'ailleurs travaillées par les tribuns de la métropole et par les nobles italiotes, jaloux de se dérober au patronage égoïste des grandes familles. Au milieu de cet ouragan qui s'élève, apparaissent les champions de l'émancipation, les Gracchus, Drusus, Saturnius.--La partie est engagée; les joueurs sont en présence, et l'enjeu est sur la table.
La seconde partie nous entraîne sur les champs de bataille où, après des efforts admirables, la confédération italienne ne tardera pas à succomber. Nous voyons périr, l'une après l'autre, toutes ces armées qui eurent leurs jours de triomphe, et qui effrayèrent Rome au point de lui rappeler les jours terribles de l'invasion des barbares. Nous rencontrons tour à tour le vieux Marius, face de lion qui faisait peur aux Cimbres, et Sylla, ce philosophe sanglant qui fut toujours si heureux.
Au souffle puissant de ces hommes de guerre, le flux des peuples révoltés, qui avait inondé l'Italie, commence à décroître rapidement. Les armées romaines regagnent le terrain perdu; les Vaincus meurent ou s'éloignent. Encore un triomphe pour Rome!
La troisième partie achève de raconter les défaites de la diète italienne; mais avant de s'éteindre, cette courageuse insurrection jettera une dernière lueur vers le ciel. Conduite par Pontius Telesinus, une armée de Lucaniens, de Samnites et d'Étrusques vient camper à un mille de la métropole, devant la porte Colline. Les confédérés, altérés de vengeance, voient briller au soleil les tours de Rome. «C'est la tanière des ravisseurs, crie le général, brûlons-la, détruisons-la; tant que la forêt maudite ne sera pas rasée, les loups ne laisseront pas de liberté à l'Italie.» La ville éternelle résistera-t-elle à cette dernière agression? Il y eut dans Rome un moment d'indicible épouvante; mais l'armée de Sylla s'avance à grands pas. La lutte fut terrible.--Les derniers bataillons de la diète restèrent sur le champ de bataille, où les vainqueurs, épuisés, comptèrent cinquante mille morts. On chercha longtemps Telesinus; «on le trouva enfin percé de coups, mais respirant encore, entouré de cadavres ennemis. L'orgueil du triomphe se lisait dans ses yeux éteints, qu'il tournait encore menaçants vers Rome. Heureux si la mort le surprit tandis qu'il se croyait vainqueur.»
Telle fut l'issue de la guerre sociale, qui jeta son dernier cri sous les murailles de Rome, et qui prépara la voie où entra Sylla, suivi de ses vingt-quatre licteurs aux haches ensanglantées.
La conjuration de Catilina n'offre pas un intérêt moins vif: les hommes qui prennent part à cette nouvelle entreprise ont même des proportions plus héroïques. Ainsi, si on n'entend plus parler du sauvage Marius, ou voit se lever au milieu du récit les immortelles figures de César, de Pompée et de Cicéron. Le héros de la conjuration, Catilina, ne manque pas non plus d'une certaine grandeur romanesque. Salluste flétri ses crimes, mais il semble éprouver une admiration contagieuse lorsqu'il le peint avec ces mots: «Vastus animus, immoderuta, incredibilia, numis alta, semper cupiebat.» A coup sûr cet esprit exalté, qui visait au sublime, n'était pas un conspirateur vulgaire. D'ailleurs, si les singulières actions de sa vie ne suffisent pas à le sauver du mépris des gens de bien, l'héroïsme de sa mort ne doit-il pas lui mériter quelque estime? «il est beau, comme dit Salluste, de périr en couvrant de son cadavre la place ou, vivant, on a combattu.»
M. Mérimée, en abordant cette période de l'histoire romaine, ne s'est pas abusé sur les difficultés de son entreprise. Il savait que les historiens de cet événement, Salluste, Cicéron, Suétone, Plutarque, etc., n'ayant pas pu ou n'ayant pas voulu nous livrer le mot de l'énigme, il lui était difficile de prétendre expliquer ce mystère. S'il n'a donc pas entièrement soulevé le voile, il a du moins jeté un vif rayon de lumière sur le front du conspirateur. Dans un tableau très-animé de la société romaine à cette époque, il a indiqué les causes de la domination que Catilina exerça sur la jeunesse patricienne. Il a ainsi fait comprendre la neutralité, sinon la complicité de Jules César et les honneurs qui furent rendus aux mânes de l'homme mystérieux que le sénat avait essayé de flétrir du nom d'ennemi public.
A coup sûr, si une rare sagacité, fortifiée par des recherches consciencieuses, avait pu résoudre une question que les contemporains ont laissée dans l'obscurité, M. Mérimée aurait complètement réussi. Dans l'introduction de son livre, il se propose surtout d'être sincère et précis; on peut dire qu'il a dépassé le but; car, à ces deux qualités que personne ne lui contestera, il joint celle d'être un écrivain toujours ingénieux et attachant.
G.
Histoire, d'Espagne depuis les premiers temps historiques jusqu'à la mort de Ferdinand VII; par M. Rosseeuw-Saint-Hilaire, professeur agrégé d'histoire à la Faculté des Lettres. Nouvelle édition, revue et corrigée. Tome 1er. 1 vol. in-8.--Paris, 1844. Furne. 5 fr.
Il y a dix ans que M. Rosseeuw-Saint-Hilaire a commencé ce grand travail qu'il refait aujourd'hui. La nouvelle édition de son Histoire d'Espagne formera 10 volumes in-8, qui paraîtront de mois en mois. Le premier vient d'être mis en vente. Nous y avons remarque d'importantes améliorations que nous nous empressons de signaler.
Le premier plan de M. Rosseeuw-Saint-Hilaire avait été de sauter à pieds joints par-dessus les débuts si obscurs des annales de la Péninsule, pour arriver tout droit à l'invasion gothique, point de départ de l'Espagne moderne. Mais la nécessité d'étudier au berceau même de la race ibérique ses mœurs et son caractère, si fidèlement continuées par la race espagnole, l'a décidé à résumer dans une introduction rapide la marche des trois dominations successives qui ont passé sur la Péninsule avant la domination gothique. Les conquêtes phéniciennes et carthaginoises, si peu et si mal connues, y sont moins racontées que jugées, en passant, dans leurs résultats généraux, tenant à la conquête romaine, qui forme à elle seule un ensemble aussi complet que celui de la monarchie gothique, il a dû lui accorder une place plus étendue, sans tomber toutefois dans les interminables longueurs des historiens espagnols. Un aperçu de l'organisation politique et sociale établie par Rome dans la Péninsule complète ce tableau auquel M. Rosseeuw-Saint-Hilaire a joint une courte histoire de l'établissement du christianisme sur ce sol où il a jeté de bonne heure de si profondes racines.
Outre cette introduction, ce premier volume renferme toute l'histoire de l'Espagne gothique, divisée en deux livres. M. Rosseeuw-Saint-Hilaire prend les Goths à leur origine, nous les montre conquérant l'Espagne 410 ans après Jésus-Christ, y fondant un royaume, se convertissant au catholicisme, gouvernant leur conquête pendant trois siècles, et enfin se laissant battre par les Arabes à la fameuse bataille du Guadalete. En terminant son second livre, le jeune et savant historien dit un dernier adieu à ce peuple qu'il a suivi des bords de la mer Noire à ceux du Guadalete. «Nous ne le retrouverons plus dans l'histoire, s'écrie-t-il, car lorsque nous verrons poindre dans les Asturies une monarchie et un peuple nouveau, il ne sera plus question des Goths, mais de la monarchie et du peuple espagnols; il n'y aura plus pour les soldats de Pelago qu'une foi, qu'un nom, qu'un idiome, qu'un même amour de l'indépendance, qu'une même haine de l'étranger. Tel sera, jusqu'à la fin du quinzième siècle, le seul lien commun entre les cinq ou six royaumes qui naîtront des débris de l'empire gothique, pour tendre pendant huit siècles vers cette unité qu'ils ne sont pas même bien sûrs d'avoir trouvée aujourd'hui.»
Le droit occupera une place importante dans cette nouvelle édition de l'Histoire d'Espagne. M. Rosseeuw-Saint-Hilaire a parfaitement compris que la science de la législation a jusqu'ici été trop séparée de l'histoire, et que toutes les deux n'ont qu'à gagner à être rapprochées. Après avoir achevé l'histoire des Goths, il étudie dans toutes ses parties le Forum judicum, ou le code gothique, code essentiellement théocratique, écrit par et pour le clergé, où l'on parle peu de l'Église, mais où tout, en fin de compte, aboutit à elle.
Sept appendices curieux sur la langue basque, la langue gothique, les actes du concile de Braga, le rituel gothique, les institutions des Ostrogoths, le roi Roderich, la langue espagnole, et un tableau des législations comparées, forment les pièces justificatives de ce premier volume, imprimé avec le soin particulier que la librairie Furne apporte à toutes ses publications, et publie au plus bas prix possible.
Œuvres choisies de Campanella, précédées d'une Notice; par madame Louise Colet. 1 vol. in-18.--Paris. 1844. Lavigne. 3 fr. 50.
Pendant les vingt-sept années qu'il passa dans les prisons des Espagnols, Campanella écrivit, lorsque ses bourreaux cessaient de le torturer, un nombre considérable de traités de logique, de physique, de morale, de métaphysique et de politique Si hardies et si nouvelles qu'elles fussent alors, les vérités qu'il proclamait n'ont plus qu'un intérêt historique. Notre siècle les a toutes dépassées; aussi les dix volumes in-folio du moine dominicain de Cosenza restent-ils enfouis sous les rayons des bibliothèques publiques, et ne sont-ils lus maintenant, à de rares intervalles, que par un très-petit nombre d'esprits curieux et méditatifs. Mais Campanella n'a pas été seulement un philosophe, un savant et un homme d'État, il a cultivé la poésie. Or le propre des productions de l'imagination, des œuvres de sentiment, est de ne point vieillir. Si l'esprit humain se perfectionne, le cœur reste toujours le même. Nos connaissances se sont étendues et tendent à s'étendre chaque jour. Mais les plus grands poètes de l'antiquité et du moyen âge n'ont pas encore été et ne seront peut-être jamais surpassés par les poètes modernes.
Persuadée sans doute de cette incontestable vérité, madame Louise Colet a cru devoir traduire en français quelques-unes des poésies de Campanella et une partie de sa correspondance. A ce choix de fragments elle a ajouté la Cité du Soleil, écrite en latin, et traduite également en français par M. Jules Rosset.
«Dans ses poésies, Campanella semble, dit-elle, avoir réuni sa philosophie, sa politique et sa morale. Jamais son esprit ne s'est élevé plus haut, jamais son regard n'a porté plus avant. Dans quelques sonnets, et surtout dans ses admirables Canzone, il fait un sombre et pathétique tableau des malheurs du temps et de son propre martyre. Il parle tour à tour au peuple et aux puissants le langage qui doit les éclairer; il pressent les révolutions; il les provoque, dans sa juste et sainte colère, et il cherche à les guider dans sa sagesse. Sa pensée indomptable éclate dans des vers d'une concision dantesque, et parfois aussi, il faut le dire, se perd dans les obscurités de la métaphysique. Nous avons courageusement lutté avec cette énergique poésie, prodigue d'idées, avare de mots. Nous ne pensons pas avoir vaincu toutes les difficultés; mais nous espérons qu'on trouvera du moins dans notre traduction le sens inaltérablement beau de l'original.»
A la suite des poésies et des lettres, madame Louise Colet a réuni les jugements de divers philosophes et historiens sur Campanella. Enfin, grâce à l'obligeance de M. Feuillet de Conches, possesseur d'une lettre autographe du moine de Stilo, elle a pu offrir à ses lecteurs un fac simile de cette écriture si rare.
Ce petit volume s'ouvre par une Notice un peu trop romanesque sur Campanella; mais madame Louise Colet nous affirme, dès le début, que malgré le tour étrange de ce travail, chaque description de lieu, chaque fait historique, chaque date, chaque détail sont scrupuleusement vrais. Nous sommes trop poli pour en douter.
Œuvres de Turgot, nouvelle édition classée par ordre de matières, avec les notes de Dupont de Nemours, augmentée de lettres inédites, des questions sur le commerce, et d'observations et de notes nouvelles; par MM. Eug. Daire et H. Dussard; et précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de Turgot, par M. Eug. Daire. 2 beaux volumes grand in-8, de 800 pages chacun, avec un portrait de Turgot gravé sur acier. 20 fr. Paris, 1844. Guillaumin.
Nous répéterons à nos lecteurs ce que disait dernièrement M. Passy à ses collègues de l'Académie des sciences morales et politiques: «Nous ne vous entretiendrons ni de Turgot ni de ses nombreux écrits. Ce n'est pas ici qu'il faut rappeler quelle fut la noble vie de Turgot et combien ses travaux ont de prix et jettent de lumière sur l'état et le mouvement des sciences économiques en France pendant la seconde moitié du siècle dernier. Ce que nous avons à signaler, c'est le merite éminent de l'édition nouvelle. Les Œuvres de Turgot entraient de plein droit et devaient occuper une grande place dans la belle collection des principaux économistes, dont M. Guillaumin est l'habile éditeur.» Jusqu'à ce jour, en effet, il n'avait existé qu'une seule édition à peu près complète des œuvres du célèbre ministre de Louis XVI. Cette édition, publiée par Dupont de Nemours, contenait neuf volumes. Le classement irrationnel des matières offrait en outre de graves inconvénients qui ont été évités avec soin dans l'édition nouvelle. Au lieu de l'ordre chronologique, M. Eug. Daire a eu l'heureuse idée d'adopter l'ordre des matières proprement dit, de sorte que le lecteur puisse suivre les idées de l'auteur sur chaque sujet dans leur marche et dans leur développement sans être condamné à de longues et pénibles recherches. De plus, il publie pour la première fois des documents précieux, entre autres des lettres inédites et le procès-verbal du lit de justice tenu à Versailles le 12 mai 1776, pour l'enregistrement des édits sur l'abolition de la corvée et des jurandes, monument curieux de l'histoire économique et politique des derniers temps de l'ancien régime. Enfin aux notes de Dupont de Nemours en ont été jointes de nouvelles, rédigées tout exprès par MM. Daire et Dossard. Les changements accomplis depuis un demi-siècle sont tels que certains passages des œuvre de Turgot ne pourraient plus être compris s'ils n'étaient pas expliqués, car il ne reste maintenant aucune trace des faits auxquels ils se rapportent.
Cette nouvelle édition est précédée d'une notice sur Turgot, par M. E. Daire. Ce n'est pas seulement l'histoire de Turgot et de ses ouvrages, c'est celle des dernières années du dix-huitième siècle. Après avoir lu cette intéressante notice, on comprend mieux que jamais l'urgente nécessité de la révolution française. Le grand ministre qui seul défendait l'intérêt général entre la coalition des intérêts privés s'était vu sacrifié par le roi aux clameurs de l'égoïsme. Louis XVI voulait sincèrement le bonheur du peuple; mais il renvoya le seul homme capable de soutenir son autorité chancelante. Le 12 mai 1776, Turgot quitta le ministère. «Ce fut, a dit avec raison un historien contemporain, une des époques les plus fatales pour la France.» Presque toutes les reformes que Turgot avait opérées disparurent sous ses successeurs. Mais ce qu'ils n'eurent pas la puissance d'anéantir, ce lut l'esprit qui les avait dictées et qui devait, malgré tous leurs efforts, fonder en France le principe de l'égalité civile, acheté par nos pères au prix de sacrifices sanglants, que le génie du ministre de Louis XVI avait prévus et voulait leur épargner. L'étude approfondie de cette époque mémorable contient encore d'utiles enseignements pour la nôtre. Les hommes d'État qui gouvernent la France pourraient lire avec profit les œuvres de Turgot et la notice de M. Eugène Daire. Ils y puiseraient une foule de leçons que nous ne saurions trop les engager à méditer.
Histoire des Expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en France au dixième siècle; par M. Depping; ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Nouvelle édition entièrement refondue. Un vol. in-18.--Paris, 1844. Didier. 3 fr. 50 c.
En 1820, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, à Paris, mit au concours, pour le sujet d'un prix, la question des causes qui ont motivé les nombreuses émigrations des peuples connus sous le nom de Normands, et l'histoire de leurs établissements en France. Jusqu'à ce jour, en effet, les expéditions de ce peuple n'avaient guère de mises en rapport avec l'histoire des pays qu'ils ravagèrent et où ils séjournèrent. M. Depping concourut, et il remporta le prix. Son ouvrage, couronné en 1822, ne fut imprime qu'en 1826. A peine eut-il paru, son auteur commença à sentir, comme il le déclare lui-même, tout ce qui y manquait; des documents inédits parurent successivement; d'autres sociétés savantes, stimulées par l'exemple de l'Académie des Inscriptions, provoquèrent de nouvelles recherches sur quelques parties de cet intéressant sujet. De là résulta pour M Depping l'obligation de soumettre les sources historiques à un nouvel examen. Malgré l'accueil bienveillant fait à son premier ouvrage, qui a été traduit dans plusieurs langues du Nord, il l'a refait en grande partie, et il le présente aujourd'hui au public comme un ouvrage presque nouveau. Nous ne doutons pas que ses désirs ne soient satisfaits, et que le public ne reconnaisse les soins qu'il a pris pour rendre son travail plus digne de ses suffrages.
La loterie au profil de l'œuvre du Mont-Carmel sera tirée le lundi 1er juillet, à une heure précise, au palais du Luxembourg, et sera précédée d'un concert auquel veulent bien concourir les artistes les plus distingués. Le Comité a l'honneur d'annoncer qu'on sera admis sur la présentation d'un billet de loterie ou du récépissé d'un lot, qui ne donneront droit qu'à une entrée personnelle.
On pourra trouver encore des billets à l'entrée de la salle et à celle de l'exposition.
Mademoiselle Taglioni.

Le pas de l'Ombre.
Modes.

Paris a voulu fêter le retour de la gracieuse sylphide, et les représentations de Marie Taglioni ont donné aux toilettes du soir l'occasion de jeter pour cette saison leur dernier éclat. Les femmes se sont parées de leurs plus jolies robes, de leurs plus beaux bijoux et des fleurs les plus fraîches.
Les robes de tarlatane à deux grands volants qui couvrent la jupe entièrement, puisque le second part de la ceinture, et qui ont plutôt l'air de deux jupes posées sur une troisième; les robes à deux et trois jupes et les hauts volants de dentelle posés presque à plat sur cette mousseline si claire, étaient en majorité.
Quelques robes de pékins glacés ou pékins à petites rayures garnies de rubans à la Pompadour venaient varier un peu l'aspect uniforme de ces blanches toilettes par trop sylphides.
Pour la coiffure, on porte toujours beaucoup de fleurs naturelles et de vieux bijoux. En général, les coiffures en cheveux sont très-simples. Le règne des coiffeurs est passé, l'art s'en va. Les grands artistes en sont réduits à se rappeler leurs triomphes d'autrefois.
Ce n'est pas seulement à notre époque, comme on les en accuse, que les coiffeurs ont pris le titre d'artistes. Nous voyons au bas des gravures de modes publiées par un sieur Depain, au commencement de la révolution: «Le sieur Demain continue d'enseigner l'art de coiffer.» Mais alors les coiffeurs méritaient vraiment ce titre. Que d'art ne fallait-il pas pour établir sur la tête ces édifices tout chargés de plumes, de fleurs et de rubans! la coiffure à l'espoir, coiffure à la nation, coiffure aux charmes de la liberté; cette dernière, qui ne laissait guère la liberté des mouvements, semblait l'emblème de celle dont on jouissait alors.
Depuis ce temps, la coiffure a subi bien des transformations. De changements en changements, elle est arrivée à sa plus simple expression.
Maintenant que tout est dit sur les bals et les spectacles, on s'occupe des préparatifs de départ pour la campagne. Les coutils de fil à rayures espacées sur fond blanc en couleurs fraîches, telles que bleu, vert et rouille, font des redingotes simples et jolies; les corsages sont montants, justes, et sans autre ornement qu'une rangée de boutons d'ivoire ou de nacre.
On fait aussi beaucoup de robes à revers qui laissent voir dessous un fichu de batiste plissé, à petit col brodé, garni de valenciennes. Les manches sont à la religieuse avec revers, dessous de manches en batiste, et entre-deux brodés. Les écharpes algériennes et les chapeaux de paille ouvragés compléteront très-bien ces parures champêtres.
Il se pose plus de biais sur les robes de soie que de volants. Ces biais sont presque toujours de coupes à grandes dents, dites gueules de loup, et bordés d'un plissé de ruban, d'une passementerie ou d'un effilé.
Beaucoup de robes de barège et de robes d'organdi ou tarlatane de couleur ont des volants festonnés; les corsages sont alors à revers festonnés comme les volants.
La lingerie est très-riche dans ce moment. Aux charmants petits bonnets du matin, aux fichus, aux sous-manches, peignoirs, etc., viennent encore se joindre de délicieux canezous, qui rehaussent l'élégance des toilettes d'été. On ne porte pas de pèlerine, le canezou l'a détrônée; il règne seul dans les modes de la saison. Les plus jolis se font à entre-deux de tulle et bouillon de mousseline.
Alexandrine, non contente des succès que lui ont valu ses capotes du printemps en crêpe, ses chapeaux en paille de riz, ornés de marabouts ombrés, ses capotes en rubans nuancés, garnies de fleurs ou de crêpe doublé d'Angleterre, et tant d'autres coquetteries qui ajoutent tous les jours à sa célébrité, prépare encore de nouvelles coiffures, de nouvelles séductions.
On fait, pour la prochaine saison des eaux, des robes tarlatanes brodées en paille, d'autres au point de chaînette de couleurs. C'est aussi pour ces réunions que les vieux bijoux sont très-recherchés. Le fichu du matin ou le canezou ne saurait être attaché autrement que par une petite épingle en grenat ou en chrysoprase entourée de marcassite. A la ceinture il faut une châtelaine. Une ou deux grosses bagues sont également indispensables. Et l'on ne peut se passer d'épingles pour la coiffure, de bracelets, d'échelles de corsage en grosses coques de perles entourées de marcassites, et enfin de chaînes, toujours de marcassite, car ces chaînes trouvent partout à se placer, soit retenues par des épingles semblables dans les cheveux, soit suspendues à l'épingle du corsage.
Rébus.
EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS.
C'est en vain que l'étranger tenterait d'humilier la France ou de l'abaisser.