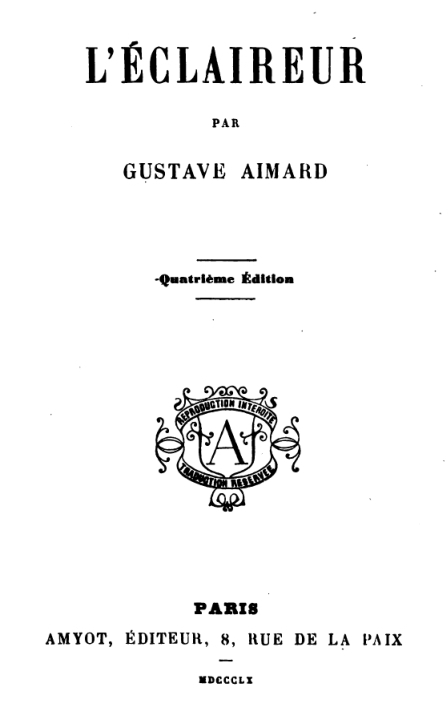
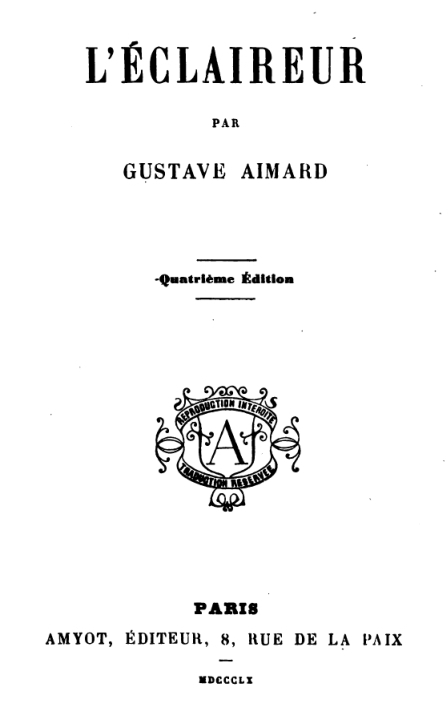
C'était vers la fin de mai 1855, dans un des sites les plus ignorés des immenses prairies du Far-West, à peu de distance du Río Colorado del Norte, que les tribus indiennes de ces parages nomment, dans leur langage imagé, le fleuve sans fin aux lames d'or.
Il faisait une nuit profonde. La lune aux deux tiers de sa course montrait, à travers les hautes branches des arbres, sa face blafarde, dont ne s'échappaient qu'avec peine de minces rayons d'une lumière tremblotante qui ne laissait distinguer que vaguement les accidents d'un paysage abrupte et sévère. Il n'y avait pas un souffle dans l'air, pas une étoile au ciel. Un silence de mort planait sur le désert. Silence interrompu seulement à de longs intervalles par les glapissements saccadés des coyotes en quête d'une proie, ou les miaulements ironiques de la panthère et du jaguar à l'abreuvoir.
Pendant les ténèbres, les grandes savanes américaines, où nul bruit humain ne trouble la majesté de la nuit, prennent, sous l'œil de Dieu, une imposante splendeur qui remue à son insu le cœur de l'homme le plus fort et le pénètre malgré lui d'un religieux respect.
Tout à coup les branches serrées d'un buisson de floripondios s'écartèrent avec précaution, et dans l'espace laissé vide apparut la tête anxieuse d'un homme dont les yeux brillants comme ceux d'une bête fauve lançaient dans toutes les directions des regards inquiets. Après quelques secondes d'une immobilité complète, l'homme dont nous parlons quitta le buisson au milieu duquel il était caché et s'élança d'un bond au dehors.
Bien que son teint hâlé eut atteint presque la couleur de la brique, cependant à son costume de chasse et surtout la nuance blonde de ses longs cheveux et à ses traits hardis, francs et accentués, il était facile de reconnaître en cet homme un de ces audacieux coureurs des bois canadiens dont la forte race s'éteint tous les jours et tend à disparaître avant peu.
Il fit quelques pas, le canon de son rifle en avant, le doigt sur la détente, inspectant minutieusement les taillis et les fourrés sans nombre qui l'entouraient; puis, rassuré probablement par le silence et la solitude qui continuaient à régner aux environs, il s'arrêta, posa à terre la crosse de son rifle, pencha le haut du corps en avant, et imita à s'y méprendre le chant du centzontle, le rossignol américain.
A peine la dernière modulation de ce chant, doux comme un soupir d'amour, vibrait-elle dans l'air, que du même buisson qui déjà avait livré passage au chasseur, s'élança un second personnage.
Celui-ci était un Indien; il vint se placer auprès du Canadien, et après quelques secondes de silence:
—Eh bien? lui demanda-t-il en affectant une tranquillité peut-être loin de son cœur.
—Tout est calme, répondit le chasseur, la Cihuatl peut venir.
L'Indien secoua la tête.
—Depuis le lever de la lune, Mahchsi-Karehde est séparé de l'Églantine, il ignore où elle se trouve en ce moment.
Un bienveillant sourire plissa les lèvres du chasseur.
—L'Églantine aime mon frère, dit-il doucement, le petit oiseau qui chante au fond de son cœur l'aura guidé sur les traces du chef; Mahchsi-Karehde a-t-il oublié le chant avec lequel il l'appelait à ses rendez-vous d'amour dans la tribu?
—Le chef n'a rien oublié.
—Qu'il appelle donc alors.
L'Indien ne se fit pas répéter cette invitation; le cri du Walkon s'éleva dans le silence.
Au même instant on entendit un froissement de branches, et une jeune femme, bondissant comme une biche effrayée, vint tomber haletante dans les bras du guerrier indien qui s'étaient ouverts pour la recevoir. Cette étreinte n'eut que la durée d'un éclair; le chef, honteux sans doute devant un blanc, bien que ce blanc fût son ami, du mouvement de tendresse auquel il s'était laissé entraîner, repoussa froidement la jeune femme en lui disant d'une voix dans laquelle ne perçait aucune trace d'émotion:
—Ma sœur est sans doute fatiguée, nul danger ne la menace en ce moment; elle peut dormir, des guerriers veilleront sur elle.
—L'Églantine est une fille comanche, répondit-elle d'une voix timide, son cœur est fort, elle obéira à Mahchsi-Karehde (l'Aigle-Volant); sous la protection d'un chef aussi redoutable elle sait qu'elle est en sûreté.
L'Indien lui lança un regard empreint d'une indicible tendresse; mais reprenant presque aussitôt cette apparente impassibilité dont les peaux-rouges ne se départent jamais:
—Les guerriers veulent tenir conseil, que ma sœur dorme, dit-il.
La jeune femme ne répliqua point, elle s'inclina respectueusement devant les deux hommes, et, s'éloignant de quelques pas, elle se blottit dans l'herbe, ferma les yeux et s'endormit ou parut s'endormir.
Le Canadien s'était contenté de sourire en voyant le résultat obtenu par le conseil qu'il avait donné au guerrier; il avait écouté, en hochant approbativement la tête, les quelques mots échangés entre les deux peaux-rouges. Le chef, abîmé dans ses pensées, resta quelques instants les yeux fixés avec une expression indéfinissable sur la jeune femme endormie; enfin il passa à plusieurs reprises la main sur son front comme pour dissiper les nuages qui assombrissaient son esprit, et se tournant vers le chasseur.
—Mon frère, le visage pâle a besoin de repos, un chef veillera, dit-il.
—Les coyotes ont cessé de glapir, la lune a disparu, une bande blanchâtre s'élève à l'horizon, répondit le Canadien; le jour ne tardera pas à paraître, le sommeil a fui mes paupières, les hommes doivent tenir conseil.
L'Indien s'inclina sans répondre, posant son fusil à terre il ramassa plusieurs brassées de bois sec qu'il porta auprès de la dormeuse.
Le Canadien battit le briquet; bientôt le feu jaillit, le bois s'embrasa, la flamme colora les arbres de ses reflets sanglants; alors les deux hommes s'accroupirent auprès l'un de l'autre, bourrèrent leurs calumets de manachée le tabac sacré, et commencèrent à fumer silencieusement avec cette imposante gravité que les Indiens, en toutes circonstances, apportent à cette symbolique opération.'
Nous profiterons du moment de répit que nous offre le hasard pour faire le portrait de ces trois personnages appelés à jouer un rôle important dans le cours de ce récit.
Le Canadien était un homme de quarante-cinq ans environ, haut de six pieds anglais, long, maigre et sec; nature nerveuse composée de muscles et de nerfs, parfaitement adaptée au rude métier de coureur des bois, qui exige une vigueur et une audace au delà de toute expression. Comme tous ses compatriotes, le Canadien présentait dans ses traits le type normand dans toute sa pureté; son front large, ses yeux gris pleins de finesse, son nez un peu recourbé, sa bouche grande et garnie de dents magnifiques, les épais cheveux blonds mêlés de quelques fils d'argent qui s'échappaient de son bonnet de peau de loutre et tombaient en énormes boucles sur les épaules, tous ces détails donnaient à cet homme une physionomie ouverte, franche et loyale qui appelait la sympathie et plaisait de prime abord. Ce digne géant nommé Bonnaire, mais connu seulement dans les prairies par le sobriquet de Bon-Affût, sobriquet qu'il justifiait amplement par la justesse de son coup d'œil et son adresse à découvrir les repaires des bêtes fauves, était né aux environs de Montréal; mais emmené tout jeune dans les grands bois du haut Canada, la vie du désert avait eu tant de charmes pour lui, qu'il avait renoncé à la vie civilisée et depuis près de trente ans parcourait les vastes solitudes de l'Amérique du Nord, ne consentant à entrer dans les villes et les villages que pour vendre les peaux des animaux qu'il avait tués ou renouveler sa provision de poudre et de balles.
Le compagnon de Bon-Affût, l'Aigle-Volant, était un des chefs les plus renommés de la tribu des Bisons-Blancs, une des plus puissantes de la batailleuse nation des Comanches, cette indomptable et féroce nation qui, dans son incommensurable orgueil, s'intitule superbement la Reine des prairies, titre que nulle autre qu'elle n'ose revendiquer.
L'Aigle-Volant, bien que fort jeune encore puisqu'il avait à peine vingt-cinq ans, s'était distingué déjà dans maintes circonstances par des traits d'une audace et d'une témérité tellement inouïes, que son nom seul inspirait une invincible terreur aux innombrables hordes indiennes que parcourent sans cesse le désert dans tous les sens.
Sa taille était haute, bien prise, parfaitement proportionnée; ses traits étaient fins, ses yeux noir comme la nuit acquéraient, sous l'influence d'une émotion forte, cette fixité étrange qui commande le respect; ses gestes étaient nobles et sa démarche gracieuse, empreinte de cette majesté innée chez les Indiens.
Le chef était revêtu de son costume de guerre.
Ce costume est assez singulier pour mériter une description détaillée.
La tête de l'Aigle-Volant était coiffée du mahch-akoub-hachka, bonnet que, seuls, les guerriers distingués qui ont tués beaucoup d'ennemis ont le droit de porter; il est fait de bandes blanches d'hermine ayant par derrière une large pièce de drap rouge tombant jusqu'au mollet, sur laquelle est attachée une crête droite de plumes d'aigle blanches et noires qui commence à la tête et se prolonge en rang serré jusqu'au bout. Au-dessus de l'oreille droite il avait passé dans sa chevelure un couteau de bois peint en rouge et long comme la main: ce couteau était l'emblème de celui avec lequel il avait tué un chef Dacotah; il portait, en outre, huit petites brochettes en bois, peintes en bleu et garnies à l'extrémité supérieure d'un clou doré pour indiquer le nombre de coups de feu dont il avait été blessé; au-dessus de l'oreille gauche il portait une grosse touffe de plumes de hibou jaunes et peintes en rouge à leur extrémité, comme signe de ralliement des Menin-ochaté, c'est-à-dire la bande des Chiens; son visage était peint moitié en rouge et son corps en rouge-brun avec des raies dont la couleur avait été enlevée avec un doigt mouillé. Ses bras, à compter de l'épaule, étaient ornés de vingt-sept raies jaunes indiquant le nombre de ses hauts faits, et sur sa poitrine il avait dessiné avec de la couleur bleue une main, ce qui annonçait qu'il avait souvent fait des prisonniers. Il portait à son cou un magnifique mato-unknappinindè, collier de griffes d'ours gris, longues de trois pouces et blanchâtres à la pointe. Ses épaules étaient couvertes de la grande mih-ihé ou robe de bison, tombant jusqu'à terre et peinte de diverses couleurs. Il avait serré étroitement à la ceinture le woupanpihunchi ou culottes consistant en deux parties séparées, une pour chaque jambe, descendant jusqu'à la cheville et brodée à la partie extérieure de piquants de porc-épic de couleur variée se terminant par une longue touffe traînant par terre; son nokké, larges bandes de drap rayées de blanc et de noir, s'enroulait autour de ses hanches et retombait devant et derrière en longs plis; ses humpés ou souliers en peau de bison étaient peu ornés, mais il avait attaché au-dessus de la cheville des queues de loups qui traînaient à terre derrière lui et dont le nombre égalait les ennemis qu'il avait vaincus; à son ichparakehn ou ceinture pendaient, d'un côté une poire à poudre, un sac à balles et un couteau à scalper, de l'autre un carquois en peau de panthère garni de flèches longues et acérées, et son tomawhauks; son eruhpa,—fusil,—était posé à terre à portée de sa main.
Ce guerrier, revêtu de cet étrange costume, avait quelque chose d'imposant et de sinistre qui inspirait la terreur.
Quant à présent, nous nous bornerons à dire que Églantine avait quinze ans au plus, qu'elle était fort belle pour une Indienne, et qu'elle portait dans toute son élégante simplicité le sévère costume adopté par les femmes de sa nation.
Terminant ici cette description peut-être trop détaillée, mais qui était nécessaire pour connaître les hommes que nous avons mis en scène, nous reprendrons le cours de notre récit.
Depuis longtemps nos deux personnages fumaient auprès l'un de l'autre sans échanger une parole; enfin le Canadien secoua le fourneau de sa pipe sur le pouce de sa main gauche, et s'adressant à son compagnon:
—Mon frère est-il satisfait? demanda-t-il.
—Ooah! répondit l'Indien en baissant affirmativement la tête, mon frère a un ami.
—Bon, reprit le chasseur, et que fera maintenant le chef?
—L'Aigle-Volant rejoindra sa tribu avec Églantine, puis il reviendra chercher la piste des Apaches.
—A quoi bon?
—L'Aigle-Volant veut se venger.
—A votre aise, chef, ce n'est certes pas moi qui vous engagerai à renoncer à vos projets contre des ennemis qui sont aussi les miens; seulement je crois que vous n'envisagez pas la question à son véritable point de vue.
—Que veut dire mon frère le guerrier pâle?
—Je veux dire que nous sommes loin des huttes des Comanches, et qu'avant de les atteindre nous aurons sans doute plus d'une fois encore maille à partir avec les ennemis, dont le chef se croit peut-être un peu prématurément débarrassé.
L'Indien haussa les épaules avec dédain.
—Les Apaches sont de vieilles femmes, bavardes et poltronnes, dit-il, l'Aigle-Volant les méprise.
—Possible! reprit le chasseur en hochant la tête; cependant, à mon avis, nous aurions mieux fait de continuer notre route jusqu'au lever du soleil, afin de mettre une plus grande distance entre eux et nous, au lieu de nous arrêter aussi imprudemment ici; nous sommes bien près encore du camp de nos ennemis.
—L'eau de feu a bouché les oreilles et fermé les yeux des chiens apaches; ils dorment étendus sur la terre.
—Hum! Ce n'est pas mon opinion, je suis au contraire, persuadé qu'il veillent et qu'ils nous cherchent.
Au même instant, comme si le hasard avait voulu justifier la crainte du prudent chasseur, une dizaine de coups de feu éclatèrent avec fracas; un horrible cri de guerre auquel le Canadien et le Comanche répondirent par un cri de défi sortit du sein de la forêt et une trentaine d'Indiens apaches se ruèrent en hurlant vers le brasier auprès duquel se tenaient nos trois personnages; mais ceux-ci avaient subitement disparu comme par enchantement.
Les Apaches s'arrêtèrent avec un frémissement de rage, ne sachant plus quelle direction prendre pour retrouver leurs rusés ennemis. Soudain trois coup de feu furent tirés de l'intérieur de la forêt; trois Apaches roulèrent sur le sol, la poitrine traversée.
Les Indiens poussèrent un hurlement de fureur et se précipitèrent dans la direction des coups de feu.
Au moment où ils arrivaient à lisière de la forêt, un homme en sortit en agitant de la main droite une robe de bison en signe de paix.
Cet homme était Bon-Affût le Canadien.
Les Apaches s'arrêtèrent avec une hésitation de mauvais augure; le Canadien, sans paraître remarquer ce mouvement, s'avança résolument vers eux du pas lent et tranquille qui lui était habituel; en le reconnaissant, les Indiens brandirent leurs armes avec colère et voulurent courir sur lui, car ils avaient bien des motifs de haine contre le chasseur; leur chef les arrêta d'un geste péremptoire.
—Que mes fils soient patients, dit-il avec un sourire sinistre, il ne perdront rien pour attendre.
Le jour même où commence notre récit, à trois kilomètres environ de l'endroit où se passaient les évènements que nous avons rapportés dans notre précédent chapitre, dans une vaste clairière située sur la lisière d'une immense forêt vierge dont les derniers contreforts venaient mourir sur les rives même du Río Colorado, une assez nombreuse caravane avait fait halte au coucher du soleil.
Cette caravane venait du sud-est, c'est-à-dire du Mexique; elle paraissait être en marche depuis longtemps déjà, autant qu'il était possible d'en juger par l'état de délabrement dans lequel se trouvaient les vêtements des individus qui en faisaient partie ainsi que les harnais de leurs chevaux et de leurs mules. Du reste, les pauvres bêtes étaient réduites à un état de maigreur et de faiblesse qui témoignait hautement des rudes fatigues qu'elles avaient dû éprouver. Cette caravane se composait de trente à trente-cinq individus environ, tous revêtu du pittoresque et caractéristique costume de ces chasseurs et gambusinos demi-sang, qui seuls ou par petites bandes de trois ou quatre au plus parcourent sans cesse le Far-West, qu'ils explorent dans ses plus mystérieuses profondeurs pour chasser, trapper ou découvrir les innombrables gisements aurifères qu'il recèle dans son sein.
Les aventuriers firent halte, mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux à des piquets et s'occupèrent immédiatement, avec cette adresse et cette vivacité que donne seule une longue habitude, à installer leur campement de nuit. L'herbe fut arrachée sur un assez grand espace; les charges des mules empilées en cercle formèrent un rempart derrière lequel on pouvait résister à un coup de main des rôdeurs de la prairie, puis des feux furent allumés en croix de saint André dans l'intérieur du camp.
Dès que ce dernier soin fut pris, quelques-uns des aventuriers dressèrent une large tente au-dessus d'un palanquin hermétiquement fermé et attelé de deux mules, une devant, l'autre derrière. La tente dressée, le palanquin fut dételé, et les rideaux en retombant le couvrirent si bien, qu'il se trouva entièrement caché.
Ce palanquin était une énigme pour les aventuriers; nul ne savait ce qu'il renfermait, bien que la curiosité générale fût singulièrement éveillée au sujet de ce mystère incompréhensible surtout dans ces parages sauvages; chacun gardait avec soin ses appréciations et ses pensées au fond de son cœur, surtout depuis le jour que dans un passage difficile, profitant de l'éloignement accidentel du chef de la cuadrilla qui ordinairement ne quittait jamais le palanquin sur lequel il veillait comme un avare sur son trésor, un chasseur s'était penché de côté et avait légèrement entr'ouvert un des rideaux; mais à peine cet homme avait-il eu le temps de jeter un coup d'œil furtif à travers l'ouverture ménagée par lui, que le chef, arrivant à l'improviste, lui avait fendu le crâne d'un coup de machette et l'avait renversé mort à ses pieds.
Puis il s'était tourné vers les assistants terrifiés, et les dominant par un regard fascinateur:
—Y a-t-il un autre de vous, avait-il dit, qui veuille découvrir ce que je prétends cacher à tous?
Ces paroles avaient été prononcées avec un tel accent d'implacable raillerie et de féroce méchanceté, que ces hommes de sac et de corde, pour la plupart sans foi ni loi, et accoutumés à braver en riant les plus grands périls, s'étaient sentis frissonner intérieurement et leur sang se figer dans leurs veines. Cette leçon avait suffi. Nul n'avait cherché depuis à découvrir le secret du capitaine.
A peine les dernières dispositions étaient-elles prises pour le campement, qu'un bruit de chevaux se fit entendre et deux cavaliers arrivèrent au galop.
—Voici le capitaine! se dirent les aventuriers l'un à l'autre.
Les nouveaux venus jetèrent la bride de leurs chevaux aux hommes accourus pour les recevoir, et se dirigèrent à grands pas vers la tente. Arrives là, le premier s'arrêta, et s'adressant à son compagnon:
—Caballero, lui dit-il, soyez le bienvenu au milieu de nous; quoique fort pauvres nous-mêmes, nous partagerons avec joie le peu que nous possédons avec vous.
—Merci, répondit le second en s'inclinant, je n'abuserai pas de votre gracieuse hospitalité; demain, au point du jour, je serai, je crois, assez reposé pour continuer ma route.
—Vous agirez comme bon vous semblera: installez-vous auprès de ce foyer préparé pour moi, tandis que j'entrerai quelques instants sous cette tente; bientôt je vous rejoindrai et j'aurai l'honneur de vous tenir compagnie.
L'étranger s'inclina et prit place devant le feu allumé à peu de distance de la tente, pendant que le capitaine laissait retomber derrière lui le rideau qu'il avait soulevé et disparaissait aux yeux de son hôte.
Celui-ci était un homme aux traits accentués, dont les membres trapus dénotaient une force peu commune; les quelques rides qui sillonnaient son visage énergique semblaient indiquer qu'il avait dépassé déjà le milieu de la vie, bien que nulle trace de décrépitude ne se laissât voir sur son corps solidement charpenté, et que pas un cheveu blanc n'argentât sa longue et épaisse chevelure noire comme l'aile du corbeau. Cet homme portait le costume des riches hacenderos mexicains, c'est-à-dire la manga, le zarapé aux couleurs bariolées, les calzoneras de velours ouvertes au genou, et les botas vaqueras; son chapeau, en poil de vigogne galonné d'or, avait la forme serrée par une riche toquilla attachée par un diamant de prix; un machette sans fourreau pendait à sa hanche droite, passé simplement dans un anneau de fer; les canons de deux revolvers à six coups brillaient à sa ceinture, et il avait jeté sur l'herbe auprès de lui un rifle américain magnifiquement damasquiné en argent.
Après que le capitaine l'eut laissé seul, cet homme, tout en s'installant devant le feu de la façon la plus confortable, c'est-à-dire en disposant son zarapé et ses armes d'eau pour lui servir de lit au besoin, jeta autour de lui un regard furtif dont l'expression aurait sans doute donné beaucoup à penser aux aventuriers, si ceux-ci avaient pu le surprendre; mais tous s'occupaient aux soins de l'installation du camp et des préparatifs de leur souper; s'en reposant surtout sur la loyauté de l'hospitalité des prairies, ils ne songeaient en aucune façon à surveiller ce que faisait l'étranger assis à leur foyer.
L'inconnu, après quelques minutes de réflexion, se leva et s'approcha d'un groupe de trappeurs, dont la conversation semblait fort animée et qui gesticulaient avec ce feu naturel aux races du Midi.
—Eh! fit un d'eux en apercevant l'étranger, ce seigneur va, d'un mot, nous mettre d'accord.
Celui-ci, directement interpellé, se tourna vers son interlocuteur.
—Que se passe-t-il donc, caballero? demanda-t-il.
—Oh! Mon Dieu, une chose bien simple, répondit l'aventurier; votre cheval, une belle et noble bête, je dois en convenir, señor, ne veut pas frayer avec les nôtres, il fait rage des pieds et des dents contre les compagnons que nous lui avons donnés.
—Eh! Cela est simple, en effet, observa un second aventurier en ricanant; ce cheval est un costeño, il est trop fier pour frayer avec de pauvres tierras interiores comme nos chevaux.
A cette singulière raison, tous éclatèrent d'un rire homérique.
L'inconnu sourit d'un air narquois.
—Peut-être est-ce la raison que vous avancez, peut-être y en a-t-il une autre, dit-il doucement; dans tous les cas, il y a un moyen bien facile de terminer le différend, moyen que je vais employer.
—Ah! fit le second aventurier, et quel est-il?
—Le voici, reprit l'inconnu, du même air placide.
S'avançant alors vers le cheval que deux hommes avaient peine à contenir:
—Lâchez-le! dit-il.
—Mais si nous le lâchons, nul ne sait ce qui arrivera.
—Lâchez-le, je réponds de tout; puis s'adressant au cheval: Lélio! dit-il.
A ce nom, le cheval releva sa noble tête, et fixant son œil intelligent sur celui qui l'appelait, d'un mouvement brusque et irrésistible il se débarrassa des deux hommes qui cherchaient à l'arrêter, les envoya rouler sur l'herbe, aux éclats de rire de leurs compagnons, et vint frotter sa tête contre la poitrine de son maître, en poussant un hennissement de plaisir.
—Vous voyez, reprit l'inconnu en flattant le noble animal, que ce n'est pas difficile!
—Hum! répondit d'un ton de mauvaise humeur en se frottant l'épaule le premier aventurier qui se relevait; c'est un démonio auquel je ne confierai pas ma peau, toute vieille et toute racornie qu'elle soit à présent.
—Ne vous en occupez pas davantage, je me charge de lui.
—Foi de Domingo, j'en ai assez pour ma part; c'est une noble bête, mais elle a le diable au corps!
L'inconnu haussa les épaules sans répondre et retourna auprès du foyer suivi par son cheval qui marchait pas à pas derrière lui, sans témoigner la moindre velléité de se livrer de nouveau à ces excentricités qui avaient si fort étonné les aventuriers, tous hommes cependant passés maîtres dans l'art de l'hippiatrique. Ce cheval était un barbe pur sang arabe, qui avait probablement coûté une somme énorme à son propriétaire actuel, et dont les allures devaient sembler étranges à des gens habitués aux chevaux américains. Son maître lui donna la provende, l'installa auprès de lui, puis il se rassit devant le feu.
Au même instant le capitaine apparut à l'entrée de la tente.
—Je vous demande pardon, dit-il avec cette charmante courtoisie innée chez les Hispano-américains, je vous demande pardon, señor caballero, de vous avoir si longtemps négligé, mais un devoir impérieux réclamait ma présence; maintenant me voici tout à vous.
L'inconnu s'inclina.
—C'est moi, répondit-il, qui vous prie, au contraire, d'agréer mes excuses pour le sans-façon avec lequel j'use de votre hospitalité.
—Pas un mot de plus sur ce sujet, si vous ne voulez me désobliger.
Le capitaine s'assit auprès de son hôte.
—Nous allons dîner, dit-il; je ne puis vous offrir qu'une maigre pitance; mais à la guerre comme à la guerre, j'en suis réduit à la portion congrue, c'est-à-dire au tasajo et aux haricots rouges au piment.
—C'est délicieux, et certes, j'y ferais honneur si je me sentais le moindre appétit; mais, en ce moment, il me serait impossible de porter la plus légère bouchée de quoi que ce soit à ma bouche.
—Ah! fit le capitaine en lançant à l'inconnu un regard défiant.
Mais il rencontra une physionomie si naïvement placide, un sourire si franc, qu'il eut honte de ses soupçons, et son visage, qui s'était rembruni, reprit instantanément toute sa sérénité.
—J'en suis fâché; je vous demanderai alors la permission de dîner seul; car, au contraire de vous, caballero, je vous confesse que je me meurs littéralement de faim.
—Je serais désespéré de vous occasionner le moindre retard.
—Domingo! cria le capitaine, mon dîner!
L'aventurier que le cheval de l'inconnu avait si rudement secoué ne tarda pas à arriver en traînant la jambe, et portant, dans une écuelle en bois, le souper de son chef; quelques tortillas de maïs, qu'il tenait à la main, complétaient ce repas d'une sobriété presque claustrale.
Domingo était un métis indien, à l'air rechigné, aux traits anguleux et à la physionomie sournoise; il paraissait avoir à peu près cinquante ans, autant qu'il est possible de juger de l'âge d'un Indien par l'apparence; depuis sa mésaventure avec le cheval, Domingo gardait rancune à l'inconnu.
—Con su permiso, dit le capitaine en rompant une tortilla.
—Je fumerai une cigarette, ce qui sera encore vous tenir compagnie, répondit l'étranger avec son éternel sourire.
L'autre s'inclina poliment et attaqua son maigre repas avec cette vivacité qui dénote une longue abstinence.
Nous saisirons cette occasion pour faire au lecteur le portrait du chef de la caravane.
Don Miguel Ortega, noms sous lesquels il était connu de ses compagnons, était un élégant et beau jeune homme de vingt-six ans au plus, au teint bronzé, aux traits fins, à l'œil fier et brillant, dont la taille élevée, les membres bien attachés, la poitrine large et bombée dénotaient une rare vigueur. Certes, dans toute l'étendue des anciennes colonies espagnoles, il aurait été difficile, sinon impossible, de rencontrer un plus séduisant cavalier, portant mieux le pittoresque costume mexicain, plus hombre de a caballo et réunissant au même degré que lui ces avantages extérieurs qui charment les femmes et entraînent le vulgaire. Cependant, pour un observateur, don Miguel avait une trop grande profondeur dans l'œil, un froncement trop rude du sourcil et un sourire trop faux et trop perfide pour que, sous ces dehors séduisants, cet homme ne cachât pas une âme atrophiée et des instincts mauvais.
Un repas de chasseur assaisonné par l'appétit n'est jamais long; celui-ci fut promptement expédié.
—Là, fit le capitaine en s'essuyant les doigts avec une touffe d'herbe; maintenant une cigarette afin de faciliter la digestion, puis j'aurai l'honneur de vous souhaiter le bonsoir; vous n'avez pas, sans doute, l'intention de nous quitter avant le point du jour.
—Je ne saurais vous le dire, cela dépendra un peu du temps qu'il fera cette nuit; je suis assez pressé, et vous le savez, caballero, ainsi que le disent si justement les Gringos, nos voisins, le temps est de l'argent.
—Mieux que moi, caballero, vous savez ce que vous avez à faire; agissez à votre guise, seulement, avant que je me retire, veuillez agréer mes souhaits de bonne nuit et de bonne réussite dans vos projets.
—Je vous remercie, caballero.
—Un dernier mot, ou plutôt une dernière question avant de nous séparer.
—Faites.
—Il est bien entendu que, si cette question vous paraît indiscrète, vous êtes parfaitement libre de ne pas y répondre.
—Cela m'étonnerait de la part d'un cabellero aussi accompli, veuillez donc vous expliquer.
—Je me nomme don Miguel Ortega.
—Et moi don Stefano Cohecho.
Le capitaine s'inclina.
—Me permettez-vous à mon tour, reprit l'étranger, de vous adresser une question?
—Je vous en prie.
—Pourquoi cet échange de nom?
—Parce que, dans la Prairie, il est bon de pouvoir distinguer ses ennemis de ses amis.
—C'est juste; maintenant?
—Maintenant je suis certain de ne pas vous compter parmi les premiers.
—¿Quién sabe? repartit en riant don Stefano; il y a de si étranges hasards!
Les deux hommes, après avoir encore échangé quelques mots de la façon la plus amicale, se serrèrent cordialement la main; don Miguel rentra sous la tente, et don Stefano, après s'être étendu les pieds au feu, s'endormit ou du moins ferma les yeux.
Une heure après, le silence le plus complet régnait dans le camp. Les feux ne jetaient plus qu'une lueur douteuse, et les sentinelles, appuyées sur leurs rifles, se laissaient elles-mêmes aller à cette espèce de vague somnolence qui n'est pas encore le sommeil, mais qui déjà n'est plus la veille.
Soudain un hibou, caché probablement dans un arbre voisin, poussa à deux reprises son hou houlement mélancolique.
Don Stefano ouvrit subitement les yeux; sans changer de position, il s'assura par un regard investigateur que tout était tranquille autour de lui; puis, après s'être convaincu que son machette et ses revolvers ne l'avaient pas quitté, il saisit son rifle et imita à son tour le cri du hibou; un cri pareil lui répondit.
L'étranger, après avoir accommodé son zarapé de façon à imiter un corps humain, dit, en le flattant à voix basse, quelques mots à son cheval, afin de le tranquilliser et de lui faire prendre patience, et s'allongeant sur le sol, il se dirigea, en rampant doucement, vers une des issues du camp, s'arrêtant par intervalle, afin de jeter un regard autour de lui.
Tout continuait à être calme. Arrivé au pied du retranchement formé par les charges des mules, il se redressa, franchit l'obstacle d'un bond de tigre et disparut dans la prairie.
Au même instant, un homme se releva, sauta par-dessus le retranchement et s'élança à sa poursuite.
Cet homme était Domingo.
Don Stefano Cohecho semblait parfaitement connaître le désert. Dès qu'il fut dans la prairie et ainsi qu'il le croyait, à l'abri de toute investigation fâcheuse, il releva fièrement la tête; sa démarche se fit plus assurée, son œil brilla d'un feu sombre, et il s'avança à grands pas vers un bouquet de palmiers dont les maigres parasols offraient pendant le jour un abri précaire contre les rayons ardents du soleil.
Cependant il ne négligeait aucune précaution, parfois il s'arrêtait brusquement pour prêter l'oreille au moindre bruit suspect ou pour interroger d'un regard investigateur les sombres profondeurs du désert, puis, après quelques secondes, rassuré par le calme qui régnait autour de lui, il reprenait sa marche de ce pas délibéré qu'il avait adopté en quittant le camp.
Domingo, pour nous servir de l'expression indienne, marchait littéralement dans ses pas, épiant et surveillant chacun de ses mouvements avec cette sagacité particulière aux métis, tout en ayant bien soin d'être toujours à l'abri d'une surprise de la part de l'homme qu'il espionnait. Domingo était une de ces natures comme il ne s'en rencontre que trop sur les frontières; douées de grandes qualités et de grands vices, aussi bonnes pour le bien que pour le mal, capables d'accomplir des choses extraordinaires dans un sens comme dans l'autre, mais qui, la plupart du temps, ne se laissent guider que par leurs mauvais instincts.
Il suivait en ce moment l'étranger sans se rendre positivement compte du motif qui le faisait agir, ne sachant pas encore lui-même s'il serait pour ou contre lui, attendant pour se décider que la position se dessinât nettement, et qu'il eût pesé l'avantage qu'il retirerait d'une trahison ou de l'accomplissement de ses devoirs; aussi évitait-il avec soin de laisser soupçonner sa présence, il devinait que le mystère qu'il voulait découvrir lui offrirait, s'il parvenait à le découvrir, de grands avantages, surtout s'il savait l'exploiter; et, dans le doute, il ne s'abstenait pas mais agissait de façon à ne pas compromettre la découverte de ce précieux secret.
Les deux hommes marchèrent ainsi près d'une heure à la suite l'un de l'autre, sans que don Stefano soupçonnât une seconde qu'il était aussi finement épié, et que l'un des plus adroits coquins des prairies était sur ses talons.
Après des tours et des détours sans nombre dans les hautes herbes, don Stefano arriva sur la rive même du Río Colorado, qui en cet endroit coulait large et calme comme un lac sur un lit de sable bordé par d'épais bouquets de cotonniers et par de hauts peupliers dont les racines plongeaient dans l'eau; arrivé là, l'inconnu s'arrêta, prêta l'oreille un instant, et portant ses doigts à sa bouche il imita le glapissement du coyote; presque immédiatement le même cri s'éleva du milieu des palétuviers, et une légère pirogue faite d'écorce de bouleau, conduite par deux hommes, apparut sur la rive.
—Eh! fit don Stefano d'une voix contenue, je désespérais de vous rencontrer!
—N'avez-vous donc pas entendu notre signal? répondit un des individus de la pirogue.
—Serais-je venu sans cela! Seulement il me semble que vous auriez pu vous avancer un peu au-devant de moi.
—Ce n'était pas possible.
La pirogue s'engrava alors dans le sable; les deux hommes sautèrent légèrement à terre, et en un instant ils eurent rejoint don Stefano. Tous deux portaient le costume et les armes des chasseurs de la Prairie.
—Hum! reprit don Stefano, la route est longue du camp pour venir jusqu'ici, je crains que l'on s'aperçoive de mon absence.
—C'est un risque qu'il vous faut courir, répondit celui qui déjà avait parlé, homme de haute taille, à la figure ouverte, à la physionomie grave et sévère, et dont les cheveux blancs comme la neige tombaient en longues boucles sur les épaules.
—Enfin, puisque vous voilà, expliquons-nous et surtout soyons brefs, le temps est précieux. Qu'avez-vous fait depuis notre séparation?
—Pas grand-chose: nous vous avons suivi de loin, voilà tout, prêts à vous venir en aide si besoin était.
—Merci; pas de nouvelles?
—Aucunes: qui aurait pu nous en donner?
—C'est juste; et votre ami Bon-Affût, l'avez-vous découvert?
—Non.
—Cuerpo de Cristo! Ceci est contrariant, car si mes pressentiments ne me trompent pas, bientôt il nous faudra jouer des couteaux.
—On en jouera.
—Je le sais, Balle-Franche[1], je connais de longue date votre courage; mais vous, Ruperto, votre camarade et moi nous ne sommes que trois hommes, en résumé de compte.
—Qu'importe?
—Comment, qu'importe? Lorsqu'il s'agit de combattre contre trente ou quarante chasseurs aguerris, en vérité, Balle-Franche, vous me rendrez fou avec vos idées. Vous ne doutez de rien: songez-donc que cette fois nous n'avons pas à lutter contre des Indiens mal armés, mais contre des blancs, des bandits de sac et de corde, qui se feront tuer sans reculer d'un pouce, et que nous succomberons inévitablement.
—C'est vrai, je n'y avais pas réfléchi, ils sont beaucoup.
—Nous morts que deviendrait-elle?
—Bon, bon, reprit le chasseur en secouant la tête, je vous répète que je n'y songeais pas.
—Vous voyez donc bien qu'il est indispensable que nous nous entendions avec Bon-Affût et les hommes dont il peut disposer.
—Oui, mais allez donc trouver à point nommé dans le désert la piste d'un homme comme Bon-Affût? Qui sait; où il se trouve en ce moment? il peut n'être qu'à une portée de fusil de nous comme en être éloigné de cinq cents milles.
—C'est à en devenir fou.
—Le fait est que la position est grave. Êtes-vous au moins sûr cette fois de ne pas vous être trompe et de tenir la bonne piste?
—Je ne puis rien assurer encore, bien que tout me fasse supposer que je ne me trompe pas, mais rapportez-vous-en à moi, je saurai bientôt à quoi m'en tenir.
—Du reste, ce sont les mêmes traces que celles que nous suivons depuis Monterey; il y a des chances que ce soient eux.
—Que résolvons-nous?
—Dame, je ne sais que vous dire.
—Vous êtes désespérant, sur ma parole; comment, vous ne pouvez me suggérer aucun moyen?
—Il me faudrait d'abord une certitude, et puis, vous l'avez dit vous-même: à nous trois, ce serait folie de tenter ce coup de main!
—Vous avez raison, je retourne au camp; la nuit prochaine, nous nous reverrons, je serai bien malheureux si, cette fois, je n'ai pas découvert ce qui nous importe tant de savoir; vous, pendant ce temps-là, cherchez, furetez, fouillez la Prairie dans tous les sens, et, si cela est possible, ayez-moi des nouvelles de Bon-Affût.
—Cette recommandation est inutile, je ne demeurerai pas inactif.
Don Stefano saisit la main du vieux chasseur, et la pressant fortement entre les siennes:
—Balle-Franche, lui dit-il d'une voix émue, je ne vous parlerai pas de notre vieille amitié, ni des services que plusieurs fois j'ai été assez heureux pour vous rendre, je vous répéterai seulement, et je sais qu'avec vous cela suffira, c'est que du succès de notre expédition dépend le bonheur de ma vie.
—Bon, bon, ayez confiance en moi, don José; je suis trop vieux pour changer d'amitié, je ne sais qui a tort ou raison dans cette affaire, je souhaite que la justice soit de votre côté; mais cela ne m'occupe pas, quoi qu'il arrive, je vous serai fidèle et bon compagnon.
—Merci, mon vieil ami, à la nuit prochaine.
Après avoir dit ces quelques mots, don Stefano, ou du moins celui qui se faisait appeler ainsi, fit un mouvement pour s'éloigner, mais d'un geste brusque Balle-Franche l'arrêta.
—Qu'y a-t-il? demanda l'étranger. Le chasseur posa l'index de sa main droite sur sa bouche pour lui recommander le silence, et se tournant vers Ruperto, qui avait assisté, impassible et silencieux, à l'entretien:
—Au Coyote! lui dit-il d'une voix basse et inarticulée.
Sans répondre, Ruperto bondit comme un jaguar et disparut dans un buisson de cotonniers qui se trouvait à peu de distance.
Au bout de quelques instants, les deux hommes qui étaient demeurés le corps penché en avant, dans l'attitude de gens qui écoutent, mais sans prononcer une parole, entendirent un froissement de feuilles, un bruit de branches brisées suivi de la chute d'un corps lourd sur le sol, puis plus rien.
Presque aussitôt, le cri de la chouette s'éleva dans la nuit.
—Ruperto, nous appelle, dit alors Balle-Franche, tout est fini.
—Que s'est-il donc passé? demanda don Stefano avec inquiétude.
—Moins que rien, répliqua le chasseur, en lui faisant signe de le suivre. Vous aviez un espion à vos trousses, voilà tout.
—Un espion?
—Pardieu! Vous allez le voir.
—Oh! Oh! Ceci est grave.
—Moins que vous le supposez, puisque nous le tenons.
—Oui, mais alors il nous faudra donc tuer cet homme?
—Qui sait? Cela dépendra probablement de l'explication que nous aurons avec lui; dans tous les cas, ce n'est pas un grand mal d'écraser de semblables vermines.
Tout en parlant ainsi, Balle-Franche et son compagnon avaient pénétré dans le buisson.
Domingo, renversé et garrotté étroitement au moyen de la reata de Ruperto, se débattait vainement pour rompre les liens qui lui entraient dans les chairs. Ruperto, les deux mains réunies sur le canon de son rifle dont la crosse reposait à terre, écoutait en ricanant mais sans lui répondre le flot d'injures et de récriminations que la rage arrachait au métis.
—¡Dios me ampare! disait celui-ci en se tordant comme une vipère. ¡Verdugo del demonio! Est-ce ainsi que l'on agit entre gente de razón? Suis-je donc un peau-rouge pour me ficeler comme une carotte de tabac et me serrer les membres comme à un veau que l'on mène à l'abattoir? Si jamais tu tombes entre mes mains, chien maudit, tu me payeras le tour que tu m'as joué!
—Au lieu de menacer, mon brave homme, dit Balle-Franche en intervenant, il me semble que vous feriez mieux de convenir loyalement que vous êtes entre nos mains et d'agir en conséquence.
Le bandit tourna brusquement la tête, la seule partie du corps qu'il avait de libre vers le chasseur.
—Vous avez bon air à m'appeler brave homme et à me donner des conseils, vieux trappeur de rats musqués, lui dit-il brutalement; êtes-vous des blancs ou des Indiens, pour traiter ainsi un chasseur.
—Si au lieu de chercher à entendre ce qui ne vous regardait pas, digne señor Domingo, c'est ainsi qu'on vous nomme je crois, dit don Stefano d'un air narquois, si vous étiez resté tranquillement à dormir dans votre camp, le petit désagrément dont vous vous plaignez ne vous serait pas arrivé.
—Je dois reconnaître la justesse de votre raisonnement, reprit le bandit avec ironie, mais dame, que voulez-vous? J'ai toujours eu la manie de chercher à apprendre ce qu'on voulait me cacher.
L'étranger lui lança un regard soupçonneux.
—Et avez-vous depuis longtemps cette manie, mon bon ami? dit-il.
—Depuis ma plus tendre jeunesse, répliqua-t-il effrontément.
—Voyez-vous cela, vous avez dût apprendre bien des choses alors?
—Énormément, mon bon seigneur.
Don Stefano se tourna vers Balle-Franche.
—Mon ami, lui dit-il, desserrez donc un peu les liens de cet homme, il y a tout à gagner en sa compagnie: je désire jouir quelques instants de sa conversation.
Le chasseur exécuta silencieusement l'ordre qui lui était donné.
Le bandit poussa un soupir de satisfaction en se sentant moins gêné et se releva sur son séant.
—¡Cuerpo de Cristo! s'écria-t-il avec un accent railleur, au moins maintenant la position est tenable, on peut causer.
—N'est-ce pas?
—Ma foi, oui, je suis bien à votre service pour tout ce que vous voudrez, seigneurie.
—Alors je profiterai de votre complaisance.
—Profitez, seigneurie, profitez; je ne puis que gagner à causer avec vous.
—Croyez-vous?
—J'en suis convaincu.
—Au fait, vous pourriez avoir raison; dites-moi, à part cette noble curiosité dont vous m'avez si franchement fait l'aveu, n'auriez-vous pas par hasard d'autres petits défauts?
Le bandit eut l'air de chercher consciencieusement pendant deux ou trois minutes dans sa tête, puis il répondit en faisant l'agréable.
—Ma foi non, seigneurie, je ne vois pas.
—En êtes-vous sûr?
—Hum! Il se pourrait, mais pourtant je ne crois pas.
—Là, vous le voyez, vous n'en êtes pas sûr?
—Au fait, c'est vrai! s'écria le bandit avec une feinte franchise; vous le savez, seigneurie, la nature humaine est si incomplète.
Don Stefano fit un geste d'assentiment.
—Si je vous aidais, dit-il, peut-être que...
—Nous trouverions, n'est-ce pas, seigneurie, interrompit vivement Domingo. Eh bien! Aidez, aidez, je ne demande pas mieux, moi.
—Ainsi, par exemple, remarquez bien que je n'affirme rien, je suppose, voilà tout.
—¡Caray! Je le sais bien, allez, seigneurie, ne vous gênez pas.
—Ainsi dis-je! N'auriez-vous pas un certain faible pour l'argent?
—Pour l'or surtout.
—C'est ce que je voulais dire.
—C'est qu'aussi l'or est bien tentant, seigneurie.
—Je ne vous en fais pas un crime, mon ami, je me borne à constater; du reste, cette passion est si naturelle!
—N'est-ce pas?
—Que vous devez en être atteint.
—Eh bien! Je vous avoue, seigneurie, que vous avez deviné.
—Voyez-vous, j'en étais sûr.
—Oh! L'or gagné honnêtement.
—Cela va sans dire; ainsi, par exemple, supposons que quelqu'un vous offrit mille piastres pour découvrir le secret du palanquin de don Miguel Ortega.
—Dame! fit le bandit en fixant un clair regard sur l'étranger qui, de son côté, l'examinait attentivement.
—Et si ce quelqu'un, continua don Stefano, vous donnait en sus, comme arrhes du marché, une bague comme celle-ci.
En disant ces paroles, il faisait chatoyer un magnifique diamant aux yeux du bandit.
—J'accepterais, cuerpo de Cristo! s'écria celui-ci avec un accent de convoitise, dussé-je, pour découvrir ce secret, compromettre à jamais la part que j'espère en Paradis!
Don Stefano se tourna vers Balle-Franche.
—Déliez cet homme, dit-il froidement, nous nous entendons.
En se sentant libre, le métis fit un bond de joie.
—La bague! dit-il.
—La voilà, fit don Stefano en la lui remettant, c'est convenu?
Domingo croisa le pouce de sa main droite sur celui de sa main gauche, et redressant fièrement la tête:
—Sur la sainte croix du Rédempteur, dit-il d'une voix ferme et accentuée, je jure de faire tous mes efforts pour découvrir le secret que don Miguel cache si jalousement; je jure de ne jamais trahir le caballero avec lequel je traite en ce moment; ce serment, je le fais devant les trois caballeros ici présents, m'engageant, si je le faussais, à subir sans me plaindre telle peine, fût-ce la mort, qu'il plaira à ces trois caballeros de m'infliger.
Le serment fait par Domingo est le plus redoutable que puisse prononcer un Hispano-américain; il n'y a pas d'exemple qu'il ait été jamais faussé. Don Stefano s'inclina convaincu de la loyauté du bandit.
Soudain plusieurs coups de feu, suivis de cris horribles, éclatèrent à peu de distance.
Balle-Franche tressaillit.
—Don José, dit-il à l'étranger en lui posant la main sur l'épaule, Dieu nous favorise; retournez au camp: la nuit prochaine, je vous apprendrai probablement du nouveau.
—Mais ces coups de feu?
—Ne vous en inquiétez pas, retournez au camp, vous dis-je, et laissez-moi agir.
—Allons, puisque vous le voulez, je me retire.
—A demain?
—A demain.
—Et moi? fit Domingo, caramba, compagnons, si vous allez jouer du couteau, ne pourriez-vous pas me prendre avec vous?
Le vieux chasseur le regarda attentivement.
—Eh! fit-il au bout d'un instant, votre idée n'est pas mauvaise, venez donc puisque vous le désirez.
—A la bonne heure donc, voilà un prétexte tout trouvé pour justifier mon absence.
Don Stefano sourit; après avoir une dernière fois rappelé à Balle-Franche leur rendez-vous pour la nuit suivante, il quitta le buisson et se dirigea vers le camp.
Les deux chasseurs et le métis demeurèrent seuls.
[1] Voir Balle-Franche, 1 vol. in-12, Amyot, éditeur.
Indiens et chasseurs.
A l'endroit où se trouvaient les trois chasseurs, nous l'avons dit déjà, le Río Colorado formait une large nappe, dont les eaux argentées serpentaient à travers une contrée superbe et pittoresque.
Parfois, sur l'une ou l'autre rive, le sol s'élevait presque subitement en montagnes hardies d'un aspect grandiose; d'autres fois il se déroulait en rives de fraîches et riantes prairies couvertes d'une luxuriante végétation, ou en vallons gracieux et ondulés, fourrés d'arbres de toutes sortes.
C'était dans l'un de ces vallons que la pirogue de Balle-Franche avait abordé; abrités de toutes parts par les hautes futaies qui les enveloppaient d'un épais rideau de verdure, les chasseurs auraient échappé, même pendant le jour, aux investigations des curieux ou des indiscrets qui auraient tenté de les surprendre à cette heure avancée de la nuit, aux rayons tremblotants de la lune, qui ne parvenaient jusqu'à eux que tamisés par le dôme de feuilles qui les cachait; ils pouvaient se considérer comme étant complètement en sûreté.
Rassuré par la force de sa position. Balle-Franche, dès que don Stefano l'eut quitté, dressa son plan de campagne avec cette lucidité que peut seule donner une longue habitude de la vie du désert.
—Compagnon, dit-il au métis, connaissez-vous la Prairie?
—Pas autant que vous certainement, vieux trappeur, répondit modestement celui-ci; mais assez cependant pour vous être d'un bon secours dans l'expédition que vous voulez tenter.
—J'aime cette façon de répondre, elle dénote le désir de bien faire; écoutez-moi attentivement: la couleur de mes cheveux et les rides qui sillonnent mon visage vous disent assez que je dois posséder une certaine expérience; ma vie entière s'est écoulée dans les bois; il n'y a pas un brin d'herbe que je ne connaisse, un bruit dont je ne puisse me rendre compte, une empreinte que je ne sache découvrir; il y a quelques instants plusieurs coups de feu ont éclaté non loin de nous, le cri de guerre des Indiens a été poussé; parmi ces coups de feu je suis certain d'avoir reconnu le son du rifle d'un homme pour lequel je professe la plus chaleureuse amitié, cet homme est en danger en ce moment, il combat contre les Apaches qui l'ont surpris et attaqué pendant son sommeil. Le nombre des coups de feu me fait supposer que mon ami n'a avec lui que deux compagnons; si nous ne lui venons pas en aide il est perdu, car ses adversaires sont nombreux; le coup de main que je veux tenter est presque désespéré; nous avons toutes les chances contre nous; réfléchissez avant que de répondre: êtes-vous toujours résolu à nous accompagner, Ruperto et moi, en un mot à risquer votre chevelure en notre compagnie?
—Bah! fit insoucieusement le bandit, on ne meurt qu'une fois; peut-être ne retrouverai-je jamais une aussi belle occasion de mourir honnêtement. Disposez de moi, vieux trappeur, je suis à vous corps et âme.
—Bien, je m'attendais à cette réponse. Cependant mon devoir était de vous avertir du danger qui vous menaçait; maintenant, ne parlons pas davantage et agissons, car le temps presse et chaque minute que nous perdons est un siècle pour celui que nous voulons sauver. Marchez dans mes moksens, ayez l'œil et l'oreille au guet, surtout soyez prudents et ne faites rien sans mon ordre; partons!
Après avoir visité avec soin l'amorce de son rifle, précaution imitée par ses deux compagnons, Balle-Franche s'orienta pendant quelques secondes; puis, avec cet instinct des chasseurs qui chez eux est presque une seconde vue, il s'avança d'un pas rapide, bien que silencieux, dans la direction du combat, en invitant d'un geste les deux hommes à le suivre.
Il est impossible de se faire une idée, même lointaine, de ce qu'est une marche de nuit dans la Prairie, à pied, au milieu des broussailles, des arbres enchevêtrés les uns dans les autres, des lianes qui s'enroulent de tous les côtés, montant, descendant dans toutes les directions en formant les plus extravagantes paraboles; marchant sur un terrain mouvant composé de détritus de toutes sortes accumulés par les siècles, tantôt formant des buttes de plusieurs pieds de haut pour tout à coup ouvrir des fosses profondes; non seulement il est difficile de se tracer une route au milieu de ce tohu-bohu et de ce pêle-mêle inextricable lorsqu'on marche franchement devant soi, sans craindre de révéler sa présence; mais cela devient presque impossible lorsqu'il faut s'ouvrir silencieusement passage, ne pas faire fouetter une branche ou frissonner une feuille, bruit presque imperceptible qui suffirait cependant pour donner l'éveil à l'ennemi que l'on veut surprendre.
Une longue habitude du désert peut seule faire acquérir à l'homme l'adresse nécessaire pour mener à bien ce rude labeur.
Cette adresse, Balle-Franche la possédait au plus haut degré; il semblait deviner les obstacles qui, à chaque pas, se dressaient devant lui, obstacles dont les moindres auraient, dans une circonstance semblable, fait reculer l'homme le plus résolu par la conviction de son impuissance à les surmonter.
Les deux autres chasseurs n'avaient plus qu'à suivre le sillon si adroitement et si péniblement tracé par leur guide. Heureusement que les aventuriers n'étaient séparés que par une faible distance de ceux qu'ils allaient secourir; sans cela, il leur aurait fallu la nuit presque tout entière pour les joindre. Si Balle-Franche avait voulu, il aurait pu longer la lisière de la forêt et marcher dans les hautes herbes, route incomparablement plus facile et surtout moins fatigante; mais, avec sa justesse de conception habituelle, le chasseur avait compris que la direction qu'il avait prise était la seule qui lui permettait d'arriver jusqu'au théâtre de la lutte, sans être découvert par les Indiens, qui, malgré toute leur sagacité, ne se douteraient jamais qu'un homme osât se hasarder à suivre un tel chemin.
Après une course d'environ vingt minutes, Balle-Franche s'arrêta. Les chasseurs étaient arrivés.
En écartant légèrement les branches des arbres et les broussailles, voici ce qu'ils aperçurent.
Devant eux, à dix pas à peine, se trouvait une clairière; au centre de cette clairière, trois feux étaient allumés et entourés de guerriers apaches, qui fumaient gravement, tandis que leurs chevaux, attachés à des piquets, broutaient les jeunes pousses des arbres.
Bon-Affût se tenait impassible auprès des chefs, debout et appuyé sur son rifle, échangeant parfois avec eux quelques paroles. Balle-Franche ne comprenait rien à ce qu'il voyait. Tous ces hommes semblaient dans les meilleurs termes avec le chasseur, qui, de son côté, ne trahissait, ni par ses gestes, ni par son visage, aucune préoccupation.
Pour bien faire comprendre au lecteur la position singulière dans laquelle se trouvaient placés tous ces hommes vis-à-vis les uns des autres, il nous faut faire quelques pas en arrière.
Nous avons dit qu'après l'attaque subite des Indiens, Bon-Affût s'était élancé au-devant eux, en agitant une robe de bison, en signe de paix. Les Indiens s'étaient arrêtés, avec cette déférence courtoise qu'ils apportent dans toutes leurs relations, afin d'écouter les explications du chasseur. Deux chefs s'étaient même avancés vers lui en l'invitant poliment à s'expliquer.
—Que demande mon frère le visage pâle? dit un des chefs en le saluant.
—Mon frère rouge ne me connaît-il pas, est-il donc nécessaire que je lui dise mon nom, afin qu'il sache à qui il parle? répondit Bon-Affût d'un ton de mauvaise humeur.
—Cela est inutile; je sais que mon frère est un grand guerrier blanc; mes oreilles sont ouvertes,'j'attends l'explication qu'il veut me donner.
Le chasseur haussa les épaules avec mépris.
—Les Apaches sont-ils donc devenus des coyotes lâches et pillards, qui se mettent en troupes pour chasser dans la Prairie? Pourquoi m'ont-ils attaqué?
—Mon frère le sait.
—Non, puisque je le demande. Les Apaches Antilopes avaient pour chef un grand guerrier, nommé le Loup-Rouge; ce chef était mon ami, j'avais fait avec lui un traité; mais le Loup-Rouge est mort, sans doute, sa chevelure orne la hutte d'un Comanche, puisque les jeunes gens de sa tribu sont venus m'attaquer, contre la paix jurée, traîtreusement, pendant mon sommeil.
Le chef se redressa en fronçant les sourcils.
—Le visage pâle a comme tous ces compatriotes une langue de vipère, dit-il rudement; une peau couvre son cœur, et les paroles que souffle sa poitrine sont autant de perfidies; le Loup-Rouge n'est pas mort, sa chevelure n'orne pas la hutte d'un chien comanche, il est toujours le premier sachem des Apaches Antilopes, le chasseur le sait bien, puisqu'il lui parle en ce moment.
—Je suis heureux que mon frère se soit nommé, répondit le chasseur, je ne l'aurais pas reconnu à sa façon d'agir.
—Oui, il y a un traître entre nous, reprit sèchement le chef; mais ce traître est un visage pâle, et non pas un Indien!
—J'attends que mon frère s'explique, je ne le comprends pas, un brouillard s'est étendu sur mes yeux, mon esprit est voilé; les paroles du chef dissiperont, je n'en doute pas, ce nuage.
—Je le désire! Que le chasseur réponde avec une langue honnête et sans détour; sa voix est une musique qui longtemps a résonné doucement à mon oreille et réjoui mon cœur, je serais heureux que son explication me rendît l'ami que je croyais avoir perdu.
—Que mon frère m'interroge! Je répondrai à ses questions.
Sur un signe du Loup-Rouge, les Apaches avaient allumé plusieurs feux et établi un camp provisoire. Malgré toute sa finesse, le doute était entré dans le cœur du chef apache, il voulait prouver, au chasseur blanc qu'il redoutait, qu'il agissait franchement et ne nourrissait aucun mauvais dessein contre lui. Les Apaches, voyant la bonne entente qui semblait régner entre leur sachem et le chasseur, s'étaient hâtés d'exécuter l'ordre qu'ils avaient reçu. Toute trace de lutte avait en un moment disparu, et la clairière offrait l'aspect d'un campement de chasseurs paisibles, recevant la visite d'un ami.
Bon-Affût sourit intérieurement du succès de sa ruse et de la façon dont il avait su en quelques mots donner un tout autre tour à la position; cependant il n'était pas sans inquiétude sur l'explication que le chef allait lui demander; il se sentait dans un guêpier dont, à moins d'un hasard providentiel, il ne savait comment il parviendrait à sortir. Le Loup-Rouge avait invité le chasseur à prendre place à ses côtés auprès du feu, offre que celui-ci n'avait eu garde d'accepter, ne se doutant pas encore de quelle façon tourneraient les choses, et voulant se conserver une chance de salut au cas où l'explication deviendrait orageuse.
—Le chasseur pâle est-il prêt à répondre? demanda le Loup-Rouge.
—J'attends le bon plaisir de mon frère!
—Bon! Que mon frère ouvre les oreilles alors, un chef va parler.
—J'écoute!
—Le Loup-Rouge est un chef renommé; son nom est redouté par les Comanches, qui fuient devant lui comme des femmes timides. Un jour, à la tête de ses jeunes gens, le Loup-Rouge s'introduisit dans un altepetl (village) des Comanches, les Bisons Comanches chassaient dans la Prairie, leurs guerriers et leurs jeunes hommes étaient absents; le Loup-Rouge brûla les Calli et emmena les femmes prisonnières; est-ce vrai?
—C'est vrai! répondit le chasseur en s'inclinant.
—Parmi ces femmes, il s'en trouvait une pour laquelle le cœur du chef apache avait parlé; cette femme était la Cihuatl du sachem des Bisons Comanches. Le Loup-Rouge la mena dans sa tribu, la traita non comme une prisonnière, mais comme une sœur bien-aimée. Que fit le chasseur pâle?
Le chef s'interrompit en fixant un regard sévère sur Bon-Affût; celui-ci ne sourcilla pas.
—J'attends que mon frère m'accuse, afin de savoir ce qu'il me reproche, dit-il.
Le Loup-Rouge continua avec une certaine animation dans la voix:
—Le chasseur pâle, abusant de l'amitié du chef, s'introduisit dans son altepetl, sous le prétexte de visiter son frère rouge; comme il était connu et aimé de tous, il parcourut le village à sa guise, fureta partout, et lorsqu'il eut découvert l'Églantine, il l'enleva pendant une nuit obscure, comme un traître et un lâche!
A cette insulte, le chasseur serra le canon de son rifle par un mouvement convulsif; mais, reprenant presque aussitôt son sang-froid:
—Le chef est un grand guerrier, dit-il, il parle bien, les paroles arrivent à ses lèvres avec une abondance pleine de charme; malheureusement il se laisse entraîner par la passion et ne rapporte pas les choses ainsi qu'elles se sont passées.
—Ooah! s'écria le chef, le Loup-Rouge est donc un imposteur, sa langue menteuse doit être jetée aux chiens alors.
—J'ai écouté patiemment les paroles du chef, à son tour d'écouter les miennes.
—Bon! Que mon frère parle.
En ce moment, un sifflement faible comme un soupir se fit entendre; les Indiens n'y prêtèrent pas attention, mais le chasseur tressaillit, son œil profond lança un éclair et un sourire de triomphe plissa le coin de ses lèvres:
—Je serai bref, dit-il; je me suis, en effet, introduit dans le village de mon frère, mais franchement et loyalement, pour lui demander au nom de Mahchsi-Karehde, le grand sachem des Bisons Comanches, sa femme que le Loup-Rouge avait enlevée: cette femme, j'offrais de payer pour elle une riche rançon composée de quatre eruhpas,—fusils,—de six peaux de bisons femelles et de deux colliers de griffes d'ours gris; j'agissais ainsi dans le but d'empêcher une guerre entre les Bisons Comanches et les Apaches Antilopes; mon frère le Loup-Rouge, au lieu d'accepter mes propositions amicales, les a méprisées; je l'ai averti alors que, de gré ou de force, l'Aigle-Volant reprendrait sa femme traîtreusement enlevée dans son village pendant que lui était absent; puis je me suis retiré. Quel reproche peut m'adresser mon frère? Dans quelle circonstance me suis-je mal conduit avec lui? L'Aigle-Volant a repris sa femme: il a bien fait, il était dans son droit; le Loup-Rouge n'a rien à dire à cela, dans une circonstance semblable il aurait agi de même; j'ai dit, que mon frère réponde si son cœur lui prouve que j'ai eu tort.
—Bon! répondit le chef, mon frère était ici avec l'Églantine il y a quelques minutes, il me dira où elle s'est cachée; le Loup-Rouge la reprendra, et il n'y aura plus de nuages entre le Loup-Rouge et son ami.
—Le chef oubliera cette femme, qui ne l'aime pas et qui ne peut être la sienne; cela vaudra mieux, d'autant plus que l'Aigle-Volant ne consentira pas à la lui céder.
—Le Loup-Rouge a des guerriers pour soutenir ses paroles, dit l'Indien avec orgueil; l'Aigle-Volant est seul, comment s'opposera-t-il à la volonté du sachem?
Bon-Affût sourit.
—L'Aigle-Volant a des amis nombreux, dit-il; il est en ce moment réfugié dans le camp des visages pâles dont le Loup-Rouge peut d'ici voir étinceler les feux dans la nuit; que mon frère prête l'oreille, je crois entendre des bruits de pas dans la forêt.
L'Indien se leva avec agitation; en ce moment trois hommes entrèrent dans la clairière; ces trois hommes étaient Balle-Franche, Ruperto et Domingo.
A leur vue les Apaches, qui les connaissaient parfaitement, se levèrent en tumulte et poussèrent un cri d'étonnement, presque de frayeur, en saisissant leurs armes. Les trois chasseurs continuèrent à s'avancer tranquillement sans paraître s'occuper de ces démonstrations presque hostiles.
Nous allons expliquer en quelques mots l'apparition des chasseurs et leur intervention qui allait changer probablement la face des choses.
Balle-Franche et ses deux compagnons, grâce à la position qu'ils occupaient, non seulement voyaient tout ce qui se passait dans la clairière, mais encore ils entendaient, sans en perdre un mot, la conversation de Bon-Affût et du Loup-Rouge.
Depuis longues années déjà, les deux chasseurs canadiens étaient intimement liés; maintes fois ils avaient frappé ou entrepris de compagnie quelques-unes de ces audacieuses expéditions que les coureurs des bois accomplissent souvent contre les Indiens; ces deux hommes n'avaient pas de secrets l'un pour l'autre; tout était commun entre eux, les haines et les amitiés.
Balle-Franche était parfaitement au courant des faits auxquels le Loup-Rouge faisait allusion, et si certaines raisons que nous connaîtrons plus tard ne l'en avaient empêché, il aurait probablement aidé son ami à enlever l'Églantine au chef apache. Cependant un point restait toujours obscur dans son esprit: c'était la présence de Bon-Affût au milieu des Indiens, cette rixe dont il avait entendu les cris et ces coups de feu et qui semblait se terminer par une conversation amicale.
Par quel concours étrange de circonstances, Bon-Affût, l'homme le plus au fait des ruses indiennes, dont la réputation en fait d'adresse et de courage était universelle parmi les chasseurs et les trappeurs des prairies de l'Ouest, se trouvait-il ainsi dans une position équivoque, au milieu de trente ou quarante Apaches, les Indiens les plus fourbes, les plus traîtres et les plus féroces de tous ceux qui sillonnent le désert dans tous les sens; voilà ce que le digne chasseur ne pouvait s'expliquer et ce qui le rendait tout songeur. Au risque de ce qui pourrait arriver, il résolut de révéler sa présence à son ami, au moyen d'un signal convenu entre eux de longue date, afin de l'avertir qu'en cas de besoin un ami veillait sur lui. C'était alors qu'il avait fait entendre ce sifflement au bruit duquel nous avons vu tressaillir le chasseur. Mais ce signal eut un second résultat, auquel Balle-Franche était loin de s'attendre; les branches de l'arbre au tronc duquel s'appuyait le Canadien s'écartèrent doucement, et un homme se suspendant par les bras tomba tout à coup à deux pas de lui, mais cela si légèrement, que sa chute ne produisit pas le moindre bruit.
Au premier coup d'œil, Balle-Franche avait reconnu l'homme qui semblait ainsi tomber du ciel; grâce a sa puissance sur lui-même, il ne témoigna rien de l'étonnement que lui causait cette apparition imprévue.
Le chasseur posa à terre la crosse de son rifle, et saluant poliment l'Indien:
—Drôle d'idée que vous avez, chef, lui dit-il en souriant, de vous promener ainsi sur les arbres à cette heure de nuit.
—L'Aigle-Volant guette les Apaches, répondit l'Indien avec un accent guttural; mon frère ne s'attendait-il pas à me voir?
—Dans la Prairie, il faut s'attendre à tout, chef; je vous avoue que peu de rencontres me sont aussi agréables que la vôtre, en ce moment surtout.
—Mon frère est sur la piste des Antilopes?
—Ma foi, je vous jure, chef, qu'il y a une heure je ne me croyais pas aussi près d'eux; si je n'avais pas entendu vos coups de feu, il est probable qu'en ce moment je dormirais tranquille à mon campement.
—Oui, mon frère a entendu chanter le rifle d'un ami, et il est venu.
—Vous avez deviné juste, chef. Ah ça! Maintenant, mettez-moi au fait, car je ne sais rien, moi.
—Mon frère pâle n'a-t-il pas entendu le Loup-Rouge?
—Parfaitement, il n'y a rien autre?
—Rien, l'Aigle-Volant a enlevé sa femme; les Apaches l'ont poursuivi comme de lâches coyotes, et cette nuit ils l'ont surpris à son feu.
—Très bien, l'Églantine est-elle en sûreté?
—L'Églantine est une femme comanche, elle ignore la crainte.
—Je le sais, c'est une bonne créature; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour le moment: que comptez-vous faire?
—Attendre l'instant favorable, pousser mon cri de guerre, et tomber sur ces chiens.
—Hum! Votre projet est un peu vif; si vous me le permettez, j'y changerai quelque chose.
—La sagesse parle par la bouche du chasseur pâle; l'Aigle-Volant est jeune; il lui obéira.
—Bon, d'autant plus que je n'agirai que dans votre intérêt; maintenant, laissez-moi écouter, la conversation me semble prendre une tournure fort intéressante pour nous.
L'Indien s'inclina sans répondre, Balle-Franche se pencha en avant pour mieux entendre ce qui se disait.
Au bout de quelques minutes le chasseur jugea probablement qu'il était temps d'intervenir, car il se tourna vers le chef, et lui parlant oreille à oreille ainsi qu'il avait fait pendant tout leur colloque précédent:
—Que mon frère me laisse mener cette affaire, dit-il; sa présence nous serait plus nuisible qu'utile; nous ne pouvons avoir la prétention de combattre un aussi grand nombre d'ennemis, la prudence exige que nous ayons recours à la ruse.
—Les Apaches sont des chiens, murmura le Comanche avec colère.
—Je suis de votre avis; mais, quant à présent, feignons de ne pas les considérer comme tels. Croyez-moi, nous prendrons bientôt notre revanche; d'ailleurs l'avantage nous reste, puisque nous les trompons.
L'Aigle-Volant baissa tête.
—Le chef me promet-il de ne pas faire un geste sans un signal de moi? reprit le chasseur avec insistance.
—L'Aigle-Volant est un sachem, il a dit qu'il obéirait à la Tête-Grise.
—Bien; maintenant regardez, votre attente ne sera pas longue.
Après avoir prononcé ces paroles avec cet accent railleur, moitié figue et moitié raisin, qui lui était habituel, le vieux chasseur écarta résolument les broussailles et entra d'un pas ferme dans la clairière, suivi de ses deux compagnons.
Nous avons dit l'émotion causée par cette arrivée imprévue.
L'Aigle-Volant avait regagné son embuscade au haut de l'arbre dont il n'était descendu que pour causer avec le chasseur et lui donner les renseignements dont celui-ci avait si grand besoin. Balle-Franche s'était arrêté auprès de Bon-Affût.
—Ami, lui dit-il alors en espagnol, langue que la plupart des Indiens comprennent, votre ordre est exécuté; l'Aigle-Volant et sa femme sont à présent dans le camp des Gambucinos.
—Bien, répondit Bon-Affût, comprenant à demi-mot; quels sont les deux hommes qui vous accompagnent?
—Deux chasseurs que le chef des Gachupines m'a donnés pour m'accompagner, malgré mes assurances que vous vous trouviez au milieu d'amis; lui-même ne tardera pas à arriver à la tête de trente cavaliers.
—Retournez auprès de lui et dites-lui qu'il n'est pas nécessaire qu'il se dérange, ou plutôt, non, j'irai moi-même afin d éviter tout malentendu.
Ces paroles dites sans emphase, naturellement, par un homme que chacun des Indiens présents avait été souvent à même d'apprécier, produisirent sur eux un effet impossible à rendre.
Nous l'avons dit déjà plusieurs fois dans différents de nos ouvrages, les peaux-rouges joignent à la plus folle témérité la plus grande prudence, ils ne tentent jamais une entreprise sans calculer d'avance toutes les chances de réussite qu'elle peut leur offrir. Dès que ces chances disparaissent pour faire place à de mauvais résultats probables, ils n'ont pas honte de reculer, par la raison toute simple que chez eux, l'honneur comme nous le comprenons en Europe ne tient qu'une place secondaire et que le succès seul est considéré.
Certes le Loup-Rouge était un homme brave, il en avait dans maints combats donné d'innombrables preuves; cependant il n'hésita pas devant l'intérêt général à sacrifier ses désirs secrets, et en cela, nous le croyons, il donna une grande preuve de cet esprit de famille et de ce patriotisme pour ainsi dire instinctif qui est une des plus grandes force des Indiens. Tout fin qu'il était, le chef apache se laissa complètement tromper par Balle-Franche, dont l'aplomb imperturbable et l'intervention inattendue auraient suffi pour égarer l'opinion d'un individu plus intelligent encore que l'homme auquel il avait affaire. Le Loup-Rouge prit son parti immédiatement et sans arrière-pensée.
—Mon frère la Tête-Grise est le bienvenu à mon foyer, dit-il; mon cœur se réjouit de recevoir un ami; ses compagnons et lui peuvent prendre place autour du feu du conseil, le calumet d'un chef est prêt à leur être offert.
—Le Loup-Rouge est un grand chef, répondit Balle-Franche, je suis heureux des sentiments de bienveillance qu'il éprouve pour moi; j'accepterais son offre avec le plus grand plaisir, si des raisons urgentes ne m'obligeaient à rejoindre le plus tôt possible mes frères, les visages pâles, qui m'attendent à peu de distance de l'endroit où campent les Apaches Antilopes.
—J'espère qu'aucun nuage ne s'est élevé entre la Tête-Grise et son frère le Loup-Rouge, reprit le chef d'un accent cauteleux; deux guerriers doivent s'estimer.
—C'est aussi mon opinion, chef, voilà pourquoi je me suis aussi franchement présenté dans votre camp, lorsqu'il m'aurait été facile de me faire accompagner de plusieurs guerriers de ma nation.
Balle-Franche savait fort bien que les Apaches comprenaient l'espagnol, et que, par conséquent, rien de ce qu'il avait dit à Bon-Affût ne leur avait échappé; mais il était de son intérêt et de celui de son compagnon de feindre l'ignorer, et d'accepter comme argent comptant les propositions insidieuses du chef.
—Ses amis les visages pâles sont campés non loin d'ici? reprit le chef.
—Oui, répondit Balle-Franche, à quatre ou cinq portées de flèches au plus, dans la direction de l'ouest.
—Ooah! J'en suis fâché, fit l'Indien, sans cela j'aurais accompagné mes frères jusqu'à leur camp.
—Et qui vous empêche de venir avec nous? dit nettement le vieux chasseur; redouteriez-vous une mauvaise réception, par hasard?
—Och! Qui oserait ne pas recevoir le Loup-Rouge avec les égards qui lui sont dus? reprit l'Apache avec orgueil.
—Personne, assurément.
Le Loup-Rouge se pencha vers un chef subalterne et lui dit quelques mots à l'oreille; cet homme se leva et quitta la clairière. Les chasseurs virent ce mouvement avec inquiétude, ils échangèrent un regard qui signifiait: Tenons-nous sur nos gardes; et sans affectation ils reculèrent de quelques pas en arrière en se rapprochant les uns des autres, afin d'être prêts au moindre signe suspect; ils connaissaient la perfidie des gens avec lesquels ils se trouvaient, et s'attendaient à tout de leur part. L'Indien expédié par le chef rentra en ce moment dans la clairière; il avait à peine été absent dix minutes.
—Eh bien? lui demanda le Loup-Rouge.
—Nilijti,—c'est vrai,—répondit laconiquement l'Indien.
Le visage da sachem se rembrunit, il crut être certain alors que Balle-Franche ne l'avait pas trompé; car l'homme qu'il avait envoyé hors du camp était chargé, par lui, de s'assurer si effectivement on apercevait à peu de distance le feu d'une troupe de blancs; la réponse de son émissaire lui prouvait qu'une trahison n'était pas possible, qu'il fallait continuer à feindre de bons sentiments, et se séparer dans des termes convenables des hôtes incommodes dont il aurait tant désiré se débarrasser autrement.
Sur son ordre, les chevaux furent détachés, et les guerriers se mirent en selle.
—Le jour est proche, dit-il, la lune est rentrée dans la grande montagne; je me mets en route avec mes jeunes hommes; que le Wacondah protège mes frères pâles!
—Merci, chef, répondit Bon-Affût, mais ne venez-vous pas avec moi?
—Nous ne suivons pas le même sentier, répondit sèchement le chef, en lâchant la bride à son cheval.
—C'est probable, chien maudit, grommela Balle-Franche entre ses dents.
Toute la troupe était partie à fond de train et avait disparu dans les ténèbres; bientôt le bruit de ses pas cessa de se faire entendre, se confondant dans l'éloignement avec ces mille rumeurs sans cause apparente qui troublent incessamment le majestueux silence du désert.
Les chasseurs étaient seuls. Comme les augures de l'ancienne Rome, qui ne pouvaient se regarder sans rire, peu s'en fallut que les chasseurs ne s'éclatassent au nez après le départ précipité des Apaches. Sur un signal de Bon-Affût, l'Aigle-Volant et l'Églantine vinrent se joindre aux coureurs des bois qui déjà s'étaient installés sans façon devant les feux dont ils avaient si adroitement dépossédé leurs ennemis.
—Hum! fit Balle-Franche en bourrant sa pipe, je rirai longtemps de ce tour, il est presque aussi bon que celui que j'ai joué aux Pawnies en 1827, sur le haut Arkansas; j'étais bien jeune alors; depuis quelques années à peine je parcourais la Prairie, et je n'étais pas, comme aujourd'hui, habitué aux diableries indiennes; je me rappelle que....
—Mais par quel hasard vous rencontré-je ici, Balle-Franche? lui demanda son ami en l'interrompant brusquement.
Bon-Affût savait que dès que Balle-Franche commençait une histoire, il n'y avait plus de raison pour qu'il s'arrêtât dans sa narration; le digne homme, pendant le cours d'une vie longue et accidentée, avait vu et fait tant de choses extraordinaires, que le moindre événement qui lui arrivait, ou dont il était seulement le témoin, devenait immédiatement pour lui un prétexte pour un de ses interminables récits; ses amis; qui connaissaient sa faiblesse, ne se gênaient nullement pour l'interrompre; du reste, nous devons rendre à Balle-Franche cette justice de dire qu'il ne se fâchait jamais contre les interrupteurs; il est vrai que dix minutes après il recommençait une histoire qu'on avait soin d'interrompre comme la première, sans qu'il se fâchât davantage.
A la question de Bon-Affût, il répondit:
—Nous allons causer, et je vous conterai cela. Puis se tournant vers Domingo: Mon ami, lui dit-il, je vous remercie de l'aide que vous nous avez prêté; retournez au camp, et n'oubliez pas votre promesse, surtout ne manquez pas de rapporter ce que vous avez vu, à la personne que vous savez.
—C'est convenu, vieux trappeur. Soyez tranquille. Adieu.
—Bonne chance.
Domingo jeta son rifle sur l'épaule, alluma sa pipe et se dirigea à grands pas du côté du camp qui, du reste, n'était pas fort éloigné et où il arriva une heure plus tard.
—Là, dit Bon-Affût, maintenant je crois que rien ne s'oppose plus à ce que vous me répondiez.
—Si, mon ami, une chose encore.
—Laquelle?
—Voici la nuit presque passée; elle a été rude pour tout le monde; je suppose que deux ou trois heures de sommeil nous sont non pas indispensables, mais au moins nécessaires, d'autant plus que rien ne nous presse.
—Dites-moi seulement un mot, ensuite je vous laisserai dormir aussi longtemps que vous le désirerez.
—Voyons ce mot?
—Comment vous êtes-vous trouvé si à point ici pour me venir en aide?
—Diable, voilà précisément ce que je craignais, votre question m'oblige à entrer dans des détails beaucoup trop longs pour que je puisse vous satisfaire en ce moment.
—C'est que voyez-vous, mon ami, malgré le vif désir que j'aurais à demeurer quelques jours avec vous, je suis forcé de vous quitter au lever du soleil.
—Allons donc, ce n'est pas possible.
—Pardonnez-moi.
—Mais quelle raison assez urgente?...
—Je me suis engagé comme éclaireur avec une caravane à laquelle j'ai donné pour demain rendez-vous au gué del Rubio vers deux heures de l'après-midi; ce rendez-vous est pris depuis plus de deux mois. Vous savez qu'un engagement est sacré pour nous autres chasseurs, vous ne voudriez pas me faire manquer à ma parole.
—Pas pour toutes les peaux de bisons qui se tuent chaque année dans la Prairie. Vers quelle partie du Far-West guidez-vous ces hommes?
—Je le saurai demain.
—Et à quelle sorte de gens avez-vous affaire? Sont-ils Espagnols ou Gringos?
—Ma foi je les suppose Mexicains; leur chef de nomme, je crois, don Miguel Ortega, ou un nom approchant; quelque chose comme cela enfin.
—Hein! s'écria Balle-Franche, en faisant un bond de surprise: quel nom avez-vous dit?
—Don Miguel Ortega; après cela peut-être me trompé-je, mais je ne crois pas.
—C'est étrange! répéta le vieux chasseur, comme se parlant à lui-même.
—Je ne vois rien d'étrange là-dedans; ce nom me semble fort ordinaire.
—Pour vous, c'est possible; et vous avez traité avec lui?
—Parfaitement.
—Comme éclaireur?
—Oui, mille fois oui.
—Eh bien, rassurez-vous, Bon-Affût, nous avons de longs jours à vivre ensemble.
—Feriez-vous partie de sa troupe?
—Dieu m'en garde!
—Alors je n'y comprends plus rien.
Balle-Franche sembla sérieusement réfléchir pendant quelques instants, puis se tournant vers son ami:
—Écoutez-moi, Bon-Affût, lui dit-il, aussi bien vous êtes mon plus ancien ami, et je ne veux pas vous voir vous fourvoyer de gaieté de cœur; j'ai à vous donner certains renseignements qui vous sont indispensables pour vous acquitter convenablement de la tâche que vous avez acceptée; je vois que nous ne dormirons pas cette nuit, ainsi prêtez-moi l'oreille avec attention; ce que vous allez entendre en vaut la peine.
Bon Affût, surpris de l'accent solennel du vieux chasseur, le regarda avec inquiétude.
—Parlez, lui dit-il.
Balle-Franche rassembla un instant ses souvenirs, puis il prit la parole et commença une longue histoire que les assistants écoutèrent avec une attention et un intérêt qui croissaient d'instant en instant; car jamais, jusqu'à ce jour, ils n'avaient entendu de récit d'événements aussi bizarres et aussi extraordinaires.
Le soleil était levé depuis longtemps; le vieux chasseur parlait encore.
Voici dégagée de toutes les observations plus ou moins justes dont il plut au prolixe chasseur de l'embellir, l'histoire extraordinaire que le Canadien raconta à ses auditeurs. Cette histoire se lie si intimement à notre récit, que nous sommes contraints de la rapporter dans tous ses détails.
Peu de villes offrent un aspect plus enchanteur que Mexico; l'ancienne capitale des Aztèques s'étend, molle et paresseuse comme une nonchalante créole, à demi voilée par les épais rideaux de saules élancés qui bordent au loin les canaux et les routes. Bâtie juste à égale distance de deux océans, à environ 2,280 mètres au-dessus de leur niveau, c'est-à-dire à la hauteur de l'hospice du mont Saint-Bernard, cette ville jouit cependant d'un ciel délicieusement tempéré, entre deux magnifiques montagnes, le Popocatepetl—montagne fumante—et l'Iztaczehualt, ou la femme blanche, dont les cimes chenues, couvertes de glaces éternelles, se perdent dans les nues. L'étranger qui arrive à Mexico au coucher du soleil, par la chaussée de l'Est, une des quatre grandes voies qui conduisent à la cité des Aztèques, et qui seule aujourd'hui reste encore isolée au milieu des eaux du lac de Tezcuco, sur lequel elle est construite, éprouve, à la vue de cette ville, une émotion étrange dont il ne peut se rendre compte. L'architecture mauresque des édifices, les maisons peintes de couleurs claires, les coupoles sans nombre des églises et des couvents, qui dépassent les azotéas et couvrent, pour ainsi dire, la capitale tout entière de leurs vastes parasols jaunes, bleus ou rouges, dorés par les derniers rayons du soleil couchant, la brise tiède et parfumée du soir, qui arrive comme en se jouant à travers les branches touffues des arbres, tout concourt à donner à Mexico un air tout à fait oriental qui étonne et séduit à la fois. Mexico, brûlée entièrement par Fernando Cortez, fut rebâtie par ce conquérant sur le plan primitif: toutes les rues se coupent a angle droit, et vont aboutir à la plaza Mayor par cinq artères principales, qui sont les calles de Tacuba, de la Monterilla, de Santo Domingo, de la Moneda et de San Francisco.
Toutes les villes espagnoles du Nouveau-Monde, construites sur le même plan, ont cela de commun entre elles, que, dans toutes, la plaza Mayor est bâtie de la même façon. Ainsi, à Mexico, elle a sur une des faces, la cathédrale et le Sagrario; sur la seconde, le palais du président de la république, renfermant les ministères, au nombre de quatre, des casernes, une prison, etc.; sur la troisième face, se trouve l'Ayuntamiento; enfin la quatrième est remplie par deux bazars, le Parian et le Portal de las Flores.
Le 10 juillet 1854, vers dix heures du soir, après une chaleur torride qui, pendant tout le jour, avait contraint les habitants à se renfermer dans leurs maisons, la brise s'était levée, avait rafraîchi l'air, et chacun, montant sur les azotéas couvertes de fleurs, qui les font ressembler à des jardins suspendus, s'était hâté de jouir de cette sereine placidité des nuits américaines, qui semble, à travers le ciel bleu, pleuvoir des étoiles. Les rues et les places étaient envahies par les promeneurs; partout c'était un tohu-bohu, un pêle-mêle inextricable de piétons, de cavaliers, d'hommes, de femmes, d'Indiens et d'Indiennes, ou les haillons, la soie et l'or se mêlaient de la façon la plus bizarre, au milieu des cris, des quolibets et des éclats de rire, enfin, comme la ville enchantée des Mille et une Nuits, Mexico, au coup de cloche de l'oración, semblait s'être réveillée tout à coup d'un long sommeil séculaire, tant les visages respiraient la joie et semblaient heureux d'aspirer l'air à pleins poumons.
En ce moment, un sous-officier, facile à reconnaître au cep de vigne qu'il tenait à la main comme indice de son grade, déboucha de la calle San Francisco et se mêla à la foule qui encombrait la plaza Mayor, marchant en se dandinant avec cet air narquois et gobe-mouche particulier aux militaires de tous les pays. Celui-ci était un jeune homme à la mine hautaine, au regard fier et à la fine moustache coquettement relevée. Après avoir fait deux ou trois fois le tour de la place, en agaçant les jeunes filles et coudoyant les hommes, il s'approcha, de l'air toujours en apparence aussi indifférent, d'une échoppe adossée contre un des portales, et dans laquelle un vieillard, au visage de fouine et au regard sournois, s'occupait à renfermer, dans un tiroir d'une méchante table, maculée d'un nombre innombrable de taches d'encre, du papier, des plumes, des enveloppes, de la poudre, enfin tous les ustensiles nécessaires au métier d'écrivain public, métier qu'exerçait, en effet, le petit vieillard, ainsi que l'indiquait une planche suspendue au-dessus de la porte de l'échoppe, et sur laquelle était écrit, en lettres blanches sur fond noir: Juan-Bautista Leporello, Evangelista. Le sergent regarda pendant quelques secondes à travers les vitres, encombrées de spécimens d'écritures de toutes sortes; puis, satisfait sans doute de ce qu'il voyait, il frappa trois coups à la porte avec son cep de vigne.
Il y eut un mouvement de chaise dans l'intérieur; le soldat entendit le bruit d'une clef dans une serrure, puis la porte s'entrebâilla et l'evangelista parut, avançant timidement la tête.
—Eh! C'est vous, don Aníbal; ¡Dios me ampare! Je ne vous attendais pas aussitôt, dit-il de cette voie pateline et traînante que certains hommes emploient lorsqu'ils se sentent entre les mains d'un individu plus fort qu'eux.
—¡Cuerpo de Cristo! Faites donc l'innocent, vieux coyote, répondit rudement le sergent; qui donc, si ce n'est moi, oserait mettre le pied dans votre bouge maudit.
L'evangelista ricana en hochant la tête et relevant sur son front ses lunettes d'argent à verres ronds:
—Eh! Eh! fit-il en toussotant d'un air mystérieux, bien des gens ont recours à mon ministère, beau chérubin d'amour.
—Possible, répliqua le soldat en le repoussant sans cérémonie et entrant dans l'échoppe; ceux-là je les plains de tomber entre les mains d'un vieil oiseau de proie comme vous; mais moi, ce n'est pas cela qui m'amène.
—Peut-être vaudrait-il mieux pour vous et pour moi que vos visites eussent un autre motif que celui qui vous conduit ici? hasarda timidement l'evangelista.
—Trêve de sermon, fermez votre porte, mettez les volets pour que nul ne nous voie du dehors, et causons, nous n'avons pas de temps à perdre.
Le vieillard ne répliqua pas; il s'occupa immédiatement, avec une célérité dont on ne l'aurait pas cru capable, de fermer les volets qui, la nuit, défendaient son échoppe contre les entreprises des rateros; puis il vint s'asseoir auprès de son hôte, après avoir soigneusement verrouillé la porte en dedans.
Ces deux hommes, vus ainsi à la lueur d'un candil fumeux, formaient entre eux un étrange contraste: l'un jeune, beau, fort, hardi; l'autre vieux, cassé et hypocrite; tous deux se lançant à le dérobé des regards d'une expression indéfinissable, et, sous une apparente cordialité, cachant probablement une haine profonde, se parlant à voix basse, oreille contre oreille, semblaient deux démons conspirant la perte d'un ange.
Ce fut le soldat qui le premier reprit la parole d'une voix faible comme un souffle, tant il paraissait redouter d'être entendu.
—Voyons, Tío Leporello, dit-il, entendons-nous; la demie vient de sonner au Sagrario, ainsi parlez; qu'avez-vous appris de nouveau?
—Hum! fit l'autre, pas grand chose d'intéressant.
Le soldat lui lança un regard soupçonneux et parut réfléchir.
—C'est juste, dit-il au bout d'un instant, je n'y songeais plus; ou donc ai-je la tête?
Il fouilla dans sa poitrine et de la poche de son uniforme il sortit d'abord une bourse assez bien garnie, à travers les mailles de soie verte de laquelle étincelait l'or d'un nombre considérable d'onces, puis une longue navaja qu'il ouvrit et plaça sur la table auprès de lui. Le vieillard tressaillit à la vue de la lame acérée dont l'acier bleuâtre lançait des éclairs sinistres; le soldat ouvrit la bourse et fit ruisseler en joyeuses cascades les pièces devant lui. L'evangelista oublia instantanément le couteau pour ne plus s'occuper que de l'or, attiré malgré lui comme par un aimant irrésistible par le chatoiement du métal.
Le soldat avait fait tout ce que nous venons de dire avec le sang-froid d'un homme qui sait posséder entre les mains des arguments irrésistibles.
—Ça! reprit-il, fouillez dans votre mémoire, vieux démon, si vous ne voulez pas que ma navaja vous apprenne à qui vous avez à faire au cas où vous l'auriez oublié.
L'evangelista sourit d'un air agréable en jetant un regard de convoitise sur les onces.
—Je sais trop ce que je vous dois, don Aníbal, dit-il pour ne pas chercher à vous satisfaire par tous les moyens dont je dispose,
—Trêve de momeries et d'hypocrites politesses, vieux singe, et venons au fait. Prenez d'abord ceci, cela vous encouragera à être sincère.
Il lui mit dans la main quelques onces, que l'evangelista fit disparaître avec une prestesse si grande, qu'il fut impossible au soldat de savoir ou elles étaient passées.
—Vous êtes généreux, don Aníbal, cela vous portera bonheur.
—Au fait, au fait
—M'y voici.
—J'écoute.
Et le sergent s'accouda sur la table, dans la position d'un homme qui se prépare à écouter un récit intéressant, tandis que l'evangelista toussait, crachait, et par une vieille habitude de prudence, bien qu'il se trouvât seul avec le soldat dans son échoppe, jetait un regard soupçonneux autour de lui.
Les bruits de la plaza Mayor s'étaient éteints les uns après les autres, la foule s'était dispersée dans toutes les directions et était rentrée dans ses demeures, le plus grand silence régnait au dehors; en ce moment onze heures sonnèrent lentement à la cathédrale, les deux hommes tressaillirent malgré eux aux sons lugubres de l'horloge; les serenos chantèrent l'heure de leur voix traînarde et avinée, puis ce fut tout.
—Voulez-vous parler, oui ou non? s'écria brusquement le soldat avec un accent de menace.
L'evangelista fit un bond sur sa butaca, comme s'il se réveillait en sursaut, et passant à plusieurs reprises la main sur son front:
—Je commence, dit-il d'une voix humble.
—C'est bien heureux, reprit l'autre d'un ton bourru.
—Vous saurez donc; mais, observa-t-il en se reprenant, faut-il entrer dans tous les détails?
—¡Demonios! s'écria le soldat avec colère, finissons en une fois pour toutes, vous savez que je veux avoir les renseignements les plus complets; ¡canarios! Ne jouez pas avec moi, comme un chat avec une souris; vieillard, je vous en avertis, ce jeu serait dangereux pour vous.
L'evangelista s'inclina d'un air de conviction et reprit:
—Donc ce matin, j'étais à peine installé dans mon oficina; j'arrangeais mes papiers et je finissais de tailler mes plumes, lorsque j'entendis frapper discrètement à ma porte; je me levai, j'allai ouvrir: c'était une femme jeune et belle, autant que je pus en juger, car elle était embozada dans sa manta noire, de façon à ne pas être reconnue.
—Ce n'était donc pas la femme qui depuis un mois vous vient trouver chaque jour? interrompit le soldat.
—Si, mais comme vous l'avez sans doute remarqué, à chacune de ses visites elle a soin de changer de costume afin, sans doute, de se rendre méconnaissable; mais malgré ces précautions, je suis trop habitué aux finesses des femmes pour me laisser tromper, et je l'ai reconnue au premier regard que me lança son œil noir.
—Très bien; continuez.
—Elle demeura un instant silencieuse devant moi, jouant avec son éventail d'un air embarrassé, je lui offris poliment un siège feignant de ne pas la reconnaître et lui demandant à quoi je pouvais lui être bon.—Oh! me répondit-elle d'une voix mutine, je voudrais une chose bien simple.—Parlez, señorita, s'il s'agit de mon ministère, croyez bien que je me ferai un devoir de vous obéir.—Serais-je venue sans cela? me répondit-elle; mais êtes-vous un homme auquel on puisse se fier? Et en disant cela, elle fixait sur moi son grand œil noir d'un air interrogateur. Je me redressai, et, de mon accent le plus sérieux je lui répondis, en plaçant la main sur mon cœur:—Un evangelista est un confesseur, les secrets meurent dans mon sein. Elle sortit alors un papier de la poche de sa saya et le tourna et le retourna entre ses doigts, puis tout à coup elle se mit a rire en s'écriant:—Que je suis folle, je fais du mystère à propos de rien; d'ailleurs vous n'êtes en ce moment qu'une machine, puisque vous ne comprendrez pas vous-même ce que vous écrirez. Je m'inclinai à tout hasard, m'attendant à quelque combinaison diabolique, semblable à celles que depuis un mois elle me fait faire chaque jour.
—Trêve de réflexions, interrompit le sergent.
—Elle me donna le papier, reprit l'evangelista; et, ainsi que cela est convenu entre vous et moi, je pris une feuille de papier que je plaçai sur une autre préparée d'avance et noircie d'un côté, si bien que les mots que j'écrivais sur mon papier étaient reproduits par la feuille noire sur une autre, sans que la pauvre niña s'en doutât le moins du monde; après cela, la lettre n'était pas longue, elle avait tout au plus deux ou trois lignes; seulement je veux être damné, ajouta-t-il en se signant pieusement, si j'ai compris un seul mot à cet affreux grimoire que j'ai copié; ce doit être sans nul doute du morisque.
—Après?
—Après j'ai plié le papier en forme de lettre, et j'y ai mis une adresse.
—Ah! Ah! fit le soldat avec intérêt, c'est la première fois.
—Oui, mais ce renseignement ne vous avancera guère.
—Peut-être. Quelle est cette adresse?
—Z. p. V. 2, calle S. P. Z.
—Hum! fit le soldat d'un air pensif, en effet c'est un peu vague; ensuite?
—Ensuite elle est partie en me donnant une once d'or.
—Elle est généreuse.
—Pobre niña, fit l'evangelista en posant ses doigts crochus sur ses yeux secs d'un air attendri.
—Assez de momeries auxquelles je ne crois pas; voilà tout ce qu'elle vous a dit?
—A peu près, fit l'autre en hésitant.
Le sergent le regarda.
—Il y a donc autre chose? dit-il en lui jetant quelques pièces d'or que Tío Leporello fit disparaître incontinent.
—Presque rien.
—Dites toujours, Tío Leporello, vous qui êtes evangelista, vous savez que c'est ordinairement dans le post-scriptum des lettres que se trouve la raison qui les a fait écrire.
—En quittant mon oficina, la señorita fit signe à une providencia[1] qui passait; la voiture s'arrêta, et bien que la niña parlât bien bas, je l'entendis dire au cocher: Au couvent des Bernardines.
Le sergent tressaillit imperceptiblement.
—Hum! fit-il d'un air indifférent parfaitement joué, cette adresse ne signifie pas grand-chose; maintenant donnez-moi le papier.
L'evangelista fouilla dans son tiroir et en tira une feuille de papier blanc sur laquelle quelques mots étaient tracés en noir d'une façon presque illisible.
Dès que le soldat eut le papier entre les mains, il le parcourut des yeux; il paraît que ce qu'il lut avait pour lui un grand intérêt, car il pâlit visiblement, et un tremblement convulsif agita tout son corps, mais se remettant presque aussitôt:
—C'est bien, dit-il en déchirant le papier en parcelles imperceptibles, voilà pour vous!
Et il jeta sur la table une nouvelle poignée d'onces.
—Merci, caballero, s'écria Tío Leporello en se précipitant avidement sur le précieux métal.
Un sourire ironique plissa les lèvres du soldat, et profitant de la position du vieillard, qui était penché sur la table pour ramasser l'or il leva son couteau et le lui enfonça jusqu'au manche entre les deux épaules. Le coup fut si bien assené, porté d'une main si ferme, que le vieillard tomba comme une masse sans pousser un soupir, sans proférer une plainte. Le soldat le regarda un instant impassible et froid; puis rassuré par l'immobilité de sa victime, qu'il crut morte:
—Allons, murmura-t-il, cela vaut mieux; au moins de cette façon il ne parlera pas!
Après cette philosophique oraison funèbre, l'assassin essuya tranquillement son couteau, ramassa son or, éteignit le candil, ouvrit la porte de l'échoppe, la referma avec soin derrière lui, et s'éloigna de ce pas assuré, bien qu'un peu pressé, d'un promeneur attardé qui se hâte de regagner son logis.
La plaza Mayor était déserte.
[1] Nom des voitures de place à Mexico.
L'ancien Mexico était traversé par des canaux comme Venise, ou pour être plus vrai comme les villes de Hollande, car généralement dans toutes les rues il y avait un chemin latéral entre le canal et les maisons. Aujourd'hui que toutes les rues sont pavées, et qu'excepté dans un quartier de la ville les canaux ont disparu, on a peine à comprendre comment Cervantes, dans une de ses Nouvelles, a pu comparer Venise à Mexico; cependant si les canaux ne sont plus visibles, ils existent toujours sous le sol, et dans certains bas quartiers où on les a transformé en égouts, ils se révèlent par l'odeur fétide qu'ils exhalent ou bien encore par des amas d'ordures et des eaux stagnantes et croupissantes.
Le sergent, après avoir si lestement réglé ses comptes avec le malheureux evangelista, avait traversé la place dans toute sa largeur et s'était enfoncé dans la calle de la Monterilla.
Il marcha assez longtemps dans les rues, du même pas tranquille qu'il avait adopté en sortant de l'échoppe de l'evangelista. Enfin, après une course de vingt minutes environ à travers des carrefours déserts et des ruelles sombres dont l'apparence misérable devenait à chaque pas plus menaçante, il s'arrêta devant une maison d'apparence plus que suspecte, au-dessus de la porte de laquelle, derrière un retablo de las Ánimas Benditas brûlait un candil fumeux; les fenêtres de cette maison étaient éclairées et sur l'azotea des chiens de garde hurlaient lugubrement à la lune. Le sergent frappa deux coups à la porte de cette sinistre demeure avec le cep de vigne qu'il tenait à la main.
On fut assez longtemps à lui répondre; les cris et les chants cessèrent subitement dans l'intérieur; enfin le soldat entendit un pas lourd qui se rapprochait: la porte fut entr'ouverte, car, ainsi que cela se pratique partout à Mexico, une chaîne de fer soutenait les vantaux, et une voix avinée dit d'un ton bourru:
—¿Quién es?—Qui est-ce?
—Gente de paz, répondit le sergent.
—Hum! Il est bien tard pour courir la tuna et entrer au velorio! reprit l'autre, qui semblait se consulter.
—Je ne veux pas entrer.
—Que diable demandez-vous alors?
—¡Pan y sal! Por los cabelleros errantes[1], répondit le soldat d'un ton de commandement, en se plaçant de façon à ce que les rayons de la lune tombassent sur son visage.
L'homme se recula en poussant une exclamation de surprise.
—¡Válgame Dios! señor don Toribio, s'écria-t-il avec l'accent d'un profond respect, qui aurait reconnu votre seigneurie sous ce misérable accoutrement? Entrez, entrez, ils vous attendent avec impatience.
Et cet homme, devenu aussi obséquieux qu'il était insolent quelques minutes auparavant, se hâtait de détacher la chaîne afin d'ouvrir la porte toute grande.
—C'est inutile. Pepito, reprit le soldat; je te répète que je n'entrerai pas: combien sont-ils?
—Vingt, seigneurie.
—Armés?
—Complètement.
—Qu'ils descendent à l'instant, je les attends ici; va, mon fils, le temps presse.
—Et vous, seigneurie?
—Moi, tu m'apporteras un chapeau, une esclavina, mon épée et mes pistolets; allons, dépêche.
Pepito ne se fit pas répéter cet ordre; laissant la porte ouverte, il s'éloigna en courant.
Quelques minutes plus tard, une vingtaine de bandits armés jusqu'aux dents firent irruption dans la rue en se bousculant les uns les autres. Arrivés auprès du soldat, ils le saluèrent respectueusement, et, sur un signe de lui, ils demeurèrent immobiles et silencieux.
Pepe avait apporté les objets demandés par celui que l'evangelista avait nommé don Aníbal, que lui appelait don Toribio et qui, probablement, portait encore d'autres noms, mais auquel nous conserverons provisoirement le dernier.
—Les chevaux sont-ils prêts? demanda don Toribio, en recouvrant son uniforme avec l'esclavina et en passant à sa ceinture une longue rapière et une paire de pistolets doubles.
—Oui, seigneurie, répondit Pepito, le chapeau à la main.
—Bien, mon fils! Tu les apporteras où je t'ai dit; seulement, comme la nuit il est défendu de parcourir les rues à cheval, tu feras attention aux celadores et aux serenos.
Tous les bandits éclatèrent de rire a cette singulière recommandation.
—Là, reprit don Toribio, en se coiffant d'un chapeau à larges bords que Pepito lui avait apportés avec le reste, voilà qui est fait; maintenant nous pouvons partir; écoutez-moi attentivement, caballeros.
Les leperos et les autres coquins qui composaient l'assistance, flattés d'être traités de caballeros, se rapprochèrent de don Toribio afin de mieux entendre ses instructions.
Celui-ci continua.
—Vingt hommes marchant en troupe dans les rues de la ville éveilleraient, sans aucun doute, la susceptibilité et les soupçons des agents de la police; nous avons besoin d'user de la plus grande prudence, et surtout du plus grand mystère, pour réussir dans l'expédition pour laquelle je vous ai convoqués; vous allez donc vous séparer et vous rendre chacun isolément sous les murs du couvent des Bernardines; arrivés là, vous vous dissimulerez le mieux qu'il vous sera possible et vous ne bougerez pas avant mon ordre. Surtout pas de rixe, pas de querelle; vous m'avez bien compris?
—Oui, seigneurie, répondirent les bandits tous d'une voix.
—Très bien; partez alors, il faut que vous soyez au couvent dans un quart d'heure.
Les bandits se dispersèrent dans toutes les directions avec la rapidité d'une volée d'oiseaux de proie; deux minutes plus tard ils avaient disparu aux angles des rues les plus rapprochées.
Pepito seul était resté.
—Et moi, demanda-t-il respectueusement à don Toribio, ne voulez-vous pas, Seigneurie, que je vous accompagne? Je m'ennuierai bien si je restais seul ici.
—Je ne demanderais pas mieux que de t'emmener, mais qui nous préparera les chevaux si tu m'accompagnes?
—C'est vrai, je n'y songeais pas.
—Mais sois tranquille, muchacho, si je réussis, comme je l'espère, tu viendras avec moi bientôt.
Pepito, complètement rassuré par cette promesse, salua respectueusement l'homme mystérieux qui semblait être son chef, et rentra dans sa maison, dont il renferma soigneusement la porte sur lui.
Don Toribio, demeuré seul, resta quelques instants plongé dans de profondes réflexions; enfin il releva la tête, enfonça son chapeau sur les yeux, s'enveloppa avec soin dans son esclavina et s'éloigna à grands pas en murmurant à voix basse:
—Réussirai-je?
Question à laquelle personne, pas même lui, n'aurait pu répondre.
Le couvent des Bernardines s'élève dans un des plus beaux quartiers de Mexico, non loin du Paseo de Bucareli, la promenade à la mode; c'est un vaste édifice construit entièrement en pierres de taille, qui date de la reconstruction de la ville après la conquête et qui fut fondé par Fernando Cortez lui-même. Son ensemble est imposant et majestueux comme tous les couvents espagnols: c'est presque une petite ville dans la grande, car il renferme tout ce qui peut être agréable et utile à la vie; une église, un hôpital, une buanderie, un vaste potager, un jardin touffu et bien dessiné qui offre de doux ombrages réservés pour la promenade des religieuses; de larges cloîtres garnis de grands tableaux de bons maîtres, représentant des scènes de la vie de la Vierge et de celle de saint Bernard à qui le couvent est consacré; ces cloîtres, bordés de galeries circulaires sous lesquelles ouvrent les cellules des religieuses, encadrent des cours sablées ornées de pièces d'eau dont les gerbes élancées rafraîchissent l'air à l'heure si chaude de midi. Les cellules sont des charmantes retraites où rien de ce qui compose le confortable ne fait défaut; une couchette, deux butacas couvertes en cuir tanné de Cordoue, un prie-Dieu, une petite table de toilette dans le tiroir de laquelle on est certain de trouver un miroir, quelques tableaux de sainteté occupent la place principale. Dans un angle de la pièce on voit, entre une guitare et une discipline, une statue de la Vierge en bois ou en albâtre, portant une couronne de roses blanches sur la tête et ayant devant elle une lampe qui brûle constamment. Tel est l'ameublement qu'à peu d'exceptions près on est sur de rencontrer dans toutes les cellules des religieuses.
Le couvent des Bernardines renfermait, à l'époque où se passe cette histoire, cent cinquante religieuses et environ une soixantaine de novices. Dans ce pays de tolérance, il est rare de voir des religions cloitrées; les sœurs peuvent sortir en ville, faire et recevoir des visites; la règle est excessivement douce, et, à part les offices auxquels elles sont tenues d'assister avec une grande ponctualité, les religieuses, une fois rentrées dans leurs cellules, sont à peu près libres de faire ce que bon leur semble sans que personne y prenne garde ou semble s'en apercevoir.
Nous avons décrit les cellules du couvent, qui se ressemblent toutes; mais celle de la mère supérieure mérite une description particulaire. Rien de plus luxueux, de plus religieux et de plus mondain que son ensemble. C'était une immense salle carrée, percée de deux larges fenêtres en ogives, a petits carreaux enchâssés dans du plomb sur lesquels étaient peints des sujets de sainteté d'un fini et d'une sûreté de touche admirable. Les murs étaient recouverts de longues tentures en cuir de Cordoue gaufré et doré, des tableaux de prix représentant les principaux traits de la vie du saint patron du couvent étaient groupés avec cette symétrie et ce goût que l'on ne rencontre que chez les gens d'église. Entre les deux fenêtres était placée une magnifique Vierge de Raphaël devant laquelle se trouvait un autel. Une lampe d'argent, pleine d'huile odoriférante, descendait du plafond et brûlait nuit et jour devant l'autel, que d'épais rideaux de damas cachaient à volonté. Les meubles se composaient d'un grand paravent chinois derrière lequel se dérobait le lit de l'abbesse, simple couchette en bois de chêne sculpté, entourée d'une moustiquaire de gaze blanche. Une table carrée, aussi en chêne, supportant quelques livres et un pupitre, était au milieu de la chambre; dans un angle une vaste bibliothèque garnie de livres traitant de matières religieuses, laissant apercevoir à travers les glaces qui la fermaient les riches reliures d'ouvrages rares et précieux, quelques butacas et des sièges à pieds torses étaient adossés à la muraille. Enfin, un brasero en argent, rempli de noyaux d'olives, faisait face à un superbe meuble-bahut, dont les fines cannelures étaient un chef-d'œuvre de la Renaissance.
Pendant le jour, la lumière, tamisée par les vitraux coloriés des fenêtres, ne répandait qu'une clarté douce et mystique qui faisait éprouver au visiteur un sentiment de respect et de recueillement, en donnant à cette vaste pièce un aspect sévère et presque lugubre.
Au moment ou nous introduisons le lecteur dans cette cellule, c'est-à-dire peu d'instants avant la scène que nous avons précédemment rapportée, l'abbesse était assise dans un grand fauteuil à dossier droit surmonté de la couronne abbatiale, et dont le siège en cuir doré était garni d'une double frange de soie et d'or.
Cette abbesse était une petite femme replète, grassouillette, d'une soixantaine d'années, dont les traits auraient paru sans expression sans le regard clair et perçant qui s'échappait comme un jet de lave de ses yeux gris lorsqu'un sentiment violent l'agitait. Elle tenait à la main un livre ouvert et semblait plongée dans une profonde méditation.
La porte de la cellule s'ouvrit doucement: une jeune fille, revêtu du costume de novice, s'avança timidement en effleurant à peine le parquet de son pas léger et craintif.
Cette jeune fille alla se placer devant le fauteuil et attendit silencieusement que l'abbesse levât les yeux sur elle.
—Ah! Vous voici, mon enfant, dit enfin la supérieure en s'apercevant de la présence de la novice, approchez!
Celle-ci s'avança de quelques pas encore.
—Pourquoi êtes-vous sortie ce matin sans m'en avoir demandé la permission?
En entendant cette parole à laquelle cependant la jeune fille devait s'attendre, elle se troubla, pâlit et balbutia quelques mots inintelligibles.
L'abbesse reprit d'une voix sévère:
—Prenez garde, niña, quoique vous ne soyez encore que novice et que ne vous ne deviez prendre le voile que dans quelques mois, comme toutes vos compagnes, vous ne dépendez que de moi, de moi seule.
Ces mots furent prononcés avec un accent et une intonation qui firent frémir la jeune fille.
—Ma sainte mère! murmura-t-elle.
—Vous étiez l'amie intime, presque la sœur de cette jeune folle que sa résistance contre notre volonté souveraine a brisée comme un faible roseau et qui est morte ce matin.
—Croyez-vous donc qu'elle soit morte, ma mère? répondit la jeune fille timidement et d'une voix entrecoupée par la douleur.
—Qui en doute? s'écria l'abbesse avec éclat, en se levant à demi sur son fauteuil et en fixant un regard de vipère sur la pauvre enfant.
—Personne! Madame, personne! s'écria-t-elle en se reculant avec terreur.
—N'avez-vous pas, comme les autres membres de la communauté, continua l'abbesse avec un accent terrible, assisté à son convoi? N'avez-vous pas entendu les prières prononcées sur son cercueil?
—C'est vrai, ma mère.
—N'avez-vous pas vu descendre son corps dans les caveaux du couvent et sceller au-dessus la pierre tumulaire que l'ange de la justice divine doit seul soulever au jugement dernier? Dites, n'avez-vous pas assisté à cette cérémonie triste et terrible! Oseriez-vous soutenir que tout ne s'est pas passé ainsi et qu'elle est vivante, encore, cette misérable créature que Dieu a subitement frappée dans sa colère, pour qu'elle servît d'exemple à ceux que Satan pousse à la révolte.
—Pardon, ma sainte mère, pardon! J'ai vu ce que vous dites, j'ai assisté à l'enterrement de doña Laura; hélas! Le doute n'est point possible, elle est bien morte.
En prononçant ces dernières paroles, la jeune fille ne put retenir ses larmes, qui coulèrent abondamment.
L'abbesse la regarda d'un air soupçonneux:
—C'est bien, reprit-elle, retirez-vous; mais, je vous le répète, prenez garde; je sais que, vous aussi, un esprit de révolte s'est emparé de votre cœur, je vous surveillerai. La jeune fille salua humblement la supérieure et fit un mouvement pour obéir à l'ordre qu'elle avait reçu.
Tout à coup un bruit terrible se fit entendre; des cris d'effroi, des menaces résonnèrent dans les corridors et on entendit se rapprocher rapidement les pas pressés d'une foule en tumulte.
—Qu'est-ce que cela signifie? s'écria l'abbesse avec, effroi, quelle est cette rumeur?
Elle se leva avec agitation et se dirigea d'un pas incertain vers la porte de la cellule contre laquelle on frappait en ce moment à coups répétés.
—Mon Dieu! Mon Dieu! murmura la novice en jetant un regard suppliant à la statue de la Vierge dont le doux visage sembla lui sourire, sont-ce enfin des libérateurs!
Nous retournerons auprès de don Toribio, que nous avons laissé marchant avec ses compagnons dans la direction du couvent.
Ainsi que cela avait été convenu entre lui et ses complices, don Toribio trouva toute la troupe réunie sous les murs du couvent.
Sur leur chemin, les bandits, afin de ne pas être dérangés par les serenos, les avaient garrottés, bâillonnés et menés avec eux au fur et à mesure qu'ils les rencontraient disséminés dans les rues qu'ils parcouraient. Grâce à cette habile manœuvre, ils étaient arrivés sans encombre au but de leur course. Douze serenos avaient été capturés pendant le trajet.
Une fois parvenu au couvent, don Toribio fit poser les serenos à terre et donna l'ordre de les coucher les uns sur les autres, au pied même de la muraille.
Puis, sortant un loup de velours de l'une de ses poches, il s'en couvrit le visage, précaution imitée par ses compagnons, et s'approchant d'une misérable masure, qui s'élevait à peu de distance, il enfonça la porte d'un coup d'épaule. Le maître de la bicoque arriva effaré et à moitié vêtu pour s'informer de ce que signifiait cette manière insolite de frapper à sa porte; le pauvre diable recula avec un cri de terreur en apercevant les hommes masqués qui étaient groupés à l'entrée de la maison.
Don Toribio était pressé, il entama la conversation en allant de suite droit au but;
—Buenas noches, Tío Salado; je suis charmé de vous voir en bonne santé, lui dit-il.
L'autre répondit sans trop savoir ce qu'il disait:
—Je vous remercie, caballero, vous êtes trop bon.
—Allons, dépêchez-vous, prenez votre manteau et venez avez nous.
—Moi! fit Salado avec un geste d'effroi.
—Vous-même.
—Mais en quoi puis-je vous être utile?
—Je vais vous le dire: je sais que vous êtes fort considéré au couvent des Bernardines, comme pulquero d'abord et ensuite comme hombre de bien y religioso.
—Oh! Oh! Jusqu'à un certain point, répondit évasivement le pulquero.
—Pas de fausse modestie, je sais que vous avez le pouvoir de vous faire ouvrir les portes de cette maison quand bon vous semble; c'est pour cette raison que je vous invite à nous accompagner.
—¡Jesús María! Y pensez-vous, caballero? s'écria le pauvre diable avec effroi.
—Pas d'observations, dépêchons, ou de par Nuestra señora del Carmen, je brûle votre bicoque!
Un sourd gémissement sortit de la poitrine de Salado, qui après avoir jeté un regard désespéré sur les masques noirs qui l'entouraient, se mit en devoir d'obéir.
De la maison du pulquero au couvent il n'y avait que quelques pas; ils furent bientôt franchis: don Toribio se tourna vers son prisonnier plus mort que vif:
—Ah ça, compadre, lui dit-il nettement, nous voici arrivés, à vous maintenant de nous ouvrir les portes.
—Mais, au nom du Ciel, s'écria le pulquero, en faisant un dernier effort pour résister; comment voulez-vous que je m'y prenne? Vous ne songez donc pas que je n'ai aucun moyen de...
—Ecoutez! fit impérieusement don Toribio, vous comprenez que je n'ai pas le loisir de discuter avec vous: ou vous nous introduisez dans le couvent, et cette bourse qui contient cinquante onces est à vous, ou vous refusez, et alors, ajouta-t-il froidement en sortant un pistolet de sa ceinture, je vous brûle la cervelle avec ceci!
Une sueur froide baigna les tempes du pulquero; il connaissait trop bien les bandits de son pays pour leur faire l'injure de douter de leurs paroles.
—Eh bien! lui demanda l'autre en armant le pistolet, avez-vous réfléchi?
—¡Cáspita! caballero, ne jouez pas avec cela, je vais essayer.
—Pour mieux réussir, voici la bourse, fit don Toribio.
Le pulquero s'en empara avec un mouvement de joie dont il est impossible de donner une idée; puis, il se dirigea lentement vers la porte du couvent, tout en cherchant dans sa tête comment il pourrait s'y prendre pour gagner honnêtement la forte somme qu'il venait de recevoir sans courir le moindre risque, problème, nous l'avouons, dont la solution n'était pas facile à trouver.
[1] Mot à mot: Pain et sel pour les cavaliers errants.
Le pulquero s'était enfin décidé à obéir. Soudain une pensée lumineuse traversa son cerveau, et ce fut le sourire aux lèvres qu'il souleva le marteau pour frapper.
Au moment où il allait le laisser retomber, don Toribio lui arrêta le bras.
—Qu'y a-t-il? demanda Salado.
—Onze heures sont sonnées depuis longtemps déjà, tout le monde dort ou doit dormir dans le couvent, peut-être vaudrait-il mieux employer un autre moyen.
—Vous vous trompez, caballero, répondit le pulquero; la tourière veille.
—Vous en êtes sur?
—¡Caramba!—répliqua l'autre, qui avait enfin formé son plan et qui maintenant craignait d'être obligé de restituer l'argent qu'il avait reçu si l'homme qui le poussait en avant changeait de résolution,—le couvent des Bernardines de Mexico est ouvert jour et nuit aux gens qui viennent y chercher des médicaments. Laissez-moi faire.
—Allez donc alors, répondit le chef de l'expédition en lui lâchant le bras.
—Salado ne se fit pas répéter l'autorisation de peur d'une nouvelle objection, il se hâta de laisser tomber le marteau qui résonna sur son clou de cuivre. Don Toribio et ses compagnons s'étaient effacés contre la muraille.
Au bout d'un instant la planchette du judas glissa dans sa rainure, et la face ridée de la tourière apparut à l'ouverture.
—Qui êtes-vous, mon frère? demanda-t-elle d'une voix chevrotante et endormie; pourquoi venez-vous à cette heure avancée frapper au couvent des Bernardines?
—¡Ave María purísima! dit Salado de son air le plus cafard.
—Sin pecado concebida, mon frère, seriez-vous malade?
—Je suis un pauvre pécheur que vous connaissez, ma sœur; mon âme est plongée dans l'affliction.
—Qui donc êtes-vous, mon frère? Je crois en effet reconnaître votre voix; mais la nuit est si noire, que je ne puis distinguer les traits de votre visage.
—Et j'espère bien que tu ne les verras pas, dit mentalement Salado, qui ajouta à haute voix, je suis le señor Templado qui tient une locanda dans la calle Plateros.
—Ah! Je vous remets à présent, mon frère.
—Je crois que cela prend, murmura le pulquero.
—Que désirez-vous, mon frère? Hâtez-vous de me l'apprendre, au très saint nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, fit-elle en se signant dévotement, mouvement imité par Salado, car l'air est très froid, et il me faut continuer mes oraisons que vous avez interrompues.
—¡Válgame Dios, ma sœur! Ma femmes et mes deux enfants sont malades; le révérend père gardien des Franciscains m'a engagé à venir vous demander trois bouteilles de votre eau miraculeuse.
Nous ferons observer en passant que chaque couvent fabrique, au Mexique, une soi-disant eau miraculeuse dont la recette est soigneusement gardée; cette eau guérit, dit-on, toutes les maladies, miracle que nous n'avons jamais pour notre compte été mis à même de constater; il va sans dire que cette panacée universelle se vend très cher et forme le plus clair des revenus de la communauté.
—Jésus! s'écria la vieille, dont les yeux pétillèrent de joie à la commande exorbitante du pulquero; trois bouteilles!
—Oui, ma sœur. Je vous demanderai aussi la permission de me reposer un instant! Car je suis venu si vite, et l'émotion de la maladie de ma femme et de mes enfants m'a tellement brisé, que j'ai peine à me tenir debout.
—Pauvre homme! fit la tourière avec pitié.
—Oh! Ce sera réellement une charité que vous ferez, ma sœur.
—Señor Templado, regardez, je vous prie, autour de vous, afin de voir s'il n'y a personne dans la rue; nous vivons dans un si mauvais temps, qu'on ne saurait prendre trop de précautions.
—Il n'y a personne, ma sœur, répondit le pulquero en faisant signe aux bandits de se tenir prêts.
—Alors je vais ouvrir.
—Dieu vous en récompensera, ma sœur.
—Amen! fit-elle dévotement.
On entendit le grincement de la clef dans la serrure, le bruit des verrous qu'on tirait, et la porte s'ouvrit.
—Entrez vite, mon frère, dit la religieuse.
Mais Salado s'était prudemment retiré en arrière et avait cédé la place à don Toribio.
Celui-ci s'élança sur la tourière sans lui laisser le temps de se reconnaître, la saisit à la gorge et lui serrait le cou dans ses deux mains comme dans un étau:
—Un mot sorcière, lui dit-il à l'oreille, et je te tue!
Épouvantée par cette attaque subite d'un homme dont le visage était couvert d'un masque noir, la vieille femme tomba à la renverse sans connaissance.
—Au diable la coquine! s'écria don Toribio avec colère: qui nous guidera maintenant?
Il essaya d'abord de faire revenir la tourière; mais reconnaissant bientôt qu'il n'y réussirait pas, il fit signe à deux de ses hommes de la bâillonner et de la garroter solidement; puis, après avoir recommandé à ces deux individus de rester en sentinelle à la porte, il s'empara du trousseau de clefs dont la religieuse était dépositaire, et il se mit en devoir, suivi de tous ses autres compagnons, de pénétrer dans le bâtiment habité par les religieuses. Ce n'était pas chose facile à découvrir dans cette immense Thébaïde que la cellule habitée par la supérieure, car c'était à l'abbesse seule que don Toribio en voulait.
Or, pour causer avec la supérieure, il fallait d'abord la trouver, et c'était là ce qui embarrassait les bandits, maîtres de la place qu'ils avaient conquise par ruse. Cependant au moment où ils commençaient à perdre tout espoir, un incident, suscité par leur présence inopportune, vint à leur secours.
Les bandits s'étaient répandus comme un torrent qui a rompu ses digues dans les cours et les cloîtres, sans s'inquiéter le moins du monde des suites que leur invasion pouvait avoir pour le couvent, criant et jurant comme des damnés; ils semblaient vouloir ne laisser aucun recoin, si secret qu'il fût, sans l'avoir visité avec soin; il est vrai qu'en agissant ainsi ils ne faisaient que se conformer aux ordres de leur chef.
Les religieuses, accoutumées au calme et au silence, ne tardèrent pas à se réveiller à ce bruit, qu'elles crurent un moment causé par un tremblement de terre; elles s'étaient précipitamment jetées à bas de leurs couchettes, et à peine vêtues étaient venues, comme une nichée de colombes effrayées, se réfugier vers la cellule de l'abbesse en poussant des cris d'effroi épouvantables.
La supérieure, partageant l'erreur de ses religieuses, était parvenue à ouvrir sa porte, réunissant son troupeau autour d'elle, elle s'avança résolument vers l'endroit d'où partait le bruit, s'appuyant majestueusement sur sa crosse abbatiale.
Soudain elle aperçut une bande de démons masqués, criant, hurlant et brandissant des armes de toutes sortes. Mais avant qu'elle eut jeté un cri, don Toribio s'élança vers elle.
—Point de bruit, dit-il, nous ne voulons pas vous faire du mal; nous venons, au contraire, réparer celui que vous avez fait.
Muettes de terreur à la vue de tant d'hommes masqués, les femmes étaient restées comme pétrifiées.
—Que voulez-vous de moi? balbutia la supérieure d'une voix tremblante.
—Vous allez le savoir, répondit le chef; et se tournant vers un de ses hommes: Les mèches soufrées, dit-il.
Un bandit lui apporta silencieusement ce qu'il demandait.
—Maintenant, écoutez-moi avec attention, señora. Hier une novice de votre couvent qui, il y a quelques jours, avait refusé de prendre le voile, est morte subitement.
La supérieure promena un regard de commandement autour d'elle, puis s'adressant à l'homme qui lui parlait:
—Je ne sais ce que vous voulez dire, répondit-elle avec assurance.
—Fort bien, je m'attendais à cette réponse. Je continue: cette novice, âgée à peine de seize ans, se nommait doña Laura de Acévedo y Real del Monte; elle appartenait à l'une des premières familles de la République; ce matin ses obsèques ont eu lieu avec tout le cérémonial usité en pareil cas, dans l'église même de ce couvent; puis son corps à été descendu en grande pompe dans les caveaux réservés à la sépulture des religieuses.
Il s'arrêta en fixant à travers son masque sur la supérieure des yeux qui lançaient des éclairs.
—Je vous répète que je ne sais ce que vous voulez dire, répondit-elle froidement.
—Ah! Fort bien, écoutez encore ceci, señora, et faites-en votre profit, car vous êtes tombée, je vous le jure, entre les mains d'hommes qui ne vous feront pas grâce et ne se laisseront attendrir ni par vos larmes, ni par vos cris de douleur, si vous les obligez à en venir à certaines extrémités.
—Vous ferez ce que bon vous semblera, répondit la supérieure toujours impassible; je suis entre vos mains; je sais que je n'ai pour le moment du moins nul secours à attendre de qui que ce soit, Dieu me donnera la force de souffrir le martyre.
—Madame, répondit don Toribio en ricanant, vous blasphémez en ce moment: c'est un péché mortel que vous commettez sciemment, mais peu m'importe, ce sont vos affaires. Voici les miennes: vous allez à l'instant m'indiquer l'entrée des caveaux et l'endroit ou repose doña Laura Acévedo; j'ai juré d'enlever son corps d'ici, coûte que coûte. J'accomplirai mon serment, quoi qu'il arrive; si vous consentez à ce que je vous demande, mes compagnons et moi, nous nous retirerons en enlevant le corps de la pauvre morte, mais sans toucher à une épingle des richesses immenses que renferme ce couvent.
—Et si je refuse, répondit-elle avec hauteur.
—Si vous refusez, reprit-il en appuyant sur chaque mot, comme s'il avait voulu mieux les faire comprendre à son interlocutrice, le couvent sera pillé, ces blanches colombes deviendront la proie du démon, ajouta-t-il avec un geste qui fit frémir de terreur les religieuses, et vous, je vous appliquerai à une certaine torture qui, je n'en doute pas, vous déliera la langue.
L'abbesse sourit avec mépris.
—Commencez par moi, dit-elle.
—C'est aussi mon intention; allons, ajouta-t-il d'une voix rude, à la besogne!
Deux hommes s'avancèrent et s'emparèrent de la supérieure; celle-ci n'essaya aucunement de se défendre. Elle demeura immobile, impassible en apparence; cependant un froncement imperceptible de ses sourcils témoignait de l'émotion intérieure qu'elle éprouvait.
—C'est votre dernier mot, señora, demanda don Toribio?
—Faites votre office, bourreaux, répondit-elle avec mépris, essayez de vaincre la volonté d'une vieille femme.
—C'est ce que nous allons faire; allez! commanda-t-il.
Les deux bandits se mirent en devoir d'obéir à leur chef.
—Arrêtez, au nom du Dieu vivant! s'écria une jeune fille en se précipitant résolument devant la supérieure et repoussant les bandits.
Cette jeune fille était la novice avec laquelle causait l'abbesse au moment de l'invasion du couvent.
Il y eut une seconde d'hésitation suprême.
—Taisez-vous, je vous l'ordonne, s'écria l'abbesse; laissez-moi souffrir, Dieu nous voit.
—C'est justement parce qu'il nous voit que je parlerai, répondit péremptoirement la jeune fille, c'est lui qui a envoyé ici ces hommes que je ne connais pas pour empêcher un grand crime. Suivez-moi, caballeros, vous n'avez pas un instant à perdre, je vais vous conduire aux caveaux.
—Malheureuse! reprit l'abbesse en se débattant avec rage entre les mains de ceux qui la contenaient, malheureuse, c'est sur toi que retombera ma colère.
—Je le sais, répondit tristement la jeune fille, mais aucune considération personnelle ne m'empêchera d'accomplir un devoir sacré.
—Bâillonnez cette vieille coquine! Il faut en finir! ordonna le chef.
L'ordre fut immédiatement exécuté; malgré sa résistance désespérée la supérieure fut en quelques minutes réduite à l'impuissance.
—Qu'un de vous la garde, continua don Toribio, et au moindre geste suspect, faites-lui sauter la cervelle. Puis changeant de ton et s'adressant à la novice: Mille fois merci, señorita, dit-il d'une voix émue, terminez ce que vous avez si bien commencé, guidez-nous vers ces redoutables caveaux.
—Venez! répondit-elle en se mettant à leur tête.
Les bandits, devenus sages tout à coup, la suivirent silencieusement, avec les marques du plus profond respect.
Sur un ordre péremptoire de don Toribio, les religieuses, rassurées désormais, s'étaient dispersées et étaient rentrées dans leurs cellules.
Pendant qu'ils traversaient les corridors, don Toribio s'approcha de la jeune fille et prononça à son oreille deux ou trois mots qui la firent tressaillir.
—Ne craignez rien, ajouta-t-il, j'ai voulu seulement vous prouver que je savais tout; je ne veux être pour vous, señorita, que l'ami le plus respectueux, le plus dévoué.
La jeune fille soupira sans répondre.
—Qu'allez-vous devenir désormais, seule dans ce couvent, livrée sans défense à la haine de cette furie pour laquelle il n'existe au monde rien de sacré; vous ne tarderez pas à reprendre la place de celle que nous allons délivrer, ne vaut-il pas mieux la suivre?
—Hélas, pauvre Laura! murmura-t-elle sourdement.
—Vous qui avez tant fait pour elle jusqu'à présent, l'abandonnerez-vous à ce moment suprême, ou plus que jamais votre aide et votre appui lui deviendront nécessaires; n'êtes-vous pas sa sœur de lait, son amie la plus chère! Qui vous arrête? Orpheline depuis votre plus tendre enfance, sur Laura se concentrent toutes vos affection; répondez-moi, Doña Luisa, je vous en conjure.
La jeune fille fit un geste d'étonnement, presque d'effroi.
—Vous me connaissez! fit-elle.
—Ne vous ai-je pas dit que je savais tout; allons, mon enfant, si ce n'est pour vous que ce soit pour elle, accompagnez-la, ne me contraignez pas à vous laisser ici aux mains d'ennemis terribles qui vous infligeront d'affreuses tortures.
—Vous le voulez, balbutia-t-elle tristement.
—C'est elle qui vous en prie par ma bouche.
—Eh bien, soit, le sacrifice sera complet; je vous suivrai, bien que j'ignore si en agissant ainsi je fais bien ou mal; mais malgré que je ne vous connaisse pas, qu'un masque me dérobe vos traits, j'ai foi en vos paroles; il me semble que vous avez un noble cœur, Dieu veuille que je ne commette pas une erreur.
—C'est ce Dieu de bonté et de miséricorde qui vous inspire cette résolution, pauvre enfant.
Doña Luisa laissa tomber sa tête sur sa poitrine, en poussant un soupir qui ressemblait à un sanglot.
Ils continuèrent à marcher auprès l'un de l'autre sans échanger un seul mot.
La troupe était sortie des cloîtres et parcourait en ce moment des bâtiments démeublés et qui depuis longues années semblaient ne pas avoir été habités.
—Ou nous conduisez-vous donc, Niña? demanda don Toribio; je croyais que dans ce couvent les caveaux étaient, comme dans les autres, creusés sous le sol de l'église.
La jeune fille sourit tristement.
—Aussi n'est-ce pas aux caveaux que je vous conduis, répondit-elle d'une voix tremblante.
—Ou donc alors?
—Aux in-pace!
—Oh! murmura-t-il.
—Le cercueil qui devant tous a été ce matin descendu dans les caveaux, continua doña Luisa, contenait en effet le corps de cette pauvre Laura, il était impossible de faire autrement à cause de la coutume qui exige que les morts soient ensevelis dans leurs habits et à visage découvert; mais aussitôt que la foule se fut écoulée, que les portes de l'église se furent refermées sur l'assistance, la supérieure ordonna de relever la pierre des caveaux qui n'étaient pas encore assujettie, elle fit remonter et transporter le corps dans l'in-pace le plus profond du couvent. Mais nous voici arrivés, dit-elle en s'arrêtant et en désignant une large pierre posée à plat sur le sol de la salle dans laquelle ils se trouvaient.
Cette scène avait quelque chose de lugubre et de saisissant; dans cette salle nue, ces hommes masqués groupés autour de cette jeune fille vêtue de blanc, éclairés seulement par les reflets sanglants des torches qu'ils agitaient, ressemblaient à s'y méprendre à ces mystérieux francs juges qui aux anciens jours s'assemblaient dans les ruines pour juger les rois et les empereurs.
—Soulevez cette pierre, dit don Toribio d'une voix creuse.
Après quelques efforts la pierre fut enlevée ouvrant un gouffre sombre d'où s'exhala une bouffée d'air chaud et fétide. Don Toribio prit une torche et se pencha sur l'ouverture.
—Mais, fit-il au bout d'un instant, ce caveau est désert.
—Oui, répondit simplement doña Luisa, celle que vous cherchez est plus bas.
—Comment plus bas! s'écria-t-il avec un mouvement d'effroi dont il ne fut pas le maître.
—Ce caveau n'est pas assez profond, un hasard peut le faire découvrir, les cris peuvent s'entendre au dehors; il y a deux autres caveaux comme celui-ci superposés l'un sur l'autre. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, l'abbesse a résolu de faire disparaître une religieuse et de la retrancher a jamais du nombre des vivants, cette religieuse est descendue dans le dernier, celui qu'on nomme l'Enfer! Là tout bruit meurt, tout sanglot reste sans écho, toute plainte est vaine. Oh! L'inquisition faisait bien les chose, allez! Et puis il y a si peu de temps qu'elle ne règne plus au Mexique, que dans les couvents on en a conservé quelque chose: cherchez plus bas, caballero, cherchez plus bas!
Don Toribio, à ces paroles, sentit une sueur froide perler à la racine de ses cheveux; il se croyait en proie à un cauchemar horrible. Faisant un effort suprême pour dompter l'émotion qui l'accablait, il descendit dans le caveau au moyen d'une échelle mobile appuyée contre une des parois; plusieurs de ses compagnons le suivirent.
Après quelques recherches ils découvrirent une pierre semblable à la première. Don Toribio plongea la torche dans le gouffre.
—Vide! s'écria-t-il avec horreur.
—Plus bas, vous dis-je! Cherchez plus bas, répéta d'une voix sombre doña Luisa, demeurée sur le bord du caveau supérieur.
—Que leur avait donc fait cette adorable créature pour la martyriser ainsi? s'écria don Toribio au comble de la douleur.
—L'avarice et la haine sont deux terribles conseillères, répondit la jeune fille; mais hâtez-vous, hâtez-vous; chaque minute qui s'écoule est un siècle pour celle qui attend.
Don Toribio, en proie à une rage indicible, se mit en devoir de découvrir le dernier caveau. Après quelques instants, ses recherches furent couronnées de succès.
A peine la pierre fut-elle soulevée, que, sans tenir compte de l'air méphitique qui s'élança de l'ouverture et faillit éteindre sa torche, il se pencha en avant.
—Je la vois! Je la vois! s'écria-t-il avec un cri ressemblant plutôt à un rugissement qu'à la voix humaine.
Et sans attendre davantage, sans même calculer la hauteur, il se précipita dans le caveau.
Quelques minutes plus tard, il remontait dans la salle, portant dans ses bras le corps inanimé de doña Laura.
—En retraite, mes amis! En retraite! s'écria-t-il en s'adressant à ses compagnons; ne demeurons pas une seconde de plus dans ce repaire de bêtes fauves à face humaine.
Sur un signe de lui, doña Luisa fut enlevée dans les bras d'un vigoureux lepero, et tous s'éloignèrent en courant dans la direction des cloîtres. Bientôt ils atteignirent la cellule de la supérieure.
En les apercevant, l'abbesse fit un effort violent pour briser ses liens, et se tordit impuissante, comme une vipère, en lançant à ces hommes qui avaient déjoué ses hideux projets, des regards chargés de haine et de rage.
—Misérable! s'écria don Toribio, en passant près d'elle, et en la repoussant dédaigneusement du pied, soyez maudite, votre châtiment commence, car votre victime vous échappe.
Par un de ces efforts que seule la haine arrivée à son paroxysme peut rendre possible, l'abbesse parvint à déranger un peu son bâillon.
—Peut-être! s'écria-t-elle d'une voix qui résonna comme un glas funèbre aux oreilles de don Toribio.
Vaincue par ce dernier effort, elle s'évanouit.
Cinq minutes plus lard, il ne restait plus dans le couvent que ses hôtes accoutumés.
A ce point de son récit Balle-Franche s'arrêta et s'occupa d'un air pensif à charger de tabac sa pipe indienne.
Il y eut un long silence.
Les assistants, encore sous le coup de cette histoire extraordinaire, n'osaient hasarder aucune réflexion.
Bon-Affût releva la tête.
—Cette histoire est fort dramatique et fort sombre, dit-il; mais pardonnez-moi ma rude franchise, mon vieux et cher camarade, elle me semble n'avoir aucun rapport avec ce qui se passe autour de nous, et les événements dans lesquels nous sommes probablement appelés a être acteurs, ou tout au moins spectateurs intéressés.
—Au fait, observa Ruperto, que nous importent, à nous autres coureurs des bois, les aventures qui arrivent à Mexico, ou dans n'importe quelle autre ville des tierras interiores? Nous sommes ici dans le désert pour chasser, trapper ou combattre les peaux-rouges; toute autre question doit fort peu nous toucher.
Balle-Franche hocha la tête d'une façon significative, et posant machinalement sa pipe auprès de lui:
—Vous vous trompez, compagnons, reprit-il; croyez-vous donc que je vous aurais fait perdre votre temps à écouter ce long récit, s'il n'avait pour nous tous une raison d'actualité des plus importantes?
—Expliquez-vous alors, mon ami, reprit Bon-Affût, car je vous avoue que, pour ma part, je n'ai absolument rien compris à ce qu'il vous a plu de nous dire.
Le vieux Canadien leva la tête, et sembla, pendant quelques instants, calculer la hauteur du soleil.
—Il est six heures et demie du matin, dit-il, vous avez encore devant vous plus de temps qu'il ne vous en faut pour vous rendre au gué del Rubio, où doit vous attendre celui auquel vous vous êtes engagé à servir de guide; écoutez-moi donc, car je n'ai pas fini tout à fait; maintenant que je vous ai rapporté le mystère, je vais vous dire quels sont les renseignements qui sont venus l'éclaircir.
—Parlez, répondit Bon-Affût, du ton d'un homme qui se résout à écouter par condescendance un récit qu'il sait ne pas devoir l'intéresser.
Balle-Franche, sans paraître remarquer l'apathique complaisance de son ami, reprit la parole en ces termes:
—Vous avez vu que tout avait été prévu par don Toribio avec une prudence qui devait éloigner tous soupçons et couvrir cette aventure d'un voile impénétrable; malheureusement, l'evangelista Leporello n'avait pas été tué roide: il put non seulement parler, mais encore montrer un double de chacune des lettres qu'il remettait tous les jours au jeune homme, lettres que celui-ci lui payait si cher et que, par cette prudence innée dans la race mexicaine, il avait précieusement gardées pour s'en faire un arme au besoin contre don Toribio, ou, ce qui est plus probable encore, pour se venger au cas où il serait victime d'une trahison. Ce fut ce qui arriva: l'evangelista, trouvé agonisant par un client matinal, eut la force de faire une déclaration en règle au juez de lettras[1] et de lui remettre les papiers, puis il mourut. Cet assassinat, rapproché de l'enlèvement des serenos par une troupe nombreuse et de l'envahissement du convent des Bernardines, donna une piste que la police commença à suivre avec une ténacité extrême, d'autant plus que la jeune fille dont le corps avait été si audacieusement enlevé, avait des parents puissants qui, pour certaines raisons à eux connues, ne voulurent pas laisser ce crime impuni, et répandirent l'or à profusion. L'on sut bientôt que les bandits, en sortant du couvent, étaient montés sur des chevaux amenés par des gens apostés par eux, et s'étaient éloignés à toute bride dans la direction des presidios. On parvint même à découvrir un des hommes qui avaient fourni les chevaux; cet individu, nommé Pepito, plutôt gagné par l'or qu'on lui offrit qu'effrayé par les menaces, déclara avoir vendu, pour le compte de don Toribio Carvajal, vingt-cinq chevaux de route, livrables à deux heures du matin, au couvent des Bernardines; comme ces chevaux avaient été payés d'avance, lui, Pepito, ne s'était pas préoccupé du singulier endroit qu'on lui assignait et de l'heure non moins singulière. Don Toribio et ses amis étaient arrivés portant avec eux deux femmes, dont l'une paraissait évanouie, et ils s'étaient immédiatement éloignes à toute bride. La piste des ravisseurs avaient été suivie ainsi jusqu'au presidio du Tubac, où don Toribio avait fait reposer sa troupe pendant quelques jours; là il avait acheté un palanquin fermé, une tente de campagne, toutes les provisions nécessaires à une longue exploration dans le désert, et une nuit il avait disparu subitement avec toute sa troupe, augmentée de tous les gens sans aveu ramassés par lui au presidio, sans que nul pût dire de quel côté il s'était dirigé; ces renseignements étaient vagues, mais suffisants jusqu'à un certain point; les parents de la jeune fille continuèrent leurs recherches.
—Je crois commencer à entrevoir où vous en voulez venir, interrompit Bon-Affût, mais concluez; lorsque vous aurez terminé, je vous ferai certaines observations, dont, j'en suis convaincu, vous reconnaîtrez comme moi la justesse.
—Je ne demande pas mieux, mon bon camarade, interrompit Balle-Franche, et il continua. Un homme qui, il y a une vingtaine d'années, m'a rendu un certain service assez important, que je n'avais pas revu depuis, et que, certes, je n'aurais pas reconnu s'il ne m'avait pas dit son nom, seule chose que je n'avais point oubliée, vint me trouver, sur ces entrefaites; Ruperto, mon associé et moi, nous étions au presidio du Tubac occupés à vendre quelques peaux de tigres et de panthères. Cet homme me dit ce que je vous ai rapporté; il ajouta qu'il était proche parent de la jeune fille, il me rappela le service qu'il m'avait rendu, bref il sut tellement m'émouvoir, que je m'engageai a l'aider à se venger de son ennemi. Deux jours plus tard nous prenions la piste; pour un homme habitué comme moi à suivre la trace des Indiens, cette piste était un jeu d'enfant, et bientôt je le conduisis presque en présence de la caravane espagnole commandée par don Miguel Ortega.
—L'autre se nommait don Toribio Carvajal.
—Ne pouvait-il pas avoir changé de nom?
—A quoi bon dans le désert?
—Dans la prévision qu'on le poursuivrait.
—Les parents avaient donc un grand intérêt à cette poursuite?
—Don José m'a dit être l'oncle de la jeune fille, pour laquelle il a une tendresse de père.
—Mais elle est morte, il me semble, ou du moins c'est, si je ne me trompe, ce que vous m'avez dit.
Balle-Franche se gratta l'oreille.
—Voilà justement où la question s'embrouille, dit-il; c'est qu'il paraît qu'elle n'est pas morte du tout, au contraire.
—Hein! s'écria Bon-Affût, elle n'est pas morte! Cet oncle le sait donc, c'est donc de son consentement que la pauvre créature a été enterrée vive! Mais si cela est, il y a là-dessous une odieuse machination.
—Ma foi, puisqu'il faut vous l'avouer, j'en ai peur! dit le Canadien d'une voix peu assurée; cependant cet homme m'a rendu un grand service, je n'ai aucune preuve à l'appui de mes soupçons, et...
Bon-Affût se leva, et se plaçant en face du chasseur:
—Balle-Franche, lui dit-il d'une voix sévère, nous sommes compatriotes, nous nous aimons comme deux frères; pendant de longues années nous avons dormi côte à côte dans la Prairie, partageant entre nous la bonne et la mauvaise fortune, nous sauvant cent fois la vie l'un à l'autre, soit dans nos luttes contre les bêtes fauves, soit dans nos combats contre les Indiens; est-ce vrai?
—C'est vrai, Bon-Affût, c'est vrai, et celui qui dirait le contraire en aurait menti! répondit le chasseur avec émotion.
—Mon ami, mon frère, un grand crime a été commis ou est sur le point de se commettre; prenons garde, veillons, veillons avec soin; qui sait, si nous ne sommes pas les instruments choisis par la Providence pour démasquer les coupables et faire triompher les innocents! Ce don José, m'avez-vous dit désire que je me joigne à vous, fort bien, j'accepte; vous, Ruperto et moi, nous allons nous rendre au gué del Rubio, et croyez-moi, mon ami, maintenant que je suis averti, quel que soit le coupable, je le découvrirai.
—J'aime mieux qu'il en soit ainsi, répondit naïvement le chasseur. J'avoue que la position étrange dans laquelle je me trouvais me pesait singulièrement. Je ne suis qu'un pauvre chasseur, moi, qui ne comprend rien à toutes ces infamies des villes.
—Vous êtes un homme honnête dont le cœur est juste et l'esprit droit; mais le temps se passe; maintenant que nous sommes convenus de nos faits et que nous nous entendons, je crois que nous ferons bien de nous mettre en route.
—Je partirai quand vous le voudrez.
—Un instant encore. Pouvez-vous pendant quelque temps vous passer de Ruperto?
—Parfaitement.
—De quoi s'agit-il? demanda celui-ci.
—D'un service à me rendre.
—Parlez, Bon-Affût, je suis prêt.
—Nul ne peut prévoir l'avenir: peut-être dans quelques jours aurons-nous besoin d'alliés sur lesquels il nous soit possible de compter; ces alliés, le chef ici présent nous les donnera quand nous les lui demanderons; accompagnez-le dans son village, puis, dès qu'il y sera arrivé, quittez-le et prenez notre piste, sans cependant nous rejoindre positivement, mais seulement de façon que, si besoin était, nous sachions où vous rencontrer.
—J'ai compris, dit laconiquement le chasseur en se levant; soyez tranquille.
Bon-Affût, se tourna alors vers l'Aigle-Volant et lui expliqua ce qu'il attendait de lui.
—Mon frère a sauvé l'Églantine, répondit noblement le chef; l'Aigle-Volant est un sachem dans sa tribu; deux cent guerriers suivront le sentier de la guerre au premier signe de mon père; les Comanches sont des hommes, les paroles que soufflent leurs poitrines viennent de leur cœur.
—Merci, chef, répondit Bon-Affût, en serrant chaleureusement la main que lui tendait le peau-rouge; que le Wacondah veille sur vous pendant votre voyage!
Après avoir mangé en hâte un morceau de venaison cuite sur les charbons du foyer, et bu un trago de pulque, dont, suivant l'habitude de sa nation, la seule qui ne boive pas de liqueur forte, le Comanche s'abstint de prendre sa part, les quatre hommes se séparèrent, Ruperto, l'Aigle-Volant et l'Églantine, s'enfonçant dans la Prairie, dans la direction de l'ouest, tandis que Balle-Franche et Bon-Affût, obliquant un peu à gauche, se dirigeaient, au contraire, vers l'Est, afin de gagner le gué del Rubio, où le second était attendu.
—Hum! observa Balle-Franche en jetant son rifle sous le bras gauche et se mettant en marche de ce pas élastique particulier aux coureurs des bois, nous nous sommes taillé une rude besogne.
—Qui sait, mon ami? répondit Bon-Affût d'un ton soucieux. Dans tous les cas, il nous faut découvrir la vérité.
—C'est aussi mon avis.
—Il y a une chose que je veux savoir avant tout.
—Laquelle?
—Ce que renferme le palanquin si bien fermé de don Miguel.
—Pardieu! Une femme, sans doute.
—Qui vous l'a dit?
—Personne, mais je le présume.
—Ne préjugeons de rien, mon ami; avec le temps tout s'éclaircira.
—Dieu le veuille!
—Dieu voit tout et sait tout, mon ami. Croyez bien que, s'il lui a plu de faire germer au fond de nos cœurs les soupçons qui nous tourmentent en ce moment, c'est que, ainsi que je vous le disais, il y a un instant, il veut faire de nous les instruments de sa justice.
—Que sa volonté soit faite! répondit Balle-Franche en ôtant pieusement son bonnet; je suis prêt à obéir à tout ce qu'il ordonnera de moi.
Après cet échange mutuel de pensées, les chasseurs, qui jusqu'à ce moment avaient marché côte à côte, prirent la file indienne, à cause des difficultés du chemin, c'est-à-dire qu'ils ne s'avancèrent plus qu'à la suite l'un de l'autre.
Arrivés dans les hautes herbes, après être sortis de la forêt, ils s'arrêtèrent un instant pour s'orienter.
—Il est tard, observa Bon-Affût.
—Oui, il est près de midi; suivez-moi, nous aurons bientôt rattrapé le temps perdu.
—Comment cela?
—Au lieu de marcher, ne seriez-vous pas d'avis de faire la route à cheval?
—Oui, si nous avions des chevaux?
—Voilà justement ce que je veux vous procurer.
—Vous avez des chevaux?
—J'ai laissé cette nuit, ici aux environs, mon cheval et celui de Ruperto, pour aller au rendez-vous que m'avait assigné don José, rendez-vous auquel j'étais forcé d'aller dans une pirogue.
—Eh! Eh! Ces braves bêtes arrivent bien; pour ma part je suis rompu, je vous l'avoue; voici longtemps déjà que je chemine à pied à travers la Prairie, mes jambes commencent à ne plus vouloir me porter.
—Venez par ici, nous ne tarderons pas à les voir.
En effet, les chasseurs n'eurent pas fait trois cents pas dans la direction marquée par Balle-Franche, qu'ils aperçurent les chevaux occupés à brouter tranquillement les pois grimpants et les jeunes pousses des arbres. Les nobles bêtes, en entendant le sifflet d'appel, relevèrent leur tête fine et intelligente, et accoururent vers les chasseurs en hennissant de plaisir. Ainsi que c'est l'habitude dans la Prairie, ils étaient sellés; seulement leur bozal était suspendu à leur cou. Les chasseurs les bridèrent, sautèrent sur leur dos et se remirent en route.
—Maintenant que nous avons chacun un bon cheval entre les jambes nous sommes certains d'arriver à temps, observa Bon-Affût; ainsi, il est inutile de nous presser nous pouvons causer à notre aise: dites-moi, Balle-Franche, avez-vous vu déjà don Miguel Ortega?
—Jamais, je l'avoue.
—Ainsi, vous ne le connaissez pas?
—Si je dois m'en rapporter à don José, c'est un scélérat; quant à moi, n'ayant jamais eu de rapports avec lui, je serais fort embarrassé d'avoir sur son compte une opinion bonne ou mauvaise.
—Moi, c'est différent, je le connais.
—Ah!
—Parfaitement.
—Depuis longtemps?
—Depuis assez longtemps, je le crois du moins pour avoir été à même de le juger.
—Ah! Ah! Qu'en pensez-vous?
—Beaucoup de bien et beaucoup de mal.
—Diable!
—Pourquoi vous étonnez-vous? Tous les hommes ne sont-ils pas dans le même cas?
—A peu près, j'en conviens.
—Celui-là n'est ni plus mauvais ni meilleur que les autres; cette nuit, comme je pressentais que vous alliez me parler de lui, j'ai voulu vous laisser votre liberté d'action en vous disant que je ne le connaissais que fort peu; mais il est possible que bientôt votre opinion se modifie complètement, et peut-être regretterez-vous l'appui que vous avez donné jusqu'à présent à ce don José, ainsi que vous le nommez.
—Voulez-vous que je vous parle nettement Bon-Affût, maintenant que nul, si ce n'est Dieu, ne peut nous entendre?
—Parlez, mon ami, je ne serais pas fâché de connaître votre pensée tout entière.
—La voici: je suis certain que vous en savez beaucoup plus que vous ne voulez en avoir l'air sur l'histoire que je vous ai contée cette nuit.
—Peut-être avez-vous raison, mais qui vous fait croire cela?
—Bien des choses, et d'abord celle-ci.
—Voyons.
—Vous êtes un homme trop sensé, vous avez acquis une trop grande expérience des choses de la vie, pour prendre sans cause sérieuse la défense d'un homme que, d'après les principes que nous professons dans les Prairies, vous devez au contraire plutôt considérer, sinon comme un ennemi, du moins comme un de ces individus avec lesquels il est souvent désagréable de se trouver en contact et d'en tenir des relations.
Bon-Affût se mit à rire.
—Il y a du vrai dans ce que vous dites là, Balle-Franche, fit-il.
—N'est-ce pas?
—Je ne lutterai pas de finesse avec vous: oui, j'ai de fortes raisons pour prendre la défense de cet homme; ces raisons, je ne puis vous les dire en ce moment: c'est un secret qui ne m'appartient pas, dont je suis seulement dépositaire; j'espère que bientôt vous saurez tout, mais jusque-là, reposez-vous sur ma vieille amitié et laissez-moi agir à ma guise.
—A la bonne heure, au moins maintenant je commence à voir clair, et, quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur moi.
—Pardieu! Je savais bien que nous finirions par nous entendre, mais silence, et ne laissez rien paraître, nous sommes au rendez-vous. Diable! Les Mexicains ne se sont pas fait attendre, ils ont déjà établi leur camp au bord de la rivière.
En effet, un camp de chasseurs se voyait à peu de distance, appuyé d'un côté sur la rivière, de l'autre sur la forêt, et présentant une enceinte parfaitement fortifiée avec des ballots et des troncs d'arbres entrelacés, la face tournée vers la prairie.
Les deux chasseurs se firent reconnaître par les sentinelles et pénétrèrent sans difficulté dans l'intérieur.
Don Miguel Ortega était absent, les gambucinos l'attendaient d'un moment à l'autre. Les chasseurs mirent pied à terre, entravèrent leurs chevaux et s'assirent tranquillement auprès du feu.
Don Stefano Cohecho avait quitté, ainsi qu'il l'avait annoncé la veille, les gambucinos au point du jour.
[1] Juge criminel
Pour l'intelligence des faits qui vont suivre, nous allons, usant de notre privilège de conteur, rétrograder d'une quinzaine de jours, afin de faire assister le lecteur à une scène qui se lie intimement aux événements les plus importants de cette histoire, et qui se passait à quelques centaines de milles au plus de l'endroit où le hasard avait rassemblé nos principaux personnages.
La Cordillère des Andes, cette immense arête du continent américain, que sous différents noms elle traverse dans toute sa longueur, du nord au sud, à divers sommets qui forment des llanos immense, sur lesquels vivent des populations entières à une hauteur où cesse en Europe toute végétation.
Après avoir traversé le presidio de Tubac, sentinelle perdue de la civilisation sur l'extrême limite du désert, et s'être avancé dans la région mediano de la tierra caliente la longueur d'à peu près cent vingt milles, on se trouve tout à coup et sans transition en face d'une forêt vierge qui n'a pas moins de trois cent vingt milles de profondeur sur quatre-vingts et quelques de largeur.
La plume la plus exercée est impuissante à décrire les merveilles sans nombre que renferme ce réseau inextricable de végétation qu'on appelle une forêt vierge, et l'aspect à la fois étrange et bizarre, majestueux et imposant, qu'elle présente aux yeux éblouis. L'imagination la plus fantaisiste recule devant cette prodigieuse fécondité d'une nature élémentaire, renaissant continuellement de sa propre destruction avec une force et une vigueur toujours nouvelles. Des lianes qui courent d'arbre en arbre, de branche en en branche, plongent ça et là dans la terre pour s'élever plus loin vers le ciel, et forment en se croisant et s'enchevêtrant les unes dans les autres une barrière presque infranchissable, comme si la nature jalouse avait voulu dérober aux regards profanes les mystérieux secrets de ces forêts, sous l'ombre desquelles les pas de l'homme n'ont retenti qu'à de longs intervalles et jamais impunément. Des arbres de tout âge et de toute espèce poussent sans ordre et sans symétrie comme s'ils avaient été semés au hasard, ainsi que les grains de blé dans les sillons. Les uns, minces et élancés, comptent à peine quelques années; l'extrémité de leur branche est recouverte par les hautes et larges ramures de ceux dont la tête superbe a vu passer des siècles. Sous la feuillée murmurent doucement des sources pures et limpides, qui courent et s'échappent des fissures des rochers et vont, après mille et mille détours, se perdre dans quelque lac ou dans quelque rivière inconnue dont les eaux libres n'ont encore reflété dans leur calme miroir que les arcanes sublimes de la solitude. Là se trouvent pêle-mêle et dans un désordre pittoresque tous ces magnifiques produits des régions tropicales, l'acajou, l'ébénier, le palissandre, le mahogany tortueux, le chêne noir, le chêne-liège, l'érable, le mimosa au feuillage argenté, le tamarinier, poussant dans toutes les directions ses branches chargés de fleurs, de fruits et de feuilles qui forment un dôme impénétrable aux rayons du soleil. Des profondeurs vastes et inexplorées de ces forêts sortent de temps à autre des bruits inexplicables, des rugissements féroces, des miaulements félins, des cris moqueurs mêlés à des sifflements aigus, chants joyeux et pleins d'harmonie ou expression de colère, de rage et de terreur des hôtes redoutés qui les peuplent.
Après s'être engagé résolument au milieu de ce chaos, et lutté corps à corps avec cette nature inculte et sauvage, on parvient, la hache d'une main et la torche de l'autre, à se frayer pouce à pouce, pas à pas, une route impossible a décrire; tantôt en rampant comme un reptile sur des détritus de feuilles, de bois mort ou de fiente d'oiseaux, amoncelés depuis des siècles; ou bien en courant de branche en branche au sommet des arbres et voyageant pour ainsi dire dans les airs. Mais malheur à celui qui néglige d'avoir l'œil constamment ouvert sur tout ce qui l'entoure et l'oreille au guet! Car, outre les obstacles élevés par la nature, il a à craindre les morsures venimeuses des serpents troublés dans leurs retraites, et les attaques furieuses des bêtes fauves. Il faut encore surveiller avec soin le cours des fleuves et des rivières que l'on rencontre, relever la position du soleil pendant le jour, ou se guider la nuit par la croix du sud, car une fois égaré dans une forêt vierge, il est impossible d'en sortir; c'est un dédale dont aucun fil d'Ariane ne pourrait aider à trouver l'issue.
Puis enfin, lorsqu'on est parvenu à surmonter les dangers que nous avons détaillés, et mille autres non moins terribles que nous avons passé sous silence, on débouche dans une plaine immense, au centre de laquelle s'élève une ville indienne.
C'est-à-dire qu'on se trouve devant une de ces mystérieuses cités dans lesquelles aucun Européen n'a jamais pénétré, dont on ignore même la position exacte, et qui, depuis la conquête, servent d'asile aux derniers restes de la civilisation des Aztèques.
Les récits fabuleux faits par quelques voyageurs sur les richesses incalculables enfouies dans ces villes, ont allumé la convoitise et l'avarice d'un grand nombre d'aventuriers qui, à diverses époques, ont tenté de trouver la route perdue de ces reines des prairies et des savanes mexicaines. D'autres, poussés seulement par l'attrait irrésistible que les entreprises extraordinaires offrent aux imaginations vagabondes, sont aussi, depuis une cinquantaine d'années surtout, partis à la recherche de ces villes indiennes, sans que jamais jusqu'à ce jour le succès ait couronné ces diverses expéditions. Quelques-uns sont revenus désenchantés et à demi perclus de ce voyage vers l'inconnu; un certain nombre on laissé leurs cadavres au fond des précipices ou dans les quebradas pour servir de pâtures aux oiseaux de proie, enfin d'autres, plus malheureux encore, ont disparu sans laisser de traces, et sans que depuis on ait jamais su ce qu'ils étaient devenus.
Nous, par suite de circonstances trop longues à rapporter ici, mais dont quelque jour nous ferons le récit, nous avons habité, malgré nous, une de ces impénétrables villes, mais, plus heureux que nos prédécesseurs dont nous avons rencontré, comme de sinistres jalons, les os blanchis épars sur la route, nous sommes parvenu à nous en échapper a travers milles périls, tous miraculeusement évités.
La description que nous allons donner est donc de la plus scrupuleuse exactitude, et impossible à révoquer en doute, car nous parlons de visu.
Quiepaa-Tani, la ville qui s'offre enfin aux yeux dès que l'on a franchi la forêt vierge dont nous venons de tracer un aperçu, s'étend de l'est à l'ouest et forme un carré long. Une large rivière, sur laquelle sont jetés plusieurs ponts de lianes d'une légèreté et d'une élégance incroyables, la traverse dans toute sa longueur. A chaque angle de ce carré, un bloc énorme de rocher, coupé à pic du côté qui regarde la campagne, sert de fortifications presque imprenables; ces quatre citadelles sont reliées, en outre, entre elles par une muraille épaisse de vingt pieds à la cime et haute de quarante, qui, en dedans de la ville, forme un talus dont la base à soixante pieds de large. Cette muraille est construite en briques du pays, faites avec de la terre sablonneuse et de la paille hachée; on les nomme adobas; elles sont longues d'environ un mètre. Un fossé large et profond double presque la hauteur des murs.
Deux portes donnent seules entrée dans la cité. Ces portes sont flanquées de tours et de poivrières absolument comme une forteresse du moyen-âge, et ce qui vient encore à l'appui de la comparaison, un petit pont composé de planches, extrêmement étroit et mobile, posé de façon à être enlevé à la moindre alerte, est la seule communication de chacune de ces portes avec le dehors.
Les maisons sont basses et se terminent en terrasses qui se relient les unes aux autres; elles sont légères et bâties en jonc et en cañaverales revêtus de ciment, à cause des tremblements de terre si fréquents dans cette région; mais elles sont vastes, bien airées et percées de nombreuses fenêtres. Toutes n'ont qu'un seul étage d'élévation, et les façades sont enduites d'un verni d'une blancheur éclatante.
Cette étrange ville, aperçue de loin, surgissant au milieu des hautes herbes de la prairie, offre le plus singulier et le plus séduisant aspect.
Par une belle soirée du mois d'octobre, cinq personnes, dont il eut été impossible de distinguer les traits ou le costume, en raison de l'obscurité, débouchèrent de la forêt que nous avons décrite plus haut, s'arrêtèrent un moment, avec une indécision marquée, sur l'extrême lisière du bois qu'elles venaient de franchir, et commencèrent à examiner le terrain. Devant elles s'élevait un monticule qui encaissait la forêt, et dont le sommet, bien que peu élevé, coupait l'horizon en droite ligne.
Après avoir échangé quelques paroles entre eux, deux des personnages restèrent où ils se trouvaient; les autres trois se couchèrent à plat ventre et, en rampant sur les pieds et sur les mains, s'avancèrent au milieu des herbes gigantesques qu'ils faisaient onduler et qui cachaient entièrement leur corps.
Puis, parvenus sur le haut du tertre qu'ils avaient eu une si grande difficulté à gravir, ils plongèrent leurs regards dans le vide et demeurèrent frappés d'étonnement et d'admiration.
L'éminence au sommet de laquelle ils se trouvaient était coupée à pic, ainsi que toute la partie du terrain qui s'étendait à leur droite et à leur gauche. Une magnifique plaine se déroulait à cent pieds au-dessous d'eux, et au milieu de cette plaine, c'est-à-dire à mille mètres environ de distance, s'élevait, fière et imposante, Quiepaa-Tani[1], la ville mystérieuse, défendue par ses tours massives et ses épaisses murailles. L'aspect de cette vaste cité, au milieu de ce désert, produisit sur l'esprit des trois hommes un sentiment de stupeur dont ils ne purent se rendre compte et qui, pendant quelques minutes, les rendit muets de surprise.
Enfin l'un d'eux se releva sur le coude, et s'adressant à ses compagnons:
—Mes frères sont-ils contents? dit-il avec un accent guttural qui, bien qu'il s'exprimât en espagnol, le faisait reconnaître pour Indien, Addick—le Cerf—a-t-il tenu sa promesse?
—Addick est un des premiers guerriers de sa tribu; sa langue est droite et le sang coule clair dans ses veines, répondit un des deux hommes auxquels il s'adressait.
L'Indien sourit silencieusement sans répondre: ce sourire eût donné fort à penser à ceux qui l'accompagnaient, s'ils avaient pu le voir.
—Il me semble, observa celui qui n'avait pas encore parlé, qu'il est bien tard pour rentrer dans la ville.
—Demain, au lever du soleil, Addick conduira les deux Lis à Quiepaa-Tani, répondit l'Indien, la nuit est trop sombre.
—Le guerrier a raison, repartit le second interlocuteur, il faut remettre la partie à demain.
—Oui, retournons auprès de nos compagnes, qu'une trop longue absence pourrait inquiéter.
Joignant le geste à la parole, le premier interlocuteur se retourna et, suivant exactement le sillon que son corps avait tracé parmi les herbes, il se trouva bientôt, ainsi que ses compagnons qui avaient imité tous ses mouvements, sur la lisière de la forêt, dans laquelle, après leur départ, les deux personnages qu'ils avaient laissés en arrière étaient rentrés.
Au silence qui règne sous ces sombres voûtes de feuillage et de branches pendant le jour, avaient succédé les bruits sourds d'un sauvage concert, formé par les cris aigus des oiseaux de nuit qui s'éveillaient et se préparaient à fondre sur les loros, les colibris ou les cardinaux attardés loin de leurs nids, les rugissements des cougouars, les miaulements hypocrites des jaguars et des panthères et les aboiements saccadés des coyotes, dont les échos se répercutaient en sons lugubres sous les voûtes profondes des cavernes inaccessibles et des fondrières béantes qui servaient de repaires à ces hôtes dangereux.
Reprenant la route qu'ils s'étaient tracée avec la hache, les trois hommes se virent bientôt auprès d'un feu de bois mort, qui brûlait au centre d'une éclaircie de terrain. Deux femmes, ou plutôt deux jeunes filles étaient accroupies pensives et tristes auprès du feu. Ces jeunes filles comptaient à peine trente ans à elles deux; elles étaient belles de cette beauté créole que le pinceau divin de Raphaël a seul pu exprimer dans ses ravissantes têtes, de Vierge. Mais, en ce moment, elles étaient pâles, semblaient fatiguées, et leurs visages reflétaient une sombre tristesse. Au bruit des pas qui se rapprochaient, elles levèrent les yeux, et un éclair de joie vint comme un rayon de soleil animer leur visage.
L'Indien jeta quelques menues branches dans le feu qui menaçait de s'éteindre, tandis que l'un des chasseurs s'occupait à donner aux chevaux, entravés à peu de distance, leur provende de pois grimpants.
—Eh bien! Don Miguel, demanda l'une des jeunes filles en s'adressant au chasseur qui avait pris place à leurs côtés, sommes-nous bientôt au but de notre voyage?
—Vous êtes arrivée, señorita: demain, sous la conduite de notre ami Addick, vous entrerez dans la ville, asile inviolable où nul ne vous poursuivra.
—Ah! reprit-elle en jetant un regard distrait sur le visage sombre et impassible de l'Indien, demain nous nous séparerons?
—Il le faut, señorita; le soin de votre sûreté l'exige.
—Qui oserait me venir chercher dans ces parages inconnus?
—La haine ose tout! Je vous en supplie, señorita, ayez foi en mon expérience; mon dévouement pour vous est sans bornes; vous avez, bien que fort jeune encore, assez souffert pour qu'un rayon béni du soleil vienne égayer votre front rêveur et dissiper les nuages que la pensée et la douleur y amassent depuis si longtemps.
—Hélas! fit-elle en baissant la tête pour cacher les larmes qui coulaient sur ses joues.
—Ma sœur, mon amie, ma Laura! s'écria l'autre jeune fille en l'embrassant tendrement, soit courageuse jusqu'au bout; ne reste-je pas avec toi? Oh! Ne crains rien, ajouta-t-elle avec une charmante expression, je prendrai la moitié de tes peines, comme cela le fardeau te semblera moins lourd.
—Pauvre Luisa, murmura la jeune fille en lui rendant ses caresses, c'est à cause de moi que tu es malheureuse; comment pourrai-je jamais reconnaître ton dévouement?
—En m'aimant comme je t'aime, mon ange chérie, et en reprenant espoir.
—Avant un mois, je l'espère, reprit don Miguel, vos persécuteurs seront mis pour toujours dans l'impossibilité de vous nuire; je joue avec eux une partie terrible, dont ma tête est l'enjeu; mais peu m'importe, si je vous sauve. Laissez-moi, en vous quittant, emporter dans mon cœur l'espoir que vous n'essayerez en aucune façon de sortir du refuge que je vous ai trouvé, et que vous attendrez patiemment mon retour.
—Hélas! caballero, vous le savez, je n'existe que par un miracle; mes parents, mes amis, tous ceux enfin que j'aimais m'ont abandonné, excepté Luisa, ma sœur de lait, dont le dévouement pour moi ne s'est jamais démenti; et vous que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, et qui, tout à coup, vous êtes révélé à moi dans ma tombe, comme l'ange de la justice divine; depuis cette nuit terrible où, comme Lazare, je suis, grâce à vous, sortie du sépulcre, vous m'avez entourée des soins les plus délicats et les plus intelligent, vous avez remplacé ceux qui m'avaient trahie, vous avez été pour moi plus qu'un père, presque un dieu.
—Señorita! s'écria le jeune homme confus et heureux à la fois de ces paroles.
—Je vous dis cela, don Miguel, continua-t-elle avec une certaine animation fébrile, parce je tiens à vous prouver que je ne suis pas ingrate. Je ne sais ce que, dans sa sagesse, Dieu décidera de moi; mais, sachez-le, ma dernière prière et ma dernière pensée seront pour vous. Vous voulez que je vous attende, je vous obéirai; croyez-le bien, je ne dispute plus ma vie que par une certaine curiosité de joueur aux abois, ajouta-t-elle avec un sourire navrant; mais je comprends combien vous avez besoin de votre liberté d'action pour la rude partie que vous avez entreprise; aussi, partez tranquille, j'ai foi en vous.
—Merci, señorita, cette promesse double mes forces, Oh! Maintenant, je suis certain de réussir.
Un espèce de jacal en branchage avait été préparé pour les jeunes filles par l'autre chasseur et le guerrier indien; elles s'y retirèrent pour se livrer au sommeil.
Quelque bourrelé d'inquiétudes que fût l'esprit du jeune homme, cependant, après quelques minutes d'une méditation profonde, il s'étendit auprès de ses compagnons et ne tarda à s'endormir. Au désert, la nature ne perd jamais ses droits, les plus grandes douleurs ne parviennent que rarement à l'emporter sur les exigences matérielles de l'organisation humaine.
A peine les premiers rayons du soleil commencèrent-ils à teindre le ciel d'un reflet d'opale, que les chasseurs ouvrirent les yeux. Les préparatifs du départ furent bientôt terminés, le moment de la séparation arriva, les adieux furent tristes. Les deux chasseurs avaient accompagné les jeunes filles jusqu'à la lisière de la forêt, afin de demeurer plus longtemps avec elles.
Doña Luisa, profitant d'un instant ou le chemin devenait tellement étroit qu'il était presque impossible de marcher deux de front, s'approcha du chasseur compagnon de don Miguel:
—Un service, lui dit-elle rapidement à voix basse.
—Parlez, lui répondit celui-ci sur le même ton.
—Cet Indien ne m'inspire qu'une médiocre confiance.
—Vous avez tort, je le connais.
Elle secoua la tête d'un air mutin.
—C'est possible, fit-elle; voulez-vous me rendre le service que je réclame de vous? Sans cela je le demanderai à don Miguel, quoique j'eusse préféré le lui laisser ignorer.
—Parlez, vous dis-je.
—Donnez-moi un couteau et vos pistolets.
Le chasseur la regarda en face.
—Bien, dit-il au bout d'un instant, vous êtes une brave fille. Voilà ce que vous me demandez.
Et sans que personne s'en aperçut, il lui remit les objets qu'elle désirait obtenir de lui, en y joignant deux petits sacs, l'un de poudre et l'autre de balles.
—On ne sait pas ce qu'il peut arriver, fit-il.
—Merci, lui dit-elle avec un mouvement de joie dont elle ne fut pas maîtresse.
Puis tout fut dit: elle fit disparaître les armes sous ses vêtements avec une prestesse et un certain air résolu qui firent sourire le chasseur.
Cinq minutes plus tard, on arriva sur la lisière de la forêt.
—Addick, dit laconiquement le chasseur, souvenez-vous que vous me répondez de ces deux femmes!
—Addick a juré, répondit seulement l'Indien.
On se sépara; il était impossible de demeurer plus longtemps à l'endroit où l'on se trouvait sans courir le risque d'être découvert par les Indiens.
Les jeunes filles et le guerriers se dirigèrent vers la ville.
—Montons sur la colline, dit don Miguel, afin de les revoir une dernière fois.
—J'allais vous le proposer, répondit simplement le chasseur.
Ils reprirent, avec les mêmes précautions, la place qu'ils avaient pendant quelques minutes occupée la nuit précédente.
Aux rayons resplendissants du soleil qui s'était levé radieux, la verte campagne avait pris un aspect véritablement enchanteur. La nature s'était pour ainsi dire animée, et un spectacle des plus variés avait remplacé l'aspect sombre et solitaire sous lequel elle leur était apparue la veille.
Des portes de la ville, qui étaient ouvertes, sortaient des groupes d'Indiens à pied et à cheval, qui se dispersaient de tous les côtés, avec des cris de joie et des éclats de rire stridents. De nombreuses pirogues sillonnaient la rivière, les champs se peuplaient de troupeaux de vigognes et de chevaux conduits par des Indiens armés de longues gaules, qui, venus des environs, se dirigeaient vers la ville. Des femmes bizarrement vêtues et portant gaillardement sur leur tête de longues mannes en osier remplies de viandes, de fruits ou de légumes, marchaient en causant entre elles, et accompagnant chaque phrase de ce rire continuel, saccadé et métallique dont les peuplades indiennes ont le secret et dont le bruit ressemble assez à celui que produirait la chute d'une quantité de cailloux sur un plat de cuivre.
Les jeunes filles et leur guide ne tardèrent pas à se mêler à cette foule bigarrée, au milieu de laquelle elles disparurent.
Don Miguel poussa un soupir.
—Partons, dit-il d'une voix profonde.
Ils regagnèrent la forêt.
Quelques minutes plus tard ils se remettaient en route.
—Il faut nous séparer, fit don Miguel, lorsqu'ils eurent traversé la forêt dans toute sa longueur, je retourne à Tubac.
—Moi, je vais tâcher de rendre un petit service à un chef indien de mes amis.
—Toujours vous songez aux autres et jamais à vous, mon brave Bon-Affût; toujours vous êtes occupé à être utile à quelqu'un.
—Que voulez-vous, don Miguel, il paraît que c'est ma mission; vous savez que chacun a la sienne sur la terre.
—Oui, répondit le jeune homme d'une voix sourde. Allons, adieu, ajouta-t-il au bout d'un instant, n'oubliez pas notre rendez-vous.
—Soyez tranquille, dans quinze jours, au gué del Rubio, c'est convenu.
—Pardonnez-moi mes réticences pendant les quelques jours que nous avons passés ensemble; ce secret n'est pas à moi seul, Bon-Affût; je ne suis pas le maître de le divulguer, même à un ami aussi éprouvé que vous.
—Gardez votre secret, mon ami, je ne suis nullement curieux de le connaître; seulement il est bien entendu que nous ne nous connaissons point, n'est-ce pas.
—Oui, ceci est fort important.
—Allons, adieu.
—Adieu.
Les deux cavaliers se serrèrent la main, l'un tourna à droite, l'autre à gauche, et ils s'éloignèrent à toute bride, chacun dans une direction opposée.
[1] Littéralement, quiepaa ciel, tani montagne, en langue zapotèque.
La nuit était sombre, pas une étoile ne brillait au ciel; le vent soufflait avec force à travers les épaisses ramures de la forêt vierge avec ce sifflement triste et monotone qui ressemble au bruit des grandes eaux lorsque menace la tempête; les nuées étaient basses, noires, chargées d'électricité; elles couraient rapidement dans l'espace, cachant incessamment le disque blafard de la lune, dont les rayons sans chaleur rendaient encore les ténèbres plus épaisses; l'atmosphère était lourde, et des bruits sans nom, répercutés par les échos comme les roulements d'un tonnerre lointain, s'élevaient du fond des quebradas et des barancas ignorées de la Prairie; les bêtes fauves hurlaient tristement sur toutes les notes du clavier humain, et les oiseaux de nuit, troublés dans leur sommeil par cet étrange malaise de la nature, poussaient des cris rauques et discordants.
Au camp des gambucinos, tout était calme; les sentinelles veillaient, appuyées sur leurs rifles et accroupies devant un feu mourant qui achevait de s'éteindre. Au centre du camp, deux hommes fumaient leurs pipes indiennes en causant entre eux à voix basse.
Ces deux hommes étaient Balle-Franche et Bon-Affût.
Enfin Balle-Franche éteignit sa pipe, la repassa à sa ceinture, étouffa un bâillement et se leva en allongeant les bras et les jambes pour rétablir la circulation du sang.
—Qu'allez-vous faire? lui demanda Bon-Affût en se tournant à demi de son côté d'un air nonchalant.
—Dormir, répondit le chasseur.
—Dormir?
—Pourquoi non? La nuit est avancée; seuls, j'en suis convaincu, nous veillons encore: il est plus que probable que nous ne verrons pas don Miguel avant le lever du soleil; donc, le plus convenable, pour le moment du moins, est de dormir, si toutefois vous n'en avez pas décidé autrement.
Bon-Affût posa un doigt sur sa bouche comme pour recommander la prudence à son ami.
—La nuit est avancée, dit-il à voix basse, un orage terrible se prépare! Où peut-être allé don Miguel? Cette absence prolongée m'inquiète plus que je ne saurais dire; il n'est pas homme à abandonner ainsi ses compagnons sans une raison bien puissante, ou peut-être....
Le chasseur s'arrêta en hochant tristement la tête.
—Continuez, fit Balle-Franche, dites votre pensée tout entière.
—Eh bien, je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur.
—Oh! Oh! Croyez-vous? Ce don Miguel est cependant, d'après ce que j'ai entendu dire, un hombre de a caballo d'un courage à toute épreuve et d'une force peu commune.
—Tout cela est vrai, répondit Bon-Affût d'un air préoccupé.
—Eh bien, pensez-vous donc qu'un tel homme bien armé et connaissant la vie de la Prairie ne soit pas de taille à se tirer d'un mauvais pas, quelque danger qui le menace?
—Oui, s'il a affaire à un adversaire loyal, qui se place résolument devant lui et entame une lutte à armes égales.
—Quel autre péril peut-il craindre?
—Balle-Franche, Balle-Franche! reprit le chasseur avec tristesse, vous avez trop longtemps habité les comptoirs des marchands de pelleteries du Missouri.
—Ce qui veut dire...? demanda le Canadien d'un ton piqué.
—Eh! Mon ami, ne vous fâchez pas de mon observation; mais il est évident pour moi que vous avez en grande partie oublié les mœurs du désert.
—Hum! Ceci est grave pour un chasseur, Bon-Affût, et en quoi, s'il vous plaît, ai-je oublié les mœurs du désert?
—Pardieu! En ce que vous ne semblez plus vous souvenir que, dans la contrée où nous sommes, toute arme est bonne pour se défaire d'un ennemi.
—Eh! Je sais cela aussi bien que vous, mon ami; je sais aussi que l'arme la plus redoutable est celle qui se cache.
—C'est-à-dire la trahison.
Le Canadien tressaillit.
—Redoutez-vous donc une trahison? demanda-t-il.
—Que puis-je craindre autre?
—C'est vrai, fit le chasseur en baissant la tête; mais, ajouta-t-il au bout d'un instant, que faire?
—Voilà justement ce qui m'embarrasse; je ne puis pourtant demeurer plus longtemps ainsi: l'inquiétude me tue; quoi qu'il arrive, je veux savoir ce qui s'est passé.
—Mais de quelle façon?
—Je ne sais, Dieu m'inspirera.
—Cependant vous avez une idée?
—Certes, j'en ai une.
—Laquelle?
—La voici, je compte même sur vous pour m'aider à la mettre à exécution.
Balle-Franche serra affectueusement la main de son ami.
—Vous avez raison, dit-il; voyons votre idée.
—Elle est bien simple: nous allons quitter le camp à l'instant même, et battre dans tous les sens les abords de la rivière.
—Oui; seulement je vous ferai observer que l'orage en tardera pas à éclater, déjà la pluie tombe en larges gouttes.
—Raison de plus pour nous hâter.
—C'est juste.
—Ainsi vous m'accompagnez?
—Pardieu! En doutiez-vous, par hasard?
—Je suis un niais; pardonnez-moi, frère, et merci.
—Pourquoi donc? C'est moi, au contraire, qui vous remercie.
—Comment cela?
—Eh mais! Grâce à vous, je vais faire une promenade charmante.
Bon-Affût ne répliqua pas; les deux chasseurs sellèrent et bridèrent leurs chevaux, et après avoir visité leurs armes avec tout le soin d'hommes qui sont convaincus qu'ils ne tarderont pas à s'en servir, ils se mirent en selle et s'avancèrent vers la barrière du camp.
Deux sentinelles se tenaient l'œil au guet, immobiles et droites à cette barrière; elles se placèrent devant les coureurs des bois.
Ceux-ci n'avaient aucunement l'intention de s'éloigner inaperçus, n'ayant aucune raison de cacher leur départ.
—Vous partez? demanda une des sentinelles.
—Non, nous allons seulement pousser une reconnaissance aux environs.
—A cette heure?
—Pourquoi pas?
—Dame! Il me semble que par un temps pareil mieux vaut dormir que courir la Prairie.
—Il vous semble mal, compagnon, répondit Bon-Affût d'un ton péremptoire, et d'abord, retenez ceci: je ne dois compte de mes actions à personne; si je sors à cette heure, par l'orage qui menace, c'est que j'ai probablement pour agir ainsi des raisons puissantes; ces raisons, je ne puis et ne dois vous les dire; maintenant, voulez-vous, oui ou non, me livrer passage? Sachez seulement que je vous rendrai responsable plus tard du retard que vous apporterez à l'exécution de mes projets.
Le ton employé par le chasseur en leur parlant frappa les deux sentinelles; elles se consultèrent quelques minutes à voix basse, puis celle qui, jusque-là, avait porté la parole, se tourna vers les deux hommes, qui attendaient impassibles le résultat de cette délibération.
—Passez, dit-elle; vous êtes en effet libre d'aller où bon vous semblera; j'ai fait mon devoir en vous interrogeant, Dieu veuille que vous fassiez le vôtre en sortant ainsi.
—Bientôt vous le saurez. Un mot encore.
—J'écoute.
—Notre absence, si Dieu le veut, sera de courte durée, sinon, au lever du soleil nous serons de retour; cependant faites bien attention à cette recommandation: si vous entendez trois fois le cri du jaguar répété à intervalles égaux, montez à cheval en toute hâte et arrivez, non pas vous seulement, mais suivi d'une dizaine de vos compagnons, car si vous entendez ce cri, c'est qu'un grand péril menacera votre cuadrilla. M'avez-vous bien compris?
—Parfaitement.
—Et vous ferez ce que je vous recommande?
—Je le ferai parce que je sais que vous êtes le guide que nous attendons et qu'une trahison n'est pas à redouter de votre part.
—Bien, au revoir.
—Bonne chance.
Les chasseurs sortirent, la barrière fut immédiatement refermée derrière eux.
A peine les coureurs des bois débouchaient-ils dans la Prairie que l'ouragan qui menaçait depuis le coucher du soleil éclata avec fureur.
Un fulgurant éclair traversa l'espace, suivi presque instantanément d'un effroyable coup de tonnerre; les arbres se courbèrent sous l'effort du vent et la pluie commença à tomber à torrents.
Les aventuriers n'avançaient qu'avec d'extrêmes difficultés au milieu de l'horrible chaos des éléments en fureur; leurs chevaux, effrayés par les mugissements de la tempête, buttaient et se cabraient à chaque pas. Les ténèbres étaient devenues tellement épaisses que bien que marchant côte à côte, les deux hommes avaient peine à se voir. Les arbres, tordus par le souffle tout puissant de la brise poussaient des plaintes humaines auxquelles répondaient les hurlements lugubres des fauves épouvantés, la rivière gonflée par la pluie soulevait des vagues dont la cime écumante se brisait avec fracas sur les rives sablonneuses.
Balle-Franche et Bon-Affût, aguerris aux temporales du désert, secouaient dédaigneusement la tête à chaque effort de la rafale qui passait au-dessus d'eux comme un simoun ardent, et continuaient à avancer en sondant de l'œil l'ombre qui les enveloppait comme d'un lourd linceul et en prêtant l'oreille aux bruits que les échos se renvoyaient de l'un à l'autre en les rendant plus éclatants et plus vibrants encore.
Ils atteignirent ainsi, sans avoir échangé une parole, le gué del Rubio. Là, comme d'un commun accord, ils s'arrêtèrent.
Le Rubio, affluent perdu et ignoré du Gran Río Colorado del Norte, dans lequel il se jette après un cours tourmenté d'une vingtaine de lieues à peine, est en temps ordinaire un mince filet d'eau que les pirogues indiennes ont peine à parcourir et que les chevaux passent a gué avec de l'eau à peine au ventre presque partout; mais à cette heure le placide ruisseau était devenu tout à coup un torrent fougueux roulant à grand bruit dans ses eaux profondes et fangeuses des arbres déracinés et même des quartiers de rocs.
Songer à traverser le Rubio eût été commettre en ce moment une insigne folie; l'homme assez téméraire pour tenter cette entreprise aurait été en quelques minutes emporté et roulé par les eaux furieuses, dont la nappe jaunâtre s'élargissait de minute en minute.
Les chasseurs demeurèrent un instant immobiles sous les torrents de pluie qui les inondaient, considérant d'un œil rêveur l'eau qui montait toujours et maintenant à grand-peine leurs chevaux effrayés qui se cabraient avec de sourds hennissement de terreur.
Ces deux hommes au cœur de bronze restaient impassibles au milieu du fracas épouvantable des éléments déchaînés, sans paraître s'apercevoir de l'effroyable tempête qui hurlait autour d'eux, aussi calmes et l'esprit aussi tranquille que s'ils avaient été confortablement assis au fond de quelque antre inaccessible auprès d'un joyeux feu de sarments. Ils n'avaient qu'une idée, venir en aide à celui qu'ils soupçonnaient courir en ce moment un danger terrible.
Tout à coup ils tressaillirent et relevèrent brusquement la tête en fixant devant eux des regards ardents et avides, mais l'ombre était trop épaisse, ils ne purent rien distinguer.
Au milieu des mille bruits de la tempête un cri avait frappé leur oreille.
Ce cri était un appel suprême, cri d'agonie strident et prolongé, comme l'homme fort vaincu par la fatalité en trouve lorsqu'il est contraint d'avouer son impuissance, que tout lui manque à la fois et qu'il n'a plus d'autre recours que Dieu. Les deux hommes se penchèrent vivement en avant, et plaçant leurs mains à leur bouche en forme d'entonnoir, ils poussèrent à leur tour un cri aigu et prolongé.
Puis ils écoutèrent.
Au bout d'une minute, un second cri plus perçant, plus désespéré que le premier traversa l'espace.
—Oh! s'écria Bon-Affût, en se haussant sur ses étriers et en serrant les poings avec douleur, cet homme est en danger de mort.
—Quel qu'il soit il faut le sauver, répondit résolument Balle-Franche.
Ils s'étaient compris.
Mais comment sauver cet homme! Où était-il? Quel danger le menaçait? Qui pouvait répondre à ces questions qu'ils s'adressaient mentalement?
Là se dressait l'impossible.
Au risque d'être emportés par les eaux, les chasseurs contraignirent leurs chevaux à entrer dans la rivière, et presque couchés sur le cou des nobles bêtes épouvantées, ils interrogèrent les flots.
Mais nous l'avons dit, les ténèbres étaient trop épaisses, ils ne purent rien voir.
—L'enfer s'en mêle! s'écria Bon-Affût, avec désespoir. Mon Dieu! Mon Dieu! Laisserons-nous donc mourir cet homme sans lui venir en aide!
En ce moment un éclair sillonna le ciel d'un éblouissant zigzag.
A sa lueur fugitive, les chasseurs entrevirent un cavalier luttant avec rage contre l'effort des flots.
—Courage! Courage! crièrent-ils.
—A moi! répondit l'inconnu d'une voix étranglée.
Il n'y avait pas à hésiter, chaque seconde était un siècle. L'homme et le cheval luttaient courageusement contre le torrent qui les entrainait, la résolution des chasseurs fut prise en une seconde. Ils se serrèrent silencieusement la main et enfoncèrent en même temps les éperons dans les flancs de leurs montures, les chevaux se cabrèrent avec un hennissement de douleur, mais contraints d'obéir à la main de fer qui les maîtrisait, ils bondirent effarés au milieu de la rivière.
Soudain deux coups de feu se firent entendre, une balle passa en sifflant entre les deux hommes et un cri de douleur sortit du sein de l'eau.
L'homme qu'ils allaient secourir était blessé.
L'orage augmentait toujours, les éclairs se succédaient avec une rapidité inouïe. Les chasseurs aperçurent l'inconnu cramponné à la bride de son cheval et se laissant emporter par lui.
Puis sur l'autre rive, le corps penché en avant, un homme, le rifle épaulé prêt à tirer.
—Chacun le sien dit laconiquement Bon-Affût.
—Bien, répondit non moins brièvement Balle-Franche. Le Canadien prit la reata pendue à l'argon de sa selle, la leva dans sa main et la faisant tourner autour de sa tête, il attendit la lueur du prochain éclair.
Son attente ne fut pas longue, mais si rapide qu'elle eût été, Balle-Franche avait profité de cette lueur passagère pour jeter la reata. La corde de cuir s'échappa en sifflant et le nœud coulant qui la terminait s'abattit sur le cou du cheval qui luttait si courageusement contre le torrent.
—Courage! Courage! cria Balle-Franche. A moi, Bon-Affût! A moi!
Et donnant une forte secousse à son cheval, il le fit volter sur les jambes de derrière, au moment où il allait perdre pied, et le lança vers la rive.
—Me voici! répondit Bon-Affût, qui guettait l'occasion de faire feu, patience! J'arrive.
Tout à coup il pressa la détente, le coup partit, de l'autre rive un cri de colère et de douleur arriva jusqu'aux chasseurs.
—Il est touché! dit Bon-Affût, demain je saurai qui est ce drôle, et, rejetant son rifle derrière lui, il lança son cheval au-devant de Balle-Franche.
Le cheval que le Canadien avait lacé se sentant soutenu et entraîné au rivage, seconda avec l'intelligence que possèdent ces nobles animaux, les efforts que l'on faisait pour le sauver.
Les deux chasseurs s'étaient attelés à la reata. Les forces réunies de leurs montures, aidées parle cheval lacé parvinrent à rompre le courant, et après une lutte de quelques minutes ils atteignirent enfin le rivage. Dès qu'ils furent relativement en sûreté, les Canadiens sautèrent à bas de leur selle et s'élancèrent vers le cheval de l'inconnu.
Aussitôt qu'elle avait senti la terre ferme sous ses pieds, la noble bête s'était arrêtée, semblant comprendre que si elle avançait elle briserait contre les pierres qui jonchaient le sol son maître, qui, bien que sans connaissance, tenait toujours serrée entre ses main crispées la bride qu'il n'avait pas lâchée. Les chasseurs coupèrent cette bride, soulevèrent entre leurs bras l'homme qu'ils avaient si miraculeusement sauvé, et le portèrent à quelques pas plus loin, sous un arbre au pied duquel ils le déposèrent doucement. Puis tous deux avidement penchés sur son corps, ils attendirent une lueur quelconque qui leur permit de le reconnaître.
—Oh! s'écria tout à coup Bon-Affût, en se redressant, avec une expression de douleur mêlée d'épouvante, don Miguel Ortega!
Ainsi que nous l'avons rapporté plus haut, après avoir quitté Balle-Franche, don Stefano était retourné au camp des gambucinos, dans lequel il était parvenu à rentrer sans être aperçu.
Une fois dans l'intérieur du camp, le mexicain n'avait plus rien à redouter; il regagna le feu auprès duquel son cheval était attaché, caressa la noble bête qui avait tourné vers lui la tête et redressé les oreilles à son approche, puis il se coucha tranquillement, se roula dans ses couvertures et s'endormit avec cette placidité particulière aux consciences tranquilles.
Plusieurs heures s'écoulèrent, sans que nul bruit ne vint troubler le calme qui planait sur le camp.
Soudain, don Stefano, ouvrit les yeux; une main s'était doucement posée sur son épaule droite.
Le Mexicain regarda l'homme qui interrompait son sommeil; à la lueur des étoiles pâlissantes, il reconnut Domingo. Don Stefano se leva et suivi silencieusement le gambucino. Celui-ci le conduisit aux retranchements, dans le but probablement de causer sans craindre les oreilles indiscrètes.
—Eh bien? lui demanda don Stefano, lorsque le gambucino lui eut fait signe qu'il pouvait parler.
Domingo, suivant l'ordre qu'il en avait reçu de Balle-Franche, lui rapporta succinctement ce qui s'était passé dans la Prairie. En apprenant que le Canadien avait enfin rencontré Bon-Affût, don Stefano tressaillit de joie, puis il se remit à écouter le récit du gambucino, avec un intérêt croissant. Lorsque celui-ci eut enfin terminé, ou du moins qu'il le vit demeurer silencieux devant lui:
—Est-ce tout? lui demanda-t-il.
—Tout, répondit l'autre.
Don Stefano sortit sa bourse, y puisa quelques pièces d'or et les remit à Domingo; celui-ci les prit avec un mouvement de plaisir.
—Balle-Franche ne t'a chargé de rien autre pour moi? demanda encore le Mexicain.
L'autre sembla réfléchir un instant.
—Ah! fit-il, j'oubliais; le chasseur m'a chargé de vous dire, seigneurie, que vous ne quittiez pas le camp.
—Sais-tu la raison de cette recommandation?
—Certes, il compte rejoindre ce soir la cuadrilla au gué del Rubio.
Le front du Mexicain s'assombrit à cette parole.
—Tu en es sûr? dit-il.
—Voilà ce qu'il m'a dit.
Il y eut un silence de quelques secondes.
—Bon, reprit-il au bout d'un instant; le chasseur n'a rien ajouté de plus?
—Rien.
—Hum! murmura don Stefano, enfin n'importe; puis, appuyant fortement la main sur l'épaule du gambucino et le regardant bien en face: maintenant, ajouta-t-il, en pesant avec intention sur chaque mot, retiens bien ceci: tu ne me connais pas; quoi qu'il arrive, tu ne souffleras pas un mot de la façon dont nous nous sommes rencontrés dans la Prairie.
—Vous pouvez y compter, seigneurie.
—J'y compte, répondit le Mexicain, avec une intonation qui fit trembler Domingo tout brave qu'il était; souviens-toi du serment que tu m'as fait et de l'engagement que tu as pris envers moi.
—Je m'en souviendrai.
—Si tu tiens tes promesses et si tu m'es fidèle, je me charge de te mettre pour toujours à l'abri du besoin, sinon, prends garde.
Le gambucino haussa les épaules avec dédain, et répondit d'un ton de mauvaise humeur:
—Il est inutile de me menacer, seigneurie; ce qui est dit est dit, ce qui est promis est promis.
—Nous verrons.
—Si vous n'avez rien d'autre à me recommander, je crois que nous ferons bien de nous séparer. Voici le jour qui commence à poindre, mes compagnons ne tarderont pas à s'éveiller, et je crois que vous n'êtes pas plus soucieux que moi que l'on nous surprenne ensemble.
—Tu as raison.
Ils se quittèrent sur ce mot; don Stefano retourna à sa place, le gambucino s'étendit au premier endroit venu, et bientôt tous deux furent endormis ou plutôt le parurent.
Aux premiers rayons du soleil, don Miguel souleva le rideau de la tente et se dirigea vers son hôte; celui-ci dormait à poings fermés. Don Miguel se fit un scrupule de troubler ce paisible sommeil; il s'accroupit auprès du feu, rapprocha les tisons épars, les raviva, tordit une fine cigarette de maïs et fuma philosophiquement en attendant le réveil de son hôte.
Cependant tout était en mouvement dans le camp: les gambucinos vaquaient aux devoirs du matin, les uns conduisaient les chevaux à la rivière, afin de les baigner; d'autres attisaient les feux afin de préparer le déjeuner de la cuadrilla, enfin chacun s'occupait à sa manière dans l'intérêt général.
Enfin, don Stefano, sur le visage duquel jouait depuis quelques minutes un rayon de soleil, jugea à propos de s'éveiller; il se retourna, allongea ses membres et ouvrit les yeux en baillant à plusieurs reprises.
—Caramba! fit-il en se redressant, il est déjà jour; comme une nuit est vite passée; il me semble qu'il y a une heure à peine que je me suis couché.
—Je vois avec plaisir que vous avez bien dormi, caballero, lui dit poliment don Miguel.
—Eh quoi! C'est vous, mon hôte, s'écria don Stefano avec un étonnement parfaitement joué; la journée sera heureuse pour moi, puisque le premier visage que j'aperçois, on ouvrant les yeux, est celui d'un ami.
—Je reçois ce compliment comme une galanterie de votre part.
—Ma foi non; je vous assure que ce que je vous dis est l'expression sincère de ma pensée, répondit le Mexicain avec bonhomie: il est impossible de mieux faire les honneurs du désert et de mieux comprendre les saintes lois de l'hospitalité.
—Je vous remercie de la bonne opinion que vous voulez bien avoir de moi. J'espère que vous ne nous quitterez pas encore, et que vous consentirez à demeurer quelques jours avec nous.
—Je le voudrais, don Miguel; Dieu m'est témoin que je serais heureux de jouir, pendant quelque temps, de votre charmante compagnie; malheureusement cela m'est absolument impossible.
—Il serait vrai?
—Hélas! Oui, un devoir impérieux m'oblige à vous quitter aujourd'hui même; vous me voyez au désespoir de ce fâcheux contre-temps.
—Quel motif assez puissant peut vous contraindre à vous éloigner aussi brusquement?
—Mon Dieu, un motif bien trivial, et qui probablement vous fera sourire. Je suis négociant à Santa Fe; il y a quelques jours, les faillites successives de plusieurs négociants de Monterey, avec lesquels je suis en rapports suivis d'affaires, m'ont obligé à quitter subitement ma maison, afin de tâcher de sauver par ma présence quelques bribes du naufrage dont je suis menacé; je me suis mis en route sans demander avis à personne, et me voilà.
—Mais, objecta don Miguel, vous êtes fort loin de Monterey encore.
—Je le sais bien, et c'est ce qui me désespère; j'ai une peur affreuse d'arriver trop tard, d'autant plus que j'ai été averti que les gens auxquels j'ai affaire sont des fripons; les sommes qu'ils ont à moi sont considérables et forment, s'il faut vous l'avouer, le plus clair de ma fortune.
—Cáspita! S'il en est ainsi, je comprends que vous ayez hâte d'arriver.
—N'est-ce pas?
—Je ne soupçonnais pas que vous eussiez un motif aussi sérieux de presser votre voyage.
—Vous le voyez, plaignez-moi, don Miguel.
Toute cette conversation avait eu lieu entre les deux personnages avec une aisance charmante et une bonhomie parfaitement jouée de part et d'autre; pourtant ni l'un ni l'autre n'était dupe: don Stefano, comme cela arrive souvent, avait commis l'énorme faute de vouloir être trop fin et de s'avancer au delà des bornes de la prudence, en cherchant à persuader son interlocuteur de la sincérité de ses paroles. Cette feinte sincérité avait éveillé la méfiance de don Miguel pour deux raisons: d'abord parce que, venant de Santa Fe et se rendant à Monterey, don Stefano non seulement n'était pas sur la route qu'il aurait dû suivre, mais encore il tournait complètement le dos à ces deux villes, erreur que son ignorance de la topographie du pays lui faisait commettre sans qu'il s'en doutât; la seconde raison était aussi péremptoire: jamais un négociant quelconque n'aurait osé essayer, quelque graves que fussent les motifs d'un pareil voyage, de franchir seul le désert, à cause des Indios bravos, des pirates, des bêtes fauves et des mille autres dangers non moins grands auxquels il se serait exposé sans espoir possible de leur échapper.
Cependant don Miguel feignit d'admettre sans discussion les raisons que lui donnait son hôte, et ce fut de l'air le plus convaincu qu'il lui répondit:
—Malgré le vif désir que j'aurais eu à jouir plus longtemps de votre agréable société, je ne vous retiens plus, caballero; je comprends combien il est urgent pour vous de vous hâter.
Don Stefano s'inclina avec un imperceptible sourire de triomphe.
—Enfin, ajouta don Miguel, je souhaite que vous réussissiez à sauver votre fortune des griffes de ces fripons; dans tous les cas j'espère, caballero, que nous ne nous séparerons pas avant d'avoir déjeuné. Je vous avouerai que votre refus d'accepter une part de mon maigre souper hier au soir m'a peiné.
—Oh! interrompit don Stefano, croyez, caballero...
—Vous m'avez donné une excuse fort admissible, continua don Miguel; mais, ajouta-t-il avec intention, nous autres gambucinos et aventuriers, nous sommes de singulières natures, nous nous figurons, à tort ou à raison, que l'hôte qui refuse de manger avec nous est notre ennemi ou le deviendra.
Don Stefano tressaillit légèrement à cette brusque attaque.
—Pouvez-vous supposer cela, caballero? dit-il évasivement.
—Ce n'est pas moi qui le suppose, c'est nous tous, la race bizarre à laquelle nous appartenons, c'est un préjugé, une superstition stupide, tout ce que vous voudrez, mais cela est ainsi, fit-il avec un sourire acéré comme la pointe d'un poignard, et rien ne pourra changer notre nature: ainsi c'est convenu, nous allons déjeuner, puis je vous souhaiterai bon voyage, et nous nous séparerons.
Don Stefano prit une figure désespérée.
—Allons, je joue du malheur, dit-il en hochant la tête.
—Comment cela?
—Mon Dieu! Je ne sais comment vous expliquer ce qui m'arrive; c'est si ridicule que vraiment je n'ose...
—Dites toujours, caballero; bien que je ne sois qu'un grossier aventurier, peut-être parviendrai-je à vous comprendre.
—C'est que je vais vous blesser.
—Pas le moins du monde; n'êtes-vous pas mon hôte? Un hôte est envoyé par Dieu, c'est-à-dire sacré.
Don Stefano hésita.
—Eh! fit en riant don Miguel, je vais faire servir le déjeuner; peut-être vous déliera-t-il la langue.
—Voilà justement la question embarrassante, s'écria vivement le Mexicain avec un accent chagrin, c'est que, malgré tout mon désir de vous être agréable, je ne puis accepter votre gracieuse invitation.
Le jeune homme fronça le sourcil.
—Ah! Ah! fit-il en fixant un regard soupçonneux sur son interlocuteur, pourquoi donc?
—Voilà justement ce que je n'ose vous avouer.
—Osez, osez, caballero; ne vous ai-je pas averti que vous aviez le droit de tout dire?
—Mon Dieu, c'est vous qui m'y forcez, dit-il d'une voix de plus en plus triste, figurez-vous que j'ai fait vœu à Nuestra Señora de los Ángeles de ne jamais, tout le temps que je serai en route pour ce voyage maudit, prendre de nourriture avant le soleil couché.
—Ah! fit don Miguel d'un accent peu convaincu; mais hier au soir, lorsque je vous ai offert à souper, le soleil était couché depuis longtemps déjà il me semble.
—Attendez donc, je n'ai pas fini.
—J'écoute.
—Et alors même, reprit le Mexicain, de ne manger qu'une des tortillas de maïs que je porte avec moi dans mes alforjas, et que j'ai fait bénir par un prêtre avant mon départ de Santa Fe; vous voyez, tout cela doit vous paraître bien ridicule, mais nous sommes compatriote tous deux, nous avons du sang espagnol dans les veines, et au lieu de rire de ma sotte superstition vous me plaindrez.
—Cáspita! D'autant plus que vous vous êtes astreint à une rude pénitence. Je ne chercherai pas à vous faire renoncer à votre superstition, car moi aussi j'ai la mienne; je crois que le mieux est de ne pas revenir sur ce sujet.
—Vous ne m'en voulez pas, au moins?
—Moi! Pourquoi donc vous en voudrais-je?
—Ainsi, nous sommes toujours bons amis?
—Plus que jamais, fit en riant don Miguel.
Cependant la façon dont ses paroles furent prononcées ne rassura que médiocrement le Mexicain; il lança un regard en dessous à son interlocuteur et se leva.
—Vous partez? lui demanda le jeune homme.
—Si vous me le permettez je me mettrai en route.
—Faites, faites, mon hôte.
Don Stefano, sans répondre se mit incontinent à seller son cheval.
—Vous avez là une noble bête, observa don Miguel.
—Oui, c'est un barbe pur sang.
—Voilà la première fois que je vois un individu de cette race précieuse.
—Regardez-le tout à votre aise.
—Je vous remercie; mais je craindrais de vous retarder davantage; hola! Mon cheval, ajouta-t-il en s'adressant à Domingo.
Celui-ci lui amena un mustang plein de feu, sur le dos duquel le jeune homme s'élança d'un bond; de son côté, don Stefano s'était mis en selle.
—Est-ce que vous allez faire une promenade aux environs? demanda-t-il.
—Si vous me le permettez, j'aurai l'honneur de vous accompagner pendant quelques pas, à moins, ajouta-t-il avec un sourire railleur, que vous ayez encore fait un vœu qui vous le défende, auquel cas je m'abstiendrai.
—Allons! fit don Stefano d'un ton de reproche, vous m'en voulez.
—Ma foi non, je vous jure.
—A la bonne heure; nous partirons quand vous voudrez.
—Je suis à vos ordres.
Ils piquèrent leurs chevaux et sortirent du camp.
A peine avaient-ils fait une vingtaine de pas, que don Miguel tira la bride de son cheval et l'arrêta.
—Vous me quittez déjà? lui demanda don Stefano.
—Je ne ferai pas un pas de plus, répondit le jeune homme; et, redressant fièrement la tête et fronçant les sourcils, écoutez-moi, lui dit-il d'un ton hautain: ici vous n'êtes plus mon hôte, nous sommes hors de mon camp, dans le désert; je puis donc m'expliquer clairement et nettement avec vous, et, voto à brios, je vais le faire.
Le Mexicain le regarda d'un air surpris.
—Je ne vous comprends pas, dit-il.
—Peut-être; je souhaite que cela soit, mais je ne le crois pas; tant que vous avez été mon hôte, j'ai feint d'ajouter foi aux mensonges que vous me débitiez; mais maintenant vous n'êtes plus pour moi, que le premier venu, un étranger, et je veux vous faire connaître franchement ma pensée; je ne sais quel nom appliquer sur voire face blême, mais je suis certain que vous êtes mon ennemi ou tout au moins l'espion de mes ennemis.
—Caballero, ces paroles... s'écria don Stefano.
—Ne m'interrompez pas, continua le jeune homme avec violence, peu m'importe qui vous êtes, il me suffit de vous avoir démasqué; je vous remercie d'être entré dans mon camp; au moins maintenant, si je vous rencontre jamais, je vous reconnaîtrai; seulement croyez-moi; ceci est un conseil que je me permets de vous donner: secouez vos chaussures en me quittant, ne vous trouvez plus en face de moi, il pourrait vous arriver malheur!
—Des menaces! interrompit le Mexicain pâle de rage.
—Prenez mes paroles comme il vous plaira, mais retenez-les dans l'intérêt de votre sûreté; bien que je ne sois qu'un aventurier, je vous donne en ce moment une leçon de loyauté dont vous ferez bien de profiter; rien ne me serait plus facile que d'acquérir les preuves de votre trahison; j'ai avec moi trente compagnons dévoués qui, sur un signe de moi, vous feraient un fort mauvais parti, et, en fouillant vos habits et vos afforjas, trouveraient sans doute au milieu de vos tortillas bénites, fit-il avec un sourire sardonique, les raisons de la conduite que vous avez tenue avec moi depuis que je vous ai rencontré; mais vous avez été mon hôte, et ce titre est votre sauvegarde; allez en paix, et ne vous placez plus sur ma route.
En prononçant ces mots il leva le bras et appliqua un vigoureux coup de chicote (cravache) sur la croupe du cheval de don Stefano. Le barbe, peu habitué à de semblables traitements, partit comme un trait, malgré tous les efforts de son cavalier pour le retenir.
Don Miguel le suivit un instant des yeux, puis il retourna à son camp en riant a gorge déployée de la façon dont il avait terminé l'entretien.
—Allons, enfants! dit-il aux gambucinos, en route vivement, il nous faut arriver avant le coucher du soleil au gué del Rubio, ou le guide nous attend.
Une demi-heure plus tard, la caravane se mettait en marche.
Aucun incident digne d'être rapporté ne troubla le voyage pendant le cours de cette journée. La cuadrilla traversait un pays accidenté, coupé de rivières peu profondes, parsemé de hautes futaies et de bouquets de cotonniers, peuplés par une infinité d'oiseaux de toutes sortes et de toutes couleurs; à l'horizon une longue ligne jaunâtre, au-dessus de laquelle planait un épais nuage de vapeurs, indiquait le Río Colorado Grande del Norte.
Ainsi que don Miguel l'avait prévu, on atteignit le gué del Rubio quelques minutes avant le coucher du soleil.
Nous expliquerons ici en quelques mots de quelle façon campent les caravanes dans le désert; cette description est indispensable pour que le lecteur puisse comprendre comment il est facile de sortir et de rentrer dans le camp sans être aperçu.
La cuadrilla, en sus de ses mules de charge, conduisait avec elle une quinzaine de wagons chargés de marchandises; lorsque l'endroit du campement était choisi, les quinze wagons étaient disposés en carré à la distance de trente-cinq pieds l'un de l'autre; dans les intervalles étaient placés six ou huit hommes qui allumaient un feu autour duquel ils se groupaient pour cuisiner, manger, causer et dormir. Les chevaux étaient placés au centre du carré, non loin de la tente mystérieuse qui marquait juste le milieu du camp. Chaque cheval avait le pied hors montoir avec le pied correspondant de derrière attachés à une corde longue de vingt pouces. Nous ferons remarquer que bien qu'un cheval entravé de cette façon se trouve d'abord fort gêné, bientôt il s'accoutume suffisamment pour pouvoir marcher lentement. Du reste, cette mesure toute de prudence est prise afin que les bêtes ne s'éloignent pas et ne soient point enlevées par les Indiens. Deux chevaux sont toujours entravés ensemble, un qui a les pieds attachés, et l'autre retenu seulement par une longe, et qui en cas d'alarme piaffe et galope autour de son compagnon qui lui sert pour ainsi dire de pivot.
L'espace laissé libre par les wagons était rempli par des fascines, des arbres empilés les uns sur les autres, et les ballots des mules.
Rien n'est plus singulier que l'aspect d'un de ces campements d'aventuriers dans la prairie. Les feux sont entourés de groupes pittoresques, assis, penchés ou debout, les uns cuisinant, d'autres raccommodant leurs habits ou les harnais des chevaux, d'autres fourbissant leurs armes; par intervalles, du sein de ces groupes s'élèvent des éclats de rire qui annoncent que les contes joyeux font gaiement la ronde, et qu'en devisant on cherche à oublier les fatigues du jour et à se préparer à celles du lendemain.
Puis, pour compléter le tableau, de distance en distance devant les retranchements les sentinelles calmes et droites, appuyées sur leurs riffles.
Ainsi que nous l'avons dit, au centre s'élève la tente du chef gardée par un factionnaire qui surveille en même temps les chevaux.
D'après la description que nous avons donnée, il est facile de comprendre que les wagons forment des espèces d'embrasures au moyen desquelles un homme adroit peut facilement, en rampant sous les trains, sortir sans être aperçu des factionnaires et rentrer lorsque bon lui semble, sans avoir éveillé l'attention de ses compagnons, dont les regards, ordinairement dirigés vers la campagne, n'ont aucune raison de surveiller ce qui se passe à l'intérieur du camp.
Aussitôt que tout fut en ordre, que chacun fut installé aussi confortablement que le permettaient les circonstances, don Miguel se fit amener un cheval frais sur lequel il monta, et s'adressant à ses compagnons groupés autour de lui:
—Señores, dit-il, une affaire pressante m'oblige à m'éloigner pour quelques heures, veillez avec soin sur le camp pendant mon absence, surtout ne laissez pénétrer personne au milieu de vous; nous nous trouvons dans des régions où la plus grande prudence est nécessaire pour se garantir de la trahison qui menace sans cesse et prend toutes les formes pour tromper ceux que la négligence empêche de se tenir sur leurs gardes. Le guide que nous attendons si impatiemment, arrivera sans doute d'ici à quelques instants; ce guide, plusieurs d'entre vous le connaissent déjà de vue, tous le connaissent de réputation, peut-être viendra-t-il seul, peut-être amènera-t-il quelqu'un avec lui. Cet homme, dans lequel nous devons avoir la plus grande confiance, doit être, pendant mon absence, entièrement libre de ses actions, aller et venir sans qu'on lui oppose le moindre obstacle; vous m'avez entendu, suivez de point en point mes recommandations; du reste, je vous le répète, je serai bientôt de retour.
Après avoir fait un dernier signe d'adieu à ses compagnons, don Miguel sortit du camp et se dirigea vers le Rubio, dont il traversa facilement le gué presque à sec en ce moment.
Ce que le chef des aventuriers avait dit à ses compagnons, à propos de Bon-Affût, était une inspiration du ciel, car, s'il n'avait par ordonné péremptoirement qu'on laissât le chasseur libre de ses mouvements et de ses volontés, il est probable que les sentinelles lui auraient barré le passage, et alors le jeune homme, privé du secours providentiel des deux coureurs des bois, aurait été incontestablement perdu.
Après avoir traversé le gué, don Miguel lança son cheval à toute bride tout droit devant lui; cette course furieuse dura à peu près deux heures, à travers des bois touffus qui, à chaque instant, se faisaient plus épais et se métamorphosaient peu à peu en forêt.
Après avoir traversé une gorge assez profonde, dont les flancs rapides étaient couverts de fourrés impénétrables, le jeune homme arriva à une espèce de carrefour étroit ou aboutissaient plusieurs sentiers de bêtes fauves, et au centre duquel un Indien, revêtu de son costume de guerre, fumait gravement accroupi devant un feu de fiente de bison, pendant que son cheval, entravé à quelque distance, broutait du bout des lèvres les jeunes pousses des arbres. Dès qu'il aperçut l'Indien, don Miguel pressa l'allure de son cheval afin de le joindre plus promptement.
—Bonsoir, chef, dit-il en sautant légèrement à terre et en serrant amicalement la main que lui tendait le guerrier.
—Ooah! fit le chef, je n'attendais plus mon frère pâle.
—Pourquoi donc, puisque je vous avais promis de venir.
—Peut-être aurait-il mieux valu que le visage pâle demeurât dans son camp; Addick est un guerrier, il a découvert une piste.
—Bon! Les pistes ne manquent pas dans la prairie.
—Och! Celle-ci est large et foulée sans précaution: c'est une trace des visages pâles.
—Bah! Que m'importe, fit insoucieusement le jeune homme; croyez-vous donc que ma troupe est la seule qui parcoure les prairies en ce moment?
Le peau-rouge secoua la tête.
—Un guerrier indien ne se trompe pas sur le sentier de la guerre. Cette piste est celle d'un ennemi de mon frère.
—Qui vous le fait supposer?
L'Indien parut ne pas vouloir s'expliquer plus clairement; il baissa la tête, et au bout d'un instant il répondit:
—Mon frère verra.
—Je suis fort, bien armé, je me soucie fort peu de ceux qui prétendraient me surprendre.
—Un homme n'en vaut pas dix, fit sentencieusement l'Indien.
—Qui sait? répondit légèrement le jeune homme; mais, continua-t-il, ce n'est pas de cela qu'il s'agit en ce moment; je viens ici chercher les nouvelles que le chef m'a promises.
—La promesse d'Addick est sacrée.
—Je le sais, chef, voilà pourquoi je n'ai pas hésité à venir; mais le temps se passe, j'ai une longue route à faire pour rejoindre mes compagnons, un orage se prépare, et je vous avoue que je serais médiocrement flatté d'y être exposé à mon retour; veuillez donc être bref.
Le chef s'inclina affirmativement, et de la main il indiqua au jeune homme une place à ses côtés.
—Bon; maintenant commencez, chef, je suis tout oreille, répondit don Miguel en se laissant tomber sur le sol; et d'abord, comment se fait-il que ce ne soit qu'aujourd'hui que je vous rencontre?
—Parce que, répondit flegmatiquement l'Indien, comme mon frère le sait, il y a loin d'ici au Queche-Pitao (ville de Dieu); un guerrier n'est qu'un homme, Addick a accompli l'impossible pour rejoindre plus tôt son frère le visage pâle.
—Soit, chef, je vous remercie. Maintenant venons au fait: que vous est-il arrivé depuis notre séparation?
—Quiepaa-Tani a ouvert ses portes toutes grandes devant les deux jeunes vierges pâles; elles sont en sûreté, dans le Queche, loin des regards de leurs ennemis.
—Et ne vous ont-elles chargé de rien me dire?
L'Indien hésita une seconde.
—Non, dit-il enfin, elles sont heureuses, et elles attendent.
Don Miguel soupira.
—C'est étrange, murmura-t-il.
Le chef jeta sur lui à la dérobée un regard inquisiteur.
—Que fera mon frère? demanda-t-il.
—Bientôt je serai près d'elles.
—Mon frère à tort, nul ne sait où elles se trouvent; à quoi bon révéler leur refuge?
—Bientôt, je l'espère, je serai libre d'agir sans craindre les regards indiscrets.
Une flamme sombre brilla dans l'œil du peau-rouge.
—Wacondah seul est maître de demain, fit-il.
Don Miguel le regarda.
—Que veut dire le chef?
—Rien autre que ce que je dis.
—Bon. Mon frère veut-il m'accompagner à mon camp?
—Addick retourne à Quiepaa-Tani, afin de veiller sur celles que son frère lui a confiées.
—Vous reverrai-je bientôt?
—Peut-être, répondit-il évasivement; mais, ajouta-t-il, mon frère ne m'a-t-il pas dit qu'il comptait se rendre au Queche?
—En effet.
—Quand viendra mon frère?
—Au plus tard, dans les premiers jours de la prochaine lune; pourquoi cette question?
—Mon frère est un visage pâle; si Addick ne l'introduit pas lui-même dans le Queche, le chef blanc n'y pourra pas pénétrer.
—C'est juste, à l'époque que je vous ai indiquée, je vous attendrai au pied de la colline ou nous nous sommes quittés.
—Addick y sera.
—Bien je compte sur vous; maintenant il faut que je vous quitte: la nuit tombe rapidement, le vent commence à souffler avec force, je dois partir.
—Adieu, répondit laconiquement le chef, sans faire un geste pour le retenir.
—Adieu.
Le jeune homme se mit en selle et piqua des deux.
Addick le regarda s'éloigner d'un air pensif; puis, lorsqu'il eut disparu derrière un bouquet d'arbres, il se pencha légèrement en avant et imita à deux reprises le sifflement du cobra Capel.
A ce signal, les branches d'un fourré peu distant du feu s'écartèrent avec précaution, et un homme parut.
Cet individu, après avoir jeté autour de lui un regard soupçonneux, s'avança vers le chef, devant lequel il s'arrêta.
Cet homme était don Stefano Cohecho.
—Eh bien? dit-il.
—Mon père a entendu? demanda l'Indien d'un ton équivoque.
—Tout.
—Alors je n'ai rien à apprendre à mon père.
—Rien.
—L'orage commence; que veut faire mon père?
—Ce qui est convenu; les guerriers du chef sont prêts?
—Oui.
—Où sont-ils?
—A l'endroit désigné.
—Bien, partons.
—Partons.
Ces deux hommes, qui depuis longtemps déjà devaient fort bien se connaître, s'étaient entendus en quelques mots.
—Venez, dit don Stefano à voix haute.
Une dizaine de cavaliers mexicains parurent.
—Voilà du renfort au cas où vos guerriers ne suffiraient pas, fit-il en se tournant vers le chef.
Celui-ci dissimula un mouvement de mauvaise humeur et répondit, en haussant les épaules avec dédain:
—A quoi bon vingt guerriers sur un homme seul!
—C'est que cet homme en vaut cent! répondit don Stefano avec un ton de conviction qui donna à réfléchir au chef.
Ils partirent.
Cependant don Miguel galopait toujours; il était loin pourtant de se douter du complot qui, en ce moment, se tramait contre lui; et, s'il hâtait sa marche, ce n'était nullement par appréhension, mais parce que le vent, dont la violence croissait de minute en minute, et les larges gouttes de pluie qui commençaient à tomber, l'avertissaient de chercher un abri au plus vite. Tout en galopant, il réfléchissait au court entretien qu'il avait eu avec le guerrier peau-rouge; en repassant dans son esprit les paroles qui avaient été échangées entre eux, il sentait une inquiétude vague, une crainte secrète, se glisser dans son cœur, sans qu'il lui fût possible de se rendre bien clairement compte de l'émotion qu'il éprouvait; il lui semblait entrevoir une trahison derrière les réticences étudiées du chef; il se rappelait maintenant que parfois celui-ci avait paru gêné en lui parlant. Tremblant alors qu'un malheur ne fut arrivé aux jeunes filles ou qu'un péril les menaçât, il sentit augmenter son inquiétude, d'autant plus qu'il ne savait quel moyen employer pour s'assurer de la fidélité de l'homme qu'il soupçonnait d'une perfidie.
Tout à coup un éclair éblouissant traversa la nuée, son cheval fit un brusque écart de côté et deux ou trois balles sifflèrent auprès de lui.
Le jeune homme se redressa sur sa selle. Il se trouvait au milieu de la gorge que quelques heures auparavant, il avait traversée; une obscurité profonde l'enveloppait de toutes parts, et dans l'ombre, tout autour de lui, il lui sembla voir s'agiter des formes humaines indécises et comme effacées par l'épaisseur des ténèbres. En ce moment, d'autres coups de feu furent tirés sur lui, son chapeau fut enlevé par une balle, et plusieurs flèches passèrent à quelques lignes de son visage.
Don Miguel releva résolument la tête.
—Ah! Traîtres! s'écria-t-il d'une voix forte.
Et, enlevant son cheval avec les genoux, il s'élança en avant avec une vélocité vertigineuse, tenant la bride aux dents, à demi couché sur le cou de sa monture, et un revolver de chaque main.
Un effroyable cri de guerre se fit entendre, mêlé à des imprécations de fureur articulées en espagnol.
Don Miguel passa comme un tourbillon au milieu de la masse qui s'agitait autour de lui, et déchargea ses revolvers au plus épais de ses ennemis inconnus. Des cris de douleur et de rage, des coups de feu et des flèches le poursuivirent sans ralentir la course effrénée de son cheval, qui semblait ne plus toucher terre, tant il détalait avec rapidité.
Derrière lui, le jeune homme entendait le galop furieux de plusieurs chevaux qui se pressaient à sa poursuite.
—Trahison! Trahison! criait-il en brandissant son sabre, faisant cabrer son cheval et bondissant comme un chacal au milieu de l'affreuse mêlée qui se resserrait incessamment autour de lui.
Soudain, au plus fort de la lutte, au moment suprême où il sentait que ses forces étaient sur le point de l'abandonner, trois coups de feu éclatèrent dans l'ombre, et les gens qui l'attaquaient, pris à revers, furent contraints, à leur tour, de se défendre contre des ennemis invisibles.
—Nous arrivons! cria une voix vibrante dont l'accent énergique fit tressaillir les assaillants, tenez bon! Tenez bon!
Don Miguel répondit par un hurlement terrible et se rejeta au milieu de la mêlée avec un redoublement d'efforts. Maintenant il n'était plus seul, il se savait soutenu, il se croyait sauvé.
La foule oscilla dans l'ombre comme les blés murs sous la faux du moissonneur, la masse compacte des assaillants se fendit en deux parts, trois hommes, trois démons, se précipitèrent au milieu de la trouée qu'ils avaient faite, et leurs chevaux vinrent en bondissant se ranger aux côtés de celui de l'aventurier.
—Ah! Ah! s'écria celui-ci avec un éclat de rire railleur, la lutte est égale maintenant; en avant, compagnons, en avant!
Et il se rejeta dans la mêlée, suivi de ces intrépides auxiliaires.
Qui étaient ces hommes? D'où venaient-ils? Il ne le savait pas et ne songeait pas à le demander. D'ailleurs, ce n'était pas le moment des explications, il fallait vaincre ou mourir.
—Tuez-le! Tuez-le! hurlait un homme qui, à chaque minute, se précipitait sur lui le sabre haut, avec toute la féroce ardeur d'une haine invétérée.
—Oh! C'est donc vous, don Stefano Cohecho, s'écria don Miguel, je savais bien que nous nous rencontrerions, votre voix vous a dénoncé.
—A mort! A mort! répondit celui-ci.
Les deux hommes se jetèrent à corps perdus l'un sur l'autre, les chevaux se heurtèrent avec une force terrible l'homme que l'aventurier prenait pour don Stefano roula sur le sol.
—Victoire! cria don Miguel en fouillant avec son machette tout ce qui se trouvait à sa portée.
Ses amis inconnus toujours auprès de lui s'élancèrent à sa suite. Malgré tous leurs efforts, ceux qui les attaquaient ne purent plus longtemps, maintenir leur position, et ils commencèrent à fuir dans toutes les directions.
La gorge était franchie.
Désormais nul obstacle sérieux ne s'opposait à la fuite de don Miguel; il pressa son cheval, la noble bête redoubla d'ardeur.
Un peu plus libre alors, le jeune homme regarda autour de lui. Ses défenseurs inconnus avaient subitement disparus comme par enchantement.
—Qu'est-ce que cela signifie? murmura-t-il.
En ce moment il sentit au bras gauche une commotion assez semblable à un coup de fouet: une balle venait de l'atteindre. Cette blessure le rappela au sentiment de sa position présente.
Ses ennemis s'étaient ralliés et avaient recommencé leur poursuite. Devant lui il entendait gronder les flots jaunâtres du Rubio; la colère de Dieu et la colère des hommes semblaient se liguer contre lui pour l'accabler: ce fut alors qu'une épouvante insensée s'empara de lui; il se crut perdu et poussa ce premier cri d'agonie entendu des chasseurs.
Cependant ceux qui le poursuivaient gagnaient rapidement sur lui; sans hésiter, sans réfléchir, il se précipita dans le Rubio avec son cheval; une vingtaine de balles firent crépiter l'eau tout autour de lui; il se retourna bravement sur son cheval et fit feu une dernière fois de ses revolvers en poussant ce cri auquel les chasseurs répondirent par le mot:
—Courage!
Mais la nature humaine a des bornes qu'elle ne peu dépasser. Ce dernier effort acheva d'éteindre le peu de forces qui lui restaient, et, serrant avec la frénésie de désespoir la bride de son cheval, il roula dans le fleuve et s'évanouit en murmurant d'une voix éteinte:
—Laura! Laura!
Deux coups de feu se croisèrent au-dessus de sa tête, l'un tiré par l'homme qui, de la rive, le couchait en joue l'autre par Bon-Affût. L'inconnu poussa un hurlement de bête fauve, s'affaissa en tournoyant comme un homme ivre et disparut.
Qui était cet homme? Était-il mort ou seulement blessé?
Les événements que nous avons entrepris de raconter sont tellement mêlés d'incidents enchevêtrés les uns dans les autres par cette implacable fatalité du hasard qui domine la vie humaine, que nous sommes contraint, à notre grand regret, d'interrompre encore une fois notre récit, pour faire assister le lecteur à une scène qui se passait non loin du gué del Rubio le jour même ou s'accomplissaient les faits que nous avons rapportés dans nos précédents chapitres.
Environ vers une heure de la tarde, c'est-à-dire au moment ou les rayons du soleil, parvenu à son zénith, font peser sur la Prairie une chaleur si intense, que tout ce qui vit et qui respire cherche un refuge au plus profond des bois, trois cavaliers passèrent le gué del Rubio et s'engagèrent résolument dans la sente que devait quelques heures plus lard suivre don Miguel Ortega.
Ces cavaliers étaient des blancs, et qui plus est des Mexicains; il était facile de reconnaître, au premier abord, qu'ils n'appartenaient ni de près ni de loin à aucune des classes d'aventuriers qui, sous des dénominations différentes, telles que trappeurs, chasseurs, coureurs des bois, gambucinos ou pirates, pullulent dans les Prairies de l'Ouest, qu'ils parcourent incessamment dans tous les sens.
Le costume de ces cavaliers était celui porté habituellement par les hacenderos mexicains des frontières: le feutre à large bord galonné et garni de la toquilla, la manga, les calzoneras de velours ouvertes au genou, le zarapé, les botas vaqueras et les armas de agua, sans lesquelles nul ne se hasarde au désert. Ils étaient armés de rifles, revolvers, navaja et machete. Leurs chevaux, en ce moment accablés par la chaleur mais rafraîchis un peu au passage du gué, avaient les jambes fines, redressaient fièrement la tête et montraient qu'au besoin ils auraient pu, quelle que fût leur fatigue apparente, fournir une longue course.
Des trois cavaliers, l'un paraissait être le maître ou du moins le supérieur des deux autres.
C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux traits durs, accentués, mais empreints d'une rare franchise et d'une grande énergie; sa taille était haute, bien prise, vigoureusement charpentée, il se tenait droit et roide sur sa selle avec cette prestance assurée qui dénote les vieux soldats.
Ses compagnons appartenaient à la classe des Indios mansos, race abâtardie dans laquelle le sang indien et le sang espagnol se sont tellement mêlés, qu'il n'est plus possible de leur assigner un type caractéristique. Cependant la richesse de leurs vêtements et la façon dont ils cheminaient auprès du premier cavalier laissaient deviner qu'ils étaient pour lui des serviteurs de confiance, des hommes dont la fidélité était éprouvée de longue date, presque des amis enfin, et non des domestiques dans la brutale réception du mot. Autant qu'il est possible de reconnaître l'âge d'un Indien sur le visage duquel les traces de décrépitude sont presque toujours invisibles, ces deux hommes devaient avoir atteint le milieu de la vie, c'est-à-dire quarante à quarante-cinq ans.
Ces trois cavaliers venaient à peu de distance les uns des autres, l'air soucieux et triste; parfois ils jetaient autour d'eux un regard découragé, étouffaient un soupir et continuaient leur route la tête basse comme des hommes qui ont la conviction d'avoir entrepris une tâche au-dessus de leurs forces, mais que la volonté et surtout le dévouement poussent en avant quand même.
La présence de ces étrangers sur les rives du Rubio était du reste un de ces faits insolites que nul n'aurait pu expliquer, et qui certes aurait fort étonné les chasseurs ou les Indiens dont ils auraient été aperçus.
Dans les parages où ils se trouvaient, les animaux étaient rares, donc ils ne chassaient pas. Ces régions éloignées de toutes les zones civilisées, aboutissaient fatalement aux contrées inexplorées, dernier refuge des Indiens; ces hommes n'étaient donc pas des trafiquants ni des voyageurs ordinaires.
Quelle raison assez puissante les avaient déterminés à s'enfoncer ainsi dans le désert en aussi petit nombre, lorsque pour eux tout visage humain devait immanquablement être celui d'un ennemi?
Où allaient-ils? Que cherchaient-ils?
A cette double question, nul, si ce n'est ces hommes seuls, n'aurait osé répondre.
Cependant le gué avait été traversé; devant eux s'étendait une lande stérile et sablonneuse aboutissant à la gorge dont nous avons parlé plus haut.
Dans cette lande, pas un brin d'herbe ne verdissait; les rayons incandescents du soleil tombaient d'aplomb sur un sable brûlant qui rendait encore, s'il est possible, la chaleur plus lourde et plus étouffante.
Le plus âgé des voyageurs se tourna vers ses compagnons:
—Courage, muchachos! dit-il d'une voix douce, avec un triste sourire, en désignant à trois milles au loin à peu près les contreforts d'une forêt vierge, dont la végétation drue et serrée leur promettait une ombre réparatrice; courage, bientôt nous nous reposerons.
—Que votre seigneurie ne s'inquiète pas de nous, répondit un des criados; ce que votre seigneurie supporte sans se plaindre, nous autres pouvons aussi le supporter.
—La chaleur est accablante, ainsi que vous je sens le besoin de quelques heures de repos.
—A la rigueur nous pourrions continuer encore longtemps notre route, reprit celui qui déjà avait parlé, mais nos chevaux ont peine à se traîner; les pauvres bêtes sont presque fourbues.
—Oui, bêtes et gens il faut nous arrêter. Quelque forte que soit la volonté, il y a des limites devant lesquelles l'organisation humaine doit fléchir; courage! Dans une heure nous serons arrivés.
—Allez, allez, seigneurie, ne songez pas à nous davantage.
Le premier voyageur ne répondit pas, ils continuèrent silencieusement leur marche.
Cependant ils ne tardèrent pas à atteindre la gorge, qu'ils traversèrent, et bientôt ils se trouvèrent au milieu de bouquets d'arbres qui, se rapprochant doucement, commencèrent à les abriter tant bien que mal; sur le point d'arriver à l'endroit que le premier voyageur avait désigné pour y faire halte, il s'arrêta tout à coup, et se tournant vers ses compagnons:
—Voyez donc, dit-il, ne vous semble-t-il pas voir une légère colonne de fumée s'élever du milieu des fourrés, là-bas devant nous, un peu sur la gauche à la lisière de la forêt.
Ceux-ci regardèrent.
—Effectivement, répondit le plus âgé; il n'y a pas à s'y tromper, bien que d'ici on pourrait croire que c'est un nuage de vapeur; cependant la façon dont monte la spirale et sa nuance bleuâtre, tout indique que c'est de la fumée.
—Depuis dix mortels jours que nous errons dans ces immenses solitudes sans rencontrer âme qui vive, ce feu doit être pour nous le bienvenu, puisqu'il nous annonce des hommes, c'est-à-dire des amis; allons donc tout droit à leur rencontre, peut-être obtiendrons-nous d'eux de précieux renseignements sur le but de notre voyage.
—Permettez, seigneurie, répondit vivement le criado: lorsque nous avons quitté le presidio, vous avez consenti à vous laisser guider par moi, excusez-moi de vous donner un conseil qui, je le crois, dans les circonstances présentes, vous sera fort utile.
—Parle, mon brave Bermudez, j'ai la plus entière confiance dans ton expérience et dans ta fidélité, ton conseil sera bien reçu par moi.
—Merci, seigneurie, répondit celui qu'on venait de nommer Bermudez; j'ai longtemps été votre vaquero, et dans ce métier je me suis souvent trouvé en rapport, soit avec des Indiens, soit avec des chasseurs, ce qui m'a donné sur la vie du désert certaines notions dont j'ai fait mon profit, bien que je n'aie jamais pénétré aussi loin qu'aujourd'hui dans les prairies. Ainsi, dans les parages où nous sommes, nous devons surtout redouter la rencontre de nos semblables, ne les accoster qu'avec prudence, en usant des précautions les plus grandes, d'autant plus que nous ne savons en face de qui nous nous trouverons et si nous aurons affaire à des amis ou à des ennemis.
—C'est vrai, ton observation est juste, mais malheureusement elle arrive un peu tard.
—Pourquoi donc?
—Parce que si nous avons aperçu la fumée de leur feu, il est probable que depuis longtemps déjà les gens qui sont là-bas nous ont vus et épient tous nos mouvements, d'autant plus que nous n'avons aucunement cherché à dissimuler notre présence.
—Cela est certain, don Mariano, cela est certain, reprit Bermudez en secouant la tête. Voilà, si vous me le permettez, ce que je propose à votre seigneurie, afin d'éviter un malentendu toujours désagréable: vous m'attendrez ici avec Juanito, tandis que moi je m'avancerai seul et je pousserai une reconnaissance jusqu'auprès du feu.
Don Mariano hésita à répondre, il lui semblait dur d'exposer ainsi son vieux domestique.
—Décidez-vous, seigneurie, dit vivement celui-ci; je connais la manière de causer des peaux-rouges, ils me salueront ou d'une volée de flèches, ou d'une balle; mais, comme ils sont généralement très maladroits, je suis à peu près certain de ne pas être blessé, et alors, j'entrerai facilement en pourparlers avec eux. Vous voyez que les risques que j'ai à courir ne sont pas grands.
—Bermudez a raison, seigneurie, ajouta sentencieusement Juanito, homme méthodique et silencieux, qui ne prenait la parole que dans les grandes circonstances, vous devez le laisser agir à sa guise.
—Non, répondit résolument don Mariano; je ne consentirai jamais à cela. Dieu est le maître de notre existence, lui seul peut en disposer à son gré; s'il t'arrivait quelque chose de fâcheux, mon pauvre Bermudez, je ne me le pardonnerais pas; nous continuerons à avancer tous trois ensemble; au moins, si ce sont des ennemis qui sont devant nous, nous pourrons nous défendre.
Bermudez et Juanito se disposaient à prendre la parole pour répondre à leur maître, et il est probable que la discussion se serait prolongée longtemps encore, mais en ce moment le galop d'un cheval se fit entendre, les herbes s'écartèrent, et un cavalier apparut à une dizaine de pas du groupe environ. Ce cavalier était blanc, il portait le costume des chasseurs de la Prairie.
—Hola, caballeros! cria-t-il en faisant un geste amical de la main et en arrêtant son cheval, avancez sans crainte et soyez les bienvenus; j'ai reconnu votre indécision, je suis venu pour y mettre un terme.
Les trois hommes échangèrent un regard.
—Venez, venez, reprit le chasseur, nous sommes des amis, je vous le répète, vous n'avez rien à redouter de nous.
—Je vous remercie de votre cordiale invitation, répondit enfin don Mariano, et je l'accepte de grand cœur.
Puis toute défiance étant éteinte entre eux, les quatre personnages s'avancèrent de compagnie vers le feu qu'ils atteignirent au bout de quelques minutes.
Auprès de ce feu se tenaient deux personnes, un Indien et sa femme.
Les voyageurs mirent pied à terre, débarrassèrent leurs montures de leur selle et de leur bride, et après leur avoir donné la provende, ils s'assirent avec un soupir de satisfaction auprès de leurs nouveaux amis, qui leur firent, avec toute la cordiale simplicité du désert, les honneurs de leurs provisions et de leur campement.
Le lecteur a sans doute reconnu dans ces trois nouveaux personnages, Ruperto, l'Aigle-Volant et l'Églantine, que nous avons laissés se dirigeant vers le village du chef, où Ruperto avait reçu de Balle-Franche la mission d'accompagner le peau-rouge.
Non seulement don Mariano et ses compagnons étaient fatigués, mais encore ils avaient très faim; le chasseur et les Indiens les laissèrent assouvir leur appétit en toute liberté, puis lorsqu'ils les eurent vus, allumer leurs papelitos, ils les imitèrent, et la conversation s'engagea. Commencée un peu à bâtons rompus par ces questions habituelles au désert, sur le temps, la chaleur et l'abondance du gibier, elle ne tarda pas à devenir plus intime et à prendre un caractère tout à fait sérieux.
—Maintenant que le repas est terminé, chef, dit Ruperto, éteignez le feu, il est inutile que nous révélions notre présence aux vagabonds qui sans doute rôdent en ce moment dans la Prairie.
L'Églantine, sur un signe de l'Aigle-Volant, éteignit le feu.
—C'est en effet votre fumée qui vous a dénoncés, répondit don Mariano,
—Oh! reprit Ruperto en riant, parce que nous l'avons voulu, sans cela nous aurions fait notre feu de façon à demeurer invisibles.
—Vous désiriez donc être découverts?
—Oui, c'était un coup de dés.
—Je ne vous comprends pas.
—Ce que je vous dis vous semble une énigme, mais vous ne tarderez pas à savoir à quoi vous en tenir. Regardez, ajouta le chasseur en étendant le bras dans la direction de la gorge, voyez-vous ce cavalier qui accourt à toute bride, dans un quart d'heure à peine il sera auprès de nous; grâce à la précaution que je viens de prendre, il passera sans nous apercevoir.
—Redouteriez-vous quelque chose de ce cavalier?
—Rien; au contraire le chef et moi nous sommes ici pour lui venir en aide.
—Vous le connaissez donc?
—Pas le moins du monde.
—Hum! Vous devenez de plus en plus incompréhensible, caballero.
—Patience, reprit en riant le chasseur; ne vous ai-je pas dit que bientôt vous auriez le mot de l'énigme.
—Oui, et je vous avoue que ma curiosité est si bien excitée que je l'attends avec impatience?
Cependant le cavalier que Ruperto avait désigné à don Mariano s'approchait rapidement, et bientôt, ainsi que l'avait prévu le chasseur, il passa sans l'apercevoir à quelques pas seulement du campement.
Aussitôt qu'il eut disparu dans la forêt, Ruperto reprit la parole.
—Il y a quelques heures, dit-il, non loin de l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, le chef et moi, sans le vouloir, nous avons assisté à une conversation dont ce cavalier était l'objet, conversation dans laquelle il était tout simplement question de lui tendre un piège et de le faire tomber dans un guet-apens odieux; je ne connais pas la raison qui engageait les deux hommes qui causaient, sans se croire si bien écoutés, à machiner cet assassinat; je ne sais pas qui est ce cavalier et je ne veux pas le savoir, mais j'ai pour tout ce qui, de près ou de loin, sent la trahison une répulsion instinctive; ce chef indien est comme moi; nous avons immédiatement résolu de sauver ce cavalier si cela nous était possible; nous savions qu'il devait passer ici, puisqu'il avait un rendez-vous avec l'un des deux individus que le hasard ou plutôt la Providence nous faisait si singulièrement écouter. Deux hommes, quelque braves qu'ils soient, sont bien faibles contre une vingtaine de bandits, cependant nous ne perdîmes pas courage, résolus, si Dieu ne nous envoyait pas d'auxiliaires, à tenter bravement l'aventure à nous deux, d'autant plus que les gens dont nous surprenions les sanglants projets nous semblaient être d'atroces coquins; cependant sur l'avis du chef, j'allumai le feu, certain que, si le hasard amenait quelque voyageur de ce côté, la fumée lui servirait de phare et l'amènerait incontestablement ici; vous voyez, caballero, que je ne me suis pas trompé dans mes prévisions, puisque vous êtes venu.
—Et j'en suis heureux, répondit chaleureusement don Mariano; je m'associe de grand cœur à votre projet, qui me semble de tout point émaner d'un cœur loyal et bon.
—Ne me faites pas meilleur que je ne suis, caballero, répondit le chasseur, je ne suis qu'un pauvre diable de coureur des bois, fort ignorant des choses des villes, seulement je me laisse, en toutes circonstances, guider par les inspirations de mon cœur.
—Et vous avez raison, car elles sont saines et justes, disposez de moi comme vous l'entendrez; je me mets à votre disposition pour tout ce que vous jugerez convenable de faire.
—Merci; maintenant nous sommes en force, si nombreux qu'ils soient, je vous certifie que les pícaros verront beau jeu; mais nous avons encore du temps devant nous: reposez-vous, dormez quelques heures; lorsque le moment sera venu, nous nous concerterons pour convenir de ce que nous aurons à faire.
Don Mariano était trop fatigué pour se faire répéter cette invitation; quelques minutes plus tard, lui et ses compagnons étaient plongés dans un sommeil profond et réparateur.
Au coucher du soleil, Ruperto les réveilla.
—Il est temps, dit-il.
Ils se levèrent; ces quelques heures de repos leur avaient rendu toutes leurs forces. Les dispositions à prendre étaient simples, elles furent bientôt réglées.
Nous avons vu ce qui était arrivé: Addick et don Stefano, surpris eux-mêmes lorsqu'ils croyaient surprendre don Miguel, ignorant contre combien d'ennemis ils avaient à lutter, avaient, ainsi que tous leurs compagnons, été mis en fuite après une lutte acharnée.
Don Mariano et Ruperto, satisfaits d'avoir sauvé don Miguel, s'étaient retirés dès que l'issue du combat ne leur avait plus paru douteuse.
Rappelés cependant sur les bords du Rubio, par les quelques coups de feu tirés au dernier moment par don Miguel, ils avaient vu tomber un homme et s'étaient élancés vers lui autant peut-être afin de lui porter secours que pour le faire prisonnier. Cet homme était évanoui. Don Mariano et Ruperto l'enlevèrent dans leurs bras et le transportèrent sous le couvert de la forêt, où, dans un espace dénué d'arbres, l'Églantine était parvenu à grand-peine à allumer du feu; mais lorsqu'à la lueur des flammes du foyer ils purent reconnaître le visage du blessé, les deux hommes avaient poussé un cri de stupéfaction.
—Don Stefano Cohecho! s'était écrié Ruperto.
—Mon frère! avait dit don Mariano avec une douleur mêlée d'épouvante.
Cependant, avec les premières lueurs du matin, l'ouragan terrible qui avait si cruellement sévi pendant la nuit presque tout entière s'était peu à peu calmé; le vent avait balayé le ciel et emporté au loin les nuages sombres qui plaquaient de taches noirâtres le bleu de l'éther; le soleil se levait majestueusement dans des flots de lumière; les arbres, rafraîchis par la tempête; avaient repris ce vert mat que souillait la veille le sable poussiéreux du désert, et les oiseaux, dont les innombrables myriades se cachaient frileusement sous l'épaisse feuillée du couvert, entonnaient à plein gosier l'harmonieux concert que chaque matin, au réveil de la nature, ils chantent au Très Haut; hymne sublime et grandiose, harmonie saisissante dont le rythme, plein de naïves mélodies, fait doucement rêver l'homme perdu dans ces océans de verdure, et le plonge à son insu dans la mélancolique rêverie de l'espoir dont la réalisation est au ciel.
Ainsi que nous l'avons dit, don Miguel Ortega sauvé grâce au courage à toute épreuve et à la présence d'esprit des deux coureurs des bois, avait été transporté par eux au pied d'un arbre où ils l'avaient étendu.
Le jeune homme était évanoui. Le premier soin des chasseurs fut de rechercher ses blessures. Il en avait deux, une au bras droit, l'autre à la tête. Aucune des deux n'était dangereuse. La blessure du bras saignait beaucoup; une balle avait déchiré les chairs, mais sans occasionner de rupture d'os ni aucun autre accident grave. Quant à la blessure de la tête, produite évidemment par un instrument tranchant, les cheveux s'étaient déjà collés dessus et avaient arrêté l'hémorragie.
L'évanouissement de don Miguel était causé par la perte de sang d'abord, puis par la surexcitation nerveuse d'une lutte longue et acharnée et par la somme immense de forces qu'il avait été contraint de dépenser pour résister aux ennemis nombreux qui l'avaient traîtreusement attaqué.
Les coureurs des bois, par la vie qu'ils mènent et les accidents sans nombre auxquels ils sont sans cesse exposés, sont contraints de posséder quelques connaissances pratiques en médecine et surtout en chirurgie. Élèves des peaux-rouges, les simples jouent un grand rôle dans leur système de médication. Balle-Franche et Bon-Affût, étaient passés maîtres dans l'art de traiter sommairement les plaies, à la mode indienne. Après avoir lavé avec soin les blessures, coupé les cheveux de celle de la tête, ils prirent des feuilles d'oregano, en formèrent une espèce de cataplasme en les mouillant légèrement avec un peu d'eau-de-vie étendue d'eau et appliquèrent ce remède primitif sur les blessures en l'assujettissant avec des feuilles d'abanijo coupées en bandes et attachées aux moyens de fils d'aloès. Puis, avec la lame d'un couteau, ils écartèrent légèrement les mâchoires serrées du blessé, et introduisirent quelques gouttes de liqueur dans sa bouche. Au bout de quelques instants don Miguel entrouvrit faiblement les yeux, et une rougeur fugitive colora les pommettes de ses joues pâlies.
Les chasseurs, les deux mains croisées sur l'extrémité de leur rifle, examinaient avec soin le visage du blessé, cherchant à lire sur ses traits les résultats probables des moyens qu'ils avaient cru devoir employer pour le soulager.
L'homme qui sort d'un évanouissement profond n'a pas, dans le premier moment, conscience des objets extérieurs ni le souvenir des faits qui se sont passés; l'équilibre brusquement rompu entre ses facultés par les chocs successifs qu'elles ont éprouvés, ne se rétablit que lentement et graduellement, au fur et à mesure que la vue devient plus nette et la mémoire plus claire. Don Miguel jeta autour de lui un regard sans chaleur et sans expression, et referma presque aussitôt les yeux comme s'il avait été fatigué déjà de l'effort qu'il avait été contraint de faire pour les ouvrir.
—Dans quelques heures ses forces seront revenues, et avant trois jours il n'y paraîtra plus, observa Balle-Franche, en hochant sentencieusement la tête; vrai Dieu! C'est un de ces hommes carrés comme je les aime!
—N'est-ce pas, répondit Bon-Affût; si jeune et déjà si vaillant, quel rude assaut il a soutenu!
—Oui, et bravement, on peut le dire! C'est égal, si nous ne nous étions pas trouvés là, il aurait eu de la peine à s'en tirer.
—Il aurait succombé, cela ne fait point le moindre doute, c'eût été malheureux.
—Très malheureux! Enfin l'en voilà hors. Ah çà, qu'allons-nous en faire à présent? Nous ne pouvons demeurer éternellement ici; d'un autre côté, il est incapable de faire un mouvement, il faudrait cependant le ramener au camp, ses hommes doivent être inquiets de son absence, qui sait ce qui arriverait si elle se prolongeait?
—C'est juste. Nous ne pouvons pas songer à le mettre sur son cheval, il faut aviser à un autre expédient.
—Pardieu! Ce n'est pas embarrassant, la torpeur dans laquelle il est tombé durera près de deux heures, dans l'intervalle, il sera à peine capable de prononcer quelques mots et de se rappeler vaguement ce qui est arrivé; il n'est donc pas nécessaire que nous demeurions tous deux auprès de lui, un seul suffira, moi, par exemple; vous, vous profiterez de cela pour vous rendre au camp, annoncer ce qui s'est passé, dire aux gambucinos dans quel état se trouve leur chef, demander du secours et l'amener dans le plus court délai possible.
—Vous avez, ma foi raison, Balle-Franche, votre conseil est excellent, je vais le mettre immédiatement à exécution; je serai tout au plus absent pendant deux heures, veillez bien, car nous ne savons qui sont les gens qui rôdent aux environs et probablement espionnent nos démarches.
—Soyez tranquille, Bon-Affût, je ne suis pas un de ces hommes qui se laissent surprendre; ainsi, tenez, je me souviens d'une aventure qui m'arriva à peu près dans les mêmes conditions que celles ou nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a longtemps de cela, c'était en 1824, j'étais tout jeune alors, et je...
Mais, Bon-Affût, qui voyait avec effroi poindre une des interminables histoires de son ami, se hâta de l'interrompre sans cérémonie, en disant:
—Pardieu! Je vous connais de longue date, Balle-Franche, et je sais quel homme vous êtes, aussi je m'en vais parfaitement tranquille.
—C'est égal, insista le chasseur, si vous me laissiez vous expliquer...
—Inutile, inutile, mon ami; d'un homme de votre trempe et de votre expérience les explications sont oiseuses, interrompit Bon-Affût en se jetant vivement en selle et s'éloignant à toute bride.
Balle-Franche le suivit longtemps des yeux.
—Hum! fit-il d'un ton pensif, Dieu m'est témoin que cet homme est une des plus excellentes créatures qui existent; je l'aime comme un frère, eh bien, je ne pourrai jamais lui faire comprendre combien il est utile et précieux de conserver dans sa mémoire le souvenir des choses passées, afin de ne pas se trouver embarrassé lorsque surgit tout à coup une de ces difficultés si fréquentes dans la vie du désert; enfin, à la grâce de Dieu!
Et il se remit à examiner le blessé avec cette sollicitude intelligente qu'il n'avait jusque-là cessé de lui témoigner.
Don Miguel n'avait pas fait un mouvement, près d'une heure s'était écoulée, et le blessé, dont l'évanouissement s'était peu à peu dissipé, était instantanément tombé dans un sommeil lourd et agité dont rien ne semblait devoir le tirer avant longtemps. Balle-Franche, assis auprès de lui, le rifle entre les jambes, fumait philosophiquement sa pipe indienne, attendant avec cette patience particulière aux chasseurs qu'un symptôme quelconque lui annonçât que le blessé parvenait à secouer cette torpeur de mauvais présage qui s'était emparée de lui.
Le vieux Canadien aurait désiré, au risque de voir se déclarer une fièvre intense, qu'une commotion subite vint fouetter l'organisme du jeune homme et le rejeter brutalement dans la vie; il comptait sur l'arrivée des gambucinos pour obtenir ce résultat, et souvent il interrogeait le désert avec inquiétude pour tâcher de les apercevoir. Mais il ne voyait, il n'entendait rien. Tout était calme et silencieux autour de lui.
—Allons, murmurait-il parfois, en jetant un regard mécontent sur don Miguel étendu à ses pieds, le choc a été trop rude, et rien qui vienne galvaniser cette matière et lui rendre la conscience de son être! Sur mon âme c'est jouer de malheur!
Au moment où, pour la centième fois peut-être, il répétait cette phrase avec un dépit toujours croissant, il entendit à quelque distance un froissement assez fort dans les feuilles et un bris de branches mortes.
—Eh! Eh! fit le chasseur, qu'est-ce que c'est que cela?
Il leva vivement la tête et examina avec soin les alentours; tout à coup il partit d'un éclat de rire concentré, et ses yeux étincelèrent de joie.
—Pardieu! s'écria-t-il gaiement, voilà justement mon affaire, c'est Dieu qui m'envoie ce gaillard-là pour me tirer d'embarras, qu'il soit le bienvenu.
A une vingtaine de pas au plus du chasseur, couché sur la maîtresse branche d'un mezquite énorme, un magnifique jaguar fixait sur lui des regards flamboyants, en passant par intervalle une de ses pattes de devant derrière ses oreilles avec ces minauderies et ces ronrons particuliers à la race féline. Cette bête fauve, probablement effrayée par l'ouragan de la nuit, n'avait pu encore regagner sa tanière vers laquelle elle se dirigeait, lorsque sur son chemin elle avait rencontré les deux hommes.
Le jaguar ou tigre d'Amérique, loin d'attaquer l'homme, évite avec soin sa rencontre, ce n'est que poussé et contraint qu'il accepte le combat, mais alors il devient terrible et une lutte avec lui est souvent mortelle, à moins que son antagoniste soit aguerri et au courant des nombreuses ruses qu'il emploie pour s'assurer la victoire.
A l'instant où le tigre apercevait le chasseur, celui-ci l'avait vu, le combat était donc imminent. Les deux ennemis restèrent plusieurs minutes à s'observer, les regards croisés comme deux lames d'épées.
—Allons, décide-toi donc, paresseux, murmura Balle-Franche.
Le jaguar poussa un sourd rugissement, aiguisa quelques secondes ses griffes formidables sur la branche qui lui servait de piédestal, puis se repliant et se pelotonnant pour ainsi dire sur lui-même, il bondit sur le chasseur. Celui-ci ne bougea pas; le rifle à l'épaule, les pieds écartés et fortement appuyés en terre, le corps un peu penché, il suivait d'un œil intelligent tous les mouvements du fauve; au moment où celui-ci s'élança, le chasseur pressa la détente.
Le coup partit, le tigre tournoya dans l'espace avec un hurlement furieux et retomba aux pieds de Balle-Franche. Le Canadien se pencha vers lui, le jaguar était mort; la balle du chasseur lui était entrée dans le crâne par l'œil droit et l'avait foudroyé.
Cependant, au hurlement du fauve et à la détonation du rifle de Balle-Franche, don Miguel avait ouvert les yeux il s'était brusquement relevé sur le coude droit, et le regard effaré, les traits contractés par une émotion étrange et terrible qui empourprait son visage.
—A moi! A moi! cria-t-il d'une voix tonnante.
—Me voilà! s'écria Balle-Franche, en accourant et l'obligeant à se recoucher.
Don Miguel le regarda.
—Qui êtes-vous? lui dit-il, au bout d'un instant, que me voulez-vous? Je ne vous connais pas.
—C'est juste, répondit imperturbablement le chasseur, qui lui parlait comme à un enfant, mais vous me connaîtrez bientôt, soyez tranquille; pour le moment, qu'il vous suffise de savoir que je suis un ami.
—Un ami! répéta le blessé, qui cherchait à remettre de l'ordre dans ses idées encore confuses et couvertes d'un épais bandeau, quel ami?
—Pardieu! fit le chasseur, vous ne devez pas les compter par milliers je suppose; je suis votre ami depuis quelques heures, je vous ai sauvé au moment où vous alliez mourir.
—Mais tout cela ne me dit rien, ne m'apprend rien. Comment suis-je ici, comment vous y trouvez-vous?
—Voilà bien des questions à la fois, il m'est impossible d'y répondre. Vous êtes blessé, et votre état vous interdit toute conversation. Voulez-vous boire?
—Oui, répondit machinalement don Miguel.
Balle-Franche lui tendit sa gourde.
—Mais, reprit-il au bout d'un instant, je n'ai pas rêvé cependant.
—Qui sait?
—Ces coups de feu, ces cris que j'ai entendus?
—La moindre des choses, un jaguar que je viens de tuer et que vous pouvez voir à quelques pas.
Il y eut un silence de quelques minutes; don Miguel réfléchissait profondément, la lumière commençait à se faire dans son esprit, la mémoire revenait; le chasseur suivait avec anxiété sur le visage du jeune homme les progrès incessants du retour de la pensée. Enfin un éclair d'intelligence brilla dans l'œil du jeune homme, et fixant son regard fiévreux sur le vieux chasseur:
—Combien y a-t-il de temps que vous m'avez sauvé? lui demanda-t-il.
—Trois heures à peine.
—Ainsi, il s'est écoule depuis que les événements qui m'ont amené ici ont eu lieu...
—Une nuit seulement.
—Oui, reprit le jeune homme d'une voix profonde, une nuit terrible. Oh! J'ai cru mourir.
—Vous n'avez échappé que par miracle.
—Merci.
—Je n'étais pas seul.
—Qui donc encore m'est venu en aide. Dites-moi son nom, afin que je le garde précieusement dans ma mémoire.
—Bon-Affût.
—Bon-Affût! s'écria le blessé avec attendrissement; toujours lui. Oh! Je devais m'attendre à ce nom, car il m'aime, lui.
—Oui.
—Et vous, quel est votre nom?
—Balle-Franche.
Le jeune homme tressaillit, et étendant le bras:
—Votre main, fit-il; vous aviez raison tout à l'heure de dire que vous étiez un ami, vous l'êtes effectivement depuis longtemps déjà, Bon-Affût m'a souvent parlé de vous.
—Depuis trente ans lui et moi nous sommes liés.
—Je le sais; mais où est-il donc, que je ne le vois pas?
—Il est parti, voilà deux heures environ, pour se rendre au campement de votre cuadrilla, afin d'amener des secours.
—Il songe à tout.
—Moi, je suis demeuré pour vous soigner et veiller sur vous pendant son absence, mais il ne peut tarder à revenir.
—Croyez-vous que je serai longtemps réduit à l'impuissance?
—Non, vos blessures ne sont pas sérieuses. Ce qui vous abat en ce moment, c'est le choc moral que vous avez reçu, et surtout le sang que vous avez perdu lorsque vous avez roulé évanoui dans le Rubio.
—Ainsi cette rivière...
—Est le Rubio.
—Je suis donc à l'endroit même où s'est terminée la lutte?
—Oui.
—Combien de jours pensez-vous que je demeure ainsi?
—Quatre ou cinq au plus.
Il y eut encore quelques secondes d'interruption à cette conversation à bâtons rompus.
—Vous m'avez dit que ce qui m'abat le plus est l'affaiblissement de mes facultés produit par le choc moral que j'ai reçu, n'est-ce pas? reprit don Miguel.
—Oui, je l'ai dit.
—Croyez-vous qu'une volonté ferme et puissante pourrait amener une réaction favorable à cet état?
—Je le crois.
—Donnez-moi votre main.
—La voilà.
—Bon, soutenez-moi.
—Que voulez-vous faire?
—Me lever.
—Vive Dieu! Je disais bien que vous étiez un homme. Allons, soit, j'y consens, essayez.
Après plusieurs minutes d'efforts infructueux, don Miguel parvint enfin à se tenir debout.
—Enfin! s'écria-t-il d'un ton de triomphe.
Au premier pas qu'il fit, il perdit l'équilibre et roula à terre.
Balle-Franche s'élança vers lui.
—Laissez-moi, lui cria-t-il, laissez-moi, je veux me relever seul.
Il y parvint; cette fois il prit mieux ses précautions que la première, et réussit à faire quelques pas.
Balle-Franche le regardait avec admiration.
—Oh! Il faut que la volonté dompte la matière, reprit don Miguel, les sourcils froncés et les veines gonflées; j'y arriverai.
—Vous vous tuerez.
—Non, car il faut que je vive; donnez-moi à boire.
Pour la seconde fois Balle-Franche, lui passa sa gourde; le jeune homme la porta avidement à ses lèvres.
—Maintenant, s'écria-t-il avec un accent fébrile, en rendant cette gourde au chasseur, à cheval!
—Comment, à cheval! s'écria Balle-Franche avec stupéfaction.
—Oui, je veux partir.
—Mais c'est de la folie cela!
—Laissez-moi faire, vous dis-je, je me tiendrai; seulement, comme ma blessure au bras gauche m'empêche de me mettre seul en selle, je réclame votre aide.
—Vous le voulez?
—Je l'exige.
—Soit donc, et à la grâce de Dieu.
—Il nous protégera, soyez-en certain.
Balle-Franche aida le jeune homme à se mettre en selle; contre les prévisions du chasseur, il s'y tint droit et ferme.
—Maintenant, dit-il, prenez la peau de votre jaguar, et partons.
—Où allons-nous?
—Au camp; Bon-Affût sera bien étonné de me voir, lui qui me croit à demi-mort.
Balle-Franche suivit silencieusement le jeune homme; il renonçait à chercher plus longtemps à s'expliquer ce caractère étrange.
Malgré la ferme volonté de don Miguel de dompter la douleur, le mouvement du cheval lui occasionnait des souffrances atroces qui crispaient ses traits et faisaient perler sur son front, pâle comme celui d'un cadavre, des gouttelettes d'une sueur froide; parfois, sa vue se troublait, il lui semblait que tout tournait autour de lui, il chancelait sur sa selle et se cramponnait avec force à la crinière de son cheval pour ne pas tomber.
—Stupide matière! murmurait-il d'une voix sourde, ne pourrai-je donc pas te vaincre!
Alors, il redoublait d'efforts pour paraître impassible, souriait à Balle-Franche, et lui adressait gaiement la parole.
Pour la première fois, le vieux chasseur se trouvait à court; il avait beau fouiller sa mémoire, afin de trouver dans sa vie, cependant si accidentée, une circonstance analogue à celle dans laquelle il se trouvait en ce moment, à son grand regret, il était forcé de convenir in petto que jamais il n'avait vu rien de pareil; cela le chagrinait malgré lui, aussi venait-il d'un air tout maussade auprès du jeune homme.
Cependant ils avançaient toujours; tout à coup, ils entendirent un grand bruit de chevaux à une distance assez rapprochée en avant d'eux, sur la sente qu'ils suivaient.
—Voilà Bon-Affût, dit don Miguel.
—C'est probable.
—Il sera bien étonné de me rencontrer venant au-devant du secours qu'il m'amène.
—Cela est certain.
—Pressons un peu le pas de nos chevaux.
Balle-Franche le regarda.
—Vous avez juré de vous donner une congestion cérébrale, n'est-ce pas? lui dit-il nettement.
—Comment cela, répondit le jeune homme étonné.
—Pardieu! Cela est facile à prévoir, reprit le chasseur d'un ton bourru; depuis une heure, vous faites folie sur folie, mais ne vous y trompez pas, caballero, ce que vous prenez pour de la force n'est que de la fièvre, c'est elle seule qui vous soutient, prenez-y garde, ne vous obstinez pas dans une lutte impossible, et dont, je vous en avertis, vous ne sortirez pas vainqueur. Je vous ai laissé agir à votre guise, parce que je ne voyais pas d'inconvénient à le faire jusqu'à présent; mais, croyez-moi, en voilà assez, vous avez donné la mesure de vos forces, vous avez prouvé ce que vous pourriez dans une circonstance urgente; c'est tout ce qu'il faut, maintenant arrêtons-nous et attendons.
—Merci, répondit don Miguel en lui serrant cordialement la main, vous êtes réellement mon ami, vos rudes paroles me le prouvent; oui, je suis un fou, mais que voulez-vous, je me trouve dans une position étrange, où toute heure que je perds peut amener pour moi et pour d'autres personnes des périls extrêmes, j'ai peur de succomber avant d'avoir accompli la tâche que le malheur m'a imposée.
—Vous succomberez bien plus vite, si vous ne voulez pas être raisonnable, quatre ou cinq jours sont bientôt passés, et puis, ce que vous ne pourrez pas accomplir, vos amis l'accompliront.
—C'est vrai, vous me faites rougir de moi-même; non seulement je suis un fou, mais encore je suis un ingrat.
—Allons ne parlons plus de cela; le bruit se rapproche, il est probable que ce sont vos compagnons; cependant il serait possible que ce fussent des ennemis, dans le désert on doit s'attendre à tout; entrons dans ce fourré où nous demeurerons parfaitement invisibles aux regards des arrivants, si c'est Bon-Affût, nous nous montrerons, sinon nous nous tiendrons cois.
Don Miguel approuva chaleureusement ce conseil, il comprenait qu'en cas de lutte, il ne serait que d'un piètre secours à son compagnon dans l'état où il se trouvait.
Les deux hommes disparurent dans le fourré qui se referma sur eux, et ils attendirent, le pistolet au poing, l'arrivée des gens dont le galop des chevaux croissait de minute en minute.
Balle-Franche ne s'était pas trompé, c'était effectivement Bon-Affût qui revenait avec une quinzaine de gambucinos. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à quelques pas d'eux, les deux hommes se montrèrent.
Bon-Affût ne pouvait en croire ses yeux, il ne comprenait pas comment cet homme, qu'il avait laissé privé de connaissance, étendu sur la terre comme un corps inerte et presque sans vie, avait eu la force de venir à sa rencontre, et de se tenir aussi droit et aussi ferme sur sa selle.
Don Miguel jouit quelques instants de son triomphe et de l'admiration qu'il inspirait à ces hommes pour lesquels la seule suprématie est celle de la force, puis il se pencha en souriant vers Bon-Affût.
—Vous n'en êtes pas moins le bienvenu avec le secours que vous m'amenez, mon ami, lui dit-il à voix basse; ce secours me devient en ce moment, sinon indispensable, du moins fort nécessaire, la volonté seule me maintient à cheval dans la position où je suis.
—Il faut vous hâter de retourner au camp, et de crainte d'accident, vous étendre sur un brancard.
—Un brancard! se récria don Miguel.
—Il le faut, croyez-moi; il est urgent que vous repreniez, dans le plus bref délai, le commandement de votre cuadrilla, n'usez donc pas vos forces dans d'inutiles bravades.
Don Miguel s'inclina sans répondre, il avait compris la portée de l'argument du chasseur; lui-même, après être descendu de cheval avec le secours des deux Canadiens, donna l'ordre à ses compagnons de construire le brancard qui devait servir à le transporter.
Bon-Affût, passant son bras sous celui du jeune homme et faisant signe à Balle-Franche de les suivre, s'écarta de quelques pas de la troupe, et, faisant asseoir sur l'herbe l'aventurier;
—Maintenant que vous êtes en état de me répondre, profitons du temps pendant lequel on confectionne le brancard, pour causer; vous avez beaucoup de choses à m'apprendre.
Le jeune homme soupira.
—Interrogez, répondit-il.
—Oui, cela vaudra mieux ainsi; comment et par qui avez-vous été attaqué?
—Je ne saurais vous le dire; c'est une étrange histoire, tellement embrouillée qu'il m'est impossible, malgré tous mes efforts, d'en deviner le premier mot.
—C'est égal, dites-nous ce qui vous est arrivé, peut-être nous autres, qui avons plus que vous l'habitude des prairies, trouverons-nous un fil conducteur qui servira à nous guider dans ce labyrinthe inextricable en apparence.
Don Miguel, sans se faire prier davantage, rapporta alors, dans tous leurs détails, les faits tels qu'ils s'étaient passés.
Au nom d'Addick, Bon-Affût fronça les sourcils.
Lorsque le Mexicain parla de don Stephano, les chasseurs échangèrent un regard d'intelligence; mais lorsque le jeune homme arriva à la singulière péripétie du combat où, sur le point de succomber, il avait été tout à coup secouru par des inconnus qui avaient disparu comme par enchantement après l'avoir dégagé, les chasseurs donnèrent les marques de la plus grande surprise.
—Voilà, ajouta don Miguel, l'odieux guet-apens dans lequel je suis tombé et dont j'aurais été victime, si vous n'étiez pas accourus à propos pour me sauver. Maintenant que vous savez tout, aussi bien que moi, quelle est votre opinion?
—Hum! fit le chasseur, tout cela est bien extraordinaire, en effet; il y a au fond de cette histoire une sombre machination, menée avec une adresse et une perversité diaboliques qui m'effrayent. J'ai certains soupçons que je tiens avant tout à éclaircir; je ne puis donc vous donner de suite mon opinion. Il faut avant tout, que j'approfondisse certaines choses. Rapportez-vous en à moi pour cela. Mais ces hommes, qui sont venus si à propos à votre secours, ne les avez-vous pas vus? Ne leur avez-vous pas parlé?
—Vous oubliez, répondit en souriant don Miguel, qu'ils me sont apparus au milieu du combat, apportés pour ainsi dire par l'ouragan qui sévissait avec fureur. Le temps eût été mal choisi pour une conversation.
—C'est vrai, je ne sais ce que je dis; mais, ajouta le chasseur en frappant la terre de la crosse de son rifle, je n'en aurai pas le démenti, je vous jure que bientôt j'aurai découvert quels sont vos ennemis, quelques soins qu'ils prennent et quelques précautions qu'ils emploient pour se cacher.
—Oh! Je compte bien me mettre à leur poursuite, dès que mes forces seront un peu revenues.
—Vous, caballero, répondit sèchement Bon-Affût, vous allez vous guérir d'abord. Arrivé à votre camp, vous vous enfermerez comme dans une citadelle, et vous ne ferez pas un mouvement avant de m'avoir revu.
—Comment, de vous avoir revu? Vous avez donc l'intention de me quitter?
—A l'instant, Balle-Franche et moi, nous allons partir; auprès de vous, nous ne vous servirions à rien, au lieu que nous vous serons utiles au dehors.
—Que voulez-vous faire?
—A notre retour vous saurez tout.
—Je ne puis demeurer dans une telle inquiétude, en outre je ne vous comprends pas.
—C'est cependant limpide. Je veux, aidé par Balle-Franche, arracher le masque à ce don Stefano, masque qui, à mon avis, doit cacher un bien laid visage, savoir quel est cet homme, et pourquoi il s'est posé vis-à-vis de vous en ennemi acharné.
—Merci, Bon-Affût; maintenant je suis tranquille. Allez, faites ce que bon vous semblera, je suis convaincu que tout ce qui sera humainement possible d'accomplir, vous l'accomplirez; seulement avant de nous séparer, promettez-moi une chose.
—Laquelle?
—Promettez-moi que, dès que vous aurez obtenu tous les renseignements que vous allez chercher, vous me les transmettrez, sans rien entreprendre contre cet homme dont je tiens à tirer personnellement, vous m'entendez, Bon-Affût, personnellement une vengeance exemplaire.
—Ceci vous regarde, je n'aurais garde d'aller sur vos brisées; à chacun sa tâche en ce monde: cet homme est votre ennemi et non le mien. Dès que je serai parvenu à vous mettre face à face, ou du moins à vous placer vis-à-vis l'un de l'autre dans une position égale, vous ferez comme vous l'entendrez, je m'en lave les mains.
—Bon, bon! murmura don Miguel, si quelque jour je tiens ce démon entre mes mains comme il m'a tenu entre les siennes, je ne le laisserai pas échapper, moi, je vous le jure.
—Ainsi, c'est convenu, nous pouvons partir?
—Quand il vous plaira.
Balle-Franche avait assisté calme et impassible jusque-là à l'entretien des deux hommes; mais à cette parole il fit un pas en avant, et, posant la main sur le bras de Bon-Affût:
—Un instant, dit-il.
—Quoi, encore? répondit le chasseur.
—Un mot seulement, mais un mot qui a, je le crois, dans les circonstances actuelles une certaine importance.
—Dites vite alors.
—Vous voulez découvrir quel est ce don Stefano, ainsi qu'il lui plaît de se faire appeler, et je vous approuve; mais il est, il me semble, une chose bien autrement sérieuse que nous devons d'abord nous appliquer à découvrir.
—Laquelle?
Balle-Franche tourna la tête à droite et à gauche, pencha le haut du corps légèrement en avant, et baissant la voix de façon que ceux auxquels il s'adressait ne l'entendaient eux-mêmes que difficilement, il reprit d'un ton sévère:
—La vie du désert ne ressemble en rien à celle des villes. Là-bas, on se connaît peu ou beaucoup, soit de nom, soit par des relations personnels; on est souvent lié par des intérêts plus ou moins directs; enfin, il existe entre tous les habitants des villes des liens sociaux qui les attachent les uns aux autres, et en forment, pour ainsi dire, une même famille. Au désert, ce n'est plus cela: l'égoïsme et le personnalisme règnent en maître; le moi est la loi suprême; chacun ne pense qu'à soi, n'agit que pour soi, et, dirai-je plus, n'aime que soi.
—Abrégez, pour Dieu! Balle-Franche, abrégez, interrompit Bon-Affût avec impatience; où diable voulez-vous en venir?
—Patience! continua l'imperturbable Canadien, patience, vous allez le savoir. Donc, pour me résumer, au désert, à moins d'avoir pendant longues années vécu côte à côte avec un homme, partageant avec lui les peines et les plaisirs, la bonne et la mauvaise fortune, chaque individu vit seul, sans amis, ne comptant que des indifférents ou des ennemis. Dans le guet-apens dont cette nuit don Miguel a failli être la victime, deux sortes de gens se sont spontanément révélés à lui. Ces deux sortes de gens sont des ennemis acharnés d'abord, puis ensuite des amis non moins acharnés. Ne croyez pas, continua le chasseur en s'échauffant, que je n'ai pas calculé la portée du mot que je viens de prononcer; vous vous tromperiez extraordinairement. Ne vous semble-t-il pas étrange, comme à moi, maintenant que vous êtes de sang-froid et que vous raisonnez dans toute la plénitude de vos facultés, ne vous semble-t-il pas étrange, dis-je, que soudainement, à un moment donné, sans qu'il soit possible de savoir ni pourquoi ni comment, ces hommes soient tout à coup sortis pour ainsi dire de terre afin de vous prêter main-forte; puis, lorsque le péril fut passé ou à peu près, ils soient disparus aussi brusquement qu'ils étaient venus, sans laisser de traces de leur passage et sans rompre l'incognito qui les couvrait; cela n'est-il pas étrange, répondez?
—En effet, murmura Bon-Affût, je n'y avais pas songé jusqu'à présent, la conduite de ces hommes est inexplicable.
—Voilà justement ce qu'il faut expliquer, s'écria violemment Balle-Franche: la Prairie n'est pas assez habitée pour que, à point nommé, par un ouragan épouvantable, il se trouve là des hommes tout prêts à vous défendre pour la seule satisfaction de le faire; ces gens, pour agir ainsi, devaient avoir des motifs secrets, un but qu'il est urgent de découvrir. Qui nous dit qu'ils ne faisaient pas partie de la troupe qui vous attaquait, que ce n'était pas un jeu joué afin de s'emparer plus facilement de vous, coup de partie dont notre présence imprévue est venue déranger l'exécution? Je vous le répète, il nous faut d'abord, et avant tout, retrouver ces hommes, savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent; en un mot, s'ils sont pour nous des amis ou des ennemis.
—Il est bien tard maintenant pour entreprendre une telle recherche, observa don Miguel.
Les deux chasseurs sourirent en échangeant un regard significatif.
—Bien tard pour vous, certainement, qui n'avez pas la clef du désert, reprit Balle-Franche; mais pour nous, c'est autre chose.
—Oui, appuya Bon-Affût; que nous retrouvions seulement une trace de leur passage, si légère qu'elle soit, une empreinte sur le sable mouillé, que nous tenions un bout de leur piste, cela nous suffira pour arriver à l'autre, et nous vous rendrons bon compte de ces inconnus dont, ainsi que l'a fort bien observé Balle-Franche, la conduite est trop étrange et trop belle pour être loyale.
—Oh! Que ne puis-je vous suivre! s'écria don Miguel avec regret.
—Guérissez-vous d'abord; bientôt, j'en ai la certitude, votre rôle commencera; car, avant trois jours, nous vous apporterons tous les renseignements qui vous manquent aujourd'hui, et, sans lesquels vous ne pouvez rien faire.
—Ainsi, vous me promettez que dans trois jours...
—Oui, dans trois jours nous serons de retour de notre expédition; comptez sur notre promesse et soignez-vous de façon à pouvoir vous mettre immédiatement en campagne.
—Je serai prêt.
—Allons, au revoir; le soleil est haut déjà, nous n'avons pas une minute à perdre.
—Au revoir et bonne chance.
Les chasseurs serrèrent cordialement la main de don Miguel, remontèrent à cheval et s'éloignèrent rapidement dans la direction du gué del Rubio.
Le chef des gambucinos, placé sur une civière, reprit doucement, escorté par ses compagnons, le chemin de son camp, où il arriva un peu avant le coucher du soleil.
Nous retournerons à présent auprès de don Stefano Cohecho, que nous avons laissé évanoui entre Ruperto et don Mariano.
La double exclamation poussée par le chasseur et le voyageur mexicain, en reconnaissant l'homme qu'ils avaient relevé sur les bords de la rivière, avait plongé les assistants dans une stupéfaction profonde.
Bermudez reprit le premier son sang-froid, et, s'approchant de son maître:
—Venez, don Mariano, lui dit-il, ne restez pas ici, peut-être serait-il bon qu'en ouvrant les yeux votre frère ne vous vît pas.
Don Mariano fixait un regard ardent sur le blessé.
—Comment se fait-il que je le retrouve là? dit-il, comme se parlant à soi-même; que fait-il dans ces régions sauvages? Il me mentait donc en m'écrivant que d'importantes affaires l'appelaient au États-Unis et qu'il partait pour la Nouvelle-Orléans?
—Le señor don Estevan, votre frère, répondit gravement Bermudez, est un de ces hommes aux allures ténébreuses, dont il est impossible de connaître les pensées et de deviner les actes; voyez, ce chasseur lui donne un nom qui ne lui appartient pas: dans quel but se cache-t-il ainsi? Croyez-moi, don Mariano, il y a là-dessous un mystère que nous éclaircirons avec la grâce de Dieu; mais soyons prudents, ne révélons pas notre présence à don Estevan: il sera toujours temps de le faire, si nous reconnaissons que nous nous sommes trompés.
—C'est vrai, Bermudez, votre avis est bon, je veux le suivre; seulement avant de m'éloigner, laissez-moi m'assurer de l'état où il se trouve: cet homme est mon frère, et, quelques grands que soient ses torts envers moi, je ne voudrais pas le voir mourir sans secours.
—Peut-être cela vaudrait-il mieux, murmura Bermudez.
Don Mariano lui jeta un regard mécontent et se pencha sur le blessé.
Celui-ci était toujours évanoui. L'Églantine lui prodiguait ces soins délicats et intelligents dont les femmes de toutes les couleurs et de toutes les nations ont le secret, sans cependant parvenir à le rappeler à la vie.
—Croyez-moi, seigneurie, insista Bermudez, éloignez-vous.
Don Mariano jeta un dernier regard sur son frère et sembla hésiter un instant; puis, se détournant avec effort.
—Allons! dit-il.
Le visage du vieux domestique rayonna.
—Je vous recommande cet homme, fit encore don Mariano en s'adressant à Ruperto; ayez pour lui tous les soins que réclame son état et que l'humanité exige.
Le chasseur s'inclina sans répondre. Le gentilhomme mexicain fit quelques pas pour se rapprocher de son cheval, qui, avec ceux de ses compagnons, était attaché à un jeune ébénier. Ce n'était qu'à regret que don Mariano s'éloignait; une voix secrète semblait l'avertir d'attendre.
Au moment où il mettait le pied à l'étrier, une main se posa sur son épaule; il se retourna.
Un homme était devant lui; cet homme était l'Aigle-Volant.
Le chef avait laissé les blancs s'occuper du soin de transporter les blessés; avec cet instinct particulier à sa race, il avait visité, lui, avec le plus grand soin le lieu de l'embuscade et tous les endroits où les hasards de la lutte avaient conduit les combattants. Son but, en agissant ainsi, avait été de découvrir quelque trace, quelque indice qui, le cas échéant, seraient utiles à ceux qui auraient intérêt à approfondir les causes du guet-apens tendu à don Miguel. Le hasard l'avait servi à souhait en lui fournissant une preuve dont le prix devait être immense, et que, sans nul doute, don Stefano aurait rachetée avec le plus clair de son sang, afin de l'anéantir; malheureusement cette preuve, tout intéressante qu'elle fût, était lettre close pour l'Indien, et dans ses mains n'avait aucune valeur.
L'Aigle-Volant songea aussitôt à don Mariano, qui pourrait probablement lui expliquer l'importance de la trouvaille mystérieuse qu'il avait faite; après l'avoir tournée et retournée plusieurs fois, il la cacha définitivement dans son sein, et, avec la décision caractéristique de sa race, il s'était élancé d'un pas rapide vers le campement où il était certain de rencontrer le Mexicain.
—Mon père va partir? demanda le peau-rouge.
—Oui, répondit don Mariano; mais je suis heureux de vous voir avant mon départ, chef, afin de vous remercier de votre cordiale hospitalité.
L'Indien s'inclina.
—Mon père sait déchiffrer les colliers des visages pâles, n'est-ce pas? continua-t-il; les blancs ont beaucoup de science, mon père doit être un chef dans sa nation.
Don Mariano regarda le Comanche avec surprise.
—Que voulez-vous dire? lui demanda-t-il.
—Nos pères indiens nous ont appris à transmettre, sur des peaux d'animaux préparées à cet effet, les événements intéressants qui se sont passés parmi nous dans nos tribus aux anciens âges du monde; les visages pâles savent tout: ils ont la grande médecine, eux aussi ont des colliers.
—Certes nous avons des livres sur lesquels, au moyen de signes convenus, on retrace l'histoire des nations et jusqu'aux pensées des hommes.
Le chef fit un geste de joie.
—Bon, dit-il, mon père doit connaître ces signes, car sa tête est grise.
—Je les connais en effet; cette science bien simple que je possède pourrait-elle donc vous être de quelque utilité?
L'Aigle-Volant secoua négativement la tête.
—Non, dit-il, pas à moi, mais peut-être à d'autres.
—Je ne vous comprends pas, chef; soyez donc assez bon pour vous expliquer plus clairement, je désire m'éloigner avant que l'homme qui est là reprenne connaissance.
L'Indien jeta un regard de côté sur le blessé.
—Il n'ouvrira pas les yeux avant une heure, dit-il, l'Aigle-Volant peut causer avec son père.
Malgré lui don Mariano se sentait intéressé à connaître ce que l'Indien désirait lui dire, il se résolut à attendre et lui fit signe de parler.
Le chef reprit d'une voix grave:
—Que mon père écoute, dit-il; l'Aigle-Volant n'est pas une vieille femme bavarde, c'est un chef renommé; les paroles que souffle sa poitrine sont toutes inspirées par le Wacondah; l'Aigle-Volant aime les visages pâles parce que ceux-ci ont été bons pour lui et lui ont, dans plusieurs circonstances, rendus de grands services. Après le combat, le chef a parcouru le champ de bataille, près de l'endroit où est tombé l'homme que mon père a amené ici; l'Aigle-Volant a trouvé un sac de médecine renfermant plusieurs colliers, l'Indien les a regardés dans tous les sens, mais il n'a pu les comprendre parce que le Wacondah a étendu sur ses yeux l'épais bandeau qui empêche les peaux-rouges d'égaler les blancs, cependant le chef, soupçonnant que, peut-être, ce sac mystérieux, inutile pour lui, pourrait être important pour mon père ou quelques-uns de ses amis, l'a serré précieusement dans sa poitrine et il est accouru en toute hâte afin de le remettre à mon père. Le voilà, ajouta-t-il en sortant un portefeuille de son sein et le présentant à don Mariano; que mon père le prenne, peut-être parviendra-t-il à connaître ce qu'il renferme.
Bien que l'action du peau-rouge fut toute naturelle de sa part, que ce portefeuille et ce qu'il contenait devait probablement être fort indifférent au gentilhomme, ce ne fut cependant qu'avec un secret serrement de cœur qu'il le prit des mains du chef.
L'Indien croisa les bras sur sa poitrine et attendit, fort satisfait de ce qu'il venait de faire.
Don Mariano examina d'un air distrait le portefeuille qu'il tenait à la main. Ce portefeuille était en chagrin noir assez ordinaire, sans enjolivements ni dorures; on reconnaissait que c'était plus un meuble d'utilité que de luxe; il était bourré de papiers et fermé au moyen d'une petite serrure en argent. L'examen, commencé d'abord, ainsi que nous l'avons dit, d'un air distrait, prit soudain une grande importance pour don Mariano, ses yeux étaient tombés sur ces mots à demi effacés, gravés en lettres d'or sur un des côtés du portefeuille:
« Don Estevan de Real del Monte. »
A la vue de ces mots qui lui révélaient le nom du propriétaire de l'objet qu'il tenait, il fit un geste de surprise en lançant un regard profond à son frère toujours étendu sans connaissance, et, par un mouvement indépendant de sa volonté, sa main se crispa avec force. Cette pression rompit l'attache qui fermait le portefeuille; il s'ouvrit, et plusieurs papiers s'en échappèrent.
Bermudez se baissa vivement, les ramassa et les remit à son maître. Celui-ci fit machinalement le geste de les replacer dans le portefeuille. Bermudez l'arrêta résolument.
—C'est Dieu qui vous donne les moyens de connaître enfin la vérité, dit-il; ne négligez pas l'occasion qu'il vous offre, sans cela vous pourriez plus tard vous en repentir.
—Violer les secrets de mon frère, murmura don Mariano avec un mouvement de répulsion.
—Non, repartit sèchement Bermudez, mais savoir comment il est devenu le maître des vôtres; seigneurie, souvenez-vous de la cause de notre voyage.
—Mais si je me trompais... s'il n'était pas coupable?
—Tant mieux! De cette façon vous en acquerrez les preuves.
—Ce que tu me pousses à faire là est mal, je n'ai pas le droit d'agir ainsi.
—Eh bien, moi qui ne suis qu'un misérable criado dont les actions n'ont aucune portée sérieuse, dans votre intérêt, je le prends, ce droit, seigneurie.
Et, par un geste rapide comme la pensée, il s'empara du portefeuille.
—Malheureux! s'écria don Mariano, arrête! Que vas-tu faire?
—Sauver, peut-être, celle que vous chérissez, puisque vous n'osez pas le faire vous-même.
—Que mon père laisse son esclave, dit l'Indien, en s'interposant, le Wacondah l'inspire.
Don Mariano n'eut pas le courage de résister plus longtemps, d'autant plus que, malgré lui, un sentiment inconnu dont il ne pouvait se rendre compte lui disait que c'était lui qui avait tort et que Bermudez faisait bien d'agir ainsi. Le métis avait, avec le plus grand sang-froid, ouvert les papiers sans paraître s'occuper de ce que son action avait de risqué au point de vue des convenances.
—Oh! s'écria-t-il tout à coup, ne vous avais-je pas dit, seigneurie, que c'était Dieu qui vous mettait entre les mains les preuves que vous cherchiez vainement depuis si longtemps; lisez! Lisez! Et s'il est possible, doutez encore du témoignage de vos yeux et refusez plus longtemps de croire à la perfidie de votre frère et à son odieuse trahison.
Don Mariano s'empara des papiers avec un geste fébrile et les parcourut rapidement des yeux. Après en avoir lu deux ou trois, il s'arrêta, leva les yeux au ciel, et laissa tomber sa tête dans ses mains avec l'expression de la plus grande douleur.
—Oh! fit-il avec désespoir, mon frère! Mon frère!
—Courage! lui dit doucement Bermudez.
—J'en aurai! répondit-il, l'heure de la justice est arrivée.
Un changement étrange s'était subitement opéré en lui. Cet homme si craintif quelques minutes auparavant, dont l'hésitation était extrême, s'était métamorphosé; il semblait avoir grandi, ses traits avaient pris une rigidité imposante, ses yeux lançaient des éclairs.
—Plus de craintes puériles, dit-il, plus de tergiversations. Il faut agir.
Se tournant alors vers l'Aigle-Volant:
—Cet homme est-il gravement blessé? lui demanda-t-il.
L'Indien alla examiner avec soin don Stefano.
Pendant tout le temps qu'il fut éloigné, nul ne prononça une parole; chacun comprenait que don Mariano avait enfin pris une résolution énergique et qu'il l'accomplirait, quelles qu'en dussent être plus tard les conséquences pour lui, sans remords et sans hésitation.
L'Aigle-Volant revint au bout de quelques minutes.
—Eh bien? lui demanda le gentilhomme.
—Cet homme n'est pas réellement blessé, répondit l'Indien, il a reçu seulement une contusion sérieuse à la tête qui l'a plongé dans une espèce d'évanouissement léthargique, dont il ne sortira pas avant une heure.
—Fort bien; et en se réveillant, dans quel état se trouvera-t-il?
—Il sera très faible, mais peu à peu cette faiblesse se dissipera, et demain il sera aussi bien portant qu'avant le coup qu'il a reçu.
Un sourire amer plissa les livres de don Mariano.
—Priez ce chasseur, votre ami, d'approcher, dit-il, j'ai à vous parler à tous deux; un service à vous demander.
Le chef obéit.
—Me voici à vos ordres, seigneurie, dit Ruperto.
—Nous allons tenir conseil, reprit alors don Mariano; n'est-ce pas la locution dont vous vous servez au désert lorsque vous avez à traiter d'affaires sérieuses?
Le chasseur et l'Indien firent un geste affirmatif.
—Ecoutez-moi avec attention, continua le gentilhomme d'une voix ferme et accentuée: l'homme qui est là est mon frère, cet homme doit mourir; je ne veux pas le tuer, je veux le juger; vous tous ici présents serez ses juges, moi je l'accuserai. Voulez-vous m'aider à accomplir, non pas un acte de vengeance, mais un acte de la plus rigoureuse justice? Je vous le répète, je l'accuserai devant vous présents, et, pièces en main; votre conscience sera éclairée; cet homme pourra se défendre, liberté entière lui sera laissée pour cela devant vous, de plus vous serez libres de le condamner ou de l'absoudre, suivant que vous le trouverez innocent ou coupable. Vous m'avez entendu, réfléchissez, j'attends votre réponse.
Il y eut un silence suprême.
Après quelques minutes, Ruperto prit la parole.
—Dans le désert, où ne pénètre pas la justice humaine, dit-il, la loi de Dieu doit régner; lorsque nous avons le droit de tuer les bêtes féroces et malfaisantes, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de punir un scélérat? J'accepte la mission dont vous me chargez, parce que, dans mon cœur, j'ai la persuasion qu'en agissant ainsi j'accomplis un devoir et que je suis utile à la société tout entière, dont je me fais le vengeur.
—Bien, répondit don Mariano, je vous remercie. Et, vous chef?
—J'accepte, dit nettement le Comanche; les traîtres doivent être punis, n'importe à quelle race ils appartiennent. L'Aigle-Volant est un chef, il a le droit de siéger au feu du conseil au premier rang des sachems et de condamner ou d'absoudre.
—A vous maintenant, reprit don Mariano en se tournant vers ses domestiques, répondez.
Bermudez fit un pas en avant, et saluant respectueusement don Mariano:
—Seigneurie, dit-il, nous connaissons cet homme: enfant, nous l'avons fait sauter et jouer sur nos genoux; plus tard il a été notre maître; nos cœurs ne seraient pas libres en sa présence; nous ne pouvons le juger, nous ne devons pas le condamner, nous ne sommes bons qu'à exécuter le jugement, quel qu'il soit, qu'on porte contre lui si nous en recevons l'ordre; d'anciens esclaves, libres par la bonté de leur maître, ne sont jamais égaux à lui.
—Ces sentiments sont ceux que j'attendais de vous; je vous remercie de votre franchise, mes enfants. En effet, vous ne devez pas intervenir dans cette affaire; Dieu, je l'espère, nous enverra deux hommes au cœur loyal et à la volonté ferme pour vous remplacer et remplir sans arrière-pensée les fonctions de juges.
—Dieu vous a entendu, caballero, dit une voix rude, nous voici, disposez de nous.
Les branches du taillis auprès duquel étaient réunis nos personnages s'écartèrent alors brusquement, et deux hommes parurent.
Ils firent quelques pas en avant, appuyèrent à terre le canon de leur rifle, et attendirent.
—Qui êtes-vous? demanda don Mariano.
—Chasseurs.
—Votre nom?
—Bon-Affût.
—Et vous?
—Balle-Franche. Depuis une demi-heure environ, nous sommes embusqués derrière ce taillis, nous avons entendu tout ce que vous avez dit, il est donc inutile de revenir sur l'exposé que vous avez fait, seulement il est un autre homme qui doit assister au jugement de cet individu.
—Un autre homme? Et qui donc?
—Celui qu'il a traîtreusement attaqué, que vous avez sorti de ses mains et que nous avons sauvé, nous autres.
—Mais cet homme, qui sait où il se trouve maintenant?
—Nous, dit Bon-Affût, nous qui l'avons quitté il y a une heure à peine pour nous mettre sur votre piste.
—Oh! S'il en est ainsi, vous avez raison; il faut que cet homme vienne.
—Malheureusement il est assez gravement blessé; mais s'il ne peut venir, il se fera porter, et je ne sais pourquoi, mais il me semble que non seulement sa présence est nécessaire parmi nous, mais encore qu'elle est indispensable pour l'éclaircissement de certains faits qu'il est de notre devoir de dévoiler.
—Que voulez-vous dire?
—Patience, caballero, bientôt vous nous comprendrez; le campement de cet homme n'est pas éloigné, il peut-être ici avant le coucher du soleil.
—Mais qui le préviendra.
—Moi! répondit Balle-Franche.
—Je vous remercie de cette offre loyale.
—Nous sommes peut-être plus intéressés que vous à l'éclaircissement de cette machination mystérieuse, répondit Bon-Affût.
Sur un signe de son ami, Balle-Franche remonta sur son cheval qu'il avait laissé dans le taillis, et s'éloigna à toute bride, pendant que don Mariano le suivait d'un regard curieux et troublé tout à la fois.
—Vous me parlez par énigmes, dit-il, en s'adressant au Canadien toujours appuyé sur son rifle.
Bon-Affût secoua la tête.
—C'est une triste histoire que celle dont les odieuses péripéties vont se dérouler devant vous, et dont vous ne savez pas le premier mot, malgré les preuves que vous croyez posséder, seigneurie.
Don Mariano poussa un soupir, deux larmes brûlantes coulèrent sur ses joues creusées par la douleur.
—Courage, mi amo, lui dit Bermudez, Dieu est enfin pour vous!
Le gentilhomme serra la main de son fidèle domestique, et détourna la tête pour cacher l'émotion qu'il éprouvait.
Lorsque Balle-Franche se fut éloigné, Bon-Affût, l'Indien et Ruperto se rapprochèrent du blessé, toujours plongé dans le même état d'insensibilité, et se groupèrent autour de lui afin de surveiller son réveil.
Don Mariano, dont les scrupules étaient éteints désormais et qui avait hâte de connaître, dans tous leurs détours, les ténébreuses machinations de son frère, afin de baser sur de solides arguments l'accusation qu'il voulait porter contre lui devant le tribunal suprême qu'il avait si inopinément installé, se retira avec ses domestiques dans un épais taillis, et là, loin des regards, il ouvrit le portefeuille avec une impatience fébrile, et commença la lecture des papiers qu'il contenait avec une horreur qui croissait à chaque lettre nouvelle qu'il dépliait.
Don Mariano ne voulait pas que son frère connût sa présence avant de comparaître devant ses juges, il comptait sur son apparition inopinée pour déjouer sa perspicacité et sa présence d'esprit en lui faisant perdre le sang-froid; voilà pour quelle raison il s'était caché dans un endroit inaccessible aux plus clairvoyants regards, se réservant d'apparaître subitement lorsque le moment serait arrivé.
Plus d'une heure s'écoula encore sans que don Stefano, malgré les soins incessants de l'Églantine, fit un mouvement qui indiquât son retour à la vie. Cependant les trois hommes accroupis silencieusement autour de lui ne s'étaient pas un instant relâchés de leur surveillance: ils comprenaient toute la portée de l'acte qu'ils étaient appelés à accomplir, et désiraient, avec cette intuition, que possèdent instinctivement les âmes loyales, que l'homme qu'ils allaient juger fût assez remis et assez en possession de ses facultés intellectuelles pour défendre bravement sa vie.
Au moment où le soleil, déclinant rapidement à l'horizon, allongeait démesurément l'ombre des arbres et n'apparaissait plus entre les plus basses branches que comme un globe de feu, la brise du soir passa en se levant comme un souffle rafraîchissant sur le front pâle du blessé, qui poussa un profond soupir à cette sensation de bien-être que lui faisait éprouver, après la chaleur accablante du jour, cette bienfaisante fraîcheur.
—Il va ouvrir les yeux, murmura Bon-Affût.
L'Aigle-Volant posa un doigt sur ses lèvres en montrant le blessé.
Si bas qu'eût parlé le chasseur, don Stefano l'avait entendu, sans comprendre peut-être le sens des paroles qui avaient frappé ses oreilles, mais pourtant suffisamment pour lui faire faire un mouvement prononcé et rappeler en lui le sentiment de l'existence.
Don Stefano n'était pas un homme ordinaire; digne fils de la race abâtardie du Mexique, la ruse formait le point le plus saillant de son caractère, profondément dissimulé: habitué à toujours juger mal des hommes et des choses, la méfiance semblait innée dans son cœur. Les paroles de Bon-Affût l'avertirent de se tenir sur ses gardes. Sans bouger, sans ouvrir les yeux, afin de ne pas révéler son retour à la vie, il fit un effort suprême pour se rappeler les circonstances qui avaient précédé l'événement dont il était victime, afin d'arriver de déduction en déduction à se rendre compte de la position dans laquelle il se trouvait, et deviner, s'il était possible, entre les mains de qui le hasard ou sa mauvaise fortune l'avait fait tomber.
La tâche que s'imposait don Stefano n'était pas facile, puisqu'il était, par la force des circonstances, privé de son plus solide auxiliaire, la vue, qui lui aurait permis de reconnaître les gens qui l'entouraient, ou du moins lui aurait révélé s'ils étaient amis ou ennemis. Aussi, bien qu'il écoutât avec la plus grande attention, afin de saisir une phrase ou un mot qui le guidât dans ses suppositions, et lui permit d'assoir son calcul sur des données sinon positives, du moins probables, comme les chasseurs, avertis par le chef et soupçonnant une ruse, s'abstinrent de leur côté de faire un geste et de prononcer un mot, toutes ses prévisions furent déjouées, et il demeura dans la plus complète ignorance.
Ce silence prolongé augmenta encore l'inquiétude de don Stefano, et le plongea au bout de quelque temps dans une anxiété telle qu'il résolut, coûte que coûte, d'en sortir. Mettant presque aussitôt son projet à exécution, il fit un mouvement comme pour se lever, et ouvrit brusquement les yeux en jetant autour de lui un regard circulaire et investigateur.
—Comment vous sentez-vous? lui demanda Bon-Affût en se penchant vers lui.
—Bien faible, répondit don Stefano d'une voix dolente; j'éprouve une pesanteur générale et je sens d'affreux bourdonnements dans les oreilles.
—Hum! continua le chasseur, cela n'est pas dangereux, il en est toujours ainsi à la suite d'une chute.
—J'ai donc fait une chute, reprit le blessé, que la vue de Ruperto, qu'il avait reconnu, commençait à rassurer.
—Dame! Il est probable, puisque nous vous avons ramassé étendu sur le sable auprès du gué del Rubio.
—Ah! C'est là que vous m'avez trouvé?
—Oui, il y a environ trois heures.
—Merci du secours que vous m'avez donné, sans lui il est probable que je serais mort.
—C'est fort possible; mais ne vous hâtez pas de nous remercier.
—Pourquoi donc? demanda don Stefano en dressant subitement les oreilles à cette réponse ambigüe qui lui paraissait une menace déguisée.
—Eh! Qui sait, repartit Bon-Affût avec bonhommie, nul ne peut répondre de l'avenir.
Don Stefano, dont les forces revenaient rapidement et qui déjà avait reconquis toute sa lucidité d'esprit, se dressa brusquement, et fixant sur le Canadien un regard qui semblait vouloir fouiller au fond de ses pensées les plus secrètes:
—Mais je ne suis pas votre prisonnier cependant.
—Hum! fit le chasseur sans répondre autrement. Cette interjection donna fort à penser au blessé et l'inquiéta plus qu'une longue phrase.
—Parlons franchement, dit-il au bout de quelques minutes de réflexions.
—Je ne demande pas mieux.
—De vous trois, il y en a un que je connais, continua-t-il en désignant Ruperto, qui fit silencieusement un geste affirmatif; je n'ai jamais, que je sache offensé cet homme, au contraire.
—C'est vrai, répondit Ruperto.
—Vous, je ne vous ai jamais vu, donc vous ne pouvez nourrir contre moi aucun sentiment d'inimitié.
—En effet, voici la première fois que la Providence nous met face à face.
—Reste ce guerrier indien qui, de même que vous, m'est parfaitement inconnu.
—Tout cela est exact.
—Pour quelle raison pourrais-je donc être votre prisonnier? A moins, ce que je ne crois pas, que vous soyez de ces oiseaux de proie nommés pirates qui pullulent dans le désert.
—Nous ne sommes pas des pirates, mais de loyaux et honnêtes chasseurs.
—Raison de plus pour que de nouveau je vous adresse ma question, et vous demande si je suis, oui ou non, votre prisonnier.
—Cette question n'est pas aussi simple que vous le supposez; bien que nous n'ayons, nous autres, aucun reproche à vous adresser personnellement, n'avez-vous pas insulté ou offensé d'autres individus depuis que vous errez dans les Prairies?
—Moi?
—Qui donc, si ce n'est vous? N'avez-vous pas cherché, pas plus tard que cette nuit, à assassiner un homme dans une embuscade que vous lui aviez tendue.
—Oui, mais cet homme est mon ennemi.
—Eh bien! Supposez pour un instant que nous soyons les amis de cet homme.
—Mais cela n'est pas, cela ne peut pas être.
—Pourquoi donc? Qui vous le fait supposer?
Don Stefano haussa les épaules avec dédain.
—Vous me croyez donc bien simple, dit-il, que vous supposez que je me payerai d'une telle défaite?
—Ce n'en est pas autant une que vous le croyez.
—Allons donc! Si j'étais tombé entre les mains de cet homme, il m'aurait fait transporter à son camp, afin de se venger de moi devant les bandits qu'il commande et auxquels la vue de mon supplice aurait été sans doute beaucoup trop agréable pour qu'il cherchât à les priver de ce ravissant spectacle.
Le vieux chasseur, dont jusqu'à ce moment la parole avait été ironique et le visage narquois, changea tout à coup de ton et devint aussi sérieux et aussi sévère que précédemment il avait été railleur.
—Écoutez, dit-il, et profitez de ce que vous allez entendre: nous ne sommes pas les dupes de votre feinte faiblesse; nous savons très bien que vos forces sont à peu près revenues; l'avis que je vous donne est franc et a pour but de vous prévenir contre vous-même: vous n'êtes pas notre prisonnier, il est vrai, et pourtant vous n'êtes pas libre.
—Je ne vous comprends pas, interrompit don Stefano dont le visage s'était éclairci, mais que ces dernières paroles avaient subitement rembruni.
—Aucune des personnes présentes, continua Bon-Affût, n'a de reproches à vous faire; nous ne savons qui vous êtes, et avant aujourd'hui, moi, au moins, j'ignorais complètement votre existence; mais il y a un homme qui prétend avoir contre vous, non pas des sentiments de haine, ce serait une affaire à régler entre vous et lui dans une rencontre loyale, mais des motifs de plainte assez forts pour provoquer votre mise en jugement immédiate.
—Ma mise en jugement immédiate! répéta don Stefano au comble de l'ébahissement; mais devant quel tribunal cet homme prétend-il donc me faire comparaître? Nous sommes au désert ici.
—Oui, et vous paraissez l'oublier; au désert ou les lois des villes sont impuissantes pour atteindre les coupables, il existe une législation terrible, sommaire, implacable, à laquelle, dans l'intérêt commun, tout homme offensé à droit de faire appel, lorsque d'impérieuses circonstances l'exigent.
—Et cette loi, demanda don Stefano, dont le visage pâle déjà prit une teinte cadavéreuse, quelle est-elle?
—C'est la loi du Lynch.
—La loi du Lynch!
—Oui, c'est en son nom que nous, qui, comme vous l'avez dit, ne vous connaissons pas, nous avons été réunis afin de vous juger.
—Me juger! Mais cela n'est pas possible. Quel crime ai-je commis? Quel est l'homme qui m'accuse?
—Je ne puis répondre à ces questions; j'ignore le crime dont on vous accuse; je ne sais pas davantage le nom de votre accusateur; seulement, croyez-moi, nous n'avons ni haine ni préventions contre vous; donc, nous serons impartiaux; préparez votre défense pendant le peu d'instants qui vous restent, et lorsque le moment sera arrivé, tâchez de prouver votre innocence en confondant votre accusateur, chose que je vous souhaite ardemment.
Don Stefano laissa tomber sa tête dans ses mains avec une expression de désespoir.
—Mais comment voulez-vous que je prépare ma défense, puisque j'ignore quels sont les faits que l'on m'impute? Éclairez-moi dans ces ténèbres, faites luire à mes yeux une lueur, si faible qu'elle soit, afin que je puisse me guider, savoir où je vais enfin.
—En parlant ainsi que je l'ai fait, caballero, j'ai obéi à ma conscience qui m'ordonnait de vous avertir du danger qui vous menace; vous en dire davantage me serait impossible, puisque, ainsi que vous, j'ignore tout complètement.
—Oh! C'est à en devenir fou! s'écria don Stefano.
Sur un geste de Bon-Affût, Ruperto et l'Aigle-Volant se levèrent; le chasseur fit signe a l'Églantine de les imiter; tous quatre se retirèrent et don Stefano demeura seul.
Le Mexicain se laissa aller sur le sol avec cette fureur insensée de l'homme fort devant lequel se dresse tout à coup un obstacle infranchissable, et qui, acculé dans une position désespérée, est contraint de s'avouer vaincu. En proie à la plus profonde anxiété, ne sachant de quel côté se tourner pour conjurer la tempête qui grondait sur sa tête, il cherchait vainement dans son esprit les moyens d'échapper aux mains qui le tenaient. Son génie inventif, si fécond en ruses de toutes sortes, ne lui fournissait aucun faux-fuyant, aucun stratagème qui put l'aider à soutenir avantageusement cette lutte suprême contre l'inconnu; en vain il se creusait la tête, il ne trouvait rien.
Tout à coup il se releva, et par un mouvement prompt comme la pensée, il porta la main à sa poitrine.
—Ah! s'écria-t-il avec découragement en laissant retomber le bras le long de son corps, qu'est donc devenu mon portefeuille?
Il chercha avidement autour de lui, mais il ne trouva rien.
—Je suis perdu, ajouta-t-il, si ces hommes s'en sont emparé; que faire, que devenir?
Un bruit de chevaux se fit entendre au loin, se rapprochant de plus en plus de l'endroit où campaient les chasseurs.
Bientôt le bruit devint plus distinct et il fut facile de reconnaître la marche d'une nombreuse troupe de cavaliers. En effet, au bout d'un quart d'heure, une trentaine de chasseurs, conduits par Balle-Franche, entrèrent dans la clairière.
—Balle-Franche parmi ces bandits, murmura don Stefano, qu'est-ce que cela veut dire?
Son incertitude ne fut pas de longue durée; les arrivants conduisaient au milieu d'eux un homme, cet homme, don Stefano le reconnu immédiatement.
—Don Miguel Ortega! Oh! Oh! Puis il ajouta au bout d'un instant, avec un de ces sourires narquois dont il avait l'habitude, je connais mon accusateur maintenant. Allons, allons, fit-il à part lui, la position n'est pas aussi désespérée que je le supposais; ces hommes, il est évident qu'ils ne savent rien, et que mes précieux papiers ne sont pas tombés entre leurs mains. Hum! Je crois que cette terrible loi du Lynch aura tort cette fois, et que j'échapperai à ce péril comme j'ai échappé à tant d'autres.
Don Miguel avait passé sans voir don Stefano, ou peut-être, ce qui est plus probable, sans paraître l'apercevoir. Quant à don Stefano, intéressé à se renseigner et à ne pas laisser échapper le moindre détail de ce qui se passait autour de lui, il suivait d'un œil attentif, bien qu'en affectant le maintien le plus indifférent, tous les mouvements des chasseurs. Après avoir doucement déposé la civière à l'extrémité opposée du lieu où don Stefano était étendu, les gambucinos, sans quitter leurs chevaux, formèrent un grand cercle autour de la clairière et demeurèrent immobiles la carabine sur la cuisse, rendant par cette manœuvre toute tentative de fuite impossible.
Des crânes de bisons destines à servir de sièges furent disposés en demi-cercle devant un feu de branches sèches. Sur ces crânes, au nombre de cinq, cinq hommes prirent place immédiatement. Ces cinq hommes se rangèrent dans l'ordre suivant: don Miguel Ortega, remplissant les fonctions de président, au centre, ayant à sa droite Bon-Affût et à sa gauche Balle-Franche, puis le chef indien et un gambucino.
Ce tribunal en plein air, au milieu de cette forêt vierge, entouré de ces cavaliers aux costumes étranges, immobiles comme des statues de bronze florentin, offrait un aspect imposant et saisissant à la fois; ces cinq hommes, au front sévère, aux sourcils froncés, calmes et impassibles, ressemblaient à s'y méprendre, à cette sainte véhémence qui, dans les anciens jours, sur les bords du Rhin, s'était substituée à la justice légale impuissante à réprimer les crimes, et rendait ses arrêts en plein air, au grondement sourd des vents et aux murmures mystérieux des grandes eaux.
Malgré lui, don Stefano sentit un frémissement de terreur parcourir son corps, en jetant un coup d'œil circulaire sur la clairière et en apercevant tous ces regards fatalement dirigés sur lui avec cette implacable fixité de la force et du droit du désert.
—Hum! murmura-t-il à part lui, je crois que j'aurai peine à m'en tirer, et que je me suis trop hâté de chanter victoire.
En ce moment, deux chasseurs, sur un signe de don Miguel, quittèrent leur rang, mirent pied à terre et s'approchèrent du blessé. Celui-ci fit un effort sur lui-même et parvint à se mettre debout; les chasseurs le prirent par-dessous les bras et le conduisirent en présence du tribunal.
Don Stefano se redressa, croisa les bras sur la poitrine, et, jetant un regard sardonique aux hommes devant lesquels on l'avait amené:
—Oh! Oh! dit-il avec un accent railleur en s'adressant à don Miguel, c'est donc vous, caballero, qui êtes mon accusateur?
Le capitaine haussa imperceptiblement les épaules.
—Non, répondit-il, je ne suis pas votre accusateur, je suis votre juge.
Après ces paroles, il y eut un moment d'attente, presque d'hésitation. Un silence de plomb semblait planer sur la forêt.
Don Stefano le premier surmonta l'impression de terreur qui, malgré lui, se glissait dans son âme.
—Eh bien, dit-il avec un regard méprisant et une voix claire et incisive, puisque ce n'est pas vous, où donc est-il, cet accusateur? Se cacherait-il, à présent que l'heure est arrivée? Reculerait-il devant la responsabilité qu'il a assumée? Qu'il paraisse, je l'attends.
Don Miguel secoua la tête.
—Peut-être lorsqu'il paraîtra, trouverez-vous qu'il est venu trop tôt, répondit-il.
—Que voulez-vous de moi, alors?
—Vous allez l'apprendre.
Don Miguel était pâle et sombre; un sourire triste errait sur ses lèvres blêmies; on voyait qu'il faisait des efforts inouïs pour surmonter sa faiblesse et se tenir ferme sur son siège.
Après quelques minutes de réflexion, il releva la tête.
—Comment vous nommez-vous? demanda-t-il.
—Don Stefano Cohecho, répondit l'accusé sans hésiter.
Les juges échangèrent un regard.
—Où êtes-vous né?
—A Mazatlán, en 1808.
—Quelle est votre profession?
—Négociant à Santa Fe.
—Quel motif vous a conduit dans le désert?
—Je vous l'ai dit déjà à vous même.
—Répétez-le, reprit don Miguel toujours impassible.
—Je vous ferai observer que ces questions oiseuses Et fort inutiles pour vous me fatiguent.
—Je vous demande quel motif vous a conduit dans le désert?
—La faillite de plusieurs de mes correspondants m'a obligé de faire un voyage afin d'essayer de sauver quelques bribes de ma fortune compromise; je suis dans le désert, parce que pour me rendre où je vais il n'y a pas d'autre route.
—Où allez-vous?
—A Monterey, vous voyez la docilité que je mets à répondre à toutes vos questions, fit-il de ce même ton goguenard qu'il employait depuis qu'il avait été amené devant ses juges.
—Oui, reprit lentement et en appuyant sur chaque mot don Miguel, vous faites preuve d'une grande docilité; je voudrais, pour vous, que vous fussiez aussi sincère.
—Qu'entendez-vous par ces paroles? reprit don Stefano d'un ton hautain.
—J'entends qu'à chacune de mes questions vous avez répondu par un mensonge, dit nettement et sèchement don Miguel.
Don Stefano fronça le sourcil, son œil fauve lança un éclair fulgurant.
—Caballero! s'écria-t-il, une telle insulte...
—Ce n'est pas une insulte, continua l'aventurier toujours impassible, c'est la vérité, et vous le savez aussi bien que moi.
—Je serais curieux de savoir ce que cela signifie, essaya de dire le Mexicain.
Don Miguel le regarda fixement.
Malgré lui, don Stefano baissa les yeux.
—Je vais vous satisfaire, dit l'aventurier.
—J'écoute.
—A ma première question, vous avez répondu que votre nom était don Stefano Cohecho?
—Eh bien?
—C'est faux, vous vous nommez don Estevan de Real del Monte.
Un frémissement imperceptible agita le corps de l'accusé.
Don Miguel continua:
—A ma deuxième question, vous avez répondu que vous étiez né à Mazatlán en 1808; c'est faux, vous êtes né à Guanajuato en 1805.
L'aventurier attendit un moment pour donner à celui qu'il interpellait ainsi le temps de répondre; don Estevan, auquel nous conserverons désormais son nom véritable, ne jugea pas convenable de le faire; il demeura froid et sombre.
Don Miguel sourit avec mépris et ajouta:
—A ma troisième question, vous m'avez répondu que vous exerciez la profession de négociant et que vous étiez établi à Santa Fe; c'est faux encore; jamais vous n'avez été commerçant; vous êtes sénateur, et vous résidez à Mexico; enfin vous m'avez dit que vous ne faisiez que traverser le désert pour vous rendre à Monterey où vous appellent les intérêts de votre commerce supposé; quant à cette dernière allégation, je n'ai pas besoin, je crois, de vous en démontrer la fausseté, elle ressort de l'ensemble même de vos autres réponses; maintenant j'attends votre réponse, si vous en avez une à me faire, ce dont je doute.
Don Estevan avait eu le temps de se remettre du rude coup qu'il avait reçu; aussi il ne se troubla pas croyant deviner d'où partait l'attaque et par quels moyens ceux devant lesquels il se trouvait étaient parvenus à obtenir les renseignements qu'ils possédaient sur lui; il répondit d'un ton moqueur en pinçant ses lèvres d'un air narquois:
—Pourquoi donc supposez-vous que je ne puis vous répondre, caballero? Rien ne m'est plus facile, au contraire, cáspita! Parce que, pendant mon évanouissement, vous avez, dirai-je volé? Non, je suis poli, je dirai donc enlevé adroitement mon portefeuille, qu'après l'avoir ouvert vous y avez trouvé certains renseignements, vous me les jetez à la face, convaincu que je resterai atterré en vous trouvant si au fait de mes affaires! Allons donc! Vous êtes fou, sur mon âme; toutes ces choses ne sont que des niaiseries qui ne supportent pas l'analyse. Oui, c'est vrai, je me nomme don Estevan; je suis né à Guanajuato en 1805, et je suis sénateur; après? Voilà-t-il pas de puissants motifs pour baser une accusation contre un caballero! ¡Cuerpo de Cristo! Suis-je donc le seul qui, dans le désert, porte un autre nom que le sien? De quel droit, vous tous, qui ne vous désignez entre vous que par des surnoms, prétendriez-vous m'obliger à ne pas suivre votre exemple?
Tout cela est le comble du ridicule, et si vous n'avez pas de meilleurs raisons à m'opposer, je vous engage à me laisser tranquillement vaquer à mes affaires.
—Nous en avons d'autres, répondit don Miguel d'un ton glacial.
—Je les connais, ¡vive Cristo! Vos raisons; vous m'accusez, n'est-ce pas, de vous avoir à vous, don Miguel, qui vous nommez aussi don Toribio et que parfois on appelle don José, vous m'accusez, dis-je, de vous avoir fait tomber dans un guet-apens, dont vous ne vous êtes sauvé que par miracle; mais ceci est une affaire entre vous et moi, dont Dieu seul doit être juge.
—Ne mettez pas le nom de Dieu en avant, il n'a rien à voir dans cette affaire; je vous ai dit déjà que je n'étais pas votre accusateur, mais votre juge.
—Fort bien; rendez-moi mon portefeuille et restons-en là, croyez-moi; car dans tout cela je ne vois pas trop l'avantage qu'il y aura pour vous, à moins que vous ayez résolu de m'assassiner, ce qui serait fort possible, auquel cas à votre aise; je n'ai pas la prétention de lutter contre les trente ou quarante bandits qui m'entourent. Ainsi tuez-moi, si bon vous semble, mais terminez-en.
Don Estevan prononça ces paroles d'un ton de souverain mépris dont ses juges, en hommes dont le parti est pris d'avance, ne parurent pas s'apercevoir.
—Nous ne vous avons pas volé votre portefeuille, répondit don Miguel, nul de nous ne l'a vu, encore moins ouvert; nous ne sommes pas des bandits et nous n'avons aucunement l'intention de vous assassiner. Nous sommes convoqués pour vous juger d'après les règles de la loi du Lynch, et nous nous acquittons de ce devoir avec toute l'impartialité dont nous sommes capables.
—Mais alors, puisqu'il en est ainsi, que celui qui m'accuse paraisse, je le confondrai. Pourquoi s'obstine-t-il à se cacher? La justice doit se rendre à la face de tous. Qu'il vienne, cet homme qui prétend faire peser sur moi la responsabilité de crimes que j'ignore; qu'il vienne, et je lui prouverai qu'il n'est qu'un vil calomniateur.
A peine don Estevan prononçait-il ces paroles que les branches d'un buisson voisin s'écartèrent, et un homme parut; il s'avança à grand pas vers le Mexicain, et lui posant résolument la main sur l'épaule:
—Prouvez-moi donc que je ne suis qu'un vil calomniateur, don Estevan, dit-il d'une voix basse et concentrée en plongeant son regard dans le sien avec une expression de haine implacable.
—Oh! s'écria don Estevan, mon frère! Et chancelant comme un homme ivre, il recula de quelques pas, le visage couvert d'une pâleur mortelle, et les yeux injectés de sang et démesurément ouverts.
Don Mariano le maintint d'un bras ferme pour l'empêcher de rouler sur le sol, et approchant presqu'à le toucher son visage du sien:
—C'est moi qui t'accuse, Estevan, dit-il. Maudit qu'as-tu fait de ma fille?
L'autre ne répondit pas: don Mariano le considéra un instant avec une expression impossible à rendre et le repoussa dédaigneusement par un geste de souverain mépris. Le misérable trébucha, étendit les bras, cherchant instinctivement à se retenir; mais les forces lui manquèrent; il tomba sur ses genoux en cachant son visage dans ses mains avec une expression de désespoir et de rage trompée dont nul pinceau ne saurait exprimer la hideur.
Les assistants étaient demeurés calmes et impassibles, ils n'avaient pas prononcé un mot, pas fait un geste; seulement une terreur secrète s'était emparée d'eux, et ils échangeaient des regards qui, si l'accusé avait pu les apercevoir, lui auraient révélé le sort que dans leur pensée ils lui réservaient.
Don Mariano ordonna d'un geste à ses deux domestiques de le suivre, et l'un à sa droite l'autre à sa gauche, il se plaça au centre de la clairière, en face du tribunal improvisé, et prit la parole d'une voix forte, claire et accentuée.
—Écoutez-moi, caballeros, et lorsque j'aurai dit tout ce que j'ai à vous dire sur cet homme que vous voyez la brisé et confondu, avant même que j'aie prononcé un mot, vous le jugerez sans haine et sans colère avec votre conscience. Cet homme est mon frère: jeune, pour une cause qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ici, notre père voulut le chasser de sa présence; j'intercédai pour lui et j'obtins, sinon sa grâce tout entière, du moins qu'il fût toléré sous le toit paternel. Les jours se passèrent minute à minute, les années s'écoulèrent, l'enfant devint homme; mon père en mourant m'avait donné toute sa fortune au préjudice de son autre fils qu'il avait maudit; je déchirai le testament, j'appelai cet homme auprès de moi, et je lui restituai, à lui mendiant et misérable, cette part de richesse et de bien-être dont, à mon avis, mon père n'avait peut-être pas eu le droit de le priver.
Don Mariano se tut et se tourna vers ses domestiques.
Les deux hommes étendirent en même temps le bras droit, se découvrirent de la main gauche, et tous deux en même temps, comme s'ils répondaient à la muette interrogation de leur maître:
—Nous affirmons que tout cela est strictement vrai, dirent-ils.
—Ainsi cet homme me devait tout, fortune, position, avenir; car, grâce à mon influence, j'étais parvenu à le faire élire sénateur. Voyons maintenant comment il m'a récompensé de tant de bienfaits et quelle a été sa reconnaissance. Il avait réussi à me faire oublier ce que je considérais comme des erreurs de jeunesse et à me persuader qu'il était entièrement revenu au bien; sa conduite était en apparence irréprochable: dans différentes circonstances il avait même affecté un rigorisme de principes dont j'avais été obligé de le reprendre, enfin il était parvenu à faire de moi sa dupe, s'appliquant avec une profondeur de scélératesse qui passe toute expression à épaissir le bandeau qu'il avait étendu sur mes yeux. Marié et père de deux enfants, il les élevait avec une sévérité qui, pour moi, était la preuve de sa conversion, et il avait soin de me répéter souvent: « Je ne veux pas que mes enfants deviennent ce que j'ai été. » A la suite d'un de ces innombrables pronunciamientos qui minent et démembrent notre beau pays, rendu, je ne sais par quelle machination ténébreuse, suspect au nouveau gouvernement, je fus obligé de prendre du jour au lendemain la fuite pour sauver ma vie menacée; je ne savais à qui confier ma femme et ma fille, qui, malgré leur désir, ne pouvaient me suivre; mon frère s'offrit à veiller sur elles; un secret pressentiment, une voix du ciel que j'eus le tort de mépriser me soufflait au fond du cœur de ne pas avoir foi en cet homme et de ne pas accepter sa proposition. Le temps pressait, il fallait partir: les soldats envoyés pour m'arrêter frappaient à coups redoublés à la porte de mon hôtel; je confiai ce que j'avais de plus cher au monde à mon frère, à ce lâche que voyez là, et je m'enfuis. Pendant deux ans que dura mon absence, j'écrivis lettre sur lettre à mon frère sans jamais recevoir de réponse, j'étais en proie à une inquiétude mortelle; enfin j'allais, en désespoir de cause, me résoudre à rentrer au Mexique, au risque d'être pris et fusillé, lorsque, grâce à certains amis qui faisaient des démarches incessantes en ma faveur, je fus rayé de la liste de proscription, et il me fut permis de rentrer dans ma patrie. Deux heures à peine après avoir reçu cette nouvelle je partis; j'arrivais à la Veracruz quatre jours plus tard; sans prendre le temps de me reposer, je m'élançai sur un cheval, et tout d'une traite, ne quittant ma monture fatiguée que pour sauter sur une autre, je franchis les quatre-vingt-dix lieues qui séparent la Veracruz de la capitale; j'allai descendre tout droit chez mon frère. Il était absent, mais une lettre de lui m'annonçait que, contraint par une affaire urgente de se rendre à la Nouvelle-Orléans, il serait de retour au bout d'un mois et me priait de l'attendre; mais de ma femme et de ma fille, rien; des intérêts de fortune que je lui avais confiés, pas un mot; mon inquiétude se changea en terreur, j'eus le pressentiment d'un malheur: sortant à moitié fou de la maison de mon frère, je remontai sur le cheval ruisselant de sueur et à demi fourbu qui m'avait amené, et qui était demeuré à la porte sans que personne songeât à s'occuper de lui, et je me dirigeai, aussi vite qu'il me fut possible, vers mon hôtel: fenêtres et portes étaient fermées; cette maison que j'avais quittée si riante et si animée, était silencieuse et morne comme un tombeau. Je restai un instant sans oser heurter à la porte; enfin, je m'y décidai, préférant la réalité, toute terrible qu'elle pouvait être, à cette incertitude qui me rendait fou.
A cet endroit de sa narration, don Mariano s'arrêta, la voix brisée par l'émotion intérieure qu'il éprouvait et qu'il lui était impossible de dompter plus longtemps.
Il y eut un silence.
Don Estevan n'avait pas changé de position depuis le commencement de la narration faite par son frère, il paraissait plongé dans une profonde douleur et terrassé par les remords.
Au bout d'un instant, Bermudez, voyant que son maître était incapable de continuer son récit, prit à son tour la parole:
—Ce fut moi qui ouvris la porte; Dieu m'est témoin que j'aime mon maître, que pour lui, sans hésiter, je sacrifierais ma vie avec joie. Hélas! J'étais destiné à lui causer la plus grande douleur qu'il soit possible à un homme de souffrir: contraint de répondre aux questions dont il me pressait, je lui appris la mort de sa femme et celle de sa fille, toutes deux mortes à quelques semaines l'une de l'autre, au couvent des bénédictines. Le coup fut terrible: don Mariano tomba comme foudroyé. Un soir que, selon sa coutume depuis son retour, don Mariano, seul dans sa chambre à coucher, la tête dans ses mains, s'abîmait dans de tristes réflexions en contemplant avec des yeux pleins de larmes le portrait de ces êtres si chers qu'il ne devait jamais revoir, un homme embossé dans un large manteau, le sombrero rabattu sur les yeux, demanda à parler au seigneur de Real del Monte; sur mes observations que sa seigneurie ne recevait personne, cet homme insista avec une ténacité étrange, disant qu'il avait à remettre à mon maître une lettre dont le contenu était de la plus haute importance; je ne sais comment cela se fit, mais l'accent de cet homme me parut si sincère que, malgré moi, j'enfreignis les ordres positifs que j'avais reçus et je l'introduisis auprès de don Mariano.
Le gentilhomme releva alors la tête, et, appuyant la main sur le bras de son vieux domestique:
—Maintenant, laissez-moi continuer, Bermudez, dit-il; du reste, ce que j'ai à ajouter est peu de chose.
Se tournant alors vers les chasseurs toujours impassibles et froids en apparence, il reprit:
—Lorsque cet homme fut devant moi: seigneurie, me dit-il sans préambule, vous pleurez deux personnes qui vous étaient bien chères et dont le sort vous est inconnu.
—Elles sont mortes, répondis-je.
—Peut-être! fit-il. Que donneriez-vous à celui qui vous apporterait, je ne dis pas une bonne nouvelle, mais un peu d'espoir?
—Sans répondre, je me levai, et allant à un meuble où je serrais mon or et mes bijoux:
—Tendez votre chapeau, lui dis-je. En un instant, ce chapeau fut plein d'or et de diamants; l'inconnu fit disparaître le tout, et s'inclinant vers moi:
—Je me nomme Pepito, me dit-il; je fais un peu tous les métiers; un homme qu'il est inutile de vous nommer m'a confié ce chiffon de papier, avec injonction de vous le remettre aussitôt votre arrivée à Mexico. Je n'ai su que ce matin votre retour; je viens ce soir accomplir l'ordre que j'avais reçu. Je lui arrachai le papier des mains et je le lus pendant que ce Pepito se confondait en remercîments que je n'écoutais pas, et se retirait. Voilà ce que contenait ce papier.
Don Miguel étendit le bras vers don Mariano.
—« Un ami de la famille de Real del Monte, dit-il d'une voix vibrante, avertit don Mariano qu'il a été indignement trompé par l'homme dans lequel il avait mis toute sa confiance et qui lui devait tout. Cet homme a empoisonné doña Serafina de Real del Monte: la fille de don Mariano a été enterrée toute vive dans un des in pace du couvent des Bernardines. Si le seigneur Real del Monte désire approfondir l'affreuse machination dont il a été victime, et peut-être revoir une des deux personnes que celui qui l'a trompé croit avoir fait disparaître pour toujours, que le señor don Mariano garde le plus complet silence sur le contenu de ce billet, qu'il feigne toujours la même ignorance, mais qu'il fasse en secret les préparatifs d'un long voyage que nul ne doit soupçonner. Le 5 novembre prochain, au coucher du soleil, un homme se trouvera au Teocali de Quinametzin (le Géant). Cet homme accostera don Mariano en prononçant deux noms: celui de sa femme et celui de sa fille; alors il lui apprendra tout ce qu'il ignore, et peut-être pourra-t-il lui rendre un peu de ce bonheur qu'il a perdu. » Ce billet se terminait là, il n'était pas signé.
—C'est vrai, répondit don Mariano au comble de l'étonnement. Mais comment avez-vous appris ces détails? C'est vous sans doute qui...
—Lorsqu'il en sera temps, je vous répondrai, fit don Miguel d'un ton péremptoire. Continuez.
—Que dirai-je de plus? Je partis pour me rendre au rendez-vous étrange qui m'était assigné, nourrissant au fond de mon cœur je ne sais quel fol espoir. Hélas! L'homme est ainsi fait qu'il se rattache à tout ce qui peut l'aider à douter d'un malheur. Aujourd'hui, Dieu, qui probablement m'a pris en pitié, m'a fait rencontrer cet homme qui est mon frère; sa vue me causa un étonnement que je ne puis exprimer. Comment se trouvait-t-il ici, lui qui m'avait écrit qu'il partait pour la Nouvelle-Orléans? Un vague soupçon, que j'avais toujours repoussé jusque-là me mordit au cœur avec une force telle que je commençai à croire, quoique cela me parût bien horrible, que mon frère était le traître auquel je devais tous mes maux. Cependant je doutais encore, je flottais indécis, lorsque ce portefeuille, perdu par ce misérable et retrouvé par le chef indien, l'Aigle-Volant, déchira tout à coup et fit tomber de mes yeux l'épais bandeau qui les couvrait, en me donnant toutes les preuves des odieuses machinations et des crimes commis par cet infâme, par ce fratricide indigne, dans le but ignoble de me dépouiller de ma fortune afin d'en faire jouir ses enfants. Voilà ce portefeuille, parcourez les papiers qu'il renferme, et décidez entre ce frère indigne et moi.
En disant cela, don Mariano tendit le portefeuille à don Miguel. Celui-ci le repoussa doucement.
—Ces preuves sont inutiles pour nous, don Mariano, dit-il, nous en possédons de plus péremptoires encore.
—Que voulez-vous dire?
—Vous allez me comprendre.
Et don Miguel se leva.
Sans bien s'expliquer pour quelle raison il en était ainsi, don Estevan sentit un frisson parcourir tout son corps, devinant par une espèce d'intuition que l'accusation de son frère n'avait rien d'aussi terrible que les faits que don Miguel se préparait à révéler; il releva un peu la tête, pencha le corps en avant, et la poitrine haletante, les narines dilatées, fasciné pour ainsi dire par le chef des aventuriers, il attendit, en proie à une anxiété toujours croissante, qu'il plût à don Miguel de parler.
Le soleil avait disparu à l'horizon, l'ombre avait remplacé la lumière, les ténèbres, tombant du ciel, avaient couvert la forêt d'un impénétrable linceul de brune; les gambucinos s'armant de branches d'ocote les allumèrent, et alors la clairière où se passaient les faits que nous rapportons se trouva fantastiquement éclairée de torches aux reflets sanglants, dont la lueur tourmentée se jouait sur les arbres et les individus réunis sous leurs larges ramures, et imprimait à tout un cachet étrange et sinistre.
Don Miguel, après avoir jeté autour de lui un regard pour solliciter l'attention, prit enfin la parole:
—Puisque vous avez trouvé ce portefeuille, dit-il, je n'ai plus rien à vous apprendre. C'est en effet votre frère qui a commis les crimes affreux que vous lui reprochez; heureusement son but n'a pu être complètement atteint; votre femme est morte, il est vrai, don Mariano, mais votre fille vit encore; elle est en sûreté, c'est moi qui ai été assez heureux pour l'arracher à ses bourreaux et l'enlever de l'in pace horrible dans lequel ils l'avaient enfouie toute vivante; votre fille, je vous la rendrai, don Mariano, je vous la rendrai pure et immaculée comme je l'ai prise dans son tombeau.
Don Mariano, si ferme dans la douleur, fut sans force pour la joie; la commotion qu'il reçut fut tellement violente, qu'il roula sans connaissance sur le sol en joignant par un dernier effort les mains avec ferveur pour remercier le ciel de lui donner tant de joie, après l'avoir accablé de tant de souffrances. Les domestiques du gentilhomme, assistés par plusieurs gambucinos, s'empressèrent autour de lui et lui prodiguèrent tous les soins que réclamait son état.
Don Miguel laissa à l'émotion causée par la chute de don Mariano le temps de se calmer, puis après avoir, d'un geste, réclamé le silence:
—A nous deux, maintenant, don Estevan! dit-il. Furieux de voir une de vos victimes vous échapper, vous n'avez pas craint de la poursuivre jusqu'ici, sachant que c'était moi qui l'avais sauvée; vous m'avez dressé une embuscade, dans laquelle vous espériez me faire périr: l'heure est venue de régler nos comptes.
En reconnaissant qu'il n'avait plus son frère pour adversaire, don Estevan avait repris toute son audace et toute sa forfanterie. A cette interpellation, il s'était froidement redressé, et fixant sur le jeune homme un regard railleur:
—Oh! Oh! dit-il avec ironie, monsieur l'homme de bien, vous ne seriez pas fâché de m'assassiner, n'est-ce pas? Pour me faire taire. Croyez-vous donc que je suis la dupe des beaux sentiments que vous étalez complaisamment? Oui, vous avez sauvé ma nièce, c'est vrai, et je vous en remercierais si je ne vous connaissais pas aussi bien.
A ces singulières paroles, les assistants firent un mouvement de surprise qui n'échappa pas à don Estevan: satisfait de l'effet qu'il croyait avoir produit, il continua:
Le misérable avait jugé la question du premier coup d'œil: ne pouvant pas complètement s'innocenter, il résolut de tourner la difficulté, ce qu'il comptait faire d'autant plus facilement que le seul qui aurait pu le démentir était incapable de l'entendre, et par conséquent de lui imposer silence, en rétablissant les faits sous leur véritable jour. Prenant alors une physionomie placide:
—Mon Dieu, dit-il avec bonhommie, nul de nous n'est infaillible; qui ne se trompe pas au moins une fois dans sa vie? Loin de moi la pensée de chercher à amoindrir ce que l'action qu'on me reproche a d'odieux; oui, j'ai menti à la foi jurée; j'ai trompé mon frère, l'homme auquel je devais tout. Vous voyez, caballeros, que je fais bon marché de moi-même et que je n'essaie nullement de me disculper; mais, de cette faute à commettre un crime, il y a un abîme, et, grâce à Dieu, le reproche d'assassinat ne peut m'être fait, et je renvoie à qui de droit la responsabilité de cet acte inqualifiable.
—Mais à qui donc alors? lui demanda don Miguel, étonné malgré lui et effrayé de l'astuce de cet homme.
—Eh! Mon Dieu, reprit-il avec un aplomb imperturbable, j'en rendrai responsables les gens trop zélés, qui toujours comprennent beaucoup plus qu'ils ne devraient comprendre, et qui, soit par convoitise, soit pour tout autre motif, vont toujours plus loin qu'il ne le faudrait; certes, je l'avoue, je désirais m'emparer de la fortune de mon frère, mais je prétendais en devenir maître par les voies légales.
Les gambucinos, tous hommes de sac et de corde, doués d'une conscience extraordinairement élastique, qui, naturellement, les rendait fort peu scrupuleux en fait d'actions plus ou moins répréhensibles, étaient cependant épouvantés d'entendre une semblable théorie: ils se demandaient tout bas, avec cette naïve crédulité d'hommes à demi sauvages, si l'individu qu'ils avaient devant eux et qui parlait ainsi était réellement leur semblable, ou si plutôt l'esprit du mal n'avait pas pris cette enveloppe pour les tromper.
—Comprenez-moi bien, caballero, reprit don Estevan dont la voix se raffermissait de plus en plus: la supérieure des bénédictines est ma parente, cette femme a pour moi une affection sans bornes; lorsque je lui eus laissé entrevoir mes projets de fortune, elle m'engagea à y persévérer, m'assurant qu'elle connaissait un moyen infaillible de faire réussir ces projets; je crus d'autant plus facilement à ses paroles, que pour moi ce moyen était des plus faciles et consistait simplement à obliger ma nièce à prendre le voile et à se faire religieuse; je ne voyais pas plus loin, je vous le jure. Pauvre chère fille, je l'aimais trop pour désirer sa mort! Tout marcha au gré de mes désirs, sans que je me mêlasse de rien absolument; ma belle-sœur mourut; cette mort me parut toute naturelle, après les chagrins sans nombre qui l'avaient accablée. On m'accuse de l'avoir empoisonnée, c'est faux; peut-être l'a-t-elle été, je ne soutiendrais pas le contraire; mais, dans ce cas il faudrait accuser de ce crime ma parente, dont le but était évidemment de rapprocher de moi cette fortune que je convoitais. J'écrivis aussitôt à mon frère pour lui annoncer cette mort qui me peina réellement; il ne reçut pas ma lettre; je ne vois rien d'étonnant à cela, d'autant plus qu'il ne faisait pour ainsi dire que passer dans les villes où le menait son caprice. Souvent j'allais au couvent des bénédictines visiter ma nièce; elle me paraissait assez décidée à prendre le voile; la supérieure, de son côté, me répétait sans cesse de ne m'inquiéter de rien: je laissais donc aller les choses sans m'en occuper. Le jour où ma nièce devait prononcer ses vœux, j'allai au couvent: alors il se passa quelque chose d'inusité et de scandaleux; au moment de faire profession, la jeune fille se ravisa et refusa net d'entrer en religion; je me retirai, désespéré de ce contre-temps. Le soir, une religieuse se présenta à mon hôtel et m'annonça que ma nièce, à la suite d'une scène fort vive avec la supérieure, avait été frappée d'une congestion cérébrale et était morte subitement. Cette nouvelle me causa une douleur inouïe; toute la nuit je marchai dans ma chambre à coucher, déplorant ce nouveau et irréparable malheur qui accablait mon malheureux frère; en y réfléchissant, un soupçon germa dans mon esprit; cette mort me parut extraordinaire; je redoutai un crime. Afin d'éclaircir mes soupçons, au point du jour j'accourus au couvent; là, une nouvelle incroyable m'attendait: la communauté était bouleversée, l'effroi se montrait sur tous les visages; pendant la nuit, une troupe d'hommes armés s'était introduite dans le couvent; ma nièce avait été enlevée de son tombeau et emportée par ces hommes qui, en même temps, avaient emmené une jeune novice. Alors, convaincu que je ne m'étais pas trompé, qu'un crime avait été commis, je m'enfermai avec la supérieure dans sa cellule, et, à forces de menaces et de prières, je parvins à lui arracher la vérité; mon horreur fut au comble en apprenant que mon infortunée nièce avait effectivement été enterrée toute vive. Une chose me restait à faire, un devoir à remplir; découvrir ses traces, la retrouver afin de la ramener dans les bras de son père; je n'hésitai pas: deux jours plus tard, j'étais parti. Voilà la vérité tout entière; ma conduite a été répréhensible, coupable même; mais, je le jure, elle n'a pas été criminelle.
Les assistants avaient écouté cette justification hasardée avec un silence glacial; lorsque don Estevan se tut, pas un geste, pas un signe approbateur ne vint lui donner l'espoir d'avoir convaincu son auditoire.
—En supposant, ce que je n'admets pas, car il existe trop de preuves du contraire, que ce que vous dites soit la vérité, répliqua don Miguel, pour quelle raison avez-vous donc voulu m'assassiner, moi qui ai sauvé celle dont vous déploriez le malheur et que vous vouliez ramener dans les bras de son père?
—Ne le comprenez-vous donc pas? s'écria don Estevan avec un feint étonnement, faut-il donc tout vous dire?
—Oui, tout, répondit sèchement le jeune homme.
—Eh bien! Oui, j'ai voulu vous assassiner, parce que, au presidio de Tubac, on m'avait assuré que vous n'aviez enlevé ma nièce que dans le but de la déshonorer; je voulais venger sur vous l'outrage que je croyais que vous lui aviez fait.
Don Miguel pâlit à cette insulte.
—Infâme! s'écria-t-il d'une voix tonnante; osez-vous proférer une aussi odieuse calomnie!
Les assistants s'étaient récriés avec horreur aux paroles de don Estevan qui, malgré son audace, se sentant vaincu, fut contraint de baisser la tête sous le poids de la réprobation générale.
Bon-Affût se leva alors.
—Caballeros, dit-il, vous avez entendu l'accusation portée contre cet homme par son frère. Pendant tout le temps qu'a duré cette accusation, vous avez remarqué sa contenance; maintenant vous venez d'entendre sa défense; nous l'avons laissé libre de tout dire, sans l'interrompre et sans chercher à l'intimider; or l'heure de prononcer votre jugement est arrivée; c'est toujours une chose sérieuse que de condamner un homme; cet homme fut-il le dernier des misérables; la loi du Lynch, vous le savez tous comme moi, ne connaît pas de moyens termes: elle tue ou elle absout. Bien que choisis pour juger cet homme nous ne voulons pas encourir seuls la responsabilité de cet acte; réfléchissez donc sérieusement avant de répondre aux questions que je vous adresserai, et surtout souvenez-vous que de vos réponses dépendent la vie ou la mort de ce malheureux: caballeros, dans votre âme et conscience, cet homme est-il coupable?
Il y eut un instant de silence suprême; tous les visages étaient graves, tous les cœurs battaient avec force.
Don Estevan les sourcils froncés, le front pâle, les bras croisés sur la poitrine, mais la contenance ferme, car il était brave, attendait en proie à une anxiété que par la seule force de sa volonté, il parvenait à renfermer en lui-même.
Bon-Affût, après avoir attendu quelques minutes, reprit d'une voix lente et solennelle:
—Caballeros, cet homme est-il coupable?
—Oui, s'écrièrent les assistants d'une seule voix.
Cependant don Mariano, grâce aux soins de ses domestiques, commençait à donner quelques signes de vie, précurseurs de son retour à la connaissance.
Balle-Franche se pencha à l'oreille de Bon-Affût.
—Est-il convenable, lui dit-il a voix basse, que don Mariano assiste à la condamnation de son frère?
—Non certes, répondit vivement le vieux chasseur; d'autant plus que maintenant que le premier moment de colère est passé, il est probable qu'il intercéderait en sa faveur; mais comment faire pour l'éloigner?
—Je m'en charge, je vais le conduire au camp des gambucinos.
—Hâtez-vous.
Balle-Franche se leva et s'approcha de Bermudez avec lequel il échangea quelques mots oreille à oreille; puis les deux domestiques, prenant leur maître dans leurs bras, disparurent avec lui dans les taillis, suivis par le chasseur et par l'Églantine, à laquelle le Canadien avait fait signe de venir. Dans l'état d'agitation et de surexcitation où se trouvaient les gambucinos, nul ne remarqua ce départ, le bruit des pas de plusieurs chevaux qui s'éloignaient ne fut même pas entendu.
Don Estevan seul s'aperçut de cet enlèvement dont il comprit la portée.
—Je suis perdu! murmura-t-il.
Bon-Affût fit un geste, le silence se rétablit comme par enchantement.
—Quelle peine a mérité le coupable? dit-il.
—La mort! répondirent les assistants comme un écho funèbre.
Alors se tournant vers le condamné, le chasseur reprit:
—Don Estevan de Real del Monte, venu au désert dans des intentions criminelles, vous êtes tombé sous le coup de la loi du Lynch; la loi du Lynch est la loi de Dieu: œil pour œil, dent pour dent, elle n'admet qu'une peine, celle du talion. C'est la loi primitive des anciens jours rendue à l'humanité. Vous aviez condamné une malheureuse jeune fille à être enterrée vive et à mourir de faim. Vous allez être enterré vif, pour mourir de faim; seulement, comme vous pourriez longtemps appeler la mort avant qu'elle daignât vous répondre, nous vous donnerons les moyens de faire cesser vos souffrances lorsque le courage vous manquera pour les endurer davantage. Nous sommes plus éléments que vous ne l'avez été vous-même envers votre malheureuse victime, vous ne serez enterré que jusqu'aux aisselles; votre bras gauche sera laissé libre, et à votre portée on placera un pistolet afin que vous puissiez vous faire sauter la cervelle lorsque vous aurez assez souffert. J'ai dit. Cette condamnation est-elle juste? ajouta-t-il en s'adressant aux assistants.
—Oui, dirent-ils d'une voix basse et concentrée, œil pour œil, dent pour dent.
Don Estevan avait écouté avec épouvante les paroles du vieux chasseur: l'horrible supplice auquel il était condamné le frappa de stupeur; car bien qu'il s'attendit à recevoir la mort, celle-là lui semblait tellement épouvantable que dans le premier moment il ne put y croire; pourtant lorsqu'il vit sur un signe de Bon-Affût deux gambucinos se mettre en devoir de creuser une fosse, ses cheveux se hérissèrent de terreur sur sa tête, une sueur froide perla à ses tempes, et d'une voix étranglée il s'écria en joignant les mains:
—Oh! Pas cette mort atroce, je vous en supplie, tuez-moi de suite.
—Vous êtes condamné, il vous faut subir votre peine telle qu'elle est prononcée, répondit froidement le vieux chasseur.
—Oh! Donnez-moi ce pistolet que vous m'avez promis, pour que je me brûle la cervelle à l'instant; vous serez vengés.
—Nous ne nous vengeons pas; ce pistolet vous sera remis lorsque nous partirons.
—Oh! Vous êtes implacables, s'écria-il en se laissant tomber sur le sol, où il se roula avec une rage impuissante.
—Nous sommes justes, dit encore Bon-Affût.
Don Estevan, arrivé au paroxysme de la fureur, se releva subitement, et, bondissant comme un jaguar, il se précipita tête baissée contre un arbre dans l'intention de se briser le crâne. Mais les gambucinos surveillaient trop attentivement ses mouvements pour lui laisser accomplir cette résolution désespérée; ils s'emparèrent de lui, et malgré sa résistance acharnée et ses cris de bête fauve, ils le garrottèrent et le mirent dans l'impossibilité de faire un mouvement.
Alors sa colère se changea en désespoir.
—Oh! s'écria-t-il, si mon frère était là, il me sauverait! Mon Dieu! Mon Dieu! Mariano! A moi, à moi!
Bon-Affût s'approcha de lui.
—Vous allez être descendu dans la fosse, lui dit-il; avez-vous quelque disposition à prendre?
—C'est donc vrai cet horrible supplice! dit-il avec égarement.
—C'est vrai.
—Mais alors vous êtes des bêtes féroces.
—Nous sommes vos juges.
—Oh! Laissez-moi vivre, ne serait-ce qu'un jour.
—Vous êtes condamné.
—Malédiction sur vous, démons à face humaine! Assassins! De quel droit me tuez-vous?
—Du droit qu'a tout homme d'écraser un serpent; pour la dernière fois, avez-vous des dispositions à prendre?
Don Estevan, brisé par cette effroyable lutte, garda un instant le silence: puis deux larmes tombèrent lentement de ses yeux brûlés de fièvre, et il murmura d'une voix douce, presque enfantine:
—Oh! Mes fils, mes pauvres chéris, que deviendrez-vous lorsque je ne serai plus là!
—Finissons-en, reprit le chasseur.
Don Estevan fixa sur lui son œil hagard.
—J'ai deux fils, dit-il, parlant comme dans un rêve; ils n'ont que moi, moi seul, hélas, et je vais mourir! Écoutez, si vous n'êtes pas tout à fait une bête fauve, jurez-moi d'accomplir ce que je vais vous demander?
Le chasseur se sentit malgré lui ému par cette douleur poignante.
—Je vous le jure, dit-il.
Le condamné parut rassembler ses idées.
—Du papier et un crayon, fit-il d'une voix brisée.
Bon-Affût avait encore le portefeuille qui lui avait été enlevé; il déchira un feuillet et le lui remit avec le crayon.
Don Estevan sourit amèrement à la vue de son portefeuille; il s'empara du papier et écrivit précipitamment quelques lignes, puis il plia le papier et le rendit au chasseur.
Un changement extraordinaire s'était opéré sur le visage du condamné: ses traits étaient calmes, ses regard doux et suppliants.
—Tenez, dit-il, je compte sur votre parole; prenez cette lettre, elle est pour mon frère; je lui recommande mes enfants, c'est à cause d'eux que je vais mourir. Qu'importe! s'ils sont heureux, j'aurai toujours atteint mon but, c'est tout ce qu'il me faut. Mon frère est bon, il n'abandonnera pas les malheureux orphelins que je lui lègue. Je vous en supplie, remettez-lui ce papier.
—Avant une heure il sera entre ses mains, je vous le jure.
—Merci; maintenant faites de moi ce que vous voudrez, peu m'importe; j'ai assuré le sort de mes enfants, c'est tout ce que je voulais.
La fosse était creusée. Deux gambucinos saisirent don Estevan et le descendirent dedans, sans qu'il essayât une résistance inutile: lorsqu'il fut placé debout dans le trou, le sol arriva juste au niveau de ses aisselles, son bras droit fut attaché le long de son corps, le gauche laissé libre, puis on entassa la terre autour de ce vivant, qui déjà n'était plus qu'un cadavre.
Lorsque la fosse fut comblée, un gambucino prit une écharpe et s'approcha du condamné.
—Que prétendez-vous faire? demanda-t-il avec terreur, bien qu'il devinât l'intention de cet homme.
—Vous bâillonner, répondit brutalement le gambucino.
—Oh! fit-il.
Il se laissa bâillonner, sans avoir la conscience de ce qu'on lui faisait; il était brisé.
Bon-Affût plaça alors un pistolet armé sous la main crispée du misérable, et se découvrant:
—Don Estevan, dit-il d'une voix grave et solennelle, les hommes vous ont condamné; priez Dieu afin qu'il vous fasse miséricorde, car vous n'avez plus d'autre espoir que lui, maintenant.
Puis les chasseurs et les gambucinos remontèrent à cheval, éteignirent les torches et disparurent dans les ténèbres comme une légion de noirs fantômes.
Le condamné demeura seul dans les ténèbres que ses remords peuplaient de spectres hideux.
Le cou allongé, les yeux démesurément ouverts, l'oreille au guet, il regardait, il écoutait.
Tant qu'il entendit résonner au loin les pas des chevaux des gambucinos qui s'éloignaient, un fol espoir demeura au fond de son âme, il attendait, il espérait.
Qu'attendait-il? Qu'espérait-il? Lui-même n'aurait pu le dire; mais l'homme est ainsi fait.
Peu à peu, tous les bruits s'éteignirent, et don Estevan se trouva enfin seul, au milieu d'un désert inconnu, sans secours d'aucune espèce à attendre de qui que ce fût.
Alors il poussa un profond soupir, referma la main sur la crosse du pistolet et appuya l'anneau glacé du canon sur sa tempe, en murmurant une dernière fois le nom de ses enfants.
Cependant les gambucinos s'étaient éloignés en proie à ce sentiment de malaise indéfinissable qui, malgré lui, serre le cœur de l'homme lorsqu'il vient d'accomplir un acte dont tout en reconnaissant la nécessité et même la stricte justice, il sait qu'il n'avait peut-être pas le droit de prendre l'initiative.
Nul ne parlait, tous les fronts étaient inclinés; ils venaient sombres et pensifs aux côtés les uns des autres, n'osant pas se communiquer leurs pensées et prêtant malgré eux l'oreille aux bruits mystérieux de la solitude.
Ils atteignaient à peine les dernières limites du couvert de la forêt: devant eux comme un long ruban d'argent les eaux du Rubio miroitaient aux rayons blafards de la lune; ils allaient arriver au gué, lorsque tout à coup le bruit lointain d'un coup de feu résonna sourdement, répercuté par les échos des Quebradas.
Instinctivement, ces hommes cependant si braves et si éprouvés tressaillirent, et ils s'arrêtèrent avec un mouvement de stupeur, presque d'effroi.
Il y eut quelques secondes d'un silence funèbre.
Bon-Affût comprit qu'il fallait rompre le charme funeste qui pesait comme un remords sur tous ces hommes; domptant avec peine l'émotion qui lui serrait la gorge:
—Frères! dit-il d'une voix grave, la vindicte du désert est satisfaite, le misérable que nous avons condamné s'est enfin fait justice.
Il y a dans la voix humaine une puissance étrange et incompréhensible: ces quelques mots prononcés par l'éclaireur suffirent pour rendre à tous ces homme leur énergie première.
—Dieu lui fasse miséricorde! répondit don Miguel.
—Amen! firent les gambucinos en se signant avec dévotion.
Désormais le lourd poids qui pesait sur leur poitrine en était enlevé; le coupable était mort, la logique implacable du fait accompli donnait encore une fois raison à la loi du Lynch et supprimait du même coup les regrets et les remords en mettant un terme à l'incertitude cruelle qui jusque-là les avait oppressés.
Don Stefano mort, celle qu'il avait si impitoyablement poursuivie était sauvée; aux yeux de tous ces hommes au cœur de bronze, cette raison seule suffisait pour éteindre en eux toute pitié pour le coupable.
Une réaction subite s'opéra en eux, et ces natures rebelles un instant domptées se relevèrent plus fortes et plus implacables que jamais.
Sur un geste du Canadien la troupe reprit sa marche et bientôt elle disparut au milieu des dunes de sable qui couvrent les rives du gué del Rubio.
Le désert un instant troublé par le bruit du pied des chevaux sur les cailloux de la plage, retomba dans son calme et majestueux silence.
Balle-Franche, ainsi que nous l'avons dit, avait, aidé par les deux domestiques, enlevé don Mariano, à demi évanoui encore, afin de le conduire au camp des gambucinos, et de lui éviter le spectacle atroce de l'exécution de son frère.
Le mouvement et l'air de la nuit eurent rapidement rappelé le gentilhomme à la vie. En ouvrant les yeux, son premier mot, après avoir jeté un regard autour de lui afin de se reconnaître, fut pour demander son frère. Personne ne répondit; les gens qui l'emportaient continuèrent à marcher: ils redoublèrent même de vitesse.
—Arrêtez! cria alors don Mariano en se redressant avec effort et saisissant la bride du cheval des mains de son conducteur; arrêtez, je le veux!
—Êtes-vous en état de vous conduire vous-même? lui demanda Balle-Franche.
—Oui, répondit-il.
—Alors on va vous rendre votre cheval, mais à une condition.
—Laquelle?
—C'est que vous vous engagerez à nous suivre.
—Suis-je donc votre prisonnier?
—Non, bien loin de là.
—Pourquoi alors cette pression que vous prétendez exercer sur ma volonté?
—C'est dans votre intérêt seul que nous agissons.
—Comment me trouvé-je ici?
—Ne le devinez-vous pas?
—J'attends que vous me l'expliquiez.
—Nous n'avons pas voulu que, après avoir accusé votre frère, vous assistiez à son exécution.
Don Mariano, accablé, baissa tristement la tête.
—Est-il mort? dit-il d'une voix basse et étranglée en frissonnant.
—Pas encore, répondit Balle-Franche.
L'accent du chasseur était si sombre, son visage si lugubre, que le gentilhomme mexicain fut saisi de terreur.
—Oh! Vous l'avez tué! murmura-t-il.
—Non, répondit sèchement Balle-Franche, c'est par sa propre main qu'il doit mourir; lui-même se tuera.
—Oh! Tout cela est horrible! Au nom du ciel, dites-moi tout: je préfère la vérité, si terrible qu'elle soit, à cette affreuse incertitude.
—A quoi bon vous rapporter cette scène? Vous ne la connaîtrez que trop tôt dans tous ses détails.
—C'est bien, répondit résolument don Mariano en arrêtant son cheval, je sais ce qui me reste à faire.
Balle-Franche lui lança un regard d'une expression indéfinissable, et posant la main sur la bride:
—Prenez garde! lui dit-il sèchement, de vous laisser emporter par un premier mouvement toujours irréfléchi, et de regretter plus tard ce que vous aurez fait ce soir.
—Mais je ne puis laisser périr mon frère, cependant, s'écria-t-il; je serais fratricide.
—Non, car il a été justement condamné; vous n'avez été que l'instrument dont la justice divine s'est servie afin de punir un coupable.
—Oh! Vos spécieux raisonnements ne me convaincront pas, mon maître: si dans un moment de colère et de haine insensée, j'ai oublié les liens qui m'attachaient à ce malheureux, maintenant je vois et je comprends toute l'horreur de mon action, et je réparerai le mal que j'ai fait.
Balle-Franche lui étreignit le bras avec force, se pencha à son oreille, et le regardant fixement:
—Silence! lui dit-il à voix basse, vous le perdrez en voulant le sauver; ce n'est pas à vous à le tenter, laissez ce soin à d'autres.
Don Mariano chercha à lire dans l'œil du chasseur la détermination que celui-ci semblait avoir prise, et, lâchant la bride, il continua à marcher d'un air pensif. Un quart d'heure plus tard, ils arrivèrent au gué del Rubio.
Ils s'arrêtèrent au bord de l'eau, qui, resserrée dans son lit étroit, coulait calme et tranquille en ce moment avec un doux murmure.
—Rendez-vous au camp, dit Balle-Franche; Il est inutile que je vous accompagne plus loin. Je vais, ajouta-t-il avec un regard significatif à don Mariano, rejoindre les gambucinos; continuez paisiblement votre route, vous arriverez au camp quelques minutes à peine avant nous.
—Ainsi vous retournez? fit don Mariano.
—Oui, reprit Balle-Franche. Adieu, à bientôt.
—A bientôt, reprit le gentilhomme en lui tendant la main.
Le chasseur la prit et la serra cordialement.
Don Mariano poussa son cheval dans la rivière, ses domestiques l'imitèrent silencieusement.
Balle-Franche, immobile sur le rivage, suivit des yeux leur passage d'un bout à l'autre; il les vit prendre terre; don Mariano se retourna, fit un geste de la main droite, et les trois hommes s'enfoncèrent dans les hautes herbes. Dès qu'ils eurent disparu, Balle-Franche fit volter son cheval et regagna le couvert de la forêt vierge. Le chasseur paraissait en proie à une grande préoccupation; enfin, arrivé à un certain endroit, il s'arrêta et jeta autour de lui un regard soupçonneux et investigateur. Le silence le plus profond et la tranquillité la plus complète régnaient aux environs.
—Il le faut! murmura le chasseur; ne pas agir ainsi serait plus qu'un crime, ce serait une lâcheté! Allons, Dieu jugera entre nous!
Après avoir une dernière fois examiné avec soin les environs, rassuré probablement par le silence et la solitude, il mit pied à terre, défit la bride de son cheval, afin qu'il pût paître à son gré, l'entrava pour qu'il ne s'éloignât pas trop et qu'il lui fût facile de le retrouver dès qu'il en aurait besoin, jeta son rifle sur l'épaule, et s'enfonça avec précaution dans les buissons en murmurant encore une fois à part lui ce mot:
—Allons!
Le chasseur ruminait sans doute un de ces projets dont l'exécution difficile exige la tension continuelle de toutes les facultés de l'homme, car sa marche était lente; calculée, son œil errait sans cesse dans les ténèbres: la tête tendue en avant, il écoutait les bruits sans nom du désert, s'arrêtant parfois lorsqu'un bruissement insolite dans les broussailles frappait son oreille et lui révélait la présence d'un être inconnu non loin de lui.
Soudain, il s'arrêta, demeura quelques secondes immobile, et, s'affaissant sur lui-même, il disparut tout entier au milieu d'un fouillis inextricable de feuilles, de branches et de lianes entrelacées, au sein duquel il était impossible de le deviner. A peine s'était-il caché ainsi, que les sabots de plusieurs chevaux résonnèrent au loin sous les épais arceaux de verdure de la forêt. Peu à peu le bruit se rapprocha, les pas devinrent plus distincts, et une troupe de cavaliers apparut enfin, marchant en colonne serrée.
Ces cavaliers étaient les gambucinos et les chasseurs.
Bon-Affût causait à voix basse avec don Miguel, porté sur un brancard sur les épaules de deux Mexicains, car il était encore trop faible pour se tenir à cheval. La petite troupe s'avançait doucement, à cause du blessé qu'elle avait au milieu d'elle, et se dirigeait vers le gué del Rubio.
Balle-Franche regarda passer ses compagnons sans faire un mouvement qui décelât sa présence; il était évident qu'il voulait que ceux-ci ignorassent qu'il était revenu sur ses pas et que les motifs qui le faisaient agir devaient demeurer un secret entre lui et Dieu.
Ce fut en vain qu'il chercha l'Aigle-Volant et l'Églantine parmi les gambucinos: les deux peaux rouges s'étaient séparés de la troupe. Cette absence parut contrarier vivement le chasseur; cependant, au bout d'un instant, ses traits se rassérénèrent, et il haussa les épaules de cette façon insouciante qui veut dire que l'homme a pris son parti d'une contrariété contre laquelle il n'y a pas à lutter.
Lorsque les gambucinos eurent disparu, le chasseur sortit de sa cachette; il écouta un instant le bruit de leurs pas, qui s'affaiblissait de plus en plus et qui bientôt finit par s'éteindre complètement dans le lointain.
Le chasseur se redressa.
—Bon, murmura-t-il d'un air satisfait, je puis maintenant agir à ma guise, sans craindre d'être troublée, à moins que l'Aigle-Volant et sa squaw ne soient restés à rôder aux environs. Bah! Nous verrons bien; d'ailleurs ce n'est pas probable, le chef a trop grande hâte de rejoindre sa tribu pour s'amuser à perdre son temps ici; allons toujours.
Sur ce, il jeta son rifle sur l'épaule, et se remit en route d'un pas léger et délibéré, sans cependant négliger complètement les précautions usitées au désert dans toute marche; car, la nuit, hommes ou fauves, les coureurs des bois savent qu'ils sont toujours surveillés par des ennemis invisibles.
Balle-Franche atteignit ainsi la lisière de la clairière où s'étaient passées les scènes dramatiques que nous avons rapportées dans la première partie de cette histoire, et au centre de laquelle il ne restait plus en ce moment qu'un homme enterré vivant, face à face avec ses crimes, sans espoir de secours possible et abandonné de la nature entière, sinon de Dieu. Le chasseur s'arrêta, s'étendit sur le sol, et regarda.
Un silence funèbre, silence de la tombe, planait sur la clairière; don Estevan les yeux agrandis par la peur, la poitrine oppressée par la terre qui se tassait autour de son corps par un mouvement lent et continuel, sentait l'air manquer peu à peu à ses poumons; ses tempes battaient à se rompre, le sang bouillonnait dans ses artères, des gouttelettes d'une sueur glacée perlaient à la racine de ses cheveux; un voile sanglant s'étendait sur sa vue, il se sentait mourir.
A ce moment suprême, où tout lui manquait à la fois, le misérable poussa un cri rauque et déchirant: deux larmes jaillirent de ses yeux brûlés de fièvre; sa main comme nous l'avons dit, se crispa nerveusement sur la crosse du pistolet laissé pour abréger son supplice, et il appuya le canon à sa tempe en murmurant avec un accent de désespoir indicible:
—Mon Dieu! Mon Dieu! Pardonnez-moi!
Et il pressa la détente.
Soudain une main se posa sur son bras, la balle se perdit dans l'air et une voix sévère et douce à la fois répondit:
—Dieu vous a entendu, il vous pardonne!
Le misérable tourna la tête avec égarement, regarda d'un air épouvanté l'homme qui lui parlait ainsi; et, trop faible pour résister à l'émotion terrible qui l'agitait, il poussa un cri ressemblant à un sanglot, et s'évanouit.
L'homme qui était arrivé si à propos pour don Estevan à son secours était Balle-Franche; le lecteur l'a sans doute deviné déjà.
—Hum! fit-il en secouant la tête, il était temps que j'intervinsse.
Alors, sans perdre un instant, le digne homme s'occupa à sortir de la tombe dans laquelle on l'avait bouclé tout vivant, celui qu'il voulait sauver. C'était une rude besogne, surtout privé comme il l'était des outils nécessaires.
Les gambucinos avaient travaillé en conscience et comblé la fosse de façon à ce que l'homme qu'ils enterraient fût solidement accoré de tous les côtés à la fois.
Balle-Franche était obligé de creuser avec son couteau, en usant des plus grandes précautions pour ne pas blesser don Estevan. Parfois le chasseur s'arrêtait, essuyait son front ruisselant de sueur, regardait le visage pâle du Mexicain toujours évanoui; puis, après quelques secondes de cette contemplation muette, il hochait sentencieusement la tête deux ou trois fois, et se remettait au travail avec une nouvelle ardeur.
C'était un étrange spectacle que ce groupe formé par ces deux hommes dans ce désert, entouré de profondes ténèbres; certes, s'il eût été donné à un indiscret de voir ce qui se passait en ce moment dans cette clairière perdue au milieu d'une forêt vierge, peuplée de bêtes fauves dont les sourds rauquements s'élevaient par intervalles dans le silence comme pour protester contre l'envahissement de leur repaire, l'homme qui aurait assisté à cette scène aurait cru être témoin de quelque incantation diabolique, et se serait éloigné au plus vite, en proie à la plus vive terreur. Cependant Balle-Franche creusait toujours; sa tâche avançait lentement, parce que, au fur et à mesure qu'il descendait plus profondément dans le sol, les difficultés se faisaient pour lui plus grandes.
Un instant le chasseur s'arrêta, désespérant de parvenir à sauver le condamné; mais ce mouvement de découragement n'eut que la durée d'un éclair: le Canadien, honteux de cette pensée, se remit à creuser avec l'énergie fébrile que donne à l'homme résolu la réaction d'une volonté forte sur une faiblesse passagère.
Enfin, après des difficultés inouïes, ce travail, vingt fois interrompu, vingt fois repris, fut achevé; le chasseur poussa un ah! de triomphe et de bonheur: s'élançant hors de la fosse, il saisit don Estevan par dessous les aisselles, le tira vigoureusement à lui, l'enleva du trou, et parvint non sans peine à l'étendre sur le sol.
Son premier soin fut de couper avec son couteau les liens qui enveloppaient de réseaux inextricables le corps du malheureux; il desserra, ses vêtements afin de rendre à ses poumons le jeu nécessaire à l'aspiration de l'air extérieur, puis il remplit une demi calebasse, qui lui servait de tasse, avec l'eau de sa gourde, et vida cette eau sur le visage de don Estevan.
L'évanouissement de celui-ci avait été causé par l'émotion qu'il avait éprouvée en voyant arriver un sauveur au moment où il croyait n'avoir plus qu'à mourir; cette immersion subite d'une eau glacée opéra en lui une réaction favorable; il poussa un soupir et ouvrit les yeux.
Le premier mouvement de cet homme en reprenant connaissance fut de lancer vers le ciel un regard de défit et tendant la main à Balle-Franche:
—Merci, lui dit-il.
Le chasseur se recula sans toucher la main qu'on lui offrait.
—Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, dit-il.
—Qui donc?
—Dieu!
Don Estevan plissa ses lèvres pâles avec dédain; mais comprenant bientôt qu'il fallait tromper son sauveur s'il voulait qu'il lui continuât la protection dont en ce moment il ne pouvait encore se passer:
—C'est vrai, dit-il avec une feinte douceur, Dieu d'abord, vous ensuite.
—Moi, repartit Balle-Franche, j'ai accompli un devoir, payé une dette; maintenant nous sommes quittes. Vous m'avez, il y a dix ans, rendu un important service: aujourd'hui je vous sauve la vie; c'est un prêté pour un rendu; je vous dispense de toute reconnaissance, comme vous devez, de votre côté, m'en dispenser; à compter de cette heure nous ne nous connaissons plus, nos voies sont différentes.
—Allez-vous donc m'abandonner ainsi? fit-il avec un mouvement d'effroi dont il ne fut pas le maître.
—Que puis-je faire de plus?
—Tout.
—Je ne vous comprends pas.
—Mieux valait me laisser mourir dans la fosse, où vous même avez aidé à me descendre, que me sauver pour me condamner à mourir de faim dans ce désert, à devenir la proie des bêtes fauves ou à tomber entre les mains des Indiens. Vous le savez, Balle-Franche, dans la Prairie, un homme désarmé est un homme mort; vous ne me sauvez pas en ce moment, vous rendez mon agonie plus longue et plus douloureuse, puisque l'arme que, dans leur cruelle générosité, vos amis m'avaient laissée pour mettre fin a mes maux lorsque le courage et l'espoir me manqueraient, ne peut plus même me servir à présent.
—C'est juste murmura Balle-Franche.
Le chasseur baissa la tête sur sa poitrine et réfléchit profondément pendant quelques secondes.
Don Estevan suivait avec anxiété sur le visage loyal et caractérisé du chasseur les diverses émotions qui, tour à tour, s'y reflétaient.
Le Canadien reprit:
—Vous avez raison de me demander des armes; si vous en êtes privé, vous risquez d'être, avant quelques heures, dans une position semblable à celle dont je vous ai sorti.
—Vous le reconnaissez?
—Pardieu! Cela n'est pas douteux.
—Alors, soyez généreux jusqu'au bout, donnez-moi les moyens de me défendre.
Le chasseur hocha la tête.
—Je n'avais pas prévu cela, dit-il.
—Ce qui signifie que si vous l'aviez prévu, vous m'auriez laissé mourir.
—Peut-être!
Ce mot tomba comme un coup de massue sur le cœur de don Estevan; il lança un regard sinistre au chasseur.
—Ce que vous dites-là n'est pas bien, dit-il.
—Que voulez-vous que je vous réponde? reprit celui-ci; à mes yeux vous avez été justement condamné. J'aurais dû laisser la justice suivre son cours; je ne l'ai pas fait, peut-être ai-je eu tort; maintenant que j'envisage la question de sang-froid, tout en reconnaissant que vous avez raison de me demander des armes, qu'il est indispensable que vous en ayez pour votre sûreté personnelle d'abord, et ensuite afin de pourvoir à vos besoins, je redoute de vous en donner.
Don Estevan était assis auprès du chasseur: il jouait d'un air nonchalant avec le pistolet déchargé, semblant écouter fort attentivement ce que lui disait Balle-Franche.
—Pourquoi donc? répondit-il.
—Eh! Mais, pour une raison bien simple: je vous connais de longue date, vous ne l'ignorez pas don Estevan; je sais que vous n'êtes pas un homme à oublier une injure: je suis convaincu que si je vous rends vos armes, vous ne penserez plus qu'à la vengeance, voilà ce que je veux éviter.
—Et pour cela, s'écria le Mexicain avec un rire strident, vous ne voyez qu'un moyen, c'est de me laisser mourir de faim. Oh! Oh! Singulière philanthropie que la vôtre! compañero; vous avez une façon d'arranger les choses un peu bien brutale, pour un homme qui se pique d'honneur et de loyauté.
—Vous ne me comprenez pas, je ne veux pas vous donner des armes, il est vrai; mais je ne veux pas non plus laisser incomplet le service que je vous ai rendu.
—Hum! Et comment ferez-vous pour obtenir ce résultat? Je suis curieux de le savoir, fit don Estevan en ricanant.
—Je vous escorterai jusqu'aux frontières de la Prairie, vous gardant de tout danger pendant le voyage, vous défendant et chassant pour vous; cela est simple, je crois.
—Fort simple, en effet. Et, arrivé là-bas, moi j'achète des armes, et je reviens chercher ma vengeance.
—Non pas!
—Comment cela!
—Parce que vous allez me jurer à l'instant, sur votre honneur, d'oublier tout sentiment de haine envers vos ennemis et de ne jamais rentrer dans la Prairie.
—Et si je ne veux pas jurer?
—Alors c'est différent, je vous abandonne; et comme cela sera arrivé par votre faute, je me considérerai comme entièrement quitte envers vous.
—Oh! Oh! Mais en admettant que j'accepte les dures conditions que vous me posez, encore faut-il savoir comment nous voyagerons; la route est longue d'ici aux établissements, je ne suis guère en état de la faire à pied.
—C'est vrai, mais que cela ne vous inquiète point; j'ai laissé mon cheval dans un fourré à quelques pas d'ici près du Rubio; eh bien! Vous le monterez jusqu'à ce que je puisse m'en procurer un autre.
—Et vous?
—Moi, je suivrai à pied; nous autres chasseurs, nous sommes aussi bons piétons que cavaliers; voyons, décidez-vous.
—Eh! Mon Dieu, il faut bien faire ce que vous désirez.
—Oui, je crois que c'est le plus sûr pour vous; donc, vous consentez à faire le serment que je vous demande?
—Je ne vois pas le moyen de m'en tirer autrement. Mais, fit-il tout à coup, que se passe-t-il donc là dans ce taillis?
—Où cela? dit le chasseur.
—Là, reprit don Estevan, en étendant le bras dans la direction d'un épais massif de broussailles.
Le chasseur se retourna vivement vers l'endroit que lui désignait le Mexicain.
Celui-ci ne perdit pas de temps: saisissant par l'extrémité du canon le pistolet avec lequel il avait continué a jouer, il le leva rapidement, et déchargea un coup de la crosse sur le crâne du chasseur: ce coup fut porté avec tant de force et de précision, que Balle-Franche étendit les bras, ferma les yeux, et roula sur le sol en poussant un profond soupir.
Don Estevan le considéra un instant avec une expression de mépris et de haine satisfaite:
—Idiot! murmura-t-il en le poussant du pied, c'était avant de me sauver qu'il fallait me faire ces sottes conditions; mais à présent il est trop tard. Je suis libre, cuerpo de Cristo, et je me vengerai!
Après avoir prononcé ces paroles en lançant vers le ciel un regard de défi, il se baissa sur le chasseur, le dépouilla de ses armes sans la moindre pudeur, et l'abandonna, sans même songer à savoir s'il était mort ou seulement blessé.
—C'est toi, chien maudit reprit-il, qui mourras de faim ou seras dévoré par les bêtes fauves; quant à moi, maintenant, je ne crains plus rien, j'ai entre les mains les moyens d'accomplir ma vengeance!
Et le misérable quitta à grands pas la clairière pour chercher le cheval de Balle-Franche, dont il comptait faire sa monture.
Les gambucinos atteignirent leur camp un peu avant le lever du soleil. Pendant leur absence, les quelques hommes laissés à la garde des retranchements n'avaient pas été inquiétés.
Don Mariano attendait le retour des Mexicains avec une vive impatience: aussitôt qu'il les aperçut, il alla au-devant d'eux.
Bon-Affût était sombre: la réception qu'il fit au gentilhomme, bien que cordiale, fut cependant assez sèche.
Le chasseur, quoiqu'il eût la conviction d'avoir accompli un devoir en condamnant don Estevan était triste cependant, en songeant à la responsabilité qu'il avait assumée sur lui dans cette affaire.
Autre chose est tuer un homme dans un combat, en défendant sa vie, au milieu de l'enivrement de la bataille, et juger et exécuter froidement un individu contre lequel on n'a aucun motif personnel de haine ou de colère.
Le vieux Canadien redoutait intérieurement les reproches de don Mariano; il connaissait trop bien le cœur humain pour ne pas savoir que le gentilhomme, dès qu'il envisagerait de sang-froid l'action qu'il avait excité les gambucinos à commettre, la détesterait, et maudirait ceux qu'il avait trouvés trop dociles à le servir.
Quelque grands que fussent les torts de don Estevan envers don Mariano, si criminelle que fût sa conduite, ce n'était pas à son frère à l'accuser, et surtout à requérir sa mort de ces hommes implacables chez lesquels tous sentiments de clémence sont éteints, par suite de la rude vie qu'ils sont contraints de mener.
Maintenant que plusieurs heures s'étaient écoulées depuis la condamnation de don Estevan, Bon-Affût, chez lequel la réflexion était arrivée, et lui avait permis d'envisager cette action sous un jour différent, en était venu à se demander tout bas s'il avait réellement le droit d'agir ainsi qu'il l'avait fait, et si ce qu'il prenait pour un acte de sévère et stricte justice n'était pas un assassinat et une vengeance déguisée: aussi s'attendait-il à ce que don Mariano, en le voyant, lui adressât des reproches et lui demandât compte de la vie de son frère.
Le chasseur se prépara à répondre aux questions que sans doute don Mariano allait lui faire; et, dès qu'il l'aperçut, son front, déjà assailli de tristes pensées, se rembrunit encore. Mais Bon-Affût s'était trompé: pas un reproche, pas une parole ayant trait au jugement ne sortirent des lèvres de don Mariano; aucune allusion, même détournée, ne vint faire soupçonner au chasseur que le gentilhomme avait l'intention d'attaquer ce sujet délicat.
Le Canadien respira, seulement à la dérobée pendant les quelques instants qu'ils marchèrent côte à côte pour rentrer au camp; il examina à plusieurs reprises le visage de don Mariano: le gentilhomme était pâle, triste, mais sa physionomie était calme et ses traits impassibles.
Le chasseur hocha la tête.
—Il roule quelques projets dans sa pensée, murmura-t-il à voix basse.
Dès que l'enceinte du camp fut franchie, que les barricades eurent été refermées sur les gambucinos, don Miguel après avoir placé les sentinelles aux retranchements, se tourna vers Bon-Affût et don Mariano:
—Le soleil se lèvera dans deux heures environ, leur dit-il; veuillez accepter mon hospitalité et me suivre sous ma tente.
Les deux hommes s'inclinèrent.
Don Miguel fit signe à ses porteurs de poser à terre le brancard sur lequel il était assis; il se leva, aidé par Bon-Affût, et, appuyé sur le bras du chasseur, il entra dans la tente, suivi par don Mariano.
Le rideau retomba derrière eux.
Les gambucinos, fatigués des courses de la nuit, s'étaient hâtés de desseller leurs chevaux, de leur donner la provende; puis, après avoir jeté quelques brassées de bois sec dans les feux, afin de raviver la flamme, ils s'étaient enveloppés dans leurs frazadas et leurs zarapés, et s'étaient étendus sur le sol, où ils n'avaient pas tardé à s'endormir. Dix minutes après le retour de la troupe, tous les aventuriers étaient plongés dans le plus profond sommeil; seuls, trois hommes veillaient encore: ces trois hommes étaient don Miguel, Bon-Affût et don Mariano, réunis sous la tente où ils avaient entre eux une conversation à laquelle nous ferons assister le lecteur.
L'intérieur de la tente sous laquelle don Miguel avait introduit ses deux compagnons était meublée de la façon la plus simple: dans un angle se trouvait le palanquin hermétiquement fermé; dans l'angle opposé, plusieurs fourrures étendues sur le sol marquaient la place d'un lit; quatre ou cinq crânes de bisons servaient de sièges; il était impossible de rencontrer rien d'aussi simple et de moins confortable que tout cela.
Don Miguel se jeta sur son lit, après avoir engagé d'un geste gracieux ses compagnons à s'assoir sur les crânes de bisons. Bon-Affût et don Mariano rapprochèrent leurs sièges de l'endroit où se tenait leur hôte, et s'assirent silencieusement.
Don Miguel prit alors la parole:
—Caballeros, dit-il, les faits qui se sont passés cette nuit, faits sur lesquels je ne reviendrai pas, ont besoin d'être clairement expliqués, surtout dans la prévision des complications probables qui en découleront dans les événements auxquels d'ici à peu de temps, je l'espère, nous serons appelés à prendre part; ce que j'ai à dire vous regarde, et vous intéresse particulièrement, don Mariano: c'est donc surtout à vous que je m'adresse. Quant à Bon-Affût, il sait à peu près à quoi s'en tenir sur ce que vous allez entendre: si je le prie d'assister à l'entretien que je désire avoir avec vous, c'est d'abord à cause de la vieille amitié qui nous a lié toujours, ensuite parce que ses avis nous seront d'un grand secours pour les résolutions ultérieures que nous aurons à prendre.
Don Mariano fixa l'aventurier d'une façon qui fit entendre à celui-ci qu'il ne comprenait absolument rien à ce long exorde.
—Ne vous souvenez-vous pas, señor don Mariano, fit alors le Canadien, que, avant de me rendre au camp pour vous amener don Miguel, je vous ai dit que vous ignoriez le plus intéressant de cette histoire que vous croyiez si bien savoir.
—En effet, je me le rappelle, bien qu'à ce moment je n'ai pas attaché à cette déclaration tout l'intérêt qu'elle méritait.
—Eh bien, si je ne me trompe, don Miguel va en quelques mots vous mettre au courant de ces affreuses machinations. Puis il ajouta, comme par réflexion: il est un homme que j'aurais désiré voir ici; il était important que lui aussi connût toute la vérité; mais depuis notre retour au camp je ne l'ai pas aperçu.
—De qui voulez-vous parler?
—De Balle-Franche, que j'avais chargé de vous accompagner jusqu'ici.
—Il m'a accompagné en effet; mais aux approches du camp, jugeant sans doute que je n'avais plus besoin de sa protection, il m'a quitté.
—Ne vous a-t-il pas dit dans quelle intention? reprit le chasseur, en regardant fixement le gentilhomme.
Don Mariano fut intérieurement troublé par cette interrogation; mais voulant laisser à Balle-Franche le soin d'expliquer son absence, et peu désireux d'avouer son désir de sauver son frère, il répondit avec une certaine hésitation qu'il ne put entièrement cacher:
—Non, il ne m'a rien dit; je croyais qu'il vous avait rejoint, je suis aussi étonné que vous de son absence.
Bon-Affût fronça imperceptiblement le sourcil.
—C'est étrange! fit-il. Du reste, ajouta-t-il, il ne tardera probablement pas à revenir, et alors nous saurons ce qu'il aura fait.
—Oui, maintenant, don Miguel, je suis à vos ordres; parlez, je vous écoute attentivement, reprit don Mariano, qui ne se souciait nullement de voir la conversation se continuer sur ce sujet.
—Donnez-moi mon vrai nom, don Mariano, répondit le jeune homme; ce nom vous inspirera peut-être quelque confiance en moi: je ne suis ni don Toribio Carvajal ni don Miguel Ortega, je me nomme don Leo de Torres.
—Leo de Torres! s'écria don Mariano en se levant avec stupéfaction, le fils de mon ami le plus cher!
—C'est moi répondit simplement le jeune homme.
—Mais non, cela n'est pas possible. Basilio de Torres est mort massacré avec toute sa famille par les Indiens Apaches sur les ruines fumantes de son hacienda prise d'assaut, il y a vingt ans de cela.
—Je suis le fils de don Basilio de Torres, reprit l'aventurier. Regardez-moi bien, don Mariano: est-ce que les traits de mon visage ne vous rappellent rien.
Le gentilhomme s'approcha, posa les mains sur les épaules de l'aventurier, et l'examina quelques secondes avec la plus profonde attention.
—C'est vrai, dit-il au bout d'un instant avec des larmes dans la voix, cette ressemblance est extraordinaire. Oui, oui, s'écria-t-il avec explosion, je vous reconnais maintenant!
—Oh! reprit le jeune homme avec un sourire, j'ai entre les mains des actes qui garantissent mon identité. Mais, fit-il, ce n'est plus de cela qu'il s'agit, revenons à ce que je voulais vous dire.
—Comment se fait-il que, depuis l'affreuse catastrophe qui vous a rendu orphelin, jamais je n'aie entendu parler de vous, moi le meilleur ami, presque le frère de votre père; j'aurais été si heureux de veiller sur vous.
Don Leo, auquel désormais nous restituerons son véritable nom, fronça le sourcil; son front fut sillonné de rides profondes; il répondit avec un accent triste et d'une voix tremblante:
—Merci, don Mariano, de l'amitié que vous me témoignez, croyez que j'en suis digne; mais, je vous en prie, laissez-moi conserver au fond de mon cœur le secret de mon silence; un jour peut-être, je l'espère, il me sera permis de parler, alors je vous dirai tout.
Don Mariano lui serra la main.
—Agissez à votre guise, lui dit-il d'une voix profondément émue; ne vous souvenez que d'une chose, c'est que vous avez retrouvé en moi le père que vous avez perdu.
Le jeune homme détourna la tête afin de cacher les larmes qu'il sentait lui venir aux yeux. Il y eut une pose assez longue: au dehors, le glapissement des coyotes rompait seul par intervalles le silence imposant du désert.
L'intérieur de la tente n'était éclairé que par une torche de bois d'ocote fichée en terre, dont la flamme tremblotante faisait jouer sur le visage des trois hommes des ombres et des lumières qui imprimaient à leur physionomie une expression étrange et fantastique.
—Le ciel commence à se rayer de larges bandes blanches, reprit don Leo; les chouettes et les hiboux cachés sous la feuillée saluent le retour du jour; le soleil va paraître; laissez-moi, en quelques mots, vous mettre au courant des faits que vous ignorez; car si j'en crois mes pressentiments, il nous faudra bientôt agir avec vigueur, afin de réparer le mal commis par don Estevan.
Les deux hommes s'inclinèrent affirmativement: don Leo continua:
—Certaines raisons qu'il est inutile de rapporter ici m'avaient, il y a quelques mois, conduit à Mexico; par suite de ces raisons, je menais une vie assez singulière, fréquentant des gens de la pire espèce, et me faufilant, lorsque l'occasion s'en présentait, dans les sociétés les plus ou les moins mêlées, suivant que vous comprendrez mes paroles. N'allez pas croire, par ce qui précède, que je me livrais à quelques opérations criminelles, vous commettriez une grave erreur: seulement, de même que bon nombre de nos compatriotes, je faisais certains commerces interlopes, peut-être vus d'un mauvais œil par les préposés du gouvernement, mais qui, pour cela, n'ont rien de fort répréhensibles en eux.
Bon-Affût et don Mariano échangèrent un regard: ils avaient compris ou cru comprendre.
Don Leo de Torres feignit de ne pas apercevoir ce regard.
—Un des lieux que je fréquentais le plus assidûment, dit-il, était la plaza Mayor; là, je visitais un evangelista, vieillard d'une cinquantaine d'années, doublé de juif et de lombard, qui, sous une apparence vénérable, cachait l'âme la plus vénale et le cœur le plus corrompu; ce coquin émérite, dans l'intérêt des mille commerces occultes auxquels il se livrait, et à cause de ses fonctions d'evangelista, connaissait à fond les secrets d'un nombre infini de familles et était au courant de toutes les infamies qui se commettent tous les jours dans cette immense capitale. Un jour que par hasard je me trouvais chez lui à l'oración, une jeune fille entra; cette jeune fille était belle, paraissait honnête; elle tremblait comme la feuille en mettant le pied dans l'antre du misérable; celui-ci lui fit son plus charmant sourire et lui demanda obséquieusement à quoi il pouvait lui servir: elle lança un regard timide autour d'elle et m'aperçut. Je ne sais pourquoi j'avais flairé un mystère; la tête sur la table, le front posé sur mes deux mains croisées, je feignais de dormir.—Cet homme? fit-elle en me désignant.—Oh! répondit l'evangelista, il est ivre de pulque; c'est un pauvre sous-officier sans importance; d'ailleurs, il dort.—Elle hésita; puis, semblant prendre tout à coup sa résolution, elle sortit un mince papier de sa poitrine.—Copiez cela, dit-elle à l'evangelista, je vous donnerai deux onces.—Le vieux coquin saisit le papier et le parcourut des yeux.—Mais ce n'est pas du castillan, cela, dit-il.—C'est du français, reprit-elle; que vous importe?—A moi, rien.—Il prépara son papier, ses plumes, et copia le billet sans plus d'observation; lorsque cela fut terminé, la jeune fille compara les deux billets, fit un sourire de satisfaction, déchira l'original, plia la copie en forme de lettre, dicta une adresse abrégée à l'evangelista; puis elle prit la lettre, la serra dans son corsage, et sortit après avoir payé le prix convenu que l'evangelista saisit avec joie, car il avait plus gagné en quelques minutes qu'il ne gagnait d'ordinaire en un mois. A peine la jeune fille eut-elle disparu, que je relevai la tête; mais l'evangelista me fit signe de reprendre ma première position: il avait entendu tourner la clef dans la serrure de la porte de sa bicoque; j'obéis, et bien m'en prit, car un homme entra presque aussitôt. Cet homme désirait évidemment ne pas être connu; il était embossé avec soin dans un large manteau; les ailes de son sombrero étaient rabattues sur ses yeux; il fit en entrant un geste de mécontentement.—Quel est cet homme? dit-il en me désignant.—Un pauvre diable, ivre, qui dort.—Une jeune fille sort d'ici.—C'est possible, répondit l'evangelista, mis sur ses gardes par cette question.—Pas de phrases ambigües, drôle, répondit l'étranger avec hauteur; je te connais et je te paye, ajouta-t-il en laissant tomber une lourde bourse sur la table; réponds. L'evangelista tressaillit; tous ses scrupules disparurent à la vue de l'or qui scintillait à travers les mailles de la bourse.—Une jeune fille sort d'ici, reprit l'inconnu.—Oui.—Que t'a-t-elle demandé?—De lui transcrire un billet écrit en français.—C'est bien, montre-moi ce billet.—Elle l'a plié en forme de lettre, a mis une adresse et l'a emporté.
—Je sais tout cela.—Alors?—Alors, repartit l'inconnu en ricanant, comme tu n'es pas un niais, tu as gardé une copie de ce billet, c'est cette copie que je veux voir. Je ne sais pourquoi la voix de cet homme m'avait frappé malgré moi; comme il me tournait à peu près le dos, j'en profitai pour faire à l'evangelista un signe qu'il comprit. —Je n'y ai pas songé, répondit-il. Il prit en disant ces mots une physionomie si naïvement niaise, que l'inconnu y fut trompé; il fit un geste de dépit.—Enfin, reprit-il, elle reviendra?—Je ne sais pas.—Je le sais, moi; chaque fois qu'elle viendra, tu conserveras une copie de ce qu'elle te fera écrire. C'est ici que doivent arriver les réponses de ces lettres?—Je l'ignore.—L'inconnu haussa les épaules. —Tu ne les remettras qu'après me les avoir montrées. A demain, et ne sois pas aussi sot qu'aujourd'hui, si tu veux que je me charge de ta fortune. L'evangelista grimaça un sourire. L'étranger se détourna pour sortir. Dans ce mouvement, un pan de son manteau s'accrocha après la table; les plis se dérangèrent et j'entrevis son visage; j'eus besoin de toute ma puissance sur moi-même pour ne pas pousser un cri en le reconnaissant: cet homme était don Estevan, votre frère. Il ramena son manteau sur son visage en étouffant une malédiction, et sortit. A peine fut-il dehors, que je me levai d'un bond; je verrouillai la porte, et me plaçant en face de l'evangelista:—A nous deux! lui dis-je. Il fit un geste de terreur; mon visage avait une expression terrible qui le fit reculer jusqu'au mur de sa bicoque en serrant la bourse qu'il venait de recevoir et que sans doute il supposait que je voulais lui voler.—Je suis un pauvre vieillard, me dit-il.—Où est la copie que tu as refusée à cet homme? répondis-je d'une voix brève. Il se baissa sur son pupitre, prit cette copie, et me la présenta sans dire un mot; je la lus en frémissant: j'avais compris.—Tiens, lui dis-je, en lui donnant une once, chaque fois tu me remettras le billet de la jeune fille, je te permets de le faire voir aussi à cet homme; seulement, retiens bien ceci: aucune des réponses écrites par l'individu qui sort d'ici ne doit être remise par toi à la jeune fille avant que je ne l'aie lue; je ne suis pas aussi riche que cet étranger, cependant je te payerai convenablement; tu me connais. Je n'ai plus qu'une chose à te dire: c'est que si tu me trahis, je te tuerai comme un chien. Je sortis. En refermant la porte, j'entendis l'evangelista murmurer a demi-voix:—¡Santa Virgen! Dans quel guêpier me suis-je fourré! Maintenant, voici la clef de ce mystère: la jeune fille que j'avais rencontrée chez l'evangelista était novice au couvent des Bernardines, où se trouvait votre fille; doña Laura, ne sachant à qui se fier, l'avait chargée de faire parvenir à don Francisco de Paulo Serrano...
—Mon beau-frère, son parrain! s'écria don Mariano.
—Celui-là même, continua don Leo; elle avait, dis-je, chargé doña Louisa, son amie, de faire parvenir au señor Serrano des billets dans lesquels elle lui révélait les machinations criminelles de son oncle, les persécutions auxquelles elle était en butte, en le suppliant, comme le meilleur ami de son père, de venir à son secours et de la prendre sous sa protection.
—Oh! Ma pauvre fille! murmura don Mariano.
—Don Estevan, reprit don Leo, par je ne sais quel moyen avait appris les intentions de votre fille; afin de bien connaître ses projets et le moment venu de pouvoir les renverser, il feignit de tout ignorer, laissa la jeune fille porter les lettres à l'evangelista, lisant les copies et faisant lui-même les réponses, par la raison toute simple que don Francisco ne recevait pas les lettres de votre fille, parce que don Estevan avait gagné son valet-de-chambre qui les lui rendaient toutes cachetées; cette habille perfidie aurait réussi sans nul doute si le hasard ou plutôt la Providence ne m'avait placé aussi à propos dans l'échoppe de l'evangelista.
—Oh! murmura don Mariano, cet homme était un monstre.
—Non, reprit don Leo; les circonstances l'obligèrent à aller beaucoup plus loin qu'il n'aurait peut-être voulu; rien ne prouve qu'il désirât la mort de votre fille.
—Que voulait-il donc alors?
—Votre fortune; en contraignant doña Laura à prendre le voile, il atteignait son but; malheureusement, comme cela arrive toujours lorsqu'on s'engage dans cette voie épineuse qui fatalement aboutit au crime, bien qu'il eût froidement calculé toutes les chances de réussite, il ne pouvait prévoir mon intervention dans l'exécution de ses projets, intervention qui devait le faire échouer et l'obliger à commettre un crime afin d'assurer leur réussite. Doña Laura, persuadée que la protection de don Francisco ne lui faillirait pas, suivait scrupuleusement les conseils que je lui faisais parvenir dans les billets que je lui écrivais au nom de l'ami auquel elle s'adressait; quant à moi, je me tenais prêt à agir aussitôt que le moment serait venu. Je n'entrerai dans aucuns détails à ce sujet. Doña Laura refusa, dans l'église même, de prononcer ses vœux: le scandale fut extrême; l'abbesse, furieuse, résolut d'en finir. La malheureuse jeune fille, endormie au moyen d'un puissant narcotique, fut toute vivante plongée au fond d'un in pace dans lequel elle devait mourir de faim.
—Oh! s'écrièrent les deux hommes en tressaillant d'horreur.
—Je vous répète, continua don Leo, que je ne crois pas don Estevan capable de cette barbarie; il en fut probablement le complice indirect, mais rien de plus: l'abbesse fut seule coupable. Don Estevan accepta les faits accomplis, il en profita, rien de plus; nous devons le supposer ainsi pour l'honneur de l'humanité; autrement cet homme serait un monstre. Averti le jour même de ce qui s'était passé au couvent, je réunis une troupe de bandits et d'aventuriers, puis, la nuit venue, je m'introduisis par ruse dans le couvent, et, le pistolet au poing, j'enlevai votre fille.
—Vous! s'écria don Mariano avec un mouvement de surprise mêlé de joie. Mon Dieu, mon Dieu! Ainsi elle est sauvée, elle est en sûreté?
—Oui, dans un endroit où moi-même, aidé par Bon-Affût, je l'ai cachée.
—Don Estevan ne l'y aurait jamais trouvée, fit le chasseur avec un sourire narquois.
Le gentilhomme était en proie à une agitation extrême.
—Où est-elle, s'écria-t-il; je veux la voir; dites-moi en quel lieu elle se trouve, ma pauvre et chère enfant!
—Vous comprenez, répondit le jeune homme, que je ne l'ai pas gardée auprès de moi; je savais que les espions de don Estevan et votre frère lui-même me poursuivaient et surveillaient toutes mes démarches. Après avoir mis doña Laura en sûreté, j'attirai sur mes traces toutes les poursuites. Voici comment: ce palanquin, dit-il en le désignant du doigt, ce palanquin, a jusqu'au presidio de Tubac, renfermé doña Laura. J'eus soins de la laisser apercevoir une fois ou deux: il n'en fallut pas davantage pour faire supposer qu'elle était toujours auprès de moi; grâce au soin que je prenais de tenir constamment ce palanquin hermétiquement fermé et de n'en laisser approcher personne, j'avais le projet d'entraîner vos ennemis à ma suite, et, arrivé dans le désert, de les punir; mes calculs ont été plus justes que ceux de don Estevan, car Dieu me secondait; maintenant que le criminel a été puni, que doña Laura n'a plus rien à craindre, je suis prêt à vous faire connaître sa retraite et à vous conduire vers elle.
—Oh! Mon Dieu! Vous êtes juste et bon, s'écria don Mariano avec une expression de joie ineffable; mon Dieu, soyez béni! Je vais revoir mon enfant! Elle est sauvée!
—Elle est perdue si vous ne vous hâtez pas! s'écria une voix sépulcrale.
Les trois hommes se retournèrent avec épouvante.
Balle-Franche, le visage pâle et ensanglanté, les habits déchirés et souillés de sang, se tenait droit et immobile à l'entrée de la tente dont il tenait le rideau soulevé.
Les Indiens, à cause de la vie qu'ils sont contraints de mener et de l'éducation qu'ils reçoivent, sont d'un caractère essentiellement défiant: habitués à se mettre constamment en garde contre tout ce qui les environne, à soupçonner les intentions en apparence les plus loyales, de cacher une trahison ou une perfidie, ils ont acquis une habileté peu commune pour deviner les projets des personnes avec lesquelles le hasard les met en rapport et déjouer les embûches tendues sous leurs pas par leurs ennemis.
Mahchsi-Karehde, nous l'avons dit déjà, était un guerrier expert, aussi sage au conseil que vaillant au combat, et qui, bien que très jeune encore, jouissait à juste titre d'une grande réputation dans sa tribu.
Aussitôt que Bon-Affût, au nom de la loi de Lynch, eut prononcé la sentence de don Estevan, il y eut une espèce de désordre parmi les chasseurs qui rompirent leurs rangs et commencèrent à causer et à discuter vivement entre eux, ainsi que cela arrive toujours en pareil cas. L'Aigle-Volant profita de ce que l'attention était portée ailleurs et que personne ne songeait à lui pour faire à l'Églantine, dont les yeux étaient incessamment fixés sur lui, un signe que la jeune femme comprit, et il se glissa silencieusement au milieu des buissons, où il disparut sans que nul ne s'occupât de son absence.
Après avoir marché pendant environ vingt minutes dans la forêt, se jugeant probablement assez éloigné, le chef s'arrêta, et se tourna vers sa femme qui ne l'avait pas quitté d'un pas.
—Laissons les visages pâles, dit-il, accomplir leur œuvre; l'Aigle-Volant est un guerrier comanche, il ne doit pas intervenir davantage entre eux.
—Le chef retourne dans son village? demanda timidement l'Églantine.
L'Indien sourit d'un air fin.
—Tout n'est pas fini encore, répondit-il, l'Aigle-Volant veillera sur ses amis.
La jeune femme baissa la tête, et voyant que l'Indien s'était assis, elle se prépara à allumer le feu du campement. Le chef l'arrêta d'un geste.
—L'Aigle-Volant ne veut pas être découvert, reprit-il; que ma sœur prenne place à ses côtés, et qu'elle attende; un ami est en péril à cette heure.
En ce moment il se fit, non loin de l'endroit où les deux peaux-rouges étaient arrêtés, un grand bruit de branches cassées et froissées dans le taillis.
L'Indien prêta attentivement l'oreille pendant quelques minutes, le corps penché vers le sol.
—L'Aigle-Volant revient, dit-il en se relevant.
—L'Églantine l'attendra, répondit la jeune femme en lui jetant un doux regard.
Le chef déposa auprès de sa compagne les armes qui auraient pu le gêner dans l'exécution du projet qu'il méditait; il ne garda que sa reata qu'il leva avec soin dans sa main droite, et se dirigea à pas de loup dans la direction du bruit qu'il avait entendu et qui de seconde en seconde se faisait plus fort.
A peine se fut-il avancé d'une vingtaine de pas en se frayant un chemin à travers les lianes entrelacées et les hautes herbes qui lui barraient le passage, qu'il aperçut, arrêté à dix mètres de lui environ, un magnifique cheval noir qui, les oreilles couchées en arrière, le cou allongé et les quatre pieds tendus, fixait sur lui ses grands yeux intelligents d'un air effaré en renâclant avec force, la bouche couverte d'écume et les naseaux sanglants.
—Ooah! murmura le chef en s'arrêtant tout court et admirant le superbe animal en connaisseur.
Il se rapprocha de quelques pas encore, en ayant soin de ne pas effaroucher davantage le cheval, qui suivait tous ses mouvements d'un œil inquiet; et à l'instant où il le vit bondir pour s'échapper, il fit siffler sa reata autour de sa tête et la lança avec tant d'adresse que le nœud coulant tomba sur les épaules du cheval; celui-ci essaya pendant trois ou quatre minutes de reprendre la liberté qui lui était si subitement ravie; mais bientôt, reconnaissant l'inutilité de ses efforts, il se résigna à accepter de nouveau l'esclavage, et laissa approcher l'Indien sans chercher à continuer plus longtemps la lutte. C'est avec raison que nous disons qu'il se résigna à accepter de nouveau l'esclavage, car cet animal n'était pas un cheval sauvage, mais bien le magnifique barbe de don Estevan, que celui-ci avait probablement perdu pendant le combat lorsqu'il avait été blessé. Les harnais du cheval étaient en partie brisés et déchirés par les ronces, mais cependant encore en état de servir.
Le chef, joyeux de la bonne aubaine que lui procurait le hasard, monta sur le cheval et retourna auprès de l'Églantine, qui, soumise et obéissante comme une véritable femme indienne, n'avait pas bougé depuis son départ.
—L'Aigle-Volant retournera dans son village monté sur un coursier digne d'un aussi grand chef, lui dit-elle en l'apercevant.
L'Indien sourit avec orgueil.
—Oui, répondit-il, les sachems seront fiers de lui.
Et avec ce naïf enfantillage qui s'allie si bien à la rudesse primitive de ces hommes de fer, il s'amusa à exécuter pendant quelques instants les passes, les voltes et les courbettes les plus difficiles, heureux de l'admiration effrayée de celle qu'il aimait et qui ne pouvait s'empêcher de trembler en le voyant manœuvrer aussi facilement ce magnifique animal. Le chef mit enfin pied à terre et vint, tout en conservant dans la main la bride du cheval, s'asseoir auprès de la jeune femme.
Ils demeurèrent ainsi assez longtemps côte à côte sans échanger une parole: l'Aigle-Volant paraissait réfléchir profondément. Ses yeux erraient çà et là dans les ténèbres, comme s'il eût voulu pénétrer et distinguer dans l'obscurité quelque objet lointain; il écoutait avidement les bruits de la solitude, en jouant machinalement avec son couteau à scalper.
—Les voilà! s'écria-t-il tout à coup en se relevant, comme poussé par un ressort.
L'Églantine le regarda avec étonnement.
—Ma sœur n'entend-elle pas? lui demanda-t-il.
—Oui, fit-elle après un instant, j'entends un bruit de chevaux dans les halliers.
—Ce sont les visages pâles qui regagnent leur camp.
—Allons-nous donc les suivre?
—L'Aigle-Volant ne quitte jamais sans raison le sentier tracé par ses mocassins; l'Églantine accompagnera le guerrier.
—Mon père en doute-t-il?
—Non; l'Églantine est une digne fille des Comanches; elle viendra sans murmurer. Un visage pâle, ami de Mahchsi-Karehde, est en danger en ce moment.
—Le chef le sauvera.
L'Indien sourit.
—Oui, dit-il; ou, si j'arrive trop tard pour cela, au moins je le vengerai, et son âme tressaillira de joie dans les Prairies bienheureuses en apprenant de son peuple que son ami ne l'a pas oublié.
—Je suis prête à suivre le chef.
—Partons donc alors, car il est temps.
L'Indien se mit en selle d'un bond: l'Églantine se prépara à le suivre à pied.
Les femmes indiennes ne montent jamais le cheval de guerre de leurs maris ou de leurs frères. Condamnées par les lois qui régissent leurs peuplades à demeurer constamment courbées sous un joug de fer, à être réduites à la plus complète abjection, et à s'occuper des travaux les plus durs et les pénibles, elles supportent tout sans se plaindre, persuadées qu'il en doit être ainsi, et que rien ne saurait les soustraire à l'implacable tyrannie qui pèse sur elles depuis leur naissance jusqu'à leur mort. En obligeant sa femme à le suivre à pied au milieu d'une forêt vierge par des chemins impraticables, rendus plus difficiles encore à cause des ténèbres, l'Aigle-Volant était convaincu qu'il ne faisait qu'une chose toute simple et toute naturelle; l'Églantine, de son côté, le comprit ainsi, car elle ne se permit pas la moindre observation.
Ils se mirent donc en route, tournant le dos à la rivière et s'avançant du côté de la clairière.
Dans quel but le chef retournait-il sur ses pas et reprenait-il le trajet qu'il avait accompli une heure auparavant afin de s'éloigner des gambucinos?
C'est ce que bientôt nous apprendrons probablement.
A une centaine de mètres de la clairière environ, ils entendirent le bruit d'un coup de feu.
L'Aigle-Volant s'arrêta.
—Ooah! murmura-t-il, que se passe-t-il donc? Me serais-je trompé?
Mettant immédiatement pied à terre, il donna son cheval à garder à sa femme, en lui ordonnant de le suivre à distance; et se glissant parmi les herbes, il s'avança en toute hâte vers la clairière, inquiet de ce coup de feu qu'il ne savait à quoi attribuer, car l'idée ne lui vint pas un seul instant que ce fût don Estevan qui l'eût tiré dans l'intention de se tuer; le chef était convaincu qu'un homme de ce caractère n'abandonnait jamais une partie, quelque désespérée qu'elle fût. Son appréciation n'était pas complètement fausse.
Persuadé de ce que nous avons dit plus haut, l'Aigle-Volant, redoutant un malheur dont il semblait avoir prévu la possibilité, se hâtait donc de gagner la clairière, afin d'éclaircir ses doutes, et tremblant de les voir se changer en certitude.
Arrivé sur la lisière de la clairière, il s'arrêta, écarta les branches avec précaution, et regarda. Les ténèbres étaient tellement épaisses, qu'il ne put rien distinguer; un silence funèbre régnait sur cette partie de la forêt. Soudain les buissons s'écartèrent, un homme, ou plutôt un démon, bondit comme un chacal, passa auprès de lui avec une vélocité extrême, et se perdit bientôt dans l'obscurité.
Un triste pressentiment serra le cœur du peau-rouge; il fit un mouvement pour se lancer à la poursuite de l'inconnu; mais se ravisant presqu'aussitôt.
—Voyons ici d'abord, murmura-t-il; cet homme je suis certain de le retrouver quand je le voudrai.
Il entra dans la clairière. Les feux abandonnés ne jetaient plus aucune lueur, tout était ombre et silence. Le chef marcha rapidement vers l'endroit où la fosse avait été creusée. Elle était vide, don Estevan avait disparu; sur le revers du talus, formé par les terres rejetées en dehors de la fosse, un homme étendu gisait sans mouvement.
L'Aigle-Volant se pencha sur lui et l'examina attentivement pendant quelques secondes.
—Je le savais! murmura-t-il en se redressant avec un sourire de dédain, cela devait arriver ainsi, les faces pâles sont de vieilles femmes bavardes, l'ingratitude est un vice blanc, la vengeance est une vertu rouge.
Le chef demeura pensif, les yeux fixés sur le blessé.
—Le sauverai-je? reprit-il enfin. A quoi bon? Ne vaut-il pas mieux laisser les coyotes se déchirer entre eux; les guerriers rouges se rient de leur fureur; celui-là ajouta-t-il, était cependant un des meilleurs entre ces faces pâles pillardes qui viennent nous relancer jusque dans nos derniers refuges! Bah! Que m'importe! Nos deux races sont ennemies; les bêtes fauves l'achèveront, à chacun sa proie.
Et il fit un geste pour s'éloigner. Soudain il sentit une main se poser sur son épaule, et une voix timide murmura doucement à son oreille:
—Ce visage pâle est l'ami de la tête grise qui a délivré l'Aigle-Volant; le sachem l'ignore-t-il?
Le chef tressaillit à cette question qui répondait si bien à ses pensées intérieures; car, tout en se parlant à lui-même et en cherchant à se prouver qu'il avait raison d'abandonner le blessé, l'Indien savait fort bien que l'action qu'il préméditait était répréhensible et que l'honneur exigeait qu'il secourût l'homme étendu à ses pieds.
—L'Églantine connaît ce chasseur? répondit-il évasivement.
—L'Églantine l'a vu il y a deux jours pour la première fois, lorsqu'il a sauvé si courageusement l'ami du chef.
—Ooah! murmura l'Indien, ma sœur dit vrai; ce guerrier est brave, son cœur est large, il est l'ami des peaux-rouges, l'Aigle-Volant est un chef renommé pour sa grandeur d'âme, il n'abandonnera pas le visage pâle aux hideux coyotes.
—Mahchsi-Karehde est le plus grand guerrier de sa nation, sa tête est pleine de sagesse, ce qu'il fait est bien.
L'Aigle-Volant sourit avec satisfaction à ce compliment de la jeune femme.
—Visitons les blessures de cet homme.
L'Églantine alluma une branche d'ocote dont elle se fit une torche; les deux Indiens se penchèrent sur le blessé toujours immobile, et à la flamme vacillante de la torche, ils l'examinèrent de nouveau et plus attentivement.
Balle-Franche n'avait qu'une blessure légère occasionnée par le pommeau du pistolet dont il avait été frappé; la force du coup, en amenant une abondante hémorragie, avait causé un étourdissement suivi d'une syncope; la plaie était assez étroite, peu profonde et placé à la partie supérieure du front entre les deux sourcils; évidemment, don Estevan avait essayé d'assommer le digne chasseur de la même façon que dans les Corridas de toros de México; les espadas expérimentés se plaisent parfois à tuer ainsi un taureaux, afin de faire briller leur adresse aux yeux de tous les spectateurs groupés anxieusement sur les gradins del acho. Son coup, bien que lancé d'une main ferme, avait été porté trop précipitamment, et n'avait pas été calculé assez sûrement pour être mortel; seulement, il est évident que si le chef indien ne l'avait pas secouru avant la fin de la nuit, le chasseur aurait été tout vivant dévoré par les bêtes fauves qui rôdaient aux environs en quête d'une proie.
Tous les Indiens, lorsqu'ils sont en voyage, portent sur eux, passé en bandoulière, un sac en parchemin qui a à peu près la forme d'une gibecière et qu'ils nomment sac à la médecine; ce sac contient les simples dont ces hommes primitifs se servent afin de guérir les blessures qu'ils reçoivent dans les combats, leurs instruments de chirurgie et les poudres destinées à couper les fièvres.
Après avoir examiné la blessure de Balle-Franche, le chef hocha la tête avec satisfaction, et il se mit immédiatement en devoir de la panser. Avec un instrument tranchant fait d'une pierre d'obsidienne aiguisée et coupant comme un rasoir, il commença d'abord, aidé par l'Églantine, par raser les cheveux autour de la plaie; ensuite il fouilla dans son sac à la médecine, en tira une poignée de feuilles d'oregano qu'il pila et pétrit avec soin, avec de l'eau-de-vie de Barcelone nommé refino. Nous ferons remarquer ici que, dans tous les médicaments indiens, l'eau-de-vie joue un grand rôle; il ajouta à ce mélange un peu d'eau et de sel, forma du tout une pâte assez compacte, et après avoir lavé la plaie à deux reprises avec de l'eau coupée de refino, il appliqua dessus cette espèce de cataplasme, en l'assujettissant avec des feuilles d'abanijo.
Ce remède si simple produisit un effet presque instantané: au bout de dix minutes au plus, le chasseur poussa un soupir, ouvrit les yeux, et se redressa en regardant de tous les côtés, comme un homme réveillé en sursaut d'un profond sommeil, et qui ne se rend pas encore bien compte des objets extérieurs.
Cependant Balle-Franche était un homme doué d'une organisation trop solide pour que cet état durât longtemps; bientôt il parvint à remettre de l'ordre dans ses idées, se souvint de ce qui s'était passé, et de la trahison dont il avait été la victime de la part de l'homme qu'il avait sauvé.
—Merci, peau-rouge, dit-il d'une voix faible encore, en tendant la main au chef.
Celui-ci la serra cordialement.
—Mon frère se sent mieux, répondit-il avec sollicitude.
—Je me sens aussi bien maintenant que si rien ne m'était arrivé.
—Ooah! Mon frère se vengera de son ennemi alors.
—Rapportez-vous-en à moi pour cela, le traître ne m'échappera pas, aussi vrai que mon nom est Balle-Franche, répondit énergiquement le chasseur.
—Bon! Mon frère tuera son ennemi, et il suspendra sa chevelure à l'entrée de son wigwam.
—Non, non, chef, cette vengeance peut convenir à un peau-rouge, mais ce n'est pas celle d'un homme de ma race et de ma couleur.
—Que fera donc mon frère?
Le chasseur sourit finement, puis au bout de quelques instants, il reprit la conversation, mais sans répondre à la demande de l'Indien.
—Depuis combien de temps me trouvé-je ici? dit-il.
—Une heure environ.
—Pas davantage?
—Non.
—Dieu soit loué! Mon assassin ne peut être loin encore.
—Och, une mauvaise conscience est un puissant aiguillon, observa sentencieusement l'Indien.
—C'est juste.
—Que veut faire mon frère?
—Je ne sais encore; la position est des plus délicates pour moi, reprit Balle-Franche d'un air pensif; poussé par mon cœur et le souvenir d'un service rendu il y a longtemps déjà, j'ai commis une action qui peut être interprétée de plusieurs façons différentes; je reconnais maintenant que j'ai eu tort; cependant je vous avoue, peau-rouge, que je ne me soucie nullement d'être en butte aux reproches de mes amis; il est dur pour un homme de mon âge, dont les cheveux sont blancs et qui devrait avoir de l'expérience, de s'entendre dire qu'il a agi comme un enfant, et qu'il n'est qu'un sot.
—Il vous faut pourtant prendre un parti.
—Je le sais bien; voilà justement ce qui me tourmente, d'autant plus qu'il est urgent que don Miguel et don Mariano soient avertis le plus tôt possible de ce qui est arrivé, afin de remédier aux suites de ma sottise.
—Écoutez, dit le chef, je comprends combien l'aveu qu'il vous faut faire vous répugne; il est excessivement pénible pour un vieillard de courber la tête sous des reproches, quelque mérités qu'ils soient.
—Eh bien?
—Si vous y consentez, je ferai moi, ce que vous avez tant de peine à vous résoudre à faire. Pendant que vous accompagnerez l'Églantine, j'irai trouver vos amis, les visages pâles; je leur rapporterai ce qui s'est passé, je les mettrai en garde contre leur ennemi, et vous, vous n'aurez rien à redouter de leur colère.
A cette proposition du chef indien, le rouge de l'indignation empourpra le visage du chasseur.
—Non, s'écria-t-il avec véhémence, je n'ajouterai pas une lâcheté à ma faute; je saurai subir les conséquences de mon action, tant pis pour moi; je vous remercie, chef; votre proposition part d'un bon cœur, mais je ne puis l'accepter.
—Mon frère est le maître.
—Hâtons-nous, s'écria le chasseur, nous n'avons perdu que trop de temps; Dieu sait quelles peuvent être les conséquences de mon action et les malheurs qui peut-être en découleront. S'il m'est impossible de les prévenir, il est de mon devoir de faire tout pour en amoindrir la portée; venez, chef, suivez-moi, rendons-nous au camp sans plus tarder.
En prononçant ces paroles, le chasseur se leva avec une impatience fébrile.
—Je suis sans armes, reprit-il, le misérable me les a enlevées.
—Que mon frère ne se chagrine pas pour cela, répondit l'Indien, il trouvera au camp les armes nécessaires.
—C'est vrai; allons retrouver mon cheval que j'ai laissé à quelques pas.
L'Indien l'arrêta.
—C'est inutile, dit-il.
—Comment cela?
—Cet homme s'en est emparé.
Le chasseur se frappa le front avec découragement.
—Que faire, murmura-t-il.
—Mon frère prendra mon cheval.
—Et vous, chef?
—J'en ai un autre,
—Ah! reprit Balle-Franche.
Sur un signe de l'Aigle-Volant, l'Églantine amena le cheval.
Les deux hommes se mirent en selle; le chef prit sa femme en croupe et se penchant sur le cou de leurs chevaux, ils s'élancèrent à toute bride dans la direction du camp des gambucinos, où ils arrivèrent au bout d'une heure environ sans nouvel accident.
Il nous faut maintenant revenir à deux des principaux personnages de cette histoire, que nous avons négligés trop longtemps; pour cela nous ferons quelques pas en arrière, et nous reprendrons notre récit au moment où Addick, suivi des deux jeunes filles que don Leo venait de lui confier, se dirigeait vers Quiepaa-Tani.
Un frisson de volupté inouïe parcourut le corps de l'Indien, dès qu'il se vit dans la plaine avec les jeunes filles, loin des regards inquisiteurs de don Leo et de ceux plus clairvoyants encore de Bon-Affût. Son œil pétillant de plaisir courait de doña Laura à doña Louisa, sans pouvoir s'arrêter plus sur l'une que sur l'autre. Toutes deux il les trouvait si belles, qu'il ne se rassasiait pas de les contempler avec la frénétique admiration qu'éprouvent les Indiens à la vue des femmes Espagnoles, qu'ils préfèrent infiniment à celles de leurs tribus.
Or, tout en faisant remarquer cette particularité au lecteur, nous devons ajouter que, de leur côté, les Espagnols recherchent avidement les bonnes grâces des Indiennes auxquelles ils trouvent d'irrésistibles attraits. Est-ce l'effet d'une sage combinaison de la Providence, qui veut accomplir la fusion des deux peuples d'une façon complète? Nul ne le sait; mais ce qu'on ne peut mettre en doute, c'est qu'il est peu d'Espagnols de l'Amérique du Sud qui n'aient quelques gouttes de sang indien dans les veines.
Le jeune chef indien, en possession de ses deux captives—car c'est ainsi qu'il les considéra aussitôt qu'elles furent placées sous sa garde—avait d'abord songé à les conduire au milieu de sa tribu, sauf à savoir plus tard sur laquelle il jetterait son dévolu; mais plusieurs raisons lui firent abandonner ce projet presque aussitôt qu'il l'eut conçu. D'abord, la distance à traverser pour gagner sa tribu était immense, il était peu probable qu'il parvînt à la franchir en compagnie de deux femmes frêles et délicates qui ne pourraient supporter les fatigues sans nombre d'un voyage dans le désert; d'un autre côté, la ville n'était qu'à deux milles au plus devant lui, la foule qui augmentait de plus en plus lui ôtait la liberté de ses mouvements, et les sombres silhouettes des deux chasseurs qui se détachaient en noir au sommet de la colline, l'avertissaient qu'au moindre mouvement suspect, il verrait se dresser devant lui deux ennemis formidables.
Faisant donc de nécessité vertu, il renferma au plus profond de son cœur les émotions qui l'agitaient, et résolut d'accomplir ostensiblement sa mission en entrant dans la ville; mais il se réservait de confier les jeunes filles à son frère de lait Chicuhcoatl—huit serpents[1]—Amantzin[2] de Quiepaa-Tani, qui, en sa qualité de grand-prêtre du temple du Soleil, avait la possibilité de les cacher à tous les yeux, jusqu'au jour où tous les obstacles étant levés, Addick serait libre d'agir à sa guise et de reprendre ses captives.
Les malheureuses jeunes filles séparées violemment des deux seuls amis qui leur restaient, étaient tombées dans un état de prostration qui leur ôtait la faculté de s'apercevoir des hésitations et des tergiversations du guide perfide entre les mains duquel elles se trouvaient. Livrées sans défense aux volontés d'un sauvage, qui pouvait, si l'envie lui en prenait, se porter à toutes les violences envers elles, bien qu'on leur eût garantit sa fidélité, elles savaient qu'elles n'avaient à attendre aucun secours humain. Force leur fut donc d'abandonner leur sort à Dieu, et de se résigner chrétiennement aux dures épreuves que sans doute elles auraient à subir pendant leur séjour au milieu des Indiens.
Les trois voyageurs mêlés à la foule toujours plus épaisse de ceux qui, comme eux, se dirigeaient vers la ville, ne tardèrent pas à atteindre les bords des fossés, suivis par les regards inquisiteurs de ceux qui les entouraient; car les Indiens n'avaient pas tardé à reconnaître les jeunes filles pour Espagnoles.
Addick, après avoir d'un regard ordonné la prudence à ses compagnes, prit l'air le plus insouciant qu'il lui fut possible d'affecter, quoique son cœur battît à lui briser la poitrine, et se présenta pour entrer.
Après avoir franchi le pont de bois, il arriva impassible en apparence devant la porte.
Alors une lance s'abattit devant les étrangers et leur barra le passage.
Un homme, qu'à son riche costume il était facile de reconnaître pour un chef influent de la cité, se leva de dessus une butaca sur laquelle il était nonchalamment assis, occupé à fumer son calumet, s'avança à pas mesurés, et s'arrêta en considérant attentivement le groupe formé par Addick et ses compagnes.
L'Indien, surpris et presque effrayé d'abord de cette démonstration hostile, se remit presque aussitôt. Un éclair de joie brilla dans son œil fauve, il se pencha vers la sentinelle, et murmura à son oreille quelques paroles d'une voix basse et indistincte.
Le peau-rouge releva immédiatement sa lance avec un geste respectueux, fit un pas en arrière, et leur livra passage.
Ils entrèrent.
Addick se dirigea d'un pas rapide vers le temple du Soleil, en se félicitant, à part lui, d'avoir échappé aussi facilement au danger qui, pendant quelques minutes, avait été suspendu au-dessus de sa tête.
Les jeunes filles le suivirent avec cette résignation du désespoir qui ressemble, à s'y méprendre, à de la docilité et à de la déférence, mais qui n'est, en réalité, que l'impossibilité reconnue de se soustraire au sort que l'on redoute.
Pendant que nos personnages traversent les rues de la ville pour se rendre à leur destination, nous décrirons en quelques mots Quiepaa-Tani, dont le lecteur ne connaît encore que l'extérieur.
Les rues étroites, tirées au cordeau et percées à angle droit, viennent aboutir à une place immense, située juste au centre de la ville, et qui porte le nom de Conaciuhtzin[3]. Il est probable que c'est dans le but d'être agréable au soleil que les Indiens ont imaginé cette place d'où rayonnent toutes les rues de la ville, car on ne peut se figurer une plus exacte représentation de l'astre qu'ils vénèrent que cette disposition mystérieusement et emblématiquement symétrique.
Quatre magnifiques Expan ou palais s'élèvent dans la direction des quatre points cardinaux; sur la face ouest, se trouve le grand temple nommé Amantzin-expan, entouré d'un nombre infini de colonnes ciselées d'or et d'argent.
L'aspect de cet édifice est des plus imposants; on arrive au seuil par un escalier de vingt marches faites chacune d'une seule pierre de dix mètres de long; les murs sont excessivement élevés, et le toit, comme celui des autres édifices, se termine en terrasse. Les Indiens, qui connaissent parfaitement le moyen de construire des voûtes souterraines, ignorent complètement l'art de lancer des dômes dans les airs. L'intérieur du temple est relativement d'une grande simplicité. De longues tapisseries brodées en plumes de mille couleurs, et représentant au moyen de l'écriture hiéroglyphique toute l'histoire de la religion indienne, couvrent les murailles. Au centre du temple est placé un teocali ou autel isolé, surmonté d'un soleil éclatant d'or et de pierreries s'appuyant sur la grande ayolte ou tortue sacrée. Par un artifice ingénieux, chaque matin les premiers rayons du soleil levant viennent frapper et font étinceler des feux les plus brillants cette splendide idole qui semble alors se vivifier et éclairer véritablement tout ce qui l'environne. Devant l'autel est placée la table des sacrifices, immense bloc de marbre ressemblant à un de ces menhirs druidiques si communs dans la vieille Armorique. C'est une sorte de table en pierre soutenue par quatre blocs de rocher. La table légèrement creusée au centre, est pourvue d'un conduit destiné à l'écoulement du sang des victimes. Disons vite que les sacrifices humains tendent chaque jour à se raréfier; nous sommes heureusement loin du temps où pour faire la dédicace d'un temple on immolait en un seul jour, à México, soixante mille victimes humaines; maintenant ces sacrifices n'ont lieu que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, et alors les victimes sont choisies seulement parmi les condamnés à mort. Au fond du temple est une enceinte fermée par d'épais rideaux et interdite au peuple. Ces rideaux cachent l'entrée d'un escalier qui conduit aux vastes souterrains s'étendant sous tout le temple, et dans lesquels les prêtres seuls ont le droit de descendre. C'est dans l'endroit le plus secret et le plus retiré de ces souterrains que brûle sans interruption le feu sacré de Moctecuzoma[4]. Le seuil du temple est jonché de feuilles et de fleurs renouvelées chaque matin.
Sur la face sud de la place s'élève le tanamitec ou palais du chef.
Ce palais, dont le nom traduit littéralement signifie endroit entouré de murailles, n'est qu'une suite de salles de réception et d'immenses cours qui servent aux guerriers chargés de la défense de la ville, pour leurs exercices militaires. Un corps de bâtiments séparé, et dans lequel les visiteurs ne sont pas admis, est affecté au logement de la famille du chef. Un autre corps de bâtiment sert d'arsenal et renferme toutes les armes de la ville, telles que les flèches, les sagaies, les lances, les arcs et les boucliers indiens depuis les temps les plus reculés, les sabres, les épées et les fusils européens, dont, après les avoir tant redoutés, les aborigènes sont parvenus à se servir aussi bien que nous, si ce n'est mieux.
La plus grande curiosité sans contredit que renferme cet arsenal est un petit canon ayant appartenu à Cortez, et que ce conquérant fut forcé d'abandonner sur la grande chaussée, lors de sa retraite précipitée de México pendant la noche triste. Ce canon est encore aujourd'hui, pour les Indiens, un objet de vénération et de crainte, tant les souvenirs de la conquête sont restés palpitants au fond de leurs cœurs après tant d'années et de vicissitudes de toutes sortes.
Sur cette même place s'élève le fameux Ciuatl-expan, ou palais des vestales. C'est là que, loin du regard des hommes, vivent et meurent les vierges du soleil. Nul homme, le grand-prêtre excepté, ne peut pénétrer dans l'intérieur de cet édifice réservé aux femmes vouées au soleil; une mort affreuse châtierait immédiatement l'audacieux qui tenterait de transgresser cette loi. La vie des vestales indiennes a beaucoup de points de ressemblance avec celle des religieuses qui peuplent les couvents européens. Elles sont cloîtrées, font vœu de chasteté perpétuelle, et s'engagent à ne jamais adresser la parole à un homme, à moins que cet homme ne soit leur père ou leur frère; et dans ce cas, ce n'est qu'à travers une grille et en présence d'une tierce personne qu'elles peuvent converser avec lui, en ayant bien soin de voiler leur visage.
Lorsque, dans les cérémonies, elles paraissent en public ou assistent aux fêtes religieuses dans le temple, elles sont complètement voilées. Une vestale convaincue d'avoir laissé voir son visage à un homme est condamnée à mort.
Dans l'intérieur de leur demeure, elles s'occupent à des travaux de femmes et se livrent avec ferveur à l'accomplissement des rites de leur religion. Les vœux sont volontaires: une jeune fille ne peut être admise à faire partie des vierges du soleil que lorsque le grand-prêtre a acquis la certitude que nul ne l'a forcée à prendre cette détermination, et qu'elle suit réellement sa vocation.
Enfin, le quatrième palais situé à l'est de la place est le plus splendide et en même temps le plus sombre de tous.
On le nomme Iztlacat-expan, ou palais des prophètes: il sert de demeure au Amanani et aux chalchiuh—prêtres.—On ne saurait exprimer l'aspect mystérieux, triste et froid de cette résidence, dont les fenêtres sont garnies d'un treillage de jonc qui obstrue, tant ses mailles sont serrées, presque tout l'éclat du jour. Un silence morne règne continuellement dans cette enceinte; mais parfois, au milieu de la nuit, lorsque tout repose dans la ville, les Indiens endormis se réveillent terrifiés par d'étranges clameurs qui semblent sortir du Iztlacat-expan.
Quelle est la vie des hommes qui l'habitent? A quoi passent-ils leur temps? Nul ne le sait! Malheur à l'imprudent qui, curieux de s'instruire sur ce point, chercherait à surprendre des secrets qu'il doit ignorer; la vengeance des prêtres offensés serait implacable.
Si le vœu de chasteté est imposé aux vestales, il n'en est pas de même à l'égard du grand-prêtre et de ses prêtres; cependant, nous devons faire observer qu'il en est bien peu qui se marient, tous s'abstiennent, au moins ostensiblement, d'entretenir des liaisons avec l'autre sexe. Le noviciat des prêtres dure dix ans, ce n'est qu'après l'expiration de ce laps de temps, et après avoir subi des épreuves sans nombre, que les novices prennent le titre de chalchiuh. Jusque là, ils peuvent revenir sur leur détermination et embrasser une autre carrière; mais ce cas est extrêmement rare. Il est vrai que, s'ils profitaient de la faculté que leur accorde la loi, ils seraient infailliblement assassinés par leurs confrères qui craindraient de voir une partie de leurs secrets dévoilés au vulgaire. Du reste, les prêtres sont fort respectés des Indiens dont ils savent se faire aimer; on peut dire qu'après le chef, le Amanani est l'homme le plus puissant de la tribu.
Chez ces peuples où la religion est un si formidable levier, il est à remarquer que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel n'entrent jamais en lutte; chacun sait jusqu'où vont ses attributions et suit la ligne qui lui est tracée, sans chercher à empiéter sur les droits de l'autre. Grâce à cette intelligente diplomatie, prêtres et chefs marchent de concert et doublent leurs forces.
L'Européen habitué au tumulte, au bruit et au mouvement des villes de l'Ancien-Monde, dont les rues sont constamment encombrées de voitures de toutes sortes et de passants affairés qui se heurtent, se choquent et se bousculent à chaque pas, serait étrangement surpris à l'aspect de l'intérieur d'une ville indienne. Là, pas de bruyantes voies de communication, bordées de boutiques magnifiques offrant à la curiosité ou à la convoitise des acheteurs et des filous ces superbes et éblouissant spécimens de l'industrie européenne. Là, pas de voitures, ni même de charrettes; le silence n'est troublé que par le pas de rares passants qui se hâtent de regagner leur demeure, et qui marchent avec la gravité empesée des savants ou des magistrats de tous pays.
Les maisons, qui toutes sont fermées hermétiquement, ne laissent au dehors transpirer aucun des bruits du dedans. La vie indienne est concentrée dans la famille; murée pour l'étranger, les mœurs sont patriarcales, et la voie publique ne devient jamais, ainsi que cela arrive trop souvent chez nous autres peuples civilisés, le théâtre honteux des disputes, des luttes ou des rixes des citoyens.
Les marchands se réunissent dans d'immenses bazars, où, jusqu'à midi, ils débitent leurs marchandises, c'est-à-dire leurs fruits, leurs légumes et leurs quartiers de viande; car tout autre commerce est inconnu chez les Indiens, chaque famille tissant et confectionnant elle-même ses vêtements et les objets, meubles ou ustensiles de ménages qui lui sont nécessaires; puis, lorsque le soleil est arrivé à la moitié de sa course, les bazars se ferment et les Indiens marchands, qui tous habitent la campagne, sortent de la ville pour n'y rentrer que le lendemain avec des denrées fraîches. Chacun fait sa provision pour la journée.
Chez les Indiens, les hommes ne travaillent jamais, ce sont les femmes qui, seules, sont chargées des achats, des soins du ménage et de la préparation de tout ce qui est indispensable à l'existence. Les hommes, trop fiers pour s'astreindre aux travaux d'intérieur, chassent ou font la guerre.
Le payement de ce que l'on vend ou de ce que l'on achète ne se fait pas, comme en Europe, au moyen d'espèces sonnantes qui, en général, ne sont connues ou acceptées que par les Indiens du littoral qui trafiquent avec les blancs, mais bien au moyen du libre échange qui se pratique chez toutes les tribus qui habitent l'intérieur des terres. Le moyen est des plus simples. L'acheteur troque un objet quelconque contre celui qu'il veut acquérir, et tout est dit.
Or, maintenant que nous avons fait connaître Quiepaa-Tani au lecteur, terminons ce chapitre en disant que Addick et ses compagnes, après avoir pendant assez longtemps erré à travers les rues désertes de la ville, étaient arrivés au Iztlacat-expan.
Le chef indien avait, selon ses désirs, trouvé dans le Amanani un complaisant auxiliaire, qui lui avait promis sur sa tête de veiller, avec une scrupuleuse attention, sur les prisonnières qu'il se chargeait de garder en dépôt.
Il est bon d'ajouter que Addick avait appris au grand-prêtre que celles qu'il lui confiait étaient filles d'un des plus puissants gentilshommes du Mexique, et qu'afin d'obliger celui-ci à accorder sa protection aux Indiens, il était résolu à prendre une d'elles pour épouse; seulement, comme les deux filles lui plaisaient également, et que pour cette raison il lui avait été impossible jusqu'à ce moment de faire un choix entre elles, il s'abstint prudemment de désigner celle qu'il préférait; il ajouta, afin de conquérir complètement les bonnes grâces de l'homme qu'il prenait pour complice, et dont l'avarice sordide lui était connue de longue date, qu'un magnifique présent le récompenserait largement de la tutelle qu'il le priait d'accepter.
Tranquille désormais sur le sort des jeunes filles, et la première partie du plan qu'il avait formé ayant complètement réussi, Addick se mit en mesure de faire réussir de même la seconde; il prit en conséquence assez lestement congé de celles qu'il avait juré de protéger et qu'il trahissait indignement, et remontant à cheval, il sortit de la ville et se dirigea en toute hâte vers le gué del Rubio où il savait rencontrer don Leo.
[1] De Chicuey huit, coalt serpent.
[2] D'Amanani devin.
[3] Place du soleil.
[4] Voir Le Chercheur de pistes, 1 vol. in-12. Amyot, éditeur.
Laissons Addick tout à ses plans de trahison s'éloigner au galop de Quiepaa-Tani, et occupons-nous un peu des deux jeunes filles qu'il avait, avant son départ, confiées au Amanani.
Celui-ci les avait enfermées dans le Ciuatl-expan, habité par les vierges du soleil.
Bien que prisonnières, elles étaient traitées avec les plus grands égards, d'après l'ordre qu'en avait donné Addick, et elles auraient peut-être supporté les ennuis de leur injuste captivité avec patience, si une inquiétude profonde sur le sort qui leur était réservé et une tristesse invincible, résultant des événements dont elles avaient été victimes et des circonstances terribles qui les avaient amenées au point où elles se trouvaient, en les séparant brusquement de leur dernier défenseur, ne s'étaient emparées d'elles.
Ce fut alors que se dessina nettement la différence de caractères des deux amies.
Doña Laura, habituée aux hommages empressés des brillants cavaliers qui fréquentaient la maison de son père et aux jouissances de la vie molle et luxueuse, qui est celle de toutes les riches familles mexicaines, souffrit en se sentant privée brutalement des joies et des caresses dont son enfance avait été entourée; oubliant les tortures du couvent pour ne se souvenir que des joies de la maison paternelle, et incapable de résister au chagrin qui la dévorait, elle tomba dans un état de découragement et de torpeur qu'elle n'essaya pas même de combattre.
Doña Luisa, au contraire, qui trouvait dans sa nouvelle condition peu de changement avec son état de novice, tout en déplorant le coup qui la frappait, le subit avec courage et résignation; son âme fortement trempée accepta l'infortune comme la conséquence de son dévouement à son amie.
A son insu peut-être, depuis quelque temps un autre sentiment s'était glissé dans le cœur de la jeune fille, sentiment qu'elle ne cherchait pas à s'expliquer, de la force duquel elle ne se rendait pas bien compte, mais qui doublait son courage et lui faisait espérer une délivrance, sinon prompte, du moins possible, exécutée par l'homme qui déjà avait tout risqué pour son amie et pour elle, et ne les abandonnerait pas dans les nouvelles tribulations dont elles avaient été assaillies par suite de l'odieuse trahison de leur guide.
Lorsque les deux amies s'entretenaient ensemble de quelque probabilité de délivrance, Laura n'osait prononcer le nom de don Miguel, et par une retenue dont la raison est facile à deviner, elle feignait de se reposer sur le nom et la puissance de son père; plus franche, Luisa se contentait de répondre que la bravoure et le dévouement que don Miguel leur avait témoignés lui étaient un sûr garant que celui qui, déjà une fois les avait sauvées, ne tarderait pas à venir à leur secours.
Laura, que sa compagne n'avait pas jugé à propos de mettre au courant des obligations sans nombre qu'elle avait au jeune homme, ne comprenait pas le rapport qui pouvait exister entre lui et l'avenir, et elle interrogeait Luisa. Mais celle-ci restait muette à ce sujet ou éludait la question.
—En vérité, mon amie, lui disait Laura, tu parles sans cesse de don Miguel; certes nous lui devons une grande reconnaissance pour le service qu'il nous a rendu; mais maintenant son rôle est à peu près fini; mon père, averti par lui de la position où nous nous trouvons, viendra avant peu nous délivrer.
—Querida de mi corazón[1], lui répondait Luisa en hochant la tête, qui sait où est ton père en ce moment; moi j'espère dans le secours de don Miguel, parce que lui seul nous a sauvées de son propre mouvement, sans espoir de récompense d'aucune sorte, qu'il est trop loyal et trop homme de cœur pour ne pas terminer une entreprise qu'il a si bien commencée.
Cette dernière phrase fut dite par la jeune fille avec tant de conviction, que Laura en demeura surprise et leva les yeux sur son amie qui se sentit instinctivement rougir sous le poids de ce regard investigateur.
Laura n'ajouta rien, mais elle se demanda en elle-même quelle pouvait être la nature du sentiment qui poussait son amie à prendre la défense d'un homme qu'elle n'attaquait pas et auquel elle, Luisa, n'avait que de médiocres obligations et qu'elle connaissait à peine.
Depuis ce jour, comme par un accord tacite, il ne fut plus parlé de don Miguel, son nom ne fut plus prononcé entre les jeunes filles.
Il est un fait étrange et qui pourtant est d'une vérité incontestable, c'est que, de quelque pays qu'ils soient et à quelque religion qu'ils appartiennent, les prêtres sont continuellement dévorés du désir de faire des prosélytes quand même. Le Amanani de Quiepaa-Tani ressemblait en cela à tous ses confrères. Il n'avait garde de laisser échapper l'occasion qui semblait se présenter à lui de convertir les deux Espagnoles à la religion du Soleil. Doué d'une haute intelligence, foncièrement convaincu de l'excellence du principe religieux qu'il professait, de plus ennemi acharné des Espagnols, il conçut le projet, dès qu'il fut chargé par Addick de veiller sur les jeunes filles, d'en faire des prêtresses du Soleil. En Amérique, il ne manque pas d'exemples de conversions de cette nature, ce qu'elles peuvent avoir de monstrueux pour nous n'a rien qui ne paraisse tout naturel en ce pays.
Le Amanani dressa ses batteries en conséquence. Les jeunes filles ne parlaient pas l'indien; lui, de son côté, ne savait pas un mot d'espagnol; mais cette difficulté énorme en apparence fut vite tournée par le grand-prêtre. Il se trouvait allié à un guerrier renommé appelé Atoyac, celui-là même qui faisait sentinelle à la porte de la ville lors de l'arrivée de Addick. Cet homme avait épousé une Indienne mansa—civilisée—qui, élevée non loin de Monterey, parlait la langue espagnole assez pour se faire comprendre. C'était une femme d'une trentaine d'années environ, bien qu'elle en parût au moins cinquante. Dans ces régions où la croissance est si prompte, une femme se marie ordinairement à douze ou treize ans. Continuellement astreinte aux durs travaux qui dans d'autres pays sont le partage des hommes, leur fraîcheur disparaît bientôt, arrivées à vingt-cinq ans, elles sont atteintes d'une décrépitude précoce qui, dix ans plus tard, fait des êtres repoussants et hideux de femmes qui dans leur jeunesse étaient en général douées d'une grande beauté et de grâces exquises dont bien des Européennes seraient jalouses à juste titre.
La femme de Atoyac se nommait Huitlotl ou le Pigeon: c'était une douce et simple créature qui, ayant beaucoup souffert elle-même, était instinctivement portée à compatir aux douleurs des autres. Or, malgré la loi qui défendait l'introduction des étrangers dans le palais des vierges du Soleil, le grand-prêtre prit sur lui de laisser parvenir le Pigeon auprès des jeunes filles.
Il faut avoir été prisonnier soi-même au milieu d'individus dont on ne comprend pas le langage pour se représenter la satisfaction que durent éprouver les captives en recevant enfin la visite de quelqu'un qui pouvait causer avec elles et les aider à vaincre l'ennui dans lequel elles passaient tout leur temps. L'Indienne fut donc accueillie comme une amie, et sa présence comme une distraction des plus agréables.
Mais, dès la seconde entrevue, les Espagnoles devinèrent dans quel but intéressé ces visites étaient permises, et alors une véritable tyrannie succéda aux courtes et joyeuses conversations des premiers jours. Ce fut pour les jeunes filles un supplice permanent. Espagnoles et attachées à la religion de leurs pères, elles ne pouvaient à aucun prix répondre aux espérances du grand-prêtre, cependant la bonne Indienne, incapable de jouer ce rôle de mensonges et de fourberies auquel on la condamnait, ne leur avait pas caché que, malgré les paroles mielleuses et les manières insinuantes du Amanani, elles devaient s'attendre à souffrir les plus affreux tourments si elles refusaient de se consacrer au culte du Soleil. La perspective était loin d'être rassurante.
Les jeunes filles savaient les Indiens capables de mettre sans le moindre remords leurs odieuses menaces à exécution; aussi, tout en se promettant intérieurement de rester inébranlable dans la foi de leurs pères, les pauvres enfants étaient-elles dévorées de mortelles inquiétudes.
Le temps s'écoulait, le grand-prêtre commençait à s'impatienter de la lenteur de la conversion. Le peu d'espoir que les deux jeunes filles avaient conservé de se soustraire au sacrifice que l'on exigeait d'elles les abandonnait peu à peu.
Cette douloureuse situation, qui s'aggravait encore par l'absence de toute nouvelle du dehors, finit par déterminer chez elles une maladie dont les progrès furent si rapides, que le grand-prêtre jugea prudent de suspendre l'exécution de son ardent projet de prosélytisme.
Laissons pour quelques instants les malheureuses prisonnières se féliciter presque de l'altération survenue à leur santé, et qui pour quelque temps au moins les affranchit des odieuses obsessions dont elles sont l'objet, et reprenons le fil des événements qui survinrent aux autres personnages qui figurent dans cette histoire.
Aussitôt que don Estevan s'était vu libre, il avait enfoncé les éperons dans les flancs du cheval de Balle-Franche, et avait commencé à travers la forêt une course furieuse, dont le but évident était de s'éloigner au plus vite de la clairière qui avait failli lui devenir si épouvantablement fatale.
En proie à une terreur folle que chaque minute qui s'écoulait décuplait encore, le malheureux galopait à l'aventure, sans but et sans pensée, ne suivant aucune direction, mais fuyant tout droit devant lui, poursuivi par le fantôme hideux de la mort qui, pendant une heure longue comme un siècle, s'était penchée sur son épaule et avait déjà tendu son bras de squelette pour le saisir, lorsqu'un hasard miraculeux lui avait tout à coup, à la dernière et suprême minute de son agonie, envoyé un libérateur.
Don Estevan, au fur et à mesure que la lucidité rentrait dans son cerveau, que le calme renaissait dans sa pensée, redevenait l'homme qu'il avait toujours été, c'est-à-dire le scélérat implacable si justement condamné et exécuté par la loi de Lynch. Au lieu de reconnaître dans sa délivrance le doigt tout-puissant de la Providence qui voulait ainsi lui entrouvrir les voies du repentir, il ne vit qu'un fait matériellement accidentel et n'eut plus qu'une pensée, celle de se venger des hommes qui l'avaient abattu et lui avaient posé le pied sur la poitrine.
Combien d'heures galopa-t-il ainsi dans les ténèbres, roulant dans sa tête des projets de vengeance et jetant au ciel d'ironiques regards de défi, nul ne saurait le dire. La nuit tout entière s'écoula dans cette course furibonde, le lever du soleil le surprit à une longue distance du lieu où il avait subi sa sentence.
Il s'arrêta un instant afin de remettre un peu d'ordre dans ses idées et de jeter un regard autour de lui.
Les arbres assez clairsemés à l'endroit où il se trouvait, laissaient découvrir entre leurs troncs éloignés les uns des autres, à peu de distance en avant, une campagne nue terminée au loin par de hautes montagnes dont les cimes bleuâtres se confondaient à l'horizon avec le ciel; une rivière assez large coulait silencieuse entre deux rives escarpées et dénuées de végétation.
Don Estevan poussa un soupir de soulagement; en supposant, ce qui n'était guère probable, que quelqu'un se fût mis à sa poursuite, la rapidité de sa course et les innombrables crochets qu'il avait faits avaient dû complètement dérober ses traces. Il s'avança au petit pas jusqu'à la lisière de la forêt résolu à s'arrêter une heure ou deux afin de laisser reposer son cheval haletant, et de prendre lui-même un repos indispensable après tant de fatigues et d'angoisses.
Dès qu'il eut atteint les premiers arbres du couvert, il s'arrêta de nouveau, s'assura par un regard circulaire que nul être humain n'apparaissait aux environs, et, rassuré par le calme et le silence qui régnaient autour de lui, il mit pied à terre, dessella son cheval qu'il entrava de façon à ce que, sans s'éloigner, il put chercher sa nourriture, et, s'étendant sur le sol, il se mit à réfléchir.
Sa position était loin d'être agréable: il se trouvait seul, presque sans armes, dans un pays inconnu, contraint de fuir les hommes de sa couleur, obligé de ne compter que sur lui-même pour faire face à tous les événements qui surviendraient et aux dangers qui l'environnaient de toutes parts.
Certes, un homme plus résolu que ne l'était don Estevan et doué par la nature d'une organisation plus fortement trempée que celle qu'il possédait, se serait, à sa place, trouvé fort empêché et se serait laissé aller, sinon au désespoir, du moins au découragement. Le Mexicain, vaincu par les atroces émotions et les fatigues inouïes qu'il avait endurées pendant la nuit fatale qui venait de s'écouler, tomba malgré lui dans un état de prostration et d'insensibilité tels, que peu à peu les objets extérieurs disparurent pour ainsi dire à ses yeux, et il n'exista plus que par la pensée, ce phare toujours brillant dans le cerveau humain et que Dieu, dans sa bonté infini, y fait luire dans les plus épaisses ténèbres, afin de rendre à la créature, dans les situations extrêmes, le sentiment de sa force et la volonté de la lutte.
Depuis longtemps déjà don Estevan était assis, le coude sur le genou, la tête dans la main, regardant sans voir, écoutant sans entendre, lorsque tout à coup il tressaillit et se redressa brusquement.
Une main s'était posée doucement sur son épaule.
Si léger qu'eût été cet attouchement, il avait suffi pour réveiller le Mexicain et le rendre au sentiment de sa situation présente.
Il regarda.
Deux hommes, deux Indiens étaient près de lui.
Ces Indiens étaient Addick et le Loup-Rouge.
Un éclair de joie brilla dans l'œil de don Estevan: ces deux hommes, il le pressentait, étaient pour lui deux alliés. Il les désirait sans espérer de les rencontrer jamais.
En effet, dans le désert, peut-on être certain de trouver ceux que l'on cherche? Addick fixait sur lui un regard sardonique.
—Och! dit-il, mon frère pâle dort les yeux ouverts; sa fatigue est grande à ce qu'il paraît.
—Oui, répondit don Estevan.
Il y eut un instant de silence.
—Je n'espérais pas retrouver aussitôt mon frère et surtout dans une position aussi agréable, reprit l'Indien.
—Ah! fit encore don Estevan.
—Oui, aidé par mon frère le Loup-Rouge et ses guerriers, je m'étais mis en marche afin de porter, s'il était possible, secours au visage pâle.
Le Mexicain le regarda d'un air soupçonneux.
—Merci, dit-il enfin avec une mordante ironie, je n'ai eu besoin du secours de personne.
—Tant mieux, cela ne m'étonne pas; mon frère est un grand guerrier dans sa nation; mais peut-être ce secours qui lui a été inutile jusqu'à présent lui servira-t-il plus tard.
—Écoutez, peau-rouge, fit don Estevan, croyez-moi, ne luttons pas de finesse, soyons francs l'un vis-à-vis de l'autre; vous savez de mes affaires beaucoup plus que je n'aurais voulu vous en laisser deviner; comment l'avez-vous appris, peu m'importe; seulement, si je vous connais bien, vous avez une proposition à me faire, proposition que sans doute, d'après la position dans laquelle je me trouve, vous pensez que j'accepterai; faites donc cette proposition clairement, nettement, ainsi qu'un homme doit le faire, et finissons-en, au lieu de perdre un temps précieux en vains discours et en circonlocutions inutiles.
Addick sourit sournoisement.
—Mon frère parle bien, dit-il d'un ton mielleux, sa sagesse est grande; je serai franc avec lui; il a besoin de moi, je veux le servir.
—¡Voto a brios! Voilà qui est parler en homme; ceci me plaît; continuez, chef, si la fin de votre discours ressemble au commencement, je ne doute pas que nous nous entendions.
—Ooah! J'en suis convaincu; mais, avant de nous asseoir au foyer du conseil, mon frère a besoin de reprendre ses forces affaiblies par un long jeûne et de grandes fatigues. Les guerriers du Loup-Rouge sont campés ici près sous le couvert; que mon frère me suive; lorsqu'il aura pris un peu de nourriture, nous terminerons notre affaire.
—Soit, marchez, je vous suis, répondit don Estevan.
Les trois hommes s'éloignèrent alors dans la direction du camp des peaux-rouges, établi en effet à une centaine de pas au plus de l'endroit qu'ils venaient de quitter.
Les Indiens, mieux que tout autre peuple, les Arabes exceptés, entendent les lois de l'hospitalité, cette vertu des races nomades ignorée dans les villes où elle est, à la honte des peuples civilisés, remplacée par un froid égoïsme et une méfiance honteuse.
Don Estevan fut traité par les Indiens aussi bien qu'il leur fut possible de le faire. Après qu'il eut bu et mangé autant que l'exigeaient ses besoins, Addick reprit la parole:
—Mon frère pâle veut-il m'entendre à présent? dit-il; ses oreilles sont-elles ouvertes?
—Mes oreilles sont ouvertes, chef, je vous écoute avec toute l'attention dont je suis capable.
—Mon frère veut se venger de ses ennemis?
—Oui, s'écria don Estevan avec violence.
—Mais ces ennemis sont forts, ils sont nombreux; déjà mon frère a succombé dans la lutte qu'il a voulu soutenir contre eux; un homme, quand il est seul, est plus faible qu'un enfant.
—C'est vrai, murmura le Mexicain.
—Si mon frère consent à accorder au Loup-Rouge et à Addick ce qu'ils lui demanderont, les chefs rouges aideront mon frère dans sa vengeance et s'engagent à la faire réussir.
Une rougeur fébrile empourpra le visage de don Estevan: un mouvement convulsif agita ses membres.
—¡Voto a brios! murmura-t-il d'une voix sombre: quelle que soit la condition que vous me posiez, je l'accepte, si vous me servez comme vous me le dites.
—Que mon frère ne s'engage pas légèrement, reprit en ricanant l'Indien: cette condition, il ne la connaît pas encore; peut-être regretterait-il de s'être trop avancé.
—Je vous répète, répondit fermement don Estevan, que je souscris à cette condition, quelle qu'elle soit; faites-la moi donc connaître sans plus tarder.
Le cauteleux Indien hésita ou parut hésiter trois ou quatre minutes qui durèrent un siècle pour le Mexicain; enfin, il reprit d'une voix perfidement doucereuse:
—Je sais où sont les deux jeunes filles pâles que mon frère cherche vainement.
Don Estevan, à cette parole, bondit comme s'il avait été soudainement piqué par un serpent.
—Vous le savez! s'écria-t-il en lui serrant le bras avec force et en le regardant fixement.
—Je le sais, répondit Addick, toujours impassible.
—Ce n'est pas possible.
L'Indien sourit avec mépris.
—C'est sous ma garde, dit-il, guidées par moi, qu'elles ont été conduites où elles se trouvent maintenant.
—Et vous pouvez m'y conduire?
—Je le puis.
—A l'instant?
—Oui, si vous acceptez mes conditions.
—C'est vrai, dites-les donc.
—Que préfère mon frère: ces jeunes filles ou la vengeance?
—La vengeance!
—Bon, les jeunes filles pâles demeureront où elles sont; Addick et le Loup-Rouge sont seuls, leurs callis sont solitaires, ils ont besoin chacun d'une femme; les guerriers chassent; les ciuatl préparent la nourriture et soignent les papous. Mon frère me comprend-il?
Ces paroles furent prononcées avec une si étrange accentuation que, malgré lui, le Mexicain frissonna; mais se remettant presque aussitôt:
—Et si j'accepte? dit-il.
—Le Loup-Rouge a deux cents guerriers: ils sont à la disposition de mon frère pour l'aider à accomplir sa vengeance.
Don Estevan laissa tomber sa tête dans ses mains: pendant plusieurs minutes, il demeura immobile; cet homme, qui, de sang-froid, avait résolu la mort de sa nièce, hésita à l'odieuse proposition qui lui était faite; cette condition lui semblait plus horrible que la mort.
Les Indiens attendirent, témoins impassibles en apparence du combat qui se livrait dans le cœur de l'homme qu'ils voulaient séduire; ils assistaient à cette lutte des bons et des mauvais penchants, calculant froidement dans leur for intérieur les chances de réussite que leur offraient les mauvais instincts du misérable qu'ils tenaient palpitant sous leur regard. Du reste, la lutte ne fut pas longue: don Estevan releva la tête, et, la voix calme, le visage froid et sans traces d'émotion d'aucune sorte:
—Eh bien, soit, dit-il, le sort en est jeté; j'accepte, je tiendrai ma parole; mais d'abord tenez la vôtre.
—Nous la tiendrons, répondirent les Indiens.
—Avant le huitième soleil, ajouta Addick, les ennemis de mon frère seront en sa puissance; il en disposera comme bon lui semblera.
—Et maintenant que dois-je faire? reprit don Estevan.
—Voici notre projet, fit Addick:
Les trois hommes discutèrent alors le plan de campagne qu'ils voulaient suivre, afin d'atteindre le but qu'ils se proposaient. Mais, comme nous verrons bientôt se dérouler ce plan, nous les laisserons, afin de nous occuper d'autres personnages de cette histoire, vers lesquels il nous faut revenir.
[1] Chérie de mon cœur.
Les personnes réunies sous la tente de don Leo ne purent réprimer un mouvement de surprise et presque d'effroi à l'apparition imprévue de Balle-Franche; pâle, sanglant, les vêtements en désordre.
Le chasseur s'était arrêté à l'entrée de la tente, chancelant et promenant autour de lui des yeux hagards, tandis que peu à peu son visage prenait une expression de douleur et de profond découragement.
Tous ces hommes, habitués à la vie accidentée du désert, dont le courage, incessamment mis aux plus rudes épreuves, ne s'étonnaient de rien, se sentirent cependant frémir intérieurement et eurent le pressentiment d'un malheur.
Balle-Franche demeurait toujours immobile et muet.
Don Leo, le premier, rappela sa présence d'esprit et parvint à reprendre assez de puissance sur lui-même pour interpeler le nouveau venu.
—Qu'avez-vous, Balle-Franche? lui demanda-t-il d'une voix qu'il cherchait vainement à affermir: de quelle fâcheuse nouvelle vous êtes-vous fait le porteur auprès de nous?
Le Canadien passa à plusieurs reprises le revers de sa main sur son front inondé de sueur, et, après avoir jeté un dernier regard circulaire et soupçonneux autour de lui, il se décida enfin à répondre d'une voix basse et inarticulée:
—J'ai à vous annoncer une nouvelle terrible!
Le cœur de l'aventurier se serra; cependant il domina son émotion, et, d'une voix calme avec un soupire résigné:
—Qu'elle soit la bienvenue, car nous ne pouvons en apprendre d'autre; parlez donc, mon ami, nous vous écoutons.
Balle-Franche hésita, une rougeur fébrile envahit son visage; mais faisant un effort suprême:
—Je vous ai trahi! dit-il, lâchement trahi!
—Vous! s'écrièrent les assistants avec un accent de dénégation unanime en haussant les épaules.
—Oui, moi!
Ces deux mots furent prononcés du ton d'un homme dont la résolution est définitivement prise et qui accepte loyalement la responsabilité d'un acte qu'il reconnaît intérieurement blâmable.
Les assistants se regardèrent avec stupeur.
—Hum! murmura Bon-Affût en secouant tristement la tête, il y a là-dessous quelque chose d'incompréhensible; laissez-moi le soin de l'apprendre, continua-t-il en s'adressant à don Leo qui semblait se préparer à adresser de nouvelles questions au chasseur; je sais comment le faire parler.
L'aventurier y consentit d'un geste muet et se laissa retomber sur sa couche, tout en fixant un regard profondément interrogateur sur le Canadien.
Bon-Affût quitta la place que jusqu'à ce moment il avait occupée, et, s'approchant de Balle-Franche, il lui posa la main sur l'épaule. Le Canadien tressaillit à cet attouchement amical, redressa la tête et jeta un regard triste au vieux chasseur.
—Pardieu! fit celui-ci avec un sourire, le diable m'emporte si les oreilles ne nous ont pas tinté tout à l'heure! Voyons, Balle-Franche, mon vieux camarade, que s'est-il passé? Pourquoi cette mine effarée comme si le ciel était sur le point de nous tomber sur la tête? Que signifie cette prétendue trahison dont vous vous accusez et dont je garantis, moi qui vous connais depuis quarante ans, l'impossibilité flagrante.
—Ne vous avancez pas ainsi pour moi, frère, répondit Balle-Franche d'une voix creuse, j'ai manqué à la loi des Prairies, j'ai trahi, vous dis-je.
—Mais, au nom du diable, expliquez-vous alors! Vous ne pouvez avoir traité à notre préjudice avec ces chiens Apaches nos ennemis! Une pareille supposition serait ridicule.
—J'ai fait pis.
—Oh! Oh! Quoi donc alors?
—J'ai... hasarda Balle-Franche en hésitant.
—Quoi?
Don Mariano s'interposa tout à coup.
—Silence, dit-il d'une voix ferme; je devine ce que vous avez fait, et je vous en remercie; c'est à moi qu'il appartient de vous justifier devant nos amis, laissez-moi le faire.
Tous les regards se fixèrent curieusement sur le gentilhomme.
—Caballeros, reprit-il, ce digne homme s'accuse devant vous, comme d'une trahison, d'avoir consenti à me rendre un service immense; en un mot, il a sauvé mon frère!
—Il serait possible! s'écria don Leo avec violence.
Balle-Franche baissa affirmativement la tête.
—Oh! dit l'aventurier; malheureux, qu'avez-vous fait?
—Je n'ai pas voulu être fratricide! répondit noblement don Mariano.
Cette parole éclata comme la foudre au milieu de ces hommes au cœur de lion; ils baissèrent instinctivement la tête, et se sentirent frissonner malgré eux.
—Ne reprochez pas à ce loyal chasseur, reprit don Mariano, d'avoir sauvé ce misérable. N'a-t-il pas été assez puni? La leçon a été trop rude pour qu'elle ne lui profite pas. Forcé de se reconnaître vaincu, courbé sous la honte et les remords, il erre maintenant seul et sans appui sous l'œil tout puissant de Dieu, qui, lorsque son heure sera arrivée, saura bien lui infliger le châtiment de ses crimes! Maintenant, don Estevan n'est plus à redouter pour nous; jamais nous ne le retrouverons sur notre route.
—Arrêtez! s'écria Balle-Franche avec véhémence: s'il devait en être ainsi que vous le dites, je ne me reprocherais pas aussi violemment d'avoir consenti à vous obéir. Non, non, don Mariano, j'aurais du refuser. Morte la bête, mort le venin! Savez-vous ce qu'a fait cet homme? Dès qu'il s'est vu libre, grâce à moi, oubliant aussitôt que j'étais son sauveur, il a voulu traîtreusement m'arracher cette vie que je venais de lui rendre. Regardez la plaie béante de mon crâne, ajouta-il en enlevant d'un geste brusque le bandeau qui entourait sa tête, voilà la preuve de reconnaissance qu'il m'a laissée en se séparant de moi.
Tous les assistants poussèrent une exclamation d'horreur.
Balle-Franche raconta alors dans les plus grands détails, les événements qui s'étaient passés.
Les chasseurs l'écoutèrent avec attention; lorsque son récit fut terminé, il y eut un instant de silence.
—Que faire? murmura don Leo avec tristesse; tout est à recommencer à présent; il ne manque pas dans la Prairie, de misérables avec lesquels cet homme puisse s'entendre.
Don Mariano, accablé par ce qu'il venait d'apprendre, restait sombre et silencieux, sans prendre part à la discussion, reconnaissant intérieurement la faute qu'il avait commise, mais ne se sentant pas le courage de l'avouer et d'assumer ainsi sur lui la responsabilité immense du jugement prononcé par les coureurs des bois.
—Il faut en finir, dit Bon-Affût, les moments sont précieux; qui sait ce que fait ce scélérat pendant que nous délibérons? Levons le camp au plus vite, rendons-nous auprès des jeunes filles, elles doivent être sauvées d'abord; quant à nous, nous saurons bien déjouer les machinations criminelles de ce misérable lorsqu'elles s'adresseront directement à nous.
—Oui! s'écria don Leo, en route, en route! Dieu veuille que nous arrivions à temps!
Et oubliant sa faiblesse et ses blessures, l'aventurier se leva résolument. Balle-Franche l'arrêta; le vieux chasseur, débarrassé du poids qui pesait si lourdement sur sa conscience, avait repris toute son audace et toute sa liberté d'intelligence.
—Permettez, dit-il, nous avons affaire a forte partie, n'agissons pas à la légère, ne nous laissons pas tromper cette fois; voici ce que je propose:
—Parlez, répondit don Leo.
—D'après ce que je connais de cette malheureuse histoire, vous avez, don Miguel, aidé par mon vieux camarade Bon-Affût, caché les deux jeunes filles dans un lieu que vous supposez hors des atteintes de votre ennemi.
—Oui, répondit l'aventurier, à moins d'une trahison.
—Il faut toujours soupçonner une trahison possible au désert, reprit brutalement le chasseur, vous en avez la preuve devant vous; redoublons donc de prudence: don Miguel et sa cuadrilla vont, guidés par moi, se mettre immédiatement à la poursuite de don Stefano; croyez-moi, le plus important pour nous est de nous assurer de la personne de notre ennemi, et, vive Dieu! Pour l'atteindre, je vous jure que tout ce qui est humainement possible de faire, je le ferai; j'ai un terrible compte à régler avec lui maintenant, ajouta-t-il avec une expression de haine concentrée à laquelle personne ne se méprit.
—Mais les jeunes filles? s'écria don Leo.
—Patience, don Miguel; si vous aviez eu autant de forces que de volonté, c'eût été à vous que j'eusse réservé l'honneur de les aller chercher dans l'asile que vous leur avez si judicieusement choisi; mais cette tâche serait trop rude pour vous; laissez donc à Bon-Affût le soin de l'accomplir, soyez certain qu'il vous en rendra bon compte.
Don Leo de Torres demeura un instant sombre et pensif; Bon-Affût lui prit la main, et la lui serrant chaleureusement:
—Le conseil de Balle-Franche est bon, lui dit-il; dans les circonstances présentes, c'est le seul que nous puissions suivre: il nous faut joûter de ruse avec nos adversaires, afin de déjouer leurs fourberies. Laissez-moi ce soin; ce n'est pas en vain que l'on me nomme l'Éclaireur; je vous jure, sur ma vie, que je vous ramènerai les jeunes filles.
L'aventurier poussa un soupir.
—Faites donc comme vous l'entendrez, dit-il d'une voix triste, puisque je suis réduit à l'impuissance.
—Bien, don Leo, s'écria don Mariano, je reconnais que vos intentions sont réellement loyales, je vous remercie de votre abnégation; quant à vous, mon brave ami, ajouta-t-il en se tournant vers Bon-Affût, bien que je sois vieux et peu habitué à la vie de désert, je veux vous accompagner.
—Votre désir est juste, monsieur, je n'ai pas le droit de m'y opposer, puisque c'est votre fille que je vais essayer de sauver; les fatigues que vous endurerez et les périls que vous courrez pendant cette expédition ajouteront encore au bonheur que vous éprouverez à embrasser votre enfant, lorsque je serai parvenu à vous la rendre.
—Maintenant, dit Balle-Franche, vous, Bon-Affût, qui connaissez la direction que vous allez suivre, indiquez-nous un rendez-vous où nous puissions nous réunir lorsque chacun de nous aura accompli la tâche dont il se charge.
—C'est vrai, répondit le Canadien, ceci est important; il serait même bon qu'un détachement de la cuadrilla de don Miguel se rendit directement au rendez-vous que nous allons choisir, afin qu'en cas de malheur chaque troupe put y trouver un secours ou une réserve.
—En effet, quinze de mes hommes les plus résolus iront immédiatement camper au lieu que vous désignerez, Bon-Affût, fit don Leo, afin d'être prêts à se porter partout où leur présence sera nécessaire.
—C'est une guerre en règle que nous faisons, ne l'oublions pas; ne négligeons donc aucune précaution; Ruperto, qui est un vieux chasseur de bisons, prendra, sauf votre bon plaisir, don Leo, le commandement de cette troupe, et il se rendra à Amaxtlan[1].
—Oh! Je connais bien l'endroit, interrompit Ruperto, j'y ai souvent chassé le castor et la loutre.
—Voilà qui est bien, reprit Bon-Affût; maintenant, quoi qu'il arrive, nous devons nous trouver tous au lieu du rendez-vous, d'aujourd'hui en un mois, à moins d'un empêchement grave, et, dans ce cas, le détachement qui manquerait expédierait un émissaire à Ruperto, afin de l'instruire de la cause de son retard; est-ce convenu?
—Oui, répondirent les assistants.
—Mais, ajouta don Leo, vous ne partez pas seul avec don Mariano, je suppose?
—Non, je prends encore Domingo, que, pour certaines raisons à moi connues, je ne suis pas fâché d'avoir constamment sous la main; les deux domestiques de don Mariano me suivront aussi, ils sont braves, dévoués; je n'ai pas besoin de plus de monde.
—C'est bien peu, observa don Leo.
Le vieux chasseur eut un sourire d'une expression indéfinissable.
—Moins nous serons, mieux cela vaudra, dit-il, pour l'entreprise périlleuse que nous tentons; notre petite troupe passera invisible où une plus nombreuse serait arrêtée; rapportez-vous-en à moi.
—Je n'ai plus qu'un mot à ajouter.
—Dites.
—Réussissez!
Le Canadien sourit encore, mais cette fois avec une expression de tendre pitié.
—Je réussirai! répondit-il simplement, en serrant avec force la main que lui tendait son ami.
Les deux hommes s'étaient entendus.
Don Leo sortit alors de la tente.
Bientôt tout fut en mouvement dans le camp. Les gambucinos s'occupaient activement à détruire les retranchements, charger les wagons, seller les chevaux, etc., enfin chacun faisait les préparatifs d'un départ précipité.
—Ne m'avez-vous pas dit, demanda Bon-Affût à Balle-Franche, que vous aviez été relevé par l'Aigle-Volant?
—En effet, répondit celui-ci.
—Le chef s'est-il donc déjà séparé de vous?
—Aucunement; il m'a suivi au camp ainsi que l'Églantine.
—Dieu soit loué! Il m'accompagnera dans mon expédition; c'est un guerrier brave et expérimenté; son aide sera, je le crois, fort nécessaire à la réussite de mes projets. Où est-il resté?
—Ici, à quelques pas; allons le trouver, j'ai certaines chose à lui dire, moi aussi.
Les deux chasseurs quittèrent la tente de compagnie; ils aperçurent bientôt l'Aigle-Volant accroupi devant un feu et fumant impassiblement son calumet indien; sa femme se tenait immobile à ses côtés, attentive à satisfaire ses moindres désirs.
A la vue des chasseurs, le chef ôta sa pipe de sa bouche et les salua courtoisement.
Balle-Franche savait que le Comanche avait pris plusieurs mesures sur les empreintes laissées dans sa fuite par don Estevan; c'étaient ces mesures, dont il espérait se servir plus tard afin de retrouver la piste de son ennemi, qu'il désirait demander au chef.
Celui-ci les lui remit sans faire la moindre difficulté; le chasseur les serra précieusement dans sa poitrine avec un geste de satisfaction.
—Eh! murmura-t-il à part lui, voilà qui me fera trouver, un bout de la piste; avec l'aide de Dieu, j'espère que je ne tarderai pas à atteindre l'autre.
Cependant Bon-Affût s'était assis auprès de l'Aigle-Volant.
—Mon frère rouge compte-t-il toujours retourner dans sa tribu? lui demanda-t-il.
—Il y a longtemps que le sachem est absent, répondit l'Indien; ses fils ont hâte de le voir.
—Bon! fit le chasseur, cela doit être ainsi: l'Aigle-Volant est un chef renommé, ses fils ont besoin de lui.
—Les Comanches sont trop sages pour qu'un guerrier leur fasse faute et que son absence soit remarquée.
—Mon frère est modeste, mais son cœur vole vers le village de ses pères.
—Tous les hommes ne sont-il pas de même?
—C'est vrai, le sentiment de la patrie est inné au cœur de l'homme.
—Les visages pâles lèvent leur camp?
—Oui.
—Retournent-ils du côté du grand lac salé, dans leurs villages en pierre?
—Non, ils partent pour une grande chasse au bison, dans les prairies au bas de la grande rivière sans fin aux lames d'or.
—Ooah! fit le chef avec une certaine émotion; alors bien des lunes se passeront avant que je revoie mon frère.
—Pourquoi cela, chef?
—Le grand chasseur pâle n'accompagne-t-il pas ses frères?
—Non, fit laconiquement Bon-Affût.
—Och! Mon frère veut rire; que feront les visages pâles s'il ne les accompagne pas?
—Je vais du côté du soleil.
L'Indien tressaillit; il fixa un regard perçant sur son interlocuteur.
—Du côté du soleil, dit-il, comme se parlant à lui-même.
—Oui, reprit Bon-Affût, dans les prairies toujours vertes du pays d'Acatlan[2], sur les bords de la belle rivière d'Atonatiuh[3].
Un frémissement soudain agita le corps du chef; Bon-Affût était impassible, indifférent en apparence, bien qu'il suivit attentivement les diverses émotions qui malgré le masque que le chef cherchait à plaquer sur son visage, contractaient ses traits.
—Mon frère a tort, répondit-il au bout d'un instant.
—Pourquoi donc?
—Mon frère ignore que la terre dont il parle est sacrée; jamais le pied d'un blanc ne l'a impunément foulée.
—Je le sais, répondit négligemment le chasseur.
—Mon frère le sait, et il persiste à s'y rendre?
—Oui.
Il y eut entre les deux hommes un silence de quelques minutes; l'Indien aspirait précipitamment la fumée de son calumet, en proie à une émotion qu'il ne pouvait maîtriser. Enfin il reprit la parole:
—Chacun a sa destinée, dit-il de ce ton sentencieux particulier aux Indiens: mon frère attache sans doute une grande importance à ce voyage.
—Une immense; je me rends sur cette terre, bien que je connaisse parfaitement les périls qui m'y attendent, pour des intérêts d'une grande importance, et poussé par une volonté plus forte que la mienne.
—Bon! Je ne demande pas les secrets de mon frère: le cœur d'un homme est à lui, seul il doit y lire; L'Aigle-Volant est un puissant sachem, il suit aussi cette route; il protégera son frère pâle, si les intentions du chasseur sont pures.
—Elles le sont.
—Ooah! Mon frère a la parole d'un chef. J'ai dit.
Après avoir prononcé ces paroles, l'Indien reprit son calumet et recommença à fumer silencieusement. Bon-Affût était trop au fait des mœurs indiennes pour insister davantage; il se leva la joie au cœur d'avoir réussi à s'assurer un allié aussi puissant que le chef comanche, et il alla en toute hâte faire ses préparatifs de départ.
De leur côté, pendant la conversation que nous avons rapportée, les gambucinos n'étaient pas demeurés inactifs; don Miguel ou don Leo, ainsi qu'il plaira au lecteur de le nommer, avait si bien pressé ses gens, que déjà tout était prêt, les wagons chargés et attelés, les cavaliers en selle, le rifle sur la cuisse droite, n'attendaient plus que le signal de la marche.
Don Leo choisit dans sa troupe quinze vieux gambucinos aguerris contre les ruses indiennes, et sur lesquels il croyait pouvoir compter; il leur dit quelques mots afin de les mettre au fait de ses intentions, et les plaça sous les ordres de Ruperto avec injonction de lui obéir en tout, ainsi qu'ils le feraient à lui-même; les gambucinos le lui jurèrent.
Ce devoir accompli, il appela Domingo. Le gambucino arriva auprès de son chef avec cette démarche sournoisement indolente qui lui était particulière, et attendit respectueusement que celui-ci lui expliquât ses ordres.
Quand Domingo sut ce que l'on attendait de lui, il ne fut nullement flatté de la mission de confiance que son chef lui donnait, d'autant plus qu'il se souciait fort peu d'être sous la surveillance immédiate de Bon-Affût, dont le regard perçant avait le privilège de lui occasionner incessamment des tressaillements nerveux, et dont la surveillance assidue lui était des plus désagréables; cependant, comme il était impossible de désobéir ostensiblement à don Leo, le digne gambucino fit contre fortune bon cœur, se promettant in petto de se tenir sur ses gardes et de redoubler de prudence.
Lorsque don Leo se fut acquitté de tous les devoirs d'un chef sage et intelligent, il monta à cheval, bien qu'avec une certaine difficulté, à cause de la faiblesse occasionnée par ses blessures. Il se plaça en tête de sa troupe, à la droite de Balle-Franche, et après avoir fait un dernier signe d'adieu à don Mariano et à Bon-Affût, il donna le signal du départ.
Les deux troupes se mirent immédiatement en marche: celle conduite par Ruperto appuyant sur la gauche, et se dirigeant vers les montagnes, et celle de Balle-Franche suivant provisoirement le cours du Rubio.
Il ne restait plus au camp abandonné que Bon-Affût, don Mariano, l'Aigle-Volant, l'Églantine, les deux domestiques et le gambucino Domingo, qui suivait d'un regard d'envie ses compagnons qui s'éloignaient de plus en plus et qui finirent bientôt par disparaître.
Cette dernière troupe se composait donc de six hommes et d'une femme, en tout sept personnes.
Le vieux chasseur, pour des raisons qu'il gardait secrètes, ne voulait pas se mettre en route avant le coucher du soleil.
A peine cet astre eut-il disparu l'horizon dans des flots de vapeurs, que la nuit fut profonde et le paysage plongé presque immédiatement dans d'épaisses ténèbres.
Nous avons déjà fait plusieurs fois observer que dans les hautes latitudes américaines le crépuscule n'existe pas, ou du moins est tellement faible, que la nuit arrive pour ainsi dire sans transition.
Bon-Affût, depuis le départ des deux premiers détachements, n'avait pas prononcé un mot, pas fait un mouvement; ses compagnons, pour des motifs sans doute analogues aux siens, avaient respecté cette disposition silencieuse de leur chef; mais à peine la nuit fut-elle venue que le chasseur se redressa.
—En route, dit-il d'une voix brève.
Tous se levèrent.
Bon-Affût jeta autour de lui un regard investigateur.
—Laissez vos chevaux, dit-il, ils nous sont inutiles; ce n'est pas un voyage que nous entreprenons, nous commençons une chasse à l'homme; il nous faut être libres de nos mouvements; la piste que nous suivons est difficile. Juanito, vous resterez ici avec les animaux jusqu'à ce que vous receviez de nos nouvelles.
Le criado fit un geste de mécontentement.
—J'aurais préféré vous suivre et ne pas abandonner mon maître, dit-il.
—Je le comprends, mais j'ai besoin qu'un homme courageux et résolu surveille nos animaux, je ne pouvais mieux m'adresser qu'à vous; du reste, j'espère que vous ne demeurerez pas longtemps seul cependant comme nous ne savons quels chemins nous aurons à suivre ni les empêchements qui se dresseront sur notre route, construisez-vous une hutte. Chassez, faites ce que bon vous semblera, mais souvenez-vous que vous ne devez pas bouger d'ici sans mon ordre.
—C'est convenu, compadre, répondit Juanito; vous pouvez partir quand vous voudrez; votre voyage durerait-il six mois que vous seriez certain de me retrouver à votre retour.
—Bon, fit Bon-Affût, je compte sur vous.
Puis il siffla son mustang, qui accourut à son appel, et vint appuyer sa tête intelligente sur l'épaule de son maître qui le flatta. C'était une noble bête, d'une assez grande taille, à la tête petite, mais dont les yeux pétillaient d'ardeur; son large poitrail, ses jambes fines et nerveuses, tout dénotait en lui le cheval de race. Bon-Affût saisit la reata qui pendait par un anneau fixé à la selle de l'animal, la détacha, l'enroula autour de son corps, puis, frappant légèrement la croupe du mustang, il le regarda s'éloigner avec un soupir de regret.
Les compagnons du chasseur s'étaient munis de leurs armes et de vivres, consistant en pennekann, viande de bison séchée et pulvérisée, et en tortillas de maïs.
—Allons, en route! s'écria le Canadien en jetant son rifle sur son épaule.
—En route, firent les autres.
—Bon voyage et heureuse réussite, leur dit Juanito, ne pouvant s'empêcher d'accompagner cet adieu d'un soupir qui laissait deviner combien il était fâché d'être ainsi laissé en arrière.
—Merci, répondirent les aventuriers.
Aussitôt qu'ils eurent quitté le camp, ils prirent la file indienne, c'est-à-dire qu'ils marchèrent l'un derrière l'autre, le second posant ses pieds sur l'empreinte exacte des pas du premier, le troisième sur celle des pas du second, et ainsi de suite jusqu'au sixième et dernier. Seulement celui-ci, comme fermant la marche prenait le soin d'effacer autant que possible les traces laissées par lui et ceux qui le précédaient.
Juanito, après les avoir suivis quelques instants du regard pendant qu'ils descendaient le monticule au sommet duquel se trouvait le camp, vint nonchalamment se rasseoir auprès du feu.
—Hum! murmura-t-il, je vais avoir bien peu d'agrément ici; enfin, puisqu'il le faut!
Et sur cette réflexion philosophique, le digne Mexicain alluma sa cigarette et se mit à fumer paisiblement, en suivant avec intérêt les spirales bleuâtres, fantastiquement contournées par la brise du soir, produites par la fumée de son tabac, pur havane, dont il humait le parfum avec tout le flegme méthodique d'un véritable sagamore indien.
[1] D'Aman, endroit où une rivière se divise en plusieurs branches.
[2] Littéralement pays des roseaux; d'acatl, roseau.
[3] Soleil d'eau; de atl, eau, et tonatiuh, soleil.
Dans le Nouveau-Monde, lorsqu'on se trouve voyager dans les régions indiennes et qu'on tient à ne pas être dépisté par les peaux-rouges, il faut avoir soin de se diriger vers l'est si l'on a affaire dans l'ouest, et vice versa; en un mot, imiter la manœuvre du navire qui, surpris par un vent contraire, est obligé de louvoyer et de tirer des bordées qui le rapprochent insensiblement du point qu'il désire atteindre.
Bon-Affût était trop au fait de l'intelligence et de la finesse des Indiens pour ne pas agir de la même façon. Bien que la présence de l'Aigle-Volant fût, jusqu'à un certain point, une garantie de sécurité pour Bon-Affût, cependant, ignorant avec quel parti indien le hasard le mettrait en contact, il résolut de faire en sorte, si toutefois cela était possible, de n'être découvert par aucun.
Fenimore Cooper, l'immortel historien des Indiens de l'Amérique du Nord, nous a initiés, dans ses excellents ouvrages, aux ruses employées par les Tuscaroras, les Mohegans et les Hurons, lorsqu'ils veulent déjouer les recherches de leurs ennemis; mais, n'en déplaise aux nombreux admirateurs de la sagacité du jeune Uncas, magnifique type de la nation Delaware, dont il ne fut cependant pas le dernier héros, puisque, bien que fort diminuée, elle existe encore, les Indiens des États-Unis ne sont que des enfants, comparées aux Comanches, aux Apaches, aux Pawnees et autres nations des grandes Prairies de l'ouest du territoire mexicain, qui, au reste, peuvent à juste titre, passer pour leurs maîtres sous tous les rapports.
La raison en est toute simple et des plus faciles à comprendre.
Les tribus du nord n'ont jamais réellement existé à l'état de puissances politiques; chacune d'elles se gouverne séparément et en quelque sorte selon sa fantaisie; les Indiens dont elles sont formées s'allient rarement avec leurs voisins, et ont, de temps immémorial, constamment vécu de la vie nomade. Aussi n'ont-ils jamais possédé que les instincts très développés, il est vrai, des hommes qui sans cesse habitent les bois, c'est-à-dire une agilité merveilleuse, une grande finesse d'ouïe et une longueur de vue miraculeuse, qualités que, pour le dire en passant, on retrouve au même degré chez les Arabes et, en général, chez tous les peuples errants, quel que soit le coin de terre qui les abrite.
Pour ce qui est de leur sagacité et de leur adresse, les bêtes fauves les leur ont enseignées, ils n'ont eu que la peine de les imiter.
Les Indiens du Mexique joignent aux avantages que nous avons signalés les restes d'une civilisation avancée, civilisation qui, depuis la conquête, s'est réfugiée dans des repaires inabordables, mais qui n'en existe pas moins de fait.
Les familles ou tribus se considèrent entre elles comme les parties d'un même tout: la nation.
Or la nation américaine, continuellement en lutte avec les Espagnols d'un côté et les Américains du Nord de l'autre, a senti le besoin de doubler ses forces pour triompher des deux formidables ennemis qui la harcèlent sans relâche, et peu à peu ses enfants ont modifié dans leurs mœurs ce qui leur était nuisible, pour s'approprier celles de leurs oppresseurs et les combattre par leurs propres armes; ils ont poussé si loin cette tactique, qui, du reste, les a jusqu'à ce jour sauvés non seulement du joug, mais encore d'une totale extermination, qu'ils sont passés maîtres en fourberies et en ruses; leurs idées se sont agrandies, leur intelligence s'est développée, et ils sont parvenus à surpasser leur ennemis en astuce et en diplomatie, si nous pouvons nous servir de cette expression. Et cela est si vrai que, depuis trois cents ans, ceux-ci non seulement n'ont pas réussi à les dompter, mais même à se soustraire à leurs invasions périodiques, ces invasions que les Comanches nomment superbement la lune du Mexique, et pendant le cours desquelles ils ruinent impunément tout ce qui se rencontre sur leur passage.
Peut-on véritablement considérer comme des sauvages ces hommes qui, refoulés jadis par la terreur des armes à feu et la vue des chevaux, ces animaux dont ils ignoraient l'existence, contraints de se cacher au sein de montagnes inaccessibles, ont cependant défendu leur terrain pied à pied, et, dans certaines régions, sont arrivés à reconquérir une portion de leur ancien territoire?
Mieux que personne, nous savons qu'il existe des sauvages en Amérique, sauvages dans toute l'acception du mot; mais ceux-là on en a eu bon marché, chaque jour ils disparaissent du sol, car ils n'ont ni l'intelligence nécessaire pour comprendre ni l'énergie pour se défendre. Ce sont ces sauvages dont nous parlons qui, avant d'être soumis aux Espagnols ou aux Anglo-américains, l'étaient aux Mexicains, aux Péruviens et aux Araucans du Chili, et cela à cause de leur organisation intellectuelle qui les élève à peine au-dessus de la brute.
Il ne faut pas confondre ces peuplades d'ilotes qui ne sont que des exceptions dans l'espèce, avec les grandes nations indomptées dont nous essayons ici de décrire les mœurs, mœurs qui se modifient sans cesse; car, malgré les efforts qu'elles font pour se soustraire à son influence, la civilisation européenne qu'elles méprisent plutôt encore par haine héréditaire de leurs conquérants et de la race blanche en général que pour tout autre motif, les cerne, les accable et les envahit de toutes parts.
Peut-être avant cent ans les Indiens émancipés qui sourient de pitié à la vue des luttes mesquines que se livrent entre elles les républiques, fantômes qui les entourent, et le colosse pygmée des États-Unis qui les menace, reprendront leur rang dans le monde et porteront haut la tête; et ce sera justice, car ce sont d'héroïques natures richement douées, capables, bien dirigées, d'entreprendre et de mener à fin de grandes choses.
Au Mexique même, depuis l'époque où à la male heure ce pays a proclamé sa soi-disant indépendance, tous les hommes éminents qui ont surgi soit dans les arts, soit dans la diplomatie, soit dans la guerre, appartiennent à la race indienne pure. A l'appui de ce dire, nous citerons un seul fait d'une immense signification: la meilleure histoire de l'Amérique du Sud qui ait été publiée en espagnol jusqu'à ce jour a été écrite par un Inca: Garcilasso de la Vega! Cela n'est-il pas concluant; n'est-il pas temps de faire justice de toutes ces théories systématiquement absurdes qui s'obstinent à représenter la race rouge comme une race bâtarde, incapable d'amélioration et fatalement appelée à disparaître!
Terminant ici cette digression beaucoup trop longue, mais qui était indispensable pour l'intelligence des faits qui vont suivre, nous reprendrons notre récit au point où nous l'avons interrompu.
Après trois heures d'une marche fatigante et difficile dans les hautes herbes, les aventuriers atteignirent les premiers contreforts qu'ils voulaient franchir.
Vers le milieu de la nuit, Bon-Affût, après avoir accordé deux heures de repos à ses compagnons, se remit en marche.
Au lever du soleil, ils arrivèrent à une espèce de cañon ou gorge étroite formée par deux murailles de rochers perpendiculaires, ils furent contraints de marcher pendant quatre heures dans le lit d'un torrent à demi desséché, où les pas ne laissaient heureusement aucune empreinte visible.
Pendant plusieurs jours leur voyage à travers des montagnes abruptes et désolées s'effectua avec de grande fatigues, mais sans offrir d'incident digne d'être rapporté; enfin ils se trouvèrent de nouveau dans la région des tierras calientes; la verdure avait reparu, la chaleur se faisait sentir; aussi les aventuriers, qui venaient de souffrir beaucoup du froid dans les hautes régions de la Serrania, éprouvèrent-ils une sensation de bien-être indicible en aspirant les émanations de cette atmosphère douce et embaumée, en contemplant ce ciel bleu et l'éblouissant soleil qui remplaçaient le ciel gris et blafard et l'étroit horizon chargé de brume et de givre des montagnes qu'ils laissaient derrière eux.
Vers la fin du quatrième jour, après avoir quitté les montagnes, Bon-Affût poussa un cri de satisfaction en apercevant surgir dans les lointains bleuâtres de la Prairie les premiers plans d'une immense forêt vierge vers laquelle il avait dirigé sa marche.
—Courage, mes amis! dit-il, nous rencontrerons bientôt l'ombre et la fraîcheur qui nous manquent ici.
Les aventuriers, sans répondre, allongèrent le pas en hommes qui appréciaient parfaitement la valeur de la promesse qui leur était faite.
La nuit était complète lorsqu'ils atteignirent, non pas la forêt, mais les bords d'une rivière assez large dont les hautes herbes leur avaient dérobé le voisinage, bien que depuis quelques instants ils entendissent le murmure continu de l'eau sur les cailloux de la rive. Bon-Affût résolut d'attendre au lendemain pour chercher un gué.
On campa; mais, par prudence, le feu ne fut pas allumé, les aventuriers se roulèrent dans leurs zarapés après avoir pris un maigre repas, et ne tardèrent pas à s'endormir.
Seul, Bon-Affût veillait.
Cependant la lune descendait à l'horizon, les étoiles commençaient à blanchir et à s'éteindre dans les profondeurs du ciel; le chasseur, dont la fatigue fermait malgré lui les yeux, allait s'abandonner au sommeil, lorsque tout à coup un bruit étrange, inattendu, le fit tressaillir. Il se redressa comme frappé par une commotion électrique, et prêta l'oreille. Un léger frémissement agitait les roseaux qui bordaient la rivière, dont l'eau calme et immobile semblait un long ruban d'argent. Il n'y avait pas un souffle de vent dans l'air.
Le chasseur posa la main sur l'épaule de l'Aigle-Volant; celui-ci ouvrit les yeux et le regarda.
—Les Indiens! murmura le Canadien à l'oreille du chef.
Puis, rampant sur les mains et sur les genoux, il se glissa sur la berge et se mit à l'eau.
Alors il regarda autour de lui.
La lune répandait une clarté suffisante pour laisser distinguer le paysage à une assez grande distance.
Le chasseur, malgré l'attention avec laquelle il inspectait les environs, ne vit rien. Tout était calme. Il attendit, le regard fixe et l'oreille au guet.
Une demi heure s'écoula, sans que le bruit qui l'avait éveillé se renouvelât. Il avait beau écouter, aucun son ne venait troubler le silence de la nuit.
Cependant Bon-Affût était certain de ne pas s'être trompé. Dans le désert, tous les bruits ont une cause, une raison d'être; les chasseurs les connaissent et savent fort bien les distinguer entre eux, sans jamais se tromper.
Cependant le chasseur était plongé dans l'eau jusqu'à la ceinture: en Amérique, si la chaleur du jour est étouffante, en revanche les nuits sont excessivement fraîches; Bon-Affût sentait un froid glacial l'envahir de toutes parts. De guerre lasse et croyant s'être trompé, il se disposait enfin à abandonner la place et à remonter sur la rive, lorsque, au moment où il se décidait à exécuter ce mouvement, un corps dur vint frapper sa poitrine.
Il baissa les yeux et étendit instinctivement les mains en avant. Il étouffa un cri de surprise: ce qui l'avait touché, c'était le flanc d'une pirogue qui glissait sans bruit à travers les roseaux qu'elle écartait sur son passage.
Cette pirogue, de même que toutes les embarcations indiennes de ces parages, était construite en écorce de bouleau, détachée de l'arbre au moyen de l'eau chaude.
Bon-Affût examina cette mystérieuse pirogue, qui semblait s'avancer sans le secours d'aucun être humain, plutôt se laissant dériver au gré du courant que filant en ligne directe. Cependant une chose étonnait le Canadien, c'est que cette pirogue filait droit sans aucune oscillation. Évidemment un être invisible, un Indien probablement, la dirigeait; cela ne faisait pas un doute. Mais où se tenait cet homme? Était-il seul? C'est ce qu'il était impossible de deviner.
L'anxiété du Canadien était extrême: il n'osait faire le moindre geste dans la crainte de révéler imprudemment sa présence; cependant la pirogue filait toujours. Résolu à savoir enfin à quoi s'en tenir, Bon-Affût tira doucement son couteau de sa ceinture, et retenant sa respiration, il s'accroupit dans la rivière, en ne laissant que le haut de son visage à la surface de l'eau.
Ce qu'il avait espéré arriva: au bout d'un instant, il vit briller dans l'ombre, comme deux charbons ardents, les yeux d'un Indien qui nageait derrière la pirogue et la poussait avec le bras. Le peau-rouge tenait sa tête au niveau de l'eau en jetant autour de lui des regards investigateurs.
Le Canadien reconnut un Apache. Soudain les yeux de cet homme se fixèrent sur le chasseur; celui-ci jugea qu'il fallait en finir: s'élançant avec la souplesse et la rapidité d'un jaguar, il saisit son ennemi à la gorge; sans lui donner le temps de pousser un cri d'alarme, il lui plongea son couteau dans le cœur.
Le visage de l'Apache devint noir, ses yeux s'ouvrirent démesurément, il battit un instant l'eau avec ses jambes et ses bras; mais bientôt ses membres se roidirent, une convulsion suprême agita tout tous son corps, il disparut emporté par le courant et laissant derrière lui un léger sillon rougeâtre.
Il était mort.
Le Canadien, sans perdre un instant, enjamba la pirogue, et s'accrochant aux roseaux, il regarda du côté où il avait laissé ses compagnons. Ceux-ci, réveillés par l'Aigle-Volant, s'étaient approchés avec précaution, emportant avec eux le rifle abandonné sur le rivage par le chasseur.
Aussitôt qu'ils furent réunis, ils dégagèrent la pirogue des roseaux qui lui barraient le passage, et d'après le conseil de Bon-Affût, après s'être embarqués, avoir mis l'embarcation en pleine eau et lui avoir fait prendre le courant, ils s'étendirent au fond.
Depuis quelques temps déjà ils dérivaient ainsi doucement, se croyant à l'abri des ennemis invisibles qu'ils soupçonnaient cachés autour d'eux, lorsque soudain une clameur terrible éclata comme un coup de tonnerre et vibra dans l'espace.
Le corps de l'Apache tué par Bon-Affût avait, pendant quelques minutes suivi le fil de l'eau, puis il s'était arrêté dans des herbes et des bois morts, juste en face d'un campement indien auprès duquel les aventuriers étaient passés quelques heures auparavant sans le soupçonner.
A la vue du cadavre de leur frère, les peaux-rouges avaient poussé le formidable rugissement de douleur dont nous avons parlé, et s'étaient précipités en tumulte vers le rivage en se désignant du doigt la pirogue.
Bon-Affût, se voyant découvert, saisit les pagaies, et aidé par l'Aigle-Volant et Domingo, en quelques instants il se mit hors d'atteinte.
Les Apaches déconcertés, furieux de cette fuite, et ne sachant à qui ils avaient affaire, gesticulèrent en accablant leurs ennemis inconnus de toutes les insultes que la langue indienne put leur fournir, les traitant de lapins, de canards, de chiens, de hiboux et autres épithètes empruntées à la nomenclature des animaux qu'ils haïssent ou méprisent.
Le chasseur et ses compagnons s'inquiétaient peu de ces injures impuissantes: ils continuaient à pagayer vigoureusement, ce qui rétablissait dans leurs membres la circulation du sang.
Cependant les Indiens changèrent de tactique: plusieurs longues flèches barbelées furent lancées sur la pirogue, quelques coups de fusil même furent tirés; mais la distance était trop grande, l'eau seule fut fouettée par les balles.
La nuit se passa ainsi.
Les aventuriers pagayaient avec ardeur, car ils avaient reconnu que la rivière, à l'aide de ses nombreux détours, se rapprochait sensiblement de la forêt qu'ils avaient tant d'intérêt à atteindre. Cependant, croyant ne plus avoir rien à redouter de leurs ennemis, ils abandonnèrent pendant quelques instants les pagaies afin de se délasser et prendre un peu de nourriture.
Le jour était venu sur ces entrefaites, un magnifique paysage se déroula aux yeux éblouis des aventuriers.
—Oh! s'écria l'Aigle-Volant avec une expression de surprise.
—Qu'y a-t-il? dit aussitôt Bon-Affût qui comprit que le chef avait aperçu quelque chose d'extraordinaire.
—Voyez! reprit emphatiquement le Comanche en tendant le bras dans la direction qu'ils avaient parcourue pendant la nuit.
—Vertudieu! s'écria le Canadien, deux pirogues à notre poursuite! Oh! Oh! Il va falloir en découdre.
—Cuerpo del Cristo! fit à son tour Domingo avec un soubresaut qui faillit faire chavirer la frêle embarcation.
—Quoi encore?
—Regardez!
—Mille diables! exclama le chasseur, nous sommes cernés.
En effet, deux pirogues s'avançaient rapidement à l'arrière des aventuriers, tandis que deux autres, parties de deux points opposés de la berge, venaient sur leur avant dans l'intention évidente de leur barrer le passage et leur couper la retraite.
—¡Voto a Dios! Voilà des peaux-rouges qui veulent nous faire danser un singulier jaleo! murmura Domingo. Qu'en dites-vous, vieux chasseur?
—Bon, bon, fit gaiement Bon-Affût, nous leur payerons la musique. Attention, compagnons, et redoublons d'énergie.
Sur un signe de lui, les hommes saisirent tous des pagaies et imprimèrent un tel élan à leur pirogue, qu'elle sembla voler sur l'eau.
La situation se faisait critique pour les blancs.
Bon-Affût, debout, appuyé sur son rifle, calculait froidement les chances pour et contre de cette rencontre inévitable. Ce n'étaient pas les embarcations qui lui donnaient la chasse qu'il redoutait, elles étaient à une trop grande distance en arrière pour espérer l'atteindre; toute son attention se portait sur celles qui venaient à l'avant et entre lesquelles il fallait absolument passer. Chaque coup de pagaie diminuait la distance qui séparait les blancs des peaux-rouges.
Les pirogues ennemies, autant qu'on pouvait en juger de loin, semblaient surchargées de monde et n'avancer qu'avec une certaine difficulté. Bon-Affût avait jugé la position d'un coup d'œil infaillible; il prit une de ces résolutions hardies auxquelles il devait la grande réputation dont il jouissait, résolution qui, seule, dans ce moment critique, pouvait le sauver, lui et les siens.
Bon-Affût avait, ainsi que nous l'avons dit, pris une résolution suprême. Au lieu de chercher à s'échapper en passant entre les deux pirogues, ce qui était risquer de se faire couler, il appuya légèrement sur la gauche et mit le cap directement sur la pirogue la plus près de la sienne.
Les Indiens trompés par cette manœuvre dont ils ne comprirent pas d'abord la portée, l'accueillirent par des cris de joie et de triomphe. Les aventuriers gardèrent le silence, mais ils redoublèrent d'efforts et continuèrent à avancer.
Un sourire railleur passa sur les lèvres du chasseur canadien.
Au fur et à mesure que sa pirogue s'approchait de celle des Apaches, il avait reconnu que la rive gauche de la rivière s'échancrait, et il venait de s'apercevoir que cette échancrure était formée par une île assez rapprochée de la terre, mais laissant encore un passage suffisant pour son embarcation, qui évitait ainsi un détour et lui faisait gagner du terrain sur les ennemis qui le poursuivaient.
L'affaire capitale était d'atteindre la pointe de l'île avant les Indiens de la première pirogue.
Ceux-ci avaient fini, sinon par deviner complètement, du moins par se douter de l'intention de leur intrépide adversaire; aussi avaient-ils, de leur côté, changé de tactique et modifié leur manœuvre. Au lieu de marcher à l'encontre des blancs, comme ils avaient fait jusqu'à ce moment, ils avaient brusquement viré de bord et pagayaient vigoureusement dans la direction de l'île.
Bon-Affût comprit qu'il fallait à tout prix retarder leur marche.
Jusqu'alors pas une flèche, pas un coup de feu n'avait été échangé de part ni d'autre; les Apaches étaient si persuadés qu'ils réussiraient à s'emparer des aventuriers, qu'ils avaient jugé inutile d'en venir à cette extrémité.
Les blancs, de leur côté, qui sentaient la nécessité d'économiser leur poudre dans un pays ennemi où il leur serait impossible de renouveler leur provision, les avaient jusque-là imités par prudence, quelque désir qu'ils eussent d'en venir aux mains.
Cependant la pirogue indienne n'était plus qu'à une cinquantaine de mètres de l'île; le chasseur, après avoir jeté un dernier regard autour de lui, se pencha vers ses compagnons, et leur dit quelques mots à voix basse.
Immédiatement ceux-ci rentrèrent les pagaies, et saisissant leurs rifles, s'agenouillèrent en appuyant leur arme sur le plat-bord de l'embarcation, après toutefois avoir fait glisser une seconde balle dans le canon.
Bon-Affût avait fait de même.
—Y sommes-nous? demanda-t-il au bout d'un instant.
—Oui! répondirent les aventuriers.
—Feu alors! Et tirons bas.
Les cinq détonations se confondirent en une seule.
Nous avons fait observer que les deux embarcations étaient excessivement rapprochées l'une de l'autre.
—Aux pagaies maintenant! Et vivement! cria le chasseur en donnant l'exemple, comme toujours.
Huit bras reprirent les pagaies, la légère pirogue recommença à voler sur l'eau. Seul, le chasseur rechargea son rifle et attendit agenouillé, prêt à tirer.
L'effet de la décharge des blancs se fit bientôt connaître: les cinq coups de feu, dirigés tous vers le même endroit, avaient ouvert une énorme brèche au flanc de l'embarcation indienne, juste au niveau de la flottaison.
Des cris d'effroi et de douleur s'élevèrent du groupe d'Apaches qui sautèrent à l'eau les uns après les autres, nageant dans toutes les directions. Quant à la pirogue, abandonnée à elle-même, elle dériva un instant, s'emplit d'eau peu à peu, et finit par couler bas.
Les aventuriers, se croyant débarrassés de leurs ennemis, ralentirent pour un instant leurs efforts.
Tout à coup l'Aigle-Volant leva sa pagaie, tandis que Bon-Affût saisissait son rifle par le canon. Deux Apaches aux membres athlétiques et aux regards féroces cherchaient à s'accrocher à la pirogue pour la faire chavirer. Ils retombèrent bientôt la tête fendue et roulèrent au fil de l'eau.
Quelques minutes plus tard, les chasseurs atteignirent le passage.
Cependant plusieurs Apaches étaient parvenus à la nage jusqu'à l'île; aussitôt sortis de l'eau, ils se mirent à la poursuite des blancs, en courant le long de la berge; faute de mieux, ils leurs jetaient des pierres, car ils ne pouvaient se servir de leurs rifles mouilles, et ils avaient perdu leurs arcs et leurs flèches par suite de leur brusque plongeon dans la rivière.
Toutes primitives que fussent les armes employées en ce moment par les Apaches, cependant Bon-Affût recommanda à ses compagnons de redoubler d'efforts, afin d'être le plus tôt possible à l'abri des projectiles énormes qui, de derrière toutes les touffes d'herbe et tous les accidents de terrain, pleuvaient drus comme grêle autour de la pirogue; car les peaux-rouges, selon leur habitude, avaient un soin extrême de ne pas rester à découvert, de crainte des balles.
Cependant cette situation devenait insoutenable, il fallait en sortir; le chasseur qui guettait attentivement l'occasion de donner une leçon sévère à ses ennemis acharnés, crut enfin l'avoir trouvée: il vit à quelques mètres de lui, sur la rive, un buisson de floripondios s'agiter légèrement; épaulant vivement son rifle, il ajusta et lâcha la détente.
Un cri terrible s'échappa du fouillis de floripondios, de cañaverales, de lianes et de plantes aquatiques qui formaient ce buisson, et un Apache, bondissant comme un tigre blessé, en sortit dans l'intention d'aller s'abriter plus loin derrière les arbres verts qui s'élevaient à peu de distance dans l'intérieur de l'île. Bon-Affût, qui avait rechargé son rifle en toute hâte, le baissa dans la direction du fuyard, mais il le releva aussitôt.
L'Apache venait de tomber sur le sable, et se roulait dans les dernières convulsions de l'agonie.
Au même instant Une dizaine d'Indiens s'élancèrent de derrière les buissons, se précipitèrent sur le cadavre, l'enlevèrent dans leurs bras, et disparurent avec la rapidité d'une légion de fantômes.
Un calme subit, une tranquillité inouïe succédèrent à l'agitation extrême et aux cris désordonnés qui, quelques minutes auparavant, faisaient retentir les échos.
—Pauvre diable! murmura Bon-Affût en replaçant son rifle dans le fond de la pirogue et en saisissant une paire de pagaies, je suis fâché de ce qui lui est arrivé; je crois qu'ils en ont assez; maintenant qu'ils connaissent la portée de mon rifle, ils nous laisseront tranquilles.
Le chasseur avait calculé juste: en effet, les peaux-rouges ne donnèrent plus signe de vie.
Ce que nous disons là n'a rien qui doive surprendre le lecteur: chaque pays comprend l'honneur et sa façon; les Indiens ont pour principe de ne jamais s'exposer inutilement à un danger quelconque. Pour eux, le succès seul peut justifier leurs actions; aussi, dès qu'ils ne se jugent pas les plus forts, ils renoncent sans honte, avec la plus grande facilité, aux projets qu'ils avaient conçus et préparés pendant de longues semaines.
Les aventuriers doublèrent enfin la pointe de l'île.
La seconde pirogue se trouvait déjà fort loin derrière eux; quant à celles qu'ils avaient aperçues en premier, elles n'apparaissaient plus que comme des points presque imperceptibles à l'horizon. Lorsque les peaux-rouges de la deuxième pirogue avaient vu que les aventuriers avaient pris sur eux une avance qu'il leur était impossible de regagner et qu'ils leur échappaient définitivement contre leurs prévisions, ils avaient fait une décharge générale de leurs armes; impuissante démonstration qui ne blessa personne, car les balles et les flèches tombèrent à une distance considérable des blancs; puis ils virèrent de bord, afin de rejoindre leurs compagnons sur l'île où ils s'étaient réfugiés.
Bon-Affût et ses compagnons étaient sauvés.
Après avoir pagayé une heure encore environ pour mettre entre eux et leurs ennemis une distance infranchissable, ils prirent un instant de repos, afin de se remettre de cette chaude alerte et bassiner avec un peu d'eau fraîche les contusions qu'ils avaient reçues, car quelques pierres les avaient atteints. Dans l'ardeur de l'action, ils ne s'en étaient pas aperçu; mais, maintenant que le danger était passé, ils commençaient à en souffrir.
La forêt, qui le matin, à cause des méandres multipliés de la rivière était si éloignée d'eux, s'était excessivement rapprochée, ils avaient l'espoir de l'atteindre avant la nuit; après une courte interruption, ils reprirent donc les pagaies avec une nouvelle ardeur et continuèrent leur route. Au coucher du soleil, la pirogue disparaissait en s'engouffrant sous l'immense dôme de feuillage de la forêt vierge que le courant d'eau coupait en biaisant.
Dès que les ténèbres commencèrent à tomber, le désert se réveilla, et les hurlements des bêtes fauves se rendant à l'abreuvoir se firent entendre sourdement dans les profondeurs inexplorées de la forêt. Bon-Affût ne jugea pas prudent de s'engager à cette heure dans des parages inconnus, qui sans doute recelaient des dangers de toute espèce. En conséquence, après avoir louvoyé encore pendant quelque temps afin de trouver un atterrage convenable, le chasseur donna l'ordre d'accoster sur une pointe de rocher qui s'avançait dans l'eau et formait une espèce de promontoire sur lequel on pouvait aborder sans difficulté.
Aussitôt à terre, le Canadien fit le tour du rocher afin de reconnaître les environs et savoir dans quelle partie de la forêt ils se trouvaient.
Cette fois le hasard avait mieux servi le chasseur qu'il n'aurait osé l'espérer. Après avoir écarté à grand-peine et avec des précautions minutieuses les lianes et les broussailles qui obstruaient le chemin, il se trouva subitement, et sans s'en douter, à l'entrée d'une grotte naturelle, formée probablement par une de ces convulsions volcaniques si fréquentes dans ces régions.
A cette vue, il s'arrêta, et allumant une branche d'ocote dont il avait eu le soin de se prémunir, il entra résolument dans la grotte, suivi de ses compagnons. L'apparition subite de la lumière de la torche effraya une nuée d'oiseaux de nuit et de chauves-souris qui, avec des cris aigus, se mirent à voler lourdement et à s'échapper de tous les côtés. Bon-Affût continua sa route, sans s'occuper de ces hôtes funèbres dont il interrompait si inopinément les lugubres ébats.
Cette grotte était haute, spacieuse et aérée. C'était, dans les circonstances où se trouvaient les aventuriers, une précieuse trouvaille, car elle leur offrait un abri à peu près sûr, pour la nuit, contre les recherches des Apaches, qui certainement n'avaient pas renoncé à les poursuivre.
Les aventuriers, après avoir exploré la caverne dans tous les sens, et s'être assurés qu'elle avait deux sorties, ce qui leur garantissait les moyens de fuir s'ils étaient attaqués par de trop nombreux ennemis, retournèrent vers l'embarcation, la retirèrent de l'eau, et, la chargeant sur leurs épaules, ils la portèrent au fond de la grotte. Puis, avec cette patience dont les Indiens et les coureurs des bois sont seuls capables, ils effacèrent les moindres traces, les plus légères empreintes qui auraient pu faire reconnaître leur débarquement et deviner la retraite qu'ils avaient choisie. Les brins d'herbes courbés furent redressés, les lianes et les buissons qu'ils avaient écartés furent rapprochés, et, après ce soin accompli, nul n'eut pu se douter que plusieurs hommes avaient passé par là.
Après quoi, faisant une ample provision de bois mort et de branche d'ocote pour les torches, ils rentrèrent dans la grotte avec l'intention manifeste de prendre enfin un peu de repos dont ils avaient si grand besoin.
Tous ces préparatifs avaient demandé du temps; aussi la nuit était-elle fort avancée déjà lorsque les aventuriers, après avoir pris un maigre repas préparé à la hâte, s'enveloppèrent enfin dans leurs zarapés et s'étendirent les pieds au feu et la main sur leur rifle. Rien ne troubla leur sommeil, qui durait encore lorsque les premiers rayons du soleil empourprèrent l'horizon de reflets joyeux. Ce fut Bon-Affût qui réveilla ses compagnons.
L'Aigle-Volant n'était pas dans la grotte.
Cette absence n'inquiéta nullement le chasseur; il connaissait trop bien le sachem comanche pour redouter une trahison de sa part.
—Debout! cria-t-il aux dormeurs, le soleil est levé; nous nous sommes assez reposés, il est temps de songer à nos affaires.
—Au bout d'un instant ils étaient sur pied.
Le chasseur ne s'était pas trompé; à peine commençait-on à rallumer le feu pour le repas du matin, que l'Aigle-Volant parut. Le chef portait sur ses épaules un élan magnifique qu'il jeta silencieusement à terre, puis il alla s'accroupir auprès de l'Églantine.
—Ma foi, chef! dit gaiement Bon-Affût, vous êtes un homme de précaution, votre chasse est la bienvenue; nos vivres commençaient à furieusement diminuer.
Le Comanche sourit de plaisir à cette parole, mais il ne répondit pas autrement: de même que tous ses congénères, l'Indien ne parlait que lorsque cela était absolument nécessaire.
Sur un signe du Canadien, Domingo, qui était un grand chasseur, se mit immédiatement en devoir de dépouiller l'élan.
Le pennekann, le queso et le blé indien restèrent donc au fond des alforjas des aventuriers, grâce à de succulents filets levés adroitement sur l'animal par Domingo, et qui, rôtis sur la braise, leur procurèrent un délicieux déjeuner; ce festin fut couronné par quelques gouttes de pulque dont l'Aigle-Volant et sa femme, d'après l'habitude des Comanches de s'abstenir de liqueurs fortes, refusèrent seuls de prendre leur part.
Puis les pipes et les cigarettes furent allumées, et chacun commença à fumer silencieusement.
Bon-Affût réfléchissait au parti qu'il devait prendre, pendant que Domingo et Bermudez préparaient tout pour le départ; enfin il se décida à parler:
—Caballeros, dit-il, nous voici arrivés à l'endroit où commence réellement notre voyage; il est temps que je vous fasse savoir où nous allons. Dès que nous aurons traversé cette forêt, ce qui ne sera pas long, nous aurons devant nous une plaine immense au centre de laquelle s'élève une ville; cette ville est nommée par les Indiens Quiepaa-Tani: c'est une de ces mystérieuses cités où, depuis la conquête, s'est réfugiée la civilisation mexicaine des Incas; c'est à cette ville que nous nous rendons, car c'est dans son sein que se sont retirées les jeunes filles que nous voulons sauver; cette ville est sacrée: malheur à l'Européen ou au blanc qui serait découvert aux environs! Je vous avoue que les périls que nous avons courus jusqu'à présent ne sont rien en comparaison de ceux qui probablement nous attendent avant que nous atteignions le but que nous nous sommes proposé; il est impossible que nous songions à nous introduire tous dans cette ville; cette tentative serait une folie et n'aboutirait qu'à nous faire stérilement massacrer. D'un autre côté, nous pouvons avoir besoin de retrouver ici des compagnons dévoués qui, le cas échéant, nous viendront en aide. Voici donc ce que j'ai résolu: Bermudez va retourner sur ses pas, c'est-à-dire à l'endroit où nous avons laissé Juanito; puis, tous deux, conduisant les chevaux avec eux, rallieront au rendez-vous convenu le détachement de Ruperto et celui de Balle-Franche, si cela est possible, et les amèneront ici. Quel est votre avis, caballeros? Approuvez-vous mon projet?
—De tous points, répondit don Mariano en s'inclinant.
—Et vous, chef?
—Mon frère est prudent, ce qu'il fait est bien.
—Quoi! Je vais vous quitter, murmura le pauvre Bermudez en s'adressant à son maître.
—Il le faut mon ami, répondit celui-ci; mais pas pour longtemps, je l'espère.
—Tâchez de vous bien rappeler la route que nous avons suivie, afin de ne pas vous tromper au retour, reprit le chasseur.
—Je tâcherai.
—Eh! Vieux chasseur, dit en ricanant Domingo, pourquoi diable ne m'envoyez-vous pas, moi qui suis un coureur des bois et qui connais le désert sur le bout du doigt, au lieu de ce pauvre homme qui, j'en suis certain, laissera ses os en route?
Bon-Affût lança au gambucino un regard pénétrant qui lui fit baisser la tête en rougissant.
—Parce que, répondit-il en appuyant avec intention sur chaque mot, ami Domingo, j'ai pour vous une si forte inclination que je ne puis consentir à vous perdre de vue une seule minute; vous me comprenez, n'est-ce pas?
—Parfaitement, parfaitement, bégaya le gambucino avec confusion; il est inutile de vous fâcher, vieux chasseur, je resterai; ce que j'en disais, c'était dans votre intérêt, voilà tout.
—J'apprécie votre offre comme elle le mérite, répondit en radiant le Canadien, n'en parlons plus. Et il continua en s'adressant à Bermudez: Comme nous pouvons avoir bientôt besoin de secours, tâchez en revenant de prendre, si cela est possible, une route plus directe et plus courte.
—Je ferai en sorte.
—Cette grotte est un excellent refuge, elle est assez spacieuse pour vous donner abri à tous; vous y demeurerez avec les chevaux et vous ne la quitterez que sur un ordre de moi: c'est entendu?
—Et compris, soyez tranquille; je suis trop pénétré de l'importance des recommandations que vous me faites pour les négliger.
—Un dernier mot. Je vous ai dit qu'il fallait absolument, pour le succès de l'expédition difficile que nous tentons, que nous trouvions ici, en cas de besoin, un fort détachement d'hommes résolus; recommandez bien à Ruperto de redoubler de prudence et d'éviter autant que possible, je ne dis pas une rixe avec les Indiens, mais même leur rencontre.
—Je le lui dirai.
—Maintenant, remettons la pirogue à flot, et bonne chance.
—Dieu veuille que vous réussissiez à sauver la pauvre niña, dit le vieux domestique avec une émotion qu'il ne put maîtriser; je donnerais avec joie ma vie pour elle.
—Allez en paix, mon ami, répondit Bon-Affût d'un ton affectueux, j'ai déjà fait le sacrifice de la mienne.
Les aventuriers sortirent alors de la grotte, non sans avoir d'abord interrogé le dehors du regard, afin de voir si nul danger n'existait. Un silence profond régnait sous le couvert impénétrable de la forêt.
Les aventuriers enlevèrent sur leurs épaules la pirogue dans laquelle ils avaient placé des provisions pour le compagnon qui les quittait.
Bientôt l'embarcation se balança légèrement sur l'eau.
Bermudez fit ses derniers adieux, puis se détournant avec effort, il sauta dans la pirogue, saisit les pagaies et s'éloigna.
—Au revoir! lui cria don Mariano d'une voix émue.
—A bientôt, si Dieu veut, répondit Bermudez.
—Amen! murmurèrent pieusement les aventuriers.
Bon-Affût suivit longtemps des yeux la marche de la pirogue, puis se retournant par un mouvement brusque vers ses compagnons:
—C'est un cœur dévoué, murmura-t-il, comme se parlant a lui-même: arrivera-t-il?
—Dieu le protégera, répondit don Mariano.
—C'est vrai, reprit le chasseur en passant sa main sur son front; je suis fou, sur ma parole, d'avoir de telles pensées, et ingrat, qui plus est, ingrat envers la Providence, qui a veillé sur nous jusqu'ici avec une si grande sollicitude.
—Bien parlé, mon ami, fit don Mariano; j'ai le pressentiment que nous réussirons.
—Eh bien, voulez-vous que je vous parle franchement, fit gaiement le chasseur; moi aussi, j'en ai le pressentiment; ainsi, en avant.
—L'Aigle-Volant posa alors sa main sur l'épaule du chasseur.
—Avant que de partir, je voudrais tenir conseil avec mon frère, dit-il; le cas est grave.
—Vous avez raison, chef, rentrons dans la grotte; nos mouvements doivent être combinés avec la plus grande prudence, afin, le moment venu, de ne pas commettre une irréparable bévue qui compromettrait sans retour le succès de notre expédition.
Le Comanche fit un signe d'assentiment, et précédant ses amis, il retourna à la caverne. Le feu n'était pas complètement éteint, il couvait sous la cendre; en un instant il fut ravivé; les quatre hommes s'accroupirent gravement autour.
Alors le chef détacha son calumet de sa ceinture, le bourra de tabac sacré, l'alluma, et après avoir aspiré lentement deux ou trois bouffées de fumée, il le passa à Bon-Affût. Le calumet fit ainsi le tour du cercle sans qu'un mot fût prononcé, pendant que le tabac contenu dans le fourneau se consumait. Lorsqu'il ne resta plus que de la cendre, le chef le secoua dans le brasier, replaça le calumet à sa ceinture et s'adressant à Bon-Affût:
—Un chef voudrait parler, dit-il.
—Mon frère peut parler, répondit le chasseur en s'inclinant, nos oreilles sont ouvertes.
Le sachem, après avoir d'un geste ordonné à sa femme de s'éloigner hors de la portée de la voix, ce que, selon la coutume indienne, l'Églantine fit immédiatement, s'inclina révérencieusement devant les membres du conseil et prit la parole en ces termes.
L'Aigle-Volant, depuis le commencement de l'expédition à laquelle il avait consenti à prendre part, avait constamment joué un rôle passif, acceptant sans les discuter les combinaisons proposées par Bon-Affût, exécutant avec franchise et fidélité les ordres qu'il recevait du chasseur, en un mot, remplissant entièrement le rôle d'un guerrier subordonné à un chef dont le devoir est de penser pour lui; aussi la nouvelle attitude prise subitement par le sachem remplit-elle d'étonnement le Canadien, qui ne prévoyait nullement sur quel sujet allait s'établir le débat, et qui craignait intérieurement que, dans la situation critique où il se trouvait en ce moment, le Comanche n'eût l'intention de l'abandonner à ses propres ressources, de se retirer, et peut-être de créer des obstacles à l'exécution de ses projets. Aussi attendit-il impatiemment l'explication de la conduite étrange de son allié.
Le chef, toujours impassible, s'était levé; après avoir salué à la ronde, il se décida enfin à prendre la parole:
—Visages pâles, mes frères, dit-il de sa voix gutturale et sympathique, depuis plus d'une lune que nous sommes ensemble sur le même sentier, partageant les mêmes fatigues, dormant côte à côte, mangeant du produit de la même chasse, sans que le chef que vous avez admis à partager vos travaux et vos périls ait été jusqu'à ce jour admis à entrer aussi avant dans votre confiance qu'un ami doit y être; votre cœur est toujours pour lui resté fermé et entouré d'un nuage épais, vos projets lui sont aussi inconnus que le premier jour, les paroles que souffle votre poitrine sont et demeurent pour lui des énigmes indéchiffrables; cela est-il bien? Cela est-il juste? Non. Pourquoi m'avez-vous appelé, pourquoi m'avez-vous prié de vous accompagner, si je dois demeurer toujours pour vous un étranger? Jusqu'à présent j'ai renfermé dans mon cœur l'amertume que me causait votre conduite soupçonneuse; pas une plainte n'est montée de mon cœur à mes lèvres, en me voyant traité d'une manière si peu conforme à mon rang et aux relations que j'ai toujours entretenues avec vous; en ce moment même je continuerais à garder le silence, si mon amitié pour vous n'était pas plus forte que le ressentiment que me cause votre conduite peu généreuse à mon égard. Nous sommes sur la terre sainte des Indiens, le sol que nous foulons est sacré; des périls nous entourent, des embûches sans nombre sont tendues de toutes parts sous nos pas; comment vous aiderai-je à les conjurer si vos projets ne me sont enfin révélés, si je ne sais, en un mot, si le sentier que nous suivons est celui de la guerre ou celui de la chasse? Parlez avec franchise, ôtez la peau de votre cœur, de même que j'ai ôté celle du mien, éclairez-moi sur la conduite que vous avez l'intention de tenir et le but que vous vous proposez, afin que je vous aide de mes conseils si cela est nécessaire, et que, étant votre allié, je ne reste pas plus longtemps en dehors de vos délibérations, ce qui est honteux pour la nation à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, et indigne d'un guerrier tel que moi. J'ai dit, mes frères; j'attends votre réponse, qui, j'en suis convaincu, sera telle que doivent la faire des guerriers aussi sages et aussi expérimentés que vous l'êtes.
Pendant le long discours du chef comanche, Bon-Affût avait à plusieurs reprises donné des marques d'impatience, s'il n'avait craint de manquer aux règles de l'étiquette indienne en l'interrompant, certes il l'aurait fait; ce n'avait été qu'à grand-peine qu'il était parvenu à se contraindre et à conserver l'apparence impassible qui est de rigueur en semblable circonstance. Aussitôt que le chef eut repris sa place, le chasseur se leva, et après avoir salué d'un signe de tête les assistants, il prit la parole d'une voix ferme, et répondit en ces termes:
—Le Wacondah est grand, il tient dans sa main droite le cœur de tous les hommes, quelle que soit leur couleur: seul il peut connaître les intentions et lire dans leur âme. Les reproches que vous m'adressez, chef, ont une apparence de justice que je ne veux pas discuter avec vous; vous avez pu supposer, d'après la conduite que les circonstances m'ont jusqu'à présent contraint à tenir vis-à-vis de vous, que je ne vous accordais pas la confiance que vous méritez à si juste titre; il n'en est rien, j'attendais que l'heure de parler fût venue, non seulement pour vous expliquer mes intentions, mais encore pour réclamer votre aide et votre intervention. Vous désirez que je m'explique immédiatement, je vais le faire; mais peut-être eût-il mieux valu que vous attendissiez que cette forêt dans laquelle nous nous trouvons fût traverser.
—Je ferai observer à mon frère que je n'exige rien de lui; j'ai cru devoir lui faire certaines observations; s'il ne les trouve pas justes, son cœur est bon, il me pardonnera en songeant que je ne suis qu'un pauvre Indien dont l'intelligence est obscurcie par un nuage, et que je n'ai pas eu l'intention de le blesser.
—Non, non, chef, reprit vivement le chasseur; puisque nous sommes sur cette question, mieux vaut l'éclaircir tout de suite, afin de ne plus avoir à y revenir et que rien dorénavant ne s'élève entre nous.
—Je suis à la disposition de mon frère, prêt à l'entendre si cela lui plaît, et content d'attendre encore s'il le juge nécessaire.
—Je vous remercie, chef; mais je m'en tiens à ma résolution première, je préfère tout vous dire.
Le Comanche sourit avec finesse.
—Mon frère est bien résolu à parler? lui demanda-t-il.
—Oui.
—Bon; alors mon frère n a rien à ajouter, tout ce qu'il a à me dire, je le sais, il ne m'apprendrait rien de plus que ce que j'ai deviné moi-même.
Le chasseur ne put retenir un geste d'étonnement.
—Oh! Oh! murmura-t-il, que signifie cela, chef? Pourquoi alors les reproches que vous m'avez adressés?
—Parce que j'ai voulu faire comprendre à mon frère qu'un ami ne doit rien avoir de caché pour un autre, surtout lorsque cet ami est éprouvé depuis longues années, que sa fidélité est à l'épreuve, et qu'on sait que l'on peut compter sur lui comme sur soi-même.
Le chasseur sourit légèrement, mais se remettant aussitôt:
—Merci de la leçon que vous me donnez, chef, dit-il en lui tendant cordialement la main, je la mérite, car j'ai en effet manqué de confiance en vous; le service que j'attends de vous est si important pour moi que je reculais tous les jours à vous le demander et que, malgré moi, je vous l'avoue, je ne m'y serais probablement décidé qu'au dernier moment.
—Je le sais, répondit le Comanche avec un ton de bonne humeur tout à fait rassurant.
—Cependant, reprit le chasseur, malgré l'assurance que vous avez de connaître mes projets, peut-être serait-il bon que j'entrasse vis-à-vis de vous dans certains détails que vous ignorez.
—Je répète à mon frère pâle que je sais tout; l'Aigle-Volant est un des premiers sachems de sa nation, il a l'ouïe fine et la vue perçante: depuis près de deux lunes il n'a pas quitté le grand chasseur pâle; pendant ce laps de temps, bien des événements se sont passés, bien des paroles ont été prononcées devant lui; le chef a vu, il a entendu, et tout est aussi clair dans son esprit que si toutes ces choses avaient été dessinées pour lui dans un de ces colliers—livres—que savent si bien faire les blancs et dont j'ai vu quelques-uns entre les mains des chefs de la prière.
—Quelle que soit votre pénétration, chef, reprit le chasseur avec insistance, j'ai peine à me figurer que vous soyez aussi bien au courant de mes intentions que vous le supposez.
—Non seulement je connais les intentions de mon frère, mais encore je sais quel est le service qu'il attend de moi.
—Pardieu, chef, vous me ferez un énorme plaisir en me le disant, non pas que je doute de votre pénétration, les hommes rouges sont renommés pour leur finesse; cependant cela me semble si extraordinaire, que je vous avoue que je serais charmé d'en avoir le cœur net, ne serait-ce que pour ma satisfaction personnelle et pour prouver aux personnes qui nous écoutent combien nous avons tort, nous autres blancs, de nous imaginer que nous vous sommes si supérieurs en intelligence, lorsque vous nous laissez au contraire si loin derrière vous.
—Hum! murmura Domingo, ce que vous dites là est un peu fort, vieux chasseur; il est connu que les Indiens sont des bêtes brutes.
—Ce n'est pas mon avis, observa don Mariano; bien que je connaisse fort peu les peaux-rouges, avec lesquels jusqu'à présent je ne m'étais jamais trouvé en rapport, cependant, depuis mon arrivée dans ces régions, je leur ai vu accomplir des actions si étonnantes que je ne serais nullement surpris que ce chef eût, ainsi qu'il l'assure, pénétré complètement vos projets.
—Je le crois aussi, reprit le chasseur. Du reste, nous allons en juger. Parlez, chef, afin que nous sachions le plus tôt possible à quoi nous en tenir sur cette pénétration dont vous vous flattez.
—L'Aigle-Volant n'est pas une vieille femme bavarde, qui se vante à tort et à raison; c'est un sachem dont les actions et les paroles sont mûrement pesées; il n'a pas la prétention d'en savoir plus que ses frères les visages pâles; seulement l'expérience qu'il a acquise lui tient lieu de sagesse, elle l'aide à expliquer ce qu'il voit et ce qu'il entend.
—C'est bien chef, je sais que vous êtes un guerrier vaillant et renommé: nos oreilles sont ouvertes, nous vous écoutons avec toute l'attention que vous méritez.
—Mon frère le grand chasseur pâle veut entrer dans Quiepaa-Tani, où se sont réfugiées deux jeunes femmes blanches, dont l'une est la fille du chef à la barbe grise; ces deux femmes ont été confiées à un sachem apache nommé Addick; mon frère le chasseur a hâte d'arriver à Quiepaa-Tani, parce qu'il redoute une trahison du chef apache, qu'il soupçonne de s'être allié avec l'homme qui a été juge par les visages pâles pour enlever les deux femmes et les faire disparaître. J'ai dit: ai-je bien compris les intentions de mon frère, ou bien me suis-je trompé?
Les assistants se regardèrent avec étonnement; le chef jouit un instant de son triomphe, puis il reprit:
—Maintenant, voici le service que le chasseur veut demander à son frère le sachem comanche:
—Vrai Dieu! chef, s'écria Bon-Affût, je dois avouer que tout ce que vous avez dit est vrai! Comment l'avez-vous appris? Je ne sais de quelle façon l'expliquer, bien qu'à la rigueur on en a assez parlé devant vous pour que vous ayez fini par le deviner; mais quant au service que j'attends de vous, si vous pouvez me le dire, vive Dieu! Je vous reconnaîtrai pour le plus...
—Que mon frère ne s'avance pas trop, interrompit en souriant le chef, de peur qu'il ne me prenne bientôt pour un adepte de la grande médecine—sorcier—.
—Hum! fit gravement le chasseur, je ne jurerais pas que ce n'est point.
—Och! Mon frère jugera. Aucun visage pâle n'est parvenu jusqu'à ce jour à entrer dans Quiepaa-Tani; cependant mon frère veut, coûte que coûte, y pénétrer, afin d'obtenir des renseignements certains sur les deux jeunes vierges pâles; malheureusement mon frère ne sait comment mettre à exécution le projet ni comment il parviendrait à sauver les jeunes filles s'il les voyait en danger. Voilà pourquoi il a pensé à l'Aigle-Volant; il s'est dit que son frère rouge était un chef, qu'il devait avoir à Quiepaa-Tani des amis ou des parents, que l'entrée du Tzinco—ville,—interdite pour lui à cause de sa couleur, ne l'était pas pour le chef, et que les renseignements qu'il ne pouvait pas prendre, l'Aigle-Volant les prendrait pour lui.
—Oui, voilà ce que j'ai pensé, chef. A quoi bon le cacherai-je? Me suis-je trompé? Ne ferez-vous pas cela pour moi?
—Je ferai mieux, répondit l'Indien; que mon frère écoute. L'Églantine est une femme; nul ne s'occupera d'elle, elle entrera inaperçue dans le Tzinco, et, mieux que le chef, obtiendra tous les renseignements dont mon frère a besoin; lorsque le moment d'agir sera venu, l'Aigle-Volant aidera le chasseur.
—Pardieu! Vous avez raison, Sachem, votre idée est meilleure que la mienne; il est préférable sous tous les rapports que ce soit l'Églantine qui aille à la découverte; une femme ne peut inspirer de soupçons, mieux que qui que ce soit elle apprendra des nouvelles. En route donc sans plus tarder; aussitôt que nous aurons traversé la forêt, nous l'enverrons au Tzinco.
L'Aigle-Volant secoua la tête et retint par le bras le chasseur, qui déjà s'était levé pour se mettre en route.
—Mon frère est vif, fit-il; qu'il me laisse lui dire encore un mot.
—Voyons!
—L'Églantine partira en avant, mon frère aura plus tôt des nouvelles.
Don Mariano se leva, et serrant avec émotion la main du Comanche:
—Merci pour cette bonne pensée qui vous est venue, chef, lui dit-il; vous avez toutes les délicatesses, votre cœur est noble, il sait compatir aux douleurs d'un père; merci, encore une fois.
L'Indien se détourna pour ne pas laisser voir sur son visage les traces du sentiment qui l'agitait malgré lui, ce qui, dans sa pensée, était indigne d'un chef, qui doit en toute circonstance demeurer impassible.
—En effet, reprit Bon-Affût, ce que propose le chef nous fera gagner un temps précieux; son idée est excellente.
L'Aigle-Volant ordonna d'un geste à l'Églantine de s'approcher.
La jeune femme obéit.
Alors le chef lui expliqua dans sa langue ce qu'elle devait faire, pendant que, timidement posée devant lui, elle l'écoutait avec une grâce charmante.
Lorsque le chef lui eut donné ses instructions dans les plus grands détails, et qu'elle se fut bien pénétrée de ce qu'on attendait d'elle, elle se tourna gracieusement vers don Mariano et Bon-Affût, et, avec un doux sourire, elle leur dit d'une voix harmonieuse:
—L'Églantine saura.
Ces deux mots remplirent le cœur du pauvre père de joie et d'espérance.
—Soyez bénie, jeune femme, lui dit-il, soyez bénie pour le bien que vous me faites en ce moment et pour celui que vous avez l'intention de me faire.
La séparation du mari et de la femme fut ce qu'elle devait être entre Indiens, c'est-à-dire grave et froide; quelque amour qu'éprouvât l'Aigle-Volant pour sa compagne il aurait eu honte devant des étrangers, et surtout devant des blancs, de montrer la moindre émotion et de laisser deviner ses sentiments pour elle.
Après s'être une dernière fois inclinée devant don Mariano et Bon-Affût en signe d'adieu, l'Églantine s'éloigna rapidement, de ce pas gymnastique et relevée qui fait des Indiens les premiers et les meilleurs marcheurs du monde. Si grand que fut le stoïcisme du chef, cependant il suivit la jeune femme du regard, jusqu'à ce qu'enfin elle eut disparu au milieu des arbres.
Comme rien ne les pressait en ce moment, les aventuriers laissèrent passer la grande chaleur du jour, et ils ne se remirent en route que lorsque le soleil à son déclin n'apparut plus que comme un globe de feu presque au niveau du sol. Leur marche fut lente à cause des difficultés sans nombre qu'ils avaient à surmonter pour se frayer une route à travers le fouillis de lianes et de plantes de toutes sortes enchevêtrées les unes dans les autres en réseaux inextricables qu'il leur fallait couper à coups de hache à chaque pas.
Enfin, après quatre jours d'une course pendant laquelle ils avaient eu à supporter des fatigues inouïes, ils virent enfin devant eux les arbres devenir plus clairsemés, le couvert se fit moins épais, et entre les arbres ils aperçurent au loin un horizon profond et découvert.
Bien que les aventuriers se trouvassent au sein d'une forêt vierge où, selon toutes probabilités, ils ne devaient s'attendre à rencontrer aucun individu de leur espèce, cependant ils ne négligeaient aucune précaution et n'avançaient qu'avec prudence, marchant en file indienne, le doigt sur la détente du rifle, l'œil et l'oreille au guet; car aussi près d'une des villes sacrées des Indiens, ils pouvaient s'attendre, surtout après la chaude escarmouche qu'ils avaient eue à soutenir quelques jours auparavant, à être espionnés par des éclaireurs envoyés à leur recherche.
Vers le soir du quatrième jour, au moment où ils se préparaient à camper pour la nuit dans une clairière assez vaste sur les bords d'un ruisseau sans nom, comme on en rencontre tant dans les forêts vierges, Bon-Affût, qui marchait en tête de la petite troupe, s'arrêta tout à coup et se baissa vivement sur le sol en donnant les marques du plus grand étonnement.
—Qu'y a-t-il? lui demanda don Mariano au bout d'un instant.
Bon-Affût ne lui répondit pas; mais il se tourna vers le chef indien en lui disant avec une certaine inquiétude:
—Voyez vous-même, chef, ceci me semble inconcevable.
L'Aigle-Volant se baissa à son tour vers le sol, et demeura assez longtemps à considérer les empreintes qui semblaient intriguer si vivement le chasseur.
Enfin il se releva.
—Eh bien? lui demanda Bon-Affût.
—Une troupe de cavaliers a passé par ici aujourd'hui même; répondit-il.
—Oui, fit le chasseur; mais qui sont ces cavaliers? D'où viennent-ils? Voilà ce que je voudrais savoir.
L'Indien reprit son inspection avec une attention plus minutieuse que précédemment.
—Ce sont des visages pâles, dit-il.
—Comment! Des visages pâles! s'écria Bon-Affût d'une voix étouffée par la prudence, c'est impossible; songez donc où nous sommes; jamais blanc, excepté moi, n'a jusqu'à ce jour pénétré dans ces régions.
—Ce sont des visages pâles, reprit le chef. Voyez, il y en a un qui s'est arrêté ici, il est descendu de cheval; tenez, voici la trace de ses pas, son pied a écrasé cette touffe d'herbe, un des clous de sa chaussure a laissé une ligne noire sur cette pierre.
—C'est vrai, murmura Bon-Affût, les mocassins des Indiens ne laissent pas de telles empreintes; mais qui peuvent être ces hommes? Comment ont-ils pénétré ici? Quelle direction ont-ils suivie pour venir?
Pendant que Bon-Affût s'adressait in petto ces questions et cherchait vainement la solution de ce problème qui lui semblait insoluble, l'Aigle-Volant avait fait quelques pas en suivant attentivement les empreintes parfaitement visibles sur le sol.
—Et bien, chef, lui demanda le chasseur en le voyant revenir vers lui, avez-vous trouvé quelque chose qui puisse nous renseigner?
—Ooah! fit l'Indien en hochant la tête, la piste est fraîche, les cavaliers ne sont pas loin.
—En êtes-vous sur, chef? Songez combien il est important pour nous de savoir qui sont les gens que nous avons pour voisins.
Le Comanche demeura un instant silencieux, plongé sans doute dans de sérieuses réflexions; puis, relevant la tête:
—L'Aigle-Volant, dit-il, essaiera de satisfaire son frère. Que les visages pâles demeurent ici jusqu'à son retour; le chef va prendre la piste, bientôt il dira au chasseur si ces hommes sont des amis ou des ennemis.
—Pardieu! J'irai avec vous, chef, répondit vivement Bon-Affût; il ne sera pas dit que, pour nous être utile, vous vous soyez exposé à un danger sérieux, sans avoir auprès de vous un ami pour vous soutenir.
—Non, reprit l'Indien, mon frère doit rester ici, un guerrier seul est suffisant.
Le chasseur savait que, lorsque le chef avait pris une résolution, rien ne pouvait lui en faire changer; il n'insista pas.
—Partez donc, dit-il, et agissez à votre guise; je sais que ce que vous ferez sera bien.
Le Comanche rejeta son rifle sur l'épaule, s'étendit sur le sol, et disparut dans les buissons en rampant comme un serpent.
—Et nous, demanda don Mariano, qu'allons nous faire?
—Attendre le retour du chef, répondit Bon-Affût, et en l'attendant, préparer le repas du soir dont, ainsi que moi, je n'en doute pas, vous commencez à reconnaître l'urgence.
Les aventuriers s'installèrent tant bien que mal dans la clairière où ils se trouvaient, et, ainsi que l'avait dit Bon-Affût, ils préparèrent le souper en attendant le retour de leur batteur d'estrade, dont cependant l'absence fut beaucoup plus longue qu'ils ne l'avaient supposé, car la nuit était tombée déjà depuis longtemps sans qu'il eût reparu.
Ainsi que nous l'avons dit dans notre précédent chapitre, l'Aigle-Volant s'était lancé sur la piste des cavaliers dont les empreintes avaient été aperçues par Bon-Affût.
L'Indien était réellement un des plus fins limiers de sa nation; car, bien que la nuit vint rapidement et l'empêchât bientôt de distinguer les traces qui servaient à le guider dans ses recherches, il n'en continua pas moins à avancer d'un pas aussi sûr et aussi assuré que s'il eût été au milieu de l'un de ces larges chemins jadis tracés par les Espagnols au temps de leur domination, et dont il reste encore quelques vestiges à demi effacés aux environs des grandes cités hispano-américaines.
Dix minutes environ après avoir quitté ses compagnons, le chef s'était relevé, et sans paraître attacher grande importance aux vestiges laissés sur le sol, il avait continué sa marche, se contentant de s'orienter de temps en temps en jetant un regard perçant sur les arbres et les buissons qui l'entouraient.
L'Aigle-Volant continua à marcher ainsi pendant une heure sans hésiter et sans ralentir son pas; arrivé à un endroit où les arbres s'écartaient à droite et à gauche, de façon à former un vaste carrefour dans lequel venaient aboutir plusieurs sentes de bêtes fauves, le chef s'arrêta un instant, jeta un regard soupçonneux et investigateur autour de lui, saisit son rifle que jusqu'alors il avait porté rejeté en arrière sur l'épaule, visita l'amorce avec soin, et, courbant légèrement le corps au niveau des hautes herbes, il s'avança à pas mesurés du côté d'un buisson touffu dont il écarta les branches avec précaution et dans lequel il ne tarda pas à disparaître tout entier.
Dès qu'il fut complètement caché dans le fouillis de plantes au milieu duquel il avait cherché un abri, le Comanche s'agenouilla, entr'ouvrit peu à peu le rideau de feuillage qui le masquait, et regarda. Tout à coup, par un mouvement brusque l'Aigle-Volant se releva, désarma son rifle qu'il plaça sur son épaule, puis il quitta le buisson la tête haute et le sourire aux lèvres.
Au centre d'une vaste clairière, éclairée par trois ou quatre brasiers ardents, une vingtaine d'hommes étaient campés, pittoresquement groupés autour des feux et préparant joyeusement leurs repas du soir, tandis que leurs chevaux entravés à l'amble broutaient leur provision de pois grimpants et les jeunes pousses des arbres auprès desquels ils se trouvaient.
Ces cavaliers, l'Aigle-Volant les avait reconnus au premier coup d'œil, étaient don Leo de Torres, Balle-Franche et les gambucinos détachés à la poursuite de don Estevan. L'Indien s'approcha du feu auprès duquel don Leo et les chasseurs étaient assis, et s'arrêtant devant eux:
—Que le Wacondah veille sur mes frères! dit-il en forme de salut: un ami les vient visiter.
—Qu'il soit le bienvenu, répondit gracieusement don Leo en lui tendant la main.
—Oui, ajouta Balle-Franche, mille fois le bienvenu! Bien que sa présence ait lieu de nous surprendre.
Le chef s'inclina et prit place entre les deux blancs.
—Comment se fait-il que nous vous rencontrions ici? demanda le chasseur.
—La question que m'adresse mon frère en ce moment est celle que je me préparais à lui faire moi-même.
—Comment cela? fit don Leo.
—Mon frère le guerrier pâle ne sait-il pas où il se trouve en ce moment?
—D'aucune façon; depuis notre séparation, nous avons toujours suivi la piste de notre ennemi sans pouvoir jamais l'atteindre: cette piste nous a conduits dans des parages inconnus à Balle-Franche lui-même.
—Je dois l'avouer, voici la seconde fois que pareille chose m'arrive, et cela dans des circonstances identiques; la première, je me rappelle que c'était en 1843, j'étais alors au...
—Mais interrompit sans façon l'Aigle-Volant, si le chasseur ne connaît pas ces régions, mon frère le guerrier les connaît, lui.
—Moi? fit don Leo, pas le moins du monde, chef; voici, je vous le certifie, la première fois que je viens de ce côté.
—Mon frère se trompe, il y est venu déjà; seulement, de même que tous les visages pâles, la mémoire de mon frère est courte, il a oublié.
—Non, chef; j'ai trop l'habitude du désert pour ne pas reconnaître du premier coup d'œil un endroit quel qu'il soit où je serais déjà venu.
L'Indien sourit de cette prétention si mal justifiée.
—C'est pourtant ce qui arrive aujourd'hui à mon frère, dit-il, bien que trois lunes tout au plus se soient écoulées depuis qu'il a visité ces parages en compagnie du chasseur pâle auquel il donne le nom de Bon-Affût.
L'aventurier se redressa brusquement, une vive émotion se laissa voir sur son visage.
—Que voulez-vous dire, au nom du ciel, peau-rouge? s'écria-t-il avec émotion.
—Je veux dire que Quiepaa-Tani est là, répondit l'Indien en étendant le bras dans la direction du sud-ouest, que nous en sommes éloignés à peine d'une demi-journée de marche.
—Il serait possible?
—Un chef ne ment jamais.
—Oh! s'écria le jeune homme avec énergie en se levant subitement, merci de cette bonne nouvelle, chef.
—Qu'allez-vous faire? lui demanda Balle-Franche.
—Comment! Ce que je vais faire! Ne le devinez-vous pas? Celles que nous voulons sauver sont à quelques lieues à peine de nous, et vous m'adressez cette question!
—Je vous l'adresse parce que je crains que, par votre fougue et votre imprudence, vous ne compromettiez le succès de notre expédition.
—Vos paroles sont dures, vieux chasseur; mais je vous les pardonne, car vous ne pouvez comprendre ce que j'éprouve.
—Peut-être oui, peut-être non, don Miguel; mais, croyez-moi, dans une expédition comme la nôtre, la ruse seule peut nous faire réussir.
—Au diable la ruse et celui qui la conseille! s'écria le jeune homme avec violence. Je veux délivrer les jeunes filles que moi-même, par ma folle confiance, j'ai fait tomber dans ce traquenard.
—Et que vous perdrez pour jamais par une autre folie, croyez-en l'expérience d'un homme qui a vécu au désert plus d'années que vous ne comptez de mois dans votre vie. Depuis que nous suivons la piste de don Estevan, nous avons constaté qu'un fort parti de cavaliers indiens s'est joint à lui, n'est-ce pas? A deux pas d'une ville sainte dont la population est immense, avez-vous l'intention de lutter avec vos quinze gambucinos contre plusieurs milliers de guerriers peaux-rouges, braves et expérimentés? Ce serait de gaieté de cœur vouloir se faire massacrer sans profit. Si don Estevan se dirige de ce côté, c'est que lui aussi sait que les jeunes filles sont à Quiepaa-Tani. Ne brusquons rien, surveillons les mouvements de notre ennemi sans révéler notre présence et lui laisser soupçonner que nous sommes aussi près de lui; de cette manière je vous réponds du succès sur ma tête.
Le jeune homme avait écouté ces paroles avec la plus grande attention. Lorsque Balle-Franche se tut, il lui serra affectueusement la main, et reprenant sa place auprès de lui:
—Merci, mon vieil ami, lui dit-il, merci de la rude façon dont vous m'avez parlé: vous m'avez fait rentrer en moi-même; j'étais fou. Mais, ajouta-t-il au bout d'un instant, que faire? Comment sauver ces malheureuses enfants?
L'Aigle-Volant, pendant la conversation qui précède, était demeuré calme et silencieux, fumant impassiblement son calumet indien; en entendant don Leo parler ainsi, il comprit qu'il était temps qu'il intervint:
—Que le guerrier pâle reprenne courage, dit-il: l'Églantine-des-bois est à Quiepaa-Tani; demain à l'endit-ha—lever du soleil,—nous aurons des nouvelles des vierges pâles.
—Oh! Oh! fit joyeusement le jeune homme. Aussitôt que votre femme reviendra de ce nid de démons, je lui promets, chef, la plus belle paire de bracelets et les plus beaux pendants d'oreilles que jamais cithuatl indienne n'a portés.
—L'Églantine n'a pas besoin de récompense pour rendre service à mes amis.
—Je le sais, chef; mais vous ne me refuserez pas la satisfaction de lui donner cette légère marque de ma reconnaissance?
—Mon frère est libre.
—Ah ça! observa tout à coup Balle-Franche, par quel hasard vous êtes-vous présenté ce soir à notre campement?
—Ne l'avez-vous pas compris?
—Ma foi! Non, je vous l'avoue; nous étions loin de vous soupçonner aussi près de nous.
—C'est vrai, dit don Leo; mais, maintenant que je sais où nous sommes, tout s'explique.
—Oui; mais cela ne nous dit pas pourquoi le chef est venu nous trouver ici.
—Parce que, répondit l'Aigle-Volant, nous avons découvert vos traces par le travers de la piste que nous suivions.
—C'est juste, et vous avez voulu nous reconnaître? Le chef baissa affirmativement la tête.
—Nos amis se sont-ils arrêtés bien loin d'ici?
—Non, répondit l'Indien; maintenant je vais aller les rejoindre afin de leur apprendre quels sont les hommes que j'ai vus. Mon absence a été longue; les visages pâles s'inquiètent promptement. Je pars.
—Un instant encore, fit Balle-Franche. Puisque le hasard nous a réunis, peut-être vaudrait-il mieux ne plus nous séparer; nous aurons peut-être avant peu besoin les uns des autres.
—En effet, qu'en pensez-vous, chef? Vaut-il mieux que ce soit nous qui vous accompagnions à votre camp ou préférez-vous nous rejoindre.
—Nous viendrons ici.
—Hâtez-vous donc, car je suis curieux de savoir ce qui vous est arrivé depuis notre séparation au gué del Rubio.
—L'Aigle-Volant est un bon payntzin—coureur,—répondit le chef, mais il n'a que les pieds d'un homme.
—En effet, pourquoi donc n'êtes-vous pas venus à cheval?
—Nos chevaux sont restés au camp de la grande rivière; une piste se suit mieux à pied.
—Il est facile de remédier à cela. Combien êtes-vous?
—Quatre.
—Comment! Quatre? Vous étiez davantage il me semble.
—Oui, mais le chasseur pâle vous expliquera pourquoi deux de nos compagnons nous ont quittés.
—Bon, je vous accompagnerai.
Don Leo donna immédiatement l'ordre de préparer quatre chevaux, recommanda a Balle-Franche de veiller sur le campement pendant son absence; alors se mettant en selle, mouvement imité par le chef, tous deux s'éloignèrent en conduisant en bride les chevaux destinés à ceux qu'ils allaient retrouver.
Il ne fallut aux deux hommes que vingt minutes, à peu près, pour faire la route que, seul, l'Aigle-Volant avait mis plus d'une heure à parcourir, à cause des précautions qu'il avait été obligé de prendre lorsqu'il suivait une piste inconnue, qui pouvait appartenir à des ennemis. Ils trouvèrent don Mariano et Bon-Affût, le canon du rifle en avant, et faisant bonne guette. En attendant le retour de l'Aigle-Volant, ils avaient fini par s'endormir; mais les pas des chevaux les avaient réveillés; à tout hasard, ils s'étaient mis sur la défensive.
Seulement, à leur réveil, une surprise fort désagréable les attendait. Ils ne se virent plus que deux au lieu de trois.
Domingo, le gambucino, avait disparu. Aussitôt la reconnaissance effectuée entre don Leo, le chasseur et don Mariano, le Canadien, avant toute chose, leur dit avec agitation:
—Pied à terre, pied à terre, caballero, et en chasse tous!
—Comment! En chasse à cette heure? répondit don Leo; êtes-vous fou, Bon-Affût?
—Je ne suis pas fou, reprit vivement le Canadien; mais, je vous le répète, pied à terre et en chasse! Nous sommes trahis!
—Comment, trahis! s'écria don Leo en bondissant de surprise, et par qui, au nom du ciel?
—Par Domingo! Le traître s'est enfui pendant notre sommeil! Oh! J'avais raison de me défier de sa face cuivrée!
—Domingo enfui? Traître? Vous vous trompez!
—Je ne me trompe pas. En chasse, vous dis-je! Au nom de celles que vous avez juré de sauver!
Il n'en fallait pas autant pour exaspérer le jeune homme; il se précipita en bas de son cheval et saisissant son rifle:
—Que faut-il faire? demanda-t-il.
—Partageons-nous le terrain, répondit rapidement le chasseur; partons chacun d'un côté, que Dieu bénisse nos recherches! Nous n'avons perdu que trop de temps déjà.
Sans un plus long échange de paroles, les quatre hommes s'enfoncèrent dans la forêt par quatre côtés différents.
Mais les ténèbres étaient épaisses; sous le couvert où même en plein jour les rayons du soleil ne pénétraient qu'avec peine, par cette nuit noire et sans lune, on ne distinguait rien à deux pas de soi; et si, au lieu de fuir, le gambucino s'était contenté de se cacher aux environs, évidemment les chasseurs passeraient auprès de lui sans l'apercevoir.
Les recherches durèrent longtemps; les chasseurs comprenaient de quelle importance était pour eux de retrouver le fugitif; mais, malgré toute leur adresse, ils ne purent rien découvrir.
Bon-Affût, don Mariano et don Leo étaient depuis quelques instants de retour auprès du foyer; ils se communiquaient, d'un air découragé, le mauvais résultat de leur poursuite, lorsque tout à coup une lueur éblouissante sillonna la forêt et un coup de feu se fit entendre, suivi presque immédiatement d'un second.
—Courons cria Bon-Affût, l'Aigle-Volant a dépisté la vermine; jamais si bon limier n'a été en quête d'une proie.
Les trois hommes s'élancèrent au pas de course dans la direction des détonations qu'ils avaient entendues. En approchant, ils reconnurent qu'une lutte acharnée avait lieu; le cri de guerre des Comanches, poussé d'une voix retentissante par l'Aigle-Volant, ne leur laissa pas le moindre doute à cet égard. Enfin, ils débouchèrent, en courant, sur le théâtre de l'action.
L'Aigle-Volant, le pied posé sur la poitrine d'un homme renversé devant lui, et qui se tordait comme un serpent pour échapper à l'étreinte qui le brisait, avait le dos appuyé contre un chêne noir, et le tomahawk à la main, il se défendait comme un lion contre cinq ou six Indiens qui l'attaquaient à la fois.
Les trois blancs saisirent leurs rifles par le canon et, s'en servant comme de massues, se précipitèrent dans la mêlée avec un cri de défi terrible.
L'effet de cette diversion fut instantané. Les peaux-rouges se dispersèrent dans toutes les directions et s'enfuirent comme une légion de fantômes.
—Sus! Sus! hurla don Leo en s'élançant en avant.
—Arrêtez! lui cria Bon-Affût en le retenant par le bras, autant poursuivre le nuage qu'emporte le vent; laissez échapper ces misérables, nous les retrouverons, je vous le garantis!
L'aventurier comprit qu'en ce moment une poursuite dans les ténèbres serait donner sur lui d'énormes avantages à ses ennemis plus au fait de la localité et probablement fort nombreux; il s'arrêta avec un soupir de regret.
Le chef fut alors entouré et félicité pour sa belle résistance. Le sachem reçut ces compliments avec la modestie qui lui était habituelle.
—Ooah! répondit-il seulement, les Apaches sont des vieilles femmes poltronnes; un guerrier comanche suffit pour en tuer six fois dix, et vingt davantage.
Par un hasard miraculeux, le brave Indien n'avait reçu que quelques égratignures sans importance, dont, malgré les pressantes sollicitations de ses amis, il ne voulut pas consentir à s'occuper autrement qu'en les lavant avec un peu d'eau fraîche.
—Mais, dit soudain Bon-Affût en se baissant, qu'avons-nous ici? Eh! Eh! Je ne me trompe pas, voilà notre fugitif.
C'était, en effet, Domingo. Le pauvre diable avait la cuisse brisée; prévoyant sans doute le sort qui l'attendait, il hurlait de douleur sans vouloir répondre autrement.
—Ce serait une bonne action, dit don Mariano, de casser la tête à ce misérable, afin de terminer ses souffrances.
—Ne nous pressons pas, observa l'implacable chasseur, chaque chose aura son temps; laissez l'Aigle-Volant nous expliquer comment il l'a rencontré.
—Oui! Ceci est important, appuya don Leo.
—C'est le Wacondah qui a livré cet homme entre mes mains, répondit sentencieusement le chef. J'avais fouillé la forêt avec autant de soin que me le permettaient les ténèbres, je revenais vers vous fatigué de près de deux heures de recherches infructueuses, lorsqu'au moment où j'y songeais le moins, je fus brusquement attaqué par plus de dix Apaches qui se ruèrent sur moi de tous les côtés à la fois. Cet homme était en tête des assaillants; il déchargea son cruhpa sur moi sans m'atteindre; je répondis de la même façon, mais plus heureusement, car il tomba; je posai immédiatement le pied sur sa poitrine de crainte qu'il ne m'échappât, et je me défendis de mon mieux contre mes ennemis, afin de vous donner le temps d'accourir à mon secours. J'ai dit.
—Vrai dieu, chef! s'écria le chasseur avec enthousiasme, vous êtes un brave guerrier! Ce que vous avez fait est beau! Ce misérable, après nous avoir abandonnés, avait rejoint un parti de ces oiseaux de proie, il revenait dans l'intention sans doute de nous attaquer pendant notre sommeil.
—Enfin, reprit don Mariano, il est retrouvé, tout est pour le mieux.
Le blessé fit un effort suprême, se redressa, et s'appuyant sur la main droite, il ricana horriblement.
—Oui, oui, répondit-il, je sais que je vais mourir; mais ce ne sera pas sans vengeance!
—Que dis-tu, misérable? s'écria don Mariano.
—Je dis que votre frère sait tout, mon beau seigneur, et qu'il parviendra à déjouer vos projets.
—Vipère! Que t'ai-je fait pour agir ainsi envers moi?
—Vous ne m'avez rien fait, répondit-il avec un rire de démon; mais, ajouta-t-il en désignant don Leo, celui-là, je le hais depuis longtemps.
—Eh bien, meurs, misérable! s'écria le jeune homme exaspéré en lui posant sur le front l'anneau glacé de son rifle.
L'Aigle-Volant détourna l'arme.
—Cet homme est à moi, mon frère, dit-il.
Don, Leo ramena lentement son rifle vers lui, et se tournant vers le chef:
—J'y consens, fit-il, mais à condition qu'il mourra.
Un sourire sinistre plissa pendant une seconde les lèvres minces de l'Indien.
—Oui, répondit-il, et d'une mort apache.
Détachant alors l'arc qu'il portait suspendu auprès de son carquois de peau de panthère, il entoura le crâne du gambucino avec la corde, et faisant tourniquet au moyen d'une flèche passée dans cette corde, tandis que, le genou appuyé entre les épaules du misérable, il empoignait fortement sa chevelure de la main droite et la tirait à lui, il le scalpa ainsi, en lui infligeant la plus abominable torture qui se puisse imaginer, puisque, au lieu de toucher les chairs avec son couteau, il les arracha littéralement au moyen de la corde. Le bandit le visage inondé de sang, les traits défigurés, joignit les mains avec effort en s'écriant avec une expression impossible à rendre:
—Tuez-moi! Oh! Par pitié, tuez-moi!
Le Comanche rapprocha son visage féroce de celui du bandit.
—On ne tue pas les traîtres! dit-il d'une voix sourde. Et, le saisissant par le cou, il passa la lame de son couteau entre ses dents serrées, lui ouvrit la bouche de force et lui arracha la langue qu'il jeta avec dégoût.
—Meurs comme un chien, lui dit-il; ta langue menteuse ne trahira plus personne.
Domingo poussa un cri de douleur tellement horrible que les assistants tressaillirent de terreur, et il roula sans connaissance sur le sol[1].
L'Aigle-Volant repoussa dédaigneusement du pied le corps du bandit, et se tournant vers ses compagnons:
—Partons, dit-il.
Ceux-ci le suivirent silencieusement, atterrés et épouvantés de la scène dont ils avaient été les témoins. Une heure plus tard, ils rejoignirent Balle-Franche à son campement.
Au lever du soleil, l'Aigle-Volant s'approcha de Bon-Affût et lui toucha légèrement l'épaule du doigt.
—Que voulez-vous? demanda le chasseur en s'éveillant.
—Le sachem va au-devant de l'Églantine, répondit simplement le chef.
Et il s'éloigna.
—Il y a cependant quelque chose dans ces rudes natures, murmura le chasseur en le suivant du regard.
[1] Le récit de ce supplice est historique; l'auteur l'a vu infliger par un Apache à un Américain du Nord.
Deux heures après le lever du soleil, l'Aigle-Volant était de retour au camp; l'Églantine l'accompagnait.
Le conseil fut immédiatement réuni, afin d'apprendre les nouvelles.
La jeune Indienne ne savait pas grand chose. Tout se résumait à ceci:
Les deux Mexicaines étaient encore dans la ville. Addick était absent, mais on l'attendait d'un moment à l'autre.
Ces nouvelles, si brèves qu'elles fussent, étaient bonnes cependant; car, bien que les détails manquassent, les chasseurs savaient que leurs ennemis n'avaient pas encore eu le temps d'agir. Il s'agissait donc de les devancer et d'enlever les jeunes filles avant qu'ils n'eussent les moyens de s'y opposer.
Mais, pour enlever les jeunes filles, il fallait s'introduire dans la ville, et là gisait la difficulté.
Difficulté qui, au premier abord, semblait insurmontable.
Dans ce moment de détresse, tous les yeux se tournèrent vers l'Aigle-Volant. Le chef souriait.
A l'expression d'angoisse peinte sur toutes les physionomies, l'Indien devina ce qu'on attendait de lui.
—L'heure est arrivée, dit-il; mes frères pâles exigent de moi le plus grand sacrifice qu'ils puissent demander à un sachem, c'est-à-dire de leur ouvrir les portes de l'un des derniers refuges de la religion indienne, du principal sanctuaire où se conserve encore intacte la loi de Ilhuicamina[2], le plus grand, le plus puissant et le plus malheureux de tous les souverains qui ont gouverné le pays d'Hanahuac[3]; cependant, afin de prouver à mes frères pâles combien mon sang coule rouge dans mes veines et combien mon cœur est pur et sans nuage, pour eux je le ferai, ainsi que je l'ai promis.
A cette assurance donnée par l'Aigle-Volant, dont la parole ne pouvait être révoquée en doute, tous les visages s'éclaircirent.
Le chef continua:
—L'Aigle-Volant n'a pas la langue fourchue; ce qu'il dit, il le fait; il introduira le grand chasseur pâle dans Quiepaa-Tani; seulement, mes frères doivent oublier qu'ils sont guerriers et braves; la ruse seule peut les faire triompher. Le grand chasseur des visages pâles a-t-il compris les paroles du chef? Est-il résolu à se fier à sa prudence et à son expérience?
—J'agirai comme vous me l'indiquerez, chef, répondit Bon-Affût, qui savait que c'était à lui que s'adressait le Comanche; je vous promets de me laisser entièrement guider par vous.
—Ooah! reprit l'Indien en souriant, tout est bien alors; avant deux heures, mon frère sera dans Quiepaa-Tani.
—Dieu veuille qu'il en soit ainsi et que ma pauvre enfant soit sauvée, murmura don Mariano.
—Je suis depuis longtemps habitué à lutter de ruse avec les Indiens, répondit le chasseur; jusqu'à présent, grâce à Dieu, je me suis toujours assez bien tiré de mes rencontres avec eux; j'ai, cette fois encore, bon espoir de réussir.
—Nous nous tiendrons prêts à vous venir en aide, si besoin était, dit don Leo.
—Surtout, arrangez-vous de façon à ne pas être dépistés; vous savez que ce traître de Domingo, leur a donné l'éveil.
—Rapportez-vous-en à moi pour cela, Bon-Affût, dit Balle-Franche; je sais ce que c'est que de jouer à cache-cache avec les Indiens; ce n'est pas la première fois que cela m'arrive, et je me souviens qu'en 1845, à l'époque ou j'étais...
—Je sais, interrompit le Canadien, que vous n'êtes pas homme à vous laisser surprendre, mon ami, et cela me suffit; seulement tenez-vous sur vos gardes, afin d'être prêt au premier signal.
—Et quel sera ce signal? Car il faut bien nous entendre, afin d'éviter un malentendu toujours regrettable qui, dans les circonstances où nous nous trouvons, pourrait avoir des conséquences excessivement graves.
—Vous avez raison; lorsque vous entendrez le cri de l'épervier d'eau répété trois fois à intervalles égaux, alors il faudra agir vigoureusement.
—C'est compris, répondit Balle-Franche; rapportez-vous-en à nous.
—Je suis prêt, dit Bon-Affût au chef; que faut-il faire?
—D'abord il faut vous habiller, répondit l'Aigle-Volant.
—Comment! M'habiller? fit le chasseur en jetant un regard étonné sur sa personne.
—Ooah! Mon frère croit-il donc qu'il entrera à Quiepaa-Tani avec ses vêtements de visage pâle?
—C'est juste, un déguisement indien est de rigueur; attendez un instant.
Le travestissement n'était pas long à opérer.
L'Églantine s'était modestement retirée dans l'épaisseur du bois, afin de ne pas assister à la toilette du chasseur.
En quelques minutes Bon-Affût avait tiré de ses alforjas un rasoir avec lequel il avait abattu barbe et moustache.
Pendant ce temps, le chef avait été cueillir une plante qui croissait en abondance dans la forêt. Après en avoir extrait le jus, l'Aigle-Volant aida le Canadien, qui s'était dépouillé de tous ses vêtements, à s'en teindre le corps et le visage. Puis le chef lui dessina, tant bien que mal, une ayotl, ou tortue sacrée, sur la poitrine, accompagnée de quelques ornements fantastiques qui n'avaient rien de belliqueux, et qu'il lui reproduisit sur le visage. Il donna aux cheveux, encore presque tous noirs du chasseur, une nuance blanchâtre destinée à le faire paraître très âgé; car on sait que chez les Indiens les cheveux conservent fort longtemps leur couleur; il noua les cheveux sur le sommet de la tête, à la mode des Yumas, les peaux-rouges les plus voyageurs qui existent, et à gauche de cette touffe, afin de bien exprimer qu'elle ornait le chef d'un homme pacifique, il planta une plume de papagallo, au lieu de la mettre au milieu même du chignon, ainsi qu'ont coutume de le faire les guerriers.
Une fois ces préparatifs terminés, l'Aigle-Volant demanda aux Européens, qui avaient suivi avec curiosité les différentes péripéties de cette métamorphose, comment ils trouvaient leur compagnon.
—Ma foi, répondit naïvement Balle-Franche, si je n'avais pas assisté à sa transformation, je ne le reconnaîtrais pas; et, à propos de cela, je me rappelle une singulière aventure qui m'arriva en 1836. Figurez-vous...
—Et vous, qu'en dites-vous? reprit l'Indien en coupant impitoyablement la parole au Canadien et en s'adressant à don Leo.
Celui-ci ne put s'empêcher de rire en regardant le chasseur.
—Ma foi, je le trouve affreux; il ressemble si bien à un peau-rouge que je suis certain qu'il peut hardiment se risquer.
—Och! Les Indiens sont bien fins, murmura le chef; cependant, je crois que, déguisé ainsi, si mon frère veut bien se pénétrer de l'esprit du personnage qu'il représente, il n'a rien à craindre.
—Je ne demande pas mieux; seulement je vous ferai observer, chef, que j'ignore encore quel est le personnage que vous me destinez à représenter.
—Mon frère est un tlacateotzin, un grand médecin yuma.
—Pardieu! L'idée est bonne; de cette façon je pourrai m'introduire partout.
Le Comanche s'inclina en souriant.
—Je serai bien maladroit si je ne réussis pas, continua le chasseur; mais, puisque je suis médecin, je ne dois pas oublier de me fournir de médicaments.
Bon-Affût, fouillant alors dans ses alforjas, en retira tout ce qui aurait pu le compromettre, et n'y laissa que sa trousse de voyage et une petite boîte à médicaments qu'il portait toujours avec lui, bagage précieux auquel il avait eu recours dans mainte occasion. Il ferma les alforjas, les jeta sur son dos, et se tournant vers le chef:
—Je suis prêt, lui dit-il.
—Bon; l'Églantine et moi nous irons en avant, afin de faciliter la route à mon frère.
Le chasseur fit un signe d'assentiment.
L'Indien appela sa femme: tous deux, après avoir pris congé des aventuriers, s'éloignèrent.
Aussitôt que le chef eut disparu, le chasseur fit à son tour ses adieux à ses amis. C'était peut-être la dernière fois qu'il les voyait. Qui pouvait prévoir le sort qui lui était réservé au milieu des Indiens farouches aux mains desquels il allait se livrer sans défense?
—Je vous accompagnerai jusqu'à la lisière de la forêt, lui dit don Leo, afin de bien me rendre compte des moyens que je pourrai employer afin d'être à portée d'accourir à votre premier signal.
—Venez, lui dit laconiquement le chasseur.
Ils partirent suivis par les vœux de tous leurs compagnons, qui voyaient s'éloigner Bon-Affût avec un sentiment de tristesse et une anxiété inexprimable.
Les deux hommes marchaient côte à côte sans échanger une parole; le Canadien était plongé dans de profondes réflexions; don Leo, lui, semblait en proie à une émotion dont il ne parvenait pas à se rendre maître. Ils arrivèrent ainsi jusqu'aux derniers arbres de la forêt.
Le chasseur s'arrêta.
—C'est ici que nous devons nous quitter, dit-il à son compagnon.
—C'est vrai, murmura le jeune homme, en jetant un regard triste autour de lui. Et il se tut.
Le Canadien attendit un instant; voyant enfin que don Leo s'obstinait à garder le silence:
—N'avez-vous rien à me dire? reprit-il.
—Pourquoi m'adressez-vous cette question? lui demanda le jeune homme en tressaillant.
—Parce que, répondit le chasseur, ce n'est pas seulement afin de jouir plus longtemps de ma compagnie que vous êtes venu jusqu'ici, don Leo; vous devez, je le répète, avoir quelque chose à me dire.
—Oui, c'est vrai, fit-il avec effort, vous avez deviné, j'ai à vous parler; mais je ne sais comment cela se fait, ma gorge se serre, je ne puis trouver de paroles pour vous exprimer ce que j'éprouve. Oh! Si j'avais votre expérience et votre connaissance des langues indiennes, nul autre que moi, je vous assure, Bon-Affût, ne serait allé à Quiepaa-Tani.
—Oui, cela doit être ainsi, murmura le chasseur, se parlant à lui-même plutôt que répondant à son ami; et pourquoi ne serait-ce pas? L'amour est le soleil de la jeunesse; tout aime dans le monde: pourquoi deux êtres beaux et bien faits resteraient-ils seuls insensibles l'un pour l'autre et ne s'aimeraient-ils pas? Que voulez-vous que je lui dise pour vous, ajouta-t-il brusquement.
—Oh! s'écria le jeune homme, vous vous êtes donc aperçu que je l'aimais? Ce secret, que je n'osais m'avouer à moi-même, vous en êtes donc le maître?
—Ne craignez rien pour cela, mon ami; ce secret est aussi en sûreté dans mon cœur que dans le vôtre.
—Hélas, mon ami! Les paroles que je voudrais lui dire, ma bouche seule pourrait les prononcer avec l'espoir de les faire peut-être parvenir à son cœur. Ne lui dites rien, cela vaudra mieux; seulement, apprenez-lui que je suis ici, que je veille sur elle, et que je mourrai ou qu'elle sera libre bientôt dans les bras de son père.
—Je lui dirai tout cela, mon ami.
—Et puis, ajouta-t-il en rompant par un mouvement fébrile une chaînette d'acier pendue à son cou et soutenant un petit sachet de velours noir, prenez cette amulette; c'est tout ce qui me reste de ma mère, fit-il avec un soupir, elle la suspendit à mon cou le jour de ma naissance: c'est une relique sainte, un morceau de la vraie croix béni par le Pape; donnez-lui cela, qu'elle le garde précieusement; cette amulette m'a préservé de bien des périls. C'est tout ce que je puis faire pour elle en ce moment. Allez, mon ami, sauvez-la, puisque, moi, je suis condamné à former des vœux stériles pour sa délivrance. Vous m'aimez, Bon-Affût; je n'ajouterai qu'un mot: de la tentative que vous faites en ce moment résultera pour moi la vie ou la mort. Adieu! Adieu!
Saisissant par un mouvement nerveux la main du chasseur, il la serra avec force à plusieurs reprises, et se détournant brusquement afin de ne pas laisser voir ses larmes, il s'enfonça à pas précipités dans la forêt, où il disparut après avoir fait un dernier signe de la main à son ami qui le regardait s'éloigner.
Après le départ de don Leo, le Canadien demeura un instant sombre et pensif, en proie à une indicible tristesse.
—Pauvre jeune homme, murmura-t-il en poussant un profond soupir, est-ce donc ainsi que l'on est quand on aime?
Au bout d'un instant, il vainquit l'émotion étrange qui lui serrait le cœur, et relevant résolument la tête:
—Le sort en est jeté, dit-il, en avant!
Prenant alors la démarche tranquille et nonchalante d'un Indien, il se dirigea à pas lents vers la plaine, tout en jetant autour de lui des regards interrogateurs.
Aux rayons resplendissants du soleil qui s'était levé radieux, la verte campagne que traversait le chasseur avait pris un aspect réellement enchanteur. De même que la première fois qu'il était venu dans cette contrée, tout était en mouvement autour de lui.
Le Canadien, qui, à l'aide de son nouvel extérieur, pouvait examiner à loisir tout ce qui se passait, regardait curieusement le tableau animé qu'il avait sous les yeux; mais ce qui fixa le plus son attention fut une troupe de cavaliers vêtus ou plutôt peints en guerre, armés de ces longs javelots et de ces longues flèches barbelées qu'ils manient avec une si grande dextérité et dont les blessures sont si dangereuses. La plupart portaient en outre un rifle en bandoulière et une reata à la ceinture, et, marchant en bon ordre, ils s'avançaient au trot vers la ville, paraissant venir du côté opposé à celui par lequel arrivait le chasseur.
Les nombreuses personnes répandues dans la campagne s'étaient arrêtées pour les examiner; Bon-Affût, profitant de cette circonstance, pressa le pas afin de se mêler aux curieux, au milieu desquels, ainsi qu'il le désirait, il fut bientôt confondu, sans que personne songeât à lui accorder la moindre attention.
Les cavaliers allaient toujours le même train, sans paraître remarquer la curiosité qu'ils excitaient, ils se trouvèrent bientôt à une quarantaine de pas de la porte principale. Arrivés à cette distance, ils s'arrêtèrent.
Au même instant, trois cavaliers sortirent au galop de la ville, traversèrent en deux bonds le pont jeté sur le fossé, et vinrent à leur rencontre.
Trois guerriers se détachèrent alors de la première troupe et s'approchèrent d'eux.
Après quelques paroles échangées brièvement, les six cavaliers réunis rejoignirent le détachement qui était demeuré immobile en arrière et entrèrent avec lui dans la ville.
Bon-Affût, qui le suivait de près, arriva à la porte à l'instant où les derniers cavaliers disparaissaient dans la cité.
Le chasseur comprit que le moment était venu de payer d'audace: prenant alors l'air le plus insouciant qu'il lui fût possible d'affecter, bien que son cœur battît à lui briser la poitrine, il se présenta à son tour pour entrer.
Il avait aperçu à quelque distance l'Aigle-Volant et sa femme, arrêtés à causer avec un Indien qui semblait tenir un certain rang.
Cette vue redoubla le courage du hardi Canadien.
Il franchi hardiment le pont et arriva impassible en apparence devant la porte.
Alors une lance s'abattit devant lui et lui barra le passage.
A un geste de l'Aigle-Volant, l'Indien avec lequel il causait le quitta et se dirigea vers la porte.
C'était un guerrier de haute taille, auquel ses cheveux grisonnants et les rides nombreuses de son visage imprimaient un certain caractère de douceur, de finesse et de majesté; il dit un mot à la sentinelle qui s'opposait au passage du chasseur; celle-ci releva aussitôt sa lance et se recula de quelques pas après s'être respectueusement incliné.
Le vieil Indien fit signe au Canadien d'entrer.
—Mon frère est le bienvenu dans Quiepaa-Tani, dit-il gracieusement en saluant le chasseur; mon frère a des amis ici.
Bon-Affût, grâce à la vie qu'il menait depuis longtemps dans les Prairies, parlait plusieurs dialectes indiens avec autant de facilité que sa langue maternelle; d'après la question que lui adressait le peau-rouge, il comprit qu'il était soutenu; alors il prit l'aplomb nécessaire pour bien jouer son rôle et reprit:
—Mon frère est-il un chef?
—Je suis un chef.
—Och! Que mon frère interroge; Ometochtli répondra.
—En changeant pour ainsi dire de personnalité, le chasseur avait aussi eu soin de changer de nom; après des recherches longtemps stériles, il s'était enfin arrêté à celui de Ometochtli, comme se rapportant le mieux au personnage qu'il voulait représenter; car, malgré son apparence formidable, ce nom signifie simplement Deux-Lapins[4], nom des plus inoffensifs, et parfaitement dans l'esprit du rôle adopté par le chasseur.
—Je n'ai pas à interroger mon frère, répondit le chef avec courtoisie; je sais qui il est et d'où il vient; mon frère est un des adeptes de la grande médecine, de la sage nation des Yumas.
—Le chef est bien renseigné, répondit le chasseur; je vois qu'il a causé avec l'Aigle-Volant.
—Mon frère a quitté sa nation depuis longtemps?
—Il y aura sept lunes aux premières feuilles que j'ai pris les mocassins du voyageur.
—Ooah! reprit le chef avec un certain accent de respect; où sont donc situés les territoires de chasse de la nation de mon frère?
—Sur les bords du grand lac sans rivage—la mer.—
—Mon frère compte-t-il exercer la grande médecine à Quiepaa-Tani?
—Je n'y viens que dans ce but et dans celui d'adorer le Wacondah dans le temple magnifique que la piété des Indiens lui a élevé dans la cité sainte.
—Très bon; mon frère est un homme sage; sa nation est pacifique, dit-il en relevant la tête et redressant sa haute taille avec orgueil; je suis un guerrier et on me nomme Atoyac.
Par un hasard étrange, le premier Indien avec lequel Bon-Affût se trouvait en rapport était le même qui avait reçu Addick et dont la femme avait été choisie par le grand-prêtre pour lui servir d'interprète auprès des jeunes filles; il est vrai que ces deux circonstances étaient complètement ignorées du chasseur.
—Mon frère est un grand chef, répondit-il aux paroles de l'Indien.
Celui-ci s'inclina avec une modestie superbe en recevant cette flatteuse qualification.
—Je suis un fils de la sainte tribu à qui est confiée la garde du temple, dit-il.
—Que le Wacondah bénisse la race de mon frère.
Le chef était complètement sous le charme: les compliments du chasseur l'avaient enivré.
—Que mon frère Deux-Lapins me suive; nous allons rejoindre ses amis qui nous attendent, puis nous nous rendrons dans mon calli, qui sera le sien pendant tout le temps de son séjour à Quiepaa-Tani.
Bon-Affût s'inclina respectueusement.
—Je ne suis pas digne de secouer la poussière de mes mocassins sur le seuil de sa porte.
—Le Wacondah bénit ceux qui pratiquent l'hospitalité; mon frère Deux-Lapins est l'hôte d'un chef; qu'il me suive donc.
—Je suivrai mon frère, puisque telle est sa volonté.
Et, sans plus de résistance, il se mit à marcher derrière le vieux chef, charmé au fond du cœur de s'être si bien tiré de cette première épreuve. Ainsi que nous l'avons dit, l'Aigle-Volant et l'Églantine étaient arrêtés à quelques pas dans l'intérieur, ils les eurent bientôt rejoints.
Tous les quatre, sans prononcer une parole, se dirigèrent vers la maison habitée par le chef et qui se trouvait située à l'autre extrémité de la ville.
Ce long trajet permit au chasseur de jeter un regard sur les rues qu'il traversait et de prendre une connaissance superficielle de Quiepaa-Tani.
Enfin ils arrivèrent à la demeure du chef.
Huilotl—le Pigeon,—la femme de Atoyac, assise les jambes croisées sur une natte en paille de maïs, confectionnait des tortillas, destinées probablement au dîner de son époux.
Non loin d'elle se tenaient trois ou quatre esclaves du sexe féminin appartenant à cette race bâtarde d'Indiens dont nous avons eu occasion de parler plus haut et auxquels, à juste titre, on peut appliquer la qualification de sauvages.
Au moment où le chef et ses hôtes entrèrent dans le calli, le Pigeon et ses esclaves levèrent les yeux avec curiosité.
—Huilotl, dit le chef avec dignité, je vous amène des étrangers: le premier est un grand et renommé sachem comanche; vous le connaissez déjà, ainsi que sa femme.
—L'Aigle-Volant et l'Églantine sont les bienvenus dans le calli d'Atoyac, répondit-elle.
Le Comanche s'inclina légèrement sans prononcer un mot.
—Celui-ci reprit le chef en désignant le chasseur, est un célèbre tlacateotzin des Yumas; il se nomme Deux-Lapins; il habitera aussi avec nous.
—Les paroles que j'ai adressées au sachem des Comanches, je les répète pour le grand médecin des Yumas, dit-elle avec un sourire d'une certaine douceur; le Pigeon est son esclave.
—Ma mère me permettra de baiser ses pieds, répondit galamment le Canadien.
—Mon frère baisera mon visage, reprit l'épouse du chef en tendant sa joue à Bon-Affût, qui l'effleura respectueusement de ses lèvres.
—Mes frères prendront le pulque de l'arrivée, continua le Pigeon; la route est longue et poudreuse, et les rayons du soleil sont ardents.
—Le pulque désaltère la bouche aride des voyageurs, répondit Bon-Affût pour lui et ses compagnons.
La présentation était faite.
Les esclaves approchèrent des butacas sur lesquelles les voyageurs s'étendirent; des pots en terre rouge, assez semblables aux alcaforas espagnoles, remplis de pulque, furent apportés, et la liqueur, versée par la maîtresse de la maison elle-même dans des vases de corne, fut présentée par elle aux étrangers avec cette charmante et attentive hospitalité dont les Indiens seuls possèdent le secret.
[1] Littéralement homme-dieu. De tlacatl, homme, et teotl, dieu, nom donné par certaines tribus comanches à ceux qui exercent l'art de guérir.
[2] Surnom de Motecuhzoma 1er: qui lance des flèches jusqu'au ciel. De ilhuicatl, ciel, et mitl, flèche. L'hiéroglyphe de ce roi est en effet une flèche qui frappe le ciel.
[3] Mexique.
[4] Ometochtli vient ome, deux, et tochtli, lapin.
Tout en feignant d'être absorbé par le soin de répondre aux politesses empressées de son hôte, le Canadien examinait attentivement l'intérieur de la maison dans laquelle il se trouvait, afin de se former une idée des autres habitations de la ville; car il supposait, à juste titre, que dans toutes la distribution devait être à peu près semblable.
La pièce dans laquelle Atoyac avait reçu ses hôtes était une assez grande chambre carrée, dont les murs blanchis a la chaux étaient ornés de chevelures humaines et d'une rangée d'armes tenues dans un état de propreté excessive.
Des peaux de jaguars et de ocelotl[1] des zarapés et des frazadas étaient entassés dans des espèces de grandes caisses destinées, selon toutes probabilités, à servir de lits.
Des butacas et autres sièges de bois excessivement bas meublaient cette pièce, au centre de laquelle était placés, une table élevée d'environ quarante centimètres seulement de terre.
Cet intérieur bien simple, comme on le voit, se retrouve, au reste, reproduit presque identiquement dans tous les callis indiens, qui se composent généralement de six pièces.
La première est celle que nous venons de décrire: c'est là que se tient habituellement la famille.
La seconde est destinée aux enfants.
La troisième sert de chambre à coucher.
La quatrième renferme les métiers à tisser les zarapés que les Indiens confectionnent avec un talent inimitable; ces métiers faits en bambous sont d'une simplicité de mécanisme admirable.
La cinquième contient les provisions de toutes espèces pour la saison des pluies, époque où la chasse est impossible.
Et, enfin, la sixième est réservée aux esclaves.
Quant à la cuisine, en réalité, elle n'existe pas; c'est dans le corral, c'est-à-dire en plein air, que se préparent les aliments.
Les cheminées y sont également inconnues; chaque pièce est chauffée au moyen d'un large brasero en terre.
Les soins intérieurs du calli sont confiés aux esclaves qui travaillent sous la surveillance immédiate de la maîtresse du logis.
Ces esclaves ne sont pas tous des sauvages; les Indiens rendent complètement aux blancs les maux qu'ils en reçoivent; beaucoup de malheureux Espagnols pris à la guerre, où tombés dans les embuscades que leur tendent sans cesse les peaux-rouges, sont condamnés à la servitude la plus dure.
Le sort de ces malheureux est encore plus triste que celui de leurs compagnons d'esclavage, car ils n'ont pas la perspective d'être un jour rendus à la liberté: ils doivent, au contraire, s'attendre à périr tôt ou tard victimes de la haine de leurs maîtres cruels, qui se vengent impitoyablement sur eux des vexations sans nombre qu'ils ont souffertes sous le tyrannique et abrutissant système du gouvernement espagnol.
Aussi, est-ce réellement sous le coup de cette dure captivité que l'homme peut s'appliquer les mots désespérants écrits par le divin Dante Alighieri sur les portes de son Enfer: Lasciate ogni speranza.
Atoyac, chez lequel le hasard avait si providentiellement conduit le Canadien, était un des sachems les plus respectés des guerriers de Quiepaa-Tani. Dans sa jeunesse, il avait longtemps habité parmi les Européens, et la grande expérience qu'il avait acquise, en parcourant les contrées éloignées de sa tribu, avait ouvert son intelligence, éteint en lui certains préjugés de caste, et le rendait plus sociable et plus policé que la plupart de ses compatriotes.
Tout en buvant son pulque à petite dose, ainsi que doit le faire un gourmet qui apprécie à sa juste valeur la liqueur dont il s'abreuve, il causa avec le chasseur, et peu à peu, soit par l'influence du pulque, soit plutôt par la confiance instinctive que lui inspirait le Canadien, il devint plus communicatif. Ainsi que cela arrive toujours en pareille circonstance, il commença par ses propres affaires et les raconta dans les plus grands détails au chasseur; il lui apprit qu'il était père de quatre fils, guerriers renommés, dont le plus grand bonheur était de faire des courses sur le territoire espagnol, pour brûler les haciendas, ravager les moissons et enlever des prisonniers; puis il lui raconta les voyages qu'il avait faits, et parut vouloir prouver au médecin Deux-Lapins que son grand courage comme guerrier, son expérience et ses vertus militaires ne l'empêchaient nullement, au besoin, de comprendre ce qu'il y avait de noble et de respectable dans la science; il insinua même que lui, bien qu'étant un sachem, il ne dédaignait pas de se livrer parfois à l'étude des simples et à la recherche des secrets de la grande médecine dont le Wacondah, dans sa bonté suprême, avait doté certains hommes d'élite pour le soulagement de l'humanité entière.
Bon-Affût affecta de paraître profondément touché de la considération que le puissant sachem Atoyac portait au caractère sacré dont il était revêtu, et il résolut in petto de profiter des bonnes dispositions de son hôte à son égard pour le sonder adroitement sur ce qu'il avait tant à cœur de savoir, c'est-à-dire, en quel état se trouvaient les jeunes filles et dans quel endroit de la ville elles étaient renfermées.
Cependant comme la susceptibilité des Indiens est excessivement facile à éveiller, qu'il était nécessaire d'user de la plus grande patience, le chasseur ne laissa rien deviner de ses intentions, et il attendit patiemment que le chef lui fournît lui-même l'occasion de l'interroger.
La conversation était devenue à peu près générale; cependant plus d'une heure s'était écoulée déjà, et malgré tous ses efforts aidés par ceux de l'Aigle-Volant, le chasseur n'avait encore pu parvenir à aborder de front la question qui lui tenait tant au cœur, lorsqu'un Indien se présenta sur le seuil de la porte.
—Le Wacondah se réjouit, dit le nouveau venu en s'inclinant respectueusement; j'ai une mission pour mon père.
—Que mon fils soit le bienvenu, répondit le chef; mes oreilles sont ouvertes.
—Le grand conseil des sachems de la nation est réuni, dit l'Indien; on n'attend plus que mon père Atoyac.
—Que se passe-t-il donc de nouveau?
—Le Loup-Rouge vient d'arriver avec ses guerriers, son cœur est rempli d'amertume, il veut parler au conseil. Addick l'accompagne.
L'Aigle-Volant et le chasseur échangèrent un regard.
—Le Loup-Rouge et Addick sont de retour? s'écria Atoyac avec étonnement; c'est étrange! Qui a pu les ramener si tôt et surtout ensemble.
—Je l'ignore; mais ils sont entrés dans la ville il y a une heure à peine.
—Était-ce donc le Loup-Rouge qui commandait les guerriers qui sont arrivés ce matin?
—Lui-même. Mon père ne l'aura pas regardé lorsqu'il est passé devant lui. Que répondrai-je aux chefs?
—Que je me rends au conseil.
L'Indien s'inclina et partit.
Le vieillard se leva avec une agitation mal contenue et se prépara à sortir.
L'Aigle-Volant l'arrêta.
—Mon père est ému, dit-il, un nuage est sur son esprit.
—Oui, répondit franchement le chef, je suis triste.
—Quelle cause peut troubler ainsi mon père?
—Frère, dit avec amertume le vieux chef, bien des lunes se sont écoulées depuis la dernière visite faite par vous à Quiepaa-Tani.
—L'homme n'est que le jouet des événements, jamais il ne peut faire ce qu'il projette.
—C'est vrai. Peut-être eût-il mieux valu pour vous et pour nous que vous ne fussiez pas aussi longtemps demeuré éloigné de nous.
—Souvent, bien souvent, j'ai eu le désir de venir; mais toujours la fatalité m'en a empêché.
—Oui, cela doit être ainsi; sans cela nous vous aurions vu; bien des choses qui se sont passées n'auraient pas eu lieu.
—Que voulez-vous dire?
—Ce serait trop long à vous expliquer, le temps me manque en ce moment pour le faire; il faut que je me rende au conseil où je suis attendu; qu'il vous suffise de savoir que depuis quelque temps un mauvais génie a soufflé un esprit de discorde parmi les sachems du grand conseil; deux hommes sont parvenus à faire prévaloir une influence funeste sur ses délibérations et à imposer leurs idées et leurs volontés à tous les chefs.
—Et ces hommes, qui sont-ils?
—Vous ne les connaissez que trop.
—Mais encore quels sont leurs noms?
—Le Loup-Rouge et Addick.
—Ooah! fit l'Aigle-Volant; prenez-y garde, l'ambition de ces hommes peut, si vous n'y faites pas attention, amener de grands malheurs sur vos têtes.
—Je le sais; mais puis-je m'y opposer? Seul suis-je assez fort pour combattre leur influence et faire rejeter les propositions qu'ils imposent au conseil?
—C'est vrai, répondit le Comanche avec un ton rêveur; mais comment empêcher?
—Il y aurait peut-être un moyen, fit Atoyac d'un ton insinuant après un léger silence.
—Lequel?
—Il est bien simple: vous êtes un des premiers et des plus renommés sachems de votre nation.
—Eh bien?
—Vous avez, en cette qualité, je le crois, le droit de siéger au conseil.
—En effet.
—Pourquoi n'y siégeriez-vous pas?
L'Aigle-Volant jeta un regard interrogateur au Canadien qui écoutait cette conversation le visage impassible, bien que son cœur battît à rompre sa poitrine; car il devinait, par une espèce de pressentiment, que dans ce conseil on discuterait des questions de la plus haute importance pour lui. A la muette interrogation du chef, il comprit que rester plus longtemps hors de la discussion serait affecter aux yeux de son hôte, pour les intérêts de la ville, une indifférence que celui-ci pourrait prendre en mauvaise part.
—Si j'étais un aussi grand chef que l'Aigle-Volant, dit-il, je n'hésiterais pas à me présenter au conseil; ici ce ne sont pas les intérêts de telle ou telle nation qui se discutent, ce sont souvent des questions vitales qui sont soulevées dans l'intérêt de la race rouge en général: s'abstenir dans de telles circonstances, serait, à mon avis, donner aux ennemis de l'ordre et de la tranquillité de la ville une preuve de faiblesse, dont, sans doute, ils sauraient profiter pour faire réussir leurs projets anarchiques.
—Le croyez-vous? répondit l'Aigle-Volant en feignant d'hésiter.
—Mon frère Deux-Lapins a bien parlé, reprit avec feu Atoyac, c'est un homme sage. Mon frère doit suivre son conseil, et cela avec d'autant plus de raison que sa présence ici est connue de tout le monde, et que son absence du conseil produirait certainement un très mauvais effet.
—Puisqu'il en est ainsi, répondit le Comanche, je ne résiste plus à votre désir, je suis prêt à vous suivre.
—Oui, ajouta avec intention le chasseur, allez au conseil; peut-être votre présence imprévue suffira-t-elle pour renverser certains projets et empêcher de grands malheurs.
—Je me comporterai de façon à en imposer à nos ennemis, répondit évasivement le Comanche, qui, tout en feignant d'adresser ces paroles à son hôte, les adressait réellement au chasseur.
—Partons, répondit Atoyac.
L'Aigle-Volant s'inclina silencieusement.
Ils sortirent.
Le chasseur demeura seul dans le calli en présence des deux femmes.
Le Pigeon, pendant la conversation précédente, avait été occupée à causer à voix basse avec l'Églantine; presque aussitôt après le départ des guerriers, les deux femmes se levèrent et se préparèrent à sortir.
L'Églantine, sans prononcer une parole, mit un doigt sur ses lèvres en regardant le chasseur; celui-ci s'enveloppa dans sa robe de bison, et s'adressant à la femme d'Atoyac:
—Je ne veux pas gêner ma sœur, dit-il, pendant que les chefs sont en conseil; j'irai faire une promenade dehors, afin d'examiner avec plus de soin le temple magnifique que je n'ai fait qu'entrevoir en venant ici.
—Mon père a raison, répondit-elle, d'autant plus que l'Églantine et moi nous avons à sortir de notre côte, et que nous aurions été contraintes de laisser mon père seul dans le calli.
L'Églantine sourit doucement en faisant un léger signe de tête au chasseur.
Celui-ci, soupçonnant que la femme de l'Aigle-Volant avait découvert la retraite des jeunes filles dans sa conversation avec son amie, et que le désir qu'elle témoignait de l'éloigner n'avait d'autre but que celui d'obtenir de plus grands renseignements sur elles, ne fit pas d'objection, et sortit lentement du calli, en marchant avec toute la majesté et l'importance du sage personnage qu'il représentait.
Du reste, le Canadien n'était pas fâché d'être seul pendant quelque temps, afin de réfléchir aux moyens qu'il emploierait pour se rapprocher des jeunes filles, démarche qui ne lui semblait nullement facile à faire. D'un autre côté, il comptait profiter de la liberté qu'on lui laissait pour aller faire un tour dans la ville en cherchant à s'enquérir des renseignements topographiques dont il avait besoin.
Ignorant comment se terminerait son séjour dans la ville, et de quelle façon il en sortirait, il prit à tout hasard les indications les plus précises sur les plans des rues et des édifices, au double point de vue d'une attaque ou d'une évasion.
Le chasseur avait mis sur son visage un masque si épais d'indifférence et de placidité, ses questions étaient faites d'un air si insouciant, que nul de ceux auxquels il les adressa ne songea à le soupçonner un instant, et, comme cela arrive toujours, il parvint à obtenir, grâce à son adresse, des détails excessivement précieux sur les endroits faibles de la place, comment on pouvait en sortir et y rentrer sans être aperçu après la fermeture des portes, et beaucoup d'autres renseignements non moins précieux que le chasseur classa avec soin dans sa mémoire, et dont il se réserva in petto, le moment venu, de faire bon usage.
A Quiepaa-Tani, il y a bon nombre de gens inoccupés, dont la vie s'écoule à flâner d'un côté et d'un autre, en traînant à leur suite un ennui incurable; ces gens furent ceux avec lesquels le chasseur lia connaissance pendant sa longue promenade dans la ville, écoutant avec la plus grande patience leurs récits prolixes et décousus; puis, lorsqu'il était certain d'en avoir tiré tout ce qu'il pouvait, il les laissait là pour aller recommencer un peu plus loin le même manège avec d'autres.
Bon-Affût était demeuré dehors près de trois heures: lorsqu'il rentra au calli, Atoyac et l'Aigle-Volant n'étaient pas encore de retour; seulement les deux femmes, accroupies sur des nattes, causaient entre elles avec une certaine animation.
Eh l'apercevant, l'Églantine lui jeta un regard d'intelligence.
Le chasseur se laissa tomber sur une butaca, détacha le calumet passé à sa ceinture, l'alluma et se mit à fumer.
Cependant, après avoir échangé avec le soi-disant médecin une salutation muette, les deux femmes avaient repris leur conversation.
—Ainsi, dit l'Églantine, les prisonniers faits sur les visages pâles sont amenés ici.
—Oui, répondit le Pigeon.
—Cela m'étonne, continua la jeune femme; car il suffirait que l'un d'eux parvînt à s'échapper pour que le secret de la situation exacte de la ville fut révélé aux Gachupines, et alors on ne tarderait pas à les voir apparaître dans la plaine.
—C'est vrai; mais ma sœur ignore que l'on ne s'échappe pas de Quiepaa-Tani.
L'Églantine hocha la tête d'un air de doute.
—Och! fit-elle, les blancs sont bien rusés: il est certain, cependant, que les deux jeunes filles pâles que nous venons de voir ne s'échapperont pas, elles sont trop bien gardées pour cela; je ne sais pourquoi j'éprouve pour elles une si grande pitié.
—La même chose m'arrive. Pauvres enfants! Si jeunes, si douces, si jolies, séparées à jamais de tous ceux qui leur sont chers! Leur sort est affreux!
—Oh! Bien affreux! Mais qu'y faire? Elles appartiennent à Addick, ce chef ne consentira jamais à leur rendre la liberté.
—Nous irons les voir encore, n'est-ce pas ma sœur?
—Demain, si vous voulez.
—Merci, cela me rendra bien heureuse, je vous assure. Ces derniers mots surtout frappèrent le chasseur.
A la révélation subite qui lui avait été faite, Bon-Affût avait éprouvé une telle émotion qu'il lui avait fallu toute la force et toute la puissance qu'il avait sur lui-même pour que le Pigeon ne remarquât pas son trouble.
En ce moment Atoyac et l'Aigle-Volant parurent, leurs traits étaient animés, ils semblaient en proie à une colère qui, pour être concentrée, n'en était que plus terrible.
Atoyac vint droit au chasseur qui s'était levé pour le recevoir.
En remarquant l'animation peinte sur le visage de l'lndien, Bon-Affût pensa que peut-être il avait découvert quelque chose le concernant, ce ne fut qu'avec une certaine méfiance qu'il attendit la communication que son hôte paraissait vouloir lui faire.
—Mon père est bien un adepte de la grande médecine? lui demanda Atoyac en attachant sur lui un regard scrutateur.
—Ne l'ai-je pas dit à mon frère? répondit le chasseur, qui commençait à se croire sérieusement menacé et qui échangea un geste interrogateur avec l'Aigle-Volant.
Celui-ci souriait.
Le Canadien se rassura un peu; il était évident que, s'il eût couru un danger, le Comanche n'eût pas été aussi calme.
—Que mon frère vienne donc avec moi et qu'il prenne les instruments de son art, s'écria Atoyac.
Il n'eût pas été prudent de refuser d'obéir à cette injonction, bien qu'un peu brutalement faite; d'ailleurs, rien ne lui prouvait que son hôte eut de mauvais desseins contre lui. Le chasseur accepta donc.
—Que mon frère marche devant, je le suivrai, se contenta-t-il de répondre.
—Mon père parle-t-il la langue des barbares Gachupines?
—Ma nation habite les bords du lac salé sans rivages, les visages pâles sont nos voisins, je comprends et je parle un peu l'idiome dont ils se servent.
—Tant mieux.
—S'agit-il donc de guérir un visage pâle, demanda le Canadien, qui tenait à être fixé sur ce qu'on exigeait de lui.
—Non, répondit Atoyac; un des grands chefs apaches a amené ici, il y a déjà plusieurs lunes, deux femmes des visages pâles; ce sont elles qui sont malades; le malin esprit s'est emparé d'elles, en ce moment, la mort étend ses ailes sur la couche où elles reposent.
Bon-Affût tressaillit à cette nouvelle inattendue, le cœur faillit lui manquer, un frisson involontaire agita tous ses membres; il lui fallut un effort surhumain pour refouler au fond de son âme l'émotion profonde qu'il éprouvait et pour répondre d'une voix calme à Atoyac:
—Je suis aux ordres de mon frère, ainsi que mon devoir l'exige.
—Partons, alors, répondit l'Indien.
Bon-Affût prit sa boîte à médicaments, la plaça avec précaution sous son bras, sortit du calli à la suite du sachem, et tous deux se dirigèrent à grands pas vers le palais des vestales, accompagnés, ou pour mieux dire surveillés à distance par l'Aigle-Volant, qui marcha sur leurs traces sans les perdre un instant de vue.
[1] Tigre de la petite espèce dont le nom a été conservé en français avec une légère différence.
Nous sommes contraints, maintenant, de faire quelques pas en arrière, afin d'éclaircir certains faits qui sont forcément restés dans l'ombre et qu'il est urgent que nous fassions connaître au lecteur.
Nous avons rapporté comment don Estevan, Addick et le Loup-Rouge s'étaient facilement entendus, afin d'obtenir une vengeance commune.
Mais, comme cela arrive généralement dans tous les traités, chacun ayant stipulé d'abord dans son intérêt privé, il se trouva que don Estevan fut celui auquel cette association devait apporter le moins d'avantages positifs.
Peu de blancs peuvent lutter de finesse et de diplomatie avec les peaux-rouges.
Les Indiens, comme tous les peuples vaincus, courbés depuis des siècles sous un joug abrutissant, n'ont conservé qu'une arme, arme mortelle souvent, il est vrai, au moyen de laquelle ils combattent la plupart du temps avec succès leurs heureux adversaires.
Cette arme est la ruse; l'arme des lâches ou des faibles, défense de l'esclave contre le maître.
Les conditions posées par les deux chefs indiens à don Estevan étaient nettes et claires. Les chefs, au moyens des guerriers qu'ils mettraient sous les armes, aideraient le Mexicain à s'emparer et à se venger de ses ennemis, en leur infligeant tel châtiment qu'il lui conviendrait; en retour, don Estevan renoncerait à revoir sa nièce et l'autre jeune fille, toutes deux prisonnières à Quiepaa-Tani, et les livrerait en toute propriété aux deux chefs, pour eux en faire ce que bon leur semblerait, renonçant d'avance à intervenir, de quelque manière que ce fût, dans la façon dont ils se comporteraient avec leurs prisonnières.
Ces conditions bien et dûment acceptées, les chefs indiens se mirent en mesure de remplir le plus tôt possible les clauses du traité.
Le Loup-Rouge avait contre les deux chasseurs et don Leo une haine d'autant plus invétérée que, toujours, dans les diverses rencontres qu'il avait eues avec ces trois hommes, il avait été vaincu. Il saisit donc avec empressement l'occasion qui se présentait de prendre sa revanche, se croyant certain cette fois de rendre à ses ennemis abhorrés toutes les humiliations qu'ils lui avaient infligées et tout le mal qu'ils lui avaient fait.
En moins de trois ou quatre jours, Addick et le Loup-Rouge parvinrent à réunir une troupe de près de cent cinquante guerriers d'élite, ennemis acharnés des blancs, et pour lesquels l'expédition qui se préparait était, pour nous servir d'une expression vulgaire, une véritable partie de plaisir.
Lorsque don Estevan se vit à la tête d'une troupe aussi nombreuse et aussi résolue, son cœur se dilata de joie et il se crut assuré du succès.
Que pouvait donc tenter don Leo avec les quelques hommes dont il disposait?
La route était longue pour se rendre à Quiepaa-Tani, presque impraticable; il fallait traverser des montagnes abruptes, des forêts vierges, d'immenses déserts, et en supposant que les gambucinos réussissent à surmonter ces obstacles en apparence infranchissables, une fois arrivés devant la ville, que feraient-ils?
Auraient-ils la prétention de s'en emparer? Tenteraient-ils, avec une trentaine d'hommes au plus, de prendre d'assaut une ville de plus de vingt mille âmes, défendue par de fortes murailles, ceinte d'un large fossé et renfermant dans son sein trois mille hommes d'élite, les guerriers les plus renommés de toutes les nations indiennes, spécialement chargés de défendre la ville sainte et qui sans hésiter se feraient tuer jusqu'au dernier avant de se rendre?
Une telle supposition ne tombait pas sous le sens; elle était tellement folle que don Estevan ne s'y arrêta pas une minute.
Le premier soin des chefs indiens fut de chercher à savoir dans quelle direction se trouvaient leurs ennemis. Malheureusement pour les peaux-rouges, les dispositions prises par les chasseurs étaient si adroites, qu'ils furent contraints malgré eux de suivre leurs ennemis sur trois pistes différentes et de scinder leur détachement en trois corps, afin de surveiller les gambucinos de tous les côtés.
Dans cette circonstance se présenta la première difficulté entre les trois associés.
Addick et le Loup-Rouge, lorsqu'il s'agit de diviser leurs forces, voulurent naturellement prendre chacun le commandement d'un corps séparé, combinaison qui déplut tout d'abord à don Estevan et à laquelle il se refusa péremptoirement d'acquiescer, en leur faisant observer, avec une sorte de justice, que, dans l'affaire dont il s'agissait, tout dépendait des chefs; que les guerriers n'avaient autre chose à faire que de surveiller les mouvements de leurs ennemis, tandis qu'eux, chefs de l'expédition, ils devaient rester réunis, afin de bien combiner les modifications à apporter à leur plan de campagne et pouvoir agir avec vigueur s'il se présentait une occasion favorable.
La vérité était que don Estevan, forcé par les circonstances à s'allier avec les deux sachems, n'avait pas la moindre confiance dans ses honorables associés; il les méprisait autant qu'il en était méprisé lui-même, et croyait être certain que, s'il les laissait se séparer de lui sous n'importe quel prétexte, il ne les reverrait jamais, et qu'ils l'abandonneraient dans la Prairie, le laissant sans le moindre remords se tirer d'affaire tout seul comme il l'entendrait.
Les Indiens comprirent parfaitement la pensée de leur associé; mais, trop fins pour lui laisser voir qu'ils l'avaient devinés, ils feignirent d'admettre les raisons qu'il leur donnait et d'en reconnaître l'opportunité. Les chefs restèrent donc unis et ils poussèrent en avant, accompagnés seulement d'une vingtaine d'hommes, ayant divisé les autres en deux troupes pour surveiller les gambucinos.
Don Estevan avait hâte d'arriver à Quiepaa-Tani, afin d'enlever les deux jeunes filles de la ville et de les avoir entre les mains, afin, par leur présence, de stimuler l'ardeur de ses associés.
Ils se mirent en route.
Alors il se passa une chose singulière: ce fut que six détachements de guerriers se suivirent à la piste, pendant plus d'un mois, chacun marchant sur les traces de celui qui le précédait, sans se douter qu'il était à son tour suivi par une autre qui marchait sur les siennes.
Les choses allèrent ainsi sans amener de rencontre jusqu'à la nuit où Domingo disparut dans la forêt vierge.
Voici comment cela arriva.
Bon-Affût avait bien jugé le gambucino en le soupçonnant capable de trahison. Voilà pourquoi il avait exigé qu'il demeurât avec lui, afin de le surveiller avec plus de soin.
Malheureusement, depuis le départ du gué del Rubio, malgré l'incessante surveillance exercée par Bon-Affût, il n'avait jamais surpris chez le gambucino le moindre mouvement louche qui pût corroborer ses soupçons et les changer en certitude. Domingo faisait strictement en apparence et loyalement son devoir. Lorsqu'on arrivait au campement, que les petits arrangements pour la nuit étaient pris, le repas terminé le gambucino, un des premiers, s'enveloppait de son zarapé, s'étendait sur le sol et se livrait au sommeil en prétextant de sa lassitude.
Enfin le bandit sut si bien régler sa conduite et masquer ses batteries que, tout fin qu'il était, le chasseur s'y laissa prendre. Peu à peu sa vigilance se relâcha, sa méfiance s'endormit, et, bien que ne comptant pas beaucoup sur la fidélité du gambucino, il cessa de le suivre incessamment de l'œil, comme il faisait pendant les premiers jours; et puis ils avaient fait beaucoup de chemin depuis un mois; les chasseurs se trouvaient en ce moment dans des parages complètement inconnus: il n'était pas supposable que le gambucino, presque étranger à la vie du désert, se hasardât à fausser compagnie aux gens avec lesquels il se trouvait, et se risquât à errer seul dans le désert, où, selon toutes probabilités, il se verrait, après quelques jours d'une existence précaire, réduit à mourir de faim.
Ceci prouvait seulement une chose, c'est que Bon-Affût, malgré toute sa finesse, ne connaissait pas l'homme auquel il avait affaire, et ne se doutait pas de cette ténacité dans les idées qui forme le fond du caractère des métis mexicains.
Domingo haïssait le chasseur parce que celui-ci l'avait démasqué, et avec cette patience qui caractérise la race à laquelle il appartenait, il attendait l'occasion de se venger, certain que, par la force des choses, cette occasion viendrait pour lui un jour ou l'autre.
En attendant, il regardait et écoutait. On ne se cachait pas pour parler devant lui, par la raison qu'il aurait fallu que Bon-Affût avertît ses compagnons des soupçons qu'il avait contre le gambucino, chose que la loyauté du chasseur lui empêchait de faire; aussi Domingo avait-il mis à profit cette facilité pour apprendre bien des détails sur l'expédition dont malgré lui il faisait partie, détails dont il se réservait de faire son profit en les vendant le plus cher possible à celui qu'ils intéressaient le plus, aussitôt que le hasard les mettrait en présence.
Le soir où Bon-Affût avait découvert cette piste qui l'avait si fort intrigué, le gambucino, en furetant aussi de son côte, avait, au milieu d'un buisson, fait une trouvaille dont il se garda bien de faire part à ses compagnons.
Cette trouvaille n'était autre qu'un sac à tabac de petite dimension, richement brodé en or, ainsi qu'en portent généralement les riches mexicains.
Domingo se rappelait fort bien l'avoir vu entre les mains de don Estevan.
Ce sac avait donc été perdu par lui. Provisoirement il le cacha dans sa poitrine, se réservant de l'examiner plus à loisir, lorsqu'il ne craindrait pas d'être surpris par ses compagnons.
L'Aigle-Volant se lança sur la piste, ainsi que nous l'avons dit plus haut, et ses amis, après avoir allumé le feu, préparé le repas et mangé quelques bouchées, attendirent son retour.
La journée avait été fatigante. L'Indien tardait à revenir; Bon-Affût et don Mariano, après avoir causé assez longuement entre eux, sentirent leur paupières s'appesantir, leurs yeux se fermer; bref, ils succombèrent à la fatigue, se laissèrent aller sur le sol, et furent bientôt plongés dans un profond sommeil; quant à Domingo, depuis plus d'une heure il dormait comme s'il n'avait jamais dû se réveiller.
Cependant il arriva une chose singulière, c'est qu'à peine don Mariano et Bon-Affût eurent fermés leurs yeux, le gambucino ouvrit les siens, et cela si franchement, que tout portait à supposer que son sommeil était feint, qu'au contraire jamais il n'avait été si éveillé.
Il jeta autour de lui un regard soupçonneux et demeura immobile; mais, au bout de quelques minutes, rassuré par le bruit calme et régulier de la respiration de ses compagnons, il se redressa tout doucement sur son séant. Il hésita encore plusieurs minutes, puis il sortit le sac à tabac de l'endroit où il l'avait caché et l'examina avec l'attention la plus soutenue.
Ce sac n'avait en soi rien qui le distinguât des autres; seulement une circonstance frappa le chasseur: il était plein à peu près jusqu'à la moitié de tabac; ce tabac était frais.
Donc il n'y avait pas longtemps que ce sac avait été perdu par don Estevan: quelques heures à peine; si cela était, comme tout le faisait supposer, don Estevan ne devait pas être éloigné, il devait se trouver à une lieue, deux au plus, du campement des chasseurs.
Ce raisonnement était logique: aussi le gambucino en tira-t-il cette conséquence que l'occasion qu'il attendait depuis si longtemps était enfin arrivée et que, coûte que coûte, il fallait la saisir.
Une fois cette conséquence admise, le reste est facile à comprendre.
Le gambucino se leva, se glissa comme un reptile dans les broussailles et se lança en enfant perdu à la recherche de don Estevan.
Le hasard est le maître du monde, il règle toutes choses à son gré, ses combinaisons parfois sont tellement bizarres qu'il semble prendre un malin plaisir à faire, contre toutes probabilités, réussir les plans les plus odieux; ce fut ce qui arriva dans cette circonstance.
A peine le gambucino avait-il erré pendant une heure dans la forêt, s'orientant tant bien que mal dans l'obscurité qui l'enveloppait comme d'un linceul, qu'il arriva, au moment où il s'y attendait le moins, en vue d'un feu allumé sur l'extrême lisière du couvert.
Il marcha immédiatement vers la lueur brillante qu'il avait aperçue, instinctivement persuadé qu'auprès du brasier qui lui servait de phare, il allait retrouver l'homme à la recherche duquel il s'était mis.
Ses pressentiments ne l'avaient pas trompé: le campement vers lequel il se dirigeait était effectivement celui de don Estevan et de ses associés, qui, nous devons en convenir, ne se croyaient pas si près de leurs ennemis; car, sans cela, ils eussent incontestablement pris toutes les précautions usitées au désert pour dissimuler leur présence.
L'apparition subite du gambucino dans le cercle éclairé par le brasier produisit un véritable coup de théâtre.
Les Indiens et don Estevan lui-même étaient tellement loin de se douter de l'arrivée de cet homme, qu'il y eut un moment de tumulte effroyable pendant lequel le gambucino fut saisi, renversé et garrotté avant même d'avoir pu articuler un mot pour se défendre.
Des guerriers saisirent leurs armes et se dispersèrent aux environs, afin de s'assurer que l'individu tombé si à l'improviste au milieu d'eux était seul et qu'on n'avait rien à redouter.
Enfin cette chaude alerte se calma peu à peu, les esprits se rassurèrent et l'on songea à interroger le prisonnier. C'était ce que celui-ci désirait et ce qu'il demandait avec instance depuis qu'on s'était si brutalement jeté sur lui.
Il fut amené en présence des trois chefs et immédiatement reconnu par don Estevan.
—Eh! fit celui-ci en ricanant, c'est mon digne ami Domingo. Qui diable vous amène ici, mon brave camarade?
—Vous allez le savoir, car je ne viens que pour vous rendre service, répondit le bandit avec son effronterie accoutumée. Seulement je vous serais obligé de me faire détacher, si c'est possible; ces cordes m'entrent dans les chairs et elles me font tellement souffrir qu'il me sera impossible d'articuler une parole tant que je n'en serai pas débarrassé.
Lorsqu'on eut consenti à la réclamation du bandit, celui-ci, sans se faire prier, raconta dans les plus grands détails ce qu'il avait appris.
Les révélations du gambucino donnèrent fort à penser à ses auditeurs, qui demandèrent ensuite comment il avait su qu'ils se trouvaient aux environs.
Domingo reprit son récit qu'il compléta en annonçant comment il avait trouvé la bourse à tabac, et comment, après que ses deux compagnons don Mariano et Bon-Affût s'étaient endormis, il les avait quittés pour se mettre à la recherche de don Estevan.
Dans le récit fait par le gambucino une chose surtout frappa vivement don Estevan, c'est que deux de ses plus grands ennemis étaient à quelques pas de lui et qu'ils étaient seuls.
Il se pencha aussitôt à l'oreille du Loup-Rouge et lui dit quelques mots auxquels celui-ci répondit par un sourire sinistre.
Dix minutes plus tard le feu était éteint; les Apaches, armés jusqu'aux dents, guidés par Domingo, se glissaient à pas de loup dans la forêt et se dirigeaient vers l'endroit où le chasseur et le gentilhomme reposaient tranquillement, ne soupçonnant pas le danger terrible qui les menaçait et la trahison dont ils étaient victimes.
Nous avons raconté comment échoua l'entreprise des Indiens et de quelle façon le misérable Domingo reçut le châtiment de son crime.
Malheureusement il avait eu le temps de parler, et ses paroles avaient été recueillies avec soin.
Lorsque les Apaches eurent reconnu qu'ils avaient affaire à plus forte partie qu'ils ne le supposaient et que ceux qu'ils voulaient surprendre étaient sur leur gardes, ils se retirèrent en toute hâte, afin de délibérer au parti qu'ils avaient à prendre pour prévenir leurs ennemis et déjouer leurs projets.
La délibération ne fut pas longue, contrairement aux coutumes indiennes. Malgré la nuit dont l'épais manteau couvrait encore la terre, ils montèrent à cheval et se dirigèrent, aussi rapidement que cela leur fut possible, vers Quiepaa-Tani, afin d'entrer dans la ville les premiers et d'avoir le temps de préparer leurs amis à les seconder dans la lutte qui se préparait.
Malgré toutes ses objections, don Estevan fut laissé en arrière, caché avec quelques guerriers sur la lisière de la forêt. Les chefs, malgré leur influence, n'osant pas enfreindre ouvertement les lois indiennes, en introduisant dans la ville un visage pâle autre qu'un prisonnier, don Estevan fut contraint de se résigner à les attendre.
Mais si les Indiens n'avaient pas perdu de temps, les chasseurs l'avaient, de leur côté, si bien mis à profit, que, ainsi que nous l'avons vu, Bon-Affût déguisé en médecin Yuma entrait en même temps qu'eux dans Quiepaa-Tani.
Pendant que le Loup-Rouge se hâtait de mettre tout en œuvre pour convoquer le grand conseil des chefs, Addick se séparait de lui et se dirigeait de toute la vitesse de son cheval vers l'habitation de son ami Chinchcoalt—huit serpents,—l'amantzin ou grand-prêtre.
Mais celui-ci en apprenant le retour du jeune chef s'était enfermé avec le Pigeon, qui, en compagnie de l'Églantine, était venue le visiter. L'amantzin l'avait prévenue de l'arrivée d'Addick—arrivée qu'elle connaissait déjà,—et il lui avait recommandé de garder le silence sur la part active qu'elle avait déployée dans la tentative d'abjuration conçue par lui contre les deux jeunes filles.
Le Pigeon, à qui l'Églantine avait fait la leçon, s'était engagée à rester muette; elle avait fait part au grand-prêtre de la présence à Quiepaa-Tani d'un grand médecin yuma nommé Deux-Lapins, dont la science pouvait être utile au rétablissement de la santé des prisonnières d'Addick. L'amantzin avait remercié l'Indienne en lui disant qu'il verrait probablement Atoyac au conseil et qu'il ne manquerait pas de le prier de lui amener Deux-Lapins.
Plus tranquille désormais, l'amantzin congédia les deux femmes et se rendit auprès d'Addick, bien préparé à le recevoir.
Aux premiers mots que lui dit le jeune chef relativement au vif désir qu'il avait de voir ses prisonnières le plus tôt possible, le vieillard répondit qu'afin d'être à même de les surveiller plus efficacement et de les soustraire à la curiosité gênante des oisifs de la ville qui tous les obsédaient de leurs continuelles visites, il avait été obligé de les transférer au palais des vierges du Soleil, en attendant qu'elles fussent rendues à leur légitime possesseur.
Addick se confondit en remerciements pour le soin que son ami avait mis à s'acquitter de la mission qu'il lui avait confiée, remerciements que le grand-prêtre reçut avec une hypocrite modestie, tout en le regardant avec un sourire narquois qui donna fort à penser au jeune chef.
Aussi, sans plus de tergiversations, se résolut-il à aborder franchement la question.
Les deux hommes demeurèrent un instant silencieux en face l'un de l'autre, se dévorant du regard, les sourcils froncés, les lèvres serrées comme deux duellistes sur le point d'engager le fer.
C'était en effet un duel qu'ils allaient avoir à soutenir, duel d'autant plus terrible que la seule arme dont ils pouvaient se servir était la ruse et la dissimulation.
Le pouvoir des prêtres indiens est immense: il est d'autant plus redoutable qu'il est sans contrôle et ne relève que du dieu qu'ils invoquent et qu'ils savent faire intervenir dans toutes les circonstances où ils ont besoin de son appui.
Nul peuple n'est aussi superstitieux que les peaux-rouges; pour eux la religion est toute physique, ils en ignorent complètement les dogmes et préfèrent croire, les yeux fermés, aux absurdités que leur débitent leurs devins, plutôt que de se donner la peine de réfléchir sur des mystères qu'ils ne comprendraient pas et dont, dans leur for intérieur, ils se soucient fort peu.
Nous avons dit que le grand-prêtre de Quiepaa-Tani était un homme d'une haute intelligence, résidant constamment dans la ville, possédant les secrets et, par conséquent, la confiance de la plupart des familles; il avait assis son pouvoir et sa popularité sur des bases solides et presque inébranlables. Addick le savait: maintes fois il avait eu besoin de recourir à la puissance occulte du devin, il comprenait donc parfaitement les conséquences fâcheuses qu'aurait pour lui une rupture avec un pareil homme.
Chinchcoalt se tenait les bras croisés sur la poitrine, le visage impassible, devant le jeune chef dont les yeux flamboyaient et les traits exprimaient la plus violente indignation.
Cependant, au bout de quelques minutes, par un effort de volonté inouïe, Addick éteignit le feu de ses regards, rasséréna l'expression de son visage et tendit la main au prêtre, en lui disant d'une voix douce et conciliante dans laquelle il n'y avait aucune trace de l'émotion intérieure qui l'agitait:
—Mon père m'aime; ce qu'il a fait est bien, et je l'en remercie.
L'amantzin s'inclina avec déférence en touchant légèrement du bout de ses doigts maigres la main qui lui était tendue.
—Le Wacondah m'a inspiré, répondit-il d'une voix hypocrite.
—Que le saint nom du Wacondah soit béni, fit le chef. Mon père ne me laissera-t-il pas voir mes prisonnières?
—Je le voudrais; malheureusement cela est impossible.
—Comment! s'écria le jeune homme avec une nuance d'impatience qu'il ne put complètement dissimuler.
—La loi est positive: l'entrée du palais des vierges du Soleil est interdite aux hommes.
—C'est vrai; mais ces jeunes filles ne font pas partie des vierges du Soleil; ce sont des femmes des visages pâles que j'ai amenées ici.
—Je le sais, ce que dit mon fils est juste.
—Eh bien, mon père le voit, rien ne s'oppose à ce que mes prisonnières me soient rendues.
—Mon fils se trompe; leur présence parmi les vierges du Soleil les a malgré elles placées sous le coup de la loi. Forcé par des circonstances impérieuses, je n'ai pas, dans le premier moment, réfléchi à cela lorsque je les ai fait entrer dans le palais. Je voulais, pour me conformer aux recommandations de mon fils, les sauver à tout prix. Maintenant je regrette ce que j'ai fait, mais il est trop tard.
Addick éprouva une tentation énorme de briser avec son casse-tête le crâne du misérable jongleur qui se moquait aussi effrontément de lui avec son accent hypocrite et son air doucereux; mais, heureusement pour le devin et probablement pour lui-même, car cette action, toute juste qu'elle était, ne serait pas demeurée impunie; il parvint à se contenir.
—Voyons, reprit-il au bout d'un instant, mon père est bon, il ne voudrait pas me réduire au désespoir: n'y aurait-il pas un moyen de lever cette difficulté en apparence insurmontable?
Le prêtre sembla hésiter. Addick le dévorait du regard en attendant sa réponse.
—Oui, reprit-il au bout d'un instant, il y a peut-être un moyen.
—Lequel? s'écria le jeune homme avec joie; que mon père parle.
—Ce serait, répondit le vieillard en pesant sur les mots et comme à contrecœur, ce serait d'obtenir du grand conseil une automation de les reprendre dans le palais.
—Ooah! Je n'y avais pas songé. En effet, le grand conseil peut autoriser cela; je remercie mon père. Oh! J'obtiendrai cette permission.
—Je le désire, répondit le prêtre d'un ton qui donna fort à penser au jeune homme.
—Est-ce que mon père suppose que le grand conseil voudrait me faire l'affront de me refuser une grâce aussi mince? lui demanda-t-il.
—Je ne suppose rien, mon fils. Le Wacondah tient dans sa main droite le cœur des chefs, lui seul peut les disposer en votre faveur.
—Mon père a raison. Je me rends immédiatement au conseil, il doit être réuni en ce moment.
—En effet, répondit l'amantzin, le premier hachesto—crieur—des puissants sachems est venu me convoquer quelques instants avant que je n'aie le plaisir de voir mon fils.
—Ainsi mon père se rend au conseil?
—J'y accompagnerai mon fils, s'il veut bien y consentir.
—Ce sera un honneur pour moi. Je puis, n'est-ce pas, compter sur l'appui de mon père?
—Quand cet appui a-t-il manqué à Addick?
—Jamais. Cependant, aujourd'hui surtout, je voudrais être certain que mon père me l'accordera.
—Mon fils sait que je l'aime, j'agirai comme je le dois, répondit évasivement le devin.
Addick, à son grand regret, fut contraint de se contenter de cette réponse ambiguë.
Les deux hommes sortirent alors et traversèrent la place pour entrer au palais des sachems où se réunissait le conseil.
Une foule d'Indiens attirés par la curiosité encombraient cette place ordinairement solitaire et saluaient de leurs acclamations le passage des sachems renommés.
Lorsque le grand-prêtre parut accompagné par le jeune chef, les Indiens se séparèrent devant eux avec un respect mêlé de crainte et les saluèrent silencieusement.
L'amantzin était encore plus redouté qu'il n'était aimé du peuple, comme cela arrive généralement à tous les hommes qui disposent d'un grand pouvoir.
Chinchcoalt ne parut pas s'apercevoir de l'émotion que causait sa présence et des chuchotements craintifs qui se faisaient entendre sur son passage. Les yeux baissés, la démarche modeste et même humble, il entra dans le palais à la suite du jeune chef dont la contenance assurée et le regard orgueilleux formaient un saisissant contraste avec la tenue que lui-même affectait.
Le lieu destiné à la réunion du grand conseil était une immense salle carrée d'une simplicité extrême, orientée nord et sud; au fond se trouvait attachée au mur blanchi à la chaux une espèce de tapisserie faite avec des plumes et du duvet d'oiseaux rares, sur laquelle était reproduite, au moyen de plumes aux couleurs éclatantes, l'image vénérée du Soleil planant au-dessus de la grande Tortue sacrée, emblème du monde.
Au-dessous de cette tapisserie, soutenue par quatre lances croisées et plantées dans le sol, était le calumet sacré qui ne doit jamais être souillé par le contact de la terre. Ce calumet, dont le fourneau d'une couleur rouge était fait d'une argile précieuse qui ne se trouve que dans une certaine région du haut Missouri, avait un tuyau long de dix pieds entièrement garni de plumes, de grelots et de sonnettes en or, et à son extrémité pendait un petit sac de médecine en peau d'élan, constellé d'hiéroglyphes.
Au centre de la salle, dans un trou ovale creusé à cet effet, était empilé, avec une certaine symétrie, le bois destiné au feu du conseil et qui ne devait être allumé que par le grand-prêtre.
Cette salle était éclairée par douze hautes fenêtres garnies de longs rideaux faits en poil de vigogne, et qui tamisaient une lumière sombre et douteuse, parfaitement en harmonie avec l'aspect imposant qu'offrait cette vaste salle.
Au moment où l'amantzin et Addick pénétrèrent dans le lieu de la réunion, tous les chefs composant le conseil étaient arrivés; ils se promenaient par groupes de long en large, causant à voix basse en les attendant.
Aussitôt que le grand-prêtre fut entré, chacun prit place autour du foyer, sur un signe du plus ancien sachem.
Ce sachem était un vieillard que deux guerriers tenaient par dessous les bras pour le soutenir. Chose étrange parmi les Indiens, une longue barbe blanche comme de l'argent tombait sur sa poitrine, ses traits étaient empreints d'une majesté extraordinaire; du reste, les autres chefs lui témoignaient un respect et une vénération profonde.
Ce chef se nommait Axayacatl, c'est-à-dire la face de l'eau[1]; il prétendait descendre des anciens Incas qui gouvernèrent la terre d'Anahuac[2] avant la conquête espagnole, et de même que son homonyme, huitième roi du Mexique, son hiéroglyphe était une figure devant laquelle il plaçait le signe de l'eau. Ce qui pouvait venir à l'appui de ses prétentions, c'est que sa peau n'avait pas cette teinte rougeâtre de cuivre neuf qui distingue la race indienne, mais se rapprochait au contraire du type européen.
Quoi qu'il en soit de l'origine de ce chef, ce qui était vraiment prouvé, c'est que, dans sa jeunesse, il avait été un des plus braves et des plus renommés guerriers des Comanches, cette nation orgueilleuse et indomptable qui s'intitule la reine des Prairies, qu'elle prétend avoir seule le droit de parcourir impunément.
Lorsque le grand âge d'Axayacatl et ses nombreuses blessures l'avaient empêché de faire plus longtemps la guerre, les Indiens, dont il était généralement vénéré, l'avaient à l'unanimité élu chef suprême de Quiepaa-Tani.
Depuis plus de vingt ans il exerçait cette fonction à la satisfaction de toutes les nations indiennes.
Après s'être assuré d'un coup d'œil que tous les chefs étaient accroupis autour du foyer, le sachem prit des mains du hachesto qui se tenait debout à ses côtés, un tison allumé qu'il plaça au milieu de la pile de bois préparée pour le feu du conseil, en disant d'une voix faible, mais cependant distincte:
—Wacondah, tes enfants se réunissent pour discuter de graves intérêts; que la flamme, qui est ton essence souffle à leur poitrine et fasse monter jusqu'à leurs lèvres des paroles sages et dignes de toi.
Le bois, probablement enduit de matières résineuses, avait pris feu presque immédiatement, et bientôt une flamme brillante monta en tournoyant vers le faîte de la salle.
Pendant que le sachem prononçait les paroles que nous avons rapportées, deux prêtres secondaires avaient enlevé le calumet sacré de l'endroit où il était placé, et, après l'avoir bourré d'un tabac réservé seulement pour les cérémonies extraordinaires, ils l'avaient apporté sur leurs épaules et présenté respectueusement à l'amantzin. Celui-ci prit avec une baguette de médecine, afin de conjurer les mauvais présages, un charbon incandescent dans le foyer et alluma le calumet en prononçant l'invocation suivante:
—Wacondah! Être sublime et inconnu, toi que le monde ne peut contenir et dont l'œil puissant aperçoit l'insecte le plus petit timidement caché sous l'herbe, nous t'invoquons, toi que nul homme ne peut comprendre. Permets que le Soleil, ton représentant visible, nous soit favorable et ne chasse pas au loin la fumée sainte du grand calumet que nous envoyons vers lui.
L'amantzin, conservant toujours le fourneau du calumet dans la paume de sa main, présenta le tuyau tour à tour à chaque chef, en commençant par le plus âgé, c'est-à-dire par Axayacatl. Les sachems aspirèrent chacun quelques bouffées de fumée avec le décorum et le recueillement exigés par l'étiquette, les regards baissés vers la terre et le bras droit appuyé sur le cœur. Lorsqu'enfin le tuyau du calumet arriva au grand-prêtre, celui-ci fit tenir le fourneau par un de ses acolytes et fuma jusqu'à ce que tout le tabac fût réduit en cendre. Alors le hachesto s'approcha, vida la cendre dans un petit sac de peau d'élan, qu'il ferma et jeta ensuite au milieu du feu en disant d'une voix haute et accentuée:
—Wacondah! Les descendants des fils d'Aztlan[3] implorent ta clémence; fais descendre tes rayons lumineux dans leurs cœurs, afin que leurs paroles soient celles d'hommes sages.
Puis les deux prêtres reprirent le calumet et allèrent le replacer au-dessous de l'image du Soleil.
Le vieux sachem reprit la parole:
—Le conseil est réuni, dit-il; deux chefs renommés arrivés ce matin seulement à Quiepaa-Tani, de retour d'un long voyage, ont, disent-ils, des communications importantes à faire aux sachems: qu'ils parlent nos oreilles sont ouvertes.
Nous n'entrerons pas ici dans les détails des discussions qui eurent lieu pendant ce conseil; nous ne rapporterons pas les discours prononcés par le Loup-Rouge et par Addick; cela nous entraînerait beaucoup trop loin et pourrait sembler fastidieux au lecteur. Qu'il suffise de dire que, bien que les passions des chefs fussent mises adroitement en jeu par les deux sachems qui avaient demandé la réunion, que parfois à de vives attaques il y eut de vives ripostes, nous nous bornerons à constater que tout se passa avec le décorum et la décence qui caractérisent les assemblées indiennes; que, bien que chacun défendit son opinion pied à pied, cependant personne ne sortit des limites du bon goût et du savoir-vivre, et nous résumerons les débats en constatant que le Loup-Rouge et Addick échouèrent complètement dans leurs projets, et que le bon sens, ou plutôt le mauvais vouloir de leurs collègues, les empêcha d'atteindre le but qu'ils se proposaient.
Le grand-prêtre, tout en feignant de prendre parti pour Addick, sut si bien embrouiller la question que le conseil déclara à l'unanimité que les deux jeunes filles blanches renfermées au palais des vierges du Soleil devaient être considérées, non pas comme pensionnaires du chef qui les avait amenées dans la ville, mais comme prisonnières de la confédération tout entière, et, comme telles, demeurer sous la garde de l'amantzin, auquel on intima l'ordre de les garder avec la plus grande vigilance et de ne laisser sous aucun prétexte pénétrer le jeune chef jusqu'à elles. Chinchcoatl, lorsqu'il avait insinué à Addick de s'adresser au conseil, savait pertinemment quel serait le résultat de cette démarche; mais, ne voulant pas se faire un ennemi du jeune homme en lui refusant sa demande, il avait adroitement décliné la responsabilité du refus en en rendant responsable le conseil tout entier et en mettant, grâce à cette manœuvre, Addick dans l'impossibilité de lui demander compte de sa conduite déloyale à son égard.
Le Loup-Rouge avait été plus heureux auprès du conseil: la raison en était simple, la communication qu'il faisait intéressait la ville. Le chef apache avait demandé qu'une troupe de cinq cents guerriers commandés par un chef renommé fût mise sous les armes pour veiller à la sûreté commune, compromise gravement par l'apparition aux environs de Quiepaa-Tani d'une quarantaine de visages pâles dont le but évidemment n'était autre que de surprendre la ville et de s'en emparer.
Les chefs accordèrent au Loup-Rouge ce qu'il demandait, et même beaucoup plus qu'il n'aurait osé l'espérer: au lieu de cinq cents guerriers, on arrêta que mille seraient choisis; que la moitié de ces guerriers, sous les ordres d'Atoyac, parcourrait la campagne dans tous les sens, afin de surveiller les approches de l'ennemi, tandis que l'autre moitié, sous le commandement immédiat du gouverneur, veillerait au dedans. Puis le conseil se sépara.
Le grand-prêtre s'approcha alors d'Atoyac et lui demanda si réellement il avait chez lui un tlacateotzin renommé. Celui-ci lui répondit qu'en effet, le jour même, un grand médecin yuma était arrivé à Quiepaa-Tani, et qu'il lui avait donné l'hospitalité dans son calli. L'Aigle-Volant se joignit alors à Atoyac pour assurer au grand-prêtre que ce médecin, qu'il connaissait depuis fort longtemps jouissait à juste titre d'une réputation fort étendue parmi les Indiens, et que lui-même lui avait vu faire des cures merveilleuses. L'amantzin n'avait aucune raison de se méfier de l'Aigle-Volant; il accorda donc la plus grande confiance à ses paroles et, séance tenante, il pria Atoyac de lui amener ce tlacateotzin dans le plus bref délai au palais des vierges du Soleil, afin de donner ses soins aux deux jeunes filles blanches placées sous sa tutelle par le conseil général de la nation, et dont la santé lui inspirait depuis quelque temps des craintes sérieuses.
Addick entendit ces paroles prononcées d'une voix assez haute, et, s'approchant rapidement du grand-prêtre:
—Que dit donc mon père? s'écria-t-il avec agitation.
—Je dis, répondit l'amantzin de sa voix doucereuse que les deux jeunes filles que mon fils a confiées à ma garde ont été éprouvées par le Wacondah, qui leur a envoyé le fléau de la maladie.
—Leur vie serait-elle en danger? reprit le jeune homme avec une angoisse mal contenue.
—Le Wacondah seul tient en son pouvoir l'existence de ses créatures; mais cependant je crois que le péril pourrait être conjuré: d'ailleurs, ainsi que mon fils l'a entendu, j'attends un illustre tlacateotzin de la nation yuma, venu des bords du grand lac salé sans rivages, qui, par le secours de sa science, peut rendre, je n'en doute pas, la force et la santé aux esclaves que mon fils a conquises sur les barbares espagnols.
Addick, à cette fâcheuse nouvelle, ne put réprimer un mouvement de dépit qui prouva au grand-prêtre qu'il n'était pas entièrement sa dupe et qu'il se doutait de ce qui s'était passé; mais, soit respect, soit crainte de se tromper dans sa supposition, ou plutôt parce que le lieu dans lequel Addick se trouvait ne lui parut pas propice à une explication comme celle qu'il voulait avoir avec l'amantzin, il se contraignit et se contenta de prier le vieillard de ne rien négliger pour sauver les captives, en ajoutant qu'il saurait se montrer reconnaissant envers lui pour les soins qu'il leur donnerait. Puis, renonçant subitement à la discussion, il s'inclina légèrement devant le grand-prêtre, lui tourna le dos et sortit de la salle en causant vivement à voix basse avec le Loup-Rouge qui l'attendait à quelques pas de là.
L'amantzin suivit un instant le jeune homme des yeux avec une expression indéfinissable; puis, reprenant sa conversation avec Atoyac et l'Aigle-Volant, il les pria de lui envoyer le médecin yuma le soir-même si cela était possible. Ceux-ci le lui promirent, puis ils le quittèrent pour retourner à leur calli, où sans doute le médecin les attendait.
Cependant, ce qui s'était passé au conseil avait donné beaucoup à réfléchir l'Aigle-Volant en lui faisant comprendre que les deux chefs apaches connaissaient la plus grande partie du secret de Bon-Affût, et que, si celui-ci voulait réussir, il fallait qu'il ne perdit pas un instant et se mit à l'œuvre à l'instant, sinon il courait grand risque d'échouer. Après dix minutes de marche, les chefs arrivèrent enfin au calli, où ils rencontrèrent Bon-Affût qui les attendait. Le chasseur, ainsi que nous l'avons dit, ne fit aucune difficulté de consentir à la requête que lui adressa Atoyac; mais, au contraire, après s'être chargé de sa boîte à médicaments, il le suivit avec empressement.
[1] Ce nom est composé de alt, eau, et de axaya, face.
[2] Anahuac signifie littéralement pays entre les eaux (les deux mers).
[3] Lieu d'où les Mexicains tiraient leur origine: ce nom vient de aztatl héron.
Bon-Affût suivait Atoyac au palais des vierges du Soleil. Malgré lui, l'intrépide chasseur sentait son cœur se serrer en songeant à la situation périlleuse dans laquelle il allait se mettre et aux conséquences terribles qu'aurait pour lui la découverte de sa personnalité par les Indiens. Cependant il se roidit contre cette émotion qui l'agitait sourdement et parvint à reprendre assez de puissance sur lui-même pour affecter une tranquillité et une indifférence qui étaient bien loin de son esprit.
Les deux hommes marchaient silencieusement côte à côte; le chasseur, craignant que ce mutisme prolongé n'inspirât à son guide des soupçons de quelque nature qu'ils fussent, résolut de l'obliger à causer, afin de donner à ses pensées un cours différent de celui qu'il redoutait de leur voir prendre.
—Mon frère a beaucoup voyagé? lui demanda-t-il pour entrer en matière.
—Quel est le guerrier appartenant à notre race dont la vie ne s'est pas écoulée dans de longues courses? répondit sentencieusement l'Indien. Les faces pâles, mon père le sait mieux que moi, nous pourchassent comme des bêtes fauves et nous obligent à nous retirer incessamment devant leurs empiètements successifs.
—C'est vrai, fit le chasseur en hochant mélancoliquement la tête. Dans quel désert assez ignoré nous est-il permis aujourd'hui de cacher les os de nos pères, avec la certitude que la charrue des blancs ne viendra pas les broyer en traçant son interminable sillon et les disperser dans toutes les directions?
—Hélas! reprit Atoyac, la race rouge est maudite: un jour viendra où on la cherchera vainement dans les plaines immenses où jadis elle était plus nombreuses que les brillantes étoiles qui tapissent le dôme du ciel; car elle est fatalement condamnée à disparaître de la surface du monde; les visages pâles ne sont que les instruments terribles de la colère implacable du Wacondah contre les enfants de la famille rouge.
—Mon frère ne parle que trop bien: jadis notre race était toute puissante, maintenant elle est tombée plus bas que les esclaves les plus vils, sans même qu'il lui reste l'espoir de se relever jamais.
—Que sont devenus les puissants empereurs de l'Anahuac qui commandaient à toute la terre? Des villes sans nombre qu'ils ont fondé, cinq seulement composent aujourd'hui le territoire de Tlapallan[1]; elles sont les derniers refuges des enfants de Quetzalcoatl[2], qui sont contraints de s'y cacher comme les daims timides, au lieu de fouler hardiment les contrées possédées dans les anciens jours par leurs ancêtres.
—Mais grâces soient rendues au Wacondah, dont la puissance est infinie; ces cinq villes sont complètement à l'abri des insultes des Gachupines.
Atoyac hocha tristement la tête.
—Mon père se trompe, dit-il: en quel lieu ignoré les faces pâles ne pénètrent-elles pas?
—C'est possible, elles atteignent tous les buts; mais jusqu'à présent aucune face pâle n'a pénétré jusqu'à Quiepaa-Tani; elles n'ont pu franchir les montagnes et traverser les déserts derrière lesquels la ville sacrée s'élève calme et paisible, se riant des vains efforts de ses ennemis pour la découvrir.
—Il y a deux soleils à peine, j'aurais parlé comme mon père, je me serais réjoui avec lui de cette ignorance des faces pâles; mais aujourd'hui cela ne m'est plus possible.
—Comment cela? Qu'est-il donc survenu dans un si court espace de temps, qui oblige mon frère à changer aussi brusquement d'opinion? demanda le chasseur subitement intéressé, et redoutant d'apprendre une mauvaise nouvelle.
—Les faces pâles sont aux environs de la ville; on les a vues. Elles sont nombreuses et bien armées.
—Cela n'est pas, mon père se trompe; ce sont des poltrons ou des vieilles femmes qui auront eu peur de leur ombre et auront fait courir ce bruit, répondit le Canadien, dont un frisson de terreur parcourut tous les membres.
—Ceux qui ont apporté cette nouvelle ne sont ni des poltrons qui ont peur de leur ombre ni des vieilles femmes bavardes, ce sont des chefs renommés; aujourd'hui, au grand conseil, ils ont annoncé la présence d'un fort parti de visages pâles, cachés dans la forêt dont les arbres ont étendu pendant si longtemps leurs ramures protectrices devant nous pour nous dérober aux regards perçants de nos ennemis.
—Ces hommes, si nombreux qu'ils soient, à moins de former une véritable armée, ne se hasarderont pas à attaquer une ville aussi forte que celle-ci, défendue par d'épaisses murailles et renfermant un nombre considérable de guerriers d'élite.
—Peut-être; qui peut le savoir? Dans tous les cas, si les visages pâles ne nous attaquent pas, c'est nous qui les attaquerons: il faut que pas un d'entre eux ne revoie les terres des visages pâles; notre sécurité et notre sûreté dans l'avenir l'exigent.
—Oui, cela doit être ainsi; mais êtes-vous bien sûrs que les chefs dont vous parlez et dont j'ignore les noms ne vous aient pas trompé et ne soient pas des traîtres?
Atoyac s'arrêta et lança un regard perçant au Canadien, qui le soutint d'un air calme, avec un visage impassible.
—Non, reprit-il au bout d'un instant, le Loup-Rouge et Addick ne sont pas des traîtres!
Le chasseur sembla réfléchir un instant, puis il s'écria d'un ton résolu qui en imposa à l'Indien:
—Non, en effet, ces deux chefs ne sont pas des traîtres, mais ils sont en passe de le devenir avant peu; les dangers qui nous menacent, ce sont eux qui les ont amassés sur nos têtes pour satisfaire leurs passions et leur soif de vengeance.
—Que mon frère s'explique, s'écria le chef au comble de l'étonnement. Ses paroles sont graves.
—J'ai eu tort de les prononcer, reprit le chasseur avec une feinte humilité. Je ne suis qu'un homme pacifique, auquel le Wacondah tout puissant a donné la mission de soulager, selon la science qu'il lui a accordée, les maux de l'humanité; je ne dois pas, faible arbrisseau, chercher à déraciner le chêne noueux dont le poids, en tombant, suffirait pour me renverser. Que mon frère me pardonne, je me suis imprudemment laissé emporter par mon indignation.
—Non, non, s'écria le chef en lui serrant le bras avec force, cela ne peut être ainsi; mon père a commencé, il faut qu'il termine et qu'il me dise tout.
Avec cette promptitude de conception qui le distinguait, le chasseur avait subitement conçu tout un plan fondé sur la méfiance qui forme le fond du caractère indien; il feignit de résister aux injonctions du chef et de ne pas vouloir entrer dans de plus grands détails sur ce qu'il avait laissé entrevoir; mais plus le soi-disant médecin s'obstinait à ne rien dire, plus le chef, de son côté, insistait pour le faire parler. Enfin le chasseur feignit de se laisser intimider par les prières mêlées de menaces que lui faisait son hôte, et, tout en protestant de la crainte qu'il avait de s'attirer la haine de deux chefs renommés, il consentit enfin à donner les renseignements qui lui étaient demandés avec tant d'insistance.
—Voici les faits, dit-il; je les raconterai à mon frère tels qu'ils sont venus à ma connaissance; seulement mon frère m'engage sa parole que, quelle que soit la résolution qu'il prendra après m'avoir entendu, il ne me mêlera en rien, moi, homme paisible et craintif, dans cette affaire; que mon nom même ne sera pas prononcé, et que les chefs dont je vais lui dévoiler la conduite ignoreront ma présence à Quiepaa-Tani.
—Que mon père parle en toute confiance; je lui jure par le nom sacré du Wacondah et par la grande Ayotl—tortue—que, quoi qu'il arrive, son nom ne sera pas mêlé à cette affaire: nul ne saura de quelle façon j'ai obtenu les renseignements qu'il me donnera. Atoyac est un des premiers sachems de Quiepaa-Tani; lorsqu'il lui plaît de dire une chose, ses paroles n'ont pas besoin d'être confirmées par d'autres témoignages que le sien.
Ainsi que cela arrive souvent, dans la circonstance présente, à part l'inquiétude causée par les habiles réticences du chasseur, le chef n'était pas fâché de l'importance qu'allaient sans doute lui donner les détails qu'il allait apprendre et le rôle qu'il serait indubitablement appelé à jouer dans les événements qui en seraient la suite.
—Och! reprit le chasseur avec un geste de satisfaction, puisqu'il en est ainsi, je parlerai.
Alors le Canadien fit à son complaisant et crédule auditeur une longue histoire extrêmement embrouillée, où la vérité était si adroitement mêlée au mensonge qu'il aurait été impossible à l'homme le plus fin de distinguer l'une de l'autre; mais dont il résultait que, si les blancs étaient parvenus aux environs de la ville, c'étaient Addick et le Loup-Rouge qui les avaient entraînes sur leurs traces, en ne cachant leur piste que tout juste ce qu'il le fallait pour que ceux qui les poursuivaient ne la perdissent pas. L'ensemble des faits racontés par le chasseur était si habilement groupé que les deux chefs enveloppés dans ce réseau de mensonges et de vérités, devaient incontestablement être convaincus de trahison s'ils étaient sérieusement interrogés, ainsi que le digne chasseur l'espérait, nous devons l'avouer, dans son for intérieur.
—Je ne me permettrai aucune réflexion, ajouta-t-il en terminant; mon frère est un chef sage et un guerrier expérimenté, il jugera beaucoup mieux que je ne saurais le faire, moi pauvre vermisseau, de la gravité des choses qu'il vient d'entendre; seulement je le supplie de se souvenir de ce qu'il m'a promis.
—Atoyac n'a qu'une parole, répondit le chef; que mon père se rassure; mais ce que j'ai entendu est extrêmement sérieux; ne perdons pas davantage de temps, il faut que je me rende auprès du premier chef de la ville.
—Peut-être est-ce dans une bonne intention que les deux sachems ont attiré si près de nous les visages pâles, insinua le chasseur; ils espèrent peut-être s'en emparer ainsi plus facilement.
—Non, répondit d'un air sombre Atoyac, leur intention ne peut être que perfide; il faut déjouer le plus tôt possible leurs machinations: sans cela de grands malheurs arriveront, surtout après la décision du conseil, qui donne au Loup-Rouge, sous les ordres du gouverneur, le commandement des guerriers destinés à agir à l'intérieur.
Heureusement pour le Canadien, le chef Atoyac était l'ennemi personnel du Loup-Rouge et d'Addick, ce qui l'empêcha de remarquer avec quelle adresse sournoise le chasseur l'avait amené à écouter son récit.
Les deux hommes reprirent à grands pas leur course interrompue, et au bout de quelques minutes ils atteignirent le palais des vestales. Après quelques pourparlers avec le guerrier chargé de la garde de la porte, le chef et le soi-disant médecin furent introduits dans l'intérieur. Le grand-prêtre vint avec empressement au devant des arrivants qu'il attendait avec impatience. L'amantzin envisagea le chasseur avec une attention soupçonneuse et lui fit subir un interrogatoire semblable à celui auquel, dans la matinée, l'avait déjà soumis Atoyac.
Ses réponses, préparées de longue main, convinrent au grand-prêtre; car, quelques minutes plus tard, il le conduisit, suivi par le chef, dans les appartements réservés du palais, afin de constater l'état de maladie des deux jeunes filles.
Le cœur du Canadien était en proie à la plus violente émotion, de grosses gouttes de sueur perlaient sur son visage. Du reste, la position critique dans laquelle il se trouvait était bien de nature à lui inspirer de sérieuses inquiétudes. Ce qu'il redoutait le plus était de ne point conserver son sang-froid et son impassibilité en présence des jeunes filles: il avait un trop grand intérêt à ne pas se trahir pour n'avoir pas la force de rester maître de lui, quoi qu'il arrivât; mais ce qu'il craignait par-dessus tout était l'effet que sa présence pourrait produire sur les jeunes filles si, malgré la perfection du déguisement qui le cachait, elles le reconnaissaient de prime-abord ou lorsqu'il se serait fait reconnaître; car il était indispensable, pour le succès de la ruse qu'il devait employer, que celles qu'il allait voir sussent à qui elles avaient affaire et entrassent franchement dans le rôle qu'il voulait leur faire jouer dans la comédie qu'il préparait. Ces réflexions et bien d'autres encore qui venaient en foule au chasseur imprimaient malgré lui à sa physionomie un cachet de sévérité qui était loin de lui nuire dans l'esprit de ceux qui l'accompagnaient.
Ils arrivèrent enfin à l'entrée des appartements secrets, dont la porte, sur un geste du grand-prêtre, s'ouvrit toute grande devant eux. Mais aussitôt qu'ils eurent pénétré dans une vaste salle qui, vu l'absence de tout meuble, pouvait fort bien être comparée à un vestibule, l'amantzin se tourna vers Atoyac et lui intima l'ordre de l'y attendre, tandis qu'il conduirait le médecin auprès des captives.
Nous l'avons dit plus haut, l'habitation des vierges du Soleil était interdite à tous les hommes, excepté au grand-prêtre. Dans certaines circonstances, une autre personne pouvait être exceptée de cette régie, le médecin, et c'était, on le sait, en cette qualité que Bon-Affût devait y être introduit.
Atoyac était trop bien au courant de la loi sévère du palais pour se permettre la moindre observation; seulement, lorsque le grand-prêtre se prépara à le quitter, il le retint respectueusement par sa robe, et se penchant à son oreille:
—Que mon père revienne promptement, lui dit-il à voix basse, j'ai d'importantes nouvelles à lui communiquer.
—D'importantes nouvelles! répéta l'amantzin en le regardant d'un air interrogateur.
—Oui, fit le chef.
—Et elles me concernent? continua lentement le grand-prêtre.
Atoyac sourit d'une façon confidentielle.
—Je le crois, dit-il, elles ont rapport au Loup-Rouge et à Addick.
L'amantzin eut un frémissement imperceptible.
—Je reviens, dans un instant, dit-il, avec un geste gracieux; puis, se tournant vers le chasseur immobile à quelques pas et en apparence indifférent à ce qui se passait entre les deux hommes: Venez, ajouta-t-il. Le chasseur s'inclina et suivit le grand-prêtre. Celui-ci lui fit traverser une longue cour entièrement pavée en briques scellées sur champ, et, franchissant dix degrés de marbre veiné de bleu et de vert, il le fit entrer dans un petit pavillon isolé, complètement séparé du corps de bâtiment dans lequel les vierges du Soleil étaient renfermées. Le grand-prêtre referma derrière lui la porte qui leur avait donné accès dans le pavillon; ils traversèrent une espèce d'antichambre, et l'amantzin, soulevant une draperie suspendue devant une porte assez étroite, introduisit le soi-disant médecin dans une salle splendidement meublée à l'indienne. Le grand-prêtre, afin de faire, s'il était possible, oublier aux jeunes filles qu'elles étaient captives, avait doré leur cage avec le plus grand soin en la garnissant de tous les objets de luxe et de confort qu'il supposait devoir les flatter.
Dans un élégant hamac en fils de palmier, entièrement garni de plumes, suspendu à deux anneaux d'or, à environ cinquante centimètres de terre seulement, était couchée une jeune femme dont le visage, d'une pâleur excessive, portait l'empreinte d'une profonde douleur et les traces évidentes d'une grande maladie.
Cette jeune femme était doña Laura de Real del Monte. Auprès d'elle, les bras croisés sur la poitrine et les yeux remplis de larmes se tenait doña Luisa, son amie, ou plutôt sa sœur par la souffrance et le dévouement; l'état d'accablement dans lequel était plongé doña Luisa prouvait que, malgré la force de son caractère, elle aussi avait enfin depuis quelque temps abandonné tout espoir de sortir de la prison dans laquelle elle était renfermée et que la maladie s'était emparée d'elle.
Cette pièce, ne recevant pas de jour du dehors, était éclairée par quatre torches d'ocote retenues par des cercle d'or scellés dans la muraille et dont la lueur vacillante projetait autour d'elle des reflets blafards.
En apercevant les deux hommes, doña Laura fit un geste d'effroi et cacha son visage dans ses mains. Le chasseur comprit qu'il fallait brusquer le dénoûment de la scène qui se préparait; il se tourna vers son guide:
—Le Wacondah est puissant, dit-il d'une voix imposante; l'Ayotl—la tortue—sacrée supporte le monde sur son écaille; son esprit est en moi, il m'inspire; je dois rester seul avec les malades, afin de lire sur leur visage la nature du mal qui les tourmente.
Le grand-prêtre hésita; il lança au soi-disant médecin un regard qui semblait vouloir lire ses plus secrètes pensées au fond de son cœur; mais, bien qu'habitué depuis longues années à abuser ses compatriotes avec ses jongleries mystiques, cependant il était Indien, et en cette qualité aussi accessible que ceux qu'il trompait aux craintes superstitieuses: il hésita.
—Je suis amantzin, dit-il avec un accent respectueux; le Wacondah ne peut voir qu'avec satisfaction ma présence ici en ce moment.
—Que mon père demeure si tel est son plaisir; je ne puis l'obliger à se retirer, répondit résolument le Canadien qui, coûte que coûte, voulait en finir; maintenant je l'avertis que je ne réponds nullement des conséquences terribles que causera sa désobéissance; l'esprit qui me possède est jaloux, il veut être obéi: que mon père réfléchisse.
Le grand-prêtre courba humblement la tête.
—Je me retire, dit-il; que mon frère me pardonne mon insistance.
Et il sortit de la salle.
Le Canadien l'accompagna silencieusement jusqu'à la porte du vestibule, la referma soigneusement derrière lui, puis il courut vers les jeunes filles.
Celles-ci se reculèrent avec épouvante.
—Ne craignez rien, leur dit-il d'une voix entrecoupée, je suis un ami.
—Un ami! s'écria doña Luisa qui s'était blottie toute tremblante dans un angle de la pièce.
—Oui, reprit-il rapidement, je suis Bon-Affût, le chasseur Canadien, l'ami, le compagnon de don Miguel.
Doña Laura se dressa dans son hamac, et un cri de surprise et de joie s'échappa de sa poitrine.
—Silence! fit le chasseur, on nous écoute peut-être.
Doña Luisa considérait avec des yeux égarés cette scène dont le sens lui échappait.
—Vous! Bon-Affût! dit enfin Laura avec un accent impossible à rendre. Oh! Nous pouvons donc être sauvées! Nous ne sommes pas abandonnées de tous!
Se laissant glisser sur le sol, elle s'agenouilla pieusement, et, joignant les mains elle murmura avec ferveur pendant que son visage était baigné de larmes:
—Oh! Mon Dieu! Merci! Merci! Pardonnez-moi d'avoir douté de votre ineffable bonté.
Puis, se relevant vivement, elle saisit les mains du chasseur, et les lui serrant avec force:
—Don Miguel, lui dit-elle, où est-il?
—Il est près d'ici, il vous attend. Mais, de grâce, écoutez-moi, les instants sont précieux.
—Oh caballero, emmenez-nous! Emmenez-nous vite! dit enfin doña Luisa complètement remise de l'émotion qu'elle avait éprouvée.
—Bientôt.
—Oui, oui, sauvez-nous! s'écria doña Laura, mon père vous récompensera.
Bon-Affût sourit.
—Votre père sera bien heureux de vous revoir, dit-il doucement.
Doña Laura leva sur lui ses beaux yeux rayonnants de joie.
—Mon père, où est-il? lui demanda-t-elle; puis elle se reprit: Non, je ne puis le revoir, il est loin! Bien loin d'ici!
—Il est avec don Miguel dans la forêt; tranquillisez-vous!
—Mon Dieu! Mon Dieu! s'écria la jeune fille, c'est trop de bonheur.
En ce moment, on entendit les pas pesants d'un homme qui montait les degrés de marbre.
—On vient, fit vivement le chasseur, prenez garde.
—Mais que faut-il faire? demanda doña Laura à voix basse.
—Attendre et avoir confiance.
—Quoi, vous allez partir?
—Nous quitter déjà? s'écrièrent-elles ensemble avec un mouvement d'effroi.
—Je reviendrai; laissez-moi agir; encore une fois, espoir et patience.
—Oh! Si vous nous abandonniez, si vous ne nous sauviez pas, s'écria Laura tout éplorée, nous n'aurions plus qu'à mourir!
—Oh! Ayez pitié de nous! murmura doña Luisa.
—Fiez-vous à moi, pauvres enfants, répondit le chasseur plus ému qu'il ne voulait le paraître de cette naïve et profonde douleur. Retenez bien ceci: quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, quel que soit le bruit que vous entendiez, reposez-vous sur moi, sur moi seul; car je veille sur vous, j'ai juré de vous sauver, et je réussirai.
—Merci! firent-elles.
Les pas entendus précédemment s'étaient arrêtés après s'être rapprochés encore. Bon-Affût, après avoir fait un dernier geste aux jeunes filles pour leur recommander la prudence, composa son visage, ouvrit brusquement la porte et, sans prononcer une parole, il passa devant le grand-prêtre qu'il n'eut pas l'air d'apercevoir, en donnant les marques d'une agitation extrême, et courut vers l'endroit où était resté Atoyac à l'attendre, en faisant des gestes incompréhensibles. L'amantzin était muet de surprise; au bout d'un instant il referma la porte que le chasseur avait laissé ouverte et suivit le médecin, mais comme s'il n'eût osé se rapprocher trop de lui.
Les jeunes filles ne savaient si elles n'étaient pas le jouet d'un rêve; dès qu'elles se retrouvèrent seules, elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre en éclatant en sanglots.
[1] Littéralement « pays rouge, » de tlapalli, rouge.
[2] Civilisateur du Mexique; ce nom vient de quetzalli, plume, et coalt, serpent; il signifie « serpent couvert de plumes. »
Le chef indien ne put retenir un geste d'effroi et fit quelques pas en arrière a l'apparition imprévue du chasseur. Celui-ci s'arrêta subitement au milieu de la salle, et, baissant la tête sur la poitrine, il sembla se plonger dans une méditation profonde.
Le grand-prêtre, en rejoignant Atoyac, lui dit en peu de mots de quelle façon le médecin était sorti de la chambre des malades, et les deux Indiens, remplis d'une crainte superstitieuse, se tinrent immobiles à quelques pas de lui, attendant respectueusement qu'il leur adressât la parole.
Cependant le chasseur parut peu à peu rentrer en possession de ses facultés, son agitation se calma, il passa la main sur son front et soupira comme un homme enfin soulagé d'une oppression terrible. Les Indiens jugèrent le moment favorable pour se rapprocher de lui et de lui adresser les questions qu'ils brûlaient de lui faire.
—Eh bien, mon père? lui dirent-ils.
—Parlez, ajouta le grand-prêtre, qu'avez-vous?
Le chasseur roula des yeux égarés autour de lui, poussa un nouveau soupir et murmura d'une voix basse et entrecoupée:
—L'esprit m'obsède, il fige la moelle de mes os!
Les Indiens échangèrent un coup d'œil épouvanté et reculèrent avec effroi.
—Wacondah! Wacondah! reprit le Canadien, pourquoi as-tu doué de cette science funeste ton malheureux serviteur?
Les deux peaux-rouges sentirent réellement leur sang se glacer dans leurs veines à ces paroles sinistres; un frisson de terreur parcourut leurs membres et leurs dents claquèrent les unes contre les autres à se briser. Bon-Affût marcha lentement vers eux; ils le regardèrent venir sans oser faire un mouvement pour l'éviter; le chasseur posa sa main droite sur l'épaule du grand-prêtre, fixa sur lui un regard perçant et dit d'une voix sombre:
—Que les fils de l'Ayotl sacrée s'arment de courage!
—Que veut dire mon père? murmura en tremblant le vieillard.
—Un esprit méchant, continua lentement le chasseur, s'est emparé de ces filles des visages pâles; cet esprit méchant frappera de mort, à compter de ce soir, tous ceux qui s'approcheront d'elles, car la science redoutable dont m'a doué le Wacondah m'a permis de m'assurer de la maligne influence qui pèse sur elles.
Les deux Indiens, crédules comme tous ceux de leur race, firent un pas en arrière. Alors le chasseur, afin de mieux corroborer ses paroles, feignit d'être repris d'une nouvelle crise et de se débattre contre l'obsession de l'esprit qui le tenait.
—Mais que faut-il faire pour les délivrer de ce pouvoir funeste? demanda timidement Atoyac.
—Toute force et toute sagesse viennent du Wacondah, répondit le Canadien, je désire demander à mon père l'amantzin, qu'il me permette de passer cette nuit en prière dans le temple du Soleil.
Les Indiens échangèrent entre eux un regard d'admiration.
—Qu'il soit fait selon la volonté de mon père, répondit le grand-prêtre en s'inclinant; ses désirs sont pour nous des ordres.
—Surtout, reprit le chasseur, que jusqu'à demain personne n'approche les filles des visages pâles; alors peut-être le Wacondah exaucera mes prières en m'indiquant les remèdes dont je dois me servir.
Le grand-prêtre s'inclina en signe d'assentiment.
—Il sera fait ainsi, dit-il; que mon père me suive, je le conduirai au temple.
—Non, répondit Bon-Affût, cela ne se peut pas, je dois entrer seul dans le sanctuaire; que mon père me dise la façon d'ouvrir la porte.
L'amantzin obéit et lui expliqua de quelle manière les barres et les verrous qui fermaient le temple étaient disposés et comment il fallait s'y prendre pour les enlever.
—Bon, fit le chasseur: demain a l'endit-ha—au lever du soleil,—je ferai connaître à mon père la volonté du Wacondah et s'il nous reste espoir de sauver les malades.
—J'attendrai, mon fils, dit le vieillard.
Les deux Indiens s'inclinèrent respectueusement devant le médecin et se retirèrent ensemble. Le chasseur fut étonné de les voir partir ainsi, il se demanda où ils pouvaient aller à pareille heure. Cependant la sortie des Indiens en ce moment n'était que la conséquence des confidences faites par Bon-Affût à Atoyac; le grand-prêtre et le chef se rendaient en toute hâte auprès du principal sachem de la ville, afin de lui faire part de ce qu'ils avaient appris sur les intentions supposées du Loup-Rouge et d'Addick.
Nous reviendrons ici sur ce que nous avons dit déjà au lecteur, pour bien lui faire comprendre le motif de la confiance avec laquelle les Indiens avaient accueilli les paroles du chasseur. Dans ces contrées, les devins sont comme les favoris de la divinité et jouissent d'un pouvoir surnaturel sans bornes; comme chez les peaux-rouges, la pratique de la médecine n'est, à proprement parler, qu'une affectation de pratiques religieuses mêlées de jongleries ridicules, les médecins sont naturellement considérés comme devins et respectés comme tels. Et qu'on ne pense pas que le vulgaire seul est imbu de cette croyance: les chefs, les guerriers, les prêtres eux-mêmes, ainsi que nous l'avons démontré plus haut, sans leur accorder peut-être une puissance aussi absolue, leur reconnaissent cependant une supériorité marquée sur eux.
Pendant les derniers événements que nous avons rapportés, la nuit était venue, mais une de ces nuits américaines, si calmes et si douces, pleines de parfums enivrants; une lueur faible et suave pleuvait des étoiles, dont l'innombrable armée plaquait le ciel d'un bleu profond de leur étincelante lumière; la lune se jouait dans l'éther et dardait sur la ville endormie ses rayons argentés qui donnaient aux objets un aspect fantastique; un silence religieux planait sur la cité. Le chasseur suivit des yeux les deux individus aussi longtemps qu'il put les apercevoir, puis il se mit en devoir de traverser la place afin de se rendre au temple.
La journée avait été rude pour le Canadien; il lui avait fallu faire à chaque instant preuve de présence d'esprit, lutter de ruse et de finesse avec des hommes dont les yeux clairvoyants sans cesse fixés sur lui avaient été maintes fois sur le point de découvrir le loup caché sous la peau de l'agneau; cependant il s'était vaillamment tiré des épreuves qu'il avait eues à soutenir, et de la façon dont les choses avaient tourné, il avait toutes raisons de croire qu'il réussirait à délivrer les jeunes filles; aussi le digne chasseur riait-il tout seul de la manière dont il avait joué son rôle et se promettait-il de continuer bravement jusqu'au bout. Arrivé au temple, il défit les barres et les verrous et entra dans l'intérieur, se contentant de repousser derrière lui les battants de la porte, se croyant certain que personne n'oserait venir le troubler, à cause de la sainteté du lieu d'abord, et ensuite de la crainte superstitieuse qu'il était parvenu à inspirer aux Indiens.
En demandant au grand-prêtre la permission de passer la nuit dans le sanctuaire, le chasseur n'avait d'autre but que celui de couvrir du manteau de la religion les moyens qu'il comptait employer pour l'évasion des jeunes filles, et en même temps d'avoir devant lui quelques heures de liberté, afin de pouvoir, sans être dérangé par la bienveillance importune et curieuse de la famille et des amis de son hôte, corroborer dans sa pensée les détails de l'exécution du plan qu'il avait formé pour enlever les deux prisonnières.
L'intérieur du temple était sombre: seule, une lampe brûlait devant la table des sacrifices et ne répandait qu'une lueur faible et tremblotante, incapable de dissiper les ténèbres. Bon-Affût se retira dans un angle obscur du temple, s'accroupit sur la terre, sortit ses pistolets de sa poitrine, les plaça auprès de lui en cas d'alerte, et, après avoir d'un regard perçant cherché à sonder les épaisses ténèbres qui l'enveloppaient, rassuré par le silence funèbre qui régnait dans cette enceinte, il se mit à réfléchir profondément. Cependant, peu à peu, soit lassitude, soit influence du lieu où il se trouvait, malgré les violents efforts du chasseur pour rester éveillé, il sentit ses paupières devenir pesantes, se fermer malgré lui, et enfin il finit par se laisser aller au sommeil invincible qui l'obsédait.
Depuis combien de temps dormait-il? Il n'aurait su le dire, lorsqu'un léger bruit qu'il entendit non loin de lui lui fit subitement ouvrir les yeux. De même que tous les hommes habitués à la vie active et périlleuse du désert, où il faut constamment se tenir sur ses gardes, le chasseur avait acquis une telle finesse de sens que, si grande que fut la lassitude qui l'accablait, chez lui le sentiment de sa sûreté veillait toujours et que son sommeil était, lorsqu'il se savait dans une situation périlleuse, aussi et peut-être plus léger que celui d'un enfant. Bon-Affût, à peine réveillé, regarda autour de lui, tout en se gardant bien de faire le moindre mouvement qui indiquât que son sommeil fût interrompu. Il ne put rien voir, la nuit durait toujours, et de plus la lampe était éteinte. Il comprit que quelqu'un s'était introduit dans le temple et qu'il était épié. Mais qui avait osé franchir le seuil sacré? Deux sortes de gens pouvaient seules se hasarder à le faire. Un ami ou un ennemi. Des amis, il n'en avait qu'un dans la ville, l'Aigle-Volant; il était évident que le guerrier, s'il avait voulu pénétrer jusqu'à lui, serait venu franchement, et non pas en se cachant, manière de procéder qui aurait pu lui attirer une balle dans la tête. C'était donc un ennemi. Mais lequel? Ceux qu'il aurait pu soupçonner, c'est-à-dire Addick ou le Loup-Rouge ne le connaissait pas, et puis ils ne l'auraient pas découvert sous son déguisement, puisqu'il avait trompé des yeux aussi clairvoyants que les leurs; du reste, dans tout le cours de la journée, il ne s'était pas une fois rencontré face à face avec les deux chefs; ce ne pouvait donc pas être eux. Mais qui était-ce alors? Voilà ce que, malgré toute sa finesse, le chasseur ne pouvait deviner. Dans le doute, et pour n'être pas pris au dépourvu, par un mouvement presque imperceptible, il allongea ses bras jusqu'à ce que ses mains atteignissent ses pistolets, les saisit, et, la tête droite, les yeux bien ouverts, l'oreille tendue à tous les bruits, il se prépara à faire bravement face à l'ennemi, quel qu'il fût, qui allait se présenter.
Cependant le bruit qui l'avait éveillé ne se renouvelait pas, tout demeurait calme et silencieux. En vain le chasseur cherchait à voir une ombre, si légère qu'elle fût, un bruit presque imperceptible; rien ne troublait la majesté du sanctuaire.
Cependant, Bon-Affût ne s'était pas trompé, il avait distinctement entendu un pas frôler timidement les dalles du temple. Il faut s'être, une fois dans sa vie, rencontré dans une position identique à celle dans laquelle se trouvait le chasseur pour bien en comprendre les angoisses et les terreurs. Sentir près de soi, à deux pas peut-être, un ennemi qui vous guette, dont l'œil féroce est implacablement fixé sur vous; savoir qu'il est là, le deviner par cette espèce d'intuition que Dieu a donnée à l'homme pour prévoir un danger, et n'oser bouger, craindre de faire le moindre mouvement qui l'avertisse que vous l'attendez; cette position, comparée à celle de l'oiseau fasciné par le reptile, est des plus cruelles et, en quelques minutes, devient un supplice tellement intolérable que la mort même lui est préférable.
Certes, Bon-Affût était un homme d'un courage à toute épreuve: l'entreprise qu'il tentait en ce moment démontrait chez lui une témérité, je ne dirai pas poussée jusqu'à la mort, ce qui ne serait rien, mais jusqu'au mépris de ces tortures atroces que les peaux-rouges sont si ingénieux à inventer et à varier pour faire palpiter les chairs de leurs victimes et extraire pour ainsi dire la vie goutte à goutte de leur corps en lambeaux. Eh bien, après un quart d'heure de l'attente terrible dans laquelle il se tenait, il se sentit frissonner malgré lui, ses cheveux se dressèrent sur son crâne, et une sueur froide perla ses tempes.
—Mille millions de démons! murmura-t-il intérieurement, vais-je donc me laisser égorger ainsi? Vive Dieu! Je veux savoir à quoi m'en tenir, quoi qu'il arrive.
Au même instant, comme poussé par un ressort, il se dressa sur ses pieds, un pistolet de chaque main.
Tout à coup une ombre se détacha d'un pilier, fit un bond de tigre, et le chasseur saisi à la gorge par une main inconnue roula sur le sol avant d'avoir pu jeter un cri; un pied s'appuya lourdement sur sa poitrine, et, comme à travers un nuage, il entrevit une face hideuse qui ricanait en le regardant. Bon-Affût était seul, abandonné, sans secours; c'en était fait de lui, rien ne pouvait le sauver; il poussa un soupir étouffé et ferma les yeux, résigné au sort qui l'attendait. Mais, au moment où il croyait recevoir le coup mortel, il sentit la main qui lui serrait la gorge se desserrer, et une voix railleuse lui dit:
—Relève-toi, puissant tlacateotzin; je voulais seulement te prouver que tu étais en ma puissance.
Le chasseur se releva tout contusionné et tout troublé encore de cette brusque attaque. L'autre continua:
—Que donnerais-tu pour échapper au péril qui te menace et pour être libre de regagner paisiblement le calli de ton hôte Atoyac?
Mais Bon-Affût avait eu le temps de se remettre de cette chaude alerte; il avait ressaisi ses pistolets, toute crainte avait fui de son cœur, il n'avait à se défendre que contre un ennemi; cet ennemi après l'avoir un instant tenu abattu sous ses pieds, commettait la faute de lui rendre la liberté de ses mouvements: la position entre eux était subitement devenue égale.
—Je ne vous donnerai rien, Loup-Rouge, répondit-il résolument; pourquoi ne m'avez-vous pas tué lorsque j'étais là, étendu à terre, sans défense?
Le chef indien, car c'était lui, recula avec étonnement en se voyant si facilement reconnu.
—Pourquoi je ne t'ai pas tué, chien? répondit-il, parce que j'ai eu pitié de toi.
—Parce que tu as eu peur, sachem! reprit fermement le chasseur; autre chose est tuer un ennemi dans un combat qu'assassiner un adepte de la grande médecine dans le temple du Wacondah, lorsqu'il est protégé par sa main toute puissante! Tu as eu peur, te dis-je.
Le chasseur avait deviné juste: c'était précisément cette crainte superstitieuse qui avait subitement arrêté le bras du chef, déjà levé pour frapper.
—Je ne discuterai pas avec toi, reprit-il; mais apprends-moi comment tu as aussi vite deviné mon nom, car je ne te connais pas.
—Mais je te connais, moi; le Wacondah m'avait annoncé ta présence; je t'attendais: si je n'ai pas prévenu ton attaque, c'est que je voulais savoir si tu pousserais l'impiété jusqu'à souiller le sanctuaire révéré du temple.
L'Indien ricana.
—Tu vas trop loin, sorcier, dit-il avec ironie; sans un mouvement de faiblesse que je me reproche, tu serais mort!
—Peut-être! Que me veux-tu?
—Ne le sais-tu pas toi, pour qui, dis-tu, rien n'est caché?
—Je sais quelle raison t'amène, tu chercherais vainement à me la dissimuler; si je t'adresse cette question, c'est que je veux savoir si tu oses mentir.
Le Loup-Rouge réfléchit un instant, puis il reprit d'un accent résolu:
—Écoute, sorcier, dit-il: ou tu es un fourbe, et je le crois, ou tu es réellement ce que tu prétends être, c'est-à-dire un grand médecin, aimé du Wacondah et inspiré par lui; dans l'un ou l'autre cas, je veux éclaircir mes doutes. Malheur à toi si tu cherches à me tromper, je te tuerai comme un chien, et de ta peau maudite, découpée en lanières sur ton corps palpitant, je ferai des harnais pour mon cheval; si, au contraire, tu dis vrai, tu n'auras pas d'ami plus dévoué que moi ni de serviteur plus sûr.
—Je méprise ta haine et je ne veux pas de ton amitié, Loup-Rouge, répondit le chasseur d'un ton imposant; tes menaces impuissantes ne m'effraient pas; mais, pour bien te faire comprendre l'étendue de ma science, je consens à faire ce que tu me demandes et à te dire quelle raison t'a poussé à venir me trouver ici.
—Fais cela, sorcier, et, quoi qu'il arrive, le Loup-Rouge sera à toi.
Le chasseur sourit avec dédain et haussa les épaules.
—Est-il donc difficile de deviner ce que veut un homme de sang? Toi et Addick, ton digne complice, vous vous êtes ligués avec un misérable chien, rebut des faces pâles, pour enlever d'ici deux pauvres jeunes filles confiées à la loyauté de ton complice; aujourd'hui, tu voudrais tromper ceux avec lesquels tu t'es allié, conserver pour toi seul les prisonnières; dénoncé au grand sachem par Atoyac, à qui toutes tes menées sont connues et qui sait en sus que tu médites de t'emparer du pouvoir et de te faire nommer gouverneur et chef suprême de Quiepaa-Tani, tu t'es senti perdu; alors tu es venu vers moi, dans l'intention de me corrompre et d'obtenir qu'au moyen du pouvoir dont je dispose, je t'aide à t'emparer des captives que tu convoites, afin que tu puisses fuir avec elles avant que l'on ait eu le temps de prendre des mesures pour se saisir de toi. Est-ce bien tout? Ai-je oublié quelque léger détail? Ou bien ai-je en effet deviné ta pensée tout entière? Réponds, chef, donne-moi un démenti si tu l'oses!
Le sachem avait écouté la longue tirade du chasseur avec un trouble croissant; les changements successifs de sa physionomie, tandis qu'il écoutait le sorcier, auraient été une étude curieuse pour celui qui aurait pu les observer; lorsqu'enfin Bon-Affût eut terminé, le Loup-Rouge baissa la tête avec confusion, et d'une voix presque indistincte, il balbutia:
—Mon père est réellement un tlacateotzin, le Wacondah l'inspire, sa science est immense! Quel est l'homme qui oserait prétendre lui cacher quelque chose? Son œil, plus perçant que celui de l'aigle, sonde les cœurs.
—Maintenant, tu as ma réponse, Loup-Rouge, reprit le chasseur; retire-toi en paix et ne trouble pas plus longtemps le recueillement dans lequel je suis plongé.
—Ainsi, demanda en hésitant le chef, mon père ne veut rien faire pour moi?
—Si, je fais beaucoup?
—Que fait donc mon père?
—Je te laisse te retirer en paix, lorsque d'un geste il me serait facile de te renverser mort à mes pieds.
L'Indien fit deux ou trois pas afin de se rapprocher du chasseur que de cette façon il toucha presque; celui-ci, dont l'oreille toujours au guet venait de percevoir un bruit de pas contenus et qui venaient de son côté, ne remarqua pas ce mouvement, car toute son attention était dirigée d'un autre côté.
Mais soudain ses sourcils, qui s'étaient froncés, se détendirent, et un sourire plissa ses lèvres: il avait découvert la cause de ce nouveau mystère.
—Eh bien, dit-il au chef, pourquoi le Loup-Rouge reste-t-il ici, lorsque je lui ai intimé l'ordre de se retirer?
—Parce que j'ai l'espoir de ramener mon père à avoir pour moi de meilleurs sentiments.
—Mes sentiments pour le chef sont ce qu'ils doivent être; je ne puis en changer.
—Si, mon père est bon, il viendra en aide au Loup-Rouge.
—Non, te dis-je.
—Mon père ne veut pas me servir?
—Je ne le veux pas.
—C'est le dernier mot de mon père?
—Mon dernier mot.
—Eh bien, meurs comme un chien que tu es! s'écria le peau-rouge avec rage en se précipitant, le couteau levé sur le chasseur.
Celui-ci, depuis quelques instants, suivait d'un œil attentif tous les mouvements du chef. Connaissant à fond le caractère fourbe et traître des Apaches, en voyant le Loup-Rouge prendre des manières félines et affecter un ton patelin, il prévoyait parfaitement ce que celui-ci méditait et quel était le dénoûment qu'il prétendait donner à cette scène; cependant, malgré cela, il ne fit pas un geste pour éviter le coup qui lui était destiné; il regarda son assassin bien en face, les bras croisés sur la poitrine, la tête haute et le visage impassible.
Cependant le bras levé contre le chasseur ne se baissa pas; un homme sortit tout à coup de l'ombre qui le cachait, apparut derrière le Loup-Rouge, lui saisit vivement le bras, le lui tordit avec une force peu commune, l'obligea à lâcher le couteau, et disparut si prestement que le chef atterré n'eut même pas le temps de reconnaître s'il avait eu affaire à un homme ou à un esprit.
Le Loup-Rouge ne jeta pas un cri, ne chercha pas à se venger; mais ses traits se décomposèrent, ses yeux roulèrent égarés dans leurs orbites; un mouvement convulsif agita tout à coup son corps, et il tomba agenouillé sur le sol, en murmurant avec épouvante:
—Pardon! Pardon! Mon père!
Le chasseur recula d'un pas, comme pour éviter le contact immonde du misérable prosterné devant lui, et poussant le couteau du pied avec dégoût:
—Ramasse ton arme, assassin! lui dit-il d'un ton de mépris suprême.
Pour toute réponse, le chef lui montra son bras disloqué qui pendait inerte le long de son corps.
—C'est toi qui l'as voulu, reprit le chasseur; ne t'avais-je pas averti que la protection du Wacondah était sur moi? Va, retire-toi dans ton calli, garde le silence sur ce qui s'est passé ici; au coucher du soleil, trouves-toi dans ta pirogue sur le bord de la rivière, en aval du pont; j'irai t'y rejoindre, peut-être te guérirai-je si tu as suivi strictement l'ordre que je te donne; surtout n'oublie pas que tu dois être seul; va.
—J'obéirai à mon père; ma bouche ne proférera pas une parole sans son ordre. Mais comment pourrais-je sans son secours sortir d'ici? Les esprits qui veillent sur mon père me frapperont de mort dès que je ne serai plus en sa présence.
—C'est vrai. Tu as été assez puni; relève-toi et appuie-toi sur mon épaule; je t'aiderai à marcher jusqu'à l'entrée du temple.
Le Loup-Rouge se releva sans répliquer; son esprit rebelle était dompté désormais, la rude leçon qu'il avait reçue lui inspirait enfin pour le médecin une terreur superstitieuse que rien ne pouvait vaincre.
Le chasseur le conduisit doucement jusqu'à la porte du temple. Arrivé là, il examina minutieusement le bras du blessé, s'assura qu'il n'était pas brisé, et le congédia en lui disant d'un ton où la bonté se mêlait à la sévérité:
—Remercie le Wacondah qui a eu pitié de toi; dans quelques jours ta blessure sera guérie; mais que cette leçon te profite, misérable; ce soir, tu me reverras; va; maintenant mon secours ne t'est plus nécessaire, tu peux seul regagner ton calli.
—J'essaierai, répondit humblement le chef.
Sur un nouveau geste du chasseur, il se mit lentement en marche.
Bon-Affût le suivit quelque temps des yeux, puis il rentra dans le temple, dont il ferma cette fois soigneusement la porte derrière lui.
Au moment où le chasseur disparaissait dans le temple, le cri du hibou s'élevait dans l'air, annonçant que le soleil n'allait pas tarder à paraître.
Pendant qu'avaient lieu à Quiepaa-Tani les événements que nous avons rapportés, au camp des gambucinos il s'en passait d'autres que nous allons raconter.
Don Leo, après s'être séparé de Bon-Affût sur la lisière de la forêt, avait regagné tout pensif l'endroit où ses compagnons l'attendaient.
Il était évident que le hardi aventurier, mécontent intérieurement de la tournure qu'avaient prise les choses, méditait quelque projet désespéré pour se rapprocher des jeunes filles.
Il avait passé plusieurs heures étendu au sommet du monticule isolé qui dominait toute la campagne et dont nous avons parlé précédemment, et de là il avait étudié avec soin la position de la ville.
Il était évident que ce jeune homme, au caractère ardent, aux passions fougueuses, ne consentait qu'à contrecœur à jouer le second rôle dans une expédition dans laquelle jusque-là il avait constamment tenu le premier; sa fierté se révoltait d'être obligé de s'astreindre à obéir à un autre, bien que cet homme fût son ami dévoué et qu'il pût compter sur lui comme sur soi-même.
Il se reprochait de laisser ainsi Bon-Affût s'exposer seul à des dangers terribles, pour une cause qui était la sienne. Mais la véritable raison, celle qu'il n'osait pas s'avouer à lui-même, celle enfin qui lui aurait fait braver avec joie les plus grands périls et même la mort pour sauver les jeunes filles, celle enfin qui le poussait sourdement à se révolter contre la prudence de Bon-Affût et à prendre à tous risques sa place dans l'exécution du plan concerté entre eux, cette raison était qu'il aimait doña Laura de Real del Monte.
Il l'aimait de cet amour puissant et invincible que les natures d'élite sont seules capables d'éprouver, amour qui grandit avec les obstacles et qui, lorsqu'il a pris possession du cœur d'un homme comme don Leo, lui fait accomplir les actes les plus téméraires et les plus extraordinaires.
Cet amour était d'autant plus fortement enraciné dans le cœur du jeune homme qu'il en ignorait complètement l'existence et ne croyait agir que sous le coup de l'affection qu'il portait aux jeunes filles et de la pitié que lui inspirait leur situation malheureuse. Si, dans le principe, il en avait été ainsi, ce qui est vrai, puisqu'il ne connaissait pas doña Laura, la position avait complètement changé depuis.
Un jeune homme ne voyage pas impunément côte à côte avec une jeune fille pendant plus d'un mois, la voyant sans cesse, causant avec elle à chaque instant du jour, sans s'éprendre d'elle.
Il y a dans les jeunes filles un certain charme dont on ne cherche pas à se rendre compte, qui semble émaner de tout leur être, s'imprégner dans tout ce qui les entoure, qui séduit et subjugue malgré eux les hommes les plus forts.
Le frou-frou soyeux de leur robe, la désinvolture molle et aérienne de leur tournure, les parfums enivrants de leur ondoyante chevelure, la pure limpidité de leur regard rêveur qui se dirige vers le ciel et, se fixant partout sans rien voir, cherche à deviner ce qu'elles ignorent, tout enfin dans ces êtres incompréhensibles et voluptueusement naïfs, semble commander l'adoration et appeler l'amour.
Doña Laura possédait surtout ce magnétisme fascinateur du regard, cette candide douceur un peu enfantine du sourire qui annihilent la volonté.
Lorsque son grand œil bleu, voilé de long cils noirs, s'abaissait complaisamment sur le jeune homme et se fixait sur lui d'un air pensif, il se sentait tressaillir dans tout son être, il avait froid au cœur; et en proie intérieurement à une sensation d'une volupté immense et inconnue, il souhaitait de mourir ainsi aux pieds de celle qui pour lui n'était plus une créature terrestre, mais presque un ange.
Pendant le cours accidenté de sa vie, l'aventurier n'avait connu de la femme que ce que la civilisation atrophiée du Mexique lui en avait laissé deviner, c'est-à-dire le côté hideux et repoussant. Le hasard, en le mettant tout à coup en contact avec une jeune fille pure et candide comme celle qu'il avait sauvée, avait apporté dans ses idées une révolution complète en lui faisant comprendre que jusqu'à ce jour la femme, telle que Dieu l'avait créée pour l'homme, lui était demeuré complètement inconnue.
Aussi, sans s'en apercevoir, tout naturellement, s'était-il laissé aller au charme qui agissait sur lui à son insu, et s'était-il mis à aimer doña Laura de toutes les forces agissantes de son âme, sans chercher à se rendre compte du nouveau sentiment qui s'était emparé de lui, heureux du présent, sans vouloir songer à l'avenir, qui n'existerait probablement jamais pour lui.
L'insouciance dans l'avenir est généralement le fond du caractère de tous les amoureux; ils ne voient et ne peuvent voir au delà du présent par lequel ils sentent, par lequel ils souffrent ou sont heureux, par lequel enfin ils vivent.
Peut-être don Leo, caché au fond des déserts avec la jeune fille qu'il avait si miraculeusement sauvée, avait-il pendant quelques jours caressé intérieurement l'espoir d'un bonheur éternel avec celle qu'il aimait, loin des villes et de leurs enivrements redoutables; mais cette pensée, s'il l'avait eue, s'était évanouie tout à coup, sans retour, à la rencontre fortuite de don Mariano: l'apparition du père de doña Laura devait anéantir pour toujours les projets formés par le jeune homme.
Le coup fut rude: cependant, grâce à sa volonté de fer, il le supporta bravement, croyant qu'il lui serait facile, dans le tourbillon de la vie accidentée à laquelle il était condamné, d'oublier la jeune fille.
Malheureusement pour don Leo, il lui avait fallu subir la loi commune, c'est-à-dire que son amour s'était accru en raison inverse des obstacles invincibles qui soudain avaient surgi; ce fut justement lorsqu'il reconnut qu'elle ne pourrait jamais être à lui à cause des raisons de famille et de fortune qui élevaient entre eux une barrière infranchissable, qu'il comprit qu'il lui était impossible de vivre sans elle.
Alors, sans chercher plus longtemps à guérir la plaie incurable qu'il avait au cœur, il se laissa au contraire complètement aller à cet amour qui était sa vie, et ne rêva plus qu'une chose, mourir en sauvant celle qu'il aimait, afin d'attirer sur ses lèvres à sa dernière heure une parole de reconnaissance, et peut-être de lui laisser un doux et triste souvenir au fond de l'âme.
On comprend que, dans de telles dispositions, don Leo voulait absolument, quoi qu'il pût arriver, délivrer lui-même la jeune fille; aussi, depuis l'instant où il s'était séparé de son ami, rêvait-il au moyen de s'introduire dans la ville et de la voir.
Ce fut dans ces dispositions qu'il rejoignit le camp.
Don Mariano était triste; Balle-Franche lui-même semblait de mauvaise humeur; enfin tout conspirait à le plonger de plus en plus dans son humeur noire.
Plusieurs heures s'écoulèrent sans que les aventuriers échangeassent une parole entre eux.
Vers deux heures de l'après-dînée, au moment de la plus forte chaleur, les sentinelles signalèrent l'approche d'une troupe de cavaliers.
Chacun courut aux armes.
Bientôt on reconnut que les nouveaux arrivés étaient Ruperto et sa cuadrilla que les domestiques de don Mariano avaient ralliés et ramenés avec eux.
Juanito avait voulu, suivant les instructions qu'il avait reçues de Bon-Affût, obliger Ruperto à se renfermer avec ses cavaliers dans la caverne de la rivière; mais le chasseur n'avait voulu rien entendre, disant que ses compagnons se trouvaient engagés plus avant que jamais blancs ne s'étaient hasardés sur le territoire sacré des peaux-rouges, qu'ils risquaient à chaque instant d'être accablés par le nombre, massacrés ou faits prisonniers; que dans une position aussi critique, il ne les abandonnerait pas sans chercher à leur venir en aide; et, malgré toutes les observations du criado, le digne chasseur, qui était doué d'une assez forte dose d'entêtement, avait poussé en avant, jusqu'à ce qu'enfin il eût rejoint le campement de ses compagnons.
Deux ou trois fois pendant son voyage il avait eu maille à partir avec les Indiens; mais ces légères escarmouches, loin de modérer son ardeur, n'avaient eu d'autre résultat que celui de l'exciter à presser sa marche, car maintenant que l'éveil était donné aux peaux-rouges, qu'ils savaient que des détachements de visages pâles erraient aux environs de leurs campements, selon toutes probabilités ils ne manqueraient pas de se réunir en grand nombre, afin de frapper un grand coup et de se débarrasser de tous leurs audacieux ennemis à la fois.
Les aventuriers accueillirent leurs compagnons avec joie: Ruperto principalement fut fort bien reçu par don Leo, qui était heureux de ce renfort d'hommes déterminés qui lui arrivaient au moment où il y songeait le moins.
L'apathie qui s'était emparée des gambucinos fit place à la plus vive activité; lorsque les divers soins dont les nouveaux venus avaient à s'occuper furent accomplis, les groupes se formèrent, et les conversations commencèrent avec cette vivacité et cette loquacité particulières aux races méridionales.
Ruperto se félicita plus que jamais d'avoir eu l'heureuse pensée de pousser en avant, lorsqu'il apprit que non seulement il y avait des campements de peaux-rouges aux environs, mais que, à peu de distance dans le voisinage, se trouvait une des cinq villes sacrées des Indiens.
—¡Canarios! dit-il, nous ferons bien de veiller sur nous, si nous ne voulons pas avant peu perdre nos chevelures; ces démons incarnés ne nous laisseront pas longtemps fouler en paix leur territoire.
—Oui, répondit nonchalamment don Leo, je crois que nous aurons raison de pas nous laisser surprendre.
—Hum! observa Balle-Franche, ce serait une surprise désagréable que celle qui amènerait une nuée de peaux-rouges sur notre dos; on ne se figure pas comme ces diables se battent bien lorsqu'ils sont en nombre. Je me rappelle qu'en 1836, à l'époque où j'étais...
—Et celui qui est le plus aventuré de nous est Bon-Affût, dit don Leo en coupant net la parole à Balle-Franche qui demeura la bouche béante. Je me reproche de l'avoir ainsi laissé partir seul.
—Il n'était pas seul, répondit le Canadien; vous savez bien, don Miguel, que l'Aigle-Volant et sa cihualt, ainsi qu'ils nomment les femmes, l'accompagnaient.
Don Leo regarda le chasseur.
—Est-ce que vous vous fiez beaucoup aux peaux-rouges, vous, Balle-Franche? lui demanda-t-il.
—Hum! reprit celui-ci en se grattant le front, c'est selon, et, s'il me faut avouer la vérité, ma foi! Je vous dirai que je ne m'y fie pas du tout.
—Vous voyez bien qu'il était seul alors. Qui sait ce qui lui sera arrivé dans cette ville maudite, au milieu de ces démons acharnés? Je vous avoue que mon inquiétude est grande, et que j'ai horriblement peur d'une catastrophe.
—Son déguisement était cependant parfait.
—C'est possible; Bon-Affût connaît à fond les mœurs des Indiens, il parle leur langue comme sa langue maternelle; mais qu'importe cela, s'il a été livré par un traître?
—Hein? fit Balle-Franche, un traître! De qui parlez-vous donc ainsi?
—Eh! De l'Aigle-Volant! ¡Caramba! Ou de sa femme, puisque eux deux seuls le connaissent.
—Écoutez! Don Miguel, répondit sérieusement Balle-Franche, permettez-moi de vous dire carrément ma façon de penser: vous avez tort de parler ainsi que vous le faites en ce moment.
—Moi! s'écria brusquement le jeune homme. Eh! Pourquoi donc, s'il vous plaît?
—Parce que vous ne connaissez que très peu, et seulement sous de bons rapports, les gens que vous voulez flétrir d'une épithète déshonorante. Moi, je connais l'Aigle-Volant depuis longues années; il était tout enfant lorsque je le vis pour la première fois; je l'ai toujours trouvé d'une franchise et d'une loyauté à toute épreuve. Tout le temps qu'il a demeuré dans notre compagnie, il nous a rendu des services ou du moins a cherché à nous en rendre, et enfin, pour trancher la question, nous tous en général, et vous surtout en particulier, nous lui avons de grandes obligations. Ce serait plus que de l'ingratitude de l'oublier.
Le digne chasseur avait prononcé cette apologie de son ami avec une ardeur et un ton ferme qui imposèrent à don Leo.
—Pardonnez-moi, mon vieil ami, lui dit-il d'une voix conciliante; j'ai eu tort, je le reconnais; mais, entourés d'ennemis comme nous le sommes, menacés à chaque instant d'être victimes d'un traître. L'exemple de Domingo est là pour corroborer mes paroles, j'ai pu me laisser entraîner à supposer...
—Toute supposition attaquant l'honneur de l'Aigle-Volant, interrompit vivement Balle-Franche, est nécessairement fausse. Qui sait si, en ce moment même où nous discutons sa loyauté, il ne risque pas sa vie pour notre service?
Ces paroles produisirent une certaine sensation sur ses auditeurs: il y eut un instant de silence que le Canadien rompit presque aussitôt en reprenant la parole:
—Mais je ne vous en veux pas, dit-il; vous êtes jeune, et, par cela même, souvent votre langue va plus vite que votre pensée; mais, je vous en prie, faites-y attention, cela pourrait, une fois ou l'autre, avoir pour vous de graves conséquences. Mais assez là-dessus. Je me souviens, à ce propos, d'une aventure assez singulière qui m'arriva en 1851. C'était à l'époque où je venais de...
—Maintenant en y réfléchissant plus sérieusement, interrompit don Leo, je vous donne pleine satisfaction; j'avais réellement tort.
—Je suis heureux que vous le reconnaissiez si loyalement.
—Ainsi n'en parlons plus, voulez-vous?
—Je ne demande pas mieux; pour en revenir à notre première conversation, je vous avoue que, moi aussi, je suis inquiet de Bon-Affût.
—Là! Vous le voyez bien.
—Oui, mais pour d'autres raisons que celles que vous avanciez.
—Dites-moi ces raisons.
—Oh! Mon Dieu! Elles sont toutes simples: Bon-Affût est un digne et brave chasseur, passé maître en fait de fourberies indiennes; mais il n'a personne pour lui donner la réplique; en cas de danger l'Aigle-Volant lui serait d'un mince secours; s'il était découvert, le brave chef ne pourrait que se faire tuer auprès de lui, et il n'y manquerait pas, j'en suis convaincu.
—Et moi aussi; mais à quoi cela les avancerait-il? Comment, après cette catastrophe, parviendrions-nous à sauver les jeunes filles?
Balle-Franche hocha la tête.
—Oui, dit-il, voilà où est la difficulté; c'est justement là le nœud de l'affaire. Malheureusement, il est bien difficile de remédier à cette éventualité, qui, je l'espère, ne se présentera pas.
—Il faut le croire; mais, si cela arrivait, que ferions-nous?
—Ce que nous ferions?
—Oui!
—Hum! Vous m'adressez-là don Miguel, une question à laquelle il ne m'est guère facile de répondre.
—Enfin, supposez que cela soit; il faudrait cependant trouver un moyen de sortir de la fausse position dans laquelle nous nous trouverions.
—Cela est certain, il le faudrait indubitablement.
—Alors?
—Alors, ma foi! Je ne sais pas ce que je ferais. Voilà, je ne suis pas un homme qui prévoit d'aussi loin; lorsqu'un malheur arrive, il est temps d'y remédier, sans se briser la tête à y songer ainsi à l'avance. Tout ce que je puis vous dire, caballero, c'est que, pour le moment, au lieu de demeurer ici, planté bêtement comme un flamant à qui on a coupé une aile, je donnerais beaucoup pour me trouver dans cette ville maudite, à proximité de veiller sur mon vieux compagnon.
—Dites-vous vrai? Seriez-vous réellement homme à tenter une telle entreprise? s'écria don Leo avec joie.
Le chasseur le regarda avec surprise.
—En doutez-vous? lui dit-il. Quand donc m'avez-vous vu me vanter de choses que je n'étais pas capable de faire?
—Ne vous fâchez pas, mon vieil ami, reprit vivement don Leo; vos paroles me font un si grand plaisir que, dans le premier moment, je n'osais pas y croire.
—Il faut toujours ajouter foi à mes paroles, jeune homme, répondit sentencieusement le chasseur.
—Ne craignez rien, dit en riant don Leo, à l'avenir, je ne les révoquerai jamais en doute.
—A la bonne heure!
—Écoutez! Si vous le voulez, nous tenterons l'affaire à nous deux.
—Pour entrer dans la ville?
—Oui!
—Pardieu! C'est une idée, cela! s'écria Balle-Franche ravi.
—N'est-ce pas?
—Oui; mais comment nous introduirons-nous dans la ville?
—Laissez-moi faire je m'en charge.
—Bon! Alors je ne m'en occupe plus; seulement, il y a autre chose.
—Quoi donc?
—Nous ne sommes guère présentables ainsi, fit le chasseur en montrant en riant leurs costumes réciproques; moi, à la rigueur, en me peignant un peu la figure et les mains, je pourrai passer; mais vous c'est impossible!
—C'est vrai. Eh bien, laissez-moi faire; je vais me confectionner un costume indien auquel vous n'aurez rien à reprocher. Vous, pendant ce temps-là, déguisez-vous comme vous l'entendrez.
—Ce sera bientôt fait.
—Et moi aussi.
Les deux hommes se levèrent tout joyeux, mais probablement pour des causes différentes. Balle-Franche était heureux d'aller au secours de son ami, tandis que don Leo ne songeait qu'a doña Laura qu'il espérait revoir.
Au moment où ils se levaient, don Mariano les arrêta.
—Est-ce sérieusement que vous parlez ainsi, caballeros, leur demanda-t-il.
—Certes, répondirent-ils, on ne peut plus sérieusement.
—Alors, c'est fort bien; je vais avec vous.
—Hein! s'écria don Leo en reculant avec stupéfaction; êtes-vous fou, don Mariano? Vous qui ne connaissez pas les Indiens, qui ne savez pas un mot de leur langue, vous risquer dans ce guêpier! C'est vouloir mourir!
—Non, répondit résolument le vieillard; je veux revoir mon enfant!
Don Leo n'eut pas le courage de combattre une résolution si nettement formulée, il baissa la tête sans répondre. Balle-Franche, lui, ne prit pas l'affaire à ce point de vue: parfaitement de sang-froid et par conséquent voyant loin et juste, il comprit les conséquences désastreuses qu'aurait pour eux la présence de don Mariano.
—Pardon, lui dit-il, mais, avec votre permission, caballero, il me semble que vous n'avez pas bien réfléchi à la résolution que vous prenez en ce moment.
—Caballero, un père ne réfléchit pas quand il s'agit de revoir son enfant qu'il croyait morte et qu'il n'espérait plus serrer dans ses bras.
—C'est juste; seulement je vous ferai observer que ce que vous voulez faire, loin de vous aider à revoir votre fille, pourra au contraire vous l'enlever à jamais!
—Que voulez-vous dire?
—Une chose bien simple: nous allons, don Miguel et moi, nous mêler au milieu des Indiens que nous espérons à peine parvenir à tromper, nous qui les connaissons; si vous nous accompagnez, il arrivera inévitablement ceci: que du premier coup les peaux-rouges verront que vous êtes un blanc, et alors, vous comprenez, rien ne pourra vous sauver, ni nous non plus. Maintenant, si vous le voulez absolument, partez, je suis prêt à vous suivre; on ne meurt qu'une fois, autant aujourd'hui que demain.
Don Mariano poussa un soupir.
—J'étais fou, murmura-t-il, je ne savais ce que je disais: pardonnez-moi; j'ai tant de hâte de revoir mon enfant!
—Ayez foi en nous, pauvre père, répondit noblement don Leo; par ce que nous avons fait déjà, jugez de ce que nous pouvons faire encore; nous allons tenter l'impossible pour vous rendre celle qui vous est si chère.
Don Mariano, succombant à l'émotion qui l'accablait, n'eut pas la force de répondre; les yeux pleins de larmes, il serra la main du jeune homme et se laissa tomber sur le sol.
Les deux aventuriers se préparèrent alors à la hardie expédition qu'ils méditaient et se mirent en devoir de se déguiser.
Grâce à leurs connaissances des coutumes indiennes, ils parvinrent à se composer des costumes en harmonie avec le rôle qu'ils voulaient jouer et à se donner assez bien l'apparence indienne.
Lorsque ces divers préparatifs furent terminés, don Leo confia à Ruperto le commandement de la cuadrilla, lui recommanda la plus grande vigilance, afin de ne pas se laisser surprendre, lui fit part du signal convenu avec Bon-Affût, et après avoir une dernière fois serré la main de don Mariano, toujours plongé dans la plus profonde douleur, les deux téméraires aventuriers prirent congé de leurs compagnons, jetèrent sur leur épaule leur rifle, dont ils n'avaient pas voulu se séparer, et se mirent en marche dans la direction de Quiepaa-Tani, accompagnés de quelques gambucinos qui voulaient les escorter jusqu'à la lisière de la forêt, et de Ruperto, qui n'était pas fâché de se rendre compte de la situation de la ville, afin de savoir comment il pourrait placer ses hommes de façon à accourir au premier signal qu'il entendrait.
Le soleil se couchait au moment où les gambucinos atteignaient la lisière de la forêt et la limite du couvert.
Devant eux, à environ une lieue et demie, s'élevait la ville au milieu de l'océan de verdure de la plaine qui l'enveloppait et lui formait une ceinture d'herbes et de fleurs.
La nuit tombait rapidement, les ténèbres s'épaississaient de minute en minute, confondant en une masse sombre tous les accidents du paysage; l'heure était enfin des plus propices pour tenter le hardi coup de main auquel ils étaient résolus.
Ils firent un dernier adieu à leurs compagnons, et s'enfoncèrent résolument dans les hautes herbes au milieu desquelles ils ne tardèrent pas à disparaître.
Heureusement pour les aventuriers, auxquels il aurait été impossible de se diriger au milieu des ténèbres, les pas des piétons et ceux des cavaliers qui se rendaient incessamment à la ville, ou de ceux qui en sortaient, avaient tracé à la longue de larges sentiers qui tous aboutissaient directement à une des portes.
Les deux hommes marchèrent assez longtemps silencieux à côté l'un de l'autre.
Chacun d'eux réfléchissait profondément à l'issue probable de cette tentative désespérée.
Dans le premier moment d'enthousiasme, ils n'avaient que légèrement songé aux difficultés sans nombre qu'ils devaient rencontrer sur leur route et aux obstacles qui, à chaque pas, surgiraient sans doute devant eux.
Ils n'avaient vu que le but à atteindre.
Mais maintenant qu'ils étaient de sang-froid, bien des choses auxquelles ils n'avaient pas pris garde ou auxquelles ils n'avaient pas voulu s'arrêter se présentaient à leur pensée, et, ainsi que cela arrive souvent, leur faisaient voir leur expédition sous un aspect tout différent.
Maintenant, le but leur paraissait presque impossible à atteindre, au lieu que les dangers et les obstacles grossissaient pour ainsi dire à vue d'œil.
Malheureusement, ces judicieuses réflexions arrivaient trop tard; il n'était plus temps de reculer, il fallait marcher en avant quand même.
Du reste, tout était calme et tranquille; il n'y avait pas un soupir de la brise dans l'air, pas un bruit dans la prairie, et au fur et à mesure que les étoiles apparaissaient au ciel, une lueur pâle et tremblotante venait légèrement modifier les ténèbres et les rendre moins intenses.
Maintenant ils commençaient à y voir assez pour se diriger sans hésitation et reconnaître les environs à une certaine distance.
Balle-Franche ne s'arrangeait que médiocrement du silence opiniâtre de son compagnon; le digne chasseur aimait assez à parler, surtout dans des circonstances semblables à celles dans lesquelles il se trouvait en ce moment; aussi résolut-il de faire causer son compagnon, d'abord afin d'entendre la voix humaine, raison que ne comprendront probablement pas les gens dont la vie, heureusement pour eux, s'est passée sédentaire et exempte de ces grands orages du cœur qui donnent cependant tant de charme à l'existence; la seconde raison du chasseur était non moins péremptoire que la première: maintenant qu'il était embarqué dans cette entreprise désespérée, il n'était pas fâché de demander certains renseignements à don Leo, afin de savoir comment celui-ci prétendait agir et quel plan de conduite il comptait adopter.
Aussi, près de la ville, dans une campagne entièrement découverte, il n'y avait pour les aventuriers que très peu de risque de rencontrer des Indiens; les seuls qu'ils étaient exposés à voir étaient des batteurs d'estrade chargés d'aller à la découverte, au cas peu probable où les Indiens, contrairement à leurs usages habituels de ne pas faire un mouvement quelconque pendant la nuit, eussent jugé nécessaire d'envoyer quelques hommes pour surveiller les alentours.
Les deux hommes pouvaient donc, pour ainsi dire sans danger, à moins d'un hasard extraordinaire, causer entre eux en ayant, bien entendu, le soin de ne parler qu'à voix basse et de tenir constamment les yeux et les oreilles en vedette pour signaler le danger aussitôt qu'il se manifesterait.
Balle-Franche après avoir toussé légèrement afin d'attirer l'attention de son compagnon, lui dit tout à coup en jetant autour de lui un regard de mauvaise humeur:
—Eh! Eh! Le ciel s'éclaircit énormément depuis quelques minutes, la nuit est moins profonde; pourvu que la lune ne se lève pas avant que nous soyons arrivés où nous voulons aller.
—Nous avons encore plus de deux heures devant nous avant que la lune ne se lève, répondit don Leo, c'est plus qu'il ne nous en faut.
—Vous croyez que deux heures nous suffiront?
—J'en suis sûr.
—Allons, tant mieux, car je n'aime que médiocrement les marches de nuit.
—Ce n'est guère la coutume d'en faire.
—En effet, depuis quarante ans que je parcours le désert dans tous les sens, c'est ce soir la seconde fois qu'il m'arrive de faire une expédition de nuit.
—Bah!
—Mon Dieu! Oui; la première fois, le fait mérite d'être constaté.
—Comment cela? demanda don Leo d'un air distrait.
—C'est que les circonstances étaient à peu près les mêmes: il s'agissait aussi de sauver une jeune fille qui avait été enlevée par les Indiens. C'était en 1835; j'étais alors au service de la Société des Pelleteries. Les Indiens Pieds-Noirs, pour se venger d'un tour que leur avait joué un mauvais drôle d'engagé, n'avaient rien trouvé de mieux que d'enlever la fille du commandant du fort Mackenzie[1]; alors...
—Écoutez, dit don Leo en lui saisissant le bras, n'entendez-vous rien?
Le Canadien, si subitement interrompu dans sa narration qu'il croyait bien cette fois conduire jusqu'au bout, ne manifesta cependant aucune mauvaise humeur, tant il était habitué à de pareilles mésaventures; il s'arrêta, se coucha sur le sol, appuya l'oreille à terre et écouta pendant deux ou trois minutes avec l'attention la plus soutenue, puis il se releva en secouant dédaigneusement la tête.
—Ce sont des coyotes en chasse d'un daim, dit-il.
—Vous en êtes certain?
—Vous ne tarderez pas à les entendre donner de la voix.
Effectivement, à peine le chasseur finissait-il de parler que les aboiements répétés des coyotes se firent entendre à une légère distance.
—Vous voyez, dit simplement le Canadien.
—En effet, répondit don Leo.
Ils reprirent leur marche interrompue un instant.
—Ah çà, dit Balle-Franche, vous savez ce qui est convenu, don Miguel; je me fie entièrement à vous pour entrer dans la ville: je ne sais pas comment nous ferons, par exemple.
—Je ne le sais pas trop moi-même, répondit le jeune homme; j'ai passé aujourd'hui plusieurs heures à examiner attentivement les murailles, et j'ai cru reconnaître un endroit par lequel il nous sera, je le suppose, assez facile de passer.
—Hum! dit Balle-Franche, votre plan ne me semble pas très bon, compagnon; il aboutira probablement à des os cassés.
—C'est une chance à courir.
—Parfaitement; mais, sans vous offenser, j'aimerais mieux autre chose, si cela est possible.
—Cette perspective ne vous fait pas peur, cependant?
—Moi, pas le moins du monde. Il est évident que les Indiens ne peuvent pas me tuer; sans cela depuis que je cours le désert, il y a longtemps que ce serait fait.
Le jeune homme ne put s'empêcher de rire du sang-froid avec lequel son compagnon émettait cette singulière opinion.
—Eh bien, alors, lui dit-il, dans ces conditions-là pourquoi trouvez-vous à reprendre à mon plan?
—Parce qu'il est mauvais: si les Indiens ne peuvent pas me tuer, rien ne prouve qu'ils ne me blesseront pas. Croyez-moi, don Miguel, soyons prudents; si l'un de nous est mis de prime-abord hors de combat, que deviendra l'autre?
—C'est juste; mais avez-vous un autre plan à me proposer, vous?
—Je le crois.
—Eh bien, faites-le-moi connaître: s'il est bon, je l'adopterai; je n'y mets pas le moindre amour-propre.
—Bon; savez-vous nager.
—Pourquoi cette question?
—Répondez d'abord, vous le saurez ensuite.
—Je nage comme un esturgeon.
—Moi comme une loutre; nous sommes dans d'excellentes conditions. Maintenant faites bien attention à ce que je vais vous dire.
—Allez toujours.
—Vous voyez cette rivière, n'est-ce pas, un peu sur notre droite?
—Pardieu!
—Fort bien. Cette rivière traverse la ville qu'elle coupe en deux, n'est-ce pas?
—Oui.
—En supposant que les peaux-rouges aient connaissance de notre présence dans ces parages, de quel côté doivent-ils craindre une attaque?
—Du côté de la plaine évidemment; cela est logique.
—De mieux en mieux, de façon que les murailles sont garnies de sentinelles qui surveillent la plaine dans toutes les directions, au lieu que la rivière du côté de laquelle on ne soupçonne aucun danger est parfaitement solitaire.
—C'est vrai! s'écria don Leo en se frappant le front, je n'y avais pas songé.
—On ne pense pas à tout, observa philosophiquement Balle-Franche.
—Mon digne ami, que je vous remercie d'avoir eu cette bonne idée; maintenant nous sommes certains d'entrer dans la ville.
—Ne vendons pas la peau de l'ours avant de...; vous connaissez le proverbe. Malgré cela, rien ne nous empêche d'essayer.
Ils obliquèrent immédiatement à gauche pour se rapprocher de la rivière qu'ils atteignirent après un quart d'heure de marche. Le rivage était désert; la rivière, calme comme un miroir, semblait un large ruban d'argent.
—Maintenant, reprit Balle-Franche, ne nous pressons pas; bien que nous sachions nager, gardons cet expédient au cas où nous n'en aurions pas d'autres. Fouillez tous les buissons d'un côté pendant que je les explorerai de l'autre; je me trompe fort, ou nous finirons par trouver une pirogue quelconque.
Les prévisions du chasseur ne l'avaient pas trompé; après quelques minutes de recherches, ils trouvèrent en effet une pirogue cachée sous un amas de feuilles, au milieu d'un épais buisson de lentisques et de floripondios; les pagaies étaient cachées à quelques pas plus loin.
Nous avons déjà dit au lecteur quel est le mode de construction adopté par les Indiens pour ces embarcations, qui entre autres avantages ont celui d'être extrêmement légères. Balle-Franche prit les pagaies; don Leo chargea la pirogue sur son dos, et en quelques minutes elle fut à flot.
—Maintenant embarquez-vous, dit Balle-Franche.
—Un instant, observa don Leo, garnissons les pagaies pour éviter le bruit.
Balle-Franche haussa les épaules.
—Ne soyons pas trop fins, dit-il, cela nous nuirait. S'il y a des Indiens près d'ici, ils verront la pirogue; si en même temps ils n'entendent pas le bruit des pagaies, ils soupçonneront un piège et voudront s'assurer de la vérité. Non, non, laissez-moi faire; couchez-vous au fond de la pirogue; elle est petite, heureusement pour nous; les peaux-rouges ne supposeront jamais qu'une si chétive embarcation, montée par un homme seul, ait la prétention de les surprendre; car ce qui fait, relativement, la sécurité de notre expédition, ne l'oubliez pas, c'est sa témérité et sa folie même: il faut être des visages pâles pour avoir des idées aussi biscornues. Je me rappelle qu'en l'année 1835, dont je vous parlais tout à l'heure...
—Partons, partons, interrompit don Leo en sautant dans la pirogue, au fond de laquelle il s'installa, d'après la recommandation de son compagnon.
Celui-ci le suivit en hochant la tête et prit les pagaies, dont il ne se servit cependant qu'avec une nonchalance affectée qui ne communiquait à l'embarcation qu'un mouvement lent et mesuré.
—Voyez-vous, continua le chasseur, de la façon dont nous marchons, s'il y a aux aguets quelques-uns de ces diables rouges, ils me prendront évidemment pour un de leurs compatriotes attardé à la pêche et qui regagne son calli.
Cependant peu à peu et d'une manière imperceptible le chasseur augmenta la marche de la pirogue, si bien qu'au bout d'une demi-heure elle avait atteint une certaine rapidité relative, qui n'était pas pourtant assez grande pour inspirer des soupçons. Ils voguèrent ainsi sans encombre pendant plus d'une heure et finirent par entrer dans la ville. Mais, s'ils avaient cru opérer leur débarquement sans être aperçus, ils s'étaient trompés: aux environs du pont, endroit où un grand nombre de pirogues tirées à terre montrait que c'était là que s'arrêtaient les Indiens, Balle-Franche aperçut une sentinelle indienne qui, appuyée sur sa longue lance, le suivait du regard. Le Canadien explora rapidement les environs et s'assura que la sentinelle était seule.
—Bon! murmura-t-il à part lui, s'il n'y a que toi, ce ne sera pas long.
Alors il rendit compte à don Leo de ce qui se passait; celui-ci lui répondit quelques mots.
—C'est vrai, dit le chasseur en se redressant, il n'y a que ce moyen.
Et il dirigea la pirogue directement sur la sentinelle. Dès que le Canadien fut à portée de voix:
—Ooah! lui dit l'Indien, mon frère rentre bien tard à Quiepaa-Tani; tout le monde dort à cette heure.
—C'est vrai, répondit Balle-Franche dans la langue dont s'était servi la sentinelle; mais j'apporte de bien beau poisson.
—Eh! fit curieusement le guerrier, puis-je le voir?
—Non seulement mon frère peut le voir, répondit gracieusement le Canadien, mais j'encore je l'autorise à choisir celui qui lui plaira.
—Och! Mon frère a la main ouverte, le Wacondah ne la lui laissera jamais vide; j'accepte l'offre de mon frère.
—Hum! murmura Balle-Franche: pauvre diable, c'est étonnant comme il mord à l'hameçon: il ne se doute guère que c'est lui qui est le poisson en ce moment; et, après cette réflexion philosophique faite in petto, il continua à avancer.
Bientôt l'avant de la pirogue grinça sur le sable du rivage. L'Indien, alléché par l'offre fallacieuse du Canadien, ne voulut pas demeurer en reste de gracieuseté avec lui, il saisit le bord de l'embarcation et commença à la tirer au plein.
—Ooah! fit-il, effectivement, ainsi que l'a dit mon frère, il a fait une bonne pêche car la pirogue est lourde.
En disant cela, il se baissa afin de se donner plus de force et se mit en devoir de la tirer de nouveau à lui. Mais il n'en eut pas le temps, don Leo bondit hors de la pirogue, et, levant son rifle par le canon, il asséna un coup de crosse terrible sur le crâne du malheureux Indien. La pauvre sentinelle fut tuée roide et roula sur le sable sans pousser un cri.
—Là! fit Balle-Franche en descendant à son tour, au moins ce n'est pas celui-là qui nous dénoncera.
—Maintenant il faut nous en débarrasser, répondit don Leo.
—Ce ne sera pas long.
L'implacable chasseur choisit alors une grosse pierre, la plaça dans la frazada du peau-rouge, fit un paquet du tout et le fit doucement couler dans l'eau. Aussitôt que cela fut fait, que toute trace du meurtre eut disparu, ils tirèrent la pirogue à terre auprès de celles qui s'y trouvaient déjà et se disposèrent à s'éloigner.
Mais alors commencèrent pour eux les véritables difficultés de l'entreprise: comment s'orienter dans cette ville inconnue, au milieu des ténèbres? Où et comment retrouver Bon-Affût. Ces deux questions semblaient aussi impossibles à résoudre l'une que l'autre.
—Bah! fit Balle-Franche, une piste ne doit pas être plus difficile à trouver dans une ville que dans le désert, essayons.
—Le principal est de nous éloigner le plus tôt possible d'ici.
—Oui, le lieu n'est pas sain pour nous; mais, j'y songe, tâchons d'atteindre la grand'place: c'est là, ordinairement, que l'on peut espérer obtenir des renseignements.
—A cette heure-ci, cela me semble assez difficile.
—Au contraire. Nous nous embusquerons en attendant le jour; le premier peau-rouge qui passera à notre portée, nous l'obligerons de nous donner des nouvelles de notre ami; un grand médecin comme lui doit être connu, que diable! ajouta-t-il en riant.
Gaieté que don Leo partagea de tout son cœur. C'était une chose étrange que l'insouciance et le laisser-aller de ces deux hommes qui, au milieu de cette ville où ils s'étaient introduits en tuant un de ses habitants, dans laquelle ils savaient ne rencontrer que des ennemis et où des dangers terribles étaient de toutes parts suspendus sur leurs têtes, se trouvaient cependant aussi à leur aise que s'ils eussent été au milieu de leurs amis, et riaient et plaisantaient entre eux comme si leur position eût été la plus agréable du monde.
—Eh! reprit Balle-Franche, nous sommes dans un assez joli labyrinthe; ne trouvez-vous pas comme moi que cela sent furieusement les os cassés ici?
—Qui sait! Peut-être nous en tirerons-nous mieux que nous ne le croyons.
—Ce qu'il y de certain, c'est que nous ne pouvons tarder à le savoir.
—Prenons cette rue qui s'ouvre là devant nous, elle est large et bien tracée; j'ai comme un pressentiment qui m'annonce qu'elle nous mettra dans la bonne voie.
—A la grâce de Dieu! Autant celle-là qu'une autre. Les chasseurs s'engagèrent donc dans la rue qui se trouvait devant eux et aboutissait au pont.
Le hasard les avait bien servis; après dix minutes de marche, ils se trouvèrent à l'entrée de la grand'place.
—Là, fit Balle-Franche d'un ton ravi; le bonheur est avec nous, nous ne pouvons nous plaindre; du reste, cela devait être ainsi; le hasard favorise toujours les fous, à ce titre nous avons droit à toute sa sympathie.
—Silence! dit vivement don Leo, voici quelqu'un.
—Où cela?
Le jeune homme étendit le bras dans la direction du temple du Soleil.
—Voyez, répondit-il.
—En effet, murmura Balle-Franche après un instant; mais il me semble que cet homme fait comme nous. Il a l'air d'être aux aguets. Quelle raison peut le faire veiller aussi tard?
Après s'être, en quelques mots, concertés entre eux, les deux aventuriers se séparèrent, et, de deux côtés différents, s'approchèrent à pas de loup du côté du nocturne promeneur, en se dissimulant le mieux qu'il leur était possible dans l'ombre, ce qui n'était pas une tâche facile. La lune était levée depuis quelque temps et répandait une lueur assez faible, il est vrai, mais cependant suffisante pour laisser, à une assez grande distance, distinguer les objets. L'homme vers lequel s'avançaient les aventuriers était toujours immobile à l'endroit où ils l'avaient aperçu; le corps penché en avant, l'oreille appuyée contre la porte du temple, il semblait écouter avec attention. Don Leo et Balle-Franche n'étaient plus qu'à cinq ou six pas, ils se préparaient à fondre sur lui, lorsque tout à coup il se redressa. Ils étouffèrent avec peine un cri de surprise.
—L'Aigle-Volant! murmurèrent-ils. Mais, si bas qu'ils eussent parlé, celui-ci les avait entendus; il avait immédiatement sondé les ténèbres d'un regard perçant.
—Ooah! fit-il en apercevant les deux hommes, et il s'avança résolument de leur côté.
Les aventuriers quittèrent l'ombre qui les protégeait et attendirent. Lorsque l'Aigle-Volant fut arrivé presque sur eux:
—C'est moi! lui dit don Leo.
—Et moi! ajouta Balle-Franche.
Le chef comanche recula avec un mouvement de stupéfaction impossible à rendre.
—La tête grise ici! s'écria-t-il.
[1] Voir Balle-Franche, un vol. in-12 chez Amyot, éditeur.
Nous avons dit que Bon-Affût, après avoir accompagné le Loup-Rouge jusqu'à la porte du temple et l'avoir vu s'éloigner, était rentré dans le sanctuaire en fermant et barricadant la porte derrière lui.
Le chef comanche l'attendait l'épaule appuyée au mur, les bras croisés sur la poitrine.
—Je vous remercie de votre aide, chef, lui dit-il; sans vous, j'étais perdu.
—Depuis longtemps déjà, répondit l'Indien, l'Aigle-Volant assistait invisible à la conversation de son frère avec le Loup-Rouge.
—Enfin nous en voilà débarrassés pour longtemps, je l'espère; maintenant rien ne viendra entraver nos projets ni empêcher leur réussite.
Le guerrier secoua négativement la tête.
—Vous doutez encore, chef? demanda le chasseur.
—Je doute plus que jamais.
—Comment! Lorsque tout marche aussi bien que nous le pouvons désirer, lorsque tous les obstacles s'abaissent devant nous?
—Och! Les obstacles s'abaissent; mais d'autres plus grands, plus difficiles à vaincre, surgissent aussitôt.
—Je ne vous comprends pas, chef. Auriez-vous une mauvaise nouvelle à m'annoncer? Parlez vite alors, le temps est précieux pour nous.
—Mon frère jugera, répondit simplement le chef. Alors, se détournant à demi, il frappa dans ses mains à deux reprises. Comme si ce signal inoffensif eût eu la puissance d'évoquer des fantômes, deux hommes sortirent instantanément de l'ombre et apparurent aux regards étonnés du chasseur. Bon-Affût les examina un instant, puis il joignit les mains avec surprise en murmurant:
—Balle-Franche et don Miguel ici! Miséricorde! Qu'allons-nous devenir?
—Est-ce donc ainsi que vous nous recevez, mon ami? lui dit affectueusement don Leo.
—Mais, au nom du ciel! Que venez-vous faire ici? Quelle mauvaise inspiration vous a poussé à me rejoindre, lorsque tout marchait si bien, que le succès était pour ainsi dire assuré?
—Nous ne sommes pas venus pour contrecarrer vos projets; au contraire, inquiets de vous savoir seul au milieu de ces démons, nous avons voulu vous voir, afin de vous aider, si cela était possible.
—Je vous remercie de cette bonne intention. Malheureusement elle est plutôt nuisible qu'utile dans les circonstances présentes. Mais comment êtes-vous parvenus à vous introduire dans la ville?
—Oh! Bien facilement, allez, répondit Balle-Franche; et il raconta en peu de mots de quelle façon ils étaient arrivés jusqu'à lui.
Le chasseur secoua la tête.
—L'action est hardie, dit-il; je dois convenir qu'elle a été bien conduite. Mais à quoi cela vous avance-t-il d'avoir couru tous ces dangers? De plus grands vous attendent ici, sans profit et sans avantage pour nous.
—Peut-être! Quoi qu'il arrive, répondit fermement don Leo, vous comprenez bien que je ne me suis pas, de gaieté de cœur, exposé à tous ces dangers, sans une raison bien forte.
—Je le suppose; mais je cherche vainement quelle peut être cette raison.
—Ne la cherchez pas plus longtemps, je vais vous la dire.
—Parlez.
—Il faut, vous comprenez, n'est-ce pas, mon vieil ami? reprit-il en appuyant avec intention sur chaque syllabe, il faut que je voie doña Laura.
—Voir doña Laura, c'est impossible! s'écria Bon-Affût.
—Je ne sais pas si cela est impossible, mais je sais que je la verrai.
—Vous êtes fou, sur mon âme! Don Leo; c'est impossible, vous dis-je.
L'aventurier haussa les épaules avec dédain
—Je vous répète que je la verrai, dit-il avec résolution, quand même, pour arriver jusqu'à elle, je devrais marcher dans le sang jusqu'à la ceinture; je le veux, cela sera!
—Mais comment ferez-vous?
—Je l'ignore, cela m'importe peu. Si vous refusez de nous aider, eh bien! Balle-Franche et moi, nous trouverons un moyen, n'est-ce pas mon vieux camarade?
—Il est certain, don Miguel, répondit celui-ci du ton placide qui lui était habituel, que je ne vous abandonnerai pas. Pour trouver un moyen d'arriver jusqu'aux captives, nous le trouverons; seulement je ne réponds pas qu'il sera bon.
Il y eut un assez long silence. Bon-Affût était atterré de la résolution de don Leo, résolution qu'il savait devoir être immuable; il calculait dans son esprit les chances bonnes ou mauvaises qu'offrait pour la réussite de ses projets l'arrivée si malencontreuse du jeune homme. Enfin il reprit la parole.
—Je n'essaierai pas, dit-il à don Leo, de chercher plus longtemps à vous dissuader de tenter de voir les jeunes filles; je vous connais assez pour savoir que ce serait inutile et que mes raisonnements n'aboutiraient peut-être qu'à vous entraîner à faire quelque irrémédiable folie; je me charge, moi de vous introduire auprès de doña Laura.
—Vous me le promettez! s'écria vivement le jeune homme.
—Oui, mais à une condition.
—Parlez, quelle qu'elle soit je l'accepte.
—Bien; lorsque le moment sera venu, je vous la ferai connaître; seulement, croyez-moi, priez l'Aigle-Volant de compléter votre déguisement; de la façon dont vous et Balle-Franche êtes attifés en ce moment, vous ne feriez point un pas dans la ville sans être reconnus. Maintenant je vous quitte, voici le jour, je dois me rendre auprès du grand-prêtre; je vous laisse à la garde de l'Aigle-Volant; suivez bien ses instructions: il y va de la vie, non seulement pour vous, mais encore pour celles que vous voulez sauver.
Le jeune homme tressaillit douloureusement.
—Je vous obéirai, répondit-il; mais vous tiendrez votre promesse.
—Je la tiendrai aujourd'hui même.
Après avoir pendant quelques instants parlé à voix basse avec l'Aigle-Volant, Bon-Affût laissa les trois hommes dans le temple et sortit.
L'amantzin se préparait à se rendre au temple au moment où le chasseur entrait dans le palais, Atoyac, curieux comme un véritable Indien qu'il était, n'avait pas, depuis la veille, quitté le grand-prêtre, afin d'assister à la seconde visite du médecin, visite qui, d'après ce qu'il avait vu déjà à la première, devait, dans sa pensée, être fort intéressante. Le chasseur retourna, accompagné de l'amantzin qui ne le quittait pas plus que son ombre, auprès des jeunes filles. Il acquit alors la certitude que doña Laura pouvait sans inconvénient supporter la fatigue d'un transport hors du palais des vierges du Soleil. La jeune fille, avec l'espoir d'une prompte délivrance, avait repris des forces, le mal qui la minait sourdement avait disparu comme par enchantement. Quant à Luisa, plus défiante, lorsque le grand-prêtre se fut retiré, car le chasseur avait exigé de demeurer seul avec les malades, elle dit au Canadien:
—Nous serons prêtes, quant vous l'ordonnerez, à vous suivre, Bon-Affût, mais à une condition.
—Comment! A une condition? se récria le chasseur. Puis il ajouta mentalement: Qu'est-ce que cela signifie? Rencontrerai-je donc des obstacles de tous les côtés? Parlez, niña, reprit-il, je vous écoute.
—Pardonnez-moi ce que mes paroles auront de dur en apparence; nous ne doutons pas de votre loyauté, Dieu nous en garde! Cependant...
—Vous vous méfiez de moi, interrompit le chasseur d'une voix chagrine. Du reste, je devais m'y attendre, vous me connaissez trop peu l'une et l'autre pour avoir foi en moi.
—Hélas! dit doña Laura, tel est le malheur de notre position que, malgré nous, nous tremblons de rencontrer partout des traîtres.
—Ce misérable Addick, auquel don Miguel s'était fié, ajouta doña Luisa, comment en a-t-il agi avec nous?
—C'est vrai! Vous devez parler ainsi! Que puis-je faire pour vous prouver d'une façon péremptoire que vous pouvez avoir en moi pleine et entière confiance?
Les deux jeunes filles rougirent et se regardèrent en hésitant.
—Tenez, reprit le chasseur avec bonhomie, je vais lever tous vos doutes. Ce soir, je vous reverrai; un homme m'accompagnera; je crois qu'il pourra vous convaincre.
—De qui parlez-vous donc? demanda vivement doña Laura.
—De don Miguel.
—Il viendra? s'écrièrent ensemble les jeunes filles.
—Ce soir, je vous le promets.
Les deux enfants se jetèrent dans les bras l'une de l'autre pour cacher leur rougeur et leur confusion.
Le chasseur, après avoir un instant admiré ce groupe gracieux, sortit en disant d'une voix douce et sympathique:
—A ce soir.
Dans la première salle du palais, l'amantzin et Atoyac attendaient avec anxiété le résultat de la visite. Lorsque le chasseur fut au milieu d'eux et que le grand-prêtre l'eut interrogé sur la situation des malades, il parut se recueillir un instant, puis il répondit d'une voix grave:
—Mon père est un homme sage; rien n'égale sa science: que son cœur soit dans la joie, car bientôt ses captives seront délivrées du méchant esprit qui les obsède.
—Mon père dit-il vrai? demanda l'amantzin en cherchant à lire sur le visage du faux médecin le degré de confiance qu'il devait lui accorder.
Mais celui-ci était impénétrable.
—Écoutez, répondit-il, voici ce que cette nuit le grand esprit m'a révélé: En ce moment arrive dans la ville un tlacateotzin d'une tribu éloignée; je ne le connais pas, jamais jusqu'à ce jour je n'avais entendu parler de lui; c'est cet homme divin qui doit m'aider à sauver les malades. Lui seul sait quels remèdes doivent leur être administrés.
—Mais, fit le grand-prêtre avec un accent de soupçon mal dissimulé, mon père nous a donné des preuves de son immense savoir; pourquoi ne termine-t-il pas seul ce qu'il a si bien commencé?
—Je suis un homme simple dont la force réside dans la protection que le Wacondah m'accorde; il m'a révélé le moyen de rendre la santé à celles qui souffrent: je dois obéir.
Le grand-prêtre s'inclina avec soumission et invita le chasseur à lui confier ce qu'il comptait faire.
—Le tlacateotzin inconnu le dira à mon père lorsqu'il aura vu ses captives, répondit Bon-Affût; mais son attente ne sera pas longue, je sens l'approche de l'homme divin. Que mon père l'introduise sans retard.
Précisément en ce moment plusieurs coups furent frappés à la porte extérieure. Le grand-prêtre, dominé malgré lui par l'assurance du chasseur, se hâta d'aller ouvrir. Don Leo parut; grâce à l'Aigle-Volant, il était méconnaissable. Il est inutile de faire remarquer au lecteur que cette scène avait été préparée par le Canadien et le guerrier comanche, pendant le court a parte qu'ils avaient eu avant de se quitter dans le temple.
Don Leo jeta un regard interrogateur autour de lui.
—Où sont les malades que je dois délivrer du grand esprit, selon l'ordre du Wacondah? dit-il d'une voix sévère.
Le grand-prêtre et le chasseur échangèrent un regard d'intelligence. Les deux Indiens étaient confondus; l'arrivée de cet homme si clairement prédite par Bon-Affût leur paraissait tenir du prodige.
Nous ne rapporterons pas la conversation qui eut lieu entre don Leo et les jeunes filles lorsqu'ils se trouvèrent en présence; nous nous bornerons à dire que, après une visite d'une heure qui pour les jeune gens s'écoula avec la rapidité d'une minute, Bon-Affût parvint à grand-peine à les faire consentir à se séparer et revint avec l'aventurier auprès du grand-prêtre, dont il redoutait d'éveiller les soupçons.
—Courage! dit rapidement le chasseur pendant le trajet, tout va bien; maintenant laissez-moi faire.
—Eh bien? demanda le grand-prêtre dès qu'ils parurent.
Bon-Affût redressa majestueusement sa haute taille, et, prenant un accent imposant et sévère:
—Écoutez, fit-il, les paroles que le grand Wacondah souffle à ma poitrine et fait arriver à mes lèvres; voici ce que dit l'homme divin ici présent: Les deux soleils qui suivront celui-ci sont tertzauh—mauvais augure;—mais le soir du troisième, dis que mexteli—la lune—répandra sa lumière bienfaisante, mon fils le sachem Atoyac prendra la peau d'une vigogne que mon père le vénéré amantzin de Quiepaa-Tani tuera d'ici là et qu'il bénira au nom de Teolt[1]; il étendra cette peau sur le sommet d'un monticule qui doit se trouver à peu de distance hors de la ville, afin que le méchant esprit en sortant du corps des jeunes filles ne puisse s'emparer d'aucun des habitants de la cité, puis il conduira les captives à la place où cette peau sera étendue.
—Mais observa le grand-prêtre, l'une d'elles est incapable de remuer du hamac où repose son corps.
—La sagesse de mon fils réside dans chacune de ses paroles; mais qu'il se rassure, le Wacondah donnera à celles qu'il veut sauver la force nécessaire.
L'amantzin fut contraint de s'incliner devant cet argument sans réplique.
—Lorsque ce que j'ai expliqué à mon père sera fait, continua imperturbablement le Canadien, il choisira quatre des plus braves guerriers de la nation pour l'aider à garder les captives pendant la nuit, et alors, après que j'aurai fait boire au puissant amantzin, ainsi qu'aux hommes qui l'accompagneront, une liqueur qui les garantira de toutes les mauvaises influences, mon frère le divin tlacateotzin chassera le méchant esprit qui tourmente les femmes pâles.
Le grand-prêtre et le sachem écoutaient en silence, ils semblaient réfléchir: le Canadien s'en aperçut; il se hâta d'ajouter.
—Bien que le Wacondah nous assiste et nous donne le pouvoir nécessaire pour triompher, il faut que mon frère l'amantzin et les quatre guerriers d'élite qu'il choisira passent avec nous la nuit qui précédera la grande médecine dans le sanctuaire révéré. Atoyac remettra, pour être offertes au Wacondah, vingt cavales pleines au sage amantzin. Mon frère fera-t-il cela?
—Hum! fit l'Indien, peu flatté de la préférence; si je le fais, que m'en reviendra-t-il?
Bon-Affût le regarda fixement.
—L'accomplissement avant la fin de la seconde lune, répondit-il, du projet qu'Atoyac mûrit depuis si longtemps dans sa pensée.
Le chasseur avait parlé au hasard; cependant il paraît que le coup avait porté juste, car le sachem répondit d'un air troublé avec une certaine agitation:
—Je le ferai.
—Mon père est un homme sage, fit le grand-prêtre, dont le front s'était éclairci lorsque le chasseur avait parlé de l'offrande des vingt cavales; le Wacondah le protège.
—Mon fils est bon, se contenta de répondre le Canadien, et il prit congé des deux hommes.
Sur la place, l'Aigle-Volant et Balle-Franche attendaient la sortie des deux aventuriers.
Tout en se dirigeant vers le calli de leur hôte, Bon-Affût expliqua dans tous ses détails son plan à ses compagnons. Du reste, rien n'était plus simple que ce projet, qui consistait à enlever les jeunes filles dès qu'elles seraient placées sur le monticule. Cette chance de succès était la seule possible; car il ne fallait pas songer à employer la force pour les faire sortir du palais des vierges du Soleil.
Le délai de trois jours fixé par Bon-Affût avant de tenter la réussite de son plan était nécessaire pour expédier l'Aigle-Volant dans sa tribu, afin de chercher des renforts dont on aurait sans doute grand besoin pendant la poursuite qui suivrait sans doute l'enlèvement. Balle-Franche devait en même temps s'éloigner de la ville pour prévenir les gambucinos du jour choisi pour l'exécution du sauvetage, afin d'éviter tout malentendu et embusquer les chasseurs dans de bonnes positions.
Le soir même, l'Aigle-Volant, l'Églantine et Balle-Franche s'embarquèrent, ainsi que cela avait été convenu, dans la pirogue du Loup-Rouge, qui attendait près du pont, d'après l'ordre qu'il en avait reçu de Bon-Affût. L'Églantine devait rester au camp des gambucinos tandis que l'Aigle-Volant, monté sur l'excellent barbe dont il avait si fortuitement hérité de don Estevan, se rendrait en toute hâte à sa tribu.
Lorsque Bon-Affût et don Leo eurent vu leurs amis s'éloigner dans la pirogue, ils retournèrent au calli d'Atoyac. Le digne sachem, bien qu'il leur gardât une secrète rancune pour l'impôt de vingt cavales qu'ils avaient levé sur lui, les reçut cependant de son mieux, n'osant pas enfreindre envers des hommes aussi puissants que les deux médecins les lois sacrées de l'hospitalité. Tout en causant, il leur apprit qu'Addick et le Loup-Rouge avaient subitement disparu de la ville sans que personne sût ce qu'ils étaient devenus. Quand au Loup-Rouge, les chasseurs le savaient, et son départ ne les inquiéta nullement; mais il n'en fut pas de même d'Addick, qui était, disait leur hôte, sorti à la tête d'un fort détachement de guerre. Ils soupçonnèrent que le jeune chef avait été rejoindre don Estevan, ce qui les engagea à redoubler de prudence, s'attendant à quelque perfide machination de la part de ces deux hommes.
Les trois jours qui devaient s'écouler se passèrent en visites aux jeunes filles et en prières au temple du Soleil. Cependant le temps semblait bien long à don Leo et aux jeunes filles, qui tremblaient toujours qu'une circonstance fortuite vînt déranger le plan si bien conçu de leur délivrance. Le dernier jour, Bon-Affût et don Leo s'entretenaient comme ils en avaient pris l'habitude avec doña Laura et doña Luisa, en leur recommandant une obéissance passive à toutes leurs injonctions, lorsqu'ils crurent entendre un certain frôlement extérieur sur la porte de la pièce qui précédait celle où habitaient les captives. Bon-Affût, reprenant aussitôt son visage d'emprunt, alla ouvrir et se trouva face à face avec le grand-prêtre, qui se recula avec la précipitation embarrassée d'une personne surprise en flagrant délit de curiosité indiscrète. Avait-il entendu ce que les jeunes gens et le chasseur s'étaient dits en espagnol? Bon-Affût, après mûre réflexion, ne le pensa pas; cependant il jugea prudent de recommander à ses compagnons de se tenir sur leurs gardes.
Ce jour si long se termina enfin; le soleil se coucha et la nuit vint. Tout était prêt pour le départ. Les captives, placées chacune dans un hamac suspendu aux épaules de quatre vigoureux esclaves, furent transportées sur le sommet du monticule choisi pour l'opération, et déposées doucement sur la peau de vigogne que l'on y avait étendue. Le grand-prêtre, d'après l'ordre de Bon-Affût, plaça en sentinelle aux quatre points cardinaux les guerriers qu'il avait amenés. Alors Bon-Affût prononça quelques paroles mystérieuses auxquelles don Leo répondit à voix basse, brûla quelques pincées d'une herbe odoriférante et ordonna aux Indiens et au grand-prêtre de s'agenouiller pour implorer le dieu inconnu—Teolt.
Don Leo, pendant ce temps-là, plongeait son regard sur la ville, cherchant à distinguer s'il ne s'y passait rien d'extraordinaire. Tout était calme, le plus profond silence régnait dans la campagne. Les deux chasseurs qui s'étaient agenouillés, eux aussi, se relevèrent.
—Que mes frères redoublent de prières, dit don Leo d'une voix sombre, je vais contraindre le méchant esprit à se retirer du corps des captives.
Malgré elles, les jeunes filles firent un mouvement d'effroi à ces paroles. Don Leo ne parut pas le remarquer; il fit un signe à Bon-Affût.
—Que mes frères approchent, commanda celui-ci.
Les sentinelles s'avancèrent avec une hésitation qui menaçait de dégénérer en frayeur au moindre mouvement suspect des médecins.
Don Leo reprit alors la parole:
—Mon frère et moi, dit-il, nous allons nous remettre en prières; mais, pour empêcher le méchant esprit de s'emparer de vous en abandonnant les captives, mon frère Deux-Lapins vous versera à chacun une corne d'une eau de feu préparée et douée par le Wacondah de la vertu de sauver ceux qui en boivent de l'atteinte du méchant esprit.
Les sentinelles étaient Apaches; au mot d'eau de feu, leurs yeux brillèrent de convoitise. Bon-Affût leur versa alors environ une pleine calebasse d'eau-de-vie mélangée d'opium à forte dose qu'ils avalèrent d'un seul trait avec des marques non équivoques de plaisir. Le grand-prêtre seul parut hésiter un instant; puis il se décida, et vida résolument la coupe, au grand soulagement des chasseurs que son hésitation commençait à inquiéter.
—Maintenant, s'écria le Canadien d'une voix rude, à genoux tous!
Les Apaches obéirent. Don Leo les imita.
Seul Bon-Affût resta debout, pendant que don Leo, le bras étendu vers le nord, semblait commander au méchant esprit de se retirer; le Canadien se mit à tourner rapidement sur lui-même en murmurant des paroles incohérentes que l'aventurier répétait après lui. Puis don Leo se releva et fit une évocation.
Vingt minutes s'étaient écoulées. Pendant cet intervalle de temps, un Indien s'était laissé aller la face contre terre, comme s'il se prosternait par humilité. Bientôt un autre fit de même, puis un autre, puis un autre encore, et enfin le grand-prêtre tomba à son tour. Les cinq Indiens ne donnaient plus signe de vie.
Bon-Affût, par acquit de conscience, fit légèrement sentir la pointe de son poignard à celui qui était le plus rapproché de lui. Le pauvre diable ne bougea pas: l'opium avait produit sur lui et sur ses compagnons un tel effet qu'on aurait pu les déchiqueter sans qu'ils se réveillassent.
Don Leo se tourna alors vers les jeunes filles qui attendaient, avec une perplexité toujours croissante, le dénoûment de cette scène.
—Fuyons! dit-il, il y va de votre vie!
Il saisit alors doña Laura dans ses bras, l'enleva sur son épaule, prit un pistolet de la main gauche et descendit en courant le monticule! Bon-Affût, plus calme que le jeune homme, commença par imiter, à trois reprises différentes, le cri de l'épervier d'eau, signal convenu entre lui et ses compagnons.
Au bout d'une minute, qui lui sembla un siècle, le même cri lui répondit.
—Dieu soit loué! s'écria-t-il, nous sommes sauvés!
Il s'avança alors vers la jeune fille et voulut la prendre dans ses bras.
—Non, lui répondit-elle en souriant, je vous remercie; je suis forte, moi, je puis marcher.
—Venez donc alors, au nom du ciel!
La jeune fille se leva.
—Allez, dit-elle, je vous suis. Songez à votre salut, je saurai me défendre!
Et elle montra au chasseur les pistolets que celui-ci lui avait remis deux mois auparavant.
—Brave fille! s'écria le chasseur. C'est égal, ne me quittez pas!
Il l'obligea à descendre devant lui, et tous deux abandonnèrent enfin le monticule. Arrivés à peu près à moitié chemin de la forêt, les chasseurs furent contraints de s'arrêter, les jeunes filles, épuisées de fatigue et d'émotion, sentaient qu'elles ne pouvaient aller plus loin.
Soudain une nombreuse troupe de cavaliers, à la tête desquels se trouvaient don Mariano, Balle-Franche et Ruperto, déboucha au galop de la forêt et accourut vers eux.
—Ah! s'écria don Leo avec une joie délirante, je l'ai donc sauvée enfin!
Les jeunes filles montèrent sur des chevaux préparés à l'avance pour elles et furent placées au centre du détachement.
—Ma fille! Ma fille chérie! répétait don Mariano en la couvrant de baisers.
L'aventurier respecta quelques instants les doux épanchements de ce père et de cette fille qui depuis si longtemps étaient séparés et n'espéraient plus se revoir. Deux larmes brûlantes qu'il ne put retenir roulèrent sur ses joues brunies, et devant un bonheur si complet il oublia une minute que désormais une barrière infranchissable était élevée entre celle qu'il aimait et lui; mais bientôt, reprenant ses esprits et comprenant la nécessité de se hâter:
—En route! En route! commanda-t-il; ne nous laissons pas surprendre.
Soudain un éclair sinistre traversa l'horizon; un sifflement aigu se fit entendre, et une balle vint s'aplatir sur la tête d'un gambucino, à deux pas de don Leo. Puis un hurlement horrible, le cri de guerre des Apaches, éclata avec fureur.
—En retraite! En retraite! s'écria Bon-Affût, voilà les peaux-rouges!
Les gambucinos, enfonçant les éperons dans les flancs de leurs chevaux, partirent avec une rapidité vertigineuse.
[1] Le grand dieu inconnu.
Bon-Affût ne s'était pas trompé: c'étaient effectivement les peaux-rouges, guidés par Addick et don Estevan d'une part et par Atoyac de l'autre, qui poursuivaient les gambucinos.
Nous expliquerons en quelques mots au lecteur, cette apparente alliance entre Addick et Atoyac. Dans le précédent chapitre, nous avons dit que Bon-Affût avait surpris l'amantzin écoutant à la porte. Bien que le grand-prêtre ne comprit pas un mot d'espagnol et par conséquent ne pût rien entendre à la conversation, cependant il avait remarqué une certaine animation dans le discours qui lui avait paru suspecte; pourtant, n'osant pas s'opposer ouvertement à la cérémonie de la grande médecine qui devait avoir lieu dans la soirée même, il fit part de ses soupçons à Atoyac. Celui-ci, déjà mal disposé envers les deux hommes, feignit cependant d'être étonné de la subite méfiance de l'amantzin et la traita de vision. Mais, à la fin, comme le vieillard insistait et qu'il paraissait fortement persuadé qu'il y avait quelque machination cachée sous les jongleries des soi-disant médecins, Atoyac finit par se rendre aux raisons de son ami, il consentit à surveiller ce qui se passerait sur le monticule, et à se tenir prêt à voler au secours de l'amantzin, si celui-ci était dupe d'une fourberie.
Ceci bien convenu entre les deux hommes, aussitôt après que le cortège des captifs eut quitté Quiepaa-Tani, Atoyac s'était mis sur ses traces avec une troupe de guerriers d'élite composée de ses parents et de ses amis; puis, arrivé au pied de l'éminence, il l'avait gravie en partie en se glissant dans les hautes herbes, et s'était mis en devoir d'écouter et d'observer ce qui se passait.
En entendant les prières des cinq hommes, le chef fut sur le point de regretter d'être venu. Bientôt le bruit des voix cessa de se faire entendre. Atoyac supposa que des prières à voix basse avaient succédé aux premières, et attendit. Cependant ce silence se prolongeant, Atoyac se décida à gravir jusqu'au sommet de l'éminence; il demeura tout interdit en n'apercevant que l'amantzin et les sentinelles étendues sur le sol. Dans le premier moment, il les crut morts et appela à lui ses compagnons, qui étaient demeurés en bas du tertre. Ceux-ci accoururent en toute hâte et s'élancèrent vers les dormeurs qu'ils secouèrent avec force sans parvenir à les éveiller. Atoyac devina alors une partie de la vérité; les cris de l'épervier d'eau qu'il avait entendu lui revinrent en mémoire, ne doutant pas que les fugitifs ne se fussent dirigés du côté de la forêt, ils se précipitèrent dans cette direction en hurlant.
Atoyac fut le premier qui aperçut les fuyards, et ce fut lui qui tira le coup de feu dont la balle avait tué un gambucino. Mais la position des blancs devenait critique; car, en arrivant sur la lisière de la forêt, ils se virent subitement arrêtés par la troupe d'Addick et d'Estevan qui les chargèrent avec fureur. Les jeunes filles étaient au milieu des gambucinos, protégées par don Mariano et Balle-Franche; elles se trouvaient relativement en sûreté.
Pendant que Bon-Affût et Ruperto faisaient volte-face pour repousser les attaques des guerriers d'Atoyac et soutenir la retraite, don Leo, s'armant d'un casse-tête que la main d'un Apache blessé venait de laisser échapper, se précipita au plus épais de la mêlée en bondissant comme un tigre aux abois. Les combattants, trop serrés les uns contre les autres pour faire usage de leurs armes à feu, s'égorgeaient à coup de couteau et de lance, ou bien s'assommaient avec les casse-têtes et les crosses des rifles et des fusils.
Cet affreux carnage dura près de vingt minutes, animé par les hurlements sauvages des Indiens et les cris non moins atroces des gambucinos. Enfin, par un effort désespéré, don Leo parvint à rompre la digue humaine qui s'opposait à son passage, et se précipita, suivi de ses compagnons, par la large et sanglante trouée qu'il avait ouverte, au prix de la mort de dix de ses plus déterminés compagnons. Laissant à Bon-Affût le soin de s'opposer aux derniers efforts des peaux-rouges, don Leo rallia son monde autour de lui, et toute la troupe s'élança dans les profondeurs de la forêt, où elle disparut bientôt.
Au lever du soleil, les aventuriers arrivèrent à la grotte qui devait primitivement servir de refuge à Ruperto. Don Leo donna l'ordre de s'arrêter.
Il était temps, les chevaux, haletants de fatigue, ne se soutenaient plus qu'avec peine; d'ailleurs, quelque diligence que fissent les Apaches, les aventuriers avaient sur eux toute une nuit d'avance: ils pouvaient donc prendre quelques heures d'un repos indispensable.
Bon-Affût, qui arriva bientôt avec l'arrière-garde, confirma les prévisions de don Leo. Les peaux-rouges avaient, au dire de Bon-Affût, subitement tourné bride dans la direction de la ville.
Cette nouvelle redoubla la sécurité des aventuriers.
Pendant que les gambucinos, diversement groupés, préparaient le repas ou pansaient leurs blessures, et que les jeunes filles, retirées dans la grotte, dormaient sur un amas de feuilles et de zarapés, don Leo et les deux Canadiens se baignèrent, afin d'effacer les traces de leurs peintures indiennes; puis, après avoir repris leurs vêtements, ils allèrent chercher quelques instants de repos.
Seul, don Leo entra dans la grotte. L'Églantine, assise aux pieds des jeunes filles endormies, les berçait doucement avec le refrain plaintif d'une chanson indienne. Don Mariano dormait non loin de sa fille. Le jeune homme remercia par un doux sourire la femme du chef, s'étendit en travers de l'entrée de la grotte, et s'endormit, lui aussi, après s'être assuré que des sentinelles veillaient à la sûreté commune.
Les premières paroles des jeunes filles, en s'éveillant, furent pour remercier leurs libérateurs. Don Mariano ne se lassait pas de caresser sa fille, qui lui était enfin rendue; le vieillard ne savait comment exprimer sa reconnaissance à don Leo. Doña Laura, avec toute la naïve franchise d'un jeune cœur auquel les détours sont inconnus, ne trouvait pas d'expressions assez fortes pour exprimer à don Leo le bonheur dont son âme débordait; seule doña Luisa demeurait sombre et pensive. En voyant avec quel laisser-aller et quel dévouement don Leo, sans autre intérêt que celui de les servir, avait si souvent risqué sa vie pour elles, la jeune fille avait deviné la grandeur et la noblesse du caractère de l'aventurier; alors l'amour était entré dans son cœur, amour d'autant plus violent que celui qui en était l'objet semblait ne pas s'en apercevoir.
L'amour rend perspicace: doña Luisa comprit bientôt pourquoi son amie lui vantait continuellement les qualités généreuses du jeune homme, elle devina la passion secrète qu'ils nourrissaient l'un pour l'autre. Une douleur cruelle la mordit au cœur à cette découverte; en vain elle se débattit contre l'horrible torture d'une jalousie effrénée car elle sentait que jamais don Leo ne l'aimerait. Cependant, malgré elle, la pauvre enfant se laissait aller sans espoir au charme de voir et d'entendre celui pour lequel elle aurait sacrifié sa vie avec bonheur. Quant à don Leo il ne voyait rien, n'entendait rien: il était ivre de joie et savourait avec délices la voluptueuse félicité dont l'inondait la présence de doña Laura, assise, belle et nonchalante, entre lui et son père.
Heureusement que Bon-Affût n'était pas amoureux, lui, et qu'il voyait nettement les dangers de la position. Il convoqua un conseil composé de lui d'abord, de don Leo, de Ruperto, de don Mariano et de Balle-Franche, dans lequel il fut résolu qu'on se dirigerait en toute hâte vers la plus prochaine frontière mexicaine, afin de mettre le plus tôt possible les jeunes femmes à l'abri de tout danger et d'échapper, si cela était possible, à un retour agressif des Indiens. Surtout il fallait se hâter, parce que, par une coïncidence malheureuse, on se trouvait à l'époque de l'année nommé par les peaux-rouges lune du Mexique, et qu'ils ont choisie pour leur déprédations périodiques sur les frontières de ce misérable pays. Bon-Affût se fit fort d'atteindre les défrichements en moins de quatre jours par des chemins, croyait-il, connus de lui seul.
On partit.
Les aventuriers ne furent pas inquiétés dans leur fuite rapide; et, ainsi que Bon-Affût l'avait annoncé dans l'après-midi du quatrième jour la cuadrilla traversait à gué le Río Gila et entrait dans la Sonora. Cependant, au fur et à mesure qu'ils avançaient sur le territoire mexicain, le front du chasseur se rembrunissait, ses sourcils se fronçaient avec inquiétude, et les regards qu'il portait de tous les côtés dénotaient une profonde préoccupation. C'est que ces parages, dont l'apparence devait dans cette saison être si luxuriante, avaient un aspect étrange et désolé qui faisait froid au cœur. Les terres bouleversées et foulées aux pieds des chevaux, les débris de jacales charbonnés, épars çà et là, les cendres amoncelées aux endroits où auraient dû s'élever d'énormes meules de grains, attestaient que la guerre avait passé par là avec toutes les horreurs qu'elle entraîne à sa suite.
Cependant, à deux lieux à l'horizon, on voyait blanchir les maisons d'un pueblo fortifié, ancien présidio, qui étincelaient aux derniers rayons du soleil. Tout était calme aux environs; mais ce calme était celui de la mort. Aucun être humain ne se montrait; aucune manada ne paraissait dans les prairies dévastées; les recuas de mules et les grelots de la nena ne se laissaient ni voir ni entendre; partout un silence de plomb, une tranquillité lugubre pesaient sur ce paysage et lui donnaient, aux gais rayons du soleil, un aspect navrant.
Tout à coup Balle-Franche, qui marchait un peu en avant de la troupe, ramena son cheval d'un écart qui avait failli le désarçonner et se pencha de côté avec Un cri de surprise. Don Leo et Bon-Affût accoururent avec empressement.
Un spectacle hideux s'offrit alors à la vue des trois hommes. Au fond d'une douve qui bordait la route, un monceau de cadavres espagnols gisaient pêle-mêle, horriblement défigurés et privés de leur chevelure.
Don Leo ordonna de faire halte, ne sachant s'il devait avancer ou reculer. Il était permis d'hésiter dans une semblable occurrence. Pousser jusqu'au présidio, peut-être était-il désert, peut-être même les peaux-rouges s'en étaient-ils rendus maîtres. Cependant une détermination, quelle qu'elle fût, devait être prise sur l'heure. Don Leo à force d'interroger l'horizon, aperçut à environ deux lieues, sur la droite, une hacienda en ruines. Bien que précaire, il valait mieux se réfugier dans cet abri que de camper en plaine. Les aventuriers piquèrent des deux, vingt minutes plus tard, ils arrivèrent à la ferme.
L'hacienda portait les traces du feu et de la dévastation; les murs lézardés étaient noircis par la fumée, les fenêtres et les portes brisées, au milieu des décombres, plusieurs cadavres d'hommes et de femmes à demi consumés étaient entassés çà et là dans les patios. Don Leo conduisit les jeunes filles toutes tremblantes dans une chambre que l'on débarrassa des débris qui en obstruaient l'entrée; puis, après leur avoir recommandé de ne pas en sortir, il rejoignit ses compagnons, qui, sous la direction de Balle-Franche, s'installaient tant bien que mal dans l'hacienda. Bon-Affût était parti à la découverte avec Ruperto. Don Mariano, excité par l'amour paternel, s'était improvisé ingénieur; aidé par une dizaine d'aventuriers, il s'occupait à fortifier la maison du mieux qu'il lui était possible.
Comme toutes les haciendas mexicaines de la frontière, celle-ci était entourée d'une haute muraille crénelée. Don Leo fit boucher la porte; puis, rentrant dans la maison, il ordonna de relever les portes et les fenêtres, fit percer des meurtrières et placer des sentinelles auprès de l'enceinte et sur l'azotea—toit. Donnant ensuite à Balle-Franche le commandement de douze hommes résolus, il lui ordonna de s'aller embusquer avec cette troupe derrière un mamelon couvert de bois qui s'élevait à deux cents mètres à peu près de l'hacienda. Il fit ensuite le dénombrement de sa troupe: en comptant les domestiques de don Mariano et le gentilhomme lui-même, il n'avait auprès de lui que vingt et un hommes; mais ces hommes étaient des aventuriers, déterminés à se faire tuer jusqu'au dernier plutôt que de se rendre. Don Leo ne perdit pas tout espoir. Enfin, toutes ces précautions prises, il attendit. Ruperto arriva bientôt; son rapport n'était pas rassurant.
Les peaux-rouges s'étaient emparés du présidio par surprise; le bourg avait été livré au pillage, puis abandonné; il était complètement désert. De nombreux partis d'Apaches battaient la campagne dans toutes les directions; il paraissait évident que les aventuriers ne pourraient faire une lieue hors de l'hacienda sans tomber dans une embuscade.
Bon-Affût arriva enfin; le chasseur ramenait avec lui une quarantaine de soldats et de paysans mexicains qui depuis deux jours erraient à l'aventure, au risque d'être surpris à chaque instant par les peaux-rouges qui massacraient sans pitié tous les blancs qui tombaient entre leurs mains. Don Leo reçut ce secours imprévu avec joie; un renfort de quarante hommes n'étaient pas à dédaigner, d'autant plus que ces individus étaient armés et par conséquent en état de lui rendre de grands services. Bon-Affût, en bon fourrier, amenait aussi avec lui plusieurs mules chargées de vivres. Le digne Canadien songeait à tout, rien ne lui échappait. Lorsque les hommes eurent été distribués aux endroits les plus exposés aux surprises, don Leo et Bon-Affût montèrent sur l'azotea afin d'examiner les environs.
Rien n'était changé: la campagne était toujours déserte. Ce calme était de mauvaise augure. Le soleil se coucha dans un flot de vapeurs rougeâtres, la lumière décrut subitement et la nuit arriva avec ses ténèbres et ses mystères.
Don Leo, laissant le Canadien seul, descendit dans la chambre qui servait de refuge aux trois femmes. Les jeunes filles étaient assises et gardaient le silence.
L'Églantine s'avança vers lui.
—Que veut ma sœur? demanda le jeune homme.
—L'Églantine veut partir, répondit-elle de sa voix douce.
—Comment! Partir! se récria-t-il avec étonnement; c'est impossible; la nuit est sombre; ma sœur courrait trop de danger seule dans la campagne; les callis de sa tribu sont bien loin dans la prairie.
L'Églantine fit sa petite moue habituelle en secouant la tête.
—L'Églantine veut partir, reprit-elle avec impatience; mon frère lui fera donner un cheval; il faut qu'elle rejoigne l'Aigle-Volant.
—Hélas! Ma pauvre enfant, l'Aigle-Volant est bien loin en ce moment, j'en ai la crainte; vous ne le retrouverez pas.
La jeune femme releva vivement la tête:
—L'Aigle-Volant n'abandonne pas ses amis, dit-elle; c'est un grand chef; l'Églantine est fière d'être sa femme. Que mon frère la laisse sortir; l'Églantine à dans le cœur un petit oiseau qui chante doucement et qui lui dit où est le sachem.
Don Leo était en proie à une vive perplexité; il ne pouvait se décider à consentir à ce que lui demandait l'Indienne; il lui répugnait d'abandonner ainsi cette jeune femme qui leur avait donné tant de preuves de dévouement depuis qu'elle était parmi eux. En ce moment il se sentit frapper sur l'épaule; il se retourna: c'était Bon-Affût qui venait le rejoindre.
—Laissez-la faire, dit-il; elle sait mieux que nous pourquoi elle agit ainsi; les peaux-rouges ne font jamais rien qu'avec connaissance de cause. Venez, chère enfant, je vais vous accompagner jusqu'à la porte et vous faire donner un cheval.
—Allez donc, répondit don Leo; mais souvenez-vous que c'est contre mon désir que vous nous avez quittés.
L'Indienne sourit, embrassa les deux jeunes filles en leur disant ce seul mot:
—Courage!
Puis elle suivit Bon-Affût.
—Pauvre chère créature! murmura don Leo. Elle va chercher à nous être utile encore, j'en suis convaincu. Se tournant alors vers les jeunes femmes:
—Niñas, leur dit-il, reprenez courage; nous sommes nombreux; demain, au lever du soleil, nous repartirons sans craindre d'être inquiétés par les maraudeurs indiens.
—Don Miguel, répondit doña Laura en souriant avec tristesse, vous essaierez en vain de nous rassurer; nous avons entendu ce que vos hommes disaient entre eux; ils s'attendent à une attaque.
—Pourquoi ne pas être franc avec nous, don Miguel? ajouta doña Luisa. Mieux vaut nous avouer clairement dans quelle position nous sommes et à quoi nous sommes exposées.
—Mon Dieu! Le sais-je moi-même? reprit-il; j'ai pris toutes les précautions nécessaires pour défendre l'hacienda jusqu'à la dernière extrémité; mais j'espère que notre piste ne sera pas découverte.
—Vous nous trompez encore, don Miguel, dit Laura avec un ton de reproche si doux qu'il alla au cœur du jeune homme.
—D'ailleurs, continua l'aventurier, sans vouloir répondre à l'interruption de celle qu'il aimait, soyez certaines, señoritas, qu'en cas d'attaque nous mourrons tous, mes compagnons et moi, avant qu'un Apache puisse franchir le seuil de cette porte.
—Les Apaches, s'écrièrent les jeunes filles, dont le souvenir de leur captivité était encore palpitant dans leur mémoire et qui tremblaient à la seule pensée de retomber entre leurs mains.
Cependant ce mouvement d'effroi n'eut que la durée d'un éclair; la physionomie de Laura reprit aussitôt l'expression angélique qui lui était habituelle, et ce fut en donnant à sa voix l'intonation la plus douce qu'elle dit à don Leo:
—Nous avons foi en vous; nous savons que, pour nous sauver, vous ferez tout ce qui est humainement possible; nous vous remercions de votre dévouement; notre sort est entre les mains de Dieu, nous avons confiance en lui. Agissez en homme, don Miguel, ne vous inquiétez pas de nous davantage; seulement, je vous en prie, veillez sur mon père.
—Oui, ajouta doña Luisa, faites bravement votre devoir; de notre côté, nous ferons le nôtre.
Don Leo la regarda sans comprendre. Elle sourit en rougissant, mais sans parler davantage.
Le jeune homme semblait vouloir dire quelques mots; mais après un moment d'hésitation, il salua respectueusement les jeunes filles et se retira.
Laura et Luisa se jetèrent alors dans les bras l'une de l'autre et s'embrassèrent avec effusion.
Lorsque don Leo entra dans le patio, Bon-Affût s'avança vers lui, et lui montrant du doigt plusieurs rangées de points noirs qui semblaient ramper dans la direction de l'hacienda:
—Regardez, lui dit-il sèchement.
—Ce sont les peaux-rouges! s'écria don Leo.
—Il y a dix minutes que je les vois, reprit le chasseur; mais nous avons encore le temps de nous préparer à les recevoir; ils ne seront pas ici avant une heure.
En effet, une heure environ se passa dans une horrible anxiété.
Soudain la tête hideuse d'un Apache parut au-dessus de la porte et jeta un regard féroce dans le patio.
—On ne se fait pas une idée comme ces Indiens sont effrontés, dit Bon-Affût en ricanant; et levant sa hache, le corps de l'Apache retomba au dehors, tandis que sa tête roulait en grinçant des dents jusqu'aux pieds de don Leo.
Plusieurs tentatives du même genre opérées sur divers points de l'enceinte furent repoussées avec un égal succès. Alors les Apaches, qui se flattaient de surprendre les blancs endormis, se voyant au contraire si mal reçus, poussèrent leur cri de guerre, et, se levant en tumulte du sol sur lequel ils avaient rampé jusqu'alors, ils se précipitèrent en bondissant contre le mur qu'ils cherchèrent à escalader de tous les côtés à la fois.
Une ceinture de flamme ceignit alors l'hacienda, et une grêle de balle les atteignit. Beaucoup tombèrent, sans que l'élan des assaillants fût ralenti. Une nouvelle décharge faite à bout portant fut impuissante à les repousser, bien qu'elle leur causa des pertes énormes. Bientôt les assaillants et les assaillis luttèrent corps à corps. Ce fut une mêlée atroce, un carnage horrible, où l'on ne lâchait prise que pour mourir, où le vaincu, entraînant souvent le vainqueur dans sa chute, l'étranglait dans une dernière convulsion. Pendant plus d'une demi-heure il fut impossible de se reconnaître; les coups de feu, les coups de lances, les flèches et les coups de machettes se froissaient et s'entrechoquaient avec une rapidité qui tenait du prodige. Enfin les Apaches reculèrent. Le mur n'avait pas été franchi. Mais la trêve fut courte. Les peaux-rouges revinrent presque immédiatement à la charge, et la lutte recommença avec un nouvel acharnement. Cette fois, malgré des prodiges de valeur inouïs, les aventuriers, débordés par la masse d'ennemis qui les assaillaient de toutes parts, furent contraints de se replier vers la maison en défendant le terrain pas à pas; mais maintenant la résistance ne pouvait pas être longue.
Tout à coup des cris se firent entendre sur les derrières des Indiens, et Balle-Franche roula sur eux comme une avalanche à la tête de sa troupe. Les peaux-rouges, surpris et épouvantés par cette attaque imprévue, se replièrent en désordre et se dispersèrent dans la campagne. Don Leo s'élança alors à la tête d'une vingtaine d'hommes pour soutenir son embuscade et achever la défaite des ennemis. Les aventuriers poursuivirent les Indiens qu'ils massacrèrent avec fureur. Tout à coup don Leo poussa un cri de surprise et de rage.
Pendant qu'il se laissait entraîner à la poursuite des Apaches, d'autres Indiens, surgissant subitement dans l'espace laissé libre, s'étaient élancés dans l'hacienda. Les gambucinos tournèrent bride et retournèrent sur leurs pas de toute la rapidité de leurs chevaux. Il était trop tard! L'hacienda était envahie.
Le combat devint alors un carnage horrible, une boucherie sans nom. Au milieu des Apaches, Atoyac, Addick et don Estevan semblaient se multiplier, tant leurs coups étaient pressés et leur fureur au comble. Sur la marche la plus élevée du perron conduisant dans l'intérieur de la maison, don Mariano et quelques gambucinos qu'il avait ralliés luttaient en désespérés contre les attaques répétées d'une foule d'Indiens. Soudain un voile sanglant s'étendit devant les yeux du jeune homme, une sueur froide inonda son visage: les Apaches avaient forcé l'entrée, ils inondaient la maison.
—En avant! En avant! hurla don Leo en se jetant à corps perdu dans la mêlée.
—En avant! répétèrent Balle-Franche et Bon-Affût.
En ce moment, les deux jeunes femmes parurent aux fenêtres poursuivies de près par des peaux-rouges, qui les saisirent dans leurs bras et les enlevèrent malgré leurs cris de désespoir et leur résistance. Tout était perdu!
Mais à cet instant suprême, le cri de guerre des Comanches vibra dans l'espace, et une nuée de guerriers, en avant desquels galopait l'Aigle-Volant, tomba comme la foudre sur les Apaches qui se croyaient vainqueurs. Cernés de tout les côtés à la fois, après une résistance héroïque, ceux-ci furent enfin forcés de plier et de chercher leur salut dans la fuite.
Les aventuriers étaient sauvés à l'instant où ils croyaient n'avoir plus qu'à se faire tuer pour ne pas tomber vivants entre les mains de leurs féroces ennemis.
Deux heures plus tard, le soleil éclairait à son lever une scène touchante dans cette hacienda qui venait d'être le théâtre d'une bataille aussi acharnée.
Les aventuriers et les guerriers comanches, arrivés si heureusement pour eux, s'étaient empressés de faire disparaître autant que possible les traces du combat. Dans un angle retiré du patio les cadavres de ceux qui avaient succombé dans la lutte étaient amoncelés et recouverts tant bien que mal avec de la paille; des sentinelles comanches gardaient une vingtaine de prisonniers apaches, et les aventuriers s'occupaient, les uns à panser leurs blessures, les autres à ouvrir de larges tranchées pour enterrer les morts.
Sous le zaguán de l'habitation, sur des bottes de paille recouvertes de zarapés, deux hommes et une femme étaient étendus. La femme était morte, c'était doña Luisa. La pauvre enfant, dont toute la vie n'avait été qu'une longue abnégation et un continuel dévouement, s'était bravement fait tuer par don Estevan, au moment où elle-même brûlait la cervelle à Addick, qui enlevait doña Laura.
Les deux hommes étaient don Mariano et Balle-Franche.
Don Leo et Laura se tenaient chacun d'un côté du vieillard, épiant avec inquiétude l'instant où il rouvrirait les yeux.
Bon-Affût, triste et le front pâle, était penché sur son vieux camarade qui allait mourir.
—Courage, lui disait-il, courage, frère, ce n'est rien!
Le Canadien essaya de sourire.
—Hum! Je sais ce qui en est, répondit-il d'une voix entrecoupée; j'en ai encore pour dix minutes au plus, et puis après, dam!
Il se tut un instant et sembla réfléchir.
—Dites moi, Bon-Affût, reprit-il, croyez-vous que Dieu me pardonnera?
—Oui, mon digne ami, car vous étiez une vaillante et bonne créature!
—J'ai toujours agi selon mon cœur. Enfin, on dit que la miséricorde de Dieu est infinie; j'espère en lui.
—Espérez, mon ami, espérez!
—C'est égal, je savais bien que les Indiens ne me tueraient jamais; vous le voyez, c'est ce don Estevan qui m'a blessé; mais je lui ai fendu le crâne à cet assassin de jeunes filles! Misérable! J'aurais dû le laisser mourir dans sa fosse! Comme un loup pris au piège.
Sa voix s'affaiblissait de plus en plus, son regard devenait vitreux, la vie se retirait à grands pas.
—Pardonnez-lui; maintenant il est mort, il ne pourra plus nuire.
—Dieu soit loué! J'ai enfin écrasé la vipère! Adieu, Bon-Affût, mon vieux camarade! Nous ne chasserons plus les daims et les bisons ensemble dans la prairie; nous ne pousserons plus notre cri de guerre contre les Apaches... où est l'Aigle-Volant?
—Il est à la poursuite des peaux-rouges.
—Oh! C'est un brave cœur; il était bien jeune quand je l'ai connu, c'était en 1845; je me rappelle que je revenais de...
Il s'arrêta. Bon-Affût, qui s'était penché le plus près possible de lui, afin d'entendre les paroles qu'il prononçait d'une voix de plus en plus faible, le regarda. Il était mort.
Le digne chasseur avait rendu son âme à Dieu, sans éprouver les cruelles angoisses de la mort. Son ami lui ferma pieusement les yeux, s'agenouilla près de lui, et, inclinant son front pâle. Il pria avec ferveur pour son vieux compagnon.
Cependant don Mariano était toujours dans le même état d'insensibilité apparente. Les deux gens lui tenaient chacun une main et interrogeaient son pouls avec inquiétude. Les deux vieux domestiques du gentilhomme pleuraient silencieusement réfugiés dans un angle de la pièce.
Tout à coup don Mariano poussa un profond soupir, une vive rougeur colora son visage, ses yeux s'ouvrirent, pendant quelques secondes il sembla chercher à rappeler ses idées troublées par les approches de l'agonie. Enfin il fit un effort suprême, se dressa à demi sur sa couche, et regardant tour à tour, avec une expression de bonté ineffable, les deux jeunes gens qui étaient tombés agenouillés, il ramena leurs mains vers lui et les réunit sur son cœur.
—Don Leo, dit-il d'une voix forte, veillez sur elle! Laura, tu l'aimes, sois heureuse! Mes enfants, je vous bénis! Mon Dieu! Pardonnez dans votre miséricorde au malheureux, cause de tous nos malheurs! Seigneur, recevez-moi dans votre sein! Mes enfants, mes enfants, au revoir!
Son corps fut soudain agité d'un tremblement convulsif, ses traits se contractèrent, et il retomba en arrière en exhalant un soupir suprême.
Il était mort!
Après avoir rendu les derniers devoirs à son vieux camarade, Bon-Affût suivit l'Aigle-Volant et ses guerriers. Depuis, on n'entendit plus parler de lui; la mort de Balle-Franche avait brisé en cet homme si fort toute énergie et toute volonté; peut-être traîne-t-il encore les restes de sa misérable existence au milieu des Indiens, parmi lesquels il s'était résolu à vivre.
Les recherches minutieuses faites plus tard par don Leo de Torres, après son mariage avec doña Laura de Real del Monte demeurèrent toutes sans résultat; le jeune homme dut, à son grand regret, renoncer à s'acquitter jamais envers cet homme au cœur si simple et si grand à la fois, auquel il devait tant de reconnaissance.
| I. | La surprise. | |
| II. | L'hôte. | |
| III. | Colloque dans la nuit. | |
| IV. | Indiens et chasseurs. | |
| V. | Explications mutuelles. | |
| VI. | Une ténébreuse histoire. | |
| VII. | Une ténébreuse histoire. (Suite) | |
| VIII. | Une ténébreuse histoire. (Fin) | |
| IX. | Balle-Franche et Bon-Affût. | |
| X. | Nouveaux personnages. | |
| XI. | Le gué del Rubio. | |
| XII. | Don Stefano Cohecho. | |
| XIII. | L'embuscade. | |
| XIV. | Les voyageurs. | |
| XV. | Retour à la vie. | |
| XVI. | Recherche de la vérité. | |
| XVII. | Don Mariano. | |
| XVIII. | Avant le jugement. | |
| XIX. | Face à face. | |
| XX. | Le jugement. | |
| XXI. | Balle-Franche. | |
| XXII. | Le camp. | |
| XXIII. | L'Aigle-Volant. | |
| XXIV. | Quiepaa-Tani. | |
| XXV. | Un trio de coquins. | |
| XXVI. | Une chasse dans la prairie. | |
| XXVII. | Une chasse dans la prairie. (Suite) | |
| XXVIII. | Peaux-Blanches et peaux-rouges. | |
| XXIX. | Le conseil. | |
| XXX. | Le deuxième détachement. | |
| XXXI. | Le tlacateotzin. | |
| XXXII. | Premiers pas à travers la ville. | |
| XXXIII. | Explications. | |
| XXXIV. | Conversation. | |
| XXXV. | L'entrevue. | |
| XXXVI. | Une rencontre. | |
| XXXVII. | Complications. | |
| XXXVIII. | Une reconnaissance de nuit. | |
| XXXIX. | La grande médecine. | |
| XL. | Le dernier coup de boutoir. | |
| Épilogue. |