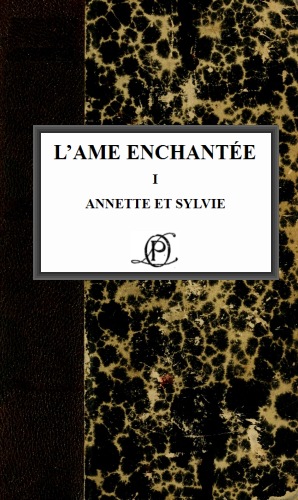
The Project Gutenberg EBook of L'âme enchantée v.1, by Romain Rolland
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
Title: L'âme enchantée v.1
Annette et Sylvie
Author: Romain Rolland
Release Date: June 14, 2014 [EBook #45970]
Language: French
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK L'ÂME ENCHANTÉE V.1 ***
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images available at The Internet Archive)
L’AME ENCHANTÉE
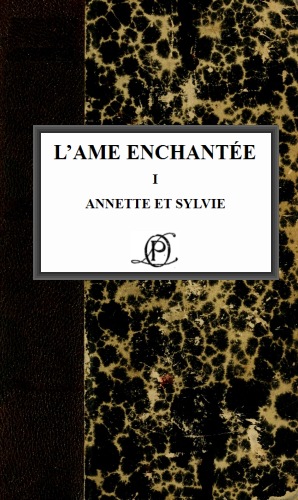
DU MÊME AUTEUR
LIBRAIRIE OLLENDORFF
JEAN-CHRISTOPHE, 10 vol. in-16
Jean-Christophe, 4 vol.: I. L’Aube, 1 vol.—II. Le Matin, 1 vol.—III. L’Adolescent, 1 vol.—IV. La Révolte, 1 vol.
Jean-Christophe à Paris, 3 vol.: I. La Foire sur la Place, 1 vol.—II. Antoinette, 1 vol.—III. Dans la Maison, 1 vol.
La Fin du Voyage, 3 vol.: I. Les Amies, 1 vol.—II. Le Buisson ardent, 1 vol.—III. La Nouvelle Journée, 1 vol.
JEAN-CHRISTOPHE en 4 vol. in-8º
Edition définitive sur beau papier vélin et Hollande.
Colas Breugnon, 1 vol.
Clerambault, 1 vol.
Liluli, 1 vol, illustrations de Frans MASEREEL.
Pierre et Luce, illustrations de Gabriel BELOT.
Au-dessus de la mêlée, 1 vol.
Aux peuples assassinés, 1 vol.
Le temps viendra, 3 actes, 1 vol.
Théâtre de la Révolution (Le 14 Juillet, Danton, Les Loups), 1 vol.
Les Tragédies de la Foi (Saint-Louis, Aërt, Le Triomphe de la Raison). 1 vol.
Le Théâtre du Peuple (Essai d’esthétique d’un théâtre nouveau), 1 vol.
Pages Choisies de R. Rolland, avec des notices par Marcel MARTINET, 2 vol. in-8º.
Romain Rolland.—L’Homme et l’Œuvre, par P. SEIPPEL, 1 vol. in-16.
Romain Rolland vivant, par P. J. JOUVE, 1 vol. in-8º.
LIBRAIRIE HACHETTE
Musiciens d’autrefois. 1 vol.
Musiciens d’aujourd’hui. 1 vol.
Voyage musical au Pays du Passé. 1 vol.
Vies des Hommes illustres 3 vol. in-16. I. Vie de Beethoven, 1 vol.—II. Vie de Michel-Ange, 1 vol.—III. Vie de Tolstoï. 1 vol.
LIBRAIRIE FONTEMOING
Histoire de l’Opéra en Europe avant Lully et Scarlatti. 1 vol. in-8º épuisé.
| LIBRAIRIE ALCAN Hændel, 1 vol. in-8º écu. |
LIBRAIRIE PLON Michel-Ange, 1 vol. in-8º |
| LIBRAIRIE DE L’HUMANITÉ Les Précurseurs, 1 vol. in. 16. |
Éditions Lumière à Anvers. Les Vaincus, 4 actes, 1 vol. |
Tout droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays, y compris la Suède, la Norvège, la Hollande, le Danemark et la Russie.
ROMAIN ROLLAND

=====PARIS=====
Société d’Éditions Littéraires et Artistiques
LIBRAIRIE OLLENDORFF
=====50, CHAUSSÉE D’ANTIN, 50=====
Tous droits réservés.
DE CETTE ÉDITION, IL A ÉTÉ TIRÉ:
SEIZE CENT CINQUANTE EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS
SUR PAPIER VELIN ALFA
———
RÉIMPOSÉE IN-16 58 × 80
SOIXANTE EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE
NUMÉROTÉS A LA PRESSE DE 1 A 60
ET
VINGT EXEMPLAIRES HORS COMMERCE
MARQUÉS A A T
Annette et Sylvie est le prélude à une œuvre en plusieurs volumes, qui porte le titre: L’Ame enchantée.
Au seuil d’un voyage nouveau qui, sans être aussi long que celui de Jean-Christophe, comptera plus d’une étape, je rappelle aux lecteurs la prière amicale que je leur adressais, à un tournant de l’histoire de mon musicien. En tête de La Révolte, je les avertissais de considérer chaque volume comme un chapitre d’une œuvre en mouvement, dont la pensée se déroule au cours de la vie représentée. Citant le vieux dicton: La fin loue la vie, et le soir le jour, j’ajoutais: Lorsque nous serons au terme, vous jugerez de ce que valait notre effort.
Certes, j’entends que chaque volume ait son caractère propre, qu’il puisse être jugé à part, comme œuvre d’art. Mais il serait prématuré de juger, d’après lui, de la pensée générale. Quand j’écris un roman, je fais choix d’un être avec qui je me sens des affinités;—(ou plutôt, c’est lui qui me choisit).—Cet être une fois élu, je le laisse libre, je n’ai garde d’y mêler ma personnalité. C’est une charge pesante qu’une personnalité qu’on porte depuis plus d’un demi-siècle. Le divin bienfait de l’art est de nous en délivrer, en nous donnant d’autres âmes à boire, d’autres existences à revêtir—(nos amis de l’Inde diraient: «d’autres de nos existences»: car tout est en chacun..)
Quand j’ai donc adopté Jean-Christophe, ou Colas, ou Annette Rivière, je ne suis plus que le secrétaire de leurs pensées. Je les écoute, je les vois agir, et je vois par leurs yeux. A mesure qu’ils apprennent de leur cœur et des hommes, j’apprends avec eux; quand ils se trompent, je trébuche; quand il se reprennent, je me relève, et nous nous remettons en route. Je ne dis pas que cette route est la meilleure. Mais cette route est la nôtre. Que Christophe, Colas et Annette, aient ou n’aient pas raison, Christophe, Colas et Annette, sont. La vie n’est pas une des moindres raisons.
Ne cherchez point ici de thèse ou de théorie. Voyez-y seulement l’histoire intérieure d’une vie sincère, longue, fertile en joies et en douleurs, non exempte de contradictions, abondante en erreurs, et toujours s’efforçant d’atteindre, à défaut de l’inaccessible Vérité, l’harmonie de l’esprit, qui est notre suprême vérité.
R. R.
Elle était assise près de la fenêtre, tournant le dos au jour, recevant sur son cou et sur sa forte nuque les rayons du soleil couchant. Elle venait de rentrer. Pour la première fois depuis des mois, Annette avait passé la journée dehors, dans la campagne, marchant et s’enivrant de ce soleil de printemps. Soleil grisant, comme un vin pur, que ne trempe aucune ombre des arbres dépouillés, et qu’avive l’air frais de l’hiver qui s’en va. Sa tête bourdonnait, ses artères battaient, et ses yeux étaient pleins des torrents de lumière. Rouge et or, sous ses paupières closes. Or et rouge dans son corps. Immobile, engourdie sur sa chaise, un instant, elle perdit conscience...
Un étang, au milieu des bois, avec une plaque de soleil, comme un œil. Autour, un cercle d’arbres aux troncs fourrés de mousse. Désir de baigner son corps. Elle se trouve dévêtue. La main glacée de l’eau palpe ses pieds et ses genoux. Torpeur de volupté. Dans l’étang rouge et or elle se contemple nue... Un sentiment de gêne, obscure, indéfinissable: comme si d’autres yeux à l’affût la voyaient. Afin d’y échapper, elle entre plus avant dans l’eau, qui monte jusque sous le menton. L’eau sinueuse devient une étreinte vivante; et des lianes grasses s’enroulent à ses jambes. Elle veut se dégager, elle enfonce dans la vase. Tout en haut, sur l’étang, dort la plaque de soleil. Elle donne avec colère un coup de talon au fond, et remonte à la surface. L’eau maintenant est grise, terne, salie. Sur son écaille luisante, mais toujours le soleil... Annette, au bras d’un saule qui pend sur l’étang, s’accroche, pour s’arracher à l’humide souillure. Le rameau feuillu, comme une aile, couvre les épaules et les reins nus. L’ombre de la nuit tombe, et l’air froid sur la nuque....
Elle sort de sa torpeur. Depuis qu’elle y a sombré, quelques secondes à peine se sont écoulées. Le soleil disparaît derrière les coteaux de Saint-Cloud. C’est la fraîcheur du soir.
Annette, dégrisée, se lève, un peu frissonnante, et, fronçant le sourcil de dépit irrité pour l’aberration où elle s’est laissée choir, dans le fond de sa chambre, devant son feu va se rasseoir. Un aimable feu de bois, dont l’office était de distraire les yeux et de tenir compagnie, plus que de réchauffer: car du jardin entrait, par la fenêtre ouverte, avec le souffle mouillé d’un soir de premier printemps, le mélodieux bavardage des oiseaux revenus qui allaient s’endormir. Annette songe. Mais cette fois, elle a les yeux ouverts. Elle a repris pied dans son monde ordinaire. Elle est dans sa maison. Elle est Annette Rivière. Et, penchée vers la flamme qui rougit son jeune visage,—en taquinant du pied sa chatte noire qui tend le ventre aux tisons d’or, elle ranime son deuil, un instant oublié; elle rappelle l’image (de son cœur échappée) de l’être qu’elle a perdu. En grand deuil, au front, aux plis des lèvres, la trace non effacée du passage de la douleur, et le dessous des paupières encore un peu gonflé par les larmes récentes, mais saine, fraîche, baignée de sève comme la nature nouvelle, cette robuste jeune fille, point belle, mais bien faite, aux lourds cheveux châtains, au cou d’un blond hâlé, aux joues, aux yeux de fleur,—cherchant à ramener sur ses regards distraits et ses rondes épaules les voiles dispersés de sa mélancolie,—semble une jeune veuve, qui voit fuir l’ombre aimée.
Veuve, Annette l’était en effet dans son cœur; mais celui dont ses doigts voulaient retenir l’ombre, était son père.
Il y avait six mois déjà qu’elle l’avait perdu. Vers la fin de l’automne, Raoul Rivière, jeune encore, (il n’avait pas atteint tout à fait la cinquantaine), fut enlevé en deux jours par une crise d’urémie. Bien que, depuis plusieurs années, sa santé, dont il abusait, l’obligeât à des ménagements, il ne s’attendait pas à un baisser de rideau aussi brusque. Architecte parisien, ancien pensionnaire de la Villa Romaine, beau garçon, né malin et doué d’une faim peu commune, fêté dans les salons, comblé par le monde officiel, il avait su collectionner, toute sa vie, sans paraître les chercher, les commandes, les honneurs et les bonnes fortunes. Figure bien parisienne, popularisée par la photographie, les dessins des magazines et la caricature,—avec son front bombé, renflé aux tempes, tête baissée, comme un taureau qui fonce, ses yeux au globe saillant, au regard d’audace, ses cheveux blancs touffus, taillés en brosse, sa mouche sous la bouche rieuse et vorace, un air d’esprit, d’insolence, de grâce et d’effronterie. Dans le Tout-Paris des arts et des plaisirs, chacun le connaissait. Et nul ne le connaissait. Homme à double nature, qui savait admirablement s’adapter à la société pour l’exploiter, mais qui savait aussi se tailler à part sa vie cachée. Homme à fortes passions et à vices puissants, qui, tout en les cultivant, se gardait d’en rien montrer qui pût effaroucher les clients,—qui avait son musée secret (fas ac nefas), mais qui ne l’entr’ouvrait qu’à de très rares initiés,—qui se foutait du goût et de la morale publics, tout en y conformant sa vie apparente et ses travaux officiels. Nul ne le connaissait, ni parmi ses amis, ni parmi ses ennemis... Ses ennemis? Il n’en avait point. Des rivaux, tout au plus, à qui il en avait cuit de se mettre sur son chemin; mais ils ne lui en voulaient pas: après les avoir roulés, il avait eu si bien l’art de les enjôler que, comme ces timides sur le pied desquels on marche, ils eussent été près de sourire et de s’excuser. Le rude et matois avait réussi le tour de force de rester en bons termes avec les concurrents qu’il supplantait, et les conquêtes qu’il délaissait.
Il avait été un peu moins heureux en ménage. Sa femme eut le mauvais goût de souffrir de ses infidélités. Quoique, depuis vingt-cinq ans qu’ils étaient mariés, elle aurait eu largement, pensait-il, le temps de s’habituer, jamais elle n’en prit son parti. D’une honnêteté morose, de manières un peu froides comme l’était sa beauté de Lyonnaise, ayant des sentiments forts, mais concentrés, elle n’était aucunement adroite à le retenir; et elle avait encore moins le talent, si pratique, de paraître ignorer ce qu’elle ne pouvait empêcher. Trop digne pour se plaindre, elle ne put cependant se résigner à ne pas lui montrer qu’elle savait et souffrait. Comme il était sensible,—(du moins, il le croyait),—il évitait d’y penser; mais il lui gardait rancune de ne pas savoir mieux voiler son égoïsme. Depuis des années, ils vivaient à peu près séparés; mais, d’un tacite accord, ils le cachaient aux yeux du monde; et même leur fille Annette ne se rendit jamais compte de la situation. Elle n’avait pas cherché à approfondir la mésintelligence de ses parents; ce lui était désagréable. L’adolescence a bien assez de ses propres préoccupations. Tant pis pour celles des autres!...
La suprême habileté de Raoul Rivière fut de mettre sa fille de son parti. Bien entendu, il ne fit rien pour cela: c’est le triomphe de l’art. Pas un mot de reproche, pas une allusion aux torts de madame Rivière. Il était chevaleresque; il laissait à sa fille le soin de les découvrir. Elle n’y avait pas manqué: car elle était, elle aussi, sous le charme de son père. Et le moyen de ne pas donner tort à celle qui, étant sa femme, avait la maladresse de se gâter ce bonheur! Dans cette lutte inégale, la pauvre madame Rivière était vaincue d’avance. Elle acheva sa défaite, en mourant la première. Raoul resta seul maître du terrain,—et du cœur de sa fille. Pendant les cinq dernières années, Annette avait vécu dans l’enveloppement moral de son aimable père, qui la chérissait et, sans penser à mal, lui prodiguait les séductions qui lui étaient naturelles. Il en fut d’autant plus dépensier avec elle qu’il en trouvait moins l’emploi au dehors; car, depuis deux ans, il était retenu davantage au foyer par les annonces de la maladie qui devait l’emporter.
Rien n’avait donc troublé la chaude intimité qui mariait le père et la fille, et remplissait le cœur, mal éveillé, d’Annette. Elle avait de vingt-trois à vingt-quatre ans; mais son cœur paraissait plus jeune que son âge; il n’était pas pressé. Peut-être, comme tous ceux qui ont devant soi un long avenir, et parce qu’elle sentait battre en elle une vie profonde, elle la laissait s’amasser, sans hâte d’en faire le compte.
Elle tenait à la fois des deux parents: du père, pour le dessin des traits et le sourire charmant qui, chez lui, promettait beaucoup plus qu’il ne pensait, et chez elle, restée pure, beaucoup plus qu’elle ne voulait;—de la mère, pour la tranquillité apparente, la mesure des manières, et pour le sérieux moral, malgré l’esprit très libre. Doublement attirante, par la séduction de l’un et la réserve de l’autre. On ne pouvait deviner ce qui dominait en elle des deux tempéraments. Sa vraie nature restait encore inconnue. Des autres, comme d’elle-même. Nul n’avait le soupçon de son univers caché. Telle une Ève au jardin, à demi endormie. Des désirs qui étaient en elle, elle n’avait pas eu à prendre conscience. Rien ne les avait éveillés, car rien ne les avait heurtés. Il semblait qu’elle n’eût qu’à étendre le bras pour les cueillir. Elle n’essayait point, assoupie à leur bourdonnement heureux. Peut-être ne voulait-elle pas essayer... Qui sait jusqu’à quel point on tâche à se duper? On évite de voir en soi ce qui inquiète... Elle préférait ignorer cette mer intérieure. L’Annette qu’on connaissait, l’Annette qui se connaissait, était une petite personne très calme, raisonnable, ordonnée, maîtresse d’elle-même, qui avait sa volonté et son libre jugement, mais qui n’avait eu, jusqu’ici, nulle occasion d’en user contre les règles établies du monde ou du foyer.
Sans nullement négliger les devoirs de la vie mondaine, et sans être blasée sur ses plaisirs, qu’elle goûtait de fort bon appétit, elle avait senti le besoin d’une activité plus sérieuse. Elle tint à faire des études assez complètes, à suivre les cours de la Faculté, à passer des examens, une double licence. D’intelligence vive, qui voulait s’occuper, elle aimait les recherches précises, particulièrement les sciences, où elle était bien douée;—peut-être parce que sa saine nature sentait le besoin d’opposer, par instinct d’équilibre, la stricte discipline d’une méthode nette et d’idées sans brouillards à l’inquiétant attrait de cette vie intérieure, qu’elle craignait d’affronter, et qui, malgré ses soins, à chaque arrêt de l’esprit inactif, venait battre son seuil. Cette activité claire, propre, régulière, la satisfaisait pour l’instant. Elle ne voulait pas songer à ce qui viendrait après. Le mariage ne l’attirait point. Elle en écartait la pensée. Son père souriait de ses partis-pris; mais il n’avait garde de les combattre: il y trouvait son compte.
La disparition de Raoul Rivière ébranla jusque dans ses fondations l’édifice ordonné, dont il était, à l’insu d’Annette, le pilier principal. Elle n’ignorait point le visage de la mort. Elle avait fait connaissance avec lui, lorsque cinq ans avant, sa mère l’avait quittée. Mais les traits de ce visage ne sont pas toujours les mêmes. Soignée depuis quelques mois dans une maison de santé, madame Rivière était partie silencieusement, comme elle avait vécu, gardant le secret de ses affres dernières, comme des soucis de sa vie, et laissant après elle, dans le candide égoïsme de l’adolescente, avec une douleur tendre, pareille aux premières pluies de printemps, une impression de soulagement que l’on ne s’avouait pas, et l’ombre d’un remords, que bientôt recouvrit l’insouciance des beaux jours.....
Tout autre fut la fin de Raoul Rivière. Frappé en plein bonheur, alors qu’il se croyait sûr de le savourer longtemps, il n’apporta au départ aucune philosophie. Il accueillit les souffrances et l’approche de la mort avec des cris de révolte. Jusqu’au suprême souffle d’une agonie haletante, comme un cheval au galop qui gravit une pente, il lutta dans l’effroi. Ces affreuses images, ainsi qu’en une cire, s’imprimèrent dans l’esprit brûlant d’Annette. Elle en resta, des nuits, hallucinée. Dans le noir de sa chambre, couchée, près de s’endormir, ou réveillée soudain, elle revivait l’agonie et le visage du mourant, avec une telle violence qu’elle était le mourant; ses yeux étaient ses yeux; son souffle était son souffle; elle ne les distinguait plus; dans ses orbites elle percevait l’appel du regard chaviré. Elle faillit être détruite.—Mais une jeunesse robuste jouit d’une telle élasticité! Plus la corde est tendue, et plus loin rejaillit la flèche de la vie. L’aveuglante lumière de ces images affolées s’éteignit, par son excès, et fit la nuit dans le souvenir. Les traits, la voix, le rayonnement du disparu, tout disparut: Annette, fixant jusqu’à l’épuisement l’ombre qui était en elle, n’y retrouva plus rien. Rien qu’elle-même. Elle seule... Seule. L’Ève au jardin se réveillait sans le compagnon à ses côtés, celui qu’elle avait toujours su près d’elle, sans chercher à le définir, celui qui, dans sa pensée, prenait, sans qu’elle s’en doutât, les formes imprécises encore de l’amour. Et soudain, le jardin perdit sa sécurité. Les souffles inquiétants du dehors étaient entrés: et le souffle de la mort, et celui de la vie. Annette ouvrit les yeux, comme les premiers hommes dans la nuit, avec l’appréhension des mille dangers inconnus embusqués autour d’elle, et l’instinct de la lutte qu’il lui faudrait livrer. Subitement, les énergies assoupies se ramassèrent et, tendues, se tinrent prêtes. Et sa solitude se peupla de forces passionnées.
L’équilibre était rompu. Ses études, ses travaux, ne lui étaient plus rien. La place qu’elle leur avait attribuée dans sa vie lui parut dérisoire. L’autre partie de sa vie, que la douleur venait d’atteindre, se révélait d’une incommensurable étendue. L’ébranlement de la blessure en avait éveillé toutes les fibres: autour de la plaie ouverte par la disparition du compagnon aimé, toutes les puissances d’amour, secrètes, ignorées; aspirées par le vide qui venait de se creuser, elles accouraient, des fonds lointains de l’être. Surprise par cette invasion, Annette s’efforçait d’en détourner le sens; elle s’obstinait à les ramener toutes à l’objet précis de sa souffrance:—toutes, l’âpre aiguillon brûlant de la Nature, dont les souffles de printemps la baignaient de moiteur,—le vague et violent regret du bonheur... perdu, ou désiré?—les bras tendus vers l’absence,—et le cœur bondissant, qui aspire au passé..., ou bien à l’avenir? Mais elle ne parvenait ainsi qu’à dissoudre son deuil dans un trouble mystère de douleur et de passion et d’obscure volupté. Elle en était, à la fois, consumée, révoltée...
Ce soir de fin d’avril, la révolte l’emporta. Son esprit de raison s’indigna des confuses rêveries, qu’il laissait sans contrôle depuis de trop longs mois, et dont il voyait le danger. Il voulut les refouler; mais ce ne fut pas sans peine: on ne l’écoutait plus; il avait perdu l’habitude du commandement... Annette, s’arrachant au regard du feu dans le foyer et à l’insidieuse emprise de la nuit qui était tout à fait venue, se leva et, frileuse, s’enveloppant dans une robe de chambre du père, elle fit la lumière dans la pièce.
C’était l’ancien cabinet de travail de Raoul Rivière. Par les baies ouvertes, on voyait, au travers du jeune feuillage des arbres, clairsemé, la Seine dans la nuit, et sur sa masse sombre qui semblait immobile, les reflets des maisons, dont les fenêtres s’allumaient sur l’autre rive, et du jour qui mourait au-dessus des collines de Saint-Cloud. Raoul Rivière, qui était homme de goût, bien qu’il se gardât d’en user pour satisfaire à l’insipide routine ou aux caprices cocasses de ses riches clients, avait fait choix pour lui, aux portes de Paris, sur le quai de Boulogne, d’un vieil hôtel Louis XVI, qu’il n’avait point bâti. Il s’était contenté de le rendre confortable. Son cabinet de travail eût aussi bien servi pour des travaux galants. Et il y avait lieu de croire que cette vocation n’était pas restée sans emploi. Rivière avait reçu ici plus d’une visite aimable, dont nul ne se doutait: car la pièce avait son entrée directe sur le jardin. Mais depuis deux années, l’entrée ne servait à rien; et la seule visiteuse avait été Annette. C’était là qu’ils avaient leurs meilleurs entretiens. Annette, allant, venant, rangeant, versant de l’eau dans un vase de fleurs, toujours en mouvement, puis immobilisée soudain avec un livre, pelotonnée dans son coin favori du divan, d’où elle pouvait voir en silence passer la rivière soyeuse, et suivre, sans interrompre sa distraite lecture, une conversation distraite avec son père. Mais lui, assis là-bas, nonchalant et lassé, dont le profil malicieux happait du coin de l’œil ses moindres mouvements, ce vieil enfant gâté qui ne pouvait admettre que, là où il était, il ne fût pas le centre de toutes les pensées, la harcelait de pointes, de questions câlines, railleuses, exigeantes, inquiètes, afin de ramener sur lui l’attention d’Annette et de s’assurer qu’elle écoutait, bien tout... Jusqu’à ce qu’à la fin, agacée et ravie qu’il ne pût se passer d’elle, elle laissât tout le reste, pour ne s’occuper que de lui. Alors, il était satisfait; et sur de son public, il lui faisait largesse des ressources variées de son brillant esprit. Il brûlait ses fusées, il effeuillait ses souvenirs. Bien entendu, il avait soin de n’en choisir que les plus flatteurs; et il les arrangeait ad usum Delphini—, au goût de la dauphine, dont il percevait finement les curiosités secrètes et les répugnances brusquement hérissées: il lui racontait juste ce qu’elle désirait entendre. Annette, tout oreilles, était fière de ses confidences. Elle croyait volontiers qu’elle avait de son père plus que n’avait jamais su en recevoir sa mère. De l’intimité de sa vie, elle restait, pensait-elle, l’unique dépositaire.
Mais un autre dépôt se trouvait en ses mains, depuis la mort du père: c’étaient tous ses papiers. Annette ne cherchait pas en prendre connaissance. Sa piété lui disait qu’ils ne lui appartenaient pas. Un autre sentiment lui soufflait le contraire. Il fallait, en tout cas, décider de leur sort: Annette, seule héritière, pouvait disparaître à son tour; et ces papiers de famille ne devaient pas tomber en des mains étrangères. Il était donc urgent de les examiner, soit afin de les détruire, soit pour les conserver. Déjà, depuis plusieurs jours, Annette s’y était décidée. Mais quand elle se retrouvait, le soir, dans la pièce imprégnée de la présence aimée, elle n’avait plus le courage que de s’en pénétrer, des heures, sans bouger. Elle craignait, en rouvrant les lettres du passé, un contact trop direct avec la réalité...
Il le fallait pourtant. Ce soir, elle s’y résolut. Dans la douceur diffuse de cette nuit trop tendre, où elle sentait, inquiète, se fondre sa douleur, elle voulut s’affirmer sa possession du mort. Elle alla vers le meuble en bois de rose, mieux fait pour une coquette que pour un travailleur,—un haut chiffonnier Louis XV,—où Rivière entassait, dans les tiroirs à sept ou huit étages, qui en faisaient comme une réduction anticipée et charmante des sky-scrapers américains, ses lettres et ses papiers intimes. Annette, s’agenouillant, ouvrit le tiroir du bas; pour mieux l’examiner, elle l’enleva du meuble; et, reprenant sa place près de la cheminée, elle le mit sur ses genoux et se pencha dessus. Nul bruit dans la maison. Elle y habitait seule, avec une vieille tante, qui tenait le ménage, et qui ne comptait guère: sœur effacée du père, tante Victorine avait toujours vécu à son service, le trouvait naturel, et maintenant continuait, au service de sa nièce, son rôle de gouvernante,—ainsi que les vieux chats, ayant fini par faire partie des meubles de la maison, auxquels elle était attachée, sans doute, autant qu’aux êtres. Retirée de bonne heure dans sa chambre, le soir, sa présence lointaine à l’étage au-dessus, le va-et-vient paisible de ses vieux pas feutrés, ne dérangeaient pas plus les songeries d’Annette qu’un animal familier.
Elle commença de lire, curieuse, un peu troublée. Mais son instinct de l’ordre et son besoin du calme, qui voulaient que, dans elle et autour, tout fût clair et rangé, s’imposaient en prenant et dépliant les lettres, une lenteur de mouvements, une froideur détachée, qui, quelque temps, du moins, purent lui faire illusion.
Les premières lettres qu’elle lut étaient de sa mère. Le ton chagrin lui rappela d’abord ses impressions de naguère, pas toujours bienveillantes, un peu agacées parfois, avec quelque pitié à l’égard de ce qu’elle jugeait, dans sa haute raison, une habitude d’esprit véritablement maladive: «Pauvre maman!...» Mais, petit à petit, poursuivant sa lecture, elle s’apercevait, pour la première fois, que cet état moral n’était pas sans motifs. Certaines allusions aux infidélités de Raoul l’inquiétèrent. Trop partiale pour juger au détriment de son père, elle passa, affectant de ne pas très bien comprendre. Sa piété lui fournissait d’excellentes raisons pour détourner les yeux. Elle découvrait toutefois le sérieux de l’âme, la tendresse blessée de madame Rivière; et elle se reprocha, en l’ayant méconnue, d’avoir ajouté aux tristesses de cette vie sacrifiée.
Dans le même tiroir, côte à côte, dormaient d’autres paquets de lettres,—(certaines même détachées, mêlées aux lettres de la mère)—que la tranquille légèreté de Raoul avait réunies ensemble, comme, dans sa vie de ménage multiple, il avait fait des correspondantes.
Cette fois, le calme imposé d’Annette se vit soumis à une difficile épreuve. De tous les feuillets de la nouvelle liasse, des voix se faisaient entendre, bien autrement intimes et sûres de leur pouvoir que celle de la pauvre madame Rivière: elles affirmaient sur Raoul leurs droits de propriété. Annette en fut révoltée. Son premier mouvement fut de froisser dans sa main les lettres qu’elle tenait, et de les jeter au feu.—Mais elle les en retira.
Elle regardait, hésitante, les feuilles déjà mordues par la flamme, qu’elle venait de reprendre. Certes, si elle avait de bonnes raisons, tout à l’heure, pour ne pas vouloir s’introduire dans les querelles passées entre ses parents, elle en avait encore de meilleures pour vouloir ignorer les liaisons de son père. Mais ces raisons ne comptaient pour rien, maintenant. Elle se sentait personnellement atteinte. Elle n’eût pas su dire comment, à quel titre, pourquoi. Immobile, penchée, fronçant le bout de son nez, avançant son museau, avec une moue de dépit, comme une chatte irritée, elle frémissait du désir de relancer au feu les insolents papiers, qu’elle serrait dans son poing. Mais, ses doigts se desserrant, elle ne résista pas à l’envie d’y jeter un regard. Et, brusquement décidée, elle rouvrit la main, redéplia les lettres, effaçant soigneusement du doigt les froissures qu’elle avait faites... Et elle lut,—elle lut tout.
Avec répulsion,—(non sans attrait aussi),—elle voyait passer ces liaisons amoureuses, dont elle n’avait rien su. Elles formaient un troupeau fantasque et bigarré. Le caprice de Raoul, en amour comme en art, était «couleur du temps». Annette reconnaissait certains noms de son monde; et elle se rappelait, avec hostilité, les sourires, les caresses, qu’elle avait reçus jadis de telle des favorites. D’autres étaient d’un niveau social moins relevé; l’orthographe n’en était pas moins libre que les sentiments exprimés. Annette accentuait sa moue; mais son esprit, qui avait les yeux vifs et railleurs, comme ceux du père, voyait l’application comique de celles qui, penchées, un frison sur les yeux, tirant le bout de la langue, faisaient galoper leur plume sur le papier. Toutes ces aventures, les unes un peu plus longues, les autres un peu moins longues, jamais très longues en somme, passaient, se succédaient; et l’une effaçait l’autre. Annette leur en savait gré,—froissée, mais dédaigneuse.
Elle n’était pas encore au bout de ses découvertes. Dans un autre tiroir, soigneusement mise à part,—(plus soigneusement, elle dut le remarquer, que les lettres de sa mère),—une liasse nouvelle lui révéla une liaison plus durable. Bien que les dates fussent négligemment marquées, il était facile de voir que cette correspondance embrassait une longue suite d’années. Elle était de deux mains,—l’une, dont l’écriture incorrecte et lâchée, qui courait de travers, s’arrêtait à moitié du paquet,—l’autre qui, d’abord, enfantine, appuyée, s’affirmait peu à peu, et continuait jusqu’aux dernières années,—bien plus, (et cette constatation fut particulièrement pénible à Annette), jusqu’aux derniers mois de la vie de son père. Et cette correspondante, qui lui dérobait une part de cette période sacrée, dont elle pensait avoir eu le privilège unique, cette intruse, doublement, écrivait à son père: «Mon père»!...
Elle eut la sensation d’une intolérable blessure. D’un geste de colère, elle rejeta de ses épaules la houppelande du père. Les lettres tombées de ses mains, repliée sur sa chaise, elle avait les yeux secs, et ses joues la brûlaient. Elle ne s’analysait pas. Elle était trop passionnée pour savoir ce qu’elle pensait. Mais, de toute sa passion, elle pensait: «Il m’a trompée!...»
Elle reprit de nouveau les lettres exécrées; et cette fois, elle ne les lâcha plus qu’elle n’en eût extrait jusqu’à la dernière ligne. Elle lisait, en soufflant des narines, bouche fermée, brûlée d’un feu caché de jalousie,—et d’un autre sentiment, obscur, qui s’allumait. Pas une seconde, l’idée ne lui vint, en pénétrant l’intimité de cette correspondance, en s’emparant des secrets de son père, qu’elle pouvait commettre un délit de conscience. Pas une seconde, elle ne douta de son droit... (Son droit! L’esprit de raison était loin. Une bien autre puissance, despotique, parlait!)... Au contraire, c’était elle qui s’estimait lésée dans son droit—dans son droit—par son père!
Elle se ressaisit pourtant. Elle entrevit, un instant, l’énormité de cette prétention. Elle haussa les épaules. Quels droits avait-elle sur lui? Que lui devait il?—L’impérieux grondement de la passion dit: «Tout.» Inutile de discuter! Annette, abandonnée à l’absurde dépit, souffrait de la morsure, et goûtait en même temps une amère jouissance de ces forces cruelles qui, pour la première fois, enfonçaient dans sa chair leur cuisant aiguillon.
Une partie de la nuit passa à sa lecture. Et lorsqu’elle consentit enfin à se coucher, sous ses paupières baissées elle relut longtemps des lignes et des mots, qui la faisaient tressauter, jusqu’à ce que le fort sommeil de la jeunesse la domptât, sans mouvement, étendue, respirant largement, très calme, soulagée par la dépense même qui s’était faite en elle.
Elle relut, le lendemain; bien des fois, elle relut, dans les jours qui suivirent, les lettres qui ne cessaient d’occuper sa pensée. Maintenant, elle pouvait à peu près reconstituer cette vie—cette double vie, qui s’était déroulée, parallèle à la sienne:—la mère, une fleuriste, à qui Raoul avait fourni les fonds pour ouvrir un magasin; la fille, qui était dans les modes, ou bien dans la couture (on ne savait pas très bien). L’une se nommait Delphine, et l’autre (la jeune) Sylvie. A en juger par le style fantasque, négligé, mais dont le déshabillé ne manquait pas de charme, elles se ressemblaient. Delphine paraissait avoir été une aimable personne, qui, malgré de petites roueries tendues ça et là dans ses lettres, ne devait pas avoir fatigué beaucoup Rivière de ses exigences. Ni la mère, ni la fille ne prenaient la vie au tragique. Au reste, elles semblaient sûres de l’affection de Raoul. C’était peut-être le meilleur moyen pour la conserver. Mais cette impertinente assurance ne froissait pas moins Annette que l’extrême familiarité de leur ton avec lui.
Sylvie occupait surtout son attention jalouse. L’autre avait disparu; et la fierté d’Annette affectait de dédaigner le genre d’intimité que Delphine avait eue avec son père; elle oubliait déjà que, les jours précédents, la découverte d’attachements du même ordre lui avait été une sensible offense. Maintenant qu’entrait en lice une intimité beaucoup plus profonde, toute autre rivalité lui semblait négligeable. L’esprit tendu, elle tâchait de se représenter l’image de cette étrangère qui, malgré son dépit, ne l’était qu’à demi. Le sans-gêne riant, le tranquille tutoiement de ces lettres où Sylvie disposait de son père, comme s’il eût été sa propriété entière, l’indignaient; elle cherchait à fixer l’insolente inconnue, afin de la confondre. Mais la petite intruse défiait son regard. Elle avait l’air de dire:
—C’est mon bien, j’ai son sang.
Et plus Annette s’irritait, plus cette affirmation faisait son chemin en elle. Elle la combattait trop pour ne pas s’habituer peu à peu au combat, et même à l’adversaire. Elle finit par ne plus pouvoir s’en passer. Le matin, la première pensée qui l’accueillait, au réveil, était celle de Sylvie; et la voix narquoise de la rivale lui disait maintenant:
—J’ai ton sang.
Si nette elle l’entendit, si vive fut, une nuit, la vision de la sœur inconnue que, dans son demi-sommeil, Annette tendit les bras, afin de la saisir.
Et le lendemain, courroucée, protestant, mais vaincue, le désir la tenait et ne la lâcha plus. Elle partit de la maison, à la recherche de Sylvie.
L’adresse était dans les lettres. Annette alla boulevard du Maine. C’était l’après-midi. Sylvie était à l’atelier. Annette n’osa point l’y relancer. Elle attendit quelques jours, et elle revint un soir après dîner. Sylvie n’était pas rentrée; ou elle était déjà ressortie: on ne savait au juste. Annette, qu’à chaque course une impatience nerveuse tenait crispée d’attente tout le jour, s’en retournait déçue; et une secrète lâcheté lui conseillait de renoncer. Mais elle était de celles qui ne renoncent jamais à ce qu’elles ont décidé;—elles y renoncent d’autant moins que l’obstacle s’entête, ou qu’elles craignent ce qui va arriver.
Elle alla de nouveau, un jour de la fin mai, vers neuf heures du soir. Et cette fois, on lui dit que Sylvie était chez elle. Six étages. Elle monta, trop vite, car elle ne voulait pas se laisser le temps de chercher des raisons pour rebrousser chemin. En haut, elle eut le souffle coupé. Elle s’arrêta sur le palier. Elle ne savait pas ce qu’elle allait trouver.
Un long couloir commun, sans tapis, carrelé. A droite, à gauche, deux portes entr’ouvertes: d’un logement à l’autre, des voix se répondaient. De la porte de gauche venait sur les carreaux rouges un reflet du couchant. Là habitait Sylvie.
Annette fit: «Toc! toc!» On lui cria: «Entrez!» sans cesser de bavarder. Elle poussa la porte; la lueur du ciel doré vint la frapper en face. Elle vit une jeune fille, à demi dévêtue, en jupon, épaules nues, pieds nus dans des savates roses, qui allait et venait, en lui tournant le dos souple et dodu. Elle cherchait quelque chose sur sa table de toilette, se parlant toute seule, et se poudrant le nez avec une houppette.
—Eh bien! Qu’est-ce que c’est donc? demanda-t-elle, d’une voix qui zézayait, à cause des épingles qu’elle mordait de côté.
Puis, subitement distraite par une branche de lilas, qui trempait dans son pot à eau, elle y plongea le nez, avec un grognement de plaisir. En relevant la tête et regardant ses yeux rieurs dans le miroir, elle aperçut, par derrière, hésitante, sur le seuil de la porte, Annette, auréolée de soleil. Elle fit: «Ah!» se retourna, ses bras nus levés autour de sa tête, prestement renfonçant les épingles dans la chevelure refaite, puis vint, les mains tendues,—et soudain, les retira, faisant un geste d’accueil, aimable, mais réservé. Annette entra, essayant, mais en vain, de parler. Sylvie se taisait aussi. Elle lui offrit une chaise; et, passant un peignoir à raies bleues usagé, elle s’assit en face d’elle, sur son lit. Toutes deux se regardaient; et chacune attendait qui allait commencer...
Qu’elles étaient différentes! Chacune étudiait l’autre, avec des yeux aigus, exacts, sans indulgence, qui cherchaient: «Qui es-tu?»
Sylvie voyait Annette, grande, fraîche, la face large, le nez un peu camus, le front de jeune génisse sous la masse des cheveux châtain d’or en torsades, les sourcils très fournis, des yeux larges bleu-clair qui affleuraient un peu et qui, étrangement, parfois se durcissaient, par ondes venues du cœur; la bouche grande, lèvres fortes, un duvet blond au coin, habituellement fermées, en une moue défensive, attentive, butée, mais qui, lorsqu’elles s’ouvraient, pouvaient s’illuminer d’un ravissant sourire, timide et rayonnant, qui transformait toute la physionomie; le menton, comme les joues, pleins, sans empâtement, solidement charpentés; la nuque, le cou, les mains, couleur de miel foncé; une belle peau bien ferme, baignée par un sang pur. Un peu lourde de taille, le buste un peu carré, elle avait les seins larges et gonflés; l’œil exercé de Sylvie les palpa sous l’étoffe, et s’arrêta surtout sur les belles épaules, dont la pleine harmonie formait avec le cou, blonde et ronde colonne, le plus parfait du corps. Elle savait s’habiller, était mise avec soin, presque trop pour Sylvie, un soin trop observé: les cheveux bien tirés, pas une boucle folle, pas une agrafe en faute, tout en ordre.—Et Sylvie se demandait: «Et dedans, est-ce de même?»
Annette voyait Sylvie presque aussi grande qu’elle—(aussi grande, oui, peut-être)—mais mince, fine de taille, tête petite pour le corps, demi-nue sous le peignoir, peu de gorge, grassouillette pourtant, les bras dodus, assise, se balançant sur son petit croupion et les deux mains croisées sur ses deux genoux ronds. Ronds, elle avait aussi le front et le menton; le nez petit, retroussé; les cheveux d’un brun-clair, très fins et plantés bas sur les tempes, des boucles sur les joues, et de petits cheveux fous sur la nuque et le cou, blanc, très blanc, et gracile. Une plante qui vit en chambre. Les deux profils du visage étaient asymétriques: celui de droite, langoureux, sentimental, chat qui dort; celui de gauche, malicieux, aux aguets, chat qui mord. La lèvre supérieure se retroussait en parlant, sur les canines rieuses.—Et Annette pensait: «Gare à qui elle croque!»
Qu’elles étaient différentes!..... Et pourtant, toutes deux avaient, du premier regard, reconnu le regard, les yeux clairs, le front, le pli du coin des lèvres,—le père...
Annette, intimidée, raidie, prit son courage et dit, d’une voix blanche, que glaçait l’excès d’émotion, qui elle était, son nom. Sylvie la laissa parler, sans cesser de la fixer, puis dit tranquillement, avec le sourire un peu cruel de sa lèvre retroussée:
—Je le savais.
Annette tressaillit.
—Comment?
—Je vous ai vue déjà—souvent—avec le père...
Elle avait eu, avant les derniers mots, une hésitation imperceptible. Peut-être, malignement, elle allait dire: «mon père». Mais elle eut ironique pitié du regard d’Annette, qui lisait sur ses lèvres. Annette comprit, détourna les yeux, rougit, humiliée.
Sylvie n’en perdit rien; elle se délecta lentement de cette rougeur. Elle continuait de parler, sans hâte, posément. Elle racontait qu’à la cérémonie mortuaire, elle était à l’église, dans un des bas-côtés, et qu’elle avait tout vu. Sa voix qui chantonnait, en nasillant un peu, dévidait son récit, sans montrer d’émotion. Mais si elle savait voir, Annette savait entendre. Et quand Sylvie eut fini, Annette, relevant les yeux, lui dit:
—Vous l’aimiez bien?
Les regards des deux sœurs échangèrent une caresse. Mais ce ne fut qu’un moment. Déjà une ombre jalouse avait passé dans les yeux d’Annette, et elle continua:
—Il vous aimait beaucoup.
Elle voulait sincèrement faire plaisir à Sylvie; mais sa voix, malgré elle, prit une nuance de dépit. Sylvie crut y sentir une intonation protectrice. Ses petites griffes pointant aussitôt des pattes, elle dit avec entrain:
—Oh! oui, il m’aimait beaucoup!
Elle fit une petite pause; puis, d’un air complaisant, décocha:
—Il vous aimait bien aussi. Souvent, il me l’a dit.
Les mains passionnées d’Annette, ses mains grandes et nerveuses, frémirent et se serrèrent. Sylvie les regardait. La gorge contractée, Annette demanda:
—Il vous parlait de moi, souvent?
—Souvent, répéta l’innocente Sylvie.
Il n’était pas très sûr qu’elle dît la vérité. Mais Annette, peu experte à cacher sa pensée, ne mettait pas en doute la parole des autres; et celle de Sylvie l’atteignit au cœur..... Ainsi, son père parlait d’elle à Sylvie, ils parlaient d’elle ensemble! Et elle, jusqu’au dernier jour, avait tout ignoré; il semblait se confier, et il l’avait dupée; il la tenait à l’écart; elle ne savait même pas l’existence de sa sœur!... Une telle inégalité, si injuste, l’accabla. Elle se sentit vaincue. Mais elle ne voulut pas le montrer; elle chercha une arme, la trouva; et elle dit:
—Vous l’avez vu bien peu, dans ces dernières années.
—Dans ces dernières années, concéda, fort à regret, Sylvie. Sans doute. Il était malade. On le tenait enfermé.
Il y eut un silence hostile. Souriantes toutes deux, toutes deux rongeaient leur frein. Annette, rude et guindée; Sylvie, l’air faux comme un jeton, caressante, maniérée. Avant de continuer la partie, elles comptaient les points. Annette, un peu soulagée d’avoir repris un (bien faible) avantage, secrètement honteuse de ses mauvaises pensées, s’efforça de remettre l’entretien sur un ton plus cordial. Elle parla du désir qu’elle avait eu de se rapprocher de celle en qui revivait, aussi,—«un peu»—son père. Mais elle avait beau faire: malgré elle, elle établissait une différence entre leurs parts; elle laissait entendre que la sienne était privilégiée. Elle racontait à Sylvie les dernières années de Raoul; et elle ne pouvait pas s’empêcher de montrer combien elle avait été plus intime avec lui. Sylvie profitait d’un arrêt dans le récit, pour servir à Annette, en retour, ses propres souvenirs de l’affection paternelle. Et chacune, sans le vouloir, enviait la part de l’autre; et chacune tâchait de faire valoir la sienne. Parlant ou écoutant,—(ne voulant pas écouter, mais entendant quand même),—elles continuaient de s’inspecter, de la tête au talon. Sylvie, complaisamment, comparait ses jambes longues et les fines chevilles de ses petits pieds nus qui jouaient dans les pantoufles, aux attaches un peu lourdes, aux chevilles engoncées d’Annette. Et Annette, étudiant les mains de Sylvie, n’oubliait pas de noter les lunules travaillées de ses ongles trop roses.—Ce n’étaient pas seulement deux jeunes filles qui se trouvaient en présence; c’étaient les deux ménages rivaux. Aussi, malgré l’abandon apparent de l’entretien, elles restaient armées du regard et du bec, et s’observaient rudement. La féroce acuité de la jalousie leur faisait à chacune percer du premier coup d’œil, crûment, jusqu’au fond de l’autre, les tares, les vices cachés, dont l’autre ne se doutait peut-être pas. Sylvie lisait dans Annette le démon d’orgueil, la dureté de principes, la violence despotique, qui n’avaient pourtant pas eu encore l’occasion de s’exercer. Annette lisait dans Sylvie la sécheresse foncière et la fausseté souriante. Plus tard, quand elles s’aimèrent, elles se donnèrent bien du mal pour oublier ce qu’elles avaient lu. Pour l’instant, leur animosité le regardait par un verre grossissant. Il y avait des secondes où elles se haïssaient. Annette, le cœur gros, pensait:
—Ce n’est pas bien, ce n’est pas bien! Je dois donner l’exemple.
Ses yeux faisaient le tour de la modeste chambre, regardaient la fenêtre, les rideaux de guipure, dans une lueur de lune le toit et les cheminées de la maison d’en face, la branche de lilas dans le pot à eau ébréché.
L’air froide, d’autant plus qu’elle brûlait au fond, elle offrit à Sylvie son amitié, son aide... Sylvie, négligemment,—un mauvais petit sourire,—écouta, laissa tomber... Annette, mortifiée, cachant mal son dépit d’orgueil et de passion naissante, se leva avec brusquerie. Elles échangèrent un adieu aimablement banal. Et, tristesse et colère au cœur, Annette sortit.
Mais comme elle était au bout du couloir carrelé et descendait déjà la première marche de l’escalier, Sylvie courut à elle, dans ses petites babouches, dont l’une resta en route, et, par derrière, lui passa les bras autour du cou. Annette se retourna, en criant d’émotion. Elle étreignit Sylvie, d’un élan passionné. Sylvie cria aussi, mais de rire, pour la violence de l’étreinte. Leurs bouches fougueusement s’étaient jointes. Mots amoureux. Tendres murmures. Remerciements, promesses qu’on se reverrait bientôt...
Elles se détachèrent. Annette, riant de bonheur, se trouva, sans savoir comment elle l’avait descendu, au bas de l’escalier. D’en haut, elle entendit un sifflement gamin, comme pour appeler un chien, et la voix de Sylvie qui chuchotait:
—Annette!
Elle leva la tête, vit tout en haut, dans un rond de lumière, la frimousse penchée de Sylvie qui riait:
—Attrape!...
reçut en pleine figure une pluie de gouttelettes et le lilas mouillé que Sylvie lui jetait,—et lui jetait aussi, des deux mains, des baisers...
Sylvie disparut. Annette, la tête levée, continuait de la chercher, quand elle n’était plus là. Et serrant dans ses bras la branche de fleurs trempée, elle embrassait le lilas.
Malgré la distance, et bien que certaines rues, à cette heure tardive, ne fussent pas très sûres, elle revint à pied. Elle aurait bien dansé. Rentrée enfin chez elle, heureuse et harassée, elle ne se coucha pas avant d’avoir placé les fleurs dans un vase, près de son lit. Et elle se releva pour les en retirer, et—comme chez Sylvie—les mettre dans son pot à eau. Recouchée, elle gardait sa lampe allumée, car elle ne voulait pas se séparer de cette journée. Mais elle se retrouva, soudain, trois heures après, au milieu de la nuit. Les fleurs étaient bien là. Elle n’avait pas rêvé, elle avait vu Sylvie... Elle se rendormit, sur le sein de l’image chérie.
Les journées qui suivirent furent remplies par un bourdonnement d’abeilles, édifiant une ruche nouvelle. Tel, autour d’une jeune reine, un essaim qui se groupe. Autour de Sylvie aimée, Annette bâtissait un nouvel avenir. La vieille ruche était désertée. Sa reine était bien morte. S’efforçant de masquer cette révolution de palais, le cœur passionné feignait de croire que son amour pour le père émigrait en Sylvie, et qu’il l’y retrouverait... Mais Annette savait bien qu’elle en prenait congé.
Impérieux grondement de l’amour nouveau, qui crée et qui détruit... Les souvenirs du père, impitoyablement, furent écartés de la vue. Les objets familiers, relégués—avec tous les égards—dans l’ombre pieuse de chambres où ils ne couraient pas risque d’être souvent troublés. La houppelande, remisée au fond d’un vieux placard. Après l’avoir enfouie, Annette l’en retira, indécise, y appuya sa joue, puis, soudain, rancunière, la rejeta. Illogisme de la passion! Qui des deux trahissait?...
Elle s’était éprise de la sœur qu’elle avait découverte. Elle ne la connaissait guère! Mais, du moment qu’on aime, cette incertitude n’est qu’un attrait de plus. Le mystère de l’inconnu s’ajoute au charme de ce qu’on croit connaître. De Sylvie entrevue, elle ne voulait retenir que ce qui lui avait plu. Elle convenait en secret que ce n’était pas très exact. Mais quand, honnêtement, elle tâchait de revoir les ombres du portrait, elle entendait les petites savates trotter dans le couloir; et les bras nus de Sylvie se nouaient autour de son cou.
Sylvie allait venir. Elle l’avait promis... Annette préparait tout, afin de la recevoir. Où la ferait-elle entrer?—Là, dans sa jolie chambre. Sylvie s’assiérait ici, à la place favorite, devant la fenêtre ouverte. Annette voyait par ses yeux, se réjouissait de lui montrer sa maison, ses bibelots, ses arbres revêtus de leur plus tendre verdure, et l’échappée là-bas, sur les coteaux fleuris. D’en partager avec elle la grâce et le confort, elle en jouissait avec une fraîcheur de sensations toutes neuves.—Mais voici qu’elle pensa que les yeux de Sylvie feraient la comparaison entre son propre logement et la maison de Boulogne. Une ombre tomba sur sa joie. Cette inégalité lui pesa, comme si elle était à son tort... N’avait-elle pas les moyens de la réparer, précisément en conviant Sylvie à profiter des avantages que le sort lui avait faits?... Oui, mais ce serait s’attribuer sur elle un avantage de plus. Annette pressentait qu’on ne le lui consentirait pas sans résistance. Elle se souvenait du silence railleur, dont Sylvie avait accueilli ses premières invites. Il fallait ménager sa susceptibilité. Comment faire?... Annette essaya quatre ou cinq plans, dans sa tête. Aucun ne la satisfit. Elle changea dix fois l’arrangement de la chambre; après y avoir disposé, avec un plaisir d’enfant, les objets de plus de prix, elle les remporta, et elle ne laissa que ce qu’elle avait de plus simple. Il n’y eut pas un détail—une fleur sur l’étagère, la place d’un portrait,—qu’elle ne discutât... Pourvu que Sylvie n’arrivât point, avant que tout fût en ordre!—Mais Sylvie ne se pressait point; et Annette eut le temps de défaire et refaire, et encore, et encore, ses petits arrangements. Elle trouvait Sylvie bien lente à venir; mais elle en profitait pour corriger quelque chose à ses plans. Inconsciente comédie! Elle se dupait, en attribuant une importance à ces riens. Toute cette agitation de rangements, de dérangements, n’était qu’un prétexte pour se donner le change sur une autre agitation de pensées passionnées, qui troublaient l’ordre habituel de sa vie raisonnée.
Le prétexte s’usa. Cette fois, tout était prêt. Et Sylvie ne venait point. Annette l’avait déjà reçue dix fois, en imagination. Elle s’épuisait à attendre... Elle ne pouvait pourtant pas retourner chez Sylvie! Si, allant la revoir, elle lisait dans les yeux ennuyés de Sylvie qu’on se passait bien d’elle! A cette seule idée, l’orgueil d’Annette saignait... Non, plutôt que cette humiliation, ne la revoir jamais!... Pourtant... Elle se décidait, hâtivement, s’habillait pour chercher l’oublieuse. Mais elle n’avait pas fini de boutonner ses gants qu’elle se décourageait; et, les jambes cassées, elle se rasseyait sur une chaise du vestibule, ne sachant plus que faire...
Et, juste à cet instant,—affaissée près de la porte, son chapeau sur la tête, toute prête à sortir, et ne s’y décidant pas,—juste, Sylvie sonna!...
Entre la sonnerie et la porte qui s’ouvre, dix secondes ne s’écoulèrent pas. Une telle promptitude et l’apparition des yeux ravis d’Annette, dirent assez à Sylvie qu’elle était attendue. Déjà les deux museaux sur le seuil s’embrassaient, avant d’avoir dit un mot. Annette, impétueusement, entraîna Sylvie à travers la maison, sans lui lâcher les mains, en la mangeant des yeux, riant de la gorge, sottement, comme un enfant heureux...
Et rien ne se passa comme elle l’avait prévu. Aucune des phrases d’accueil préparées ne servit. Elle ne fit pas asseoir Sylvie à la place choisie. Tournant le dos à la fenêtre, elles s’assirent toutes deux sur le divan, côte à côte, et, les yeux dans les yeux, parlant sans s’écouter, leurs regards se disaient:
Annette:—«Enfin! Tu es donc là?»
Sylvie:—«Tu le vois, je suis venue...»
Mais Sylvie, ayant examiné Annette, dit:
—Vous alliez sortir?
Annette secoua la tête, sans vouloir expliquer. Sylvie comprit très bien, et, se penchant, souffla:
—C’est chez moi que tu allais?
Annette tressauta, et, appuyant sa joue sur l’épaule de sa sœur, elle murmura:
—Méchante!
—Pourquoi? demanda Sylvie, baisant du coin de sa bouche les blonds sourcils d’Annette.
Annette ne répondit pas. Sylvie savait la réponse. Elle sourit, épiant malignement Annette qui, maintenant, évitait son regard. Cette violente fille! Sa fougue était brisée. Une timidité subite s’était abattue sur elle, comme un filet. Elles restèrent sans bouger, la grande sœur appuyée sur l’épaule de la petite, satisfaite d’avoir si promptement établi son pouvoir...
Puis, Annette releva la tête; et, maîtresses toutes deux de leur premier émoi, comme de vieilles amies, elles commencèrent à causer.
Elles n’avaient plus, cette fois, d’intentions hostiles. Elles étaient, au contraire, désireuses de se livrer... Oh! pas complètement, pourtant! Elles savaient qu’il est en chacun des choses qu’il ne faut pas montrer. Même quand on aime? Justement, quand on aime! Mais lesquelles, exactement? Chacune, tout en se confiant, conservant ses secrets, tâtait les limites de ce que l’amour de l’autre pourrait supporter. Et plus d’une confidence qui commençait bien franche, oscillait incertaine, au milieu de la phrase, et coulait gentiment en un petit mensonge. Elles ne se connaissaient pas; elles étaient, l’une pour l’autre, par beaucoup de côtés, une énigme déconcertante: deux natures, deux mondes, malgré tout, étrangers. Sylvie, pour cette visite,—(elle y avait songé plus qu’elle n’en eût convenu),—s’était faite aussi séduisante qu’elle pouvait. Et elle pouvait beaucoup. Annette était sous le charme, et, en même temps, gênée par certains petits artifices de coquetterie qui la mettaient mal à l’aise. Sylvie s’en apercevait, sans tenter d’y rien changer; et cette grande sœur, libre et naïve, brûlante et réservée, l’attirait, l’intimidait. (A l’entendre bavarder, on ne s’en fût pas douté!) L’une et l’autre étaient fines et très observatrices; elles ne perdaient pas un coup d’œil, ni une réflexion. Elles n’étaient pas sûres encore l’une de l’autre. Méfiantes et expansives, elles voulaient se donner. Oui, mais elles ne voulaient pas donner sans recevoir! Elles avaient toutes deux un diable de petit orgueil. Annette avait le plus fort. Mais les mouvements d’amour chez elle étaient aussi plus forts. Et elle se trahissait. Quand elle donnait plus qu’elle n’aurait voulu, c’était une défaite, que Sylvie savourait.—Tels deux négociateurs qui, brûlant de s’entendre, mais, sagement circonspects, guettant chaque mouvement, s’avancent prudemment...
Le duel était inégal. Très vite, Sylvie se rendit compte de la passion impérieuse et implorante d’Annette. Mieux qu’Annette. Elle l’expérimenta; d’une patte fourrée, elle en joua, sans en avoir l’air. Annette se sentit vaincue. Elle en eut honte et joie.
Sur la demande de Sylvie, elle lui montra tout son appartement. Elle ne l’eût pas fait, d’elle-même; elle craignait de la froisser, en étalant le bien-être dont elle était pourvue; mais, à son soulagement, Sylvie n’en manifesta pas la plus petite gêne. Elle était fort à l’aise, allait, venait, regardait et touchait, comme si elle était chez elle. Ce fut plutôt Annette qui se sentit choquée de ce parfait sans-gêne; et en même temps, elle en fut réjouie dans sa tendresse. Passant près du lit de sa sœur, Sylvie donna sur l’oreiller une petite tape amicale. Elle examina curieusement la table de toilette, d’un regard fit la revue exacte des flacons, passa distraitement dans la bibliothèque, s’extasia devant une paire de rideaux, critiqua un fauteuil, en essaya un autre, fourra son nez dans l’armoire entr’ouverte, palpa la soie d’une robe, et, ayant fait son tour, revenue dans la chambre à coucher d’Annette, s’assit dans le fauteuil bas, près du lit, continuant l’entretien. Annette lui offrit le thé, auquel Sylvie préféra deux doigts de vin sucré. Tandis que, du bout de la langue, elle suçait un biscuit, Sylvie regardait Annette, hésitante, qui voulait parler; et elle avait envie de lui dire:
—Vas-y donc!
Enfin, Annette prit son élan et, avec une brusquerie qui venait de sa tendresse contrainte, elle proposa à Sylvie d’habiter avec elle. Sylvie sourit, se tut, avala sa bouchée, trempa dans son malaga ses miettes et ses doigts, sourit de nouveau, gentiment, remerciant des yeux et de la bouche pleine, en secouant la tête, comme on fait quand on parle à un enfant; puis elle dit:
—Chérie...
Et elle refusa.
Annette insista, pressante; elle mettait à forcer le consentement une violence impérieuse. Au tour de Sylvie, maintenant, de ne plus vouloir parler! Elle s’excusait, à mi-mots, d’une voix caressante, avec un peu de gêne, aussi avec malice... (Elle l’aimait bien, la brusque et tendre, la candide grande sœur!)... Elle disait:
—Je ne peux pas.
Et Annette demandait:
—Mais, pourquoi?
Et Sylvie:
—J’ai un ami.
Annette ne comprit pas, l’espace d’une seconde. Puis, elle comprit trop, et elle fut atterrée. La lorgnant du coin de l’œil, Sylvie, toujours riante, se leva, et partit, dans un gazouillis de petits mots et de baisers.
Annette demeura en présence de son château détruit. Elle avait une grande peine, confuse, faite de sentiments mêlés. Il en était d’assez acres, qu’elle aimait mieux ne pas connaître, mais qui, par bouffées, lui contractaient la gorge... Elle qui se croyait libre de préjugés, l’idée que cette jolie sœur... Ah! c’était trop pénible! Elle en aurait bien pleuré... Pourquoi? C’était stupide! De la jalousie encore?... Non!
Elle secoua les épaules et se leva. Elle ne voulait plus y penser.—Elle y pensait, tout le temps... Elle allait, à grands pas, de pièce en pièce, afin de se distraire. Elle s’aperçut qu’elle refaisait dans l’appartement la promenade de sa sœur. Elle ne pensait qu’à elle. A elle et à cet autre... Jalouse, décidément? Non! Non! Non! Non!... Elle tapa du pied, avec colère.... Elle ne l’admettrait pas!... Mais qu’elle l’admît ou non, le mal lui mordait le cœur.—Elle se chercha des explications morales. Elle en trouva. Elle souffrait dans sa pureté. En sa nature complexe, riche d’instincts opposés, qui n’avaient pas encore eu l’occasion de se quereller, il ne manquait pas de forces puritaines. Pourtant ce n’étaient pas les scrupules religieux qui la gênaient. Élevée par un père sceptique, une mère libre-penseuse, en dehors de toute Église, elle s’était habituée à discuter de tout. Elle n’avait peur de soumettre aucun préjugé social à l’esprit d’examen. Elle admettait l’amour libre; en théorie, elle l’admettait très bien. Souvent, dans ses entretiens avec son père ou avec ses camarades d’études, elle en avait soutenu les droits; à ces revendications ne se mêlait pas trop le désir juvénile de paraître «avancée»: elle trouvait sincèrement légitime, naturelle, et même raisonnable la liberté en amour. Jamais elle n’eût songé à blâmer les jolies filles de Paris, qui vivent comme il leur plaît; elle les voyait avec sympathie, certes plus que les femmes de son monde bourgeois.... Eh bien, qu’avait-elle donc maintenant qui la peinait? Sylvie usait de son droit... Son droit? Non, pas son droit! Les autres, mais non pas elle!... On permet davantage à ceux qu’on met moins haut. Pour sa sœur, comme pour elle, Annette avait, justes ou non,—oui, justes!—de plus strictes exigences. L’amour unique lui semblait une aristocratie du cœur. Sylvie avait déchu, Annette lui en voulait!... «L’amour unique? L’amour de toi!... Jalouse, qui te mens!...» Mais plus elle était jalouse de Sylvie, plus elle l’aimait. Et plus elle lui en voulait, plus elle l’aimait. On n’en veut tant qu’à ceux qu’on aime!...
Le charme de la petite sœur, tranquillement, opérait. Inutile de s’irriter, de vouloir qu’elle fût différente; elle était ce qu’elle était. Annette se sentait peu à peu travaillée par un autre sentiment: la curiosité. Malgré elle, son esprit tâchait de se figurer comment vivait Sylvie. Elle y pensait beaucoup trop. Il lui arriva de se mettre à sa place. Elle fut assez confuse de constater qu’elle ne s’y trouvait pas trop mal. Le dépit, la révolte indignée qu’elle en eut contre elle-même, la rendit plus sévère pour Sylvie. Elle continua de bouder, et s’interdit de retourner chez sa sœur.
Sylvie ne s’en troublait point. Qu’Annette ne lui donnât plus signe de vie, ne l’inquiétait aucunement. Elle avait jugé la grande sœur, elle savait qu’Annette reviendrait. L’attente ne lui pesait pas. Elle avait de quoi occuper son cœur. Son ami, d’abord,—qui n’en habitait pourtant qu’un coin, et pas pour très longtemps. Et tant d’autres objets! Elle aimait bien Annette. Mais enfin, elle avait vécu près de vingt ans sans elle! Elle pouvait attendre encore quelques semaines... Elle devinait ce qui se passait dans l’esprit de sa sœur. Elle en éprouvait un amusement, mêlé d’un reste d’hostilité. Les deux races rivales. Les deux classes. Sans qu’il y eût paru, Sylvie avait, chez Annette, fait la comparaison de leurs vies et de leurs conditions. Elle pensait:
—Tout de même, tu vois, on a ses petits avantages. J’ai ce que tu n’as pas... Tu croyais me tenir, et tu ne me tiens pas... Oui, va, va, fais ta moue et ta lèvre gonflée!... J’ai choqué tes convenances... Quel coup, ma pauvre Annette!...
Et riant de la déconvenue qu’elle s’imaginait lire sur le visage d’Annette, elle embrassait sa main et envoyait un baiser. Mais, tout en se disant qu’Annette avait de la peine et que le morceau était un peu dur à passer, elle n’en était pas fâchée. Et, comme pour un enfant qui boude devant sa cuiller pleine, elle soufflait, narquoise et câline:
—Allons, mon beau petit! Ouvrez le bec!... Houp là!...
Il ne s’agissait pas seulement des convenances choquées. Sylvie savait fort bien qu’elle avait blessé Annette dans un autre sentiment beaucoup moins avouable. Et la brigande s’en réjouissait, car elle se sentait ainsi maîtresse de sa sœur; elle en ferait tout ce qu’elle voudrait... «Pauvre Annette! Tu peux te débattre!...» Sylvie était sûre, absolument sûre, qu’elle l’«aurait!» Railleuse, attendrie quand même, elle lui chuchotait, en pensée:
—Va! je n’en abuserai pas...
Elle n’en abuserait pas?... Et pourquoi donc point? C’est amusant d’abuser! Après tout, la vie, c’est la guerre. Au vainqueur, tous les droits! Si le vaincu y consent, c’est qu’il y trouve son compte!
Un lundi matin, elle faisait des courses, lorsque, dans la rue de Sèvres, un peu plus loin devant elle, marchant dans le même sens, elle aperçut Annette. Elle s’amusa à la suivre, quelque temps, pour l’observer. Annette marchait à grands pas, selon son habitude. Sylvie, aux petits pas, vifs, souples et dansants, riait de son allure garçonnière et sportive; mais elle appréciait la belle harmonie de ce corps vigoureux. La tête droite, sans regarder autour d’elle, Annette était absorbée. Sylvie la rattrapa, et continua de cheminer sur le trottoir auprès d’elle, sans qu’Annette la remarquât. Imitant sa démarche, et lorgnant du coin de l’œil la joue de la grande sœur, que paraissait pâlir une ombre de mélancolie, Sylvie, sans tourner la tête, remuait les lèvres, disant tout bas:
—Annette...
Impossible de l’entendre, dans le bruit de la rue. Sylvie s’entendait à peine. Annette l’entendit pourtant. Ou bien eut-elle conscience de ce «double» moqueur, qui, depuis quelques instants, l’escortait en silence? Elle vit soudain près d’elle le profil amusé, les lèvres qui remuaient comiquement sans parler, le petit œil rieur qui regardait de côté... Alors, elle s’arrêta, avec un de ces mouvements de joie impétueuse, qui avaient, une fois déjà, surpris, séduit Sylvie. Les bras brusquement tendus. Un élan de tout l’être. Sylvie pensait:
—Elle va bondir...
Un instant seulement. Déjà, elle s’était ressaisie; et, presque froidement, elle dit:
—Bonjour, Sylvie.
Mais ses joues s’étaient colorées; et sa raideur ne tint pas devant l’éclat de rire de la petite, enchantée de sa gaminerie. Elle rit avec elle:
—Ah! tu m’as attrapée!
Sylvie lui prit le bras, et elles continuèrent leur chemin, modelant tendrement leur pas, l’une sur l’autre.
—Tu étais là depuis longtemps? demandait Annette.
—Oh! depuis une demi-heure! affirma, sans hésiter, Sylvie.
—Non? s’exclamait la crédule Annette.
—Je suivais tes mouvements. Je voyais tout. Tout. Tu parlais en marchant.
—Ce n’est pas vrai! ce n’est pas vrai! protesta Annette. Ah! la petite menteuse!...
Leurs deux bras se serrèrent. Elles se mirent à bavarder des courses qu’elles venaient de faire. Elles étaient toutes joyeuses. Au milieu d’un récit passionnant d’une Exposition de blanc, au Bon Marché, où l’une était allée, où l’autre devait aller,—dans le vacarme d’une rue qu’elles traversaient, se glissant entre les voitures, avec le sûr instinct de deux petites Parisiennes, Sylvie murmura à l’oreille d’Annette:
—Tu ne m’as pas embrassée!...
Un mouvement brusque d’Annette faillit les faire écraser. En abordant le trottoir, sans cesser de marcher, leurs deux becs se joignirent... Elles allaient maintenant, plus étroitement serrées, dans une rue plus calme, qui menait... Où menait-elle?...
—Où est-ce que nous allons?
Elles s’arrêtèrent, amusées de constater que, dans leur bavardage, elles s’étaient égarées. Sylvie, agrippant Annette, dit:
—Déjeuner ensemble.
Annette se défendait,—(l’imprévu la charmait, mais la gênait un peu: elle était méthodique),—parlant de sa vieille tante, qui là-bas l’attendait. Mais Sylvie ne s’embarrassait pas de ces menus détails: elle s’était emparée d’Annette, et ne la lâcherait pas. Elle la fit téléphoner d’un bureau à la tante, et elle l’emmena dans une crémerie de sa connaissance. Ce fut pour les deux jeunes filles, et surtout pour Annette, une partie de plaisir, ce petit déjeuner que Sylvie tenait à offrir à sa sœur plus fortunée: (celle-ci l’avait compris). Annette trouvait tout exquis. Elle s’extasiait sur le pain, sur la côtelette bien cuite. Et il y eut, à la fin, des fraises dans de la crème, dont elles se régalèrent, à petits coups de langue.
Mais les langues étaient encore plus occupées à causer qu’à manger. Elles ne parlaient pourtant que de choses insignifiantes, s’imbibant l’une de l’autre, de leurs regards et de leur voix et de leur rayonnement. L’instinct a ses chemins, et plus courts et meilleurs. Il n’était pas encore temps de toucher aux sujets essentiels. Elles tournaient autour, tournaient joyeusement, telles ces guêpes bourdonnantes, qui font dix fois le tour d’une assiette, avant de s’y poser.—Elles ne s’y posèrent pas...
Sylvie se leva, et dit:
—Maintenant, il faut aller travailler.
Annette fit la mine penaude d’un enfant à qui on enlève brusquement son dessert. Elle dit:
—On était si bien! Je n’en ai pas assez.
—Moi non plus, dit Sylvie en riant. Quand est-ce qu’on en reprend?
—Le plus tôt, et le plus long... C’était trop vite fini.
—Ce soir, alors. Viens me chercher, vers six heures, à la porte de l’atelier.
Annette se troubla:
—Mais est-ce que nous serons seules?
Elle s’inquiétait de l’idée qu’elle pourrait rencontrer «l’autre».
Sylvie lut en elle:
—Oui, oui, on sera seules, dit-elle, indulgente, avec une pointe d’ironie. Elle expliqua tranquillement que l’ami était allé passer deux ou trois jours en province, dans sa famille. Annette avait rougi que Sylvie l’eût devinée. Elle ne se souvenait plus que, la veille, le matin, elle était résolue à lui marquer sa désapprobation morale. En fait de morale, elle ne vit plus qu’une chose: «Ce soir, il ne serait pas là».
—Quel bonheur! on pourra passer toute la soirée ensemble.
Elle le dit, en tapant des mains. Sylvie balança son pied, comme si elle allait danser, grimaça de plaisir, dit:
—Tout le monde est content.
prit un air distingué, parce qu’un monsieur venait d’entrer, dit:
—Au revoir, ma chère, et fila comme un trait.
Elles se retrouvèrent, quelques heures plus tard, dans la sortie de l’essaim baguenaudeur.—Babillant, lorgnant, trottant, achevant de se coiffer devant un miroir de poche, ou devant la glace du coin, les petites cousettes se retournaient en passant, et, de leurs yeux battus, vifs et curieux, dévisageaient Annette,—encore dix pas plus loin, trottant, lorgnant, babillant, se retournaient pour regarder Sylvie qui embrassait Annette. Et Annette avait peine, en voyant que Sylvie avait bavardé.
Elle emmena sa sœur dîner à Boulogne. Sylvie s’était invitée. Pour épargner la tante, qui eût fait des «Oh!», des «Ah!», il fut convenu en route que Sylvie serait présentée, à titre d’amie. Ce qui ne l’empêcha pas, à la fin du dîner, quand la vieille dame se retira dans sa chambre, conquise par les gentillesses de la petite rusée, de l’appeler: «Ma tante», comme par jeu familier...
Seules, dans le grand jardin, par la claire nuit d’été. Tendrement enlacées, elles allaient à petits pas, aspirant l’haleine des fleurs lasses, qui s’exhale à l’orée d’un beau jour. Comme les fleurs, leur âme exhalait ses secrets. Aux questions d’Annette, Sylvie répondait, cette fois, sans trop cacher. Elle racontait sa vie, depuis la petite enfance; et d’abord, ses souvenirs du père. Elles en parlaient maintenant sans gêne et sans mutuelle envie; il leur appartenait à toutes deux, et elles le jugeaient d’un sourire indulgent, ironique, comme un grand gosse amusant, séduisant, pas sérieux, pas très sage...
—(Tous les hommes sont de même!)—On ne lui en voulait pas...
—Dis, Annette, s’il avait été sage, je ne serais pas ici...
Annette lui pressait la main.
—Aïe! ne serre pas si fort!
Sylvie parla ensuite de la boutique de fleuriste, où elle avait, enfant, assise sous le comptoir, avec les fleurs tombées, tressé ses premiers rêves,—ses premières expériences de la vie de Paris, en écoutant causer sa mère et les clients,—puis, quand mourut Delphine,—(Sylvie avait treize ans),—son apprentissage chez une couturière, qui était l’amie de la mère, et l’avait recueillie,—puis, après une année et la mort de la patronne, usée par le travail, (on s’use vite, à Paris!) ses divers avatars. Des notations crues, des expériences amères, toujours contées gaiement, vues avec drôlerie. Elle peignait au passage les types et les caractères, piquant d’un coup d’aiguille, sur la trame du récit, un trait, une saillie, un mot ou un museau. Elle ne contait pas tout; elle avait un peu plus expérimenté la vie qu’elle ne disait et que peut-être il ne lui plaisait de s’en souvenir. Elle se rattrapait sur le chapitre de l’ami,—de l’ami dernier. (S’il y avait d’autres chapitres, elle les garda pour elle). Un étudiant en médecine, rencontré à un bal de quartier: (elle se fût bien privée de dîner, pour danser!) Pas très beau, mais gentil, grand, brun, les yeux rieurs, qui se plissaient au coin, les narines retroussées, un nez de bon chien, amusant, affectueux... Elle le décrivait sans le moindre emballement, mais avec complaisance, vantant ses qualités, aussi le blaguant un peu, satisfaite de son choix. Elle s’interrompait pour rire, à certains souvenirs qu’elle disait, et à d’autres qu’elle ne disait pas. Annette, tout oreilles, troublée, intéressée, se taisait, glissant çà et là quelques paroles gênées. Sylvie lui tenait la main, et de son autre main libre, comme égrenant un chapelet, lui caressait le bout des doigts, un à un, en parlant. Elle percevait la gêne de sa sœur, elle l’aimait et s’en amusait.
Les deux jeunes filles s’étaient assises sur un banc, sous les arbres; et dans la nuit venue elles ne se voyaient plus. Ce petit diable de Sylvie en profita pour conter des scènes un peu lestes et fort tendres, afin d’intimider tout à fait la grande sœur. Annette devinait sa malice; elle ne savait si elle devait sourire ou blâmer, elle eût voulu blâmer; mais elle était si jolie, la petite sœur! Sa voix sonnait si riante, sa joie semblait si saine! Annette respirait à peine, tâchant de ne pas montrer l’émoi où la jetaient ces récits amoureux. Sylvie, qui sentait sous ses doigts les émotions de l’autre, s’arrêta pour en jouir et préparer une malice nouvelle: et, se penchant vers Annette, à mi-voix, candidement, lui demanda si elle avait aussi un ami. Annette tressaillit—(elle ne s’y attendait pas)—et rougit. Les yeux perçants de Sylvie cherchaient à voir ses traits dans l’ombre protectrice; et, n’y parvenant pas, elle promena ses doigts sur la joue d’Annette...
—Elle brûle, dit-elle, en riant.
Annette riait gauchement, et brûlait encore plus. Sylvie se jeta à son cou.
—Ma sotte, ma bécasse, comme tu es donc mignonne! Non, tu es impayable! Ne m’en veux pas! Je me tords. Je t’aime bien. Aime un peu ta Sylvie! C’est pas grand’chose de bon. Mais tel quel, c’est à toi. Annette, ma canette! Tends ton bec, je t’amoure!...
Annette, passionnément, la serra dans ses bras, jusqu’à en perdre haleine. Sylvie, se dégageant, dit d’un ton connaisseur:
—Tu sais bien embrasser. Qu’est-ce qui t’a appris?
Annette lui ferma la bouche, rudement, avec sa main:
—Ne plaisante pas toujours!
—Pardon, je ne le ferai plus.
Et, la joue appuyée sur le bras de sa sœur, elle resta sagement sans parler, écoutant, regardant sur l’obscure transparence d’un pan de ciel échancré par les branches de l’arbre, dans les demi-ténèbres, le visage d’Annette qui s’inclinait vers elle et tout bas lui parlait.
Annette ouvrait son cœur. Elle disait, à son tour, la plénitude heureuse de sa jeunesse solitaire, cette aube de petite Diane, passionnée, mais sans troubles, qui jouit de ce qu’elle désire, non moins que de ce qu’elle possède, car entre l’un et l’autre, il n’y a pour elle d’autre distance que d’aujourd’hui à demain. Et elle est si sûre de demain qu’elle en goûte par avance à la treille le parfum de jasmin, sans se presser de le cueillir.
Elle conta le tranquille égoïsme de ces années, vides d’événements, gonflées du suc des rêves. Elle dit l’intimité, la tendresse absorbante qui la liait à son père. Et, en se racontant, il lui arrivait ceci de singulier qu’elle se découvrait: car, jusqu’à cette heure, elle n’avait pas eu l’occasion d’analyser son passé. Elle en était, par instants, effarée. Elle s’arrêtait dans son récit; tantôt elle avait de la peine à s’exprimer, tantôt elle s’exprimait avec une ardeur trouble et imagée. Sylvie ne comprenait pas toujours, s’amusait, écoutait moins qu’elle n’observait l’expression du visage, du corps et de la voix.
Annette avouait maintenant la souffrance jalouse, que lui avait apportée la découverte de la seconde famille que son père lui avait cachée, et le bouleversement où la jeta l’existence de cette rivale, de cette sœur. Avec sa franchise brûlante, elle ne dissimula rien de ce dont elle rougissait; sa passion se réveillait, tandis qu’elle l’évoquait; elle dit:
—Je t’ai haïe!...
d’un accent si emporté qu’elle s’arrêta, saisie du son de sa voix. Sylvie, beaucoup moins émue, mais très intéressée, sentait contre sa joue frémir la main d’Annette, et pensait:
—Il y en a du feu, là dedans!
Annette avait repris la suite des aveux qui lui coûtaient. Et Sylvie se disait:
—Est-elle drôle de tout me raconter!
Mais elle sentait croître pour l’étrange grande sœur un respect, certes moqueur, mais infiniment tendre, qui lui faisait frotter câlinement son visage contre la paume fraternelle...
Annette, dans son récit, en était venue au point où l’attrait de la sœur inconnue s’était emparé d’elle, malgré sa résistance, et où, pour la première fois, elle avait vu Sylvie. Mais ici, la franchise ne put vaincre l’émotion de son cœur. Elle essaya de poursuivre, s’arrêta et, renonçant, elle dit:
—Je ne puis plus...
Le silence se fit. Sylvie souriait. Elle se souleva, rapprocha son visage de celui de sa sœur, et, lui pinçant le menton, elle lui souffla tout bas:
—Tu es une grande amoureuse.
—Moi! protesta Annette, toute confuse.
Sylvie s’était levée du banc, et, debout devant sa sœur, elle lui serra la tête tendrement contre son corps, et dit:
A partir de ce jour, les deux sœurs se virent constamment. Il ne se passa plus de semaine qu’elles ne se réunissent. Sylvie venait le soir, à Boulogne, surprendre Annette. Plus rarement, Annette retournait chez Sylvie. Par une convention tacite, elles s’arrangeaient de façon qu’Annette ne pût rencontrer l’ami. Elles adoptèrent un jour régulier pour déjeuner ensemble à la crémerie, et jouaient à se donner rendez-vous, ça et là dans Paris. Elles avaient autant de joie l’une que l’autre, à se retrouver ensemble. Ce devint un besoin. Les jours où on ne s’était pas vues, les heures se traînaient, la vieille tante ne parvenait pas à rompre le mutisme d’Annette, et Sylvie, maussade, turlupinait l’ami, qui n’en pouvait mais. La seule chose qui permît de tolérer l’attente était la pensée de tout ce qu’on aurait à se dire, quand on se reverrait. Cela ne suffisait pas toujours; et jamais Annette ne fut aussi heureuse qu’un soir, passé dix heures, quand Sylvie sonna à la porte, disant qu’elle n’avait pu attendre au lendemain pour l’embrasser. Elle brûlait de la retenir; mais la petite, qui n’avait, jurait-elle, que cinq minutes à rester, repartit en courant, après une heure de caquetage, tout d’un trait, sans souffler.
Annette eût voulu faire profiter sa sœur de sa maison, de son bien-être. Mais Sylvie avait une façon brusque d’écarter toutes les tentatives: elle avait mis dans sa tête—sa petite tête butée—qu’elle n’accepterait aucune avance d’argent. Elle ne faisait, en revanche, aucune difficulté pour accepter un objet de toilette, ou bien pour «l’emprunter»: (ce qu’elle empruntait, elle oubliait de le rendre). Il lui arriva même, une ou deux fois, de chiper... oh! rien d’important!... Et, bien entendu, elle n’eût jamais touché à une pièce de monnaie! L’argent, ça c’est sacré! Mais un petit bibelot, un bijou sans valeur... Elle n’y résistait pas. Annette avait remarqué ce jeu de petite gazza ladra; et elle en était gênée. Pourquoi Sylvie ne lui demandait-elle pas? Elle eût été si heureuse de lui donner! Elle tâchait de ne pas voir.—Mais le grand plaisir était d’échanger entre les deux sœurs une blouse, un cache-corset, le linge de leur corps: la passion d’Annette s’en alimentait. Sylvie était experte dans l’art de s’ajuster les robes de sa sœur; et son goût modifiait le goût plus sérieux d’Annette. L’effet n’en était pas toujours très heureux, car Annette, trop éprise, exagérait parfois l’imitation, au delà de ce qui seyait à son style personnel; et Sylvie, amusée, devait retenir son zèle. Beaucoup plus avisée, elle savait, sans le dire, profiter de ce que lui apprenait la sobre distinction d’Annette, certaines nuances de parler, de gestes et de manières; mais sa copie était si fine qu’on eût dit que son modèle la lui eût empruntée.
Cependant, malgré leur intimité, Annette ne parvenait à connaître qu’une part de la vie de sa sœur. Sylvie avait son indépendance; et elle aimait à la faire sentir. Au fond, elle n’avait pas tout à fait désarmé, de son hostilité de classe; elle tenait à ce qu’Annette vît bien qu’on ne disposait pas d’elle et qu’on n’entrait chez elle qu’autant qu’il lui plaisait. D’ailleurs, son amour-propre n’était pas sans remarquer que sa sœur n’approuvait pas tout en elle. Notamment sa liaison amoureuse. Bien qu’Annette fît effort pour l’accepter, elle ne savait pas dissimuler la gêne que ce sujet lui causait. Ou bien elle le fuyait, ou, quand elle s’obligeait à en parler, avec le désir sincère de faire plaisir à Sylvie, elle avait dans le ton un rien de forcé, que percevait Sylvie; et celle-ci, d’un mot, écartait le sujet. Annette s’en attristait. Elle voulait de tout cœur que Sylvie fût heureuse, heureuse à sa manière. Que cette manière ne fût point celle qu’elle eût préférée, elle ne voulait pas le montrer. Mais elle le montrait sans doute. Quand on a des sentiments forts, on n’est pas très adroit.—Sylvie lui en voulait; et elle se vengeait par son silence. Il fallait un hasard pour qu’Annette apprît, plusieurs semaines après, certains événements importants dans la vie de la jeune sœur.
A vrai dire, de leur importance, il était impossible de faire convenir Sylvie; et peut-être glissaient-ils en effet sur l’élasticité de son tempérament; mais il se pouvait aussi que son amour-propre le prétendît plus que ce n’était. Annette, incidemment, reçut ainsi la nouvelle que, «depuis quelque temps»,—(impossible de préciser: c’était de «l’histoire ancienne»!...)—l’ami n’était plus là, la liaison s’était dénouée. Sylvie ne s’en montrait pas autrement affectée. Annette l’était davantage; mais ce n’était point de regrets. Elle essaya gauchement de savoir ce qui s’était passé. Sylvie haussait les épaules, riait, disait:
—Il ne s’est rien passé. C’est passé, voilà tout.
Annette eût dû s’en réjouir; mais ces mots de sa sœur lui causaient une peine.... Quel étrange sentiment! Comme elle était mal faite!... Ah! ce mot: «passer»..., pour le monde du cœur! Et qu’on le dît en riant!....
Mais cette grande nouvelle—(c’en était une pour elle)—fut, peu après, suivie d’une autre découverte. Un jour qu’Annette annonçait l’intention d’aller prendre sa sœur, au sortir de l’atelier, Sylvie dit tranquillement:
—Non, non, je n’y suis plus...
—Comment? fit Annette, étonnée. Depuis quand?
—Oh! depuis quelque temps...
(Toujours la même façon évasive de compter! Ç’aurait pu être aussi bien la veille que l’an dernier!)
—Qu’est-ce qui est arrivé?
—Il est arrivé.... ce qui arrive chaque année: (ainsi que dans Malbrough... «z-à Pâques ou à la Trinité...») Sitôt après le Grand-Prix, vient la morte-saison. Les patronnes se font rosses, pour nous fournir généreusement le prétexte de nous faire fiche à la porte.
—Mais alors, où es-tu?
—Oh! je suis ici et là. Je vais, je cours, je fais un peu de tout.
Annette était consternée:
—Alors, tu es sans place, et tu ne me le dis pas!
Sylvie jouait celle «qui ne s’en fait pas», qui a bien l’habitude! Négligemment, elle expliquait, d’un petit air de supériorité, (pas fâchée dans le fond, de l’émotion produite), qu’elle bâclait des costumes bon marché pour des entrepreneuses de confections, elle ourlait des petites robes, elle cousait des pantalons d’hommes—(elle bouffonnait en le racontant).—Mais Annette ne riait point. Serrant de près son enquête, elle découvrait que sa sœur courait à droite, à gauche, pour trouver du travail, et qu’elle en acceptait parfois d’exténuant, de rebutant. Maintenant, elle comprenait pourquoi la petite, «depuis quelque temps», lui paraissait pâlie... Pourquoi elle était restée plusieurs jours sans venir, donnant de mauvais prétextes, des mensonges absurdes, afin de passer sans doute une partie de la nuit à s’user les doigts et les yeux à sa couture... Sylvie continuait de conter, à sa façon railleuse d’indifférence affectée, ses petites mésaventures. Mais elle vit les lèvres de sa sœur qui tremblaient de colère. Et brusquement, Annette éclata:
—Non! fit-elle, c’est indigne! Je ne puis pas, je ne puis pas le supporter! Quoi! tu dis que tu m’aimes, tu m’as demandé toi-même que l’on soit des amies, tu prétends en être une, et tu me caches tout le plus grave de ce qui te concerne!...
(La lèvre retroussée de Sylvie faisait: «Peuh! quelle importance!...»—Mais Annette ne la laissa pas parler, le torrent était lâché).
—... J’avais confiance en toi, je croyais que tu me dirais tes peines, tes ennuis, comme je te dis les miens, que tout serait en commun... Et tu me tiens à l’écart, ainsi qu’une étrangère; je ne sais rien, je ne sais rien! Sans un hasard, je n’aurais jamais appris que tu te trouves gênée, que tu cours après une place, que tu ruines ta santé; et tu accepterais n’importe quel travail, plutôt que de m’en parler, quand tu sais que mon bonheur serait de t’aider... C’est mal, c’est mal! Tu m’as blessée. C’est un manque de franchise, c’est un manque d’amitié!... Mais je ne le tolérerai plus!... Non!... Pour commencer, tu vas venir chez moi, et tu y resteras, jusqu’à ce que la période de chômage soit passée...
(Sylvie secouait la tête).
—... Tu viendras, ne dis pas non! Écoute-moi bien, Sylvie, je ne te le pardonnerais pas. Si tu me disais non, je ne te verrais plus, de ma vie...
Sans se donner la peine de s’excuser, d’expliquer, Sylvie, souriante et entêtée, faisait:
—Non, non, chérie.
Elle avait grand plaisir de l’agitation d’Annette, qui ne se possédait plus, qui était près de pleurer, qui l’aurait bien battue. Elle pensait:
—Quand elle est animée, comme elle est plus jolie!
Mais elle n’en démordit point. Elle était bien aise de montrer à Annette qu’elle avait, elle aussi, sa petite volonté.
Le visage empourpré de colère, Annette répétait, suppliante, impérieuse:
—Reste!... Tu resteras... Je le veux... C’est dit?... Tu restes?... Tu restes?... Réponds!... C’est oui?...
Avec son même sourire exaspérant, la petite têtue répondit:
—C’est non, chérie.
Annette s’éloigna, d’un mouvement emporté:
—Alors, tout est fini.
Et, lui tournant le dos, elle alla vers la fenêtre et ne sembla plus voir Sylvie.—La petite attendit un moment, puis se leva et, de sa voix câline, dit:
—Au revoir, Annette.
Annette ne se retourna pas.
—Adieu, dit-elle.
Ses mains étaient crispées. Si elle avait fait un mouvement, Dieu sait ce qui fût arrivé! Elle eût pleuré, crié... Elle resta sans bouger, hautaine et glacée. Sylvie, un peu gênée, non sans quelque inquiétude, malgré tout amusée, s’en allant, derrière la porte lui fit un pied-de-nez.
Elle n’était pas très fière—(un peu fière, tout de même)—de sa belle résistance. Annette ne l’était pas davantage de son emportement. Avec consternation, elle se disait maintenant qu’elle avait coupé les ponts: au lieu d’être patiente, adroite, de conquérir Sylvie, elle l’avait presque chassée. Sylvie ne reviendrait plus, c’était un fait certain. Annette, par son dilemme, lui avait fermé sa porte. Et elle s’était interdit à elle-même de la lui rouvrir. Elle ne pouvait pourtant pas, après ses déclarations, aller chercher Sylvie! C’était s’avouer vaincue. Sa fierté ne le permettait pas. Ni même son bon droit. Car Sylvie avait mal agi... Non, non, elle n’irait pas!...
Elle mit son chapeau, et alla droit chez Sylvie.
Sylvie venait de rentrer. Songeuse, elle examinait la situation embrouillée. Elle la trouvait stupide, mais elle ne voyait pas le moyen d’en sortir: car elle n’envisageait pas l’idée de se plier à la volonté d’Annette, et elle n’envisageait pas davantage celle qu’Annette plierait. Au fond, elle trouvait que la Canette n’avait pas tort. Mais elle ne voulait pas céder. Sylvie n’était pas insensible aux biens de la fortune. Ceux dont disposait Annette avaient, sans qu’il y parût, suffisamment éveillé en elle la tentation et l’envie. (On ne peut pas s’en défendre, même quand on n’est pas—presque pas—envieuse!... Est-ce qu’on peut se défendre, quand on a un jeune corps, tout plein de beaux petits désirs, de se dire ce qu’on eût fait de la fortune, et comme on eût mieux su en jouir que les maladroits qui l’ont reçue dans leur bec, toute rôtie!...) Et—elle n’en convenait pas—mais elle en voulait un peu à Annette... Pourtant, si c’était une faute, Annette tâchait de se la faire pardonner.—Mais justement, Sylvie ne tenait pas à la lui pardonner... Oh! tout cela ne s’avoue pas! Chacun cultive en soi, bien cachés, cinq ou six petits monstres. Et l’on ne s’en vante point, on n’a pas l’air de les voir; mais on n’est pas du tout pressé de s’en débarrasser....—Un sentiment plus avouable était que, tentée par ces biens qu’elle n’avait pas, Sylvie voulait se donner le luxe de paraître les dédaigner... Mais, en vérité, ce luxe était sans charme; et il faisait peu d’usage.—Non, décidément, Sylvie ne goûtait pas un plaisir bien vif de sa victoire; il n’y avait pas de quoi se pavaner, si elle avait vaincu, à ses dépens! Ce qui rendait cette constatation plus pénible, c’est qu’en réalité, sa situation n’avait rien de plaisant. Sylvie avait beaucoup de mal à se tirer d’affaire. Le nombre des chômeurs était considérable; et naturellement, les exploiteurs en abusaient. La santé de la petite n’était pas très brillante. Les chaleurs écrasantes d’un mois de juillet torride, les veilles, la nourriture médiocre, l’eau fade ingurgitée, avaient produit une crise d’entérite avec dysenterie, dont elle était affaiblie. Sous le gril de son toit rôti par le soleil, ses persiennes baissées, Sylvie, à demi nue, la peau brûlante, cherchant un objet frais pour y poser les mains, pensait qu’il eût fait bien bon dans la maison de Boulogne; et, comme elle était, à défaut d’autres biens, abondamment dotée d’ironie, elle s’égayait de sa stupidité. Elle avait bien travaillé!... Et dire qu’elle et Annette étaient d’accord, au fond!... Maintenant, elles s’étaient butées... Mon Dieu! qu’on est donc bête!... Nulle des deux ne céderait!...
Et bien sûre, en effet, qu’elle ne céderait point, qu’elle serait bête jusqu’au bout, elle souriait, retroussant sa lèvre pâle, quand elle entendit dans le couloir les pas impétueux d’Annette. Tout de suite, elle les reconnut; elle bondit sur ses pieds:
—Annette revenait!... Chère fille!...
Elle ne l’attendait pas... Certes, Annette était «la plus bonne!...»
Annette était déjà entrée. Toute rouge de passion et de la chaleur de sa course, elle ne savait ce qu’elle allait faire; mais à peine entra-t-elle qu’aussitôt elle le sut. Suffoquée par l’atmosphère de four qui embrasait la demi-obscurité de la chambre, de nouveau elle fut prise d’une colère passionnée. Elle alla à Sylvie, qui se jeta à son cou; elle lui serra les épaules moites, de ses mains impatientes; et, sans répondre à ses baisers, elle dit, d’une voix irritée:
—Je t’emmène... Habille-toi... Et ne discute pas!
Sylvie discutait tout de même, pour n’en pas perdre l’habitude. Elle faisait mine de protester. Mais elle se laissait faire. Annette l’habillait impérieusement, lui mettait ses bottines, lui boutonnait sa blouse, lui piquait avec brusquerie son chapeau sur la tête, la remuait comme un paquet. Sylvie disait toujours: «Non, non, non», poussait de petits cris indignés, pour la forme; mais elle était ravie de se sentir brutalisée. Et quand Annette eut fini, elle lui prit les deux mains, les baisa, y imprima la marque de ses quenottes, et, riant de contentement, elle dit:
—Madame Tempête... Rien à faire! Je me soumets... Emporte!...
Annette l’emporta. Elle lui avait pris le bras dans ses fortes mains, qui tenaient comme un étau. Elles montèrent en taxi.—Quand elles furent arrivées, Sylvie dit à Annette:
—Je puis te le dire maintenant: eh bien, j’en mourais d’envie.
—Pourquoi étais-tu si méchante? demanda, grondeuse et heureuse, Annette.
Sylvie prit la main d’Annette, et de l’index recourbé fit: «toc, toc» sur son petit front bombé.
—Oui, il en a de la malice! fit Annette.
—Il est pareil au tien, dit Sylvie, lui montrant dans une glace leurs deux fronts obstinés. Elles sourirent l’une à l’autre.
—Et, ajouta Sylvie, on sait de qui cela vient.
La chambre de Sylvie l’attendait depuis longtemps. Même avant de connaître l’existence de Sylvie, Annette tenait la cage prête pour l’amie qui viendrait.—L’amie n’était pas venue: à peine avait-on cru voir son ombre, deux ou trois fois. La personnalité d’Annette assez à part des autres, ses manières, tour à tour froides et ardentes, l’impétueuse brusquerie d’élans qui surprenaient dans une nature réservée, je ne sais quoi d’étrange, d’exigeant, d’impérieux qui, sans qu’elle s’en doutât, couvait et jetait des lueurs, même aux heures où elle était pénétrée du désir de se donner avec une humilité passionnée,—écartaient les jeunes filles de son âge, qui sans doute l’estimaient et subissaient (dirait-on) son fluide, mais prudemment, à distance. Sylvie était la première à prendre possession de la cage d’amitié. On peut croire que ce fut sans trouble, et qu’elle n’était pas en peine d’en sortir, le jour qu’il lui plairait. Annette ne l’intimidait guère. Elle n’eut même aucune surprise de la chambre où elle fut installée. Dès sa première visite, à certains petits détails d’ingénieuse tendresse, et au trouble maladroit d’Annette en la lui montrant, elle avait deviné que ce devait être pour elle.
Maintenant qu’elle s’était reconnue vaincue,—pour son avantage—elle n’opposait plus la moindre résistance. Encore languissante de sa crise d’entérite, la petite convalescente s’abandonnait avec bonheur aux gâteries dont l’entourait sa sœur. Le médecin, appelé, l’avait trouvée anémiée, et il avait conseillé un changement d’air, un séjour d’altitude. Mais ni l’une ni l’autre n’était pressée de quitter le nid commun; et elles surent, enjôleuses, se faire dire par le médecin qu’après tout, à Boulogne, on était aussi bien, et que même, en un sens, c’était peut-être mieux que Sylvie commençât par se reconstituer dans un repos complet, avant d’aller demander à l’air vif des montagnes un bon petit coup de fouet.
Sylvie put donc s’en donner, de paresser au lit. Il y avait si longtemps que ce ne lui était arrivé! C’était délicieux de dormir, tout son soûl, de dormir pour tous les sommeils rentrés, et—le plus délicieux—de rester sans dormir, les membres étirés dans de beaux draps bien doux, le corps qui n’en peut plus de torpeur et de bonheur, et de chercher du pied les coins frais dans le lit. Et de rêver, et de rêver!... Oh! ils n’allaient pas loin, les rêves! Ils tournaient tous en rond, comme cette mouche au plafond. Ils n’arrivaient même pas à terminer leur phrase. Ils répétaient vingt fois, d’une langue empâtée, une histoire, un projet, un souvenir d’atelier, d’amoureux, ou de chapeau. Au milieu, ils repiquaient une tête dans l’étang au sommeil...
—Mais dis donc, dis donc, Sylvie!... (elle protestait, en rêve)... Ce n’est pas une vie... Veux-tu sortir de là!
En entr’ouvrant un œil, elle apercevait sa sœur, qui se penchait sur elle, et elle faisait effort—(les mots passaient à peine)—pour dire:
—Annette!... Éveille-moi!
Annette disait:
—Marmotte!
et riait, en la secouant. Sylvie jouait à l’enfant:
—Oh! ma petite maman, qu’est-ce que j’ai donc fait, pour avoir si sommeil?
Le grand amour d’Annette se déversait en transports maternels. Assise sur le lit, il lui semblait que la chère tête qu’elle pressait contre son sein était celle de sa fille. Sylvie se laissait faire, avec de petites plaintes:
—Mais comment est-ce que je ferai pour me remettre jamais à mon travail, après?
—Tu ne travailleras plus.
—Ah! mais si, par exemple! se révoltait Sylvie.
Du coup, elle était réveillée; se dégageant de sa sœur, sur son séant dressée, la petite ébouriffée fixait Annette, d’un air qui la défiait.
—Voilà qu’elle croit encore qu’on veut la retenir de force!... Mais, ma fille, va-t’en! disait Annette, en riant. Va, si le cœur t’en dit! Personne ne tient à toi!...
—Si c’est comme ça, je reste! faisait l’esprit de contradiction. Et Sylvie se renfonçait dans le lit, fatiguée de l’effort.
Mais cette fainéantise ne dura que quelques jours; et, gavée de sommeil, vint, après, la période où il n’était plus possible de la tenir en repos. Elle trôlait tout le jour, à moitié habillée: dans les pantoufles de sa sœur, trop larges pour ses pieds nus, dans le peignoir de sa sœur, qu’elle retroussait en toge, les bras et les mollets nus, elle allait de chambre en chambre, regardant, explorant tout. Elle n’avait pas beaucoup la notion du «tien». (Du «mien», c’était une autre affaire!) Annette lui ayant dit: «Tu es chez toi», elle l’avait prise au mot. Elle farfouillait partout. Elle essayait de tout. Elle pataugeait, des heures, dans la salle de bains. Elle ne laissait pas un coin sans l’avoir inspecté. Annette la trouva, le nez dans ses papiers, qui, au reste, eurent vite fait de la lasser. Et la tante, ébahie, reçut l’invasion de la petite court-vêtue, qui, après avoir fureté sur tous les meubles, remué tous les objets, et dit des mots mignons à leur propriétaire, (laquelle suivait en émoi chacun de ses mouvements), laissa tout en désordre, et la vieille demoiselle, scandalisée, charmée.
Alors, la maison fut pleine d’un intarissable babil, d’un bavardage sans queue ni tête, sans fin, sans raison de finir. En n’importe quel lieu, en n’importe quel costume, perchées sur le bras d’un fauteuil, ou le peigne à la main, se démêlant les cheveux, ou brusquement arrêtées sur une marche de l’escalier, ou en peignoir de bain, le matin, au sortir du tub,—les deux amies parlaient, parlaient, parlaient; et, une fois commencé, cela pouvait durer des heures ou des journées. Elles en oubliaient de se coucher; la tante protestait en vain, toussotait, frappait au plafond; elles tâchaient de mettre une sourdine à leur voix, en s’étouffant de rire; mais, au bout de cinq minutes... paf! le petit hautbois de Sylvie se remettait à flûter, et l’on entendait les exclamations heureuses ou indignées d’Annette, qui s’emballait toujours, et que la petite avait le don de faire monter à l’arbre. Cette fois, les coups devenaient tout à fait fâchés. Alors, on se décidait à se «pagnoter»; mais cela en durait encore un temps, le déshabillage! Les deux chambres se touchaient, les portes restaient ouvertes, on était constamment sortie de ses frontières, on causait en jupon, on causait sans jupon, et l’on eût d’un lit à l’autre causé toute la nuit, si le sommeil de la jeunesse ne fût venu tout d’un coup mettre un terme à leur clappette. Il s’abattait sur elles, d’un trait, comme un épervier sur un petit poulet. Elles tombaient sur l’oreiller, bouche ouverte, au milieu d’une phrase. Annette dormait comme une masse; son sommeil était lourd, très souvent agité, orageux, saturé de rêves; elle bousculait ses draps, elle parlait en dormant; mais elle ne s’éveillait point. Sylvie, au sommeil léger, avec un doux petit ronflement,—(si vous le lui aviez dit, elle se fût drapée dans sa dignité blessée)—se réveillait, écoutait, amusée, le charabia de sa sœur, quelquefois se levait, allait auprès du lit, où, les draps soulevés en montagne par les genoux repliés, Annette était prostrée; et, penchée à la clarté de la lampe-veilleuse—(car Annette ne pouvait dormir sans lumière)—elle épiait, intriguée, le visage épaissi, alourdi, mais étrangement passionné, parfois tragique, de la dormeuse engloutie dans l’océan des songes. Elle ne la reconnaissait plus...
—Annette? Ça? C’est ma sœur?...
Elle avait envie de l’éveiller brusquement, de lui passer les bras autour du cou:
—Loup, y es-tu?...
Mais elle était trop sûre que le loup y était, pour tenter l’expérience. Moins pure et plus normale que sa dangereuse aînée, elle jouait avec le feu, mais elle ne s’y brûlait pas.
Elles s’étudiaient l’une l’autre, longuement, s’habillant, se déshabillant, se comparant curieusement. Annette avait des accès de pudeur sauvage qui amusaient Sylvie, à la fois plus libre et plus claire. Souvent, Annette paraissait froide, on eût dit presque hostile; elle avait des violences, ou des larmes sans cause. Le bel équilibre lyonnais, dont naguère elle était fière, semblait bien compromis. Et le plus grave—c’était qu’elle ne le regrettait point.
Les confidences allaient loin, maintenant. Il ne serait pas aisé de les reproduire toutes. Des jeunes filles qui s’aiment en viennent naturellement dans leurs entretiens à des audaces tranquilles, qui gardent en leur bouche une demi-innocence, mais qui n’en auraient aucune, répétées par une autre. En ces propos s’accusait la différence des deux natures: l’amoralisme riant, bon enfant, de tout repos, de l’une; et le sérieux de l’autre, passionné, inquiétant, chargé d’électricité. Des heurts se produisaient: la légèreté gourmande et volontiers grivoise, avec laquelle Sylvie parlait des sujets amoureux, irritait Annette. Audacieuse dans l’âme, elle était réservée dans les mots; on eût dit qu’elle craignait d’entendre ce qu’elle pensait. Elle s’enfermait, par accès, à double tour, dans un mutisme farouche, qu’elle comprenait mal. Sylvie le comprenait beaucoup mieux. En quinze jours de vie commune, elle connaissait d’Annette plus qu’Annette n’en connaissait.
Ce n’était pourtant pas que ses facultés d’esprit s’élevassent au-dessus de la moyenne d’une aimable fille du peuple de Paris. En dehors d’un sens pratique, très juste et avisé—dont elle ne tirait point tout le parti possible, parce que, le plus souvent, elle préférait obéir à son caprice—il ne fallait pas beaucoup la sortir de sa sphère. Certes, tout l’amusait; mais rien ne l’intéressait à fond, hors la mode, qui n’en a point. Pour tout ce qui concernait l’art: tableaux, musique, lecture, elle ne dépassait point l’honnête médiocrité; elle ne l’atteignait pas toujours. Annette était souvent gênée par son goût. Sylvie s’en apercevait, et faisait:
—Ouf! j’ai gaffé encore... Eh bien, dis-moi ce qui se porte dans le monde comme il faut!...
(Elle parlait d’un tableau comme on parle d’un chapeau).
—... Qu’est-ce qu’on doit admirer? Une fois que je le saurai, je le ferai tout aussi bien qu’un autre...
Mais, d’autres fois, elle n’était pas aussi conciliante; elle tenait mordicus pour un héros de feuilleton, ou pour une romance fade, où elle voyait le dernier mot de l’art et du sentiment. Elle obligea cependant son aînée à découvrir la valeur, ou plutôt les promesses artistiques d’un genre, qu’Annette s’obstinait jusqu’alors à nier sans le connaître: le cinéma, dont Sylvie raffolait, à tort et à travers.
Il arrivait aussi qu’incapable de sentir la beauté d’un livre qu’elles lisaient ensemble, Sylvie comprît mieux qu’Annette la force de certaines pages, dont l’étrange vérité déconcertait sa sœur: car mieux qu’elle, Sylvie connaissait la vie. Et c’est le Livre des Livres. Ne le lit pas qui veut. Chacun le porte en soi, écrit de la première à la dernière ligne. Mais, pour le déchiffrer, il faut que le maître rude, l’Épreuve, en enseigne la langue. Sylvie en avait reçu les leçons, de bonne heure; elle lisait couramment. Annette commençait tard. Plus lentes à entrer, les leçons devaient pénétrer plus avant.
L’été fut, cette année, d’une ardeur excessive. Vers le milieu d’août, les beaux arbres du jardin étaient déjà brûlés. Dans les nuits embrasées, Sylvie tendait son bec pour gober au passage un souffle d’air. Elle était rétablie, mais elle restait pâlotte, et elle n’avait pas beaucoup d’appétit. De tout temps, elle était petite mangeuse, qui, si on l’eût laissée, eût dîné certains soirs d’une glace et de fruits. Mais Annette veillait. Mais Annette grondait. Elle avait fort à faire.—Elle décida enfin le voyage dans les montagnes, remis de semaine en semaine, avec l’arrière-pensée qu’on l’esquiverait. Elle eût voulu garder sa sœur pour elle seule, tout l’été.
Elles se rendirent dans une station des Grisons, dont Annette conservait, d’un séjour ancien, le souvenir d’une bonne et simple hôtellerie, dans un cadre pastoral, reposant, de la vieille Suisse. Mais, en quelques années, tout s’était transformé. L’hôtel avait essaimé. C’était une cité de palaces prétentieux. Dans les prairies, des routes d’autos étaient percées; et l’on entendait, au fond des bois, grincer un tramway électrique. Annette voulait fuir. Mais on était fatiguées par la nuit et le jour de voyage étouffants; on ne savait où aller; on n’avait envie que de rester étendues, sans bouger: du moins, où on était, si tout avait changé, l’air avait conservé sa pureté de cristal; Sylvie le suçait de la langue, comme ces glaces qu’à Paris, au milieu du brouhaha des rues, debout près de la voiture d’un marchand ambulant, elle léchait dans la coupe de verre. On se dit qu’on resterait quelques jours, jusqu’à ce qu’il fît moins chaud. Et puis, on s’habitua. On y trouva du charme.
La saison était animée. Un match de tennis attirait une alerte jeunesse de trois ou quatre nations. Il y avait des sauteries, de petites représentations. Un essaim bourdonnant flânait, flirtait, paradait. Annette s’en fût passée. Mais Sylvie s’amusait franchement; et le plaisir qu’elle montrait se communiqua à sa sœur. Toutes deux étaient de belle humeur, et n’avaient aucune raison de bouder les divertissements de leur âge.
Jeunes, gaies, attrayantes, chacune à sa manière, elles ne tardèrent pas à être très entourées. Annette était en beauté. Dans le plein air et les sports, elle se montrait à son avantage. Forte, bien découplée, aimant la marche et les jeux de mouvement, elle était au tennis une brillante partenaire, l’œil sûr, le jarret souple, le poignet prompt, des ripostes comme des éclairs. Habituellement sobre de gestes, elle avait, aux instants nécessaires, une admirable fougue, des détentes foudroyantes. Sylvie, émerveillée, battait des mains, en la voyant bondir; elle était fière de sa sœur. Elle l’admirait d’autant plus qu’elle se sentait incapable de l’imiter: cette svelte Parisienne était inapte à tous les jeux sportifs; et elle comprenait médiocrement leur attrait. Il fallait se donner trop de mouvement! Elle trouvait plus agréable—et surtout, plus prudent—de rester spectatrice. Elle ne perdait pas son temps....
Elle avait formé une petite cour, et elle y trônait, comme si elle n’avait fait que cela, de sa vie. La fine mouche savait imiter chez les jeunes femmes du monde qu’elle observait tout ce qui était de bon aloi, piquant, et facile à emprunter. L’air de n’y pas toucher, délicieusement distraite, elle avait toujours l’œil et l’oreille aux aguets; rien ne se perdait pour elle. Mais son meilleur modèle restait encore Annette. Avec un sûr instinct, elle savait non seulement la copier en maint et maint détails, mais relever la copie par de légères variantes, et même, en certains cas, en prendre le contre-pied,—oh! juste ce qu’il fallait pour paraître incorrecte, par un raffinement de plus. Elle montrait encore plus d’intelligence, en ne sortant jamais des limites où elle sentait le terrain solide sous ses pas. Là, elle était parfaite, de manières, de tenue et de ton. Une exquise distinction, rehaussée d’une pointe d’extravagance. Annette ne pouvait s’empêcher de rire, en l’entendant débiter à sa cour, avec un aplomb charmant, des connaissances dont elle lui avait, la veille, donné la becquée. Sylvie lui décochait un clin d’œil malicieux.—Il n’aurait pas fallu, certes, la pousser trop loin dans la conversation. Malgré tout son esprit et sa bonne mémoire, elle eût risqué de trahir ses lacunes; mais elle ne se laissait pas faire: elle surveillait ses frontières. Et puis, elle savait aussi choisir ses partenaires.
C’étaient, pour la plupart, de jeunes sportmen des pays étrangers: anglo-saxons, roumains, plus sensibles à une faute de jeu qu’à une faute de langage.—Le grand favori du petit cercle féminin était un Italien. Porteur d’un nom sonore de vieille famille lombarde, (éteinte depuis des siècles, mais le nom ne meurt jamais), il avait ce type, si répandu parmi la jeunesse à la mode de la Péninsule, et qui est d’une époque encore plus que d’une race: on y trouve curieusement assemblés l’Américain de la Cinquième Avenue et le condottiere du quattrocento: ce qui donne à l’ensemble, parfois, assez grand air—(d’Opéra).—Beau garçon, haut et droit, bien bâti, la tête ronde et la face rasée, très brun, les yeux ardents, un grand nez conquérant, aux narines bleuâtres, et la mâchoire lourde, Tullio marchait, les reins souples et le torse bombé. Ses manières étaient un mélange de hauteur, d’obséquieuse courtoisie, et de brutalité. Un homme irrésistible. Il n’avait qu’à se baisser pour ramasser les cœurs. Il ne se baissait pas. Il attendait qu’on vînt les lui mettre dans la main.
Peut-être pour cette raison qu’Annette, justement, ne lui offrit pas le sien, il avait jeté d’abord son dévolu sur elle. Champion de tennis, il avait apprécié les qualités physiques de la robuste fille; et, causant avec elle, il avait découvert d’autres sujets sportifs, où leurs goûts s’accordaient,—le cheval, le canotage, dont Annette avait fait, avec la passion qu’elle apportait à tout. Il huma de son grand nez le trop plein d’énergie qui gonflait ce corps vierge; et il le désira. Annette perçut ce désir, et elle en fut à la fois blessée et captivée. Sa forte vie physique, comprimée par des années de demi-claustration, s’éveillait, sous la flambée de ce superbe été, au milieu de cette jeunesse qui ne songeait qu’au plaisir, et dans l’excitation de ces jeux vigoureux. Les dernières semaines passées avec Sylvie, ses libres entretiens, la tendresse excessive dont elle était saturée, avaient jeté le trouble dans sa nature, dont elle connaissait si mal et si peu l’étendue. Contre un assaut des sens, la maison était mal défendue. Pour la première fois, Annette éprouva la morsure de la passion sexuelle. Elle en eut honte et colère, comme si on l’eût souffletée. Mais ce n’était pas une raison pour que le désir tombât. Au lieu de se dérober, elle tint tête aux avances, avec une froideur fière et le cœur frémissant. Lui, toujours enveloppant d’une déférence parfaite une rapace convoitise, dont la fascination luisait, il s’éprit d’autant plus qu’il vit qu’elle l’avait compris et qu’elle se posait en adversaire. C’était un autre match, autrement passionnant! Il y eut de durs défis échangés, de rudes passes d’armes, sans qu’il en parût rien au dehors. Tandis qu’il s’inclinait, avec une mâle politesse, pour lui baiser la main,—tandis qu’elle lui souriait, avec une grâce hautaine, elle lisait dans ses yeux:
—Je t’aurai.
Et ses lèvres fermées lui répondaient:
—Jamais!
Sylvie suivait le duel, de son regard de lynx; et, tout en s’en amusant, l’envie lui vint d’y jouer sa partie. Quelle partie? Vraiment, elle n’en savait rien.... Eh bien, de se divertir,—et de seconder Annette, bien sûr, cela va sans dire! Ce garçon était bien. Annette, aussi, très bien. Comme un sentiment fort toujours l’embellissait! Cette fierté brûlante, ce front de petit taureau qui s’apprête au combat, ces ondes de rougeurs et de pâleurs subites, que Sylvie croyait voir passer sur le corps, comme des frissons... L’homme se piquait au jeu...
—... Rien à faire, mon garçon, non, non, tu ne l’auras pas, si elle ne veut pas!... Mais veut-elle? ne veut-elle pas?... Décide-toi, Annette! Il est pris. Achève-le!... La sotte! Elle ne sait pas... Bon, nous allons l’aider...
Ce fut par les louanges d’Annette que s’engagea leur connaissance. Ils l’admiraient tous deux. L’Italien était décidément conquis. Radieuse, les yeux brillants, Sylvie abondait en son sens. Elle était bien adroite à célébrer sa sœur. Mais elle ne l’était pas moins à s’armer de tous ses charmes. Et, une fois mis en jeu, il n’était plus moyen de les arrêter. Elle avait beau leur dire:
—Maintenant, tiens-toi tranquille. C’est assez. Tu vas trop loin...
...Ils n’écoutaient plus rien; il n’y avait qu’à les laisser faire... C’était si amusant! Naturellement, cet idiot aussitôt avait pris feu. Que les hommes sont bêtes! Il croyait que, si l’on faisait des grâces, c’était pour ses beaux yeux... Tout de même, ils étaient beaux, ses yeux... Et maintenant, qu’est-ce qu’il allait faire, le poisson, entre les deux hameçons? Est-ce qu’il avait la prétention de les gober toutes deux? Qu’est-ce qu’il va décider?... «Eh bien, mon vieux, choisis!»
Elle ne faisait rien pour lui faciliter le choix, en s’effaçant devant Annette. Annette, pas davantage. A partir de ce moment, d’instinct elle redoubla d’efforts pour éclipser Sylvie. Les deux sœurs s’aimaient tendrement. Sylvie était aussi fière des éloges faits d’Annette qu’Annette de l’impression produite par Sylvie. Elles se conseillaient mutuellement. Elles veillaient aux détails de la toilette l’une de l’autre. Avec une science très sûre, elles savaient, par contraste, se faire valoir l’une l’autre. Aux soirées de l’hôtel, elles attiraient tous les regards. Mais en dépit qu’elles en eussent, ces regards instituaient une rivalité entre elles. Elles avaient beau s’en défendre, quand elles dansaient, elles ne pouvaient s’empêcher d’évaluer, chacune, les succès de l’autre. Surtout auprès de celui qui, décidément, les occupait beaucoup plus qu’elles ne l’eussent voulu... Il les occupait beaucoup plus, depuis qu’il ne savait de laquelle il était occupé le plus. Annette commença de sentir une souffrance confuse, quand elle vit Tullio s’empresser près de sa sœur. Toutes deux, bonnes danseuses, chacune avait sa manière. Annette fit tout ce qu’elle put pour établir sa supériorité. Et certes, elle dansait mieux, au regard des connaisseurs. Mais Sylvie, moins correcte, avait plus d’abandon; et dès l’instant qu’elle saisit l’intention d’Annette, elle devint irrésistible. Tullio, en effet, n’y résista point. Annette eut la douleur de voir qu’elle était délaissée. Après une suite de danses avec Sylvie, ils sortirent tous deux, en causant et riant, par la belle nuit d’été. Elle ne put se commander. Il fallut qu’elle quittât le salon, elle aussi. Sans oser s’engager dans le jardin, à leur suite, elle chercha à les voir, de la galerie vitrée qui menait au jardin; et elle les vit, dans l’allée, elle les vit qui, penchés l’un près de l’autre, en marchant, échangeaient des baisers.
Cette peine n’était rien auprès de celle qui suivit.—Quand, remontée dans sa chambre, assise sans lumière, Annette vit rentrer Sylvie tout animée, qui s’exclama en la trouvant seule dans l’obscurité, lui caressa les mains, lui baisota les joues, lui fit ses mille et une gentillesses ordinaires,—et quand, après avoir prétexté une migraine subite qui l’avait obligée à se retirer, elle demanda à sa sœur comment s’était passé le reste de la soirée, et si elle s’était promenée avec Tullio,—Sylvie, ingénument, répondit qu’elle ne s’était pas promenée, et qu’elle ne savait pas ce que Tullio était devenu: qu’au reste, Tullio commençait à la raser, et puis qu’elle n’aimait pas les hommes qui étaient trop beaux, et puis qu’il était fat, et puis un peu moricaud... Là-dessus, elle alla se coucher, en chantonnant une valse.
Annette ne dormit pas. Sylvie dormit très bien. Elle ne se doutait pas de la tempête qu’elle avait déchaînée... Annette était en proie à des démons lâchés. Ce qui venait de se passer était une catastrophe. Une double catastrophe. Sylvie était sa rivale. Et Sylvie lui mentait. Sylvie, la bien-aimée! Sylvie, sa joie, sa foi!... Tout était écroulé. Elle ne pouvait plus l’aimer... Plus l’aimer? Pouvait-elle, pouvait-elle ne plus l’aimer?... Oh! combien cet amour était enraciné, plus encore qu’elle ne l’avait pensé!... Mais est-ce qu’on peut aimer ce qu’on méprise?... Ah! ce ne serait rien encore, la trahison de Sylvie!... Il y avait quelque chose de plus... «Il y a... il y a... Allons, dis ce qu’il y a!...» Oui, il y avait cet homme, qu’Annette n’estimait pas, qu’Annette n’aimait pas,—et qu’elle aimait maintenant,—aimer? non!—qu’elle voulait. Une fièvre d’orgueil jaloux exigeait qu’elle le prît, qu’elle l’arrachât à l’autre,—surtout qu’elle ne laissât point l’autre le lui arracher... («L’autre», voilà ce que, pour Annette, Sylvie était devenue!...)
Elle ne reposa point une heure, cette nuit. Ses draps lui brûlaient la peau.—De l’autre lit voisin, s’élevait le bourdonnement léger du sommeil de l’innocence.
Quand elles se retrouvèrent face à face, le matin, Sylvie, du premier coup d’œil, vit que tout était changé; et elle ne comprit pas ce qui s’était passé. Annette, les yeux cernés, pâle, dure, hautaine, mais étrangement plus belle,—(et plus belle et plus laide, comme si, à un appel, toutes ses forces secrètes se fussent soudain levées)—Annette, casquée d’orgueil, froide, hostile, murée, regardait, écoutait Sylvie qui disait ses folies ainsi qu’à l’ordinaire, fit à peine bonjour, et sortit de la chambre... Le babil de Sylvie s’arrêta au milieu d’un mot. Elle sortit à son tour, suivit des yeux Annette descendant l’escalier...
Elle comprit. Annette avait vu Tullio, qui était assis dans le hall, et, traversant la pièce, elle alla droit à lui. Lui aussi reconnut que la situation avait changé. Elle s’assit près de lui. Ils causaient de sujets banals. La tête droite, dédaigneuse, elle regardait devant elle, évitant de le fixer. Mais il n’avait point de doute: c’était lui qu’elle fixait. Sous ses paupières bleuâtres, ce regard qui se cachait, comme pour fuir la lumière trop intense, disait:
—Me veux-tu?
Et lui qui, d’un ton satisfait, racontait une histoire insipide, en contemplant ses ongles, il guettait de côté, ainsi qu’un grand félin, ce corps aux seins raidis, et demandait:
—Tu veux donc aussi?
—Je veux que tu me veuilles,—telle était la réponse.
Sylvie n’hésita point. Faisant le tour du hall, elle vint et prit une chaise entre Annette et Tullio. L’irritation d’Annette se trahit d’un regard,—d’un seul: c’était assez. Sylvie en reçut le mépris, à bout portant. Elle en battit des cils, et feignit de ne pas voir; mais elle se hérissa comme une chatte sur qui vient de passer une décharge électrique; elle sourit, et se tint prête à mordre. Le duel à trois, doucereux, s’engagea. Annette, semblant ignorer la présence de Sylvie, sans tenir compte de ce qu’elle disait, parlait par-dessus sa tête à Tullio, gêné: ou, forcée de l’entendre,—car l’autre avait bon bec—soulignait, d’un sourire ou d’un mot ironique, une de ces menues erreurs de langage qui émaillaient encore les discours de Sylvie: (car malgré son adresse, la petite commère n’avait pas réussi à les extirper tout à fait de son jardin). Mortellement blessée, Sylvie ne vit plus la sœur, elle ne vit que la rivale; elle pensa:
—Tu encaisseras, à ton tour.
Et, retroussant sa lèvre sur ses canines:
—Dent pour dent, œil pour œil... Non, les deux yeux pour un...
elle se jeta dans le combat. Ah! l’imprudente Annette! Sylvie n’était point, comme elle, gênée par sa fierté; toutes armes lui étaient bonnes, pourvu qu’elle réussît. Annette, bardée d’orgueil, se fût crue dégradée, si elle eût laissé voir à Tullio une ombre de ses désirs. Sylvie ne s’embarrassait pas de semblables scrupules: on allait jouer au monsieur le jeu qui le flattait le mieux...
—Qu’est-ce que tu préfères? Aimes-tu mieux le beau dédain, ou bien que l’on t’admire?...
Elle connaissait l’homme: animal vaniteux. Tullio adorait l’encens. Elle lui en servit bonne mesure. Avec une impudence ingénue et tranquille, la petite rouée fit le tour des perfections du jeune Gattamelata de palace-hôtel:—corps, esprit, et vêture. Vêture principalement: car, comme elle le pensait, c’était à quoi il tenait le plus. Tout hommage lui plaisait. Certes. Mais qu’il fût beau, on ne le lui apprenait pas; et quant à son esprit, son grand nom lui en était une garantie certaine. Mais son habillement était son œuvre personnelle; et il était sensible au suffrage d’une experte Parisienne. De son œil connaisseur, qui s’égayait en secret de certaines naïvetés de goût fort éclatant, Sylvie l’admirait tout, du haut en bas. Annette en rougissait, de honte et de colère; la ruse de la petite lui semblait si grossière qu’elle se demandait:
—Se peut-il qu’il le supporte?
Il le supportait très bien: Tullio buvait du lait. Quand d’échelon en échelon, elle fut descendue de la cravate orange à la ceinture lilas, aux chaussettes vert et or, Sylvie fit un arrêt: elle avait son idée! Tout en s’extasiant sur la finesse des pieds de Tullio—(il en était très fier)—elle exhiba les siens, qui étaient fort jolis. Avec une coquetterie gamine, elle les rapprocha de ceux de Tullio, elle les compara, en découvrant sa jambe du talon au genou. Puis, se tournant vers Annette, dédaigneuse, renversée dans son rocking-chair, elle dit, avec un sourire délicieux:
—Chérie! fais voir aussi les tiens!
Et, d’un geste rapide, elle les dégagea bien, avec le fût des chevilles ensablées et les colonnes un peu lourdes des jambes. Deux secondes seulement. Annette arracha la petite griffe maligne, qui se retirait, contente. Tullio avait vu...
Elle n’en resta point là. Toute la matinée, elle s’ingénia à des rapprochements, qui ne semblaient point voulus, et d’où Annette ne sortait pas à son avantage. Sous prétexte d’en appeler au goût supérieur de Tullio, à propos d’un collet, d’une blouse, ou d’une écharpe, elle s’arrangeait de manière à attirer son attention sur ce qu’elle n’avait pas de plus laid, et sur ce qu’Annette n’avait pas de plus beau. Annette, frémissante, l’air de ne pas entendre, se tenait à quatre de ne pas l’étrangler. Sylvie, toujours charmante, entre deux petites rosseries, de ses doigts joints sur sa bouche lui décochait un baiser. Mais, par instants, un éclair de leurs yeux se heurtait...
(Annette)—«Je te méprise!»
(Sylvie)—«Possible. Mais c’est moi qu’on aime.»
—«Non! Non!» criait Annette.
—«Si! Si!» ripostait Sylvie.
Elles échangeaient un regard provocant.
Annette n’était pas de force à cacher longtemps son animosité sous le sourire, ainsi que ce petit serpent sous les fleurs. Si elle fût restée, elle l’eût criée. Brusquement, elle laissa le champ libre à Sylvie. Elle partit, tête haute, lui lançant un dernier regard de défi. L’œil railleur de Sylvie lui répondait:
La bataille continua, le lendemain et les jours qui suivirent, sous les regards de la galerie amusée: car la société de l’hôtel s’en était aperçue; vingt paires d’yeux désœuvrés se tenaient malignement à l’affût; des paris s’engagèrent. Les deux rivales étaient trop occupées par leur jeu pour se soucier de celui des autres.
La vérité était que, pour elles, ce n’était plus un jeu. Sylvie, aussi bien qu’Annette, était sérieusement prise. Un démon les troublait et irritait leurs sens. Tullio, glorieux de l’aubaine, n’avait point de peine à attiser le feu. Il était vraiment beau, il ne manquait pas d’esprit, il brûlait des désirs qu’il avait allumés: il valait d’être conquis. Nul ne le savait mieux que lui.
Les deux sœurs ennemies se retrouvaient dans leurs chambres, chaque soir. Elles se haïssaient. Elles affectaient pourtant de ne pas le savoir. Voisines de lit, la nuit, leur situation eût été intenable, si elles se l’étaient dit: il eût fallu en venir à un éclat public, qu’elles devaient éviter. Elles s’arrangeaient de façon à entrer, à sortir à des moments différents, à ne plus se parler, à feindre de ne pas se voir,—ou, comme c’était tout de même impossible,—à se dire froidement: «bonjour», «bonsoir», comme si de rien n’était. Le plus loyal, le plus sensé eût été de s’expliquer. Mais elles ne le voulaient pas. Elles ne le pouvaient pas. Quand la passion est lâchée dans une femme, il ne s’agit plus de loyauté; et de bon sens, moins encore.
La passion chez Annette était devenue un poison. Un baiser que Tullio, profitant de son pouvoir, avait violemment, un soir, au détour d’une allée, imprimé sur la bouche de l’orgueilleuse fille, qui ne s’était pas défendue, avait déchaîné en elle un torrent sensuel. Avec humiliation et rage, elle luttait contre. Mais elle savait d’autant moins résister que c’était la première fois que le flot l’envahissait. Malheur aux cœurs trop défendus! Quand la passion fait son entrée, le plus chaste est le plus livré...
Une nuit, dans une de ces insomnies fiévreuses qui la consumaient, Annette glissa dans le sommeil, tout en croyant qu’elle restait éveillée. Elle se voyait couchée dans son lit, les yeux ouverts; mais elle ne pouvait bouger, elle avait les membres liés. Elle savait que Sylvie, à côté, faisait semblant de dormir, et que Tullio allait venir. Déjà, elle entendait dans le couloir le plancher qui craquait et un frôlement de pas prudents qui s’avançaient. Elle voyait Sylvie se soulever de l’oreiller, sortir ses jambes des draps, se lever, se glisser vers la porte qui s’entr’ouvrait. Annette voulait se lever aussi; mais elle ne pouvait pas. Comme si elle l’eût entendue, Sylvie se retournait, revenait près du lit, la regardait, se penchait sur elle pour mieux la voir. Elle n’était pas du tout, pas du tout comme Sylvie; elle ne lui ressemblait pas; et pourtant, elle était Sylvie; elle avait un rire méchant qui découvrait ses canines; elle avait de longs cheveux noirs, sans boucles, raides et durs, qui, quand elle se baissait, lui retombaient sur le visage, entraient dans la bouche et dans les yeux d’Annette. Annette avait sur la langue le goût des crins rudes et leur odeur échauffée. La face de la rivale venait plus près, tout près. Sylvie ouvrait le lit, et entrait. Annette sentait le genou dur, qui pesait sur sa hanche. Elle étouffait. Sylvie avait un couteau; le froid de la lame frôlait la gorge d’Annette, qui se débattait, criait....—Elle se retrouva dans le calme de la chambre, assise sur son lit, ses draps bouleversés. Sylvie dormait paisiblement. Annette, comprimant les battements de son cœur, écoutait le souffle rassurant de sa sœur; et elle tremblait encore de haine et d’horreur...
Elle haïssait... Qui donc?... Et qui donc aimait-elle? Elle jugeait Tullio, elle ne l’estimait pas, elle le redoutait, elle n’avait aucune, aucune confiance en lui. Et cependant, pour cet homme qu’elle ne connaissait pas quinze jours avant, qui ne lui était rien, elle était prête à haïr celle qui était sa sœur, celle qu’elle avait aimée le mieux, celle qu’elle aimait encore... (Non!... Si!... qu’elle aimait toujours...) Elle eût sacrifié à cet homme, sur-le-champ, tout le reste de sa vie... Mais comment..., mais comment cela était-il possible!...
Elle était épouvantée; mais elle ne pouvait que constater la toute-puissance de la folie. A de certaines minutes, un éclair de bon sens, un sursaut d’ironie, le retour d’une vague de son ancienne tendresse pour Sylvie, lui soulevaient la tête au-dessus du courant. Mais il suffisait d’un regard de jalousie, de la vue de Tullio chuchotant avec Sylvie, pour qu’elle replongeât...
Il était évident qu’elle perdait du terrain. C’était justement pour cela que sa passion s’enrageait. Elle était maladroite. Annette ne savait pas cacher sa dignité blessée. Tullio eût consenti, bon prince, à ne pas choisir entre elles; il daignait leur jeter le mouchoir à toutes deux. Sylvie, prestement, le ramassait; elle ne faisait point de façons; elle se réservait, plus tard, de faire danser Tullio, à sa manière. Elle ne se fût guère troublée de voir ce Don Juan grappiller quelques baisers à la treille d’Annette. Et si cela ne lui eût pas plu, elle ne se croyait pas forcée de le montrer. On peut dissimuler.... Annette en était incapable. Elle n’admettait pas le partage; et elle laissait trop bien voir la répulsion que lui inspirait le jeu équivoque de Tullio.
Tullio commença à se refroidir pour elle. Ce sérieux passionné le gênait, «l’embêtait»: (il croyait, avec beaucoup d’étrangers, ce mot très parisien). Un peu de sérieux est bon en amour. Mais pas trop n’en faut: ce serait une corvée, et non plus un plaisir. Il se représentait la passion comme une primadonna qui, après avoir proféré sa grande cavatine, revient, les bras tendus, pour saluer le public. Mais la passion d’Annette ne semblait pas savoir que le public existât. Elle ne jouait que pour elle. Elle jouait mal....
Elle était trop vraie, trop vraiment passionnée, pour songer à s’apprêter, à corriger les traces de ses peines, de ses tourments, et ces imperfections journalières, qu’une femme plus attentive efface ou atténue, chaque jour plus d’une fois. Elle ne paraissait plus du tout à son avantage. Elle devint même laide, à mesure qu’elle se sentit vaincue.
La triomphante Sylvie, sûre de la partie gagnée, lorgnait Annette désemparée, avec une ironie satisfaite, poivrée d’un grain de méchanceté,—et quelque pitié, au fond...
—Eh bien, tu as ton compte?... C’est cela que tu voulais?... Tu en fais, une mine!... Un pauvre chien battu...
Et elle avait envie de courir l’embrasser. Mais quand elle s’approchait, Annette lui témoignait une telle animosité que Sylvie, vexée, lui tournait le dos, bougonnant:
—Tu ne veux pas, ma fille?... A ta guise! Arrange-toi!... Je suis bien bonne!... Chacun pour soi, et zut pour les autres!... Après tout, si elle souffre, cette idiote, c’est sa faute! Pourquoi est-elle toujours si ridiculement sérieuse?
(C’était ce qu’ils pensaient tous.)
Annette finit par se retirer du combat. Sylvie, avec Tullio, organisait une soirée de tableaux vivants, où elle devait se montrer avec tous ses charmes, et quelques autres en plus... (Elle était une petite magicienne de Paris, qui savait, avec un lambeau d’étoffe, se métamorphoser en une série de «doubles», tous plus jolis que l’original, mais qui, en le complétant, le faisaient paraître plus charmant qu’eux tous, puisqu’il les contenait tous)... Essayer de lutter avec elle sur ce terrain eût été un désastre pour Annette. Elle ne le savait que trop: elle était vaincue d’avance; qu’est-ce que c’eût été, après? Elle demanda à rester en dehors de la fête, prétextant sa santé: sa mauvaise mine lui était une excuse suffisante. Tullio ne se montra point très insistant.—A peine eut-elle refusé qu’elle souffrit bien plus de s’être retiré toute arme pour lutter. Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Maintenant, elle devait laisser en tête à tête Tullio et Sylvie, une partie de la journée. Elle s’obligeait à suivre, pour les gêner, toutes les répétitions. Elle ne les gênait guère. Elle les excitait plutôt,—surtout cette effrontée, qui faisait recommencer dix fois une scène d’enlèvement d’odalisque pâmée par le corsaire byronien aux yeux de sombre feu, grinçant des dents, fatal, félin, prêt à bondir, comme un jaguar. Il jouait le rôle, comme s’il allait mettre à feu et à sang tout le Palace-Hôtel. Quant à Sylvie, elle en eût remontré aux vingt mille houris, qui tirent la barbe au Prophète, en son paradis.
Le soir de la représentation vint. Annette, dissimulée au dernier rang de la salle, heureusement oubliée au milieu de l’enthousiasme, ne put rester jusqu’au bout. Elle sortit, torturée. Sa tête était en feu. Elle avait la bouche amère. Elle remâchait son tourment. La passion dédaignée lui rongeait les entrailles.
Elle alla dans les prairies qui entouraient l’hôtel; mais elle ne pouvait s’éloigner; elle tournait toujours autour de cette salle illuminée. Le soleil était couché. L’obscurité tombait. Un instinct d’animal lui fit jalousement flairer la porte par où, certainement, tous deux allaient sortir. Une petite porte de côté, qui permettait aux acteurs, sans traverser la salle, de regagner le magasin d’habillement, dans l’autre aile de la maison.—En effet, ils sortirent; et, sans aller plus loin, ils s’attardèrent dans l’ombre de la prairie, à causer. Cachée derrière un bouquet d’arbres, Annette entendit Sylvie, qui riait, qui riait...
—Non, non, pas cette nuit!
Et Tullio insistait:
—Pourquoi?
—D’abord, je veux dormir.
—On a bien le temps de dormir!
—Non, non, jamais assez!...
—Eh bien, la nuit prochaine.
—Les autres nuits, c’est pareil. Et puis, je ne suis pas seule, la nuit. On est guetté!
Et ce petit polisson de Sylvie répliquait, en se tordant de rire:
—Mais je n’ai pas peur du jour! Et vous, vous le craignez?...
Annette ne put pas écouter davantage. Une rafale de dégoût, de fureur, de douleur, l’emporta, en courant, dans la nuit, dans les champs. Peut-être entendit-on le bruit de sa course éperdue, et des branches froissées, comme sur le passage d’un animal qui fuit. Mais elle ne s’inquiétait plus de ne pas être entendue. Rien ne comptait plus pour elle. Elle fuyait, elle fuyait... Où? Elle ne le savait pas. Elle ne le sut jamais... Elle courait dans la nuit, avec un gémissement. Elle ne voyait pas devant elle. Elle courut, cinq minutes, vingt minutes, une heure? Elle ne le sut jamais... Jusqu’à ce que son pied butant contre une racine, elle tomba de tout son long, le front contre un tronc d’arbre... Et alors, elle cria, elle hurla, la bouche sur la terre, comme une bête blessée.
Autour d’elle, la nuit. Ciel sans lune, sans étoiles, noir. Terre sans souffle, sans cris d’insectes, muette. Le seul bruissement d’un filet d’eau sur les cailloux, qui s’égouttait au pied du sapin maigre, contre lequel le front d’Annette avait heurté. Et, du fond de la gorge qui coupait le haut plateau abrupt, montait le grondement farouche d’un torrent. Sa plainte se mêlait à la plainte de la femme blessée. Elles semblaient l’éternel lamento de la terre...
Aussi longtemps qu’elle cria, elle ne pensa point. Le corps, secoué de sanglots convulsifs, se déchargeait du mal, dont le fardeau, depuis des jours, l’écrasait. L’esprit se taisait.—Puis, le corps, épuisé, s’arrêta de gémir. La douleur de l’esprit revint à la surface. Et Annette reprit conscience de son abandon. Elle était seule et trahie. Le cercle de ses pensées ne s’étendait pas plus loin. Elle n’avait pas la force de rassembler leur troupeau dispersé. Elle n’avait pas la force même de se relever. Elle s’abandonnait à la terre, étendue... Ah! si la terre avait voulu la prendre!... Le grondement du torrent parlait, pensait pour elle.
Il baignait sa blessure. Au bout d’un temps, (qui fut, sans doute, long), de souffrance prostrée, Annette lentement souleva son corps meurtri. La contusion du front lui causait des douleurs assez vives; ce mal, en l’occupant, soulagea sa pensée. Elle trempa dans le ruisseau ses mains éraflées; elle les mit sur son front blessé, qui brûlait. Et ainsi, elle resta assise, appuyant ses tempes et ses yeux dans ses paumes mouillées, sentant la pénétrer cette pureté glacée. Et voici qu’elle devenait lointaine à sa douleur... Elle la regardait gémir, ainsi qu’une étrangère; et elle ne comprenait plus déjà le sens de ces fureurs. Elle pensait:
—Pourquoi?... A quoi bon?... Est-ce que cela vaut la peine?...
Le torrent, dans la nuit, disait:
—Folie, folie, folie... tout est vain... tout n’est rien...
Annette, amèrement, souriait avec pitié:
—Qu’est-ce que j’ai voulu?... Je ne le sais même plus... Où est-il, ce grand bonheur?... Le prenne qui voudra!... Je ne le disputerai pas...
Et puis, lui revinrent, soudain, par effluves, des images de ce bonheur que pourtant elle avait voulu, et les chaudes bouffées de ces désirs dont son corps—quoique sa raison les niât—était, serait longtemps encore possédé. Dans le sillage tracé par leur âpre éperon, ils traînaient après eux un relent de fureurs jalouses... Elle subit leur assaut, en silence, courbée comme sous l’aile d’un coup de vent qui passe. Puis, relevant la tête, elle dit tout haut:
—J’ai tort... Sylvie est la plus aimée... C’est juste. Elle est mieux faite pour l’amour. Et elle est bien plus jolie. Je le sais, et je l’aime. Je l’aime parce qu’elle est ainsi. Je devrais donc être heureuse de son bonheur. Je suis une égoïste... Mais pourquoi, seulement, pourquoi m’a-t-elle menti? Tout le reste, mais pas cela! Pourquoi m’a-t-elle trompée? Pourquoi ne m’a-t-elle pas dit franchement qu’elle l’aimait? Pourquoi a-t-elle agi envers moi en ennemie?... Ah! Et puis toutes ces choses en elle, que je voudrais tant ne pas voir, qui ne sont pas très propres, pas très bonnes, pas très belles!... Mais ce n’est pas sa faute. Comment pourrait-elle savoir? Quelle vie, depuis l’enfance, il lui a fallu mener!... Et moi, est-ce que j’ai le droit de lui faire des reproches? Est-ce que j’étais franche?... Et était-ce plus propre, ce qu’il y avait en moi?... Ce qu’il y avait? Ce qu’il y a!... Je sais bien que c’est toujours là...
Elle soupira, lassée. Puis, elle dit:
—Allons! il faut en finir! C’est moi la plus âgée. Et c’est moi la plus folle!... Que Sylvie soit heureuse!
Mais, après avoir dit: «Allons!» elle resta quelque temps encore sans bouger. Elle écoutait le silence, et songeait, en mordant les phalanges de ses doigts, écorchées.—Et puis, elle respira, se leva, sans parler, et se mit à marcher.
Elle revenait, dans la nuit. La lune allait paraître; elle était encore lointaine; mais derrière l’horizon, du gouffre des ténèbres on la sentait monter. Une faible clarté frangeait la ligne des cimes qui encerclaient le plateau, comme les bords d’une coupe; et, de minute en minute, s’accentuaient sur un fond d’auréole leurs profils noirs. Annette marchait sans hâte; et son sein, qui reprenait son souffle régulier, respirait lentement l’odeur des prés fauchés.
Dans l’ombre sur la route, au loin, elle entendit des pas précipités. Son cœur battit. Elle s’arrêta. Elle les reconnaissait; puis, elle se remit à marcher, plus vite, à leur rencontre. De l’autre côté aussi, on avait entendu. Une voix inquiète appelait:
—Annette!
Annette ne répondit pas: elle ne pouvait pas, elle était saisie; un ruisseau de joie coulait; tout le reste des peines, tout était effacé. Elle ne répondit pas; mais elle marcha plus vite, encore plus vite. Et l’autre, maintenant, courait. Elle répéta:
—Annette! d’une voix angoissée.
Dans la phosphorescence indécise de la lune, qui grimpait derrière la grande muraille sombre, une petite forme indistincte surgit de l’ombre blanchissante. Annette cria:
—Chérie!...
et se précipita. Comme une aveugle, les bras tendus...
Dans leur hâte à se joindre, leurs deux corps se heurtèrent. Elles s’étreignirent. Leurs bouches se cherchaient, se trouvèrent...
—Mon Annette!
—Ma Sylvie!
—Ma grande! mon amour!
—Ma petite bien-aimée!
Leurs mains palpaient, dans les ténèbres, les joues et les cheveux, se promenaient sur la nuque, le cou et les épaules, reprenaient possession du bien, de l’amie perdue.
—Chérie! s’exclama Sylvie, sentant les épaules nues, tu n’as pas ton manteau! tu n’as rien pour te couvrir!...
Annette s’aperçut qu’elle n’avait en effet que sa robe de soirée; et le froid la saisit: elle frissonna.
—Tu es folle! tu es folle! criait Sylvie, l’enveloppant, la serrant dans sa cape. Et ses mains, qui continuaient, tout le long, leur inspection, constataient les dégâts.
—Ta robe est déchirée... Mais qu’est-ce que tu as fait? Qu’est-ce qui est arrivé?... Et tes cheveux sur tes joues... Et ici, et ici, qu’est-ce que tu as au front?... Annette, tu es tombée?...
Annette ne répondait pas. Elle s’abandonnait, la bouche sur l’épaule de Sylvie, et pleurait. Sylvie la fit asseoir près d’elle sur un talus de la route. La lune, franchissant la barrière des monts, vint éclairer Annette au front blessé, que Sylvie couvrait de baisers.
—Dis-moi ce que tu as fait... Dis-moi ce qui s’est passé..... Mon trésor, mon petit loup, j’ai été si inquiète quand je suis remontée dans ta chambre et que je ne t’ai pas trouvée!... Je t’ai appelée partout... Je te cherche depuis une heure... Ah! j’étais malheureuse!... Je craignais, je craignais... je ne peux pas dire ce que je craignais... Pourquoi es-tu partie? Pourquoi t’es-tu sauvée?...
Annette ne voulait pas répondre.
—Je ne sais pas, disait-elle, j’avais mal, je voulais... marcher, respirer...
—Non, tu ne dis pas vrai. Annette, dis-moi tout!...
Elle se pencha sur elle, et plus bas:
—Mon cœur, ce n’est pas à cause de ce...?
Annette l’interrompit:
Mais Sylvie insistait:
—Ne mens pas! Dis-moi vrai. Dis! Dis à ta petite! C’est à cause de lui?
Annette, s’essuyant les yeux et s’efforçant de sourire, dit:
—Non, je t’assure... J’avais un peu de peine, c’est vrai... C’est bête... Mais c’est fini maintenant. Je suis heureuse qu’il t’aime.
Sylvie bondit sur place, frappa ses mains avec colère:
—Ainsi, c’était bien lui!... Ah! mais, je ne l’aime pas, je ne l’aime pas, cet individu!...
—Si! tu l’aimes...
—Non! non! non!
Sylvie trépignait sur la route.
—Cela m’amusait de l’aimer, je faisais cela pour jouer, mais ce n’est rien pour moi, rien, à côté de toi... Ah! tous les baisers d’un homme ne compensent pas pour moi une larme de toi...
Annette fut bouleversée de bonheur:
—C’est vrai? c’est vrai?
Sylvie lui sauta dans les bras.
Quand elles furent un peu calmées, Sylvie dit à Annette:
—Maintenant, avoue! tu l’aimais, toi aussi!
—Aussi? Ah! tu vois bien! tu as dit que tu l’aimais!...
—Non, je te dis, je te défends... je ne peux plus en entendre parler. C’est fini, c’est fini.
—C’est fini, répéta Annette.
Elles revinrent, par la route baignée de clair de lune, se souriant, ravies de s’être retrouvées.... Brusquement, Sylvie s’arrêta, et, montrant le poing à la lune, elle cria:
—Ah! l’animal!... Il me le paiera!...
Et comme la jeunesse ne perd jamais ses droits, elles rirent aux éclats de ce mot de mauvaise foi.
—Mais, sais-tu ce qu’on va faire? reprit Sylvie, rancunière. On va faire ses paquets, tout de suite, en rentrant, et demain, demain matin, filer par la première poste. Quand il viendra à table, à l’heure du déjeuner, il ne trouvera plus personne... Les oiseaux envolés!... Oh!... et puis... (Elle pouffa) Et moi qui oubliais!... Je lui ai donné rendez-vous, vers dix heures, dans les bois, tout là-haut... Il courra après moi, toute la matinée...
Elle rit de plus belle. Et Annette fit comme elle. Ce leur semblait si drôle, la tête que ferait Tullio, déçu et furieux. Les deux folles!... Leurs peines étaient déjà loin.
—Tout de même, dit Annette, ce n’est pas bien, chérie, de te compromettre ainsi.
—Bah! qu’est-ce que ça fait, pour moi? répliqua Sylvie. Je ne compte pas... Oui, reprit-elle, mordillant au passage la main d’Annette qui lui donnait de petites tapes sur l’oreille, je devrais être plus sage, maintenant que je suis ta sœur... Je le serai, je te promets... Mais toi, sais-tu, ma grande, tu ne l’étais pas beaucoup plus.
—Non, c’est vrai, dit Annette, contrite. Et, j’en ai peur, peut-être, à des moments, que je l’étais encore moins... Ah! fit-elle, se pressant plus étroitement contre sa sœur, que c’est étrange, le cœur! On ne sait jamais, jamais, ce qui va se lever dedans et vous emporter... où?
—Oui, dit Sylvie, l’étreignant, c’est pour ça que je t’aime! Ça souffle fort chez toi!
Elles étaient près de rentrer. Les toits de l’hôtel luisaient sous la clarté lunaire. Sylvie passa le bras autour du cou d’Annette et lui dit, à l’oreille, d’une voix passionnée, avec un sérieux qu’elle ne se connaissait pas:
—Ma grande! je n’oublierai pas ce que tu as souffert, cette nuit,—ce que tu as souffert par moi... Si, si, ne dis pas non!... J’ai eu le temps d’y penser, tandis que je courais à ta recherche, tremblante qu’un malheur... S’il était arrivé!... Ah! qu’est-ce que j’aurais fait!... Je ne serais pas revenue.
—Chérie, fit Annette, saisie, ce n’était pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir le mal que tu me faisais.
—Je le savais très bien, je savais que je te faisais souffrir; et même,—Annette, écoute!—et même cela me faisait plaisir!
Annette avait le cœur étreint; et elle songea qu’elle aussi, tout à l’heure, elle se serait délectée à voir souffrir Sylvie, à la faire souffrir jusqu’au sang. Elle le dit. Leurs bras se serrèrent.
—Mais qu’est-ce qu’on a? qu’est-ce qu’on est? se demandaient-elles, honteuses et écrasées, soulagées tout de même de penser que l’autre avait été pareille....
—On aime, dit Sylvie.
—On aime répéta machinalement Annette. Elle reprit, effarée:
—C’est ça, l’amour?
—Et tu sais, dit Sylvie, ça ne fait que commencer.
Annette, avec énergie, protestait qu’elle ne voulait plus aimer.
Sylvie se moqua d’elle. Mais Annette, très sérieuse, répétait:
—Je ne veux plus. Je ne suis pas faite pour ça.
—Ah bien, fit Sylvie en riant, pas de chance, ma pauvre Annette! Toi, tu cesseras d’aimer, quand tu cesseras de vivre!
Premiers jours d’octobre, gris et doux. Air silencieux. Pluie tiède qui tombe droite, et ne se presse pas. Odeur chaude et charnelle de la terre mouillée, des fruits mûrs au cellier, des cuvées au pressoir...
Près d’une fenêtre ouverte, dans la maison de campagne des Rivière, en Bourgogne, les deux sœurs étaient assises, l’une en face de l’autre, et cousaient. La tête baissée sur l’ouvrage, elles avaient l’air de pointer l’une contre l’autre leurs fronts ronds et sans plis,—ce même front bombé, plus mignon chez Sylvie, chez Annette plus fort, capricieux chez l’une, et chez l’autre obstiné,—la chèvre et la petite taure. Mais quand elles relevaient la tête, leurs yeux échangeaient un regard d’intelligence. Leurs langues se reposaient, ayant carillonné pendant des jours entiers. Elles ruminaient leur fièvre, leurs transports, leurs lampées de paroles passées, et tout ce qu’elles avaient pris et appris l’une de l’autre depuis des jours. Car, cette fois, elles s’étaient livrées tout entières, avec l’avidité de tout prendre et de tout donner. Et maintenant, elles se taisaient, pour mieux penser à tout ce butin caché.
Mais elles avaient beau vouloir tout voir et tout avoir: au bout du compte, elles restaient une énigme l’une pour l’autre. Et, sans doute, pour chaque être, chaque être est une énigme; et c’est là un attrait. Mais que de choses en chacune, que l’autre ne comprendrait jamais! Elles se disaient bien (car elles le savaient):
—Qu’est-ce que cela fait, comprendre? Comprendre, c’est expliquer. Il n’y a pas besoin d’expliquer pour aimer...
Tout de même, cela fait beaucoup! Cela fait que si on ne comprend pas, on ne prend pas tout à fait.—Et puis, aimer, justement, comment aimaient-elles? Elles n’avaient pas du tout la même façon d’aimer. Les deux filles de Raoul Rivière tenaient certes du père toutes deux une riche sève; mais refoulée chez l’une, et dispersée chez l’autre. Rien de plus différent entre les deux sœurs que l’amour. La très libre tendresse de Sylvie, riante, gamine, effrontée, mais au fond très sensée, qui s’agitait beaucoup, mais ne perdait jamais le nord, qui froufroutait des ailes, mais ne s’envolait guère qu’autour de son pigeonnier. L’étrange démon d’amour, qui habitait Annette, et dont, depuis six mois à peine, elle avait reconnu la présence; elle le comprimait, elle s’efforçait de le cacher, car elle en avait peur; son instinct lui disait que les autres le méconnaîtraient: l’Éros en cage, aux yeux bandés, inquiet, avide, et affamé, qui se meurtrit en silence aux barreaux du monde, et ronge lentement le cœur où il est enfermé! La brûlante morsure, incessante, sans bruit, faisait insensiblement chavirer l’esprit d’Annette dans un bourdonnement de torpeur blessée, qui n’était pas sans volupté: comme elle en trouvait une à des sensations qui la faisaient souffrir: une étoffe rêche, des dessous qui la serrent, la main qui se promène sur les aspérités d’un meuble ou le froid d’un mur rugueux. Mâchant l’écorce amère d’une branche qu’elle mordillait, elle sombrait, par moments, dans des oublis de soi et du temps, des pertes de conscience qui duraient, Dieu sait combien, un quart de seconde ou d’heure? et d’où elle ressortait précipitamment, soupçonneuse et honteuse, percevant le regard invisible de Sylvie qui, semblant travailler, la guettait malignement du coin de l’œil, de côté. La petite ne disait rien. Ni l’une ni l’autre ne bronchait; mais des bouffées de feu montaient aux joues d’Annette. Sylvie, sans bien comprendre, flairait de son petit nez cette vie intérieure, qui dormait au soleil et, par brusques détentes, sauvagement se repliait, comme sous des feuilles une couleuvre: elle jugeait la grande sœur bizarre, un peu maboule, vraiment pas comme tout le monde... Ce qui l’étonnait en elle, ce n’étaient pas tant ces mouvements passionnés, ces ardeurs, et tout ce qu’elle devinait des troubles pensées d’Annette, que le sérieux presque tragique qu’y apportait Annette. Tragique? Ah! bien, quelle idée! Sérieux? Pourquoi donc faire? Les choses sont comme elles sont. On les prend comme elles sont. Sylvie n’allait pas se troubler des quinze cents fantaisies qui lui passaient sous la peau! Elles passent, et puis s’en vont. Tout ce qui est bon et agréable est simple et naturel. Et tout ce qui n’est pas bon ni agréable l’est aussi, juste autant. Bon ou pas bon, je le gobe: c’est bientôt avalé! Pourquoi faire tant de façons?... Cette Annette enchevêtrée! avec ses broussailles de pensées chaudes et froides, cette filasse de désirs et de peurs, et ces touffes de passions et de pudeurs emmêlées dans tous les recoins!... Qui la débobinera?... Mais qu’elle fût ainsi anormale, excessive, et incompréhensible, amusait fort Sylvie, l’intriguait, l’attirait; et elle ne l’en aimait que mieux...
Le silence prolongé était lourd de secrets inquiétants. Sylvie s’en dégageait, brusquement, en parlant à tort et à travers... Vite, très vite, et tout bas, le nez sur son ouvrage, comme si elle l’injuriait, elle se mettait à marmonner une kyrielle de petits mots fous, de sons inarticulés, généralement en i, des «kikikiki» de pinson qui frétillait de plaisir. Et puis, elle reprenait subito un air grave, elle avait l’air de dire: «Qui? Moi? Je n’ai rien fait...»—Ou bien, mordillant son fil, elle chantonnait, de son filet de voix de tête, nasillant, quelque romance bien bête, où il était question de fleurs, «d’oiseaux jaseurs», ou une grivoiserie dont, malicieusement, l’air d’un enfant bien sage, elle détachait une grosse polissonnerie. Annette sursautait, mi-riante, mi-fâchée:
—Veux-tu, veux-tu bien te taire!
Elles étaient soulagées. L’air était détendu. Peu importent les mots! Les voix, comme les mains, rétablissent le contact. On se rejoint. Où était-on?... Gare au silence! Savons-nous où il peut, en une seconde d’oubli, t’emporter, m’emportera tire-d’aile? Parle-moi! Je te parle. Je te tiens. Tiens-moi bien!...
Elles se tenaient. Elles étaient bien décidées, quoi qu’il arrive, à ne plus se lâcher. Quoi qu’il pût arriver, cela ne touchait en rien à ce fait essentiel: «Je suis moi. Tu es toi. Nous échangeons. Tope là! On ne s’en dédira plus.» Il y avait un don mutuel, un tacite contrat, une sorte de mariage d’âme, d’autant plus efficace que nulle contrainte extérieure,—ni engagement écrit, ni sanction religieuse ou civile—ne pesait sur lui. Et qu’est-ce que cela faisait qu’elles fussent si différentes? On se trompe, en croyant que les meilleures unions reposent sur des affinités,—ou bien sur des contrastes. Ni les unes, ni les autres, mais un acte intérieur, un: «J’ai choisi, je veux, et je fais vœu», mais de la bonne trempe et solidement frappé par le coin d’une double décision têtue, comme ces deux filles au front rond. «Je t’ai, et je n’ai pas plus le pouvoir, maintenant, de te rendre, que de me reprendre... Au reste, tu es libre d’aimer qui tu voudras, de faire ce qui te plaira, quelque folie, un petit crime au besoin, si cela te chante, (je sais bien que tu ne le feras pas! mais quand même!) cela ne change rien au pacte.....» Explique qui voudra! La scrupuleuse Annette, si elle eût osé aller jusqu’au bout de sa pensée, aurait dû s’avouer qu’elle n’était pas du tout sûre de la valeur morale de Sylvie et de ses actions futures. Et Sylvie, qui voyait clair, n’eût pas mis sa main au feu qu’Annette ne serait pas capable, un jour, d’actes déconcertants. Mais cela regardait les autres, cela ne les concernait pas, elles deux. Elles deux, elles étaient sûres, elles avaient l’une dans l’autre une confiance absolue. Le reste du monde pouvait s’arranger comme il voudrait!... Quoi qu’elles fissent, du moment que ce ne pouvait atteindre leur mutuel amour, elles se pardonnaient tout, d’avance, les yeux fermés.
Ce n’était peut-être pas très moral; mais tant pis! On aurait le temps d’être moral, une autre fois.
Annette, un peu pédante, qui connaissait la vie par les livres,—ce qui ne l’empêchait pas de la découvrir ensuite: (car la vie n’a plus le même son, entendue, hors des livres)—se souvenait des beaux vers de Schiller:
—O mes fils, le monde est plein de mensonge et de haine; chacun n’aime que soi; tous les liens formés par un bonheur fragile sont incertains... Ce que le caprice a noué, le caprice le dénoue. La nature seule est sincère; elle seule repose sur des ancres inébranlables. Tout le reste flotte au gré des vagues orageuses... Le penchant vous donne un ami, l’intérêt un compagnon; heureux celui à qui la naissance donne un frère!... Contre ce monde de guerre et de trahison, ils sont deux à résister ensemble...
Sylvie ne les connaissait pas, bien sûr! Et elle eût trouvé sans doute que c’étaient, pour dire un sentiment simple, beaucoup de mots embrouillés. Mais, regardant Annette, le front penché, qui ne travaillait pas,—et sa solide nuque, et sa forte chevelure aux masses enroulées,—elle pensait:
—Elle rêve, encore, ma grande; elle est de nouveau plongée dans son coffre à folies. Ce qu’il en doit tenir, le coffre!... Heureusement que je suis là, maintenant! On ne l’ouvrira pas sans moi...
Car la petite cadette avait la conviction, peut-être exagérée, de sa supériorité de sens et d’expérience. Et elle se disait:
—Je la protégerai.
Elle aurait eu besoin de se protéger d’abord. Car, dans son coffre, les folies ne manquaient pas non plus. Mais celles-là, elle les connaissait d’avance; et elle les regardait, comme un propriétaire regarde ses locataires. Si on leur donne logement, ce ne sera pas pour rien... Et puis, «fais ce que veux, advienne que pourra!» Tant qu’il ne s’agissait que de soi, cela n’avait pas une énorme importance. On se débrouillerait toujours... Mais protéger une autre, c’était là un sentiment nouveau et délectable...
Oui, mais... Annette, le front penché, qui ne travaillait pas, caressait justement le même sentiment. Elle pensait:
—Ma petite folle chérie!... Heureusement que je suis arrivée à temps pour la guider!...
Et elle formait, pour l’avenir de Sylvie, des plans, certes charmants, mais pour lesquels Sylvie n’était pas consultée...
Quand elles avaient bien ruminé, chacune le bonheur de l’autre, (et, bien entendu, le sien propre, par-dessus le marché)...
—Zut! mon aiguille est cassée... On n’y voit plus, déjà...
...on jetait son ouvrage, et on sortait ensemble, pour se dégourdir les jambes; on allait sous la pluie, toutes deux enveloppées dans la même houppelande, jusqu’au fond du jardin, sous les arbres larmoyants qui perdaient leurs cheveux; on croquait à la treille une grappe de raisin blond, meilleur d’être mouillé; on causait, on causait... Et soudain, on se taisait, écoutant, aspirant le vent d’automne, l’odeur (on la mangerait) des fruits tombés, des feuilles mortes, la lumière lasse d’octobre qui s’éteint dès quatre heures, le silence des champs engourdis qui s’endorment, la terre qui boit la pluie, la nuit...
Et, la main dans la main, rêvant avec la nature frissonnante, qui couve l’espoir craintif et brûlant du printemps,—l’énigme de l’avenir...
Leur intimité, en ces fins jours d’octobre embrumés, enroulés comme d’une toile d’araignée, leur était devenue si nécessaire qu’elles se demandaient comment elles avaient pu jusque-là s’en passer.
Cependant, elles s’en étaient passées; et elles s’en passeraient encore. La vie ne s’enferme pas, dès vingt ans, dans une intimité, si chère soit-elle,—surtout la vie de deux êtres aussi ailés. Il faut qu’ils tentent les espaces de l’air. Si ferme que s’affirme la volonté de leur cœur, l’instinct de leurs ailes est plus fort. Quand Annette et Sylvie se disaient tendrement:
—Comment est-il possible qu’on ait vécu si longtemps l’une sans l’autre? elles ne s’avouaient pas:
—Il faudra bien pourtant, tôt ou tard, (quel dommage!) que l’on vive l’une sans l’autre!
Car l’autre ne peut pas vivre pour vous, à votre place; et vous ne le voudriez pas. Certes, il était profond, le besoin de leur tendresse mutuelle; mais elles avaient toutes deux un autre besoin plus fort, qui remontait plus loin, aux sources mêmes de leur être, les deux petites Rivière: le besoin de leur indépendance. Elles qui avaient tant de traits différents, elles avaient justement (ce n’était pas de chance!) ce trait commun entre elles. Et elles le savaient bien: c’était même une des raisons pour lesquelles, sans se le dire, elles s’aimaient le plus; car elles s’étaient reconnues en lui.—Mais alors, que devenaient leurs projets de fondre ensemble leurs vies? Quand chacune se berçait du rêve qu’elle saurait protéger la vie de l’autre, elle n’ignorait pas que l’autre n’y consentirait pas plus qu’elle-même n’y consentirait. C’était un tendre rêve, avec lequel on jouait. On tâchait que le jeu durât le plus longtemps possible.
Et il ne pouvait même pas durer longtemps.
Ce n’eût été rien encore d’être deux indépendantes. Mais ces petites Républiques, jalouses de leur liberté, avaient, sans le vouloir, comme toutes les Républiques, des instincts despotiques. Chacune avait tendance, ses lois lui semblant bonnes, à les exporter chez l’autre. Annette, capable de se juger, se blâmait après coup de ses empiétements sur le domaine de sa sœur;—mais elle recommençait. Elle avait un caractère entier et passionné qui, en dépit d’elle, était enclin à dominer. Cette nature pouvait bien s’atténuer quelque temps, sous le voile d’une grande tendresse; mais elle se maintenait. Il faut avouer, d’ailleurs, que si Annette faisait effort pour s’adapter aux volontés de Sylvie, Sylvie ne lui rendait pas la tâche commode. Elle n’en agissait qu’à sa tête; et sa tête avait, en vingt-quatre heures, plus de vingt-quatre volontés, qui n’allaient pas toujours d’accord entre elles. Annette, méthodique, ordonnée, riait d’abord, s’impatientait ensuite de ces sautes de caprices. Elle l’appelait: Rose des Vents et: Je veux... Qu’est-ce que je veux?—Et Sylvie l’appelait: Bourrasque, Madame J’ordonne, et Midi à douze heures, parce qu’elle était agacée de sa ponctualité.
Tout en se chérissant, il était difficile qu’elles pussent s’accommoder longtemps de la même façon de vivre. Elles n’avaient pas les mêmes goûts et les mêmes habitudes. Parce qu’elles s’aimaient, Annette pouvait bien prêter une oreille indulgente aux petits potins de Sylvie, qui avait l’œil très bon pour faire sa cueillette, l’oreille encore meilleure, mais non pas très bonne langue. Et Sylvie pouvait bien paraître s’intéresser, en avalant tout rond un bâillement amusé...
—(«Passe! Veux-tu passer!...»)
aux lectures assommantes dont Annette voulait avec elle partager le plaisir...
—Dieu! que c’est joli, chérie!
ou à certaines préoccupations de pensée saugrenues, sur la vie, sur la mort, ou sur la société...
—(«La barbe!... Turlututu!... Ils en ont, du temps à perdre!...»)
—Et toi, demandait Annette. Qu’est-ce que tu en penses, Sylvie?
(«Flûte!» pensait Sylvie).
—Je pense comme toi, chérie.
Cela n’empêchait pas du tout de s’adorer. Mais ça gênait tout de même un peu pour converser.
Et que faire des journées, seules dans la maison morose, à la lisière des bois, en face des champs dépouillés, sous le ciel bas d’automne qui se confond dans le brouillard avec la plaine nue? Sylvie avait beau dire et croire qu’elle adorait la campagne, elle avait bientôt fait d’en épuiser les plaisirs; elle y était désœuvrée, désorientée, perdue... La nature, la nature... Parlons franc! La nature la rasait... Non! ce pays de croquants!... Elle n’en supportait pas les petits désagréments: le vent, la pluie, la boue, (celle de Paris, en regard, lui paraissait plaisante), les souris trottinant derrière les vieilles cloisons, les araignées qui rentrent pour prendre quartiers d’hiver dans les appartements, et ces bêtes affreuses, les moustiques trompettants, qui se régalaient de ses chevilles et de ses poignets. Elle en eût bien pleuré d’agacement et d’ennui.—Annette, toute à la joie du grand air et de la solitude avec la sœur aimée, invulnérable à l’ennui, et riant des piqûres, cherchait à entraîner Sylvie dans ses courses crottées, sans remarquer la mine maussade et dégoûtée. Un souffle de vent de pluie l’enivrait; elle oubliait Sylvie, elle partait à grands pas dans les terres labourées, ou à travers les bois, en secouant les branches mouillées; ce n’était que longtemps après qu’elle se souvenait de la petite délaissée. Et Sylvie, qui boudait, en mirant piteusement son visage gonflé, se morfondait, pensant:
—Quand sera-t-on rentrées?
Enfin, parmi les mille et une volontés de la Rivière cadette, il y en avait une qui était bonne, bon teint, que rien ne pouvait altérer; et l’air de la campagne y donnait un nouveau lustre. Elle aimait son métier. Elle l’aimait vraiment. De bonne race ouvrière de Paris, il lui fallait son travail, son aiguille et son dé, pour occuper ses doigts et sa pensée. Elle avait le goût inné de la couture; ce lui était une volupté physique de manier pendant des heures une étoffe, un tissu léger, une mousseline de soie, de les plisser, froncer, de donner un coup de pouce à une coque de ruban. Et puis, sa petite caboche, qui ne se flattait pas, Dieu merci, de comprendre les idées qu’hébergeait la grande cervelle d’Annette, savait qu’ici, dans son domaine, dans le royaume des chiffons, elle avait ses idées, elle aussi, elle en avait à revendre... Eh bien, est-ce qu’elle pouvait renoncer à ses idées? On croit qu’il n’est pas de plus grand plaisir pour une femme que de porter de jolies robes!... Pour une femme vraiment douée, c’est un bien plus grand plaisir encore d’en fabriquer. Et de ce plaisir-là, quand on y a goûté, on ne peut plus se passer.—Dans l’oisiveté douillette où la tenait sa sœur, tandis qu’Annette promenait ses belles mains sur le clavier, Sylvie avait la nostalgie du bruit des grands ciseaux et de la machine à coudre. Toutes les œuvres d’art, si on les lui eût offertes, ne valaient pas pour elle le brave mannequin sans tête, qu’on drape à sa fantaisie, qu’on tourne, qu’on retourne, devant lequel on se met à croupetons, qu’on malmène sournoisement, et qu’on prend dans ses bras pour faire un tour de danse, quand la première n’y est pas. Quelques mots, çà et là, laissaient assez deviner le cours de ses pensées; et Annette, impatiente, voyant ses yeux s’illuminer, savait qu’elle allait encore subir une histoire d’atelier.
Aussi, lorsque de retour à Paris, Sylvie annonça qu’elle allait reprendre son chez soi et son travail régulier, Annette soupira; mais elle ne fut pas surprise. Sylvie, qui s’attendait à une opposition, fut beaucoup plus touchée du soupir, du silence, que de toutes les paroles. Elle courut à sa sœur assise, et, agenouillée devant elle, lui enlaçant la taille, et lui tendant ses lèvres:
—Annette, ne m’en veux pas!
—Chérie, lui dit Annette, ce qui est ton bonheur est le mien, tu le sais.
Mais elle avait de la peine. Sylvie en avait aussi.
—Ce n’est pas ma faute, dit-elle. Je t’aime tant, je t’assure!
—Oui, mon petit, je suis sûre.
Elle souriait, mais elle fit encore un gros soupir. Sylvie, toujours à genoux, lui prit entre ses mains le visage, et en approchant le sien:
—Je te défends de soupirer!... Vilaine! Si tu soupires comme ça, je ne pourrai plus partir. Je ne suis pas un petit bourreau.
—Non, chérie, tu n’es pas... J’ai tort, je ne le ferai plus... Mais ce n’était pas pour te blâmer. C’est qu’on va se quitter.
—Se quitter!... Par exemple!... Vilaine!... On se verra, tous les jours. Tu viendras. Je viendrai. Tu me gardes ma chambre. Est-ce que tu as la prétention, par hasard, de me la reprendre? Non, non, elle est à moi, je ne te la rends pas. Quand je serai fatiguée, je compte bien m’y faire gâter. Et tu sais, certains soirs, où tu ne m’attendras pas, à des heures indues, j’arrive, j’ai la clef, j’entre et je te surprends... Gare, si tu fais des farces!... Tu verras, tu verras, on s’aimera encore plus; ce sera encore meilleur... Se quitter!... Penses-tu que je voudrais te quitter, que je pourrais me passer de mon Annette jolie!
—Ah! câline! mâtine! disait Annette, en riant, comme elle s’entend bien à vous enjôler! Sacré petit menteur!
—Annette! veux-tu pas jurer! faisait Sylvie, sévère.
—Eh bien! menteur tout court... Est-ce que c’est permis?
—Oui, ça, ça peut aller, disait Sylvie, magnanime...
Elle sautait au cou d’Annette, et l’embrassait à l’étouffer.
—Je te mens, je te mens, je te mange!...
La tendre et rusée avait d’autres moyens de se faire pardonner. Elle demanda à Annette de l’aider à s’établir à son compte. Cette «jeunesse» de vingt ans voulait être maîtresse chez soi, ne plus être commandée, commander à son tour,—ne fût-ce qu’à son mannequin. Annette fut enchantée d’avoir à donner de l’argent. Les deux sœurs firent des devis ensemble, discutèrent à perte de vue sur l’installation, coururent les jours suivants pour chercher un logement, puis pour choisir les meubles et le matériel, puis pour le mettre en place, puis pour se mettre en règle avec l’administration, dressèrent pendant des soirées des listes de clientèle, firent projet sur projet, démarche sur démarche:—si bien qu’Annette finit par avoir l’illusion que c’était elle qui s’établissait avec Sylvie. Et elle en oublia que leurs vies allaient se séparer.
Les clientes ne tardèrent pas à se montrer chez Sylvie. Annette promenait dans ses visites les plus jolies robes de la petite couturière, et chantait ses louanges. Elle réussit à lui envoyer plusieurs jeunes femmes de son monde. Sylvie, de son côté, exploitait sans scrupules les adresses des clientes de ses anciennes patronnes. Elle était cependant assez sage pour ne pas vouloir élargir trop vite le cercle de ses opérations. Peu à peu. La vie est longue. On a le temps... Elle aimait le travail, mais non jusqu’à la manie de certaines fourmis humaines—et surtout féminines—qu’elle avait vues se tuer à la tâche. Elle entendait bien réserver sa place au plaisir. Le travail en est un. Mais il n’est pas le seul. «De tout, un peu.» Sa devise de petit appétit, mais friand et curieux...
En peu de temps, sa vie fut si remplie qu’il n’en resta plus beaucoup pour Annette. Sylvie lui gardait bien, quoi qu’il advînt, sa part; elle y tenait. Mais pour le cœur d’Annette, une part était peu. Elle ne savait pas se donner à moitié, ou au tiers, ou au quart. Il lui fallut apprendre que le monde est, dans ses affections, comme un petit marchand: il les livre, au détail. Ce fut long à comprendre, plus long à accepter. Elle n’en était encore qu’aux premières leçons.
Elle souffrit, sans le dire, de se voir, peu à peu, éliminée des journées de Sylvie. Sylvie n’était plus jamais seule, chez elle, à l’atelier. Et bientôt, elle ne le fut plus, en dehors du métier. Elle avait repris un ami. Annette se replia. Sa tendresse pour sa sœur la défendait maintenant contre le dépit jaloux et la sévérité des jugements de naguère. Mais elle ne la défendait pas contre la mélancolie. Sylvie, qui l’aimait assez pour avoir, malgré sa légèreté, l’intuition de la peine qu’elle causait, s’arrachait, de temps en temps, à la farandole de ses occupations, sérieuses ou plaisantes,—et tout d’un coup, au milieu d’un travail, ou bien d’un tête-à-tête, elle plantait là les affaires pressées, et courait chez Annette. Alors, c’était un tourbillon de tendresse qui passait. A l’heure où elle passait, cette tendresse n’était pas moindre chez Sylvie que chez Annette. Mais elle passait; et quand le tourbillon remportait à ses affaires ou bien à ses plaisirs Sylvie, repue d’Annette, Annette, reconnaissante du petit ouragan d’amoureux bavardage, de folles confidences, d’embrassades rieuses, qui l’avait visitée, soupirait, se retrouvant plus seule et plus troublée.
Ce n’étaient pourtant pas les occupations qui lui manquaient. Ses journées étaient aussi pleines que celles de Sylvie.
Sa vie, sa double vie, intellectuelle et mondaine, interrompue depuis la mort du père, avait repris son cours. Les besoins de son esprit, qu’avaient refoulés, pendant la dernière année, les exigences du cœur, s’étaient réveillés plus forts. Autant pour combler les heures creusées par l’absence de Sylvie que parce qu’en une riche nature l’intelligence est mûrie par les expériences de la vie passionnelle, elle s’était remise à ses études de sciences; et elle s’étonnait d’y porter un regard plus clair qu’elle ne l’avait, avant. Elle s’intéressait à la biologie, et projetait une thèse sur les origines du sentiment esthétique et ses manifestations dans la nature.
Elle avait renoué aussi ses relations de société; elle retournait dans le monde qu’elle fréquentait jadis avec son père. Elle y trouvait un plaisir neuf. Plaisir de curiosité, d’esprit plus averti, qui découvrait chez ceux qu’on croyait connaître des aspects imprévus dont on ne se doutait pas. D’autres plaisirs encore, d’un ordre bien différent, les uns dont on convenait, les autres qu’on n’avouait pas: plaisir de plaire, forces obscures d’attraction (de répulsion aussi) qui s’éveillent en nous, qui s’éveillent autour, relations magnétiques qui, sous des mots trompeurs, s’instituent entre les esprits et les corps, sourds instincts de possession qui, par moments, affleurent à la surface égale et monotone des pensées de salons, s’effacent invisibles, mais frémissent au fond...
Le monde et le travail n’occupaient encore que la moindre partie de ses jours. Jamais la vie d’Annette n’était aussi peuplée que lorsqu’elle était seule. Dans les longues soirées et les heures de la nuit, où le sommeil rejette l’âme dans la veille, avec ses pensées hallucinées, comme le flot qui se retire laisse sur le rivage les myriades d’organismes arrachés aux abîmes nocturnes de l’océan,—Annette contemplait le flux et le reflux de sa mer intérieure, et la plage ensemencée. C’était le grand équinoxe du printemps.
Une partie de ces forces qui remuaient en elle ne lui étaient pas neuves; mais en même temps que leur énergie était décuplée, le regard de l’esprit en prenait conscience avec une netteté exaltée. Leurs rythmes contradictoires mettaient au cœur une ivresse, un vertige... Impossible de saisir l’ordre caché dans cette mêlée. Le choc violent de la passion sexuelle, qui avait, en un orage d’été, secoué le cœur d’Annette, laissait un ébranlement durable. Le souvenir de Tullio avait beau être effacé, l’équilibre de l’être était pour longtemps troublé. La tranquillité de sa vie, l’absence d’événements faisaient illusion à Annette: elle eût pu croire qu’il ne se passait rien et répété volontiers le cri nonchalant de ces veilleurs de nuit, dans les belles nuits italiennes: «Tempo sereno!...» Mais la chaude nuit couvait des orages nouveaux; et l’air, instable, frémissait de remous inquiets. Un perpétuel désordre. Les poussées des âmes mortes, revivantes, se heurtaient dans cette âme en fusion... Ici, le dangereux héritage paternel, ces désirs qui, d’ordinaire, oubliés, endormis, se levaient brusquement, comme une lame de fond. Là, des forces contraires: une fierté morale, la passion de la pureté. Et cette autre passion de son indépendance, dont Annette avait éprouvé déjà, dans son union avec Sylvie, la gêne impérieuse,—dont elle pressentait, avec inquiétude, les conflits plus tragiques, un jour, avec l’amour. Tout ce travail intérieur l’occupait, la remplissait, pendant les longues journées d’hiver. L’âme, comme la chrysalide, enserrée dans le cocon de la lumière embrumée, rêvait son avenir, et s’écoutait rêver...
Soudain, elle perdait pied. Il se produisait de ces arrêts de conscience, comme l’automne dernier, çà et là, en Bourgogne, de ces vides où l’on sombre... Des vides? Non, ils n’étaient pas vides; mais que se passait-il au fond?... Ces étranges phénomènes, inaperçus, inexistants peut-être avant les dix derniers mois, et qui s’étaient déclenchés surtout depuis la crise passionnelle de l’été, devenaient plus fréquents. Annette avait le sentiment vague que ces gouffres de conscience s’ouvraient aussi la nuit, parfois, pendant qu’elle dormait... de lourds sommeils d’hypnose... Lorsqu’elle en ressortait, elle revenait de très loin; il n’en restait pas un souvenir; et pourtant, on avait la hantise qu’il s’y était passé des choses graves, des mondes, de l’innommable, de l’au-delà de ce qui est permis et tolérable à la raison, bestial et surhumain, comme chez les monstres grecs ou les gargouilles des cathédrales. Une glaise informe, et qui collait aux doigts. On se sentait lié vivant à cet inconnu des songes. Pesait une tristesse, une honte, la lourdeur chaude d’une complicité, qu’on ne pouvait définir. La chair en restait imprégnée d’une odeur fade qui traînait pendant des jours. C’était comme un secret qu’on portait, au milieu des images fugaces de la journée, caché derrière la porte close du front lisse, sans pensées, les yeux indifférents, qui regardent au dedans, et les mains sagement croisées au-dessus du ventre—lac dormant...
Annette portait ce rêve perpétuel, partout où elle allait: dans le mouvement des rues, dans la torpeur studieuse des cours et des bibliothèques, dans l’aimable banalité des entretiens de salon, que relève un grain de flirt et d’ironie. Plus d’un remarquait dans les soirées le regard absent de cette jeune fille qui, distraitement, souriait, moins à ce qu’on lui disait qu’à ce qu’elle se racontait, attrapait au hasard quelques mots qui passaient, et repartait bien loin, écoutant on ne savait quels oiseaux cachés au fond de sa volière.
Si bruyant était le concert du petit peuple intérieur qu’Annette se surprit à l’écouter, un jour que Sylvie, l’aimée, était là devant elle, lui riait, l’étourdissait de son cher bavardage, lui disait... Qu’est-ce qu’elle lui disait?... Sylvie s’en aperçut; elle la secoua en riant:
—Tu dors, tu dors, Annette!
Annette protestait.
—Si, si, je l’ai vu, tu rêves debout, comme un vieux cheval de fiacre. Qu’est-ce que tu fais de tes nuits?
—Polisson!... Et des tiennes, si je te demandais?...
—Des miennes? Tu veux savoir? Très bien! Je vais te raconter. On ne s’ennuiera pas.
—Non! Non! faisait Annette, en riant, tout à fait réveillée.
Elle mettait la main sur la bouche de sa sœur. Mais Sylvie, se dégageant et lui prenant la tête, la regardait dans les yeux:
—Tes beaux yeux de somnambule... Montre un peu ce qu’il y a dedans... Qu’est-ce que tu rêves, Annette? Dis! Dis! Dis ce que tu rêves! Raconte! Allons, raconte!
—Qu’est-ce que tu veux que je raconte?
—Dis à quoi tu pensais.
Annette se défendait, mais elle finissait toujours par céder. Ce leur était à toutes deux un vif plaisir de tendresse—peut-être aussi d’égoïsme—de tout se raconter. Elles ne s’en lassaient point. Annette essayait donc de démêler ses rêves, beaucoup moins pour Sylvie que pour son propre soulagement. Elle expliquait, non sans peine, mais avec un grand scrupule et un sérieux, qui faisait pouffer Sylvie, toutes ses folles pensées,—les naïves, les candides, les baroques, les hardies, et même parfois...
—Eh bien! eh bien! Annette!... Dis donc, quand tu t’y mets!... s’exclamait Sylvie, qui jouait la scandalisée.
Elle n’avait peut-être pas une vie intérieure moins étrange,—(ni plus ni moins que nous tous),—mais elle ne s’en doutait pas, et elle ne s’y intéressait pas, en petite personne pratique, qui croit une fois pour toutes à ce qu’elle voit, à ce qu’elle touche, au rêve sensé et vulgaire de l’existence à fleur de terre, et qui écarte, comme absurde, tout ce qui pourrait l’en troubler.
Elle riait de tout de son cœur, en écoutant sa sœur. Cette Annette, tout de même, qui eût pensé cela! Avec son air innocent, elle vous disait gravement, parfois, des choses énormes. Et puis, elle s’effarait de choses toutes simples, que tout le monde savait. Elle en faisait part à Sylvie, avec une conviction comique. Par là-dessus, Dieu sait quelles idées saugrenues lui passaient par la caboche!... Sylvie la trouvait compliquée, adorable, tordante, fichtre pas débrouillarde. Toujours cette maladie de se mettre martel en tête, pour ce qu’il n’y a qu’à laisser «chanter comme ça vous vient!»
—C’est que, disait Annette, ça chante une demi-douzaine d’airs à la fois!
—Eh bien, c’est amusant, faisait Sylvie. C’est comme à la fête du Lion de Béfort.
—Horreur! criait Annette, se bouchant les oreilles.
—Moi, j’adore ça. Trois ou quatre manèges, des tirs, des trompes de trams, des orgues à vapeur, des cloches, des sifflets, tout le monde qui crie ensemble, on ne peut plus s’entendre, on crie plus fort qu’eux tous, ça ronfle, ça rit, ça roule, ça vous réjouit le cœur...
—Petit populo!
—Mais, mon aristoquée, c’est toi, (tu viens de le dire), c’est toi qui es comme ça! Si ça ne te plaît pas, tu n’as qu’à faire comme moi. Chez moi, tout est rangé. Chaque chose à sa place. Chaque lièvre à son tour!
Et certes, elle disait vrai. Quelque chahut qu’il fît sur la place Denfert, ou dans son petit cerveau, elle savait se retrouver dans l’une comme dans l’autre. Elle eût fait instantanément l’ordre dans le désordre le plus inextricable. Elle savait mettre d’accord tous ses divers besoins, et du corps et du cœur, et de la vie bourgeoise et de celle qui ne l’était pas. A chacun son casier. Comme le lui disait Annette:
—Un meuble à tiroirs... Voilà comment tu es!...
(lui montrant le fameux chiffonnier Louis XV, où les lettres du père avaient été rangées).
—Oui, répondait Sylvie, narquoise, il me ressemblait...
(Ce n’était pas du meuble qu’elle parlait).
—...Au fond, c’est moi la vraie...
Elle voulait faire enrager Annette. Mais Annette ne «marchait» plus. Elle n’était plus jalouse de l’hérédité de son père. Elle en avait sa part. Elle l’eût bien cédée. C’était, à certains jours, un hôte assez gênant!...
Elle ne savait comment; mais, cette dernière année, elle avait perdu l’aplomb de son esprit logique et de ses jambes solides, fermement implantés dans le monde réel; et elle ne voyait pas comment elle réussirait à le retrouver. Elle eût donné beaucoup pour chausser les petites bottines de Sylvie qui, sans une hésitation, de leur pas décidé, faisaient claquer sur le sol leurs talons. Elle ne se sentait plus assez rivée à la vie quotidienne, à la vie de tout le monde et de tous les instants. Au contraire de sa sœur, elle était trop prise par son existence intérieure; et elle ne l’était plus assez par celle que le soleil éclaire. Il en serait ainsi, sans doute, tant qu’elle n’aurait pas été happée par le grand piège sexuel, où les rêveurs tombent plus vite et plus maladroitement que les autres. L’heure insidieuse venait. Le filet s’apprêtait...
Mais pour une âme un peu fauve, et de la grande espèce, ce filet même suffirait-il à la tenir longtemps?...
En attendant qu’elle le sût, elle tournait autour,—certes sans y penser: car si elle y eût pensé, elle se fût rejetée en arrière, avec une révolte irritée.—N’importe! Chacun de ses pas la rapprochait du piège...
Elle devait se l’avouer: elle qui, l’année d’avant, affectait à l’égard des hommes la tranquille assurance d’un camarade, sans doute un peu coquet, aimable, mais indifférent,—car d’eux elle ne semblait rien désirer ni craindre,—elle les voyait maintenant avec d’autres yeux. Elle se tenait dans une attitude d’observation et d’attente troublée. Depuis l’aventure avec Tullio, elle avait perdu son beau calme insolent.
Elle savait à présent qu’elle ne pourrait se passer d’eux; et le sourire de son père lui venait aux lèvres, quand elle se rappelait ses déclarations enfantines, à l’idée du mariage. La passion avait laissé dans la chair son dard de guêpe. Chaste et brûlée, naïve et avertie, elle connaissait ses désirs; et si elle les refoulait dans l’ombre de sa pensée, ils marquaient leur présence par le désarroi qu’ils introduisaient dans le reste de ses idées. Toute son activité d’esprit était désorganisée. Ses forces de réflexion étaient paralysées. Au travail, écrivant ou lisant, elle se sentait diminuée. Elle ne pouvait se concentrer sur un objet qu’au prix d’efforts disproportionnés; elle en était, après, épuisée, écœurée. Et elle avait beau faire, le nœud de son attention se défaisait toujours. Dans tout ce qu’elle pensait, s’infiltraient des nuées. Les buts très nets,—trop nets et trop bien en lumière—qu’elle avait fixés à son intelligence, s’estompaient dans le brouillard. La route droite qui devait l’y mener, s’interrompait, à tout instant coupée. Annette, découragée, pensait:
—Je n’arriverai jamais.
Après avoir naguère attribué orgueilleusement à la femme toutes les capacités intellectuelles de l’homme, elle avait l’humiliation de se dire:
—Je me suis trompée.
Sous l’impression de lassitude qui l’oppressait, elle reconnaissait (à tort ou à raison) certaines faiblesses cérébrales de la femme, qui tiennent peut-être à sa déshabitude séculaire de la pensée désintéressée, de cette activité d’esprit objectif et libéré de soi, qu’exige la science ou l’art véritables,—mais plus probablement à la sourde obsession des grands instincts sacrés, dont la nature a mis en elle le riche et lourd dépôt. Annette sentait que, seule, elle était incomplète: incomplète d’esprit, et de corps, et de cœur. Mais de ces deux derniers, elle se parlait le moins possible: ils ne se rappelaient que trop à sa pensée.
Elle était à cette heure de la vie où l’on ne peut plus vivre sans compagnon. Et la femme, moins que l’homme: car en elle, ce n’est pas seulement l’amante, c’est la mère que l’amour éveille. Elle ne s’en rend pas compte: les deux aspirations se fondent en un même sentiment. Annette, sans fixer encore sur aucun ses pensées, avait le cœur gonflé du besoin de se donner à un être, et plus fort et plus faible, qui la prît dans ses bras et qui bût à son sein. A cette idée, elle défaillait de tendresse; elle eût voulu que tout le sang de son corps se convertît en lait, afin de le donner... Bois!... O bien-aimé!...
Tout donner!... Mais non! Elle ne pouvait tout donner. Ce ne lui était pas permis... Donner tout!... Oui, son lait, son sang, son corps, et son amour... Mais tout? toute son âme? toute sa volonté? et pour la vie entière?... Non, cela, elle le savait, elle ne le ferait jamais. Quand elle l’eût voulu, elle ne l’aurait pas pu. On ne peut pas donner ce qui n’est pas à nous,—mon âme libre. Mon âme libre ne m’appartient pas. C’est moi qui appartiens à mon âme libre. Je ne puis en disposer... Sauver sa liberté est beaucoup plus qu’un droit, c’est un devoir religieux...
Il y avait dans ces pensées d’Annette un peu de la raideur morale qu’elle tenait de sa mère. Mais chez elle, tout prenait un caractère passionné; elle eût réchauffé de son sang impétueux les idées les plus abstraites... Son «âme!»... Ce mot «protestant»! (C’était elle qui parlait...—Elle l’employait souvent!...) Est-ce que la fille de Raoul Rivière n’en avait qu’une seule, âme? Elle en avait un troupeau, et, dans le tas, trois ou quatre de belle taille, qui ne s’entendaient pas toujours ensemble...
Toutefois, ce combat intérieur se livrait dans une sphère imprécise. Annette n’avait pas encore eu l’occasion de mettre à l’épreuve ces passions contraires. Leur opposition restait un jeu de l’esprit, ardent, assez émouvant, mais sans risques; on n’était pas forcé de se décider; on pouvait s’accorder le luxe d’essayer en pensée l’une ou l’autre solution.
C’était un sujet de discussions rieuses avec Sylvie, un de ces problèmes du cœur, dont raffole le cœur juvénile, dans les périodes d’oisiveté ou d’attente, jusqu’au jour où la réalité décide brusquement pour vous, sans se soucier de vos élégants arrangements.—Sylvie comprenait très bien le double besoin d’Annette; mais elle n’y voyait, pour son compte, aucune contradiction; il n’y avait qu’à faire comme elle: aimer, quand il vous plaît; être libre, quand il vous plaît...
Annette secouait la tête:
—Quoi! non?
Elle refusait de s’expliquer.
Sylvie disait, moqueuse:
—Tu trouves que c’est assez bon pour moi?
Annette se récriait:
—Non, chérie. Tu sais bien que je t’aime, comme tu es.
Mais Sylvie ne se trompait guère. Annette, par affection, se refusait à juger (en soupirant tout bas) les libres amours de Sylvie. Mais pour elle-même, elle en rejetait la pensée. Ce n’était pas seulement le puritanisme maternel qui y eût vu une flétrissure. C’était sa nature «entière», c’était la plénitude même de son Désir, qui se refusait à le morceler en menue monnaie. Malgré l’obscur appel d’une forte vie sensuelle, il lui eût été impossible, à ce moment de sa vie, d’accueillir sans révolte l’idée d’un amour où tout l’être, les sens, le cœur et la pensée, le respect qu’on a de soi, le respect qu’on a de l’autre, le religieux élan de l’âme passionnée, n’eussent pas également leur place au banquet. Donner son corps et réserver sa pensée,—non, il ne saurait en être question... C’était une trahison!... Alors, il ne restait donc qu’une solution, le mariage, l’amour unique? Etait-ce un rêve possible, pour une Annette?
Qu’il fût possible ou non, il n’en coûtait rien de le rêver, par avance. Elle ne s’en privait point.—Elle était arrivée à la lisière du bois de l’adolescence, au bel instant final où, savourant encore l’ombre et l’abri des songes, on voit s’ouvrir dans la plaine, au soleil, les longues routes blanches. Sur laquelle s’inscriront nos pas? Rien ne presse de choisir. L’esprit s’attarde en riant, et il les choisit toutes.—Une jeune fille heureuse, sans soucis matériels, qui rayonne l’amour, les bras pleins d’espérance, voit s’offrir à son cœur la possibilité de vingt vies différentes; et, avant même de se demander:
—«Quelle est celle que je préfère?» elle prend toute la gerbe, afin de la respirer. Annette goûtait, tour à tour, par l’imagination, l’avenir partagé avec tel, et puis tel, et puis tel compagnon, laissant le fruit mordu, en grignotant un autre, puis revenant au premier, en tâtant un troisième,—sans se décider pour aucun.—Age d’incertitude, heureuse d’abord, exaltée, mais qui bientôt connaît aussi des lassitudes, des dépressions accablées, et parfois même le doute désespérant.
Ainsi rêvait Annette sa vie—ses vies à venir. Elle en confiait l’incertaine attente à la seule Sylvie. Et Sylvie s’amusait des indécisions langoureuses et inquiètes de sa sœur. Elle les connaissait peu: car elle avait plutôt l’habitude—(elle s’en vantait, pour scandaliser Annette)—de se décider avant de choisir. Se décider, tout de suite. Après, on a le temps de faire son choix...
—Et au moins, disait-elle, de son air fanfaron, on sait de quoi on parle!
Dans le monde où elle allait, Annette avait de grands succès. Elle était courtisée par la plupart des jeunes gens. Les jeunes filles, dont beaucoup étaient plus jolies, ne lui en savaient pas très bon gré. Elles avaient d’autant plus de raisons d’être froissées qu’Annette ne semblait pas se donner grand mal pour plaire. Distraite, un peu lointaine, elle ne faisait rien pour piquer l’intérêt ou flatter l’amour-propre des hommes qui la recherchaient. Tranquillement installée dans un coin du salon, elle les laissait venir, sans qu’elle parût remarquer leur présence, écoutait en souriant, (on n’était jamais sûr qu’elle avait entendu), et, lorsqu’elle répondait, ne sortait guère d’aimables banalités. Cependant, ils venaient tous, et tâchaient de la captiver: les mondains, les brillants, et les honnêtes jeunes gens.
Les jalouses prétendaient qu’Annette cachait son jeu, et que son indifférence n’était qu’une ruse de coquette avertie; elles faisaient remarquer que, depuis quelque temps, la correction un peu froide d’Annette dans sa mise, avait fait place à d’élégantes toilettes, dont la note fantasque savait habilement, disaient-elles, relever l’ennui de sa laideur endormie. Les méchantes langues ajoutaient que c’était sa fortune plus que ses yeux qu’on courtisait.—Mais, quant à ses toilettes, l’artifice charmant n’en devait pas être attribué à Annette: le goût et l’esprit de Sylvie avaient tout fait. Et, sans doute, Annette était un «beau parti»; mais si sa petite cour, certes, en tenait compte, c’était plutôt la nuance de respect dont se marquaient leurs hommages qu’on devait attribuer à cette considération. Moins pourvue par la fortune, ils ne l’eussent pas moins, mais plus hardiment poursuivie.
L’appât était plus profond. Annette, sans être coquette, était suffisamment servie par ses instincts. Riches et forts, ils n’avaient pas besoin qu’on leur dît ce qu’il fallait faire: leur action était sûre, car la volonté ne s’en mêlait pas. Tandis que, souriante, engourdie, comme tassée dans sa vie intérieure, elle se laissait aller au flot agréable d’une songerie indistincte, qui ne l’empêchait pas de voir et d’entendre, en un vague voluptueux, son corps parlait pour elle; une puissante attraction s’exhalait de ses yeux, de sa bouche, de ses membres frais et robustes, de la jeunesse de son être chargé d’amour, comme une glycine en fleur. Le charme était si fort que nul, en la voyant, (à moins qu’il ne fût une femme), n’eût songé qu’elle fût laide. Et si elle parlait peu, il suffisait de quelques mots çà et là, dans un entretien vide, pour évoquer des horizons d’esprit inaccoutumés. Aussi n’offrait-elle pas moins aux désirs de ceux qui cherchaient l’âme qu’aux convoitises de ceux qui avaient reconnu en ce corps assoupi (eau qui dort) les richesses du plaisir qui s’ignorent.
Elle, ne semblait pas voir; mais elle voyait très bien. C’est un don féminin. Il était, chez Annette, complété par une vigueur d’intuition, qui est souvent le propre d’une forte vitalité, et qui, sans gestes ni paroles, perçoit immédiatement le langage d’être à être. Quand elle semblait distraite, c’était qu’elle l’écoutait. Ombreuse forêt des cœurs!... Ils étaient—eux et elle—à la chasse. Chacun cherchait sa piste. Après avoir quelque temps flotté de l’une à l’autre, Annette choisit la sienne.
Les jeunes hommes entre qui se limitait son choix appartenaient à cette bourgeoisie riche, intelligente, active, d’idées avancées, (ils le croyaient du moins), dont avait fait partie Raoul Rivière. On était peu après la tornade de l’Affaire Dreyfus. Elle avait rapproché des hommes de milieux de pensée différents, mais qu’un commun instinct de justice sociale avait groupés ensemble. Cet instinct, comme on vit par la suite, n’était pas très résistant. L’injustice sociale se borna pour lui à une seule injustice. Exemple en avait été, entre mille, ce Rivière, que les iniquités du monde n’empêchaient pas de dormir, qui même avait su conclure, sans troubles de conscience, de fructueuses affaires avec le Sultan, au temps que Sa Hautesse opérait froidement, dans le silence de l’Europe complaisante, le premier massacre des Arméniens,—et qui, très sincèrement, avait été bouleversé par la fameuse Affaire. Il ne faut pas trop demander aux hommes! Quand ils ont combattu pour la justice, une fois dans leur vie, ils sont époumonnés. Du moins, ils ont été justes, un jour: il faut leur en savoir gré. Ils s’en savent gré, eux-mêmes. La société de Rivière, les familles dont les fils étaient aujourd’hui les amoureux d’Annette, n’avaient aucun doute sur les mérites qu’ils s’étaient acquis dans le championnat du Droit, et sur l’inutilité de les renouveler par des efforts nouveaux. Ils restaient, une fois pour toutes, l’équipe du Progrès, les bras croisés.
D’esprit assez apaisé, d’ailleurs, sur le terrain international, à cette heure passagère où les luttes civiques avaient à peu près éteint les haines nationales; à part un vieux tison d’anglophobie, que la guerre des Boers faisait encore fumer,—d’un patriotisme atténué, très peu militariste,—portés à la tolérance et à la bonne humeur, car ils s’étaient bien pourvus, étant du parti vainqueur,—ils donnaient l’impression d’une société facile à vivre, à la morale large, vaguement humanitaire, plus certainement utilitaire, sceptique, sans grands principes, mais sans grands préjugés... (Il ne fallait pas s’y fier!...) Ils comptaient dans leurs rangs quelques catholiques libéraux, pas mal de protestants, un plus grand nombre de Juifs, et un gros de bonne bourgeoisie française, indifférente à toute religion et y ayant substitué la politique; elle portait des étiquettes variées, mais ne s’écartant guère du républicanisme qui, ayant duré trente ans, commençait à devenir une forme—la plus pratique—du conservatisme. Le socialisme y était représenté aussi; mais c’était par de jeunes bourgeois, riches et intellectuels, qu’avaient conquis la langue dorée et l’exemple de Jaurès. Il en était encore à sa lune de miel avec la République.
Annette ne s’était jamais sérieusement intéressée à la politique. Sa forte vie intérieure ne lui en laissait pas le temps. Mais elle avait passé, comme les autres, par son heure d’exaltation pendant «l’Affaire». Son amour pour son père la modelait à l’image de ce qu’il sentait. Elle était prédisposée, par l’élan de son cœur et par l’instinct de liberté qu’elle portait dans son sang, à se trouver toujours du parti des opprimés. Elle avait donc connu des moments d’émotion passionnée, quand Zola et Picquart affrontaient la grande Bête—l’opinion déchaînée; et il n’était pas impossible que, comme plus d’une jeune fille, en passant le long de la prison du Cherche-Midi, son cœur n’eût battu pour celui qui y était enfermé. Mais ces sentiments étaient peu raisonnés; et Annette n’avait pu s’obliger à un examen critique de «l’Affaire». La politique la rebutait; quand elle avait tenté d’y regarder de près, elle s’en était aussitôt écartée par un mélange d’ennui et de répugnance, qu’elle ne cherchait pas à analyser. Son regard était trop franc pour ne pas avoir entrevu la somme de petitesses et de malpropretés, qui se répartissent à peu près également de l’un et de l’autre côtés. Moins sincère que ses yeux, son cœur voulait continuer à croire que le parti qui soutenait les idées de justice devait être composé des hommes les plus justes. Et elle se reprochait ce qu’elle nommait sa paresse à mieux connaître leur action. C’est pourquoi elle se contraignait, à leur égard, à une sympathie d’attente,—comme à l’exécution d’une page de musique nouvelle, que garantit un nom autorisé, un auditeur respectueux, qui ne la comprend pas, fait crédit aux beautés que, plus tard, il découvrira, peut-être...
Annette, étant loyale, croyait à la vertu des étiquettes, ignorant que nulle part la fraude n’est plus courante que dans le commerce des idées. Elle attribuait encore quelque réalité aux ismes de fabrique, dont le cachet distingue les divers crus politiques; et elle était attirée par ceux qui annonçaient les partis avancés. Une secrète illusion lui faisait espérer que c’était de ce côté qu’elle aurait le plus de chances de rencontrer le compagnon. Habituée à l’air libre, elle allait vers ceux qui le cherchaient, comme elle, hors des vieux préjugés, des manies séculaires, et de l’étouffement de la maison du passé. Elle ne disait point de mal de la vieille demeure. Des générations y avaient abrité le rêve de leur vie. Mais l’air était vicié. Y reste qui voudra! Il fallait respirer. Et elle quêtait des yeux l’ami qui l’aiderait à reconstruire, saine et claire, sa maison.
Dans les salons qu’elle fréquentait, il ne manquait pas de jeunes hommes capables, semblait-il, de la comprendre et de l’aider. Avec ou sans étiquette, beaucoup avaient l’esprit hardi.—Mais le malheur voulait que leur hardiesse ne fût pas orientée vers les mêmes horizons. Comme dit le philosophe, «l’élan vital» est limité. Il ne s’exerce jamais, à la fois, de tous les côtés. Rares, infiniment, sont les esprits qui projettent leur lumière tout autour, en marchant. La plupart de ceux qui ont réussi à allumer leur lanterne (et ils ne sont pas nombreux!) tiennent leur fanal braqué devant eux, sur un point, un seul point; et autour, ils ne voient goutte. On dirait même que l’avance dans une direction soit presque toujours payée par un recul dans une autre. Tel qui, en politique, est un révolutionnaire, est, en art, un conservateur poncif. Et s’il s’est dépouillé d’une poignée de ses préjugés, (de ceux auxquels il tenait le moins), il n’en serre que plus avarement les autres contre sa peau.
Nulle part ne s’accusaient mieux les inégalités de cette marche cahotante que dans l’évolution morale des deux sexes. La femme qui, s’efforçant de rompre avec les errements du passé, s’engageait sur un des sentiers qui menaient à la société nouvelle, y rencontrait rarement l’homme qui voulait aussi fonder le monde nouveau. Il prenait une autre route. Et si leurs chemins grimpants devaient finir, peut-être, par se réunir là-haut, pour l’instant, ils se tournaient le dos. Cette divergence de buts était surtout frappante, à cette époque, en France, où l’esprit féminin, plus longtemps retenu en arrière, était en train de prendre, depuis quelques années, une soudaine avance, dont les hommes d’alors ne se rendaient pas compte. Les femmes, elles-mêmes, n’en avaient pas toujours une exacte mesure, jusqu’au jour où le heurt d’une expérience personnelle leur révélait le mur qui les séparait de leurs compagnons. Le choc était rude.—Annette devait, à ses dépens, faire la découverte du douloureux malentendu.
Parmi les âmes flottantes, dont l’essaim l’entourait, ses yeux, ses yeux distraits qui, sans qu’on s’en doutât, faisaient le tour de chacune, venaient de fixer leur choix. Mais ils ne l’avaient point dit. Elle tâchait de se donner le plus longtemps possible l’illusion d’hésiter encore. Quand on n’a plus la peine de prendre la décision, c’est alors qu’il est doux de se murmurer:
—«Rien ne me tient encore», et, pour la dernière fois, de laisser grandes ouvertes toutes les portes de l’espoir.
Ils étaient deux, surtout, entre qui elle aimait à laisser suspendu son avenir,—bien qu’elle sût très bien celui qu’elle avait choisi: deux jeunes hommes de vingt-huit à trente ans, Marcel Franck et Roger Brissot. Tous deux de bourgeoisie aisée, de manières distinguées, aimables, intelligents, mais de milieux d’esprit et de caractères différents.
Marcel Franck, de famille à demi israélite, avait un de ces types séduisants, que donnent parfois les mariages mixtes entre individus bien choisis des deux races. De taille moyenne, mince, fin, élégant, il avait les yeux bleus dans la face d’un blanc mat, le nez un peu busqué, une petite barbe blonde; le profil allongé, légèrement chevalin, rappelait Alfred de Musset. Il en avait aussi le regard spirituel, caressant, qui tantôt câlinait, tantôt déshabillait. Son père, riche commerçant en draps, homme d’affaires avisé et de passions robustes, qui avait le goût de l’art nouveau, patronnait de jeunes revues, achetait du Van Gogh et du douanier Rousseau, avait épousé une belle Toulousaine, second prix de comédie au Conservatoire, quelque temps en vedette chez Antoine et Porel, qui, d’abord prise d’assaut, et puis en justes noces, par le vigoureux Jonas Franck, avait abandonné la scène en plein succès, pour tenir intelligemment, en même temps que les affaires de son mari, un salon littéraire, bien connu des artistes. Le ménage, très uni, où, d’un tacite accord, chacun ne regardait pas de trop près la conduite de l’autre,—où chacun savait, d’ailleurs, dans l’intérêt commun, ménager le qu’en-dira-t-on,—avait élevé le fils unique dans une atmosphère d’intelligence tolérante et aiguisée. Marcel Franck y avait appris qu’il est une harmonie du travail et du plaisir, et qu’en leur savante union réside l’art de la vie. Il ne cultivait pas moins cet art que les autres, où il était devenu un très fin connaisseur. Attaché à la direction des musées nationaux, il s’était fait un renom précoce, comme écrivain d’art. Autant que les tableaux, il savait observer les figures vivantes, de son regard paresseux, pénétrant, insolent, indulgent. Et, parmi les jeunes hommes qui courtisaient Annette, il était celui qui lisait le mieux en elle. Elle le savait bien. Quelquefois, au sortir d’une de ses songeries distraites, où, dans un entretien, elle suivait de tout autres pensées que celles qu’elle exprimait, elle rencontrait ses yeux curieux, qui avaient l’air de lui dire:
—Annette, je vous vois nue.
Et le plus étonnant, c’est qu’elle n’en était pas gênée, elle, la pudique Annette. Elle avait envie de répondre:
—Comment me trouvez-vous, ainsi?
Ils échangeaient un sourire d’intelligence. S’il la voyait sans voiles, c’était de peu d’importance: elle savait qu’elle ne serait jamais à lui. Marcel lisait cette certitude en elle. Il n’en était pas troublé. Il pensait:
—On verra bien!
Car il connaissait l’autre.
L’autre,—Roger Brissot, avait été son camarade de lycée. Franck s’expliquait parfaitement qu’Annette le préférât... Pour commencer, du moins... («Ensuite?... Ça, c’est une autre affaire!...»)—Brissot était beau garçon, une belle figure claire, l’expression franche, de gais yeux bruns, les traits réguliers, un peu forts, la face pleine, les dents saines,—rasé, une abondance juvénile de cheveux noirs, relevés sur le front intelligent par la raie de côté. Grand, la poitrine large, les jambes longues, les bras musclés, il avait une aisance de mouvements et le geste animé. Il parlait bien, très bien, d’une voix chaude, musicale, un peu basse et cuivrée, qu’on aimait,—qu’il aimait. Rival d’études de Franck, d’une intelligence vive, facile, brillante, habitué aux succès de l’esprit, il n’avait pas moins de goût pour les jeux du corps. En Bourgogne, où les propriétés de sa famille—bois et vignes—touchaient à la maison de campagne des Rivière, il était intrépide marcheur, chasseur, bon cavalier. Annette l’avait jadis rencontré, plus d’une fois, dans ses promenades. Mais en ce temps, elle se souciait peu d’un compagnon, elle aimait à aller seule; et Roger, lui aussi, dans ces mois de plein-air, lâché hors de Paris, faisait le jeune Hippolyte; il affectait de préférer son cheval et son chien à une fille. Ils n’avaient guère échangé, en passant, que des saluts et des regards. De ceux-ci, tout n’avait pas été perdu. Il leur en était resté d’agréables images et la vague attraction de deux êtres physiquement bien appariés.
La famille Brissot y avait songé. Non moins que les personnes, les biens semblaient faits pour se joindre. Pourtant les relations de voisinage, tant que vécut Raoul Rivière, étaient restées polies, mais froides et assez lointaines. Par une curieuse bizarrerie, Rivière qui, pour le libre esprit, ne l’eût cédé à personne, avait, comme architecte, presque toute sa clientèle, jusqu’à l’Affaire Dreyfus, dans l’aristocratie et le camp réactionnaire: et comme il était trop habile pour ne pas leur servir la messe, et même (sans métaphore) pour ne pas y aller, lorsque c’était utile pour se faire bien noter, il passait pour réac, voire pour clérical (ce qui le faisait bien rire!) aux yeux des républicains radicaux de sa province. Or, les Brissot étaient des piliers du radicalisme. Cette famille de robe—avocats, procureurs,—qui s’enorgueillissait d’être républicaine depuis plus d’un siècle, (elle l’était en effet, au temps de la Première République, mais oubliait de mentionner que l’aïeul, ex-Conventionnel, avait reçu l’ordre du Lys, au retour des Bourbons), croyait à la République, comme d’autres croient à Dieu le Père; et elle se considérait comme liée par ses traditions: noblesse oblige! Aussi avait-elle estimé de son devoir de manifester son blâme austère à Raoul Rivière, en le tenant à distance: ce dont il ne s’était point affecté, car il n’attendait d’eux aucune commande.—Vint la fameuse Affaire, où Rivière, on l’a vu, se trouva, sans y avoir songé, dans le parti du Progrès. Il s’en vit, en un instant, blanchi; on passa l’éponge sur le passé; on découvrit même à Rivière de hautes qualités civiques et républicaines, dont il ne se serait pas douté, mais dont il eût certainement tiré un bon parti, si la mort n’était venue troubler ses plans.
Ceux des Brissot n’en souffrirent point. Ces grands républicains, qui avaient su, au cours d’un siècle, mener de front le respect de leurs principes et celui de leurs intérêts, étaient riches, et, naturellement, songeaient à l’être davantage. On savait que Rivière avait laissé à sa fille une jolie fortune. On eût été bien aise de joindre sa propriété de Bourgogne aux biens Brissot qu’elle eût heureusement complétés. Mais pour des gens qui avaient les principes des Brissot, les raisons de fortunes ne venaient qu’en second,—même quand il arrivait qu’on y pensât en premier: en question de mariage, la jeune personne devait d’abord entrer en ligne de compte.—La jeune personne, en l’occurrence, répondait à toutes les exigences. Annette satisfaisait par ce qu’on savait d’elle, par ses allures sérieuses, par ce qu’on avait appris de son dévouement à son père. Elle frappait par son intelligence, par sa simplicité. Elle avait dans le monde une tenue parfaite. Du calme. Assez d’esprit. Une bonne santé. Sans doute, trouvait-on un peu d’affectation dans ses travaux de Sorbonne, ses recherches, ses diplômes. Mais on pensait que c’étaient des passe-temps de jeune fille intelligente qui s’ennuie, et qu’elle laisse de côté, à son premier enfant. Et il ne déplaisait pas aux Brissot de montrer qu’ils aimaient les lumières, même chez une femme,—pourvu, naturellement, qu’elles ne fussent pas gênantes. Dieu merci! Annette ne serait pas la première intellectuelle de la famille. Madame Brissot la mère, et la sœur de Roger, Mademoiselle Adèle, avaient la réputation,—justifiée en un sens,—d’être femmes de tête, non moins que femmes de cœur, qui savaient prendre part à la vie de pensée, comme à la vie d’action des hommes de leur maison. L’intellectualité d’Annette était une garantie que, du moins, (le grand point!) il n’y avait de son côté nul danger clérical. Pour le reste, elle trouverait dans sa nouvelle famille l’affectueuse tutelle, qui saurait la garder de toute exagération. La chère enfant n’aurait aucune peine à s’incorporer à ceux dont elle prendrait le nom: elle n’avait plus de parents, et serait trop heureuse de se mettre sous l’égide d’une seconde mère et d’une sœur un peu plus âgée, qui déjà ne demandaient qu’à la diriger. Car les dames Brissot, qui étaient bonnes observatrices, jugeaient Annette vraiment bien sympathique, tout à fait distinguée, douce, polie, réservée, timide, (de leur point de vue, ce n’était pas un mal), un peu froide, (c’était presque une vertu).
Ce fut donc avec l’adhésion de toute la famille, préalablement consultée, que Roger fit sa cour. Il ne lui cachait rien, sûr qu’il en serait toujours approuvé. Ce grand garçon était idolâtré des siens. Il le leur rendait bien. Dans la famille Brissot, on pratiquait l’admiration mutuelle. Il y avait une hiérarchie; mais chacun avait son prix. Il fallait reconnaître qu’ils étaient tous assez bien partagés, du côté de l’esprit, comme des avantages du corps et de la fortune. Ils le reconnaissaient, mais de bonne grâce, en gens bien élevés. Ils ne le manifestaient point à ceux que, notoirement, ils jugeaient inférieurs. Mais il n’y avait aucun moyen d’en douter, à la douce certitude qui se lisait sur leurs traits. De toutes leurs certitudes, Roger était la plus certaine. Il était leur orgueil le plus tendre, et peut-être le plus justifié. L’arbre Brissot n’avait jamais porté de fruit plus réussi. Roger avait les meilleurs dons de sa race; et s’il en avait aussi les défauts, ils n’étaient point choquants: sa bonne grâce, sa jeunesse les faisait oublier. Il était plein de talent: tout lui était facile, mais surtout la parole. L’éloquence était un des fiefs de la famille. Elle comptait déjà un maître du barreau; et tous avaient, de naissance, le goût du bien dire. Il eût été injuste de prétendre, que, comme ces paroliers du Midi, ils eussent besoin de parler pour penser. Mais ils avaient besoin de parler: c’était incontestable. Leurs facultés réelles s’épanouissaient en phrases; le silence les eût atrophiées. Le père de Roger, qui avait été un des plus illustres bavards dont se fût honorée la tribune de la Chambre, et à qui ses électeurs avaient joué le mauvais tour de ne pas le renommer, étouffait de son éloquence rentrée; et Roger, alors âgé de six ans, lui disait naïvement, quand ils étaient tous deux seuls, au foyer:
—Papa, fais-moi un discours!
Il en faisait à présent, pour son compte. Sa jeune réputation avait été brillamment établie, d’emblée, dans les conférences d’avocats, au Palais. Comme tous les Brissot, il avait orienté ses dons vers la politique. Les meetings de l’Affaire Dreyfus lui furent un tremplin excellent; il se jeta dans l’arène, il y discourut à toute volée. La fougue juvénile, la bravoure, la parole débordante et choisie de ce beau garçon lui attirèrent les sympathies enthousiastes des jeunes femmes Dreyfusistes et de beaucoup de ses cadets. Les Brissot, toujours désireux de ne pas se laisser distancer sur la route du Progrès, mais très préoccupés de ne jamais faire un pas de trop, ni trop tôt, en avant,—après avoir prudemment prospecté le terrain, aiguillèrent leur fils, leur jeune gloire, sur la voie du socialisme bien-pensant. Roger, le nez sur la piste, de lui-même s’y rendait. Comme les meilleurs de la jeunesse de son temps, il était sous la fascination de Jaurès, et s’efforçait de modeler son action oratoire sur la parole splendide du grand rhéteur, pleine de visions prophétiques et de mirages illusoires. Il proclama le devoir du rapprochement entre le peuple et les intellectuels. Ce lui fut un thème de discours fort éloquents. Si le peuple—qui manquait de loisirs—n’en connut pas grand’chose, ils émurent les loisirs de la jeune bourgeoisie. Avec les souscriptions et l’aide personnelle d’un petit groupe d’amis, Roger fonda un cercle d’études, un journal, un parti. Il y dépensa beaucoup de temps et un peu d’argent. Les Brissot, qui savaient compter, savaient aussi dépenser à propos. Il leur plaisait de voir leur fils devenir le leader de la nouvelle génération. Ils préparaient le terrain pour les prochaines élections. Roger avait sa place marquée dans la Chambre future. Il ne l’ignorait pas. Habitué dès l’enfance à voir les siens croire en lui, il y croyait aussi; et, sans savoir au juste quelles étaient ses idées, il avait en elles une foi absolue. Aucune outrecuidance. Il était plein de lui, mais si naturellement! Tout lui réussissait; il y était si habitué qu’il ne songeait même pas à s’en enorgueillir; mais il eût été stupéfié qu’il en fût autrement; ses dogmes les plus certains en eussent reçu une sérieuse atteinte. Qu’il était donc sympathique! Égoïste sans le savoir, et sans fond, naïvement, bon garçon, beau garçon, disposé à donner, mais résolu à recevoir, et ne concevant pas que rien pût lui être refusé, simple, gentil, cordial, exigeant, attendant que le monde se mît à ses pieds... Il était vraiment très attrayant.
Annette subit l’attrait. Elle le jugeait assez bien, mais elle ne l’en aimait que mieux. Elle souriait de ses faiblesses, qui lui étaient infiniment chères. Il lui semblait que, par là, il était moins homme et plus enfant. Son cœur se réjouissait qu’il fût l’un et l’autre. Un charme de Roger était qu’il ne cachait rien; il se montrait tout entier. Le naïf contentement qu’il avait de lui-même lui prêtait un naturel parfait.
Il se livra d’autant mieux qu’il s’était épris d’Annette. Ardemment, sans réserves. Il n’aimait rien à demi. Mais il ne voyait rien qu’à moitié.
Il s’enflamma pour elle, un soir que dans un salon il avait été très éloquent. Annette n’avait rien dit; mais elle avait merveilleusement écouté. (Du moins, il le pensait). Ses yeux intelligents lui rendaient sa propre pensée plus claire et plus ailée. Son sourire lui donnait la joie de ce qu’il avait si bien dit, et celle plus douce encore de la sentir partagée... Qu’elle était belle ainsi, celle qui l’écoutait! Quel admirable esprit, quelle âme exceptionnelle se lisaient en ces yeux attentifs et parlants, en ce sourire qui avait tout compris!... Bien qu’il fût seul à parler, il avait l’illusion qu’il parlait avec elle. En tout cas, il ne parlait plus que pour elle; et il se sentait soulevé au-dessus de lui-même par ce dialogue intérieur, par l’échange mystérieux de ces muettes reparties...
Pour dire la vérité, Annette n’écoutait guère. Assez intelligente pour saisir promptement le sens général de la pensée de Roger, elle suivait distraitement, selon son habitude, les belles phrases balancées. Mais elle profitait de ce qu’il était occupé de son éloquence, pour bien le regarder: les yeux, la bouche, les mains, et ce mouvement du menton qu’il faisait en parlant, et ces belles narines de poulain hennissant, et sa façon de rouler certaines lettres, gentiment, et tout ce que cela exprime, et le dehors et le dedans... Elle savait regarder. Elle voyait le désir qu’il avait d’être admiré, elle voyait le plaisir qu’il avait à plaire, à ce qu’elle le jugeât beau, intelligent, éloquent, étonnant. Et elle ne pensait pas du tout—(si! un peu, un petit peu...) à le trouver comique. Elle en était au contraire attendrie...
(—«Oui, chéri, tu es beau, tu es charmant, intelligent, éloquent, étonnant... Tu veux un petit sourire?... Tiens, chéri, je t’en fais deux... avec mes plus doux yeux... Es-tu content?...»)
Et elle riait, dans son cœur, de le voir, tout heureux et glorieux, redoubler son ramage, comme un oiseau de printemps.
Il savourait l’hommage, il le buvait tout pur, sans une goutte d’ironie; il en voulait encore, il n’était jamais las. Et, s’enivrant de son chant, il ne le distinguait plus de celle qui l’admirait. Elle lui parut l’incarnation de tout ce qu’il y avait de beau, de pur, de génial en lui. Il l’adora.
Elle, en qui dès les premiers regards l’amour s’était glissé,—quand elle se sentit baignée de cette adoration, elle n’opposa plus la moindre résistance. Même la tendre ironie dont elle protégeait, comme d’un gorgerin, les battements de son cœur, tomba; et elle offrit son sein nu à l’amour. Elle avait une telle soif de tendresse! Quelle douceur de la désaltérer (elle en jouissait d’avance) aux lèvres de cet être qui la séduisait! Qu’il les lui présentât, devançant son désir, d’un élan si ardent, la pénétrait d’une reconnaissance passionnée...
Le feu avait bien pris. Chacun brûlait du désir de l’autre, et l’alimentait du sien. Et plus l’un s’exaltait, plus il attendait de l’autre; et plus l’autre s’efforçait de surpasser son attente. C’était très fatigant. Mais ils avaient à dépenser une force immense de jeunesse.
Pour l’instant, celle d’Annette était réduite à un rôle passif. On ne lui en laissait pas d’autre. Roger l’envahissait. Elle était submergée. Il lui accordait à peine le temps de respirer. Sa nature expansive, débordante, avait besoin de tout dire, de tout confier: l’avenir, le présent, le passé. Et il y en avait long! Roger tenait de la place! Mais il voulait aussi tout savoir, tout avoir. Il entrait, de vive force, dans les secrets d’Annette. Annette avait beaucoup à faire de défendre ses dernières retraites. Un peu scandalisée, heureuse et amusée, elle avait des velléités de se cabrer contre cette invasion; mais l’envahisseur était si adorable!... Elle se laissait faire, voluptueusement; elle avait, en se livrant à ce viol de pensée,—(«Et cognovit eam...» Il ne la connaissait guère!...)—de secrets mouvements de révolte et de plaisir...
Ce n’était pas trop prudent, de tout livrer de soi. Certaines confidences des heures d’abandon risquent d’être employées plus tard, comme armes, par le confident. Mais c’était bien le dernier des soucis d’Annette et de Roger. A cette heure de l’amour, rien de l’aimé ne pouvait déplaire, rien ne pouvait étonner. Tout ce que confiait l’aimé, loin de surprendre l’amant, semblait répondre à ses vœux inexprimés. Roger ne surveillait pas plus—surveillait moins encore—les aveux indiscrets, que l’oreille indulgente d’Annette enregistrait pourtant, à son insu, très fidèlement.
Quelque plaisir qu’ils prissent à mettre en commun le passé, le présent,—le présent, le passé se noyaient dans le rêve de l’avenir,—de leur avenir: car bien qu’Annette n’eût rien dit, rien promis, son adhésion était si bien supposée, escomptée, exigée qu’Annette finissait par croire elle-même qu’elle l’avait donnée. Les yeux mi-clos, heureux, elle écoutait donc Roger—(il était de ceux qui jouissent de demain toujours plus que d’aujourd’hui)—exposer avec un enthousiasme inlassable la vie magnifique de pensée et d’action qui lui était réservée... A qui, lui? A Roger. A elle aussi, bien entendu, puisqu’elle faisait partie de Roger. Elle n’était pas choquée de cette absorption: elle était trop occupée à entendre, à voir, à boire ce merveilleux Roger. Il parlait beaucoup de socialisme, de justice, d’amour, d’humanité délivrée. Il était véritablement splendide. En parole, sa générosité ne connaissait pas de bornes. Annette était émue. C’était enivrant de se dire qu’elle pourrait être associée à cette œuvre de puissante bonté. Roger ne lui demandait jamais ce qu’elle en pensait. Il était sous-entendu qu’elle pensait comme lui. Elle ne pouvait pas penser autrement. Il parlait pour elle. Il parlait pour les deux, parce qu’il parlait mieux. Il disait:
—Nous ferons... Nous aurons...
Elle ne protestait pas. Elle eût plutôt remercié. Tout cela était si large, si vague, si désintéressé qu’elle n’avait aucun motif de s’y trouver gênée. Roger était toute lumière et toute liberté... Un peu diffuse, peut-être. Annette eût, peut-être, souhaité quelques précisions. Mais cela viendrait plus tard; on ne pouvait tout dire, du premier coup. Faisons durer le plaisir!... Aujourd’hui, il n’y avait qu’à jouir de ces horizons illimités...
Elle jouissait surtout de la charmante figure, de l’ardente attraction de leurs deux corps amoureux, où subitement passaient des ondes électriques, du flot de sève sensuelle qui les gonflait tous deux, tous deux riches des forces d’une chaste jeunesse, sains, robustes et brûlants.
Jamais l’éloquence de Roger n’était plus certaine que lorsqu’elle s’interrompait et que, dans les dernières vibrations des paroles qui leur avaient ouvert des visions exaltées, leurs yeux se rencontraient: le soudain contact était comme une étreinte. Alors, un tel désir s’enflammait en eux que leur souffle s’arrêtait. Roger ne songeait plus à éblouir et à parler. Annette ne songeait plus à l’avenir de l’humanité, ni même au sien. Ils oubliaient tout, tout ce qui les entourait: le salon, le public. Ils n’étaient plus, à ces secondes, qu’un être unique, une cire en feu. Plus rien que le Désir de la nature,—unique, dévorant, et pur, comme le feu.—Ensuite, Annette, les yeux troubles et les joues allumées, s’arrachait au vertige, avec la certitude tremblante et enivrée qu’un jour elle succomberait...
Pour personne, leur passion n’était plus un secret. Ils étaient tous les deux incapables de la voiler. Annette avait beau se taire: ses yeux parlaient pour elle. Leur muet acquiescement était si éloquent qu’aux regards du monde, comme de Roger, elle semblait tacitement engagée.
Seule, la famille Brissot ne perdait pas de vue qu’Annette ne l’était point. Aux déclarations de Roger, Annette se prêtait sans doute, avec un plaisir évident. Mais elle évitait de répondre; elle était assez habile pour détourner l’entretien sur quelque grand sujet, où le naïf Roger, lâchant la proie pour l’ombre, se lançait à perte de vue, tout heureux de parler. Et cette fois encore, Annette n’avait point parlé.—Ayant deux ou trois fois observé ce manège, les Brissot, gens prudents, décidèrent de s’en mêler. Ce n’était pas qu’ils pussent concevoir un doute sur la détermination d’Annette et la félicité qu’un si brillant parti devait lui procurer. Mais enfin, il faut toujours compter avec les caprices bizarres des jeunes filles! Ils connaissaient la vie. Ils en connaissaient les pièges. Ils étaient de madrés provinciaux français. Quand la décision qu’on attend s’attarde en route, la prudence conseille d’aller la chercher. Les deux dames Brissot se mirent en chemin.
Il y avait un sourire qu’on nommait, à Paris, dans le cercle des connaissances, le sourire Brissot: il était gras et doux, affable et supérieur, badin avec mesure—et poids, sachant tout d’avance, ruisselant de bienveillance, parfaitement indifférent; il offrait à mains pleines, mais pleines restaient les mains.—Les deux dames Brissot en étaient fleuries.
Madame Brissot mère, grande belle femme, la face large, les joues grasses, bien nourrie, rebondie, avait le port imposant, le corsage opulent, et une parole onctueuse, excessivement flatteuse, qui mit à la gêne la sincère Annette. Ce n’était pas pour elle seule—(elle le remarqua bientôt avec soulagement).—Ce ton laudatif était distribué à tous avec largesse. Il s’accompagnait d’un perpétuel badinage, qui était, chez les Brissot, une marque courtoise de la certitude qui leur était infuse et de la bonhomie avec laquelle ils acceptaient ce don.
Mademoiselle Brissot, la sœur de Roger, grande et forte elle aussi, était d’un blond très pâle, si décoloré qu’il semblait presque blanc, albinos. Elle y ajoutait un nuage de poudre de riz sur les joues, et un trait de rouge aux lèvres. Elle visait à l’idéal de pastel Louis XV. Elle eût fait pour Nattier une Phœbé de Bourgogne, mignarde, chlorotique, et charnue. Sa mère appelait cette robuste fille: «ma pauvre petite mignonne»; car Mademoiselle Brissot, qui se portait comme un charme, avait conçu l’idée, en mirant sa pâleur, qu’elle devait être de santé délicate. Mais elle ne l’exploitait pas, en se faisant dorloter. Elle en usait pour mieux montrer son énergie et se donner le droit de dédaigner les créatures plus molles de son sexe, qui gémissaient de leurs petits bobos. De vrai, elle était admirable, active, infatigable, lisant tout, voyant tout, sachant tout, faisant de la peinture, se connaissant en musique, parlant de littérature, accomplissant, chaque jour, avec Madame Brissot, le programme des deux cents ou trois cents visites qu’elles devaient exécuter en un temps donné, les recevant, en retour, et donnant des dîners, suivant les concerts, les théâtres, les séances de la Chambre et les expositions, sans fléchir, sans trahir la fatigue, que par quelque soupir virilement étouffé, à des moments choisis,—d’ailleurs, sachant nourrir le corps qu’elle matait, mangeant solidement, (comme toute la famille), et dormant sa pleine nuit, sans un rêve. Elle n’était pas moins maîtresse de son cœur que de son corps. Elle préparait posément son mariage avec un homme politique, d’une quarantaine d’années, qui était en ce moment gouverneur d’une des grandes colonies d’outre-mer. Elle n’avait nullement songé à l’y accompagner. Elle ne voulait quitter Paris et le nom des Brissot que lorsque l’heureux élu pourrait lui offrir en France une situation digne d’elle. Au reste, elle savait, en haut lieu, ne pas le faire oublier. Ils s’écrivaient avec régularité des lettres cordiales et d’affaires. Cette cour à distance durait depuis plusieurs années. Le mariage viendrait à son heure. Elle n’était pas pressée. Le mari serait un peu mûr. Mais il n’en vaudrait que mieux, au goût de Mademoiselle Brissot. C’était une forte tête.—De tête, les Brissot n’avaient jamais manqué. Celle de Mademoiselle Brissot était éminemment politique. Elle était, disait sa mère, de vocation, une Égérie. Madame Brissot admirait les lumières de Mademoiselle Brissot. Mademoiselle Brissot admirait le génie domestique et l’esprit de Madame Brissot. Elles se faisaient des grâces minaudières. Elles s’embrassaient devant Annette. C’était charmant.
Elles mirent pourtant une sourdine à ce culte mutuel, pour cajoler Annette. Ce ne furent que compliments, sur elle, sur sa maison, sur ses toilettes, son goût, son esprit, sa beauté. Le ton excessivement louangeur choquait un peu Annette; mais on ne reste pas tout à fait insensible à l’opinion flatteuse que d’autres ont de vous, surtout lorsque ces autres semblent les messagers de l’être qu’on chérit. Il était difficile de douter qu’il n’en fût pas ainsi: car les dames Brissot mêlaient sans cesse le nom de Roger à leurs propos. Elles entrelaçaient ses éloges à ceux d’Annette; elles faisaient des allusions souriantes, persistantes, à l’impression produite sur lui par Annette, à des paroles qu’elle lui avait dites, et qu’il s’était hâté de redire avec enthousiasme—(il redisait tout: Annette était fâchée, mais tout de même touchée).—Elles faisaient valoir son brillant avenir; et Madame Brissot prenait un ton pénétré, pour dire son espoir, sa confiance, que Roger trouvât—qu’il eût trouvé—la compagne digne de lui. Elle ne nommait personne, mais on se comprenait. Toutes ces petites ruses étaient visibles de vingt pas, à l’œil nu. Elles voulaient l’être. C’était une sorte de jeu de société, où l’on devait parler autour du mot que chacun avait sur la langue, sans jamais le prononcer. Le sourire de Madame Brissot semblait guetter le mot, prêt à sortir, sur les lèvres d’Annette, comme pour crier:
—Un gage!
Annette souriait, ouvrait la bouche. Mais le mot ne sortait pas...
Annette fut invitée chez les Brissot, à des soirées intimes, dans leur appartement de la rue de Provence. Elle fit la connaissance de Brissot père, grand et gros, l’œil malin sous une broussaille de sourcils, rubicond, une courte barbe grise, l’air d’un avoué retors et paterne, qui l’accabla de galanteries et de plaisanteries vieillies. Il essaya de jouer aussi au jeu de société; mais ses circonlocutions mettaient les pieds dans le plat. Annette s’effaroucha; et Madame Brissot fit signe à son mari de ne plus s’en mêler. Il se tint donc en dehors de la partie, la suivant du coin de l’œil, goguenard, convenant que ce n’était pas son affaire et que les femmes s’en acquittaient mieux que lui.
Adroitement, Madame Brissot n’invita d’abord avec Annette que trois ou quatre amis intimes,—puis deux,—puis un,—puis rien. Et Annette se trouva seule, avec les quatre Brissot. «En famille», disait Madame Brissot, d’un ton plein de promesses onctueusement maternelles. Annette sentait le piège; mais elle ne se dérobait pas. Elle avait trop de plaisir à être avec Roger. Par tendresse pour lui, elle était indulgente pour les siens; elle se fermait les yeux sur ce qui, dans ce milieu, l’agaçait sourdement. La finesse d’instinct féminine en avertissait Mesdames Brissot: si fort que fût leur amour-propre, il ne faisait jamais tort à leur intérêt; elles surent, d’un tacite accord, s’effacer, parler moins, tamiser leur pensée, ménager aux amoureux de fréquents tête-à-tête, qui n’étaient pas troublés. La cause de Roger ne pouvait être mieux défendue que par lui. De plus en plus épris, inquiet de la réserve d’Annette, qui l’eût moins frappé si sa mère et sa sœur ne la lui eussent fait remarquer, Roger n’avait jamais été plus attrayant que depuis que sa confiance en soi était atteinte. Il ne discourait plus: son éloquence était tombée. Pour la première fois de sa vie, il s’efforçait à lire dans l’âme d’un autre. Assis auprès d’Annette, ses yeux humbles et ardents dévoraient, imploraient la petite énigme, tâchaient de la deviner. Annette jouissait de ce trouble, de cette timidité si nouvelle chez lui, de l’attente craintive qui guettait chacun de ses mouvements. Elle était ébranlée. A des moments, elle était près de se pencher vers lui, de dire les paroles décisives.—Et cependant, elle ne les disait pas. A la dernière seconde, elle se rejetait en arrière, d’instinct, sans savoir pourquoi; elle écartait brusquement la déclaration que Roger allait faire, et ses propres aveux. Elle échappait...
Alors, le piège se resserra. D’un des salons voisins, Madame et Mademoiselle Brissot couvaient discrètement l’infructueux entretien. On les voyait parfois, traversant le salon, souriantes et affairées. Elles jetaient, en passant, quelque mot amical; mais elles ne s’arrêtaient pas. Et les deux jeunes gens poursuivaient leurs longues causeries.
Un soir qu’ils feuilletaient distraitement un album, qui leur était un prétexte pour rapprocher leurs têtes, en échangeant à mi-voix leurs pensées, il se fit un silence; et subitement, Annette perçut le danger. Elle voulut se lever; mais le bras de Roger déjà lui entourait la taille; et la bouche passionnée du jeune homme lui prenait la bouche entr’ouverte. Elle essaya de se défendre. Mais comment se défendre contre soi-même! Ses lèvres rendirent le baiser, en voulant s’y arracher. Elle se dégageait pourtant, quand on entendit, à l’autre bout du salon, la voix émue de Madame Brissot, qui claironnait:
—Ah! ma fille chérie!..
Et elle appelait:
—Adèle!... Monsieur Brissot!...
Annette, stupéfaite, se vit, en un instant, entourée par la famille Brissot, rayonnante, attendrie. Madame Brissot la couvrait de baisers, en s’épongeant les yeux avec son mouchoir, et répétait:
Mademoiselle Brissot disait:
—Ma petite sœur!
Et Monsieur Brissot, toujours gaffeur:
—Enfin!.. Vous y avez mis le temps!..
Ce pendant que Roger, agenouillé devant Annette, lui baisait les mains, et la suppliait du regard, craintif, un peu honteux, qui demandait pardon, et implorait:
—Ne dites pas non!
Annette, pétrifiée, se laissait embrasser; la supplication de ces yeux qu’elle aimait achevait de la ligoter. Elle fit un dernier effort pour protester:
(—Mais je n’ai rien dit!..)
Mais elle vit passer dans les yeux de Roger un chagrin si sincère qu’elle ne put le supporter: elle s’obligea à sourire; et le visage de Roger s’illuminant de bonheur, le sien rayonna aussi de la joie qu’elle faisait. Elle lui serra la tête entre ses mains. Roger se releva, en criant d’allégresse. Et ils échangèrent, sous les regards bénisseurs des parents, le baiser de fiançailles.
Quand Annette se retrouva seule, chez elle, la nuit, elle fut atterrée. Elle ne s’appartenait plus. Elle s’était donnée... Donnée! Donné sa vie!... Son cœur se serra d’angoisse.
Elle s’exagérait encore l’étroitesse des liens qu’elle venait d’accepter. Elle n’était pas de ces jeunes filles modernes qui, devant leur fiancé, plaisantent agréablement avec l’idée du divorce. Elle ne donnait pas d’une main, pour reprendre de l’autre. Elle n’était plus à elle. Elle était aux Brissot.—Et soudain, les Brissot lui parurent l’ennemi. Tout ce que ses yeux avaient vu, dans ces dernières semaines, se projeta devant elle, en traits accentués: tous leurs travaux d’approche, afin de l’envelopper, leur conspiration contre sa liberté, la comédie finale qui lui avait extorqué son consentement, par surprise... (Roger, Roger lui-même n’en avait-il pas été complice?..)—Et elle se hérissa, comme une bête cernée, qui voit le cercle se resserrer, et qui se sent perdue, et qui est près de se jeter tête baissée contre les rabatteurs, pour se frayer passage, ou mourir et se venger. Pour la première fois, tout ce qui lui déplaisait dans les Brissot, mais dont elle avait écarté jusqu’alors la pensée, lui apparut grossi, odieux, intolérable... Roger même!... Jamais elle ne pourrait vivre emmurée dans cet homme, cette famille, cette coterie d’intérêts qui n’étaient pas les siens, qui ne le seraient jamais. Elle décida de rompre...
Rompre, le pouvait-elle encore, quand elle venait de s’engager? Roger le permettrait-il?... Il faudrait bien qu’il le permît! Il ne pouvait l’empêcher... A l’idée qu’il pourrait s’y opposer, Annette le haït. En cet instant, la peine de l’autre ne comptait plus; elle n’eût pas hésité à lui broyer le cœur, pour reprendre sa liberté... Et puis, elle revit ses yeux implorants. Et elle fut bouleversée... N’importe! L’égoïsme de la vie menacée, l’instinct de conservation étaient plus forts que tout, plus forts que la tendresse, plus forts que la pitié! Il lui fallait se sauver. Et malheur à qui lui barrerait l’issue!...
Toute la nuit, dans son lit, se tournant, se retournant, dévorée de fiévreuse insomnie, elle vécut par avance la scène qu’elle allait avoir avec Roger. Elle dit, elle essaya toutes les paroles qu’il et qu’elle diraient. Elle tenta de le convaincre, elle discuta, elle s’emporta, elle le plaignit, et elle le détesta.—Elle se trouva, à l’aube, épuisée, mais décidée. Elle irait chez Roger... Ou, non! elle lui écrirait; elle en serait plus libre d’exprimer jusqu’au bout ce qu’elle voulait dire, sans être interrompue. Elle briserait. Pour éviter que les Brissot ne revinssent à la charge, elle résolut de s’évader de Paris, d’aller pour quelques jours dans un hôtel des environs. Et se levant, elle écrivit la lettre, dont elle avait cent fois agité les termes dans sa tête; puis, elle commença hâtivement ses préparatifs de départ.
Elle était au milieu, quand Roger l’y surprit. Elle n’avait pas songé à défendre sa porte, ne s’attendant pas si tôt à sa venue. Il entra, devançant dans son impatience amoureuse le domestique qui l’annonçait. Il apportait des fleurs. Il débordait de bonheur et de reconnaissance. Et il était si tendre, si jeune, si séduisant qu’Annette, en le voyant, n’eut plus la force de parler. Toutes ses belles résolutions furent oubliées, son cœur était repris dès le premier regard. Avec l’étonnante mauvaise foi de l’amour, aussitôt elle découvrit autant de raisons pour le mariage qu’elle en avait contre, la minute d’avant. Elle essayait de lutter; mais la joie riait dans ses yeux cernés par les soucis de la nuit. Elle regardait son Roger, qui la buvait d’un regard enivré, et elle se disait:
—Pourtant, j’ai décidé... Je dois pourtant décider... Qu’est-ce que j’ai décidé?...
Mais le moyen de savoir, quand il y avait ce regard qui vous lampait jusqu’à l’âme! Penser, comment penser, comment se retrouver!... Elle ne savait plus, elle était perdue... Et, en attendant, c’était si bon de se sentir aimée!... Tout ce qu’elle put faire,—avec un immense effort,—ce fut de demander à Roger de ne pas précipiter le mariage... Et tout de suite, Roger prit un air si déçu, si navré qu’Annette n’eut pas le courage de continuer. Comment faire de la peine à un si cher garçon? Elle se hâta tendrement de le rassurer, de lui dire qu’elle l’aimait; faiblement, elle tenta de maintenir son délai, qu’il repoussait avec autant d’énergie que s’il se fût agi de sa vie. Enfin, après un amoureux marchandage des deux côtés, ils consentirent à céder, chacun pour moitié; et le mariage fut fixé au milieu de l’été.
Après, Roger partit; et Annette, se regardant penaude dans son miroir, y retrouva ses indécisions... Comment sortir de là? Elle contempla ses préparatifs de voyage interrompus.
—Bien travaillé! dit-elle.
Elle haussa les épaules, rit... Que Roger était charmant!... Elle remit dans l’armoire le linge, les objets qu’elle avait sortis pour sa malle...
—Tout de même, pensait-elle, je ne veux pas, je ne veux pas!...
Nerveuse, elle laissa tomber une pile de chemisettes... Patatras! Et des brosses de toilette dégringolent à la suite... Elle donna un coup de pied dans le tas, impatientée...
Et puis, elle les ramassa, courbée vers le plancher. Au milieu de son rangement, elle se lassa et s’assit sur le parquet, pas fière de sa volonté...
—Baste! fit-elle, s’étendant sur le tapis, j’ai encore quatre mois pour changer...
Le visage enfoui dans un coussin, sur le ventre couchée, elle comptait les jours...
Les Brissot, prudemment, se prêtèrent au vœu qu’exprimait Annette, de prolonger la période des fiançailles: ils ne voulaient pas compromettre le succès, en se montrant trop pressants. Mais il leur parut nécessaire d’entourer Annette, pendant les mois d’attente. On ne pouvait la laisser livrée à elle-même: l’étrange fille risquait toujours de s’échapper.
On était aux approches du Dimanche de la Passion. Les Brissot invitèrent Annette à passer chez eux, dans leur propriété de Bourgogne, les semaines de Pâques. Annette accepta, à regret; elle était tentée, et elle avait peur: peur d’ajouter aux chaînes qui déjà la liaient; peur d’être prise tout à fait, ou bien de tout briser; peur d’autres choses encore, plus dangereuses, qu’elle ne voulait pas regarder. Elle ne tenait pas à sortir de l’état d’incertitude amoureuse où elle se laissait bercer: elle en souffrait un peu, et elle y trouvait du charme. Elle eût voulu le prolonger. Mais elle savait bien que ce n’était pas sain, et qu’elle n’en avait pas le droit, vis-à-vis de Roger.
Elle se décida enfin à s’ouvrir de ses inquiétudes à Sylvie. Jamais elle ne lui avait dit un mot de son amour pour Roger. Pourtant, elle lui confiait tout: de tous les autres jeunes hommes, elle lui parlait souvent... Oui, mais les autres jeunes hommes, elle ne les aimait pas! Et le nom de Roger avait été tenu de côté.
Sylvie s’exclama, l’appela: «Cachottière!» et elle rit follement quand Annette essaya de lui expliquer son indécision, ses scrupules, ses tourments.
—Enfin, demanda-t-elle, ton oiseau, il est beau?
—Oui, répondit Annette.
—Il t’aime?
—Oui.
—Et tu l’aimes?
—Je l’aime.
—Eh bien, alors, qu’est-ce qui peut t’arrêter?
—Ah! c’est si difficile! Comment est-ce que je peux dire?... Je l’aime... Je l’aime beaucoup... Il est si ravissant!...
(Elle commença à le décrire complaisamment, sous les yeux railleurs de Sylvie. Elle s’interrompit...)
—Je l’aime beaucoup... beaucoup... Et aussi, je ne l’aime pas... Il y a des choses en lui... Je ne pourrai pas vivre avec... Je ne pourrai jamais... Et puis... Et puis, il m’aime trop. Il voudrait me manger...
(Sylvie éclata de rire.)
—... C’est vrai, me manger toute, me manger toute ma vie, toute ma pensée à moi, tout l’air que je respire... Oh! c’est un bon mangeur, mon Roger! Il fait plaisir à voir, à table... Il a bon appétit... Mais, moi, je ne veux pas être mangée.
Elle riait aussi, de bon cœur; et Sylvie riait, à son cou, assise sur ses genoux. Annette reprit:
—C’est affreux de se sentir dévorée, comme cela, toute vivante, de n’avoir plus rien à soi, de ne pouvoir plus rien garder... Et il ne s’en doute pas... Il m’aime à la folie, et j’ai idée, vois-tu, qu’il n’a pas cherché seulement à me comprendre, il ne s’en inquiète même pas. Il vient, il prend, il m’emporte...
—Eh bien, c’est rudement bon! dit Sylvie.
—Tu ne penses qu’à des bêtises! dit Annette, la serrant dans ses bras.
—Et à quoi veux-tu que je pense?
—Au mariage. C’est une chose sérieuse.
—Sérieuse! Oh! bien, pas si sérieuse!
—Quoi! ce n’est pas sérieux de donner tout de soi, sans rien réserver?
—Et qui est-ce qui parle de ça? Il faudrait être fou!
—Mais il veut tout avoir!
De rire, Sylvie se tordit comme un petit poisson.
—Ah! Canette! grande sotte!... Nique-douille!...
(Il lui paraissait si simple de dire ce qu’on voulait, de donner ce qu’on voulait, et de garder, sans le dire, tout le reste! Elle avait une ironie affectueuse à l’égard des hommes et de leurs exigences. Ils ne sont pas très malins!...)
—Mais moi non plus, je ne le suis pas, dit Annette.
—Oh! pour cela! fit Sylvie. Tu prends tout au sérieux.
Annette en convint, contrite.
—C’est malheureux, tout de même!... Je voudrais être comme toi. Tu as de la chance!
—Changeons! Passe-moi la tienne! dit Sylvie.
Annette n’avait aucune envie de changer.—Sylvie la quitta réconfortée.
Tout de même, Annette ne se comprenait pas! Elle était intriguée.
—Curieux! se disait-elle, je veux tout donner. Et je veux tout garder!...
Le lendemain,—c’était la veille du départ—tandis qu’achevant ses préparatifs, elle recommençait de se tourmenter, une singulière visite vint ajouter à ses inquiétudes, en les lui rendant plus claires. Marcel Franck se fit annoncer.
Après quelques paroles d’aimable courtoisie, il fit allusion aux fiançailles d’Annette, dont Roger ne faisait pas mystère. Il la félicita avec gentillesse; son ton et ses yeux étaient doucement ironiques, affectueux. Annette se sentait très à l’aise avec lui, comme avec un ami perspicace, à qui l’on n’a pas besoin de tout dire, ou de rien cacher: car on se comprend à demi-mot. Ils parlèrent de Roger, que Marcel Franck enviait, en souriant. Annette savait qu’il disait vrai, et qu’il était amoureux. Mais il n’y avait aucun trouble entre eux. Elle l’interrogea sur Roger, qu’il connaissait intimement. Marcel en fit l’éloge; mais comme elle insistait pour qu’il en parlât d’une façon moins banale, Marcel, en plaisantant, dit que c’était inutile qu’il lui décrivît Roger, car elle le connaissait tout aussi bien que lui. Et, en parlant ainsi, il la fixait d’un regard si pénétrant qu’un moment interdite, elle détourna les yeux. Puis, le fixant à son tour, elle retrouva son fin sourire, qui montrait qu’on s’était compris. Ils causèrent quelque temps de choses indifférentes, que brusquement Annette interrompit, préoccupée:
—Parlez-moi franchement, dit-elle. Vous trouvez que j’ai tort?
—Je ne vous donnerai jamais tort, dit-il.
—Non, pas de politesse! Vous êtes le seul qui puisse me dire la vérité.
—Vous savez cependant que ma situation est particulièrement délicate.
—Je le sais. Mais je sais aussi qu’elle n’a pas d’influence sur la sincérité de vos jugements.
—Merci! fit-il.
Elle reprit:
—Vous croyez que nous avons tort, Roger et moi?
—Je crois que vous vous trompez.
Elle baissa la tête. Puis, elle dit:
—Je le crois aussi.
Marcel ne répondit pas. Il continuait de la regarder et de sourire.
—Pourquoi souriez-vous?
—J’étais sûr que vous le pensiez.
Annette, approchant ses yeux:
—Dites-moi maintenant comment vous me voyez?
—Je ne vous apprendrai rien.
—Vous m’aiderez à voir mieux.
—Vous êtes, lui dit Marcel, une amoureuse révoltée. Perpétuellement amoureuse (pardon!) et perpétuellement révoltée. Vous avez besoin de vous donner et vous avez besoin de vous garder...
(Annette ne put cacher un petit sursaut.)
—Je vous choque?
—Non, non, tout le contraire! Comme c’est vrai! Allez! Dites encore!...
—Vous êtes, reprit Marcel, une indépendante, qui ne peut rester seule. C’est la loi de nature. Vous la sentez plus vive, parce que vous êtes plus vivante.
—Oui, vous me comprenez! Vous me comprenez mieux que lui. Mais...
—Mais c’est lui que vous aimez.
Nulle amertume dans le ton. Très amicalement, ils se dévisageaient, amusés de cette curieuse nature humaine.
—Ce n’est pas facile de vivre, dit Annette, de vivre à deux.
—Mais si, ce serait bien facile, si l’on ne s’était ingénié, depuis des siècles, à se compliquer la vie par des gênes réciproques. Il n’y a qu’à les rejeter. Mais naturellement, notre excellent Roger, comme tout bon vieux Français, n’en conçoit pas l’idée. Ils se croiraient perdus, s’ils ne sentaient plus sur eux les gênes du passé. «Où il n’y a pas de gêne, il n’y a pas de plaisir...», surtout lorsqu’en étant gêné, on gêne son voisin.
—Comment vous, concevez-vous donc le mariage?
—Comme une association intelligente d’intérêts et de plaisirs. La vie est une vigne qu’on exploite en commun: ensemble, on la cultive et l’on fait les vendanges. Mais on n’est pas forcés de boire son vin, tous deux, toujours en tête à tête. Une mutuelle complaisance qui demande et donne à l’autre la grappe de plaisir, dont on dispose, chacun, et qui le laisse discrètement achever sa cueillette ailleurs.
—Vous voulez parler, dit Annette, de la liberté de l’adultère?
—Le vieux mot périmé! Je veux parler, dit Marcel, de la liberté amoureuse, la plus essentielle de toutes.
—C’est celle qui m’importe le moins, dit Annette. Le mariage n’est pas pour moi un carrefour, où l’on se donne à tous les passants. Je me donne à un seul. Le jour où je cesserais de l’aimer et où j’aimerais un autre, je me séparerais du premier; je ne me partagerais pas entre eux, et je ne supporterais pas le partage.
Marcel fit un geste ironique, qui semblait dire:
—Quelle importance?...
—Voyez-vous, mon ami, dit Annette, au bout du compte, je suis plus loin de vous encore que de Roger.
—Vous êtes donc aussi, demanda Marcel, de la bonne vieille école: «Gênons-nous les uns les autres»?
—La seule grandeur du mariage, dit Annette, est l’amour unique, la fidélité de deux cœurs. S’il la perd, que lui reste-t-il, en dehors de quelques avantages pratiques?
—Ce n’est pas rien, fit Marcel.
—Ce n’est pas assez, dit Annette, pour compenser ses sacrifices.
—Si vous jugez ainsi, de quoi vous plaignez-vous? Vous rivez vos fers, dont on essaie de vous délivrer.
—La liberté que je veux, dit Annette, n’est pas celle du cœur. Je me sens assez forte pour le garder intact à qui je l’ai donné.
—En êtes-vous si sûre? demanda Marcel, tranquillement.
Annette n’en était pas si sûre! Elle connaissait aussi le doute. C’était la fille de sa mère qui parlait, en ce moment, ce n’était pas Annette tout entière. Mais elle ne voulait pas l’admettre, surtout avec Marcel, et dans une discussion. Elle dit:
—Je le veux.
—La volonté en ces affaires!... fit Marcel, avec son fin sourire... C’est comme si l’on décrétait qu’un feu rouge est un feu vert. L’amour est un phare à feux changeants.
Mais Annette, entêtée, dit:
—Pas pour moi!... Je ne veux pas!
Elle sentait parfaitement, et avec la même exigence, le besoin de changer et celui de rester immuable, ces deux instincts passionnés de toute forte vie. Mais tour à tour se révoltait celui des deux qui se croyait le plus menacé.
Marcel, connaissant bien la fille fière et butée, s’inclina poliment. Annette, qui se jugeait aussi exactement qu’il la jugeait, un peu honteuse, dit:
—Enfin, je ne voudrais pas...
Et, cette concession faite à l’esprit de vérité, elle continua, plus ferme, se sentant maintenant sur un terrain dont elle était sûre:
—Mais je voudrais qu’en échange du don mutuel de sa fidèle tendresse, chacun gardât le droit de vivre selon son âme, de marcher dans sa voie, de chercher sa vérité, de s’assurer, s’il le faut, son champ d’activité propre, d’accomplir en un mot la loi propre de sa vie spirituelle, et de ne pas la sacrifier à la loi d’un autre, même de l’être le plus cher: car nul être n’a le droit d’immoler à soi l’âme d’un autre, ni la sienne à un autre. C’est un crime.
—C’est très beau, chère amie, dit Marcel; mais moi, vous savez, l’âme, ça sort de ma compétence. Peut-être que ça rentre mieux dans celle de Roger. Mais j’ai peur qu’en ce cas, il ne l’entende pas de la même façon. Je ne vois pas bien les Brissot concevant, dans leur cercle de famille, la possibilité d’une autre «loi spirituelle» que celle de la fortune politique et privée des Brissot.
—A propos, dit Annette en riant, demain, je vais chez eux, en Bourgogne, pour deux ou trois semaines.
—Eh bien, fit Marcel, ce sera le cas de confronter votre idéalisme au leur. Car ce sont de grands idéalistes, eux aussi! Après tout, je me trompe peut-être. Je crois que vous vous entendrez très bien. Au fond, vous êtes admirablement faits pour aller ensemble.
—Ne me défiez pas! dit Annette. Je reviendrai peut-être de là une Brissot accomplie.
—Fichtre! ça ne serait pas gai!... Non, non, je vous en prie!... Brissot, ou non Brissot, conservez-nous Annette!
—Hélas! je voudrais la perdre que je ne le pourrais pas, j’en ai peur, dit Annette.
Il prit congé, en lui baisant la main.
—C’est dommage, tout de même!...
Il partit. Annette se disait aussi que c’était dommage, mais pas dans le même sens où l’entendait Marcel. Il avait beau la voir exactement, il ne la comprenait pas plus que Roger, qui ne la voyait point. Il eût fallu, pour la comprendre, des âmes plus «religieuses»—plus religieusement libres—que celles de presque tous ces jeunes hommes français. Ceux qui sont religieux le sont dans la tradition du catholicisme, qui est d’obéissance et de renoncement au libre mouvement de l’esprit, (surtout quand il s’agit de la femme). Et ceux qui sont libres d’esprit se doutent rarement des besoins profonds de l’âme.
Roger attendait, avec la voiture, à la petite gare de Bourgogne, où Annette descendit le lendemain. Aussitôt qu’elle le vit, ses soucis s’envolèrent. Roger était si heureux! Elle ne l’était pas moins. Elle sut gré aux dames Brissot d’avoir trouvé de mauvaises excuses pour n’être pas venues la chercher.
Un soir clair de printemps. L’horizon d’or encerclait les molles ondulations de blonde verdure nouvelle et de roses labours. Les alouettes gazouillaient. La charrette à deux roues volait sur la route blanche, qui sonnait sous les pas du petit cheval ardent; et l’air vif fouettait les joues rouges d’Annette. Elle se tenait serrée contre le jeune compagnon qui, tout en conduisant, lui riait et lui parlait et, brusquement, se penchant sur ses lèvres, lui prenait et donnait un baiser, à la volée. Elle ne résistait pas. Elle l’aimait, elle l’aimait! Cela ne l’empêchait pas de savoir que tout à l’heure elle recommencerait de le juger, de se juger. Autre chose est de juger, autre chose est d’aimer. Elle l’aimait comme cet air, comme ce ciel, comme ce souffle de prairie, comme un morceau du printemps. A demain, de faire le jour dans sa pensée! Elle se donnait congé pour aujourd’hui. Jouissons de cette heure délicieuse! Elle ne sera pas deux fois... Il lui semblait voler au-dessus de la terre, avec son bien-aimé.
On fut trop tôt arrivé, bien qu’au dernier tournant, en montant l’allée de peupliers, on allât à petits pas, et même, que s’arrêtant pour laisser souffler le cheval, à l’abri des hautes haies qui masquaient la façade du château, les deux jeunes gens s’étreignissent longuement sans parler.
Les Brissot s’empressèrent. Ils surent trouver des paroles délicates pour évoquer discrètement le souvenir de son père. Dans le cercle de famille, Annette, le premier soir, se laissait choyer, reconnaissante, attendrie; il y avait si longtemps qu’elle était privée de la chaleur affectueuse du foyer! Elle voulait se faire illusion. Chacun y mettait du sien. Sa résistance était engourdie...
Mais, au milieu de la nuit, comme elle se réveillait, écoutant une souris qui rongeait, dans le silence de la vieille maison, sa pensée évoqua l’idée de la souricière; elle se dit:
Elle eut une angoisse, elle essaya de se raisonner:
—Non, non, je ne le veux pas, je ne le suis pas...
Une sueur nerveuse lui mouillait les épaules.
Elle dit:
—Demain, je parlerai sérieusement à Roger. Il faut qu’il me connaisse. Il faut que nous voyions loyalement si nous pouvons vivre ensemble...
Mais, le lendemain venu, elle eut tant de plaisir à retrouver Roger, à se laisser envelopper de sa chaude affection, à respirer ensemble l’enivrante douceur de la campagne printanière, a rêver du bonheur—(impossible peut-être, mais qui sait? qui sait?... peut-être tout proche... il n’y a qu’à tendre la main...)—qu’elle remit au lendemain les explications... Et puis, au lendemain... Et puis, au lendemain...
Et, chaque nuit, les angoisses la reprenaient, lancinantes, avec des coups au cœur...
—Il faut, il faut parler... Il le faut pour Roger... Chaque jour il s’enchaîne et m’enchaîne davantage. Je n’ai pas le droit de me taire. C’est le tromper...
Dieu! Dieu! qu’elle était faible!... Pourtant, elle ne l’était pas, dans la vie ordinaire. Mais le souffle de l’amour est comme ces vents chauds, dont la langueur brûlante vous casse les jointures, fait défaillir le cœur. Une lassitude extrême d’obscure volupté. Une peur de bouger. Une peur de penser... L’âme, tapie dans son rêve, craint de s’en éveiller.—Annette savait bien qu’au premier geste qu’elle ferait, le rêve allait se briser...
Mais même en ne bougeant pas, le temps bouge pour nous, et la fuite des jours suffit à entraîner l’illusion qu’on voudrait conserver. On a beau se surveiller: on ne peut vivre ensemble, du matin jusqu’au soir, sans, au bout de quelque temps, se montrer comme on est.
La famille Brissot parut, au naturel. Le sourire était de façade. Annette était entrée dans la maison. Elle vit des bourgeois affairés et moroses, qui géraient leurs biens avec un plaisir âpre. Il n’était pas question ici de socialisme. Des immortels Principes, on invoquait seulement la Déclaration des Droits du propriétaire. Il ne faisait pas bon y porter atteinte. Leur garde était occupé sans relâche à dresser des contraventions. Eux-mêmes, ils exerçaient une surveillance stricte, qui leur était une sorte de délectation chagrine. Ils paraissaient en guerre d’embuscades avec leurs domestiques, avec leurs fermiers, avec leurs vignerons, avec tous leurs voisins. L’esprit de chicane procédurière, qui était dans la famille, et aussi dans la province, s’y épanouissait. Quand le père Brissot avait réussi à pincer au piège un de ceux qu’il guettait, il riait bien. Mais il ne riait point le dernier: l’adversaire était de la même glaise bourguignonne; on ne le prenait pas sans vert; le lendemain, il ripostait par un tour de sa façon. Et l’on recommençait...
Sans doute, à ces démêlés Annette n’était pas conviée; les Brissot en causaient entre eux, au salon, ou à table, tandis que Roger et Annette semblaient occupés l’un de l’autre. Mais la fine attention d’Annette suivait tout ce qui se disait autour. Roger, d’ailleurs, interrompait l’amoureux entretien, pour prendre part à la discussion, qui les passionnait tous. Ils s’échauffaient alors; tous parlaient à la fois; ils oubliaient Annette. Ou ils la prenaient à témoin de faits qu’elle ignorait.—Jusqu’à ce que Madame Brissot, se rappelant la présence de celle qui écoutait, coupât net le colloque, et que, tournant vers elle son sourire fondant, elle remît l’entretien sur des routes fleuries. Alors, sans transition, l’on revenait à l’affable bonhomie. C’était dans le ton général un curieux alliage de pruderie et de gauloiserie,—de même que se mêlaient dans la vie de château largesse et lésinerie. Monsieur Brissot, guilleret, faisait des calembours. Mademoiselle Brissot parlait de poésie. Sur ce thème chacun disait son mot. Ils prétendaient s’y connaître. Leur goût datait d’une vingtaine d’années. Pour tout ce qui concernait l’art, ils avaient des opinions arrêtées. Ils s’appuyaient sur celles, dûment contrôlées, de «leur ami un tel», qui était de l’Institut, et archi-décoré. Pas d’esprits plus timides—avec autorité—que ces grands bourgeois, qui se croyaient aussi avancés en art qu’en politique, et qui ne l’étaient pas plus dans l’une que dans l’autre: car dans l’une et dans l’autre, ils n’arrivaient jamais—à bon escient—qu’après les batailles gagnées.
Annette se sentait bien lointaine. Elle regardait, écoutait, et elle se disait:
—Mais qu’est-ce que j’ai à faire avec ces figures là?
L’idée que l’une ou l’autre pouvait prétendre à exercer sur elle une tutelle ne la révoltait même plus, lui donnait envie de rire. Elle se demandait ce qu’aurait pensé Sylvie, si on l’eût gratifiée d’une famille de cette étoffe. Quels cris, quels éclats de rire!...
Annette y répondait parfois, toute seule, dans le jardin. Et il arrivait que Roger, étonné, l’entendît et lui demandât:
—Qu’est-ce qui vous fait donc rire?
Elle répondait:
—Rien, chéri. Je ne sais pas. Des bêtises...
Et elle tâchait de reprendre sa mine bien sage. Mais c’était plus fort qu’elle: elle repartait de plus belle, et même devant mesdames Brissot. Elle demandait pardon; et mesdames Brissot, indulgentes, un peu vexées, disaient:
—Cette enfant! Il faut qu’elle dépense son rire!
Mais elle ne riait pas toujours. Des ombres passaient brusquement sur sa belle humeur. Après des heures de tendresse et de confiance rayonnantes avec Roger, elle avait, sans transition, et sans aucun motif, des accès de mélancolie, de doute, d’anxiété. L’instabilité de sa pensée, depuis l’automne dernier, bien loin de se calmer, s’accentuait plutôt dans ces mois d’amour partagé. C’étaient, par giboulées, une invasion d’instincts bizarrement désharmoniques, irritabilité, humour baroque, maligne ironie, orgueil ombrageux, rancunes inexpliquées. Annette avait beaucoup à faire de les mettre sous l’éteignoir. Et le résultat n’en était pas fameux: elle semblait alors plongée dans une taciturnité hostile et inquiétante. Comme elle gardait son intelligence nette, elle s’étonnait de ces variations, et elle se les reprochait. Cela n’y changeait pas grand’chose. Mais le sentiment de ses imperfections l’amenait à une indulgence—plus voulue que sincère—pour celles de ces «magots...» (Encore!... L’impertinente!... «Pardon! je ne le ferai plus!...») Puisqu’ils étaient les parents de Roger, elle devait les accepter, si elle acceptait Roger... Toute la question était de savoir si elle acceptait Roger. Le reste, mon Dieu, le reste n’a pas grande importance, quand on est deux pour se défendre.
Seulement, était-on deux? Roger la défendrait-il? Et même, avant de se demander si elle accepterait Roger, Roger l’accepterait-il sincèrement et d’un cœur généreux, lorsqu’il la verrait enfin comme elle était? Car, jusqu’ici, il ne voyait que sa bouche et ses yeux. Quant à ce qu’elle pensait et voulait,—la vraie Annette,—on eût dit qu’il ne tenait pas beaucoup à la connaître; il trouvait plus commode de l’inventer. Annette cependant se berçait de l’espoir que, l’amour aidant, il ne serait pas impossible, après s’être regardés bravement jusqu’au cœur, de se dire:
—Je te prends. Je te prends comme tu es. Je te prends avec tes défauts, tes démons, avec tes exigences, avec ta loi de vie. Tu es ce que tu es. Comme tu es, je t’aime.
Elle se savait capable, pour son compte, de cet acte d’amour. Pendant les derniers jours, elle avait longuement observé Roger, de ses yeux de fleur, où, sans qu’on y prît garde, tout venait se mirer. Roger, qui ne se méfiait plus, s’était souvent montré plus Brissot qu’elle n’eût voulu, pris par les intérêts et les querelles de la tribu, et y portant le même esprit chicanou. Certains petits côtés durs, retors, ne lui étaient pas plaisants. Mais elle ne voulait pas les juger sévèrement, comme elle eût fait chez d’autres. Ces traits lui semblaient imités. Roger, en beaucoup de choses, lui paraissait encore un enfant incertain, soumis aux siens, qu’il copiait béatement, très timide d’esprit, en dépit de ses grandes paroles. Bien qu’elle commençât à percer le peu de consistance de ses projets de rénovation sociale, et qu’elle ne fût plus tout à fait dupe de son idéalisme oratoire, elle ne lui en voulait pas, car elle savait qu’il ne cherchait pas à la tromper, et qu’il était sa première dupe; elle était même prête, avec une tendre ironie, à écarter de son chemin ce qui pourrait troubler l’illusion dont il avait besoin pour vivre. Et jusqu’à son égoïsme naïf, qu’il étalait parfois, d’une façon encombrante, ne la rebutait pas, lui paraissait sans méchanceté. Au fond, tous ses défauts étaient défauts de faiblesse. Et l’amusant était qu’il posait pour la force... L’homme de bronze... Aes triplex... Pauvre Roger!... C’était presque touchant. Annette en riait tout bas, mais en gardant pour lui des trésors d’indulgence. Elle l’aimait bien. Elle le voyait, malgré tout, bon, généreux, ardent. Elle était comme une mère, qui traite d’une main douce les petits vices, à ses yeux, pas bien graves, d’un cher enfant; elle ne l’en rend pas responsable; elle n’en est que plus portée à le plaindre et à le dorloter... Ah! et puis, Annette n’avait pas seulement pour Roger les yeux indulgents d’une mère! Elle avait ceux très partiaux d’une amante. Le corps parlait. Sa voix était bien forte. Celle de la raison pouvait dire ce qui lui plaisait: il y avait une façon d’entendre, qui, de ces blâmes mêmes, allumait les désirs. Annette voyait bien tout. Mais, de même qu’il est une manière, en inclinant la tête et clignant les paupières, d’harmoniser les plans d’un paysage, Annette, tout en voyant les traits fâcheux de Roger, les regardait d’un angle où ils s’adoucissaient. Elle n’eût pas été loin d’aimer jusqu’aux laideurs: car on donne plus de soi, en aimant les défauts de ce qu’on aime; quand on aime ce qu’il a de beau, on ne donne pas, on prend. Annette pensait:
—Je t’aime d’être imparfait. Si tu savais que je le vois, tu t’en irriterais. Pardon! Je n’ai rien vu... Mais moi, je ne suis pas comme toi: je veux que tu me voies imparfaite! Je le suis, je le suis; et j’y tiens; ce que j’ai d’imparfait, c’est moi, plus que le reste. Si tu me prends, tu le prends. Le prends-tu?... Mais tu ne veux pas le connaître. Quand te donneras-tu la peine enfin de me regarder?
Roger n’était pas pressé. Après plusieurs essais inutile pour l’amener sur ce terrain dangereux, qu’il semblait fuir, Annette, dans une promenade, interrompant l’entretien, s’arrêta, lui prit les deux mains, et dit:
—Roger, il faut que nous causions.
—Causer! dit-il en riant. Mais il me semble que nous ne nous en privons pas!
—Non, dit-elle, je n’entends pas nous dire des gentillesses: causer sérieusement.
Il prit tout de suite une mine un peu effrayée.
—N’ayez pas peur, dit-elle. C’est de moi que je voudrais vous parler.
—De vous? dit-il, en se rassérénant. Alors, ce ne peut être que charmant.
—Attendez! Attendez! fit-elle. Quand vous m’aurez entendue, vous ne le direz peut-être plus.
—Que pourriez-vous me dire maintenant qui me surprît? Depuis tant de jours que nous sommes ensemble, ne nous sommes-nous pas tout dit?
—Je n’ai guère eu, pour ma part, qu’à dire amen, fit Annette, en riant. C’est toujours vous qui parlez.
—Oh! la méchante! fit Roger. Est-ce que ce n’est pas de vous que je parle?
—Oui, c’est aussi de moi. Et même, vous parlez pour moi.
—Vous trouvez que je parle tant? dit Roger naïvement.
Annette se mordit les lèvres.
—Non, non, mon cher Roger, j’aime quand vous parlez. Mais quand vous parlez de moi, je reste à vous écouter; et c’est si beau, si beau, que je dis: «Ainsi soit-il!» Mais cela n’est pas ainsi.
—Vous êtes la première femme qui se plaigne que son portrait soit beau.
—J’aimerais mieux qu’il fût moi. Ce n’est pas un beau portrait, Roger, que vous allez accrocher dans votre maison de famille. Je suis une femme vivante, qui a ses volontés, ses passions, ses pensées. Êtes-vous sûr qu’elle pourra entrer chez vous, avec tout son bagage?
—Je la prends, les yeux fermés.
—Je vous demande de les ouvrir.
—Je vois votre âme limpide, qui se peint sur votre visage.
—Pauvre Roger! Bon Roger!... Vous ne voulez pas regarder.
—Je vous aime. Cela me suffit.
—Je vous aime aussi. Et cela ne me suffit pas.
—Cela ne vous suffit pas? dit-il, d’un ton consterné.
—Non. J’ai besoin de voir.
—Qu’est-ce que vous voulez voir?
—Je voudrais voir comment vous m’aimez.
—Je vous aime plus que tout.
—Naturellement! Vous ne pouvez pas moins. Mais je ne vous demande pas combien, je vous demande comment vous m’aimez... Oui, je sais que vous me voulez; mais qu’est-ce que vous voulez en faire, au juste, de votre Annette?
—La moitié de moi-même.
—Voilà bien!... C’est que, voyez-vous, mon ami, je ne suis pas une moitié. Je suis une Annette tout entière.
—C’est une façon de parler. Je veux dire que vous êtes moi, et que je suis vous.
—Non, non, ne soyez pas moi! Roger, laissez-moi l’être!
—En unissant nos vies, n’en ferons-nous pas la même?
—C’est cela qui m’inquiète. J’ai peur de ne pas pouvoir être tout à fait la même.
—Qu’est-ce qui vous trouble, Annette? Qu’est-ce que ces idées? Vous m’aimez, n’est-ce pas? Vous m’aimez? C’est l’essentiel! Ne vous inquiétez pas du reste. Le reste me regarde. Vous verrez, j’arrangerai—moi et les miens qui seront vôtres—nous arrangerons si bien votre vie que vous n’aurez rien à faire qu’à vous laisser porter.
Annette regardait à terre, et dessinait sur le sol des lettres avec le bout de son pied. Elle souriait:
(—Il ne comprenait pas du tout, ce cher garçon...)
Elle releva les yeux vers Roger, qui, bien tranquille, attendait sa réponse. Elle dit:
—Roger, regardez-moi. N’ai-je pas de bonnes jambes?
—Bonnes et belles, dit-il.
—Ça! fit-elle, le menaçant du doigt, ça n’est pas la question... Ne suis-je pas une solide marcheuse?
—Certes, dit-il, je vous aime d’être ainsi.
—Eh bien, est-ce que vous croyez que je vais me laisser porter?... Vous êtes très bon, très bon, je vous remercie; mais laissez-moi marcher! Je ne suis pas de celles qui craignent les fatigues de la route. Me les enlever, c’est m’enlever l’appétit d’exister. J’ai un peu l’impression que vous et les vôtres, vous avez tendance à me décharger de la peine d’agir et de choisir, à tout installer d’avance dans des cases prévues, bien confortablement,—votre vie, leur vie, ma vie,—tout l’avenir. Moi, je ne voudrais pas. Je ne veux pas. Je me sens au commencement. Je cherche. Je sais que j’ai besoin de chercher, de me chercher.
Roger avait un air bienveillant et railleur.
—Et que pouvez-vous bien chercher?
Il voyait là des lubies de petite fille. Elle le sentit, et dit, d’un ton ému:
—Ne vous moquez pas!... Je ne suis pas grand’chose, je ne m’en fais pas accroire... Mais enfin, je sais que je suis, et que j’ai une vie,... une pauvre vie... Ce n’est pas long, une vie, et ce n’est qu’une fois... J’ai le droit... Non, pas le droit, si vous voulez! cela paraît égoïste... J’ai le devoir de ne pas la perdre, de ne pas la jeter au hasard...
Au lieu d’être touché, il prit un air piqué:
—Vous trouvez que vous la jetez au hasard? Est-ce qu’elle sera perdue? Est-ce qu’elle n’aura point là un beau, un très bel emploi?
—Beau, sans doute... Mais lequel? Qu’est-ce que vous m’offrez?
Il décrivit avec feu, une fois de plus, sa carrière politique, l’avenir qu’il rêvait, ses grandes ambitions personnelles et sociales. Elle l’écouta parler; puis, l’arrêtant doucement au milieu, (car d’un pareil sujet il n’était jamais las):
—Oui, Roger, dit-elle. Certainement. C’est très, très intéressant. Mais pour vous dire la vérité,—ne soyez pas froissé!—je ne crois pas autant que vous en cette cause politique à laquelle vous vous consacrez.
—Quoi! vous n’y croyez pas? Vous y croyiez pourtant, lorsque je vous en parlais, dans les premiers temps que je vous vis à Paris...
—J’ai un peu changé, dit-elle.
—Qu’est-ce qui vous a fait changer?... Non, non, ce n’est pas possible... Vous changerez encore. Ma généreuse Annette ne peut pas se désintéresser de la cause du peuple, du renouveau social!
—Mais je ne m’en désintéresse pas, dit-elle. Ce dont je me désintéresse, c’est de la cause politique.
—L’une et l’autre se confondent.
—Pas tout à fait.
—La victoire de l’une sera la victoire de l’autre.
—J’en doute un peu.
—C’est pourtant le seul moyen de servir le progrès et le peuple.
(Annette pensait: «En se servant soi-même.»—Mais elle se le reprocha.)
—J’en vois d’autres.
—Le plus vieux est encore le meilleur. Comme ceux qui suivaient le Christ, donner tout, laisser tout, pour aller au peuple.
—Quelle utopie!
—Oui, je crois. Vous n’êtes pas utopiste, Roger. Je l’avais cru, d’abord. Je ne le crois plus maintenant. Vous avez, en politique, le sens des réalités. Avec votre grand talent, je suis bien sûre de vos succès futurs. Si je doute de la cause, je ne doute pas de vous. Vous aurez une belle carrière. Je vous vois déjà à la tête d’un parti, orateur applaudi, groupant au Parlement une majorité, ministre...
—Arrêtez-vous! dit-il, «... Macbeth, tu seras roi!...»
—Oui, je suis un peu sorcière... pour les autres. Mais ce qui est vexant, c’est que je ne le suis pas pour moi.
—Ce n’est pourtant pas difficile! Si je deviens ministre, cela vous concerne aussi... Voyons, là, franchement, cela ne vous ferait pas plaisir?
—De quoi? D’être ministre?... Dieu du ciel! Pas le moindre!... Pardon, Roger, pour vous, cela me ferait plaisir, sûrement. Et si j’étais avec vous, croyez que je tiendrais mon rôle, de mon mieux, je serais heureuse de vous aider... Mais, (n’est-ce pas? vous voulez bien que je sois franche?), j’avoue qu’une telle vie ne remplirait pas—mais pas du tout ma vie.
—Sans doute, je le comprends. La femme la mieux faite pour partager une vie d’action politique—voyez, par exemple, mon admirable mère!—ne saurait s’y borner. Sa vraie tâche est au foyer. Et sa vocation propre, c’est la maternité.
—Je sais, dit Annette. Cette vocation ne nous est pas disputée. Mais... (j’ai peur de ce que je vais dire, j’ai peur que vous ne me compreniez pas)... je ne sais pas encore ce que m’apportera la maternité. J’aime bien les enfants. Je crois que je serai très attachée aux miens... (Vous n’aimez pas ce mot? Oui, je vous parais froide...) Peut-être que je serai très prise... C’est possible. Je ne sais pas... Mais je ne voudrais pas dire quelque chose que je ne sens pas. Et, pour être sincère, cette «vocation», en moi, n’est pas encore tout à fait éveillée. En attendant que la vie me révèle ce que je ne connais pas, il me semble que la femme ne devrait jamais, en aucun cas, engouffrer toute sa vie dans cet amour de l’enfant... (Ne froncez pas le sourcil!...) Je suis convaincue qu’on peut aimer bien son enfant, faire loyalement sa tâche domestique, et garder assez de soi—comme on doit—pour le plus essentiel.
—Son âme.
—Je ne comprends pas.
—Comment faire comprendre sa vie intérieure? Les mots sont si obscurs, si incertains, gâchés! L’âme... C’est ridicule de parler de son âme! Qu’est-ce que cela veut dire?... Je ne pourrais pas expliquer ce que c’est.—Mais c’est. C’est ce que je suis, Roger. Le plus vrai, le plus profond.
—Le plus vrai, le plus profond, ne me le donnez-vous pas?
—Je ne puis donner tout, dit-elle.
—Alors, vous n’aimez pas.
—Si, Roger, je vous aime. Mais nul ne peut donner tout.
—Vous n’aimez pas assez. Quand on aime, on ne pense à rien garder de soi. L’amour... l’amour... l’amour...
Il s’envola dans un de ses grands discours. Annette l’entendait célébrer, en termes pathétiques, le don entier de soi, la joie du sacrifice au bonheur de l’aimé. Elle pensait:
(—Mon chéri, pourquoi dis-tu tout cela? Crois-tu que je l’ignore? Crois-tu que je ne pourrais pas me sacrifier à toi, si c’était nécessaire, et y trouver ma joie? Mais à une condition: c’est que tu ne l’exiges pas... Pourquoi l’exiges-tu?... Pourquoi sembles-tu l’attendre, comme ton droit? Pourquoi n’as-tu pas confiance en moi, en mon amour?)
Après qu’il eut fini, elle dit:
—C’est très beau. Je ne serais pas capable, vous le savez, d’exprimer ces choses aussi bien que vous. Mais peut-être qu’à l’occasion, je ne serais pas incapable de les sentir...
Il s’exclama:
—Peut-être! A l’occasion!.....
—Vous trouvez cela bien peu, n’est-ce pas?... C’est plus que vous ne croyez... Mais je n’aime pas à promettre plus... (peut-être ce sera moins)... que je ne pourrais tenir. Je ne sais pas d’avance... Il faut se faire crédit. Nous sommes des honnêtes gens. Nous nous aimons, Roger. On fera tout ce qu’on peut.
Il leva les bras, de nouveau:
—Tout ce qu’on peut!...
Elle sourit, et reprit:
—Voulez-vous me faire crédit? J’ai besoin d’y faire appel. J’ai beaucoup à demander...
Il fut prudent:
—Dites!
—Je vous aime, Roger; mais je voudrais être vraie. J’ai vécu, depuis l’enfance, assez seule, et très libre. Mon père me laissait une grande indépendance, dont je n’abusais point, parce qu’elle me semblait tout à fait naturelle, et parce qu’elle était saine. J’ai pris ainsi des habitudes d’esprit, dont il m’est difficile maintenant de me passer. Je me rends compte que je suis un peu différente de la plupart des jeunes filles de ma classe. Et pourtant, je crois que ce que je sens, elles le sentent aussi; j’ose seulement le dire, et j’en ai une conscience plus claire.—Vous me demandez d’unir ma vie à la vôtre. C’est mon souhait. C’est, pour chacune de nous, le vœu le plus profond, de trouver le cher compagnon. Et il me semble que vous pourriez l’être, Roger... si... si vous vouliez...
—Si je voulais! dit-il, la bonne plaisanterie! Je ne fais que le vouloir!...
—Si vous vouliez vraiment être mon compagnon. Ce n’est pas une plaisanterie. Réfléchissez!... Unir nos vies, cela ne signifie pas supprimer l’une ou l’autre... Qu’est-ce que vous m’offrez?... Vous ne vous en apercevez pas, parce que depuis longtemps le monde est habitué à ces inégalités. Mais elles me sont neuves... Vous ne venez pas à moi, seulement avec votre affection. Vous venez avec les vôtres, vos amis, vos clients et votre parenté, avec votre route tracée, votre carrière fixée, votre parti et ses dogmes, votre famille et ses traditions,—tout un monde qui est à vous, tout un monde qui est vous. Et moi, qui ai un monde aussi, qui suis aussi un monde,—vous me dites: «Laisse là ton monde! Jette-le, et entre dans le mien!»—Je suis prête à venir, Roger, mais à venir tout entière. M’acceptez-vous tout entière?
—Je veux tout, fit-il: c’est vous qui, tout à l’heure, disiez que vous ne pouvez me donner tout.
—Vous ne me comprenez pas. Je dis: «M’acceptez-vous libre? Et m’acceptez-vous toute?»
—Libre? répondit Roger, circonspect. Tout le monde est libre en France, depuis 89...
(Annette souriait: «Le bon billet!...»)
—... Mais enfin, il faut s’entendre. Il est bien évident que, du moment, que vous vous mariez, vous n’êtes plus tout à fait libre. Vous contractez, de ce, des obligations.
—Je n’aime pas beaucoup ce mot, dit Annette; mais la chose ne me fait pas peur. Je prendrais joyeusement, librement, ma part des peines et des travaux de celui que j’aime, des devoirs de la vie commune. Et plus ils seraient durs, plus ils me seraient chers, avec l’aide de l’amour. Mais je ne renonce pas pour cela aux devoirs de ma vie propre.
—Et quels autres devoirs? D’après ce que vous m’avez dit et ce que je crois savoir, votre vie, ma chère Annette, votre vie jusqu’à présent, si calme, si modeste, ne paraît pas avoir eu de bien grandes exigences. Que peut-elle réclamer? Est-ce de votre travail que vous voulez parler? Souhaitez-vous de le continuer? Ce genre d’activité me semble, je l’avoue, décevant pour une femme. A moins d’une vocation. C’est gênant, en ménage... Mais je ne crois pourtant pas que vous soyez affligée de ce présent du ciel. Vous êtes trop humaine et bien équilibrée.
—Non, il ne s’agit pas d’une vocation spéciale. Ce serait simple, alors: il faudrait la suivre... La demande, l’exigence (comme vous dites) de ma vie est moins facile à formuler: car elle est moins précise et beaucoup plus vaste. Il s’agit du droit qui s’impose pour toute âme vivante: le droit à changer.
Roger se récria:
—Changer! Changer d’amour?
—Même en restant toujours, comme je le veux, fidèle à un seul amour, l’âme a droit à changer... Oui, je sais bien, Roger, «changer», ce mot vous effraie... Moi-même, il m’inquiète... Quand l’heure qui passe est belle, je voudrais n’en plus bouger... On soupire de ne pas se fixer pour toujours!... Mais pourtant, on ne le doit pas, Roger; et d’abord, on ne le peut pas. On ne reste pas sur place. On vit, on va, on est poussé, il faut, il faut avancer! Ce n’est point faire tort à l’amour. On l’emporte avec soi. Mais l’amour ne doit pas vouloir nous retenir en arrière, enfermés avec lui dans l’immobile douceur d’une seule pensée. Un bel amour peut durer toute une vie; mais il ne la remplit pas toute. Songez, mon cher Roger, que, tout en vous aimant, je me trouverai peut-être un jour, (je me trouve déjà) à l’étroit dans votre cercle d’action et de pensée. Je ne songerais jamais à contester pour vous la valeur de votre choix. Mais serait-il juste qu’il me fût imposé? Et ne trouvez-vous pas équitable de me reconnaître la liberté d’ouvrir la fenêtre, si je n’ai pas assez d’air,—et même un peu la porte—(oh! je n’irai pas bien loin!)—d’avoir mon petit domaine d’action, mes intérêts d’esprit, mes amitiés propres, de ne pas rester confinée sur un même point du globe, dans le même horizon, de tâcher de l’élargir, de changer d’air, d’émigrer.., (je dis: si c’est nécessaire... je ne le sais pas encore. Mais j’ai, en tout cas, besoin de sentir que je suis libre de le faire, que je suis libre de vouloir, libre de respirer, libre... libre d’être libre... même si je ne faisais jamais usage de ma liberté.)... Pardonnez-moi, Roger, peut-être vous trouvez ce besoin absurde et puéril. Ce ne l’est pas, je vous assure, c’est le plus profond de mon être, le souffle qui me fait vivre. Si on me le retirait, je mourrais... Je fais tout, par amour... Mais la contrainte me tue. Et l’idée de la contrainte me rendrait révoltée... Non, l’union de deux êtres ne doit pas devenir un enchaînement mutuel. Elle doit être une double floraison. Je voudrais que chacun, au lieu de jalouser le libre développement de l’autre, fût heureux d’y aider. Le seriez-vous, Roger? Sauriez-vous m’aimer assez, pour m’aimer libre, libre de vous?...
(Elle pensait: «Je n’en serais que plus à toi!...»)
Roger l’écoutait, soucieux, nerveux, un peu vexé. Tout homme l’eût été. Annette aurait pu être plus habile. Dans son besoin de franchise et sa peur de tromper, elle était toujours portée à exagérer ce qui, de sa pensée, pouvait le plus choquer. Mais un amour plus fort que celui de Roger ne s’y fût pas mépris. Roger, atteint surtout dans son amour-propre, flottait entre deux sentiments: celui de ne pas prendre au sérieux ce caprice de femme, et la contrariété qu’il éprouvait de cette insurrection morale. Il n’en avait pas perçu l’appel ému à son cœur. Il n’en avait retenu qu’une sorte d’obscure menace et d’atteinte à ses droits de propriétaire. S’il eût eu plus de rouerie dans le maniement des femmes, il eût mis sous le boisseau sa vexation secrète, et promis, promis, promis... tout ce qu’Annette voulait. «Des promesses d’amoureux, autant emporte le vent! Pourquoi donc lésiner?...» Mais Roger, qui avait ses défauts, avait aussi ses vertus: il était, comme on dit, «un bon jeune homme», trop rempli de son moi pour bien connaître les femmes, qu’il avait assez peu pratiquées. Il n’eut pas l’habileté de cacher son dépit. Et, quand Annette attendait une parole généreuse, elle eut le désappointement de voir qu’en l’écoutant, il n’avait songé qu’à lui.
—Annette, dit-il, je vous avoue que j’ai peine à comprendre ce que vous me demandez. Vous me parlez de notre mariage, comme d’une prison, et vous ne semblez avoir d’autre pensée que de vous en évader. Ma maison n’a pas de barreaux aux fenêtres, et elle est assez large pour qu’on s’y trouve à l’aise. Mais on ne peut pas vivre, toutes les portes ouvertes; et ma maison est faite pour qu’on y reste. Vous me parlez d’en sortir, d’avoir votre vie à part, vos relations personnelles, vos amis, et même, si j’ai bien compris, de pouvoir vous en aller, à votre gré, du foyer, pour chercher Dieu sait quoi que vous n’y auriez pas trouvé, jusqu’à ce qu’il vous plaise, un jour, d’y rentrer... Annette, ce n’est pas sérieux! Vous n’y avez pas pensé! Aucun homme ne pourrait consentir à sa femme une situation, pour lui si humiliante, pour elle si équivoque.
Ces réflexions ne manquaient peut-être pas de bon sens. Mais il est des moments, où le bon sens tout sec, sans l’intuition du cœur, est un non-sens.—Annette, un peu froissée, dit avec une froideur fière, qui masquait son émotion:
—Roger, il faut avoir foi en la femme que l’on aime; il faut, quand on l’épouse, ne pas lui faire l’injure de croire qu’elle n’aurait pas de votre honneur le même souci que vous. Pensez-vous que celle que je suis se prêterait à une équivoque, pour vous humiliante? Toute humiliation pour vous le serait pour elle aussi. Et plus elle serait libre, plus elle se sentirait tenue à veiller sur la part de vous-même que vous lui auriez confiée. Il faut m’estimer plus. N’êtes-vous pas capable de me faire confiance?
Il sentit le danger de l’éloigner par ses doutes; et, se disant qu’après tout, il ne fallait pas attacher à ces propos de femme une importance exagérée, et qu’on aurait le temps, plus tard, d’y aviser—(si elle s’en souvenait!)—il revint à sa première idée, qui était de le prendre en plaisanterie. Il crut donc très bien faire, en disant galamment:
—Toute confiance, mon Annette! Je crois en vos beaux yeux. Jurez-moi seulement que vous m’aimerez toujours, que vous m’aimerez uniquement! Je ne vous demande rien de plus!
Mais la petite Cordelia, que ne réconciliait point cette façon badine d’esquiver la loyale réponse, dont dépendait sa vie, se raidit contre l’impossible engagement:
—Non, Roger, je ne puis pas, je ne puis pas jurer cela. Je vous aime beaucoup. Mais je ne puis pas promettre ce qui ne dépend pas de moi. Ce serait vous tromper; et je ne vous tromperai jamais. Je vous promets seulement de ne rien vous cacher. Et si je ne vous aimais plus, ou si j’aimais un autre, vous le sauriez le premier,—et même avant cet autre. Et vous, faites de même! Mon Roger, soyons vrais!
Cela ne l’arrangeait guère. La vérité gênante n’était pas une habituée de la maison Brissot. Quand elle frappait au seuil, on se hâtait de faire dire:
—«Tout le monde est absent!»
Roger n’y manqua point. Il cria:
—Ma chérie, que vous êtes donc jolie!... Là, parlons d’autre chose!...
Annette revint, déçue. Elle avait beaucoup espéré d’un franc entretien. Bien qu’elle eût prévu les résistances, elle comptait sur le cœur de Roger pour éclairer son esprit. Le plus affligeant n’était pas que Roger ne l’eût pas comprise, mais qu’il n’avait pas fait le moindre effort pour la comprendre. Il ne semblait avoir rien vu du pathétique de la question pour Annette. Il était tout en surface, et voyait tout à son image. Rien ne pouvait être plus sensible à une femme d’une forte vie intérieure.
Elle ne se trompait pas. Roger avait été interloqué, agacé par les propos d’Annette; mais il n’en avait pas du tout entrevu le sérieux; il les jugeait sans conséquence. Il pensait qu’Annette avait des idées bizarres, un peu paradoxales, qu’elle était «originale»: c’était fâcheux. Madame et Mademoiselle Brissot savaient être supérieures, sans être «originales». Mais on ne pouvait exiger cette perfection chez tous. Annette avait d’autres qualités,—que peut-être Roger ne mettait pas aussi haut, mais auxquelles (il faut le dire) il tenait, pour l’instant, beaucoup plus. A cette préférence le corps avait plus de part que l’esprit; mais l’esprit y avait aussi sa part: Roger en goûtait fort, chez Annette, la fougue primesautière, quand elle ne s’exerçait pas sur des sujets embarrassants pour lui.—Il n’était pas inquiet. Annette, avec sa droiture, lui avait montré qu’elle l’aimait. Il était convaincu qu’elle ne pourrait se détacher de lui.
Il ne se doutait guère du drame de conscience qui se jouait auprès de lui.—En vérité, Annette l’aimait tant qu’elle ne pouvait se résigner à le juger si piètre. Elle voulait croire qu’elle s’était trompée. Elle fit d’autres tentatives, elle tâcha d’y mettre du sien. Si Roger ne lui reconnaissait pas une vie indépendante, quelle part lui faisait-il du moins dans la sienne?... Mais les constatations nouvelles où elle dut arriver furent décourageantes. Le naïf égoïsme de Roger la reléguait, en somme, à la table, au salon, et au lit. Il voulait bien, gentiment, lui conter ses affaires; mais elle n’avait plus, ensuite, qu’à les approuver. Il n’était pas plus disposé à reconnaître à sa femme les droits d’un collaborateur qui discutât son action politique et pût la modifier, qu’à lui permettre une activité sociale différente de la sienne. Il lui semblait tout naturel—(cela s’était toujours fait)—que la femme qui l’aimait lui donnât toute sa vie, et qu’elle ne reçût qu’une part de la sienne. Tout au fond de lui-même, il y avait cette vieille croyance de l’homme en sa supériorité, qui fait que ce qu’il donne lui paraît d’une essence plus haute. Mais il n’en eût pas convenu: car il était bon garçon et galant Français. S’il arrivait qu’Annette prétendît appuyer certains droits de la femme sur l’exemple du mari...
—Ce n’est pas la même chose, disait, en souriant, Roger.
—Pourquoi? demandait Annette.
Roger esquivait la réponse. Une conviction qu’on ne discute pas risque moins d’être ébranlée. Celle de Roger était enracinée. Et Annette prenait le mauvais chemin pour le faire douter de soi. Ses avances, ses efforts pour trouver entre eux un terrain d’entente, après son inutile essai pour lui imposer ses idées, étaient interprétés par Roger comme une preuve nouvelle du pouvoir qu’il exerçait sur elle. Il n’en était que plus sûr de lui. Et même, il devenait fat.—Soudain, Annette s’irritait, et sa parole avait un accent frémissant... Aussitôt, Roger tournait court, et il revenait au système qui lui avait, pensait-il, si bien réussi: il promettait, en riant, tout ce qu’on voulait. Le ton fait, dit-on, passer la chanson. C’en était une pour Roger. Annette ressentait l’offense.
D’autres questions plus graves se posaient. L’intimité d’Annette avec Sylvie eût été fort menacée. Il était évident que la libre fille serait, dans ce milieu, difficilement admise, et que la petite couturière le serait encore moins. Jamais les Brissot, vaniteux, collet-monté, n’eussent admis, pour eux ou pour leur bru, d’aussi scandaleux rapports de parenté. Il eût fallu les cacher. Sylvie ne s’y fût pas plus prêtée qu’Annette. Chacune avait sa fierté, et chacune était fière de l’autre. Annette aimait Roger; et elle le voulait, d’un désir plus brûlant qu’elle ne se l’avouait; mais elle ne lui eût jamais sacrifié sa Sylvie. Elle l’avait trop aimée; et si cet amour, peut-être, avait pâli, elle n’oubliait point qu’à certaines minutes elle avait touché là le fond de la passion:—(elle le savait, elle seule; Sylvie même ne s’en doutait qu’à moitié).—Mais, dans les heures de mutuelles confidences avec Roger, Annette lui avait beaucoup trop raconté. Roger semblait alors amusé, touché... Oui, mais à condition que ce fût du passé. Il ne tenait pas du tout à voir se prolonger cette fraternité compromettante. Il était même, en secret, décidé à la faire cesser, doucement, sans avoir l’air d’y toucher. Il ne voulait partager avec personne l’intimité de sa femme. Sa femme... «Ce chien est à moi...» Comme toute sa famille, il avait le sentiment très vif de ce qui était à lui.
A mesure que le séjour d’Annette se prolongeait, cette prise de possession devenait plus étroite,—de quelques dehors affectueux qu’on l’entourât. Ce que les Brissot tenaient, ils le tenaient. Le despotisme domestique des deux femmes s’accusait journellement à mille menus détails. Leur «idée», comme on dit, était «faite» sur tout: qu’il s’agît du ménage ou du monde, de l’existence quotidienne ou des grands problèmes de la vie morale. C’était vissé, fixé, une fois pour toutes. Tout était édicté: ce qu’il convenait de louer, ce qu’il fallait rejeter,—ce qu’il fallait rejeter, surtout! Que d’ostracismes! Que d’hommes, que de choses, que de façons de penser ou d’agir, jugés, condamnés sans appel, et pour l’éternité! Le ton et le sourire enlevaient l’envie de discuter. Ils avaient l’air de dire (ils disaient souvent, en propres termes):
—Il n’y a pas deux façons de penser, ma chère enfant.
Ou bien, quand elle essayait, cependant, de montrer qu’il y avait aussi la sienne:
—Ma petite, comme vous êtes amusante!
Ce qui avait pour effet de lui clore le bec, à l’instant.
On la traitait déjà en fille de la maison, insuffisamment dressée, qu’on mettait au courant. On lui faisait connaître l’ordre et la marche des jours, des mois, et des saisons Brissot, leurs relations de province, leur relations de Paris, leurs devoirs de parenté, leurs visites, leurs dîners, la chaîne sans fin de ces corvées de société, dont les femmes gémissent, et dont elles sont très fières, parce qu’en les harassant, ce mouvement perpétuel leur donne l’illusion qu’elles servent à quelque chose. Cette vie mécanique, cette fausseté de relations, cette convention perpétuelle, étaient intolérables à Annette. Tout y semblait réglé d’avance: les travaux, les plaisirs,—car il y avait aussi des plaisirs,—mais réglés d’avance!... Vivent les peines imprévues, qui sortent du programme!... Il n’était guère d’espoir d’en sortir, même pour les peines. Annette se voyait maçonnée, comme une pierre dans un mur! A sable et chaux. Ciment romain. Mortier Brissot...
Elle s’exagérait la rigueur de cette vie. Le hasard, l’imprévu, y jouaient leur rôle, comme dans toutes les vies. Mesdames Brissot étaient plus redoutables en paroles qu’en fait; elles avaient la prétention de tout diriger; mais il n’eût pas été impossible, en les prenant par leur faible, en les oignant, flattant et encensant, de les mener par le bout du nez; une fille rusée aurait pu se dire, en les évaluant à leur juste mesure:
—Parlez toujours! Je n’en ferai qu’à ma tête!
Il était à penser qu’une énergie tenace, comme celle d’Annette, ne serait jamais étouffée. Mais Annette passait par cette fièvre nerveuse des femmes qui, à force de trop fixer l’objet qui les préoccupe, ne le voient plus comme il est. De quelques mots entendus dans la journée, elle se forgeait des monstres, le soir, quant elle était seule. Elle s’épouvantait de la lutte qu’il lui faudrait perpétuellement soutenir, et elle se répétait qu’elle ne réussirait jamais à se défendre contre tous. Elle ne se sentait plus assez forte. Elle doutait de son énergie. Elle avait peur de sa propre nature, de ces oscillations, inattendues, par où son esprit inquiet continuait d’être ballotté, de ces brusques sautes des vents qu’elle ne s’expliquait pas.—Et certes, elles provenaient de la complexité de sa riche substance, dont la neuve harmonie ne pourrait que lentement se réaliser par la vie; mais, en attendant, elles risquaient de la livrer à toutes les surprises de la violence, de la faiblesse, de la chair, de la pensée, aux hasards insidieux du destin embusqué au tournant d’une minute, sous les pierres du chemin...
Le fond de son trouble, c’est que de son amour, elle n’était plus sûre. Elle ne savait plus... Elle n’aimait plus; et elle aimait toujours. Son esprit et son cœur—son esprit et ses sens—bataillaient. L’esprit voyait trop clair: il était désabusé. Mais le cœur ne l’était point; et le corps s’irritait, en voyant qu’il allait perdre l’être qu’il convoitait; la passion grondait:
—Je ne veux pas renoncer!...
Annette sentait cette révolte, et elle en était humiliée; sa violence naturelle réagissait durement, faisait appel à sa fierté blessée. Elle disait:
—Je ne l’aime plus!...
Et son regard hostile maintenant épiait en Roger les raisons de ne plus l’aimer.
Roger ne voyait rien. Il entourait Annette de prévenances, de fleurs, d’attentions galantes. Mais il croyait la partie gagnée. Pas un instant, il ne songeait à l’âme fière, sauvage, qui, voilée, l’observait, brûlante de se donner, mais à qui lui dirait le mot de passe mystérieux qui montre qu’on s’est reconnus. Il ne le disait pas; et pour cause. Il disait, au contraire, des mots irréfléchis qui, sans qu’elle le montrât, blessaient Annette au cœur. L’instant d’après, il ne se souvenait plus de ce qu’il avait dit. Mais Annette, qui semblait n’avoir pas entendu, aurait pu le lui répéter, dix jours, dix ans après. Elle en gardait le souvenir frais et la blessure ouverte. C’était bien malgré elle: car elle était généreuse, et elle se reprochait de ne pas savoir oublier. Mais la meilleure des femmes peut pardonner les offenses intimes; elle ne les oublie jamais.
Jour après jour, des déchirures se firent dans la fine toile tissée par l’amour. On ne le remarquait point. La toile restait tendue, mais le moindre souffle y faisait passer d’inquiétants frissons.—Annette, observant Roger dans le cercle de famille, et ses traits de famille, la dureté, la sécheresse de certains de ses propos, son mépris des petites gens, se disait:
—Il déteint. De ce que j’ai aimé en lui, au bout de quelques années, il ne restera rien.
Et puisqu’elle l’aimait encore, elle voulut éviter l’amère désillusion, les conflits dégradants qu’elle prévoyait entre eux, s’ils se liaient.
L’avant-veille de Pâques, sa décision fut prise.—Dure nuit. Il fallut vaincre bien des désirs, fouler aux pieds l’espérance obstinée, qui ne voulait pas mourir. Elle avait, en pensée, bâti son nid avec Roger. Tant de rêves de bonheur, que l’on se chuchote tout bas! Y renoncer! Reconnaître que l’on s’était trompée! Se dire qu’on n’était pas faite pour le bonheur!...
Car elle se le disait, dans son découragement. Une autre, à sa place, ne l’eût pas rejeté. Pourquoi n’était-elle pas capable de l’accepter? Pourquoi ne pouvait-elle sacrifier une partie de sa nature?... Mais non, elle ne le pouvait pas! Comme la vie est mal faite! On ne peut pas se passer d’affection mutuelle, et on ne peut pas se passer non plus d’indépendance. L’une est aussi sacrée que l’autre. L’une est autant que l’autre nécessaire au souffle de nos poumons. Comment les concilier? On vous dit: «Sacrifiez! Si vous ne vous sacrifiez pas, vous n’aimez pas assez...» Mais ce sont, presque toujours, les plus capables d’un grand amour qui sont aussi les plus passionnés d’indépendance. Car tout est fort en eux. Et s’ils sacrifient à leur amour le principe de leur fierté, ils se sentent dégradés jusque dans leur amour, ils déshonorent l’amour...—Non, ce n’est pas aussi simple que voudraient nous le faire croire la morale de l’humilité,—ou celle de l’orgueil,—chrétiens ou nietzschéens. Une force ne s’oppose pas en nous à une faiblesse, une vertu à un vice, ce sont deux forces qui s’affrontent, deux vertus, deux devoirs... La seule vraie morale, selon la vie vraie, serait une morale d’harmonie. Mais la société humaine n’a jamais connu jusqu’à présent qu’une morale d’oppression et de renoncement,—tempérée par le mensonge. Annette ne pouvait mentir...
Que faire?... Sortir de l’équivoque, au plus vite, à tout prix! Puisqu’elle s’était convaincue qu’il lui serait impossible de vivre dans cette union, rompre dès le lendemain!...
Rompre!... Elle se représenta la stupeur de la famille, l’esclandre... Ceci n’était rien... Mais le chagrin de Roger... Aussitôt, s’évoqua dans la nuit l’image de la figure chérie... A cette vision, un ressac de passion de nouveau emporta tout... Annette, brûlante et glacée, immobile dans son lit, sur le dos, les yeux ouverts, comprimait les battements de son cœur...
—Roger, implorait-elle, mon Roger, pardonne-moi!... Ah! si je pouvais t’éviter cette peine!... Je ne peux pas, je ne peux pas!...
Alors, elle était baignée d’un tel flot d’amour et de remords qu’elle eût été près de courir se jeter au pied du lit de Roger, de lui baiser les mains, de lui dire:
—Je ferai tout ce que tu veux...
Quoi! elle l’aimait encore?... Elle se révolta...
—Non, non! je ne l’aime plus!...
Elle se mentait avec fureur...
—Je ne l’aime plus!...
En vain!... Elle l’aimait encore. Elle l’aimait plus que jamais. Peut-être pas avec le plus noble d’elle—(mais qu’est-ce qui est noble? ou qu’est-ce qui ne l’est pas?)—Si! avec le plus noble aussi, et avec le moins! Corps et âme!... S’il suffisait de ne plus estimer, pour ne plus aimer! Comme ce serait commode!... Mais souffrir par l’aimé n’a jamais dispensé de l’aimer: on n’en sent que plus cruellement qu’on est forcé de l’aimer!... Annette souffrait dans son amour blessé—par le manque de confiance, le manque de foi en elle, le manque d’amour profond de Roger. Elle souffrait dans l’amer sentiment de tant d’espoirs détruits, qu’elle couvait sans les montrer au jour. C’était parce qu’elle aimait si ardemment Roger qu’elle tenait à lui faire accepter son indépendance. Elle voulait être pour lui plus qu’une femme qui abdique, passive, dans l’union,—un libre et sûr compagnon.—Il n’en faisait point de cas. Elle en ressentait une douleur, une colère de passion offensée...
—Non! non! je ne l’aime plus! je ne dois plus, je ne veux plus...
Mais sa force se brisa; et, sans même achever son cri de révolte, elle pleura... Dans la nuit, en silence... Sous la glace de la raison, hélas! elle était brûlée... Ce qu’elle ne voulait pas dire: tout ce qui était à elle, même son indépendance, quelle joie elle aurait eue à le lui sacrifier, si seulement il avait eu un mouvement généreux, un geste, un simple geste, pour se sacrifier, lui, plutôt que de la sacrifier!... Elle ne l’eût pas laissé faire. Elle n’eût rien demandé de plus qu’un élan du cœur, une preuve de vrai amour... Mais bien qu’il l’aimât à sa manière, cette preuve, il eût été incapable de la donner. Cela n’entrait pas dans sa pensée. Il eût jugé le vœu d’Annette une exigence de femme, qu’il faut prendre en souriant, mais qui n’a pas grand sens. Que pouvait-elle souhaiter? Pourquoi diable pleurait-elle?—Parce qu’elle l’aimait? Eh bien, alors?...
—«Vous m’aimez, n’est-ce pas? Vous m’aimez? C’est l’essentiel...»
Ah! ce mot, elle ne l’avait pas oublié non plus!...
Annette sourit au milieu de ses larmes. Pauvre Roger! Il était ce qu’il était. On ne lui en veut pas. Mais on ne se changera pas. Ni lui, ni moi. On ne peut pas vivre ensemble...
Elle essuya ses yeux.
Après une nuit blanche—(elle ne s’était assoupie qu’une ou deux heures, à l’aube)—Annette se leva, résolue. Avec la lumière du jour, le calme lui était revenu. Elle s’habilla, se coiffa, méthodiquement, froidement, écartant de sa pensée tout ce qui pouvait éveiller ses doutes, attentive à sa toilette, qu’elle fit méticuleuse, minutieusement correcte, plus encore qu’à l’ordinaire.
Vers neuf heures, Roger frappa gaiement à sa porte. Il venait la chercher, comme chaque matin, pour une promenade.
Ils partirent, escortés par un chien gambadant. Ils prirent un chemin qui s’enfonçait sous bois. Les jeunes bois verdissants étaient criblés de soleil. Les rameaux ruisselaient de chants, de cris d’oiseaux. Chaque pas éveillait des vols, des battements d’ailes, des frôlements de feuilles, des froissements de branches, des fuites éperdues à travers la forêt. Le chien, surexcité, jappait, flairait, zigzaguait. Des geais se chamaillaient. Dans la coupole d’un chêne, deux ramiers rouissaient. Et très loin, le coucou tournait, tournait, plus loin, plus près, redisant inlassable sa vieille plaisanterie. C’était l’explosion de la crise du printemps...
Roger, bruyant, très gai, riant, excitant son chien, était lui-même comme un grand chien heureux. Annette, silencieuse, suivait, à quelques pas. Elle pensait:
—C’est ici... Non, là-bas, au détour...
Elle regardait Roger. Elle écoutait la forêt. Comme tout deviendrait autre, après qu’elle aurait parlé!... Le détour était passé. Elle n’avait point parlé... Elle dit:
—Roger...
d’une voix mal assurée, presque basse, qui tremblait... Il ne l’entendit pas. Il ne remarquait rien. Devant elle, baissé, il cueillait des violettes; et il parlait, parlait... Elle reprit:
—Roger!
cette fois, avec un tel accent de détresse qu’il se retourna, saisi. Et tout de suite, il vit la pâleur du visage mortellement sérieux; il vint à elle... Il avait peur déjà. Elle dit:
—Roger, il faut nous séparer.
Ses traits exprimèrent la stupéfaction et l’effroi. Il bégaya:
—Qu’est-ce que vous dites? Qu’est-ce que vous dites?
Elle répéta fermement, évitant de le regarder:
—Il faut nous séparer, Roger, c’est douloureux, mais il le faut. J’ai vu que c’était impossible, impossible que je sois votre femme...
Elle voulait continuer. Mais il l’en empêcha:
—Non, non, ce n’est pas vrai!... Taisez-vous! taisez-vous! Vous êtes folle!...
Elle dit:
—Il faut que je parte, Roger.
Il cria:
—Partir, vous!... Je ne veux pas!...
Il lui avait saisi les bras, il les serrait brutalement. Puis, il vit la fière figure, volontaire et glacée, il se sentit perdu, il lâcha prise, il demanda pardon, il pria, supplia:
—Annette! ma petite Annette! Restez, restez!... Non, ce n’est pas possible... Mais qu’est-ce qui s’est passé? Qu’est-ce que j’ai fait?
La pitié reparut sur le visage fermé. Elle dit:
—Asseyons-nous, Roger...
(Il s’assit docilement auprès d’elle, sur un talus de mousse: ses yeux ne la quittaient point, imploraient chacune de ses paroles).
—...Soyez calme, il faut que tout soit expliqué... Je vous en prie, soyez calme!... Croyez que je dois tendre toutes mes forces pour l’être... Je ne pourrais parler, si je ne m’y forçais pas...
—Mais ne parlez pas! dit-il, c’est une folie!...
—Il le faut.
Il voulait lui fermer la bouche. Elle se dégagea. Malgré le trouble intérieur, sa résolution semblait si inflexible qu’elle en imposa à Roger qui, renonçant à la lutte, écrasé et hagard, l’écouta parler, sans oser la regarder.
Annette, d’une voix qui paraissait impassible, froide, morne, mais qui avait de brusques cassures, et qui, une ou deux fois, s’arrêta en route pour reprendre haleine,—dit ce qu’elle avait décidé de dire: en termes nets, réfléchis, modérés, qui semblaient d’autant plus implacables... Elle avait voulu sincèrement essayer s’ils pourraient vivre ensemble. Elle l’espérait d’abord, elle le souhaitait de tout son cœur. Elle avait vu que ce rêve n’était pas réalisable. Trop de choses les séparaient. Trop de différences de milieu, de pensée. Elle mettait les torts sur son compte; elle avait reconnu que, décidément, elle ne pouvait vivre mariée. Elle avait des conceptions de vie, d’indépendance, qui ne s’accordaient pas avec celles de Roger. Peut-être Roger avait-il raison. La plupart des hommes, peut-être même des femmes, pensaient comme lui. Elle avait tort, sans doute. Mais, tort ou raison, elle était ainsi. Il était inutile qu’elle causât le malheur d’un autre et le sien propre. Elle était faite pour vivre seule. Elle dégageait Roger de toute promesse envers elle, et reprenait sa liberté. Au reste, ils ne s’étaient pas liés. Tout avait été loyal entre eux. Ils devaient se séparer loyalement, en amis...
Elle fixait, en parlant, les herbes à ses pieds; elle prenait bien garde de ne pas voir Roger. Mais, tandis qu’elle parlait, elle entendait sa respiration qui haletait, et elle eut grand’peine à aller jusqu’au bout. Quand elle eut achevé, elle se risqua à le regarder. Elle fut saisie, à son tour. Le visage de Roger était comme d’un homme qui se noie: rouge, soufflant bruyamment; il n’avait pas la force de crier. Il agita gauchement ses mains crispées, chercha, retrouva son souffle, gémit:
—Non, non, non, non, je ne peux pas, je ne peux pas...
Et il éclata en sanglots.
D’un champ à la lisière, on entendait venir la voix d’un paysan, le soc d’une charrue. Annette, bouleversée, prit Roger par le bras, l’entraîna hors du chemin, dans les taillis, plus loin, au milieu de la forêt. Roger, sans force, se laissait conduire, répétant:
—Je ne peux pas, je ne peux pas... Mais qu’est-ce que je vais devenir?...
Elle essayait tendrement de le faire taire. Mais il était submergé par son désespoir: la douleur de son amour, celle de son amour-propre, l’humiliation publique, la ruine du bonheur qu’il s’était promis, tout se mêlait à la fois; ce grand enfant gâté par la vie, qui n’avait jamais vu les choses résister à ses désirs, s’effondrait dans cette défaite: c’était une catastrophe, un écroulement de toutes ses certitudes; il perdait foi en lui, il perdait pied, il n’avait plus où se prendre. Annette, touchée de ce grand chagrin, disait:
—Mon ami... mon ami... Ne pleurez pas!... Vous avez, vous aurez une belle vie... vous n’avez pas besoin de moi...
Il continuait de gémir:
—Je ne peux pas me passer de vous. Je ne crois plus à rien... Je ne crois plus à ma vie...
Et il se jeta à genoux:
—Restez! restez!... Je ferai ce que vous voulez... tout ce que vous voudrez...
Annette savait bien qu’il promettait ce qu’il ne pourrait tenir, mais elle était attendrie. Elle répondit doucement:
—Non, mon ami, vous le dites sincèrement; mais vous ne le pourriez pas, ou vous en souffririez, et j’en souffrirais aussi; la vie nous serait un conflit perpétuel...
Quand il vit qu’il ne pouvait ébranler sa résolution, il eut une crise de larmes, à ses pieds, comme un enfant. Annette était pénétrée de pitié et d’amour. Son énergie se fondait. Elle voulait se raidir, mais elle ne pouvait résister à ces pleurs. Elle ne pensait plus à elle; elle ne pensait plus qu’à lui. Elle caressait cette chère tête appuyée contre ses jambes, elle lui disait des mots tendres. Elle releva son grand garçon désolé, elle lui essuya les yeux avec son mouchoir, elle le reprit par le bras, elle le força à marcher. Il était si prostré qu’il se laissait faire et ne savait que pleurer. Les branches d’arbres, au passage, leur fouettaient le visage. Ils allaient dans les bois, sans voir, sans savoir où. Annette sentait monter l’émotion et l’amour. Elle disait, en soutenant Roger:
—Ne pleurez pas!... mon chéri... mon petit... Cela me déchire... Je ne peux pas le supporter... Ne pleure pas!... Je vous aime... Je t’aime, mon pauvre petit Roger...
Il disait:
—Non...! au milieu de ses pleurs.
—Si! je t’aime, je t’aime, mille fois plus que tu ne m’as jamais aimée... Que veux-tu que je fasse?... Ah! je ferais... Roger, mon Roger...
Et voici qu’en marchant, à la sortie du bois, ils se trouvèrent à la clôture de la propriété des Rivière, près de la vieille maison. Annette reconnut... Elle regarda Roger... Et soudain, la passion envahit tous ses membres. Un vent de feu. Une griserie des sens, comme l’ivresse d’un acacia en fleurs... Elle courut vers la porte, tenant Roger par la main. Ils entrèrent dans l’habitation déserte. Les volets étaient clos. Au sortir de la pleine lumière, ils furent aveuglés. Roger se heurtait aux meubles. Sans vue et sans pensée, il se laissait guider par la main brûlante qui le menait, dans la nuit des pièces du rez-de-chaussée. Annette n’hésitait pas, son destin l’entraînait... Dans la chambre du fond, la chambre des deux sœurs, où de l’automne passé flottait encore l’arôme de leurs deux corps, vers le grand lit, où toutes deux avaient dormi, elle alla avec lui; et, dans une passion de pitié et de volupté,—elle se donna.
Quand ils se réveillèrent de leur foudroyante ivresse, leurs yeux s’étaient faits à l’ombre. La chambre semblait claire. Par les fentes des volets, des rais de lumière dansaient, leur rappelant la belle journée du dehors. Roger couvrait de baisers le corps d’Annette dévêtue; il disait sa reconnaissance en paroles éperdues...
Mais après qu’il l’eut dite, il se tut brusquement, le visage appuyé contre le flanc d’Annette... Annette, silencieuse, immobile, songeait... Dehors, dans le rosier au mur, bourdonnaient les abeilles... Et Annette entendit, comme un chant qui s’éloigne, l’amour de Roger qui s’envole...
Déjà, il l’aimait moins. Roger le sentait aussi, avec honte et dépit; mais il n’en voulait pas convenir. Au fond, il était choqué qu’Annette se fût donnée... Ridicule exigence de l’homme! Il veut la femme; et quand, sincèrement, elle se livre à lui, il est près de regarder son acte trop généreux comme une infidélité!...
Annette se pencha vers lui, lui souleva la tête, le regarda dans les yeux, longuement, ne dit rien, sourit avec mélancolie. Lui, qui sentait ce regard le scruter jusqu’au fond, chercha à lui donner le change. Il pensa se montrer très épris. Il dit:
—Maintenant, Annette, vous ne pouvez plus partir: je dois vous épouser.
Le sourire triste d’Annette reparut. Elle avait bien lu en lui...
—Non, mon ami, dit-elle, vous ne devez rien.
Il s’était ressaisi.
—Je veux...
Mais elle:
—Je partirai.
Il demanda:
—Pourquoi?
Et avant qu’elle ne l’eût dit, il avait déjà mieux compris ses raisons de partir.—Il se crut obligé pourtant à les rediscuter. Elle lui mit sur la bouche sa main. Il baisa cette main, avec une colère passionnée... Ah! combien il l’aimait! Il était humilié des pensées qui étaient en lui. Ne les avait-elle pas vues?... Et la main douce et moite qui lui caressait les lèvres, semblait dire:
—Je n’ai rien vu...
D’un village lointain le tintement de cloches arrivait, par bouffées... Après un long silence, Annette soupira... Allons, cette fois, c’est la fin... Elle dit, à mi-voix:
—Roger, il faut rentrer...
Leurs corps se déprirent. Agenouillé devant le lit, il appuya son front sur les pieds nus d’Annette. Il voulait lui prouver:
—Je suis à toi.
Mais il ne parvenait pas à chasser son arrière-pensée.
Il sortit de la chambre, laissant Annette se rhabiller. En l’attendant, il s’accouda sur un mur de la petite cour d’entrée, écoutant vaguement les bruits de la campagne et goûtant l’heure passée. Les idées importunes s’étaient éclipsées. Il jouissait du bonheur de l’orgueil et des sens apaisés. Il était fier de lui. Il pensa:
—Pauvre Annette!
Il se reprit:
—Chère Annette!...
Elle sortait de la maison. Aussi calme, toujours. Mais très pâle... Qui peut dire tout ce qui s’était passé, pendant les courts instants qu’il l’avait laissée seule, les assauts de la passion, la douleur, le renoncement?... Roger n’en vit rien, il était occupé de lui. Il alla à elle, et voulut recommencer ses protestations. Elle mit un doigt sur sa bouche: Silence!... A la haie qui ceignait le jardin, elle cueillit un rameau d’aubépine, elle le cassa en deux, et lui en donna la moitié. Et, sortant avec lui de la propriété, sur le seuil, elle posa sa bouche sur celle de Roger.
Ils revinrent sans parler, à travers la forêt. Annette l’avait prié de ne pas rompre le silence. Il lui tenait le bras. Il avait l’air très tendre. Elle souriait, les yeux demi-fermés. C’était lui, cette fois, qui dirigeait ses pas. Il ne se souvenait plus qu’il y avait une heure, ici, il avait pleuré...
Au fond de la forêt, les aboiements du chien poursuivaient un gibier...
Elle partit, le lendemain. Elle donna pour prétexte une lettre, une maladie subite de sa vieille parente. Les Brissot n’en furent pas dupes tout à fait. Mieux que Roger, ils avaient, depuis quelque temps, le soupçon qu’Annette leur échappait. Mais il convenait à leur dignité de n’en pas sembler admettre la possibilité et de croire aux raisons de ce brusque départ. Jusqu’à la dernière minute, on joua la comédie de la brève séparation et du prochain revoir. Cette contrainte était pénible à Annette; mais Roger l’avait priée de n’annoncer sa décision que plus tard, de Paris; et Annette s’avouait qu’elle eût été bien gênée de l’apprendre, de vive voix, aux Brissot. On échangea donc, en se quittant, des sourires, des mots mièvres, et des embrassements, où le cœur n’était guère.
Roger accompagna de nouveau, en voiture, Annette à la station. Ils étaient tristes tous deux. Honnêtement, Roger avait renouvelé à Annette sa demande de l’épouser; il s’y croyait tenu: il était gentleman. Il l’était trop. Il s’attribuait aussi, maintenant, le droit de faire sentir son autorité,—dans l’intérêt d’Annette. Il jugeait qu’en se donnant, Annette ayant abdiqué, la situation n’était plus tout à fait égale entre eux et qu’il devait maintenant exiger le mariage. Annette voyait trop que, s’il l’épousait à présent, il s’estimerait mille fois plus justifié qu’avant à la tenir en tutelle. Certes, elle lui savait gré de sa correcte insistance. Mais... elle refusa. Roger en fut secrètement irrité. Il ne la comprenait plus... (Il pensait l’avoir jamais comprise!)... Et il la jugea sévèrement. Il ne le montra point. Mais elle le devina, avec un mélange de tristesse et d’ironie,—et de tendresse toujours... (C’était toujours Roger!...)
Près d’arriver, elle mit sa main gantée sur la main de Roger. Il tressaillit:
—Annette!
Elle dit:
—Pardonnons-nous!
Il voulut parler; il ne put. Leurs mains restèrent serrées. Ils ne se regardaient pas; mais ils savaient que tous deux retenaient leurs larmes, prêtes à couler...
Ils étaient à la station: ils devaient s’observer. Roger installa Annette dans son wagon. Elle n’était pas seule dans le compartiment. Il fallut se borner à de banales amitiés; mais leurs regards avidement prenaient l’empreinte de la figure aimée.
La machine siffla. Ils se dirent:
—A bientôt!
Et ils pensaient:
—Jamais.
Le train partit. Roger rentra, dans la nuit qui tombait. Il avait le cœur plein de douleur et de colère. De colère contre Annette. De colère contre lui. Il se sentait déchiré. Il se sentait—ô honte!—il se sentait soulagé...
Et, sur la route déserte, arrêtant son cheval,—de mépris pour lui-même, de mépris et d’amour, amèrement, il pleura.
Annette rentra chez elle, dans la maison de Boulogne, et elle s’y enferma. La lettre aux Brissot partie, elle rompit tous liens avec le dehors. Aucun de ses amis ne savait qu’elle était revenue. Elle n’ouvrait aucune lettre. Elle restait des journées, sans sortir de l’étage qu’elle habitait. La vieille tante, habituée à ne pas la comprendre et à ne s’en troubler point, respectait son isolement. Sa vie extérieure paraissait suspendue. L’autre vie—la secrète—n’en était que plus intense. Dans son silence passaient des orages de passion blessée. Il fallait être seule pour s’y livrer jusqu’à épuisement. Elle sortait de là brisée, le sang bu, la bouche sèche, le front brûlant, les pieds, les mains glacés. Des périodes de torpeur aux lourds rêves succédaient. Des jours, elle rêvait; et elle n’essayait pas de diriger sa pensée. Elle était envahie par une masse confuse d’émotions mêlées... Une sombre mélancolie, une amère douceur, un goût de cendres dans la bouche, les espérances déçues, de subites lueurs de souvenirs qui faisaient bondir le cœur, des accès de désespoir, orgueil, passion ulcérés, et le sentiment des ruines, de l’irrémédiable, d’un Destin contre qui tous les efforts sont vains,—sentiment accablant d’abord, puis morne, puis se fondant peu à peu en un engourdissement, dont la tristesse lointaine était empreinte d’une étrange volupté... Elle ne comprenait pas...
Elle se revit, une nuit, en songe, dans la forêt gonflée de bourgeons. Elle était seule. Elle courait à travers les fourrés. Les branches d’arbres s’accrochaient à sa robe; les buissons humides s’agrippaient; elle s’y arracha, mais en se déchirant; elle se vit, avec honte, à demi nue. Elle se courba pour se couvrir des lambeaux de sa jupe. Et voici qu’elle aperçoit par terre, devant elle, une corbeille ovale, sous un amoncellement de feuilles ensoleillées,—non pas jaunes et dorées,—mais blanc d’argent, pareilles à un tronc de bouleau, blanc de linge très fin. Elle regarde, émue, elle s’agenouille auprès. Et elle voit le linge qui commence à bouger. Le cœur battant, elle tend la main,—s’éveille...—Son émoi persistait... Elle ne comprenait pas...
Un jour vint—elle comprit... Elle n’était plus seule... En elle se levait une vie, une vie nouvelle...
Et les semaines passaient, tandis qu’elle couvait son univers caché....
—«Amour, est-ce bien toi? Amour, toi qui m’as fui, quand je croyais te saisir, es-tu venu en moi? Je te tiens, je te tiens, tu ne m’échapperas point, ô mon petit prisonnier, je te tiens dans mon corps. Venge-toi! Mange-moi! Petit rongeur, ronge mon ventre! Nourris-toi de mon sang! Tu es moi. Tu es mon rêve. Puisque je n’ai pas pu te trouver dans ce monde, je t’ai fait avec ma chair... Et maintenant, Amour, je t’ai! Je suis celui que j’aime!...»
| Saint-Denis J. DARDAILLON, IMPRIMEUR 47, Boulevard de Châteaudun |
End of the Project Gutenberg EBook of L'âme enchantée v.1, by Romain Rolland
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK L'ÂME ENCHANTÉE V.1 ***
***** This file should be named 45970-h.htm or 45970-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/5/9/7/45970/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images available at The Internet Archive)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.