L'ILLUSTRATION
Prix du Numéro: 75 cent.
SAMEDI 23 MAI 1891
49e Année.--Nº 2517
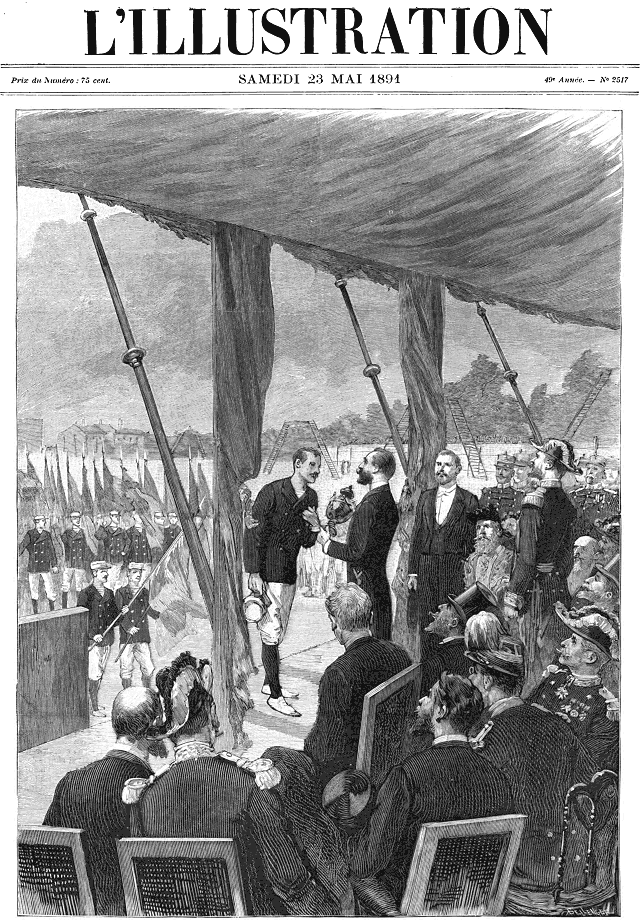
VOYAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Limoges:
distribution des récompenses de la 17e fête fédérale de l'Union de
gymnastique.
D'après les croquis de notre envoyé spécial, M.
Clair-Guyot.
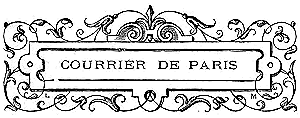
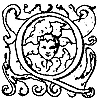 uand nous aurons assisté à cent cinquante vernissages par printemps,
nous pourrons, à notre aise, prendre nos quartiers d'été. Grands dieux,
ces vernissages, comme ils se multiplient! On sort de l'un pour entrer
dans l'autre. S'il n'y a plus en France que très peu de salons où l'on
cause, il en est une quantité où l'on expose. Les Champs-Elysées sont à
peine escomptés que l'on ouvre le Champ-de-Mars, et celui-ci est à peine
lorgné qu'on se précipite vers le Salon des Refusés, un Salon pour rire,
le vaudeville après la grande pièce.
uand nous aurons assisté à cent cinquante vernissages par printemps,
nous pourrons, à notre aise, prendre nos quartiers d'été. Grands dieux,
ces vernissages, comme ils se multiplient! On sort de l'un pour entrer
dans l'autre. S'il n'y a plus en France que très peu de salons où l'on
cause, il en est une quantité où l'on expose. Les Champs-Elysées sont à
peine escomptés que l'on ouvre le Champ-de-Mars, et celui-ci est à peine
lorgné qu'on se précipite vers le Salon des Refusés, un Salon pour rire,
le vaudeville après la grande pièce.
De toutes ces inondations de peinture, c'est bien celle du Champ-de-Mars qui semble d'un agrément plus particulier, sinon supérieur. Cela tient beaucoup à l'arrangement, à l'aménagement. On a là comme un vague ressouvenir de ce beau rêve de 1889, l'Exposition évanouie.
On a la sensation qu'on va retrouver tout à l'heure nos amies les petites Javanaises et on se demande si l'on n'entend point passer dans l'air les lointains accords--ou désaccords--de la musique de la rue du Caire. O valses des tziganes! O starlets du Danube, aux déjeuners de la Czarda! Fini, fini, tout cela. Mais l'exposition des tableaux nous reste et nous en donne une sorte d'arrière-goût.
Et puis on y cause en ce Salon, dans les salons de repos. Les fauteuils y sont bons. La lumière y arrive par des verrières de Besnard qui sont bien suggestives, comme on dit à présent.
Par les fenêtres on aperçoit dans le jardin des touffes de marronniers verts piqués de fleurs blanches. C'est très joli.
Puis les caquets s'envolent avec les pépiements d'oiseaux.
--Avez-vous vu Mme Gautereau?
--Oh! ce portrait, ma chère! Quel portrait!
--Remarquez-vous une chose: c'est que les très jolies femmes ne donnent pas toujours de très jolis portraits.
--C'est comme en photographie.
--A peu près. Et pourtant les peintres ont plus de temps à eux.
--Est-elle si jolie que cela, la belle Mme Gautereau?
--Elle ressemble à Yvette Guilbert, moins la drôlerie, et à Mlle Moreno, des Français, moins la voix. Mais elle est jolie.
--Le nom de son nouveau peintre?
--Courtois. Gustave Courtois.
--Ou Discourtois, car il ne l'a pas flattée.
--Les peintres ne sont pas en ce monde pour flatter.
--Oh! oh! Et si j'avais une verrue sur le nez, ils peindraient donc ma verrue?
--Absolument, sous peine de tirer de leur palette un mensonge.
--C'est qu'un mensonge agréable est si doux! Voyez Machard. A la bonne heure, il vous voit en beau, celui-là. Et Chaplin, le pauvre Chaplin! Moi je ne comprends la peinture que comme un madrigal!
--Ne dites pas cela si haut: voilà des peintres.
--Qui cela?
--Raffaëlli.
--Oh! c'est un sculpteur--et excellent!
--Avez-vous vu les Conscrits?
--Les Conscrits?
--Oui, les Conscrits de Dagnan. Un chef-d'œuvre!
--Ah! ces paysans, là-bas, chantant derrière un drapeau tricolore?
--Précisément. Il y a toute la France dans ce tableau-là. Ces conscrits, solides, cuits du soleil, sans pose, allant droit devant eux, c'est superbe. Ils feront de rudes soldats.
--J'ai cherché la Barricade de Meissonier, je ne l'ai pas trouvée.
--Là-bas, ce cadre crêpé de noir. Ce n'est pas grand, mais c'est admirable.
Des morts aplatis sur un tas de pavés sanglants, dans une rue vide. Je n'ai jamais mieux senti que devant cette vision l'épouvante de la guerre civile. Meissonier avait peint cela d'après nature, certainement.
--Oui. Et il avait donné ce chef-d'œuvre à Delacroix, comme une chose quelconque, une petite étude. A présent, qu'est-ce que cela vaut?
--Les yeux de la tête, mais je garde les miens pour les Boldini. Oh! ces Boldini! Etonnants, étourdissants. Voilà de vraies femmes modernes. Pas des primitifs ou des primitives, celles-là, comme le pastiche de Courtois, non, des contemporaines, des névrosées, des détraquées, des disloquées, mais si fines, si frêles, si délicates, si séduisantes! Adorables, tout simplement. Elles sont capiteuses, comme du champagne.
--Et les Pharisiens de Jean Béraud?
--Les Pharisiens? Les Parisiens, voulez-vous dire?
--Non, les Pharisiens. M. Renan invitant Jésus à dîner. C'est très amusant et bien peint.
--Je n'ai pas vu ce Mystère!
--A propos, si nous allions goûter? Un baba et du Rœderer.
--Allons goûter!
Voilà un aperçu des propos qu'entendent les salons de conversation du Champ-de-Mars. A peu de choses près, c'est cela; quand on ne récite pas l'article de Wolff ou de Mantz qu'on a lu le matin ou la veille dans son journal. Mais il est surprenant de voir la vogue que gardent les Expositions de peinture. Il y en aura bientôt 365 par an, et elles auront 365 fois un public qui se fera écraser les pieds au vernissage.
--Vernissage? La mort aux souliers vernis.
Ces gros événements parisiens--pharisiens, dirait M. Jean Béraud--s'étaient encore grossis, la semaine dernière, d'une petite anecdote spéciale. Tout-Paris s'était trouvé, les pieds et le bec dans l'eau, devant la Porte-Saint-Martin, dont l'affiche portait, barrant le titre du Petit Faust, une bande attristante! Relâche. Relâche par indisposition. Pauvre Tout-Paris! Il venait pour écouter le Petit Faust, et Jeanne Granier, malade, ne pouvait chanter.
Malade ou colère? Malade. Un rhumatisme soudain avait intéressé, comme disent les médecins, quelques cordes vocales. Et alors, en avant la laryngoscope! A nous, Poyetet Fauvel! Mais la voix ne revenait pas, et Tout-Paris attendait, à la porte du théâtre, la fin de l'averse en se disant:
--Que ferai-je, mon Dieu, ce soir?
Tout le monde ne pouvait aller au Théâtre-d'Application voir les si curieuses projections magiques du peintre Horace de Callias, il en coûtait 100 francs à cette représentation-là, et 100 francs, c'est une somme. Il est vrai qu'on avait droit en plus à une pièce de la duchesse d'Uzès et à un concert vocal, où les artistes n'étaient autres que la vicomtesse de Tredern, la comtesse Mnizeck. Il s'agissait d'une bonne œuvre, c'est tout dire.
Mais, encore une fois, tous les Parisiens n'ont pas 100 francs à mettre à une représentation. Et le soir du Petit-Faust, le Tout-Paris se disait:
--Que ferai-je, mon Dieu, ce soir?
Aller voir les Lions, c'est trop loin! Et puis Néron au lieu du Petit Faust! Alors Tout-Paris, en toilettes de premières, s'est rabattu sur les cafés-concerts du voisinage, et a écouté des chanteuses qui ne chantaient pas comme Jeanne Granier, mais qui n'avaient pas de rhumatismes sur les cordes vocales.
Les petites camarades ont fait courir le bruit que ce rhumatisme était dû à un costume manqué. Ces couturières n'en font jamais d'autres, et Mlle Granier a pour ses costumes des coquetteries toutes naturelles. La blonde Blanche d'Antigny, qui fut la première Marguerite du Petit Faust, n'avait pas de ces accès de rhumatisme. Toujours en santé et en gaieté, cette belle fille que nous vîmes arriver un matin de Russie, avec un attelage moscovite et de petits trotteurs de l'Ukraine, conduits par un moujick en blouse de soie.
Elle était, là-bas, toute-puissante, et je ne sais quel grand personnage n'avait rien à lui refuser et ne lui refusait rien. Elle disait:
--Je viens passer quinze jours à Paris, mais je repars pour Pétersbourg. Je ne veux que prendre l'air.
Seulement cet air-là lui monta à la tête. Elle trouva Paris amusant et, Nestor Roqueplan aidant, elle entra au théâtre. Au Palais-Royal, si je ne me trompe. Mais elle le quitta bien vite, ce Palais-Royal, et, superbe, rieuse, les cheveux couleur des blés, la chair couleur du lait, les yeux couleur de saphir, elle apparut dans Chilperic, vêtue d'une peau de mouton blanche, blanche comme le plus gras et le plus joli des bébés mérovingiens qu'on pût imaginer. Elle séduisit le public.
Tant de belle humeur! Pas de façons. Un Rubens à la parisine. Puis Hervé pour elle écrivit le Petit Faust et Blanche d'Antigny--Blanche, comme on disait alors--devint une des reines, une des joies de Paris. Qui s'en souvient maintenant? Et après tant de beauté, de bonté, de luxe et de bruit, quel silence succédant à quelle fin! Car voici comment elle mourut: au Grand-Hôtel, parmi ses malles à peine défaites, au retour d'un voyage au Caire. Défigurée, dit-on, par le coup de foudre d'une petite vérole noire. Zola n'eut garde d'oublier cette fin tragique lorsqu'il ramassa ses documents pour écrire Nana.
Et Nana, c'est Blanche d'Antigny, mais une Blanche poussée au drame et qui n'est pas la belle créature insouciante qui vous amusait dans le Petit Faust, le sourire aux lèvres et le cœur sur la main.
Le romancier qui évoqua la pauvre fille sera-t-il cette semaine élu à l'Académie française? On le dit ou du moins on en parle, car ces élections passionnent toujours peu ou prou le public. Les uns tiennent pour Pierre Loti, les autres pour M. Zola, d'autres pour M. de Bornier, d'autres encore pour M. Stéphen Liégeard. Qui endossera l'habit vert? Qui sera le plus heureux des quatre? Les auteurs dramatiques vont, sans aucun doute, voter pour M. de Bornier. Mais les romanciers et les critiques? Vont-ils aussi se prononcer pour ou contre le roman romanesque inventé par M. Marcel Prévost pour les besoins de sa cause qui, d'ailleurs, est bonne?
On saura cela avant la fin de la semaine, à moins que l'Académie ne vote pour personne, ce qui lui arrive parfois.
--Il est possible que nous attendions, disait l'autre jour un académicien. Attendre! Le mot est plein de sous-entendus macabres. Mais toute élection, politique ou scientifique, sénatoriale ou littéraire, qu'est-ce donc, si ce n'est le jeu de la mort?
Et cette mort de M. Deck, qui vient attrister le monde des arts, c'est une perte. Ce grand céramiste fut un homme simple, bon, dévoué à sa tâche. Une espèce de gens chaque jour plus rare. Deck était Alsacien; toute sa vie, il l'avait vouée à cet art qui fit la gloire des Palissy et des Avisseau.
Je gage qu'on va profiter de la mort de Deck pour demander à quoi sert la manufacture de Sèvres et à quoi bon la conserver.
On devine tous les arguments qui peuvent être produits. Ce sont toujours les mêmes sur les lèvres de ceux qui veulent tout détruire. A quoi bon l'École de Rome? A quoi bon les Gobelins? A quoi bon tout ce qui fait la supériorité artistique de la France? Un Américain, averti de cet entraînement de certains esprits français vers une aimable abolition de notre aristocratie artistique, s'est dit--j'ai, je crois, en son temps, conté la chose:
--Il y a une affaire à faire là!
Et il a offert d'acheter pour une somme considérable (je ne sais combien de millions de dollars) la marque seule de la manufacture de Sèvres, cette marque qui est une estampille d'art.
L'État conserverait les bâtiments de Sèvres. Il y logerait une école professionnelle ou des instituteurs, à son gré, et l'Américain vendrait à l'univers des Sèvres authentiqués par la marque officielle. Ce serait donc profit pour notre budget qui a besoin de secours et pour le Yankee monnayant ainsi un peu de notre vieille gloire.
On a refusé. Jusqu'à présent on persiste à trouver que le luxe est aussi la décoration des démocraties, et Sèvres, comme Beauvais, comme les Gobelins, comme l'École des Beaux-Arts, résiste encore aux assauts. Mais il faut se hâter ou se raidir si l'on veut persister dans ce qui fut l'attrait et la séduction de la France. La mort de Deck va tout remettre en question. A quoi bon chercher un directeur nouveau quand il serait si simple de supprimer le directeur en supprimant la manufacture? Le musée resterait, et encore! L'Amérique pourrait aussi nous l'acheter. O Champfleury! que tu as bien fait de précéder le pauvre Deck!
Mais, d'ailleurs, qu'on attaque ou qu'on défende Sèvres, les choses qui doivent arriver n'en arrivent pas moins à leur heure, et, pour peu qu'on ait vécu, quelque parisien qu'on soit, on devient quasi-mahométan. Ce qui doit être arrive. Il en est de nos opinions comme de ces discours officiels qu'on entend aux gares et aux banquets, en voyage. La fumée du chemin de fer ou celle des repas les emporte. Et, comme disait le bon Théophile Gautier:
--Rien ne prouve rien; du reste, il n'y a rien; au surplus, tout cela est bien indifférent.
Cela vaut bien l'optimisme, par Allah! de M. Renan.
Rastignac.
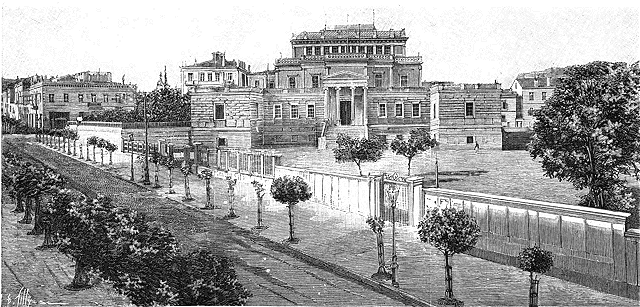
ATHÈNES.--Le palais du Parlement.
LES PARLEMENTS ÉTRANGERS
XI
GRÈCE
Commencée en 1820 par le soulèvement des Souliotes, l'insurrection des provinces grecques contre la domination turque se propagea avec rapidité l'année suivante, et le 7 juin 1821, le Sénat du Péloponnèse procédait à la désignation d'un gouvernement provisoire. Le 13 juin 1822, une Assemblée nationale, réunie à Epidaure, élabora la Constitution d'Épidaure, qui, révisée l'année suivante par une autre Assemblée réunie à Astros, devint la Constitution d'Astros (25 avril 1823), et cette dernière devait être encore modifiée quelques années plus tard, sous le nom de Constitution de Trézène, par une troisième Assemblée constituante qui siégea à Trézène (1827).
Quoi qu'il en soit, ces Constitutions établissaient en principe une forme de gouvernement républicaine; mais Capodistria, nommé président pour sept ans en 1827, s'abstint de convoquer la représentation nationale pendant deux ans, et ne la convoqua à Argos, en 1829, que pour se faire conférer un pouvoir absolu; après sa mort (9 octobre 1831), l'anarchie la plus complète régna dans le pays.
Reconnue comme monarchie indépendante, le 3 février 1830, par la conférence de Londres, la Grèce accepta pour roi, par le traité du 7 mai 1832, le prince Othon de Bavière qui, sous le nom d'Othon Ier, gouverna d'abord onze ans sans Constitution. Après la révolution militaire du 15 septembre 1843, il fut obligé de prêter serment à une Constitution imitée de la Charte française de 1830, et admettant le système de la dualité des Chambres.
Mais la Constitution actuellement en vigueur a été élaborée par l'Assemblée nationale convoquée à Athènes, deux mois après la destitution du roi Othon. Cette assemblée abolit le Sénat, et établit que le pouvoir législatif appartiendrait à une seule chambre. La Constitution fut votée le 17 octobre 1864, et un mois après le roi Georges 1er prêtait serment. Elle n'a subi qu'une modification postérieure, relative au Conseil d'État qui fut aboli, comme le Sénat l'avait été.
Voici les principales dispositions de la Constitution grecque, en ce qui concerne la Chambre des députés.
Le droit de proposer de nouvelles lois appartient à la Chambre et au roi, qui use de ce droit par l'intermédiaire de ses ministres.
Si une proposition de loi est rejetée par la Chambre, elle ne peut être présentée à nouveau au cours de la même session.
Aucune cession ou échange de territoire ne peut avoir lieu sans une loi spéciale.
Le roi ratifie et promulgue les lois: un projet de loi voté par la Chambre et non ratifié par le roi, deux mois après la clôture de la session, est considéré comme nul et non avenu. Le roi convoque régulièrement la Chambre une fois par an, et extraordinairement lorsqu'il le juge nécessaire. Il a aussi le droit de la dissoudre; mais, dans ce cas, le décret de dissolution doit ordonner la convocation des électeurs dans l'espace de deux mois à partir de la date de la dissolution, et la convocation de la Chambre dans l'espace de trois mois.
La Chambre se réunit d'office tous les ans au 1er novembre, à moins que le roi ne la convoque avant cette date. La durée de chaque session doit être de trois mois au moins, et de six mois au plus.
Les séances de la Chambre sont publiques; toutefois, sur la demande de dix membres, elle peut se réunir en séance secrète et prononcer le huis-clos.
Pour que la Chambre puisse délibérer et voter, il faut que la moitié de ses membres plus un soient présents, et les votes sont acquis par une majorité absolue des voix.
Tous les ans, la Chambre vote l'effectif des armées de terre et de mer et le budget.
Les députés prêtent serment en séance publique à la Chambre: les députés non chrétiens prêtent serment d'après la formule et les commandements de leur religion.
Le nombre total des députés ne peut pas être inférieur à 150. La durée de la période parlementaire est de 4 ans, et pour chaque session chaque député reçoit une indemnité de 2,000 drachmes (2,000 fr.). En cas de sessions extraordinaires, ils n'ont droit qu'aux frais de voyage (aller et retour).
La Chambre a le droit de mettre les ministres en accusation devant un tribunal nommé à cet effet, et présidé par le président de la cour de cassation. Le roi peut gracier un ministre condamné par ce tribunal, mais il faut pour cela l'assentiment de la Chambre.
Les députés sont nommés par le suffrage universel; les élections se font en même temps dans tout le royaume.
Est électeur tout démote (habitant d'une commune), âgé de vingt et un ans.
Est éligible tout citoyen hellène, âgé de trente ans, jouissant depuis deux ans de ses droits civils et politiques, et ayant au moins deux ans de séjour dans la circonscription électorale où l'on pose sa candidature. Les maires et les fonctionnaires publics rémunérés ne peuvent pas être élus députés, à moins qu'ils ne donnent leur démission quarante jours avant le jour du vote. Les officiers en activité de service peuvent être élus; mais, dans ce cas, ils sont mis en disponibilité pendant toute la durée de la période parlementaire.
Le vote dure un seul jour (qui doit être un dimanche), du lever au coucher du soleil. Les résultats sont proclamés par le tribunal de première instance. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix, on tire au sort. Les membres du clergé ne peuvent ni voter ni être élus.
Malgré l'annexion de l'Épire et de la Thessalie, le nombre des députés est resté fixé à 150. La population de chaque circonscription électorale est calculée non pas d'après le nombre des habitants, mais d'après le nombre des électeurs. Les élections se font au scrutin de liste.
*
* *
A l'ouverture de la session parlementaire, la présidence est donnée provisoirement au doyen d'âge, et on nomme comme secrétaires les quatre plus jeunes députés. Pour la vérification des pouvoirs, la Chambre est divisée en huit sections: la validation des élections se discute en suivant l'ordre alphabétique des circonscriptions électorales.
La Chambre élit alors à l'ouverture de chaque session, à la majorité absolue des voix et au scrutin secret, un président, trois vice-présidents et quatre secrétaires. Le président ainsi nommé se présente avec tout le bureau devant le roi.
Après la constitution de son bureau définitif, la Chambre nomme douze commissions spéciales: budget, affaires intérieures, affaires étrangères, armée, marine, etc. La commission du budget est composée de 21 membres, chacune des autres n'en comptant que 9. Les pouvoirs de ces commissions durent pendant toute la session, et le même député ne peut pas être membre de trois commissions à la fois.
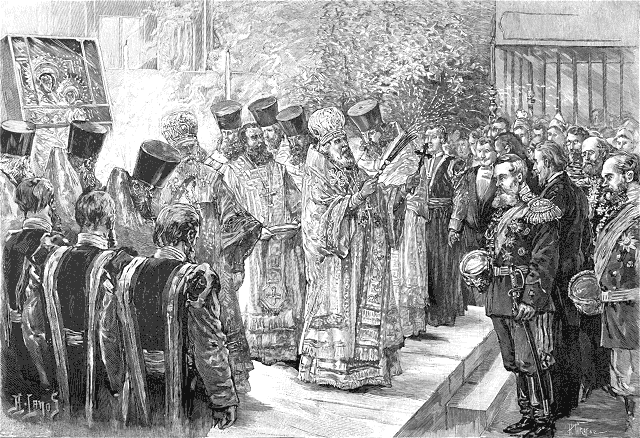
L'EXPOSITION FRANÇAISE DE MOSCOU.--Inauguration de
l'exposition par le clergé orthodoxe grec bénissant la galerie
d'honneur.
Dessin d'après nature de M. Lanos, envoyé spécial de
«l'Illustration».
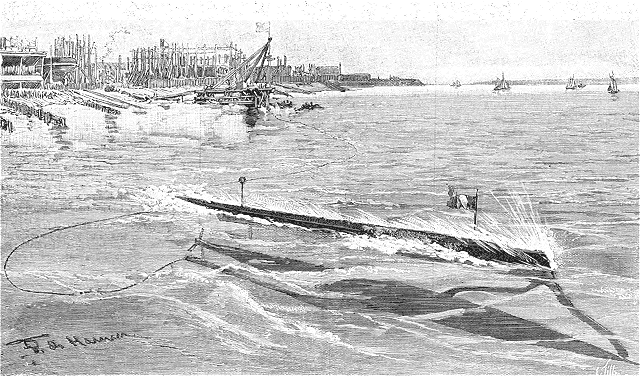
LA TORPILLE DIRIGEABLE.--La torpille en marche.
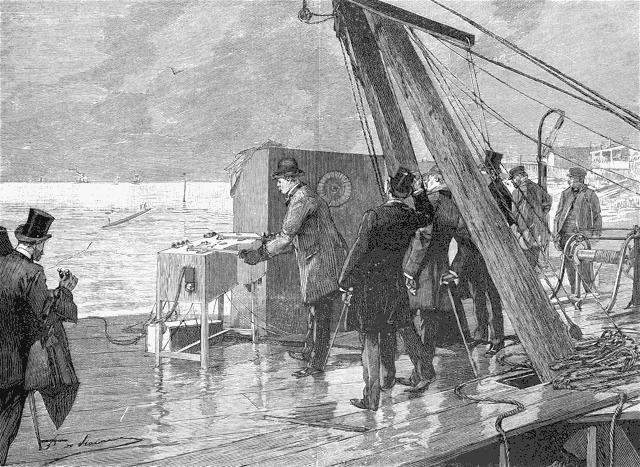
LA TORPILLE DIRIGEABLE.--L'opérateur dirigeant, de terre,
la marche de la torpille. Dessins d'après nature de notre envoyé
spécial, M. de Hænen.
Comme on le voit, la Grèce est le pays parlementaire par excellence, et son Parlement ne manque pas de bons orateurs.
Quelques mots sur les deux personnages les plus en vue: M. Charilaos Tricoupis, et le chef de l'opposition, M. Théodore Delyanni.
M. Charilaos Tricoupis, fils de Spiridion Tricoupis, le célèbre historien de la guerre de l'indépendance hellénique, est un homme de 58 ans environ; il a fait ses études à Athènes et à Paris. Après avoir été secrétaire de la légation de Grèce à Londres, il revint en 1862 dans son pays, et depuis 1865 il n'a cessé de prendre une part active à la politique. Il a été deux fois ministre des affaires étrangères, en 1807 et en 1877; il été déjà trois fois président du conseil, en 1875, 1880 et 1882. Il représente donc avec une autorité incontestée le gouvernement.
C'est d'ailleurs un homme d'une rare intelligence et d'une activité surprenante; ses adversaires eux-mêmes lui reconnaissent les plus grandes qualités. Le long séjour qu'il a fait en Angleterre a beaucoup influé sur son caractère, ses mœurs, son langage et même son accent. Ce ministre grec, très grand, très brun, a l'air d'un gentleman. Comme orateur, il a la voix forte et vibrante, l'argumentation serrée; mais son éloquence est plutôt sèche et manque de gestes. Le seul point faible de M. Tricoupis est de ne pas être économiste: c'est une science qu'il n'a pas approfondie, et, chaque fois qu'il arrive au pouvoir, il propose des lois nouvelles qui bouleversent le système fiscal et économique du pays. Malgré cela, il reste un adversaire redoutable, aussi bien sur le terrain parlementaire que sur le terrain politique.
M. Théodore Delyanni, le chef de l'opposition, fait un contraste frappant avec M. Tricoupis. Son premier mérite est d'être un enfant du pays, qu'il a étudié et connaît à fond. C'est aujourd'hui un homme de soixante-trois ans; il les porte d'ailleurs vaillamment. Après avoir étudié le droit à l'université d'Athènes, il entra tout jeune au ministère de l'intérieur où il resta jusqu'en 1862, montant toujours en grade. A cette époque, il était secrétaire général. En 1860, il avait été envoyé à Paris, avec mission d'étudier le service de l'administration générale et de l'administration municipale, le régime pénal et les établissements de bienfaisance qui dépendent de l'Assistance publique. De retour en Grèce, il fut envoyé à l'Assemblée nationale qui fut convoquée après la destitution du roi Othon, et là, il se distingua par son éloquence et ses connaissances sur le droit constitutionnel et le régime parlementaire. Il fit partie de la commission qu'élabora la constitution actuelle de la Grèce. En 1866, il avait déjà été nommé quatre fois ministre des affaires étrangères, conseiller d'État et ministre de Grèce à Paris. Après 1869, il fut nommé tour à tour ministre des finances, des cultes, de l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice et de la guerre. En 1878, alors qu'il était ministre des affaires étrangères, il représenta la Grèce au congrès de Berlin. Après la mort de Coumoundouros, il fut reconnu comme le chef autorisé de l'opposition, et lorsqu'en 1885 le roi le chargea de former le cabinet, il déploya la plus grande activité pour mettre la Grèce en état de soutenir avec la Turquie une lutte qui paraissait alors inévitable. M. Delyanni est un orateur accompli, et le type du vrai parlementaire. Son langage et sa conduite sont également modérés, et, plusieurs fois même, il a conseillé à ses partisans la même modération. Il n'a pas la raideur de M. Tricoupis, il se montre toujours affable envers tout le monde.
*
* *
Nous avons fait un portrait rapide des deux leaders du parlementarisme grec; mais, à côté d'eux, figurent quelques personnages d'une haute valeur, entre autres M. Simopoulos, ami intime de M. Tricoupis, économiste distingué. C'est un homme d'une grande méthode, et un orateur dont les discours gagnent plus à être lus qu'à être entendus.
Parmi les bons orateurs, il faut citer MM. Ralli et Hazzopoulos, dont les discours sont toujours empreints d'une réelle érudition et d'un esprit véritable.
D'autres députés ont, pour ainsi dire, des spécialités reconnues. Ainsi M. Carapanos est une autorité consultée dans les questions relatives à la Turquie qu'il connaît très bien, étant resté longtemps à Constantinople, où il a fait sa fortune. M. Typaldos Cozakis jouit d'une grande compétence pour la politique extérieure: il a été d'ailleurs longtemps secrétaire général au ministère des affaires étrangères, tandis que les questions économiques et fiscales sont plutôt du ressort de M. Sotiropoulos qui fut plusieurs fois ministre des finances.
Enfin, il faut citer un homme jeune encore, et qui n'a peut-être pas pour le moment assez de sang-froid, mais qui plus tard sera un orateur de premier ordre. Au surplus, il a de qui tenir, c'est le fils d'Alexandre Coumoundouros, l'éminent homme d'État, mort il y a quelques années.
*
* *
En Grèce, il n'y a pas de partis politiques à proprement parler: il n'y a ni royalistes, ni impérialistes, ni conservateurs, ni républicains, ni socialistes, ni anarchistes. Les diverses nuances politiques ou même sociales qui différencient les partis en France et dans les autres pays sont à peu près inconnues en Grèce ou, du moins, n'ont pas de partisans officiels et déclarés. Tous les Grecs sont plus ou moins républicains, démocrates même, et en cela ils sont bien les descendants des anciens Grecs; seulement, ils savent concilier leurs tendances et leurs opinions avec l'existence d'un roi, d'une cour, et ils n'ont jamais songé à y substituer un gouvernement républicain. Ce sont donc, en quelque sorte, des royalistes républicains; ils aiment leur souverain actuel, Georges 1er, plus encore leur reine Olga, et surtout le prince héritier Constantin. Il y a bien quelques républicains purs dans l'étendue du royaume, mais ils ne proclament pas ouvertement leur idéal politique.
Il n'y a pas longtemps, il y avait en Grèce cinq partis politiques, ayant chacun un chef; trois de ces chefs étant morts, personne n'osa recueillir leur succession, et il ne resta plus que MM. Tricoupis et Delyanni, qui groupèrent alors autour d'eux, le premier les gouvernementaux, le second ceux de l'opposition. C'est ainsi que la Grèce actuelle est aujourd'hui divisée en deux camps, les tricoupistes et les delyannistes, et, à la Chambre, les tricoupistes siègent à droite, et les delyannistes à gauche. Leurs opinions politiques sont à peu près les mêmes, mais elles diffèrent un peu dans leur application. Le parti de M. Tricoupis est un peu conservateur, tandis que le parti de M. Delyanni est plus libéral; mais cette distinction n'est qu'apparente, au fond, c'est la même chose, c'est la même eau teintée en deux couleurs.
M. Tricoupis est accusé par ses adversaires d'écouter trop les conseils de l'Angleterre et les recommandations de Berlin; M. Delyanni est considéré comme moins sensible aux influences étrangères, et on reconnaît que sa politique est plus nationale.
F. Artout.
LE PROLOGUE DE GRISÉLIDIS
Notre collaborateur Savigny nous raconte, dans une autre partie du journal, la jolie légende de Grisélidis, qui, transportée sur la scène par MM. Armand Silvestre et Eugène Morand, a obtenu, auprès du public lettré surtout, un succès du meilleur aloi. Nous sommes heureux de pouvoir donner à nos lecteurs, en entier, le prologue, qui constitue un des morceaux les mieux venus de la pièce et qui a été dit à la perfection par Mlle Ludwig.
Mesdames et Messieurs, salut!
La gloire de Dieu soit bénie!
Les clercs de cette ville, unis en compagnie,
Et qu'entre tous leur propre choix élut
Pour être dignes de vous plaire
Vont le tenter encor... Que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère
Si le conte est léger qui lui sera conté.
Ce n'est pas une tragédie,
Bien qu'il soit permis d'y pleurer.
Bien qu'on y doive rire, à tout considérer,
Ce n'est pas une comédie.
Non! C'est un conte en l'air fait pour les bonnes gens
Sans parti pris, au caprice indulgent,
Et qui, dans cet âge morose,
Las des chiffres et de la prose,
Éprouvent le désir d'aller sous les bois verts
Suivre, à la musique des vers,
Le vol du papillon ou l'âme de la rose!
Car, dans le cours obscur de nos jours incertains,
Par le sage l'heure est choisie
Qui fait planer nos cœurs plus haut que les destins
Sur l'aile de la Fantaisie!
Mais, d'ailleurs, ce n'est pas un conte tout à fait.
De la légende il vient comme l'histoire.
Bocace, après un autre, écrivit, en effet,
Cette aventure méritoire
D'une femme fidèle, et la chose est notoire.
Ils ne mentent pas plus que Pline ou que Strabon.
En fait de vérité, du grain fertile et bon
Qui saurait distinguer l'ivraie?
--L'histoire n'étant pas vraisemblable, elle est vraie!
On y parle de Dieu, du diable, et je sais bien
Que, dans ce temps rebelle aux mythes,
Tous les dieux sont défunts, tous les diables ermites!...
Mais il est quelquefois très doux d'être païen.
Dame Grisélidis était femme de bien.
Fantôme d'un passé charmant, elle s'avance
Sous le ciel doré de Provence
Comme sous un dais de soleil,
Blanche comme l'hostie en l'ostensoir vermeil.
Le mystère d'antan qui nous fut un modèle
S'appelait: Le Miroir de la Femme Fidèle.
Regardez-vous un peu, Mesdames, entre vous,
Et, l'une à l'autre, pour rassurer vos époux.
Servez-vous de miroir. Puis que chacune dise
A son mari, tout bas, sans vantardise:
--«Elle, non! mais moi, si!» Chacun sort enchanté!
Croyez bien cette vérité
Consolante, sinon très neuve:
La Foi seule nous sauve et mène au Paradis.
Et maintenant oyez quelle terrible épreuve
Subit, pour sa vertu, dame Grisélidis!
A. Silvestre et E. Morand.
NOTES ET IMPRESSIONS
Ce n'est pas la vérité qui persuada les hommes, ce sont ceux qui la disent.
Nicole.
*
* *
Quand on manque d'idées, on les remplace par des mots.
(Faust)
Goethe.
*
* *
Il faut à l'homme habitué à remplir la scène une grande force d'âme pour se résigner à ne plus jouer un rôle: il est plus facile de se suicider que de rentrer dans l'ombre.
Gustave Hagen.
*
* *
L'estime et le respect ne sont pas la même chose; on respecte les situations, on n'estime que les caractères.
Alex. Dumas fils.
*
* *
Ce qu'il y a de plus commun dans la politique, comme dans la vie, c'est la demi-sincérité.
G. Valbert.
*
* *
La jeunesse n'a pas assez souffert pour savoir consoler.
E. Legouvé.
*
* *
Les récentes causes célèbres nous révèlent que les grands crimes sont commis maintenant par de petites mains.
A. Claveau.
*
* *
Les pauvres qui ne sont point envieux ont toute la vertu qu'on peut exiger des hommes.
Armand Hayem.
*
* *
La vie a ses fruits secs comme tous les concours.
*
* *
On peut juger du mérite des gens par les critiques dont ils sont l'objet, et de leurs défauts par les éloges mêmes qu'ils reçoivent.
G.-M. Valtour.
HISTOIRE DE LA SEMAINE
La semaine parlementaire.--On a failli avoir à la Chambre une nouvelle discussion sur les événements de Fourmies. M. Chiché, député de Bordeaux, a déposé une demande d'interpellation sur l'application de la loi relativement à la répression des troubles qui ont éclaté dans la journée du 1er mai. M. Chiché, prenant au mot le gouvernement qui a repoussé l'amnistie en déclarant que la justice devait suivre son cours, réclamait cette justice égale pour tous: «De même, a-t-il dit, qu'on poursuit et qu'on poursuivra les manifestants qui ont injurié les agents de l'autorité, de même on doit poursuivre les agents du pouvoir qui ont commis un délit beaucoup plus grave, en ordonnant le feu sans avoir fait les trois sommations préalables et les roulements de tambour prescrits par la loi.»
Le gouvernement s'est refusé à discuter cette interpellation, en faisant valoir cet argument que ce serait rouvrir sur les événements de Fourmies un débat qui avait été clos par la Chambre elle-même. La majorité s'est rangée à cet avis, et l'interpellation a été renvoyée à un mois.
La discussion générale sur les tarifs douaniers s'est poursuivie et on pourra dire qu'elle a eu toute l'ampleur que commandait une question de cette importance. M. Raynal et M. Jamais ont, notamment, prononcé des discours qui ont fait grande impression sur la Chambre. Il faut convenir cependant que les théories de M. Méline ont obtenu un succès qui prouve que la majorité revient, malgré tout, aux principes protectionnistes.
Déclaration du président de la République sur la question ouvrière.--Au cours de son voyage à Limoges, où il a trouvé l'accueil sympathique auquel il est accoutumé, le président de la République a prononcé un discours d'une réelle importance, surtout si l'on tient compte de la réserve qu'il garde généralement en pareilles circonstances. Il s'agit de la question ouvrière et de l'armée, c'est-à-dire des deux choses qui passionnent à bon droit tout le pays. Après avoir annoncé divers projets de loi relatifs aux réformes sociales, le président de la République s'est exprimé ainsi:
«La République ne s'arrêtera pas dans cette voie de la réalisation des réformes pratiques et des progrès réfléchis qui doit être la peuvre d'un gouvernement d'opinion issu du vote populaire. Ce n'est pas de la violence plus ou moins désintéressée de quelques-uns que le pays peut attendre ces satisfactions désirées de tous. Ce n'est pas de la violation des lois et de la liberté du travail, sous un régime qui se recommande de la loi et de la liberté, c'est du concours de tous, sous l'égide de la République incontestée et pacifiée par la volonté du suffrage universel.
«A ce concours de tous, à ce dévouement universel pour les grands intérêts du pays, nous devons notre chère armée nationale, cette réelle école du devoir et du patriotisme. Nous lui devrons aussi l'amélioration progressive et efficace du sort des phalanges du travail, qu'on ne doit pas séparer de la masse de la nation, dont elles sont une des forces vives».
Ce discours a été salué d'applaudissements répétés.
Attentat contre le Tsarévitch.--On sait que le Tsarévitch accomplit en ce moment son tour du monde, qui semble former aujourd'hui le complément nécessaire de l'éducation d'un prince. Partout l'héritier de l'empereur de Russie a été l'objet de l'accueil le plus empressé et le plus sympathique. Cet accueil, il l'a trouvé au Japon comme ailleurs, car on doit considérer l'attentat dont il a failli être victime comme l'œuvre d'un fanatique isolé ou d'un fou.
Voici la version officielle donnée à Saint-Pétersbourg de cet événement:
Le 11 mai, pendant son voyage à Otsu, le Tsarévitch a été blessé à la tête d'un coup de sabre par un agent de police subalterne. Le malfaiteur tenta de porter un second coup au prince, mais il fut renversé d'un coup de bâton par le prince Georges de Grèce, qui accompagne le Tsarévitch dans son voyage. La blessure est légère et n'inspire pas d'inquiétude. Le prince a télégraphié aussitôt pour rassurer sur sa santé et il a annoncé qu'il continuerait son voyage sans modifier son itinéraire.
D'après une autre version, le meurtrier serait un de ces prêtres fanatiques qui considèrent comme un sacrilège la présence d'un étranger, quel qu'il soit, dans l'enceinte de leurs temples. Il ne faut pas oublier, en effet, que si, dans son ensemble, le peuple japonais se montre très ouvert à la civilisation occidentale, l'introduction dans ce pays de réformes qui ont réellement un caractère révolutionnaire et qui--c'est une exception à noter--sont accomplies par le gouvernement même, ne va pas sans soulever de violentes colères chez les partisans de l'ancien ordre de choses, et surtout chez les représentants de la religion nationale.
Le fanatisme de ces derniers est d'autant plus surexcité qu'il existe au Japon plusieurs stations de missionnaires russes qui font dans le pays une propagande très active en faveur de l'Église orthodoxe. Cette propagande réussit même d'une façon exceptionnelle, car le nombre des prosélytes orthodoxes a augmenté dans des proportions telles qu'une église a été construite pour eux à Tokyo. Elle est située sur une colline qui domine la ville et a été ouverte en avril dernier par Mgr Nikolaï, évêque russe. L'indignation des prêtres bouddhistes aurait été d'autant plus vive, que le service divin y est célébré en langue japonaise et que le bas clergé de la mission est recruté exclusivement parmi les prosélytes japonais.
Il n'est donc pas surprenant que parmi ces fanatiques il se soit trouvé un homme à l'esprit borné qui a cru faire acte méritoire en attentant à la vie de l'un des représentants les plus élevés de la civilisation européenne. Mais c'est là, il faut le répéter, un acte isolé et qui a soulevé au Japon l'indignation générale.
Il n'a servi en Europe, et surtout en France, qu'à montrer une fois de plus la sympathie dont jouit la famille impériale russe, et le président de la République, en exprimant aussitôt ses sentiments à l'empereur de Russie, n'a fait que traduire ceux de tous les Français.
L'agitation ouvrière.--En France, si les événements de Fourmies ont laissé une impression douloureuse, le calme s'est rétabli, du moins en apparence, et les suites de la journée du 1er mai n'ont pas été aussi graves qu'on aurait pu le craindre. Il en est de même dans la plupart des pays d'Europe, sauf en Belgique toutefois, où le mouvement socialiste se complique d'un mouvement politique.
Les grèves se sont généralisées dans ce pays, à Liège, à Charleroi notamment, où l'on a pu craindre des désordres sérieux. Auront-elles pour effet rétablissement, du suffrage universel? L'attitude du gouvernement ne le fait pas prévoir, bien qu'il semble résolu à faire quelques concessions sur ce point. Voici, en effet, la déclaration qu'a faite M. Beernaert à une séance du Sénat:
« Dans le discours du trône de 1886, il n'était pas question de la révision. Nous comptions encore à cette époque pouvoir opérer une large extension du droit électoral sans toucher à la constitution. Mais nous attirions l'attention de la législature sur certaines réformes d'ordre social à effectuer, ainsi que sur la nécessité d'améliorer le service personnel. Beaucoup de réformes sociales ont été votées déjà.
« Quant à une large extension du droit de suffrage, elle semble désormais assurée par la révision de la constitution, et elle le serait plus sûrement si des hommes de désordre ne semblaient s'attacher à l'entraver en prétendant la hâter par des moyens illégaux ou incorrects.»
On voit que le mot de suffrage universel n'est pas prononcé. Il sera intéressant de voir quel résultat auront eu, sur ce point, les moyens illégaux ou incorrects dont parle le ministre belge.
On ne peut abandonner cette question des grèves sans parler de la démonstration à laquelle se sont livrés un certain nombre de socialistes français, non qu'elle ait eu une grande importance au point de vue pratique, mais parce qu'elle répond au principe d'internationalisme qui tend à dominer dans le mouvement ouvrier.
Treize députés socialistes, parmi lesquels figurent MM. Basly, Baudin, Antide Boyer, etc., ont adressé aux mineurs français une consultation sur ce qu'ils doivent faire pour venir en aide à leurs frères de Belgique, «en lutte ouverte contre le capitalisme qui les exploite socialement et politiquement». Les signataires de ce document invitent les mineurs français à régler la production de la houille et à la limiter strictement aux besoins de l'industrie française. Cette décision, disent-ils, a été prise dans le Pas-de-Calais, et elle s'impose d'une façon générale à tous les mineurs.
On ne voit pas bien quelle peut être la portée d'une pareille consigne, et surtout comment elle pourrait être exécutée. On sait, en effet, qu'en France la production de la houille est inférieure à la consommation. En ce qui concerne spécialement la Belgique, il est notoire que nous sommes importateurs et non exportateurs de charbon. Enfin, au moyen de quelle enquête les ouvriers pourraient-ils fixer la quantité exacte de combustible nécessaire à notre industrie, alors que les hommes les plus compétents dans cette matière en sont réduits eux-mêmes à s'en tenir à des données assez vagues? Le manifeste des socialistes français restera donc forcément à l'état de lettre morte, de démonstration platonique; il n'a d'intérêt, comme nous l'avons dit, qu'à raison de son caractère de solidarité internationale.
La crise portugaise.--Le Portugal traverse une crise sérieuse, grave même, car elle porte à la fois sur sa situation intérieure, extérieure et financière. Les difficultés au milieu desquelles se débat ce vaillant petit peuple remontent assez loin, puisqu'elles ont pour origine le conflit né avec l'Angleterre à l'occasion de ses possessions africaines. Il est évident que le Portugal n'a pu soutenir cette lutte avec son puissant adversaire sans faire de grands sacrifices d'argent, et il est encore obligé d'en dépenser beaucoup pour se tenir prêt à tout événement. Non qu'il y ait lieu d'envisager une guerre ouverte entre les deux peuples; elle est à peu près impossible. Mais la nécessité seule de se maintenir avec honneur sur les territoires qu'il occupe en Afrique constitue pour le Portugal une lourde charge, que sa situation économique ne lui permet pas de supporter facilement. Or, si les plaies d'argent ne sont pas mortelles pour les individus--suivant un proverbe qui n'est pas toujours exact--elles sont toujours la cause de complications sérieuses pour les gouvernements, et il n'est pas surprenant que la crise financière ait eu pour conséquence en Portugal une crise intérieure.
Il est vrai que le gouvernement portugais jouit de quelques jours de répit. La trêve conclue avec l'Angleterre sous le nom de modus vivendi, et qui expirait le 11 mai, a été prorogée pour un mois. C'est un renouvellement d'échéance, mais à bref délai, et le jour n'est pas loin où il faudra s'exécuter, c'est-à-dire accepter les dernières propositions de Lord Salisbury.
D'après le Times, voici en quoi consisteraient ces propositions.
Une grande concession de 80,000 kilomètres carrés est faite au Portugal, au Nord du Zambèze. Une ligne partant de la rivière Ruo prend la direction du nord-ouest jusqu'à la rivière Loangoué et va jusqu'à Zumbo.
Au sud du Zambèze, la démarcation est à peu près la même que l'ancienne. La ligne tourne subitement à quelques kilomètres à l'est du Zumbo, se dirige vers le sud-est et touche Mazoë, sur le 32° degré et demi de longitude.
Quant au Massikessé, il en est accordé une petite parcelle au Portugal sur le plateau. C'est là que les fonctionnaires portugais pourront aller chercher un refuge contre le climat malsain des plaines.
En somme, les conditions imposées par le cabinet de Londres sont très rigoureuses. Les Portugais seront obligés d'abandonner le territoire aurifère que les agents de la Compagnie anglaise sud-africaine ont récemment envahi par la force, au mépris des termes mêmes de l'arrangement provisoire. Il est vrai que les propositions nouvelles parlent d'une compensation. Mais cette compensation n'est qu'apparente, puisque l'Angleterre donne un pays inconnu et peu accessible en échange d'une région explorée et qui passe pour riche en placers.
On assure que le gouvernement portugais, acculé par la nécessité, serait disposé à accepter la loi du plus fort, mais il s'agit de savoir si le parlement prendra la responsabilité de consacrer le nouveau traité, et, en cas de vote favorable des Cortès, si le peuple, qui a déjà donné des marques de sa susceptibilité patriotique, acceptera sans mot dire la convention passée entre les deux gouvernements. Évidemment le gouvernement conservateur de l'Angleterre craint l'intervention de ce dernier facteur, car sans cela il est bien certain que la ruine coloniale du Portugal serait consommée depuis longtemps.
Dans tous les cas, le cabinet qui a conduit jusqu'ici les négociations à Lisbonne depuis l'établissement du modus vivendi, subissant une loi souvent injuste, mais fatale, porte le poids de l'impopularité que lui vaut l'échec auquel il a abouti. Il a été obligé de se retirer, et de céder la place à des hommes nouveaux, qui auront la maigre ressource de dire qu'ils se trouvent en présence de faits accomplis. Il faut plaindre plutôt qu'envier ceux qui prennent, dans de pareilles conditions, le «fardeau du pouvoir», car ici cette expression, dont abusent si volontiers ceux pour qui le pouvoir est une source de jouissances infinies, est parfaitement à sa place.
Nécrologie.--M. Deck, céramiste, administrateur de la manufacture de Sèvres.
M. Maurice Engelhard, ancien président du conseil municipal et du conseil général de la Seine.
M. Amédée Marteau, économiste.
M. Louis Mouchot, artiste peintre.
M. Eugène Ortolan, ministre plénipotentiaire, fils du célèbre jurisconsulte.
M. Jean Bratiano, homme d'État de Roumanie.
Mgr Sebaux, évêque d'Angoulème.
Mme de Terray, comtesse de Sesmaisons, mère du général de Sesmaisons.
Mme Bozerian, femme du sénateur de Loir-et-Cher.
M. Colfavru, ancien député.
LE VOYAGE DU TSAREVITCH
Le lecteur trouvera dans l'Histoire de la Semaine les détails de l'attentat dont a été victime le tsarévitch à Otsu.
Otsu est le chef-lieu du département ou Kén de Shiga, dans la province d'Omi, une des plus importantes de la grande île de Hondo où se trouve la capitale de l'empire, Tokyo.
Sise au bord du lac Biwa, Otsu est célèbre par ses temples et les nombreux souvenirs qui se rattachent à l'ancien Japon féodal.
L'attentat où le tsarévitch a failli trouver la mort est un triste épisode de ce voyage qu'il a fait à bord du Pamyat-Azowa et au cours duquel il a recueilli partout sur son passage des marques de la plus respectueuse sympathie.
Son arrivée, le 28 mars, à Saigon, dans notre belle colonie de la Cochinchine, a été tout particulièrement l'occasion de ces manifestations; rien n'a été négligé pour donner à sa réception et à son court séjour un merveilleux éclat.

LE TSAREVITCH
Voici quelques vues représentant les principaux épisodes des trois journées que le prince y a passées.
C'est d'abord l'escadre russe mouillée dans le fleuve en face de la ville. A gauche, au fond, le Pamyat-Azowa accosté aux appontements; puis le Wladimir-Monomach, le Koraieff, le Mandjour, qu'entourent au premier plan comme pour leur faire une garde d'honneur, la Loire, la Caronade et l'Alouette.
Le jour même de son arrivée, à 5 heures du soir, le prince, après avoir reçu à bord du Pamyat-Azowa les visites des autorités de la colonie, débarque à son tour pour se rendre au palais du gouvernement où un grand dîner est donné en son honneur. Le cortège passe à travers une double haie de troupes et au milieu d'une foule immense sous l'arc de triomphe splendide que l'on voit élevé sur la place Rigault de Genouilly, hommage de la population saïgonnaise au tsarévitch.
Le lendemain, une grande revue avait lieu sur le boulevard Charner. Notre gravure représente la tribune officielle. Au milieu le tsarévitch; à sa droite, M. Piquet, gouverneur de la Cochinchine; à sa gauche, le prince Georges de Grèce; devant la tribune, le 11e régiment d'infanterie de marine rend les honneurs, pendant que défilent successivement les compagnies de débarquement de l'escadre, les tirailleurs annamites et une batterie d'artillerie.
Le troisième jour, enfin, avait lieu le bal sur le vaisseau la Loire, dernière et merveilleuse fête offerte au prince. Le pont avait été magnifiquement aménagé, et, avec ses trophées d'armes se détachant sur les massifs de verdure, formait une salle de bal admirable.
Le lendemain, le tsarévitch partait, non sans avoir témoigné à plusieurs reprises sa satisfaction, et emportait de cette terre française un souvenir qu'il gardera et des preuves non équivoques de la profonde et respectueuse sympathie de tous.
L'héritier de Russie est, comme nous le montre notre gravure, un jeune homme à la figure fine et intelligente. Voici très exactement ses noms et ses titres: Nicolas-Alexandrovitch, tsarévitch, grand-duc héritier, né à Saint-Pétersbourg le 18/6 mai 1808, ataman de toutes les troupes cosaques, capitaine en second au régiment Preobajensky de la garde, chef du régiment de la garde de Volnie, du régiment d'infanterie de Moscou n° 65 et du 81e régiment d'infanterie de Schirvan.
Nicolas-Alexandrovitch est l'aîné des cinq enfants de la couronne de Russie.
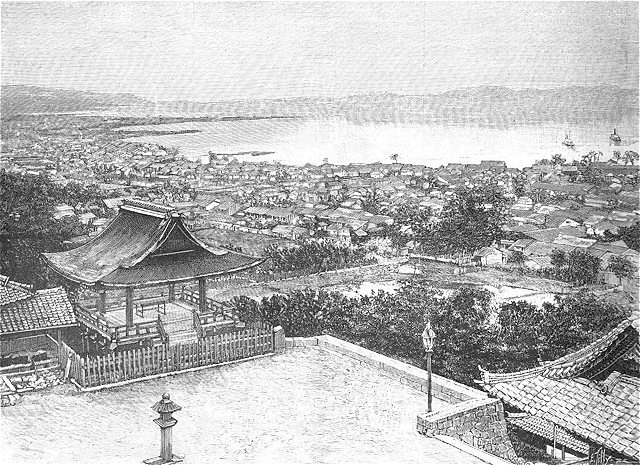
LE VOYAGE DU TSAREVITCH.--Vue de la ville d'Otsu, où a eu
lieu l'attentat contre le Tsarévitch, D'après une photographie de
l'album
de M. Léon de Tinseau, reproduite par Nadar.
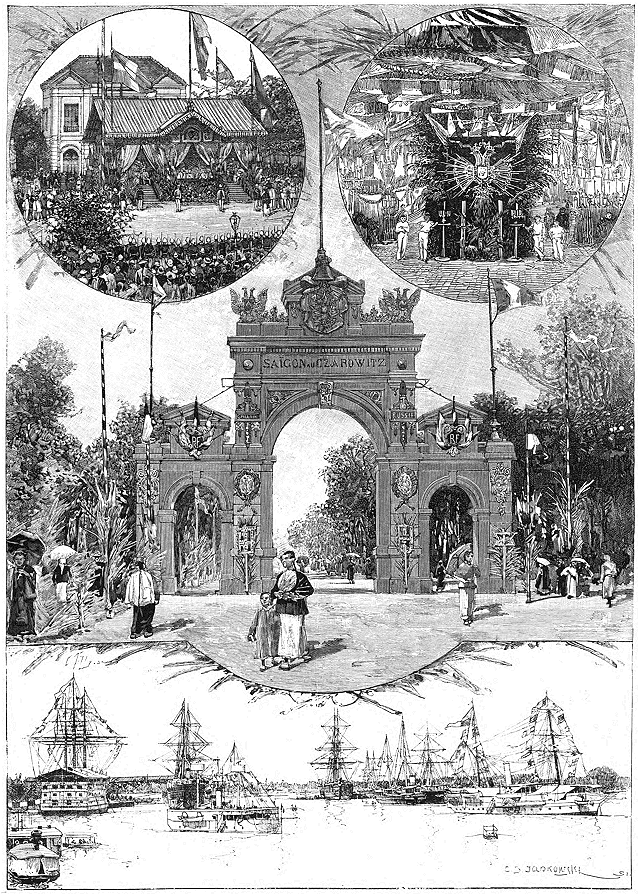
LE VOYAGE DU TSAREVITCH.--Fêtes données en l'honneur de
Son Altesse à Saïgon. 1. Pendant la revue: la tribune officielle.--2. La
salle de bal de «la Loire».--3. L'arc de triomphe de la place
Rigault-de-Genouilly.--4. L'escadre russe dans le port de Saigon,
D'après des photographies de M Talbot, de Saigon, communiquées à
«l'Illustration» par M. Léon de Tinseau.
LES BUREAUX DE PLACEMENT

Fantaisiste.
1re Dame.--Vous n'avez pas idée, ma bonne madame ma chère, de ce que cette fille buvait, j'ai dû la mettre à la porte immédiatement et je vais de ce pas au bureau de placement pour en avoir une autre.
2e Dame.--Tout comme moi, chère amie, imaginez-vous que... (elle lui parle bas à l'oreille).
1re Dame, (l'air stupéfait et scandalisé).--Que me faites-vous l'honneur de me dire?
2e Dame.--C'est comme cela; et vous comprenez que je ne fais qu'un saut au bureau de placement.
Tel est le dialogue qui se reproduit cent fois par jour à Paris, où deux mille bureaux de placement s'occupent de réappareiller maîtres et domestiques, dans un perpétuel va-et-vient ménager.
Le bureau de placement! Qui de vous, lecteur, ne passe à chaque instant, et sans y faire attention certainement, devant une plaque en tôle peinte en rouge, fixée au coin de l'entrée d'une maison, et sur laquelle sont collées de minuscules bandes de papier blanc, tranchant sur la couleur crue du fond et remplies de gribouillage: offres et demandes d'emplois, avec le mot: Agence, maison de confiance, en plus gros caractères au-dessus?
C'est là le bureau de placement, l'intermédiaire obligé entre le tyran et l'esclave à la recherche l'un de l'autre.
Pas banal du tout, le bureau de placement pour qui l'étudie. Boutique, bureau ou salon, suivant la caste qui y trafique, c'est l'endroit où se dévoilent, criés ou potinés, babillés ou sussurés, tous les secrets des ménages, tous les dessous de la vie d'intérieur; où les faiblesses de madame, les petits côtés de monsieur, sont épluchés, commentés, grossis, parmi un bruit de voix traînantes, monotones, et dans un relent légèrement graillonneux de parfumerie frelatée.
En voici un que notre dessin nous montre; entrons-y tout de suite, et examinons. Nous sommes dans le quartier des Halles. Dans une ruelle; au fond, la plaque traditionnelle, avec une main indicatrice, l'index tendu: L'Agence est au second. Escalier sombre, jour gris; au second, une porte au loquet noirci par des générations de doigts gras. Poussons-la. Un brouhaha de conversation s'arrête brusquement, et un flot de têtes curieuses s'avancent, le cou tendu, pour regarder le visiteur.
L'intérieur est crépi à la chaux, un banc de bois court le long du mur, sur lequel de larges traînées grises montrent les places des dos qui s'y sont appuyés.
D'un coup d'œil nous pouvons tout embrasser. Elles sont là, les filles sans place, attendant leur tour d'inscription; et c'est, dans le demi-jour triste et gris de la pièce, une alignée de têtes en cheveux, aux figures balourdes ou chafouines, rougeaudes ou blêmes, aux yeux battus, sortant, blanchies par la poudre de riz douteuse, d'un linge plus douteux encore.
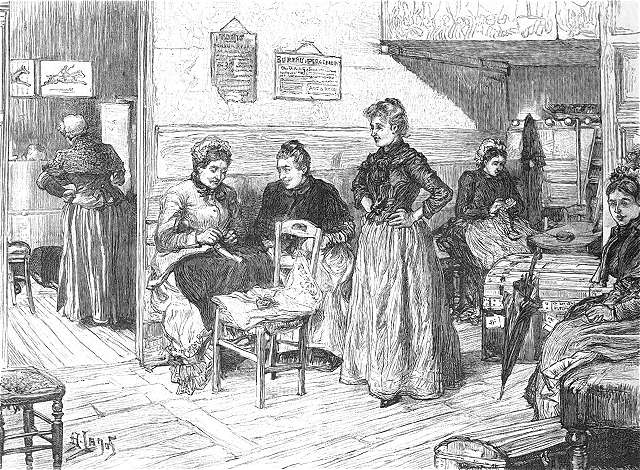
Un bureau populaire (quartier des Halles).
En terme de métier, c'est ce qu'on appelle la viande, attendant l'acheteuse où l'acheteur, et dans les murmures des conversations reprises, dans les piétinées impatientes, les respirations anxieuses sifflent, les cous se dressent, les échines se tendent dans la direction du fond, où, derrière un bureau boiteux, le patron, dont on n'aperçoit que le crâne chauve qui brille, la tête penchée sur son registre visé par la police, va les inscrire tour à tour.
L'ensemble est sale et triste parmi le désordre des malles traînant dans la chambre, et les affaires n'ont pas l'air d'aller toutes seules. Nous sommes, en effet, ici dans les bas-fonds de la profession.
*
* *
Hier encore bookmaker, ainsi que l'indiquent les gravures de courses clouées au mur, au-dessus de son bureau, le patron a quitté son métier devenu improductif et, à la hâte, a transformé son usine à paris en agence, où, en désespoir de cause, sont venues s'échouer toutes les épluchures du panier: filles de campagne épaisses, ne sachant ni lire ni écrire, servantes de brasseries ou d'estaminets, au nez en trompette, aux cheveux ébouriffés, dorés encore par place sous un restant de teinture, toutes filles enfin d'un placement improbable, difficile, dont la profession des maîtres qu'elles quittent ou qu'elles recherchent se reconnaît aux certificats faits avec des encres, des écritures et des orthographes fantaisistes, en des libellés prétentieux, qu'elles présentent, déchirés et graisseux, pliés ensemble dans un morceau de journal.
*
* *
Sortons vite, et continuons notre étude, mais dans un milieu plus relevé. Notre dessin nous montre, comme contraste, l'intérieur d'un bureau de placement mondain.
Ici, c'est tout différent. Nous sommes dans la rue Saint-Honoré, dans une maison d'apparence bourgeoise et propre dont la devise, on le sent dès l'entrée, est: silence et discrétion.
D'abord, pas de domestiques qui attendent dans l'antichambre; à peine une ou deux ombres aux profils discrètement perdus, et c'est tout.
Le bureau lui-même est dans un salon bourgeois, une sorte d'intérieur de vieille fille. La directrice et sa secrétaire, assises devant une table, causent à voix basse de leurs petites affaires dans le silence, interrompu seulement par le grincement des plumes de deux employées qui écrivent, le tic-tac de la pendule, et le bruit lointain d'un orgue de l'Oratoire, dont le massif de pierre se montre par la baie de la fenêtre du fond.
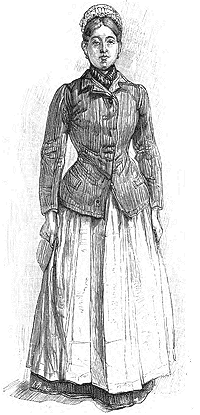
Classique
Écoutons-les causer et nous allons connaître le tout-Paris des gens de maison.
Eh bien, là aussi, il paraît que les affaires ne vont pas très bien et nous entendons des plaintes au sujet de la noblesse, de la bourgeoisie et du petit commerce, les trois genres de clientèles de la maison. La noblesse d'abord: pour l'antichambre il y a deux sortes de noblesse: la noblesse impériale et la noblesse légitimiste.
En ce qui concerne la première, souvenirs et regrets; et quels regrets! car c'était elle qui menait tout le train, d'un luxe fou. On avait alors au moins dix domestiques dans une maison: un maître-d'hôtel, quatre valets de pied, une première, une deuxième et une troisième femme de chambre, un chef de cuisine enfin avec son aide; ce personnel, sauf le cocher qui se plaçait par l'intermédiaire du carrossier, était du ressort du bureau de placement, à raison de 5% de remise sur les appointements de l'année. Et cela allait et venait sans cesse, des familles entières arrivant, attirées par les fêtes de la cour, se montant une maison complète pour quelques mois seulement et payant sans compter et sans marchander.
Tout cela a disparu emporté par la tourmente, tarissant ainsi la source des gros profits. Il n'est pas aujourd'hui jusqu'aux ambassades qui n'aient en grande partie supprimé leurs livrées.
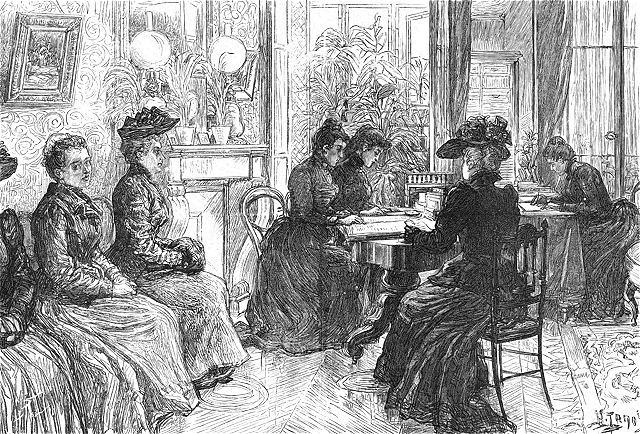
Un bureau mondain (quartier Saint-Honoré).
Quant à nos gouvernants actuels, ils sont presque tous en location. Bref, il ne reste plus que la noblesse légitimiste, bien diminuée, paraît-il, aussi. Il y a à peine sept à huit grandes familles montées et qui reçoivent encore, le reste passe la plus notable partie de l'année en voyage, à Nice, Cannes, Londres, ou dans des terres qui ne rapportent presque plus rien, mais qui, en revanche, prennent souvent le bénéfice du placeur.
C'est de sa terre, en effet, ou du village à côté, que la comtesse ramène sa domestique, fille du fermier, du garde-chasse du bon vieux temps, en retraite aujourd'hui.
La comtesse l'a vue naître, quelquefois même l'a tenue sur les fonts baptismaux; elle s'est attachée à l'enfant des champs qui, de son côté, a pour elle une affection presque filiale faite de respect et d'amitié. Le père l'a sans crainte confiée, comme elle a, sans hésiter, suivi celle qu'elle regarde comme sa maîtresse née.
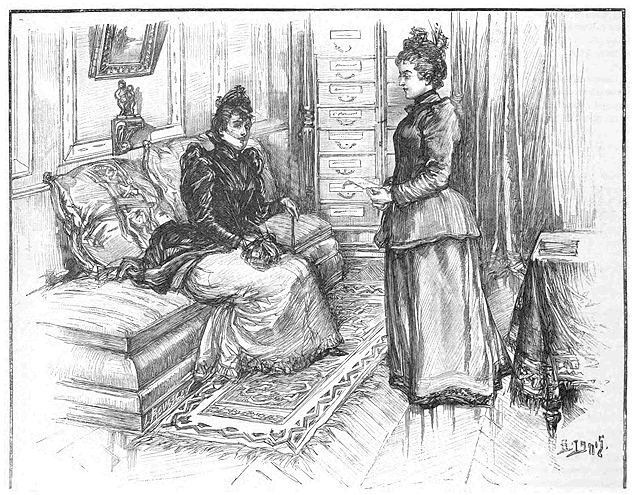
Trop jolie.

Le ménage que l'on ne sépare pas.
Toute la noblesse, cela se comprend, ne prend pas ses filles de service à la campagne, et à cette clientèle spéciale du bureau de placement correspond un personnel spécial aussi, dont nos dessins vont nous montrer les types.
Le type classique d'abord. Regardez-la, c'est la vraie domestique à la figure froide, d'une distinction un peu fruste avec ses bandeaux plats à la vierge sous le bonnet blanc. Droite, les mains dans le rang, écoutant l'ordre donné sans regarder le maître, taillée plate, à la hache, dans des vêtements noirs serrés. Admirablement dressée et stylée, elle reste dans le faubourg, quoique moins payée peut-être, parce que la maison est sûre, les maîtres bons, le travail peu fatigant; qu'elle y est en contact avec des domestiques de son rang et qu'enfin elle s'y perfectionne encore sous la direction d'un maître d'hôtel hors de pair.
La première question qu'on lui a posée, avant même de l'inscrire au bureau de placement, est: «Êtes-vous catholique? Vous savez, dans la maison où vous allez, maigre et la messe?» Elle le sait et elle est catholique; française, s'il n'y a pas d'enfants dans la maison; allemande, s'il y en a: nous verrons tout à l'heure pourquoi.
Nous en avons fini avec le premier genre de clientèle, maîtres et domestiques, du bureau de placement mondain: passons au second.
Nous avons affaire à la bourgeoisie domiciliée aux Champs-Elysées et au parc Monceau. Elle se compose de gros banquiers, en général israélites, de médecins ou d'avocats célèbres, de demi-mondaines ou d'actrices en renom. Moins de sévérité, de grandeur et de tenue dans la maison; luxe solide, mais plus criard: nous trouvons ici le groom, et la domestique qui a suivi toute la filière: bonne à tout faire d'abord, puis petite cuisinière avec deux à trois domestiques seulement, enfin cuisinière de cercle, pendant un temps plus ou moins long, pour finir cordon bleu chez le gros bourgeois.
Cette catégorie de domestiques ne va pas en général de l'autre côté de l'eau, et réciproquement. Elle change plus souvent de maison, et, quoique plus payée, tient moins à ses maîtres qui tiennent aussi moins à elle.
On trouve là, à côté de la fille qui exige ses soirées libres, la maîtresse qui ne la veut pas trop grande, parce que ses plafonds sont bas; qui la demande maigre, parce que l'escalier de service est étroit; blonde, parce qu'elle est brune; celle enfin qui, comme le représente le dessin ci-dessus, la refuse malgré les excellents certificats qu'elle lui tend, parce qu'elle est... trop jolie. Dame! elle a deux fils qui viennent de sortir du lycée, et puis son mari... N'insistons pas.
C'est dans ce milieu aussi que se rencontre et se recrute le couple qu'on ne sépare pas.
Regardez-les, côte à côte, lui petit, étriqué et maigrichon, la figure légèrement couperosée, le regard fuyant et faux, les joues ornées de favoris en côtelettes, grisonnants. Tout de noir habillé, avec un pardessus gris passé, le chapeau melon à la main, il a l'air obséquieux et béat. Elle, par contre, grosse et forte, sorte de virago mafflue. Les deux extrêmes se sont réunis, pis encore, mariés, pour fondre diverses qualités ou plutôt divers défauts en un tout pratique. Ils ne se séparent jamais, et entrent ensemble dans la maison où peu à peu ils seront les maîtres, voleront discrètement et d'où ils se retireront après fortune faite.
( A suivre.)
Hacks.
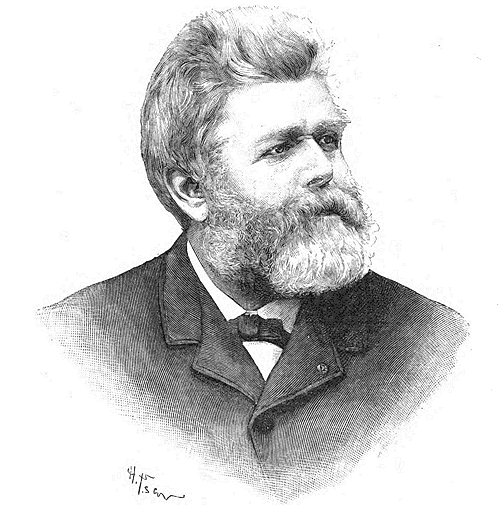
M. DECK Directeur de la manufacture de Sèvres, récemment
décédé.--Phot. Fritz Luckhardt.

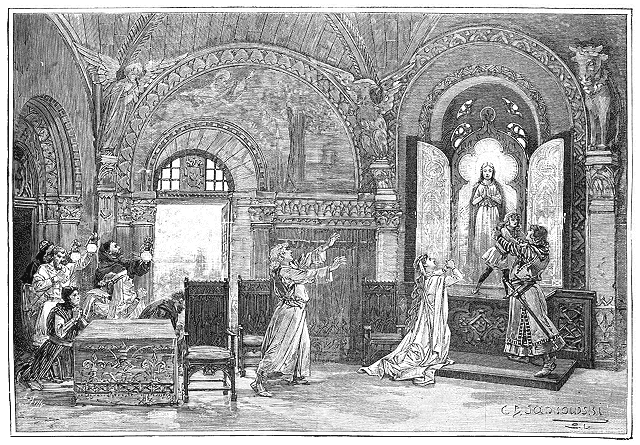
COMÉDIE-FRANÇAISE.--«Grisélidis», mystère en trois actes,
de MM. Armand Silvestre et Eugène Morand. L'oratoire de Grisélidis:
Grisélidis (Mme Bartet) et le marquis de Saluces (M. Sylvain) retrouvant
Loys.
Comédie-Française: Grisélidis, mystère en trois actes et en vers libres, par MM. Armand Silvestre et Eugène Morand.
Vous connaissez le fabliau de Grisélidis: Boccace vous l'a raconté à sa façon; Perrault à sienne. M. Armand Silvestre vous le dit à sa manière. Histoires des temps passés, vous ne retrouverez plus la naïveté avec laquelle vous avez été contées pour la première fois, parce que vous ne rencontreriez plus la simplicité des esprits qui vous écoutaient; mais tout ce que le charme, la grâce et la poésie peuvent donner à un récit des anciens jours sera mis à vos ordres, de telle sorte que vous trouverez encore des auditeurs pour vous applaudir!
Il y avait donc un marquis de Saluces qui, en se promenant dans ses domaines, rencontra une pastourelle qui avait nom Grisélidis. La jeune fille était si vertueuse et si belle qu'il l'épousa; elle lui donna un fils qui avait nom Loys, et, comme la guerre l'appelait à la Croisade, il partit contre les mécréants de Tunis et des pays d'Afrique. Voilà ce que vous apprennent les serviteurs du marquis dans cette salle de son château féodal assis sur le bord de la mer. Très curieuse cette salle avec sa fresque représentant Ève tentée par le serpent; avec son autel en bois surmonté d'un tryptique, et, au milieu, la statue de sainte Agnès la patronne se détachant dans sa niche. La servante Bertrade est à son rouet et psalmodie sa chanson pieuse. L'homme d'armes qui entre est le vieux Gondebaud que suit le hérault du marquis et qui vient inviter son maître à se préparer au départ. Il arrive, le marquis, tout à son Dieu, tout à son roi, mais bien marri de quitter son enfant et sa femme. D'autant plus que le prieur, loin de le réconforter, lui dit des paroles de découragement et de désespérance. Grisélidis est bien pure, Grisélidis est bien chaste, mais elle est femme et le diable est bien fin. Rien n'atteint le marquis dans sa confiance dans sa femme. Quant au diable, il n'y croit guère et il suffirait de la pureté de Grisélidis pour le mettre en déroute, si toutefois le démon tentait la lutte avec l'ange.
Voilà un propos bien fait pour piquer l'amour-propre du diable, lequel sort de la base de l'autel de Sainte-Agnès, qui lui sert de cachette. Pauvre diable qui, lui aussi, a ses misères. Il est marié, et sa femme le fait enrager. Le marquis de Saluces n'est pas peu étonné de se trouver face à face avec le démon qui le voyant incrédule lui propose une gageure. Il parie que pendant l'absence de son époux il mènera la marquise à mal, et le marquis, sûr de sa femme, parie avec le démon; il lui donne même son anneau pour gage. Nous allons, dès maintenant, assister au combat préparé par le diable contre la vertu de Grisélidis et suivre les fourberies du Malin qui égayent cette histoire.
Il faut avouer qu'il n'est pas des plus ingénieux, ce diable, et qu'il n'a guère dans son sac que les tours depuis longtemps en usage dans sa famille. Le premier serment de la marquise envers son époux, c'était l'obéissance.
Avec le concours de sa femme Fiammina, le diable se fait fort d'avoir raison de Grisélidis, sur ce point. Le voilà, il est déguisé en marchand d'esclaves; il revient du Levant où il a vu, dit-il, le marquis, lequel lui a acheté cette belle personne que le diable présente à Grisélidis et qui par l'ordre du maître devient la maîtresse au château. Il faut que la marquise se démette; ainsi le veut le marquis, et, pour prouver ses pouvoirs d'ambassadeur, le marchand montre à la marquise l'anneau du marquis. Grisélidis a le cœur déchiré, mais elle obéit; elle donne tous ses bijoux à cette belle esclave qui n'est autre que la femme du diable, qui a prêté son appui à son mari pour cette aventure; Grisélidis l'invite à commander désormais. Le diable en est donc pour sa peine, et la marquise triomphe de lui par son obéissance.
Alors, le diable se souvient du pouvoir magique de Méphistophélès sur Marguerite et il évoque l'amour dans la personne d'Alain, un jeune clerc, qui soupirait pour Grisélidis avant qu'elle fût devenue châtelaine et qui, par une de ces nuits étoilées et enflammées où les cœurs sont à l'amour, lui rappelle les beaux jours de leur jeunesse. A cette évocation les sens de la marquise se troublent; le diable est sur le point de gagner son pari, lorsque le petit Loys accourt: la mère est sauvée par l'enfant. Le Malin est encore vaincu.
Il ne lui reste plus que la force, qu'à cela ne tienne! il fera enlever la marquise par des corsaires. Les pirates se trompent: à voir Fiammina si bien, si richement habillée, ils la prennent pour la marquise et l'emmènent à bord. Ce que voyant, le diable furieux emporte l'enfant. Il tient désormais Grisélidis par l'amour maternel. Si elle veut ravoir son fils, cela ne dépend que d'elle. Le chef des pirates, épris de sa beauté, le lui rendra. Mais le chef des forbans a disparu, et, entre temps, le duc est de retour de la croisade. Sous un nouveau déguisement:--car le diable sort de toutes les boîtes.--Le démon fait au marquis de méchants rapports sur sa femme. Ce mari peu confiant va prêter l'oreille à la calomnie qui est un des moyens les plus puissants de l'esprit infernal, lorsque Grisélidis paraît. Les deux époux s'entendent facilement dans l'effusion de leur tendresse, mais le diable se croit toujours triomphant, il a Loys entre ses mains.
Quelle force humaine pourrait le lui arracher? aucune. Il ne reste plus que les puissances surnaturelles. «Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens», a dit La Fontaine; et miracle! pendant que les deux époux sont agenouillés aux pieds de la patronne, et prient, la croix placée sur l'autel s'illumine, le tryptique s'ouvre, et sainte Agnès leur montre Loys endormi à ses pieds. Un cantique a dit: «Le paradis de l'enfant est aux genoux de sa mère.»
Telle est cette histoire de Grisélidis, ou plutôt ce mystère de la pureté de la femme que MM. Armand Silvestre et Eugène Morand nous ont raconté en vers exquis et que le Théâtre-Français a mis en scène avec un soin et un goût irréprochable. Une évocation du moyen-âge dans les costumes et dans les décors, à ce point que nous n'avons rien vu encore qui lui soit comparable.
C'est Mlle Bartet qui fait Grisélidis, elle y est ravissante; Mlle Moreno est bien jolie dans Bertrade, sous sa robe collante et sous sa tourte blanche. Mlle Lynnès, la Fiammina du diable, a beaucoup de gaieté et d'entrain dans ce personnage, complice de toutes les diableries de son époux. Mlle Ludwig est charmante dans le prologue et dans l'épilogue de la pièce. Je citerai M. Lambert fils, M. Leloir et M. Laugier excellents dans des rôles secondaires. M. Coquelin cadet fait le diable en tout ceci avec une fantaisie et une verve comique des plus entraînantes. J'ai entendu critiquer autour de moi certaines parties de son rôle qui font un singulier contraste avec le ton général de la légende poétique; mais allez donc reprocher à M. Armand Silvestre ses excentricités? Il vous répondrait que la gaieté a ses droits même en un sujet sérieux. M. Silvain est un marquis de Saluces d'une dignité parfaite et dont la belle voix fait sonner les beaux vers du poète.
Il y aurait injustice à oublier, dans cette distribution d'éloges des plus mérités, M. Léon, Je sais plus d'un compositeur, et je parle des meilleurs, qui signerait les morceaux dont M. Léon a agrémenté cette légende, surtout celui qui accompagne par un solo de violoncelle le duo ravissant d'Alain et de Grisélidis.
M. Savigny.
LES LIVRES NOUVEAUX
Rabelais. Ses voyages en Italie, son exil à Metz, par Arthur Heulhard. 1 vol. gr. in-8°, 40 fr. (Librairie de l'Art, 29, cité d'Antin).--Cette suprême personnification de la Renaissance, Rabelais, la connaissons-nous vraiment? Son nom, certes, est populaire, il l'est entre tous, et peut-être pour cela même l'homme est légendaire bien plutôt qu'historique, et chacun se forge un Rabelais de fantaisie, suivant son idée. Quant à sa vie, à ses mœurs, à son génie, à son œuvre même, celle qui n'est point Gargantua ou Pantagruel, mystère, obscurité! Voilà un livre qui, sans nous montrer tout Rabelais, car il est décidément très grand, va nous l'éclairer sous un de ses aspects les moins connus, à coup sûr. C'est le Rabelais diplomate que M. Heulhard vient d'étudier, Rabelais au service des du Bellay, leur collaborateur et leur inspirateur sans doute dans leurs négociations politiques et religieuses. La Renaissance, ou plutôt le seizième siècle, n'est pas d'une étude facile. On parle des ténèbres du moyen-âge, mais, au point de vue de l'étude, les ténèbres se prolongent bien après le moyen-âge fini. M. Arthur Heulhard n'a pas consacré moins de dix ans à se promener, la lampe à la main, dans ces arcanes que d'aucuns se figurent peut-être de grandes voies lumineuses: son œuvre est donc respectable et considérable: Paris, Rome, Turin, Chambéry, Metz, Toulouse, Aix, Montpellier, le Mans, ont été l'objet de ses investigations qui n'ont rien laissé d'inexploré: papiers d'État, archives municipales, correspondances diplomatiques et littéraires, etc. Et maintenant que les admirateurs de Rabelais ouvrent le volume. L'auteur, modeste comme il convient à un sincère, ne se vante pas d'avoir tout dit, tout découvert. Il déclare seulement avoir fait de son mieux. Ce livre est, nous dit-il, un premier combat engagé avec un sujet devant lequel ont reculé les plus rudes jouteurs, épouvantés par la difficulté et la multiplicité des recherches. Après l'histoire de Rabelais voyageur et exilé, il nous promet la vie de Rabelais en France. Souhaitons-lui l'encouragement d'une victoire pour le fortifier dans la lutte.
L. P.
La Grande nation (1870-1871) par E. Horn; préface de Jules Simon. (E. Plon et Nourrit, édit.)--La Grande nation est la France. Ce titre témoigne à lui seul des sympathies de l'auteur pour notre pays; il pourrait suffire, en retour, à assurer la nôtre à l'écrivain, si le mérite de l'ouvrage ne s'en chargeait d'autre part. Édouard Horn est mort en 1875, député au parlement de Pesth. Hongrois de naissance et de cœur, il était Français d'adoption et avait appartenu de longues années, sous l'empire, à la rédaction du Journal des Débats, où les idées libérales l'avaient eu pour défenseur. La Grande nation est la réunion d'articles publiés par lui en 1870-1871, dans le Heuer-freier Lloyd de Pesth, dont il était directeur, et que son fils a traduits. Si pénibles que soient toujours les retours vers un passé douloureux, il n'est pas sans enseignement, après vingt années écoulées, de suivre, avec autrui, la succession de faits dont la blessure a pu, sur le moment, dénaturer la valeur; il n'est pas sans réconfort de les voir juger par un esprit large et de constater la foi que l'Europe a toujours eue et conserve encore, quoi qu'elle fasse, dans le rôle civilisateur reconnu à la France. C'est à l'étranger qu'on apprend à connaître son pays; pour qui ne peut courir le monde, un livre supplée au voyage; il nous montre, par ce que les autres pensent de nous, ce que nous pouvons penser d'eux-mêmes, et le fond que nous pouvons faire sur leur amitié.
L. P.
Rome (de 754 à 63 avant J.-C.) par Marius Fontane. 1 in-8°, 7 fr. 50 (Lemerre).--C'est le septième volume de l'Histoire universelle. L'auteur le fait commencer à la date précise de l'an 754, où des hommes, venus d'Albe-la-Longue, tracèrent l'enceinte d'une ville, sur le bord du Tibre, à cinq lieues de la mer, entre sept collines protectrices, religieusement, selon le rite étrusque. Ecartant l'origine grecque, comme fabuleuse, il dégage la Ville Éternelle des légendes et des symboles, pour nous la montrer, aux premiers jours, comme un asile et un repaire, un campement d'exilés et de malfaiteurs, foule d'aventuriers et de proscrits, à qui l'on refusait des épouses lorsqu'ils sollicitaient un mariage. Les destinées de Rome sont contenues dans cette origine: dès la première heure, apparaît et demeure pour y présider le droit de guerre, d'extermination et de vol, le droit de conquête dont elle admet et proclame la légitimité supérieure, «si bien que les Romains, exerçant le métier des armes comme une profession lucrative, finiront par croire à la grandeur de leur mission, et magnifiquement, soumettant et exploitant les peuples, épuiseront leur force, dilapideront leurs biens, déshonoreront leur génie.» On voit qu'on peut compter sur l'indépendance d'historien de l'auteur. Son admiration pour les anciens maîtres du monde est des plus modérées. M. Marius Fontane n'accepte pas, loin de là, toutes les idées reçues. Nous pouvons, de notre côté, ne pas accepter toutes les siennes; mais les qualités de son style, jointes à la nouveauté de ses vues, doublent l'attrait de son remarquable ouvrage.
L. P.
Nouvelles, par Claude Vignon. L'éditeur Lemerre met en vente, dans sa «Petite Bibliothèque littéraire», un volume de Nouvelles de Claude Vignon, qui comprend quelques-unes des meilleurs pages de cet écrivain distingué: Un Accident, Paradis perdu, la Statue d'Apollon et l'Exemple.
Ces nouvelles sont précédées d'une intéressante notice de Jules Simon ainsi que d'une lettre de Claude Vignon à un de ses éditeurs, lettre qui est une véritable profession de foi littéraire.
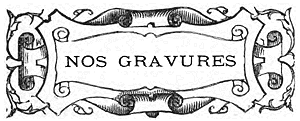
M. CARNOT A LIMOGES
On a fait au Président de la République, à Limoges, un accueil qui a dû aller profondément au cœur de M. Carnot puisqu'il venait dans sa ville natale visiter des compatriotes. Partout, d'ailleurs, ce sont les mêmes acclamations qui saluent le passage du chef de l'État.
Pendant son séjour à Limoges, M. Carnot a distribué les récompenses du dix-septième concours fédéral de gymnastique. Pour qu'aucun retard ne vint priver les concurrents du grand honneur de recevoir solennellement les médailles conquises, les opérations du concours et les exercices avaient eu lieu la veille et l'avant-veille de l'arrivée du président de la République.
C'est sur la grande place appelée le Champ de Juillet que la distribution des récompenses a eu lieu. Le terrain est de vastes proportions et la décoration était magnifique. Un quadrilatère de tribunes se dressait, tout flamboyant de drapeaux, de guirlandes et d'oriflammes, tout noir de monde à l'heure de la cérémonie. A l'entrée principale, un arc-de-triomphe monumental faisait face à la tribune présidentielle.
M. Carnot est arrivé à trois heures, après le déjeuner qui avait eu lieu en son honneur à la préfecture. Il a pris place dans sa tribune; à sa droite était M. Bourgeois, ministre de l'instruction publique; à sa gauche, M. Constans, ministre de l'intérieur, M. le général Galland. M. Prudhomme, président de la Société de gymnastique de Limoges et président de l'union des Sociétés de gymnastique de France, a souhaité la bienvenue à M. Carnot et l'a remercié du bienveillant intérêt que le chef de l'État témoigne, pour la troisième fois, à une œuvre virile et essentiellement patriotique. M. Carnot a répondu qu'il connaissait les sentiments des Société de gymnastique; et, pour reconnaître les services qu'elles rendent au relèvement national, il a attaché sur la poitrine de leur président la croix de la Légion d'honneur.
La distribution des récompenses a commencé ensuite. Au pied de la tribune étaient venus se placer les porte-étendards et porte-guidons des sociétés récompensées accompagnés des présidents respectifs et d'un collègue. A la lecture de l'appel, le porte-étendard de la société récompensée sortait des rangs avec les deux camarades qui l'accompagnaient; le porte-étendard restait au bas des gradins avec l'un de ses compagnons. Et, tandis qu'il saluait du drapeau, le troisième délégué montait auprès du président pour recevoir la récompense que M. Carnot remettait en prononçant quelques paroles d'éloges.
Après la distribution des récompenses, les sociétés de gymnastique ont exécuté des mouvements d'ensemble avec une précision et une correction que le public a vivement applaudies.
INAUGURATION DE L'EXPOSITION FRANÇAISE DE MOSCOU
Nous avons donné, dans notre numéro du 17 janvier de cette année, une vue panoramique des bâtiments affectés à l'Exposition française de Moscou. Cette exposition réunit dans ses diverses classes des échantillons assez nombreux et choisis avec goût de tous les produits que le travail français a intérêt à exporter: tissus, denrées alimentaires, vins, liqueurs, parfumerie, jouets, bibelots, tous plus ingénieux les uns que les autres.
Nos principales industries d'art, céramique, bronze, orfèvrerie, joaillerie, ont tenu à honneur d'y exposer des modules nouveaux qui seront remarqués même après ceux qu'on a admirés en 1889 au Champ-de-Mars. Enfin 500 peintres et sculpteurs se sont joints aux 1,500 exposants des sections industrielles et ont envoyé à Moscou le meilleur de leurs œuvres, déjà connues ou inédites.
On sait que l'empereur de Russie a accordé très gracieusement à l'entreprise française la libre disposition de l'édifice dans lequel a été installée l'Exposition nationale russe de 1882. A l'exemple du souverain, les autorités russes de tout ordre ont aidé de leur mieux nos compatriotes dans le difficile travail d'une organisation si lointaine, souvent entravée et un peu retard et par un hiver dur et prolongé. Il n'est que juste de remercier l'administration russe de ses prévenances.
Samedi 9 mai (date française), a eu lieu l'ouverture. La cérémonie a été à la fois officielle et religieuse, suivant le désir exprimé par les autorités russes et le vœu de la population. Pour les Russes, une bénédiction est le prologue obligé de toute inauguration, qu'il s'agisse de l'entreprise la plus profane, même d'un théâtre. On avait donc transporté en équipage dans le pavillon d'honneur l'image sainte de la vierge d'Iverski, l'icône le plus renommé de la Russie, qui garde, pour ainsi dire, dans sa petite chapelle, la porte du Kremlin.
Devant cette image, un des membres du haut clergé de Moscou, qui a le rang d'évêque, plusieurs popes en riches ornements sacerdotaux et un chœur religieux ont coopéré à la bénédiction Après un Te Deum, l'évêque a prononcé une longue allocution, puis il a fait le tour de l'assistance en jetant de l'eau bénite sur les installations de la galerie d'honneur. La partie religieuse de la cérémonie s'est terminée par des prières et une espèce de Magnificat. Notre dessin représente le moment où le cortège ecclésiastique va quitter l'estrade pour faire le tour de la galerie. L'évêque tient le goupillon; il est coiffé d'une magnifique mitre de filigrane d'or serti de pierreries et d'images saintes peintes sur émail. A gauche se tiennent les chantres; à droite sont les principaux personnages de la Commission française et des autorités russes; M. Dietz-Monnin, vice-président de la Commission de l'Exposition, remplaçant le président Teisserenc de Bort, retenu à Paris; à côté de lui M. Flourens, ancien ministre des affaires étrangères. La principale figure militaire est celle de S. E. le général Kostanda, gouverneur intérimaire de Moscou, qui, après la bénédiction, a déclaré l'Exposition ouverte et ajouté dans un bref discours que «Moscou, cœur de la Russie, accueillait avec une chaude sympathie l'œuvre française de l'Exposition.»
LA TORPILLE AUTOMOBILE DIRIGEABLE SIMS-EDISON
Une intéressante expérience a eu lieu tout récemment aux chantiers de Graville au Havre appartenant à la Compagnie des Forges et Chantiers: il s'agissait des essais d'une torpille automobile dirigeable.
On sait que les torpilles automobiles sont des appareils, véritables projectiles, qui, par le jeu d'un moteur contenu dans leurs flancs, se meuvent en avant, entre deux eaux, dans une direction donnée, et font explosion au contact du but visé. Mais elles présentent cet inconvénient que, lorsqu'elles ont quitté l'appareil de lancement, elles sont à la merci des flots et ne peuvent pas, par elles-mêmes, rectifier la direction primitivement donnée, de telle sorte qu'elles manquent souvent le but.
Pour obvier à cette imperfection capitale, on a imaginé les torpilles automobiles dirigeables, conservant avec le point de départ une communication qui permet de diriger, de modifier au besoin leur allure et leur marche, enfin de produire l'explosion au moment voulu.
C'est dans cet ordre d'idées qu'a été conçue et exécutée la torpille Sims-Edison que représentent nos dessins.
Elle se compose de deux parties: le flotteur et le poisson.
Le flotteur en feuilles de cuivre laminé est rempli d'une substance légère, insubmersible. Il n'est là que pour soutenir le poisson à un niveau constant au-dessous de la surface de l'eau; son avant est, en effet, taillé en forme d'étrave très oblique et très tranchante pour lui permettre de glisser au-dessous des obstacles ou de les fendre pour les traverser. Le poisson, qui est la torpille proprement dite, est relié au flotteur par des entretoises d'acier. Ces dispositions se voient bien sur notre dessin.
Le flotteur est formé de quatre compartiments étanches: celui de l'avant renferme l'explosif dont la charge peut être portée à 225 kilogrammes; le second compartiment ne renferme que de l'air, il sert à isoler la partie explosive; le troisième contient 3,500 mètres de câble, composé de 2 fils, soigneusement enroulé sur une bobine creuse et pouvant se dérouler par l'arrière de la torpille au moyen d'un tube qui y est adapté. Ce câble a 1 centimètre de diamètre seulement et une densité égale à celle de l'eau de mer, de telle sorte que, déroulé, il flotte, et que l'eau qui s'introduit à sa place dans l'appareil n'en augmente pas le poids.
Le compartiment de l'arrière renferme le moteur électrique qui actionne à 800 tours à la minute l'hélice, et donne une vitesse de 20 nœuds. Il est surmonté d'un petit gouvernail.
Le poids total de la torpille est de 1,360 kilogrammes, sa longueur est de 8 mètres. Elle se met à l'eau au moyen de porte-manteaux comme un canot ordinaire. Une petite sphère rouge de repère, placée au-dessus de l'eau à son avant, permet d'en suivre les évolutions.
Voyons comment on va pouvoir la diriger. Notre dessin représente l'opérateur à l'œuvre.
Une machine placée à terre fournit le courant continu, lequel traverse une table de commutation devant laquelle l'opérateur est placé.
Avant la mise à l'eau, l'extrémité du câble de la torpille est fixée aux commutateurs. Dès que le courant passe, il va actionner le moteur électrique de la torpille qui se met en marche, déroulant au fur et à mesure son câble derrière elle.
Nous ne pouvons donner ici la description trop technique du moteur: disons seulement qu'il est à deux pôles et a ses inducteurs roulés en séries, de telle sorte que le sens de la rotation est indépendant de celui du courant qui le traverse et que l'on a ainsi la faculté de pouvoir à volonté inverser le sens de ce courant. Cette inversion est alors mise à profit pour enflammer la charge explosive au moyen d'une bobine intermédiaire, dans laquelle le courant de marche ordinaire ne produit qu'un circuit d'une trop faible force pour enflammer l'amorce, mais dans laquelle l'inversion brusque de ce même courant de marche ordinaire produit par contre une tension suffisante pour produire cette inflammation.
La manœuvre du gouvernail se fait à peu près de la même manière à l'aide d'un électro-aimant polarisé et d'un inverseur placé sous la main de l'opérateur: les courants inversés, suivant qu'ils sont envoyés dans un sens ou dans un autre, mettent la barre en position et permettent de rectifier à chaque instant la marche ou de faire même virer complètement bord sur bord la torpille.
C'est ce que l'on voit exécuter dans notre dessin est la torpille qui file dans la direction de la pleine mer est ramenée par la manœuvre de l'inverseur droit sur le piquet qui est le but qu'elle doit atteindre.
Ces essais ont remarquablement réussi. L'opérateur, ainsi qu'on le voit, est chaussé de bottes isolantes et a des gants en caoutchouc, précautions justifiées par les tensions élevées dont on fait usage et qui sont de 25 ampères et 1,300 volts, capables de donner la mort ou de provoquer de graves accidents.
Nous ne pouvons juger ici la valeur de la torpille dirigeable Sims-Edison comme engin de guerre, l'expérience à cet, égard prononcera. Mais, comme application ingénieuse et savante de l'électricité, elle constitue très évidemment un énorme progrès.
DECK
Depuis les belles époques de Rouen et de Nevers, la faïence française subissait une éclipse: l'homme qui a su lui rendre son éclat, Deck, vient de mourir.
Il est né en Alsace en 1823; à peine âgé de vingt ans, il met sac au dos et fait son tour comme compagnon poêlier; il parcourt à pied toute l'Autriche, réparant les poêles de faïence dans les pays ou on était encore assez heureux pour brûler du bois, il s'arrête dans les villes deux jours ou deux mois selon l'ouvrage, il gagne en moyenne deux francs par jour, mais il fait une ample provision de remarques et d'observations. Il désire Paris, il s'y rend; il se fait embaucher dans une fabrique de poêles; d'ouvrier il devient contremaître, puis il s'établit fort modestement rue Saint-Jacques; sans argent il se contente d'abord de travailler pour les autres et de faire cuire au dehors; il est apprécié et peut enfin avoir son four. Il commence par un genre qui se rapproche de l'énigmatique faïence d'Oiron; puis il se prend d'amour pour les faïences anciennes de la Perse à émaux transparents. Bientôt il excelle, et trouve cet émail turquoise, chaud, lumineux, ombrant par accumulation, bleu à la lumière artificielle; mais il ne s'arrête jamais et montre ces admirables fonds d'or que lui ont inspiré les mosaïques de Saint-Mate de Venise. Alors il s'attaque à la porcelaine, retrouve le flambé des Chinois et le céladon que les modernes fabricants de la Chine ne savent plus reproduire.
Les honneurs lui arrivent, il est nommé membre de la commission de Sèvres, chevalier de la Légion d'honneur; il reste modeste et laborieux, toujours épris de son art; il ne recherche pas la fortune, il ne se doute pas des affaires, et n'a pas le sens du commerce: c'est un céramiste de race, sacrifiant tout à son métier.
La direction de notre Manufacture nationale de porcelaine est vacante; en 1887, le gouvernement lui offre la place, il l'accepte non sans hésitations et voilà l'ancien ouvrier poêlier à Sèvres; le simple soldat est devenu maréchal de France. Déjà miné par la maladie, il se met à l'œuvre, compose une pâte nouvelle, reprend la porcelaine tendre, mais la mort le surprend.
Sa vie a été bien remplie, elle prouvera ce que peuvent le courage, la persévérance, la science unie au bon sens, le calme et le sentiment de la valeur personnelle.
Z.
GRISÉLIDIS
Grisélidis, le mystère que vient de représenter la Comédie-Française, se déroule dans des décors qui rappellent l'art symbolique des primitifs; les enluminures des missels, les fleurettes et les grandes lettres peintes qui enjolivent les grimoires, les vitraux de cathédrales, ont inspiré le metteur en scène comme les poètes. C'est le cadre qu'il faut à Grisélidis, la marquise de Saluces, une sœur,
Des vierges en or fin d'un livre de légendes
Dans un flot de velours traînant leurs petits pieds.
La gravure que nous publions représente la dernière scène du troisième et dernier acte. Celui-ci se passe, comme le premier, dans l'oratoire de dame Grisélidis. Le panneau de droite est occupé par un beau triptyque dont les volets s'ouvrent ou se ferment sur une statue de Sainte-Agnès, foulant sous ses pieds un diable sculpté... Le fond est garni d'une large tapisserie que surmonte une fresque, où l'on voit peinte une scène de l'Histoire sacrée... La fenêtre a vue sur la campagne verdoyante. De hautes stalles et des coffres en bois sculpté meublent l'oratoire.
Donc, le diable n'a pas eu raison de la vertu de dame Grisélidis, et, pour se venger, pour la mettre à une dernière épreuve, il lui a ravi son fils, l'enfantelet Loys. Le marquis de Saluces, qui arrive de la croisade et se croyait trompé, vient de reconnaître son erreur, mais, en même temps, il apprend le rapt de son fils... Alors, un miracle s'accomplit. La croix de l'autel se change en une épée flamboyante: elle met en fuite le diable qui disparaît derrière la tapisserie avec un dernier ricanement. On ouvre les volets de la niche de Sainte-Agnès, qu'un instant auparavant les châtelains avaient trouvée vide, non sans un grand effroi: Sainte-Agnès a repris sa place et elle porte le petit Loys dans ses bras. Le miracle est complet: ce sont les prières ferventes de dame Grisélidis qui l'ont obtenu du ciel. Vassaux, tenanciers, hommes d'armes, bergers et lavandières tombent à genoux, devant cette manifestation non équivoque de la faveur dont Dieu le père et les saints entourent la demeure et la famille du marquis de Saluces: il passe sur cette scène comme un souffle de la foi qui inspirait Fra Angelico da Fiesole.
Ad. Ad.

ANIE
Roman nouveau, par HECTOR MA LOT
Illustrations d'ÉMILE BAYARD
Suite.--Voir nos numéros depuis le 21 février 1891.
Mais dès le surlendemain Barincq alla déjeuner chez sa fille, anxieux de savoir si Sixte avait ouvert le paquet; il le trouva intact, comme il l'avait noué lui-même, sur la table de Sixte.
--Tiens, ton mari n'a pas ouvert ce paquet? dit-il.
--Quand Sixte rentre, il est tellement écœuré des paperasses que le général lui fait lire ou écrire qu'il a l'horreur des papiers.
--Il ferait tout de même bien de ne pas le laisser traîner: c'est toute sa jeunesse qui est là-dedans.
--Je le lui dirai.
Le vendredi, quand il revint sous un prétexte quelconque, car il n'avait pas l'habitude de faire deux voyages par semaine à Bayonne, le paquet était toujours dans le même état.
Il attendit le dimanche; mais ni Anie ni Sixte ne parlèrent de rien; donc il n'y avait rien, semblait-il.
Ce fut seulement dix jours après, que Sixte rentrant un soir de mauvais temps avant sa femme, retenue par l'odieux enchaînement des visites quelle avait à rendre et dont la comptabilité exigeait une tenue de livres, ouvrit le paquet, n'ayant rien de mieux à faire.
Pas bien intéressantes pour lui ces lettres, dont les premières, qu'il avait oubliées, étaient écrites dans un style enfantin, que paralysait encore le respect envers celui auquel il s'adressait.
Les laissant de côté il prit la liasse des comptes qui, par les chiffres seuls des factures, était plus curieuse.
--C'était cela qu'on avait dépensé pour lui; cela qu'il avait coûté.
Comme il les parcourait les unes après les autres, ses yeux tombèrent sur une feuille de papier timbré, de l'écriture de M. de Saint-Christeau.
Qu'était cela?
Il lut.
Mais c'était le testament de M. de Saint-Christeau, celui qu'il connaissait, celui que l'inventaire devait faire trouver, et qui avait échappé sûrement aux recherches du notaire, parce qu'on n'avait pas pris ces factures les unes après les autres, pour les classer, et qu'il s'était glissé entre deux papiers insignifiants.
Avant qu'il fut revenu de sa surprise, sa femme rentra, et, comme à l'ordinaire, vint vivement à lui pour l'embrasser.
--Tiens, dit-elle, tu te décides à lire ces papiers?
Mais elle n'avait pas achevé sa question, qu'elle s'arrêta stupéfaite de la physionomie qu'elle avait devant elle.
--Qu'as-tu? Mon Dieu, qu'as-tu? demanda-t-elle.
--Voilà ce que je viens de trouver, lis.
Il lui tendit la feuille.
--Mais c'est le testament de mon oncle Gaston! s'écria-t-elle, dès les premières lignes.
--Lis, lis.
Elle alla jusqu'au bout; alors le regardant:
--Que vas-tu faire? demanda-t-elle d'une voix qui tremblait.
--Mais que veux-tu que je fasse? répondit-il. Imagines-tu que je vais m'armer de ce testament pour troubler ton père, si heureux d'être le propriétaire d'Ourteau? Pour qui travaille-t-il? Pour nous. A qui donne-t-il ses revenus? A nous. Non, non, ce testament, que je ne suis pas fâché d'avoir d'ailleurs, par un sentiment de reconnaissance envers M. de Saint-Christeau, ne sortira jamais de ce tiroir, dans lequel je vais l'enfermer, et ton père ignorera toujours qu'il existe.
Elle lui jeta les bras autour du cou, et l'embrassa nerveusement, avec un flot de larmes.
--Mais que pensais-tu donc de moi? dit-il.
--C'est de fierté que je pleure.
IV
De temps en temps, Sixte parlait de d'Arjuzanx à sa femme: ou bien il avait reçu sa visite, ou bien ils s'étaient rencontrés par hasard; en tous cas, au grand ennui d'Anie, les relations continuaient entre eux, et rien n'annonçait qu'elles dussent finir.
Un jour, il lui annonça d'un air assez embarrassé que d'Arjuzanx, qui venait de louer une villa à Biarritz, l'avait invité à pendre la crémaillère avec quelques amis: de la Vigne, Mesmin, Bertin.
--Tu as accepté?
--Je peux me dégager.
--Il ne faut pas te dégager.
--Si cela t'ennuie.
--C'est toujours un chagrin pour moi de ne pas t'avoir, mais je serais ridicule de vouloir te confisquer: on ne me trouve déjà que trop accapareuse.
--Ne t'inquiète donc pas de ce qu'on trouve ici ou de ce qu'on ne trouve pas.
--Mais si; c'est mon devoir de m'en inquiéter: je ne dois pas te rendre heureux seulement par ma tendresse, je dois aussi m'appliquer à te faire une vie à l'abri de toute critique; avec votre camaraderie militaire, personne plus que vous n'est exposé aux interprétations bizarres; ne devez-vous pas être tous coulés dans le même moule? Va donc dîner chez M. d'Arjuzanx et amuse-toi bien comme les autres. En réalité, ce qui m'ennuie le plus, ce n'est pas que tu ailles chez M. d'Arjuzanx, mais c'est que tu sois obligé un jour ou l'autre de lui rendre ce dîner.
--Il vaut donc mieux ne pas y aller.
--C'est bien difficile.
--Alors?
--Alors j'ai tort, cela est certain; je me le dis, je me le répète; mais j'ai beau faire, je ne peux pas m'habituer à l'idée que des relations suivies s'établissent entre M. d'Arjuzanx et nous. Si le prétendant m'a inspiré autrefois une répulsion qui a abouti à mon refus, l'homme ne m'est pas moins antipathique.
--As-tu quelque chose à lui reprocher?
--Malheureusement non; sans quoi ce serait fini.
--D'Arjuzanx est fier et susceptible; si tu le tiens à distance, il n'insistera pas.
--Le rôle est aimable pour moi.
--Dans ma position il m'est bien difficile de le prendre, j'aurais trop l'air d'un jaloux.
--Un jaloux triomphant. Enfin, vas-y pour cette fois. Nous aviserons plus tard. Car je t'assure que mes sentiments à son égard ne changeront pas; et je n'imagine rien de plus pénible que des relations avec qui n'inspire pas sympathie et confiance. Quand je vous vois si différents l'un de l'autre, je me demande comment vous avez pu vous lier d'amitié au collège.
Bien qu'il fût trop épris de sa femme pour sentir autrement qu'elle, Sixte trouvait cependant qu'elle était bien sévère: pas si antipathique que cela, d'Arjuzanx, semblait-il: rageur, violent, obstiné dans ses idées, entêté dans ses rancunes, oui, cela était vrai; mais sans que cela allât jusqu'à l'extrême et le rendit gênant ou ridicule.
Libre, Anie n'aurait pas laissé Sixte accepter l'invitation du baron, et d'une façon ou d'une autre se serait arrangée pour qu'il refusât sans paraître le pousser à un refus qui serait venu de lui; mais précisément cette liberté elle ne l'avait pas, et le nom seul d'un des convives de d'Arjuzanx le lui avait rappelé de façon à fermer ses lèvres.
Au temps où Sixte lui faisait la cour et pendant leurs tête-à-tête dans les jardins d'Ourteau, elle avait voulu qu'il lui dit ce qu'était le monde nouveau au milieu duquel elle allait vivre à Bayonne dans une sorte de camaraderie obligatoire; quels étaient ses mœurs, ses usages, ses habitudes, ses travers, ses faiblesses, ses ridicules, ses qualités, ses mérites; et de ces longs récits il était sorti pour elle un enseignement qu'elle s'était bien promis de ne pas oublier.
Parmi les officiers de la garnison, il y en avait un, le lieutenant de la Vigne, qui avait épousé une jeune fille de la ville dont le père avait fait une grosse fortune dans le commerce et la raffinerie des pétroles. Élevée dans le couvent le plus aristocratique de Bordeaux, cette fille avait contracté la folie des vanités mondaines, à laquelle d'ailleurs sa nature la prédestinait, et, rentrée à Bayonne dans sa famille honnêtement bourgeoise, elle n'eût jamais consenti à accepter pour mari un homme dans les affaires et en relations commerciales avec son père ou les amis de son père. C'est pourquoi, lorsqu'elle avait hérité de la fortune de sa mère, elle s'était offert un joli petit lieutenant, qui à une profession décorative et honorable ajoutait le prestige d'un nom ou plutôt d'une apparence de nom: Ruchot de la Vigne. Le nom il l'avait reçu de son père, tout petit propriétaire campagnard; l'apparence il la tenait des bons pères qui l'avaient élevé.--Comment! Ruchot? lui avaient-ils dit lorsqu'il était entré chez eux; Ruchot tout court! il faut ajouter quelque chose à cela. Votre père a bien une propriété?--Il a une vigne.--C'est parfait; vous vous appellerez désormais Ruchot de la Vigne, comme vous avez des camarades qui s'appellent Mouton du Pré, Jannot du Gué, Petit de la Mare; ça fait bien sur le palmarès, et plus tard ça sert dans la vie pour un beau mariage.
En effet, cela lui avait servi à épouser la fille du raffineur de pétrole, qui n'aurait jamais consenti à être Mme Ruchot tout court, et qui était fière de s'entendre annoncer sous le nom de Mme de la Vigne. Il est vrai qu'à la mairie on lui avait impitoyablement coupé le de la Vigne, mais on le lui avait généreusement donné à l'église; et l'église était pleine, tandis qu'à la mairie il n'y avait personne.
Devenue Mme de la Vigne, elle tenait plus que personne à sa noblesse: si son linge, son argenterie, ses voitures, ses bijoux, n'étaient pas marqués de ses armes, en tout cas étaient-ils agrémentés d'emblèmes qu'on pouvait prendre pour des armes de loin, et qui pour elle en étaient. S'étant payé un officier, il semblait qu'elle avait acheté avec lui tout le régiment, et les officiers de la place, y compris le général. Quand elle disait à son mari:--N'est-ce pas un officier de votre régiment?--elle parlait de quelqu'un qui lui appartenait et lui devait de la déférence, sinon de la reconnaissance.
Les histoires à ce sujet qui couraient la ville étaient aussi nombreuses que réjouissantes, embellies chaque jour par les camarades du seigneur de la Vigne, qui s'amusaient autant des prétentions de la femme que de l'esclavage du mari, véritable caniche en laisse qu'elle promenait sans cesse avec elle, et qui n'avait le droit ni de faire un pas, ni de dire un mot, ni de dépenser un sou, sans en avoir reçu préalablement la permission.
Anie, qui, elle aussi, épousait un officier pauvre, s'était promis de ne pas tomber dans ces travers et de veiller à ce que rien en elle ne pût rappeler les exigences de Mme de la Vigne, ou évoquer des comparaisons que leurs positions, à l'une comme à l'autre, ne rendraient que trop faciles. Sans doute, elle se savait à l'abri de ces prétentions vaniteuses; mais, aimant son mari comme elle l'aimait, saurait-elle toujours se garder d'exigences matrimoniales auxquelles son cœur épris pourrait trop facilement l'entraîner?
Pour elle la question avait sa gravité et son inquiétude; aussi, quand Sixte avait prononcé le nom de son camarade de la Vigne, n'avait-elle pas hésité à répondre: «Il faut accepter.»
V
Quand Sixte arriva chez le baron il était presque en retard, et tous les invités se trouvaient réunis dans le salon de la villa, dont les fenêtres ouvraient sur la mer; il y avait là quelques propriétaires de la contrée, des Russes, des Espagnols, et les camarades que d'Arjuzanx lui avait annoncés.
--Je croyais que tu ne viendrais pas, dit l'un d'eux.
--Et pourquoi?
--Lune de miel.
--Miel n'est pas glu.
Le dîner était combiné pour laisser des souvenirs aux convives et les rendre fidèles, composé de mets envoyés des pays d'origine: poulardes de la Bresse, écrevisses de Styrie, ortolans des Landes tirés dans les terres de d'Arjuzanx, pâté de foie gras de Nancy; en vins, les premiers crus authentiques.
Ce qui ne fut pas de premier cru, ce fut la conversation, qui se maintint dans la banalité, ces étrangers que le hasard réunissait n'ayant entre eux ni idées communes, ni habitudes, ni relations; on parla du climat de Biarritz; puis de la température, de la plage, des villas et de leurs habitants, on passa aux casinos.
--Très agréables, ces deux casinos; quand on est nettoyé dans l'un, on peut essayer de se refaire dans l'autre.
Mais d'Arjuzanx ne fut pas de cet avis: pour lui le jeu n'était un plaisir qu'entre amis, là où l'on trouvait la sincérité, la tranquillité, et où l'on n'était pas exposé à s'asseoir à côté de gens qu'on ne saluait pas dans la rue; si, d'autre part, il fallait surveiller les croupiers pour voir s'ils ne bourraient pas la cagnotte ou n'étouffaient pas les plaques en même temps qu'il fallait se défier des grecs, le jeu devenait un très vilain travail que pouvaient seul accepter ceux qui lui demandaient leur gagne-pain.
--Aussi, messieurs, dit-il en concluant, si jamais l'envie vous prend? dans l'après-midi ou dans la soirée, de tailler un bac, considérez cette maison comme vous appartenant, un cercle dont nous faisons tous partie, et où vous pourrez amener vos amis.
Le menu, si abondant qu'il fût, eut une fin cependant, on passa dans le salon, où l'on fuma des cigares exquis en regardant la mer; mais le miroitement de la lune sur les vagues, pas plus que les éclats du feu tournant de Saint-Martin renaissant et mourant dans les profondeurs bleues de la nuit, n'étaient des spectacles faits pour retenir longtemps l'attention de cette jeunesse peu contemplative.
Les cigares n'étaient pas à moitié brûlés que les yeux s'interrogèrent d'un air vague et inquiet:
--Que va-t-on faire?
A cette question, l'un des convives répondit en rappelant la proposition de d'Arjuzanx:
--Si on taillait un bac?
Dix voix appuyèrent.
--Je ne vous demande que le temps de faire desservir la table, dit d'Arjuzanx; nous serons mieux dans la salle à manger qu'ici; j'enverrai aussi chercher des cartes, car je n'en ai pas.
Un quart d'heure après on était assis autour de la table sur laquelle on avait dîné, et le banquier disait:
--Messieurs, faites votre jeu.
Sixte, de la Vigne et un de leurs camarades étaient restés dans le salon, où ils causaient; d'Arjuzanx vint les rejoindre.
--Vous ne jouez pas?
--Tout à l'heure, répondit de la Vigne.
--Et toi, Sixte?
--Ma foi non.
--Je t'ai connu joueur, cependant.
--Au collège.
--Et à Saint-Cyr aussi, dit de la Vigne.
--J'ai joué, continua Sixte, quand le gain ou la perte de cent francs me crispait les nerfs, arrêtait mon cœur et m'inondait de sueur, mais maintenant qu'est-ce que cela peut me faire de gagner ou de perdre?
--Et l'émotion du jeu? dit d'Arjuzanx.
--Je ne désire pas me la donner, et même je souhaite ne pas me la donner.
--Alors tu n'es pas sûr de toi?
--Qui est sûr de soi?
--Si tu n'as pas apporté d'argent, continua d'Arjuzanx, ma bourse est à ta disposition, et à la vôtre aussi, monsieur de la Vigne.
--J'accepte vingt-cinq louis, dit de la Vigne d'un ton qui montrait que son porte-monnaie n'avait pas été garni.
Aussitôt qu'il fut en possession des vingt-cinq louis, de la Vigne passa dans le salon.
--Voilà qui prouve, dit d'Arjuzanx avec une ironie légèrement méprisante, que Mme de la Vigne tient de court son mari.
Sixte ne répliqua rien, mais deux minutes après il entrait à son tour dans le salon et mettait dix louis sur la table.
Il gagna, laissa sa mise et son gain sur le tapis, gagna une seconde fois, puis une troisième.
Alors il ramassa ses seize cents francs et retourna dans le salon, tout surpris de ressentir en lui une émotion que le gain d'une somme en réalité minime n'expliquait pas.
Quelle étrange chose! pendant ces trois coups, il avait éprouvé ces frémissements, ces arrêts de respiration qui l'avaient si fort secoué autrefois quand il était gamin ou à l'École.
Comme il avait eu raison de dire à d'Arjuzanx qu'on n'était jamais sûr de soi!
--S'il s'en allait!
Mais la fausse honte qui l'avait fait jeter ses dix louis sur la table le retint: que ne dirait-on pas?
Il alluma un cigare; mais devant la fenêtre où il le fumait lui arrivaient les bruits de la salle à manger se mêlant au murmure rauque de la marée montante; de temps en temps la voix du banquier ou des pontes et aussi le tintement de l'or, le flic flac des billets et des cartes, dominaient ces bruits vagues: Messieurs, faites votre jeu. Cartes, cinq, neuf.
Fut-ce ce sentiment de fausse honte, fut-ce la magie, la suggestion de ces bruits? Toujours est-il qu'au bout de dix minutes il revenait dans le salon et déposait cinquante louis sur l'un des tableaux qui gagna.
Jusque-là, il avait joué debout; machinalement, il attira une chaise et s'assit: il était dans l'engrenage.
Alors l'ivresse du jeu le prit, l'emporta, et anéantit sa raison aussi complètement que sa volonté: il n'était plus qu'un joueur, et, en dehors de son jeu, rien n'existait plus pour lui.
De parties en parties, le jeu arriva vite à une allure enfiévrée, vertigineuse; à son tour, Sixte prit la banque, gagna, perdit, la reprit et, à une heure du matin, il devait quarante mille francs à d'Arjuzanx, cinq mille à de la Vigne, vingt mille aux autres; en tout soixante-cinq mille francs représentés par des cartes qui portaient écrit au crayon le chiffre de ses dettes envers chacun.
Alors d'Arjuzanx l'attira dans son cabinet.
--Si tu veux payer ce que tu dois, lui dit-il, je mets vingt-cinq mille francs à ta disposition; il y a des étrangers qui ne te connaissent pas, peut-être voudras-tu t'acquitter envers eux tout de suite.
--Je le voudrais.
--Eh bien, accepte ce que je t'offre; ne vaut-il pas mieux que je sois ton seul créancier? entre nous, cela ne tire pas à conséquence; tu me rembourseras quand tu pourras.
VI
Du quai, Sixte vit qu'une lampe brûlait dans la chambre de sa femme; et, au bruit qu'il fit en ouvrant sa grille, Anie parut sur la verandah.
En route il s'était dit qu'elle se serait couchée, et qu'il la trouverait endormie, ce qui retarderait l'explication jusqu'au lendemain; mais non, elle l'avait attendu et la confession devrait se faire tout de suite.
Pendant qu'il traversait le jardin, la lumière avait disparu de la fenêtre de la chambre, et quand il entra dans le vestibule il trouva sa femme devant lui qui le regardait.
--Tu t'es impatientée?
Anie avait trop souvent entendu sa mère dire à son père: «Je ne te fais pas de reproches, mon ami», pour tomber dans ce travers des femmes qui se croient indulgentes; aussi en descendant l'escalier avait-elle mis dans les yeux son plus tendre sourire; mais, en le voyant sous le jet de lumière qu'elle dirigeait sur lui, ce sourire s'effaça.
--Qu'avait-il?
Elle le connaissait trop bien, elle était en trop étroite communion de cœur, d'esprit, de pensée, de chair avec lui, pour n'avoir pas reçu un choc, et malgré elle, instinctivement, elle formula tout haut le cri qui lui était monté à la gorge:
--Qu'as-tu? Que s'est-il passé? Que t'est-il arrivé?
--Je vais te le dire. Montons.
Au fait cela valait mieux ainsi: au moins les embarras de la préparation seraient épargnés.
Et, en arrivant dans leur chambre, en quelques mots rapides il dit ce qui s'était passé chez d'Arjuzanx, sa perte, le chiffre de cette perte.
A mesure qu'il parlait il vit l'expression d'angoisse qui contractait le visage de sa femme, relevait ses sourcils, découvrait ses dents, s'effacer; il n'avait pas fini qu'elle se jeta sur lui et l'embrassa passionnément.
--Et c'est pour cela que tu m'as fait cette peur affreuse! s'écria-t-elle.
--N'est-ce rien?
--Qu'importe!
--Il faut payer.
--Eh bien, tu paieras; ne peux-tu pas prendre soixante-cinq mille francs sur ta fortune sans que ce soit une catastrophe?
A son tour, sa physionomie sombre se rasséréna:
--Alors, il n'y a donc qu'à prendre les soixante-cinq mille francs dans notre caisse, dit-il avec un sourire.
--Il n'y a qu'à les demander à mon père; ce que je ferai dès demain matin.
--Ce que nous ferons, reprit-il; c'est déjà beaucoup que tu sois de moitié dans une démarche dont je devrais être seul à porter la responsabilité.
Les choses arrangées ainsi, elle pouvait maintenant poser une question qu'elle avait sur les lèvres, et cela sans qu'il pût voir dans sa demande une intention de reproche ou de blâme:
--Mais comment as-tu perdu cette somme? dit-elle.
--Ah! comment?
Elle hésita une seconde, puis se décidant:
--Tu es donc joueur? dit-elle.
--Je l'ai été à deux périodes de ma vie: à quinze ans au collège, et à vingt ans à Saint-Cyr. A quinze ans, j'ai, à un certain moment, perdu cent vingt francs contre d'Arjuzanx, en jouant quitte ou double. Tu imagines quelle somme c'était pour moi qui n'avais que vingt sous qu'on me donnait par semaine, et quelles émotions j'ai alors éprouvées; heureusement d'Arjuzanx me donnant toujours ma revanche, j'ai fini par m'acquitter. Plus tard, à Saint-Cyr, j'ai perdu douze cents francs qui pendant longtemps ont pesé sur ma vie d'un poids terriblement lourd. Depuis, je n'avais pas touché à une carte; et il y a dix ans de cela. Comment me suis-je laissé entraîner, moi qui n'aime ni le jeu ni les joueurs? Je n'en sais rien. Un coup de vertige. Et aussi, je dois te le confesser, puisque je ne te cache rien, certaines railleries qui, adressées à de la Vigne, me parurent passer par-dessus la tête de celui-ci pour frapper sur moi.
--Alors tu as bien fait, dit-elle.
--Peut-être; mais où j'ai eu tort, ça été en ne m'arrêtant pas à temps.
--Qui s'arrête à temps?
--Toutes les ivresses sont les mêmes; il arrive un moment où l'on ne sait plus ce qu'on fait, et où l'on est le jouet d'impulsions mystérieuses, auxquelles on obéit, avec la conscience parfaitement nette qu'on est misérable de les subir. C'est mon cas; ce qui n'atténue en rien ma responsabilité.
Le lendemain, non le matin comme le voulait Anie, mais dans l'après-midi, aussitôt que Sixte fut libre, ils partirent en voiture pour Ourteau où ils arrivèrent à la nuit tombante. Barincq qui rentrait à ce moment même se trouva juste à point pour donner la main à sa fille descendant du phaéton.
--Quelle bonne surprise! dit-il en l'embrassant. Qui vous amène?
--Nous allons te dire ça, répondit Anie, quand nous serons avec maman.
--Enfin, vous êtes en bonne santé, c'est l'essentiel; et vous dînez avec nous, c'est la fête. Manuel, va vite dire à la cuisine que les enfants dînent.
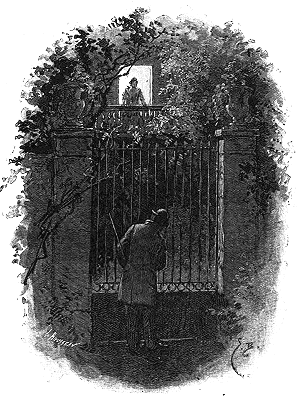
Justement, j'ai gardé ce matin un superbe saumon pour vous l'envoyer, nous le mangerons ensemble.
Il avait pris le bras de sa fille:
--Et ça ne peut se dire que devant ta mère, votre affaire?
--Cela vaut mieux.
--Alors, allons la rejoindre tout de suite.
Ils entrèrent dans le salon où se tenait Mme Barincq, sous la lumière de la lampe, coupant une revue qu'elle ne lirait jamais et à laquelle elle n'était abonnée que parce qu'elle trouvait cela «châtelain».
--Anie a quelque chose à nous annoncer, dit-il.
Il n'y avait pas à reculer.
--Un accident, dit-elle, qui la nuit, dernière, est arrivé à mon mari.
--Un accident! s'écrièrent en même temps le mari et la femme.
--Dans une réunion chez M. d'Arjuzanx, il a été entraîné à jouer, et il a perdu...
--Soixante-cinq mille francs, acheva Sixte.
--Soixante-cinq mille francs! répéta Mme Barincq en laissant tomber sa revue et son couteau à papier.
--Que nous venons te demander, papa, dit Anie en regardant son père.
--Il est évident que ce n'est pas vous qui pouvez les payer, répondit-il d'un ton tout franc.
--Et les dettes de jeu se paient dans les vingt-quatre heures, dit Anie.
--C'est certain.
Depuis le mariage, Mme Barincq, au contact du bonheur de sa fille, s'était singulièrement adoucie à l'égard de Sixte, qu'elle n'appelait que mon cher Valentin, mon bon gendre, ou mon enfant tout court, mais la perte des soixante-cinq mille francs la suffoqua.
--Comment, monsieur! vous perdez soixante-cinq mille francs! dit-elle.
--Hélas! ma mère.
--Et comment avez-vous perdu soixante-cinq mille francs?
--Le comment ne signifie rien, interrompit Anie.
--Au contraire, il signifie tout; vous êtes donc joueur, monsieur?
--On n'est pas joueur parce que par hasard on perd une somme au jeu, continua Anie.
Sans répondre à sa fille, Mme Barincq se leva et, s'adressant à son mari:
--Ainsi, dit-elle, vous avez marié ma fille à un joueur!
--Mais, chère amie...
--Je ne vous fais pas de reproches, vous êtes assez malheureux de votre faute, pauvre père, mais enfin vous l'avez sacrifiée.
Puis tout de suite, se retournant vers son gendre:
--Comment n'avez-vous pas eu la loyauté de nous prévenir que vous étiez joueur?
--Mais, maman, interrompit Anie, Valentin n'est pas joueur; il y a dix ans qu'il n'avait touché aux cartes.
--Eh bien, quand il y touche, ça nous coûte cher!
Barincq crut que ce mot lui permettait d'arrêter la scène qui, pour lui, était d'autant plus injuste que tout bas il se disait que Sixte avait bien le droit de perdre ce qui lui appartenait.
--Donc il n'y a qu'à payer, conclut-il.
Mais sa femme ne se laissa pas couper la parole:
--Je ne fais pas de reproches à M. Sixte, reprit-elle, seulement je répète que quand on entre dans une famille, on doit avouer ses vices...
--Mais Valentin n'a pas de vices, maman.
--C'est peut-être une vertu de jouer. Je dis encore que quand un homme a le bonheur inespéré... pour bien des raisons, d'être distingué par une jeune fille accomplie, et d'entrer dans une famille... une famille accomplie aussi, il doit se trouver assez honoré et assez heureux pour ne pas chercher des distractions ailleurs...
Pendant que Mme Barincq parlait avec une véhémence désordonnée, Anie regardait son mari qui, immobile, calme en apparence, mais très pâle, ne bronchait pas; elle coupa la parole à sa mère:
--Allons-nous-en, dit-elle à son mari.
Mais son père la prenant par la main la retint:
--Ni les paroles de ta mère, dit-il, ni ton départ n'ont de raison d'être. Dans la situation présente, il n'y a qu'une chose à faire: payer. C'est à quoi nous devons nous occuper.
--Où est l'argent? demanda Mme Barincq.
--Je ne l'ai pas; mais je le trouverai. Sixte, mon cher enfant, accompagnez-moi chez Rébénacq. Et toi, Anie, reste avec ta mère, à qui tu feras entendre raison.
--J'ai besoin de te parler, s'écria Mme Barincq en faisant signe à son mari de la suivre.
--Et tu n'a rien dit du testament! s'écria Anie en se jetant dans les bras de son mari quand son père et sa mère furent sortis, ah! cher, cher!
--C'est lui justement qui m'a si bien fermé les lèvres; et puis, quand ta mère me disait qu'un mari qui a eu le bonheur de trouver une femme telle que toi n'a pas à chercher de distractions autre part, elle n'avait que trop raison.
--Tu es un ange.
VII
Non seulement Barincq n'avait pas soixante-cinq mille francs dans sa caisse ou chez son banquier, pour les donner à Sixte, mais encore il n'en avait pas même dix mille, ni même cinq mille.
L'argent liquide trouvé dans la succession de Gaston et toutes les valeurs mobilières avaient été absorbés par la transformation de la terre d'Ourteau, défrichements, constructions, achat des machines, acquisition des vaches, des porcs, et si complètement qu'il n'avait pu faire face aux dépenses du mariage d'Anie que par un emprunt.
Mais cela n'était pas pour l'inquiéter: la réalité avait justifié toute ses prévisions, aucun de ses calculs ne s'était trouvé faux, et avant quelques années sa terre transformée donnerait tous les résultats qu'il attendait de cette transformation et même les dépasserait largement: c'était la fortune certaine, une belle fortune, et si facile à gérer, qu'au cas où il viendrait à disparaître, Anie et Sixte n'auraient qu'à en confier l'administration à un brave homme pour qu'elle continuât à leur fournir pendant de longues années les mêmes revenus.
(A suivre.)
Hector Malot.
