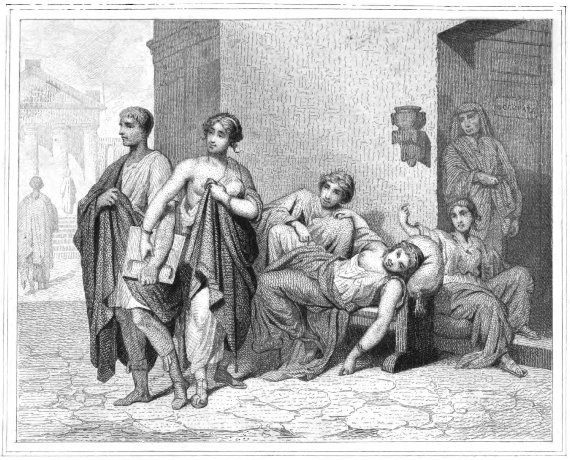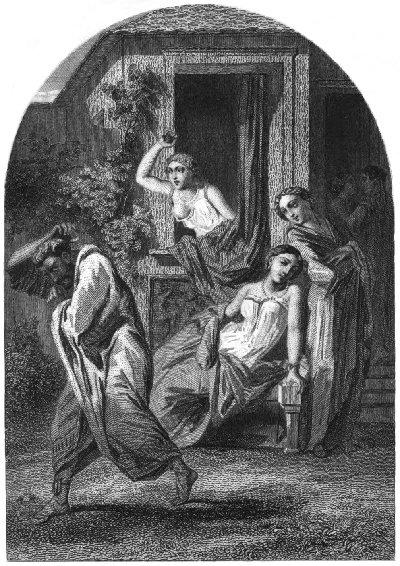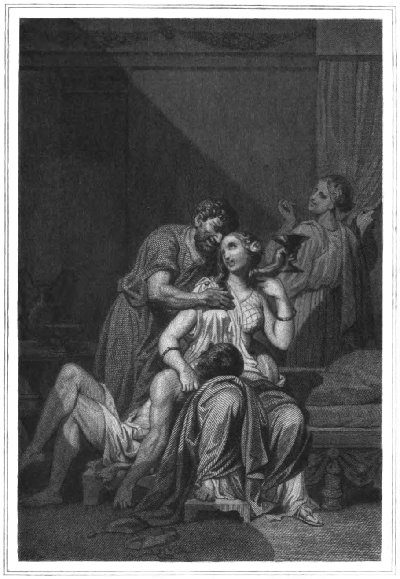The Project Gutenberg EBook of Histoire de la prostitution chez tous les
peuples du monde depuis l'antiquité la p, by Pierre Dufour
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
Title: Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 2/6
Author: Pierre Dufour
Release Date: September 13, 2013 [EBook #43712]
Language: French
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HISTOIRE DE LA PROSTITUTION 2/6 ***
Produced by Laurent Vogel, Bibimbop, Guy de Montpellier
and the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned
images of public domain material from the Google Print
project.)
Note de transcription:
Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été
corrigées. Il y a une note plus détaillée
à la fin de ce livre.
Ce texte contient quelques mots et expressions en Grec, comme φαγέδαινα.
Si ceux-ci n’apparaissent pas correctement, veuillez vérifier le jeu de caractères
utilisé pour l’affichage. Vous pouvez également
faire glisser votre souris sur le texte et la translittération en
caractères latins apparaîtra.
La Table des matières se trouve ici.
HISTOIRE
DE LA
PROSTITUTION
CHEZ TOUS LES PEUPLES DU MONDE
DEPUIS
L’ANTIQUITÉ LA PLUS RECULÉE JUSQU’A NOS JOURS,
PAR
PIERRE DUFOUR,
Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes
françaises et étrangères.
ÉDITION ILLUSTRÉE
Par 20 belles gravures sur acier, exécutées par les
Artistes les plus éminents.
TOME SECOND
PARIS.—1851.
SERÉ, ÉDITEUR, 5, RUE DU PONT-DE-LODI;
ET CHEZ MARTINON, RUE DU COQ SAINT-HONORÉ, 4.
TYPOGRAPHIE PLON FRÈRES,
RUE DE VAUGIRARD, 36, A PARIS.
HISTOIRE
DE LA
PROSTITUTION
CHEZ TOUS LES PEUPLES DU MONDE
DEPUIS
L’ANTIQUITÉ LA PLUS RECULÉE JUSQU’A NOS JOURS,
PAR
PIERRE DUFOUR,
Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes
françaises et étrangères.
TOME DEUXIÈME.
PARIS—1851
SERÉ, ÉDITEUR, 5, RUE DU PONT-DE-LODI,
ET
P. MARTINON, RUE DU COQ-SAINT-HONORÉ.
HISTOIRE
DE
LA PROSTITUTION.
Sommaire.—Les lieux de Prostitution à Rome.—Leurs différentes
catégories.—Les quarante-six lupanars d’utilité publique.—Les
quatre-vingts bains de la première région.—Le petit sénat
des femmes, fondé par Héliogabale.—Les lupanars de la région
Esquiline, de la région du grand Cirque, et de la région du temple
de la Paix.—La Suburre.—Les cellules voûtées du grand Cirque.—Les
Cent Chambres du port de Misène.—Description
d’un lupanar.—Les cellules des prostituées.—L’écriteau.—Ameublement
des chambres.—Peintures obscènes.—Décoration
intérieure des cellules.—Lupanars des riches.—Origine
du mot fornication.—Les stabula ou lupanars du dernier ordre.—Les
pergulæ ou balcons.—Les turturillæ ou colombiers.—Le
casaurium ou lupanar extra-muros.—Origine du mot casaurium.—Les
scrupedæ ou pierreuses.—Meritoria et Meritorii.—Les
ganeæ ou tavernes souterraines.—Origine du mot lustrum.—Personnel
d’un lupanar.—Le leno et la lena.—Les ancillæ
ornatrices.—Les aquarii ou aquarioli.—Le bacario.—Le
villicus.—Adductores, conductores et admissarii.—Costume
des meretrices dans les lupanars.—Fêtes qui avaient lieu dans
[6]
les lupanars à l’occasion des filles qui se prostituaient pour la
première fois, et lors de l’ouverture d’un nouveau lupanar.—Loi
Domitienne relative à la castration.—Les castrati, les spadones
et les thlibiæ.—Messaline au lupanar.—Le prix de la virginité
de Tarsia, et le prix courant de ses faveurs.—Tableau
d’un lupanar romain, par Pétrone.—Salaire des lupanars.—Dissertation
sur l’écriteau de Tarsia.—Prix de la location d’une
cellule.—Les quadrantariæ et les diobolares.
Les lieux de Prostitution à Rome étaient, devaient
être aussi nombreux que les prostituées; ils
présentaient aussi bien des variétés, que leur nom
se chargeait de signaler ordinairement, de même
que les noms des filles publiques caractérisaient
également les différents genres de leur métier. Il y
avait, comme nous l’avons dit, deux grandes catégories
de filles, les sédentaires et les vagantes,
les diurnes et les nocturnes; il y avait aussi deux
principales espèces de maisons publiques, celles qui
n’étaient destinées qu’à l’exercice de la Prostitution
légale, les lupanars proprement dits, et celles qui,
sous divers prétextes, donnaient asile à la débauche
et lui offraient, pour ainsi dire, les moyens de se cacher,
comme les cabarets, les tavernes, les bains, etc.
On comprend que ces établissements, toujours suspects
et mal famés, n’étaient point entretenus sur
le même pied, et recevaient, de la Prostitution qui
s’y glissait sournoisement ou qui s’y installait avec
effronterie, un aspect particulier, une physionomie
locale, une vie plus ou moins animée, plus ou moins
indécente.
[7]
Publius Victor, dans son livre des Lieux et des
Régions de Rome, constate l’existence de quarante-six
lupanars; mais il n’entend parler que des plus importants,
qui pouvaient être regardés comme des
fondations d’utilité publique et qui étaient placés
sous la surveillance directe des édiles. Il serait difficile
d’expliquer autrement ce petit nombre de lupanars,
en comparaison du grand nombre des mérétrices.
Sextus Rufus, dans sa nomenclature des
Régions de Rome, n’énumère pas les lupanars qui
s’y trouvaient, mais il le laisse assez entendre, en
comptant quatre-vingts bains dans la première région,
dite de la porte Capène, outre les Thermes de Commode,
ceux de Sévère, et plusieurs bains qu’il
désigne par les noms de leurs fondateurs ou de leurs
propriétaires. Il ne cite, d’ailleurs, nominativement
qu’un seul lupanar; créé par Héliogabale dans la
sixième région, sous l’insolente dénomination de
petit sénat des femmes (senatulum mulierum). Il n’y
a pas dans les auteurs latins une seule description
complète de lupanar; mais on peut la faire aisément,
avec la plus scrupuleuse exactitude, d’après cinq
ou six cents passages des poëtes, qui conduisent
sans façon leurs lecteurs dans ces endroits, qu’ils
supposaient sans doute leur être familiers. On doit
penser que si l’organisation intérieure des lupanars
était à peu près la même dans tous, ils différaient
d’ameublement, en raison du quartier où ils étaient
situés. Ainsi, les plus sales et les plus populaciers
[8]
furent certainement ceux de la cinquième région,
dite Esquiline, et ceux de la onzième région, dite
du grand Cirque; les plus élégants et les plus convenables,
ceux de la quatrième région, dite du temple
de la Paix, laquelle renfermait le quartier de
l’Amour et celui de Vénus. Quant à la Suburre, située
dans la deuxième région, dite du mont Cœlius,
elle réunissait autour du grand marché (macellum
magnum) et des casernes de troupes étrangères
(castra peregrina) une foule de maisons de Prostitution
(lupariæ), comme les qualifie Sextus Rufus dans
sa nomenclature, et un nombre plus considérable
encore de cabarets, d’hôtelleries, de boutiques de
barbiers (tabernæ) et de boulangeries. Les autres
régions de la ville n’étaient point exemptes du fléau
des lupariæ, puisqu’elles possédaient aussi des boulangers,
des barbiers et des hôteliers; mais ces
mauvais lieux y furent toujours rares et peu fréquentés:
les édiles avaient soin, d’ailleurs, de les
repousser autant que possible dans les régions éloignées
du centre de la ville, d’autant plus que la
clientèle ordinaire de ces lieux-là habitait les faubourgs
et les quartiers plébéiens. Ce fut, de tout
temps, autour des théâtres, des cirques, des marchés
et des camps, que les lupanars se groupaient
à l’envi, pour lever un plus large tribut sur les passions
et la bourse du peuple.
Le grand Cirque paraît avoir été entouré de cellules
voûtées (cellæ et fornices), qui ne servaient qu’à
[9]
la Prostitution pour l’usage du bas peuple, avant,
pendant et après les jeux; mais il ne faudrait pas
faire entrer ces asiles de débauche, accrédités par
l’usage, dans la catégorie des lupanars réglementés
par la police édilienne. Prudentius, en racontant le
martyre de sainte Agnès, dit positivement que les
grandes voûtes et les portiques qui subsistaient encore
de son temps auprès du grand Cirque, avaient
été abandonnés à l’exercice public de la débauche; et
Panvinius, dans son traité des Jeux du Cirque, conclut,
de ce passage, que tous les cirques avaient également
des lupanars, comme annexes indispensables. On sait,
en effet, que les mérétrices qui assistaient aux solennités
du cirque et aux représentations du théâtre,
quittaient leur siége aussi souvent qu’elles étaient appelées,
pour contenter des désirs qui se multipliaient
et s’échauffaient autour d’elles. Le savant jésuite
Boulenger, dans son traité du Cirque, n’hésite pas à
déclarer que la Prostitution avait lieu dans le Cirque,
dans le théâtre même, et il cite ce vers d’un vieux
poëte latin, en l’honneur d’une courtisane bien connue
au grand Cirque: Deliciæ populi, magno notissima
Circo Quintilia. En effet, sous les gradins que
le peuple occupait, se croisaient des voûtes formant
de sombres retraites, favorables à la Prostitution
populaire, qui ne demandait pas tant de raffinements.
On serait presque autorisé à donner la
même destination aux ruines d’une immense construction
souterraine, qu’on voit encore près de l’ancien
[10]
port de Misène, et qu’on appelle toujours les
Cent Chambres (centum cameræ). Il est probable que
ce singulier édifice, dont l’usage est resté ignoré et
incompréhensible, n’était qu’un vaste lupanar approprié
aux besoins des équipages de la flotte romaine.
Mais habituellement les lupanars, loin d’être établis
sur d’aussi gigantesques proportions, ne contenaient
qu’un nombre assez borné de cellules très-étroites,
sans fenêtres, n’ayant pas d’autre issue qu’une porte,
qui n’était fermée souvent que par un rideau. Le
plan d’une des maisons de Pompéï peut donner une
idée fort juste de ce qu’était un lupanar, quant
à l’ordonnance des cellules, qui s’ouvraient sans
doute sous un portique et sur une cour intérieure,
comme dans ces maisons où les chambres à coucher
(cubiculi), généralement fort exiguës et contenant à
peine la place d’un lit, ne sont éclairées que par une
porte, où deux personnes ne passeraient pas de
front. Les chambres étaient seulement plus nombreuses
et plus rapprochées les unes des autres
dans les lupanars. Pendant le jour, l’établissement
étant fermé n’avait pas besoin d’enseigne, et ce
n’était qu’un luxe inutile lorsque le maître du lieu
faisait peindre sur la muraille l’attribut obscène de
Priape: on en suspendait la figure à l’entrée du
repaire qui lui était dédié. Le soir, dès la neuvième
heure, un pot à feu ou une grosse lampe en forme de
phallus servait de phare à la débauche, qui s’y
[11]
rendait d’un pas hardi ou qui y était quelquefois
attirée par hasard. Les filles se rendaient chacune à
son poste avant l’ouverture de la maison; chacune
avait sa cellule accoutumée, et devant la porte de cette
cellule, un écriteau sur lequel était inscrit le nom
d’emprunt (meretricium nomen) que portait la courtisane
dans l’habitude de son métier. Souvent, au-dessous
du nom, se trouvait marqué le taux de l’admission
dans la cellule, pour éviter des réclamations
de part et d’autre. La cellule était-elle occupée, on retournait
l’écriteau, derrière lequel on lisait: OCCUPATA.
Quand la cellule n’avait pas d’occupant, on disait,
dans le langage de l’endroit, qu’elle était nue (nuda).
Plaute, dans son Asinaria, et Martial, dans ses
épigrammes, nous ont conservé ces détails de
mœurs. «Qu’elle écrive sur sa porte, dit Plaute:
Je suis occupée.» Ce qui prouve qu’en certaines circonstances,
l’inscription était tracée à la craie ou au
charbon par la courtisane elle-même. «L’impudique
lena, dit Martial, ferme la cellule dégarnie d’amateur»
(obscena nudam lena fornicem clausit). Un passage
de Sénèque, mal interprété, avait fait croire que
dans certains lupanars, les mérétrices, qui se tenaient
en dehors de la porte, portaient l’écriteau pendu au
cou et même attaché au front; mais on a mieux
compris cette phrase: Nomen tuum pependit in fronte;
stetisti cum meretricibus, en voyant cet écriteau suspendu
devant la porte (in fronte), tandis que les
filles restaient assises à côté.
[12]
Les chambres étaient meublées à peu près toutes
de la même manière; la différence ne consistait que
dans le plus ou moins de propreté du mobilier et
dans les peintures qui ornaient les cloisons. Ces
peintures à la détrempe et à l’eau d’œuf représentaient,
soit en tableaux, soit en ornements, les
sujets les plus conformes à l’usage habituel du local:
c’étaient, dans les lupanars du peuple, des scènes
grossières de la Prostitution; dans les lupanars d’un
ordre plus relevé, c’étaient des images érotiques
tirées de la mythologie; c’étaient des allégories aux
cultes de Vénus, de Cupidon, de Priape et des dieux
lares de la débauche. Le phallus reparaissait sans
cesse sous les formes les plus bouffonnes; il devenait
tour à tour oiseau, poisson, insecte; il se blottissait
dans des corbeilles de fruits; il poursuivait
les nymphes sous les eaux et les colombes dans les
airs; il s’enroulait en guirlandes, il se tressait en
couronnes: l’imagination du peintre semblait se
jouer avec le signe indécent de la Prostitution,
comme pour en exagérer l’indécence; mais ce qui
est remarquable, dans ces peintures si bien appropriées
à la place qu’elles occupaient, on ne voyait
jamais figurer isolément l’organe de la femme,
comme si ce fût une convention tacite de le respecter
dans le lieu même où il était le plus méprisable. Au
reste, les mêmes scènes, les mêmes images, se rencontraient
souvent dans l’ornementation peinte des
chambres à coucher conjugales: la pudeur des yeux
[13]
n’existait plus chez les Romains, qui avaient presque
déifié la nudité. La décoration intérieure des cellules
du lupanar ne se recommandait pas, d’ailleurs,
par sa fraîcheur et par son éclat: la fumée des
lampes et mille souillures sans nom déshonoraient les
murailles qui portaient çà et là les stigmates de leurs
hôtes inconnus. Quant à l’ameublement, il se composait
d’une natte, d’une couverture et d’une lampe.
La natte, d’ordinaire grossièrement tressée en jonc
ou en roseau, était souvent déchiquetée et toujours
usée, aplatie; on la remplaçait, dans quelques maisons,
par des coussins et même par un petit lit en
bois (pulvinar, cubiculum, pavimentum); la couverture,
hideusement tachée, n’était qu’un misérable
assemblage de pièces, en étoffes différentes, qu’on
appelait, à cause de cela, cento ou rapiéçage. La
lampe, en cuivre ou en bronze, répandait une clarté
indécise à travers une atmosphère chargée de miasmes
délétères qui empêchaient l’huile de brûler et
la flamme de s’élever au-dessus de son auréole fumeuse.
Ce misérable mobilier était choisi exprès,
pour que personne n’eût l’idée de se l’approprier: il
n’y avait rien à voler dans ces lieux-là.
Cependant il est certain, d’après les désignations
mêmes des maisons de débauche, qu’elles n’étaient
pas toutes fréquentées par la vile populace, et qu’elles
offraient par conséquent de notables différences
en leur régime intérieur. Dans les lupanars les
mieux ordonnés, une fontaine et un bassin ornaient
[14]
la cour carrée, impluvium, autour de laquelle on
avait ménagé les cellules ou chambres, cellæ; ailleurs,
ces chambres se nommaient sellæ, siéges à
s’asseoir, parce qu’elles étaient trop petites pour y
mettre un lit. Mais dans les lupanars réservés exclusivement
à la plèbe, et qui n’étaient autres que
des caves ou des souterrains, chaque cellule, étant
voûtée, se nommait fornix; c’est de ce mot-là, devenu
bientôt synonyme de lupanar, qu’on a fait fornication,
pour exprimer ce qui se passait dans les
ténèbres des fornices. L’odeur infecte de ces voûtes
était proverbiale, et ceux qui y avaient pénétré portaient
longtemps avec eux cette odeur nauséabonde
dans laquelle on ne sentait pas seulement la fumée
et l’huile: Olenti in fornice, dit Horace, redolet adhuc
fuliginum fornicis, dit Sénèque. Il y avait des
lupanars du dernier ordre, qu’on appelait stabula,
parce que les visiteurs y étaient reçus pêle-mêle sur
la paille, comme dans une écurie. Les pergulæ ou
balcons devaient ce surnom à leur genre de construction:
ici, une galerie ouverte régnait le long
du premier étage et surplombait la voie publique;
les filles étaient mises en montre sur cette espèce
d’échafaud, et le lénon ou la léna se tenait, en bas,
à la porte; là, au contraire, lénon ou léna occupait
une fenêtre haute et dominait du regard son troupeau
de garçons ou de filles. Quelquefois la pergula
n’était qu’une petite maison basse à auvent, sous
lequel étaient assises les victimes de l’un et de l’autre
[15]
sexe. Quand le lupanar était surmonté d’une sorte
de tour ou de pyramide, en haut de laquelle on
allumait le soir un fanal, on l’appelait turturilla ou
colombier, parce que les tourterelles ou les colombes y
avaient leur nid; saint Isidore de Séville, en parlant
de ces nids-là, se permet un jeu de mots assez peu
orthodoxe: Ita dictus locus, quo corruptelæ fiebant,
quod ibi turturi opera daretur, id est peni. Le casaurium
était le lupanar extra-muros, simple cabane
couverte de chaume ou de roseaux, qui servait de
retraite à la troupe errante des filles en contravention
avec la police de l’édile. Le mot casaurium,
dans la bouche du peuple, ne semblait pas venir de
plus loin que casa, chaumière, hutte, ou baraque;
mais les savants retrouvaient dans ce mot-là l’étymologie
grecque de κασσα ou de κασαυρα, qui signifiait
meretrix: κασαυρα avait fait tout naturellement
casaurium. C’était dans ces bouges que se réfugiaient
quelquefois les scrupedæ (pierreuses), que la
Prostitution cachait ordinairement au milieu des
pierres et des décombres.
Les lupanars avaient, en outre, des noms généraux
qui s’appliquaient à tous sans distinction: «Meritoria,
dit saint Isidore de Séville, ce sont les lieux
secrets où se commettent les adultères.» C’étaient
surtout ceux consacrés à la Prostitution des hommes,
des enfants, des meritorii. «Ganeæ, dit Donatius,
ce sont des tavernes souterraines, où l’on fait la
débauche, et dont le nom dérive du grec, γας,
[16]
terre;» «Ganei, dit le jésuite Boulenger, ce sont des
boutiques de Prostitution, ainsi nommées par analogie
avec γανος, volupté, et γυνη, femme.» On employait
fréquemment l’expression de lustrum dans le sens
de lupanar, et ce qui n’avait été d’abord qu’un jeu
de mots était devenu une locution usuelle où l’on
ne cherchait plus malice. Lustrum signifiait à la fois
expiation et bois sauvage. Les premiers errements de
la Prostitution s’enfonçaient dans l’ombre épaisse
des forêts, et depuis, comme pour expier ces mœurs
de bête fauve, les prostituées payaient un impôt
lustral expiatoire: de là l’origine du mot lustrum
pour lupanar. «Ceux qui, dans les lieux retirés et
honteux, s’abandonnent aux vices de la gourmandise
et de l’oisiveté, dit Festus, méritent qu’on les
accuse de vivre en bêtes (in lustris vitam agere).»
Le poëte Lucilius nous fait encore mieux comprendre
la véritable portée de cette expression dans ce vers:
«Quel commerce fais-tu donc en quêtant autour des
murs dans les endroits écartés? (in lustris circum oppida
lustrans).» On appliquait avec raison le nom de
desidiabula aux lupanars, pour représenter l’oisiveté
de ses malheureux habitants. S’il n’y avait que des
femmes dans un établissement de Prostitution, il
prenait les noms de sénat des femmes, de conciliabule,
de cour des mérétrices (senatus mulierum, conciliabulum,
meretricia curia, etc.); et selon que ces noms
étaient pris en bonne ou en mauvaise part, les épithètes
qu’on y ajoutait en complétaient le sens;
[17]
Plaute traite aussi de conciliabule de malheur un de
ces lieux infâmes. Quand l’une et l’autre Vénus,
suivant le terme latin le plus décent, trouvait à se
satisfaire dans ces repaires, on les qualifiait pompeusement
de réunion de tous les plaisirs (libidinum
consistorium).
Le personnel d’un lupanar variait autant que sa
clientèle. Tantôt le leno ou la lena n’avait dans son
établissement que des esclaves achetés de ses deniers
et formés par ses leçons; tantôt ce personnage n’était
que le propriétaire du local et servait seulement
d’intermédiaire à ses clientes, qui lui laissaient une
part dans les bénéfices de chaque nuit; ici, le maître
ou la maîtresse du logis suffisait à tout, préparait
les écriteaux, discutait les marchés, apportait de
l’eau ou des rafraîchissements, faisait sentinelle et
gardait les cellules occupées; là, ces spéculateurs
dédaignaient de se mêler de ces menus détails: ils
avaient des servantes et des esclaves qui vaquaient
chacun à son emploi spécial; les ancillæ ornatrices
veillaient à la toilette des sujets, réparaient les désordres
de la toilette et refardaient le visage; les
aquarii ou aquarioli distribuaient des boissons rafraîchissantes,
de l’eau glacée, du vin et du vinaigre
aux débauchés qui se plaignaient de la chaleur
ou de la fatigue; le bacario était un petit esclave
qui donnait à laver et présentait l’eau dans un vase
(bacar) à long manche et à long goulot; enfin, le
villicus ou fermier avait pour mission de débattre les
[18]
prix avec les clients et de se faire payer, avant de
retourner l’écriteau d’une cellule. Il y avait, en
outre, des hommes et des femmes attachés à l’établissement,
pour pratiquer en sous-ordre le lenocinium;
pour aller aux alentours du lupanar recruter
des chalands; pour appeler, pour attirer, pour entraîner
les jeunes et les vieux libertins: de là leurs
dénominations d’adductores, de conductores, et surtout
d’admissarii. Ces émissaires de Prostitution tiraient
ce nom de ce qu’ils étaient toujours prêts, au
besoin, à changer de rôle et à se prostituer eux-mêmes,
si l’occasion s’offrait d’exciter à la débauche
pour leur propre compte. Au reste, dans la langue
des éleveurs et des paysans romains, admissarius
était tout simplement, tout naïvement, l’étalon, le
taureau, qu’on amène à la vache ou à la jument.
Cicéron, dans son discours contre Pison, nous donne
une preuve de la monomanie de ces chasseurs
d’hommes et de ces chercheurs de plaisir: «Or, cet
admissaire, dès qu’il sut que ce philosophe avait fait
un grand éloge de la volupté, se sentit piqué au
vif, et il stimula tous ses instincts voluptueux, à cette
pensée qu’il avait trouvé non pas un maître de
vertu, mais un prodige de libertinage.»
Le costume des meretrices dans les lupanars n’était
caractérisé que par la coiffure, qui consistait en
une perruque blonde; car la courtisane prouvait
par là qu’elle n’avait aucune prétention au titre
de matrone, toutes les Romaines ayant des cheveux
[19]
noirs qui témoignaient pour elles de leur naissance
ingénue. Cette perruque blonde, faite avec des
cheveux ou des crins dorés et teints, semble avoir
été la partie essentielle du déguisement complet que
la courtisane affectait en se rendant au lupanar; où
elle n’entrait même qu’avec un nom de guerre ou
d’emprunt. Elle devait, d’ailleurs, sur d’autres points,
éviter toute ressemblance avec les femmes honnêtes;
ainsi, elle ne pouvait porter la bandelette (vitta),
large ruban avec lequel les matrones tenaient leurs
cheveux retroussés; elle ne pouvait revêtir une
stole, longue tunique tombant sur les talons, réservée
exclusivement aux matrones: «Ils appelaient
matrones, dit Festus, celles qui avaient le droit d’avoir
des stoles.» Mais les règlements de l’édile
relatifs à l’habillement des courtisanes ne concernaient
pas celui qu’elles adoptaient pour le service
des lupanars. Ainsi, dans la plupart, étaient-elles
nues, absolument nues ou couvertes d’un voile de
soie transparent, sous lequel on ne perdait aucun
secret de leur nudité, mais toujours coiffées de la perruque
blonde, ornée d’épingles d’or, ou couronnée
de fleurs. Non-seulement elles attendaient nues dans
leurs cellules, ou bien se promenant sous le portique
(nudasque meretrices furtim conspatiantes, dit
Pétrone), mais encore, à l’entrée du lupanar, dans
la rue, sous le regard des passants: Juvénal, dans
sa XIe satire, nous montre un infâme giton sur le
seuil de son antre puant (nudum olido stans fornice).
[20]
Souvent, à l’instar des prostituées de Jérusalem et
de Babylone, elles se voilaient la face, en laissant le
reste du corps sans voile, ou bien elles ne couvraient
que leur sein avec une étoffe d’or (tunc nuda papillis
prostitit auratis, dit Juvénal). Les amateurs (amatores)
n’avaient donc qu’à choisir d’après leurs goûts.
Le lieu n’était, d’ailleurs, que faiblement éclairé par
un pot à feu ou par une lampe qui brûlait à la porte,
et l’œil le plus perçant ne découvrait dans le rayon
lumineux que des formes immobiles et des poses
voluptueuses. Dans l’intérieur des cellules, on n’en
voyait pas beaucoup davantage, quoique les objets
fussent rapprochés de la vue, «et parfois même,
la lampe s’éteignant faute d’air ou d’huile, on ne
savait pas même, dit un poëte, si l’on avait affaire
à Canidie ou à son aïeule.»
Lorsqu’une malheureuse, lorsqu’une pauvre enfant
se sacrifiait pour la première fois, c’était fête au
lupanar; on appendait à la porte une lanterne qui
jetait une lumière inaccoutumée sur les abords de
ce mauvais lieu; on entourait de branches de laurier
le frontispice de l’horrible sanctuaire: ces lauriers
outrageaient la pudeur publique pendant plusieurs
jours; et quelquefois, le sacrifice consommé,
l’auteur de cette vilaine action, qu’il payait plus
cher, sortait du bouge, couronné lui-même de lauriers.
Cet impur ennemi de la virginité s’imaginait
avoir remporté là une belle victoire, et la faisait
célébrer par des joueurs d’instruments qui appartenaient
[21]
aussi au personnel de la débauche. Un tel
usage, toléré par l’édile, était un outrage d’autant
plus sanglant pour les mœurs, que les nouveaux
mariés conservaient, surtout dans le peuple, une
coutume analogue, et ornaient aussi de branches de
laurier les portes de leur demeure le lendemain des
noces. «Ornentur, dit Juvénal, postes et grandi janua
lauro.» Tertullien dit aussi en parlant de la nouvelle
épouse: «Qu’elle ose sortir de cette porte
décorée de guirlandes et de lanternes, comme d’un
nouveau consistoire des débauches publiques.»
On pourrait aussi entendre que l’établissement et
l’ouverture d’un nouveau lupanar donnaient lieu à
ce déploiement de lauriers et d’illuminations. En
lisant Martial, Catulle et Pétrone, on est forcé, avec
tristesse, avec horreur, d’avouer que la Prostitution
des enfants mâles, dans les lupanars de Rome, était
plus fréquente que celle des femmes. Ce fut Domitien
qui eut l’honneur de défendre cette exécrable
Prostitution, et si la loi qu’il décréta pour l’empêcher
ne fut pas rigoureusement observée, on doit
croire qu’elle arrêta les progrès effrayants de ces
monstruosités. Martial adresse à l’empereur cet éloge,
qui nous permet de suppléer au silence des historiens
sur la loi domitienne relative aux lupanars:
«Le jeune garçon, mutilé autrefois par l’art infâme
d’un avide trafiquant d’esclaves, le jeune garçon ne
pleure plus la perte de sa virilité, et la mère indigente
ne vend plus au riche entremetteur son fils,
[22]
destiné à la Prostitution. La pudeur qui, avant vous,
avait déserté le lit conjugal, a commencé à pénétrer
jusque dans les réduits de la débauche.» Ainsi
donc, sous Domitien, on ne châtra plus les enfants,
que l’on changeait ainsi en femmes pour l’usage de la
Prostitution, et Nerva confirma l’édit de son prédécesseur;
mais cette castration continua de se faire,
hors de l’empire romain, ou du moins hors de Rome,
et des marchands d’esclaves y amenaient sans cesse,
sur le marché public, de jeunes garçons mutilés de
différentes manières, que proscrivait la jurisprudence
romaine, tout en autorisant les prêtres de Cybèle
à faire des eunuques, et les maîtres, à retrancher,
en partie du moins, la virilité de leurs esclaves. On
connaissait donc trois espèces d’eunuques, toutes
trois utilisées par la débauche: castrati, ceux qui
n’avaient rien gardé de leur sexe; spadones, ceux
qui n’en avaient que le signe impuissant; et thlibiæ,
ceux qui avaient subi, au lieu du tranchant de l’acier,
la compression d’une main cruelle.
Nous ne trouvons dans les écrivains latins que
trois descriptions de l’intérieur d’un lupanar et de ce
qui s’y passait. Une de ces descriptions, la plus célèbre,
nous introduit avec Messaline dans le bouge
obscène où elle se prostitue aux muletiers de Rome:
«Dès qu’elle croyait l’empereur endormi, raconte
Juvénal dans son admirable poésie, que la prose est
incapable de rendre, l’auguste courtisane, qui osait
préférer au lit des Césars le grabat des prostituées, et
[23]
revêtir la cuculle de nuit destinée à s’y rendre, se
levait, accompagnée d’une seule servante. Cachant
ses cheveux noirs sous une perruque blonde, elle
entre dans un lupanar très-fréquenté, dont elle écarte
le rideau rapiécé; elle occupe une cellule qui est la
sienne; nue, la gorge couverte d’un voile doré, sous le
faux nom de Lysisca inscrit à sa porte, elle étale le
ventre qui t’a porté, noble Britannicus! Elle accueille
d’un air caressant tous ceux qui entrent et leur demande
le salaire; puis, couchée sur le dos, elle soutient
les efforts de nombreux assaillants. Enfin, quand le
lénon congédie ses filles, elle sort triste, et pourtant
elle n’a fermé sa cellule que la dernière; elle brûle
encore de désirs qu’elle n’a fait qu’irriter, et, fatiguée
d’hommes, mais non pas rassasiée, elle se
retire le visage souillé, les yeux éteints, noircie
par la fumée de la lampe; elle porte au lit impérial
l’odeur du lupanar.» La fière indignation du poëte
éclate dans ce tableau et en fait presque disparaître
l’obscénité. Après Juvénal, c’est tomber bien bas que
de citer un simple commentateur, Symphosianus,
qui a écrit sur l’Histoire d’Apollonius de Tyr ce roman
grec rempli de fables, que toutes les littératures
du moyen âge avaient adopté et popularisé: «La
jeune fille se prosterne aux pieds du lénon, dit
Symphosianus; elle s’écrie: Aie pitié de ma virginité
et ne prostitue pas mon corps en me déshonorant
par un honteux écriteau! Le lénon appelle le fermier
des filles, et lui dit: «Qu’une servante vienne la
[24]
parer et qu’on mette sur l’écriteau: Celui qui déflorera
Tarsia donnera une demi-livre d’argent (environ
150 fr. de notre monnaie); ensuite, elle sera livrée à
tout venant, moyennant une pièce d’or (20 fr.)» Ce
passage serait encore plus précieux pour l’histoire
des mœurs romaines, si l’on était plus sûr du sens
exact des mots mediam libram et singulos solidos,
qui établissent, les uns, le prix particulier de la virginité,
les autres, le salaire commun de la Prostitution.
Pétrone, dans son Satyricon, nous a laissé un
morceau trop curieux, trop important, pour que
nous ne le citions pas textuellement: c’est la peinture
d’un lupanar romain: «Las enfin de courir et
baigné de sueur, j’aborde une petite vieille qui vendait
de grossiers légumes: «Dites-moi, la mère,
dis-je, est-ce que vous ne savez pas où j’habite?»
Charmée d’une politesse si naïve: «Pourquoi ne le
saurais-je?» reprit-elle. Elle se lève et se met à
marcher devant moi. Je pensais que ce fût une devineresse;
mais bientôt, quand nous fûmes arrivés
dans un lieu très-écarté, cette aimable vieille tira
un mauvais rideau: «C’est ici, dit-elle, où vous
devez habiter (hic, inquit, debes habitare).» Comme
j’affirmais ne pas connaître la maison, je vis des gens
qui se promenaient entre des mérétrices nues et leurs
écriteaux. Je compris tard, et même trop tard, que
j’avais été amené dans un lieu de Prostitution. Détestant
les piéges de cette maudite vieille, je me
[25]
couvris la tête avec ma robe, et je me mis à fuir, au
milieu du lupanar, jusqu’à l’issue opposée (ad alteram
partem).» Ce dernier trait du récit sert à prouver
qu’un lupanar avait d’ordinaire deux issues: l’une
par où l’on entrait, l’autre par où l’on sortait, sans
doute sur deux rues différentes, afin de mieux cacher
les habitudes de ceux qui s’y rendaient. On
peut en conclure qu’il y avait pour un homme
estimé une sorte de honte à fréquenter ces lieux-là,
malgré la tolérance des mœurs romaines à cet égard.
Il est certain, d’ailleurs, d’après diverses autorités
qui confirment le témoignage de Pétrone, qu’on
n’entrait pas au lupanar et qu’on n’en sortait pas sans
avoir la tête couverte ou le visage caché; les uns portaient,
à cet effet, un cuculle ou capuchon rabattu
sur les yeux; les autres s’enveloppaient la tête avec
leur robe ou leur manteau. Sénèque, dans la Vie
heureuse, parle d’un libertin qui fréquentait les mauvais
lieux non pas timidement, non pas en cachette,
mais même à visage découvert (inoperto capite).
Capitolinus, dans l’Histoire Auguste, nous
montre aussi un empereur débauché, visitant la nuit
tavernes et lupanars, la tête couverte d’un cuculle
vulgaire (obtecto capite cucullo vulgari).
Quant au salaire des lupanars, il ne devait pas
être fixe, puisque chaque fille avait un écriteau indiquant
son nom et son prix. Le passage de Symphosianus,
cité plus haut, a égaré les commentateurs
qui ont cherché à évaluer, chacun à sa manière, le
[26]
tarif que le lénon avait fixé pour la défloration de
Tarsia et pour le prix courant de ses faveurs; car
les savants ne sont pas d’accord sur la valeur de la
livre et du sou dans l’antiquité. Symphosianus ne dit
pas, d’ailleurs, s’il s’agissait de la livre d’or ou de la
livre d’argent. Dans le premier cas, on a estimé que
la demi-livre demandée sur l’écriteau de Tarsia, à
titre de vierge, représentait 433 fr. de notre monnaie
actuelle; ce ne serait que 37 fr. 64 c., si le lénon
voulait parler d’une demi-livre d’argent. Nous avons
fait d’autres calculs et nous sommes arrivé à un
autre résultat. Selon nous, le prix de la prélibation
(primæ aggressionis pretium, disent les savants) aurait
été de 150 fr.; quant au taux des stuprations
suivantes, le docte Pierrugues le porte à 11 fr. 42 c.
pour le sou d’or, et à 78 c. pour le sou d’argent.
Nous avons trouvé, dans nos chiffres, que c’étaient
20 fr. Au reste, ce salaire n’avait rien d’uniforme,
et comme il ne fut jamais soumis à aucun contrôle
administratif, il variait suivant les mérites et la réputation
de la personne que faisait connaître son
écriteau nominatif. Cependant, il y a dans Pétrone
un détail précis qui nous permet de savoir à quel
prix on louait une cellule dans un lupanar: «Tandis
que j’errais, dit Ascylte, par toute la ville, sans
découvrir en quel endroit j’avais laissé mon gîte, je
fus abordé par un citoyen à l’air respectable, qui me
promit très-obligeamment de me servir de guide.
Entrant donc dans des ruelles tortueuses, il me conduisit
[27]
en ce mauvais lieu où il me fit ses propositions
malhonnêtes en tirant sa bourse. Déjà la dame
du lieu avait touché un as pour la cellule (jam pro
cellâ meretrix assem exegerat).» Si le louage d’une
cellule coûtait un as (un peu plus d’un sou), on
doit supposer que le reste ne se payait pas fort cher.
En effet, quand Messaline demande le salaire (æra
proposcit), Juvénal nous fait entendre clairement
qu’elle se contente de quelque monnaie de cuivre.
Nous avons déjà parlé ailleurs des prostituées qui ne
se taxaient qu’à deux oboles et à un quadrans, ce
qui les avait fait surnommer quadrantariæ et diobolares.
Festus explique ainsi le nom de celles-ci:
Diobolares meretrices dicuntur, quæ duobus obolis
ducuntur. C’était la concurrence qui avait fait tomber
si bas le salaire de la Prostitution.

- Alp. Cabasson del.
- Drouart imp.
- Alp. Leroy et F. Lefman. Sculp.
LUPANAR ROMAIN
Sommaire.—A quelle époque remonte l’établissement de la Prostitution
légale à Rome.—De l’inscription des prostituées.—Ce
que dit Tacite du motif de cette inscription.—Femmes et
filles de sénateurs réclamant la licencia stupri.—Avantages
que l’état et la société retiraient de l’inscription des courtisanes.—Le
taux de chaque prostituée fixé sur les registres de l’édile.—Serment
des courtisanes entre les mains de l’édile.—Pourquoi
l’inscription matriculaire des meretrices se faisait chez
l’édile.—De la compétence de l’édile, en matière de Prostitution.—Police
de la rue.—Les Prostitutions vagabondes.—Julie,
fille d’Auguste.—Police de l’édile dans les maisons publiques.—Les
édiles plébéiens et les grands édiles patriciens.—Ce qui
arriva à un édile qui voulut forcer la porte de la maison de la
meretrix Mamilia.—Des divers endroits où se pratiquait la
Prostitution frauduleuse.—Les bains publics.—La femme du
consul, aux bains de Teanum.—Luxe et corruption des bains
de Rome.—Mélange des sexes dans les bains publics.—Le bain
de Scipion.—Les balneatores et les aliptes.—Les débauchés de
la cour de Domitien, aux bains publics.—Bains gratuits pour le
bas peuple.—Bains de l’aristocratie et des gens riches.—Tolérance
de la Prostitution des bains.—Les serviteurs et servantes des
bains.—Les fellatrices et les fellatores.—Le fellateur Blattara et
la fellatrice Thaïs.—Zoïle.—La pantomime des Attélanes.—Les
cabarets.—Infamie attachée à leur fréquentation.—Description
d’une popina romaine.—Le stabulum.—Les cauponæ et
[30]
les diversoria.—Visites domiciliaires nocturnes de l’édile.—Les
caves des boulangeries.—Police édilitaire pour les lupanars.—Contraventions,
amendes et peines afflictives.—A quoi s’exposait
Messaline, en exerçant le meretricium dans un lupanar.—De
l’installation d’une femme dans un mauvais lieu.—Les
délégués de l’édile.—Heures d’ouverture et de fermeture des
lupanars et autres mauvais lieux publics.—Les meretrices au
Cirque.—La Prostitution des théâtres.—Les crieurs du théâtre.—La
Prostitution errante.—Les murs extérieurs des maisons
et des monuments, mis, par l’édilité, sous la protection d’Esculape
pour les préserver des souillures des passants.—Impudicité
publique des prostituées des carrefours et ruelles de Rome.—Catulle
retrouve sa Lesbia parmi ces femmes.—Le tribunal de
l’édile.—Distinction établie par Ulpien, entre appeler et poursuivre.—Pouvoirs
donnés par la loi aux pères et aux tuteurs
sur leurs fils et pupilles qui se livraient à la débauche.—Les
adventores.—Les venatores.—La jeunesse d’Alcinoüs.—Les
salaputii.—Le poëte Horace putissimum penem.—Les semitarii.—Adulter,
scortator et mœchus.—Mœchocinædus et
mœchisso.—Héliogabale aux lupanars.—Ordonnances somptuaires
relatives aux mérétrices.—Costume des courtisanes.—Leur
chaussure.—Leur coiffure.—Défense faite aux prostituées
de mettre de la poudre d’or dans leurs cheveux.—Les cheveux
bleus et les cheveux jaunes.—Costume national des prostituées
de Tyr et de Babylone.—L’amiculum ou petit ami.—Galbanati,
galbani et galbana.—La mitre, la tiare et le nimbe.—Origine
de ces trois coiffures.—Défense faite aux mérétrices
d’avoir des litières et des voitures.—Carmenta, inventrice des
voitures romaines.—La basterne et la litière.—La cella et l’octophore.—Les
lupanars ambulants.—La loi Oppia.
On ne saurait dire à quelle époque s’établit régulièrement
à Rome la Prostitution légale, ni quand
elle fut soumise à des lois de police, sous la juridiction
spéciale des édiles. Mais il est probable que
ces magistrats, dès le commencement de l’édilité,
qui remontait à l’an de Rome 260, s’occupèrent
[31]
d’imposer certaines limites à la Prostitution des rues,
et de lui tracer une sorte de jurisprudence dans l’intérêt
du peuple. Malheureusement, il n’est resté de
cette jurisprudence que des traits épars, douteux
ou presque effacés, qui permettent toutefois d’en apprécier
la sagesse et l’équité. On pourrait presque
assurer qu’aucune des dispositions prévoyantes de
la police moderne à l’égard des femmes de mauvaise
vie n’avait été négligée par l’édilité romaine. Cette
magistrature populaire avait reconnu qu’elle devait,
en laissant à ces femmes dégradées la plus grande
liberté possible, les empêcher d’exercer une sorte
d’usurpation effrontée sur les femmes de bien; voilà
pourquoi elle s’était attachée surtout à donner en
quelque sorte à la Prostitution un caractère public,
à lui infliger des marques distinctives, à la noter
d’infamie aux yeux de tous, afin de lui ôter l’envie
et les moyens de s’approprier indûment les priviléges
de la vertu et de la pudeur. En ne tolérant
pas qu’une courtisane pût être prise pour une matrone,
on épargnait à la matrone l’injure de pouvoir
être prise pour une courtisane. Le premier soin des
édiles fut donc de forcer la courtisane à venir elle-même
devant eux avouer sa profession infâme, en
leur demandant le droit de s’y livrer ouvertement
avec cette autorisation légale qu’on appelait licentia
stupri. Telle est l’origine de l’inscription des filles
publiques sur les registres de l’édile.
On ne possède, du reste, aucun renseignement
[32]
sur le mode de cette inscription: il paraît que toute
femme qui voulait faire métier de son corps (sui
quæstum facere), était tenue de se présenter devant
l’édile et de lui déclarer ce honteux dessein, que
l’édile essayait parfois de combattre par quelques
bons conseils. Si cette femme persistait, elle se faisait
enregistrer comme vouée désormais à la Prostitution;
elle indiquait son nom, son âge, le lieu
de sa naissance, le nom d’emprunt qu’elle choisissait
dans son nouvel état, et même, s’il faut en
croire un commentateur, le prix qu’elle adoptait une
fois pour toutes comme tarif de son odieux commerce.
Tacite dit, au livre II de ses Annales, que
cette inscription chez l’édile était fort anciennement
exigée des femmes qui voulaient se prostituer, et
que le législateur avait pensé ne pouvoir mieux punir
ces impudiques, que de les contraindre ainsi à
prendre acte de leur déshonneur (more inter veteres
recepto, qui satis pœnarum adversus impudicas in
ipsâ professione flagitii credebant). Mais ce qui fut
un frein dans les temps austères de la république,
devint sous les empereurs un jeu et une dérision,
puisqu’on vit alors des filles et des femmes de sénateurs
réclamer de l’édile la licentia stupri. On comprend,
d’ailleurs, quelle était l’utilité judiciaire de
l’inscription. D’une part, on avait obtenu de la
sorte une liste authentique de toutes les femmes qui
devaient payer à l’État l’impôt de la Prostitution,
le vectigal attaché comme une servitude à ce honteux
[33]
trafic; d’une autre part, dans tous les cas où
une courtisane manquait au devoir de sa profession,
dans les rixes, les querelles, les différends, les
scandales, les contraventions, les délits de toute
nature, auxquels cette honteuse profession donnait
souvent lieu, on n’avait qu’à consulter les registres
de l’édile, pour trouver l’état civil de la personne
mise en cause. On savait de la sorte, non-seulement
le véritable nom de la coupable ou de la victime,
mais encore son nom de guerre, luparium nomen,
sous lequel on la connaissait dans le monde de la
débauche. Plaute, dans son Pœnulus, parle de ces
créatures avilies qui changeaient de nom pour faire
un indigne commerce de leur corps (namque hodie
earum mutarentur nomina, facerentque indignum genere
quæstum corpore). Il n’était pas moins nécessaire
de consigner sur les registres le taux que chacune
fixait pour sa marchandise, car le savant Pierrugues
a recueilli ce fait, si étrange qu’il soit, dans
son Glossarium eroticum: qu’on allait devant l’édile
débattre la valeur et le payement d’une Prostitution,
comme s’il se fût agi d’un pain ou d’un fromage
(tanquam mercedis annonariæ, de pretio concubitûs jus
dicebat ædilis). La tâche de l’édile était donc multiple
et souvent bien délicate, mais l’édile suffisait
à tout.
L’inscription d’une courtisane sur les registres de
la licentia stupri était indélébile, et jamais une
femme qui avait reçu cette tache ne pouvait s’en
[34]
laver ni la faire disparaître. Elle avait beau renoncer
à sa scandaleuse profession et se faire à elle-même
une espèce d’amende honorable, en vivant chastement,
en se mariant, en mettant au jour des enfants
semi-légitimes, il n’y avait pas de pouvoir
social ou religieux qui eût le droit de la réhabiliter
entièrement et de rayer son nom dans les archives
de la Prostitution légale. Elle restait, d’ailleurs,
comme nous l’avons déjà dit, stigmatisée par la
note d’infamie, qu’elle avait méritée à une époque
quelconque de sa vie, sous l’empire de la nécessité,
de la misère ou même de l’ignorance. Et pourtant,
suivant l’observation du savant Douza, aussitôt que
les meretrices quittaient le métier, elles s’empressaient
de reprendre leur vrai nom et de laisser dans
le lupanar le faux nom qu’elles avaient affiché sur
leur écriteau. Un jurisconsulte, qui ne cite pas ses
autorités, a prétendu que toute courtisane, au moment
de son inscription, prêtait serment dans les
mains de l’édile et jurait de n’abandonner jamais
l’ignoble profession qu’elle acceptait librement, sans
contrainte et sans répugnance; mais les malheureuses,
liées par ce serment monstrueux, en auraient
été relevées, lorsqu’une loi de Justinien (Novella LI)
eut déclaré qu’un pareil serment contre les bonnes
mœurs n’engageait pas l’imprudente qui l’aurait
prêté. Ce vœu de Prostitution, que l’histoire offre
plus d’une fois au point de vue religieux, entre
autres chez les Locriens, dont les filles jurèrent de
[35]
se prostituer à la prochaine fête de Vénus, si leurs
pères remportaient la victoire sur l’ennemi, ce vœu
de Prostitution légale n’a rien d’invraisemblable et
correspond même avec la note d’infamie qui en
était la conséquence immédiate.
On s’est demandé pourquoi l’inscription matriculaire
des meretrices se faisait chez l’édile plutôt que
chez le censeur, qui avait dans ses attributions la
surveillance des mœurs. Juste-Lipse, dans ses Commentaires
sur Tacite, répond à cette question purement
spéculative, en faisant remarquer que l’édile
était chargé de la police intérieure des lupanars, des
cabarets et de tous les lieux suspects qui servaient
d’asile à la Prostitution. C’est au sujet de la juridiction
édilitaire sur ces lieux-là, que Sénèque a pu
dire: «Tu trouveras la vertu dans le temple, au
forum, dans la curie, sur les murailles de la ville;
la volupté, tu la trouveras, se cachant le plus souvent
et cherchant les ténèbres, à l’entour des bains
et des étuves, dans des endroits où l’on redoute
l’édile (ad loca ædilem metuentia).» Juste-Lipse aurait
dû ajouter, pour mieux expliquer la compétence de
l’édile en matière de Prostitution, que l’édile devait
surtout comprendre, dans les attributions de sa
charge, la voie publique, via publica, qui appartenait
essentiellement à la Prostitution et qui en était
presque synonyme. «Personne ne défend d’aller et
de venir sur la voie publique,» dit Plaute, faisant
allusion à l’usage que chacun peut faire d’une
[36]
femme publique, en la payant bien entendu. (Quin
quod, palam est venale, si argentum est, emas. Nemo
ire quemquam publicâ prohibet viâ). L’édile avait
donc la police de la rue et de tout ce qui pouvait
être considéré comme étant de ses dépendances:
ainsi, les lieux publics tombaient naturellement sous
la juridiction absolue de l’édile.
D’abord, et Justin le dit expressément, les femmes
qui s’adonnaient à la Prostitution sans s’être fait
inscrire chez l’édile et sans avoir acheté ainsi le
libre exercice de la profession impudique, étaient
exposées à payer une amende et même à être chassées
de la ville, quand on les avait surprises en flagrant
délit; mais ordinairement, celles qui se trouvaient
en faute, pourvu qu’elles fussent encore jeunes et
capables de gagner quelque chose, attiraient à elles
une âme charitable de lénon, qui se chargeait
des frais de leur amende et de leur inscription, et
qui, pour se rembourser de ses avances, les faisait
travailler à son profit, en les enfermant dans un
mauvais lieu. Les Prostitutions vagabondes, erratica
scorta, n’étaient donc pas permises à Rome, mais il
fallait bien fermer les yeux sur leur nombre et sur
leurs habitudes variées, qui auraient exigé une armée
de custodes pour garder les rues et les édifices,
un sénat d’édiles pour juger les délits, et une foule
de licteurs pour battre de verges les coupables et
pour faire exécuter les condamnations. La ville de
Rome offrait une multitude de temples, de colonnes,
[37]
de statues, de monuments publics, tels que des
aqueducs, des thermes, des tombeaux, des marchés,
etc., dont la disposition architecturale n’était
que trop favorable aux actes de la Prostitution; il y
avait, à chaque pas, une voûte sombre, sous laquelle
se tapissait la nuit une prostituée ou un mendiant;
tout endroit voûté (arcuarius ou arquatus) servait
d’asile à la débauche errante, que personne n’avait
droit de venir troubler, parce que tout le monde
avait le droit de dormir en plein air, sub dio. On
pourrait même inférer de plusieurs faits consignés dans
l’histoire, que certains lieux écartés, dans le voisinage
de certaines chapelles et de certaines statues,
étaient le théâtre ordinaire de la Prostitution nocturne.
C’est ainsi que Julie, fille d’Auguste, allait se prostituer
dans un carrefour, devant une statue du
satyre Marsyas, et la place où s’accomplissait cette
espèce de sacrifice obscène était toujours occupée,
dès que la nuit couvrait d’un dais étoilé la couche
de pierre qui servait d’autel au hideux sacrifice. Il
suffisait d’une statue de Priape ou de quelque dieu
gardien, armé du fouet, du bâton ou de la massue,
pour protéger toutes les turpitudes nocturnes qui
venaient se réfugier sous ses auspices et s’abriter sous
son ombre.
Ce n’était donc que rarement que l’édile usait de
rigueur à l’égard des contraventions de cette nature;
mais, en revanche, il exerçait quelquefois une police
assez tracassière sur les maisons publiques qui
[38]
dépendaient de sa juridiction. Non-seulement il faisait
des enquêtes continuelles pour rechercher les
crimes qui pouvaient se commettre dans ces maisons
soumises particulièrement à sa surveillance, mais il
s’assurait souvent par lui-même que tout s’y passait
d’une manière conforme aux règlements de l’édilité.
Nous avons cité plus d’une fois les lieux suspects
ou infâmes qui ressortissaient à la juridiction édilitaire:
c’était dans ces lieux-là, que la Prostitution
se cachait pour échapper à l’impôt, et que le lenocinium
se livrait à ses plus basses négociations. L’édile,
précédé de ses licteurs, parcourait les rues, à toute
heure de jour et de nuit, pénétrait partout où sa
présence pouvait être utile, et se rendait compte, par
ses propres yeux, du régime intérieur de ces officines
de débauche. Aussi, quand on annonçait de loin
l’approche d’un édile, les femmes de mauvaise vie,
les vagabondes, les joueurs, les esclaves en rupture
de ban, les malfaiteurs de tout genre s’empressaient
de lever le pied, et aussitôt les cabarets, les hôtelleries,
les boutiques mal famées étaient vides. Cette
police urbaine appartenait aux édiles plébéiens, sur
qui reposait tout le poids de l’édilité active; les
grands édiles patriciens, assis sur leur chaise curule,
ne faisaient pas autre chose que de juger les causes
qui leur étaient renvoyées par les tribuns, et qui
rentraient dans leurs attributions purement administratives.
Cette division de pouvoirs et de rôles
s’établit naturellement vers l’an de Rome 388, quand
[39]
aux deux édiles plébéiens, le sénat ajouta deux
édiles curules ou patriciens. Ceux-ci portaient seuls
un habit distinctif, la robe prétexte, en laine
blanche, bordée de pourpre, tandis que les autres
n’étaient reconnaissables qu’à leurs licteurs ou plutôt
à leurs appariteurs, sorte d’huissiers qui marchaient
devant eux et qui leur faisaient ouvrir les portes, en
énonçant les noms et qualités de l’édile; car un
édile ne pouvait pénétrer dans une maison particulière,
qu’en vertu de sa charge et pour en accomplir
les devoirs. On parla beaucoup à Rome de la déconvenue
d’un édile curule, à qui une courtisane eut
l’audace de tenir tête, et qui n’eut pas l’avantage
devant les tribuns du peuple. Aulu-Gelle rapporte
cet arrêt mémorable tel qu’il l’avait trouvé dans un
livre d’Atteius Capito, intitulé Conjectures. A. Hostilius
Mancinus, édile curule, voulut s’introduire,
pendant la nuit, chez une meretrix, nommée Mamilia;
celle-ci refusa de le recevoir, quoiqu’il déclinât son
nom et fît valoir ses prérogatives; mais il était seul,
sans licteurs; il ne portait pas la robe prétexte, et,
de plus, il n’avait rien à faire comme édile dans
cette maison. Il s’irrita de rencontrer tant d’obstacles
de la part d’une fille publique; il menaça de briser
les portes et il essaya de le faire. Alors Mamilia, que
ces violences ne déconcertaient pas, fit semblant de
ne pas reconnaître l’édile, et lui jeta des pierres du
haut d’un balcon (de tabulato). L’édile fut blessé à
la tête. Le lendemain, il cita devant le peuple l’insolente
[40]
Mamilia, et l’accusa d’avoir attenté à sa
personne. Mamilia raconta comment les choses
s’étaient passées; comment l’édile, en effet, avait
essayé d’enfoncer la porte, et comment elle l’en avait
empêché à coups de pierres. Elle ajouta que Mancinus,
sortant d’un souper, s’était offert à elle, pris
de vin et une couronne de fleurs au front. Les tribuns
approuvèrent la conduite de Mamilia, en
déclarant que Mancinus, en se présentant, la nuit, à
moitié ivre et couronné de fleurs, à la porte d’une
courtisane, avait mérité d’être chassé honteusement.
Ils lui défendirent donc de porter plainte devant le
peuple, et la courtisane eut ainsi raison de l’édile.
- Castelli, del.
- Paris Imp. Drouart, 11, r. du Fouarre
- Outhwaite, sc.
A. HOSTILIUS MANCINUS ET MANILIA
Ce fait curieux prouverait que Mamilia demeurait
dans une maison particulière qui échappait à la police
des édiles; car, dans les lieux de libre pratique
dépendant de leur autorité immédiate, on n’eût
pas osé résister à ce point. Ainsi, ces magistrats renouvelaient-ils
sans cesse leurs visites dans les bains
et les étuves, dans les cabarets et les hôtelleries,
dans les boutiques de boulanger, de boucher (lanii),
de rôtisseur (macellarii), de barbier et de parfumeur.
Ils auraient été certainement embarrassés de
constater, de poursuivre et de punir tous les cas de
Prostitution frauduleuse et prohibée, qu’ils rencontraient
sur leur passage. C’était surtout dans les
bains publics, que se cachaient les débauches les
plus monstrueuses; et l’on peut dire que la Prostitution
s’augmenta toujours à Rome, en proportion des
[41]
bains qu’on y créait. Publius Victor compte huit cents
bains, tant grands que petits, dans l’enceinte de la
ville. Et, comme on sait que les citoyens riches se
faisaient un point d’honneur de fonder par testament
une piscine ou une étuve destinée à l’usage du peuple,
on n’est pas étonné de cette multitude de
bains, parmi lesquels les plus considérables ne contenaient
pas moins de mille personnes à la fois. Dans
les temps austères de la République, le bain était
entouré de toutes les précautions de pudeur et de mystère;
non-seulement les sexes, mais encore les âges
étaient séparés; un père ne se baignait pas avec son
fils pubère, un gendre avec son beau-père; le service
était fait par des hommes ou par des femmes,
selon que le bain recevait exclusivement des femmes
ou des hommes. Ces établissements n’étaient pas
encore très-nombreux, et il y avait des heures réservées
pour les hommes et pour les femmes, qui se
succédaient dans les mêmes bassins, sans pouvoir
jamais s’y rencontrer. Cicéron raconte que le consul
étant allé à Teanum en Campanie, sa femme dit
qu’elle voulait se baigner dans les bains destinés aux
hommes. En effet, le questeur fit sortir des bains
tous ceux qui s’y trouvaient, et, après quelques moments
d’attente, la femme du consul put se baigner;
mais elle se plaignit à son mari des retards qu’elle
avait éprouvés, et aussi de la malpropreté de ces
bains. Là-dessus, le consul ordonna de saisir M. Marius,
l’homme le plus distingué de la ville, et de le
[42]
battre de verges sur la place publique, comme s’il
fût responsable de la malpropreté des bains. Il est
probable que la femme du consul avait signalé à
son mari quelque fait plus grave, et ce qui le donne
à penser, c’est que le même consul, passant à Ferentinum,
s’informa aussi de la situation des bains publics,
et en fut si mécontent, qu’il fit fouetter les
questeurs de cette petite ville, où les hommes se
déshonoraient, sous prétexte de se baigner.
Les bains de Rome ne tardèrent pas à ressembler
à ceux que les Romains avaient trouvés en Asie:
on y admit tous les genres de luxe et de corruption,
presque sous les yeux de l’édile, qui était chargé d’y
faire respecter les mœurs, et qui ne s’occupait que
d’améliorations matérielles, imaginées pour les amollir
et les corrompre davantage. D’abord, le bain
devint commun pour les deux sexes, et quoiqu’ils
eussent chacun leur bassin ou leur étuve à part, ils
pouvaient se voir, se rencontrer, se parler, lier des
intrigues, arranger des rendez-vous et multiplier
les adultères. Chacun menait là ses esclaves, mâles
ou femelles, eunuques ou spadones, pour garder les
vêtements et pour se faire épiler, racler, parfumer,
frotter, raser et coiffer. Ce mélange des sexes eut
d’inévitables conséquences de Prostitution et de débauche.
Les maîtres des bains avaient aussi des esclaves
dressés à toute sorte de services, misérables
agents d’impudicité, qui se louaient au public pour
différents usages. Dans l’origine, les bains étaient si
[43]
sombres, que les hommes et les femmes pouvaient
se laver côte à côte sans se reconnaître autrement
que par la voix; mais bientôt on laissa la lumière
du jour y pénétrer de toutes parts et se jouer sur
les colonnes de marbre et les parois de stuc. «Dans
ce bain de Scipion, dit Sénèque, il y avait d’étroits
soupiraux plutôt que des fenêtres, qui souffraient à
peine assez de clarté pour ne point outrager la pudeur;
mais maintenant on dit que les bains sont des
caves, s’ils ne sont pas ouverts de manière à recevoir
par de grandes fenêtres les rayons du soleil.»
Cette indécente clarté livrait la nudité aux yeux de
tous, et faisait resplendir les mille faces de la
beauté corporelle. Outre la grande étuve (sudatorium),
outre les grandes piscines d’eau froide, d’eau
tiède et d’eau chaude dans lesquelles on prenait le
bain pêle-mêle, et autour desquelles on se mettait
entre les mains des esclaves, balneatores et aliptes,
l’établissement renfermait un grand nombre de salles
où l’on se faisait servir à boire et à manger, un
grand nombre de cellules où l’on trouvait des lits de
repos, des filles et des garçons. Ammien Marcellin
nous montre, dans un énergique tableau, les débauchés
de la cour de Domitien, envahissant les bains
publics et criant d’une voix terrible: «Où sont-ils?
où sont-ils?» Puis, s’ils apercevaient quelque
meretrix inconnue, quelque vieille prostituée, rebut
de la plèbe des faubourgs, quelque ancienne louve
au corps usé par la fornication, ils se jetaient dessus
[44]
tous ensemble, et ils la traitaient, cette malheureuse,
comme une Sémiramis: Si apparuisse subito compererint
meretricem, aut oppidanæ quondam prostibulum
plebis, vel meritorii corporis veterem lupam,
certatim concurrunt, etc. Les édiles veillaient à ce
que ces scandales n’eussent pas lieu dans les bains
qui avaient un poste de soldats au dehors, et qui permettaient
à tous les désordres de s’y produire sans
bruit, sans éclat, sans trouble. La Prostitution y
avait donc un air décent et mystérieux.
Il en était des bains publics comme des lupanars:
leur organisation intérieure variait suivant l’espèce de
public qui les fréquentait. Ici, c’étaient des bains
gratuits pour le bas peuple; là, c’étaient des bains à
bon marché, puisque l’entrée ne coûtait qu’un quadrans,
deux liards de notre monnaie; ailleurs, c’étaient
des bains magnifiques, où l’aristocratie et les
gens riches, fût-ce des affranchis, se rencontraient
sur un pied d’égalité. Tous ces bains s’ouvraient à
la même heure, à la neuvième, c’est-à-dire vers trois
heures après midi; à cette heure-là, s’ouvraient
aussi les lieux publics, les cabarets, les auberges, les
lupanars. Tous ces bains se fermaient à la même
heure aussi, au coucher du soleil: tempus lavandi,
lit-on dans Vitruve, a meridiano ad vesperam est
constitutum. Mais les lupanars seuls restaient ouverts
toute la nuit. Le règne de la Prostitution légale,
commencé en plein soleil, se prolongeait jusqu’au
lendemain matin. Quant à la Prostitution des bains,
[45]
elle n’était que tolérée, et l’édile faisait semblant, autant
que possible, de l’ignorer, pourvu qu’elle n’affectât
point un caractère public. Les empereurs vinrent
en aide à l’édilité, pour obvier aux horribles
excès qui se commettaient dans tous les bains de
Rome, où les deux sexes étaient admis. Adrien défendit
rigoureusement ce honteux mélange d’hommes
et de femmes; il ordonna que leurs bains fussent
tout à fait séparés: Lavacra pro sexibus separavit,
dit Spartien. Marc-Aurèle et Alexandre-Sévère renouvelèrent
ces édits en faveur de la morale publique;
mais, dans l’intervalle de ces deux règnes,
l’exécrable Héliogabale avait autorisé les deux sexes
à se réunir aux bains. Les serviteurs et les servantes
de bains étaient, au besoin, les lâches instruments des
récréations que les deux sexes y venaient chercher.
Les matrones ne rougissaient pas de se faire masser,
oindre et frotter, par ces baigneurs impudiques. Juvénal,
dans sa fameuse satire des Femmes, nous représente
une mère de famille qui attend la nuit pour
se rendre aux bains, avec son attirail de pommades
et de parfums: «Elle met sa jouissance à suer avec
de grandes émotions, quand ses bras retombent
lassés sous la main vigoureuse qui les masse, quand
le baigneur, animé par cet exercice, fait tressaillir
sous ses doigts l’organe du plaisir (callidus et cristæ
digitos impressit aliptes) et craquer les reins de la
matrone.» Un des commentateurs de Juvénal, Rigatius,
nous explique les procédés malhonnêtes de ces
[46]
aliptes, avec une intelligence de la chose, qui se sert
heureusement du latin: Unctor sciebat dominam
suam hujusmodi titillatione et contrectatione gaudere.
Il se demande ensuite à lui-même, le plus candidement
du monde, si ce baigneur-là n’était pas un infâme
sournois.
L’édile n’avait rien à voir là-dedans, si personne
ne se plaignait. Les bains étaient des lieux d’asile
pour les amours, comme pour les plus sales voluptés:
«Tandis qu’au dehors, dit l’Art d’aimer d’Ovide,
le gardien de la jeune fille veille sur ses habits,
les bains cachent sûrement ses amours furtifs (celent
furtivos balnea tuta jocos).» Les femmes devaient
être plus intéressées que les hommes à conserver ces
priviléges attachés aux bains publics: pour les unes,
c’était un terrain neutre, un centre, un abri tutélaire,
où elles pouvaient sans danger satisfaire leurs
sens; pour les autres, c’était un marché perpétuel
où la Prostitution trouvait toujours à vendre ou à
acheter. Quoique les bains dussent être fermés la
nuit, ils restaient ouverts en cachette pour les privilégiés
de la débauche; tout était sombre au dehors,
tout éclairé à l’intérieur, et les bains, les soupers,
les orgies duraient toujours, presque sans interruption.
Le lenocinium se pratiquait sur une vaste
échelle dans ces endroits-là, et beaucoup venaient,
sous prétexte de se baigner, spéculer sur la virginité
d’une jeune fille ou d’un enfant, sinon chercher pour
eux-mêmes le bénéfice de quelque atroce Prostitution.
[47]
L’habitude des bains développait chez les personnes
des deux sexes, qui l’avaient prise avec une
sorte de passion, les instincts et les goûts les plus
avilissants; en se voyant nus, en voyant toutes ces
nudités qui s’étalaient dans les postures les plus
obscènes, en se sentant pressés et touchés par les
mains frémissantes des baigneurs, ils contractaient
insensiblement une rage de plaisirs nouveaux et inconnus,
à la poursuite desquels ils consacraient leur
vie entière; ils s’usaient et se consumaient lentement
au milieu de cette impure Capoue des bains publics.
C’était là que l’amour lesbien avait établi son sanctuaire,
et la sensualité romaine renchérissait encore
sur le libertinage des élèves de Sapho. Celles-ci se
nommaient toujours Lesbiennes, quand elles n’ajoutaient
rien aux préceptes de la philosophie féminine
de Lesbos; mais elles prenaient le nom de
fellatrices, quand elles réservaient à des hommes ces
ignobles caresses dont leur bouche ne craignait pas
de se souiller. Ce n’est pas tout: ces misérables
femmes apprenaient leur art exécrable à des enfants,
à des esclaves, qu’on appelait fellatores. Cette
impureté se répandit tellement à Rome, qu’un satirique
s’écriait avec horreur: «O nobles descendants
de la déesse Vénus, vous ne trouverez bientôt plus
de lèvres assez chastes pour lui adresser vos
prières!» Martial, dans ses épigrammes, revient
sans cesse sur cette abomination, qui faisait vivre
une foule d’infâmes et qui n’empêchait pas l’édile de
[48]
dormir: nous n’oserions traduire l’épigramme flétrissante
qu’il adresse à un de ces êtres vils, nommé
Blattara; mais il nous est plus aisé de donner un à peu
près honnête de celle qui regarde Thaïs, fellatrice à
la mode en ce temps-là: «Il n’est personne dans le
peuple, ni dans toute la ville, qui se puisse vanter
d’avoir eu les faveurs de Thaïs, quoique beaucoup
la désirent, quoique beaucoup la pourchassent.
Pourquoi donc Thaïs est-elle si chaste? C’est que sa
bouche ne l’est pas.» (Tam casta est, rogo, Thaïs?
immò fellat.) Martial ne pardonne pas aux exécrables
fellateurs qu’il trouve sur son chemin; il
les déteste et les maudit tous dans la personne de
Zoïle: «Tu dis que les poëtes et les avocats sentent
mauvais de la bouche; mais le fellateur, Zoïle,
pue bien davantage!» Cette infâme imagination de
luxure s’était, sous les empereurs, tellement répandue
à Rome, que Plaute et Térence, qui avaient fait
pourtant allusion au vice des fellateurs, semblaient
n’en avoir rien dit, et que dans les Attélanes, où la
pantomime surpassa les plus grandes témérités du
dialogue, les auteurs exprimaient sans cesse par un
jeu muet les honteux mystères de l’art fellatoire.
Et cependant les édiles devaient rester aveugles
en face de ces horribles débauches qui se produisaient
presque sous leurs yeux! Ce n’était pas même
la Prostitution proprement dite; ce n’en étaient que
les préludes ou les accessoires; c’était surtout l’acte
le plus caractéristique de l’esclavage, que de præbere
[49]
os,
suivant l’expression usuelle qui se rencontre
jusque dans les Adelphes de Térence; les édiles n’avaient
donc pas à se mêler de la conduite individuelle
des esclaves, excepté en ce qui concernait les
meretrices. Il est remarquable que les ignobles artisans
de ces débauches ne faisaient presque jamais
partie du collége des courtisanes enregistrées. On ne
les rencontrait donc pas dans les lupanars, mais
dans les cabarets et dans tous les lieux suspects où
l’on allait boire, manger, jouer ou dormir. Quiconque
entrait en ces lieux-là, fréquentés par des
gens perdus d’honneur, se voyait confondu avec
eux ou dégradé à leur niveau, lors même qu’il ne se
fût point abandonné à leurs vices ordinaires. Il suffisait
de la présence d’un homme ou d’une femme
dans une taverne (popina), pour que cette femme ou
cet homme se soumît par là, en quelque sorte, à
toute espèce d’outrages. Ainsi, le jurisconsulte Julius
Paulus dit en propres termes dans le Digeste: «Quiconque
se sera fait un jouet de mon esclave ou de
mon fils, même du consentement de celui-ci, je serai
censé avoir reçu une injure personnelle, comme si
mon fils ou mon esclave eût été conduit dans un cabaret,
comme si on l’eût fait jouer à un jeu de hasard.»
L’injure et le dommage existaient, du moment où le
jeune homme avait mis le pied dans le cabaret, car
il n’était jamais sûr d’en sortir aussi pur, aussi
chaste, qu’il y était entré. La police édilitaire surveillait
soigneusement les cabarets, qui devaient
[50]
être fermés pendant la nuit et ne s’ouvrir qu’au
point du jour: ils pouvaient recevoir toute sorte de
gens, sans s’inquiéter de leurs hôtes, mais ils n’étaient
point autorisés à leur donner un gîte, et ils
renvoyaient leur monde, quand la cloche avait
sonné dans les rues pour la fermeture des bains et de
tous les lieux publics. Ce seul fait indique la disposition
intérieure d’une popina romaine, qui se composait,
en général, d’une petite salle basse au rez-de-chaussée,
toute garnie d’amphores et de grandes
jarres pleines de vin, sur le ventre desquelles on
lisait l’année de la récolte et le nom du cru: au fond
de cette salle, humide et obscure, qui ne recevait de
jour que par la porte surmontée d’une couronne de
laurier, une ou deux chambres très-resserrées servaient
à la réception des hôtes qui s’y attablaient
pour jouer et pour faire la débauche. Aucune apparence
de lit, d’ailleurs, dans ces bouges infectés de
l’odeur du vin et de celle des lampes: «Les auberges,
dit Cicéron dans un passage qui établit clairement
la différence de la popina et du stabulum, les
auberges sont ses chambres à coucher; les tavernes,
ses salles à manger.» On ne trouvait dans ces endroits-là,
que des bancs, des escabeaux et des tables,
qui favorisaient peu la Prostitution ordinaire.
Il fallait aller dans les cauponæ et les diversoria,
pour y louer une chambre et un lit. Le diversorium
n’était destiné qu’à recevoir des voyageurs, des
étrangers, qui y passaient la nuit, sans y souper; la
[51]
caupona tenait, au contraire, de l’auberge et du cabaret:
on y logeait et l’on y soupait. On ne manquait
pas de compagnes et de compagnons, que le
maître du lieu avait toujours en réserve pour l’usage
de ses locataires. La Prostitution, dans ces maisons
de passage, avait des allures plus décentes, des habitudes
moins excentriques, et pourtant l’édile y
venait souvent faire des visites nocturnes, pour rechercher
les femmes de mauvaise vie qui auraient
pu se soustraire à l’inscription sur les registres et
celles qui se livraient hors des lupanars à l’exercice
de leur métier. Elles s’enfuyaient à moitié nues;
elles se cachaient dans le cellier derrière les amphores
d’huile et de vin; elles se blottissaient sous
les lits, lorsque l’appariteur de l’édile frappait à la
porte de la rue, lorsque les licteurs déposaient leurs
faisceaux devant la maison. L’objet de ces visites
domiciliaires était surtout de punir les contraventions
aux règlements, par de fortes amendes; aussi,
comme le dit Sénèque, tous les lieux suspects craignaient-ils
la justice de l’édile, et tous ces lieux-là
étaient plus ou moins consacrés à la Prostitution.
Sénèque, dans sa Vie heureuse, parle, avec dégoût, de
ce plaisir honteux, bas, trivial, misérable, qui a pour
siége et pour asile les voûtes sombres et les cabarets
(cui statio ac domicilium fornices et popinæ sunt).
L’édile visitait aussi les boulangeries et les caves
qui en dépendaient. Dans ces caves, quelquefois
profondes et séparées de la voie publique, on ne
[52]
se bornait pas à mettre des provisions de blé dans
d’énormes vases de terre cuite, on ne se bornait pas
à y faire tourner la meule par des esclaves: il
y avait souvent des cellules souterraines où se réfugiait
la Prostitution pendant le jour, aux heures où
les lupanars étaient fermés et inactifs. Les meretrices,
dit Paul Diacre, demeuraient d’ordinaire dans
les moulins (in molis meretrices versabantur). Pitiscus,
qui cite ce passage, ajoute que les meules et les
filles se trouvaient dans des caves communiquant
avec la boulangerie, de telle sorte que tous ceux
qui entraient là n’y venaient pas pour acheter du
pain; la plupart ne s’y rendaient que dans un but
de débauche (alios qui pro pane veniebant, alios qui
pro luxuriæ turpitudine ibi festinabant). C’était une
Prostitution déréglée, que l’édile ne se lassait pas de
poursuivre: il descendait souvent dans les souterrains
où l’on écrasait le blé en le pilant ou en le moulant,
et il y découvrait toujours une foule de femmes,
non inscrites, les unes attachées au service des
meules, les autres simples locataires de ces bouges
ténébreux, au fond desquels la débauche semblait
se dérober dans l’ombre à sa propre ignominie.
Les lupanars étaient également sous la surveillance
immédiate des édiles; mais ceux-ci n’avaient point à
s’occuper de ce qui s’y passait, pourvu qu’il n’y eût
ni tumulte, ni rixe, ni scandale au dedans comme au
dehors, pourvu que les portes en fussent ouvertes à
la neuvième heure, c’est-à-dire à trois heures après
[53]
midi, et fermées le lendemain matin à la première
heure. Le lénon ou la léna avait, pour ainsi dire, la
délégation d’une partie des devoirs de l’édile, dans
le régime de l’établissement. Comme ce lupanaire de
l’un ou de l’autre sexe se chargeait de faire l’écriteau
de chacune de ses femmes, c’était à lui que revenait
naturellement le soin de vérifier l’inscription
régulière de chacune sur les registres de l’édilité; il
devait être responsable du délit, quand une ingénue
ou citoyenne libre, quand une femme mariée et adultère,
quand une fille au pouvoir de père ou de tuteur,
quand une malheureuse enfant se prostituait de gré
ou de force; car la loi Julia enveloppait dans la pénalité
de l’adultère tous les complices qui l’auraient
favorisé, même indirectement. Les maîtres et entrepreneurs
de mauvais lieux avaient donc souvent à
compter avec l’édile, d’autant plus que le lénocinium
ne respectait rien, ni naissance, ni rang, ni âge,
ni vertu. Toute infraction aux règlements donnait
lieu à une amende, et les amendes de cette nature,
que l’édile appliquait à sa volonté, étaient exigibles
à l’instant même. Un retard de payement amenait
sur les épaules du condamné une libérale provision
de coups de verges. Cette fustigation s’exécutait en
pleine rue, devant le lupanar, et ensuite le patient,
après avoir payé l’amende, sortait tout meurtri des
mains du licteur, pour aviser aux moyens de se
rembourser à l’aide d’un nouveau trafic de Prostitution.
Tout, au reste, pouvait être matière à réprimande
[54]
et à punition. Les maîtres de lupanar se sentaient
trop à la discrétion de l’édile pour ne pas se
ménager, en cas de malheur, quelque appui, quelque
influence favorable; ils en trouvaient chez des
sénateurs débauchés, auxquels ils réservaient les prémices
de certains sujets de choix. L’édile lui-même
n’était pas incorruptible, et le lénon savait par quel
genre de présent on pouvait quelquefois le gagner
et le rendre favorable.
Il serait difficile d’établir l’état des contraventions
et des délits qui avaient lieu dans les lupanars de
Rome; ce n’était pas sans doute l’édile qui se chargeait
de les constater par lui-même; il se faisait représenter
par des officiers subalternes. Ceux-ci allaient
vérifier la gestion des lupanaires, écouter et
recueillir les plaintes qui pouvaient s’élever contre
eux, examiner les lieux, et relever surtout les listes
des mérétrices en cellule. La préoccupation du législateur
à l’égard de la débauche publique semble
avoir été seulement d’empêcher la Prostitution des
femmes patriciennes et des filles ingénues, et de
poursuivre l’adultère jusque sous ce masque infâme.
On ne devait admettre dans les lupanars ouverts
sous la garantie de la loi, que des femmes à qui la
loi ne défendait pas de se vendre et de se prostituer.
Messaline, en exerçant le meretricium dans un lupanar,
se donnait pour Lysisca, courtisane, dont elle
avait pris le nom de débauche et qui probablement
vaquait ailleurs à son métier. Messaline s’exposait
[55]
donc, sinon à être reconnue, du moins à se voir
accusée d’usurpation de nom et de qualité; les
filles inscrites chez l’édile ayant seules le droit
d’exercer dans les lupanars. Sénèque, dans deux
passages différents de ses Controverses, parle de
l’installation d’une femme dans un mauvais lieu,
sans indiquer les diverses formalités qu’elle était
forcée de subir auparavant: «Tu t’es nommée meretrix,
dit Sénèque; tu t’es assise dans une maison
publique; un écriteau a été mis sur ta cellule; tu
t’es livrée à tout venant.» Et ailleurs: «Tu t’es
assise avec les courtisanes; tu t’es aussi parée pour
plaire aux passants, parée des habits que le lénon t’a
fournis; ton nom a été affiché à la porte; tu as reçu
le prix de ta honte.» Il est certain que le lénon
ne louait pas des habits et une cellule à toutes les
femmes qui se présentaient pour le service public:
elles étaient obligées, avant tout, de justifier de leur
qualité et de produire même un certificat de meretrix,
appelé licentia stupri. Un autre passage des
Controverses de Sénèque laisserait entendre que ce
certificat se délivrait dans le lupanar même, et que
le lénon avait un registre où il inscrivait les noms de
ses clientes: «Tu as été amenée dans un lupanar,
dit Sénèque, tu y as pris ta place; tu as fait ton prix:
l’écriteau a été dressé en conséquence. C’est là tout
ce qu’on peut savoir de toi. D’ailleurs, je veux ignorer
ce que tu nommes une cellule et un obscène lit
de repos.» Les délégués de l’édile ne se faisaient
[56]
pas scrupule, au besoin, d’exiger de plus grands
détails et d’interroger les mérétrices elles-mêmes.
L’édile se montrait surtout très-sévère pour les
infractions aux heures d’ouverture et de fermeture
des lupanars; car ces heures avaient été fixées pour
que les jeunes gens n’allassent pas dès le matin se
fatiguer et s’énerver dans des lieux de débauche, au
lieu de suivre les exercices gymnastiques, les études
scolaires et les leçons civiques qui composaient l’éducation
romaine. Le législateur avait voulu aussi
que la chaleur du jour fût un obstacle à la Prostitution
et que ceux qu’elle accablerait ne fussent pas
tentés de chercher un surcroît de sueurs et de lassitude.
Il n’y avait d’exception, pour les heures assignées
à la libre pratique des lieux et des plaisirs publics,
que les jours de fête solennelle, quand le
peuple était invité aux jeux du Cirque. Ces jours-là,
la Prostitution se transportait là où était le peuple,
et tandis que les lupanars restaient fermés et déserts
dans la ville, ceux du Cirque s’ouvraient en
même temps que les jeux; et sous les gradins où se
pressait la foule des spectateurs, les lénons organisaient
des cellules et des tentes, où affluait de toutes
parts une procession continuelle de courtisanes et de
libertins qu’elles avaient attirés à leur suite. Pendant
que les tigres, les lions et les bêtes féroces
mordaient les barreaux de leurs cages de fer; pendant
que les gladiateurs combattaient et mouraient;
pendant que l’assemblée ébranlait l’immense édifice
[57]
par un tonnerre de cris et de battements de mains, les
meretrices, rangées sur des siéges particuliers, remarquables
par leur haute coiffure et par leur vêtement
court, léger et découvert, faisaient un appel permanent
aux désirs du public et n’attendaient pas, pour
les satisfaire, que les jeux fussent achevés. Ces courtisanes
quittaient sans cesse leur place et se succédaient
l’une à l’autre pendant toute la durée du
spectacle. Les portiques extérieurs du Cirque ne
suffisant plus à cet incroyable marché de Prostitution,
tous les cabarets, toutes les hôtelleries du voisinage
regorgeaient de monde. On comprend que
ces jours-là la Prostitution était absolument libre,
et que les appariteurs de l’édile n’osaient pas s’enquérir
de la qualité des femmes qui faisaient acte
de meretrix. Voilà pourquoi Salvien disait de ces
grandes orgies populaires: «On rend un culte à
Minerve dans les gymnases; à Vénus, dans les
théâtres;» et ailleurs: «Tout ce qu’il y a d’impudicités
se pratique dans les théâtres; tout ce qu’il y
a de désordres, dans les palestres.» Isidore de Séville,
dans ses Étymologies, va plus loin, en disant
que théâtre est synonyme de Prostitution, parce que
dans le même lieu, après la fin des jeux, les meretrices
se prostituent publiquement. (Idem vero theatrum,
idem et prostibulum, eo quod post ludos exactos
meretrices ibi prosternerentur). Les édiles n’avaient
donc pas à s’occuper de la Prostitution des théâtres,
comme si cette Prostitution faisait partie nécessaire
[58]
des jeux qu’on donnait au peuple. Généralement,
d’ailleurs (on peut du moins le supposer d’après
plusieurs endroits de l’Histoire Auguste), les théâtres
étaient exploités par une espèce de femmes qui logeaient
sous les portiques et dans les galeries voûtées
de ces édifices; elles avaient pour lénons ou
pour amants les crieurs du théâtre, qu’on voyait
circuler sans cesse de gradin en gradin pendant la
représentation; ces crieurs ne se bornaient pas à
vendre au peuple ou à lui distribuer gratis, aux
frais du grand personnage qui donnait les jeux, de
l’eau et des pois chiches: ils servaient principalement
de messagers et d’interprètes pour lier les parties
de débauche. C’est donc avec raison que Tertullien
appelait le cirque et le théâtre les consistoires
des débordements publics, consistoria libidinum publicarum.
Il est probable que l’édile, malgré son autorité
presque absolue sur la voie publique, ne troublait
pas trop la Prostitution errante; on ne voit nulle
part, dans les poëtes et les moralistes qui parlent de
ce genre abject de Prostitution, l’apparence d’une
mesure répressive ou préventive. L’édile se bornait
sans doute à faire observer les règlements relatifs au
costume, et il punissait sévèrement les mérétrices
inscrites qui s’aventuraient dans les rues avec la
robe longue et les bandelettes des matrones; mais il
ne devait pas surveiller de fort près les mœurs de
la voie publique, quand la nuit les couvrait d’un
[59]
voile indulgent. La voie publique appartenait à tous
les citoyens; chacun en avait la libre disposition, et
chacun y trouvait protection en se plaçant sous la
sauvegarde du peuple. Il eût donc été difficile d’empêcher
un citoyen d’user de sa liberté individuelle
en pleine rue. Ainsi, l’édilité, à l’époque de sa plus
grande puissance, n’avait aucune action coercitive
contre les passants qui souillaient de leur urine les
murs extérieurs des maisons et des monuments; elle
recourut alors, dans l’intérêt de la salubrité de
Rome, à l’intervention du dieu Esculape, et elle fit
peindre deux serpents, aux endroits que l’habitude
avait plus particulièrement consacrés à recevoir le dépôt
des immondices et des urines. Ces serpents sacrés
écartaient la malpropreté, qui ne se fût pas abstenue
devant l’édile en personne, et qui n’avait garde de
commettre une profanation, puisque le serpent était
l’emblème du dieu de la médecine. Il n’y avait malheureusement
pas de serpent que la Prostitution vagabonde
eût à redouter sous les voûtes et dans les
coins obscurs où elle se réfugiait, dès que la rue devenait
sombre et moins fréquentée. Pitiscus, qui n’avance
pas un fait sans l’entourer de preuves tirées
des écrits ou des monuments de l’antiquité, nous représente
les prostituées de Rome, celles de la plus
vile espèce, occupant la nuit les carrefours et les
ruelles étroites de la ville, appelant et attirant les
passants et ne se conduisant pas avec plus de pudeur
que les chiens qui le jour tenaient la place:
[60]
Quos in triviis venereis nodis cohærere scribit Lucretius.
L’édile ne pouvait que reléguer ces turpitudes
dans des quartiers mal famés, où les honnêtes gens
ne pénétraient jamais et qui n’avaient pour habitants
que des voleurs, des mendiants, des esclaves fugitifs
et des femmes de mauvaise vie. La police évitait
de remuer cette fange de la population, et il fallait
un vol, un meurtre, un incendie, pour que les
officiers de l’édile descendissent au fond de ces repaires.
La voie publique, dans les faubourgs et
aux abords des murailles de la ville, était donc le
théâtre nocturne des plus hideuses impuretés. C’est
là que Catulle rencontra un soir cette Lesbie, qu’il
avait aimée plus que lui-même, plus que tous les
siens; mais s’il la reconnut, combien elle était changée,
et quel horrible métier elle pratiquait impunément
dans l’ombre! Il se détourna, indigné, les
yeux obscurcis par les larmes et souhaitant n’avoir
rien vu; puis, cette plainte s’exhala de son cœur de
poëte:
Illa Lesbia quam Catullus unam
Plus quam se atque suos amavit omnes,
Nunc in quadriviis et angiportis
Glubit magnanimos Remi nepotes!
Si l’édile laissait en paix les malheureuses instigatrices
de l’immoralité publique, il se mêlait encore
moins de la conduite de leurs complices ordinaires;
il n’avait pas, d’ailleurs, de censure à exercer sur les
mœurs, et il se gardait bien de porter atteinte aux
[61]
priviléges des citoyens romains, sous prétexte de
faire respecter la pudeur de la rue. Il recevait seulement,
à cet égard, les réclamations qui lui étaient
adressées, et il citait directement devant sa chaise
curule ceux qui avaient donné lieu à ces réclamations.
Elles étaient quelquefois fort graves; par exemple,
lorsqu’une mère de famille se plaignait d’avoir
été insultée et traitée comme une courtisane, c’est-à-dire
suivie et appelée dans la rue. L’édile avait
alors à examiner si, par son costume, sa démarche
ou ses gestes, la matrone pouvait avoir motivé une
méprise injurieuse, et si l’auteur de l’insulte pouvait
arguer de son ignorance et de sa bonne foi. En
général, les femmes qui eussent été en droit de
porter plainte au tribunal de l’édile préféraient
s’épargner le scandale d’un débat semblable, et ne
pas avoir à comparaître en public pour faire condamner
l’insulteur, surtout si elles se sentaient répréhensibles
au point de vue de leur toilette; car il suffisait
d’une tunique un peu trop courte, d’une coiffure
trop haute, et de la nudité du cou, des épaules
ou de la gorge, pour justifier un appel ou une provocation.
«Appeler et poursuivre sont deux choses
bien différentes, dit Ulpien, au titre XV, De injuriis et
famosis libellis; appeler, c’est attenter à la pudeur
d’autrui par des paroles insinuantes; poursuivre,
c’est suivre avec insistance, mais silencieusement.»
Quand les libertins doutaient de la condition d’une
femme qu’ils trouvaient sur leur chemin, et dont ils
[62]
convoitaient la possession, ils ne lui parlaient pas
d’abord, mais ils la suivaient par derrière, jusqu’à
ce qu’elle eût témoigné par un signe ou par un coup
d’œil que la poursuite ne lui était pas injurieuse ni
désagréable; ils se croyaient alors autorisés à lui
adresser des propositions verbales. On n’accostait
pas en pleine rue une femme étrangère, si elle n’avait
pas répondu, de la voix, du geste ou du regard,
à la première tentative d’appel, et cet usage resta
dans les mœurs des villes romaines longtemps après
que la corruption publique eut fait fléchir les rigueurs
de la loi. «Cette fille qui lui parle publiquement, dit
Prudentius dans ses quatrains moraux, il lui ordonne
de s’arrêter au détour de la rue.» Les mérétrices
seules étaient, pour ainsi dire, à la discrétion du premier
venu; chaque passant avait le droit de les
arrêter dans la rue et de leur demander une honteuse
complaisance, comme si c’était une marchandise
offerte à quiconque voulait la payer au taux fixé.
Hormis les cas où le sectateur (sectator), par libertinage
ou par erreur, se permettait de poursuivre ou
d’appeler une ingénue dont la démarche et l’habillement
ne justifiaient pas ces attentats, la recherche des plaisirs
de la débauche était absolument libre pour les
hommes, sinon pour les jeunes gens. Ceux-ci seulement
pouvaient être punis par leur père ou leur
tuteur; car la loi admettait le renoncement à la
paternité dans trois cas, où le père avait le droit, non-seulement
de déshériter son fils, mais encore de le
[63]
chasser de la famille et de lui ôter son nom: premièrement,
si ce fils couchait souvent hors de la
maison paternelle; secondement, s’il s’adonnait à
des orgies infâmes, et, en dernier lieu, s’il se plongeait
dans de sales plaisirs. C’était donc le père qui,
en certaines circonstances, réunissait dans sa main
les pouvoirs de l’édile et du censeur contre son fils
débauché. Le tuteur avait également une partie
de la même autorité, à l’égard de son pupille. Mais
les jeunes gens n’étaient pas les seuls provocateurs et
sectateurs de la Prostitution; les hommes d’un âge
mûr, les plus graves, les plus barbus, se trouvaient
souvent compris dans cette foule impure, qui n’attendait
pas la nuit pour se ruer à la débauche. L’édile
eût souvent rougi des grands noms et des nobles
caractères, qu’il aurait pu découvrir sous les capes de
ces coureurs de mauvais lieux! Il y avait aussi bien
des catégories diverses parmi ces impudiques qui
formaient l’armée active de la Prostitution: les uns
se nommaient adventores, parce qu’ils allaient au-devant
des femmes et des filles qui leur semblaient
d’un commerce facile; les autres se nommaient
venatores, parce qu’ils pourchassaient, sans avoir
l’argent à la main comme les précédents, tout ce qui
leur promettait une proie nouvelle; on appelait Alcinoi
juventus (jeunesse d’Alcinoüs) ces beaux efféminés,
qui se promenaient nonchalamment par la
ville, en habit de fête, frisés, parfumés, parés, en
cherchant des yeux çà et là ce qui pouvait réveiller
[64]
leurs désirs, épuisés par une nuit d’excès. Les salaputii
étaient de petits hommes très-ardents, très-lubriques,
qui ne payaient pas d’apparence, mais qui
avaient quelque motif de se dire les héritiers d’Hercule.
Le poëte Horace se vantait d’être un des mieux
partagés dans la succession, et l’empereur Auguste
l’avait surnommé, à cause de cela, putissimum
penem, qu’il traduisait lui-même par homuncionem
lepidissimum (le plus drôle de petit bout d’homme)!
Les semitarii étaient des espèces de satyres, aux larges
épaules, au cou épais et nerveux, aux bras
robustes, au regard timide, à l’air sournois: ils
allaient se poster en embuscade dans les chemins
creux, sur la lisière des bois, au milieu des champs,
et là ils guettaient le passage de quelque misérable
prostituée; ils s’emparaient d’elle, de vive force, et
malgré ses cris, malgré ses efforts, ils en avaient
toujours bon marché. Comme ils ne s’adressaient
qu’à des femmes réputées communes, la loi des Injures
ne pouvait leur être appliquée, et la malheureuse,
en se relevant toute meurtrie et toute poudreuse,
ne trouvait que des rires et des quolibets
pour se consoler de sa mésaventure. Enfin, tout
homme marié qui entrait dans un lupanar devenait
un adultère (adulter); celui qui fréquentait les lieux
de débauches était un scortator; celui qui vivait familièrement
avec des courtisanes, qui mangeait avec
elles et qui se déshonorait dans leur compagnie,
s’appelait mœchus. Cicéron accuse Catilina de s’être
[65]
fait une cohorte prétorienne de scortateurs; le poëte
Lucilius dit qu’un homme marié qui commet une
infidélité à l’égard de sa femme porte aussi la peine
de l’adultère, puisqu’il est adultère de nom; et un
vieux scoliaste de Martial donne à entendre que le
mot adulter s’appliquait à un adultère par accident
ou par occasion, tandis que le mot mœchus exprimait
surtout l’habitude, l’état normal de l’adultère.
La langue latine aimait les diminutifs autant que les
augmentatifs; elle avait donc augmenté le substantif
mœchus en créant mœchocinædus, qui comprenait
dans un seul mot plusieurs sortes de débauches; elle
avait en même temps cherché le diminutif du verbe
mœchor, en disant mœchisso, qui signifiait à peu près
la même chose, avec un peu plus de délicatesse.
Mais la langue grecque, d’où mœchus avait été tiré,
possédait dix ou douze mots différents, formés de la
même souche, pour exprimer les nuances et les variétés
de μοιχεύω et de μοιχὁς.
Tout homme qui se respectait encore ne se rendait
aux lieux de Prostitution, que le visage caché et la
tête enveloppée dans son manteau. Personne n’avait,
d’ailleurs, à lui demander compte du déguisement
qu’il jugeait à propos de prendre. Ainsi, quand
Héliogabale allait la nuit visiter les mauvais lieux
de Rome, il n’y entrait que couvert d’une cape
de muletier, pour n’être pas reconnu: Tectus cucullione
mulionico, ne agnosceretur, ingressus, dit
Lampridius. L’édile lui-même ne se fût pas permis
[66]
de lever ce capuchon, qui lui eût montré l’empereur;
mais il faisait observer très-rigoureusement,
surtout pendant le jour et sur la voie publique, les
ordonnances somptuaires qui défendaient, aux mérétrices
inscrites ou brevetées, l’usage de la stole ou
robe longue, des bandelettes de tête, des tuniques
de pourpre, et même, en divers temps, des broderies
et des joyaux d’or. Ces ordonnances du sénat
furent renouvelées par les empereurs, à plusieurs
époques, et leur application trouva parfois de la
mollesse ou du relâchement dans le pouvoir des
édiles, qui ne punissaient pas également toutes les
contraventions. Ainsi, voyait-on souvent au théâtre
et au cirque les grandes courtisanes, vêtues comme
des reines, étincelantes d’or et de pierreries; elles
ne se soumettaient pas aisément à porter des toges ou
tuniques jaunes et des dalmatiques à fleurs: «Qui
porte des vêtements fleuris, dit Martial, et qui permet
aux mérétrices d’affecter la pudeur d’une matrone
vêtue de la stole?» Une femme qui se vouait
à la Prostitution était déchue de la qualité de matrone,
et elle renonçait elle-même à paraître en
public avec la toge et les insignes des honnêtes
femmes: son inscription sur les registres de l’édile
la rendait indigne de la robe longue et ample, dite
matronale. Aussi, Martial raille-t-il, à l’occasion de
cadeaux envoyés à une prostituée (mœcham): «Vous
donnez des robes d’écarlate et de pourpre violette à
une fameuse courtisane! Voulez-vous lui donner le
[67]
présent qu’elle a mérité? Envoyez-lui une toge.»
La toge, dans l’origine des institutions romaines,
avait été commune aux deux sexes; mais, lorsque
l’invasion des femmes étrangères dans la République
eut nécessité l’adoption d’un vêtement particulier
aux matrones, celles-ci prirent la stole, qui tombait
à longs plis jusqu’aux talons et qui cachait si pudiquement
la gorge, que les formes en étaient à peine
accusées sous la laine ou sous le lin. La toge ou tunique
sans manches resta le vêtement des hommes
et en même temps des femmes qui avaient perdu les
priviléges de leur sexe avec les droits et les honneurs
réservés aux matrones. Telle était probablement
la principale règle de costume, à laquelle les
édiles tenaient la main.
Il y avait, en outre, bien des défenses et bien des
prescriptions moins importantes concernant l’habillement
des mérétrices, mais elles se modifièrent tant
de fois, qu’il serait difficile de les fixer d’une manière
générale et de leur assigner une époque certaine.
La chaussure et la coiffure des courtisanes
avaient été réglées comme leur vêtement; néanmoins,
l’édilité se montrait moins rigoureuse au sujet de ces
parties de leur toilette. Les matrones s’étant attribué
l’usage du brodequin (soccus), les courtisanes
n’eurent plus la permission d’en mettre, et elles
furent obligées d’avoir toujours les pieds nus dans
des sandales ou des pantoufles (crepida et solea),
qu’elles attachaient sur le cou-de-pied avec des courroies
[68]
dorées. Tibulle se plaît à peindre le petit pied
de sa maîtresse, comprimé par le lien qui l’emprisonne:
Ansaque compressos colligat arcta pedes. La
nudité des pieds, chez les femmes, était un indice
de Prostitution, et leur éclatante blancheur faisait de
loin l’office du lénon, puisqu’elle attirait les regards
et les désirs. Parfois, leurs sandales ou leurs pantoufles
étaient entièrement dorées: Auro pedibus
induto, a dit Pline, en parlant de cette splendide
marque de déshonneur. Parfois, pour imiter la couleur
de l’or, elles se contentaient de chaussure jaune,
quoique cette chaussure eût été primitivement celle
des nouveaux mariés: «Portant un brodequin
jaune à son pied blanc comme la neige,» a dit Catulle.
Mais les nouveaux mariés se fussent bien
gardés de mettre des sandales ou des pantoufles, et
les courtisanes n’eussent point osé porter la couleur
jaune en brodequins.
Les matrones avaient aussi adopté une coiffure
qu’elles ne laissèrent point usurper par les courtisanes:
c’était une large bandelette blanche, qui servait
à la fois de lien et d’ornement à la chevelure. Cette
bandelette fut probablement, dans les temps héroïques
de Rome, une réminiscence de celle qui ornait la tête
des génisses et des brebis offertes en sacrifice aux divinités.
La matrone se présentait elle-même, en guise
de victime, aux autels de la Pudeur, comme pour
rappeler que le culte des dieux générateurs, à une
époque reculée, avait reçu en offrande le tribut de la
[69]
virginité. Ce ne furent pas les courtisanes, mais les
femmes chastes qui s’arrogèrent le droit de ceindre de
bandelettes leurs cheveux lissés et brillants; on permit
aux vierges la bandelette simple, qui les faisait
reconnaître, et la bandelette double resta exclusivement
l’apanage des matrones: «Loin d’ici! s’écrie
Ovide dans l’Art d’aimer, loin, bandelettes minces
(vittæ tenues), insigne de la pudeur! Loin, tunique
longue, qui couvre la moitié des pieds!» Cette stole
ou longue robe (insista), ordinairement bordée de
pourpre dans le bas, ne caractérisait pas moins la
matrone romaine que ces bandelettes qui encadraient
si gracieusement une chevelure noire et qui en
retenaient derrière la tête les anneaux tressés. Hormis
ces bandelettes simples ou doubles, les courtisanes
étaient libres de prendre la coiffure qui leur
plaisait le mieux. Nous avons dit qu’elles s’enveloppaient
la tête avec leur palliolum, demi-mantelet
d’étoffe; qu’elles abaissaient un capuce sur leur visage,
tandis que les matrones se montraient partout
à visage découvert et la tête nue, pour faire entendre
qu’elles n’avaient rien à se reprocher, et
qu’elles ne rougissaient pas sous les regards du
public, leur juge perpétuel. Ces fières Romaines,
pendant plusieurs siècles, auraient cru se déshonorer
en cachant leur chevelure, en la teignant, en la
poudrant, en dénaturant sa couleur noire; elles ne
se résignaient même à la diviser en tresses qui venaient
s’enrouler sur le sommet de la tête ou sur les
[70]
tempes, que pour se distinguer des jeunes filles non
mariées (innuptæ), que leur chevelure frisée ou
bouclée avait fait surnommer cirratæ. Les courtisanes
ne se privèrent pas de copier les différents
genres de coiffures adoptées par les matrones et les
cirratæ, mais elles en changèrent l’aspect par les
nuances variées qu’elles donnaient à leurs cheveux:
tantôt elles les teignaient en jaune avec du safran,
tantôt en rouge avec du jus de betterave, tantôt en
bleu avec du pastel; quelquefois elles affaiblissaient
seulement l’éclat de leurs cheveux d’ébène, en les
frottant avec de la cendre parfumée; puis, lorsque
les empereurs se firent une espèce d’auréole divine
en semant de la poudre d’or dans leurs cheveux,
les courtisanes furent les premières à s’approprier
une mode qu’elles regardaient comme leur appartenant,
et elles trônèrent vis-à-vis des Césars, dans
les fêtes publiques et les jeux solennels, le front
ceint d’une chevelure dorée, comme les déesses
dans les temples. Mais leur divinité ne dura pas
longtemps, et la poudre d’or leur fut interdite; elles
remplacèrent cette poudre par une autre, faite avec
de la gaude, qui brillait moins au soleil, mais qui
était plus douce à l’œil. Celles que la couleur bleue
avait séduites se poudrèrent à leur tour avec du
lapis pulvérisé: «Que tous les supplices du Ténare
punissent l’insensé qui fit perdre à tes cheveux leur
nuance naturelle! s’écrie Properce aux genoux de sa
maîtresse. Rends-moi souvent heureux, ma Cynthie;
[71]
à ce prix, tu seras belle et toujours assez belle à
mes yeux. De ce qu’une folle se peint en bleu le visage
et la chevelure, s’ensuit-il que ce fard embellisse?»
L’édile faisait la guerre aux chevelures dorées
chez les courtisanes; mais il ne les empêchait pas de
faire teindre leurs cheveux en bleu ou en jaune, il
les y encourageait même, car c’étaient là leurs couleurs
distinctives (cærulea et lutea): le bleu, par
allusion à l’écume marine, qui avait engendré Vénus,
et à certains poissons qui étaient nés en même
temps qu’elle; le jaune, par allusion à l’or, qui était
le véritable dieu de leur industrie malhonnête.
Les édiles auraient eu trop à faire, s’il leur eût
fallu constater, juger et punir toutes les contraventions
somptuaires que se permettaient les mérétrices;
ils fermaient les yeux sur une foule de petits délits
de ce genre, qu’on pardonnait à la coquetterie féminine.
Mais, en général, les femmes inscrites n’avaient
aucun intérêt à se faire passer pour des
matrones, et elles préféraient suivre des modes étrangères
qui leur étaient propres et qui les signalaient
de loin à l’attention de leur clientèle. C’est ainsi
qu’elles portaient plus volontiers des vêtements qui
n’avaient pas même de nom dans la langue romaine:
babylonici vestes et sericæ vestes. On appelait babylonici
vestes des espèces de dalmatiques traînant sur
les talons et agrafées par devant, faites en étoffes
peintes, bariolées, à fleurs, à broderies et de mille
couleurs. Les courtisanes de Tyr et de Babylone
[72]
avaient apporté à Rome ce costume national, cette
antique livrée de la Prostitution. On appelait sericæ
vestes d’amples robes en tissu de soie, si léger et si
transparent, que, selon l’expression d’un témoin oculaire,
elles semblaient inventées pour faire mieux
voir ce qu’elles avaient l’air de cacher. Les courtisanes
de l’Inde ne s’habillaient pas autrement, et
au milieu de la gaze, on les voyait absolument nues.
«Vêtements de soie, dit avec indignation le chaste
auteur du Traité des bienfaits, vêtements de soie, si
tant est qu’on puisse les nommer des vêtements,
avec lesquels il n’est aucune partie du corps que la
pudeur puisse défendre, avec lesquels une femme
serait fort embarrassée de jurer qu’elle n’est pas nue;
vêtements qu’on dirait inventés pour que nos matrones
ne puissent en montrer plus à leurs adultères
dans la chambre à coucher, qu’elles ne font en public!»
Sénèque en voulait particulièrement à cette
mode asiatique, car il y revient encore dans ses Controverses:
«Un misérable troupeau de servantes se
donne bien du mal pour que cette adultère étale sa
nudité sous une gaze diaphane, et pour qu’un mari
ne connaisse pas mieux que le premier étranger
venu les charmes secrets de sa femme.» Les robes
babyloniennes, quoique plus décentes que les tissus
de Tyr, qu’un poëte latin compare à une vapeur
(ventus textilis), étaient plus généralement adoptées
par les mérétrices; car il fallait être bien sûr de ses
perfections cachées, pour en faire une montre aussi
[73]
complète. Cette impudique exhibition, dans tous les
cas, n’avait rien à craindre des réprimandes de l’édile,
et les femmes inscrites ou non, qui se permettaient
ce costume aérien, ne se piquaient pas de singer
les matrones. Il en était de même de celles qui s’habillaient
à la babylonienne, avec des dalmatiques
orientales qu’une personne honnête eût rougi de
porter en public, et qui resplendissaient des plus
vives couleurs: «Étoffes peintes, tissues à Babylone,
dit Martial, et brodées par l’aiguille de Sémiramis.»
Les courtisanes qui se soumettaient docilement à
la toge professionnelle y ajoutaient l’amiculum,
manteau court, fait de deux morceaux, cousus par
le bas et attachés sur l’épaule gauche avec un bouton
ou une agrafe, de sorte qu’il y avait deux ouvertures
ménagées pour passer les bras. Cet amiculum,
dont le nom galant équivalut à petit ami, ne descendait
pas au-dessous de la taille; il avait à peu près
la même apparence que la chlamyde des hommes;
il servait exclusivement aux femmes de mauvaise
vie. Isidore de Séville, dans ses Étymologies, assure
que ce vêtement était si connu par sa destination,
qu’on faisait prendre l’amiculum à une matrone
surprise en adultère, afin que cet amiculum attirât à
lui une partie de l’opprobre qui rejaillissait sur la
stole romaine. Ce mantelet, qui se nommait κυκλας
(cyclas) en grec, et qui n’avait jamais paru malhonnête
aux femmes grecques, fut sans doute apporté à
[74]
Rome par des hétaires, qui lui léguèrent leur infamie.
La couleur de l’amiculum paraît avoir été
blanche, puisque ce vêtement était de lin. Quant à
la toge qu’on portait par-dessous, elle était presque
toujours verte: cette couleur étant celle de Priape,
dieu des jardins. Les commentateurs ont beaucoup
écrit sur la nuance de ce vert: les uns l’ont fait pâle,
les autres foncé; ceux-ci lui ont donné un reflet
doré, ceux-là une nuance jaunâtre. Quoiqu’il en fût,
ce vert-là (galbanus) avait été accaparé par les libertins
des deux sexes, à tel point qu’on les désignait
par le surnom de galbanati, habillés de vert; on
appliquait l’épithète de galbani aux mœurs dissolues;
on appelait galbana une étoffe fine et rase d’un vert
pâle. Vopiscus nous représente un débauché, vêtu
d’une chlamyde écarlate et d’une tunique verte à
longues manches. Juvénal nous en montre un autre,
habillé de bleu et de vert (cærulea indutus scutulata
aut galbana rasa). Enfin, il s’était fait une telle affinité
entre la couleur verte et celui qui la portait, que
galbanatus était devenu synonyme de giton ou mignon.
Toutes les modes étrangères appartenaient de droit
aux courtisanes qui avaient perdu le titre de citoyenne,
et qui, d’ailleurs, venaient la plupart des
pays étrangers. Leur coiffure d’apparat, car le capuce
ou cuculle (cucullus) ne leur servait que le soir ou le
matin, pour aller au lupanar et pour en sortir; la
coiffure qu’elles portaient de préférence au théâtre et
[75]
dans les cérémonies publiques, où leur présence
était tolérée; cette coiffure, qui leur fut longtemps
particulière, témoignait assez que la Prostitution
avait commencé en Orient, et que Rome lui laissait
son costume national. On distinguait trois sortes de
coiffure ou d’habillements de tête spécialement réservés
aux mérétrices de Rome: la mitre, la tiare et
le nimbe. Le nimbe paraît égyptien; c’était une bande
d’étoffe plus ou moins large, qu’on ceignait autour
du front pour en diminuer la hauteur. Les Romains,
à l’exemple des Grecs, n’admiraient pas les grands
fronts chez les femmes, et celles-ci cherchaient à dissimuler
le leur, qui était plus élevé et plus proéminent
que le front des femmes grecques. Le nimbe ou
bandeau frontal était quelquefois chargé d’ornements
en or, et ses deux bouts pendaient de chaque
côté de la tête, comme les bandelettes qui descendent
sur les mamelles d’un sphinx. La mitre venait évidemment
de l’Asie-Mineure, de la Chaldée ou de la
Phrygie, selon qu’elle était plus ou moins conique.
La tiare venait de la Judée et de la Perse. Cette tiare,
en étoffe de couleur éclatante, avait la forme d’un cylindre,
et ressemblait aux dômes pointus des temples
de l’Inde; la mitre, au contraire, affectait la
forme d’un cône, et tantôt celle d’un casque ou
d’une coquille. Telle était la mitre phrygienne, que
les peintres ont attribuée par tradition au berger
troyen Pâris jugeant les trois déesses et donnant la
pomme à Vénus. Ces souvenirs mythologiques justifiaient
[76]
assez l’adoption de ce bonnet recourbé,
comme emblème de la liberté du choix et du plaisir.
Quant à la mitre pyramidale, elle avait deux pendants
comme le nimbe, avec une bordure autour du
front; après avoir été l’insigne des anciens rois de
Perse et d’Assyrie, elle couronnait encore d’une
royauté impudique les courtisanes de Rome, qui
régnaient mitrées ou nimbées (nimbatæ et mitratæ)
aux représentations du théâtre et aux jeux du
cirque, sans payer d’amende au censeur ni à l’édile.
Plus tard, le nom de cette coiffure orgueilleuse devint
pour elles un sobriquet méprisant.
Mais les édiles, qui souffraient que les mérétrices
fussent vêtues, coiffées et chaussées comme les reines
de Tyr et de Ninive, tenaient la main pourtant à ce
qu’elles n’eussent pas de litière ni aucune espèce de
voiture. Les matrones avaient seules le droit de se
faire porter par des véhicules, des chevaux ou des
esclaves, et elles se montraient fort jalouses de ce
privilége. Dans les premiers siècles de Rome, elles se
servaient déjà d’une voiture grossière dont l’invention
était attribuée à Carmenta, mère d’Evandre; et
comme cette voiture, sorte de charrette fermée, montée
sur roues, rendait de grands services aux femmes
grosses incapables de marcher, son inventrice fut
déifiée et chargée de présider aux accouchements.
Les Romains, en ce temps-là, ne toléraient pas même
chez les femmes la mollesse et le luxe: le sénat interdit
l’usage des voitures de Carmenta. Les femmes,
[77]
surtout celles qui se voyaient enceintes, protestèrent
contre l’arrêt trop rigoureux du sénat et formèrent
un pacte entre elles, en jurant de se refuser au devoir
conjugal et de ne pas donner d’enfants à la
patrie jusqu’à ce que cet arrêt fût annulé. Elles repoussèrent
si impitoyablement leurs maris, que
ceux-ci supplièrent le sénat de rapporter la malheureuse
loi qui les privait de leurs femmes. Celles-ci,
satisfaites de leur triomphe, en firent honneur à la
déesse Carmenta, et lui érigèrent un temple sur le
penchant du mont Capitolin. Depuis cet événement
mémorable, dont Grævius a recueilli plusieurs versions
dans ses Antiquités Romaines, les matrones
restèrent en possession de leurs voitures, qui avaient
perdu leurs roues et qui, au lieu de rouler sur le
pavé inégal, étaient doucement portées par des
hommes ou par des chevaux. Ces voitures étaient de
deux espèces, la basterne (basterna) et la litière
(lectica); la première, soutenue sur un brancard que
deux mules transportaient à petits pas, formait une
sorte de cabinet suspendu, fermé et vitré: «Précaution
excellente, dit le poëte qui nous fournit
cette description, pour que la chaste matrone, allant
à travers les rues, ne soit pas profanée par le regard
des passants.» La litière, également couverte
et fermée, était portée à bras d’hommes. Il y en eut
de toutes formes et de toutes grandeurs, depuis la
chaise, cella, qui ne pouvait servir qu’à une personne,
jusqu’à l’octophore qui se balançait sur les
[78]
épaules de huit porteurs. Dans l’une, la femme était
assise; dans l’autre, elle était couchée sur des coussins,
et elle avait souvent à ses côtés deux ou trois
compagnes de route. Le luxe envahit les litières
ainsi que tout ce qui contribuait à rendre la vie
molle et voluptueuse: ces litières furent peintes, dorées
en dehors, tapissées en dedans de fourrures et
d’étoffes de soie. C’est alors que les courtisanes voulurent
s’en emparer pour leur propre usage.
Elles y réussirent un moment, mais l’édile ne fit
que se relâcher de sa sévérité, en admettant quelques
exceptions accordées à la faveur et à la richesse.
Sous plusieurs empereurs, on vit les fameuses mérétrices
en litière. Ces privilégiées ne se contentèrent
pas de la litière fermée, qui passait silencieusement
dans les rues sans laisser voir ce qu’elle contenait.
On perfectionna ce mode de transport: l’intérieur
devint une véritable chambre à coucher, et, suivant
l’expression d’un commentateur, ce furent des lupanars
ambulants. Il y avait, en outre, des litières ouvertes,
à rideaux, dans lesquelles l’œil du passant
plongeait avec convoitise. Parfois, les rideaux de
cuir ou d’étoffe étaient tirés, mais la femme en soulevait
le coin pour voir et pour être vue. Le relâchement
des mœurs avait multiplié les litières à Rome
et en même temps les avantages qu’en retirait la
Prostitution élégante. Les matrones elles-mêmes ne
s’étonnaient plus qu’on les confondit avec les courtisanes:
«Alors nos femmes, les matrones romaines,
[79]
dit tristement Sénèque, s’étalaient dans leurs voitures
comme pour se mettre à l’encan!» Les unes
cherchaient ainsi les aventures; les autres allaient
au rendez-vous. La litière s’arrêtait à l’angle d’une
place ou dans une rue écartée; les porteurs la déposaient
à terre et faisaient le guet à l’entour; cependant
la portière s’était entr’ouverte, et un bel
adolescent avait pénétré dans ce sanctuaire inviolable.
On ignorait toujours si la litière était vide ou occupée.
Les courtisanes, d’ailleurs, donnaient l’exemple
aux matrones; on ne les rencontrait pas seulement en
voiture fermée, on les voyait partout en chaise découverte,
in patente sella, dit Sénèque. Un scoliaste
de Juvénal fait preuve d’imagination plutôt que de
critique, en avançant que les filles qui se prostituaient
en voiture s’appelaient sellariæ, par opposition
aux cellariæ, qui étaient les habituées cellulaires
des lupanars. Juvénal ne dit pas même qu’on entrait
dans la chaise de Chione, quand on avait un caprice
de passage; il dit au contraire: «Tu hésites à faire
descendre de sa chaise à porteur la belle Chione!»
Mais Pierre Schœffer, dans son traité De re vehiculari,
est d’avis qu’en certaines circonstances la voiture
se changeait en lieu mobile de Prostitution. Ce
fut sans doute pour cette raison que Domitien défendit
l’usage de la litière non-seulement aux mérétrices
inscrites, mais même à toutes les femmes notées
d’infamie (probrosis feminis).
- H Cabasson del.
- Drouart, imp., r. du Fouarre, 11, Paris
- A. Garnier, sc.
MESSALINE.
Les édiles eurent encore d’autres prohibitions à
[80]
faire exécuter à l’égard de ces femmes-là; car il
est certain qu’à différentes époques la pourpre et
l’or leur furent interdits. Mais le règlement de police
s’usait bientôt contre la ténacité d’un sexe qui aime
la toilette et qui supporte difficilement des privations
de coquetterie. Plusieurs antiquaires veulent
qu’il y ait eu une loi à Rome, par laquelle l’usage
des ornements d’or et d’étoffes précieuses était absolument
défendu aux femmes de mauvaise vie,
excepté dans l’intérieur des lieux de débauche et
pour l’exercice de leur métier à huis clos. Si cette
loi exista, elle ne fut pas longtemps en vigueur ou
du moins elle reçut de fréquentes atteintes, car les
poëtes nous représentent souvent les courtisanes vêtues
de pourpre et ornées de joyaux. Ovide, dans le
Remède d’amour, n’a pas l’air de se souvenir des lois
somptuaires, en décrivant la toilette d’une courtisane
ou du moins d’une femme de plaisir: «Les
pierreries et l’or la couvrent tout entière, tellement
que sa beauté est la moindre partie de sa valeur.»
Plaute, dans une de ses comédies, met en scène une
mérétrice dorée, mais il semble dire que c’est chose
nouvelle à Rome: Sed vestita, aurata, ornata, ut lepide!
ut concinne! ut nove! Juvénal nous dépeint une courtisane
d’hôtellerie, la tête nue environnée d’un nimbe
d’or (quæ nudis longum ostendit cervicibus aurum); et
pourtant, il fait évidemment allusion au privilége
qu’avaient les matrones de porter seules des pierreries
et des boucles d’oreilles, dans ces vers où il dit
[81]
qu’une femme qui a des émeraudes au cou et des
perles aux oreilles se permet tout et ne rougit de rien:
Nil non permittit mulier, sibi turpe putat nil,
Cum virides gemmas collo circumdedit et cum
Auribus externis magnos commisit elenchos.
Apulée confirme le témoignage de Juvénal: «L’or
de ses bijoux, l’or de ses vêtements, ici filé, là travaillé,
annonçait tout d’abord que c’était une matrone.»
On sait néanmoins que la loi Oppia avait
interdit la pourpre à toutes les femmes, pour la réserver
aux hommes. Néron renouvela cette interdiction,
qui ne fut levée définitivement que sous le
règne d’Aurélien; mais elle aurait toujours subsisté
pour les courtisanes et pour les femmes réputées
infâmes, dans l’opinion d’un savant italien, Santinelli,
qui n’a pas pris garde que les anciens avaient
plusieurs sortes de pourpre, et qu’une seule, la plus
éclatante, était l’insigne du pouvoir. La pourpre plébéienne
ou violette ne fut certainement pas comprise
dans les lois d’interdiction, que les empereurs
d’Orient restreignirent, en les exagérant, à la pourpre
impériale (purpura). Ferrarius, dans son traité De re
vestiaria, prétend, pour accorder ces autorités contradictoires,
que les courtisanes avaient la permission
de porter de l’or et de la pourpre sur elles,
même en public, pourvu que la pourpre ne fût point
appliquée par bandes à leurs vêtements, pourvu que
l’or ne s’enroulât pas en bandelettes dans leurs cheveux.
[82]
Il vaut mieux croire que les règlements somptuaires
relatifs aux courtisanes subirent de fréquentes
variations, dépendant tantôt du sénat, tantôt
de l’empereur, tantôt de l’édile, et qu’il suffisait
de l’influence d’une de ces souveraines d’un jour
ou plutôt du crédit d’un de leurs amants pour faire
abandonner d’anciens usages qui reprenaient force
de loi sous une autre influence plus honorable. A
Rome, comme dans toutes les villes où la Prostitution
fut soumise à des ordonnances de police, les
femmes de mauvaise vie, quoique tolérées et autorisées,
furent en butte à des mesures de rigueur qui
ressemblaient souvent à des persécutions, mais qui
avaient toujours pour objet de réprimer des excès
et de corriger des abus dans les mœurs publiques.

Sommaire.—La Prostitution élégante.—Les bonnes mérétrices.—Leurs
amants.—Différence des grandes courtisanes de Rome
et des hétaires grecques.—Cicéron chez Cythéris.—Les preciosæ
et les famosæ.—Leurs amateurs.—La voie Sacrée.—Promenades
des courtisanes.—Promenades des matrones.—Cortége
des matrones.—Ce que dit Juvénal des femmes romaines.—Ogulnie.—Portrait
de Sergius, le favori d’Hippia,
par Juvénal.—Le gladiateur obscène de Pétrone.—Les suppôts
de Vénus Averse.—Ce qu’à Rome on appelait plaisirs
permis.—Langue muette du meretricium.—Le doigt du milieu.—Le
signum infame.—Pourquoi le médius était voué à
l’infamie chez les Grecs.—La chasse à l’œil et le vol aux oreilles.—Les
gesticulariæ.—Pantomime amoureuse.—Réserve
habituelle du langage parlé de Rome.—De la langue érotique
latine.—Frère et sœur.—La sœur du côté gauche et le petit
frère.—Des écrits érotiques et sotadiques ou molles libri.—Bibliothèque
secrète des courtisanes et des débauchés.—Les livres
lubriques de la Grèce et de Rome détruits par les Pères de
l’Église.
Il y avait à Rome une Prostitution qui ne relevait
certainement des édiles en aucune manière,
[84]
pourvu qu’elle n’usurpât point les prérogatives vestiaires
des matrones. C’était la Prostitution que l’on
pourrait nommer voluptueuse et opulente, celle que
la langue latine qualifiait de bonne (bonum meretricium).
Les femmes qui la desservaient se nommaient
aussi bonnes mérétrices (bonæ mulieres), pour désigner
la perfection du genre; ces courtisanes, en effet,
pouvaient bien être inscrites sur les registres de
l’édilité, comme étrangères, comme affranchies,
comme musiciennes, mais elles n’avaient pas d’analogie
avec les malheureuses esclaves de l’incontinence
publique; on ne les rencontrait jamais, à la
neuvième heure du jour, la tête enveloppée d’un
palliolum ou cachée sous un capuchon, courant au
lupanar ou cherchant aventure; jamais on ne les
surprenait, dans les rues et les carrefours, en flagrant
délit de débauche nocturne; jamais on ne les trouvait
dans les hôtelleries, les tavernes, les bains
publics, les boulangeries et autres lieux suspects;
jamais enfin, quoiqu’elles fussent notées d’infamie
comme les autres, on ne rougissait pas de se montrer
en public avec elles et de se déclarer leur
amant, car elles avaient la plupart des amants privilégiés,
amasii ou amici, et ces amants étaient, en
quelque sorte, des manteaux plus ou moins brillants
qui cachaient leurs amours mercenaires. Elles formaient
l’aristocratie de la Prostitution; et, de même
que dans la Grèce, elles exerçaient à Rome une
immense action sur les modes, sur les mœurs, sur
[85]
les arts, sur les lettres et sur toutes les circonstances
de la vie patricienne. Mais, dans aucun cas, elles
n’avaient d’empire sur la politique et sur les affaires
de l’État; elles ne se mêlaient pas, ainsi que les
hétaires grecques, des choses publiques et du gouvernement;
elles vivaient toujours en dehors du
forum et du sénat; elles se contentaient de l’influence
que leur donnaient leur beauté et leur esprit
dans le petit monde de la galanterie, monde parfumé,
élégant et corrompu, dont Ovide rédigea le code
sous le titre de l’Art d’aimer, et qui eut pour poëtes
historiographes Properce, Catulle et une foule d’écrivains
érotiques, que l’antiquité semble avoir par
pudeur condamnés à l’oubli.
Ces courtisanes en renom ressemblaient aux hétaires
d’Athènes, autant que Rome pouvait ressembler
à la ville de Minerve; autant que le caractère
romain pouvait se rapprocher du caractère athénien.
Mais les descendants d’Évandre étaient trop fiers de
leur origine et trop pénétrés de la majesté du titre
de citoyen romain, pour accorder à des femmes, à
des étrangères, à des infâmes, si aimables qu’elles
fussent d’ailleurs, un culte d’admiration et de respect.
Une courtisane qui aurait voulu prendre et qui
aurait pris de l’autorité sur un sénateur consulaire,
sur un magistrat, sur un chef militaire, eût déshonoré
celui qui se serait soumis à cette honteuse dépendance,
à cette ridicule sujétion. Les hommes
d’Etat les plus graves, les plus austères, ne se privaient
[86]
pas du plaisir de fréquenter les courtisanes
et de se mêler aux mystères de leur intimité; Cicéron
lui-même soupait chez Cythéris, qui avait
été esclave avant d’être affranchie par Eutrapelus,
et qui devint la maîtresse favorite du triumvir Antoine.
Mais ces rapports continuels qui avaient lieu
entre les courtisanes et les personnages les plus considérables
de la république restaient ordinairement
circonscrits dans l’intérieur d’une maison de plaisance,
d’une villa, où ne pénétrait pas l’œil curieux
du peuple. Dans les rues, à la promenade, au
cirque, au théâtre, si les courtisanes à la mode,
les précieuses et les fameuses (famosæ et preciosæ)
paraissaient entourées d’une troupe d’amateurs
(amatores) empressés, c’étaient de jeunes débauchés,
qui faisaient honte à leur famille, c’étaient
des affranchis, que leur richesse mal acquise n’avait
pas lavés de la tache d’esclavage; c’étaient des
artistes, des poëtes, des comédiens, qui se mettaient
volontiers au-dessus de l’opinion; c’étaient des
lénons déguisés, qui recherchaient naturellement
les meilleures occasions de trafic et de lucre. Ainsi,
chez les Romains, la courtisane la plus triomphante
ne voyait autour d’elle que des gens mal famés, excepté
dans les soupers et les comessations, où elle
réunissait parfois les premiers citoyens de Rome,
qui abusaient, à huis clos, des licences de la vie
privée.
Il fallait aller, le soir, sur la voie Sacrée, ce rendez-vous
[87]
quotidien du luxe, de la débauche et de
l’orgueil, pour voir combien était nombreuse, et
combien était brillante cette armée de courtisanes à
la mode, qui occupaient Rome en ville conquise,
et qui y faisaient plus de captifs et de victimes que
n’en avaient fait les Gaulois de Brennus. Elles venaient
là tous les jours faire assaut de coquetterie,
de toilette et d’insolence, au milieu des matrones,
qu’elles éclipsaient de leurs charmes et de leurs
atours. Tantôt, elles se faisaient porter par de robustes
Abyssins dans des litières découvertes, où
elles étaient couchées indolemment, à demi nues,
un miroir d’argent poli à la main, les bras chargés
de bracelets, les doigts de bagues, la tête inclinée
sous le poids des boucles d’oreilles, du nimbe et
des aiguilles d’or; à leurs côtés, de jolies esclaves
rafraîchissaient l’air avec de grands éventails en
plumes de paon; devant et derrière les litières, marchaient
des eunuques et des enfants, des joueurs
de flûte et des nains bouffons, qui formaient cortége.
Tantôt, assises ou debout dans des chars légers,
elles dirigeaient elles-mêmes les chevaux avec rapidité,
et cherchaient à se dépasser l’une l’autre,
comme si elles luttaient de vitesse dans la carrière.
Souvent, elles montaient de fins coursiers, qu’elles
conduisaient avec autant d’adresse que d’audace;
ou de belles mules d’Espagne, qu’un nègre menait
par la bride. Les moins riches, les moins ambitieuses,
les moins turbulentes allaient à pied, toutes
[88]
élégamment vêtues d’étoffes bariolées en laine ou
en soie, toutes coiffées avec art, leurs cheveux nattés
formant des diadèmes blonds ou dorés, entrelacés
de perles et de joyaux; les unes jouaient avec
des boules de cristal ou d’ambre pour se tenir les
mains fraîches et blanches; les autres portaient des
parasols, des miroirs, des éventails, quand elles
n’avaient pas des esclaves qui les leur portassent,
mais chacune avait au moins une servante qui la
suivait ou qui l’accompagnait comme un émissaire
indispensable. Ces courtisanes, on le voit, n’étaient
pas toutes sur le même pied de fortune et de distinction,
mais elles se ressemblaient par ce seul
point, qu’elles ne figuraient pas sur les registres de
l’édile, et qu’elles se trouvaient ainsi exemptes
des règlements de police relatifs à la Prostitution,
car elles n’avaient pas un prix taxé, un nom de
guerre inscrit et reconnu, en un mot, le droit
d’exercer leur métier dans les lupanars publics. Elles
se gardaient bien de demander à l’édile la dégradante
licentia stupri, mais elles ne se faisaient pas
faute de se vouer à la Prostitution, comme si elles
en avaient obtenu licence. On ne les inquiétait pas
toutefois à cet égard, à moins qu’elles n’insultassent
trop ouvertement à la juridiction édilitaire, en se
livrant sans choix (sine delectu), dans les lieux publics,
à des œuvres de débauche vénale.
Ces mérétrices faciles abondaient sur la voie Sacrée,
et, si l’on en croit Properce, elles ne s’en éloignaient
[89]
pas beaucoup, pour donner satisfaction au
passant qui leur faisait signe: «Oh! que j’aime
bien mieux, dit-il dans ses élégies, cette affranchie
qui passe la robe entr’ouverte, sans crainte
des argus et des jaloux; qui use incessamment avec
ses cothurnes crottés le pavé de la voie Sacrée, et
qui ne se fait pas attendre si quelqu’un veut aller à
elle! Jamais elle ne différera, jamais elle ne te demandera
indiscrètement tout l’argent qu’un père
avare regrette souvent d’avoir donné à son fils; elle
ne te dira pas: J’ai peur, hâte-toi de te lever, je t’en
prie!» (Nec dicet: Timeo! propera jam surgere, quæso!)
Cette coureuse de la voie Sacrée, on le voit, gagnait
sa vie en plein jour, sans trop se soucier de l’édile et
des lois de police. Properce semble même indiquer
qu’elle prenait à peine la précaution de s’écarter de
la voie Sacrée, qui commençait à l’Amphithéâtre et
conduisait au Colisée, en longeant le temple de la
Paix et la place de César. Il y avait aux alentours
du Colisée assez de bocages et de bois, sacrés ou
non, dans lesquels l’amour errant ne rencontrait
qu’un peuple de statues et de termes qui ne le troublaient
pas. D’ailleurs, les bains, les auberges, les
cabarets, les boulangeries, les boutiques de barbier,
offraient des asiles toujours ouverts à la Prostitution
anonyme, dont la voie Sacrée était le rendez-vous
général. Les matrones y venaient aussi, la plupart
en litière ou en voiture, surtout à certaines époques
où elles avaient obtenu le privilége exclusif des
[90]
chaises et des litières (sellæ et lecticæ); elles n’affectaient
pas, dans ces temps de corruption inouïe,
une tenue beaucoup plus décente que celle des courtisanes
de profession; elles étaient, comme celles-ci,
étendues sur des coussins de soie, dans un costume,
que ne rendaient pas moins immodeste les bandelettes
de leur coiffure et la pourpre de leur stole à
longs plis flottants, entourées d’esclaves et d’eunuques
portant des éventails pour chasser les mouches,
et des bâtons pour éloigner la foule. Ces matrones,
ces héritières des plus grands noms de Rome, ces
épouses, ces mères de famille, devant lesquelles la
loi s’inclinait avec vénération, s’étaient bien relâchées,
sous les empereurs, des vertus chastes et
austères de leurs ancêtres. Celles qui paraissaient
dans la voie Sacrée, pour y étaler la pompe de leur
toilette et l’attirail de leur cortége, avaient souvent
pour objet de choisir un amant ou plutôt un vil et
honteux auxiliaire de leur lubricité. «Leurs servantes
laides et vieilles, dit M. Walkenaer dans sa
belle Histoire de la vie d’Horace, s’écartaient complaisamment
à l’approche de jeunes gens efféminés
(effeminati), dont les doigts étaient chargés de bagues,
la toge toujours élégamment drapée, la chevelure
peignée et parfumée, le visage bigarré par ces
petites mouches, au moyen desquelles nos dames,
dans le siècle dernier, cherchaient à rendre
leur physionomie plus piquante. On remarquait
aussi, dans ces mêmes lieux, des hommes, dont la
[91]
mise faisait ressortir les formes athlétiques et qui
semblaient montrer avec orgueil leurs forces musculaires.
Leur marche rapide et martiale offrait un contraste
complet avec l’air composé, les pas lents et
mesurés de ces jeunes jouvenceaux, aux cheveux
soigneusement bouclés, aux joues fardées, jetant de
côté et d’autre des regards lascifs. Ces deux espèces
de promeneurs n’étaient le plus souvent que des
gladiateurs et des esclaves; mais certaines femmes
d’un haut rang choisissaient leurs amants dans les
classes infimes, tandis que leurs jeunes et jolies suivantes
se conservaient pures contre les attaques des
hommes de leur condition, et ne cédaient qu’aux
séductions des chevaliers et des sénateurs.»
Nous avons rapporté en entier ce morceau pittoresque,
dont le savant académicien a pris les traits
dans Martial, Aulu-Gelle, Cicéron, Sénèque et Horace;
mais nous regrettons l’absence de beaucoup
de détails de mœurs, que Juvénal, l’implacable Juvénal,
aurait pu ajouter à cette peinture des promenades
de Rome: «Nobles ou plébéiennes, s’écrie
Juvénal dans sa terrible satire contre les Femmes,
toutes sont également dépravées. Celle qui foule la
boue du pavé ne vaut pas mieux que la matrone
portée sur la tête de ses grands Syriens. Pour se
montrer aux jeux, Ogulnie loue une toilette, un cortége,
une litière, un coussin, des suivantes, une
nourrice, et une jeune fille à cheveux blonds, chargée
de prendre ses ordres. Pauvre, elle prodigue à
[92]
d’imberbes athlètes ce qui lui reste de l’argenterie
de ses pères: elle donne jusqu’aux derniers morceaux...
Il en est que charment seuls les eunuques
impuissants et leurs molles caresses, et leur menton
sans barbe; car elles n’ont pas d’avortement à préparer.»
Les satires de Juvénal et de Perse sont remplies
des prostitutions horribles que les dames romaines
se permettaient presque publiquement, et
dont les héros étaient d’infâmes histrions, de vils
esclaves, de honteux eunuques, d’atroces gladiateurs.
Juvénal fait un affreux portrait de Sergius, le
favori d’Hippia, épouse d’un sénateur: «Ce pauvre
Sergius avait déjà commencé à se raser le menton
(c’est-à-dire atteignait quarante-cinq ans), et ayant
perdu un bras, il était bien en droit de prendre sa
retraite. En outre, sa figure était couverte de difformités;
c’était une loupe énorme, qui, affaissée sous
le casque, lui retombait sur le milieu du nez;
c’étaient de petits yeux éraillés qui distillaient sans
cesse une humeur corrosive. Mais il était gladiateur:
à ce titre, ces gens-là deviennent des Hyacinthe,
et Hippia le préfère à ses enfants, à sa patrie, à sa
sœur et à son époux. C’est donc une épée que les
femmes aiment.» Il faut voir dans Pétrone le rôle
abominable que joue le gladiateur obscène; mais le latin
seul est assez osé pour exprimer tous les mystères de
la débauche romaine. «Il y a des femmes, dit ailleurs
Pétrone, qui prennent leurs amours dans la fange, et
dont les sens ne s’éveillent qu’à la vue d’un esclave,
[93]
d’un valet de pied à robe retroussée. D’autres raffolent
d’un gladiateur, d’un muletier poudreux, d’un
histrion qui étale ses grâces sur la scène. Ma maîtresse
est de ce nombre: elle franchit les gradins du
sénat, les quatorze bancs de chevaliers, et va chercher
au plus haut de l’amphithéâtre l’objet de ses
feux plébéiens.»
La voie Sacrée, les portiques, la voie Appienne,
et tous les lieux de promenade à Rome étaient donc
fréquentés par les misérables agents de la Prostitution
matronale, autant que par les courtisanes et les
femmes de mœurs faciles, par les odieux suppôts de
Vénus Averse (Aversa), autant que par les libertins
de toutes les écoles et de tous les rangs. Mais, il
faut bien le reconnaître, en présence de cette variété
d’enfants et d’hommes dépravés qui faisaient montre
de leur turpitude, les courtisanes semblaient presque
honnêtes et respectables; elles n’étaient pas, d’ailleurs,
aussi nombreuses ni aussi effrontées que ces
impurs chattemites, que ces sales gitons, que ces
impudiques spadones, que ces efféminés de tout âge,
qui, frisés, parés, huilés, fardés comme des femmes,
n’attendaient qu’un signe ou un appel pour se
prêter à tous les plus exécrables trafics. Les lénons
et les lènes ne manquaient pas de se trouver là sur
pied, aux aguets, prompts et dociles aux démarches,
aux négociations. Ils ne se bornaient pas à porter
des tablettes et des lettres d’amour: ils servaient
d’intermédiaires directs pour fixer un prix, pour désigner
[94]
un lieu de rendez-vous, pour lever les obstacles
qui s’opposaient à une entrevue, pour fournir
un déguisement, une cape de nuit, une chambre,
une litière, tout ce qu’il fallait aux amants. A chaque
instant, une vieille s’approchait d’un beau patricien et
lui remettait en cachette des tablettes d’ivoire, sur
la cire desquelles le style avait gravé un nom, un
mot, un vœu: c’était une courtisane qui en voulait à ce
noble et fier descendant des Caton et des Scipion. Tout
à coup, un Nubien allait toucher l’épaule d’un mignon,
remarquable par ses grandes boucles d’oreilles
et par ses longs cheveux: c’était un vieux sénateur
débauché qui appelait à lui cet homme métamorphosé
en femme. Ailleurs, un robuste porteur d’eau,
qui passait là par hasard, était convoité par deux
grandes dames qui l’avaient remarqué simultanément,
et qui se disputaient à qui ferait la première
le sacrifice de son honneur à ce manant: «Si le galant
fait défaut, dit Juvénal, qu’on appelle des
esclaves; si les esclaves ne suffisent point, on mandera
le porteur d’eau (veniet conductus aquarius).»
Un geste, un regard, un mot: gladiateur, eunuque,
enfant, se présentait et ne reculait devant aucune
espèce de service. Et l’édile, que faisait l’édile, pendant
que Rome se déshonorait ainsi à la face du
ciel par les vices de ses habitants les plus considérables?
Et le censeur, que faisait le censeur, pendant
que les mœurs publiques perdaient jusqu’aux
apparences de la pudeur? Le censeur et l’édile ne pouvaient
[95]
rien là où la loi se taisait, comme si elle eût
craint d’en avoir trop à dire. On appelait plaisirs
permis ou licites, à Rome païenne, tout ce que le
christianisme rejeta dans le bourbier des plaisirs défendus.
C’est donc en plaisantant que Plaute fait dire à
un personnage de son Charençon (Curculio): «Pourvu
que tu t’abstiennes de la femme mariée, de la veuve,
de la vierge, de la jeunesse et des enfants ingénus,
aime tout ce qu’il te plaît!» Catulle, dans le chant
nuptial de Julie et de Manlius, nous montre le mariage
comme un frein moral à de honteuses habitudes:
«On prétend, dit le poëte de l’amour physique,
que tu renonces à regret, époux parfumé, à
tes mignons (glabris); nous savons que tu n’as jamais
connu que des plaisirs permis; mais ces plaisirs-là,
un mari ne saurait plus se les permettre (scimus hæc
tibi, quæ licent sola cognita, sed marito ista non eadem
licent).» Il n’y avait donc que la philosophie qui
pouvait combattre les débordements de cette ignoble
licence, qui ne rencontrait pas de digue dans la législation
romaine.
Une partie des intrigues et des intelligences qui
se nouaient sur la voie publique avait lieu par signes.
On sait que la pantomime était un art très-raffiné
et très-compliqué qui s’apprenait surtout au théâtre,
et qui se perfectionnait selon l’usage qu’on en faisait.
De là le talent merveilleux des courtisanes, dans ce
qui constituait la langue muette du meretricium. Il
y avait aussi les différents dialectes de la pantomime
[96]
amoureuse. Souvent l’expression la plus éloquente
de cette langue lascive brillait ou éclatait dans un
regard. Les yeux se parlaient d’autant mieux, qu’une
excellente vue et une prodigieuse spontanéité d’esprit
suivaient, devançaient même les éclairs de la
prunelle. Si l’œil n’était pas compris par l’œil, les
mouvements des lèvres et des doigts servaient de
truchement plus intelligible, mais moins décent, entre
des personnes qui eussent parfois rougi de faire
usage de la parole. Ainsi, le signe adopté généralement
par les sectateurs de la plus infâme débauche
masculine consistait dans l’érection du doigt du milieu,
à la base duquel les autres doigts de la main
se groupaient en faisceau, pour figurer le honteux
attribut de Priape. Suétone, dans la Vie de Caligula,
nous représente cet empereur qui offre sa main à
baiser, en lui donnant une forme et un mouvement
obscènes (formatam commotamque in obscenum modum).
Lampridius, dans la Vie d’Héliogabale, nous
dit que ce monstrueux débauché ne se permettait jamais
une parole indécente, lors même que le jeu
de ses doigts indiquait une infamie (nec unquam verbis
pepercit infamiam, quum digitis infamiam ostentaret).
Ces gestes obscènes s’exécutaient avec une étonnante
rapidité qui échappait d’ordinaire au regard
des indifférents. On pourrait supposer, d’après plusieurs
passages de l’Histoire d’Auguste, que le signum
infame n’était pas toléré sous tous les empereurs, et
que les plus célèbres par leurs désordres avaient
[97]
appliqué une pénalité sévère à ce signe de débauche,
qui laissa au doigt du milieu le surnom de doigt infâme.
Au reste, les Athéniens ne se montraient pas
plus indulgents à l’égard de ce doigt, qu’ils nommaient
catapygon, et qu’ils auraient eu honte de
réhabiliter en lui confiant un anneau. Le médius
avait été voué à l’infamie, en Grèce, parce que les
villageois s’en servaient pour savoir si leurs poules
avaient des œufs dans le ventre, ce qui donna naissance
au verbe grec σκιμαλίζειν, inventé tout exprès
pour qualifier le fait de ces villageois. «Moque-toi
bien, Sextillus, dit Martial, moque-toi de celui qui
t’appelle cinæde, et présente-lui le doigt du milieu.»
La présentation de ce doigt indiquait à la fois la demande
et la réponse, dans le langage tacite de ces
honteux débauchés. Ils avaient encore un autre signe
d’intelligence où le doigt du milieu changeait de
rôle: ils portaient ce doigt à leur tête, soit au front,
soit au crâne, et faisaient mine de se gratter: «Ce
qui dénote l’impudique, dit Sénèque dans sa cinquante-deuxième
lettre, c’est sa démarche, c’est sa
main qu’il remue, c’est son doigt qu’il porte à sa
tête, c’est son clignement d’yeux.» Juvénal nous
autorise à supposer que ce grattement de la tête
avec un doigt, avait remplacé, dans la langue du
geste, l’élévation du médius hors de la main fermée:
«Vois, dit-il, vois affluer de toutes parts à
Rome, sur des chars, sur des vaisseaux, tous ces
efféminés qui se grattent la tête d’un seul doigt (qui
[98]
digito scalpunt uno caput).» Mais les courtisanes parlaient
plus volontiers de l’œil que du doigt, et rien
n’égalait l’éloquence, la persuasion, l’attraction de
leur regard oblique (oculus limus). Le grave rhéteur
Quintilien veut que l’orateur, en certaines occasions,
ait les regards baignés d’une douce volupté,
obliques, et, pour ainsi dire, amoureux (venerei).
Apulée, dans son roman érotique, peint une
courtisane qui lance des coups d’œil obliques et
mordants (limis atque morsicantibus oculis). C’était
là ce que les courtisanes nommaient chasser à l’œil
(oculis venari): «La vois-tu, dit le Soldat de Plaute,
faire la chasse au courre avec les yeux, et la chasse
au vol avec les oreilles? (Viden’ tu illam oculis
venaturam facere atque aucupium auribus?)»
Ce langage muet, que les courtisanes excellaient
partout à parler et à comprendre, était devenu si
familier à toutes les femmes de Rome, que ces dernières
n’en avaient pas d’autres pour les affaires de plaisir.
Un vieux poëte latin compare cet échange rapide de
regards, de gestes, de signes, entre une précieuse
et ses amants, à un jeu de balle, dans lequel un
bon joueur renvoie de l’un à l’autre la pelote qu’il
reçoit de toutes mains: «Elle tient l’un, dit-il, et
fait signe à l’autre; sa main est occupée avec celui-ci,
et elle repousse le pied de celui-là; elle met son
anneau entre ses lèvres et le montre à l’un, pour
appeler l’autre; quand elle chante avec l’un, elle
s’adresse aux autres en remuant le doigt.» Le
[99]
grand maître de l’art d’aimer, Ovide, dans son
poëme écrit sur les genoux des courtisanes, et souvent
sous leur dictée, a mis dans la bouche d’une
de ses muses ces leçons de la pantomime amoureuse:
«Regarde-moi, dit cette habile gesticularia,
regarde mes mouvements de tête, l’expression de
mon visage, remarque et répète après moi ces
signes furtifs (furtivas notas). Je te dirai, par un
froncement de sourcils, des paroles éloquentes qui
n’ont que faire de la voix; tu liras ces paroles sur
mes doigts, comme si elles y étaient notées. Quand
les plaisirs de notre amour te viendront à l’esprit,
touche doucement avec le pouce tes joues roses;
s’il y a dans ton cœur quelque écho qui te parle de
moi, porte la main à l’extrémité d’une oreille. O
lumière de mon âme, quand tu trouveras bien ce
que je dirai ou ferai, promène ton anneau dans tes
doigts. Touche la table avec la main, à la manière
de ceux qui font un vœu, lorsque tu souhaiteras
tous les maux du monde à mon maudit jaloux.»
Les poëtes sont pleins de ces dialogues tacites des
amants, et Tibulle surtout vante l’habileté de sa
maîtresse à parler par signes en présence d’un témoin
importun, et à cacher de tendres paroles sous
une ingénieuse pantomime (blandaque compositis
abdere verba notis). Cette langue universelle était
d’autant plus nécessaire à Rome, que souvent on
n’aurait pu s’entendre autrement, car la plupart des
courtisanes étaient étrangères et beaucoup ne trouvaient
[100]
pas à parler leur langue natale au milieu de
cette population rassemblée de tous les pays de
l’univers connu. Un grand nombre de ces femmes
de plaisir n’avaient d’ailleurs reçu aucune éducation,
et n’eussent pas su plaire en défigurant le
latin de Cicéron et de Virgile, quoique, selon un
poëte romain, l’amour ou le plaisir ne fasse pas de
solécismes. Il y avait aussi, dans l’habitude du langage
de Rome, une réserve singulière qui ne permettait
jamais l’emploi d’un mot ou d’une image
obscène. Les écrivains, poëtes ou prosateurs, même
les plus graves, n’avaient garde de s’astreindre à
cette chasteté d’expression, comme si l’oreille seule
était blessée de ce qui n’offensait jamais les yeux.
On évitait, dans la conversation la plus libre, non-seulement
les mots graveleux, mais encore les alliances
de mots qui pouvaient amener la pensée sur
des analogies malhonnêtes. Cicéron dit que si les
mots ne sentent pas mauvais, ils affectent désagréablement
l’ouïe et la vue: «Tout ce qui est bon à
faire, suivant le proverbe latin, n’est pas bon à dire
(tam bonum facere quam malum dicere).»
La langue érotique latine était pourtant très-riche
et très-perfectionnée; elle avait pris dans le grec
tout ce qu’elle put s’approprier sans nuire à son génie
particulier; elle se développait et s’animait sans
cesse, en se prêtant à toutes les fantaisies libidineuses
de ses poëtes amoureux; elle repoussait les
néologismes barbares, et elle procédait plutôt par
[101]
figures, par allusions, par double sens, de sorte
qu’elle faisait passer dans son vocabulaire celui de
la guerre, de la marine et de l’agriculture. Elle n’avait,
d’ailleurs, qu’un petit nombre de mots techniques,
la plupart de racine étrangère, qui lui fussent
propres, et elle préférait détourner de leur acception
les mots les plus honnêtes, les plus usuels, pour les
marquer à son cachet, au moyen d’un trope souvent
ingénieux et poétique. Mais cette langue-là, qui ne
connaissait pas de réticences dans les élégies de
Catulle, dans les épigrammes de Martial, dans les
histoires de Suétone, dans les romans d’Apulée,
n’était réellement parlée que dans les réunions de
débauche et dans les mystères du tête à tête. Il est
remarquable que les courtisanes, les moins décentes
dans leur toilette et dans leurs mœurs, auraient
rougi de proférer en public un mot indécent. Cette
pudeur de langage les empêchait de paraître souvent
ce qu’elles étaient, et les poëtes, qui faisaient leur
cour ordinaire, pouvaient s’imaginer qu’ils avaient
affaire à des vierges. Les petits noms de tendresse
que se donnaient entre eux amants et maîtresses
n’étaient pas moins convenables, moins chastes,
moins innocente, quand la maîtresse était une courtisane,
quand l’amant était un poëte érotique. Celui-ci
la nommait sa rose, sa reine, sa déesse, sa colombe,
sa lumière, son astre; celle-ci répondait à ces douceurs,
en l’appelant son bijou (bacciballum), son
miel, son moineau (passer), son ambroisie, la prunelle
[102]
de ses yeux (oculissimus), son aménité (amœnitas),
et jamais avec interjections licencieuses, mais
seulement j’aimerai! (amabo), exclamation fréquente
qui résumait toute une vie, toute une vocation. Dès
que des rapports intimes avaient existé entre deux
personnes de l’un et de l’autre sexe, dès que ces
rapports commençaient à s’établir, on se traitait réciproquement
de frère et sœur. Cette qualification
était générale chez toutes les courtisanes, chez les
plus humbles comme chez les plus fières. «Qui te
défend de choisir une sœur?» dit une des héroïnes
de Pétrone; et ailleurs, c’est un homme qui dit à un
autre: «Je te donne mon frère.» Quelquefois, en
désignant une maîtresse qu’on avait eue, on la nommait
sœur du côté gauche (læva soror, dit Plaute), et
une mérétrice donnait le nom badin de petit frère à
quiconque faisait marché avec elle.
On ne saurait trop s’étonner de la décence, même
de la pudibonderie du langage parlé, contraste perpétuel
avec l’immodestie des gestes et l’audace des
actes. De là cette locution qui revenait à tout propos
dans le discours, en forme de conseil: Respectez les
oreilles (parcite auribus). Quant aux yeux, on ne
leur épargnait rien et ils ne se scandalisaient pas de
tout ce qu’on leur montrait. Ils n’avaient donc pas de
répugnance à s’arrêter sur les pages d’un de ces livres
obscènes, de ces écrits érotiques ou sotadiques, en
vers ou en prose, que les libertins de Rome aimaient
à lire pendant la nuit (pagina nocturna, dit Martial).
[103]
C’était un genre de littérature très-cultivé chez les
Romains, quoique peu goûté des honnêtes gens. Les
auteurs de cette littérature, chère aux courtisanes,
semblaient vouloir, par leurs ouvrages, se faire un
nom dans les fastes de la débauche et honorer par
là les dieux impudiques auxquels ils se consacraient.
Mais ce n’étaient pas seulement des libertins de profession
qui composaient ces livres lubriques (molles
libri); c’étaient parfois les poëtes, les écrivains les
plus estimés, qui se laissaient entraîner à ce dévergondage
d’imagination et de talent; c’était ordinairement
de leur part une sorte d’offrande faite à
Vénus; c’était, en certains cas, un simple jeu littéraire,
un sacrifice au goût du jour. «Pline, qui est
généralement estimé, dit Ausone (dans le Centon
Nuptial), a fait des poésies lascives, et jamais ses
mœurs n’ont fourni matière à la censure. Le recueil
de Sulpitia respire la volupté, et cette digne matrone
ne se déridait pourtant pas souvent. Apulée, dont
la vie était celle d’un sage, se montre trop amoureux
dans ses épigrammes: la sévérité règne dans
tous ses préceptes, la licence dans ses lettres à Cœrellia.
Le Symphosion de Platon contient des poëmes
qu’on dirait composés dans les mauvais lieux (in ephebos).
Que dirai-je de l’Erotopægnion du vieux poëte
Lævius, des vers satiriques (fescenninos) d’Ænnius?
Faut-il citer Evenus, que Ménandre a surnommé le
sage? Faut-il citer Ménandre lui-même et tous les auteurs
comiques? Leur manière de vivre est austère,
[104]
leurs œuvres sont badines. Et Virgile, qui fut appelé
Parthénie, à cause de sa chasteté, n’a-t-il pas décrit
dans le huitième livre de son Énéide les amours de
Vénus et de Vulcain, avec une indécente pudeur?
N’a-t-il pas, dans le troisième livre de ses Géorgiques,
accouplé aussi décemment que possible des hommes
changés en bêtes?» Pline, pour s’excuser d’une débauche
d’esprit qu’il n’avait pas l’air de se reprocher,
disait: «Mon livre est obscène, ma vie est
pure (lasciva est nobis pagina, vita proba).»
La bibliothèque secrète des courtisanes et de leurs
amis devait être considérable, mais à peine est-il
resté le nom des principaux auteurs qui la composaient.
Chez les Romains de même que chez les Grecs,
ce sont les érotiques qui ont eu le plus à souffrir des
proscriptions de la morale chrétienne. Vainement la
poésie demandait grâce pour eux; vainement ils se
réfugiaient sous la protection éclairée et libérale des
doctes amateurs de l’antiquité; vainement ils se
perpétuaient de bouche en bouche dans la mémoire
des voluptueux et des femmes galantes: le christianisme
les poursuivait impitoyablement jusque dans
les souvenirs de la tradition. Ils disparurent, ils s’effacèrent
tous, à l’exception de ceux que protégeait,
comme Martial et Catulle, l’heureux privilége de
leur réputation poétique. Le scrupule religieux alla
même jusqu’à déchirer bien des pages dans les
œuvres des meilleurs écrivains. Les lettres latines
ont perdu ainsi la plupart des poëtes de l’amour
[105]
païen, et cette destruction systématique fut l’œuvre
des Pères de l’Église. Nous ne possédons plus rien
de Proculus, qui, suivant Ovide, avait marché sur les
traces de Callimaque; rien des orateurs Hortensius et
Servius Sulpitius, qui avaient fait de si beaux vers
licencieux; rien de Sisenna, qui avait traduit du
grec les Milésiennes (Milesii libri) d’Aristide; rien
de Mémonius et de Ticida, qui, au dire d’Ovide,
ne s’étaient pas plus souciés de la pudeur dans les
mots que dans les choses; rien de Sabellus, qui
avait chanté les arcanes du plaisir, à l’instar de la
poëtesse grecque Eléphantis; rien de Cornificius, ni
d’Eubius, ni de l’impudent Anser, ni de Porcius, ni
d’Ædituus, ni de tous ces érotiques qui faisaient les
délices des courtisanes et des bonnes mérétrices de
Rome. Les nouveaux chrétiens ne pardonnèrent pas
davantage aux Grecs qu’ils comprenaient moins encore,
ni à l’ignoble Sotadès, qui donna son nom aux
poésies inspirées par l’amour contre la nature; ni à
Minnerme de Smyrne, dont les vers, dit Properce,
valaient mieux en amour que ceux d’Homère; ni à
l’impure Hemiteon de Sybaris, qui avait résumé
l’expérience de ses débauches dans un poëme nommé
Sybaritis; ni à l’effrontée Nico, qui avait mis en
vers ses actes de courtisane; ni au célèbre Musée,
dont la lyre, égale de celle d’Orphée, avait évoqué
toutes les passions vénéréiques. Ainsi fut anéanti
presque complétement le panthéon de la Prostitution
grecque et romaine, après deux ou trois siècles
[106]
de censure persévérante et d’implacable proscription.
Les courtisanes et les libertins furent moins
acharnés que les savants pour défendre leurs auteurs
favoris; car libertins et courtisanes, en devenant
vieux, devenaient dévots et brûlaient leurs
livres. Ce sont les savants qui nous ont conservé
Horace, Catulle, Martial et Pétrone.

Sommaire.—Maladies secrètes et honteuses des anciens.—Impura
Venus.—Les auteurs anciens ont évité de parler de ces
maladies.—Invasion de la luxure asiatique à Rome.—A
quelles causes on doit attribuer la propagation des vices contre
nature chez les anciens.—Maladies sexuelles des femmes.—Les
médecins de l’antiquité se refusaient à traiter les maladies
vénériennes.—Pourquoi.—Les enchanteurs et les charlatans.—La
grande lèpre.—La petite lèpre ou mal de Vénus.—Importation
de ce mal à Rome par Cneius Manlius.—Le
morbus indecens.—La plupart des médecins étaient des esclaves
et des affranchis.—Pourquoi, dans l’antiquité, les maladies
vénériennes sont entourées de mystère.—L’existence de ces
maladies constatée dans le Traité médical de Celse.—Leur
description.—Leurs curations.—Manuscrit du treizième siècle
décrivant les affections de la syphilis.—Apparition de l’éléphantiasis
à Rome.—Asclépiade de Bithynie.—T. Aufidius.—Musa,
médecin d’Auguste.—Mégès de Sidon.—Description
effrayante de l’éléphantiasis, d’après Arétée de Cappadoce.—Son
analogie avec la syphilis du quinzième siècle.—Le campanus
morbus ou mal de Campanie.—Spinturnicium.—Les fics,
les marisques et les chies.—La Familia ficosa.—La rubigo.—Le
satyriasis.—Junon-Fluonia.—Dissertation sur l’origine des
mots ancunnuentæ, bubonium, imbubinat et imbulbitat.—Les
clazomènes.—Des maladies nationales apportées à Rome par les
étrangers.—Les médecins grecs.—Vettius Vales.—Themison.—Thessalus
[108]
de Tralles.—Soranus d’Ephèse.—Les empiriques,
les antidotaires et les pharmacopoles.—Ménécrate.—Servilius
Damocrate.—Asclépiade Pharmacion.—Apollonius de Pergame.—Criton.—Andromachus
et Dioscoride.—Les médecins
pneumatistes.—Galien et Oribase.—Archigène.—Hérodote.—Léonidas
d’Alexandrie.—Les archiatres.—Archiatri
pallatini et archiatri populares.—L’institution des archiatres
régularisée et complétée par Antonin-le-Pieux.—Eutychus,
médecin des jeux du matin.—Les sages-femmes et les medicæ.—Épigramme
de Martial contre Lesbie.—Le solium ou bidet,
et de son usage à Rome.—Pourquoi les malades atteints de maladies
honteuses ne se faisaient pas soigner par les médecins romains.—Mort
de Festus, ami de Domitien.—Des drogues que
vendaient les charlatans pour la guérison des maladies vénériennes.—Superstitions
religieuses.—Offrandes aux dieux et
aux déesses.—Les prêtres médecins.—La Quartilla de Pétrone.—Abominable
apophthegme des pædicones.
Cet épouvantable amas de Prostitutions de tous
genres, dans la fange desquelles se vautrait la société
romaine, ne pouvait manquer de corrompre la
santé publique. Quoique les poëtes, les historiens
et même les médecins de l’antiquité se taisent sur ce
sujet, qu’ils auraient craint de présenter sous un
jour déshonorant, quoique les fâcheuses conséquences
de ce qu’un écrivain du treizième siècle
appelle l’amour impur (impura Venus) aient laissé
fort peu de traces dans les écrits satiriques, comme
dans les traités de matière médicale, il est impossible
de méconnaître que la dépravation des mœurs avait
multiplié chez les Romains le germe et les ravages
des maladies de Vénus. Ces maladies étaient certainement
très-nombreuses, toujours fort tenaces et
[109]
souvent terribles; mais elles ont été à peu près négligées
ou du moins rejetées dans l’ombre par les
médecins et les naturalistes grecs et romains. Nous
ne pouvons hasarder que des conjectures philosophiques
sur les causes de cet oubli et de ce silence
général. En l’absence de toute indication claire et
formelle à cet égard, nous sommes réduits à supposer
que des motifs religieux empêchaient d’admettre
parmi les maladies ostensibles celles qui affectaient
les organes de la génération et qui avaient pour
origine une débauche quelconque. Les anciens ne
voulaient pas faire injure aux dieux, qui avaient
accordé aux hommes le bienfait de l’amour, en accusant
ces mêmes dieux d’avoir mêlé un poison
éternel à cette éternelle ambroisie; les anciens ne
voulaient pas qu’Esculape, l’inventeur et le dieu de
la médecine, entrât en lutte ouverte avec Vénus, en
essayant de porter remède aux vengeances et aux
châtiments de la déesse. En un mot, les maladies
des organes sexuels, peu connues, peu étudiées en
Grèce comme à Rome, se cachaient, se déguisaient,
comme si elles frappaient d’infamie ceux qui en
étaient atteints et qui se soignaient en cachette avec
le secours des magiciennes et des vendeuses de
philtres.
Les maladies vénériennes furent sans doute moins
fréquentes et moins compliquées chez les Grecs que
chez les Romains, parce que la Prostitution était loin
de faire les mêmes ravages à Athènes qu’à Rome. Il
[110]
n’y avait pas en Grèce, comme dans la capitale du
monde romain, une effroyable promiscuité de tous
les sexes, de tous les âges, de toutes les nations. Le
libertinage grec, que relevait un certain prestige de
sentiment et d’amour idéal, n’avait pas ouvert les
bras, comme le libertinage romain, à toutes les débauches
étrangères: le premier avait toujours, même
dans ses plus grands excès, conservé ses instincts
de délicatesse, tandis que le second s’était abandonné
à ses plus grossiers appétits, et avait poussé
aux dernières limites la brutalité matérielle. On ne
peut douter que de graves accidents de contagion
secrète n’aient accompagné l’invasion de la luxure
asiatique dans Rome. Ce fut vers l’an de Rome 568,
187 ans avant Jésus-Christ, que cette luxure asiatique,
comme l’appelle saint Augustin dans son livre
de la Cité de Dieu, fut apportée en Italie par le proconsul
Cneius Manlius, qui avait soumis la Gallo-Grèce
et vaincu Antiochus-le-Grand, roi de Syrie.
Cneius Manlius, jaloux d’obtenir les honneurs du
triomphe, qui ne lui fut pourtant pas décerné, avait
amené avec lui des danseuses, des joueuses de flûte,
des courtisanes, des eunuques, des efféminés et tous
les honteux auxiliaires d’une débauche inconnue jusqu’alors
dans la République romaine. Les premiers
fruits de cette débauche furent évidemment des maladies
sans nom qui attaquèrent les organes de la
génération, et qui se répandirent dans le peuple, en
s’aggravant, en se compliquant l’une par l’autre:
[111]
«Alors, dit saint Augustin, alors seulement, des
lits incrustés d’or, des tapis précieux apparaissent;
alors, des joueuses d’instruments sont introduites
dans les festins, et avec elles beaucoup
de perversités licencieuses (tunc, inductæ in convivia
psalteriæ et aliæ licentiosæ nequitiæ).» Ces
joueuses d’instruments venaient de Tyr, de Babylone
et des villes de la Syrie, où, depuis une époque
immémoriale, les sources de la vie étaient gâtées
par d’horribles maladies nées de l’impudicité. Les
livres de Moïse témoignent de l’existence de ces
maladies chez les Juifs, qui les avaient prises en
Égypte et qui les avaient retrouvées plus redoutables
parmi les populations de la Terre promise. Les Hébreux
détruisirent presque complétement ces populations
ammonites, madianites, chananéennes; mais
celles-ci, en disparaissant devant eux, leur avaient
légué, comme pour se venger, une foule d’impuretés
qui altérèrent à la fois leurs mœurs et leur sang. Il
n’y eut bientôt pas au monde une race d’hommes
plus vicieuse et plus malsaine que la race juive. Les
peuples voisins de la Judée, ces antiques desservants
de la Prostitution sacrée, mettaient du moins plus
de raffinements et de délicatesse dans leurs débordements,
et, par conséquent, chacun était meilleur
gardien de son corps et de sa santé. La Syrie tout
entière, néanmoins, il faut le constater, renfermait
un foyer permanent de peste, de lèpre et de mal
vénérien (lues venerea). Ce fut à ce dangereux foyer
[112]
que Rome alla chercher des plaisirs nouveaux et des
maladies nouvelles.
Nous avons déjà soutenu cette thèse, qui n’est
point un paradoxe et que la science appuierait au
besoin sur des bases solides, le vice contre nature,
que Moïse, seul entre tous les législateurs avant
Jésus-Christ, avait frappé de réprobation, n’existait,
ne pouvait exister à l’état de tolérance dans toute
l’antiquité, que par suite des périls fréquents, continus,
qui troublaient l’ordre régulier des plaisirs
naturels. Les femmes étaient souvent malsaines, et
leur approche, en certaines circonstances, sous des
influences diverses de tempérament, de saison,
de localité, de genre de vie, entraînait de fâcheuses
conséquences pour la santé de leurs maris
ou de leurs amants. Les femmes les plus saines, les
plus pures, cessaient de l’être tout à coup par des
causes presque inappréciables, qui échappaient aux
précautions de l’hygiène comme aux remèdes de la
médecine. La chaleur du climat, la malpropreté
corporelle, l’indisposition mensuelle du sexe féminin,
les dégénérescences de cette indisposition ordinaire,
les flueurs blanches, les suites de couches
et d’autres raisons accidentelles produisaient des
maladies locales qui variaient de symptômes et de
caractères, selon l’âge, l’organisation, le tempérament
et le régime du sujet. Ces maladies étranges,
dont l’origine restait à peu près inconnue, et dont la
guérison radicale était fort longue, fort difficile et
[113]
même impossible en différents cas, entouraient d’une
sorte de défiance les rapports les plus légitimes entre
les deux sexes. On regardait, d’ailleurs, comme une
souillure presque indélébile toute inflammation,
toute infirmité, tout affaiblissement des forces génératrices.
On mettait sur le compte des mauvais sorts,
des mauvais esprits et des mauvaises influences, ces
germes empoisonnés, qui se cachaient dans les plus
tendres caresses d’une femme aimée, et l’on en
venait bientôt à redouter ces caresses qu’on avait tant
désirées avant de connaître ce qu’elles renfermaient
de perfide et d’hostile. Voilà comment la crainte et
quelquefois le dégoût éloignèrent du commerce des
femmes les hommes que l’expérience avait éclairés
sur les phénomènes morbides qui semblaient
attachés à ce commerce; voilà comment un honteux
désordre d’imagination avait essayé de changer les
lois physiques de l’humanité et d’enlever aux
femmes le privilége de leur sexe, pour le transporter
à des êtres bâtards et avilis, qui consentaient
à n’être plus d’aucun sexe, en devenant les instruments
dociles d’une hideuse débauche. Il est vrai que
d’autres maladies d’un genre plus répugnant et
non moins contagieux s’enracinèrent parmi la population,
avec le goût dépravé qui les avait fait naître
et qui les métamorphosait sans cesse; mais ces maladies
étaient moins répandues que celles des femmes,
et sans doute on pouvait mieux s’en garantir. On
comprend aussi que dans toutes ces maladies mystérieuses,
[114]
la lèpre, endémique dans tout l’Orient,
prenait figure et se montrait sous les formes les plus
capricieuses, les plus inexplicables.
Les médecins de l’antiquité, on a tout lieu de
le croire, se refusaient au traitement des maux de
l’une et l’autre Vénus (utraque Venus), puisque ces
maux avaient, à leurs yeux, comme aux yeux de
la foule, un air de malédiction divine, un sceau
d’infamie. Les malheureux qui en étaient atteints
recouraient donc, pour s’en débarrasser, à des pratiques
religieuses, à des recettes d’empirisme vulgaire,
à des œuvres ténébreuses de magie. Ce
fut là surtout ce qui fit la puissance des sciences occultes
et de l’art des philtres; ce fut là, pour les
prêtres ainsi que pour les magiciens, un moyen de
richesse et de crédit. Cette contagion vénérienne,
qui résultait inévitablement d’un commerce impur,
était toujours considérée comme un châtiment céleste,
ou comme une vengeance infernale; la victime
de la contagion, loin de se plaindre et d’accuser
l’auteur de son infortune, s’accusait elle-même et
ne cherchait qu’en soi les motifs de cette douloureuse
épreuve. De là, bien des offrandes, bien des
sacrifices dans les temples; de là, bien des invocations
magiques au fond des bois; de là, l’intervention
officieuse des vieilles femmes, des enchanteurs
et de tous les charlatans subalternes qui vivaient aux
dépens de la Prostitution. Il est impossible de comprendre
autrement le silence des écrivains grecs et
[115]
romains au sujet des maladies honteuses, qui étaient
autrefois plus fréquentes et plus hideuses qu’elles
ne le sont aujourd’hui. Ces maladies, les médecins
proprement dits ne les soignaient pas, excepté en
cachette, et ceux qui en étaient infectés, hommes et
femmes, ne les avouaient jamais, alors même qu’ils
devaient en mourir. La lèpre, d’ailleurs, cette affection
presque incurable qui se transformait à l’infini
et qui à ses différents degrés offrait les symptômes
les plus multiples, la lèpre servait de prétexte unique
à toutes les maladies vénériennes; la lèpre,
aussi, les engendrait, les modifiait, les augmentait,
les dénaturait et leur donnait essentiellement l’apparence
d’une affection cutanée. Il est bien clair
que la lèpre et les maladies vénériennes, en se
confondant, en se combinant, en s’avivant réciproquement,
avaient fini par s’emparer de l’économie
et par laisser un virus héréditaire dans tout le corps
d’une nation; ainsi, la grande lèpre appartenait
traditionnellement au peuple juif; la petite lèpre ou
le mal de Vénus (lues venerea), au peuple syrien.
Quand ce mal vint à Rome avec les Syriennes
que Cneius Manlius y avait transplantées, comme
pour fonder dans sa patrie une école de plaisir,
Rome, déjà victorieuse et maîtresse d’une partie
du monde, Rome n’avait pas de médecins. On ne
les avait tolérés dans l’intérieur de la ville, que
par des circonstances exceptionnelles, en temps
de peste et d’épidémie. Mais, une fois la santé publique
[116]
hors de péril, les médecins grecs qu’on avait
appelés étaient éconduits avec ce dédain que le
peuple de Romulus, aux époques de sa grossière et
sauvage indépendance, témoignait pour les arts qui
fleurissent à la faveur de la paix. Les Romains, il
est vrai, avaient mené jusque-là une vie rude, laborieuse,
austère, frugale; ils ne connaissaient
guère d’autre maladie que la mort, suivant l’expression
d’un vieux poëte, et leur robuste nature,
exercée de bonne heure aux fatigues et aux privations,
ne craignait d’infirmités que celles qui étaient
causées par des blessures reçues à la guerre. Toute
la médecine dont ils avaient besoin se bornait donc
à la connaissance des plantes vulnéraires et à la pratique
de quelques opérations chirurgicales. Leur
sobriété et leur continence les mettaient alors à l’abri
des maux qui sont produits par les excès de table et
par la débauche. Ceux qu’un vice odieux, familier
aux Faunes et aux Aborigènes leurs ancêtres, avait
souillés de quelque hideuse maladie, se gardaient
bien de la répandre et en mouraient, plutôt que d’en
chercher le remède et de révéler leur turpitude. Au
reste, dans ces temps d’innocence ou plutôt de pudeur,
toutes les maladies qui s’attachaient aux
parties honteuses, quels que fussent d’ailleurs leurs
diagnostics, étaient confondues dans une seule dénomination,
qui témoigne de l’horreur qu’elles
inspiraient: morbus indecens. La pensée et l’imagination
évitaient de s’arrêter sur les particularités
[117]
distinctives de différentes affections qu’on désignait
de la sorte. Il est permis cependant d’indiquer, sinon
de décrire et d’apprécier, celles qui se montraient le
plus fréquemment. C’était la marisca, tumeur cancéreuse
ayant la grosseur d’une grande figue dont elle
portait le nom et obstruant le fondement ou même
quelquefois débordant au dehors et se propageant autour
de l’anus. Quand cette tumeur était moins grosse,
on l’appelait ficus ou figue ordinaire; quand elle se
composait de plusieurs petites excroissances purulentes,
on la nommait chia, qui était aussi le nom grec
de la petite figue sauvage. Chez les femmes, ce mal
prenait souvent le caractère d’un écoulement plus ou
moins âcre, parfois sanguinolent, toujours fétide,
dont le nom générique fluor demandait une épithète
que la nature du mal se chargeait de prescrire.
Mais le morbus indecens présentait encore peu de
variétés, et lorsqu’il avait atteint une victime ou
plutôt un coupable, de l’un ou de l’autre sexe, il
n’allait pas se greffer ailleurs et engendrer d’autres
espèces de fruits impurs: le mal, livré à lui-même,
faisait des ravages incurables et dévorait secrètement
le malade, dont les bains et les frictions ne
faisaient que prolonger le déplorable état. Il arrivait
pourtant quelquefois que, chez un tempérament
énergique, le mal avait l’air de céder et de disparaître
pour un temps; il revenait ensuite à la
charge avec plus de ténacité et sous des formes plus
malignes. Il n’y avait, au reste, que la magie et
[118]
l’empirisme qui osassent lutter contre les tristes effets
du morbus indecens. Les seuls médecins, qui fussent
alors à Rome, étaient de misérables esclaves, juifs
ou grecs, dont toute la pharmacopée se composait
de philtres, de philatères, de talismans et de pratiques
superstitieuses: cette médecine-là semblait faite
exprès pour des maladies que les malades attribuaient
volontiers, pour s’épargner la honte d’en
avouer la cause, à la fatalité, à l’influence malfaisante
des astres et des démons, à la vengeance des
dieux, à la volonté du destin.
Il ne faut pas négliger de remarquer que la médecine
grecque s’établit à Rome presque en même temps que
la luxure asiatique; celle-ci date de l’an de la fondation
588; celle-là, de l’an 600 environ. Soixante-dix
ans auparavant, vers 535, quelques médecins grecs
avaient essayé de se fixer dans la ville où les appelaient
différentes maladies contre lesquelles l’austérité
romaine ne pouvait rien (on doit présumer que
le morbus indecens était une de ces maladies chroniques
et invétérées); mais ils éprouvèrent tant
d’avanies, tant de difficultés, tant de répugnances,
qu’ils renoncèrent à ce premier établissement; ils ne
revinrent que quand Rome fut un peu moins fière
de la santé de ses habitants. La bonne chère et la
débauche avaient, dans l’espace de quelques années,
créé, développé, multiplié un plus grand nombre de
maladies qu’on n’en avait vu depuis la fondation de
la ville. Parmi ces maladies, les plus communes et
[119]
les plus variées furent certainement celles que la débauche
avait produites; on les rapportait toujours à
des causes avouables, ou plutôt on évitait d’en déclarer
les causes, et le médecin avait soin de les couvrir
d’un manteau décent, en les rangeant dans la catégorie
des maladies honnêtes. Voilà pourquoi les
maladies honteuses, dans les ouvrages de médecine
de l’antiquité, ne se montrent nulle part ou bien se
déguisent sous des noms qui en sauvaient l’infamie.
C’est dans l’immense et dégoûtante famille de la
lèpre que nous devons rechercher presque tous les
genres de maux vénériens, qui ne faisaient pas
faute à l’ancienne Prostitution plus qu’à la moderne.
La plupart des médecins étaient des esclaves ou des
affranchis: «Je t’envoie un médecin choisi parmi
mes esclaves,» lit-on dans Suétone (mitto tibi præterea
cum eo ex servis meis medicum), et ce passage,
quoique diversement interprété par les commentateurs,
prouve que le médecin n’était souvent qu’un
simple esclave dans la maison d’un riche patricien.
Chacun pouvait donc avoir un médecin particulier,
dès qu’il l’achetait, sans doute fort cher; car la
valeur vénale d’un esclave dépendait de son genre
de mérite, et un médecin habile, qui devait
être à la fois chirurgien adroit et savant apothicaire,
ne se payait pas moins cher qu’un musicien
ou un philosophe grec. On comprend que le médecin,
n’ayant pas d’autre rôle que de soigner son
maître et les gens de la maison, exerçait servilement
[120]
son art, et, de peur des verges ou de plus rudes
châtiments, environnait d’une prudente discrétion
les maladies domestiques qu’il avait charge de
guérir, sous peine des plus cruelles représailles. Les
médecins affranchis n’étaient pas dans une position
beaucoup plus libre à l’égard de leurs malades; ils
ne craignaient pas d’être battus et mis aux fers,
dans le cas où leur traitement réussirait mal, mais
on pouvait les attaquer en justice et leur faire payer
une amende considérable, si le succès n’avait pas
répondu à leurs efforts et si l’art s’était reconnu impuissant
contre la maladie. Il est évident que dans
cette situation délicate le médecin ne s’adressait
qu’à des maladies dont il était presque sûr de
triompher. Cet état de choses nous indique assez
que, pour être certain d’avoir des soins en cas de
maladie, il fallait avoir au moins un médecin au
nombre des esclaves qui composaient le personnel
de la maison, et ce médecin, dépositaire des secrets
de la santé de son maître, était surtout nécessaire à
celui-ci, lorsque Vénus ou Priape lui devenait tout à
coup défavorable ou hostile.
Ce seul fait explique suffisamment, à notre avis,
le mystère qui entourait les maladies vénériennes
dans l’antiquité, mystère que recommandaient également
la religion et la pudeur publique. Les Romains
élevèrent un temple à la Fièvre, un temple à la Toux;
mais ils auraient craint de faire honte à Vénus, leur
divine ancêtre, en décernant un culte aux maladies
[121]
qui déshonoraient cette déesse. Ils niaient peut-être
ces maladies, comme injurieuses pour l’humanité, et
ils ne voulaient pas même que le morbus indecens
eût un nom dans les annales de la médecine et de
la république romaine. L’existence de ce mal, de la
véritable syphilis, ou du moins d’une affection analogue,
n’est pourtant que trop bien constatée dans le
Traité médical de Celse, qui seulement n’ose pas l’attribuer
à un commerce impur, et qui évite de remonter
à son origine suspecte. Celse, élève ou plutôt
contemporain d’Asclépiade de Bithynie, le premier
médecin célèbre qui soit venu de Grèce à Rome,
Celse ne nous laisse aucun doute sur la présence
très-caractéristique du mal vénérien chez les Romains,
car il décrit dans son livre, dans cet admirable
résumé des connaissances médicales du siècle
d’Auguste, plusieurs affections des parties sexuelles,
affections évidemment vénériennes, que la science
moderne s’est obstinée longtemps à ne pas rapprocher
des phénomènes identiques de la syphilis du
quinzième siècle. Ces affections sont peintes avec trop
de vérité dans l’ouvrage latin pour qu’on puisse se
méprendre sur leur nature contagieuse et sur leur
transmission vénéréique. C’est bien là le morbus indecens,
la lues venerea, quoique Celse ne leur donne pas
ces noms génériques, quoiqu’il attribue des noms
distinctifs, dont la création semble lui appartenir, aux
variétés du mal obscène. Les réflexions dont Celse fait
précéder le long paragraphe qu’il consacre aux maladies
[122]
des parties honteuses, dans le sixième livre de son
traité de médecine, ces réflexions confirment notre
sentiment au sujet des motifs de réserve et de convenance
qui s’opposaient au traitement public de ces
maladies à Rome. «Les Grecs, dit Celse, ont, pour
traiter un pareil sujet, des expressions plus convenables,
et qui d’ailleurs sont acceptées par l’usage,
puisqu’elles reviennent sans cesse dans les écrits et
le langage ordinaire des médecins. Les mots latins
nous blessent davantage (apud nos fœdiora verba), et
ils n’ont pas même en leur faveur de se trouver parfois
dans la bouche de ceux qui parlent avec décence.
C’est donc une difficile entreprise de respecter
la bienséance, tout en maintenant les préceptes
de l’art. Cette considération n’a pas dû cependant
retenir ma plume, parce que d’abord je ne veux pas
laisser incomplets les utiles renseignements que j’ai
reçus, et qu’ensuite il importe précisément de répandre
dans le vulgaire les notions médicales relatives
au traitement de ces maladies, qu’on ne révèle jamais
à d’autres que malgré soi. (Dein, quia in vulgus
eorum curatio etiam præcipue cognoscenda, quæ invitissimus
quisque alteri ostendit.)» Celse s’excuse ainsi
de publier un traitement qui était tenu secret, et
il semble vouloir le mettre à la portée de tout le
monde (in vulgus) pour obvier aux terribles accidents
qui résultaient de l’ignorance des médecins et
de la négligence des malades.
Il passe en revue ces maladies, qu’on retrouverait
[123]
avec tous leurs signes spéciaux dans les monographies
de la syphilis. Il parle d’abord de l’inflammation
de la verge (inflammatio colis), qui produit un
tel gonflement que le prépuce ne peut plus être ramené
en avant ou en arrière; il ordonne d’abondantes
fomentations d’eau chaude pour détacher le
prépuce, et des injections adoucissantes dans le canal
de l’urètre; il recommande de fixer la verge sur
l’abdomen, afin d’obvier à la souffrance que cause
la tension du prépuce, qui quelquefois, en se découvrant,
met à nu des ulcères secs ou humides. «Ces
sortes d’ulcères, dit-il, ont surtout besoin de fréquentes
lotions d’eau chaude; on doit aussi les couvrir
et les soustraire à l’influence du froid. La verge,
en certains cas, est tellement rongée sous la peau,
qu’il en résulte la chute du gland. Il devient alors
nécessaire d’exciser en même temps le prépuce.» Il
indique pour la guérison de ces ulcères une préparation,
composée de poivre, de safran, de myrrhe, de
cuivre brûlé et de minéral vitriolique broyés ensemble
dans du vin astringent. N’est-ce pas là une gonorrhée
syphilitique accompagnée de chancres et
d’ulcérations? Celse mentionne ensuite des tubercules
(tubercula), que les Grecs nomment φὐματα,
excroissances fongueuses qui se forment autour du
gland et qu’il faut cautériser avec le fer rouge ou
des caustiques, en saupoudrant avec de la limaille
de cuivre la place des escarres, pour empêcher le
retour de cette végétation parasite. Celse, après
[124]
avoir clairement présenté ces phénomènes du virus
vénérien, s’arrête à certains cas exceptionnels, où
les ulcères, résultant d’un sang vicié, sinon d’une disposition
particulière du malade, produisent la gangrène,
qui attaque même le corps de la verge. Il faut
alors pratiquer des incisions, trancher dans le vif,
enlever les chairs gangrenées et cautériser avec des
caustiques en poudre, notamment avec un composé
de chaux, de chalcitis et de piment. Le malade, qui
a subi cette opération souvent dangereuse, se voit
condamné au repos et à l’immobilité jusqu’à ce que
les escarres de la cautérisation soient tombées d’elles-mêmes.
L’hémorrhagie est à craindre, quand il a été
nécessaire d’abattre une partie de la verge. Celse
signale ensuite un chancre (cancri genus), que les
Grecs nomment φαγέδαινα, chancre très-malfaisant,
dont le traitement ne souffre aucun retard, et qui
doit être brûlé avec le fer rouge, dès son apparition;
autrement, ce phagédénique s’empare de la verge,
contourne le gland, envahit le canal et plonge jusqu’à
la vessie; il est accompagné, dans ce cas, d’une
gangrène latente, sans douleur, qui détermine la
mort malgré tous les secours de l’art. Est-il possible
de prétendre que cette espèce de chancre n’était pas
l’indice local de la syphilis la plus maligne? Celse
ne fait que citer en passant une sorte de tumeur calleuse,
insensible au toucher, qui s’étend sur toute la
verge, et qui demande à être excisée avec précaution.
Quant au charbon (carbunculus) qui se montre
[125]
au même endroit, il a besoin d’être détergé par des
injections, avant d’être cautérisé. On peut avoir recours,
après la chute de l’excroissance, aux médicaments
liquides qu’on prépare pour les ulcères
de la bouche.
Dans les inflammations lentes ou spontanées du
testicule, qui ne sont pas la suite d’un coup (sine
ictu orta), et qui proviennent, par conséquent, d’un
accident vénérien, Celse conseille la saignée du
pied, la diète et l’application de topiques émollients.
Il donne la recette de plusieurs de ces topiques,
pour le cas où le testicule devient dur et passe à
l’état d’induration chronique. Celse a grand soin de
distinguer le gonflement des testicules, produit par
une cause interne, de celui qui résulte d’une violence
extérieure, d’une pression ou d’un coup. Il
n’aborde qu’avec répugnance les maladies de l’anus,
qui sont, dit-il, très-nombreuses et très-importunes
(multa tædiique plena mala)! Il n’en décrit que
trois: les fissures ou rhagades, le condylome et les
hémorrhoïdes, qui pouvaient être souvent vénériennes.
Les fissures de l’anus, que les Grecs
nomment ῥαγἀδια, et dont Celse n’explique pas la
honteuse origine, se traitaient avec des emplâtres,
dans la préparation desquelles entraient du plomb,
de la litharge d’argent et de la térébenthine. Quelquefois
les rhagades s’étendaient jusqu’à l’intestin,
et on les remplissait de charpie trempée dans la
même solution antisyphilitique. Les affections de ce
[126]
genre réclamaient une alimentation douce, simple
et gélatineuse, avec un repos complet et l’usage fréquent
des demi-bains d’eau tiède. Quant au condylome,
cette excroissance qui naît ordinairement de
certaines inflammations de l’anus (tuberculum, quod
ex quâdam inflammatione nasci solet), il faut le traiter,
dès son début, de la même manière que les
rhagades: après les demi-bains et les emplâtres
fondants, on a recours, en certains cas, à la cautérisation
et aux caustiques les plus énergiques: l’antimoine,
la céruse, l’alun, la litharge sont les ingrédients
ordinaires des topiques destinés à détruire le
condylome, après la disparition duquel il est utile
de prolonger le régime adoucissant et rafraîchissant.
Celse, en conseillant des remèdes analogues contre
les hémorrhoïdes ulcérées et tuberculeuses, laisse
entendre qu’il les attribuait souvent à une cause
semblable. Il ne parle qu’avec beaucoup de réserve
d’un accident que la débauche rendait plus fréquent
et plus dangereux, la chute du fondement et de la
matrice (si anus ipse vel os vulvæ procidit). Il évite
aussi de s’occuper des maladies honteuses qui se
rencontraient également chez les femmes, et c’est à
peine si, en terminant, il indique sommairement un
ulcère pareil à un champignon (fungo quoque simile),
qui affectait l’anus et la matrice. Il prescrit de fomenter
cet ulcère avec de l’eau tiède en hiver et de
l’eau froide en été, de le saupoudrer avec de la limaille
de cuivre, de la cire et de la chaux, et d’employer
[127]
ensuite la cautérisation, si le mal persiste
malgré le premier traitement. Mais on voit que
Celse n’ose pas, par déférence pour le sexe féminin,
le présenter comme intéressé au même titre que l’autre
sexe dans les maladies obscènes: il croirait lui
faire injure que de le montrer exposé aux inflammations,
aux ulcères, aux tubercules et aux hideux
ravages du mal vénérien.
Et maintenant, que le savant auteur du Manuel
des maladies vénériennes vienne nier ce qui est dans
l’ouvrage de Celse, et fasse preuve d’une obstination
bien aveugle, en déclarant que: «dans tout Celse
on ne trouve rien qui puisse faire soupçonner l’existence
du virus syphilitique, mais bien des maladies
locales, et dues aussi le plus souvent à des causes locales
non virulentes;» qu’il ajoute, après avoir résumé
le programme de Celse sur les maladies des parties
génitales: «Il est donc naturel de conclure, avec
Astruc et de Lamettrie, que tous ces maux prétendus
vénériens, dont les anciens ont fait mention, étaient
des maladies non syphilitiques.» Notre conclusion
sera entièrement contradictoire; et, après avoir comparé
les descriptions des médecins romains avec
celles que l’observation moderne nous offre comme
plus exactes et plus complètes dans l’histoire de la
syphilis; après nous être rendu compte des motifs
de chacun des traitements prescrits par la médecine
ancienne et moderne, nous n’avons pas eu de doute
sur l’origine et la nature du mal. La syphilis, la
[128]
véritable syphilis, engendrée par la lèpre et la débauche,
existait à Rome ainsi que dans la plupart
des pays où les mœurs étaient corrompues par le
mélange des populations étrangères. Le dernier traducteur
de Celse, plus éclairé ou du moins plus
impartial que ses devanciers, nous apprend que le
docte M. Littré a découvert des manuscrits du
treizième siècle «où toutes les affections des parties
génitales signalées par les anciens, et même les
accidents que nous regardons comme secondaires,
sont formellement rapportés au coït impur; et cela,
deux siècles avant l’époque qu’on veut assigner à
l’invasion de la maladie vénérienne.»
Cette maladie avait fait son apparition à Rome
sous le nom redoutable d’elephantiasis, vers l’an 650
de Rome (105 ans avant notre ère); et l’éléphantiasis,
qui eut bientôt infecté l’Italie, donna des
formes étranges à toutes les maladies avec lesquelles
il se compliquait. Asclépiade de Bithynie dut en
partie sa célébrité à cette terrible affection, qu’il
nommait le Protée du mal, et qu’il excellait à guérir,
pour l’avoir longtemps observée dans l’Asie-Mineure.
Aussi, selon le témoignage de Pline, les Romains
crurent-ils bénir en lui un génie bienfaisant envoyé
par les dieux. Asclépiade, qui avait appliqué à la
médecine le système philosophique d’Épicure, voulait
voir dans toutes les maladies un défaut d’harmonie
entre les atomes dont le corps humain lui
semblait composé. Le premier, il divisa les maladies
[129]
en affections aiguës et en affections chroniques; le
premier, il chercha les causes de l’inflammation
dans un engorgement quelconque: on devine qu’il
avait étudié spécialement les maladies vénériennes.
Grand partisan des moyens diététiques, il ordonnait
souvent les frictions et les fomentations d’eau; il
avait imaginé les douches (balneæ pensiles), et, à
l’exemple de son maître Épicure, il n’était pas
ennemi des plaisirs sensuels, pourvu qu’on s’y adonnât
avec modération. Ce médecin grec devait réussir
auprès des Romains, parce qu’il ne gênait pas trop
leurs penchants, et qu’il permettait même à ses malades
un sage emploi de leurs facultés physiques;
c’était, suivant lui, empêcher l’âme de s’endormir,
puisqu’il la faisait résider dans les organes des cinq
sens. A l’instar d’Asclépiade, son disciple favori,
T. Aufidius, recommanda l’usage des frictions dans
toutes les maladies, traita victorieusement la lèpre
et toutes ses dégénérescences vénériennes, et mit au
nombre de ses remèdes la flagellation et les plaisirs
de l’amour, qu’il jugeait souverains contre la mélancolie.
La lèpre était devenue, à Rome, de même que
chez les Juifs, la maladie chronique, permanente,
héréditaire; elle puisait de nouvelles forces et de
prodigieux éléments dans l’abus et le déréglement
des jouissances amoureuses; elle se transformait et
se reproduisait sans cesse sous les aspects les plus
affligeants; elle était environnée d’un affreux cortége
[130]
d’ulcères et de bosses chancreuses; elle ne disparaissait
sous l’action énergique des remèdes et des
opérations chirurgicales, que pour reparaître bientôt
avec des caractères plus sinistres, avec un principe
plus vivace. Musa, le médecin d’Auguste, qu’il
guérit d’une maladie que les historiens n’ont pas
nommée ni décrite, maladie inflammatoire et locale,
puisque des bains tièdes en éteignirent les ardeurs;
Musa paraît s’être voué plus particulièrement à
l’étude et au traitement des maladies lépreuses,
scrofuleuses et vénériennes. Il avait été esclave
avant d’être affranchi par Auguste, et il devait connaître
les affections secrètes, qu’on traitait d’ordinaire
à la dérobée dans l’intérieur des familles, affections
graves et tenaces qui s’attaquaient à toutes les
parties de l’organisme, après avoir pris naissance dans
un coït impur. Musa inventa plusieurs préparations
contre les ulcères de mauvais caractère; et ces préparations,
qui gardèrent son nom en tombant dans
l’empirisme, étaient réputées infaillibles dans la plupart
des cas vénériens que Celse a décrits. Musa ne
se bornait pas à des topiques extérieurs: il soumettait
le malade à un traitement dépuratif interne, en
lui ordonnant de boire des sucs de laitue et de chicorée.
Ce traitement, inusité avant lui, démontre
assez qu’il regardait le mal vénérien comme un virus
qui se mêlait au sang et aux humeurs en les enflammant
et en les corrompant. Il traitait avec le même
système tous les maux qu’il croyait, de près ou de
[131]
loin, dérivés de ce virus: les ulcérations de la
bouche, les écoulements de l’oreille, les affections
des yeux; infirmités si communes à Rome, qu’elles y
étaient devenues endémiques, sous les empereurs.
Mégès de Sidon, qui exerçait dans le même temps
que Musa, se distingua aussi en traitant les maladies
lépreuses, qui devaient être souvent vénériennes.
Mégès était élève de Themison, qui fonda l’École
méthodique, et qui, pour parvenir à la guérison de
la lèpre, en avait d’abord recherché les causes,
étudié les caractères et défini le principe.
Ce principe était ou avait été vénérien dans l’origine.
La lèpre, de quelque pays qu’on la fasse venir,
de l’Égypte ou de la Judée, de la Syrie ou de
la Phénicie, fut d’abord une affection locale, née
d’un commerce impur, développée, aggravée par le
manque de soins médicinaux, favorisée par des circonstances
accidentelles, et transformée sans cesse,
graduellement ou spontanément, selon l’âge, le tempérament,
le régime et la constitution physique du
malade. De là ces variétés de lèpre que les médecins
grecs et romains semblent avoir évité de décrire
dans leurs ouvrages, comme si la théorie au sujet de
cette maladie honteuse leur inspirait autant de répugnance
que la pratique. La lèpre-mère était donc,
suivant toute probabilité, la véritable syphilis du
quinzième siècle, et c’est dans l’éléphantiasis que
nous croyons reconnaître à la fois la syphilis et la
lèpre-mère. Celse parle à peine de l’éléphantiasis,
[132]
«presque ignorée en Italie, dit-il, mais très-répandue
dans certains pays.» Il ne l’avait pas observée
sans doute, ou du moins il ne voulait pas s’étendre
sur une hideuse maladie qu’il regardait comme une
rare exception. «Ce mal, se borne-t-il à dire, affecte
la constitution tout entière, au point que les os mêmes
sont altérés. La surface du corps est parsemée de
taches et de tumeurs nombreuses, dont la couleur
rouge prend par degrés une teinte noirâtre. La peau
devient inégale, épaisse, mince, dure, molle et
comme écailleuse; il y a amaigrissement du corps et
gonflement du visage, des jambes et des pieds.
Quand la maladie a acquis une certaine durée (ubi
vetus morbus est), les doigts des pieds et des mains
disparaissent, en quelque sorte, sous ce gonflement;
puis, une petite fièvre se déclare, qui suffit pour emporter
le malade, accablé déjà par tant de maux.»
Cette description est bien pâle, bien incomplète
auprès de celle que nous a laissée un contemporain
de Celse, un illustre médecin grec, Arétée de Cappadoce,
qui avait probablement étudié la maladie dans
l’Asie-Mineure, où elle était si fréquente et si terrible.
Voici cette description effrayante, que nous réduisons
des deux tiers en supprimant beaucoup de
traits métaphoriques et poétiques qui n’ajoutent rien
à la vérité et à l’horreur du tableau. Nous remarquerons,
à l’appui de notre opinion, qu’Arétée confond
dans l’éléphantiasis plusieurs maladies, telles que le
[133]
satyriasis et la mentagre (mentagra), qui n’auraient
été, selon lui, que des symptômes ou des formes
particulières de l’éléphantiasis. «Il y a, dit-il, bien
des rapports entre l’éléphant maladie et l’éléphant
bête fauve, et par l’apparence, et par la couleur, et
par la durée; mais ils sont l’un et l’autre uniques
en leur espèce: l’animal ne ressemble à aucun autre
animal, la maladie à aucune autre maladie. Cette
maladie a été aussi appelée lion, parce qu’elle ride
la face du malade comme celle d’un lion; satyriasis,
à cause de la rougeur qui éclate sur les pommettes
des joues du malade, et en même temps à cause de
l’impudence des désirs amoureux qui le tourmentent;
enfin, mal d’Hercule, parce qu’il n’y en a pas de plus
grand ni de plus fort. Cette maladie est, en effet, la
plus énergique pour abattre la vigueur de l’homme,
et la plus puissante pour donner la mort; elle est
également hideuse à voir, redoutable comme l’animal
dont elle porte le nom, et invincible comme la
mort; car elle naît de la cause même de la mort: le
refroidissement de la chaleur naturelle. Cependant,
son principe se forme sans signes apparents: aucune
altération, aucune souillure, n’attaquent d’abord l’organisme,
ne se montrent sur l’habitude du corps, ne
révèlent l’existence d’un mal naissant; mais ce feu
caché, après avoir demeuré longtemps enseveli dans
les viscères, comme dans le sombre Tartare, éclate
enfin, et ne se répand au dehors qu’après avoir
envahi toutes les parties intérieures du corps.
[134]
»Ce feu délétère commence, chez la plupart des
malades, par la face, qui devient luisante comme un
miroir; chez les autres, par les coudes, par les genoux,
par les articulations des mains et des pieds.
Dès lors, ces malheureux sont destinés à périr, le
médecin, par négligence ou par ignorance, n’ayant
pas essayé de combattre le mal lorsqu’il était encore
faible et mystérieux. Ce mal augmente; l’haleine du
malade est infecte; les urines sont épaisses, blanchâtres,
troubles comme celles des juments; les aliments
ne se digèrent pas, et le chyle, formé par leur
mauvaise coction, sert moins à nourrir le malade que
la maladie elle-même dont le bas-ventre est le centre.
Des tubérosités y bourgeonnent les unes auprès des
autres; elles sont épaisses et raboteuses; l’espace
intermédiaire de ces tumeurs inégales se gerce
comme le cuir de l’éléphant; les veines grossissent,
non par la surabondance du sang, mais par l’épaisseur
de la peau. La maladie ne tarde pas à se manifester:
de semblables tubérosités apparaissent sur
tout le corps. Déjà les poils dépérissent et tombent;
la tête se dégarnit et le peu de cheveux, qui résistent
encore, blanchit; le menton et le pubis sont bientôt
dépilés. La peau de la tête est ensuite découpée
par des fentes ou gerçures profondes, rigides et multipliées.
La face se hérisse de poireaux durs et pointus,
quelquefois blancs à leur sommet, verdâtres à
la base; la langue se couvre de tubercules en forme
de grains d’orge. Quand la maladie se déclare par
[135]
une violente éruption, des dartres envahissent les
doigts, les genoux et le menton. Les pommettes des
joues enflent et rougissent; les yeux sont obscurcis
et de couleur cuivreuse; les sourcils chauves se rapprochent
et se contractent, en se chargeant de larges
poireaux noirs ou livides, de sorte que les yeux
sont comme voilés sous les rides profondes qui s’entre-croisent
au-dessus des paupières. Ce froncement
de sourcils, cette difformité, impriment sur la face
humaine le caractère du lion et de l’éléphant. Les
joues et le nez offrent aussi des excroissances noirâtres;
les lèvres se tuméfient: la lèvre inférieure est
pendante et baveuse; les dents sont déjà noircies; les
oreilles s’allongent, mollasses et flasques comme
celles de l’éléphant; des ulcères rayonnent autour
et il en sort une humeur purulente. Toute la superficie
du corps est sillonnée de rides calleuses et
même de fissures noires qui la découpent comme un
cuir: de là dérive le nom de la maladie. Des crevasses
divisent aussi les talons et les plantes des pieds jusqu’au
milieu des orteils. Si le mal prend des accroissements,
les tubérosités des joues, du menton, des
doigts, des genoux, se terminent en ulcères fétides
et incurables; ils s’élèvent même les uns au-dessus
des autres, de façon que les derniers semblent dominer
et ronger les premiers. Il arrive même que les
membres meurent avant le sujet, jusqu’à se séparer
du reste du corps, qui perd ainsi successivement le
nez, les doigts, les pieds, les mains entières, les parties
[136]
génitales; car le mal ne tue le malade, pour le
délivrer d’une vie horrible et de cruels tourments,
qu’après l’avoir démembré.»
Quand on rapprochera cet affreux tableau de celui
que les médecins du quinzième siècle ont tracé, à
l’apparition de la syphilis en Europe, on ne doutera
pas que cette même syphilis n’ait déjà sévi quinze
siècles auparavant sous le nom d’éléphantiasis; on
ne doutera pas non plus que la lèpre, de quelque
espèce qu’elle fût, n’ait puisé sa source dans une
cohabitation impure. Tel paraît être le sentiment de
Raimond, le savant historien de l’Eléphantiasis:
«Les lois économiques établies dans l’Orient, dit-il
au sujet des gonorrhées qui étaient fort communes et
au sujet du commerce des femmes, prouvent que les
maladies des organes génitaux et des aines, qui ont
une si étroite correspondance avec eux, étaient
réellement vénériennes.» C’est à la lèpre, c’est aux
maladies syphilitiques, qu’il faut attribuer la haine
et le mépris que les Juifs qui en étaient affligés inspiraient
partout, et davantage chez les Romains.
La lèpre et le mal vénérien ne faisaient plus qu’un,
à force de se combiner ensemble; rien n’était plus
fréquent que leur invasion; mais aussi rien ne semblait
plus déshonorant, et personne ne voulait s’avouer
malade, quand tout le monde l’était ou l’avait
été. La position des médecins entre ces mystères et
ces répugnances de l’opinion devait être toujours délicate
et difficile; ils ne traitaient que la lèpre; ils
[137]
inventaient sans cesse des onguents, des panacées,
des antidotes contre la lèpre, et les lépreux ne se
montraient nulle part, à moins que le mal fît irruption
sur le visage ou sur les mains. De là ces ulcères
des doigts, que Celse prétendait guérir avec des
lotions de lycium ou marc d’huile bouillie; de là ces
excroissances charnues, nommées en grec πτερυγιον,
qui végétaient à la base des ongles, et qui ne
cédaient pas toujours à l’emploi des caustiques minéraux;
de là cet oscedo ou abcès malin de la bouche,
que Marcellus Empyricus, au quatrième siècle, décrivait
naïvement sans en approfondir la source,
mais en l’entourant de ses indices syphilitiques; de
là une autre maladie de la bouche, mieux caractérisée
encore et plus répandue dans le bas peuple,
dans la classe où se recrutaient les mérétrices errantes
et les lâches complaisants de la débauche fellatoire.
Cette maladie repoussante se nommait campanus
morbus, parce qu’on accusait Capoue, cette reine
de la luxure et de l’infamie, comme l’appelle Cicéron
(domicilium superbiæ, luxuriæ et infamiæ), de
l’avoir enfantée. Il est certain que la plupart des
habitants de Capoue portaient sur la face les stigmates
honteux de ce mal infâme. Horace, dans le
récit de son voyage à Brindes, met en scène Sarmentus,
affranchi d’Octave et un de ses mignons;
il le représente riant et plaisantant sur le mal campanien,
et sur sa propre figure que ce mal avait
déshonorée (campanum in morbum, in faciem per
[138]
multa jocatus). Sarmentus avait à la joue gauche
une horrible cicatrice qui grimaçait sous les poils de
sa barbe (at illi fœda cicatrix setosam lævi frontem
turpaverat oris). Un des commentateurs d’Horace,
Cruquius, a commenté aussi le mal de Campanie, et
il l’a dépeint comme une excroissance livide qui
hérissait les lèvres et qui finissait par obstruer l’orifice
de la bouche. Plaute ne nous laisse pas douter
de la nature de cette excroissance, lorsque dans son
Trinummus, il proclame l’infamie de la race campanienne,
qui, dit-il, surpasse en patience les Syriens
eux-mêmes (Campas genus multo Syrorum jam antidit
patientia). Plaute avait appris de bien odieux
mystères d’impudicité, en tournant la meule chez
un boulanger d’Ombrie.
Dans la plupart des maladies de Vénus, les tumeurs
et les excroissances, que les médecins considéraient
comme le mal lui-même au lieu de n’y
voir que les effets locaux d’un mal occulte, ces
fâcheux symptômes passaient ordinairement à l’état
chronique, excepté dans les cas assez rares où les
frictions, les bains de vapeur et les boissons rafraîchissantes
affaiblissaient le virus vénérien et le détruisaient
graduellement. On ne sortait jamais d’un
traitement long et douloureux, sans en porter les
marques, non-seulement sur le corps, mais souvent
au visage. Ainsi, par suite des ulcères de la bouche,
les lèvres se tuméfiaient et devenaient lippeuses,
livides ou sanguinolentes; ce qui déformait tellement
[139]
les traits du visage, qu’on appelait spinturnicium
une femme que le mal avait ainsi défigurée, et dont
la lippe dégoûtante ressemblait à la grimace d’une
harpie (spinturnix). Les fics, les marisques et les
chies, qui se produisaient sans cesse dans les affections
de l’anus, résistaient au fer et au feu d’un traitement
périodique; le malade retombait bientôt entre
les mains de l’opérateur: «De ton podex épilé, dit
Juvénal, le médecin détache, en riant, des tubercules
chancreux (podice levi cæduntur humidæ, medico
ridente, mariscæ).» Cette honteuse production de la
débauche était si multipliée, surtout parmi le peuple,
qui négligeait de se soigner et qui voyait le mal se
perpétuer de père en fils, qu’on avait fait une épithète
et même un superlatif, ficosus, ficosissimus,
pour qualifier les personnes qu’on savait affligées de
ces ulcères et de ces tubercules. On voit, dans une
ode des Priapées, se promener fièrement le libertin
le plus chargé de fics qui soit entre les poëtes (inter
eruditos ficosissimus ambulet poetas). Martial, dans
une de ses épigrammes intitulée De familia ficosa,
nous fait une effrayante peinture de cette famille, et
en même temps de tous ses contemporains: «La
femme a des figues, le mari a des figues, la fille a des
figues, ainsi que le gendre et le petit-fils. Ni l’intendant,
ni le métayer, ni le journalier, ni le laboureur,
ne sont exempts de ce honteux ulcère. Jeunes et
vieux, tous ont des figues, et, chose étonnante, pas
un de leurs champs n’a de figuiers.» Les écoulements
[140]
purulents et les gonorrhées n’étaient pas moins
fréquents que ces tumeurs, qu’ils précédaient ou
accompagnaient; mais les médecins, du moins dans
la théorie et dans la science écrite, n’avaient pas
distingué, parmi ces affections inflammatoires de
l’urètre et du vagin, celles qui résultaient d’un commerce
impur. On peut supposer que ces dernières
se trahissaient par des accidents particuliers, notamment
par un ulcère qu’on appelait rouille (rubigo).
«La rubigo, dit un ancien commentateur des Géorgiques
de Virgile, est proprement, comme l’atteste
Varron, un mal du plaisir honteux, qu’on appelle
aussi ulcère. Ce mal naît ordinairement d’une abondance
et d’une superfluité d’humeur, qui se nomme
en grec σατυρίασις.» C’est le nom de cet ulcère, qu’on
avait appliqué à la rouille des blés altérés par l’humidité
et la moisissure. Le passage que nous avons
cité de Servius, qui s’appuie sur l’autorité de Varron,
établit suffisamment une opinion que nous avait
inspirée l’examen du satyriasis des anciens. Cette
maladie, si commune chez eux, n’était autre que la
blennorrhagie aiguë de nos jours. Il y avait, d’ailleurs,
une espèce de satyriasis causé d’ordinaire par les
excès vénériens, et surtout par les stimulants dangereux
qu’on employait pour aider à ces excès. «Ce
satyriasis, dit Cœlius Aurelianus, est une violente
ardeur des sens (vehemens Veneris appetentia); elle
tire son nom des propriétés d’une herbe que les
Grecs appellent σατυριον. Ceux qui usent de cette
[141]
herbe sont provoqués aux actes de Vénus par l’érection
des parties génitales. Mais il existe des préparations
destinées à exciter les sens à l’acte vénérien.
Ces préparations, qu’on nomme satyriques, sont
âcres, excitantes et funestes aux nerfs.» Cœlius Aurelianus
caractérisait ainsi le satyriasis, d’après les
leçons de son maître Themison, qui avait observé le
premier cette maladie et qui la traitait par des applications
de sangsues, qu’on ne paraît pas avoir
employées avant lui.
Les écoulements sanguins, rouillés et blanchâtres,
les pertes et les flueurs de leucorrhée affligeaient
si généralement les femmes de Rome, qu’elles invoquaient
Junon sous le nom de Fluonia, pour que la
déesse les débarrassât de ces désagréables incommodités,
qui n’étaient pas toujours des suites de
couches, et qui accusaient souvent un germe impur.
Les femmes affectées de ces écoulements malsains
se disaient ancunnuentæ, mot bizarre qui paraît
formé du substantif obscène, cunnus, plutôt que
dérivé du verbe cunire, salir ses langes, comme le
prétend Festus. Ces diverses maladies amenaient
presque toujours l’engorgement des glandes inguinales,
et, faute de soins ou de régime, la suppuration
de ces glandes. On regardait l’aster comme un
remède efficace contre les affections des aines, et on
appelait cette plante bubonium, du grec βουβώνιον.
On appliqua bientôt à la maladie, ou du moins à un
de ses symptômes, le nom du remède, et l’on confondit
[142]
sous ce nom de bubon tous les genres de pustules,
d’abcès et d’ulcères qui avaient pour siége les
aines. Nous croyons pouvoir faire un rapprochement
de mots, qui peut-être jettera du jour sur les
causes ordinaires de cette maladie inguinale. Les
Romains avaient fait le verbe imbubinare pour dire
souiller de sang impur; ce verbe se rapportait spécialement
à l’état des femmes pendant leur indisposition
menstruelle. On employait aussi la même expression
pour tout écoulement âcre, et un vers
célèbre, dans les fragments du vieux Lucilius, compare
l’une à l’autre deux souillures différentes que
subissait un débauché à double fin: Hæc te imbubinat
et contra te imbulbitat ille. Cependant, Jules
César Scaliger proposait de lire imbulbinat au lieu
d’imbulbitat, et par conséquent de traduire ainsi,
sans pouvoir rendre toutefois le jeu de mots latin:
«Elle te donne des bubons, et lui, au contraire, te
rend des tubercules.»
Nous sommes étonné de ne pas trouver dans les
poëtes plus d’allusions à une maladie qui devait être
pourtant bien répandue chez les Romains, aux écoulements
du rectum, à cette infâme souillure de la
débauche antique. Il faut, à notre avis, chercher la
description, ou du moins le traitement de cette maladie
honteuse, dans le paragraphe que Celse a consacré
aux hémorrhoïdes. Par pudeur, plutôt que
par ignorance, on avait compris dans la classe des
hémorrhoïdes tous les écoulements analogues, quelle
[143]
que fût leur cause, quelle que fût leur nature. On
ne saurait en douter, quand on voit Celse prescrire
dans certains cas contre le flux hémorrhoïdal et contre
les tumeurs qui l’accompagnaient l’emploi des caustiques
et des emplâtres astringents. Nous ne pensons
pas qu’on doive reconnaître la cristalline dans
les clazomènes (clazomenæ), que les savants ont rangés
parmi les maladies de l’anus. Selon Pierrugues, ce
seraient les fissures ou déchirures du fondement
indiquées par Celse, et leur surnom dériverait du
nom de la ville de Clazomène en Ionie, où d’abominables
mœurs avaient rendu presque générale cette
affection qui ne se concentra pas dans cette ville dissolue.
Nous voyons plutôt dans les clazomènes certains
tubercules fongueux qui poussaient autour du
pubis, et nous adopterons l’étymologie proposée
par Facciolati, κλαζόμενος, brisé ou rompu. Voici
d’ailleurs la fameuse épigramme d’Ausone, où l’on
découvre le véritable caractère des clazomènes:
«Quand tu arraches les végétations qui hérissent ton
podex baigné dans l’eau chaude, quand tu frottes à
la pierre ponce les clazomènes qui sortent de tes
reins, je ne vois pas la véritable cause de ton mal,
si ce n’est que tu as eu le courage de prendre une
double maladie, et que, femme par derrière, tu es
resté homme par-devant.» Telle est l’horrible épigramme
que l’abbé Jaubert, traducteur de Martial,
n’a pas osé traduire, et que les commentateurs ne
paraissent pas avoir comprise:
[144]
Sed quod et elixo plantaria podice velles
Et teris incusas pumice clazomenas;
Causa latet; bimarem nisi quod patientia morbum
Appetit, et tergo fœmina, pube vir es.
Au reste, la présence du mal de Clazomène à
Rome n’avait rien de surprenant; car Rome, sous
les empereurs, fut envahie par les étrangers, qui y
apportèrent sans doute leurs maladies comme leurs
mœurs. «Je ne puis souffrir, Romains, s’écrie Juvénal,
je ne puis souffrir Rome devenue grecque; et
pourtant, cette lie achéenne ne fait qu’une faible
portion des habitants de Rome. Depuis longtemps
l’Oronte de Syrie s’est déversé dans le Tibre, et il
nous a amené sa langue, ses mœurs, ses harpes, ses
flûtes, ses tambours et ses courtisanes qui se prostituent
dans le Cirque. Allez à elles, vous qu’enflamme
la vue d’une louve barbare coiffée de sa mitre
peinte!» Les poëtes et les écrivains latins n’ont pas
oublié de flétrir les hôtes étrangers de Rome, qu’ils
accusaient surtout d’avoir corrompu ses mœurs en
lui apportant leurs vices et leurs débauches nationales.
C’était la Phrygie, c’était la Sicile, c’était Lesbos,
c’était la Grèce entière, qui avaient pollué la
vieille austérité romaine. Lesbos apprit aux Romains
toutes les turpitudes de l’amour lesbien; la Phrygie
leur livra ses efféminés (Fœmineus Phryx, dit Ausone),
ces jeunes esclaves aux longs cheveux flottants,
aux grandes boucles d’oreilles, aux tuniques
à larges manches, aux brodequins rouges et verts.
[145]
Lacédémone, la fière Sparte, envoya aussi une colonie
de gitons et de tribades: Juvénal représente de
la sorte une infamie lacédémonienne, qui a tourmenté,
sans résultat plausible, l’imagination des scoliastes
et des traducteurs: Qui Lacedæmonium pytismate
lubricat orbem; Martial cite les luttes féminines
inventées par Léda et mises en honneur par la licencieuse
Lacédémone (libidinosæ Lacedæmonis palæstras).
Et Sybaris, et Tarente, et Marseille! «Sybaris
s’est emparée des sept collines!» murmure Juvénal,
qui regrette toujours la simplicité romaine des premiers
siècles; Sybaris, la reine des voluptés et des
maladies vénériennes. Tarente (molle Tarentum, dit
Horace) était là, en même temps, avec ses beaux
garçons à la peau parfumée, aux membres épilés,
au corps nu sous des vêtements d’étoffe transparente,
comme si ce fussent des nymphes. Marseille se
présentait également avec ses enfants, exercés
à la débauche, mais qui souvent ne vouaient
que leur coupable main à la Prostitution, témoin ce
passage d’une comédie de Plaute: «Où es-tu, toi
qui demandes à pratiquer les mœurs marseillaises?
si tu veux me prêter ta main (si vis subigitare me),
l’occasion est bonne.» On ne finirait pas d’énumérer
les villes et les pays étrangers, qui avaient le plus
servi à la dépravation de Rome. Il ne faut pas oublier
Capoue et les Opiciens: ces derniers, qui peuplaient
une partie de la Campanie, s’étaient dégradés
à tel point que leur nom était synonyme de la Prostitution
[146]
la plus humiliante. Ausone a fait une épigramme
contre Eunus Syriscus, inguinum liguritor,
maître passé en l’art des Opiciens (Opicus magister).
On est effrayé de la quantité de maladies invétérées
et mystérieuses qui devaient exister dans les basses
régions des plaisirs honteux.
Il venait de la Grèce autant de médecins que de
courtisanes; mais ces médecins, que le préjugé romain
poursuivait partout d’un mépris qui allait jusqu’à
la haine, se préoccupaient moins de faire des
cures radicales que de gagner de l’argent. Ils devenaient
riches rapidement, dès que leur réputation
les désignait au traitement d’une affection particulière;
mais la santé publique, en dépit des progrès
de la médecine méthodique, ne s’améliorait pas. Il
est permis d’en juger par la nature des maladies qui
s’offraient de préférence aux études de la science.
C’était toujours la lèpre avec ses nombreuses variétés.
Chaque praticien en renom inventait un nouveau
remède contre quelque manifestation locale de cette
peste chronique, qui se mêlait à toutes les maladies.
Il y eut une multitude de collyres pour les maux
d’yeux, de topiques pour les ulcères, de gargarismes
pour les aphthes, d’emplâtres pour les tumeurs, ce
qui prouve que ces affections plus ou moins lépreuses
et vénériennes se reproduisaient à l’infini.
Après Musa, le médecin en vogue fut Vettius Valens,
moins connu encore par son talent iatrique et chirurgical
que par son commerce clandestin avec
[147]
Messaline. Il eut sans doute plus d’une occasion,
grâce à sa maîtresse, de connaître les maladies de
l’amour. En même temps que lui, un autre élève
de Themison exerçait à Rome: Mégès de Sidon
guérissait surtout les dartres lépreuses, et traitait
avec succès le gonflement scrofuleux des seins. Il
fut éclipsé par son condisciple Thessalus de Tralles,
qui n’avait ni son savoir ni son expérience, mais
qui se vantait d’être le vainqueur des médecins
(ἰατρονικης) anciens. Ce Thessalus, que Galien qualifie
de fou et d’âne, avait l’audace de prétendre qu’il
opérait des guérisons subites, en usant des médicaments
les plus violents à fortes doses. Il obtint,
en effet, quelques brillants succès dans le traitement
de la lèpre, des ulcères et des scrofules. Ce
traitement semblait alors constituer toute la médecine;
car la lèpre, qui s’était incorporée partout,
semblait être la seule maladie. Le nombre des malades
augmentant, Thessalus trouva bon d’augmenter
aussi le nombre des médecins, et comme il ne
demandait que six mois pour faire des élèves aussi
habiles que lui, ce fut à qui viendrait écouter ses
leçons: cuisiniers, bouchers, tanneurs et d’autres
artisans renoncèrent à leur métier pour se mettre à
la suite de Thessalus, qui marchait environné d’un
cortége de disciples fanatiques. Les médecins ne
firent que déchoir davantage en considération et en
savoir. La grande affaire était toujours la guérison
de la lèpre. Soranus d’Éphèse vint à Rome, sous
[148]
Trajan, et apporta diverses préparations qui réussirent
dans l’alopécie et la mentagre. Moschion, un des
rivaux de Soranus, s’occupa particulièrement des
maladies de la femme et de l’étude de ses parties
sexuelles; il traitait les fleurs blanches par des
moyens énergiques qui les arrêtaient sur-le-champ.
A côté de ces médecins méthodistes, on voit en
foule les empiriques, les antidotaires et les pharmacopoles.
Ils étaient encore plus méprisés, plus abhorrés
que les médecins. Horace ne croit pas leur faire injure,
en les plaçant sur la même ligne que les bateleurs,
les mendiants, les parasites et les prostituées
(ambubajarum collegia, pharmacopolæ). Ces charlatans
avaient dans leur domaine les maladies honteuses
qui offraient un vaste champ à la pharmacopée.
Parmi ces empiriques, on distingua pourtant plusieurs
savants botanistes, plusieurs manipulateurs ingénieux.
Sous Tibère, Ménécrate, l’inventeur du
diachylon, composait des emplâtres, souvent efficaces
contre les dartres, les tumeurs et les scrofules;
Servilius Damocrate fabriquait d’excellents emplâtres
émollients; Asclépiade Pharmacion guérissait les
ulcères de mauvais caractère, Apollonius de Pergame,
les aphthes; Criton, la lèpre; Andromachus,
l’inventeur de la thériaque, et Dioscoride, l’auteur
d’un grand et célèbre ouvrage sur la matière médicale,
paraissent avoir attaché plus d’importance à
la morsure des serpents qu’au venin vénérien, qui
faisait cependant plus de victimes.
[149]
La recherche et le traitement de ce venin intéressèrent
davantage l’école des médecins pneumatistes
qui florirent à Rome pendant le second siècle de
l’ère moderne et qui comptèrent dans leurs rangs
Galien et Oribase. Un de ces médecins, Archigène,
parvint à combattre les affections lépreuses et eut
recours quelquefois à la castration pour diminuer
les accidents de la maladie, qui était certainement
vénérienne dans les cas où il sacrifiait la virilité de
son malade. Il avait éclairci avec bonheur la doctrine
des ulcérations de la matrice. Un autre pneumatiste,
non moins habile, Hérodote, se montra
partisan zélé des sudorifiques, qui, selon lui, dégageaient
le pneuma de tout ce qu’il pouvait contenir
d’hétérogène: l’emploi des sudorifiques était sans
doute tout-puissant contre les maladies qui avaient
un principe syphilitique. Ces maladies commençaient
à être mieux observées et la médication devenait
plus rationnelle. Un contemporain de Galien, Léonidas
d’Alexandrie, qui semble avoir été un praticien
aussi heureux qu’habile, s’était fait distinguer
dans le traitement des parties génitales; ses remarques
sur les ulcères et les verrues de ces parties sont
encore du plus haut intérêt, de même que celles qui
ont pour objet le gonflement et l’inflammation des
testicules. «A la vérité, dit Kurt Sprengel dans son
Histoire de la médecine, il ne fait pas mention du
commerce avec une femme impure; mais les bords
calleux, qu’il indique comme le caractère distinctif
[150]
de ces sortes d’ulcères, tiennent évidemment à la
présence d’un virus interne.» Ce virus, qu’on le
nomme lèpre ou syphilis, existait dans un grand
nombre de maladies locales que Galien et Oribase
n’ont pas décrites avec des symptômes vénériens,
mais qu’ils traitaient empiriquement, sur la foi des
anciens topiques qui venaient la plupart de l’Orient
aussi bien que les maladies elles-mêmes, plus simples
et moins méconnaissables à leur berceau.
Nous attribuons au développement des maladies
lépreuses ou vénériennes à Rome, l’établissement
des archiatres ou médecins publics. Le premier qui
ait porté le titre d’archiatre et qui en ait rempli les
fonctions dans l’intérieur du palais impérial, fut
Andromachus l’ancien, qui vivait sous Néron. Cet
archiatre surveillait la santé, non-seulement de
l’empereur, mais encore de tous les officiers du
palais. Cette charge était si compliquée, qu’un seul
médecin ne pouvait y suffire, et le nombre des archiatres
palatins (archiatri palatini) alla toujours
s’accroissant jusqu’à Constantin. Ils étaient parfois
décorés de hautes dignités, et l’empereur les qualifiait
de præsul spectabilis, honorable maître. On avait
institué aussi, dans Rome et dans toutes les villes
de l’empire, des archiatres populaires (archiatri populares),
qui exerçaient gratuitement leur art dans
l’intérêt du peuple et qui présidaient, pour ainsi
dire, à une police de santé. Il y eut d’abord un de
ces archiatres dans chacune des régions de Rome,
[151]
c’étaient donc quatorze médecins pour toute la ville;
mais on doubla, on tripla ce nombre, et bientôt
ils furent aussi nombreux que les prêtresses de
Vénus. Antonin le Pieux régularisa et compléta cette
noble institution; il décréta que l’on nommerait dix
archiatres populaires dans les grandes villes, sept
dans les villes de second ordre et cinq dans les plus
petites. Les archiatres formaient dans chaque ville
un collége médical qui avait des élèves. Ce collége
se recrutait lui-même, en votant sur le choix du
candidat que lui présentait la municipalité, en cas
de vacance d’un office d’archiatre. La municipalité
s’assurait ainsi que la santé et la vie des citoyens ne
seraient confiées qu’à des hommes probes et instruits.
Ces archiatres jouissaient de divers priviléges qui
témoignent de la déférence et de la protection que
l’autorité leur accordait. Ils étaient payés aux frais
de l’État, par les soins du décurion, qui leur faisait
délivrer leur salaire sans aucune retenue. L’État leur
donnait ce traitement, dit le Code Justinien, afin
qu’ils pussent fournir gratuitement des remèdes
aux pauvres et qu’ils ne fussent pas obligés, pour
vivre, d’exiger la rémunération de leurs soins. Ils
pouvaient cependant accepter la récompense qu’un
malade leur offrait à titre de gratitude; mais
ils devaient attendre pour cela que le malade fût
guéri. Les archiatres étaient exempts de loger des
troupes, de comparaître en justice dans la forme
ordinaire, d’accepter la charge de tuteur ou de curateur
[152]
et de payer aucune contribution de guerre,
soit en argent, soit en blé, soit en chevaux. Enfin,
quiconque osait les injurier ou les offenser de quelque
manière, se voyait exposé à une punition arbitraire
et souvent à une amende considérable. Ces
médecins des pauvres n’étaient probablement pas
de ces Grecs mal famés, qui venaient à Rome vendre
des antidotes, tailler et cautériser des verrues, laver
et panser des ulcères, quand ils ne s’acquittaient pas
des plus bas emplois du lénocinium et quand ils ne
se soumettaient point à de plus viles complaisances
pour leurs malades.
Les archiatres populaires, il n’en faut pas douter,
étaient placés sous l’autorité immédiate de l’édile:
la médecine légale résultait donc de cette organisation,
mais il est impossible de dire les matières
qu’elle embrassait et l’action qu’elle pouvait avoir
dans la police des prostituées. Nous n’avons pas
même, à ce sujet, un seul texte qui puisse nous
guider ou seulement nous éclairer. Les probabilités
ne manquent pas pour nous faire supposer que ces
médecins d’arrondissement ou de région avaient les
yeux ouverts sur la santé des mérétrices inscrites.
Peut-être, même, ces mérétrices se trouvaient-elles
astreintes à la visite et à la surveillance de certains
médecins particuliers, puisque les vestales et les
gladiateurs avaient aussi leurs médecins à part. Le
Code de Théodose parle formellement des vestales
et des gymnases. Deux inscriptions antiques constatent
[153]
les fonctions des médecins du Cirque; l’une
de ces inscriptions nous donne le nom d’Eutychus,
médecin des jeux du matin (medicus ludi matutini).
Il est donc tout naturel que les mérétrices aient eu
aussi leurs médecins, plus expérimentés, plus savants
que les autres dans le traitement des maladies
impures. Quant aux courtisanes qui n’étaient pas
sous la tutelle de l’édile, elles avaient préféré probablement
aux médecins ces vieilles femmes qu’on
nommait medicæ et qui n’étaient pas seulement
sages-femmes (obstetrices), car elles s’adonnaient
autant à la magie qu’à la médecine empirique. La
qualité de medica qu’elles prenaient dans l’exercice
de leur art prouve qu’elles le pratiquaient souvent
avec l’autorisation de l’édile et du collége des archiatres.
Gruter rapporte cette inscription: Secunda
L. Livillæ medica, mais il ne l’explique pas. Cette
L. Livilla avait-elle en sa maison deux femmes
esclaves expertes dans l’art de guérir, deux sages-femmes,
deux faiseuses d’onguents et d’antidotes? ou
bien ne s’agit-il que d’une seule medica, heureuse
dans ses cures, secunda? On comprend, d’ailleurs,
que les femmes qui dans leurs accouchements ne
recevaient pas les soins d’un médecin, mais ceux de
l’obstetrix, ne voulaient pas davantage se confier aux
regards indiscrets d’un homme, lorsqu’elles étaient
affligées de quelque maladie secrète ou honteuse
(pudenda). Il fallait donc des femmes médecins qui
traitassent les affections des femmes, et quand celles-ci
[154]
étaient assez riches pour entretenir un certain nombre
d’esclaves et de servantes, il y avait parmi elles
un médecin domestique, qui se chargeait de diriger
et de surveiller la santé de sa maîtresse. Il y avait
aussi certainement des femmes, libres ou affranchies,
qui pratiquaient la médecine et la chirurgie pour
leur propre compte, et c’était à elles que s’adressaient
les femmes du peuple qui avaient la pudeur
de ne pas se mettre dans les mains des médecins.
Une épigramme de Martial, contre Lesbie, courtisane
grecque qui avait eu quelque vogue, fait allusion
à une de ces maladies sexuelles, que les femmes, même
les plus éhontées, eussent rougi de divulguer à un
médecin d’un autre sexe que le leur: «Chaque fois
que tu te lèves de ta chaise, j’ai souvent remarqué,
malheureuse Lesbie, que ta tunique se colle à ton
derrière (pædicant miseram, Lesbia, te tunicæ), et
que, pour la détacher, tu la tires à droite et à gauche,
avec tant d’effort que la douleur t’arrache des larmes
et des gémissements; car l’étoffe adhère à tes
fesses et pénètre dans ton rectum, comme un vaisseau
pris entre deux rochers des Symplegades. Veux-tu
obvier à ce honteux inconvénient? je t’apprendrai
un moyen, Lesbie: Ne te lève ni ne t’assieds!»
C’était pour des affections locales du même genre,
que les bains de siége sont souvent recommandés
par Celse et par les médecins romains. Le meuble
qui servait à prendre ces bains de siége, aussi fréquents
en bonne santé qu’en état de maladie, était
[155]
de différentes formes, carré, rond ou ovale, en bois,
en terre cuite, en bronze et même en argent. On le
nommait solium, comme si une femme, en l’occupant,
siégeait sur un trône, avant ou après l’acte le
plus délicat de sa royauté. Un ancien commentateur
de Martial dit que les femmes de Rome, matrones
ou courtisanes, à l’époque du luxe et de la mollesse
asiatique, auraient tout refusé à leurs amants ou à
leurs maris, si on ne leur eût pas permis de se laver
(abluere) dans un bidet d’argent. Ces ablutions devinrent
d’autant plus fréquentes que les femmes
étaient moins saines et que la santé des hommes se
trouvait plus exposée. On doit attribuer à ces ablutions
et à celles qui se renouvelaient sans cesse dans
les bains et les étuves, on doit attribuer aux frictions
et aux fomentations qui les accompagnaient
toujours, une foule de guérisons des maladies récentes
et légères; en tous les cas, le développement
des affections vénériennes rencontrait de puissants
obstacles dans l’usage journalier et presque continuel
des bains sudorifiques.
Les médecins, surtout ceux qui avaient une nombreuse
et riche clientèle, dédaignaient certainement
de s’abaisser au traitement des maladies secrètes; ils
ne l’entreprenaient qu’avec répugnance, dans l’espoir
d’être généreusement rétribués. Ce dédain médical
à l’égard de ce genre de maladies nous paraît
ressortir des habitudes mêmes de ces médecins
célèbres qui arrivaient chez leurs malades avec un
[156]
cortége de vingt, de trente et quelquefois de cent
disciples, comme le dit Martial. Le nombre de ces
disciples indiquait proportionnellement le mérite ou
plutôt la réputation de leur maître; et tous venaient,
après lui, tâter le pouls du malade et juger des diagnostics
du mal. On n’a pas besoin de démontrer
qu’un malade vénérien ne se livrait pas ainsi en
spectacle aux observations médicales et aux quolibets
de la suite d’un médecin. Il y avait donc des
médecins ou des pharmacopoles qui s’appropriaient
le traitement des maladies secrètes et qui entouraient
de mystère et d’une discrétion à l’épreuve ce traitement,
que la médecine empirique se voyait trop souvent
forcée d’abandonner à la chirurgie. Un mal
obscène, longtemps négligé d’abord, puis largement
traité par l’empirisme, se terminait d’ordinaire par
une opération terrible dont parle Martial dans cette
épigramme: «Baccara, le Grec, confie la guérison
de ses parties honteuses à un médecin, son rival;
Baccara sera châtré.» Une autre épigramme de Martial,
sur la mort de Festus, nous permet de supposer
que les malades désespéraient souvent de leur guérison,
et se tuaient pour échapper à d’incurables
infirmités, à une agonie douloureuse. Telle fut la fin
de l’ami de l’empereur Domitien, du noble Festus,
qui, atteint d’un mal dévorant à la gorge, mal horrible
envahissant déjà son visage, résolut de mourir,
et consola lui-même ses amis avant de se frapper
stoïquement d’un poignard, comme le grand Caton.
[157]
Les guérisons étaient, devaient être longues et
difficiles, lorsque le mal avait eu le temps de s’étendre
et de s’enraciner. Les charlatans, qui vendaient
sans contrôle une quantité de drogues en tablettes et
en bâtons portant leur cachet, profitaient nécessairement
de l’embarras où se trouvait le malade privé
de médecin. Dans bien des circonstances, la superstition
se chargeait seule de lutter contre la maladie,
dont elle n’arrêtait guère les progrès. Le
misérable patient allait de temple en temple, de dieu
en déesse, avec des offrandes, des prières et des
vœux. Les malades qui avaient le moyen de se faire
peindre des tableaux votifs, faisaient suspendre ces
tableaux dans les sanctuaires de Vénus, de Priape,
d’Hercule ou d’Esculape. Il est permis de croire que
la décence était respectée dans ces peintures allégoriques.
Cependant on suspendait aussi autour des
autels de toutes les divinités les représentations figurées
des organes malades, en plâtre, en terre cuite,
en bois, en pierre ou en métal précieux. On offrait
des sacrifices expiatoires, dans lesquels figuraient
toujours les gâteaux de pur froment (coliphia), qui
avaient la forme des parties sexuelles et qui affectaient
les plus extravagantes proportions. Les prêtres
de certains dieux et déesses ne mangeaient
pas d’autre pain que ces gâteaux obscènes, que les
libertins réservaient aussi pour leur joyeuse table:
Illa silegineis pinguescit adultera cunnis, dit Martial,
qui attribue à cette pâtisserie une action favorable
[158]
à l’embonpoint. Les chapelles et les temples
qui voyaient affluer le plus de malades et d’offrandes
étaient ceux dont les prêtres se mêlaient de médecine.
Au reste, tout le monde avait le droit de se
dire médecin à Rome et de fabriquer des drogues.
Les maladies secrètes ouvraient un vaste champ
aux spéculations du charlatanisme, et parmi ces
spéculateurs, les oculistes n’étaient pas les moins ingénieux;
les barbiers ne se bornaient pas non plus
à manier le peigne et le rasoir; les barbiers, ces
lénons astucieux qui tendaient la main à tous les
commerces de la Prostitution, regardaient comme
leur propriété les maladies qui en provenaient; les
esclaves des bains, les unctores, les aliptes des deux
sexes, connaissaient naturellement tous les secrets de
la santé de leurs clients, et après leur avoir fourni
des moyens de débauche, ils leur fournissaient des
moyens de guérison; enfin, les maladies de Vénus
étaient si multipliées et si ordinaires, que chacun
s’était fait une hygiène à son usage, et pouvait au
besoin se traiter soi-même sans prendre aucun confident
et sans avoir à craindre aucune indiscrétion.
Et pourtant ces maladies, si nombreuses, si variées,
si singulières chez les anciens, sont restées
dans l’ombre, et les plus grands médecins de l’antiquité
semblent s’être entendus tacitement pour les
tenir cachées sous le manteau d’Esculape. Mais on
peut aisément s’imaginer ce qu’elles étaient, quand
on songe à l’effroyable déréglement des mœurs dans
[159]
la Rome des empereurs; quand on voit la Prostitution
guetter les enfants au sortir du berceau et s’en
saisir avec une cruelle joie, avant qu’ils aient atteint
leur septième année. «Que mon bon génie me confonde,
s’écrie la Quartilla de Pétrone, si je me souviens
d’avoir jamais été vierge! (Junonem meam
iratam habeam, si unquam me meminerim virginem
fuisse!)» Le mal vénérien était inhérent à la Prostitution
et se répandait partout avec elle. Si la santé
d’un maître devenait suspecte, celle de tous ses
esclaves courait de grands risques. Un orateur romain,
Acherius, contemporain d’Horace, n’avait-il
pas osé dire hautement en plaidant une cause criminelle:
«La complaisance impudique est un crime
chez l’homme libre, une nécessité chez l’esclave, un
devoir chez l’affranchi (Impudicitia, inquit Acherius, in
ingenuo crimen est, in servo necessitas, in libero officium)!»
C’est Cœlius Rhodiginus qui rapporte, dans
ses Antiquæ Lectiones, cet abominable apophthegme
des pædicones.

Sommaire.—Les medicæ juratæ.—Origine des sages-femmes.—L’Athénienne
Agonodice.—Les sagæ.—Exposition des nouveau-nés
à Rome.—Les suppostrices ou échangeuses d’enfants.—Origine
du mot sage-femme.—Les avortements.—Julie,
fille d’Auguste.—Onguents, parfums, philtres et maléfices.—Pratiques
abominables dont les sagæ se souillaient pour fabriquer
les philtres amoureux.—La parfumeuse Gratidie.—Horribles
secrets de cette magicienne, dévoilés par Horace, dont elle fut la
maîtresse.—Le mont Esquilin, théâtre ordinaire des invocations
et des sacrifices magiques.—Gratidie et sa complice la
vieille Sagana, aux Esquilies.—Le nœud de l’aiguillette.—Comment
les sagæ s’y prenaient pour opérer ce maléfice, la terreur
des Romains.—Comment on conjurait le nœud de l’aiguillette.—Philtres
aphrodisiaques.—La potion du désir.—Composition
des philtres amoureux.—L’hippomane.—Profusion
des parfums chez les Romains.—La nicérotiane et le foliatum.—Parfums
divers.—Cosmétiques.—Le bain de lait d’ânesse
de Poppée.—La courtisane Acco.—Objets et ustensiles à
l’usage de la Prostitution, que vendaient les sagæ et les parfumeuses.—Le
fascinum.—Les fibules.—Comment s’opérait
l’infibulation.—De la castration des femmes.—Les prêtres de
Cybèle.
Nous ne savons rien des services que les medicæ
rendaient aux femmes, dans des circonstances délicates
[162]
où la santé de celles-ci réclamait l’œil et la
main d’une personne de leur sexe; nous en sommes
réduits à des conjectures, très-plausibles, il est vrai,
sur ce chapitre secret de l’art de guérir, que les écrivains
de l’antiquité ont laissé couvert d’un voile
impénétrable. Mais si nous ne pouvons apprécier, d’après
des autorités bien établies, le rôle que les medicæ
remplissaient dans la thérapeutique des maladies de
l’amour, nous n’aurons pas de peine à constater leur
utile et active intervention, non-seulement dans les
cas de grossesse et d’accouchement, mais encore
dans la préparation mystérieuse des cosmétiques,
des parfums et des philtres. Il y avait sans doute, à
Rome et dans les principales villes de l’empire romain,
des medicæ juratæ, comme les appelle Anianus
dans ses Annotations au Code théodosien:
«Toutes les fois qu’il y a doute sur la grossesse d’une
femme, cinq sages-femmes jurées, c’est-à-dire ayant
licence d’étudier la médecine (medicæ), reçoivent
l’ordre de visiter cette femme (ventrem jubentur
inspicere).» Mais, outre ces praticiennes émérites,
qui subissaient probablement examen médical et
qui se soumettaient au contrôle des archiatres populaires,
beaucoup de femmes, des étrangères surtout,
des affranchies ou même des esclaves, s’adonnaient
à la médecine occulte et mêlaient à cet art, qu’elles
avaient étudié ou non, le métier de parfumeuse
et les pratiques souvent criminelles de la magie.
Hygin, dans son recueil de fables mythologiques,
[163]
nous raconte ainsi à quelle occasion la médecine fut
exercée par une femme, pour la première fois, en
Grèce. Dès les temps les plus reculés, c’étaient des
hommes qui assistaient les femmes en travail d’enfant,
quoique la pudeur eût à souffrir des secours
qu’elle était obligée d’accepter. Mais une jeune Athénienne,
nommée Agonodice, résolut d’affranchir son
sexe d’une sorte de servitude déshonorante, dont
Junon s’indignait: elle coupe ses cheveux, prend
un habit d’homme, et va suivre les leçons d’un
célèbre médecin, qui l’instruit dans l’art des accouchements
et qui fait d’elle une excellente sage-femme.
Alors elle commence à suppléer son maître et à exécuter
son projet; elle se montre si adroite, si habile,
si décente surtout, que les matrones en mal d’enfant
ne veulent plus avoir d’autre médecin. Il est probable
qu’Agonodice leur déclarait son sexe sous le
sceau du secret; car bientôt aucune femme d’Athènes
n’eut recours, pour sa délivrance, aux soins des médecins.
Ceux-ci s’en étonnèrent d’abord; ils s’irritèrent
et se liguèrent ensuite contre le jeune rival qui
leur enlevait leur clientèle. On ne voyait qu’Agonodice
auprès du lit des femmes en couches, qui lui
souriaient et lui parlaient avec une étrange familiarité.
Sa jeunesse, sa charmante figure, ses grâces
et son mérite éveillèrent la calomnie: on prétendit
qu’il savait l’art de changer en jouissance les douleurs
de l’enfantement; il fut dénoncé aux magistrats
comme impudique et corrupteur de femmes honnêtes.
[164]
Il ne répondit pas à ses accusateurs et comparut
devant l’aréopage. Là, sans rien alléguer pour
sa justification, il ouvrit sa tunique et révéla son
sexe, qui le fit absoudre. Les médecins furent convaincus,
et le peuple demanda l’abrogation d’une
ancienne loi qui défendait aux femmes l’exercice
de l’art iatrique. Cette histoire prouverait que la
médecine fut toujours exercée depuis par les hommes
et par les femmes indistinctement, et que celles-ci
s’étaient réservé, presque exclusivement, à Rome
ainsi qu’à Athènes, le traitement des maladies de
leur sexe.
Les femmes qui s’occupaient de médecine, et surtout
de médecine secrète, étaient donc fort nombreuses
et de différentes classes: les medicæ les plus
considérées par leur savoir et leur caractère touchaient
sans doute à toutes les branches de l’art;
les obstetrices se bornaient au rôle de sages-femmes;
les adsestrices n’étaient que des aides ou des élèves
de ces sages-femmes; puis, venait en dernier lieu la
catégorie multiple et variée des parfumeuses et des
magiciennes, qui toutes ou presque toutes appartenaient
ou avaient appartenu à la Prostitution. C’était
là le refuge des vieilles courtisanes; c’était là l’emploi
favori des entremetteuses. On confondait sous
le nom général de sagæ les diverses espèces de ces
vendeuses d’onguents et de philtres, qu’elles fabriquaient
souvent elles-mêmes avec des cérémonies
magiques inventées par la Thessalie. Mais les sagæ
[165]
n’étaient pas toutes magiciennes; la plupart même ne
connaissaient que les éléments les plus simples et les
plus innocents de cet art exécrable; beaucoup ignoraient
absolument la composition des drogues qu’elles
vendaient, et qui causaient trop souvent de funestes
accidents, sur lesquels la justice fermait volontiers
les yeux; quelques-unes n’étaient que des espèces de
sages-femmes non autorisées, qui se chargeaient
d’opérer des avortements et qui entouraient d’invocations
et d’amulettes la naissance des enfants illégitimes.
On sait que le nombre de ces naissances
était considérable à Rome, et que chaque matin on
recueillait dans les rues, au seuil des maisons, sous
les portiques et dans les fours des boulangers, les
cadavres des nouveau-nés, qu’on vouait à une
mort certaine en les exposant nus sur la pierre
au sortir du ventre maternel. C’était la saga qui
remplissait l’affreuse mission de l’infanticide, et
qui étouffait dans les plis de sa robe les innocentes
victimes que leurs cris condamnaient à périr
violemment. Souvent, il est vrai, la mère avait
pitié du fruit de ses entrailles, et elle se contentait
de faire exposer l’enfant, enveloppé dans ses langes,
soit au bord de la mare du Velabre (lacus Velabrensis),
soit sur la place aux légumes (in Foro olitorio),
au pied de la colonne du Lait (Columna lactaria);
là, du moins, ces malheureux orphelins étaient recueillis
et adoptés aux frais de l’État, qui leur tenait
lieu de tuteur, mais en leur infligeant le stigmate de
[166]
la bâtardise. Il arrivait aussi que des matrones stériles,
des suppostrices (infâmes mégères qui faisaient
métier de changer les enfants en nourrice), des citoyens,
chagrins de n’avoir pas d’héritiers, venaient
choisir parmi ces pauvres petits abandonnés ceux
qui pouvaient le mieux servir à leurs desseins honnêtes
ou malhonnêtes. Souvent le Velabre retentissait
de vagissements dans l’ombre, et l’on voyait
passer comme des spectres les sagæ, les mères elles-mêmes,
qui apportaient leur tribut à ce hideux minotaure
qu’on appelait l’exposition (expositio) des enfants
sur la voie publique. Il est évident que l’origine
du mot sage-femme doit se rapporter à celui de saga,
qui ne se prenait qu’en mauvaise part, et que Nonius
emploie comme synonyme d’instigatrice à la débauche
(indagatrix ad libidinem).
Ces sagæ prêtaient volontiers les mains aux avortements
qui se pratiquaient au début de la grossesse
(aborsus), ou dans les derniers mois de la gestation
(abortus). Ces avortements, que la loi était censée
punir et qu’elle évitait de rechercher, parce qu’elle
aurait eu trop à faire, devinrent si fréquents sous
les empereurs, que les femmes les moins éhontées ne
craignaient pas d’empêcher de la sorte l’augmentation
de leur famille. Il y avait certaines potions qui procuraient,
sans aucun danger, un avortement prompt
et facile; mais on usait aussi de drogues malfaisantes,
qui tuaient à la fois la mère et son fruit. Dans
ce cas-là, on assimilait aussi à l’empoisonneuse
[167]
l’obstetrix ou la saga, qui, par imprudence, par ignorance
ou autrement, avait commis un double meurtre:
cette misérable était condamnée au dernier
supplice. Quant à celles qui administraient ces potions
abortives et qui n’agissaient pas à l’insu de la
femme enceinte, on pouvait confisquer une partie
de leurs biens et les envoyer aux îles, parce que
leur fait est de mauvais exemple, dit le jurisconsulte
Paulus. Mais la punition de ce délit était fort
rare, et bientôt elle fut impossible; car tout le monde
se rendait coupable au même chef, et l’impératrice
donnait souvent l’exemple, de l’aveu de l’empereur,
sans avoir même la pudeur de cacher cet outrage
à la nature. Le motif le plus ordinaire des avortements
continuels n’était que la crainte d’altérer la
pureté d’un ventre poli et d’une belle gorge, en les
sacrifiant aux atteintes plus ou moins fâcheuses
d’une pénible grossesse et d’un douloureux enfantement.
«Penses-tu, dit Aulu-Gelle avec indignation
en parlant de ces criminelles marâtres, que la nature
ait donné les mamelles aux femmes comme de gracieuses
protubérances destinées à orner la poitrine et
non à nourrir les enfants? Dans cette idée, la plupart
de nos merveilleuses (prodigiosæ mulieres) s’efforcent
de dessécher et de tarir cette fontaine sacrée
où le genre humain puise la vie, et risquent de corrompre
ou de détourner leur lait, comme s’il gâtait
ces attributs de la beauté. C’est la même folie qui
les porte à se faire avorter, à l’aide de diverses drogues
[168]
malfaisantes, afin que la surface polie de leur
ventre ne se ride pas et ne s’affaisse point sous le
poids de leur faix et par le travail des couches.»
L’avortement était souvent motivé par des raisons
plus coupables encore: ici, une femme mariée voulait
détruire la preuve de son adultère; là, une femme
libertine, sentant ses désirs et son ardeur amoureuse
s’éteindre sous l’empire d’une grossesse, employait
un moyen criminel, pour ne pas perdre ce qu’elle
préférait aux joies de la maternité. Cet engourdissement
de sens durant la gestation n’était pourtant
pas général, et quelques femmes, au contraire, dont
la débauche avait exalté l’imagination, ne se trouvaient
jamais plus ardentes en amour que dans le cours
d’une grossesse, qui les rassurait, d’ailleurs, contre
des obstacles de la même espèce. Ainsi, Julie, fille
d’Auguste, ne se livrait à ses amants que quand
elle était grosse du fait de son mari Agrippa, et le
temps de sa grossesse ne mettait aucune interruption
à ses désordres. Macrobe rapporte qu’elle répondit
à ceux qui s’étonnaient de ce que ses enfants,
malgré ces débordements, ressemblaient toujours à
son mari: «En effet, je n’accepte des passagers à
mon bord, que quand le navire est chargé (at enim
nunquam nisi navi plenâ tollo vectorem).» Dès qu’une
femme devenait enceinte, les conseils, les offres et les
séductions ne lui manquaient pas pour la décider à
faire à sa beauté le sacrifice de son enfant; elle était
assaillie et circonvenue par les entremetteuses d’avortement:
[169]
«Elle te cachait sa grossesse, dit un
personnage du Truculentus de Plaute, car elle redoutait
que tu ne lui persuadasses de consentir à un
avortement (ut abortioni operam daret) et à la mort
de l’enfant qu’elle portait.»
Les grossesses et les avortements donnaient donc
beaucoup de besogne aux sagæ de Rome; mais ce
n’était là que le moindre des mystères de leur art.
Elles tiraient encore meilleur parti de leurs onguents,
de leurs parfums, de leurs philtres et de
leurs maléfices. Ces maléfices ressemblaient à ceux
qui avaient lieu en Grèce, en Thessalie surtout, dès
l’époque la plus ancienne, et le récit que fait Horace,
dans ses Épodes, d’une incantation magique,
ne diffère presque pas de la peinture que Théocrite
avait faite d’une pareille scène trois siècles auparavant.
Le but de ces superstitions abominables était,
d’ailleurs, toujours le même, dans tous les temps,
chez tous les peuples. La magicienne jetait des sorts
ou composait des philtres. Ces philtres avaient surtout
pour objet de raviver les feux de l’amour et de
lui créer des ardeurs nouvelles, surhumaines, inextinguibles;
ces philtres devaient changer la haine
en amour ou l’amour en haine, et vaincre toutes les
résistances de la pudeur ou de l’indifférence. Les
sorts servaient plus particulièrement à des ressentiments
et à des vengeances. Ce genre de maléfices
était sans doute plus rare chez les Romains que chez
les Grecs; mais, en revanche, nulle part la science des
[170]
philtres d’amour ne fut poussée plus loin ni plus
répandue qu’à Rome sous les Césars. Horace nous
fait connaître les pratiques abominables dont les
sagæ de son temps se souillaient pour fabriquer certains
philtres amoureux. Horace avait été l’amant
d’une parfumeuse napolitaine, nommée Gratidie,
qu’il a vouée à l’exécration publique sous le nom de
Canidie. Horace, dans sa liaison avec cette Canidie,
qu’il finit par détester autant qu’il l’avait aimée,
s’était initié avec horreur aux plus noirs secrets des
magiciennes: «Elles avaient des relations continuelles
avec les courtisanes, dit M. Walckenaer
dans son excellente Histoire de la vie et des écrits
d’Horace; elles étaient de ce nombre et elles se mêlaient
de toutes sortes d’intrigues d’amour.» Gratidie
fut une des plus célèbres parmi les sagæ de
Rome, grâce à la colère poétique d’Horace, qui ne
lui pardonnait pas de s’être vendue à un vieux
libertin, appelé Varus; cette parfumeuse était donc
assez jeune et assez belle pour trouver encore à se
vendre, et ses charmes méritaient d’être l’objet des
regrets d’un amant délaissé. Les scoliastes d’Horace
ont pensé que le poëte reprochait surtout à
Gratidie d’avoir exercé sur lui le funeste pouvoir
des breuvages d’amour, et de lui avoir ainsi enlevé
sa jeunesse, ses forces, ses illusions et sa santé. Horace,
en effet, fut sans cesse affligé d’un mal d’yeux,
qu’on peut, sans faire injure à Canidie, attribuer
aux philtres et à la maladie de Vénus.
[171]
Le mont Esquilin était le théâtre ordinaire des
invocations et des sacrifices magiques. Ce monticule
servait de cimetière aux esclaves, qu’on enterrait
pêle-mêle sans leur accorder un linceul; la nuit, il
n’y avait de vivants, dans cette solitude peuplée de
morts, que des voleurs qui s’y trouvaient en sûreté,
et des sorcières qui y venaient accomplir des œuvres
de ténèbres. A l’extrémité des Esquilies, près
de la porte Métia, entourée de gibets et de croix où
pendaient les cadavres des suppliciés, le carnifex
ou bourreau avait sa demeure isolée, comme pour
veiller sur ses sujets; une statue monstrueuse de
Priape veillait aussi sur cet infect et hideux repaire
des sagæ et des voleurs. Là, aux pâles rayons de
la lune, on voyait Canidie accourir, les pieds nus,
les cheveux épars, le sein découvert, le corps
enveloppé d’un ample manteau, ainsi que sa complice,
la vieille Sagana. Horace les avait vues, ces
horribles mégères, déchirant à belles dents une brebis
noire, versant le sang de l’animal dans une
fosse, dispersant autour d’elles les lambeaux de
chair palpitante, évoquant les mânes et interrogeant
la destinée. Les chiens et les serpents erraient à l’entour
du sombre sacrifice, et la lune voila sa face sanglante
pour ne pas éclairer cet affreux spectacle.
Priape lui-même eut horreur de ce qu’on lui montrait,
et il fit éclater en deux le tronc de figuier dans
lequel son image était grossièrement taillée. Au
bruit du bois qui se fendait, les deux magiciennes
[172]
eurent peur et s’enfuirent, sans achever leur maléfice,
éperdues et semant sur la route: Canidie, ses
dents; Sagana, sa perruque pyramidale, et leurs
herbes, et leurs anneaux constellés. Elles revinrent
pourtant, une autre nuit, sur le mont Esquilin, pour
un mystère plus abominable: elles avaient enlevé
un jeune enfant à sa famille; elles l’avaient enterré
vif dans la fosse des esclaves, et la tête seule de la
victime s’élevait au-dessus du sol; elles lui présentaient
des viandes cuites, dont l’odeur irritait sa
faim et son agonie. L’enfant les conjure au nom de
sa mère, au nom de leurs enfants, Canidie et Sagana
sont impitoyables; Canidie brûle dans un feu magique
le figuier sauvage arraché sur des tombeaux,
le cyprès funèbre, les plumes et les œufs de la
chouette trempés dans du sang de crapaud, les
herbes vénéneuses que produisent Colchos et l’Ibérie,
et des os ravis à la gueule d’une chienne affamée;
Sagana, la crinière hérissée, danse devant le
bûcher, en l’aspergeant d’eau lustrale: «O Varus,
s’écrie Canidie rongeant ses ongles avec sa dent
livide, ô Varus, que de larmes tu vas répandre!
Oui, des philtres inconnus te forceront bien de revenir
à moi, et tous les charmes des Marses ne te
rendront pas la raison. Je préparerai, je verserai
moi-même un breuvage qui vaincra les dégoûts que
je t’inspire. Oui, les cieux s’abaisseront au-dessous
des mers, la terre s’élèvera au-dessus des nues, où
tu brûleras pour moi, comme le bitume dans ces
[173]
feux sinistres.» Mais l’enfant qui se lamente est
près d’expirer; sa voix s’affaiblit; ses prunelles
éteintes se fixent immobiles sur les mets exposés
devant sa bouche; Canidie s’arme d’un poignard et
s’approche, pour lui ouvrir le ventre au moment où
s’exhalera son dernier soupir, car, de son foie desséché
et de la moelle de ses os, elle doit composer un
breuvage d’amour (exsucta uti medulla et aridum
jecur amoris esset poculum): «Je vous dévoue aux
Furies, s’écrie l’infortuné qui râle, et cette malédiction
rien au monde ne saurait la détourner de vous.
Je vais périr par votre cruauté; mais, spectre nocturne,
je vous apparaîtrai; mon ombre vous déchirera
le visage avec ses ongles crochus, qui sont la
force des dieux mânes; je pèserai sur vos poitrines
haletantes, et je vous priverai de sommeil, en vous
glaçant d’effroi. Dans les rues, la populace vous
poursuivra à coups de pied, vieilles obscènes. Puis,
les loups et les corbeaux des Esquilies se disputeront
vos membres privés de sépulture!»
Tous les maléfices des sagæ n’étaient pas aussi
terribles, et ordinairement, ces faiseuses de philtres
n’allaient la nuit sur le mont Esquilin que pour y
cueillir des plantes magiques au clair de la lune,
pour y chercher des cheveux et des os de morts, et
pour y prendre de la graisse de pendu. Il fallait
aussi les payer fort cher pour obtenir d’elles ces
pratiques exécrables, qui étaient souillées de sang
humain, quoique la vie des enfants fût estimée peu
[174]
de chose à Rome; mais l’enfant qu’on immolait,
après l’avoir enterré vivant, devait avoir été volé à
sa nourrice ou à ses parents; autrement, son foie et
sa moelle n’auraient pas eu la même puissance pour
donner de l’amour. Or, le rapt d’un enfant né libre
ou ingénu pouvait être puni du dernier supplice.
Les philtres magiques étaient préparés en vue d’un
des trois résultats suivants, que l’amour ou la haine
sollicitait de l’art des sagæ: faire aimer celui ou
celle qui n’aimait pas; faire haïr celui ou celle qui
aimait; paralyser, glacer chez un homme toute
l’ardeur, toute l’énergie de son tempérament. Ce
troisième maléfice, que le moyen âge a tant redouté
sous le nom de nœud de l’aiguillette et que la jurisprudence
criminelle a constamment poursuivi presque
jusqu’à nos jours, n’était pas moins détesté par
les Romains, qui s’indignaient de se voir en butte à
ses tristes effets. Les sagæ excellaient dans ce genre
de maléfice; elles savaient frapper d’impuissance
les natures les plus indomptables, et il leur suffisait,
pour cela, de faire des nœuds avec des cordes ou des
fils noirs, en prononçant certaines paroles et certaines
invocations. C’était là ce qu’on appelait præligare,
quand il s’agissait d’empêcher les premiers rapports
entre un amant et sa maîtresse, entre une femme et
son mari; nodum religare, quand on voulait annihiler
et suspendre ces rapports qui avaient déjà existé.
Le nœud de l’aiguillette, qui fut de tout temps la
terreur des amours, n’a jamais pris son origine que
[175]
dans un fantôme de l’imagination; mais les anciens,
comme les modernes, en l’attribuant à une force
invisible, se faisaient au moins un refuge pour leur
vanité d’homme. Les Romains avaient une singulière
peur de ce maléfice, qui leur semblait une honte pour
celui qu’il privait des priviléges de son sexe; ils le
regardaient comme si foudroyant et si tenace, qu’ils
évitaient même d’en parler; ils croyaient sans cesse
en être menacés; et, pour le conjurer, s’ils avaient
l’amour en tête, ils formaient des nœuds, qu’ils défaisaient
aussitôt, avec des cordons ou des courroies
qu’ils entortillaient d’abord autour d’une statue
d’Hercule ou de Priape. Ces sacrifices que les hommes
offraient à ces deux divinités, en secret, sur
l’autel du foyer domestique, ces sacrifices n’avaient
pas d’autre objet que de rompre les nœuds magiques
qu’une main ennemie pouvait faire pour lier les sens
et tromper l’espérance du plaisir. La moindre allusion
à ce fatal complot de la magie était réputée
funeste, comme si on évoquait un génie malfaisant,
dès qu’on l’avait nommé. Les poëtes, les écrivains,
si vieux qu’ils fussent, craignaient de toucher à ce
sujet délicat, qui d’un jour à l’autre pouvait leur
devenir personnel et les affliger à leur tour; on se
gardait donc bien de rire du malheur d’autrui. C’est
avec une extrême réserve que Tibulle, dans une
élégie, s’associe à la douleur d’un amant qui se
cherche en vain et qui ne se trouve plus, même dans
les bras de la belle Pholoë: «Quelque vieille, avec
[176]
ses chants magiques et ses philtres puissants, dit le
poëte de l’amour, aurait-elle jeté sur toi un sort,
durant la nuit silencieuse? La magie fait passer dans
un champ la moisson du champ voisin; la magie
arrête la marche du serpent irrité; la magie essaie
même d’arracher la lune de son char. Mais pourquoi
accuser de ton malheur les chants d’une sorcière?
Pourquoi accuser ses philtres? La beauté n’a pas
besoin des secours de la magie; mais ce qui t’a
rendu impuissant, c’est d’avoir trop caressé ce beau
corps, c’est d’avoir trop prolongé tes baisers, c’est
d’avoir trop pressé sa cuisse contre la tienne.» (Sed
corpus tetigisse nocet, sed longa dedisse oscula, sed
femori conseruisse femur.) Tibulle a mis une si
grande réserve en abordant ce sujet de mauvais
augure, que l’élégie qu’il lui consacre est pleine de
réticences et d’obscurités.
Mais les philtres les plus puissants et aussi les
plus redoutables furent ceux que les sagæ et les
vieilles courtisanes fabriquaient, d’après des recettes
inconnues, sans le secours de la magie. L’unique
destination de ces philtres était d’échauffer les sens
et d’accroître les transports amoureux. On en faisait
à Rome un prodigieux usage, malgré les dangers
d’une pareille surexcitation de la nature. Tous les
jours un breuvage de cette espèce causait la mort,
ou la folie, ou la paralysie, ou l’épilepsie; mais ce
fatal exemple n’arrêtait personne, et la soif du plaisir
imposait silence à la raison. Ces philtres, d’ailleurs,
[177]
n’étaient pas tous également funestes, et d’ordinaire,
les accidents qu’on leur attribuait à bon droit, provenaient
surtout de l’abus plutôt que de l’usage
modéré. D’abord, les libertins se contentaient d’une
dose minime, qui leur rendait tous les feux de la
jeunesse; mais, ces feux diminuant, ils augmentaient
graduellement cette dose de poison, auquel ils devaient
quelques simulacres de jouissance, et bientôt
le philtre était sans action sur une nature épuisée,
qui s’exhalait dans un dernier effort d’amour en
démence. C’est ainsi que périrent avant l’âge, l’ami
de Cicéron, L. Licin. Lucullus, le modèle des prodigues
et des voluptueux, le poëte Lucrèce, et tant
d’autres qui passèrent de la folie à la mort. On
appelait aphrodisiaca tous ces philtres, en général
plus ou moins malfaisants, qui avaient pour objet
de raviver le foyer de Vénus. On les administrait
aussi aux femmes qui manquaient de sens, aux
jeunes filles dont l’appétit amoureux ne s’était pas
encore éveillé; mais les médecins sages et honnêtes
désapprouvaient hautement l’emploi de ces aphrodisiaques,
surtout pour les jeunes filles: «Ces
philtres, qui rendent le teint pâle, s’écrie Ovide dans
son Remède d’amour, ne profitent pas aux jeunes
filles; ces philtres nuisent à la raison et renferment
le germe de la folie furieuse.» La plupart de ces
philtres étaient des potions qu’il fallait prendre de
confiance, sans en connaître les ingrédients que la
superstition ou l’empirisme avait combinés. Le malheureux
[178]
qui s’exposait à un empoisonnement pour
retrouver quelques instants de plaisir sensuel, n’avait
souvent pour garantie que la réputation bonne ou
mauvaise de la saga chez laquelle il allait acheter
ce plaisir. Souvent, il est vrai, les potions n’étaient
composées que de jus et de décoctions d’herbes:
«Les plantes qui stimulent les sens, dit Celse, sont
le calament, le thym, la sarriette, l’hysope et surtout
le pouliot, ainsi que la rue et l’ognon» (ou plutôt
le champignon, cepa); mais souvent aussi, dans ces
breuvages funestes, on faisait entrer des matières
minérales et même animales, qui constituaient les
amatoria les plus terribles. Un breuvage de cette
espèce, dont Canidie possédait la recette, se nommait
poculum desiderii, dit Horace, la potion du désir.
Il y avait aussi des eaux naturelles, sulfureuses et
ferrugineuses, qui passaient pour favorables aux
sens et inoffensives dans leurs effets érotiques. C’étaient
là les philtres que la médecine opposait à ceux
des parfumeuses et des magiciennes. Ces eaux excitantes,
aquæ amatrices, comme on les qualifiait perdaient
presque toute leur vertu, quand on les prenait
loin de la source. Martial dit dans une épigramme:
«Hermaphrodite hait les eaux qui font aimer (odit
amatrices Hermaphroditus aquas);» dans une autre
épigramme, il semble faire entendre que ces sortes
d’eaux étaient affermées ou possédées, par des femmes,
sans doute des courtisanes, qui les avaient
mises en vogue et qui les exploitaient: «Quel est cet
[179]
adolescent qui s’éloigne des ondes pures de la fontaine
d’Yanthis et qui se réfugie auprès de la naïade,
maîtresse de cette fontaine (at fugit ad dominam
Naiada)? N’est-ce pas Hylas? Trop heureux qu’Hercule,
le demi-dieu de Tirynthe, soit adoré dans le
bois qui entoure la fontaine, et qu’il veille de si
près sur ses eaux amoureuses! Arginus, puise sans
crainte à la source, pour nous donner à boire; les
nymphes ne te feront rien, mais prends garde
qu’Hercule ne s’empare de toi!» Ces aquæ amatrices
n’étaient donc pas, ainsi que plusieurs savants l’ont
cru, des breuvages composés et préparés de la main
d’une saga, mais tout simplement des eaux minérales,
qui, en ranimant la vigueur d’un tempérament
fatigué, le disposaient naturellement aux œuvres
de l’amour et semblaient évoquer une nouvelle
jeunesse.
Des renseignements précis sur la composition des
philtres ne se trouvent nulle part dans les écrivains
de l’antiquité. On comprend, au reste, le mystère
dont les vendeurs de philtres entouraient leur industrie
souvent coupable, mystère que la science
n’essayait pas de pénétrer. On ne se souciait que des
effets, qui étaient vraiment prodigieux, on ne s’occupait
pas des causes. Le physiologiste Virey a rassemblé,
dans Dioscoride, Théophraste, Pline, etc.,
tous les éléments épars et indécis qui lui ont permis
de reconstruire l’histoire des aphrodisiaques chez
les anciens. Il les a divisés en deux classes principales:
[180]
les végétaux et les animaux; parmi les premiers,
on distinguait les stupéfiants ou narcotiques,
les stimulants âcres et aromatiques, les odorants et
spiritueux. La mandragore, la pomme épineuse, le
chanvre sauvage, dans lequel on reconnaît le népenthès
d’Homère, causaient une ivresse voluptueuse
qui se prolongeait dans un infatigable redoublement
de sensations érotiques, et qui conduisait délicieusement
à la perte de la mémoire, à la stupidité et à
la mort. Les champignons, surtout les phallus et les
morilles, les agarics, les aristoloches, les résines
âcres, les herbes aromatiques et les graines de ces
plantes stimulaient puissamment les organes du plaisir;
les liqueurs spiritueuses dans lesquelles on
avait fait infuser certaines fleurs odorantes, développaient
aussi chez les deux sexes l’activité sensuelle.
Mais ces excitants, empruntés au règne
végétal, n’avaient bientôt plus d’empire sur les
monstrueux débauchés qui se proposaient toujours
de dépasser les bornes de la force humaine, et qui
cherchaient leurs modèles parmi les dieux de leur
mythologie amoureuse. Ils avaient donc recours
à des philtres redoutables, à l’aide desquels ils pouvaient,
pendant des nuits entières, se persuader que
Jupiter ou Hercule était descendu de l’Olympe pour
se métamorphoser en homme. Ils en mouraient parfois,
sans être rassasiés de volupté, et leur effrayant
priapisme se continuait longtemps après leur mort.
Les insectes, les poissons, les substances animales
[181]
étaient tour à tour appelés à concourir à l’affreux
mélange qu’on désignait sous le nom caractéristique
de satyrion. Cantharides, grillons, araignées et bien
d’autres coléoptères, broyés et réduits en poudre ou
seulement infusés dans du vin, agissaient avec violence
sur les organes sexuels et leur communiquaient
immédiatement une violente irritation, qui
amenait fréquemment de graves affections de la
vessie. On employait aussi avec le même succès les
œufs de muge, de sèche et de tortue, en y mêlant
de l’ambre gris; mais, après des prodiges de virilité,
après de longs et frénétiques emportements d’amour,
la victime de son propre libertinage tombait dans
une maladie convulsive qui ne se terminait que par
la mort: «De là, s’écrie Juvénal, ces atteintes de
folie, de là cet obscurcissement de l’intelligence, de
là ce profond oubli de toute chose!» Juvénal parle
des philtres thessaliens, qu’une épouse criminelle
destinait à troubler la raison de son mari. Martial,
qui ne pardonne pas davantage à ces breuvages
dangereux, conseille seulement aux amants fatigués
ou refroidis l’usage des bulbes (ognons, suivant tel
commentateur; champignons, suivant tel autre;
épices, selon nous): «Que celui qui ne sait pas se
conduire en homme dans la lutte amoureuse, qu’il
mange des bulbes et il sera invincible; vieillard, si
ton ardeur languit (languet anus), ne cesse pas de
manger de ces bulbes généreuses, et la tendre Vénus
sourira encore à tes exploits!»
[182]
Qui præstare virum Cypriæ certamine nescit,
Manducet bulbos, et bene fortis erit.
Languet anus: pariter bulbos ne mandere cesset,
Et tua ridebit prælia blanda Venus.
Mais de tous les philtres amatoires que fabriquaient
les sagæ, le plus célèbre et le plus formidable
était l’hippomane, sur la mixture duquel les
savants ne sont pas même d’accord. Les écrivains
de l’antiquité n’ont pas peu contribué à laisser planer
le doute sur l’origine de l’hippomane, puisqu’ils
lui donnent deux sources totalement différentes.
Virgile, par exemple, appelle ainsi le virus âcre et
fétide, qui découle de la vulve des cavales dans le
temps du rut: «Un virus gluant distille de l’organe
des juments; c’est l’hippomane que recueillent trop
souvent les marâtres odieuses, pour le mêler à des
herbes magiques avec des conjurations.» Juvénal,
Lucain, Pline, Ovide, donnent, au contraire, le nom
d’hippomane à une excroissance de chair qui se
montre quelquefois sur le front du poulain nouveau-né,
et que la cavale arrache avec ses dents et dévore,
avant de tendre les mamelles à son nourrisson.
Cette excroissance de chair noire, grosse comme une
figue, les villageois s’empressaient de la couper et
de la garder précieusement pour la vendre aux sagæ,
qui en faisaient usage dans leurs philtres. Il est probable,
d’après ces témoignages si différents, que les
sagæ reconnaissaient deux espèces d’hippomane;
le second est représenté comme plus actif et plus
[183]
redoutable que le premier. Juvénal nous montre Cæsonia
qui, pour accroître la violence de la potion,
y fait entrer le front entier d’un poulain naissant
(cui totam tremuli frontem Cæsonia pulli infudit). Enfin,
Juvénal dépeint avec horreur les effrayants résultats
de l’hippomane, qui produisit la démence et
la mort de Caligula, le règne de Néron et les crimes
de ce règne: Tanti partus equæ! s’écrie-t-il. «Et
tout cela est le fruit d’une jument, tout cela est
l’œuvre d’une empoisonneuse!»
C’étaient de véritables empoisonneuses, ces vieilles
sans remords, ces femmes sans nom, ces hideux
débris de la Prostitution et de la débauche, qui mélangeaient
à leurs philtres, non-seulement des matières
excrétées par les animaux, le castoreum, le musc,
la civette, le sperme de cerf, le membre du loup, du
hérisson, etc., mais encore le sang menstruel des
femmes, mais encore la liqueur séminale des
hommes. Ces horribles mixtures engendraient des
maladies épouvantables, qui ne suffisaient pourtant
pas pour effrayer le libertinage, pour arrêter ses
étranges désordres. Les magiciennes émérites ajoutaient
toujours à leurs préparations érotiques certains
ingrédients empruntés à la nature humaine, la moelle
des os, le foie, les testicules, le fiel d’un enfant ou
d’un supplicié, et surtout cette pellicule mince qui
enveloppe quelquefois la tête des nouveau-nés au
sortir de la matrice. Les sages-femmes arrachaient
adroitement cette pellicule à laquelle on attribuait
[184]
tant de vertus singulières, et elles la vendaient fort
cher aux faiseuses de philtres amoureux, ou bien aux
avocats, qui croyaient devenir plus diserts en la
portant sur eux comme un talisman. On peut juger
que le commerce des sagæ était très-répandu et très-lucratif;
mais aucune de ces doctes opératrices ne
nous a laissé le livre des recettes, qui faisaient sa
réputation et sa richesse. L’art des parfums et des
cosmétiques, que les sagæ pratiquaient aussi avec
d’incroyables ressources de raffinement et d’invention,
ne nous est pas plus connu. Les poëtes et les
écrivains de tous les genres reviennent sans cesse
sur ces parfums, sur ces cosmétiques (unguenta), qui
accompagnaient partout l’une ou l’autre Vénus; mais
ils ne sortent guère des généralités vagues, et ils ne
nous initient jamais aux innombrables secrets de la
parfumerie antique, comme si ces secrets, déjà connus
du temps d’Homère, qui en fait remonter l’origine
aux dieux et aux déesses, ne se transmettaient
de génération en génération que sous la foi du serment.
Chez les Romains, la passion des parfums
étant devenue aussi ardente, aussi effrénée que la
passion des plaisirs sensuels, le métier des parfumeuses
et des unguentaires avait fait des progrès
extraordinaires, et la famille si multipliée des essences,
des huiles, des baumes, des pommades, des
poudres, des pâtes, des ingrédients cosmétiques et
aromatiques, s’était augmentée encore à l’infini,
s’augmentait tous les jours et mettait à contribution
[185]
les végétaux, les minéraux, les animaux même du
monde entier, pour combiner et créer de nouveaux
mélanges odoriférants et, en même temps, de nouvelles
jouissances au profit de la sensualité et de
l’amour.
Les anciens, les Romains surtout, ne comprenaient
pas l’amour sans parfums, et, en effet, les parfums
âcres et stimulants, dont ils se servaient à profusion
dans l’habitude de la vie, les préparaient
merveilleusement à l’amour. On sait que le musc,
la civette, l’ambre gris et les autres odeurs animales
qu’ils portaient avec eux dans leurs vêtements,
dans leur chevelure, dans toutes les parties de leur
corps, ont une action très-active sur le système nerveux
et sur les organes de la génération. Ils ne se
bornaient pas à l’emploi extérieur de ces parfums,
car, sans parler des philtres énergiques réservés pour
des circonstances particulières, ils ne craignaient
pas d’admettre les aromates et les épices en quantité
dans leur alimentation journalière. C’est sans doute
à ces causes permanentes qu’il faut attribuer l’appétit,
le prurit permanent, qui tourmentait la société
romaine et qui la jetait dans tous les excès de
l’amour physique. La luxure asiatique avait apporté
ces parfums avec elle, et depuis lors il se fit une si
prodigieuse consommation de substances aromatiques,
à Rome, qu’on put croire que l’Arabie, la
Perse et tout l’Orient n’y suffiraient pas. Vainement,
quelques philosophes, quelques hommes vertueux
[186]
et simples, des vieillards par malheur, essayèrent de
combattre cette mode, aussi dangereuse pour la
santé que pour les mœurs; vainement, leurs conseils
sages furent répétés dans des livres de morale,
même dans la poésie et jusque sur le théâtre: on ne
prit pas plus garde à leurs conseils qu’à leurs reproches
et à leurs menaçantes prédictions. Rome
fut bientôt aussi parfumée que Sybaris et Babylone.
Plus on y estimait, plus on y recherchait les parfums,
plus on méprisait les parfumeurs et les parfumeuses;
ce n’étaient que des courtisanes hors d’âge
et des entremetteuses; ce n’étaient que de vieux
cinædes et d’infâmes lénons. Les honnêtes gens,
qui avaient besoin de leurs services, n’entraient
dans leur boutique qu’en se cachant le visage, le
soir ou de grand matin. Cicéron, Horace, ne les
nomment qu’avec un profond dédain: «Ajoute encore,
si tu veux, dit le premier dans son traité
de Officiis, ajoute tes onguentaires, les sauteurs et
la misérable tourbe des joueurs d’osselets.» Horace
fait marcher de pair le lénon (auceps) et l’onguentaire,
dans la vile population du bourg toscan (tusci
turba impia vici). Quant aux parfumeuses, leur nom
seul était la plus grande injure qu’on pût adresser
à une femme qui se piquait d’être née libre (ingenua)
et citoyenne. Les officines de parfumerie
n’étaient que des entrepôts de lenocinium et des
repaires de débauche; aussi, les personnes riches
avaient-elles en leur propre maison un laboratoire,
[187]
dans lequel se fabriquaient tous les parfums dont
elles faisaient usage, et elles entretenaient un ou
plusieurs parfumeurs parmi leurs esclaves ou leurs
affranchis.
Il y avait sans doute des parfums caractéristiques
qui annonçaient de loin la condition de la personne,
son rang, ses mœurs et sa santé: telle odeur forte
et pénétrante révélait la nécessité de cacher quelque
mauvaise odeur naturelle; telle odeur suave et
douce convenait aux matrones élégantes, aux
hommes de bon goût et de vie décente; telle odeur
enivrante dénonçait la courtisane ou tout au moins
la femme coquette et légère; telle odeur énervante
et agaçante accusait le passage d’un giton; ici un
parfum, là un autre, et de toutes parts, dans les rues,
à la promenade, dans les maisons, un mélange indéfinissable
d’odeurs aromatiques qui absorbaient
l’air. En effet, chaque homme, chaque femme,
chaque enfant se parfumait au sortir du lit, après le
bain, avant le repas, et en se couchant; on se
frottait tout le corps avec des huiles parfumées, on
en versait aussi sur la chevelure, on imprégnait
d’essences les habits, on brûlait nuit et jour des
aromates, on en mangeait dans tous les mets, on en
buvait dans toutes les boissons. Le satirique Lucilius,
pour tourner en ridicule cette pharmacomanie,
feignait de s’étonner de ce que ses contemporains
qui prenaient tant de parfums n’en rendissent pas
quelque chose. «Une femme sent bon, disait Plaute
[188]
dans la Mostellaria, quand elle ne sent rien, car ces
vieilles qui se chargent de parfums, ces décrépites
édentées qui couvrent de fard les ruines de leur
beauté, dès que leur sueur s’est mêlée à ces parfums,
aussitôt elles puent davantage, comme un
cuisinier qui fait un ragoût de plusieurs sauces mélangées.»
C’était principalement dans les préludes
de la palestre de Vénus, pour nous servir de l’expression
antique (palestra venerea), que les parfums
venaient en aide à la volupté. Les deux amants se
faisaient oindre tout le corps avec des spiritueux
embaumés, après s’être lavés dans des eaux odoriférantes;
l’encens fumait dans la chambre, comme
pour un sacrifice; le lit était entouré de guirlandes
de fleurs et semé de feuilles de roses; le lit, ainsi
que tous les meubles, recevait une pluie de nard
et de cynnamome. Les ablutions d’eaux aromatisées
se renouvelaient souvent dans le cours de ces longues
heures d’amour, au milieu d’une atmosphère
plus parfumée que celle de l’Olympe.
Ces parfums, on le conçoit, avaient été inventés
par des gens qui se connaissaient en plaisir et qui
savaient les moyens de l’exciter, de le prolonger,
de le développer. Aussi, en vieillissant, les prostitués
des deux sexes s’adonnaient-ils de préférence
à ce genre de travail et de commerce. Ils continuaient
de la sorte à servir, quoique indirectement,
les goûts du public; quand ils composaient quelque
parfum, quelque cosmétique nouveau, ils étaient
[189]
fiers de lui donner leur nom. Le parfumeur Nicérotas
inventa la nicérotiane, dont Martial vante l’odeur
stupéfiante (fragras plumbea nicerotiana); Folia, la
magicienne, amie et complice de Canidie, trouva un
procédé ingénieux, pour préparer le nard de Perse,
qui fut depuis appelé foliatum. Mais ordinairement
le parfum ou le cosmétique tirait son nom du pays
qui avait fourni son principal ingrédient: on avait
le baume de Mendès, originaire d’Égypte; l’onguent
de Chypre; le nard d’Achæmenium; l’huile
d’Arabie, l’huile de Syrie, le malobathrum de Sidon,
etc. La plupart des parfums, les plus actifs du
moins, venaient de l’Orient et spécialement de la
péninsule arabique; on s’était donc accoutumé à
comprendre indistinctement tous les produits de la
parfumerie sous la désignation générique de parfum
arabe (arabicum unguentum): «Brûlons, dit Tibulle,
brûlons les parfums que nous envoie de sa riche
contrée le voluptueux Arabe!» Cependant on appliquait
plus particulièrement cette dénomination, arabus
ou arabicus, à une huile odorante dont les femmes
et les efféminés oignaient leurs longs cheveux.
On fabriquait aussi une autre huile, non moins estimée,
avec les graines de myrobolan (myrobolani),
arbuste aromatique qui croît en Arabie. On tirait
encore plusieurs espèces de parfums très-recherchés,
de l’arbre de Judée, dont la gomme odoriférante
s’appelait opobalsamum; de l’amome d’Assyrie, de
la myrrhe de l’Oronte, de la marjolaine de Chypre
[190]
(amaracus cyprinus); du cynnamome de l’Inde, etc.
Mais, comme nous l’avons dit, on ignore à peu près
les doses et les principes de ces mixtures balsamiques
qui se rapportaient généralement à quelque
besoin de la vie amoureuse.
Les cosmétiques, dont un parfum quelconque
accompagnait toujours la composition, sont encore
plus inconnus que les parfums de toilette et d’amour;
à peine si la discrétion intéressée des vendeurs et
des acheteurs a trahi les noms de quelques-uns de
ces merveilleux secrets de coquetterie conservatrice,
dissimulatrice et ornatrice. De tout temps, ces secrets-là
ont été les mieux gardés. Ainsi, on ne sait rien
de la poudre dépilatoire (dropax unguentum) avec
laquelle on faisait tomber tous les poils du corps,
même la barbe; rien de l’onguent pour les dents
(odontotrimma), destiné à les rendre blanches et
brillantes; rien du diapasmata, fabriqué en pastilles
par Cosmus, du temps de Martial, contre la mauvaise
haleine; rien du malobathrum, distillé en huile pour
les cheveux, etc. Pline indique seulement quelques
recettes, celle de l’huile de coing (melinum unguentum),
celle du megalium et du telinum, celle enfin
de l’onguent royal, que les rois parthes avaient
appliqué à l’usage de leur majesté; mais on est
assez embarrassé pour définir les propriétés et les
avantages de chacun de ces cosmétiques odoriférants.
Tous les cosmétiques cependant ne se recommandaient
pas par leur bonne odeur; par exemple,
[191]
voulait-on, jusqu’à un âge avancé, se maintenir le
ventre ferme, poli et blanc, on le frottait, non-seulement
avec de la farine de fèves, avec des feuilles
de nielle bouillies et salées, mais encore avec
de l’urine; les femmes, après leurs couches, ne
manquaient pas, dit Pline, de faire disparaître avec
des fermentations d’urine les rides et les taches qui
altéraient la pureté de leur ventre (æquor ventris).
On avait aussi une confiance absolue dans l’efficacité
du lait d’ânesse, pour blanchir la peau. On se
rappelait que Poppée prenait tous les jours un bain
de lait, que lui fournissaient cinquante ânesses qui
avaient mis bas depuis peu de jours, et qu’on renouvelait
sans cesse, afin que leur lait fût toujours
nouveau. Comme toutes les dames romaines ne pouvaient
avoir des ânesses nourricières dans leur écurie,
les parfumeurs avaient imaginé de condenser
le lait d’ânesse en onguent et de le vendre en tablettes
solides qu’on faisait fondre pour l’étendre sur
la peau: «Cependant, hideux à voir, dit Juvénal
en faisant le portrait d’une riche coquette, son visage
est ridiculement couvert d’une sorte de pâte; il
exhale l’odeur des gluants cosmétiques de Poppée,
et là viennent se coller les lèvres de son pauvre
mari. Elle se lave avec du lait, et pour se procurer
ce lait, elle mènerait à sa suite un troupeau d’ânesses,
si elle était envoyée en exil au pôle hyperboréen.
Mais cette face, sur laquelle on applique tant
de drogues différentes et qui reçoit une épaisse
[192]
croûte de farine cuite et liquide, l’appelle-t-on un
visage ou un ulcère?» Ces épigrammes, ces injures,
ces malédictions des poëtes n’empêchaient pas les
vieilles femmes de Rome de se farder, de se couvrir
de blanc et de rouge, de se teindre les cheveux, et
de retenir aussi longtemps que possible les restes de
leur beauté fugitive; elles se rattachaient donc avec
une sorte de désespoir aux dernières illusions que
l’art des cosmétiques leur offrait encore, et elles
cherchaient à s’abuser elles-mêmes sur les désastres
irréparables de l’âge. Les courtisanes à la mode, les
fameuses et les précieuses surtout, ne savaient pas
vieillir, et la vieillesse d’une femme commençait à
trente ans chez les Romains, qui ne faisaient cas
que de l’extrême jeunesse et même de l’enfance. Une
de ces prêtresses de Vénus, nommée Acco, effrayée
de la marche des années qui emportaient avec elles
la fraîcheur de son teint, l’éclat de sa chevelure,
l’émail de ses dents et les grâces de sa taille, se flatta
d’oublier sa propre métamorphose en ne se regardant
plus dans le miroir; mais un jour un amant
qu’elle fatiguait de plaintes et de reproches lui
présenta ce fatal miroir où elle vit tout à coup sa
décrépitude: à l’instant, ses cheveux achevèrent de
blanchir, sa bouche édentée demeura entr’ouverte,
et ses yeux devinrent fixes en se remplissant de
larmes: elle était folle, épouvantée de son enlaidissement;
elle mourut de s’être revue telle que la
décrépitude l’avait faite. Son nom se perpétua dans
[193]
le souvenir des mères qui, pour déshabituer leurs
enfants de s’écorcher le visage, de se tourmenter
le nez avec les doigts et de s’arracher les cils, les
menaçaient de la colère d’Acco, comme d’un épouvantail.
Les sagæ et les parfumeuses ne se bornaient pas à
faire commerce de cosmétiques et de parfums; elles
vendaient encore tous les objets et tous les ustensiles
qui pouvaient servir à la Prostitution: les fouets,
les aiguilles, les fibules et les cadenas de chasteté,
les amulettes, les phallus et une quantité d’affiquets
de libertinage, que l’antiquité, dans sa plus grande
dépravation, n’a pas osé décrire. Si les Pères de
l’Église, saint Augustin, Lactance, Tertullien, Arnobe,
etc., n’avaient pas divulgué les turpitudes
inouïes de la débauche romaine, nous hésiterions à
croire que ces raffinements monstrueux aient existé,
sans que les lois essayassent de les atteindre et de
les punir. Ainsi, ce n’était pas seulement dans les
lupanars qu’on employait le fascinum, phallus factice
en cuir, ou en linge, ou en soie, qui servait à tromper
la nature; c’était dans les chambres à coucher
des matrones que délaissaient leurs maris et qui
n’osaient pas s’exposer aux périls de l’adultère;
c’était dans les assemblées secrètes de l’amour lesbien;
c’était dans les bains publics, c’était dans le
sanctuaire du foyer domestique. Saint Paul, en
sa première épître aux Romains, atteste les progrès
que les doctrines de Sapho avaient faits à Rome,
[194]
lorsqu’il dit en parlant des indignes descendants de
Scipion et de Caton: «Dieu les a livrés aux passions
de l’ignominie; car les femmes ont changé
l’usage naturel des hommes en un usage qui est
contre nature, et semblablement les hommes, abandonnant
l’usage naturel de la femme, se sont embrasés
d’impurs désirs les uns envers les autres,
accomplissant l’infamie du mâle avec le mâle, et recevant,
comme il le fallait, en eux-mêmes le châtiment
de leur erreur.» (Propterea tradidit illos Deus
in passiones ignominiæ. Nam fœminæ eorum immutaverunt
naturalem usum in eum usum qui est contra
naturam. Similiter autem et masculi, relicto naturali
usu fœminæ, exarserunt in desideriis suis invicem,
masculi in masculos turpitudinem operantes, et mercedem
quam oportuit erroris sui in semetipsis recipientes).
Nous ferons remarquer, à l’occasion de ce
passage célèbre de l’apôtre, que cette récompense
ou plutôt ce châtiment que les coupables recevaient
en eux-mêmes ne pouvait être qu’une de ces affreuses
maladies de l’anus, qui étaient si communes
parmi les pædicones et les cinædes de Rome. Enfin,
les obscènes fascina, qui se fabriquaient et qui se
vendaient dans le quartier des parfumeurs, chez les
barbiers et chez les vieilles courtisanes, étaient
quelquefois mis en œuvre pour aiguillonner les sens
paresseux des vieillards débauchés; nous ne nous
sentons pas le courage de traduire ce texte de
Pétrone, même en le déguisant: Profert Enothea
[195]
scorteum fascinum, quod ut oleo et minuto atque urticæ
trito circumdedit semine, paulatim cœpit inserere ano
meo. Comment le libertinage avait-il pu imaginer
ce mélange irritant de poivre et de graine d’ortie
réduits en poivre et détrempés d’huile d’olive? On
peut deviner tous les accidents organiques qui devaient
résulter de cet infernal topique et qui se trouvaient
sans doute compris dans le châtiment que les
coupables recevaient en eux-mêmes, selon saint Paul.
Il est permis de supposer que les sagæ et les parfumeuses
se chargeaient aussi de certaines opérations,
également honteuses par leur nature et par
leur objet, quoiqu’on eût essayé de les faire autoriser
par la médecine et exécuter par des médecins,
la castration des femmes et l’infibulation des deux
sexes. «Quelques chirurgiens, dit Celse, sont dans
l’usage de soumettre les jeunes sujets à l’infibulation,
et cela dans l’intérêt de leur voix ou de leur santé.
Cette opération se pratique ainsi: on tire en avant
le prépuce, et, après avoir marqué d’encre les points
opposés que l’on veut percer, on laisse les téguments
revenir sur eux-mêmes. On traverse alors le prépuce,
à l’endroit désigné, avec une aiguille chargée
d’un fil dont on noue les deux bouts et qu’on fait
mouvoir chaque jour jusqu’à ce que le pourtour de
ces ouvertures soit bien cicatrisé. Ce résultat obtenu,
on remplace le fil par une boucle, et la meilleure
sera toujours la plus légère. Néanmoins cette
opération est plus souvent inutile que nécessaire.
[196]
(Sed hoc quidem sæpius inter supervacua, quam inter
necessaria est.) Celse n’ose pas s’élever davantage
contre cette détestable invention, que la jalousie la
plus scandaleuse avait fait adopter sous prétexte de
conserver la voix de ces jeunes esclaves au moment
de la puberté, et parfois pour les préserver de la
triste habitude des pollutions nocturnes. Cette
boucle (fibula), qui empêchait le patient de faire
acte de virilité, était en or ou en argent, tantôt
soudée au feu, tantôt fermée par un ressort. Ce qui
prouve la véritable destination de ces fibules, c’est
qu’on les adaptait également à l’anus, par une opération
analogue à celle que Celse a décrite. Quant à
l’infibulation des femmes, qui s’est modifiée au
moyen âge en créant les cadenas de chasteté, elle
se pratiquait à peu près de la même manière que
celle des hommes, et l’anneau ou fibule, qui tenait
à demi fermées les parties sexuelles, traversait l’extrémité
des grandes lèvres, et ne s’ouvrait qu’à l’aide
d’une clef. Rien n’était plus commun que l’infibulation
chez les esclaves du sexe masculin; mais, pour les
esclaves de l’autre sexe, on se servait de préférence
d’un vêtement particulier, nommé subligar ou subligaculum,
qui se laçait par derrière, et qui formait
une espèce d’égide protectrice pour celles qu’on
couvrait de cette ceinture de cuir ou de crin rembourré.
Une ancienne coutume exigeait que les acteurs
ne parussent pas sur la scène, par respect pour
les spectateurs, sans être revêtus de ce caleçon qui
[197]
obviait à tout accident et rassurait la pudeur des
matrones: Scenicorum mos quidem tantam habet,
lisons-nous dans le traité de Officiis, vetere disciplinâ
verecundiam, ut in scenam sine subligaculo prodeat
nemo. Une épigramme de Martial nous apprend que
les femmes honnêtes se piquaient de précaution,
en portant partout le subligar: «La rumeur publique
raconte, Chioné, que tu n’as jamais connu
d’homme, et que rien n’est plus pur que ta virginité.
Cependant tu la caches plus qu’il ne faut, quand
tu te baignes. Si tu as de la pudeur, transporte le
subligar sur ton visage!» Martial parle ailleurs
d’une ceinture de cuir noir, que les esclaves mâles
s’attachaient autour des reins, quand ils accompagnaient
aux bains leur maître ou leur maîtresse
(inguina succinctus nigrâ tibi servus alutâ stat);
mais, dans une autre épigramme, il nous montre un
esclave infibulé se baignant avec sa maîtresse: «Le
membre couvert d’une capsule d’airain, un esclave
se baigne avec toi, Cœlia. Pourquoi cela, je te prie,
puisque cet esclave n’est ni citharœde ni chanteur?
Tu ne veux pas sans doute voir sa nature? Alors
pourquoi se baigner avec tout le monde? Sommes-nous
donc tous, pour toi, des eunuques? Crains,
Cœlia, de paraître jalouse de ton esclave: ôte lui sa
fibule.»
Enfin, comme nous l’avons dit, c’était dans ces
boutiques d’impuretés et de maléfices, que s’opérait
la castration des femmes. On n’a pas de renseignements
[198]
précis sur ce genre de castration, qui avait
pour but de rendre stériles les malheureuses qu’on
mutilait. On a même regardé comme une fable cette
opération cruelle et inutile, qui fut d’abord en usage
chez les Lydiens, si l’on en croit l’historien Xanthus
de Lydie. Suivant un ancien scoliaste, l’opération
consistait dans l’enlèvement de petites glandes placées
à l’entrée du col de la matrice, glandes que les
anciens regardaient comme des testicules nécessaires
à la génération. Souvent on suppléait à la section
de ces glandes, en les comprimant avec le doigt.
Les filles qu’on soumettait à ce traitement barbare,
comme si c’étaient des poules qu’on voulût engraisser
pour la table (simili modo, dit Pierrugues,
Itali et Gallo-provinciales gallinas eunuchant), se
voyaient ainsi privées à jamais des douceurs de la
maternité, mais en revanche elles devenaient plus
aptes aux travaux de Vénus, par cela même qu’elles
ignoraient ceux de Junon. Au reste, cette espèce de
castration était peu fréquente, excepté pour les
filles qu’on destinait à la Prostitution des lupanars
et qu’on croyait mettre ainsi à l’abri des grossesses
et des avortements. Nous avons lu cependant, au
sujet de l’opération mystérieuse qu’on faisait subir
aux femmes de plaisir dès leur enfance, nous
avons lu, dans un docte rhéteur du seizième siècle,
que cette opération, pratiquée sur des sujets choisis
en raison de leur conformation particulière,
changeait complétement le sexe de la victime et
[199]
faisait saillir hors de l’organe les parties qui y sont
ordinairement enfermées, en sorte que cette femme
eunuque (eunuchata) avait l’apparence, sinon le
sexe d’un homme. La castration des hommes et des
enfants était moins compliquée et infiniment plus
répandue; elle devint même tellement abusive, que
Domitien se vit obligé de la défendre, à l’exception
de certains cas privilégiés. Ce n’étaient pas des
médecins, surtout des médecins en renom, qui exécutaient
ces hideuses mutilations, que la cupidité
et la débauche avaient tant multipliées; c’étaient
les barbiers, c’étaient les baigneurs, c’étaient plus
spécialement les sagæ et leur horrible séquelle qui
travaillaient pour le compte des marchands d’esclaves,
des lupanaires et des lénons. On avait besoin
d’une telle quantité d’eunuques à Rome pour satisfaire
aux exigences de la mode et du libertinage,
que d’infâmes lènes n’avaient pas d’autre industrie
que de voler des enfants pour en faire des castrati,
des spadones ou des thlibiæ. «Domitien, dit Martial,
ne supporta pas de telles horreurs: il empêcha que
l’impitoyable libertinage fît une race d’hommes stériles
(ne faceret steriles sæva libido viros).» Les odieux
auteurs et complices de ces crimes furent condamnés
aux mines, à l’exil et souvent à la mort.
Mais, chose étrange, la superstition resta en possession
de l’atroce privilége que l’édit impérial
refusait aux vendeurs d’esclaves et aux agents de la
débauche: les prêtres de Cybèle continuèrent non-seulement
[200]
à se mutiler eux-mêmes avec des tessons
de pot, mais encore ils exercèrent les mêmes violences
sur les malheureux enfants qui tombaient entre
leurs mains. Ces galli, la plupart vils débauchés
perdus de maladies honteuses, s’intitulaient semiviri,
et prétendaient sacrifier à leur déesse les restes
gangrenés de leur virilité absente. Quand ils n’avaient
plus rien à offrir à Cybèle, ils allaient chercher
leurs impures offrandes sur le premier venu
qui se livrait sans défiance à leur couteau. Martial a
mis en vers une aventure qui arriva de son temps
et qui témoigne de la farouche superstition des galli.
Nous empruntons cette traduction à la grande collection
des auteurs latins, publiée par M. Désiré Nisard,
professeur à l’École normale: «Tandis que Misitius
gagnait le territoire de Ravenne, sa patrie, il joignit
en chemin une troupe de ces hommes qui ne le sont
qu’à moitié, des prêtres de Cybèle. Il avait pour
compagnon de route le jeune Achillas, esclave fugitif,
d’une beauté et d’une gentillesse des plus agaçantes.
Or, nos castrats s’informent de la place qu’il
doit occuper au lit; mais, soupçonnant quelque ruse,
l’enfant répond par un mensonge. Ils le croient; chacun
va dormir, après boire. Alors la bande scélérate,
saisissant un fer, mutila le vieillard couché sur le
devant du lit, tandis que le jeune garçon, caché
dans la ruelle, était à l’abri de leurs étreintes.» Ces
abominables prêtres de Cybèle prenaient part à toutes
les infamies du bourg toscan; tous les trafics
[201]
leur étaient bons, et, toujours pris de vin, toujours
furieux, toujours obscènes, ils semblaient avoir fait
un culte de la plus sale débauche, et vouloir remplacer
la Prostitution des femmes par celle des
eunuques. C’est ainsi que Juvénal nous représente
le grand spadon (semivir) entrant chez une matrone,
à la tête d’un chœur fanatique de galles, armés de
tambours et de trompettes. Ce personnage, dont la
face vénérable s’est vouée à d’obscènes complaisances
(obscœno facies reverenda minori) et qui, dès longtemps,
a retranché avec un tesson la moitié de ses
parties génitales, porte la tiare phrygienne des
courtisanes, et se pique de rivaliser avec celles-ci,
en servant à la fois aux plaisirs des deux sexes.
Les sagæ, les magiciennes, les empoisonneuses et
tous les auxiliaires féminins de la débauche romaine
étaient moins coupables et moins odieuses que ces
prêtres hermaphrodites qui déshonoraient la religion
païenne.

Sommaire.—La débauche dans la société romaine.—Pétrone
arbiter.—Aphorisme de Trimalcion.—Le verbe vivere.—Extension
donnée à ce verbe par les délicats.—La déesse Vitula.—Vitulari
et vivere.—Journée d’un voluptueux.—Pétrone
le plus habile délicat de son époque.—Les comessations ou
festins de nuit.—Étymologie du mot comessationes.—Origine
du mot missa, messe.—Infamies qui avaient lieu dans les comessations
du palais des Césars.—Mode des comessations.—Lits
pour la table.—La courtisane grecque Cytheris.—Bacchides
et ses sœurs.—Reproches adressés à Sulpitius Gallus
au sujet de sa vie licencieuse, par Scipion l’Africain.—Le repas
de Trimalcion.—Les histrions, les bouffons et les arétalogues.—Les
baladins et les danseuses.—Danses obscènes qui avaient
lieu dans les comessations, décrites par Arnobe.—Comessations
du libertin Zoïle.—Leur description par Martial.—Épisode
du festin de Trimalcion.—Services de table et tableaux lubriques.—Ameublement
et décoration de la salle des comessations.—Santés
érotiques.—Thesaurochrysonicochrysides, mignon
du fameux bouffon de table Galba.—Présence d’esprit et cynisme
de Galba à un souper où il avait été convié avec sa
femme.—Rôles que jouaient les fleurs dans les comessations.—Dieux
et déesses qui présidaient aux comessations.—Les
lares Industrie, Bonheur et Profit.—Le verbe comissari.—Théogonie
des dieux lares de la débauche.—Conisalus, dieu
[204]
de la sueur que provoquent les luttes amoureuses.—Le dieu
Tryphallus.—Pilumnus et Picumnus, dieux gardiens des femmes
en couches.—Deverra, Deveronna et Intercidona.—Viriplaca,
déesse des raccommodements conjugaux.—Domiducus.—Suadela
et Orbana.—Genita Mana.—Postversa et Prorsa.—Cuba
Dea.—Thalassus.—Angerona.—Fauna, déesse favorite des
matrones.—Jugatinus et ses attributions obscènes.
On ne peut se faire une idée exacte et complète
de ce qu’était la débauche dans la société romaine,
si l’on détourne la vue des scènes lubriques qui sont
peintes avec une sorte de naïveté par l’auteur du
Satyricon. Pétrone a représenté fidèlement ce qui se
passait tous les jours, presque publiquement, dans
la capitale de l’empire, quoiqu’il ait placé à Naples,
pour éloigner les allusions, son roman étrange et
pittoresque, consacré à l’histoire de la volupté et de
la Prostitution sous le règne de Néron. Pétrone était
un voluptueux raffiné, excellent juge (d’où son
surnom arbiter) en fait de choses de plaisir: il raconte
en style fleuri et figuré les plus grandes turpitudes,
et l’on doit croire qu’il écrivait d’après ses
impressions et ses souvenirs personnels. Il suffirait
donc de relever tous les tableaux, tous les enseignements,
tous les mystères de libertinage qu’on
trouve accumulés dans les fragments de cette composition
érotique et sodatique, pour avoir sous les
yeux une peinture fidèle de la vie privée des jeunes
Romains. La philosophie pratique de ces infatigables
débauchés se résumait dans cette sentence
de Trimalcion: Vivamus, dum licet esse! C’est-à-dire:
[205]
«Menons joyeuse vie tant qu’il nous est
donné de vivre!» Le verbe vivere avait pris une
signification beaucoup plus large et moins spéciale,
qu’à l’époque où il s’entendait seulement du
fait matériel de l’existence, et où il ne s’appliquait
pas encore à un genre de vie plutôt qu’à un autre.
Les délicats de Rome (delicati) n’eurent pas de peine
à se persuader que ce n’était pas vivre que vivre
sans jouissances, et que jouir toujours, c’était vivre
réellement, vivere. Les femmes de mœurs faciles,
dans la compagnie desquelles ils vivaient de la
sorte, ne comprirent pas autrement ce verbe à leur
usage, que les philologues accueillaient eux-mêmes
avec sa nouvelle acception. Ce fut dans ce sens que
Varron employa vivere, quand il dit: «Hâtez-vous de
vivre, jeunes filles, vous à qui l’adolescence permet
de jouir, de manger, d’aimer et d’occuper le char
de Vénus (Venerisque tenere bigas).» Pour mieux
constater encore la belle extension du sens de vivere,
un voluptueux de l’école de Pétrone écrivit sur le
tombeau d’une compagne de plaisir: Dum vivimus
vivamus, qu’il est presque impossible de traduire:
«Tant que nous vivons, jouissons de la vie.» Au
reste, cette vie de jouissances perpétuelles était devenue
tellement générale parmi la jeunesse patricienne,
qu’on avait jugé nécessaire de lui donner
une déesse particulière pour la protéger. Cette
déesse, si l’on s’en rapporte à l’étymologie que lui
applique Festus, tira son nom Vitula, du mot vita ou
[206]
de la joyeuse vie à laquelle on la faisait présider. Vitula
n’avait sans doute pas d’autre culte que celui qu’on
lui rendait, devant l’autel des dieux domestiques,
dans le cubiculum ou dans le triclinium, où l’on avait
plus d’une occasion de l’invoquer. Grâce à la déesse,
on dit bientôt vitulari au lieu de vivere, et nous
penchons à supposer que vitulari signifiait vivre
couché à table ou dans un lit, aussi paresseusement
qu’une génisse (vitula) dans l’herbe des champs.
Les voluptueux, en effet, ne passaient pas leur vie
autrement: «Il donnait le jour au sommeil, dit Tacite
en parlant de Pétrone le type le plus célèbre de
son espèce, il donnait la nuit aux devoirs de la
société et aux plaisirs. Il se fit une réputation par
la paresse comme d’autres à force de travail. A la
différence de tous les dissipateurs qui se font un
renom de désordre et de débauche, Pétrone était
estimé le plus habile voluptueux.» On est étonné
que quelques natures énergiques et actives aient
pu mener de front les affaires, l’étude et la politique,
avec ces voluptés incessantes qui dévoraient la
vie. Quelle liberté d’esprit et d’action pouvaient
avoir des hommes qui dormaient et se baignaient
le jour, qui la nuit s’épuisaient en orgies effrayantes?
Ces festins de nuit, ces soupers, qui se prolongeaient
jusqu’au lever du soleil et qui ouvraient
carrière aux excès les plus monstrueux, s’appelaient
comessationes ou comissationes. Ce mot essentiellement
latin, qui ne dérive pas du grec κομειν,
[207]
nourrir, ni de κομη, chevelure, ni de κομιδη, nourriture,
etc., avait été formé de comes, et voulait dire
proprement un compagnonnage, une réunion d’amis
et de bons compagnons. Nous aurions honte
d’avancer ici, avec beaucoup de probabilité, que ce
mot impur, toujours pris en mauvaise part, a été la
source du mot missa, messe, parce que les premiers
chrétiens se rassemblaient la nuit, dans des lieux
secrets, pour célébrer les mystères sacrés de leur
culte, et pour s’approcher de la sainte table de la
communion. Il est certain que les comessations profanes,
qui avaient lieu pendant la nuit, et qui admettaient
tous les procédés de plaisir, toutes les
formes de jouissance, tous les essais de volupté,
méritèrent amplement l’horreur qu’elles inspiraient
aux hommes sages et aux mères de famille. Ce n’étaient
pas seulement des festins succulents et copieux
où l’on se gorgeait de viandes et de vins, où
l’on ne cessait de manger et de boire que pour tomber
ivre mort; c’étaient trop souvent d’affreux conciliabules
de débauche, des théâtres et des arènes
d’obscénité, d’abominables sanctuaires de Prostitution.
On ne saurait énumérer, sans dégoût et sans
stupeur, tout ce qui se passait pendant les longues
heures nocturnes qui voyaient la comessation se dérouler
et s’exalter au milieu des concerts d’instruments,
des chants lascifs, des danses obscènes, des
propos impudiques, des cris et des rires indécents.
Suétone, Tacite, les auteurs de l’Histoire Auguste,
[208]
mettent en scène à chaque instant les infamies qui
avaient lieu dans les comessations du palais des
Césars. Cicéron, dans son plaidoyer pour Cœlius,
range sur la même ligne les adultères et les comessations
(libidines, amores, adulteria, convivia, comessationes).
Un honnête homme pouvait s’oublier
parfois dans une orgie de ce genre, mais il ne se
vantait pas d’y avoir pris part, et il rougissait souvent
d’avoir été le spectateur, quelquefois le complice
de ces débordements.
La mode des comessations fut contemporaine de
l’invasion de la luxure asiatique à Rome, elle commença,
dès que les Romains, à l’instar des peuples
amollis de l’Orient, se couchèrent sur des coussins
et sur des lits pour prendre leur repas. Jusque-là,
tout le monde mangeait assis, et même le siége qu’on
approchait de la table n’était pas trop moelleux; les
femmes elles-mêmes s’asseyaient sur des bancs ou
des trépieds de bois. «On les appela siéges (sedes
dictæ), dit Isidore dans ses Étymologies, parce que
chez les anciens Romains l’usage n’était pas de manger
couché, mais de s’asseoir à table; mais bientôt
les hommes commencèrent à s’étendre sur des lits
devant la table; les femmes seules restaient assises,
ce qui faisait dire à Valère-Maxime: «Les mœurs austères,
la génération actuelle les conserve plus scrupuleusement
au Capitole, lors du repas sacré qui s’y
donne en l’honneur de Jupiter, que dans l’intérieur
des maisons.» Les femmes qui se permettaient
[209]
d’imiter les hommes en se couchant à table, faisaient
acte d’impudicité et témoignaient par là qu’elles ne
s’arrêtaient pas à cet oubli des convenances. Dans
le joyeux souper où Cicéron ne dédaigna pas de
prendre place à côté de la courtisane grecque Cythéris,
cette belle précieuse ne fit aucune simagrée pour
se mettre sur un lit d’ivoire, sans prétendre à la
tenue grave et décente d’une matrone qui se fût
assise et qui n’eût pas même osé s’appuyer sur le
coude. Plaute nous montre aussi d’autres courtisanes,
Bacchides et ses sœurs, occupant un seul lit
à table. Quelquefois, un même lit recevait deux convives
de sexes différents, et dans ce cas, ils étaient
placés, tantôt l’un contre l’autre, mais échelonnés,
pour ainsi dire, de manière que l’un avait la tête
appuyée sur la poitrine de l’autre; tantôt étendus
face à face, chacun dans un sens opposé, mais tous
deux si rapprochés l’un de l’autre, qu’ils auraient
pu manger dans la même assiette. On voyait ainsi
l’amant et la maîtresse, le giton et son maître, soupant
côte à côte et se disputant les morceaux jusque
sur les lèvres. Souvent aussi, la femme ou l’adolescent
était accroupi derrière l’homme qui occupait le
devant du lit, et qui avait soin que les mets et le
vin arrivassent en abondance à sa compagne mâle
ou femelle: celui ou celle qui se déshonorait en
acceptant le partage d’un lit de festin, prenait donc
place au fond ou au milieu de ce lit surchargé de
coussins moelleux, et cela se nommait accumbere interior,
[210]
c’est-à-dire se coucher dans l’intérieur du lit.
Quelques scoliastes ont pensé cependant qu’il fallait
lire inferior, et que ce mot faisait allusion à la
position inférieure que prenait la courtisane ou le
cinæde en appuyant sa tête sur le sein de son amant
(in gremio amatoris): «Celui qui tous les jours se
parfume et s’ajuste devant un miroir, dit un jour
amèrement Scipion l’Africain à Sulpitius Gallus en
lui reprochant la mollesse efféminée de ses mœurs,
celui qui se rase les sourcils, qui s’arrache les poils
de la barbe, qui s’épile les cuisses; qui, dans sa
jeunesse, vêtu d’une tunique à longues manches,
occupait dans les repas le même lit que son corrupteur;
celui qui n’aime pas seulement le vin, mais
aussi les garçons, doutera-t-on qu’un pareil homme
n’ait fait tout ce que les cinædes ont l’habitude de
faire?» Aulu-Gelle, qui rapporte ces paroles de
Scipion l’Africain, nous apprend que la tunique à
la syrienne, chiridota, dont les manches couvraient
tout le bras et tombaient sur la main jusqu’au bout
des doigts, était le vêtement ordinaire des efféminés
dans les comessations, où ils abdiquaient absolument
tous les caractères de leur sexe.
Il faut lire dans Pétrone la description du repas
de Trimalcion, pour se représenter les épisodes multipliés
d’une orgie qui durait une nuit entière. On
ne mangeait pas, on ne buvait pas sans interruption;
il y avait des intermèdes de plusieurs sortes: d’abord,
les conversations provocantes, obscènes ou voluptueuses;
[211]
puis, la musique, le chant, la danse et les
divertissements de toute espèce; après ou même
pendant ces intermèdes, tous les désordres que l’ivresse
ou la luxure pouvait inventer. On était bientôt
las des histrions (mimi), qui jouaient des pantomimes
ou qui récitaient des vers; des bouffons et
des aretalogues (aretalogi), qui dissertaient sur des
sujets comiques; on n’écoutait plus qu’avec distraction,
et les yeux, obscurcis par les fumées de Bacchus,
commençaient à se fermer. Mais tout à coup
les baladins et les danseuses venaient ranimer l’attention
des convives fatigués, en éveillant leurs sens.
Ces danseuses, la plupart venues d’Asie ou d’Égypte,
n’étaient autres que ces almées qui ont conservé
dans l’Inde la tradition de l’antique volupté;
elles se présentaient nues, sinon couvertes de voiles
dorés ou argentés, qui entouraient leur nudité
comme d’un voile diaphane; c’est ce que Pétrone
appelait se vêtir d’air tissu (induere ventum textilem)
et se montrer nue sous des nuages de lin (prostare
nudam in nebula linea). Les baladins n’étaient pas
vêtus plus décemment et ils étalaient leurs membres
nus, frottés d’huile odorante, tout chargés d’anneaux
et de grelots dorés. Ces baladins représentaient des
pantomimes, faisaient des sauts périlleux, des grimaces
et des tours de force extraordinaires; ils n’oubliaient
jamais, dans leurs poses, de faire saillir
toutes les formes, tous les muscles de leur corps;
ils accompagnaient leurs mouvements, des gestes les
[212]
plus indécents; ils donnaient à leur bouche une
expression obscène qu’ils complétaient par le jeu
rapide de leurs doigts (micatio digitum) à la manière
des Étrusques; ils échangeaient ainsi des signes
muets, qui avaient toujours quelque rapport plus ou
moins direct avec l’acte honteux (turpitudo), et quelquefois
enflammés de luxure, excités par les applaudissements
des convives, ils passaient des gestes
aux faits et se livraient d’impurs combats, en imitant
les turpitudes des faunes, qu’on voit sur les
vases peints de l’Étrurie. Quant aux danseuses,
elles exécutaient des danses qu’un Père de l’Église
chrétienne, Arnobe, a décrites dans son livre
contre les Gentils: «Une troupe lubrique formait
des danses dissolues, sautait en désordre et chantait,
tournait en dansant, et à certaine mesure, soulevant
les cuisses et les reins, donnait à ses nates et à ses
lombes un mouvement de rotation qui aurait embrasé
le plus froid spectateur.» Le jésuite Boulenger
ne craint pas de dire que ce tressaillement obscène
et ces ondulations des reins communiquaient à tous
les convives une amoureuse démangeaison (modo
nudæ, et fluctuantibus lumbis obsceno motu, pruriginem
spectantibus conciliabant).
Martial nous a laissé une esquisse des comessations
d’un libertin qu’il nomme Zoïle: cette esquisse, quoique
bien affaiblie dans la traduction classique, qui a
été publiée récemment par les soins de M. D. Nisard,
est encore plus latine que toutes les descriptions
[213]
dont nous pourrions charger un tableau de fantaisie:
«Quiconque peut être le convive de Zoïle peut souper
aussi avec les mérétrices du Summœnium et
boire de sang-froid dans le bidet ébréché de Léda.
Je prétends même qu’il serait chez elles plus proprement
et plus décemment. Vêtu d’une robe verte, il
est étendu sur le lit dont il s’est emparé le premier:
il foule des coussins de soie écarlate, et pousse, à
droite et à gauche, avec les coudes, ses voisins de
table. Dès qu’il est repu, un de ses gitons, averti par
ses hoquets, lui présente des coquillages roses et des
cure-dents de lentisque. S’il a chaud, une concubine,
couchée nonchalamment sur le dos, le rafraîchit
doucement à l’aide d’un éventail vert, tandis
qu’un jeune esclave chasse les mouches avec une
branche de myrte. Une masseuse (tractatrix) lui
passe avec rapidité la main sur le corps et palpe
avec art chacun de ses membres. Quand il fait claquer
ses doigts, un eunuque, qui connaît ce signal et
qui sait solliciter avec adresse l’émission des urines,
dirige la mentule ivre de son maître, qui ne cesse de
boire (domini bibentis ebrium regit penem). Cependant
celui-ci, se penchant vers la troupe des esclaves
rangés à ses pieds, parmi de petites chiennes qui
lèchent des entrailles d’oie, partage entre ses valets
de palestre des rognons de sanglier, et donne des
croupions de tourterelles à son camarade de lit (concubino).
Et tandis qu’on nous sert du vin des coteaux
de Ligurie ou du mont enfumé de Marseille, il distribue
[214]
à ses bouffons le nectar d’Opimius dans des
fioles de cristal et dans des vases murrhins. Lui-même,
tout parfumé des essences de Cosmus, il ne
rougit pas de nous partager dans une coquille d’or
la pommade dont se servent les dernières prostituées.
Succombant enfin à ses libations multipliées, il s’endort.
Quant à nous, nous restons couchés sur nos
lits, et, silencieux par ordre, tandis qu’il ronfle, nous
nous portons des santés par signes.» Pétrone, dans
son festin de Trimalcion, nous montre un autre coin
du sujet, les désordres des femmes entre elles dans les
comessations: «Fortunata, femme de Trimalcion,
arriva donc, la robe retroussée par une ceinture
verte de manière à laisser voir en dessous sa tunique
cerise, ses jarretières en torsades d’or et ses
mules dorées. S’essuyant les mains au mouchoir
qu’elle portait au cou, elle se campe sur le lit de la
femme d’Habinnas, Scintilla, qui bat des mains et
qu’elle embrasse..... Ces deux femmes ne font que
rire et confondre leurs baisers avinés, et Scintilla
proclame son amie la ménagère par excellence, et
l’autre se plaint des mignons et de l’insouciance
maritale. Tandis qu’elles s’étreignent de la sorte,
Habinnas se lève en tapinois, saisit Fortunata par
les pieds, qu’elle tient étendus, et la culbute sur le
lit (pedesque Fortunatæ porrectos super lectum immisit).
Ah! ah! s’écrie-t-elle en sentant sa tunique
glisser sur ses genoux; et se rajustant au plus vite,
[215]
elle cache dans le sein de Scintilla un visage que
la rougeur rend plus indécent encore.»
Les comessations empruntaient, d’ailleurs, les caractères
les plus variés à l’imagination du prodigue
débauché qui donnait la fête et elles reflétaient plus
ou moins les goûts et les habitudes du maître du
logis. Mais elles avaient toujours pour objet principal
d’exciter au plus haut degré les sens des convives
et de les entraîner à d’incroyables excès. Ainsi,
quelquefois tout le service de table était une provocation
effrontée à l’acte de nature, et de quelque côté
que les yeux se fixassent, ils ne rencontraient que
des images voluptueuses ou obscènes. Les murailles
étaient couvertes de peintures, dans lesquelles l’artiste
avait reproduit sans voile toutes les inventions
du génie vénérien: «Le premier, dont la main
peignit des tableaux obscènes, s’écrie le tendre Properce,
et celui qui suspendit ces honteuses images
dans une maison honnête, celui-là corrompit l’innocence
des regards de la jeunesse et ne voulut pas
qu’elle restât novice aux désordres qu’il lui apprenait
ainsi: qu’il gémisse à jamais de son art, le
peintre qui reproduisit aux yeux ces luttes amoureuses
dont le mystère fait tout le plaisir!» Ces
peintures évoquaient de préférence les scènes les
plus monstrueuses de la mythologie; Pasiphaé et le
taureau, Léda et le cygne, Ganymède et l’aigle, Glaucus
et les cavales, Danaé et la pluie d’or. Dans ces
sujets consacrés, l’artiste avait cherché à traduire,
[216]
sous des noms de dieux et de déesses, les grossières
et matérielles sensations que les poëtes de l’amour
s’étaient plu à décrire: c’était ordinairement le poëme
infâme d’Éléphantis, qui fournissait les postures et
les couleurs à ces épisodes mythologiques. L’ameublement
de la salle et sa décoration se trouvaient souvent
d’accord avec les peintures: des danses de satyres,
des bacchanales, des bergeries érotiques couraient
en bas-relief autour des corniches; des statues de bronze
et de marbre mettaient encore aux prises les satyres
avec des nymphes, ces victimes éternelles de l’incontinence
des demi-dieux bocagers; les lits, les
tables, les siéges avaient des pieds de bouc et des
têtes de bouc pour ornements, comme par allusion
au fameux vers des bucoliques de Virgile: tuentibus
hircis. Les lampes suspendues au plafond, les candélabres
placés sur la table du souper, rappelaient par
quelque forme ithyphallique, souvent plaisante et ingénieuse,
le but principal de la réunion. Ici, c’est un
Amour chevauchant (equitans) sur un phallus énorme
pourvu d’ailes ou de pattes; là, ce sont des oiseaux,
des tourterelles becquetant un priape; ailleurs, une
guirlande formée avec les attributs du dieu de la
génération; ailleurs, des animaux, des plantes, des
insectes, des papillons, qui participent à cette forme
hiératique. Quant aux coupes, aux amphores,
aux ustensiles de table, qu’ils soient en verre, en
terre cuite ou en métal, ils ont pris, pour ainsi dire,
la livrée générale et ils se rapprochent de près ou
[217]
de loin, par leur configuration, de l’emblème indécent
qui préside à la comessation. Voilà pourquoi
Juvénal nous montre un comissator buvant dans un
priape de verre (vitreo bibit ille priapo). C’est là ce
que Pline appelle gravement: boire en commettant
des obscénités, bibere per obscenitates. Le pain qu’on
mangeait dans ces repas libidineux n’avait garde
d’adopter une figure plus honnête que celle des
vases à boire: les coliphia et les cunni siliginei, en
pure farine de froment, se succédaient sous la dent
des convives, qui n’avaient bientôt plus une pensée
étrangère au dieu de la fête: «Vous savez, aurait
pu leur dire l’hôte de la comessation en se servant
des propres paroles de la Quartilla de Pétrone, vous
savez que la nuit tout entière appartient au culte
de Priape.» (Sciatis Priapi genio pervigilium deberi.)
On comprenait dans ce culte les santés érotiques
que chacun portait à son tour durant ces interminables
orgies. On buvait presque toujours à l’heureux
succès des amours et aux grands exploits des amants.
On vidait autant de coupes qu’il y avait de lettres
dans le nom de la personne aimée. Martial parle de
cet usage général, dans une de ses plus jolies épigrammes:
«Buvons cinq coupes à Névia, sept à
Justine, cinq à Lycas, quatre à Lydé, trois à Ida;
sablons le falerne autant de fois qu’il y a de lettres
dans le nom de chacune de ces dames. Mais, puisque
aucune d’elles ne vient, Sommeil, viens à moi.»
Un bouffon de table, le fameux Galba, qui se chargeait
[218]
d’égayer tous les soupers auxquels on l’invitait,
proposa une santé à son mignon, dont le nom, disait-il,
avait de quoi enivrer tous les dieux de l’Olympe;
en effet, il eût fallu boire vingt-sept fois de suite,
car il avait donné à cet esclave favori le nom célèbre
forgé par Plaute pour caractériser un avare: Thesaurochrysonicochrysides.
On ne pourrait dire si ce
fut dans le même souper, que Galba fit preuve d’une
présence d’esprit et d’un cynisme remarquables. Il
avait été convié avec sa femme, qui était fort belle
et de mœurs très-complaisantes. Le maître de la
maison avait fait placer la dame auprès de lui, et
sur la fin du repas, quand tous les convives se furent
endormis sous les lourds pavots de Bacchus, il se
rapprocha de cette dormeuse et fit tout ce qui était
nécessaire pour l’éveiller. Elle ne s’éveilla pourtant
pas et se livra sans résistance. Scurra ne dormait
pas davantage, quoiqu’il fît semblant, et il laissait
le champ libre à son Mécène, lorsqu’un esclave, se
fiant à ce sommeil simulé, se glissa près du lit de
Galba et se mit à boire dans son verre: «Je ne dors
pas pour tout le monde!» s’écrie le bouffon en arrachant
l’oreille du fripon. Dans ces orgies nocturnes
tout servait de prétexte à de nouvelles santés et à de
nouveaux coups de vin, qui étaient souvent les échos
ou les présages des combats amoureux du lendemain
ou de la veille. On comptait aussi le nombre
de ces combats par les couronnes de fleurs qu’on
déposait devant une statuette d’Hercule, de Priape
[219]
ou de Vénus. Les couronnes de fleurs jouaient un
grand rôle dans toutes les circonstances où l’ivresse
du vin et des sens avait besoin à la fois d’un aiguillon
et d’un préservatif: l’odeur des fleurs tempérait
les fumées du jus de la vigne, et, en même temps,
elle exaltait les inspirations du plaisir. Pline assure
que les grands buveurs, en se couronnant de fleurs
odorantes, se délivraient des éblouissements et des
pesanteurs de tête. Il n’y avait donc pas d’orgie
sans couronnes sur les têtes, sans fleurs jonchant la
table et le plancher. On jugeait à la beauté et à
l’abondance des couronnes la libéralité et le bon
goût du comissator. Le lendemain d’un souper, les
courtisanes et les enfants meritorii, qui y avaient
assisté, envoyaient leurs couronnes flétries et brisées
à leurs lénons, pour témoigner qu’ils avaient bien
fait leur devoir (in signum paratæ Veneris, dit un
vieux commentateur d’Apulée).
Enfin, ces comessations et les actes honteux
qu’elles favorisaient, se plaçaient, néanmoins, sous les
auspices de certains dieux, de certaines déesses, qui
avaient été détournés, pour cet objet, de leurs attributions
décentes, ou qui étaient nés en pleine orgie
d’une débauche d’imagination religieuse. Au festin
de Trimalcion, deux esclaves, vêtus de tuniques blanches,
entrent dans la salle et posent sur la table les
lares du logis, tandis qu’un troisième esclave, tenant
une patère de vin, fait le tour de la table en criant:
Soyez nos dieux propices. Ces lares se nomment
[220]
Industrie, Bonheur et Profit. Mais Pétrone passe sous
silence les véritables divinités qui présidaient à ces
repas nocturnes et qui y prenaient part à différents
titres. C’était d’abord, et avant tous, Comus, qui
retrouvait en partie son nom dans ces comessations
joyeuses, préparées et célébrées sous ses auspices:
il était représenté jeune, la face enluminée, le front
couronné de roses. Son nom avait été formé du mot
comes, compagnon, qui eut naturellement son verbe
comissari, faire bonne chère entre compagnons. La
jeunesse libertine, qui s’en allait, la nuit, avec des
torches et des haches briser les portes et les fenêtres
des courtisanes, invoquait Comus et se vantait de
s’enrôler sous ses étendards bachiques; mais cette
milice turbulente, que l’édile condamnait à l’amende
et même au fouet, ne trouvait pas d’excuse dans
la mauvaise réputation du dieu qu’elle avait pris
pour chef. Vénus, Hercule, Priape, Isis, Hébé et
Cupidon étaient aussi les dieux tutélaires des comessations.
Cupidon, qui différait de l’Amour, fils de
Vénus et de Mars; Cupidon, que saint Augustin
déifie avec le titre de Deus copulationis, était fils du
Chaos et de la Terre, selon Hésiode; de Vénus et du
Ciel, selon Sapho; de la Nuit et de l’Éther, suivant
Archésilaüs; de la Discorde et du Zéphire, selon
Alcée; il régnait surtout à la fin des soupers. Hébé,
qui versait le nectar et l’immortalité aux convives
de l’Olympe, devait avoir quelque indulgence pour
les mortels réunis à table. Isis, que les impies avaient
[221]
surnommée la déesse (præfecta) tutélaire des mérétrices
et des lénons, passait pour la meilleure conseillère
des deux amours. Vénus, Priape et Hercule
aidaient Isis dans la protection qu’elle octroyait aux
amants. C’était Vénus Volupia, Pandemos et Lubentia;
c’était Hercule Bibax, Buphagus, Pamphagus,
Rusticus; c’était Priape, le dieu de Lampsaque,
Pantheus, l’âme de l’univers.
A côté de ces grands dieux qui avaient place dans
le Panthéon du paganisme et qui ne présidaient aux
festins que par complaisance, il y avait un cortége
de petits dieux obscurs, qui n’avaient pas de temple
au soleil et qui n’eussent pas osé figurer ailleurs que
sur l’autel des lares du logis. Ces dieux-là ne devaient
souvent leur existence fugitive qu’à une boutade
d’ivrogne, à une fantaisie d’amant. Quant à
leur figure, elle était ce que pouvait la faire le bon
plaisir du fabricant, qui puisait dans ses propres
idées la physionomie et les attributs de ces petites
divinités, la plupart grotesques, ridicules et hideuses.
Il faudrait d’immenses recherches archéologiques
pour recomposer la théogonie des dieux lares
de la débauche. Le premier qui s’offre à nous, c’est
Conisalus d’origine athénienne, diminutif de Priape,
et présidant à la sueur (Κονισαλος) que provoquent
les luttes amoureuses. On le représentait sous la
forme d’un phallus monté sur des pieds de bouc et
ayant une tête de faune cornu. Le dieu Tryphallus,
à qui l’on s’adressait dans les entreprises difficiles,
[222]
n’était qu’un petit bout d’homme qui portait un
penis aussi haut que son bonnet, et qui avait l’air
de le tenir comme un épieu. Pilumnus et Picumnus,
dieux gardiens des femmes en couches, étaient
également armés par la nature. Le premier, dont le
nom dérivait de pilum, pilon, suivant saint Augustin,
personnifiait une obscénité; Picumnus, frère du
précédent, avait le nom et la figure d’un pivert,
oiseau à long bec qui creuse les troncs d’arbre pour
y cacher son nid. Trois déesses infimes: Deverra,
Deveronna et Intercidona, auxquelles se recommandaient
aussi les femmes enceintes, n’étaient pas indifférentes
dans les mystères de l’amour: Intercidona
tenait une cognée; Deverra, des verges;
Deveronna, un balai. Viriplaca, déesse des raccommodements
conjugaux, avait paru assez utile aux
Romains pour qu’on lui accordât les honneurs d’une
chapelle à Rome; mais elle était adorée surtout dans
l’intérieur du ménage, et c’était devant sa statue
que se terminaient les querelles d’époux et d’amants,
sans qu’ils eussent besoin d’aller sur le mont Palatin
chercher la protection de cette conciliante déesse:
on ignore entièrement quelle était sa figure allégorique.
Le dieu Domiducus, qui accompagnait les
épouses à la demeure de leurs époux, rendait le
même service aux maîtresses et aux mignons. On
croit qu’il faut reconnaître ce dieu complaisant dans
une petite statuette de bronze, qui représente un
villageois vêtu d’une cape à cuculle, sous laquelle
[223]
sa tête est entièrement cachée; cette cape mobile se
lève et laisse voir un priape à jambes humaines. La
déesse Suadela, dont la mission était de persuader;
la déesse Orbana, qui avait les orphelins sous sa
garde; la déesse Genita-Mana, qui devait empêcher
que les enfants naquissent difformes et contrefaits;
les déesses Postversa et Prorsa, qui veillaient à la
position du fœtus dans le ventre de sa mère; la
déesse Cuba-Dea, qui s’intéressait à quiconque était
couché; le dieu Thalassus ou Thalassio, qui avait
dans son domaine le lit et tout ce qu’il comprenait;
une foule d’autres dieux et déesses recevaient des
offrandes et des invocations, lorsque les voluptueux
croyaient avoir besoin de leur aide. Angerona, placée
à côté de Vénus-Volupia, ordonnait le silence
en mettant le doigt dans sa bouche; et Fauna, la
déesse favorite des matrones, était là pour couvrir
d’un voile discret tout ce qui devait n’être pas vu
par des profanes. Enfin, s’il y avait union des deux
sexes et accomplissement des lois naturelles, on versait
du vin sur la face obscène du dieu Jugatinus:
«Quum mas et fœmina conjunguntur, dit Flavius
Blondus dans son livre de Rome triomphante, adhibetur
deus Jugatinus.» Saint Augustin, dans sa Cité
de Dieu, restreint les attributions de Jugatinus à l’assistance
des époux dans l’œuvre du mariage.

Sommaire.—Le peuple romain, le plus superstitieux de tous les
peuples.—Les libertins et les courtisanes, les plus superstitieux
des Romains.—Clédonistique de l’amour et du libertinage.—Fâcheux
présages.—Pourquoi les paroles obscènes étaient
bannies même des réunions de débauchés et de prostituées.—L’urinal
ou pot de chambre.—Périphrase décente que les
Romains employaient pour le désigner.—Signe adopté pour
demander l’urinal dans les comessations.—Présages que les
Romains tiraient du son que rendait l’urine en tombant dans
l’urinal.—Matula, matella et scaphium, usage respectif de
chacun de ces vases urinatoires.—Double sens obscène du mot
pot de chambre.—Étymologie de matula.—Périphrases honnêtes
employées par Sénèque pour désigner l’urine.—Sens
figuré et obscène que prenait le mot urina.—Présages urinatoires
dans les comessations.—Hercule Urinator.—Présages
des ructations.—Rots de bon et de mauvais augure.—Crepitus,
dieu des vents malhonnêtes.—Esclave chargé d’interpréter
les rots des convives.—Le petit dieu Pet.—Son origine
égyptienne.—Honneurs décernés par les Romains au dieu Pet
sous le nom de dieu Ridicule.—Présages tirés du son du pet.—Origine
de la qualification de vesses, donnée aux filles dans le
langage populaire.—Présages tirés de la sternutation.—L’oiseau
de Jupiter Conservateur.—Le démon de Socrate.—Jupiter
et Cybèle, dieux des éternuments.—Heureux pronostics
[226]
attribués aux éternuments dans les affaires d’amour.—Acmé
et Septimius.—Les tintements d’oreilles et les tressaillements
subits, regardés comme présages malheureux.—La droite et la
gauche du corps.—Présages résultant de l’inspection des parties
honteuses.—Présages tirés des bruits extérieurs.—Le craquement
du lit.—Lectus adversus et lectus genialis.—Le Génie
cubiculaire.—Le pétillement de lampe.—Habileté des courtisanes
à expliquer les présages.—Présages divers.—Le coup
de Vénus.—Présages heureux ou malheureux, propres aux mérétrices.—L’empereur
Proculus et les cent vierges Sarmates.—Rencontre
d’un chien.—Rencontre d’un chat.—Superstitions
singulières du peuple de Vénus.—Jeûnes et abstinence
de plaisir que s’imposaient les matrones en l’honneur des solennités
religieuses.—Privations du même genre que s’imposaient
les débauchés et les courtisanes.—Vœu à Vénus.—Moyen
superstitieux employé par les Romains pour constater la virginité
des filles.—Offrande à la Fortune Virginale des bouts de fil qui
avaient servi dans cette occasion.—Offrande des linges maculés
et des noix.—La noix, allégorie du mariage.
Le peuple romain était le plus superstitieux de
tous les peuples, et, chez lui, les plus superstitieux
furent les hommes et les femmes qui, par goût,
par habitude ou par profession, s’amollissaient le
corps et l’âme dans les arts de la débauche (stupri
artes) et dans tous les égarements des mœurs. On
comprend que la crainte des dieux et la préoccupation
de l’avenir troublaient, au milieu de leurs orgies,
ces libertins, dont la conscience ne s’éveillait
que de loin en loin et comme par hasard; on comprend
que ces êtres mercenaires, qui trafiquaient
honteusement d’eux-mêmes, et qui attendaient de
cet horrible trafic un lucre quotidien, s’inquiétaient
de savoir si le jour ou la nuit leur serait propice,
[227]
et si le sort leur enverrait quelque chance favorable.
Quant aux amants, ils avaient sans cesse à prévoir
dans le vaste champ de leurs soucis et de leurs
espérances; ils se forgeaient mille chimères, et ils
avaient besoin, à tout moment, de se créer une
sécurité ou bien une anxiété, également factices,
pour donner satisfaction à la pensée dominante qui
les tourmentait. De là, cette continuelle observation
des présages, cette constante recherche des moyens
de connaître et de diriger la destinée, cette passion
fanatique pour toutes les sciences occultes et ténébreuses.
Ce qu’on peut nommer le monde de l’amour,
à Rome, n’avait qu’une religion, la superstition la
plus crédule et la plus active; mais cette superstition,
dans ce monde de jouissances sensuelles et de
désordres sans nom, offrait des caractères bien différents
de ceux de la superstition générale, qui ne
rapportait pas à l’amour et au libertinage les auspices,
les horoscopes, les sorts et les maléfices. Tous
les Romains, depuis les enfants jusqu’aux vieillards,
les femmes ainsi que les hommes, les plus sages
comme les plus simples, étaient également sensibles
aux présages, et subordonnaient à ces présages,
bons ou mauvais, les moindres actions de leur vie.
Les personnes qui faisaient de la volupté leur plus
grande affaire, avaient encore plus de susceptibilité
vis-à-vis de ces prétendus avertissements de la destinée.
La connaissance et l’appréciation des présages
formaient un art véritable, qui avait ses règles
[228]
et ses principes; on le nommait clédonistique (cledonistica),
et, dans cette science, pleine de nuances
imperceptibles, le chapitre des amours était plus
long et plus détaillé que tous les autres.
C’était fâcheux présage que de prononcer ou d’entendre
des paroles obscènes; voilà pourquoi ces
paroles étaient bannies même des réunions de débauchés
et de prostituées, suivant un proverbe, qu’on
retrouverait dans tous les temps et chez tous les
peuples: «Faire est bon, dire est mauvais.» On
n’avait donc garde d’être scrupuleux sur les actes;
mais on évitait avec soin de les exprimer en paroles;
on ne les qualifiait pas, on ne les nommait
pas. Plaute dit, dans sa comédie de la Servante
(Casina): «Proférer des discours obscènes, c’est
porter malheur à celui qui les écoute.» (Obscenare,
omen alicui vituperare). Lucius Accius avait dit
aussi, dans sa tragédie d’Œnomaüs: «Allez sur le
champ et publiez par la ville, avec le plus grand
soin, que tous les citoyens qui habitent la citadelle,
pour appeler la faveur des dieux par d’heureux
présages, aient à écarter de leur bouche toute parole
obscène (ore obscena segregent).» Il est donc
bien certain que les plus viles pierreuses, que les
plus infâmes mascarpiones, que les plus effrontés
libertins s’abstenaient des obscénités orales; mais
ils se dédommageaient par les gestes qui avaient à
Rome tant d’éloquence, et qui composaient un si
riche vocabulaire muet. On avait une telle horreur
[229]
des mots obscènes, des expressions de mauvais augure,
qu’on ne prononçait jamais le mot urinal ou
pot de chambre (vas urinarium), et que les médecins
eux-mêmes employaient une périphrase décente pour
parler de l’urine (urina), qui ose pourtant se glisser
dans les épigrammes de Martial. Dans les comessations
où le vase urinaire jouait un rôle obligé, les
convives, qui s’en servaient à table et sous les yeux
de tous, le demandaient à l’esclave par un claquement
de doigts (digiti crepitantis signa). Quelquefois,
on faisait craquer un doigt, dans son articulation,
en le tirant avec intelligence, quand on ne voulait
pas attirer l’attention des voisins, et que l’esclave
pouvait voir ce signe, qui ne produisait qu’un très-léger
bruit. Puis, en satisfaisant ce besoin naturel
(urinam solvere, dit Pline), on prenait garde de
donner un présage par le bruit de l’urine frappant
les parois du vase: ce présage, suivant le son,
qu’elle rendait en tombant, pouvait être interprété
de diverses manières. Juvénal nous représente avec
mépris un riche gourmand qui se réjouit d’entendre
résonner le vase d’or sous le jet de son urine. Ce
vase, que Plaute se permet de nommer souvent
dans ses comédies pour faire rire la populace romaine,
se nommait matula, matella et scaphium. Ce
dernier était surtout destiné aux femmes, qui le
cachaient aux yeux de leurs maris et de leurs
amants: on n’est pas d’accord sur la forme du
scaphium, qui fut sans doute souvent obscène et
[230]
ithyphallique. Quant à la matula, c’était un énorme
bassin de métal, sur l’orifice duquel on pouvait
s’asseoir et qui tenait lieu de garde-robe. La matella,
au contraire, ne servait qu’à des usages portatifs,
et n’offrait qu’une médiocre capacité, qu’un
bon buveur (compotator) remplissait plusieurs fois
dans le cours d’un souper. Les lexicographes ne
font pas de distinction entre ces trois sortes de
vases, lorsqu’ils disent pour toute définition: «Le
vase dans lequel nous nous soulageons la vessie,
s’appelle tantôt matella et tantôt scaphium.» Le nom
de ce vase s’employait au figuré, avec un sens
obscène qui, chose remarquable, a passé dans toutes
les langues modernes. Plaute avait accusé très-nettement
cette image impure, quand il dit dans sa
Mostellaria: «Par Hercule! si tu ne me donnes pas
le pot, je me servirai de toi (tam Hercle! ego vos pro
matula habebo, nisi matulam datis).» Perse, par une
autre allusion, emploie aussi au figuré le mot matula
dans le sens de stupide, parce que le pot de chambre
reçoit tout et se plaint à peine: Numquam ego tam
esse matulam credidi («Je n’ai jamais cru que je
fusse aussi pot de chambre!» pour traduire littéralement
avec l’esprit de notre langue). Pour ce qui est
de l’étymologie de matula, il faudrait sans doute la
chercher dans mentula. L’urine, que Sénèque désigne
par des périphrases honnêtes (aqua immunda,
humor obscenus), était aussi matière à présages,
selon qu’elle jaillissait roide, sans intermittence, par
[231]
filets, par saccades ou par nappes. Une évacuation
abondante et facile de ce liquide obscène, avant un
sacrifice à Vénus, annonçait l’heureux accomplissement
de ce sacrifice, dans lequel le mot urina prenait
un nouveau sens figuré et plus obscène encore.
Juvénal est bien près de lui donner ce sens, lorsqu’il
dit qu’à la vue des danses lascives de l’Espagne,
la volupté s’insinue par les yeux et les oreilles, et
met en ébullition l’urine que renferme la vessie:
Et mox auribus atque oculis concepta urina movetur.
Ces présages urinatoires se produisaient surtout
dans les comessations, où retentissait à chaque instant
le claquement d’un doigt impatient, et où l’on
apportait parfois sur la table une statuette d’Hercule
urinator, pour détendre les reins et calmer la vessie
des convives. On n’attachait pas moins d’importance
aux présages des ructations, que nous nommons des
rots dans la langue triviale où cette incongruité a
été reléguée. Les Romains, les gros mangeurs surtout
ne pensaient pas comme nous là-dessus. Il y
avait des rots de bon augure, que tous les convives
applaudissaient; il y en avait aussi qui suffisaient
pour assombrir et déranger un repas. Nous serions
en peine aujourd’hui de définir quels étaient les rots
de bon et de mauvais présage; mais, dans aucun
cas, le ructus ne passait pas pour un manque de
savoir-vivre. On n’imposait nulle contrainte à ces
bruyantes et désagréables explosions d’un orage de
l’estomac, puisqu’on avait divinisé, sous le nom de
[232]
crepitus, ces vapeurs, ces vents intérieurs, qui s’échappaient
avec éclat par la bouche ou par le fondement.
Cicéron, dans ses Lettres familières, ne rougit
pas de vanter la sagesse des stoïciens qui prétendaient
que les plaintes du ventre et de l’estomac ne
doivent pas être comprimées (stoici crepitus aiunt
æque liberos ac ructus esse oportere). Les anciens
avaient, à cet égard, des idées bien différentes des
nôtres. Ils jugeaient en bien ou en mal les bruits
des rots, et ils en tiraient des augures, avec une imperturbable
gravité. Il fallait être Romain pour ne
pas s’enfuir à ce vers d’une comédie de Plaute:
Quid lubet? Pergin’ ructare in os mihi? «Plaît-il? Continueras-tu
à me roter dans la bouche!» L’interlocuteur
répond à cette vilenie: «Roter me semble très-doux,
ainsi et toujours.» (Suavis ructus mihi est,
sic et sine modo.) Dans les repas de nuit, les convives
chargés de nourriture et de boisson, se renvoyaient
de l’un à l’autre les rots, et un esclave se trouvait là
exprès pour en noter les présages. Chaque ructator
savait à point nommé si les destins lui étaient favorables,
et s’il n’aurait pas quelques contrariétés dans
ses affaires d’amour: «Il y a là sans cesse un complaisant
prêt à crier merveille, dit Juvénal, si l’amphitryon
a bien roté (si bene ructavit), s’il a pissé
droit (si rectum minxit), si le bassin d’or a résonné
en recevant son offrande.»
On attachait bien d’autres présages, généralement
propices, à l’émission des flatus qui se révélaient à
[233]
l’ouïe ou à l’odorat; non-seulement on était plein
d’indulgence réciproque pour ces accidents que le
bruit ou l’odeur trahissait d’ordinaire, mais encore
on s’applaudissait mutuellement de n’avoir pas mis
d’obstacle aux volontés de la nature et de ce dieu
omnipotent qu’on appelait Gaster. Chaque fois qu’un
crepitus se faisait entendre, les assistants se tournaient
vers le midi ou l’auster, patrie des vents,
gonflaient leurs joues et faisaient mine de souffler en
serrant les lèvres comme un Zéphyr. Ce n’était que
dans les assemblées sérieuses ou religieuses, que l’on
devait imposer silence à son derrière et tenir closes
les outres de l’Éole indécent. Mais partout ailleurs,
et surtout à table, liberté entière et indulgence absolue.
«Quand nous restons au logis, au milieu des
esclaves et des servantes, disait Caton, si quelqu’un
d’entre eux a peté sous sa tunique, il ne me fait
aucun tort; s’il arrive qu’un esclave ou une servante
se permette de faire pendant son sommeil ce qu’on
ne fait pas en compagnie, il ne me fait pas de mal.»
Le petit dieu Pet figurait dans toutes les comessations
sous la figure d’un enfant accroupi, qui se
presse les flancs et qui paraît être dans l’exercice de
ses fonctions divines. Ce dieu-là avait été imaginé
par les Égyptiens, qui, ce semble, avaient grand
besoin de l’invoquer souvent. «Les Égyptiens, dit
Clément d’Alexandrie, tiennent les bruits du ventre
pour des divinités» (Ægyptos crepitus ventri pro
numinibus habent); mais, suivant un commentateur,
[234]
il s’agirait plutôt ici des murmures d’intestins, que
l’on nomme borborygmes dans le langage technique.
Saint Jérôme est plus explicite, en disant qu’il ne
parlera pas du pet, qui est un culte chez les Égyptiens
(taceam de crepitu ventris inflati, quæ pelusiaca
religio est). Saint Césaire, dans ses Dialogues,
ajoute même que ce culte inspirait une sorte de fanatisme
aux païens qui le pratiquaient: Nisi forte
de ethnicis Ægyptiis loquamur, qui flatus ventris non
sine furore quodam inter deos retulerunt. Enfin, Minutius
Félix ne veut certainement pas plaisanter, en
avançant que les Égyptiens redoutent moins Sérapis
que les bruits qui sortent des parties honteuses du
corps (crepitus per pudenda corporis emissos). Tout
Égyptien qu’il fût, le dieu Pet s’était naturalisé chez
les Romains, qui lui donnaient une place honorable
sur l’autel des dieux lares. Ils lui avaient même décerné
les honneurs d’une chapelle, hors des murs,
près de la source d’Égérie; mais ils l’adoraient en
public sous le nom du dieu Ridicule et sous la forme
d’un petit monstre malin, représenté dans la posture
qui convenait le mieux à ses faits et gestes. Le présage
résidait dans le son du pet (peditum, comme
l’appelle Catulle) plutôt que dans son odeur; car la
clédonistique s’attachait de préférence aux bruits. Il
paraît cependant que les femmes ne se permettaient
pas ce genre de liberté, et qu’elles se refusaient ainsi
à fournir des présages de leur cru; car Apulée parle
d’une figue dont les femmes s’abstenaient, parce
[235]
qu’elle cause des flatuosités (quia pedita excitat).
Les femmes évitaient donc avec précaution de faire
entendre les esprits de leur ventre, qui parfois rompaient
toute barrière dans les convulsions du plaisir:
le présage devenait alors plus significatif. Lorsque,
par aventure, ces esprits avaient annoncé une
grossesse, le bruit promettait un enfant mâle, l’odeur,
une fille. Telle est probablement l’énigme de cette
qualification malhonnête qu’on applique aux filles
dans le langage populaire, où on les traite de vesses.
Au reste, la vesse (visium) n’était jamais prise en
aussi bonne part que le pet (crepitus) chez les Romains.
«Le mot divisio est honnête, dit Cicéron;
mais il devient obscène dès qu’on réplique: intercapedo.»
Ces présages, dont la foi la plus candide
n’excuse pas la malpropreté, venaient des Grecs en
ligne directe; car Aristophane nous montre dans ses
Chevaliers un personnage que tire de sa rêverie l’incongruité
d’un impudique, et qui remercie les dieux
d’un si heureux présage.
Il y avait encore d’autres bruits humains, qui se
prêtaient aux capricieuses interprétations de la clédonistique:
l’éternument, par exemple, était compris
de bien des manières, selon qu’il se présentait
retentissant, plaintif, éclatant, burlesque, simple
ou réitéré. Éternuer le matin, éternuer le soir, éternuer
la nuit, c’étaient trois significations distinctes:
fâcheuse, bonne, excellente. C’était bien plus significatif
encore, si l’éternument arrivait tout à coup
[236]
au milieu des travaux de Vénus: la déesse proclamait
par là une bienveillante protection à l’égard du
sternutateur qui avait eu soin de se tourner à droite
pour éternuer. L’éternument, dans un repas, mettait
en joie les convives, qui saluaient à la fois et applaudissaient
celui que le dieu avait visité; car, d’après
une antique croyance qui reparaît sans cesse dans
les écrivains grecs, on attribuait la sternutation au
passage invisible d’un dieu tutélaire: on l’avait
surnommé l’oiseau de Jupiter conservateur; Socrate
disait que c’était un démon, et il se vantait de comprendre
le langage sternutatoire de ce démon familier.
L’éternument était moins bon chez les femmes
que chez les hommes; et elles le craignaient, d’ailleurs,
au point de recourir, lorsqu’elles y étaient
sujettes, à certains moyens préservatifs. Éternuer
trois fois de suite ou en nombre impair, c’était le
meilleur des présages. «Les dieux fassent que
j’éternue sept fois, disait Opimius, avant d’entrer
dans la couche de ma déesse!» On expliquait toujours
l’éternument par des causes surnaturelles; on
voulait voir, dans cette violente secousse des esprits
animaux, la sortie de quelque génie qui avait traversé
la cervelle de l’éternueur. La mythologie racontait
que Pallas, engendrée dans le front de Jupiter,
avait d’abord voulu se faire jour à la faveur d’un
éternument, qui faillit amener un nouveau chaos
dans l’univers naissant. La mythologie, toujours ingénieuse
dans ses fables allégoriques, supposait que
[237]
Vénus n’avait jamais éternué de peur de se faire des
rides. Jupiter et Cybèle présidaient donc aux éternuments
que l’on regardait comme favorables et
qui avaient été lancés à droite, avec le plus de bruit
possible. Ces éternuments n’étaient pas chose indifférente
en amour, et on leur attribuait une foule
d’heureux pronostics. Lorsque Catulle nous montre
Acmé et Septimius dans les bras l’un de l’autre, se
jurant un éternel amour: «Ne servons qu’un dieu,
s’écrie Acmé en délire, s’il est vrai que le feu qui
coule dans mes veines est plus ardent que le tien!»
Et le poëte ajoute: «L’Amour, qui avait jusque-là
éternué à gauche, marque son approbation en éternuant
à droite (Amor, sinistram ut ante, dextram
sternuit approbationem).» Properce ne peut mieux
rendre les bienfaits d’un pareil éternument, qu’en
supposant que l’Amour, le jour de la naissance de
Cynthie, éternua de la sorte sur le berceau de cette
belle:
Num tibi nascenti et primis, mea vita, diebus,
Candidus argutum sternuit omen Amor.
On était aussi très-préoccupé, en amour, des tintements
d’oreilles, des tressaillements subits du corps
(sallisationes) et des mouvements incohérents d’un
membre. Ces présages, du moins généralement, n’étaient
pas heureux; on les regardait comme les indices
d’une infidélité ou de tout autre délit qui outrageait
l’amour. Pline n’était pas si crédule que ses
[238]
contemporains; il affirme pourtant que les tintements
d’oreilles sont les échos du discours que tiennent les
absents. La jalousie avait foi surtout à ces pressentiments;
et un amant dont les oreilles tintaient ne
doutait pas que la vertu de sa maîtresse ne fût en
péril. C’était aussi quelquefois un symptôme de
l’amour qui se parlait et qui se répondait à lui-même,
comme dans ces vers attribués à Catulle:
Garrula quid totis resonans mihi noctibus auris
Nescio quem dicis nunc meminisse mei?
On cherchait toujours un effet surnaturel à une
cause purement physique. Il suffisait d’un tintement
d’oreilles pour troubler le tête-à-tête des amants,
pour empêcher leur rencontre, pour faire succéder
la froideur à la passion la plus vive. Le tintement
d’oreilles invitait à la défiance et annonçait des malheurs,
des larmes, une brouille, une trahison. Il en
était de même des vibrations nerveuses qui se faisaient
sentir dans les membres: celles de la main,
du pied, des organes de la génération, de tout le
corps, avaient chacune un présage particulier plus
ou moins défavorable. Après un tremblement de
cette espèce, celui qui l’avait éprouvé restait glacé
et impuissant auprès de la plus belle courtisane
grecque, auprès du cinæde le plus provoquant. Ces
phénomènes de l’économie étaient toujours plus
menaçants, lorsqu’ils affectaient la partie gauche du
corps; ainsi, pouvait-on expliquer en bonne part
[239]
tout ce qui s’opérait dans la partie droite. Il y avait
encore de bien étranges présages que signalait l’inspection
des parties honteuses et que l’on consultait
ordinairement au sortir du bain; mais ces présages-là
ne se traduisant pas en français, nous sommes
forcé de les laisser sous le voile du latin: Mentula
torta, bonum omen; infaustum, si pendula, etc.
Outre les bruits du corps humain, on s’intéressait
à tous les bruits extérieurs, pour leur donner un
sens propice ou non; ces bruits étaient de diverses
natures, en raison des personnes qui s’en préoccupaient.
Ainsi, celui auquel les amis et les agents des
plaisirs sensuels attachaient le plus d’importance,
c’était, ce devait être le craquement du lit (argutatio
lecti). Il y avait dans les murmures si variés de
ce meuble, qui crie, se plaint ou gémit, comme une
âme en peine; il y avait là un langage mystérieux,
plein de présages et d’oracles amoureux. Catulle ne
peint pas les transports d’une courtisane en délire
(febriculosi scorti), sans peindre la voix émue du
lit qui tremble et qui se déplace (tremulique quassa
lecti argutatio inambulatioque). Cette voix ressemblait
tantôt à un éclat de bois qui se fend, tantôt à
un grincement du fer contre le fer, tantôt à une
prière, tantôt à une menace, tantôt à un soupir,
tantôt à une lamentation. Chaque bruit avait un sens
particulier, heureux ou malheureux, et bien souvent
les plus tendres caresses étaient troublées,
interrompues par ces avertissements du génie cubiculaire.
[240]
Un lit qui gardait un silence absolu, et qui
se taisait sous les plus actives sollicitations, semblait
réserver l’avenir et suspecter l’amour. La place
qu’occupait le lit n’était pas non plus indifférente.
On le nommait lectus adversus, quand on le dressait
devant la porte de la chambre, pour fermer cette
porte aux divinités malfaisantes. On le nommait
lectus genialis, quand on le consacrait au Génie (Genius),
père de la Volupté. Ce Génie, c’était lui qui
donnait une âme et une voix à l’ivoire, à l’ébène, au
cèdre, à l’argent, qui composaient le trône du plaisir.
Juvénal nous représente un vil complaisant, qui
a consenti à suppléer à la virilité absente d’un
mari, en le rendant père: «Durant toute une
nuit, lui dit-il, je t’ai réconcilié avec ta femme, tandis
que tu pleurais à la porte. J’en prends à témoin et
le lit où s’est faite la réconciliation, et toi-même aux
oreilles de qui parvenaient le craquement du lit et
les accents entrecoupés de la dame.» (Testis mihi
lectulus et tu, ad quem lecti sonus et dominæ vox...) Si
le lit parlait aux amants en bonne ou en mauvaise
part, tout ce qui les entourait pendant les longues
heures employées sous les auspices de Vénus,
tout prenait une voix persuasive et impérieuse: le
pétillement de la lampe était surtout de favorable
augure, et les amants n’avaient rien à craindre, lorsque
la flamme jetait tout à coup une clarté plus vive
en s’élevant plus haut. Ovide, dans ses Héroïdes,
dit que la lumière éternue (sternuit et lumen), et que
[241]
cet éternument promet tout le bonheur, qu’on peut
souhaiter en amour.
Les courtisanes étaient les plus habiles à expliquer
ces présages, qui devaient être surtout de leur compétence:
tout le temps qu’elles ne donnaient pas à
l’amour, elles le passaient à interroger les sorts et
les augures; l’amour était, d’ailleurs, le but unique
de leurs inquiétudes et de leurs aspirations. Si le
cours ordinaire des choses ne leur fournissait pas
des auspices naturels qu’elles pussent interpréter
dans le sens de leur préoccupation, elles avaient
divers moyens de prévoir les événements et de
forcer les destins à trahir leurs secrets par certains
bruits qu’elles provoquaient. Là, elles faisaient claquer
des feuilles d’arbre sur leur poing à demi
fermé; là, elles écoutaient le crépitement des feuilles
de laurier sur des charbons ardents; ailleurs,
elles lançaient au plafond de leur cellule des pepins
de pomme ou de poire, des noyaux de cerise, des
grains de blé, et cherchaient à toucher le but où elles
visaient; quelquefois, elles écrasaient sur la main
gauche des pétales de roses, qu’elles avaient façonnées,
de l’autre main, en forme de bulle; d’autres
fois, elles comptaient les feuilles d’une tige de pavot
ou les rayons de la corolle d’une marguerite; enfin,
elles jetaient quatre dés qui devaient en tombant leur
offrir le coup de Vénus, si tous quatre présentaient
des nombres différents. Les poëtes de l’amour sont
remplis de ces divinations, qui faisaient battre le cœur
[242]
des amants. Ceux-ci, tout en ayant des présages à
eux, se montraient également sensibles aux présages
qui s’adressaient à tout le monde. Une mérétrice,
qui se heurtait aux jambages de la porte ou qui
faisait un faux pas sur le seuil, en sortant pour se
rendre au lupanar ou à la promenade, s’empressait
de rentrer chez elle, ne sortait pas de tout le jour et
s’abstenait ce jour-là des travaux de son métier. Si,
en se levant le matin, elle s’était choquée au bois
de son châlit, elle se recouchait et ne tirait aucun
parti de ce repos forcé. Les amasii et les femmes
vouées à la Prostitution étaient plus susceptibles
que tout autre, à l’observation des présages qui
s’offraient sur leur chemin, au vol ou au cri des
oiseaux, aux murmures de l’air, aux formes des
nuages, à la première rencontre, au dernier objet
dont leur regard était frappé; mais, en outre, elles
s’attachaient à certains présages qui n’avaient de
valeur que pour elles seules. Un pigeon ramier, une
colombe, un moineau, une oie, une perdrix, ces
oiseaux chers à Vénus et à Priape, ne se trouvaient
pas sans raison sur le passage d’une personne, qui
ne rêvait qu’amour et qui croyait dès lors pouvoir
tout entreprendre avec succès. L’empereur Proculus,
après avoir vaincu les Sarmates, vit un jour sur le
fronton d’un temple de Junon deux passereaux qui
s’ébattaient: il eut la patience de compter leurs cris
et leurs coups d’ailes; puis, il ordonna qu’on lui
amenât cent filles sarmates qui n’eussent jamais
[243]
connu d’homme: au bout de trois jours, il les laissa
toutes grosses de ses œuvres. Lorsqu’un coupable
zélateur de la débauche masculine entendait crier
une oie, il se sentait rempli d’ardeur et de force; si
une femme d’amour (amasia) voyait une tortue, en se
promenant dans les champs, elle faisait vœu de
céder au premier homme qui lui demanderait d’adorer
Vénus avec elle. Il ne fallait que se rencontrer
face à face avec un chien, pour être assuré d’avance
que tout réussirait au gré de vos désirs libertins.
Aviez-vous un chat devant vous, au contraire, c’était
sage de remettre au lendemain la récréation
amoureuse que vous vous étiez proposée et qui n’eût
tourné qu’à votre confusion.
Il y avait aussi des superstitions très-singulières,
qui allaient exclusivement à la crédulité du peuple
de Vénus. Ce peuple-là, fantasque et bizarre, n’observait
pas les jeûnes et les abstinences de plaisir,
que les matrones s’imposaient en l’honneur de plusieurs
solennités religieuses; mais elles ne s’épargnaient
pas des privations du même genre, pour
satisfaire des scrupules de conscience, que les matrones
ne se fussent point avisées d’avoir pour les
mêmes motifs. Une courtisane qui avait eu la faiblesse
de cohabiter avec un circoncis (recutitus), se
condamnait ensuite au repos pendant toute une
lune. Un débauché qui voulait obtenir d’un garçon
ou d’une fille la faveur de l’une ou l’autre Vénus,
n’avait qu’à formuler sa requête sous forme de vœu
[244]
adressé à la déesse, et il avait plus de chances d’être
exaucé. «O ma souveraine, ô Vénus! s’écrie un
personnage du roman d’Athénée, tandis qu’il partageait
la couche d’un bel adolescent; si j’obtiens
de cet enfant ce que j’en désire, et cela sans qu’il
le sente, demain je lui ferai présent d’une paire de
tourterelles.» L’adolescent fit semblant de ronfler,
et le lendemain il avait une paire de tourterelles.
Ce n’était pas seulement en affaire de mariage, que
la question de virginité paraissait difficile et importante
à constater. Les libertins recherchaient à
grands frais la première fleur des vierges, et c’était
là le commerce lucratif des lénons et des lènes, qui
prenaient parfois leurs victimes à l’âge de sept ou
huit ans, pour être plus certains de la condition
d’une marchandise si fragile et si rare. L’acheteur
demandait souvent des preuves, qu’on eût été fort
en peine de lui fournir, si la superstition n’avait
pas accrédité un usage étrange qui était même
employé dans les mariages du peuple pour authentiquer
l’état d’une vierge. Voici comment la chose
se passait: au moment où la fille, qui se donnait
pour intacta, allait entrer dans le lit où elle devait
cesser de l’être, on lui mesurait le col avec un fil
que l’on conservait précieusement jusqu’au lendemain;
alors, on mesurait de nouveau avec le
même fil: si le col était resté de la même grosseur
depuis la veille et si le fil l’entourait encore exactement,
on en concluait que la perte de la virginité
[245]
chez cette fille remontait à une époque déjà ancienne
et ne pouvait être mise sur le compte de celui
qui avait cru se l’attribuer; mais, au contraire,
cette virginité devenait incontestable pour les plus
incrédules, dans le cas où, le col ayant grossi après
la défloraison, le fil se trouvait trop court pour en
faire complétement le tour. C’est à ce procédé aussi
simple que naïf, que Catulle fait allusion dans son
épithalame de Thétis et de Pélée, en disant: «Demain,
sa nourrice, au point du jour, ne pourra plus
entourer le cou de l’épouse avec le fil de la veille.»
Non illam nutrix orienti luce revisens,
Hesterno collum poterit circumdare collo.
Ce fil ou ce lacet qui avait prouvé une virginité,
souvent grâce à la complaisance de la personne
chargée de mesurer le cou de la vierge devenue
femme, on le suspendait dans le temple de la Fortune
Virginale, bâti par Servius Tullius près de la
porte Capène; avec ce bienheureux fil, on dédiait à
la déesse, nommée aussi Virginensis Dea, les autres
témoignages de la virginité écrits en caractères de
sang sur les linges de la victime: «Tu offres à la
Fortune Virginale les vêtements maculés des jeunes
filles!» s’écrie Arnobe, avec une indignation que
partage saint Augustin dans la Cité de Dieu. Cette
Fortune Virginale n’était autre que Vénus, à qui
l’on offrait aussi des noix, pour rappeler que, durant
la première nuit des noces, le mystère conjugal s’accomplissait
[246]
au bruit des nuces, que les enfants répandaient
à grand bruit sur le seuil de la chambre des
époux, afin d’étouffer les cris de la virginité expirante.
«Esclave, donne, donne des noix aux enfants!»
(Concubine, nuces da), dit Catulle dans le chant nuptial
de Julie et de Manlius. «Mari, n’épargne pas les
noix!» dit Virgile dans ses Bucoliques: Sparge,
marite, nuces! Aux yeux des Romains, pour qui
tout était allégorie, la noix représentait l’énigme du
mariage, la noix, dont il faut briser la coquille
avant de savoir ce qu’elle renferme.

Sommaire.—Les courtisanes de Rome n’ont pas eu d’historiens ni
de panégyristes comme celles de la Grèce.—Pourquoi.—Les
poëtes commensaux et amants des courtisanes.—Amour des
courtisanes.—C’est dans les poëtes qu’il faut chercher les éléments
de l’histoire des courtisanes romaines.—Les Muses des
poëtes érotiques.—Leur vieillesse misérable.—Les amours
d’Horace.—Éloignement d’Horace pour les galanteries matronales.—Cupiennus.—Serment
de Salluste.—Marsæus et la
danseuse Origo.—Philosophie épicurienne d’Horace.—Ses
conseils à Cerinthus sur l’amour des matrones.—Comparaison
qu’il fait de cet amour avec celui des courtisanes.—Nééra, première
maîtresse d’Horace.—Serment de Nééra.—Son infidélité.—Bon
souvenir qu’Horace conserva de son premier amour.—Origo,
Lycoris et Arbuscula.—Débauches de la patricienne
Catia.—Ses adultères.—Liaison d’Horace avec une vieille
matrone qu’il abandonna pour Inachia.—Horribles épigrammes
qu’il fit contre cette vieille débauchée.—On ne sait rien d’Inachia.—La
bonne Cinara.—Gratidie la parfumeuse.—Ses potions
aphrodisiaques.—Rupture publique d’Horace avec Gratidie.—La
courtisane Hagna et son amant Balbinus.—Amours
d’Horace pour les garçons.—Bathylle.—Lysiscus.—Amour
d’Horace pour la courtisane étrangère Lycé.—Ode à Lycé.—Horace,
trompé par Lycé, fait des vers contre elle.—Pyrrha.—Horace,
[248]
ayant surpris Phyrrha avec un jeune homme, adresse
une ode d’adieu à cette courtisane.—Lalagé.—Partage que
fait Horace de cette affranchie avec son ami Aristius Fuscus.—Barine.—Tyndaris
et sa mère.—Déclaration d’amour que fait
Horace à Tyndaris.—La mère de Tyndaris, amie de Gratidie,
s’oppose à la liaison de sa fille avec Horace.—Amende honorable
d’Horace en faveur de Gratidie, pour obtenir les faveurs
de Tyndaris.—Tyndaris se laisse toucher et réconcilie Horace
avec Gratidie.—Lydie.—Cette courtisane trompe Horace pour
Télèphe.—Ode d’Horace à Lydie sur son infidélité.—Myrtale.—Lydie
quitte Télèphe pour Calaïs.—Réconciliation d’Horace
et de Lydie.—Chloé.—Phyllis, esclave de Xanthias.—A
quelle singulière circonstance Horace dut la révélation de la
beauté de cette esclave.—Ode à Xanthias.—Phyllis, affranchie
par Xanthias, prend Télèphe pour amant.—Horace succède
à Télèphe.—Ode à Phyllis.—Glycère, ancienne maîtresse
de Tibulle, accorde ses faveurs à Horace.—Amour passionné
d’Horace pour cette courtisane.—Ode d’Horace à Télèphe devenu
son ami.—Horace, à l’instigation de Glycère, écrit des
vers injurieux contre plusieurs de ses anciennes maîtresses.—Publication
que fait Horace de ses odes.—Glycère congédie
Horace.—Tentative d’Horace pour se rapprocher de Chloé et
faire oublier à cette courtisane Gygès son amant.—Dédains
de Chloé pour Horace, qui prend parti pour Astérie, sa rivale.—Adieux
d’Horace aux amours.—La chanteuse Lydé, dernière
maîtresse d’Horace.—Honteuse passion d’Horace pour Ligurinus.
Les courtisanes, surtout les courtisanes grecques,
qui faisaient les délices des voluptueux de Rome,
n’ont pas eu d’historien ni de panégyriste, comme
celles dont la Grèce avait reconnu l’ascendant politique,
philosophique et littéraire, en leur décernant
une espèce de culte d’enthousiasme et d’admiration.
Les Romains, nous l’avons déjà dit, étaient plus
grossiers, plus matériels, plus sensuels aussi que
[249]
les Grecs du siècle de Périclès et d’Aspasie; ce
qu’ils demandaient aux femmes de plaisir, à ces
étrangères dont ils savaient à peine la langue, ce
n’était pas une conversation brillante, solide, profonde,
spirituelle, un écho des leçons de l’académie
d’Athènes, une réminiscence de l’âge d’or des hétaires;
non, ils ne cherchaient, ils n’appréciaient
que des jouissances moins idéales et ils comptaient
seulement, au rang des auxiliaires de l’amour physique,
la bonne chère, les parfums, le chant, la
musique, la danse et la pantomime. Ils n’accordaient,
d’ailleurs, aucune influence hors du triclinium et
du cubile (salle à manger et chambre à coucher)
aux compagnes ordinaires de leurs orgies et de leurs
débauches. La vie des courtisanes n’était donc jamais
publique, et tout ce qu’elle avait d’intime
transpirait à peine dans la société des jeunes libertins.
Sans doute, cette société, tout occupée de ses
plaisirs, comprenait des poëtes et des écrivains qui
auraient pu consacrer leur prose ou leurs vers à la
biographie des courtisanes avec lesquelles ils vivaient
en si bonne intelligence; mais ce sujet lubrique
leur semblait indigne de passer à la postérité,
et, si chacun d’eux consentait à chanter la maîtresse
qu’il avait prise, en la réhabilitant, pour ainsi dire,
par l’amour, aucun, du moins parmi les auteurs
qui se respectaient, aucun n’eût osé se faire le poëte
des courtisanes à Rome, de même que les artistes,
qui ne refusaient pas de faire le portrait de ces précieuses
[250]
et fameuses, eussent rougi de s’intituler, à
l’instar de certains artistes de la Grèce, peintres de
courtisanes. Si quelques ouvrages, spécialement
consacrés à l’histoire et à l’usage des courtisanes
célèbres chez les Romains, furent composés sous la
dictée de ces sirènes, et dans le but de les immortaliser,
on peut supposer avec beaucoup de raison
que de tels ouvrages n’émanaient pas de plumes
distinguées et qu’ils doivent avoir été détruits avec
les molles libri et tous ces écrits obscènes que le
paganisme n’essaya pas de disputer aux justes
anathèmes de la morale évangélique.
Mais, en revanche, les poëtes, qui étaient alors,
comme de tout temps, les commensaux et les amants
des courtisanes, se montraient fort empressés de
leur accorder en particulier les hommages qu’ils
auraient eu honte de leur attribuer en général; leur
amour relevait à leurs yeux celle qui en était l’objet:
ce n’était plus dès lors une femme perdue, notée
d’infamie par les lois et stigmatisée du nom de
meretrix; c’était une femme aimée et, comme telle,
digne d’égards et de soins délicats. De son côté, la
courtisane, en se sentant aimée, oubliait parfois
elle-même sa profession et ressentait réellement
l’amour qu’elle avait inspiré, dont elle était fière, et
qui lui faisait la seule réputation honorable à laquelle
il lui fût permis de prétendre. «Ainsi, dit
M. Walkenaer dans son Histoire d’Horace, que nous
ne nous lasserons pas de citer avec autant de confiance
[251]
que les sources originales; ainsi, malgré les
préceptes donnés aux jeunes filles destinées à la
profession de courtisane par celles qui les élevaient
pour cette profession, elles n’étaient pas moins susceptibles
d’un véritable amour.» C’est donc dans
les recueils des poëtes classiques, c’est donc dans
les poésies adressées par eux à des courtisanes, qu’il
faut retrouver les éléments de l’histoire de ces coryphées
de la Prostitution romaine. Horace, Catulle,
Tibulle, Properce et Martial nous fournissent les
seuls documents qui puissent nous servir à dresser
un inventaire très-sommaire et très-incomplet des
courtisanes qui eurent les honneurs de la vogue depuis
l’élévation d’Auguste à l’empire jusqu’au règne
de Trajan. (41 ans avant J.-C.—100 ans après J.-C.)
Ces courtisanes, que nous nommerons les Muses des
poëtes érotiques, appartenaient la plupart à la classe
des famosæ où leur esprit, leur beauté et leur
adresse leur avaient donné droit de cité; mais, en
vieillissant, elles retombaient la plupart dans la foule
obscure des mérétrices de bas étage, et quelques-unes,
après avoir vu des consuls, des préteurs, des
généraux d’armée s’asseoir à leur table et se disputer
des faveurs qu’ils payaient à des prix fabuleux,
après avoir été entourées de clients, d’esclaves, de
lénons et de poëtes, après avoir habité un palais et
dépensé, en festins, en prodigalités de tout genre,
l’or de plusieurs provinces conquises, arrivaient par
degrés à un tel abandon, à une telle misère, qu’on
[252]
les retrouvait le soir, couvertes d’un vieux centon
ou manteau bariolé, errant avec les louves du Summœnium
et offrant au passant inconnu les infâmes
services de leur main ou de leur bouche. Ces honteux
exemples de la décadence des courtisanes n’excitaient
pas même la pitié de leurs anciens adulateurs,
et ceux-là qui les avaient le plus aimées se
détournaient avec horreur, comme nous l’apprend
Catulle, qui rencontra de la sorte, dans l’opprobre
de la Prostitution, une des maîtresses qu’il avait
chantées au milieu des splendeurs de la vie galante.
Nous passerons d’abord en revue les amours
d’Horace, pour connaître les grandes courtisanes de
son temps; car Horace, sage et prudent jusque dans
les choses du plaisir, ne faisait cas que des amours
faciles, dans lesquels son repos ne pouvait pas être
compromis. La terrible loi Julia contre les adultères
n’existait pas encore; mais la jurisprudence romaine,
quoique tombée en désuétude sur ce point délicat,
ne laissait pas moins des armes terribles dans les
mains d’un mari trompé, ou d’un père, ou d’un
frère, outragés par la conduite dissolue d’une fille
ou d’une sœur. Horace savait qu’on n’était pas impunément
amoureux d’une matrone, et qu’un amant
surpris en adultère courait risque d’être puni sur le
théâtre même de son crime, soit que le mari se contentât
de couper le nez et les oreilles du coupable,
soit que celui-ci y perdît son caractère d’homme et
fût privé des attributs de la virilité, soit enfin qu’il
[253]
pérît égorgé en présence de sa complice. Horace,
dans la satire 2e du livre I, à l’occasion de Cupiennius,
qui était fort curieux de l’amour des matrones
(mirator cunni Cupiennius albi), énumère les victimes
que cet amour avait faits, et dont le plaisir fut
tristement interrompu (multo corrupta dolore voluptas):
«L’un s’est précipité du haut d’un toit, l’autre
est mort sous les verges; celui-ci, en fuyant, est
tombé parmi une bande de voleurs; celui-ci a racheté
sa peau avec ses écus; tel autre a été souillé de
l’urine de vils esclaves; bien plus, il est advenu
que le fer a tranché les parties viriles d’un de ces
paillards (quia etiam illud accidit ut cuidam testes
caudamque salacem demeteret ferrum).» Horace répète
donc le serment que faisait souvent Salluste:
«Moi, je ne touche jamais une matrone (matronam
nullam ego tango);» mais il n’imitait pas les folies
de Salluste, qui se ruinait pour des affranchies; il
n’imitait pas davantage Marsæus, qui dissipa son
patrimoine et vendit jusqu’à sa maison pour entretenir
une danseuse nommée Origo: «Je n’ai jamais
eu affaire aux femmes des autres, disait Marsæus
à Horace.—Non, reprenait le poëte, mais vous
avez eu affaire aux baladines, aux prostituées (meretricibus)
qui ruinent la réputation encore plus que
la bourse.»
Cependant, Horace ne dédaignait pas, pour son
propre compte, les courtisanes et les danseuses;
mais il ménageait avec elles sa bourse et sa santé. Il
[254]
conservait l’usage de sa raison dans tous les déréglements
de ses sens, et il était toujours assez maître
de lui-même pour ne pas se livrer à la merci
d’une femme, en fût-il passionnément épris. Dans
ses passions les plus vives, partisan qu’il était de la
philosophie épicurienne, il suivait avant tout les inspirations
de la volupté, et il évitait soigneusement
tout ce qui pouvait être un embarras, une gêne,
un ennui. Voilà pourquoi, sans parler des honteuses
débauches que les mœurs romaines autorisaient
dans un ordre de plaisirs contraire à la nature, il
ne concentrait pas son affection sur un seul objet,
mais il la partageait d’ordinaire entre plusieurs amies
qui étaient successivement ou simultanément ses
maîtresses. Voilà pourquoi, à examiner la question
avec une froide impartialité, il préférait, à la dangereuse
promiscuité des galanteries matronales, la
tranquille possession des maîtresses mercenaires:
«Pour ne pas s’en repentir, disait-il à un desservant
idolâtre des grandes dames, cesse de pourchasser
les matrones, car il y a dans ce travail plus
de mal à gagner que de profit à recueillir. Une matrone,
si vous le permettez, Cerinthus, malgré ses
camées et ses émeraudes, n’a pas d’ailleurs la cuisse
plus polie ni la jambe mieux faite; souvent même,
on rencontre mieux chez une courtisane (atque
etiam melius persæpe togatæ est). Ajoute encore que
la marchandise de celle-ci n’est point fardée: tout
ce qu’elle veut vendre, elle le montre à découvert;
[255]
ce qu’elle a de beau, elle ne s’en vante point, elle
l’étale; elle avoue d’avance ce qu’elle cache de
défectueux. C’est l’usage des cochers qui achètent
des chevaux, de les soumettre à une inspection générale...
Chez une matrone, sauf le visage, vous ne
pouvez rien voir; le reste, si ce n’est chez Catia, est
caché jusqu’à ce que la robe soit ôtée. Si vous visez
à ce fruit défendu qu’environnent tant de retranchements
(et c’est là ce qui vous rend fou), mille choses
alors vous font obstacle: gardiens, litière, coiffeurs,
parasites, et cette stole qui descend jusqu’aux
talons, et ce manteau qui l’enveloppe par-dessus,
ce sont autant de barrières qui ne laissent point
approcher du but.»
Horace, dans cette satire où il se révèle avec ses
goûts comme avec ses habitudes, compare ensuite à
cette matrone si bien gardée une courtisane qui se
livre elle-même avant qu’on l’attaque: «Avec elle,
dit-il, rien n’est obstacle; la gaze vous la laisse voir
comme si elle était nue; vous pouvez presque la
mesurer de l’œil dans ses parties les plus secrètes;
elle n’a donc pas la jambe mal faite et le pied ignoble?
Aimeriez-vous mieux qu’on vous tendît un
piége et qu’on vous arrachât le prix de la marchandise,
avant de vous l’avoir montrée?» Puis, Horace
avoue qu’il n’a pas de patience quand le feu du
désir circule dans ses veines (tument tibi quum inguina),
et qu’il s’adresse alors à la première servante,
au premier enfant, qui peut lui venir en
[256]
aide: «J’aime, dit-il franchement, des amours faciles
et commodes (namque parabilem amo Venerem
facilemque). Celle qui nous dit: «Tout à l’heure...
Mais je veux davantage... Attendons que mon mari
soit sorti...» je la laisse aux prêtres de Cybèle,
comme dit Philon. Il prendra celle qui ne se tient
pas à si haut prix et qui ne se fait point attendre
lorsqu’on lui ordonne de venir. Qu’elle soit belle,
bien faite, soignée, mais non pas jusqu’à vouloir
paraître plus blanche ou plus grande que la nature
ne l’a faite. Celle-là, quand mon flanc droit presse
son flanc gauche, c’est mon Ilie et mon Égérie; je
lui donne le nom qu’il me plaît. Et je ne crains pas,
lorsque je fais l’amour (dum futuo), que le mari
revienne de la campagne, que la porte se brise en
éclats, que le chien aboie, que la maison s’ébranle
du haut en bas, que la femme toute pâle saute hors
du lit, qu’elle s’accuse d’être bien malheureuse,
qu’elle ait peur pour ses membres ou pour sa dot, et
que moi-même je tremble aussi pour mon compte;
car, en pareil cas, il faut fuir, les pieds nus et les
vêtements en désordre, sinon gare à vos écus, à
vos fesses et à votre réputation!... Malheureux qui
est pris! Je m’en rapporte à Fabius.» Horace, dans
son aimable épicuréisme, connaissait le plaisir plutôt
que l’amour.
Sa première maîtresse, celle du moins qu’il célébra
la première dans ses poésies, se nommait Nééra.
Il l’aimait, ou plutôt il l’entretint pendant plus d’une
[257]
année, sous le consulat de Plancus, l’an de Rome
714. Il avait, à cette époque, vingt-cinq ans, et il ne
s’était pas encore fait un nom parmi les poëtes; il
était donc trop pauvre pour payer bien cher les
faveurs de cette chanteuse, qui sans doute n’avait
pas la vogue qu’elle obtint plus tard dans les comessations.
Une nuit, elle enlaça dans ses bras son
jeune amant et prononça ce serment, dont la lune
fut le témoin muet: «Tant que le loup poursuivra
l’agneau; tant qu’Orion, la terreur des matelots,
soulèvera les mers agitées par la tempête; tant que
le zéphyr caressera la longue chevelure d’Apollon, je
te rendrai amour pour amour!» Mais le serment fut
bientôt oublié, et Néère prodigua ses nuits à un
amant plus riche qui les payait mieux. Elle ne voulait
cependant pas se brouiller avec Horace, qui rompit
tout commerce avec elle, en se disant: «Oui, s’il y
a quelque chose d’un homme dans Flaccus (si quid
in Flacco viri est), je chercherai un amour qui réponde
au mien!» Il se détacha donc de l’infidèle
Néère, et il prédit à son heureux rival que lui-même
serait abandonné à son tour, possédât-il de nombreux
troupeaux et de vastes domaines, fût-il plus beau que
Nirée, et fît-il rouler le Pactole chez sa maîtresse. Celle-ci
se distingua depuis dans son métier de chanteuse,
et lorsque Horace dut à ses poésies l’amitié de Mécène
et les bienfaits d’Auguste, il se souvint de Néère, et
il l’envoya souvent chercher pour chanter dans les
festins qu’il donnait à ses amis: «Va, jeune esclave,
[258]
dit-il dans une ode sur le retour de l’empereur après
la guerre d’Espagne, apporte-nous des parfums, des
couronnes et une amphore contemporaine de la
guerre des Marses, s’il en est échappé une aux bandes
de Spartacus. Dis à la chanteuse Néère, qu’elle
se hâte de nouer ses cheveux parfumés de myrrhe.
Si son maudit portier tarde à t’ouvrir la porte, reviens
sans elle. L’âge qui blanchit ma tête a éteint
mes ardeurs, qui naguère redoutaient peu les querelles
et les luttes; j’aurais été moins patient dans
ma chaude jeunesse, sous le consulat de Plancus!»
Il avait aimé Néère plus qu’il n’aima ses autres maîtresses;
car il voulut se venger d’elle, en lui montrant
ce qu’elle avait perdu par son infidélité.
«A l’époque où Horace entra dans le monde, dit
M. Walkenaer dans l’Histoire de son poëte favori,
il y avait à Rome trois courtisanes renommées parmi
toutes celles de leur profession; c’étaient Origo,
Lycoris et Arbuscula.» Malheureusement, les anciens
scoliastes ne nous en apprennent pas davantage à
l’égard de ces trois famosæ, qu’ils se contentent de
nommer, et Horace, qui ne paraît pas avoir eu de
rapports particuliers avec elles, raconte seulement
que la première avait réduit à la pauvreté l’opulent
Marsæus. Il affecte aussi de rapprocher de cette
courtisane avide et prodigue une patricienne, nommée
Catia, connue par ses débauches et par l’affectation
qu’elle mettait à relever indécemment le bas
de sa robe, lorsqu’elle se promenait sur la voie Sacrée.
[259]
Cette Catia, qui ne rougissait pas de rivaliser
en public avec les courtisanes, fut un jour surprise
en adultère dans le temple de Vénus Théatine, près
du théâtre de Pompée, et la populace la poursuivit
à coups de pierres. Son adultère, suivant le scoliaste
Porphyrion, sortait de l’ordinaire; car elle avait été
trouvée se livrant à la fois à Valérius, tribun du
peuple, et à un rustre sicilien (Valerio ac siculo
colono); d’autres scoliastes ne lui donnent pourtant
qu’un seul complice dans ce flagrant délit. La mésaventure
de Catia servit encore à confirmer les idées
d’Horace sur la préférence qu’il accordait à l’amour
des courtisanes. Il ne dérogea qu’une seule fois à
ses principes, et il se laissa séduire par une vieille
débauchée, qui appartenait à une famille illustre, et
qui l’avait charmé par de faux airs de philosophe
et de savante. Il eût volontiers borné sa liaison avec
cette stoïcienne à un commerce purement littéraire;
mais il ne se soumit pas longtemps aux exigences
amoureuses qu’il ne se sentait pas le courage de satisfaire.
Il s’était d’ailleurs attaché à une belle courtisane,
nommée Inachia, et il aurait eu honte de lui
opposer une indigne rivale. Celle-ci s’irrita de se voir
négligée d’abord, bientôt délaissée, puis détestée et
repoussée; elle essaya sans doute de se venger d’Horace,
en chagrinant Inachia, et Horace prit fait et cause
pour sa maîtresse, à laquelle il sacrifia sans regret
et sans pitié l’odieuse libertine qui le tenait comme
une proie. Deux horribles épigrammes, qu’il avait
[260]
faites contre elle, coururent dans Rome et la firent
montrer au doigt par tout le monde: «Tu me demandes,
ruine séculaire, lui disait-il dans la première
de ces deux pièces, ce qui amollit ma vigueur,
toi dont les dents sont noires, dont le front est labouré
de rides, et dont le hideux anus bâille entre
tes fesses décharnées comme celui d’une vache qui a
la diarrhée? Sans doute que ta poitrine, ta gorge
putride et semblable aux mamelles d’une jument,
sans doute que ton ventre flasque et tes cuisses
grêles plantées sur des jambes hydropiques, devaient
exciter mes désirs!... Mais qu’il te suffise d’être
opulente; qu’on porte à tes funérailles les images
triomphales de tes aïeux; qu’il n’y ait pas une
femme qui se pavane chargée de plus grosses perles
que les tiennes... Quoi! parce que des livres de
philosophie sont étalés sur tes coussins de soie, crois-tu
que c’est cela qui empêche mes nerfs de se roidir,
mes nerfs assez peu soucieux des lettres, et qui fait
languir mes amours (fascinum)? Va, tu as beau me
provoquer à te satisfaire (ut superbe provoces ab inguine);
il faut que ta bouche me vienne en aide (ore
ad laborandum est tibi).» Dans sa seconde ode,
Horace fait un tableau encore plus hideux de cette
impudique: «Que demandes-tu, ô femme digne
d’être accouplée à de noirs éléphants? Pourquoi m’envoies-tu
des présents, des lettres, à moi qui ne
suis pas un gars vigoureux, et dont l’odorat n’est
point émoussé?... Car, pour flairer un polype ou le
[261]
bouc immonde qui se cache sous tes aisselles velues,
j’ai le nez plus fin que celui du chien de chasse qui
sent le gîte du sanglier. Quelle sueur et quels miasmes
infects s’exhalent de tous ses membres flétris,
lorsqu’elle s’efforce d’assouvir une fureur insatiable
que trahit son amant épuisé (pene soluto), lorsque
sa face est dégoûtante de craie humide et de fard
préparé avec les excréments du crocodile, lorsque,
dans ses emportements lubriques, elle brise sa couche
et les courtines de son lit!» Il n’en fallut pas
moins, pour qu’Horace se délivrât des jalousies et des
poursuites de la femme aux éléphants (mulier nigris
dignissima barris).
Malheureusement, on ne connaît que le nom de
cette Inachia, qu’Horace proclamait, trois fois en
une nuit, la déesse du plaisir (Inachiam ter nocte
potes! s’écriait avec envie l’indigne rivale d’Inachia);
mais, presque dans le même temps, Horace s’était
lié avec une autre courtisane qui ne le cédait pas en
beauté à Inachia et qui pourtant se donnait gratis à
son poëte. Horace la nomme, pour cette raison probablement,
la bonne Cinara. Ce n’était pas le moyen
de la garder longtemps, et bientôt Cinara se mit en
quête d’un amant plus prodigue. Elle n’eut pas de
peine à le trouver, et Horace, inconsolable, ne put
l’oublier qu’en se jetant dans les fumées de Bacchus.
Cette courtisane désintéressée eut la maladresse de
devenir mère. Le poëte Properce, qui était auprès
d’elle pendant les douleurs de l’enfantement, lui
[262]
conseilla de faire un vœu à Junon, et aussitôt, sous
les auspices de cette déesse compatissante, Cinara
fut délivrée. Ce vœu, fait à Junon, semble motiver
l’opinion des scoliastes, qui veulent que Cinara soit
morte en couches. Horace la regretta toute sa vie, à
travers tous les amours qui succédèrent à celui qu’il
se rappelait sans cesse. Cinara, la bonne Cinara, se
rattachait, dans les souvenirs de jeunesse d’Horace,
à ses plus douces illusions; Cinara l’avait aimé pour
lui-même, sans intérêt et sans récompense: «Je ne
suis plus ce que j’étais sous le règne de la bonne
Cinara!» disait-il tristement, en approchant de la
cinquantaine. Gratidie, qui remplaça Cinara, n’était
pas faite pour la condamner à l’oubli: Gratidie
avait été belle et courtisée comme elle; mais les
années, en dispersant la foule de ses adorateurs, lui
avaient conseillé de joindre à son métier de courtisane
une industrie plus sûre et moins changeante.
Gratidie était parfumeuse et saga, ou magicienne:
elle vendait des philtres, elle en fabriquait aussi, et
les commentateurs d’Horace ont prétendu qu’elle
avait essayé le pouvoir de ses aphrodisiaques sur cet
amant, qu’elle croyait par là s’attacher davantage et
d’une manière plus invincible. Mais Horace, au contraire,
ne tarda pas à secouer un joug que les conjurations
et les breuvages de la magicienne n’avaient
pas réussi à lui rendre agréable et léger. Le poëte
eut horreur des œuvres ténébreuses dont son commerce
avec une saga l’avait fait complice; il craignit
[263]
aussi pour sa santé, que des stimulants trop énergiques
pouvaient compromettre, et il se sépara violemment
de Gratidie. Celle-ci employa son art
magique pour le retenir, pour le ramener; tout fut
inutile, et Horace, averti des relations libidineuses
que Gratidie entretenait secrètement avec un vieux
débauché nommé Varus, s’autorisa de ce prétexte
pour rompre avec éclat. Gratidie se plaignit alors
hautement, l’accusa d’ingratitude, et le menaça de
terribles représailles. Horace savait ce dont elle
était capable; il n’attendit donc pas une vengeance
qui pouvait le frapper par un empoisonnement plutôt
que par des maléfices: il dénonça, dans ses vers,
à l’opinion publique, les pratiques criminelles de
l’art des sagæ, et il déshonora Gratidie sous le nom
transparent de Canidie. Nous avons cité ailleurs les
sinistres révélations que fit Horace au sujet des mystères
du mont Esquilin. Gratidie fut peut-être forcée
de s’expliquer et de se justifier devant les magistrats;
elle obtint d’Horace, on ignore par quelle influence et
à quel prix, une espèce de rétractation poétique dans
laquelle perçait encore une amère et injurieuse ironie:
«Je reconnais avec humilité la puissance de
ton art, disait-il dans cette nouvelle ode destinée à
paralyser le terrible effet des deux autres; au nom
du royaume de Proserpine, de l’implacable Diane,
je t’en conjure à genoux, épargne-moi, épargne-moi!
Trop longtemps j’ai subi les effets de ta vengeance,
ô amante chérie des matelots et des marchands
[264]
forains! Vois, ma jeunesse a fui!... Tes
parfums magiques ont fait blanchir mes cheveux...
Vaincu par mes souffrances, je crois ce que j’ai nié
longtemps.... Oui, tes enchantements pénètrent le
cœur... Ma lyre que tu taxes d’imposture, veux-tu
qu’elle résonne pour toi? Eh bien, tu seras la pudeur,
la probité même!... Non, ta naissance n’a
rien d’abject... non, tu ne vas pas, la nuit, savante
magicienne, disperser, neuf jours après la mort, la
cendre des misérables... Ton âme est généreuse et
tes mains sont pures!» A ce désaveu forcé, Canidie
répond par des imprécations: «Quoi! tu aurais
impunément, nouveau pontife, lancé des foudres sur
les sortiléges du mont Esquilin et rempli Rome de
mon nom! Tu pourrais, sans éprouver mon courroux,
divulguer les rites secrets de Cotytto et te
moquer des mystères du libre Amour!» Ce passage
prouve évidemment que Gratidie, de même que la
plupart des sagæ, se prêtait à d’incroyables débauches
et ne restait pas étrangère à certaines orgies
nocturnes qui favorisaient une étrange promiscuité
des sexes, comme pour renouveler le culte impur
de Cotytto, la Vénus de Thrace, l’antique déesse
hermaphrodite de la Syrie. «La mort viendra trop
lente à ton gré! s’écriait l’infernale Canidie; tu traîneras
une vie misérable et odieuse, pour servir de
pâture à des souffrances toujours nouvelles... Tantôt,
dans les accès d’un sombre désespoir, tu voudras
te précipiter du haut d’une tour ou t’enfoncer
[265]
un poignard dans le cœur; tantôt, mais en vain, tu
entoureras ton cou du lacet funeste. Triomphante,
je m’élancerai de terre et tu me sentiras bondir sur
tes épaules.»
Horace avait besoin de respirer, après un pareil
amour, né au milieu des potions érotiques et sous
l’empire des invocations magiques: il ne pardonnait
pas toutefois à Canidie, car il décocha depuis
plus d’un trait acéré contre elle, et il put se réjouir
d’avoir fait du surnom qu’il lui donnait le pseudonyme
d’empoisonneuse: «Canidie a-t-elle donc
préparé cet horrible mets?» disait-il longtemps après,
en faisant la critique de l’ail. Horace était excessivement
sensible aux mauvaises odeurs qui agissaient
sur son système nerveux; il prit ainsi en aversion
une fort belle courtisane nommée Hagna, qui puait
du nez et n’en était pas moins idolâtrée de son
amant Balbinus. Nous passerons sous silence les
nombreuses distractions qu’Horace allait chercher
dans les domaines de Vénus masculine, et nous
laisserons sur le compte de la dépravation romaine
les continuelles infidélités qu’il faisait à son Bathylle,
en se couronnant de roses et en buvant du cécube
ou du falerne. Horace n’était pas plus moral que son
siècle, et s’il aima prodigieusement les femmes, il
n’aima pas moins les garçons, qu’il leur préférait
même souvent: «La beauté, partout où il la rencontrait,
dit le savant M. Walkenaer, faisait sur lui
une impression vive et brûlante; elle absorbait ses
[266]
pensées, troublait son sommeil, enflammait ses désirs;
il saisissait toutes les occasions de les satisfaire,
sans être arrêté par des scrupules et des considérations
qui n’avaient aucune force dans les mœurs de
son temps.» Dans une de ses épodes, adressée à
Pettius, il reconnaît que l’amour s’acharne sans cesse
après lui et l’enflamme pour les adolescents et les
jeunes filles: «Maintenant, c’est Lysiscus que
j’aime, dit-il avec passion, Lysiscus plus beau et
plus voluptueux qu’une femme. Ni les reproches de
mes amis, ni les dédains de cet adolescent ne sauraient
me détacher de lui; rien, si ce n’est un autre
amour pour une blanche jeune fille ou pour un bel
adolescent à la longue chevelure.» Lorsque le poëte
avouait ainsi sa faiblesse honteuse, l’hiver avait
trois fois dépouillé les forêts, dit-il dans la même
ode, depuis que sa raison se trouvait hors des
atteintes d’Inachia. Ce fut à cette époque, dans le
cours de sa trentième année, qu’il devint éperdument
amoureux de Lycé: c’était une courtisane
étrangère, qui exerçait la Prostitution au profit de
son prétendu mari, et qui eut l’adresse de résister
d’abord aux pressantes sollicitations du poëte.
Acron et Porphyrion, qui ont recueilli de précieux
détails sur tous les personnages nommés dans les
poésies d’Horace, ne nous font pas connaître le
véritable nom de cette Lycé, que le poëte aima entre
toutes ses maîtresses; ils nous apprennent seulement
qu’elle était d’origine tyrrhénienne, c’est-à-dire
[267]
qu’elle avait pris naissance dans l’Étrurie, où la
population entière, si l’on s’en rapporte au témoignage
de l’historien Théopompe, s’adonnait avec
fureur à la débauche la plus effrénée. Plaute fait
entendre que les mœurs de ce pays n’avaient pas
beaucoup changé de son temps, lorsqu’il met ces
paroles dans la bouche d’un personnage de sa Cistellaria:
«Vous ne serez point contrainte d’amasser
une dot, comme les femmes de Toscane, en trafiquant
indignement de vos attraits.» Lycé suivait
donc les principes de sa patrie, quand elle se vendait
au plus offrant et que ses richesses, honteusement
acquises, lui permettaient de s’entourer des
dehors d’une femme honnête, de simuler un mariage
et d’augmenter par là le prix de ses complaisances.
Horace y fut trompé comme tout le monde;
il crut avoir affaire à une vertu, et, malgré ses répugnances
à l’égard de l’adultère, il se relâcha de
ce rigorisme jusqu’à venir la nuit suspendre des
couronnes à la porte de l’astucieuse courtisane, qui
ferma d’abord les yeux et les oreilles. Il s’enhardit
par degrés et alla heurter à cette porte inexorable,
qui s’ouvrait pour d’autres que pour lui et que les
présents seuls avaient le privilége de rendre accessible.
Ce fut par une ode qu’il se fit recommander à
la sévérité feinte de la belle Étrurienne, qui n’était
pas en puissance de mari, mais qui avait auprès
d’elle un lénon affidé. Cette ode, composée dans un
genre que les Grecs nommaient paraclausithyron,
[268]
était un chant qu’on exécutait en musique devant la
porte close d’une cruelle: «Quand tu vivrais sous
les lois d’un époux barbare, aux sources lointaines
du Tanaïs, dit le poëte amoureux, Lycé, tu gémirais
de me voir, en butte aux aquilons, étendu devant
ta porte! Écoute comme cette porte est battue
par les vents, comme les arbres de tes jardins gémissent
et font gémir les toits de ta maison! Vois
comme la neige qui couvre la terre se durcit sous un
ciel pur et glacial! Abaisse ta fierté hostile à Vénus!...
Tu ne verras pas toujours un amant exposé, sur le
seuil de ta demeure, aux intempéries des saisons.»
Horace ignorait certainement que Lycé fût une
courtisane, quand il lui montrait, pour la fléchir,
son mari dans les bras d’une concubine thessalienne
nommée Piéria; quand il lui disait que son père,
originaire de Tyrrhène, n’avait pu engendrer une
Pénélope rebelle à l’amour; quand il avait recours
à la prière et aux larmes pour suppléer à l’inutilité
de ses dons. Mais bientôt on n’eut plus rien à lui
refuser, dès qu’il accorda ce qu’on lui demandait;
il était généreux; il fut aussi heureux qu’on pouvait
le faire, et il resta quelque temps l’amant en titre de
Lycé, qui ne le congédia que pour donner sa place
à un plus jeune et à un plus riche. Il ne se consola
pas aisément d’avoir été quitté, et il chercha en
vain à renouer une liaison qu’il avait rompue à contre-cœur.
Son ressentiment contre Lycé se fit jour
avec éclat, quand la beauté de cette courtisane se
[269]
ressentit de l’usage immodéré que la libertine en
avait fait: «Les dieux, Lycé, ont entendu mes
vœux! s’écria-t-il avec une joie qui ne prouve pas
que son amour fût alors éteint. Oui, Lycé, mes
vœux s’accomplissent. Te voilà vieille, et tu veux
encore paraître jeune, et d’une voix chevrotante,
quand tu as bu, tu sollicites Cupidon, qui te fuit:
il repose sur les joues fraîches de la belle Chias, qui
sait si bien chanter; il dédaigne en son vol les chênes
arides; il s’éloigne de toi, parce que tes dents
jaunies, tes rides, tes cheveux blancs, lui font peur.
Ni la pourpre de Cos, ni les pierres précieuses ne te
rendront ces années, que le temps rapide a comme
ensevelies dans l’histoire du passé. Où sont, hélas!
ta beauté, ta fraîcheur, tes grâces décentes? Ce
visage radieux, qui égalait presque celui de Cinara
et que les arts avaient cent fois reproduit, qu’en
reste-t-il maintenant? Que reste-t-il de celle en qui
tout respirait l’amour et qui m’avait ravi à moi-même?
Mais les destins donnèrent de courtes années à Cinara,
et ils te laissèrent vivre autant que la corneille
centenaire, pour que l’ardente jeunesse puisse
voir, non sans rire, un flambeau qui tombe en cendre.»
Il y a dans cette pièce le dépit et le regret d’un
amant délaissé, et l’on ne peut trop taxer d’hyperbole
un portrait si différent de celui qu’Horace avait
peint avec enthousiasme peu d’années auparavant.
Les femmes, et surtout les courtisanes, il est vrai,
chez les Romains, n’étaient pas longtemps jeunes:
[270]
le climat chaud, les bains multipliés, les cosmétiques
et les aphrodisiaques, les festins et les excès
en tout genre ne tardaient pas à flétrir la première
fleur d’un printemps qui touchait à l’hiver et qui
emportait avec lui les plaisirs de l’amour. La vieillesse
des femmes commençait à trente ans, et, si
le feu des passions érotiques couvait encore sous la
céruse et sous le fard, il fallait recourir, pour l’apaiser,
aux eunuques, aux spadones, aux gladiateurs,
aux esclaves, ou bien aux secrètes et honteuses compensations
du fascinum.
Dans le temps même qu’Horace était possesseur
des charmes de Lycé, il ne se défendit pas des séductions
d’une autre enchanteresse, et il donna
l’exemple de l’inconstance à sa nouvelle maîtresse
en traversant pour ainsi dire le lit de Pyrrha: il ne
l’aimait pas, il n’en était pas jaloux, car un jour il
la surprit, dans une grotte où elle était couchée sur
les roses, dans les bras d’un bel adolescent à la chevelure
parfumée. Il ne troubla pas les baisers de ces
deux amants, qui ne soupçonnaient pas sa présence;
il se contenta de les admirer, tous deux
enivrés d’amour et pétulants d’ardeur. Il se délecta
à ce spectacle voluptueux, et il se retira sans bruit,
avant que l’heureux couple fût en état de le voir et
de l’entendre. Mais, le lendemain, il envoya une
ode d’adieu à Pyrrha, pour lui notifier ce dont il
avait été témoin et ce qui l’avait guéri d’un amour
si mal partagé: «Malheur à ceux pour qui tu
[271]
brilles comme une mer qu’ils n’ont pas affrontée!
Quant à moi, le tableau votif que j’attache aux
parois du temple de l’Amour témoignera que j’ai
déposé mes vêtements humides, après mon naufrage!»
Les naufragés suspendaient dans le temple
de Neptune un tableau votif rappelant le danger
auquel ils avaient échappé: Horace faisait allusion
à cet usage, lorsqu’il remerciait le dieu des amants
de l’avoir sauvé au milieu d’une tourmente de jalousie
et d’infidélité. Il est remarquable que le poëte,
qui ne se piquait jamais de constance pour son propre
compte, ne souffrait pas de la part d’une maîtresse
la moindre perfidie, et pourtant toutes ses
maîtresses étaient des courtisanes! On doit attribuer
à une vanité excessive plutôt qu’à une délicatesse
de mœurs cette intolérance qui contrastait avec ses
doctrines épicuriennes. La seule fois peut-être où il
ne fut pas jaloux et où il se prêta même à un partage,
c’est quand son ami Aristius Fuscus jeta les
yeux sur une affranchie, nommée Lalagé, avec laquelle
il se reposait, des plaisirs de Rome et des
courtisanes, dans sa villa de la Sabine. Cette Lalagé
sortait à peine de l’enfance, et, ne sachant comment
résister aux poursuites de Fuscus, elle prétexta son
âge, et se défendit ainsi de lui céder immédiatement;
mais Horace, sacrifiant l’amour à l’amitié, prit lui-même
les intérêts de son ami, en l’invitant à patienter
quelque temps, jusqu’à ce qu’il eût triomphé
des refus de Lalagé: «Ne cueille pas la grappe
[272]
encore verte, lui disait-il; attends: l’automne va la
mûrir et nuancer de sa couleur de pourpre le noir
raisin; bientôt Lalagé te cherchera d’elle-même, car
le temps court malgré nous et lui apporte les années
qu’il te ravit dans sa fuite; bientôt, d’un œil moins
timide, elle provoquera l’amour, plus chérie que ne
furent jamais Chloris et la coquette Pholoé; elle
montrera ses blanches épaules et rayonnera comme
la lune au sein des mers.» En attendant, il célébrait
dans ses vers voluptueux les charmes enfantins
de Lalagé, et il parcourait la forêt de Sabine en
apprenant le nom de Lalagé à tous les échos. Il fut
sans doute trompé par cette affranchie, comme il le
fut presque en même temps par une autre, nommée
Barine, moins enfant et aussi charmante que Lalagé.
Selon les scoliastes, Barine se nommait Julia Varina,
parce qu’elle était une des affranchies de la famille
Julia. Horace eut encore la monomanie de faire de
cette courtisane une amante fidèle, et il s’aperçut
presque aussitôt que les serments dont elle l’avait
bercé n’étaient qu’un moyen de tirer de lui plus de
présents: «Barine, lui écrivit-il, je te croirais, si
un seul de tes parjures eût été suivi d’un châtiment;
si une seule de tes dents en fût devenue moins blanche;
si seulement un de tes ongles en eût été déformé;
mais, perfide, à peine as-tu, par des serments
trompeurs, engagé de nouveau ta foi, que tu
n’en parais que plus belle, que tu te montres avec
encore plus d’orgueil à cette jeunesse qui t’adore!
[273]
Oui, Barine, tu peux, avec de décevantes paroles,
prendre à témoin les ondes de la mer, les astres
silencieux de la nuit, les dieux inaccessibles au
froid de la mort. Vénus rira de tes sacriléges; les
nymphes indulgentes et le cruel Cupidon, aiguisant
sans cesse ses ardentes flèches, en riront. Il n’est
que trop vrai, tous ces adolescents ne grandissent
que pour t’assurer de nouveaux esclaves. Ceux que
tu retiens dans le servage te reprochent tes trahisons
et ne peuvent se résoudre à s’éloigner du
foyer d’une maîtresse impie!»
Horace, à cette époque, âgé de trente-huit ans
(27 ans avant J.-C.), se livrait à toute la fougue de
son tempérament; il cherchait une maîtresse fidèle
et il n’en trouvait pas, faute de la prêcher d’exemple;
il se retirait souvent dans une de ses maisons de campagne,
à Prœneste ou à Ustica, et il emmenait avec
lui, pour passer le temps, quelque belle affranchie,
qui se lassait bientôt de cette espèce de servitude
et qui le quittait pour retourner à Rome. Comme il
allait partir pour Ustica, son domaine de la Sabine,
il rencontra sur la voie Sacrée une jeune femme,
portant la toge et coiffée d’une perruque blonde:
elle était d’une beauté si merveilleuse, que tous les
regards la suivaient avec admiration, mais cette
beauté se trouvait encore relevée par celle d’une
compagne plus âgée qu’elle, quoique non moins resplendissante
d’attraits. La ressemblance de ces deux
courtisanes, qui ne différaient que par l’âge, prouvait
[274]
suffisamment que l’une était la fille de l’autre.
Horace fut émerveillé et il se sentit sur-le-champ
épris de toutes deux à la fois; mais quand il sut que
la mère avait pour amie cette parfumeuse Gratidie,
à laquelle il avait fait une si triste célébrité, il résolut
de ne s’occuper que de la fille, nommée Tyndaris,
chanteuse de son métier, entretenue par un
certain Cyrus, jaloux et colère, qui la battait. Il
envoya cette déclaration d’amour à Tyndaris: «Les
dieux me protégent, les dieux aiment mon encens
et mes vers. Viens auprès de moi, et l’Abondance te
versera de sa corne féconde tous les trésors des
champs. Là, dans une vallée solitaire, à l’abri des
feux de la canicule, tu chanteras sur la lyre d’Anacréon
la fidèle Pénélope, la trompeuse Circé, et leur
amour inquiet pour le même héros. Là, sous l’ombrage,
tu videras sans péril une coupe de Lesbos,
et les combats de Bacchus ne finiront pas comme
ceux de Mars; tu n’auras plus à craindre, qu’un
amant colère et jaloux, abusant de ta faiblesse, ose
porter sur toi des mains brutales, arracher les fleurs
de ta chevelure et déchirer ton voile innocent.» La
chanteuse, en recevant cette ode, alla consulter sa
mère, qui lui raconta l’indigne conduite du poëte à
l’égard de Gratidie, et qui lui conseilla de ne pas
s’exposer à de pareils traitements. Tyndaris répondit
donc à Horace qu’elle ne pouvait, sans offenser sa
mère, accepter les hommages de l’injurieux accusateur
de Gratidie. Alors, Horace essaya par la flatterie
[275]
de mettre dans son parti la mère de Tyndaris, à
laquelle il écrivit: «O toi, d’une mère si belle, fille
plus belle encore, je t’abandonne mes coupables
ïambes; ordonne, et qu’ils soient consumés par la
flamme ou ensevelis dans les flots... Apaise ton
âme irritée. Moi aussi, au temps heureux de ma
jeunesse, je connus le ressentiment, et je fus entraîné,
dans mon délire, à de sanglants ïambes.
Aujourd’hui je veux faire succéder la paix à la
guerre: ces vers insultants, je les désavoue, mais
rends-moi ton cœur et deviens ma maîtresse!» Tyndaris
se laissa toucher et réconcilia Horace avec la
vieille Gratidie, en faisant elle-même les frais du
raccommodement.
C’est après Tyndaris, que Lydie inspira au poëte
volage une des passions les plus vives qu’il eût encore
ressenties. Lydie était éprise d’un tout jeune
homme, qu’elle détournait des exercices gymnastiques
et des laborieux travaux de son éducation patricienne:
Horace lui reprocha de perdre ainsi
l’avenir de ce jeune homme, qu’il parvint à remplacer,
en se montrant plus libéral que lui. Mais à
peine avait-il succédé à cet imberbe Sybaris, que
Lydie, aussi capricieuse qu’il pouvait l’être jamais,
lui donna pour rival un certain Télèphe, qui s’était
emparé d’elle et qui la captivait par les sens. Horace
n’était pas homme à soutenir une semblable
rivalité; il tint bon cependant, et il essaya, par la
persuasion et par la tendresse, de lutter contre un
[276]
robuste rival, qui lui défaisait le soir tous ses projets
du matin. Sa poésie la plus amoureuse était sans
force vis-à-vis des faits et gestes de ce copieux
amant: «Ah! Lydie! s’écrie-t-il dans une ode charmante,
qui n’émut pas même cette belle inhumaine:
quand tu loues devant moi le teint de rose, les bras
d’ivoire de Télèphe, malheur à toi! mon cœur s’enflamme
et se gonfle de colère. Alors mon esprit se
trouble, je rougis et pâlis tour à tour; une larme
furtive tombe sur ma joue et trahit les feux secrets
dont je suis lentement dévoré. O douleur! quand je
vois tes blanches épaules honteusement meurtries
par lui dans les fureurs de l’ivresse; quand je vois
tes lèvres où sa dent cruelle imprime ses morsures!
Non, si tu veux m’écouter, ne te fie pas au barbare,
dont les baisers déchirent cette bouche divine où
Vénus a répandu son plus doux nectar. Heureux,
trois fois heureux, ceux qu’unit un lien indissoluble,
que de tristes querelles n’arrachent pas l’un à l’autre,
et que la mort seule vient trop tôt séparer!»
Lydie dédaigna les prières et les conseils d’Horace:
elle ne congédia point l’amant qui la mordait et qui
la meurtrissait de coups, mais elle ferma sa porte à
l’importun conseiller.
Horace ne pouvait rester un seul jour sans maîtresse.
Quoiqu’il aimât avec plus de frénésie l’infidèle
qui le chassait, il voulut, par le nombre de ses
distractions galantes, étouffer cet amour qui n’en
était que plus vivace dans son cœur; il fit parade de
[277]
ses nouvelles maîtresses: «Lorsqu’un plus digne
amour m’appelait, dit-il dans une ode, j’étais retenu
dans les liens chéris de Myrtale, l’affranchie Myrtale,
plus emportée que les flots de l’Adriatique
quand ils creusent avec rage les golfes de la Calabre.»
Mais il ne se consolait pas d’avoir perdu Lydie.
Il revint à Rome, et il apprit avec joie que le
brutal Télèphe avait un successeur, et que Lydie
était entretenue par Calaïs, fils d’Ornythus de Thurium;
Calaïs, jeune et beau, ne devait pas craindre
de rival. Horace alla voir Lydie, et elle ne le vit pas
sans émotion: ils tombèrent dans les bras l’un de
l’autre. Le poëte a chanté sa réconciliation dans cet
admirable dialogue: «Tant que j’ai su te plaire et
que nul amant préféré n’entourait de ses bras ton
cou d’ivoire, je vivais plus heureux que le grand
roi.—Tant que tu n’as pas brûlé pour une autre
et que Lydie ne passait point après Chloé, Lydie
vivait plus fière, plus glorieuse que la mère de Romulus.—Chloé
règne aujourd’hui sur moi; j’aime
sa voix si douce, mariée aux sons de sa lyre; pour
elle, je ne craindrais pas la mort, si les Destins voulaient
épargner sa vie.—Je partage les feux de Calaïs,
fils d’Ornythus de Thurium; pour lui, je souffrirais
mille morts, si les Destins voulaient épargner
sa vie.—Quoi! s’il revenait, le premier amour? s’il
ramenait sous le joug nos cœurs désunis? si je fuyais
la blonde Chloé et que ma porte s’ouvrît encore à
Lydie?—Bien qu’il soit beau comme le jour, et toi
[278]
plus léger que la feuille, plus irritable que les flots,
c’est avec toi que j’aimerais vivre, avec toi que j’aimerais
mourir!»
Les amours des courtisanes étaient changeants:
Lydie retourna bientôt à Calais, et Horace, à Chloé,
tout en regrettant Lydie, tout en s’affligeant de n’avoir
pas su la fixer. La blonde Chloé était encore
enfant, lorsqu’elle vendit sa fleur au poëte, qui la
négligea bientôt pour s’attacher à deux autres maîtresses
plus mûres et moins ignorantes, à Phyllis,
affranchie de Xanthias, et à Glycère, l’ancienne
amante de Tibulle. Ce fut dans une singulière circonstance,
qu’il eut révélation des beautés cachées
de Phyllis et qu’il se sentit jaloux de les posséder.
Un jour, il alla faire visite à un ami, nommé Xanthias,
jeune Grec de Phocée, épicurien et voluptueux
comme lui; il ne voulut pas qu’on avertît de sa présence
l’hôte aimable qu’il venait voir et qu’on lui
dit être enfermé dans la bibliothèque de sa maison,
au milieu des bustes et des portraits de ses ancêtres;
il eut l’idée de le surprendre et il le surprit, en
effet, car il ne le trouva pas la tête penchée sur un
livre: Xanthias avait écarté tous ses domestiques,
pour être seul avec une esclave dont il avait fait sa
concubine. Horace, arrêté sur le seuil, ne troubla
pas un tête-à-tête dont il observa curieusement les
épisodes et dont il partagea en quelque sorte les
plaisirs. Xanthias s’aperçut qu’il avait un témoin
muet de son bonheur, lorsqu’il eut la conscience de
[279]
lui-même et de sa situation; il rougit de honte et
chassa brutalement la belle Phyllis, qui se reprochait
tout bas son abandon, et qui se retira toute confuse
devant la colère de son maître. Il y avait chez les
Romains un préjugé très-répandu et très-invétéré,
qui représentait comme déshonorant le commerce
intime d’un homme libre avec une esclave. Xanthias
ne se consolait pas d’avoir dévoilé son secret
malgré lui, et il écoutait à peine les raisonnements
d’Horace, qui cherchait à justifier aux yeux de son
ami une faiblesse amoureuse qu’il eût volontiers
prise pour son propre compte. Horace fit l’éloge le
moins équivoque de la complice de Xanthias, et il
laissa celui-ci sous l’impression d’une sorte de jalousie
qui réhabilitait Phyllis. D’après le conseil d’Horace,
Xanthias commença par affranchir cette esclave, pour
n’avoir plus à rougir de la rapprocher de lui. Horace
lui avait envoyé une ode, dans laquelle il flattait Phyllis,
de la manière la plus délicate, en la comparant à
la blanche Briséis aimée d’Achille, à Tecmesse aimée
d’Ajax son maître, à la vierge troyenne dont
Agamemnon fut épris après la chute de Troie: «Ne
rougis pas d’aimer ton esclave, ô Xanthias! disait-il;
sais-tu si la blonde Phyllis n’a pas de nobles parents
qui seraient l’orgueil de leur gendre? Sans doute,
elle pleure une naissance royale et la rigueur des
dieux pénates. Non, celle que tu as aimée n’est pas
d’un sang avili; si fidèle, si désintéressée, elle n’a
pu naître d’une mère dont elle aurait à rougir. Si je
[280]
loue ses bras, son visage et sa jambe faite au tour,
mon cœur n’y est pour rien. Ne va pas soupçonner
un ami dont le temps s’est hâté de clore le huitième
lustre.» Horace à quarante ans n’était pas moins
curieux qu’à vingt, et ce qu’il avait vu de Phyllis le
tourmentait d’une secrète impatience de revoir à
son aise une si charmante fille. Le soin qu’il prend,
dans son ode à Xanthias, de se dire exempt de toute
convoitise, semblerait prouver le contraire, et il
est probable que Phyllis lui sut gré d’avoir contribué
à la faire affranchir. Cet affranchissement la délivra
de Xanthias qu’elle n’aimait pas, et une fois
maîtresse d’elle-même, elle s’amouracha de Télèphe,
qu’Horace avait eu déjà pour rival. Ce Télèphe ne
lui resta pas longtemps attaché et il céda la place à
Horace, qui adressa une ode consolatrice à la blonde
Phyllis, pour l’inviter à venir célébrer avec lui dans
une de ses villas les ides d’avril, mois consacré à
Vénus Marine: «Télèphe, que tu désires, n’est pas
né pour toi; jeune, voluptueux et riche, une autre
s’est emparée de lui et le retient dans un doux
esclavage, à l’exemple de Phaéton foudroyé et de
Bellérophon, que Pégase, impatient du frein d’un
mortel, rejeta sur la terre: cet exemple doit réprimer
des espérances trop ambitieuses. Ne regarde pas
au-dessus de toi, et tremblant d’élever trop haut
ton espoir, ne cherche que ton égal. Viens, ô mes
dernières amours, car, après toi, je ne brûlerai pour
aucune autre. Apprends des airs que me répétera
[281]
ta voix adorée: les chants adoucissent les noirs
chagrins.» Phyllis était devenue courtisane, et son
talent d’aulétride la faisait distinguer entre les chanteuses
qui se louaient dans les festins; quoique
Horace l’appelât ses dernières amours (meorum finis
amorum), il lui donna encore plus d’une rivale préférée.
Glycère fut celle qu’il aima davantage; il savait
par Tibulle, qui l’avait aimée avant lui, ce qu’elle
valait comme amante; il n’eut pas de répit qu’il ne
remplaçât auprès d’elle Tibulle ou plutôt le jeune
adolescent qui avait succédé à Tibulle. «Ne sois pas
si triste, Albius, au souvenir des rigueurs de Glycère?
écrivait-il à son ami Tibulle. Faut-il soupirer d’éternelles
élégies, parce qu’un plus jeune t’a éclipsé
aux yeux de l’infidèle?» Horace était assez riche et
assez aimable, pour que Glycère fermât les yeux sur
les cheveux gris que lui cachait une couronne de
roses; elle accepta les offrandes et le culte d’Horace;
elle lui donna rendez-vous dans une délicieuse maison
où elle avait établi le centre de son empire
amoureux; Horace lui envoya ce billet, au moment
où elle faisait sa toilette, au milieu de ses ancillæ
et de ses ornatrices, pour recevoir son nouvel
amant: «O Vénus, reine de Gnide et de Paphos,
dédaigne le séjour chéri de Chypre; viens dans la
brillante demeure de Glycère qui t’appelle avec des
flots d’encens! Amène avec toi le bouillant Amour,
les Grâces aux ceintures dénouées, et les Nymphes,
[282]
et Mercure, et la Jeunesse, qui sans toi n’a plus de
charmes!» Cette Glycère avait toutes les qualités
d’une courtisane consommée; elle exerça une irrésistible
influence sur les sens d’Horace, qui se livra
aux ardeurs de sa passion avec tant d’emportement,
que sa santé en fut altérée, et qu’il augmenta par
ces excès l’irritabilité de ses nerfs. Il tombait alors
dans des crises spasmodiques qui l’épuisaient encore
plus que ses transports amoureux, et souvent,
au sortir des bras de sa maîtresse, il s’abandonnait
aux sombres rêveries d’une espèce de maladie noire,
que la jalousie avait produite et qu’elle menaçait
d’aggraver tous les jours. Mais cette jalousie lui
avait été si souvent funeste dans ses amours, qu’il
se faisait violence pour la cacher et qu’il s’étourdissait
au milieu des festins: «Je veux perdre la raison,
disait-il à son ancien rival Télèphe, devenu son
ami et son compagnon de table. Où sont les flûtes
de Bérécynthe? Que fait ce hautbois suspendu près
de la lyre muette? Je hais les mains paresseuses:
semez les roses! Que le bruit de nos folies éveille
l’insensé Lycus et la jeune voisine si mal unie à ce
vieil époux. Ta noire chevelure, ô Télèphe, tes
yeux doux et brillants comme l’étoile du soir,
attirent l’amoureuse Rhodé, et moi je languis, je
brûle pour ma Glycère...» En faisant allusion à la
verte jeunesse de Télèphe, il faisait un triste retour
sur ses quarante-trois ans, sur sa chevelure grisonnante,
sur son crâne chauve, sur ses yeux bordés
[283]
de rouge, sur ses rides et sur son teint jauni. Glycère,
en courtisane adroite, évitait pourtant d’évoquer
ces fâcheuses pensées, et quelquefois Horace,
assis ou plutôt couché à table avec elle, pouvait
croire qu’il n’avait pas plus perdu que son vin en
vieillissant. Alors sa verve de poëte s’échauffait, et il
redevenait jeune en chantant Glycère: «Le fils de
Jupiter et de Sémélé, les désirs voluptueux et leur
mère cruelle m’ordonnent de rendre mon cœur aux
amours que je croyais finies pour moi. Je brûle pour
Glycère! j’aime son teint éblouissant et pur comme
un marbre de Paros; j’aime ses charmants caprices
et la vivacité dangereuse de ses regards. Vénus me
poursuit et s’attache à moi tout entière; au lieu de
chanter les sauvages tribus de la Scythie et le cavalier
parthe, si redouté dans sa fuite, ma lyre n’a
plus que des chants d’amour. Esclaves, posez, sur
un autel de vert gazon, la verveine, l’encens et une
coupe de vin: le sang d’une victime désarmera
la déesse.» Les commentateurs se sont beaucoup
occupés de ce sacrifice, et ils n’ont eu garde de se
mettre d’accord sur la déesse à qui Horace voulait
l’offrir. C’était Vénus, selon les uns; c’était Glycère
divinisée, selon les autres. On a beaucoup débattu
un autre point, aussi difficile à éclaircir: quelle
était la victime que le poëte se proposait d’immoler
(mactata hostia)? Le savant Dacier a prétendu que
les Grecs et les Romains ne souillaient jamais de
sang les sacrifices offerts à Vénus. En réponse à
[284]
cette docte argumentation, le dernier historien d’Horace
a cité un passage de Tacite, d’après lequel on
ne saurait contester que les autels de Vénus furent
ensanglantés comme ceux des autres dieux et
déesses: on avait soin seulement que les animaux
qu’on immolait, chèvres, génisses, colombes, ne
fussent pas des mâles. Le sacrifice dont il est question
dans l’ode d’Horace à Glycère, pourrait bien
être d’une espèce plus érotique, car un amant qui
appréhendait les maléfices et qui voulait surtout se
garantir du nœud d’impuissance, brûlait de l’encens
et de la verveine sur l’autel de ses dieux lares, versait
une patère de vin dans la flamme et transformait
ensuite sa maîtresse en victime qu’il immolait à
Vénus.
Pendant sa liaison avec Glycère, Horace se
brouilla impitoyablement avec plusieurs maîtresses
qu’il avait eues et qui comptaient rester ses amies.
On peut supposer avec raison que ce fut à l’instigation
de Glycère, qu’il ne fit grâce ni à Chloris, ni à
Pholoé, ni à Chloé, ni même à sa chère Lydie. Il
outragea dans ses vers celles qu’il avait chantées
naguère avec le plus de tendresse. Il est impossible
de ne pas reconnaître la haine de Glycère contre Lydie
dans cette ode injurieuse: «Les jeunes débauchés
viennent moins souvent frapper à coups redoublés
tes fenêtres et troubler ton sommeil; ta porte
reste enchaînée au seuil, elle qui roulait si facilement
sur ses gonds. Déjà tu entends de moins en
[285]
moins répéter ce refrain: Tandis que je veille dans
les longues nuits, Lydie, tu dors! Bientôt, vieille et
flétrie, au coin d’une rue solitaire, tu pleureras à
ton tour les dédains des plus vils amants. Quand de
brûlants désirs, quand cette chaleur qui met en
rut les cavales, s’allumeront dans ton cœur ulcéré,
tu gémiras de voir cette joyeuse jeunesse, qui se couronne
de myrte et de lierre verdoyant, et qui dédie
à l’Hèbre glacé les couronnes flétries.» Horace, qui
avait eu le courage d’insulter Lydie et de la représenter
meretrix de carrefour, provoquant les passants au
coin des rues; Horace n’eut pas le moindre remords,
en sacrifiant à quelque ressentiment de Glycère la
vieille Chloris et sa fille Pholoé, qui était alors une
des fameuses à la mode: «Femme du pauvre Ibicus,
mets donc enfin un terme à tes débauches et à tes
infâmes travaux. Quand tu es si proche de la mort,
cesse de jouer au milieu des jeunes filles et de faire
ombre à ces blanches étoiles. Ce qui sied assez bien
à Pholoé ne te sied plus, ô Chloris! Que ta fille,
comme une bacchante excitée par les sons des cymbales,
assiége les maisons des jeunes Romains; que,
dans son amour pour Nothus, elle folâtre comme la
chèvre lascive. Quant à toi, vieille, ce sont les
laines de Luceria, et non les cythares qui te conviennent,
et non la rose aux couleurs purpurines:
d’un tonneau de vin, on ne boit pas la lie.» Horace,
au lieu de déchirer quelques pages dans ses livres
d’odes, en ajoutait de bien amères, de bien cruelles,
[286]
qui n’effaçaient pas les chants d’amour de sa jeunesse.
Il avait quarante-sept ans; il était follement
épris de Glycère, et en publiant le recueil de ses
odes, il les mêla de telle sorte, qu’on ne pouvait
plus retrouver la suite chronologique de ses maîtresses
et de ses amours dans les pièces de vers
qu’il avait composées pour les immortaliser; mais
Glycère ne fut pas encore satisfaite de la place que
le poëte lui avait réservée dans ce recueil: elle s’irrita,
elle congédia son trop docile amant, et quoi
qu’il fît pour rentrer en grâce, elle ne voulut pas lui
pardonner ses torts imaginaires.
Horace essaya inutilement de lui inspirer de la
jalousie et de lui prouver qu’il pouvait se passer
d’elle: il se tourna vers une ancienne maîtresse,
qu’il n’avait pas du moins injuriée, et il n’épargna
rien pour redevenir son amant. Cette maîtresse était
Chloé, cette belle esclave de Thrace, qu’il avait
possédée le premier et qui n’avait pas su le retenir
sous le prestige d’une naïve tendresse d’enfant. La
blonde Chloé avait acquis de l’expérience, en devenant
une courtisane en vogue; elle se trouvait, à cette
époque, dans tout l’éclat de ses grâces, de ses talents
et de sa réputation: elle avait autour d’elle
une brillante cour d’adorateurs empressés; elle se
montrait partout avec eux, à la promenade, au
théâtre, aux bains de mer; son luxe surpassait celui
de ses rivales, et elle n’était entretenue néanmoins
que par un jeune marchand, nommé Gygès. Ce Gygès,
[287]
elle l’aimait sans doute parce qu’il n’avait pas
d’égal en beauté, mais elle lui était surtout attachée
à cause de l’immense fortune de ce jeune homme.
Ils vivaient donc ensemble comme mari et femme,
lorsque Gygès rencontra une autre courtisane, appelée
Astérie: il l’aima aussitôt et il ne songea plus
qu’à se séparer de Chloé, qui veillait sur lui comme
sur un trésor. Il prétexta un voyage en Bithynie,
où, disait-il, l’appelaient ses affaires de commerce.
Il partit et promit à Astérie de ne revenir que pour
elle. Dès qu’il fut éloigné, son amour pour Astérie
éclata par des présents qui la dénoncèrent à l’inquiète
jalousie de Chloé. Sans cesse Astérie recevait
des lettres du voyageur; Chloé n’en recevait aucune;
elle ignorait même en quel pays il se trouvait,
plus résolu que jamais à ne reparaître à Rome que
pour ne plus quitter son Astérie. Chloé était hors
d’elle, furieuse et désolée à la fois; elle apprit que
Gygès était allé de Bithynie en Épire: elle lui envoya
un émissaire chargé de lettres suppliantes et passionnées.
Le moment était mal choisi pour faire oublier à
Chloé l’absence de Gygès; Horace fut repoussé par
cette belle délaissée, qui ne lui épargna pas les dédains.
Horace se vengea, non-seulement par une
épigramme contre la superbe Chloé, mais encore
en prenant fait et cause pour Astérie, dont il se fit
l’ami et le protecteur. Il lui adressa une ode, dans
laquelle il l’encourageait à rester fidèle à son fidèle
[288]
Gygès, et à ne rien craindre des intrigues de sa
rivale abandonnée: «Astérie, prends garde que
ton voisin Énipée te plaise plus qu’il ne faut? Personne,
il est vrai, ne manie au Champ-de-Mars un
cheval avec plus d’adresse, et ne fend plus vite à
la nage les eaux du Tibre. Le soir, ferme ta porte,
aux sons de la flûte plaintive; ne jette pas les yeux
dans la rue, et quand il t’appellerait cent fois
cruelle, reste inflexible!» Il lui apprenait que l’émissaire
de Chloé avait tenté vainement d’émouvoir
le cœur de Gygès, ce cœur qui appartenait désormais
à la seule Astérie; il put jouir du désespoir de
Chloé, mais le mauvais succès de ses tentatives
amoureuses auprès de cette courtisane avait laissé
dans son propre cœur un amer découragement; il
crut se rendre justice, en invoquant une dernière
fois Vénus, qui lui avait été si souvent favorable:
«J’ai joui naguère de mes triomphes sur les jeunes
filles, et j’ai servi non sans gloire sous les drapeaux
de l’Amour. Aujourd’hui, je consacre à Vénus Marine
mes armes et ma lyre, qui n’est plus faite pour
ces combats; je les suspends, à gauche de la déesse,
aux parois de son temple. Mettez-y également les
flambeaux, les leviers et les haches qui menaçaient
les portes fermées. O déesse, qui règnes dans l’île
fortunée de Chypre et dans Memphis, où l’on ne
connut jamais les neiges de Sithonie, ô souveraine
des amours, touche seulement de ton fouet divin
l’arrogante Chloé!»
[289]
Mais Horace disait adieu trop tôt à Vénus: il reconnut
avec joie qu’il pouvait encore avoir droit
aux faveurs de la déesse. Il vit ou peut-être il
revit Lydé, habile chanteuse qui jouait de la lyre
dans les festins; il ne fut pas longtemps à lier avec
elle une partie amoureuse, et il emprunta certainement
à sa bourse les plus grands moyens de séduction.
Il mit d’abord ses projets sous les auspices de
Mercure, dieu des poëtes, des voleurs et des marchands:
«Inspire-moi, dit-il à ce dieu des courtisanes,
inspire-moi des chants qui captivent l’oreille
de la sauvage Lydé! Comme la jeune cavale bondit
en se jouant dans la plaine et fuit l’approche du
coursier, Lydé me fuit et l’amour l’effarouche encore.»
Mais elle ne tarda pas à s’apprivoiser, et elle
venait souvent chanter dans les festins où Horace
puisait au fond de ses vieilles amphores sa philosophie
sceptique et insouciante. Les odes qu’il adresse
à Lydé sont surtout des invitations à boire: «Que
faire de mieux le jour consacré à Neptune? Allons,
Lydé, tire le cécube caché au fond du cellier, et
force ta sobriété dans ses retranchements... Nous
chanterons tour à tour, moi, Neptune et les vertes
chevelures des Néréides; toi, sur ta lyre d’ivoire,
Latone et les flèches rapides de Diane. Nos derniers
chants seront pour la déesse qui règne à Gnide et
aux brillantes Cyclades, et qui vole à Paphos sur un
char attelé de cygnes. Nous redirons aussi à la Nuit
les hymnes qui lui sont dus.» Dans une ode à Quintus
[290]
Hirpinus, Horace, qui a des cheveux blancs et
qui les couronne de roses, compte encore sur la
chanteuse Lydé, pour égayer le repas où Bacchus
dissipe les soucis rongeurs: «Esclave, fais rafraîchir
promptement l’ardent falerne dans cette source
qui fuit loin de nous? Et toi, fais sortir de la maison
de Lydé le galant qu’elle y a recueilli au passage
(quis devium scortum eliciet domo Lyden)? Dis-lui de
se hâter. Qu’elle vienne avec sa lyre d’ivoire, les
cheveux négligemment noués à la manière des
femmes de Sparte!»
C’en est fait, la carrière amoureuse d’Horace se
ferme des mains de Lydé: il ne recherche plus la
société des courtisanes; il n’aime plus les femmes;
il sait qu’il n’a plus rien de ce qu’il faut pour leur
plaire, il ne s’exposera donc plus à leurs dédains et
à leurs refus; mais il invoque encore Vénus:
«Après une longue trêve, ô Vénus, tu me déclares
de nouveau la guerre! Je ne suis plus ce que j’étais
sous le règne de l’aimable Cinara, je vais compter
dix lustres; n’essaie plus, mère cruelle des tendres
amours, de courber sous ton joug, autrefois si
doux, un cœur devenu rebelle! Va où t’appellent
les vœux passionnés de la jeunesse; transporte, sur
l’aile de tes cygnes éblouissants, les plaisirs et la volupté
dans la demeure de Maxime, si tu cherches un
cœur fait pour l’amour... Pour moi, adieu les garçons,
les femmes, le crédule espoir d’un tendre retour!
adieu les combats du vin et les fleurs nouvelles
[291]
dont j’aimais à parer ma tête! Mais, hélas!
pourquoi, Ligurinus, pourquoi ces larmes furtives
qui coulent de ma joue? pourquoi au milieu de mon
discours ma voix expire-t-elle dans le silence de
l’embarras? La nuit, dans mes songes, c’est toi que
je tiens embrassé; toi que je poursuis sur le gazon
du Champ-de-Mars, cruel, et dans les eaux du
Tibre!» Horace est amoureux du beau Ligurinus, et
cette honteuse passion remplira ses dernières années.
Le favori des courtisanes, le poëte des grâces et des
amours, déshonore ses cheveux blancs et s’abandonne
aux plus hideux égarements de la Prostitution
romaine.

Sommaire.—Catulle.—Licence et obscénité de ses poésies.—Le
patient Aurélius et le cinæde Furius.—Épigramme contre
ses détracteurs.—Ses maîtresses et ses amies.—Clodia ou
Lesbie, fille du sénateur Métellus Céler, maîtresse de Catulle.—Le
moineau de Lesbie.—Pourquoi Clodia reçut de Catulle
le surnom de Lesbie.—Ce que c’était que le moineau de Lesbie.—Mort
de ce moineau chantée par Catulle.—Désespoir de
Lesbie.—Passion violente de Catulle pour Lesbie.—Rupture
des deux amants.—Résignation de Catulle.—La maîtresse
de Mamurra.—Mariage concubinaire de Lesbie.—Catulle
revoit Lesbie en présence de son mari.—Subterfuges
employés par Lesbie pour ne pas éveiller la jalousie de son mari.—La
courtisane Quintia au théâtre.—Vers de Catulle contre
Quintia.—Catulle n’a pas donné de rivale dans ses poésies, à
Lesbie.—La courtisane grecque Ipsithilla.—Billet galant qu’adressa
Catulle à cette courtisane.—Épigramme de Catulle aux
habitués d’une maison de débauche où s’était réfugiée une de
ses maîtresses.—Il ne faut pas reconnaître Lesbie dans l’héroïne
de ce mauvais lieu.—Colère de Catulle contre Aufilena.—La
catin pourrie.—Vieillesse prématurée de Catulle.—Lesbie
au lit de mort de son amant.—Properce.—Cynthie ou Hostilia,
fille d’Hostilius.—Son amour pour Properce.—Statilius Taurus,
[294]
riche préteur d’Illyrie, entreteneur de Cynthie.—Résignation
de Properce à l’endroit des amours de sa maîtresse avec
Statilius Taurus.—Les oreilles de Lygdamus.—Conseils de Properce
à sa maîtresse.—La docte Cynthie.—Élégies de Catulle
sur les attraits de sa maîtresse.—Axiome de Properce.—Nuit
amoureuse avec Cynthie.—Les galants de Cynthie.—Ses
nuits à Isis et à Junon.—Gémissements de Properce sur la
conduite de Cynthie.—Les bains de Baïes.—Les amours de
Gallus.—Properce se jette dans la débauche pour oublier sa
maîtresse.—Réconciliation de Properce avec Cynthie.—Changement
de rôles.—Acanthis l’entremetteuse.—Jalousie de Cynthie.—Lycinna.—Subterfuge
qu’employa Cynthie pour s’assurer
de la fidélité de son amant.—Les joyeuses courtisanes.
Phyllis et Téïa.—Properce pris au piége.—Fureur de Cynthie.—L’empoisonneuse
Nomas.—Funérailles précipitées de
Cynthie.—Mort de Properce.—Ses cendres réunies à celles de
Cynthie.
Horace était à peine né, que Catulle, ce grand
poëte de l’amour ou plutôt de la volupté, venait de
mourir, à l’âge de trente-six ans, victime de l’abus
des plaisirs, selon plusieurs de ses historiens; mais,
selon les autres, n’ayant succombé qu’à la faiblesse
de sa nature délicate et maladive, malgré les précautions
d’une vie calme et chaste. Cette vie-là,
dans tous les cas, n’avait pas toujours été telle,
puisque les poésies de Catulle, si mutilées et si
expurgées que les ait faites la censure des premiers
siècles du christianisme, respirent encore la licence
érotique et la philosophie épicurienne. Le poëte,
ami de Cornélius Népos et de Cicéron, a composé
ses vers au milieu des libertins et des courtisanes
de Rome; il parle même leur langage dans ces vers,
[295]
ornés de toutes les grâces du style; il ne recule
jamais devant le mot obscène, qu’il fait sonner avec
effronterie dans une phrase élégante et harmonieuse;
il se plaît aux images et aux mystères de la
débauche la plus hardie, mais il a l’excuse d’être naïf
dans ce qu’il ose dire et dépeindre. On voit que ses
voyages et son séjour en Asie, en Grèce et en Afrique,
ne lui avaient laissé ignorer rien de ce qui devait
servir à composer l’impure mosaïque de la
Prostitution romaine. Et pourtant, dans une épigramme
contre ses détracteurs, le patient Aurélius
et le cinæde Furius (pathice), qui, d’après ses
vers voluptueux (molliculi), ne le supposaient pas
trop pudique, il n’hésite point à défendre sa pudeur:
«Un bon poëte, dit-il, doit être chaste; mais est-il
nécessaire que ses vers le soient? ils ont assez de
sel et d’agrément, tout voluptueux et peu décents
qu’ils sont, quand ils peuvent éveiller les sens,
non-seulement des jeunes garçons, mais encore de
ces barbons qui ne savent plus remuer leurs reins
épuisés.» Catulle était trop instruit des secrets de
Vénus, pour n’avoir pas acquis ce savoir et cette
expérience, aux dépens de sa pudeur et de sa santé.
Il nous fait connaître, dans ses poésies, dont la
moitié n’est pas venue jusqu’à nous, trois ou quatre
courtisanes grecques qui furent ses maîtresses et
ses amies; elles étaient à la mode de son temps
(50 à 60 ans avant J.-C.), mais leur réputation de
beauté, d’esprit, de talents et de grâces, si éclatante
[296]
qu’elle ait été dans la période de leurs amours,
n’a pas duré assez longtemps pour qu’on en trouve
un reflet dans les œuvres d’Horace. Il n’y a que
Lesbie, dont le nom, immortalisé par Catulle, ait survécu
au moineau qu’elle avait tant pleuré; et encore,
suivant les commentateurs, cette Lesbie, fille d’un
sénateur, Métellus Céler, s’appelait Clodia, et n’appartenait
pas à la classe des courtisanes. Au reste,
le poëte semble avoir évité, dans les vers adressés à
Lesbie ou à son moineau, d’admettre un détail qui
aurait pu la désigner personnellement: il ne fait pas
le portrait de cette belle; il ne nous révèle pas seulement
la couleur de ses cheveux; il se borne à des
énumérations de baisers, mille fois donnés et rendus,
dont il embrouille tellement le nombre, que
les envieux ne puissent jamais les compter: «Tu
me demandes, Lesbie, combien il me faudrait de
tes baisers, pour que j’en eusse assez et trop? Autant
qu’il y a de grains de sable amoncelés en Libye,
dans les déserts de Cyrène, depuis le temple
de Jupiter Ammon jusqu’au tombeau sacré du vieux
Battus; autant qu’il y a d’étoiles qui, dans le silence
de la nuit, sont témoins des amours furtifs du genre
humain!» Cette Lesbie, que Catulle avait surnommée
ainsi par allusion à ses goûts lesbiens, et qu’il
a comparée à Sapho en traduisant pour elle l’ode de
la célèbre philosophe de Lesbos, est plus connue
par son moineau que par ses mœurs galantes. Ce
moineau, délices de Lesbie, qui jouait avec elle,
[297]
qu’elle cachait dans son sein, qu’elle agaçait avec
le doigt, et dont elle aimait à provoquer les morsures,
lorsqu’elle attendait son amant et cherchait à
se distraire de l’ennui de l’attente; ce moineau,
dont Catulle a chanté la mort, n’était pas un oiseau,
si l’on s’en rapporte à la tradition conservée
par les scoliastes; c’était une jeune fille, compagne
de Lesbie qui l’aimait à l’égal de son amant: «Pleurez,
ô Grâces, Amours, et vous tous qui êtes beaux
entre les hommes! il est mort le moineau de ma
maîtresse, moineau qui faisait ses délices et qu’elle
aimait plus que la prunelle de ses yeux!» Mais les
scoliastes de Catulle ont peut-être abusé des priviléges
de l’interprétation, en se fondant sur sa belle
imitation de l’ode de Sapho, que le poëte n’a pas
craint de dédier à Lesbie; nous ne soutiendrons pas
contre eux que Catulle n’a entendu pleurer qu’un
moineau: «O misérable moineau! voilà donc ton
ouvrage: les yeux de ma maîtresse sont enflés et
rouges d’avoir pleuré.»
Catulle était si passionnément épris de Lesbie,
qu’il ne prévoyait pas la fin de cette passion qu’elle
partageait aussi: «Vivons, ô ma Lesbie! s’écriait-il,
vivons et aimons!» Mais la jeune fille, quoique plus
aimée que nulle ne le sera jamais, se lassa la première
d’un tel amour, et congédia son amant. Celui-ci
n’essaya pas de regagner un cœur, dont il était rejeté;
il ne se plaignit pas de cette rupture, qu’il
regardait comme inévitable; il résolut seulement
[298]
d’oublier Lesbie, et de ne plus aimer à l’avenir avec
la même abnégation: «Adieu, Lesbie! dit-il tristement;
déjà Catulle s’est endurci le cœur; il ne te
poursuivra plus, il ne te suppliera plus; mais, toi, tu
gémiras, infidèle, quand tes nuits se passeront sans
qu’on t’adresse de prières. Maintenant quel sort t’est
réservé? qui te recherchera? à qui paraîtras-tu
belle? qui aimeras-tu? à qui seras-tu? qui aura tes
baisers? quelles lèvres mordras-tu? Et toi, Catulle,
puisque c’est la destinée, endurcis-toi!» Catulle
s’aperçut bientôt qu’il avait trop compté sur sa force
d’âme, et qu’il ne se consolerait pas de l’inconstance
de Lesbie; il l’aimait absente; il l’aima toujours à
travers cent maîtresses: «O dieux! murmurait-il
en essuyant ses larmes, si votre nature divine vous
permet la pitié, et si jamais vous avez porté secours
à des malheureux dans les angoisses de la mort,
voyez ma misère, et, pour prix d’une vie qui a été
pure, ôtez-moi ce mal, ce poison, qui, se glissant
comme une torpeur dans la moelle de mes os, a
chassé de mon cœur toutes mes joies!» Longtemps
après, il ne se rappelait pas sans émotion, et son
amour, et celle qui le lui avait inspiré; il s’indigna
un jour de voir comparer à Lesbie la maîtresse de
Mamurra, qui n’avait ni le nez petit, ni le pied
bien fait, ni les yeux noirs, ni les doigts longs, ni
la peau douce, ni la voix séduisante, comme la véritable
Lesbie: «O siècle stupide et grossier!» répétait-il
en soupirant.
[299]
Lesbie s’était mariée, ou plutôt elle avait formé
une de ces liaisons concubinaires que la loi romaine
rangeait dans la catégorie des mariages par usucapion.
Elle vivait donc avec un homme qu’on appelait
son mari (maritus) et qui n’était peut-être qu’un
maître jaloux. Elle ne laissait pas que de recevoir
quelquefois Catulle en présence de ce mari, qu’elle
n’osait tromper, bien qu’elle en eût belle envie. Pour
mieux feindre l’oubli du passé et pour tranquilliser
l’esprit de l’époux qu’elle regrettait secrètement d’avoir
préféré à l’amant, elle adressait tout haut des
reproches et même des injures à Catulle: «C’est
une grande joie pour cet imbécile! dit le poëte, qui
se consolait en faisant une épigramme contre le mari.
Ane, tu n’y entends rien! Si elle se taisait et qu’elle
oubliât nos amours, elle en serait guérie; quand
elle gronde et m’invective, c’est non-seulement
qu’elle se souvient, mais encore, ce qui est bien
plus sérieux, qu’elle est irritée; c’est qu’elle brûle
encore et ne s’en cache pas!» On ne voit pourtant pas,
dans les poésies de Catulle, qu’il ait demandé à Lesbie
des preuves plus positives de la passion qu’elle conservait
pour lui. Si c’était une illusion, il ne fit rien
qui pût la lui enlever, et il se contenta de voir Lesbie
en puissance de mari, sans essayer de la rendre
infidèle. Un jour, au théâtre, un murmure d’admiration
accompagna l’arrivée d’une courtisane, nommée
Quintia, qui vint se placer sur les gradins auprès
de Lesbie, comme pour l’éclipser et la vaincre
[300]
en beauté; tous les yeux, en effet, se fixèrent sur la
nouvelle venue, et l’on ne regarda plus Lesbie,
excepté Catulle, qui n’avait des yeux que pour elle.
Indigné de l’injuste préférence que le peuple accordait
à Quintia, il prit ses tablettes et improvisa cette
pièce de vers, qu’il fit circuler parmi les spectateurs,
pour venger Lesbie: «Quintia est belle pour le plus
grand nombre; pour moi, elle est blanche; longue
et roide. J’avouerai volontiers qu’elle a quelques
avantages, mais je nie absolument qu’elle soit belle;
car, dans ce grand corps, il n’y a nulle grâce, nul
attrait. Lesbie, au contraire, est belle, et si belle
de la tête aux pieds, qu’elle semble avoir dérobé aux
autres toutes les grâces.»
Lesbia formosa est: quæ quum pulcherrima tota est,
Tum omnibus una omnes surripuit veneres.
On peut dire que Catulle n’a pas donné de rivale
dans ses poésies, à cette Lesbie, qu’il ne cessa d’aimer,
lorsqu’il eut cessé de la posséder. On eût dit que
sa muse aurait rougi de prononcer le nom d’une autre
maîtresse. On ne trouve qu’un seul nom, celui
d’Ipsithilla, qui brille un moment auprès de Lesbie,
et qui disparaît comme un météore après une journée
de folie amoureuse. Cette Ipsithilla était, à en
juger par son nom, une courtisane grecque, et pour
faire passer dans notre langue le billet galant que
Catulle lui envoya un jour, il ne faut pas moins que
la traduction discrète d’un professeur de l’Université:
[301]
«Au nom de l’amour, douce Ipsithilla, mes
délices, charme de ma vie, accorde-moi le rendez-vous
que j’implore pour le milieu du jour; et, si tu
me l’accordes, ajoutes-y cette faveur, que la porte
soit interdite à tout le monde. Surtout, ne va pas sortir!...
Reste à la maison, et prépare-toi à voir se
renouveler neuf fois mes exploits amoureux (paresque
nobis novem continuas futationes). Mais, si tu dis
oui, dis-le de suite; car, étendu sur mon lit, après
un bon dîner, je foule dans mon ardeur et ma tunique
et ma couverture.» Cette épigramme, qui nous
fait comprendre pourquoi Catulle est mort si jeune,
est la seule où il désigne nominativement une de ses
maîtresses. Dans une autre épigramme qu’il adresse
aux habitués d’un mauvais lieu, il se plaint amèrement
de la perte d’une maîtresse qu’il ne nomme
pas, qu’il avait aimée comme on n’aimera jamais, et
pour laquelle il s’était battu bien des fois. Cette
femme l’avait quitté pour se réfugier dans une maison
de débauche, la neuvième qu’on rencontrait en
sortant du temple de Castor et Pollux. Là, elle se
prostituait indifféremment aux ignobles hôtes de ce
lupanar (omnes pusilli, et semitarii mœchi), qui s’entendaient
pour garder leur proie et qui ne permettaient
pas à Catulle d’entrer dans la maison, où ils
étaient au nombre d’une centaine: «Pensez-vous
être seuls des hommes? leur criait-il en colère (solis
putatis esse mentulas vobis?). Croient-ils avoir seuls
le droit de fréquenter les filles publiques et de regarder
[302]
le reste du monde comme des castrats?» Il les
défie, il les menace d’écrire la violence qu’on lui
fait, sur les murs mêmes du mauvais lieu, dans lequel
on lui refuse ce qu’on y obtient toujours à prix d’argent;
il est prêt à se mesurer contre deux cents
adversaires. Mais il a beau insister, crier, prier, en
écoutant la voix de son amante qui se livre aux contubernales,
il se morfond toute la nuit à la porte.
Certes, il ne faut pas reconnaître Lesbie dans l’héroïne
de ces débauches, dans la scandaleuse hôtesse
de cette taverne mal famée. Le mari de Lesbie, ce
Lesbius que Catulle traite avec tant de mépris, la
vendait peut-être à tour de rôle; mais il ne l’avait
pas laissée tomber à ce degré de prostitution. Catulle
avait beau dire à Lesbie qu’il l’estimait moins, il
était forcé d’avouer en gémissant qu’il l’aimait davantage:
Amantem injuria talis cogit amare magis,
sed bene velle minus. Il continuait cependant à user sa
vie dans la société des courtisanes, et il était souvent
victime de leurs tromperies: ainsi, le voit-on
fort irrité contre une certaine Aufilena, qui avait
exigé de lui à l’avance le prix des faveurs qu’elle
lui avait ensuite refusées: «L’honneur veut, Aufilena,
qu’on tienne sa parole, comme la pudeur
voulait que tu ne me promisses rien; mais voler
en fraudant, c’est pis encore que le fait d’une courtisane
avare qui se prostitue à tout venant.» Ailleurs,
il s’indigne contre une honteuse prostituée qui lui
avait dérobé ses tablettes; il l’appelle catin pourrie
[303]
(putida mœcha); il l’accable d’injures, sans obtenir
la restitution des tablettes. Elle ne s’émeut pas,
et ne fait qu’en rire; il finit par rire lui-même et
par changer de ton: «Chaste et pure jeune fille,
lui dit-il, rends-moi donc mes tablettes?» Catulle
se sentait à bout de ses forces physiques; à peine
âgé de trente-quatre ans, il touchait à la décrépitude:
il dut renoncer à tout ce qui l’avait conduit,
en si peu d’années, à une vieillesse prématurée; mais
il ne renonça pas à Lesbie. Ce n’était plus qu’un
souvenir avec lequel il retrouvait les jouissances de
son ardente jeunesse; c’était encore de l’amour qu’il
épanchait en vers tendres ou passionnés: quelquefois
il maudissait Lesbie, il allait jusqu’à l’outrager;
puis, aussitôt, comme pour obtenir son pardon, il
l’admirait, il l’exaltait, il l’invoquait à l’instar d’une
divinité: «Nulle femme n’a pu se dire aussi tendrement
aimée que tu le fus de moi, ô ma Lesbie!
Jamais la foi des traités n’a été plus religieusement
gardée que nos serments d’amour le furent par moi!
Mais vois où tu m’as conduit par ta faute, et quel
sacrifice est imposé à ma fidélité!... Car je ne pourrai
jamais t’estimer, quand tu deviendrais la plus
vertueuse des femmes, ni cesser de t’aimer, quand
tu serais la plus débauchée!» Les sens faisaient
silence chez Catulle; le cœur parlait seul, et cette
voix suprême retentit dans l’âme de Lesbie. Elle
apprit que son ancien amant n’avait plus que peu de
temps à vivre; elle crut que le chagrin était tout
[304]
son mal, elle voulut le guérir: elle revint auprès
de lui, les bras ouverts; Catulle s’y précipita, en oubliant
tout le reste. Lesbie l’avait revu mourant;
Catulle s’était ranimé pour écrire d’une main tremblante
ces admirables vers:
Restituis cupido, atque insperanti ipsa refers te
Nobis. O lucem candidiore notâ!
Quis me uno vivit felicior, aut magis hæc quid
Optandum vita, dicere quis poterit!
«Tu te rends à moi, qui te désire! tu reviens à
moi qui t’espérais sans cesse! O jour qu’il faut marquer
du caillou le plus blanc! Qui donc est plus
heureux que moi sur la terre, et qui pourrait dire
qu’il y a dans la vie quelque chose de préférable à
ce bonheur?» Catulle n’avait que des vers pour
exprimer sa joie et sa reconnaissance; son œil éteint
s’était rallumé; une rougeur inusitée avait brillé sur
ses joues creuses sillonnées de larmes; il pressait
contre sa poitrine cette maîtresse chérie qui pleurait
en le regardant. Il exhala son dernier soupir, dans
des vers où il se flattait encore de vivre en aimant
Lesbie: «Tu me promets, ô ma vie, que notre
amour sera plein de charmes et durera toujours?
Grands dieux! faites qu’elle puisse promettre et
tenir, et que ce soit sincèrement, et du cœur, qu’elle
me le dise! Ainsi, nous pourrions donc faire durer
autant que notre vie ce lien sacré d’une amitié éternelle!»
Quelles devaient être ces courtisanes, qui
savaient se faire aimer avec cette exquise délicatesse,
[305]
avec ce dévouement presque religieux!
Catulle mourut à trente-six ans, heureux d’avoir
retrouvé sa Lesbie (56 ans av. J.-C.). Le plus bel
éloge qu’on puisse faire de cette Lesbie, c’est de
rappeler l’amour si tendre et si constant qu’elle
avait inspiré à un poëte libertin, qui la respecte toujours
dans les vers qu’il lui adresse, et qui ne craint
pas ailleurs de promener sa muse dans les fanges
les plus secrètes de la Prostitution romaine.
Properce était né avant que Catulle fût mort.
Properce, qui devait être aussi, suivant l’expression
bizarre d’un rhéteur, «un des triumvirs de
l’amour,» vit le jour en Étrurie, dans la ville de Pérouse
ou dans celle de Mévanie, l’an 702 de Rome,
52 avant J.-C. Properce, en lisant les poésies de
Catulle, devint poëte; il était devenu amoureux, en
voyant Cynthie. Le véritable nom de cette belle était
Hostia ou Hostilia. Ses flatteurs prétendirent même
qu’elle descendait de Tullus Hostilius, troisième roi
de Rome; mais, quoi qu’il en fût, elle pouvait se
vanter, avec plus de certitude, de descendre en
ligne directe de son père Hostilius, écrivain érudit,
qui composa une histoire de la guerre d’Istrie. Cette
Hostilia, que sa beauté, ses grâces et ses talents
avaient mise au rang des femmes les plus remarquables
de son temps, n’était pourtant qu’une courtisane.
Elle aimait véritablement Properce, mais
néanmoins elle ne se faisait aucun scrupule de lui
donner autant de rivaux qu’elle en pouvait satisfaire.
[306]
Elle n’avait garde de lui permettre d’en user
aussi librement de son côté; lui prescrivait même
la fidélité la plus rigoureuse. Cependant, elle vivait
publiquement avec un riche préteur d’Illyrie,
nommé Statilius Taurus, qui avait bâti à ses frais
un amphithéâtre, et qui dépensait autant d’argent
pour elle que pour les combats de bêtes féroces.
Properce, que la poésie n’enrichissait pas, eût été
bien en peine de subvenir aux prodigalités de sa
Délie; il acceptait donc, comme une nécessité, la
concurrence peu redoutable que lui faisait le préteur
d’Illyrie dans les bonnes grâces d’Hostilia; il fermait
les yeux et les oreilles, par habitude, chaque
fois qu’il pouvait voir ou entendre ce rival permanent;
mais il n’en souffrait pas d’autres, ou, du
moins, il faisait mauvais visage à ceux qui partageaient
en passant les faveurs de sa maîtresse avec
lui. Ainsi, en revenant un soir, à l’improviste, de
Mévanie, impatient de se retrouver dans les bras de
sa maîtresse, il entend les sons de la flûte, il voit
la maison resplendissante de lumières. Il approche
avec inquiétude, il entre avec stupeur: les esclaves
se cachent à son aspect; aucun n’ose l’arrêter, et
tous voudraient l’empêcher d’avancer. On est en
fête dans le triclinium; on y danse, on y chante,
on y brûle des aromates; il appelle un affranchi
qui ne lui répond pas. Il saisit par les oreilles un
esclave, Lygdamus, qui tente de s’enfuir; il demande
d’une voix impérieuse quel est l’hôte magnifique
[307]
qui reçoit chez Cynthie un pareil accueil?
Est-ce un consul? est-ce un sénateur? est-ce un
histrion, un gladiateur, un eunuque? Lygdamus
garde le silence; il se laissera, plutôt que d’ouvrir
la bouche, arracher les deux oreilles; mais Properce
n’a que faire des oreilles de Lygdamus; il va droit
au triclinium, écarte les rideaux de la porte et
plonge ses regards dans la salle, où l’odeur des
mets et des aromates lui a révélé ce qui s’y passe.
En effet, devant une table somptueusement servie,
un lit d’ivoire, de pourpre et d’argent, réunit sur
les mêmes coussins Hostilia et Statilius Taurus, se
tenant embrassés et se souriant l’un à l’autre. A
cette vue il redevient calme et grave; il referme le
rideau et se retire d’un pas tranquille: «Sot! dit-il
à Lygdamus qui craint encore pour ses oreilles,
pourquoi ne m’avertissais-tu pas tout de suite que
le préteur était arrivé d’Illyrie?» Il retourna chez
lui et passa la nuit, qu’il avait réservée à un plus
doux emploi, dans le commerce des muses, seule
infidélité qu’il se permît à l’égard de son infidèle.
Le lendemain il lui envoyait une élégie qui commence
ainsi: «Le voilà revenu d’Illyrie, ce préteur,
ta riche proie, Cynthie, et mon plus grand désespoir!
Que n’a-t-il laissé sa vie au milieu des rocs
acrocérauniens? Ah! Neptune, quelles offrandes alors
je t’eusse présentées!... Aujourd’hui, et sans moi,
on festine à pleine table, et toute la nuit, excepté
pour moi seul, ta porte est ouverte. Oui, si tu es
[308]
sage, ne quitte pas un moment cette moisson qui
t’est offerte, et dépouille de toute sa toison cette
stupide brebis. Ensuite, dès que, ses richesses dissipées,
il restera pauvre et sans ressources, dis-lui de
faire voile vers d’autres Illyries.» Ces conseils, de la
part d’un amant, ne témoignaient pas de son extrême
délicatesse.
Cynthie n’était pas seulement belle; son amant
l’appelle docte, et parle plusieurs fois de son instruction,
de son esprit et de ses talents; on sait
aussi qu’elle était poëte, et son goût pour la poésie
devait être le principal lien qui l’attachait à Properce.
Celui-ci, en effet, ne pouvait la payer qu’en vers.
Dans ses élégies, il esquisse souvent le portrait de
cette courtisane distinguée; il nous apprend qu’elle
avait la taille majestueuse, les cheveux blonds, la
main admirable. «Ah! ses attraits, écrit-il à un
ami, sont le moindre aliment de ma flamme! O
Bassus! elle a bien d’autres perfections, pour lesquelles
je donnerais jusqu’à ma vie: c’est sa rougeur
ingénue; c’est l’éclat de mille talents; ce sont
ces délicieuses voluptés cachées sous sa robe discrète
(gaudia sub tacitâ ducere veste libet).» Il trouvait
sa Cynthie assez parfaite pour qu’elle se passât de
toilette et même de voile, quand il avait le bonheur
de la posséder, soit le jour, soit la nuit: «Chère
âme, lui disait-il avec transport, pourquoi donc
étaler tant d’ornements dans ta chevelure? Pourquoi
cette myrrhe de l’Oronte que tu répands sur ta
[309]
tête? Pourquoi cette étude à faire jouer les plis de
cette robe déliée, tissue dans l’île de Cos? Pourquoi
te vendre à ce luxe des barbares? Pourquoi, sous
une parure si chèrement achetée, étouffer les beautés
de la nature, et ne point laisser tes charmes
briller de leur propre éclat? Crois-moi, tu es trop
belle pour recourir à de tels artifices. L’Amour est
nu: il n’aime point le prestige des ajustements.»
L’axiome de Properce était toujours celui d’un
amant tendre et sensible: «Fille qui plaît à un seul
est assez parée.» Mais Cynthie s’obstinait à conserver,
dans le tête-à-tête le plus intime, le gênant
attirail de ses vêtements et de ses joyaux. Properce,
en nous initiant aux mystères d’une nuit amoureuse,
se plaint amèrement de cette habitude de pudeur
ou de pruderie, qu’il aurait pu expliquer par la découverte
de quelque difformité ou de quelque imperfection
cachée; il nous représente Cynthie ramenant
sans cesse sa tunique sur son sein, quoique la
lampe fût éteinte: «A quoi bon, lui dit-il, condamner
Vénus à s’ébattre dans les ténèbres? Si tu
l’ignores, les yeux sont nos guides en amour. C’est
nue, et lorsqu’elle sortait de la couche de Ménélas,
qu’Hélène, à Sparte, alluma au cœur de Pâris le feu
qui le consuma; c’est nu, qu’Endymion captiva la
sœur d’Apollon; c’est nue aussi que la déesse dormit
avec lui (nudæ concubuisse deæ). Si donc tu persistes
à coucher vêtue, tu verras si mes mains sont
habiles à mettre en pièces une tunique. Bien plus,
[310]
si tu pousses à bout ma colère, tu montreras le lendemain
à ta mère tes bras meurtris. Est-ce que ta
gorge pendante t’empêche de te livrer à ces ébats?
Cela pourrait être, si tu avais honte de montrer les
traces de la maternité.» Cynthie ne tenait compte
de ces beaux raisonnements, et Properce était bien
forcé de se contenter de ce qu’on lui offrait:
«Qu’elle veuille bien m’accorder quelques nuits
semblables, disait-il avec enivrement, et ma vie
sera longue dans une seule année; qu’elle m’en
donne beaucoup d’autres, et dans ces nuits-là je
me croirai immortel. En une nuit chacun peut être
dieu!»
Cet amour n’était pourtant pas sans nuages. Cynthie
se devait journellement aux exigences de son
métier; car, sans compter son préteur d’Illyrie, elle
avait des galants qui subvenaient à la dépense de la
maison. Elle n’accordait donc pas à Properce toutes les
faveurs qu’il réclamait à titre d’amant déclaré; elle
le tenait souvent à l’écart, elle lui fermait sa porte,
du moins la nuit, qui appartenait aux amours mercenaires;
mais elle couvrait autant que possible de
prétextes honnêtes la malhonnête vérité, qui blessait
le cœur du poëte; elle mettait sur le compte des
fêtes d’Isis, de Junon ou de quelque déesse, la
continence qu’elle s’imposait, disait-elle, à regret:
«Déjà sont encore revenues ces tristes solennités
d’Isis! écrivait un jour Properce. Déjà
Cynthie a passé dix nuits loin de moi! Périsse la
[311]
fille d’Inachus, qui des tièdes rivages du Nil a
transmis ses mystères aux matrones de l’Ausonie,
elle qui tant de fois sépara deux amants avides de
se rejoindre! Quelle que fût cette déesse, elle a
toujours été fatale à l’amour!» Cependant Properce
ne doutait pas qu’Isis fût seule coupable des scrupules
et des refus de Cynthie, qu’il essayait en vain
d’attendrir, en lui disant: «Certes nulle femme
n’entre avec plaisir dans son lit solitaire; il est quelque
chose que l’amour vous force à y souhaiter. La
passion est toujours plus vive pour les amants absents;
une longue jouissance nuit toujours aux
amants assidus.» Cynthie le laissait dire et ne changeait
rien à son genre de vie. Non-seulement elle
réservait pour les rivaux de Properce les nuits
qu’elle prétendait donner à Isis, mais encore elle
passait une partie de ses nuits à boire, à chanter,
à jouer aux dés. Properce ne pouvait ignorer d’ailleurs
ce qui faisait l’opulence de sa maîtresse, et,
comme il n’avait pas les trésors d’Attale pour payer
ce luxe dont il savait l’origine impure, il en était
réduit à gémir le plus poétiquement du monde:
«Corinthe vit-elle jamais dans la maison de Laïs
une telle affluence, lorsque toute la Grèce soupirait
à sa porte! s’écrie-t-il, en avouant que sa Cynthie
n’était qu’une courtisane à la mode. Fut-il jamais
une cour plus nombreuse aux pieds de cette Thaïs
mise en scène par Ménandre et qui égaya si longtemps
les loisirs du peuple d’Érichtée! Cette Phryné,
[312]
qui aurait pu relever Thèbes de ses cendres, eut-elle
la joie de compter plus d’admirateurs! Non, ô
Cynthie, tu les surpasses toutes, et, de plus, tu te
fais une parenté selon tes caprices, afin de légitimer
des baisers dont tu as si peur de manquer!» Ces reproches,
assez obscurs, signifient sans doute que
Cynthie faisait passer ses amants pour des parents
qu’elle recevait avec la plus touchante hospitalité.
Au reste, Properce était si jaloux d’elle, qu’il la
soupçonnait parfois de cacher un amant dans sa
robe (et miser in tunicâ suspicor esse virum).
Ce n’était pas seulement à Rome que Cynthie réunissait
autour d’elle cette foule de concurrents plus
ou moins épris et plus ou moins généreux; c’était
aussi aux bains de Baïes où elle tenait sa cour pendant
la saison des eaux thermales. La ville de Baïes
et les environs voyaient affluer alors l’élite de la
richesse, de la corruption et du plaisir. Les courtisanes
grecques en renom se seraient regardées
comme déchues, si elles n’eussent étalé leur luxe insolent
au milieu des orgies de ce lieu de délices;
elles y venaient chercher de nouvelles intrigues et
de nouveaux profits. Properce était donc jaloux de
Baïes, comme il l’eût été de dix rivaux à la fois:
«O Cynthie! as-tu quelque souci de moi? lui écrivait-il
pendant ses absences, où il ne se nourrissait
que des souvenirs du passé et des espérances de
l’avenir. Te rappelles-tu toutes les nuits que nous
avons passées ensemble? Quelle est la place qui me
[313]
reste en ton cœur? Peut-être, en ce moment, un rival
ennemi veut-il que j’efface ton nom de mes vers.»
Properce, qui n’avait pas le droit ni peut-être les
moyens de la rejoindre à Baïes, s’indignait contre
cette Baïes corrompue, contre ces rivages témoins
de tant de brouilles amoureuses, contre cet écueil
de la chasteté des femmes: «Ah! périssent à jamais,
s’écriait-il, périssent Baïes et ses eaux, qui engendrent
tous les crimes de l’amour!» Au reste, il ne
pouvait guère se faire illusion sur l’objet du voyage
de Baïes; il n’ignorait pas, d’ailleurs, que Cynthie
n’avait pas d’autre revenu que celui de ses charmes;
il la connaissait même, pour l’avoir vue à l’œuvre:
«Cynthie ne recherche pas les faisceaux, publia-t-il
dans un moment de dépit; elle ne fait nul cas
des honneurs: c’est toujours la bourse des amateurs
qu’elle pèse... Ainsi donc, on peut faire trafic de
l’amour! O Jupiter! ô infamie! Et nos filles s’avilissent
par ce trafic! Ma maîtresse m’envoie sans cesse
lui pêcher des perles dans la mer; elle me commande
d’aller pour elle butiner à Tyr! Oh! plût aux
dieux que personne à Rome ne fût riche!» Lorsque
Properce se laissait emporter à cet accès de mauvaise
humeur, il est vrai que Cynthie, accaparée par son
vilain préteur, avait interdit sa couche à l’amant de
cœur, pendant sept nuits consécutives.
Cynthie avait été la première maîtresse de Properce:
il lui jurait qu’elle serait la dernière. On doit
croire, en effet, qu’il lui donna longtemps et vainement
[314]
l’exemple de la constance. Il déclare, en plusieurs
endroits de ses élégies, qu’il était resté fidèle
à cette charmante infidèle, et l’on voit qu’il lui pardonnait
tout, dès qu’elle lui permettait de rentrer
dans ce lit où la veille encore un autre régnait à sa
place; il se faisait si peu d’illusion à cet égard,
qu’il lui disait, tout en l’embrassant: «Toi, scélérate,
tu ne peux une seule nuit coucher seule ni
passer seule un seul jour!» Il y eut entre eux cependant
plusieurs brouilles, plusieurs séparations,
qui aboutirent à un raccommodement et à un redoublement
d’amour. Dans une de ces querelles d’amoureux,
Properce, le sévère Properce voulut oublier
Cynthie, en se jetant à corps perdu dans la
débauche, en fréquentant les courtisanes les plus
abordables; il avait perdu sa pudeur ordinaire, depuis
le jour où son ami Gallus, dans l’intention de
le distraire et de faire trêve à ses chagrins de cœur,
l’avait rendu témoin, pendant une nuit entière, de
ses propres amours avec une nouvelle maîtresse:
«O nuit dont il m’est si doux de me souvenir! avait
dit le poëte, électrisé par ce spectacle: ô nuit que
j’évoquerai souvent dans mes vœux ardents, nuit
voluptueuse où je t’ai vu, Gallus, pressant dans tes
bras ta jeune maîtresse, mourir d’amour en lui
adressant des paroles entrecoupées!» Au sortir de
cette dangereuse séance, Properce était infidèle à
Cynthie. Il ne songea pas à lui donner une rivale,
choisie parmi les matrones; il était trop soucieux de
[315]
son repos pour désirer autre chose que des plaisirs
faciles. Il se mit, comme il le dit lui-même, à suivre
les sentiers battus par le vulgaire et à s’abreuver
à longs traits aux sources impures de la prostitution
publique (ipsa petita lacu nunc mihi dulcis aqua est);
il adopta une maxime bien contraire à celle de l’amour:
«Malheur à ceux qui se plaisent à assiéger
une porte fermée!» Il était résolu à ne plus aimer,
à ne plus abdiquer sa liberté: «Que toutes les filles
que l’Oronte et l’Euphrate semblent avoir envoyées
pour moi à Rome, que ces sirènes s’emparent de
moi!» Et pourtant il ne se consolait pas d’avoir
quitté Cynthie, et il continuait à la chanter, en la
maudissant: «Jamais la vieillesse ne me détachera
de mon amour, murmurait-il tout bas, quand je
devrais être un Tithon ou un Nestor!» Il apprit
tout à coup que Cynthie était tombée malade; il courut
chez elle: il ne quitta plus le chevet du lit; il la
soigna si tendrement, qu’il crut l’avoir arrachée à
la mort. Quand elle fut convalescente: «O lumière
de ma vie, lui dit-il, puisque tu es hors de danger,
porte tes offrandes sur les autels de Diane!
Rends aussi hommage à la déesse qui fut changée
en génisse (Io): dix nuits d’abstinence pour cette
déesse et dix d’amour pour moi!»
A la suite de cette réconciliation, les rôles changèrent
entre les amants; la jalousie se calma dans le
cœur de Properce, pour s’allumer dans celui de
Cynthie. Il venait d’être délivré enfin de l’odieuse
[316]
malveillance qui s’acharnait à troubler ses amours:
Acanthis, l’entremetteuse, qui avait tant d’empire
sur Cynthie, qui lui procurait des parfums, des
philtres, des cosmétiques, qui se chargeait de ses
messages, qui était la protectrice née des riches adorateurs
et l’ennemie implacable d’un poëte déshérité,
Acanthis, cette terrible mégère, avait exhalé
sa vilaine âme dans un accès de toux; elle n’était
plus là, l’infâme conseillère, pour dire à Cynthie:
«Que ton portier veille pour ceux qui apportent; si
l’on frappe les mains vides, qu’il dorme comme un
sourd, le front appuyé sur la serrure fermée. Ne repousse
pas la main calleuse du matelot, si elle est
pleine d’or, ni les rudes caresses du soldat qui
paye, ni même celles de ces esclaves barbares, qui,
l’écriteau suspendu au cou, gambadent au milieu
du marché. Regarde l’or, et non la main qui le
donne. Que te restera-t-il des vers qu’on te chante?
Sois sourde à ces vers que n’accompagne pas un
présent d’étoffes splendides, à cette lyre dont les
accords ne se mêlent pas aux sons de l’or.» Properce
assista aux derniers moments d’Acanthis et à
ses honteuses funérailles, qui mirent en évidence les
bandelettes de ses rares cheveux, sa mitre décolorée
et enduite de crasse, sa chienne si bien apprise
à faire le guet à la porte des courtisanes: «Qu’une
vieille amphore au col tronqué soit l’urne cinéraire
de cette abominable sorcière, s’écria Properce, et
qu’un figuier sauvage l’étreigne dans ses racines!
[317]
Que chaque amant vienne assaillir son tombeau à
coups de pierres, et que les pierres soient accompagnées
de malédictions!» Cynthie, qui n’écoutait
plus la voix empoisonnée d’Acanthis, donna libre
cours à sa tendresse pour Properce et en même
temps à sa jalousie. Elle le fit épier, elle l’épia elle-même;
elle l’accusa de torts qu’il n’avait pas envers
elle, et lui supposa autant de maîtresses qu’elle avait
eu d’amants. Properce attestait en vain son innocence.
Elle l’accablait de reproches et d’injures;
elle le mordait, le battait, l’égratignait, et finissait
par se martyriser elle-même, comme pour se punir
de n’être plus assez belle ni assez aimée.
Cette jalousie vague s’était fixée sur une courtisane,
nommée Lycinna, dont Properce avait été
l’amant, avant de devenir le sien. Cynthie se porta
bientôt à de telles fureurs contre la pauvre Lycinna,
que Properce fut obligé de la conjurer de faire grâce
à cette ancienne rivale, qui n’avait rien à se reprocher
envers elle; il avoua qu’il avait eu dans sa
jeunesse quelques rapports avec cette Lycinna, mais
qu’il se souvenait à peine de l’avoir connue, quoique
Lycinna lui eût enseigné, dans ces nuits d’amour,
une science qui ne lui était que trop familière.
«Ton amour, ma Cynthie, disait-il sans la convaincre,
a été le tombeau de tous mes autres
amours!... Cesse-donc tes persécutions contre Lycinna,
qui ne les a pas méritées. Quand votre ressentiment,
ô femmes, s’est donné carrière, il ne
[318]
revient jamais!» Properce, pour avoir cette paix
si nécessaire aux travaux de l’esprit, évitait de rien
faire, que Cynthie pût interpréter dans le sens de sa
jalousie; mais, comme il avait cessé de se montrer
jaloux lui-même, il avait l’air indifférent, et sa maîtresse
n’en était que plus empressée à découvrir les
causes de cette indifférence. Un jour, elle prétexta
un vœu qu’elle avait fait, d’offrir un sacrifice à Junon
Argienne dans son temple de Lanuvium. Ce
temple était situé sur la droite de la voie Appienne,
non loin des murs de Rome; dans le bois sacré qui
entourait le temple, il y avait un antre profond, qui
servait de retraite à un dragon, auquel les vierges
apportaient tous les ans des gâteaux de froment,
qu’elles lui présentaient, les yeux couverts d’un bandeau;
quand elles étaient pures, le monstre acceptait
leur offrande; sinon, il la rejetait avec d’effroyables
sifflements. Cynthie n’avait rien à porter à ce dragon:
elle ne pouvait avoir affaire qu’à la déesse.
Son voyage n’était, d’ailleurs, qu’une manière de
s’absenter, en laissant le champ libre à son amant.
Properce la vit partir dans un char attelé de mules
à la longue crinière, conduit par un efféminé au
visage rasé, et précédé par des molosses aux riches
colliers. «Après tant d’outrages faits à ma couche,
dit le poëte en racontant son aventure, je voulus,
changeant aussi de lit, porter mon camp sur un
autre terrain.» Il fit donc avertir deux joyeuses
courtisanes, Phyllis, peu séduisante à jeun, mais
[319]
charmante dès qu’elle avait bu, et Téïa, blanche
comme un lis, mais dont l’ivresse ne se contentait
pas d’un seul amant. La première demeurait sur le
mont Aventin, près du temple de Diane; la seconde,
dans les bosquets du Capitole. Elles vinrent toutes
deux dans le quartier des Esquilies, où était située
la petite maison de Properce. Tout avait été préparé
pour les recevoir d’une manière digne d’elles. Properce
se promettait d’adoucir ainsi ses chagrins, et
de raviver ses sens dans des voluptés qui lui étaient
inconnues (et venere ignotâ furta novare mea).
Le festin était servi sur l’herbe, au fond du jardin;
rien n’y manquait, ni le vin de Méthymne, ni
les aromates, ni les potions glacées, ni les roses
effeuillées; Lygdamus présidait aux bouteilles. Il
n’y avait qu’un lit de table, mais assez grand pour
contenir trois convives. Properce se plaça entre les
deux invitées. Un Égyptien jouait de la flûte, Phyllis
jouait des crotales, un nain difforme soufflait
dans un flageolet de buis. Mais cette musique ne
faisait qu’accroître la distraction du poëte, qui suivait
en pensée Cynthie au temple de Lanuvium.
Phyllis et Téïa étaient pourtant ivres, et la lumière
des lampes déclinait; on renversa la table pour
jouer aux dés. Properce n’amenait que des nombres
funestes, tels que celui qu’on nommait les
chiens; la chance ne daignait pas lui envoyer le
coup de Vénus, c’est-à-dire le numéro un. Phyllis
avait beau découvrir sa gorge et Téïa retrousser sa
[320]
tunique, Properce était aveugle et sourd (cantabant
surdo, nudabant pectora cæco). Tout à coup, la porte
d’entrée a crié sur ses gonds, et des pas légers
retentissent dans le vestibule. C’est Cynthie qui accourt,
pâle, les cheveux en désordre, les poings
fermés, les yeux pleins d’éclairs: c’est la colère
d’une femme, et l’on dirait une ville prise d’assaut
(spectaculum captâ nec minus urbe fuit). D’une main
forcenée, elle jette les lampes à la figure de Phyllis;
Téïa, épouvantée, crie au feu et demande de l’eau;
Cynthie les poursuit l’une et l’autre, déchire leurs
robes, arrache leurs cheveux, les frappe et les injurie.
Elles lui échappent à grand’ peine et se réfugient
dans la première taverne qu’elles rencontrent.
Cependant le bruit a éveillé tout le quartier; on
accourt avec des flambeaux; on voit Cynthie,
semblable à une bacchante en fureur, qui s’acharne
sur Properce, qui le soufflette, qui le mord jusqu’au
sang, et qui veut lui crever les yeux. Properce, qui
se sent coupable, accepte son châtiment avec une
secrète joie; il embrasse les genoux de Cynthie, il la
conjure de s’apaiser, il réclame son pardon; elle le
lui accorde, à condition qu’il ne se promènera plus,
richement paré, sous le portique de Pompée ni dans
le Forum; qu’il ne tournera plus ses regards vers
les derniers gradins de l’amphithéâtre, où siégent
les courtisanes, et que son Lygdamus sera vendu,
comme un esclave infidèle, les pieds chargés d’une
double chaîne. Properce consent à tout, pour expier
[321]
son impuissante tentative d’infidélité; il baise les
mains de sa despotique maîtresse, qui sourit à ce
triomphe. Ensuite, elle brûle des parfums, et lave
avec de l’eau pure tout ce que le contact de Phyllis
et de Téïa laissait empreint d’une souillure à ses
yeux; elle ordonne à Properce de changer de vêtements,
surtout de chemise, et d’exposer trois fois
ses cheveux à une flamme de soufre. Enfin, elle fait
mettre des couvertures fraîches dans le lit, où elle
se couche avec son amant: c’est là que la paix
s’achève entre eux (et toto solvimus arma toro).
Properce devait survivre à sa Cynthie. Une rivale,
une vile courtisane, nommée Nomas, qui vendait
ses nuits à vil prix sur la voie publique, versa
le poison, qu’un de ses amants avait fait apprêter
par une magicienne, pour se venger d’un affront
qu’il avait reçu de cette fière maîtresse. Properce
était absent alors; il ne put diriger les funérailles,
qui furent faites à la hâte et sans pompe: on ne
jeta pas de parfums dans le bûcher; on ne brisa
pas un vase plein de vin sur la cendre fumante de
la victime d’un si noir attentat: on avait l’air de
vouloir effacer les traces du crime. Lorsque Properce
revint à Rome, Cynthie avait été inhumée au
bord de l’Anio, sur la route de Tibur, dans l’endroit
même qu’elle avait choisi pour sa sépulture.
Properce resta foudroyé par cette mort soudaine,
mais il ne chercha pas à en punir les auteurs; il
était jour et nuit poursuivi par le spectre de Cynthie,
[322]
qui lui demandait vengeance; mais il n’osa
pas se faire l’accusateur de l’empoisonneur. Ce devait
être un personnage puissant, car Nomas, qui
avait été l’instrument du crime, se vit tout à coup
enrichie, et balaya la poussière avec sa robe brochée
d’or; en revanche, les amies de Cynthie, qui
élevèrent la voix pour la regretter ou pour la défendre,
furent impitoyablement traitées, on ne sait
par quel ordre ni par quel pouvoir: pour avoir
porté quelques couronnes sur sa tombe, la vieille
Pétalé fut attachée à la chaîne de l’infâme billot; la
belle Lalagé, suspendue par les cheveux, fut battue
de verges, pour avoir invoqué le nom de Cynthie.
Enfin, Properce, assiégé par sa conscience, et par
les fantômes qui troublaient son sommeil, érigea une
colonne et grava une épitaphe sur la tombe de sa
chère maîtresse; il accomplit aussi les dernières volontés
de cette infortunée, en recueillant chez lui la
vieille nourrice et l’esclave bien-aimée de Cynthie;
mais, en dépit des avertissements suprêmes qui lui
venaient par la porte des songes, il ne brûla pas les
vers qu’il avait consacrés à ses amours. Une nuit,
l’ombre mélancolique de Cynthie lui apparut et lui
dit: «Sois à d’autres maintenant. Bientôt tu seras
à moi seule; tu seras à moi, et nos os confondus
reposeront dans le même tombeau.» A ces mots,
l’ombre plaintive s’évanouit dans les embrassements
du poëte, qui avait cru la saisir et l’enlever au
royaume des mânes. Properce ne survécut pas longtemps
[323]
à celle qu’il ne cessait de pleurer: il mourut
à l’âge de quarante ans, et fut réuni à Cynthie dans
le tombeau qu’il lui avait élevé dans un des sites
les plus riants des cascades de Tibur. Cynthie, qui
partage l’immortalité de son poëte, ne fut pourtant
qu’une courtisane fameuse.

Sommaire.—Tibulle.—Sa vie voluptueuse.—L’affranchie Plania
ou Délie.—Le mari de cette courtisane.—La mère de Délie
protége les amours de sa fille avec Tibulle.—Tendresse platonique
de Tibulle.—Recommandations du poëte à la mère de
son amante.—Philtres et enchantements.—Ennuyée des sermons
de Tibulle, Délie lui ferme sa porte.—Tibulle dénonce
au mari de Délie l’inconduite de sa femme.—Némésis.—L’amant
de cette courtisane.—Amour de Tibulle pour Némésis.—Prix
des faveurs de cette prostituée.—Cerinthe empêche
Tibulle de se ruiner pour Némésis.—Tibulle amoureux de
Néère.—Refus de Néère d’épouser Tibulle.—Néère prend un
amant.—Désespoir de Tibulle.—Déclaration d’amour à Sulpicie,
fille de Servius.—Sulpicie accorde ses faveurs à Tibulle.—Infidélités
de Tibulle.—Glycère.—Amour sérieux de Tibulle
pour cette courtisane grecque.—Dédains de Glycère.—Ode
consolatrice d’Horace à Tibulle.—Mort de Tibulle.—Délie
et Némésis à ses funérailles.—Citheris.—Cornelius Gallus.—Citheris.—Lycoris.—Gallus
à la guerre des Parthes.—Son
poëme à Lycoris.—Retour de Gallus.—Infidélités de Lycoris.—Gentia
et Chloé.—Lydie.—La Lycoris de Maximianus,
ambassadeur de Théodoric.—Ovide.—Corinne.—Conjectures
sur le vrai nom de cette courtisane.—Le mari de Corinne.—On
n’a jamais su positivement ce que c’était que cette courtisane.—Manéges
[326]
amoureux que conseille Ovide à Corinne.—Corinne
chez Ovide.—Jalousie et brutalité d’Ovide.—Son
désespoir d’avoir frappé Corinne.—L’entremetteuse Dipsas.—Insinuations
de cette horrible vieille.—L’eunuque Bagoas.—Napé
et Cypassis, coiffeuses de Corinne.—Amours d’Ovide et
de Cypassis.—Avortement de Corinne.—Indignation d’Ovide
à la nouvelle de cet odieux attentat.—Empressement de Corinne
pour regagner le cœur d’Ovide.—Froideur d’Ovide.—Honte
et dépit de Corinne.—Ovide est mis à la porte.—Plaintes
et insistances d’Ovide pour obtenir le pardon de sa conduite.—Corinne
et le capitaine romain.—Gémissements
d’Ovide.—Ovide se retire dans le pays des Falisques.—Son
retour à Rome.—Corinne devenue courtisane éhontée.—Dernière
lettre d’Ovide à Corinne.—Ovide compose son poëme de
l’Art d’aimer, sous les yeux et d’après les inspirations des courtisanes.—Sa
liaison secrète supposée avec la fille d’Auguste.—Ovide
est exilé au bord du Pont-Euxin.—Son exil attribué
à sa passion adultère supposée.—Ovide apprend que Corinne
est descendue au dernier degré de la Prostitution.—Il meurt
de chagrin et sa dernière pensée est pour Corinne.
L’amour des courtisanes fut aussi toute la vie et
toute la renommée d’un contemporain de Properce:
Tibulle aima et chanta ses maîtresses. Tibulle, ami
de Virgile, d’Horace et d’Ovide, fut comme eux un
grand poëte et un tendre amant. Il était né à Rome,
quarante-trois ans avant l’ère chrétienne, le même
jour qu’Ovide. Son goût pour la poésie se révéla de
bonne heure, et, dès l’âge de dix-sept ans, il reconnut
qu’il n’était pas fait pour suivre la carrière des
armes, mais que son tempérament le portait à se
jeter dans celle des plaisirs: «C’est là que je suis
bon chef et bon soldat!» s’écrie-t-il dans une de ses
élégies. En effet, la vie voluptueuse, qui était sa
[327]
vocation, ne tarda pas à épuiser ses forces physiques
et à développer sa sensibilité nerveuse; il ne
possédait pas une complexion assez énergique pour
résister longtemps à l’abus de ces plaisirs, que la
corruption romaine avait si monstrueusement perfectionnés:
au milieu des jeunes débauchés dont il
partageait les orgies, il s’attristait tous les jours de
son infériorité matérielle et il s’aperçut bientôt de
son impuissance. Dès lors, il résolut de retrouver par
le cœur les jouissances que sa nature délabrée n’était
plus capable de lui procurer. Jusque-là, il avait
éparpillé entre cent maîtresses toute l’activité de ses
passions vagabondes; il les concentra désormais sur
une seule femme. Cette femme ne pouvait être
qu’une courtisane, car, à Rome, la loi et les mœurs
s’opposaient à tout amour illégitime, qui s’adressait
à une femme de condition libre, et qui n’aboutissait
pas au mariage. Tibulle ne se souciait pas de se
marier, et il ne cherchait pas une liaison mystérieuse
et coupable, qu’il eût été obligé de cacher aux yeux
même de ses amis; bien au contraire, il voulait
prendre le public pour témoin et confident de ses
occupations amoureuses.
Il arrêta d’abord son choix sur une courtisane,
qu’il nomme Délie dans le premier livre de ses élégies,
et qui portait certainement un autre nom. Suivant
l’opinion la plus probable, c’était une affranchie,
nommée Plania, dont le mari complaisant
exploitait habilement la beauté et la coquetterie.
[328]
Tibulle n’était point assez riche pour être accepté ou
même toléré par cet avare mari, qui n’avait de
jalousie qu’à l’égard d’une infidélité improductive;
mais la mère de Délie, indignée des honteuses servitudes
qu’on imposait à sa fille, prit le parti de Tibulle
auprès de celle-ci qu’il aimait et qu’il ne payait
pas. Ce fut elle, qui amena Délie à Tibulle dans les
ténèbres, et qui, craintive et silencieuse, unit en
secret leurs mains tremblantes; ce fut elle, qui présidait
aux rendez-vous nocturnes, qui attendait l’amant
à la porte et qui reconnaissait le bruit lointain
de ses pas. Ces rendez-vous n’étaient peut-être pas,
il est vrai, très-dangereux pour la vertu de la femme
et pour l’honneur du mari; car Tibulle raconte lui-même
qu’avant d’avoir touché le cœur de Délie, il
n’était déjà plus homme: «Plus d’une fois, dit-il,
je serrai dans mes bras une autre beauté; mais,
quand j’allais goûter le bonheur, Vénus me rappelait
ma maîtresse et trahissait mes feux; alors cette
belle quittait ma couche, en disant que j’étais sous
le pouvoir d’un maléfice, et publiait, hélas! ma
triste impuissance.» Il est permis de croire que
Tibulle n’avait pas changé, en devenant l’amant de
Délie. Voilà sans doute pourquoi, mécontent de lui-même
et inquiet de son impuissance, il recommande
à la vieille mère de Délie, «qu’elle lui apprenne la
chasteté (sit modo casta doce), bien que le saint bandeau
ne relève pas ses cheveux, bien que la robe
traînante ne cache pas ses pieds.» C’était donc de
[329]
la part du poëte un amour plus idéal que matériel,
et le cœur en faisait presque tous les frais. Cependant
les deux amants se voyaient quelquefois la nuit,
à l’insu du mari, et Tibulle, exalté par sa tendresse
toute platonique, attendait patiemment à la porte de
Délie, que cette porte, souvent muette et immobile,
tournât furtivement sur ses gonds, quand le jaloux
était absent ou endormi: «Je ne ressens aucun mal,
du froid engourdissant d’une nuit d’hiver, disait-il
après avoir maudit la porte inexorable; aucun mal,
de la pluie qui tombe par torrents. Ces rudes épreuves
me trouvent insensible, pourvu que Délie tire
enfin les verrous et que le tacite signal de son doigt
m’appelle à ses côtés.»
Cet amour eut toutes les péripéties des autres
amours, les jalousies, les ruptures, les raccommodements,
les larmes et les baisers; mais le poëte avait
bien de la peine à s’accoutumer au métier que faisait
sa maîtresse. Il sentait bien pourtant qu’il ne
pouvait pas lui donner le prix de ses caresses et
qu’il devait fermer les yeux ou rompre avec elle:
«O toi qui le premier enseignas à vendre l’amour,
s’écriait-il avec rage, qui que tu sois, puisse la
pierre funéraire peser sur tes os!» Il n’avait pas
d’or, pour satisfaire la vénalité de l’infâme époux de
sa Délie; il eut recours aux philtres et aux enchantements,
dans l’espoir de repousser ses rivaux et de
forcer sa maîtresse à lui être fidèle, mais enchantements
et philtres ne lui réussirent pas: «J’ai tout
[330]
fait, tout, écrivait-il à Délie, et c’est un autre qui
possède ton amour, un autre qui jouit, qui est heureux
du fruit de mes incantations!» Délie, fatiguée
des plaintes et des reproches qu’elle savait trop
mériter, ferma sa porte au poëte désolé: «Ta porte
ne s’ouvre point, disait-il avec amertume, c’est la
main pleine d’or, qu’il faut y frapper!» Dans son
désespoir, il alla jusqu’à dénoncer ses propres
amours au mari, qui feignait de les ignorer, et il lui
offrit de l’aider à garder sa femme, comme aurait
pu le faire un esclave dévoué. Délie, que l’habitude
du vice avait rendue astucieuse, ne fit que
rire des dénonciations de Tibulle et soutint effrontément
qu’elle ne lui avait jamais accordé que de la
pitié. Le mari affecta de la croire et imposa silence
à son accusateur; mais celui-ci, piqué au jeu et
irrité de recevoir un pareil démenti, entra dans les
détails les plus circonstanciés au sujet de sa liaison
avec la perfide: «Souvent, raconta-t-il au mari
narquois, en feignant d’admirer ses perles et son
anneau, j’ai su, sous ce prétexte, lui serrer la main;
souvent, avec un vin pur, je te versais le sommeil,
tandis que, dans ma coupe plus sobre, une eau furtive
m’assurait la victoire!» Le mari haussait les
épaules et souriait sans répondre, comme pour dire:
«Que ces poëtes sont fous!» Tibulle, tourmenté
par la jalousie, s’avisait de donner des conseils à
ce mari trompé et heureux de l’être: «Prends
garde, lui disait-il, qu’elle n’accorde aux jeunes
[331]
gens la faveur de fréquents entretiens; qu’une robe
aux larges plis ne laisse, quand elle reposera, son
sein découvert; que ses signes d’intelligence ne
t’échappent, et qu’avec son doigt mouillé elle ne
trace sur la table d’amoureux caractères!» Tibulle
oubliait que c’était de lui-même que Délie avait appris
l’art de tromper son Argus: il lui avait même
donné le secret des sucs et des herbes qui effaçaient
l’empreinte livide que fait la dent d’un amant dans
les combats de Vénus (livor quem facit impresso
mutua dente Venus).
Tibulle avait trop offensé Délie pour qu’elle pût
lui pardonner ses outrages; la rupture entre eux
était définitive, et le mari y trouvait son compte,
puisque sa femme ne serait plus détournée d’autres
amours plus lucratifs. Quand Tibulle fut convaincu
de l’impossibilité d’une réconciliation, il ne s’obstina
pas à la poursuivre en vain; il aima ailleurs. C’était
encore une courtisane, plus avide et plus inflexible
que Délie. Il se mit pourtant en frais de poésie pour
elle; il se flatta d’arriver à ce cœur avare, par les
séductions de la vanité: il fit fumer son encens poétique
aux pieds de la belle dédaigneuse, qu’il adorait
sous le nom de Némésis. Cette courtisane était
entretenue par un riche affranchi, qui avait été
plusieurs fois vendu au marché des esclaves et qui
devait sa richesse à de méprisables industries. Elle
ne faisait aucun cas de ce parvenu, que la fortune
avait à peine décrassé; mais elle n’avait aucun goût
[332]
pour des amours qui ne lui rapporteraient rien:
«Hélas! s’écriait tristement Tibulle, ce sont les riches,
je le vois, qui plaisent à la beauté! Eh bien!
que la rapine m’enrichisse, puisque Vénus aime
l’opulence! que Némésis nage désormais dans le
luxe, et s’avance par la ville, en étalant mes largesses
aux regards éblouis! qu’elle porte ces tissus
transparents où la main d’une femme de Cos entrelaça
des fils d’or! qu’elle attache à ses pas ces noirs
esclaves que l’Inde a brûlés et que le soleil, dans sa
course plus rapprochée de la terre, a flétris de ses
feux! que, lui offrant à l’envi leurs plus belles couleurs,
l’Afrique lui donne l’écarlate, et Tyr, la pourpre!»
Ce n’était là que des projets de poëte, et
Tibulle, après les avoir pompeusement retracés dans
une élégie, ne se hâtait pas de les mettre à exécution.
Il attendit un an, un an tout entier, les faveurs
de cette Némésis, qui sans doute les lui fit payer
d’une manière ou d’autre, mais qui ne lui inspira
guère le désir de les demander et de les obtenir une
seconde fois au même prix. Il fut sur le point de
vendre le modeste héritage de ses ancêtres, pour
satisfaire aux importunités de sa nouvelle maîtresse;
son ami Cerinthe l’empêcha de faire cette
folie, et il essaya de ne payer qu’en monnaie de
poëte: il fut congédié dédaigneusement. «C’est
une vile entremetteuse, écrivait-il à ses amis Cerinthe
et Macer, qui met obstacle à mes amours, car
Némésis est bonne. C’est l’infâme Phryné qui m’écarte
[333]
sans pitié; elle porte et rapporte en secret,
dans son sein, de furtifs messages d’amour. Souvent,
lorsque, du seuil où je l’implore en vain, je
reconnais la voix de ma maîtresse, elle me dit que
Némésis est absente; souvent, quand je réclame
une nuit qui me fut promise, elle m’annonce que
ma belle est souffrante et tout épouvantée d’un présage
menaçant. Alors je meurs d’inquiétude; alors
mon imagination égarée me montre un rival dans
les bras de Némésis et de combien de manières il
varie ses plaisirs; alors, infâme Phryné, je te voue
aux Euménides!» Ses amis le consolèrent et lui
firent comprendre que Rome ne manquait pas de
courtisanes qui seraient fières d’être aimées et
chantées par un poëte comme lui.
Aussitôt, voilà Tibulle amoureux de la jeune et
chaste Néère, qui n’était probablement pas celle
d’Horace. Tibulle, dans le troisième livre de ses
Élégies, qu’il lui a consacré, la représente comme
une innocente enfant, élevée par la plus tendre des
mères et par le plus aimable des pères. C’était, ce ne
pouvait être qu’une fille d’affranchis, et cependant
Tibulle offrit de l’épouser, ou, du moins, de la prendre
chez lui en concubinage. Quoique des cheveux
blancs n’eussent point encore fait invasion dans sa
noire chevelure, quoique la vieillesse au dos courbé
et à la marche tardive ne fût pas venue pour lui, il
se sentait près de sa fin: c’était une lampe épuisée
d’huile, qui jetait un dernier rayon. La chaste Néère,
[334]
comme il l’appelle sans cesse, refusa d’unir sa fraîche
et ardente jeunesse à cette jeunesse refroidie et
ravagée. Elle voyait avec plaisir les attentions dont
elle était l’objet de la part du noble poëte; elle
écoutait ses vers et ses soupirs; elle n’exigeait pas
d’autres présents que le recueil des Élégies de Tibulle,
écrites sur un blanc vélin et revêtues d’une
reliure dorée. Mais elle était dans l’âge de l’amour;
elle se donna donc un amant, sans retirer son amitié
à Tibulle, qui avait espéré mieux: «Fidèle ou
constante, lui disait-il, tu seras toujours ma chère
Néère!» Ce ne fut pas sans larmes et sans luttes,
qu’il se résigna enfin à n’être plus que le frère de sa
Néère; il crut mourir de chagrin; il voulait qu’on
gravât ces mots sur sa tombe: «La douleur et le
désespoir de s’être vu arracher sa Néère ont causé
son trépas!» Ses amis, ses anciens compagnons de
table et de plaisir, les poëtes de l’amour et des
courtisanes, l’entraînèrent encore, pour le distraire,
dans leurs joyeuses réunions; ils l’invitèrent
à chanter les louanges de Bacchus, qui vient en
aide aux souffrances des amants: «Oh! qu’il me
serait doux, murmurait Tibulle en vidant son verre,
de reposer près de toi pendant la longueur des
nuits, de veiller près de toi pendant la longueur
des jours! Infidèle à qui méritait son amour, elle
l’a donné à qui n’en est pas digne! Perfide!... Mais,
bien que perfide, elle m’est chère encore!» Bacchus,
qui s’emparait de lui par degrés, faisait évanouir
[335]
le fantôme de Néère: «Allons, esclave,
allons! s’écriait Tibulle en tendant sa coupe à l’échanson:
que le vin coule à flots plus pressés! Il y a
longtemps que j’aurais dû arroser ma tête avec les
parfums de la Syrie et ceindre mon front de couronnes
de fleurs!»
Tibulle savait bien qu’il ne devait plus attendre
d’une maîtresse ce doux échange de sentiments,
dans lequel son imagination rêvait encore le bonheur:
«La jeunesse et l’amour, disait-il naguère en
regrettant d’être encore jeune et de ne plus être
amoureux, la jeunesse et l’amour, ce sont les véritables
enchanteurs!» Il n’avait plus recours à la
magie et à des philtres impuissants, pour suppléer à
tout ce que lui avait enlevé sa maladie d’épuisement
et de langueur; il essaya de prouver à Néère qu’il
était capable de devenir un mari, et même, au besoin,
un amant; il fit une déclaration d’amour à Sulpicie,
fille de Servius, et il esquissa le portrait de cette
nouvelle divinité: «La grâce compose en secret
chacun de ses gestes, chacun de ses mouvements,
et s’attache à tous ses pas. Dénoue-t-elle sa chevelure,
on aime à voir flotter les tresses vagabondes;
les relève-t-elle avec art, cette coiffure sied encore à
sa beauté. Elle nous enflamme, quand elle s’avance
enveloppée d’un manteau de pourpre tyrienne; elle
nous enflamme, quand elle vient à nous vêtue d’une
robe blanche comme la neige.» Sulpicie eut pitié
du poëte mourant; elle lui accorda plus qu’il ne demandait,
[336]
et elle recueillit les dernières lueurs de ce
cœur qui s’éteignait: «Nulle autre femme, lui disait-il
avec enthousiasme, ne pourra me ravir à ta
couche!... C’est la première condition que mit Vénus
à notre liaison! Seule tu sais me plaire, et après toi,
il n’est plus dans Rome une femme qui soit belle à
mes yeux... Dût le Ciel envoyer à Tibulle une autre
amante, il la lui enverrait en vain et Vénus elle-même
serait sans pouvoir!» Mais, à l’heure même
où le poëte prononçait ce serment de fidélité, il était
infidèle, et Glycère, une des plus délicieuses courtisanes
grecques qui fussent à Rome, avait voulu
aussi se faire une petite part d’immortalité dans les
vers de Tibulle. Celui-ci, étonné d’une bonne fortune
qu’il n’avait pas cherchée, pensait la devoir à
quelqu’un de ses mérites personnels, et il se mit en
devoir d’aimer sérieusement Glycère, qui n’aimait
que ses élégies. Tibulle, pour la première fois de sa
vie, s’avisa d’aimer comme un amant et non plus
comme un poëte; il ne composa pas un seul vers
pour Glycère, qui n’eut pas la patience d’attendre
une velléité poétique et qui tourna le dos au pauvre
moribond. Cette cruauté affecta profondément Tibulle,
dont la frêle santé en fut altérée au point que
ses amis comprirent qu’il avait reçu le coup de la
mort. Horace lui adressa une ode consolatrice, où il
le suppliait d’oublier la cruelle Glycère (ne doleas
plus nimio memor immitis Glyceræ) et Tibulle apprit
presqu’aussitôt, qu’Horace lui avait succédé dans les
[337]
bonnes grâces de cette capricieuse. Tibulle ne s’en
releva pas; il succomba enfin, à l’âge de vingt-quatre
ans. Sa mère et sa sœur lui avaient fermé les yeux,
et, le jour de ses funérailles, on vit apparaître ses
deux maîtresses, Délie et Némésis, vêtues d’habits
de deuil et donnant les marques de la plus vive douleur:
ces deux rivales suivirent le cortége funèbre
ensemble et confondirent leurs larmes sur le bûcher
de leur amant, chacune se disputant la gloire
d’avoir été la plus aimée.
Cette époque du règne d’Auguste fut le triomphe
des poëtes et des courtisanes, qui s’entendaient si
bien entre eux, qu’ils semblaient inséparables: là où
était une courtisane, il y avait toujours un poëte
amoureux, du moins dans ses vers. La brillante
Glycère partageait la vogue et les adorateurs avec
la charmante Citheris, autre courtisane grecque, qui
pourrait bien être la fille de celle que Jules César
avait aimée. Horace avait aimé aussi une Citheris,
dans laquelle nous n’osons reconnaître ni celle de
César ni celle de Cornelius Gallus. Ce dernier, ami
de Tibulle, d’Ovide et de Virgile, poëte comme eux
et comme eux très-recherché dans la société des
courtisanes, s’était attaché à Citheris, qu’il chanta
sous le nom de Lycoris, et il célébra ses amours
dans un poëme en quatre chants, dont nous n’avons
plus que quelques fragments passionnés:
«Que veut cette entremetteuse, s’écriait-il indigné,
lorsqu’elle essaie de nuire à mes amours et quand
[338]
elle porte de riches présents cachés dans son sein?
Elle vante le jeune homme qui envoie ces présents;
elle parle de son noble caractère, de son frais visage
que nul duvet n’ombrage encore, de sa blonde chevelure
qui se répand autour de sa tête en boucles
ondoyantes, de son talent à jouer de la lyre et à
chanter!... Oh! combien je tremble que ma maîtresse
ne soit infidèle!... La femme est de sa nature changeante
et toujours mobile; on ne sait jamais si elle
aime ou si elle hait!» Gallus était absent de Rome,
et la guerre l’avait entraîné avec les aigles romaines
chez des peuples lointains, contre lesquels il combattait
en évoquant le souvenir de sa bien-aimée:
«Ma Lycoris, s’écriait-il, ne sera pas séduite par
un frais visage de jeune homme ni par des présents;
l’autorité d’un père et les ordres rigoureux d’une
mère la solliciteront en vain de m’oublier: son cœur
reste inébranlable dans son amour!» Dans cette
disposition amoureuse, il ne tardait pas à penser
que la plus glorieuse victoire remportée sur les Parthes
ne valait pas une nuit passée dans les bras de
sa maîtresse: «Que m’importe à moi la guerre! disait-il
en gémissant: qu’ils combattent, ceux qui
cherchent dans les travaux de Mars des richesses ou
des conquêtes! Quant à nous, nous livrons des combats
avec d’autres armes: c’est l’amour qui sonne
le clairon et qui donne le signal de la mêlée, et
moi, si je ne combats en brave depuis le lever du
soleil jusqu’à son coucher, que Vénus me traite
[339]
comme un lâche en m’arrachant mes armes! mais,
si mes vœux s’accomplissent et si les choses tournent
à mon honneur, que la femme qui m’est chère soit
le prix de mon triomphe, que je la presse sur mon
sein, que je la couvre de baisers, tant que je me
sens la force d’aimer et que je n’en ai pas honte!
Alors, que des vins généreux, mêlés de nard et de
roses, viennent enflammer mon ardeur! que ma
chevelure, couronnée de fleurs, soit arrosée de
parfums! Certes, je ne rougirai pas de dormir dans
les bras de ma maîtresse et de ne sortir du lit qu’au
milieu du jour!»
Lorsque Gallus revint de la guerre des Parthes
avec quelques blessures et quelques cheveux gris de
plus, il ne retrouva plus sa Lycoris telle qu’il l’avait
laissée: elle ne lui avait pas brodé, comme il l’espérait,
un autre manteau pour la campagne prochaine,
car elle eût été assez embarrassée de se
représenter, dans ce travail d’aiguille, les yeux
en larmes, pâle et désespérée. Elle avait pris des
amants; elle ne songeait même pas que Gallus dût
lui revenir. Celui-ci s’aperçut qu’il ne vivait plus
au temps de l’âge d’or, où, comme il l’avait dit lui-même,
«la femme était assez chaste, quand elle
savait se taire en public sur ses faiblesses.» Il ne
brûla pas les vers qu’il avait faits pour Lycoris, et
qui étaient, d’ailleurs, dans la mémoire de tous les
amants; mais il répondit à l’infidélité par l’infidélité,
et il trouva de quoi se consoler dans la classe des
[340]
courtisanes. Il voulait que Lycoris le regrettât, et il
mit à la mode, par ses élégies d’amour, plusieurs
jeunes filles que leur beauté n’avait pas encore rendues
fameuses. Ce furent d’abord deux sœurs, Gentia
et Chloé, qu’il possédait à la fois: «Ne disputez
plus avec envie, leur disait-il pour les mettre d’accord,
ne disputez plus pour savoir laquelle des deux
a la peau la plus blanche ou la moins brune; disputez
sur ce seul point: Laquelle embrase davantage
son amant, l’une par ses yeux, l’autre par ses cheveux?»
Les cheveux de Gentia étaient blonds
comme de l’or; les yeux de Chloé lançaient mille
éclairs. Ensuite, Gallus aima une belle et naïve
enfant, nommée Lydie, dont il se fit le précepteur
amoureux: «Montre, jeune fille, lui disait-il avec
admiration, montre tes cheveux blonds qui brillent
comme de l’or pur; montre, jeune fille, ton cou
blanc qui s’élève avec grâce sur tes blanches
épaules; montre, jeune fille, tes yeux étoilés sous
l’arc de tes sourcils noirs; montre, jeune fille, ces
joues roses, où éclate parfois la pourpre de Tyr;
tends-moi tes lèvres, tes lèvres de corail; donne-moi
de doux baisers de colombe! Ah! tu suces une
partie de mon âme enivrée, et tes baisers me pénètrent
au fond du cœur! N’aspires-tu pas mon sang
et ma vie? Cache ces pommes d’amour, cache ces
boutons qui distillent le lait sous ma main! Ta gorge
découverte exhale une odeur de myrrhe: il n’y a
que délices en toute ta personne! Cache donc ce sein
[341]
qui me tue par sa splendeur de neige et par sa
beauté! Cruelle, ne vois-tu pas que je me pâme?...
Je suis à moitié mort, et tu m’abandonnes!» Gallus
eut beau faire; il ne donna pas de rivale, dans ses
vers, à cette Lycoris qu’il avait si amoureusement
chantée et dont le nom resta en faveur parmi les
femmes de plaisir. Plus de quatre siècles plus tard,
une autre Lycoris inspira encore la muse d’un poëte,
Maximianus, qui mérita d’être confondu avec Cornelius
Gallus, de même que sa Lycoris était confondue
avec celle que Gallus aima et chanta. Mais ce
Maximianus, tout ambassadeur de Théodoric qu’il
ait été, ne fut qu’un vieillard impuissant, qui se plaignait
d’être le jouet de sa maîtresse et qui se réfugiait
dans les souvenirs lointains de sa jeunesse, pour
se réchauffer le cœur, et pour être moins ridicule à
ses propres yeux: «La voilà, cette belle Lycoris
que j’ai trop aimée, disait le poëte en se lamentant,
celle à qui j’avais livré mon cœur et ma fortune!
Après tant d’années que nous avons passées ensemble,
elle repousse mes caresses! Elle s’en étonne,
hélas! Déjà, elle recherche d’autres jeunes gens et
d’autres amours; elle m’appelle vieillard faible et
décrépit, sans vouloir se souvenir des jouissances
du passé, sans se dire que c’est elle-même qui a
fait de moi un vieillard!»
Un ami du véritable Gallus, en appréciateur des
charmes de la véritable Lycoris, un grand poëte
consacra aussi à l’amour les premières inspirations
[342]
de sa muse: on peut dire qu’Ovide, le chantre, le
législateur de l’art d’aimer, avait appris son métier
dans le commerce des courtisanes. Ovide appartenait
à la famille Naso: la proéminence des nez
était le caractère distinctif et l’attribut érotique des
mâles de cette famille. Le nom de Naso leur resta
de père en fils, avec ce terrible nez qui avait
fait la célébrité d’un de leurs aïeux. Sous ce rapport,
comme sous tous les autres, le dernier des Nasons
n’avait pas dégénéré. C’était un voluptueux qui
commença de bonne heure à vivre selon ses goûts:
«Mes jours, dit-il lui-même en rappelant l’origine
de son surnom poétique, mes jours s’écoulaient
dans la paresse; le lit et l’oisiveté avaient déjà
énervé mon âme, lorsque le désir de plaire à une
jeune beauté vint mettre un terme à ma honteuse
apathie!» Cette jeune beauté n’était pas, comme on
a voulu le soutenir avec des suppositions gratuites,
la fille d’Auguste, Julie, veuve de Marcellus et
épouse de Marcus Agrippa; ce fut évidemment une
simple courtisane qu’il a chantée sous le nom de
Corinne. Corinne, c’est Ovide lui-même qui nous
l’apprend, avait un mari, ou plutôt un lénon (lenone
marito); ce mari, ainsi que tous ceux des courtisanes,
se faisait un revenu malhonnête avec les
galanteries de sa femme. Ovide, qui n’était pas plus
riche que les poëtes ne le furent en tout temps, plaisait
sans doute à la femme, mais il était sûr de déplaire
au mari. Sa situation auprès de Corinne était
[343]
donc celle de Tibulle vis-à-vis de Délie et de Némésis;
seulement, sa réputation de poëte l’avait mis
au-dessus des autres, et par conséquent, les courtisanes
se disputaient, pour devenir fameuses, le
bénéfice de son amour et de ses vers. On peut croire
qu’il donna de nombreuses rivales à sa Corinne;
mais il ne remplit les vœux d’aucune d’elles, puisque
Corinne fut seule nommée dans les élégies,
qu’elle n’avait pas seule inspirées sans doute. Il ne
faut pas oublier, toutefois, pour expliquer cette singularité,
qu’Ovide avait composé cinq livres d’élégies,
et qu’il en brûla deux en corrigeant les pièces
qu’il laissait subsister. Quoi qu’il en soit, on n’a
jamais su positivement quelle était cette Corinne
mystérieuse, et ce secret fut si bien gardé du temps
d’Ovide, que ses amis lui en demandaient en vain la
révélation et que plus d’une courtisane, profitant
de la discrétion de l’amant de Corinne, avait usurpé
le surnom de cette belle inconnue et se faisait passer
publiquement pour l’héroïne des chants du poëte.
Suivant une opinion qui n’est pas la moins vraisemblable,
Corinne ne serait que la personnification
imaginaire de plusieurs courtisanes qu’Ovide avait
aimées à la fois ou successivement.
Si l’on s’en tient au récit d’Ovide, l’amour l’avait
merveilleusement disposé à recevoir l’impression
qui lui alla au cœur, quand il rencontra Corinne:
«Qui pourrait me dire, se demandait-il, pourquoi
ma couche me paraît si dure? pourquoi ma couverture
[344]
ne peut rester sur mon lit? pourquoi cette nuit,
qui m’a paru si longue, l’ai-je passée sans goûter le
sommeil? pourquoi mes membres fatigués se retournent-ils
en tous sens, sous l’aiguillon de vives douleurs?»
Il avait vu Corinne, il l’aimait, il la désirait. Il
devait se trouver avec elle dans une de ces comessations,
où la bonne chère, le vin, les parfums, la
musique et les danses favorisaient les intelligences
des cœurs et les faiblesses des sens. Mais le mari,
le lénon de Corinne, devait aussi l’accompagner, et
la jalousie s’éveilla chez Ovide, avant que la possession
de son amante lui eût donné le droit d’être
jaloux d’elle. Il lui écrivit donc pour lui transmettre
de tendres instructions sur la conduite qu’elle aurait
à tenir durant ce souper; il lui enseigne une foule
de petits manéges amoureux, qu’elle connaissait
peut-être mieux que lui: «Quand ton mari sera
couché sur le lit de table, tu iras d’un air modeste
te placer à côté de lui, et que ton pied alors touche
en secret le mien.» Il la prie de lui faire passer la
coupe où elle aura bu, pour qu’il applique ses
lèvres à l’endroit même que les siennes auront touché:
«Ne souffre pas, lui dit-il, que ton mari te
jette les bras au cou; ne pose pas sur sa poitrine
velue ta tête charmante; ne lui permets pas de
mettre la main dans ta gorge et de profaner le bout
de ton sein; surtout, garde-toi de lui donner aucun
baiser, car si tu lui en donnais un seul, je ne
pourrais plus dissimuler que je t’aime. Ces baisers
[345]
sont à moi! m’écrierais-je, et je viendrais les
prendre. Ces baisers, du moins, je puis les voir;
mais les caresses qui se cachent sous la nappe (quæ
bene pallia celant), voilà ce que redoute mon aveugle
jalousie. N’approche pas ta cuisse de sa cuisse, ne
joins pas ta jambe à la sienne, ne mêle pas à ses
pieds grossiers tes pieds délicats.» Mais le pauvre
amant, qui se crée autant de tourments que de prévisions,
s’attriste, s’indigne des libertés que le
mari échauffé par le vin pourrait prendre en sa présence
et à son insu, sans que la patiente osât souffler
mot: «Pour m’épargner tout soupçon, dit-il à la
belle, éloigne de toi cette nappe qui serait complice
de ce que j’appréhende pour l’avoir vingt fois expérimenté
moi-même avec mes maîtresses.»
Sæpe mihi dominiæque meæ properata voluptas
Veste sub injectâ dulce peregit opus.
Hoc tu non facies; sed ne fecisse puteris,
Conscia de gremio pallia deme tuo.
Ovide espère profiter, dans l’intérêt de son
amour, et de l’ivresse et du sommeil de ce mari
qui les espionne; mais tout à coup il a conscience de
l’inutilité de tant de précautions raffinées: le repas
fini, le mari emmènera sa femme et sera maître de
disposer d’elle sans contrainte et sans témoin! «Ne
te donne au moins qu’à regret, tu le peux, s’écrie-t-il
douloureusement, et comme cédant à la violence.
Que tes caresses soient muettes et que Vénus
[346]
lui soit amère!» Mais, le lendemain même, Corinne
crut devoir quelque dédommagement au donneur
de conseils; elle alla le trouver chez lui, à l’heure
où, étendu sur son lit, il se reposait de la chaleur
du jour: «Voici Corinne qui arrive, la tunique relevée,
la chevelure flottante sur son cou d’albâtre.
Telle la belle Sémiramis marchait, dit-on, vers la
couche nuptiale; telle encore Laïs, célèbre par ses
nombreux amants. J’arrachai un vêtement, qui pourtant
ne me cachait rien de ses appas; elle résistait
toutefois et voulait garder sa tunique; mais, comme
sa résistance était celle d’une femme qui ne veut
pas vaincre, elle consentit bientôt sans regret à être
vaincue. Lorsqu’elle parut devant mes yeux sans aucun
voile, je ne remarquai pas dans tout son corps la
moindre imperfection! Quelles épaules, quels bras
ai-je vus et touchés! Quelle admirable gorge il me
fut donné de presser! Sous cette poitrine irréprochable,
quel ventre poli et blanc! Quels larges
flancs, quelle cuisse juvénile! Pourquoi m’arrêter
sur chaque détail? Je ne vis rien qui ne fût digne
d’éloge, et je la tenais nue serrée contre mon corps.
Qui ne devine le reste? Nous nous endormîmes tous
deux de fatigue. Puissé-je avoir souvent de pareilles
méridiennes!»
Il possède sa maîtresse, mais il n’est pas encore
heureux: il est jaloux; il a des rivaux qui payent
cher un bonheur que, lui, ne paye pas; il querelle, il
injurie, il maltraite sa Corinne; il l’a frappée! «La
[347]
fureur m’a fait lever sur elle une main téméraire,
dit-il en se détestant, elle pleure maintenant, celle
que j’ai blessée dans mon délire!» Il ne se pardonnera
jamais cette brutalité: «J’ai eu l’affreux courage
de dépouiller son front de sa chevelure, raconte-t-il
lui-même, et mon ongle impitoyable a
sillonné ses joues enfantines. Je l’ai vue pâle, anéantie,
le visage décoloré, semblable au marbre que le
ciseau dérobe aux montagnes de Paros; j’ai vu ses
traits inanimés et ses membres aussi tremblants que
la feuille du peuplier agité par le vent, que le faible
roseau qui s’incline sous la douce haleine du zéphyr,
que l’onde dont le souffle du Notus ride la surface;
ses larmes, longtemps retenues, coulèrent le long
de ses joues, ainsi que l’eau à la fonte des neiges!»
C’est que Corinne avait souvent auprès d’elle une
vieille entremetteuse, nommée Dipsas, qui employait
toutes sortes d’artifices pour la brouiller
avec Ovide, pour écarter du moins celui-ci et pour
vendre à des amants plus riches les moments qu’elle
lui volait: «Dis-moi, demandait Dipsas en ricanant,
que te donne ton poëte, si ce n’est quelques vers?
Eh! tu en auras des milliers à lire; le dieu des vers
lui-même, couvert d’un splendide manteau d’or,
pince les cordes harmonieuses d’une lyre dorée. Que
celui qui te donnera de l’or soit à tes yeux plus
grand que le grand Homère? Crois-moi, c’est chose
assez ingénieuse, que de donner.» Ovide entendit
les perfides insinuations de cette hideuse vieille, et
[348]
il eut peine à s’empêcher de s’en prendre à ses rares
cheveux blancs, à ses yeux pleurant le vin, à ses
joues sillonnées de rides; il se contenta de la maudire
en ces termes: «Que les dieux te refusent un
asile, t’envoient une vieillesse malheureuse, des
hivers sans fin et une soif éternelle!» Le poëte
avait besoin de toute son éloquence, et surtout de
sa tendresse pour combattre la détestable influence
de Dipsas, qui travaillait à pervertir davantage la
naïve Corinne: «Ne demande au pauvre que ses
soins, ses services et sa fidélité, écrivait-il à sa
maîtresse qu’il avait laissée pensive; un amant ne
peut donner que ce qu’il possède. Célébrer dans
mes vers les belles que j’en crois dignes, voilà ma
fortune; à celle que j’aurai choisie, mon art fera un
nom qui ne mourra point; on verra se déchirer les
étoffes, l’or et les pierres précieuses se briser, mais
la renommée que procureront mes vers sera éternelle.»
Cette considération n’était pas indifférente
aux yeux de Corinne, qui se voyait avec orgueil,
dans les promenades, au théâtre, au cirque, désignée
comme la muse d’Ovide.
Son mari avait mis à ses côtés un eunuque, nommé
Bagoas, qui l’accompagnait partout et qui ne se laissait
jamais séduire sans avoir consulté son maître.
Ovide ne réussit pas à endormir ce cerbère; mais il
avait gagné les deux coiffeuses de Corinne, Napé,
qui remettait ses lettres, et Cypassis, qui l’introduisait
en cachette. Cette dernière était jolie et bien
[349]
faite; un jour, Ovide s’en aperçut, tandis qu’il
attendait sa maîtresse, et il abrégea l’attente en
se permettant tout ce que Cypassis voulut bien
lui permettre. Corinne, à son retour, remarqua
quelque désordre accusateur dans sa chambre à
coucher; la rougeur de Cypassis sembla confirmer
des soupçons que ne démentait pas la contenance
d’Ovide: «Tu la soupçonnes d’avoir souillé avec
moi le lit de sa maîtresse! s’écria-t-il en s’efforçant
de reprendre son assurance. Que les dieux, si l’envie
d’être coupable me vient jamais, que les dieux
me préservent de l’être avec une femme d’une condition
méprisable! Quel est l’homme libre qui voudrait
connaître une esclave et serrer dans ses bras
un corps sillonné de coups de fouet!» Il n’eut pas
de peine à persuader Corinne, et le soir même il
écrivait à Cypassis pour lui demander un nouveau
rendez-vous. Corinne, il est vrai, ne se gênait pas
davantage de son côté, et plus d’une fois son amant
jugea qu’elle en savait plus qu’il ne lui en avait
appris: «De telles leçons ne se donnent qu’au lit
(illa nisi in lecto nusquam potuere doceri), se disait-il
tout bas en savourant un baiser qu’il trouvait étranger
à ses habitudes: je ne sais quel maître a reçu
l’inestimable prix de ces leçons-là!»
Corinne le tint à distance sous différents prétextes
de religion, de santé et d’humeur. Ovide cherchait
dans une nouvelle galanterie la cause de son éloignement,
et il prenait le temps en patience, avec plusieurs
[350]
chambrières qui n’étaient pas moins belles
que leur maîtresse, mais avec qui le cœur n’était
pas en jeu. Tout à coup il sut par ces filles que
Corinne s’était fait avorter et que cet avortement
avait mis ses jours en péril; Ovide s’indigna de
l’odieux attentat qu’elle avait exercé sur elle-même:
«Celle qui la première essaya de repousser de ses
flancs le tendre fruit qu’ils portaient, lui dit-il sévèrement,
celle-là méritait de périr victime de ses
propres armes. Quoi! de peur que ton ventre ne
soit gâté par quelques rides, il faut ravager le triste
champ des luttes amoureuses!» Depuis cet événement,
Corinne redoublait de prévenances et de tendresse
pour son poëte; elle n’était jamais assez souvent ni
assez longtemps avec lui; l’eunuque Bagoas fermait
les yeux ou détournait la tête; le mari ne se montrait
pas; les chiens n’aboyaient plus: on envoyait
chercher Ovide absent, on le retenait presque; on
ne lui laissait rien demander, encore moins rien
désirer. Il se lassa d’être ainsi accaparé par sa maîtresse:
«De tranquilles et trop faciles amours me
deviennent insipides, lui dit-il durement; ils sont
pour mon cœur ce qu’est un mets trop fade. Si
une tour d’airain n’eût jamais renfermé Danaé, Jupiter
ne l’aurait point rendue mère.» Corinne fut bien
étonnée de ce langage capricieux et brutal; elle
n’eut pas la force d’y répondre; elle pleura en
silence: «Qu’ai-je besoin, lui dit Ovide avec plus
de dureté encore, qu’ai-je besoin d’un mari complaisant,
[351]
d’un mari lénon?» Corinne comprit qu’on
ne l’aimait plus.
En effet, bientôt elle eut la preuve irrécusable du
refroidissement d’Ovide: une nuit, toute une nuit,
il resta glacé et mort sous les baisers qu’elle lui
prodiguait. Ovide fut surpris et inquiet lui-même
de cette subite incapacité: «Naguère pourtant, se
disait-il à part lui, j’acquittai deux fois ma dette
avec la blanche Childis, trois fois avec la blanche
Pitho, trois fois avec Libas, et, pour satisfaire aux
exigences de Corinne, j’ai pu, il m’en souvient,
livrer neuf assauts dans l’espace d’une courte nuit
(me memini numeros sustinuisse novem).» Mais plus
Ovide se cherchait en lui-même, moins il était capable
de se retrouver: «Pourquoi te jouer de moi?
s’écria Corinne rouge de honte et de dépit. Qui te
forçait, pauvre insensé, à venir malgré toi t’étendre
sur ma couche? Il faut qu’une magicienne d’Éa t’ait
ensorcelé en nouant de la laine; sinon, tu sors épuisé
des bras d’une autre (aut alio lassus amore venis)!»
A ces mots, elle s’élança hors du lit en rattachant sa
tunique, et s’enfuit pieds nus; pour cacher à ses
femmes l’affront qu’elle avait subi de son amant, elle
n’en fit pas moins ses ablutions (dedecus hoc sumptâ
dissimulavit aquâ), et elle se retrancha dans une
chambre éloignée, comme dans un fort. Ovide ne se
sentait pas en état de réparer sa honteuse défaite,
et il se retira sans oser reparaître sur le champ de
bataille. Dès qu’il fut sorti, Corinne ordonna de ne
[352]
plus le recevoir, et le lendemain la porte lui fut
fermée. Il se plaignit, il insista, il adressa des vers
suppliants à l’invisible Corinne; on lui fit répondre
que désormais, au lieu de vers, on lui demandait
des espèces sonnantes. Il se mit à errer autour de la
maison de la courtisane, et une coiffeuse vint lui
apprendre que, le matin même, Corinne avait
accueilli un capitaine romain qui arrivait des guerres
d’Asie, tout couvert de blessures et tout chargé de
butin. Il n’en fallut pas davantage pour qu’Ovide,
piqué de se voir éconduit pour faire place à un
nouveau venu, s’obstinât davantage à heurter à la
porte qu’on lui fermait. L’eunuque Bagoas vint ouvrir,
et le menaça d’appeler le chien qui gardait le
logis. Ovide s’en prit aux soldats enrichis qui ont
de l’or, et aux femmes qui préfèrent ces robustes
soldats à des poëtes pauvres et débiles; il voua aux
dieux vengeurs femmes et soldats; il comparait alors
le véritable âge d’or, où l’amour ne se vendait pas,
à cet âge de fer où l’on achetait tout, même l’amour,
avec de l’or: «Aujourd’hui, une femme, disait-il
amèrement, eût-elle l’orgueil farouche des Sabines,
obéit comme une esclave à celui qui peut donner
beaucoup. Son gardien me défend d’approcher; elle
craint pour moi la colère de son mari: mais, si je
veux donner de l’or, époux et eunuque me livreront
toute la maison. Ah! s’il est un dieu vengeur des
amants dédaignés, puisse-t-il changer en poussière
des trésors si mal acquis!»
[353]
Ovide n’était pas encore guéri de son amour:
cette résistance, au contraire, ne faisait que l’accroître.
Il passait les nuits, couché sur le seuil de
Corinne; il gémissait; il répétait son nom, avec des
larmes, des soupirs et des prières. Il fut plus d’une
fois consolé par la belle Cypassis, qui vint le réchauffer
et lui porter à boire. Mais ce n’était pas elle
qui pouvait faire oublier Corinne, et le poëte voulait
mourir devant cette porte inflexible. Un matin,
avant l’aube, elle s’ouvrit doucement, et un homme
sortit. «Quoi! s’écria l’amant déconvenu, quoi!
j’ai pu, quand tu pressais je ne sais quel amant
dans tes bras, j’ai pu, comme un esclave, me faire
le gardien d’une porte qui m’était fermée! Je l’ai
vu, cet amant, sortir de chez toi, fatigué et d’un
pas traînant, comme celui d’un artisan usé par le
service; mais j’ai encore moins souffert de le voir,
que d’en être vu moi-même!» Ovide se croyait libre
d’un amour qui lui semblait désormais une honte;
mais il ne pouvait oublier Corinne, Corinne infidèle,
Corinne livrée à des caresses vénales, Corinne vendue
et marchandée comme une mérétrix de carrefour!
Il quitta Rome pour chercher l’oubli dans l’absence;
il se retira dans le pays des Falisques, où sa
femme était née, et il attendit que les échos de son
cœur fissent silence; mais le nom de Corinne lui
arrivait à travers tous les bruits, de l’air et de la
nature champêtre. Il revint à Rome et il se retrouva
[354]
plus amoureux que jamais devant la porte de Corinne.
Ses amis avaient couru à sa rencontre: ils le
rejoignirent; ils l’entourèrent; ils lui apprirent que
Corinne était devenue une courtisane éhontée, et
qu’elle descendait tous les jours la pente du vice et
du mépris public. Elle se montrait partout avec ses
galants; elle portait des costumes indécents, dans les
rues, et au théâtre; elle donnait et recevait des baisers,
en face de tout le monde, et sous les yeux de
son mari déshonoré: ses cheveux étaient souvent en
désordre; son cou portait l’empreinte des morsures;
ses bras blancs avaient été meurtris; on racontait
d’elle une foule de traits d’impudicité, d’avarice et
d’effronterie. Ovide refusait d’ajouter foi à ce qu’il
entendait; on lui fit voir la dégradation dans laquelle
sa maîtresse était tombée. Il lui écrivit une
dernière fois: «Je ne prétends pas, censeur austère,
lui disait-il, que tu sois chaste et pudique; mais ce
que je te demande, c’est de chercher du moins à me
tromper sur la vérité. Elle n’est pas coupable celle
qui peut nier la faute qu’on lui impute; c’est l’aveu
qu’elle en fait, qui seul peut la rendre infâme. Quelle
fureur de révéler au jour les mystères de la nuit, et
de dire ouvertement ce que l’on fait en secret!
Avant de se livrer au premier venu, la mérétrix met
du moins une porte entre elle et le public, et, toi, tu
divulgues partout l’opprobre dont tu te couvres, et
dénonces toi-même tes fautes honteuses!» Mais Corinne
était perdue pour elle-même comme pour
[355]
Ovide; elle marchait à grands pas dans le sentier le
plus bas de la Prostitution.
Ovide n’effaça pas toutefois le nom de Corinne
dans les vers qu’il lui avait dédiés; sous ce nom il
l’avait aimée, sous ce nom il l’avait chantée:
«Cherche un nouveau poëte, déesse des amours!»
s’écria-t-il en mettant la dernière main à ses livres
d’élégies. En effet, s’il eut encore des maîtresses, il
n’en chanta aucune, parce qu’aucune ne lui inspira
de l’amour. Il vécut toutefois plus que jamais dans
l’intimité des courtisanes, et, pour les récompenser
du plaisir qu’elles lui avaient procuré, il composa
sous leurs yeux, et d’après leurs inspirations, son
poëme de l’Art d’aimer, ce code de l’amour et de la
volupté. Dans ses nombreuses poésies, il donna toujours
une large place à ses réminiscences amoureuses,
mais il n’avoua pas une seule de ses maîtresses,
en la nommant dans des vers composés pour
elle; ce qui fit supposer qu’il avait une liaison
secrète, avec la fille de l’empereur, et qu’il se contentait
de son bonheur sans le divulguer. On attribua
son exil à cette passion adultère, qu’Auguste
n’osait pas punir autrement; selon d’autres bruits,
qui coururent à Rome, Ovide aurait surpris Auguste
commettant un inceste avec sa propre fille. Quoi
qu’il en fût, Ovide, le tendre Ovide, exilé au bord
du Pont-Euxin, parmi les barbares, mourut de
douleur, après avoir essayé de détruire tous ses
ouvrages, même les élégies de ses Amours: il venait
[356]
d’apprendre, par des lettres de Rome, que Corinne,
vieille et ridée, vêtue d’une toge déteinte et rapiécée,
était servante dans un cabaret où les bateliers
du Tibre allaient faire la débauche: «Mieux eût
valu qu’elle se fît magicienne ou parfumeuse!»
pensait-il avec stupeur. Il rendit l’âme, en collant à
ses lèvres glacées une bague qui renfermait des
cheveux de Corinne.

Sommaire.—Marcus Valerius Martial, poëte complaisant des libertinages
de Néron et de ses successeurs.—Vogue immense
qu’obtinrent les Épigrammes de Martial.—Réponse de Martial
à son critique Cornélius qui lui reprochait l’obscénité de ses poésies.—Quelles
étaient les victimes ordinaires des sarcasmes de
Martial.—Mœurs déréglées de ce poëte.—Abominable épigramme
que Martial eut l’impudeur d’adresser à sa femme
Clodia Marcella.—Quels étaient les lecteurs habituels des œuvres
de Martial.—Le libraire Secundus.—Portraits de courtisanes.—Lesbie.—Libertinage
éhonté de cette prostituée.—Les
louves errantes Chioné et Hélide.—Vieillesse ignoble
de Lesbie.—Épigramme que fit Martial contre Lesbie.—Chloé.—Avidité
de Lupercus, amant de cette courtisane.—La pleureuse
des sept maris.—Thaïs.—Injures qu’adressa Martial à
cette courtisane qui l’avait dédaigné.—Hideux portrait qu’il en
publia pour se venger de ses mépris.—Philenis et son concubinaire
Diodore.—Horrible dépravation de Philenis.—Épitaphe
que fit Martial pour cette infâme prostituée.—Galla.—Injustice
de Martial à l’égard de cette courtisane.—Épigrammes
qu’il fit contre elle.—D’où lui venait la haine qu’il lui avait
vouée.—Les vieilles amoureuses.—Effrayant cynisme de Phyllis.—Épigrammes
contradictoires de Martial contre cette courtisane.—Lydie.—Comment
[358]
Martial se conduisit envers Paulus,
qui lui avait demandé des vers contre Lysisca.—Aversion et
dégoût de Martial pour les vieilles prostituées.—Fabulla.—Lila.—Vetustilla.—Gallia.—Saufeia.—Marulla.—Thelesilla.—Pontia.—Lecanie.—Ligella.—Lyris.—Fescennia.—Senia.—Galla.—Eglé.—Les
fausses courtisanes grecques.—Celia.—Épigramme de Martial contre cette prétendue
fille de la Grèce.—Lycoris.—Glycère.—Chioné et Phlogis.
De quelle façon grossière Martial accueillit une gracieuse invitation
à l’amour que lui avait envoyée Polla.—Honteuse profession
de foi qu’il eut le triste courage d’adresser à sa femme
Clodia Marcella.—Son retour en Espagne.—Par quels moyens
Clodia Marcella décida Martial à abandonner Rome.—Épigramme
expiatoire de Martial.—Sa fin champêtre.—Honorable
sortie de Martial contre Lupus.—Pétrone.—Son Satyricon,
tableau des mœurs impures de Rome impériale.—Ascylte et
Giton.—La prêtresse du dieu Ænothée et sa compagne Proselenos.—L’entremetteuse
Philomène.—Eumolpe.—Les Épigrammes
de Pétrone.—Sestoria.—Martia.—Délie.—Aréthuse.—Bassilissa.—Suicide
de Pétrone.
Après Ovide, il faut aller jusqu’à Martial pour
retrouver en quelque sorte la filiation interrompue
des courtisanes de Rome; pendant plus d’un demi-siècle,
la poésie fait silence sur leur compte, mais
on peut présumer qu’elles n’attendirent pas Martial
pour faire parler d’elles, et que, si les poëtes érotiques
nous manquent pour constater les faits et gestes
de ces fameuses, la faute n’en est pas à un temps
d’arrêt dans les progrès de la Prostitution antique.
Loin de là, les successeurs d’Auguste avaient pris
sous leurs auspices la démoralisation de la société
romaine, et ils offraient avec impudeur l’exemple
de tous les raffinements de la débauche. Les mœurs
[359]
publiques s’étaient alors si profondément altérées,
que, parmi les poëtes, on n’en eût pas trouvé un qui
se donnât le ridicule de chanter l’épopée de ses
amours, comme l’avaient fait Tibulle, Properce et
Ovide. De même, on n’eût pas trouvé une courtisane
qui perdît sa jeunesse à fournir des sujets d’élégies
à un poëte amoureux et jaloux. La jalousie, comme
l’amour, semblait passée de mode, et l’on vivait
trop vite pour consacrer des années entières à une
seule passion, que la durée rendait presque respectable
et qui participait, pour ainsi dire, du concubinage
matrimonial. Lorsque Marcus Valerius Martial,
né à Bilbilis, en Espagne, vers l’an 43 de l’ère
chrétienne, vint à Rome, à l’âge de dix-sept ans,
pour y chercher fortune, il n’eut garde d’imiter les
poëtes de l’amour, qui avaient rencontré un Mécène
au siècle d’Auguste: il se fit, au contraire, le poëte
complaisant des libertinages du règne de Néron et
des empereurs qui se succédèrent si rapidement
jusqu’à Trajan. Martial dut ses succès littéraires à
l’obscénité même de ses épigrammes.
Il a l’air d’avoir pris pour modèles les honteuses
épigrammes de Catulle, qui les avait écrites,
du moins, avec une sorte de grossière naïveté;
Martial, au contraire, pour plaire aux débauchés
de la cour impériale, s’exerçait à renchérir, en fait
de licence, sur les poésies les plus effrontées de son
temps; il y mettait même une recherche monstrueuse
de lubricité, et il ne jetait seulement pas le voile
[360]
des expressions décentes sur des images immondes.
Les applaudissements qu’il recueillait de toutes parts
étaient son excuse et son encouragement; chaque
livre nouveau de ses épigrammes, demandé, attendu
avec impatience par tous les lecteurs qui savaient
par cœur les livres précédents, se multipliaient à
l’infini dans les mains des libraires, et les scribes,
qui en préparaient des exemplaires richement ornés
et reliés, ne pouvaient suffire à l’empressement des
acheteurs. Cet accueil enthousiaste, accordé à des vers
licencieux, n’était pas fait sans doute pour inviter
Martial à changer de genre et de ton. Aussi, quand
un censeur austère lui conseillait de s’imposer quelques
réserves dans les mots, sinon dans les idées, il
n’acceptait pas plus un conseil qu’un reproche, et il
avait mille raisons toutes prêtes pour démontrer à ses
critiques, qu’il avait bien fait de composer justement
les vers malhonnêtes qu’on voulait retrancher de ses
œuvres: «Tu te plains, Cornélius, disait-il à un
de ses censeurs, que mes vers ne sont point assez
sévères et qu’un magister ne les voudrait pas lire
dans son école; mais ces opuscules ne peuvent
plaire, comme les maris à leurs femmes, s’ils n’ont
pas de mentule... Telle est la condition imposée aux
poésies joyeuses: elles ne peuvent convenir, si elles
ne chatouillent les sens. Dépose donc ta sévérité et
pardonne à mes badinages, à mes joyeusetés, je te
prie. Renonce à châtier mes livres: rien n’est plus
méprisable que Priape devenu prêtre de Cybèle.»
[361]
Martial avait pour lui les suffrages des empereurs
et des libertins; il se souciait peu de ceux des gens
de goût, et il se contentait de la vogue irrésistible
de ses épigrammes les plus ordurières, qui, en passant
par la bouche des courtisanes et des gitons,
étaient arrivées graduellement aux oreilles de la
populace des carrefours. De là, cette renommée éclatante
que le poëte avait acquise avec des saletés, que
n’excusaient pas l’esprit et la malice qu’il savait y
jeter à pleines mains; renommée qui faillit éclipser
celles de Virgile et d’Horace, et qui balança les
triomphes satiriques de Juvénal. En effet, toute la
chronique scandaleuse de Rome était déposée, pour
ainsi dire, dans une multitude de petites pièces, faciles
à retenir et à faire circuler; dans ces pièces de
vers, le poëte avait gravé, sous des pseudonymes
transparents, les noms des personnages qu’il tournait
en ridicule ou qu’il marquait au fer rouge. Il
avait beau déclarer qu’il n’abusait pas des noms véritables
et qu’il respectait toujours les personnes dans
ses plaisanteries; on ne lui savait pas mauvais gré
des injures graves qu’il se permettait à l’égard d’une
foule de gens, que tout le monde reconnaissait dans
des portraits, où ils n’étaient pas nommés, mais
peints avec une hideuse vérité. Il ne se hasardait
pas, il est vrai, à diffamer des hommes honorables
et à poursuivre de calomnies perfides la vie privée
des citoyens. Les victimes ordinaires de ses sarcasmes
étaient toujours de méchants poëtes, d’insolentes
[362]
courtisanes, de viles prostituées, des lénons
criminels, des prodigues et des avares, des hommes
tarés et des femmes perdues. Il parle donc souvent
la langue des ignobles personnages qu’il met en
scène et comme au pilori; il a soin de prévenir ses
lecteurs qu’ils ne trouveront chez lui ni réserve ni
pruderie dans l’expression: «Les épigrammes, dit-il,
sont faites pour les habitués des Jeux-Floraux.
Que Caton n’entre donc pas dans notre théâtre, ou,
s’il y vient, qu’il regarde!»
Martial fréquentait certainement la mauvaise société
qu’il a dépeinte avec des couleurs si flétrissantes:
il a laissé voir, en deux ou trois passages, que
ses mœurs n’étaient pas beaucoup plus réglées que
celles qu’il condamne chez les autres; car il ne se
bornait pas à promener ses amours parmi les courtisanes:
il se livrait quelquefois à des désordres, que
n’excusait pas la corruption générale de son temps,
et qu’il s’est même efforcé de justifier pour répondre
aux amers reproches de sa femme Clodia Marcella.
Et pourtant, malgré ces habitudes de débauche contre
nature, il affecte, dans plus d’une épigramme, de
faire sonner bien haut l’honnêteté, la pureté de sa
vie. En jugeait-il si favorablement, par la comparaison
qu’il faisait, à son avantage, de ses mœurs privées
avec celles de ses contemporains, surtout avec
celles des empereurs à qui il dédiait ses livres:
«Mes vers sont libres, dit-il à Domitien, mais ma
vie est irréprochable: (Lasciva est nobis pagina, vita
[363]
proba est).» Pour expliquer cette contradiction apparente,
il suffit peut-être de dater les pièces où Martial
vante sa moralité et celles où il en fait si bon
marché: les premières appartiennent à sa jeunesse,
les secondes à son âge mûr. On ne doit pas oublier
que les onze premiers livres de son recueil représentent
un intervalle de trente-cinq années, qu’il passa,
presque sans interruption, à Rome. Martial, à vingt-cinq
ans, pouvait vivre chastement, tout en caressant
dans ses vers la sensualité de ses protecteurs.
A cinquante ans, il était devenu libertin, à force
d’être témoin du libertinage de ses amis, et on remarque,
en effet, que, dans les derniers livres de
ses épigrammes, il ne s’avise plus de prétendre à la
réputation de chasteté que ses écrits licencieux lui
avaient fait perdre depuis longtemps. C’est dans le
onzième livre, qu’il a eu l’impudeur d’insérer l’abominable
épigramme adressée à sa femme, qui l’avait
surpris avec son mignon et qui eût voulu se sacrifier
elle-même pour le déshabituer de ces goûts infâmes:
«Combien de fois Junon a-t-elle fait le même reproche
à Jupiter?» répliquait Martial en riant, et il
s’autorisait de l’exemple des dieux et des héros pour
persister dans ses coupables habitudes et pour repousser
les maussades complaisances de sa femme:
Parce tuis igitur dare mascula nomina rebus;
Teque, puta cunnos, uxor, habere duos.
Le poëte, il est vrai, ne se faisait pas illusion sur
[364]
le caractère de son recueil, et il savait bien pour
quels lecteurs il composait des poésies toujours
libres et souvent obscènes. «Aucune page de mon
livre n’est chaste, dit-il avec franchise; aussi,
ce sont les jeunes gens qui me lisent; ce sont les
filles de mœurs faciles, c’est le vieillard qui lutine
sa maîtresse.» Il se compare alors à son émule Cosconius,
qui faisait comme lui des épigrammes, mais
si chastes qu’on n’y voyait jamais un nuage impudique
(inque suis nulla est mentula carminibus); il
le loue de cette chasteté, mais il lui déclare que des
écrits si pudibonds ne peuvent être destinés qu’à
des enfants et à des vierges. Il ne se pique donc pas
d’imiter Cosconius, et il se moque des vénérables
matrones qui lisaient ses ouvrages en cachette,
et qui l’accusaient de n’avoir pas écrit pour les
femmes honnêtes: «J’ai écrit pour moi, leur dit-il
sans réticence. Le gymnase, les thermes, le stade,
sont de ce côté: retirez-vous donc! Nous nous
déshabillons: prenez garde de voir des hommes
nus? Ici, couronnée de roses, après avoir bu, Terpsichore
abdique la pudeur, et, dans son ivresse, ne
sait plus ce qu’elle dit: elle nomme sans détour et
franchement ce que Vénus triomphante reçoit dans
son temple au mois d’août, ce que le villageois
place en sentinelle au milieu de son jardin, ce que
la chaste vierge ne regarde qu’en mettant la main
devant ses yeux.» On est averti, par cette épigramme,
que les vers de Martial ne cherchaient pas
[365]
des matrones pour lectrices ordinaires, et qu’il fallait,
pour se plaire à ce dévergondage d’idées et
d’expressions, avoir vécu de la vie des libertins et
de leurs aimables complices. Le recueil complet du
poëte des comessations figurait dans la bibliothèque
de tous les voluptueux, et, comme il était d’un format
qui permettait de le tenir tout entier dans la
main, on le lisait partout, aux bains, en litière, à
table, au lit. Le libraire, qui le vendait à très-bas
prix, se nommait Secundus, affranchi du docte Lucensis,
et demeurait derrière le temple de la Paix
et le marché de Pallas; ce libraire vendait aussi
tous les livres lubriques, ceux de Catulle, de Pedo,
de Marsus, de Getulicus, qui n’étaient pas moins
recherchés par les jeunes et les vieux débauchés,
mais que les courtisanes affectaient de ne pas estimer
autant que les élégies de Tibulle, de Properce
et d’Ovide. Dans tous les temps, les femmes, même
les plus dépravées, ont été sensibles à la peinture
de l’amour tendre et délicat. Martial offrait pourtant
à ses lecteurs un intérêt d’à-propos, que nul poëte
n’avait su donner à ses vers: c’était, pour ainsi
dire, une galerie de portraits, si ressemblants que
les modèles n’avaient qu’à se montrer pour être
aussitôt reconnus, et si malicieusement touchés,
que le vice ou le ridicule de l’original passait en
proverbe avec le nom que le poëte avait attaché à
l’épigramme. Nous allons, parmi ces portraits, rarement
flatteurs, choisir ceux des courtisanes que
[366]
Martial s’est amusé à peindre, souvent à plusieurs
reprises et à des époques différentes, comme pour
mieux juger des changements que l’âge et le sort
apportaient dans l’existence ou dans la personne de
ces créatures; nous laisserons de côté, avec dégoût,
la plupart des portraits de cinædes et de gitons,
que la Prostitution romaine plaçait sur le même
pied que les femmes de plaisir, et que Martial ne
s’est pas fait scrupule de mettre en regard de celles-ci
dans sa collection érotique et sotadique.
Voici Lesbie; ce n’est pas celle de Catulle; elle
n’a point de moineau apprivoisé dont elle pleure la
mort, mais elle a des amants et tout le monde le
sait, parce qu’elle ouvre ses fenêtres et ses rideaux,
quand elle est avec eux; elle aime la publicité; les
plaisirs secrets sont pour elle sans saveur (nec sunt
tibi grata gaudia si qua latent); aussi, sa porte n’est-elle
jamais fermée ni gardée, lorsqu’elle s’abandonne
à sa lubricité; elle voudrait que tout Rome eût les
yeux sur elle en ce moment-là, et elle ne se trouble
ni ne se dérange, si quelqu’un entre, car le témoin
de son libertinage lui procure plus de jouissance
que ne fait son amant; elle n’a pas de plus grand
bonheur que d’être prise sur le fait (deprehendi veto
te, Lesbia, non futui). «Prends au moins des leçons
de pudeur de Chioné et d’Hélide!» lui crie Martial
indigné. Chioné et Hélide étaient des louves errantes,
qui cachaient leurs infamies à l’ombre des tombeaux.
Cette Lesbie, en vieillissant, arriva au dernier
[367]
degré de la Prostitution, et se voua plus particulièrement
aux turpitudes de l’art fellatoire (liv. II,
épigr. 50). Elle était devenue laide, et elle s’étonnait,
en dépit des avertissements de son miroir,
que ses amants d’autrefois n’eussent pas conservé
pour elle leurs désirs et leur ardeur. Elle gourmandait,
à ce sujet, la paresse glacée de Martial, qui
finit par lui dire, pour excuser son impuissance
obstinée: «Ton visage est ton plus cruel ennemi»
(contra te facies imperiosa tua est). Longtemps après,
réduite à des souvenirs qui se réveillaient chez elle
au milieu de son abandon, Lesbie se rappelait avec
orgueil les nombreux adorateurs qu’elle avait eus;
elle les faisait comparaître, avec leurs noms, leurs
qualités, leurs caractères et leurs figures, devant
l’aréopage des vieilles entremetteuses, qui l’écoutaient
en ricanant: «Je n’ai jamais accordé mes
faveurs gratis!» disait-elle fièrement (Lesbia sejurat
gratis nunquam esse fututam), et, pendant qu’elle
parlait ainsi du passé, les portefaix, qu’elle soudoyait
maintenant à tour de rôle, se battaient à sa
porte pour savoir lequel d’entre eux serait payé
cette nuit-là.
Voici Chloé; ce n’est pas celle d’Horace; elle ne
se soucie même pas de rappeler les grâces de sa
célèbre homonyme; elle n’est plus jeune, mais elle
est toujours galante; elle se console, comme Lesbie,
de n’être plus recherchée, en se donnant du plaisir
pour son argent. Il n’en faut pas moins, pour qu’elle
[368]
s’accoutume aux dédains qui l’accueillent partout,
quand elle a encore la prétention de se faire payer.
Martial lui dit avec dureté: «Je puis me passer de
ton visage, et de ton cou, et de tes mains, et de tes
jambes, et de tes tétons, et de tes nates; enfin,
pour ne pas me fatiguer à décrire tout ce dont je
peux me passer, Chloé, je puis me passer de toute
ta personne.» Mais Chloé était riche, et, à son tour,
elle pouvait se passer du prix de ses galanteries;
elle en faisait même les frais, avec une générosité
bien rare chez ses pareilles. Elle s’était éprise d’un
jeune garçon qui n’avait pas d’autre fortune que sa
beauté et ses épaules. Martial le nomme Lupercus,
par allusion à ces prêtres de Pan, qui couraient tout
nus dans les rues de Rome, aux fêtes des Lupercales,
et qui passaient pour rendre fécondes toutes
les femmes qu’ils touchaient avec des lanières de
peau de bouc. Le Lupercus de Chloé était aussi nu
et aussi pauvre qu’un luperque, et Chloé se dépouillait
pour le vêtir, pour le parer; elle lui avait donné
en présent des étoffes de Tyr et d’Espagne, un
manteau d’écarlate, une toge en laine de Tarente,
des sardoines de l’Inde, des émeraudes de Scythie
et cent pièces d’or nouvellement frappées. Elle ne
pouvait rien refuser à cet avide et besogneux amant,
qui demandait sans cesse. «Malheur à toi, brebis
tondue! lui criait Martial. Malheur à toi, pauvre
fille! Ton Lupercus te mettra toute nue!» La prédiction
ne se réalisa pas. Chloé avait assez gagné dans
[369]
son bon temps, pour rendre aux amants une partie
de l’or qu’elle en avait reçu; elle ne lésina pas avec
eux; mais, depuis qu’elle les payait au lieu de se
faire payer, elle était plus difficile à contenter; elle
dévorait, comme une larve, la jeunesse et la santé
de ses pensionnaires: elle en eut sept, qui moururent
l’un après l’autre, et tous, de la même cause;
elle leur fit élever des tombeaux très-honorables
avec une inscription où elle disait naïvement:
«C’est Chloé qui a fait ces tombeaux.» On ne l’appela
plus que la Pleureuse des sept maris.
Martial, il faut l’avouer, ne fut pas toujours impartial
dans ses épigrammes; ainsi, les injures qu’il
adresse à la courtisane Thaïs ne partent que d’un
accès de ressentiment personnel: il accuse ici Thaïs
de ne refuser personne et de se donner à tout venant,
comme si ce fût la chose la plus simple du
monde (Liv. IV, ép. 12), et là, il gourmande les
refus de Thaïs, qui lui a dit qu’il était trop vieux
pour elle (Liv. IV, ép. 50). Thaïs ne voulut pas sans
doute se rendre à la preuve ignominieuse qu’il proposait
de fournir en témoignage de virilité, car il
se vengea d’elle par le plus hideux portrait qu’on
ait jamais fait d’une femme: «Thaïs sent plus
mauvais que le vieux baril d’un foulon avare, qui
s’est brisé dans la rue; qu’un bouc qui vient de
faire l’amour; que la gueule d’un lion; qu’une
peau de chien écorché dans le faubourg au delà du
Tibre; qu’un fœtus qui s’est putréfié dans un œuf
[370]
pondu avant terme; qu’une amphore infecte de
poisson corrompu. Afin de neutraliser cette odeur
par une autre, chaque fois que Thaïs quitte ses
vêtements pour se mettre au bain, elle s’enduit de
psilothrum, ou se couvre de craie détrempée dans
un acide, ou se frotte trois et quatre fois avec de la
pommade de fèves grasses. Mais, lorsqu’elle se
croit délivrée de sa puanteur par mille artifices de
toilette, quand elle a tout fait, Thaïs sent toujours
Thaïs (Thaïda Thaïs olet).» Cette horrible peinture
est encore moins repoussante que celle qui concerne
Philénis, contre laquelle Martial avait sans doute
d’autres griefs plus réels et plus graves. Philénis,
d’ailleurs, n’était pas d’un âge à inspirer un caprice,
puisque le poëte la fait mourir presque aussi
vieille que la sibylle de Cumes. Elle avait un mari
ou plutôt un concubinaire, nommé Diodore, qui
paraît avoir marqué dans quelque expédition lointaine,
et qui, en revenant à Rome, où l’attendaient
les honneurs du triomphe, fit naufrage dans la mer
de Grèce: il parvint à se sauver à la nage, et Martial
attribue ce bonheur inouï à un vœu indécent
de Philénis, qui, pour obtenir des dieux le retour
de son Diodore, avait promis à Vénus une fille simple
et candide, comme les aiment les chastes Sabines
(quam castæ quoque diligunt Sabinæ). Cette
Philénis, espèce de virago qui se targuait d’être à
moitié homme, avait une passion effrénée pour les
femmes: «Elle va dans ses emportements, dit Martial,
[371]
jusqu’à dévorer en un jour onze jeunes filles,
sans compter les jeunes garçons.» La robe retroussée,
elle jouait à la paume, et, les membres frottés
de poudre jaune, elle lançait les pesantes masses
de plomb que manient les athlètes; elle luttait avec
eux, et, toute souillée de boue, recevait comme
eux les coups de fouet du maître de la palestre. Jamais
elle ne soupait, jamais elle ne se mettait à
table, avant d’avoir vomi sept mesures de vin, et
elle se croyait en droit d’en avaler autant, après avoir
mangé seize pains ithyphalliques. Ensuite, elle se
livrait aux plus sales voluptés, sous prétexte de
faire l’homme jusqu’au bout (Non fellat: Putat hoc
parum virile; sed plane medias vorat puellas). Et
néanmoins, cette abominable gladiatrice était à la
fois magicienne et entremetteuse; elle avait une
voix de stentor et elle faisait plus de bruit à elle
seule que mille esclaves exposés en vente et qu’un
troupeau de grues au bord du Strymon: «Ah!
quelle langue est réduite au silence!» s’écriait
Martial, lorsqu’elle fut enlevée par la mort à ses
exercices gymnastiques, à ses sortiléges et à son
infâme métier. «Que la terre te soit légère! dit l’épitaphe
que le poëte lui décerna: qu’une mince couche
de sable te recouvre, afin que les chiens puissent
déterrer tes os!»
Philénis avait probablement nui à Martial dans
ses amours; car, d’après le portrait qu’il fait d’elle,
on ne saurait supposer qu’il l’eût jamais vue de
[372]
meilleur œil; mais on peut assurer qu’il n’avait pas
été toujours aussi dédaigneux pour Galla, qu’il ne
ménage pourtant pas davantage; après l’avoir injuriée
avec acharnement, après s’être moqué de sa
décrépitude et de son délaissement, il se laisse aller
à un aveu qui témoigne de son injustice à l’égard
de cette courtisane. Il raconte qu’autrefois elle demandait
20,000 sesterces (environ 5,000 fr.) pour
une nuit, «et ce n’était pas trop,» comme il se plaît
à le reconnaître. Au bout d’un an, elle ne demandait
plus que 10,000 sesterces: «C’est plus cher
que la première fois!» pensa Martial, qui ne conclut
pas le marché. Six mois plus tard, elle était tombée
à 2,000 sesterces: Martial n’en offrit que mille,
qu’elle n’accepta pas; mais, à quelques mois de là,
elle vint elle-même se proposer pour quatre pièces
d’or. Martial refuse à son tour. Galla se pique au jeu
et se montre généreuse: «Va donc pour cent sesterces!»
dit-elle. Martial, dont l’envie se passe
tout à fait, trouve encore la somme exorbitante.
Galla fait la moue et lui tourne le dos. Un jour
elle le rencontre; il vient de recevoir une sportule
de 100 quadrants ou de 25 livres: elle veut avoir
cette sportule, et elle offre en échange ce dont elle
demandait naguère 20,000 sesterces. Martial lui répond
sèchement que la sportule est destinée à son mignon
et s’en va. Galla n’a pas de rancune; elle a
retrouvé Martial et lui veut donner tout pour rien:
«Non, il est trop tard!» lui répond le poëte capricieux.
[373]
Faut-il croire, sur la foi de cette épigramme,
que Galla était devenue si méprisable et si différente
d’elle-même, en si peu d’années? Martial la représente
d’abord comme ayant épousé six ou sept gitons,
dont la chevelure et la barbe bien peignées
l’avaient séduite et qui avaient misérablement
trompé son attente amoureuse:
Deindè experta latus, madidoque simillima loro
Inguina, nec lassâ stare coacta manu,
Deseris imbelles thalamos, mollemque maritum.
Martial lui conseille de se dédommager, en faisant
un choix parmi ces rustres, robustes et velus, qui
ne parlent que Fabius et Curius; mais il l’avertit
pourtant de ne pas se fier aux apparences, parce
qu’il y a aussi des eunuques parmi eux: «Il est
difficile, Galla, de se marier avec un véritable
homme?» lui dit-il en raillant. On excuse les impuissants,
on approuve les efféminés, quand on
assiste à la toilette de Galla, qui n’était plus que
l’ombre de ce qu’elle avait été: «Tandis que tu es
à la maison, tes cheveux sont absents et se font friser
dans une boutique du quartier de Suburra; la
nuit, tu déposes tes dents, ainsi que ta robe de
soie, et tu te couches, barbouillée de cent pommades,
et ton visage ne dort pas avec toi (nec facies tua
tecum dormiat).» Elle regrettait toujours d’avoir fait
la sourde oreille aux propositions de Martial et
cherchait une occasion de se réconcilier avec lui;
[374]
elle lui promettait des merveilles, elle lui faisait mille
agaceries; mais le poëte, rancunier, était sourd (mentula
surda est) et ne retrouvait pas ses anciennes dispositions,
vis-à-vis de cette face ridée, de ces appas flétris
et de ces cheveux grisonnants, plus capables d’inspirer
le respect que l’amour (cani reverentia cunni).
Il semble se complaire à mordre sur les vieilles
amoureuses, et il n’épargne pas celles qui ne l’avaient
pas épargné. Ainsi, après nous avoir montré
avec un effrayant cynisme Phyllis, qui s’efforce de
satisfaire deux amants à la fois (Livre X, ép. 81),
il ne nous cache pas que ses sens ne parlent plus en
tête à tête avec cette Phyllis, qui lui donne les
noms les plus tendres, les baisers les plus passionnés,
les caresses les plus ardentes, et qui ne parvient
pas à le tirer de sa torpeur (Liv. XI, ép. 29). C’est
par ironie sans doute qu’il lui indique une manière
plus sûre d’agir sur un jeune homme, toute vieille
qu’elle soit; il lui souffle ce qu’elle doit dire alors:
«Tiens, voilà cent mille sesterces, des terres en
plein rapport sur les coteaux de Sétia, du vin, des
maisons, des esclaves, de la vaisselle d’or, des meubles!»
Cette Phyllis était donc bien riche, si Martial
ne s’est pas servi d’une plaisante hyperbole pour
exprimer les promesses folles que les vieilles faisaient
à leurs amants au milieu du vertige de la
volupté. Quoi qu’il en soit, Phyllis, ou une autre du
même nom, reparaît (Liv. XI, ép. 50), et Martial,
qui ne l’outrage plus, mais qui a l’air de la supplier,
[375]
se plaint de ses mensonges et de sa rapacité: «Tantôt
c’est ta rusée soubrette qui s’en vient pleurer la
perte de ton miroir, de ta bague ou de ta boucle
d’oreille; tantôt ce sont des soies de contrebande
qu’on peut acheter à bon compte; tantôt des parfums
dont il me faut remplir ta cassolette; puis, c’est
une amphore de Falerne vieux et moisi, pour faire
expier tes insomnies à une sorcière babillarde; puis,
un loup de mer monstrueux ou un mulet de deux
livres pour régaler l’opulente amie à qui tu donnes
à souper. Par pudeur, ô Phyllis, sois vraie et sois
juste en même temps: je ne te refuse rien, ne me
refuse pas davantage?» Comment cette Phyllis, dont
la vieille main était si glacée tout à l’heure, est-elle
devenue tout à coup une belle qu’on désire et qu’on
s’efforce de contenter coûte que coûte? La métamorphose
continue et Martial est au comble de ses
vœux: «La belle Phyllis, pendant toute une nuit,
s’était prêtée à toutes mes fantaisies (se præstitisset
omnibus modis largam), et je songeais le matin au
présent que je lui ferais, soit une livre de parfums
de Cosmus ou de Niceros, soit une bonne charge de
laine d’Espagne, soit dix pièces d’or à l’effigie de
César. Phyllis me saute au cou, me caresse, me
baise aussi longuement que les colombes dans leurs
amours, et finit par me demander une amphore de
vin.» Phyllis subissait-elle une nouvelle transformation
à son désavantage, et Martial reconnaissait-il
qu’il s’était trop pressé de rétracter tout le mal qu’il
[376]
avait dit d’elle, avant de la posséder. Tout s’expliquerait
mieux si ce nom de Phyllis désignait deux
ou trois courtisanes différentes, que Martial aurait
traitées bien différemment, en commençant par le
dédain, en passant par l’amour et en arrivant à
l’insouciance.
Les autres courtisanes qu’on rencontre çà et là
dans les douze livres des épigrammes de Martial n’y
figurent pas plus de deux fois chacune; et souvent
une seule fois; mais nous nous garderions bien
d’assurer qu’elles avaient fait une impression moins
vive et moins durable sur l’esprit mobile et fantasque
du poëte. Il ne faut jamais prendre à la lettre
les duretés qu’il leur adresse, et qui n’étaient peut-être
qu’une menace de guerre pour arriver plus vite
à signer la paix. Ainsi, la première fois qu’il s’attaque
à la pauvre Lydie (Liv. XI, ép. 21), il la
dépeint comme incapable d’inspirer de l’amour et
de donner du plaisir (Lydia tam laxa est, equitis
quam culus aheni); il pousse son imagination libertine
jusqu’aux plus monstrueuses folies, et l’on
pourrait rester bien convaincu qu’il ne pense pas à
revenir sur ses jugements téméraires; mais ce n’était
là qu’une entrée en matière un peu brutale, il
est vrai: son sentiment va changer, dès qu’il aura
vu Lydie de près, dès qu’il lui reconnaîtra certaines
qualités qui en impliquent d’autres; il ne se rend
pas sur tous les points, en effet, et il continue la
guerre, pour n’avoir pas l’air de mettre bas les
[377]
armes trop tôt: «On ne ment pas, Lydie, quand
on affirme que tu as un beau teint, sinon la figure
belle. Cela est vrai, surtout si tu restes immobile et
muette comme une figure de cire ou comme un
tableau; mais, sitôt que tu parles, Lydie, tu perds
ce beau teint, et la langue ne nuit à personne plus
qu’à toi.» C’était une façon adroite de faire entendre
à Lydie, qu’il ne demandait qu’à lui apprendre à
parler, et qu’au besoin il parlerait pour elle. Martial
avait fait sa profession de foi à l’égard de ses
goûts amoureux: «Je préfère une fille de condition
libre, disait-il avec gaieté; mais, à défaut de celle-ci,
je me contenterai bien d’une affranchie. Une
esclave serait mon pis-aller; mais je la préférerai
aux deux autres, si par sa beauté elle vaut pour moi
une fille de condition libre.» On voit que Martial
n’était pas difficile sur la question de l’origine de
ses maîtresses, et qu’elles n’avaient pas besoin de
justifier de leur naissance avec lui, puisqu’il ne partageait
pas le préjugé des vieux Romains, qui
voyaient un déshonneur dans le commerce d’un
homme libre avec une esclave. Il ne s’érige pas en
défenseur des courtisanes, qui étaient souvent des
esclaves exploitées et vendues par un maître tyrannique
et avare; mais il les couvre souvent d’un
manteau d’indulgence. Quand un chevalier romain,
nommé Paulus, le prie de faire contre Lysisca des
vers qui la fassent rougir et dont elle soit irritée, il
refuse de se prêter à une lâche vengeance et il
[378]
tourne la pointe de son épigramme contre Paulus
lui-même. Cette Lysisca était peut-être la même que
celle dont Messaline prenait le nom pour se faire
admettre dans le lupanar où elle se prostituait aux
muletiers de Rome. A l’époque où Paulus était si
acharné contre elle, on ne la comptait plus que
parmi les fellatrices, qui se recrutaient chez les
courtisanes hors de mode et sans emploi.
Ces immondes complaisantes étaient si nombreuses
du temps de Martial, qu’on les rencontra à chaque
pas dans ses épigrammes, où elles se heurtent
au passage avec de vilains hommes et des enfants
qui pratiquaient le même métier. Le poëte a l’air
de les flétrir les uns et les autres, mais il ne manifeste
nulle part à leur sujet une indignation qui eût
été un anachronisme dans les mœurs romaines. Il
s’indigne davantage contre les vieilles prostituées
qui persistaient à ne pas disparaître de la scène des
amours et qui offensaient les regards de la jeunesse
voluptueuse: «Tu n’as pour amies, Fabulla, que
des vieilles ou des laides, et plus laides encore que
vieilles; tu t’en fais suivre, tu les traînes après toi
dans les festins, sous les portiques, aux spectacles.
C’est ainsi, Fabulla, que tu parais jeune et jolie.»
A trente ans, chez les Romains, une femme n’était
plus jeune; elle était vieille à trente-cinq, décrépite
à quarante. Martial laisse éclater partout son aversion
et son dégoût pour les femmes qui avaient
passé l’âge des jeux et des plaisirs: il est féroce,
[379]
impitoyable contre elles; il les poursuit de sarcasmes
amers; il ne leur offre pas d’autre alternative que
de sortir du monde, où elles ne peuvent plus servir
que d’épouvantail. Sila veut l’épouser à tout prix,
Sila qui possède en dot un million de sesterces; mais
Sila est vieille, vieille du moins aux yeux de Martial.
Il lui impose alors les conditions les plus dures,
les plus humiliantes: les époux feront lit à part,
même la première nuit; il aura des maîtresses et des
mignons, sans qu’elle puisse s’en formaliser; il les
embrassera devant elle, sans qu’elle y trouve à redire;
à table, elle se tiendra toujours à distance, de
sorte que leurs vêtements mêmes ne se touchent
pas; il ne lui donnera que de rares baisers; elle ne
lui rendra que des baisers de grand’mère: si elle
consent à tout cela, il consent à l’épouser, elle et ses
sesterces. Cette horreur de la vieillesse est une
monomanie chez Martial, qu’elle poursuit et qu’elle
attriste sans cesse: il voudrait n’être entouré que
de frais visages de femmes et d’enfants; l’idée seule
d’une amoureuse surannée lui ôte à l’instant la faculté
d’aimer, et, s’il fait l’épitaphe d’une vieille qui va
rejoindre son amant au tombeau, il se la représente
aussitôt invitant le mort à lui payer sa bienvenue
(hoc tandem sita prurit in sepulchro calvo Plotia,
cum Melanthione), et cette odieuse image le glace
lui-même dans les bras de sa maîtresse. Cependant,
malgré son horreur pour tout ce qui n’est plus jeune,
il semble se complaire à peindre la vieillesse sous
[380]
ses traits les plus révoltants; il a toujours des couleurs
nouvelles à broyer sur sa palette, quand il veut
faille un portrait de vieille femme; il imite les gens
qui ont peur des spectres et qui en parlent sans cesse,
comme pour s’aguerrir contre eux. Jamais poëte n’a
fait des figures de vieilles plus grimaçantes, plus
hideuses, plus originales; Horace lui-même est surpassé.
Le chef-d’œuvre de Martial, en ce genre, est
l’épigramme suivante, dont nous désespérons de
rendre l’effrayante énergie: «Quand tu as vécu sous
trois cents consuls, Vetustilla; quand il ne te reste
plus que trois cheveux et quatre dents; quand tu as
une poitrine de cigale, une jambe de fourmi, un
front plus plissé que ta stole, des tétons pareils à
des toiles d’araignées; quand le crocodile du Nil a
la gueule étroite en comparaison de tes mâchoires;
quand les grenouilles de Ravenne babillent mieux
que toi, quand le moucheron de l’Adriatique chante
plus doucement, quand tu ne vois pas plus clair
que les chouettes au matin, quand tu sens ce que
sentent les mâles des chèvres, quand tu as le croupion
d’une oie maigre; quand le baigneur, sa lanterne
éteinte, t’admet parmi les prostituées de cimetière;
quand le mois d’août est pour toi l’hiver et
que la fièvre pernicieuse ne pourrait même te dégeler;
eh bien! tu te réjouis de te remarier, après deux
cents veuvages, et tu cherches dans ta folie un
mari qui s’enflamme sur tes cendres! N’est-ce pas
vouloir labourer un rocher? Qui t’appellera jamais
[381]
sa compagne ou sa femme, toi que Philomélus appelait
jadis son aïeule! Mais, si tu exiges qu’on
dissèque ton cadavre, que le chirurgien Coricles
dresse le lit!... A lui seul appartient de faire ton
épithalame, et le brûleur de morts portera devant
toi les torches de la nouvelle mariée (intrare in
ipsum sola fax potest cunnum).»
Martial, au reste, ne se piquait pas souvent de
galanteries envers les courtisanes; il n’était bien inspiré
que par les mauvais compliments qu’il pouvait
leur adresser. Gallia, qui sans doute ne sent pas bon
de son fait, ressemble à la boutique de Cosmus, où
les flacons se seraient brisés et les essences renversées:
«Ne sais-tu pas, lui dit Martial, qu’à ce prix-là
mon chien pourrait sentir aussi bon?» (Liv. III,
ép. 55). Saufeia, la belle Saufeia, consent à se
donner à lui, mais elle refuse opiniâtrement de se
baigner avec lui. Ce refus paraît suspect à Martial,
qui en cherche la cause et qui se demande si Saufeia
n’a pas la gorge pendante, le ventre ridé, et le reste:
Aut infinito lacerum patet inguen iatu;
Aut aliquid cunni prominet ore tui.
Mais, après avoir ouvert la carrière à son imagination,
il vient à penser que Saufeia est bégueule
(fatua es), et il la laisse là (Liv. III, ép. 72). Quant
à Marulla, elle n’accueille les gens qu’après s’être
assurée de ce qu’ils pèsent (Liv. X, ép. 55). Il ne
s’arrête à Thélesilla, que pour lui faire affront et pour
[382]
se louer lui-même: il a fait ses preuves en amour,
et pourtant il n’est pas sûr de pouvoir en quatre ans
prouver une seule fois à Thélesilla qu’il est homme
(Liv. XI, ép. 97). Pontia lui envoie du gibier et des
gâteaux, en lui écrivant qu’elle s’ôte les morceaux de
la bouche pour les lui offrir: «Ces morceaux, je ne
les enverrai à personne, dit le cruel Martial qui se
rappelle que Pontia pue de la bouche, et à coup sûr
je ne les mangerai pas» (Liv. VI, ép. 75). Lecanie
se fait servir au bain par un esclave, dont le sexe est
décemment caché par une ceinture de cuir noir, et
cependant jeunes et vieux se baignent tout nus avec
elle: «Est-ce que ton esclave, lui demande Martial,
est le seul qui soit vraiment homme?» (Liv. VII,
ép. 35). Ligella épile ses appas surannés, Ligella
qui a l’âge de la mère d’Hector et qui se croit encore
dans l’âge des amours: «S’il te reste quelque pudeur,
lui crie Martial; cesse d’arracher la barbe à
un lion mort!» (Liv. X, ép. 90). Lyris est une
ivrognesse et une fellatrice abominable (Liv. II,
ép. 73). Fescennia boit encore plus que Lyris, mais
elle mange des pastilles de Cosmus pour neutraliser
les vapeurs empoisonnées de son estomac (Liv. I,
ép. 88). Sénia racontait que, passant un soir dans
un chemin désert, elle avait été mise à mal par des
voleurs qui ne s’étaient pas contentés de la voler:
«Tu le dis, Sénia, reprend Martial, mais les voleurs
le nient.» (Liv. XII, ép. 27). Galla, en prenant
des années et des amants, est devenue riche et
[383]
savante; Martial le reconnaît, mais il la fuit, de peur
de ne pas savoir lui parler d’amour comme il faut
(sæpe solecismum mentula nostra facit). Enfin, Églé,
qui plaît aux vieux comme aux jeunes, et qui rend
aux premiers la vigueur des seconds, en apprenant
à ceux-ci tout ce que les autres peuvent savoir
(Liv. XI, ép. 91), Églé vend ses baisers et donne
gratis ses faveurs les plus secrètes (Liv. XII, ép. 55):
«Qui veut que vous vous donniez gratis, jeune
fille, s’écrie Martial, celui-là est le plus sot et le plus
perfide des hommes!... Ne donnez rien gratis,
excepté des baisers!»
La plupart de ces courtisanes, comme l’indiquent
leurs noms, n’étaient pas grecques; elles ne venaient
pas de si loin, et beaucoup sortaient des faubourgs
de Rome, où leurs mères les avaient vendues
à la Prostitution. Le temps était passé des
scrupules et des préjugés de la vieille Rome, qui
autrefois n’eût pas souffert que ses enfants la déshonorassent
en se mettant à l’encan. On recherchait
encore les courtisanes grecques, en les payant plus
cher que d’autres; mais on en trouvait d’autant
moins qui fussent réellement originaires de la Grèce,
que toutes, afin de se renchérir, se faisaient passer
pour telles, même en conservant leur nom latin.
Les unes cependant ne savaient pas un mot de grec;
les autres n’avaient rien de la beauté grecque; celles
qui parlaient grec pour l’avoir appris, faisaient des
fautes à chaque phrase; celles qui portaient le costume
[384]
grec pour l’avoir adopté, lui attribuaient les
noms des modes romaines. Une de ces prétendues
filles de la Grèce, nommée Celia, croyait se gréciser
davantage en refusant de frayer avec les Romains:
«Tu te donnes aux Parthes, lui dit Martial, qu’elle
avait traité en Romain; tu te donnes aux Germains,
tu te donnes aux Daces; tu ne dédaignes pas les lits
du Cilicien et du Cappadocien; il t’arrive un amant
égyptien, de la ville de Cérès; un amant indien, de
la mer Rouge; tu ne fuis pas les caresses des Juifs
circoncis; l’Alain, sur son cheval sarmate, ne passe
pas devant ta maison, sans s’y arrêter. Comment se
fait-il que toi, fille de Rome, tu ne veux pas te
plaire avec les Romains?»
Quâ ratione facis, quum sis romana puella,
Quod romana tibi mentula nulla placet?
Cette même Celia, qu’une mauvaise leçon appelle
Lelia dans une autre épigramme (Liv. X, ép. 68),
s’était gravé dans la mémoire quelques mots grecs
qu’elle répétait à tout propos avec un accent romain:
«Quoique tu ne sois ni d’Éphèse, ni de Rhodes, ni
de Mytilène, mais bien d’un faubourg de Rome;
quoique ta mère, qui ne se parfume jamais, soit de
la race des Étrusques basanés, et que ton père soit
un rustre des campagnes d’Aricie, tu prodigues ces
mots voluptueux: ζωἡ et ψυχἠ. O pudeur! toi, concitoyenne
d’Hersilie et d’Égérie! Ces mots ne se disent
qu’au lit, et encore tous les lits ne doivent pas
[385]
les entendre!... c’est affaire au lit qu’une amante a
dressé elle-même pour son tendre amant. Tu désires
savoir quel est le langage d’une chaste matrone en
pareille occurrence; mais en serais-tu plus charmante
dans les mystères du plaisir (numquid, quum, crissas
blandior esse potes)? Va, tu peux apprendre et retenir
par cœur tout Corinthe, et pourtant, Celia, tu
ne seras jamais tout à fait Laïs!» Il y a du dépit
dans ces épigrammes, et Martial ne dissimule pas
qu’il eût souhaité être aimé à la grecque par cette
Laïs romaine. Quand il n’accuse pas une courtisane
d’être décrépite, de sentir le vin, d’être trop rapace,
de dévorer trop d’amants, de n’avoir plus
d’amateurs, on peut dire, avec quelque certitude,
qu’il a quelques projets sur elle et qu’il est bien près
de réussir; mais il est, d’ordinaire, sans égard et sans
pitié pour la maîtresse qu’il quitte. C’est donc de sa
part une extrême délicatesse que de ne pas injurier
ou diffamer Lycoris, en se séparant d’elle pour aller à
Glycère. «Il n’était pas de femme qu’on pût te préférer,
Lycoris, lui dit-il: adieu! Il n’est pas de
femme qu’on puisse préférer à Glycère! Elle sera ce
que tu es maintenant; tu ne peux plus être ce
qu’elle est; ainsi fait le temps: je t’ai voulue, je la
veux.» Il ne dit pas alors plus de mal de Lycoris,
qui était brune de teint et qui, pour le blanchir, allait
s’établir à Tibur, dont l’air vif passait pour favorable
à la peau (Liv. VII, ép. 13). Quand elle revint
de la campagne, il remarqua qu’elle n’était pas plus
[386]
blanche et il s’aperçut aussi qu’elle louchait: Lycoris,
il est vrai, avait pris, à la place du poëte, un
enfant beau comme le berger Pâris (Liv. III, ép. 39).
Martial semble éviter d’avouer ses maîtresses: il
les proclame assez, quand il les loue. Ainsi, en présence
de Chioné et de Phlogis, il se demande laquelle
des deux est la mieux faite pour l’amour
(Liv. XI, ép. 60). Chioné est plus belle que Phlogis;
mais celle-ci a des sens qui redonneraient de la jeunesse
au vieux Nestor, des sens que chacun voudrait
rencontrer chez sa maîtresse (ulcus habet, quod
habere suam vult quisque puellam). Chioné, au contraire,
n’éprouve rien (at Chione non sentit opus), ni
plus ni moins que si elle était de marbre: «O dieux!
s’écrie Martial, s’il m’est permis de vous faire une
grande prière et si vous voulez m’accorder le plus
précieux des biens, faites que Phlogis ait le beau
corps de Chioné, et que Chioné ait les sens de
Phlogis!»
Les libertins de Rome ne se faisaient pas faute de
souhaiter: le vœu de leur imagination lubrique
était toujours en opposition avec une réalité dont
ils étaient las ou qui ne les contentait plus. La carrière
ouverte à ces fantaisies spéculatives du libertinage
s’entourait d’horizons voluptueux, vers lesquels
Martial aimait à porter ses regards. Entre toutes les
maîtresses qu’il avait, celle qu’il n’avait pas excitait
toujours chez lui des désirs plus ardents. Une courtisane
plus délicate que ses pareilles, Polla, éprouve
[387]
pour le poëte un sentiment tendre qu’il n’a pas
cherché à lui inspirer: elle ne se défend pas contre
ce sentiment; elle s’y abandonne avec passion; elle
n’hésite pas à le déclarer, et, pour que Martial en
soit averti, elle lui envoie des couronnes de fleurs
qui doivent parler pour elle. Martial reçoit les couronnes
et ne les suspend pas à son lit, selon l’usage
des amoureux: «Pourquoi, Polla, m’envoyer
des couronnes toutes fraîches? lui écrit-il; j’aimerais
mieux des roses que tu aurais fanées (à te malo vexatas
tenere rosas).» Martial, en échange d’une gracieuse
invitation à l’amour, que lui apportaient ces
fleurs brillantes, n’adressait à Polla qu’une pensée
libertine et repoussante; car il lui demandait
de lui faire connaître, par l’envoi des couronnes
qu’elle avait portées dans les festins, le nombre
d’assauts qu’elle avait eus à y soutenir. Martial, on le
voit, ne se piquait pas de ces délicatesses, de ces
élans du cœur qui distinguent les poëtes grecs, et
qui se retrouvent comme un écho affaibli dans les
érotiques latins du siècle d’Auguste. Veut-il, dans
un moment de satiété sensuelle, se représenter la
femme qu’il souhaiterait avoir pour maîtresse, il ne va
pas la chercher en idée parmi les vierges et les matrones:
«Celle que je veux, ce dit-il sans rougir de
ses goûts, c’est celle qui, facile en amour, erre çà
et là, voilée du palliolum; celle que je veux, c’est
celle qui s’est donnée à son mignon, avant d’être à
moi; celle que je veux, c’est celle qui se vend tout
[388]
entière pour deux deniers; celle que je veux, c’est
celle qui suffit à trois en même temps. Quant à celle
qui réclame des écus d’or et qui fait sonner de belles
phrases, je la laisse en possession à quelques citoyens
de Bordeaux!» Martial était devenu grossier
de sentiments, sinon de langage, en se plongeant
de plus en plus dans le bourbier de la débauche
impériale. Cette méprisable société de courtisanes et
de gitons qui l’entourait avait fini par lui ôter le sens
moral et par lui gâter le cœur.
Il en était venu jusqu’à ne plus respecter sa
femme, cette Clodia Marcella, Espagnole comme
lui, et la compagne de sa fortune depuis trente-cinq
ans. Peu de temps avant de retourner avec elle
dans leur pays natal, il eut le triste courage de lui
adresser cette honteuse profession de foi, bien digne
d’un libertin consommé et incorrigible: «Ma femme,
allez vous promener, ou accoutumez-vous à mes
mœurs! Je ne suis ni un Curius, ni un Numa, ni un
Tatius. Les nuits passées à vider de joyeuses coupes
me charment: toi tu te hâtes de te lever de
table, après avoir bu de l’eau tristement; tu te plais
dans les ténèbres, moi j’aime qu’une lampe éclaire
mes plaisirs et que Vénus s’ébatte au grand jour; tu
t’enveloppes de voiles, de tuniques et de manteaux
épais: pour moi, une femme couchée à mes côtés
n’est jamais assez nue; les baisers à la manière des
tourterelles me délectent: ceux que tu me donnes
ressemblent à ceux que tu reçois de ta grand’mère
[389]
chaque matin. Tu ne daignes jamais seconder mon
ardeur amoureuse, ni par des paroles, ni avec les
doigts, ni du moindre mouvement, comme si tu
présentais le vin et l’encens dans un sacrifice. Les
esclaves phrygiens se souillaient derrière la porte,
chaque fois qu’Andromaque était dans les bras
d’Hector...»
Masturbabantur Phrygii post ostia servi,
Hectoreo quoties sederat uxor equo.
Et, quamvis Ithaco stertente, pudica solebat
Illic Penelope semper habere manum.
Pædicare negas: dabat hoc Cornelia Graccho;
Julia Pompeio; Porcia, Brute, tibi!
Dulcia dardanio nondum miscente ministro
Pocula, Juno fuit pro Ganymede Jovi.
Martial ne rougit pas d’invoquer l’exemple de ces
infamies, que les grands noms qu’il cite devaient
absoudre aux yeux de l’antiquité; mais sa femme
ne se soucie pas plus d’imiter Junon que Porcie ou
Cornélie. Alors le poëte, indigné de trouver si peu
de complaisance dans le lit conjugal, s’écrie avec
dureté: «S’il vous convient d’être une Lucrèce tout
le long du jour, la nuit je veux une Laïs.» Mais
Lucrèce ne tarda pas à reprendre son empire, celui
qu’une honnête femme ne demande jamais aux caprices
des sens. Il est permis de supposer que l’influence
salutaire de Marcella décida Martial à retourner
à Bilbilis, en Espagne; elle y avait des biens qu’elle
tenait de sa famille: ces biens, elle en fit abandon à
son mari, et elle parvint à l’entraîner hors de l’abîme
[390]
des dépravations romaines, au milieu desquelles
il s’oubliait depuis trente-cinq ans. Martial
se trouva comme purifié, lorsqu’il ne respira plus le
même air que ces courtisanes, ces cinædes, ces
entremetteuses, ces lénons, ces vils agents de la
luxure, ces odieux ministres de débauche qui composaient
presque toute la population de Rome. Il ne
brûla pas ses livres d’épigrammes, où il avait enregistré,
pour ainsi dire, les actes de la Prostitution
sous les règnes de sept empereurs; mais il y ajouta
une épigramme expiatoire, dans laquelle il reconnaissait
implicitement qu’il avait mal vécu jusque-là
et que le bonheur était dans la vie champêtre, auprès
d’une épouse estimable et bien-aimée: «Ce
bois, ces sources, cette treille sous laquelle on est à
l’ombre, ce ruisseau d’eau vive qui arrose les prés,
ces champs de roses qui ne le cèdent pas à celles de
Pestum, qu’on voit fleurir deux fois l’an; ces légumes
qui sont verts en janvier et qui ne gèlent jamais,
ces viviers où nage l’anguille domestique,
cette tour blanche qui abrite de blanches colombes:
ce sont là des présents de ma femme, après sept lustres
d’absence. Marcella m’a donné ce domaine, ce
petit royaume. Si Nausicaa m’abandonnait les jardins
de son père, je pourrais dire à Alcinoüs:—J’aime
mieux les miens!» Cette simple et rustique
épigramme repose l’esprit et le cœur, après toutes
les impuretés que Martial semble avoir accumulées
avec plaisir dans son recueil, où l’on est tout étonné
[391]
de trouver quelques nobles et vertueuses indignations
de poëte.
Voici une de ces honorables sorties, que fait Martial
contre les vices impunis que traîne après elle la
Prostitution: «Tu dis que tu es pauvre à l’égard des
amis, Lupus? tu ne l’es pas avec ta maîtresse; il n’y
a que ta mentule qui ne se plaigne pas de toi. Elle
s’engraisse, l’adultère, de conques de Vénus en
fleur de farine, tandis que ton convive se repaît de
pain noir! Le vin de Sétia, qui enflammerait la neige
même, coule dans le verre de cette maîtresse, et
nous, nous buvons la liqueur trouble et empoisonnée
des tonneaux de Corse. Tu achètes une nuit ou
une partie de nuit avec l’héritage de tes pères, et
ton compagnon d’enfance laboure solitairement des
champs qui ne sont pas les siens. Ta prostituée brille
chargée de perles d’Érythrée, et, pendant que tu
t’enivres d’amour, on mène en prison ton client. Tu
donnes à cette fille une litière portée par huit Syriens,
et ton ami sera jeté nu dans la bière. Va
maintenant, Cybèle, châtier de misérables gitons;
la mentule de Lupus méritait mieux de tomber
sous tes sacrés couteaux!»
Nous n’avons pas le courage de faire parler Martial
au sujet de la Prostitution masculine, qui a l’air
de l’occuper beaucoup plus que celle des femmes.
On a peine à se rendre compte de l’état de démoralisation
où l’ancienne Rome était tombée à l’égard
des monstrueux égarements de la débauche anti-physique.
[392]
Il faut lire Martial pour avoir une idée de
ces mœurs dégoûtantes, qui avaient presque détrôné
en amour le sexe féminin, et qui avaient fait des
jeunes garçons ou des efféminés un sexe nouveau
consacré à de honteux plaisirs. Il faut lire Martial
pour comprendre que l’époque de corruption, où il
vivait aussi mal que ses contemporains, osait regarder
en face et sans horreur les hideux désordres de
la promiscuité des sexes entre eux. Quand on voit,
dans ce recueil d’épigrammes, obscènes la plupart,
le panégyrique de l’empereur Domitien suivre ou
précéder l’éloge des mignons; quand on rencontre
dans la même page une invocation à la vertu, une
prière à quelque divinité, et une excitation à la pédérastie
la plus effrontée, on reste convaincu que
le sens moral était perverti dans la société romaine.
Chez les Grecs, du moins, s’il n’y avait pas plus de
retenue dans les faits, il y avait plus de décence,
moins de grossièreté dans leurs expressions. Sans
doute on n’attachait pas plus de répugnance à certains
actes répréhensibles au double point de vue
de la dignité humaine et des lois naturelles; mais
on relevait cette dégradation sensuelle, par le prestige
du dévouement, de l’amitié et de la passion
idéale. Chez les Romains, au contraire, pour tout
raffinement, le vice s’était matérialisé en rejetant
toute espèce de voile et de pudeur. Les oreilles n’étaient
pas plus respectées que les yeux, et le cœur
semblait avoir perdu ses instincts de délicatesse, dans
[393]
cet endurcissement moral qui lui donnait l’habitude
des choses honteuses. Nous ne voulons pas pénétrer
dans ces chemins détournés de la Prostitution,
qui ne nous offriraient que des objets répulsifs et
attristants, en présence desquels notre imagination
s’arrêterait épouvantée. Nous préférons renvoyer le
lecteur à Martial lui-même et aux satiriques de son
siècle, Juvénal et Pétrone. Le premier n’a rien dit
de moins que Martial, mais il s’est renfermé dans
une concision qui souvent le rend obscur et par cela
même plus réservé; les commentateurs seuls ont
suppléé à ses réticences, ont porté le flambeau dans
ses ténèbres les plus discrètes: on y pénètre d’un
pas sûr, et on est effrayé de tout ce que le poëte a
rassemblé de turpitudes dans cet enfer des Césars.
Le second, sous la forme d’un roman comique et
licencieux, a fait une peinture des excès de son
temps; ce roman est comme un long hymne en
l’honneur de Giton, son horrible héros.
Pétrone était pourtant un voluptueux des plus
habiles et des plus raffinés; Tacite l’appelle l’arbitre
du bon goût, et ce surnom lui est resté (arbiter),
sans impliquer une approbation de ses mœurs, que
la cour de Néron pouvait seule justifier. Pétrone, il
est vrai, ne se piquait pas, comme Juvénal, d’être
un sage incorruptible: il ne nombrait pas du doigt
les infamies de son temps, pour en éloigner ceux qui
n’y trempaient pas encore; il ne s’indignait nullement
des scandales que chacun étalait avec cynisme;
[394]
il s’en amusait, au contraire; il en riait le premier, et
il avait l’air de regretter de n’en pas dire davantage.
Son livre est un affreux tableau de la licence de
Rome, et, quand on songe que nous ne possédons
pas la dixième partie de ce roman d’aventures obscènes,
il est facile de supposer que nous avons perdu
les épisodes les plus révoltants, les descriptions les
plus infâmes, les saletés les plus caractérisées, puisque
l’œuvre de Pétrone a été mutilée par la censure
chrétienne, qui n’a pas réussi à l’anéantir entièrement.
Il reste assez d’impuretés de tout genre dans
les fragments que nous avons conservés, pour juger
à la fois l’ouvrage qui faisait les délices de la jeunesse
romaine, l’auteur qui avait exécuté cet ouvrage
d’après ses propres souvenirs et au reflet de
ses impressions personnelles, enfin l’époque elle-même
qui formait de tels auteurs et qui tolérait de
tels livres. Il y a vingt passages dans le Satyricon
qui sembleraient avoir été écrits dans un mauvais
lieu, et la verve, l’entrain, la pétulance du romancier,
accusent encore l’excitation qu’il avait cherchée
dans les bras de l’amour, avant de prendre sa
plume. Nous ne rappellerons pas les principales scènes
de ce drame érotique et sotadique, ni l’orgie de
Quartilla, ni celle de Trimalcion, ni celle de Circé;
car, en cet étrange roman, l’orgie succède à l’orgie
avec une terrible puissance, et les personnages se
meuvent constamment dans une atmosphère embrasée
de luxure! Ascylte et Giton, que Pétrone s’est
[395]
plu à représenter sous les couleurs les plus séduisantes,
sont pourtant des types de bassesse et de
perversité. L’un, suivant les expressions mêmes de
l’auteur, est un jeune adolescent que toutes les débauches
ont souillé, affranchi par la Prostitution,
citoyen par elle (stupro liber, stupro ingenuus), dont
le sort des dés disposait comme d’un enjeu et qui
se louait pour fille à ceux mêmes qui le croyaient
homme; l’autre, l’exécrable Giton, prit la robe de
femme en guise de toge virile, dit Pétrone, et,
croyant devoir dès le berceau n’être point de son
sexe, fit œuvre de prostituée dans un bouge d’esclaves
(opus muliebre in ergastulo fecit). Après de
semblables portraits, on ne peut que s’étonner de ne
pas les trouver tenant mieux parole et répondant à
ce qu’ils avaient promis. Ainsi, le mariage de la
petite fille de sept ans Pannychis, avec Giton, offrait
sans doute des détails extraordinaires, qui auront
empêché de dormir quelque rhéteur devenu Père de
l’Église, et que sa chaste main aura fait disparaître
sans faire grâce à l’originalité et à la richesse du
récit. Il est possible de juger ce qui manque à cet
endroit, par la prodigieuse scène qui se passa dans le
sanctuaire du temple de Priape, lorsque le héros du
lieu, ayant eu l’imprudence de tuer les oies sacrées
qui le harcelaient, se voit à la merci de la prêtresse
du dieu Ænothée et de sa compagne Proselenos. Le
latin seul a le privilége incontesté de mettre en
relief de pareilles horreurs, que le français rougirait
[396]
de reproduire même en les enveloppant de gaze
transparente. Voici les singulières et malhonnêtes
représailles que les deux vieilles tirent du pauvre
tueur d’oies: «Profert Ænothea scorteum fascinum,
quod ut oleo et minuto pipere, atque urticæ trito circumdedit
semine, paulatim cœpit inserere ano meo.
Hoc crudelissima anus spargit subinde humore femina
mea. Masturisi succum cum abrotono miscet, perfusisque
inguinibus meis, viridis urticæ fascem comprehendit,
omniaque infra umbilicum cœpit lenta manu.» C’est
peut-être le seul passage d’un auteur ancien dans
lequel il soit question, au point de vue érotique, de
la flagellation avec des orties vertes. On ne s’explique
pas que les moines des premiers siècles, qui
faisaient une si aveugle guerre aux œuvres profanes
de l’antiquité, aient laissé subsister dans Pétrone
ce passage effroyable.
Presque tous les aspects de la Prostitution antique
se retrouvent dans le Satyricon, où l’on ne rencontre
que prostituées, mignons, courtiers d’amour, tout
ce qu’il y a d’impur dans le trafic de la femme
et de l’homme. Parmi les entremetteuses, figure
une matrone des plus respectées nommée Philumène
qui, grâce aux complaisances de sa jeunesse,
avait escroqué plus d’un testament; qui, après
que l’âge eut flétri ses charmes, prodiguait son
fils et sa fille aux vieillards sans postérité, et soutenait
par ces successeurs l’honneur de son premier
métier. Cette Philumène envoya les deux enfants
[397]
dans la maison d’Eumolpe, grave personnage
plein d’ardeur et de caprice, qui aurait pris des
libertés avec une vestale, et qui ne balança pas à inviter
la petite aux mystères de Vénus Callipyge (non
distulit puellam invitare ad Pygisiaca sacra). Puis, le
narrateur, qui parle latin, par bonheur, entre dans
les détails, que nous ne traduisons pas en style
pudique et incolore. Eumolpe avait dit à tout le
monde, qu’il était goutteux et perclus des reins:
«Itaque, ut constaret mendacio fides, puellam quidem
exoravit, ut sederet supra commendatam bonitatem.
Coraci autem imperavit, ut lectum, in quo ipse jacebat,
subiret, positisque in pavimento manibus, dominum
lumbis suis commoveret. Ille lento parebat imperio,
puellæque artificium pari motu remunerabat.» Tel
est, en quelque sorte, le tableau final du roman. Les
petites pièces de vers, qu’on a recueillies à la suite
et qui faisaient partie, prétend-on, du texte en
prose supprimé ou perdu, renferment quelques pièces
amoureuses adressées évidemment à des courtisanes,
qu’elles nous font connaître par des éloges
plutôt que par des épigrammes à la manière de
Martial. Pétrone était trop ami des choses douces
et agréables pour s’envenimer l’esprit à l’endroit de
ces créatures, auprès desquelles il ne cherchait que
son plaisir. Sertoria est la seule qu’il maltraite un
peu, et peut-être dans une bonne intention, pour la
corriger de se farder sans en avoir besoin: «C’est
perdre en même temps, lui dit-il, ton fard et ton
[398]
visage!» Quand Martia lui envoie de la campagne
et châtaignes épineuses et oranges parfumées, il
lui écrit d’apporter elle-même ses présents ou de
joindre un envoi de baisers à celui des fruits: «Je
les mangerai ensemble (vorabo lubens),» dit-il à
cette aimable campagnarde. Mais une autre est à ses
côtés, une autre qu’il ne nomme pas; elle porte une
rose sur sa gorge: «Cette rose, dit-il galamment,
tire de ton sein une rosée d’ambroisie, et c’est alors
qu’elle sentira vraiment la rose.» La nuit, il s’éveille
à demi, sous le charme d’un songe charmant;
il entend la voix de Délie, qui lui parle d’amour et
qui lui laisse un baiser imprimé sur le front; il l’appelle
à son tour, il étend les bras; mais il ne trouve
plus autour de lui que la nuit et le silence: «Hélas!
murmure-t-il, c’était un écho de mon cœur et de
mon oreille!» Mais à Délie succède Aréthuse, l’ardente
Aréthuse aux cheveux dorés, qui pénètre à
pas discrets dans la chambre de son amant et qui est
déjà frémissante auprès de lui; elle ne s’endormira
pas, la folle maîtresse! elle imite curieusement les
poses et les inventions voluptueuses qu’elle a étudiées
dans le fameux code du plaisir et dans les dessins
qui l’accompagnent (dulces imitata tabellas):
«Ne rougis de rien, lui dit Pétrone, qui l’encourage,
sois plus libertine que moi!» (Nec pudeat quidquam,
sed me quoque nequior ipsa.) Bassilissa ne lui en offrait
pas autant: elle n’accordait ses faveurs, qu’ayant
été prévenue à l’avance (et nisi præmonui, te dare
[399]
posse negas). Pétrone lui vante les délices de l’imprévu:
«Les plaisirs nés du hasard, lui dit-il avec
humeur, valent mieux que ceux qui ont été prémédités
par lettres.» Ce fut probablement pour se venger
des résistances calculées de Bassilissa, qu’il lui
reprochait de mettre trop de rouge à ses joues et
trop de pommade dans ses cheveux: «Se déguiser
sans cesse, lui dit-il rudement, n’est pas se fier à
l’amour (fingere te semper non est confidere amori).»
Pétrone, riche et généreux, beau et bien fait, impatient
de jouissances et infatigable, multipliait ses
amours et changeait tous les jours de maîtresse. Il
serait mort d’épuisement et de débauche, si la colère
de Néron ne l’avait contraint à se faire ouvrir
les veines pour échapper à la crainte du supplice
qui troublait sa vie menacée; il eût préféré une
mort plus lente et plus voluptueuse, car il avait coutume
de répéter cet axiome, qu’il mettait si largement
en pratique: «Les bains, les vins, l’amour
détruisent la santé du corps, et ce qui fait le bonheur
de la vie, ce sont les bains, les vins et l’amour.»
Balnea, vina, Venus, corrumpunt corpora sana;
Et vitam faciunt balnea, vina, Venus.

Sommaire.—Les empereurs romains.—Influence perverse de
leurs mœurs dépravées.—Rigueur des lois relatives à la moralité
publique avant l’avénement des empereurs.—L’édile Quintus
Fabius Gurgès.—Les édiles Vilius Rapullus et M. Fundanius.—Le
consul Postumius.—Le chevalier Ebutius et sa
maîtresse, la courtisane Hispala Fecenia.—Jules César.—Déportements
de cet empereur.—Femmes distinguées qu’il séduisit.—Ses
maîtresses Eunoé et Cléopâtre.—Infamie de ses
adultères.—César et Nicomède, roi de Bithynie.—Chanson
des soldats romains contre César.—Octave, empereur.—Son
impudicité.—Épisode singulier des amours tyranniques d’Auguste.—Répugnance
d’Auguste pour l’adultère.—Son inceste
avec sa fille Julie.—Son goût immodéré pour les vierges.—Sa
passion pour le jeu.—Ses femmes Claudia, Scribonia et
Livia Drusilla.—Le Festin des douze divinités.—Apollon
bourreau.—Tibère, empereur.—Son penchant pour l’ivrognerie.—Sévérité
de ses lois contre l’adultère.—Étranges contradictions
qu’offrirent la vie publique et la vie privée de cet
empereur.—Tibère Caprineus.—Abominable vie que menait
ce monstre dans son repaire de l’île de Caprée.—Le tableau de
Parrhasius.—Portrait physique de Tibère.—Caligula, empereur.—Ses
amours infâmes avec Marcus Lépidus et le comédien
Mnester.—Sa passion pour la courtisane Pyrallis.—Comment
[402]
cet empereur agissait envers les femmes de distinction.—Le
vectigal de la Prostitution.—Ouverture d’un lupanar dans le
palais impérial.—Le préfet des voluptés.—Claude, empereur.—Honteuses
débauches de ses femmes Urgulanilla et Messaline.—Néron,
empereur.—Sa jeunesse.—Ses soupers publics au
Champ-de-Mars et au grand Cirque.—Les hôtelleries du golfe
de Baïes.—Pétrone, arbitre du plaisir.—Abominables impudicités
de Néron.—Son mariage avec Sporus.—Sa passion
incestueuse pour sa mère Agrippine.—Les métamorphoses des
dieux.—Acté, concubine de Néron.—Galba, empereur.—Infamie
de ses habitudes.—Othon, empereur.—Ses mœurs
corrompues.—Vitellius, empereur.—Ses débordements.—Son
amour pour l’affranchi Asiaticus.—Son insatiable gloutonnerie.—Vespasien,
empereur.—Retenue de ses mœurs.—Cénis,
sa maîtresse.—Titus, empereur.—Sa jeunesse impudique.—Son
règne exemplaire.—Domitia et l’histrion Pâris.—Domitien,
empereur.—Ses déportements.—Peines terribles
contre l’inceste des Vestales.—Nerva, Trajan et Adrien, empereurs.—Antonin-le-Pieux
et Marc-Aurèle.
Ce fut sous les empereurs, ce fut par l’influence
perverse de leurs mœurs dépravées, ce fut par leur
exemple et à leur instigation malfaisante, que la société
romaine fit d’effrayants progrès dans la corruption,
qui acheva de la désorganiser et de préparer
les voies au triomphe de la morale chrétienne. Cette
pure et sainte morale avait bien jeté quelques éclairs
précurseurs dans la philosophie du paganisme; mais
ses conseils étaient sans force et sans portée, parce
qu’ils n’émanaient pas encore de l’autorité religieuse,
parce qu’ils ne découlaient pas du dogme lui-même,
parce qu’ils restaient étrangers au culte. La religion
des faux dieux, au contraire, semblait donner
un démenti permanent aux doctrines philosophiques,
[403]
qui tendaient à rendre l’homme meilleur, en
lui apprenant à se laisser diriger par l’estime de soi
et à mériter aussi l’estime des autres. Cette religion,
toute matérielle et toute sensuelle, ne pouvait suffire
aux esprits élevés et aux nobles cœurs, que
l’Évangile du Christ allait trouver tout prêts à le
comprendre; mais il fallait des siècles de travail
mystérieux dans les âmes, pour les approprier, en
quelque sorte, à la foi nouvelle, à la morale. Tous
les excès du luxe, tous les débordements des passions,
toutes les recherches du plaisir furent le résultat
d’une extrême civilisation qui n’avait pas de
frein religieux et qui n’aspirait pas à un autre but
qu’à la satisfaction de l’égoïsme le plus brutal. Jamais
cet égoïsme ne fut poussé si loin qu’à l’époque
des Césars, qui en ont été, pour ainsi dire, la monstrueuse
personnification.
«Le vice est à son comble!» s’écriait tristement
Juvénal effrayé des infamies qu’il dénonçait dans ses
satires: Omne in præcipiti vitium stetit. Dans vingt endroits
de son recueil, ce farouche stoïcien maudit les
turpitudes de son temps et regrette les vertus austères
des Romains de la République: «Voilà, malheureux,
à quel point de décadence nous sommes parvenus!
dit-il avec amertume... Nous avons, il est vrai,
porté nos armes aux confins de l’Hibernie, nous
avons tout récemment soumis les Orcades et la Bretagne,
où les nuits sont si courtes; mais ce que fait
le peuple vainqueur dans la Ville éternelle, les peuples
[404]
vaincus ne le font pas!» L’histoire de Rome,
en effet, avant la dépravation impériale, est pleine
de faits qui témoignent, sinon de la pureté des
mœurs, du moins de la rigueur des lois relatives à
la moralité publique. L’an 457 de la fondation de
Rome, Quintus Fabius Gurgès, fils du consul, signala
son édilité en accusant au tribunal du peuple
certaines matrones qui se livraient à la débauche
(matronas stupri damnatas), et les fit condamner à
une amende énorme dont le produit fut employé à
ériger un temple à Vénus, auprès du grand Cirque.
L’an 539, les édiles populaires, Vilius Rapullus et
M. Fundanius intentèrent une accusation semblable
à des matrones coupables de pareils désordres, et
les envoyèrent en exil. L’an 568, le consul Postumius,
ayant été averti des hideuses obscénités qui
se commettaient dans la célébration des Bacchanales,
prit des mesures vigoureuses pour extirper le mal
dans sa racine, et pour anéantir la secte impudique
qui se propageait dans l’ombre, sous le vain
prétexte des mystères de Bacchus. Un jeune chevalier
romain, nommé Ebutius, était venu se plaindre
au consul qu’on avait entraîné sa maîtresse aux
Bacchanales. Cette maîtresse n’était pourtant qu’une
courtisane appelée Hispala Fecenia; esclave dans sa
jeunesse, depuis son affranchissement elle continuait
son ancien métier, au-dessus duquel la plaçait l’élévation
de ses sentiments. Elle avait contracté avec
Ebutius une liaison qui ne nuisait pas à la réputation
[405]
du jeune homme, quoiqu’il vécût aux dépens
de cette affranchie (meretriculæ munificentiâ continebatur).
Hispala demeurait sur le mont Aventin, où
elle était bien connue (non ignotam viciniæ). Le consul
pria sa belle-mère Sulpicia de mander cette courtisane,
qui ne fut pas peu étonnée d’être introduite
chez une matrone respectable. Là, Postumius l’interrogea
en présence de sa belle-mère, et il obtint
la révélation complète de toutes les horreurs qui
avaient lieu dans les assemblées nocturnes des Bacchanales.
Le lendemain, il alla au sénat, et il demanda
les moyens d’exterminer une secte infâme
qui comptait déjà sept mille initiés à Rome et aux
environs. Le sénat partagea l’indignation de Postumius
et prononça des peines terribles contre les abominables
auteurs des Bacchanales. Quant à Ebutius
et à sa compagne, ils furent généreusement récompensés:
le sénatus-consulte déclara que la belle Hispala,
malgré son origine et malgré son métier,
pourrait épouser un homme de condition libre, sans
que ce mariage pût compromettre en rien la fortune
et la réputation de son mari. Elle épousa Ebutius
et prit le rang de matrone, sous la sauvegarde des
consuls et des préteurs, qui devaient la garantir de
toute insulte. Les Bacchanales, flétries et proscrites
par arrêt du sénat, n’osèrent reparaître à Rome que
sous le règne des empereurs.
Les mœurs publiques furent perdues, dans tout
l’empire romain, du jour où le chef de l’État cessa
[406]
de les respecter lui-même, et donna le signal des
vices qu’il était appelé à réprimer. Jules César, ce
grand homme dont le génie éleva si haut la puissance
romaine, par les armes, la politique et la
législation; Jules César fut le premier à offrir aux
Romains le spectacle corrupteur de ses déportements.
On eût dit qu’il voulait prouver par là que
son ancêtre Énée lui avait transmis quelque chose
du sang de Vénus. Tous les historiens, Suétone,
Plutarque, Dion Cassius, s’accordent à reconnaître
qu’il était très-porté aux plaisirs de l’amour, et qu’il
n’y épargnait pas la dépense: pronum et sumptuosum
una in libidines fuisse, dit Suétone. Il séduisit un
grand nombre de femmes distinguées, telles que
Postumia, femme de Servius Sulpicius; Lollia,
femme d’Aulus Gabinius; Tertulla, femme de Marcus
Crassus; et Marcia, femme de Cneius Pompée;
mais il n’aima aucune femme plus que Servilie,
mère de Brutus. Il lui donna, pendant son premier
consulat, une perle qui avait coûté six millions de
sesterces (1,162,500 fr.), et, à l’époque des guerres
civiles, outre les riches présents dont il la combla,
il lui fit adjuger à vil prix les plus beaux domaines,
qu’on vendait alors aux enchères. Comme on s’étonnait
du bon marché de ces acquisitions, Cicéron
répondit par cette épigramme: «Le prix est d’autant
plus avantageux, qu’on a fait déduction du
tiers.» Le jeu de mots signifiait aussi: «On a livré
Tertia.» On soupçonnait, en effet, Servilie de favoriser
[407]
elle-même un commerce scandaleux entre sa
fille Tertia et son propre amant. César ne respectait
pas davantage le lit conjugal dans les provinces où
il passait avec son armée; après la conquête des
Gaules, le jour de son triomphe, ses soldats chantaient
en chœur:
Urbani, servate uxores, mœchum calvum adducimus!
Aurum in Galliâ effutuisti; at hic sumsisti mutuum.
«Citadins, gardez bien vos épouses, voici que
nous ramenons le libertin chauve! César, tu as répandu
en amour dans les Gaules tout l’or que tu
as pris à Rome!» Jules César fut l’amant de plusieurs
reines étrangères, entre autres d’Eunoé, femme du
roi de Mauritanie. Il aima surtout avec passion la
voluptueuse Cléopâtre, reine d’Égypte, qui lui
donna un fils qu’il eût voulu choisir pour héritier.
Ses ardeurs vénériennes s’étaient tellement accrues,
au lieu de diminuer avec les années, qu’il
convoitait toutes les femmes de l’empire romain, et
qu’il eût souhaité pouvoir en disposer à son choix.
Il avait rédigé un singulier projet de loi, qu’il eut
honte pourtant de présenter à la sanction du sénat:
par cette loi, il se réservait le droit d’épouser autant
de femmes qu’il voudrait, pour avoir autant d’enfants
qu’il était capable d’en produire. L’infamie de ses
adultères était si notoire, raconte Suétone, que Curion
le père, dans un de ses discours, l’avait qualifié
mari de toutes les femmes et femme de tous les
[408]
maris. La seconde partie de cette sanglante épigramme
tombait à faux, car, suivant l’histoire, César
ne pécha qu’une seule fois dans sa vie par impudicité,
c’est-à-dire en s’adonnant au vice contre
nature (ce vice seul était aux yeux des Romains un
outrage à la pudeur); mais ce honteux égarement
de César eut un si fâcheux éclat, qu’un opprobre
ineffaçable en rejaillit sur son nom dans le monde
entier. La calomnie s’empara sans doute d’un fait,
qui n’avait été qu’un accident de débauche, et qui
aurait passé inaperçu, si les deux coupables n’eussent
pas été Jules César et le roi Nicomède. Cicéron
rapporte, dans ses lettres, que César fut conduit par
des gardes dans la chambre du roi de Bithynie;
qu’il s’y coucha, couvert de pourpre, sur un lit
d’or, et que ce descendant de Vénus prostitua sa
virginité à Nicomède (floremque ætatis à Venere orti
in Bithynia contaminatum). Depuis cette infâme
complaisance, César se vit en butte aux ironies les
plus amères, et il les supporta patiemment, sans y
répondre et sans les démentir. Tantôt Dolabella
l’appelait en plein sénat: la concubine d’un roi, la
paillasse de la couche royale; tantôt le vieux Curion
le traitait de lupanar de Nicomède et de prostituée
bithynienne. Un jour, comme César s’était fait le
défenseur de Nysa, fille de Nicomède, Cicéron l’interrompit,
avec un geste de dégoût, en disant: «Passons,
je vous prie, sur tout cela; on sait trop ce que
vous avez reçu de Nicomède, et ce que vous lui
[409]
avez donné!» Une autre fois, un certain Octavius,
qui se permettait tout impunément, parce qu’il passait
pour fou, salua César du titre de reine, et Pompée,
du titre de roi. C. Memmius racontait à qui
voulait l’entendre, qu’il avait vu le jeune César servant
Nicomède à table et lui versant à boire, confondu
qu’il était avec les eunuques du roi. Enfin,
quand César montait au Capitole, après la soumission
des Gaules, les soldats chantaient gaiement autour de
son char de triomphe: «César a soumis les Gaules,
Nicomède a soumis César. Voici que César triomphe
aujourd’hui pour avoir soumis les Gaules; Nicomède
ne triomphe pourtant pas, lui qui a soumis César.»
Octave ne resta point au-dessous de César, en fait
d’impudicité: «Sa réputation fut flétrie dès sa jeunesse
par plus d’un opprobre,» lit-on dans Suétone.
Sextus Pompée le traita d’efféminé; Marc-Antoine
lui reprocha d’avoir acheté, au prix de son déshonneur,
l’adoption de son oncle; Lucius, frère de
Marc-Antoine, prétendit qu’Octave, après avoir
livré la fleur de son innocence à César, la vendit
une seconde fois en Espagne à Hirtius pour
300,000 sesterces (58,225 fr.); Lucius ajoutait
qu’Octave avait coutume alors de se brûler le poil
des jambes avec des coquilles de noix ardentes,
afin que ce poil repoussât plus doux. Tout le peuple
lui appliqua un jour, avec une joie maligne, un
vers prononcé sur la scène pour désigner un prêtre
de Cybèle jouant du tambourin: Viden, ut cinædus
[410]
orbem digito temperat? L’équivoque roulait sur le
mot orbem, qui pouvait s’entendre à la fois du tambourin,
de l’univers et des parties déshonnêtes que
gouvernait aussi le doigt d’un vil cinæde. Mais plus
tard Octave réfuta ces accusations, peut-être calomnieuses,
par la chasteté de ses mœurs à l’égard
d’un vice qu’on n’eut pas à lui reprocher davantage,
lorsqu’il eut atteint l’âge d’homme. Quant à ses
mœurs, sous un autre rapport, elles étaient loin
d’être chastes ou même réservées. Il semblait avoir
hérité de la fureur amoureuse de Jules César pour
toutes les femmes. En dépit de ses lois contre l’adultère,
il ne fut point aussi sévère pour lui-même, qu’il
l’était pour les autres, et il n’épargna pas, pour son
propre compte, l’honneur nuptial de ses sujets. Marc-Antoine
prétendait avoir été témoin d’un épisode singulier
des amours tyranniques de l’empereur: au
milieu d’un festin, Auguste fit passer, de la salle à
manger dans une chambre voisine, la femme d’un
consulaire, quoique le mari de celle-ci fût au nombre
des invités; et, lorsqu’elle revint avec Auguste,
après avoir donné aux convives le temps de vider
plus d’une coupe à la gloire de César, la dame avait
les oreilles rouges et les cheveux en désordre. Le
mari seul n’y prit pas garde. Avant que Marc-Antoine
se fût déclaré son ennemi et son compétiteur,
il lui écrivait familièrement: «Qui t’a donc changé?
Est-ce l’idée que je possède une reine? Mais Cléopâtre
est ma femme, et ce n’est pas d’hier, car il y a
[411]
neuf ans. Mais tu ne te contentes pas de Livie?
Oui, tu es un tel homme, que, quand tu liras
cette lettre, je te crois capable d’avoir pris Tertulla,
ou Térentilla, ou Ruffilla, ou Salvia Titiscénia, ou
peut-être toutes. Peu t’importe en quel lieu et pourquoi
tes désirs s’éveillent?» (Anne refert ubi et in
quam arrigas?)
Quelle que fût néanmoins l’incontinence d’Auguste,
il avait certaine répugnance pour l’adultère,
qui lui semblait une plaie sociale, et qu’il essaya
inutilement de combattre par des lois rigoureuses.
Quand il se permettait d’enfreindre lui-même sa
législation à cet égard, il n’épargnait aucune précaution
pour cacher une faiblesse dont il rougissait,
et qu’il n’avouait pas à ses plus chers confidents.
Ainsi, le poëte Ovide paya de sa disgrâce éclatante
le malheur d’avoir été témoin des amours incestueux
de l’empereur avec sa fille Julie. Auguste n’avait
pas à craindre sans doute une indiscrétion, de la
part de ce fidèle serviteur, qui était son rival ou
qui passait pour l’être; mais il ne voulait pas s’exposer
à voir en face, à tout moment, un homme devant
lequel il s’était déshonoré. Dans sa jeunesse,
ces scrupules ne le tourmentaient pas, puisque ses
amis, selon Suétone, ne s’occupaient qu’à lui chercher
des femmes mariées et des filles nubiles, qu’ils
faisaient mettre nues devant eux, pour les examiner
comme des esclaves en vente au marché de Toranius.
Ces tristes objets de la luxure impériale devaient,
[412]
avant d’être choisis et approuvés, remplir
certaines conditions requises par les caprices d’Auguste,
qui se montrait curieux des plus secrets détails
de leur beauté. C’est ainsi que les commentateurs
ont interprété ces mots conditiones quæsitas,
que l’historien a laissés, en quelque sorte, sous un
voile transparent. L’ardeur d’Auguste pour les plaisirs
des sens ne se refroidit pas avec l’âge, mais il
cessa de prendre ses maîtresses parmi les mères de
famille, qui ne lui inspiraient plus les mêmes désirs,
et il se rejeta exclusivement sur les vierges (ad vitiandas
virgines promtior); on lui en amena de tous
côtés, et sa femme même se prêtait à les introduire
auprès de lui. Cette espèce de fureur ne pouvait
toujours durer, et la vieillesse y mit bon ordre. Ce
fut alors qu’à la passion des femmes succéda celle
du jeu, moins fatigante et non moins insatiable que
l’autre. Auguste, en jouant aux dés, souriait encore
au coup de Vénus (trois six) qui faisait rafle,
comme il le dit gaiement dans une lettre à Tibère.
Le goût immodéré qu’il avait pour les vierges,
dans la dernière partie de sa vie, ne lui était venu
qu’au déclin de sa virilité. Lorsqu’il se sentait
jeune et vigoureux, il avait vécu avec sa première
femme Claudia, qui était à peine nubile, sans réclamer
l’usage de ses droits de mari; car elle n’était pas
moins vierge que la veille de son mariage, quand il se
sépara d’elle pour épouser Scribonia, veuve de deux
consulaires. Il répudia également Scribonia, à cause
[413]
de la perversité des mœurs de cette mère de famille.
Il se maria en troisièmes noces avec Livia Drusilla,
qu’il avait enlevée à Tibère Néron, dont elle était
enceinte; il l’aima constamment, malgré les infidélités
perpétuelles qu’il ne prenait pas seulement la
peine de lui cacher. Satisfaite d’être aimée par-dessus
tout, Livie ne regardait pas comme des rivales
toutes ces femmes vénales qui se succédaient dans
les bras de son mari. Si énormes que fussent les
excès d’Auguste en cheveux gris, ils étaient toujours
effacés, dans l’opinion publique, par ceux de
sa jeunesse. On avait beaucoup parlé surtout d’un
souper mystérieux, qu’on appelait vulgairement le
Festin des douze divinités, souper où les convives,
habillés en dieux et en déesses, imitèrent les scènes
indécentes que la poésie antique a placées dans l’Olympe,
sous l’influence de l’ambroisie qu’Hébé et
Ganymède y versaient à la ronde. Dans cette orgie,
Octave avait représenté Apollon, et un satirique
anonyme immortalisa le souvenir de ces impiétés
obscènes dans ces vers fameux: «Lorsque César
osa prendre le masque d’Apollon et célébrer dans
un festin les adultères des dieux, ces dieux indignés
s’éloignèrent du séjour des mortels et Jupiter
lui-même abandonna ses temples dorés.» Ce souper,
dont les particularités ne furent jamais bien
connues, coïncidait avec la disette à laquelle Rome
était alors en proie: «Les dieux ont mangé tout
le blé!» dirent les Romains, en apprenant que
[414]
l’Olympe avait soupé dans le palais de César: «Si
César est, en effet, le dieu Apollon, murmuraient
les plus hardis, c’est Apollon bourreau.» Le dieu
était adoré sous le nom de Tortor, dans un quartier
de la ville où l’on vendait les instruments de supplice,
entre autres les verges. Suivant un scholiaste,
cette injurieuse qualification appliquée à Auguste
faisait allusion au rôle qu’il avait joué dans cette
fête nocturne.
Les orgies d’Auguste étaient naïves et innocentes
auprès de celles qui faisaient la distraction du vieux
Tibère. Cet empereur, que son penchant pour l’ivrognerie
avait conduit par degrés à tous les vices les
plus hideux, se piquait pourtant de réformer les
mœurs des Romains; il renchérit sur la sévérité des
lois que son prédécesseur avait faites contre l’adultère;
il rétablit l’ancien usage de faire prononcer,
par une assemblée de parents, à l’unanimité des voix,
le châtiment des femmes qui auraient manqué à la
foi conjugale; quant aux maris qui fermaient les
yeux sur le scandale de la conduite de leurs épouses,
il les força de répudier avec éclat ces impudiques;
il exila dans les îles désertes des patriciennes
qui s’étaient fait inscrire sur les listes de la Prostitution
pour se livrer sans danger à leurs déportements;
il bannit de Rome les jeunes libertins de condition
libre, qui, pour obtenir le droit de paraître sur le
théâtre ou dans l’arène, avaient volontairement requis
d’un tribunal la note d’infamie. Mais il ne
[415]
tenait pour lui-même aucun compte des austères
prescriptions de sa jurisprudence, et il avait l’air de
chercher à commettre des crimes ou des turpitudes
que nul avant lui n’eût osé imaginer. Ses actes de
magistrat suprême et son genre de vie présentaient
sans cesse les plus étranges contradictions; un jour,
dans le sénat, il apostropha durement Sestius Gallus,
vieillard prodigue et libidineux, qui avait été
flétri par Auguste, et peu d’instants après, en sortant,
il s’invita lui-même à souper chez ce vieux
libertin, à condition que rien ne serait changé aux
habitudes de la maison, et que le repas serait servi
comme à l’ordinaire par de jeunes filles nues (nudis
puellis ministrantibus). Une autre fois, pendant qu’il
travaillait à la réformation des mœurs, il passa deux
jours et une nuit à table avec Pomponius Flaccus et
L. Pison, qu’il récompensa de leurs infâmes complaisances,
en nommant l’un gouverneur de Syrie et
l’autre préfet de Rome, et en les appelant, dans ses
lettres patentes, «ses plus délicieux amis de toutes
les heures.» Il punissait de mort quiconque, homme
ou femme, ne se prêtait pas aussitôt à ses sales
désirs. C’est pour se venger d’un refus de cette
espèce, qu’il fit accuser par ses délateurs la belle
Mallonia, qui préféra la mort à la honte. Durant les
débats du procès, il la conjurait de se repentir, mais
elle se perça d’une épée, après l’avoir traité tout
haut de «vieillard à la bouche obscène, velu et puant
comme un bouc.» Aussi, aux premiers jeux qui
[416]
furent célébrés depuis cette tragique aventure, tous
les spectateurs applaudirent, en appliquant à Tibère
ce passage d’une atellane: «Tel on voit un vieux
bouc lécher les chèvres (hircum vetulum capreis naturam
ligurire).» Le peuple avait surnommé l’empereur
Caprineus, en faisant allusion en même temps
à ses mœurs de bouc et à son séjour habituel dans
l’île de Caprée.
Voici comment Suétone a raconté l’abominable
vie que menait ce monstre au fond de son repaire:
«Il imagina une grande chambre, dont il fit le
siége de ses plus secrètes débauches. Là, des troupes
choisies de jeunes filles et de jeunes garçons,
dirigées par les inventeurs d’une monstrueuse Prostitution,
qu’il appelait spinthries (étincelles), formaient
une triple chaîne, et, mutuellement enlacées,
passaient devant lui, pour ranimer par ce spectacle
ses sens épuisés. Il avait aussi plusieurs chambres
diversement arrangées pour le même usage; il les
orna de tableaux et de bas-reliefs représentant les
sujets les plus lascifs; il y rassembla les livres d’Éléphantis,
afin que le modèle ne manquât pas à la
circonstance (ne cui in opera edenda exemplar imperatæ
schemæ deesset). Dans les bois et dans les forêts
il ne vit que des asiles consacrés à Vénus, et il voulut
que les grottes et les creux des rochers offrissent
sans cesse à ses regards des couples amoureux en
costumes de nymphes et de satyres... Il poussa la
turpitude encore plus loin, et jusqu’à des excès
[417]
qu’il est aussi difficile de croire que de rapporter: il
avait dressé des enfants de l’âge le plus tendre,
qu’il appelait ses petits poissons,—ut natanti sibi inter
femina versarentur ac luderent, linguâ morsuque
sensim appetentes, atque etiam, quali infantes firmiores,
necdum tamen lacte depulsos, inguini ceu papillæ
admoveret;—genre de plaisir, auquel son âge et son
tempérament le portaient le plus. Ainsi, quelqu’un
lui ayant légué le tableau de Parrhasius, où Atalante
prostitue sa bouche à Méléagre, et le testament lui
donnant la faculté de recevoir, à la place de ce tableau,
si le sujet lui déplaisait, un million de sesterces
(193,750 fr.), il préféra le tableau et le fit
placer, comme un objet sacré, dans sa chambre à
coucher. On dit aussi qu’un jour, pendant un sacrifice,
il s’éprit de la beauté d’un jeune garçon qui
portait l’encens; il attendit à peine que la cérémonie
fût achevée, pour assouvir à l’écart son ignoble
passion, à laquelle dut se prêter aussi le frère de ce
malheureux, qu’il avait remarqué jouant de la flûte;
ensuite, comme ils se reprochaient l’un à l’autre
leur opprobre, il leur fit casser les jambes à tous
deux. Le portrait physique de Tibère achèvera de
caractériser ses mœurs: «Il était gros et robuste,
d’une taille au-dessus de l’ordinaire, large des
épaules et de la poitrine, bien fait et bien proportionné.
Il était plus adroit et plus fort de la main
gauche, que de l’autre main: les articulations en
étaient si vigoureuses, qu’il perçait du doigt une
[418]
pomme encore verte, et que d’une chiquenaude il
blessait la tête d’un enfant ou même d’un jeune
homme... Son visage était beau, mais sujet à se
couvrir subitement de boutons...»
Caligula, encore moins réservé que Tibère, qu’il
s’étudiait à imiter, afficha effrontément ses amours
infâmes avec Marcus Lépidus, le comédien Mnester
et plusieurs otages avec lesquels il avait un commerce
réciproque (commercio mutui stupri). Valérius
Catullus, fils d’un consulaire, lui reprocha un jour
d’avoir abusé de sa jeunesse (stupratum à se ac latera
sibi contubernio ejus defessa, etiam vociferatus
est); mais, grossier et brutal dans ses plaisirs, il ne
les variait par aucun raffinement de volupté, et la
gourmandise, plutôt que la luxure, inspirait les déréglements
de son imagination. Il chercha l’extraordinaire,
le monstrueux, excepté en amour, qui
ne fut pas même un prétexte à ses prodigalités.
«Sans parler de ses incestes avec ses sœurs et de
sa passion bien connue pour la courtisane Pyrallis,
raconte Suétone, il ne respecta aucune femme de la
plus haute distinction (non temere ullâ illustriore
feminâ abstinuit). Ordinairement il invitait à souper
ces dames avec leurs maris, et là, les faisant passer
devant lui, il les examinait longuement et minutieusement,
à la façon des marchands d’esclaves.
Puis, à plusieurs reprises, sortant de la salle du
festin avec celle qui lui avait plu, il la ramenait
bientôt, sans cacher les souillures récentes de sa débauche,
[419]
et louait ou critiquait tout haut cette malheureuse,
dont il énumérait les beautés ou les imperfections
corporelles, ainsi que ses propres exploits.
Il en répudia quelques-unes au nom de leurs époux
absents, et il fit insérer ces divorces dans les actes
publics.» Au reste, Caligula fit, en quelque sorte,
oublier ses désordres par ses ingénieuses cruautés,
par ses folles dépenses et par ses impitoyables exactions.
Parmi les impôts bizarres et ignobles qu’il
établit à Rome, il faut citer le vectigal de la Prostitution:
chaque prostituée était taxée au prix qu’elle
exigeait elle-même en vendant son corps (ex capturis
prostitutarum, quantum quæque uno concubitu
mereret). L’empereur ajouta depuis, à ce chapitre de
la loi, qu’un pareil droit serait exigé de tous ceux,
hommes et femmes, qui avaient vécu du lenocinium
et du meretricium. On comprend que la fixation de
cet impôt ne pouvait être qu’arbitraire et facultative.
Mais un des faits les plus singuliers du règne de
Caligula, c’est la fondation et l’ouverture d’un lupanar
dans le palais des Césars. Ce fait monstrueux,
qui est rapporté par Dion Cassius et par Suétone, a
paru si peu vraisemblable à quelques critiques,
qu’ils ont voulu voir une altération du texte dans
ce passage, que Dion, à leur avis, aurait copié de
confiance, d’après Suétone, en l’amplifiant et en le
poétisant. Selon ces critiques, il s’agirait d’un tripot
et non d’un lupanar. Dion ajoute seulement au récit
de l’historien latin, que Caligula avait pris dans
[420]
les Gaules l’idée de son lupanar impérial. «Afin
qu’il n’y eût aucun genre d’exactions qui ne fût mis
en pratique, il établit un lupanar dans le palais: là,
un grand nombre de cellules furent construites et
ornées suivant la convenance du lieu, et des matrones,
des ingénus, occupèrent ces cellules. L’empereur
envoyait ses nomenclateurs autour des places
et des basiliques, pour inviter à la débauche
(in libidinem) jeunes gens et vieillards. Les arrivants
trouvaient à emprunter de l’argent à usure, et l’on
prenait les noms de ceux qui payaient largement
leur écot, comme s’ils souscrivaient ainsi pour l’accroissement
des revenus de César.» Ces détails sont,
en effet, très-vagues et très-obscurs; on les appliquerait
plutôt à un tripot qu’à un lupanar, et l’on ne
se rend pas compte surtout de cet emprunt qui
attendait les nouveaux venus que les nomenclateurs
avaient recrutés sur la voie publique. Suétone
veut-il faire entendre par là que le prix de cette
Prostitution, sous la garantie de l’empereur, était si
considérable que nul n’avait assez d’argent sur soi
pour la payer? Ce qui nous fait présumer que ce
prétendu lupanar n’était qu’une maison de jeu, dirigée
par des matrones et des fils de famille (ingenui),
c’est que Suétone ajoute immédiatement des particularités
qui ne peuvent se rapporter qu’aux jeux
de hasard (alea), dans lesquels Caligula usait de
fraude et de parjure pour être toujours maître de la
chance.
[421]
Quoi qu’il en soit, si l’emploi de préfet des voluptés
(à voluptatibus), créé par Tibère, subsista jusqu’au
règne de Néron, il est certain que le lupanar
impérial ne survécut pas à Caligula, qui l’avait inventé
et qui en tirait de gros bénéfices. Son successeur
Claude ne fut pas moins cruel ni moins sanguinaire
que lui, mais il n’en arriva pas à de
semblables excès d’impudeur. Il eut trop de femmes
légitimes pour avoir beaucoup de maîtresses, et
celles qu’il se donna, par caprice plutôt que par
amour, n’eurent point assez de notoriété et d’éclat
pour que l’histoire ait parlé d’elles. Suétone, qui a
soin d’enregistrer les mariages et les divorces de
Claude, en flétrissant les honteuses débauches (libidinum
probra) de sa première femme, Urgulanilla,
et les éclatants débordements de la troisième, Messaline,
Suétone formule un jugement général à l’égard
des mœurs de cet empereur: «Il aima passionnément
les femmes, mais il n’eut aucun commerce
avec les hommes (libidinis in feminas profusissimæ,
marium omnino expers).» Quels que fussent
d’ailleurs les désordres de Claude, ils étaient loin
d’égaler ceux de cette Messaline qui a été immortalisée
par Juvénal (voy. le fameux morceau
de la Satire VI, page 22 du présent volume), et
dont le nom est devenu, dans toutes les langues,
le synonyme de la Prostitution la plus effrontée. Il
faut chercher dans Tacite le récit des crimes et des
impudicités de cette impératrice (Liv. XI), qui avait
[422]
osé, du vivant de l’empereur, se marier publiquement
avec Silius et célébrer ce mariage adultère
par une orgie où elle joua le rôle de bacchante.
Malgré l’identité d’une courtisane nommée Lysirca,
qui ressemblait à Messaline, et qui avait pu se faire
passer pour elle dans l’exercice de son métier de
prostituée, nous n’entreprendrons pas de prouver
que Messaline a été calomniée par l’histoire, et
qu’une fatale ressemblance a fait seule son infâme
célébrité.
L’exemple de Messaline semblait avoir encouragé
Néron à surpasser ses prédécesseurs dans la carrière
des crimes de la Prostitution. Dès qu’il eut
levé le masque qui déguisait ses mauvais penchants,
il se jeta dans tous les excès que le raffinement du
libertinage avait pu imaginer et il donna satisfaction
à tous ses vices. Dans les premiers temps, il s’imposait
encore quelque contrainte en se livrant à la
débauche, à la luxure et à ses passions pétulantes,
qu’on pouvait faire passer pour des erreurs de jeunesse.
Dès que le jour tombait, il se couvrait la tête
du bonnet des affranchis ou d’une cape de muletier
pour courir les cabarets et les lieux suspects; il vagabondait
dans les rues, insultant les femmes, injuriant
les hommes et frappant tout ce qui lui résistait.
Il se compromettait alors avec les plus viles
mérétrices, avec les plus indignes lénons; il battait
souvent et se faisait battre quelquefois. C’était, suivant
lui, une manière adroite d’étudier le peuple
[423]
sur le fait, et d’apprendre à vivre en simple citoyen.
Comme les lupanaires, les maîtres d’esclaves, les
cabaretiers et les boulangers menaçaient de lui
casser les reins, il ne sortit plus sans être suivi à
distance par des gens armés, qui venaient au besoin
lui prêter main-forte. Mais il dédaigna bientôt
de cacher ses mœurs, et il se plut, au contraire, à
les afficher devant tout le monde, sans s’inquiéter
du scandale et du blâme. Ainsi, le voit-on souper en
public, soit au Champ-de-Mars, soit au grand Cirque,
et il se faisait servir par toutes les prostituées
de Rome et par des joueuses de flûte étrangères (inter
scortorum totius urbis ambubaiarumque ministeria).
Ce n’est pas tout; toutes les fois qu’il se rendait à
Ostie par le Tibre ou qu’il naviguait autour du golfe
de Baïes, on établissait, tout le long du rivage, des
hôtelleries et des lieux de débauche où des matrones,
jouant le rôle des maîtresses d’auberge, avec
mille cajoleries, l’invitaient à s’arrêter. Il s’arrêtait
fréquemment, et son voyage se prolongeait ainsi
pendant des semaines. Un préfet des voluptés ne lui
suffisant pas, il institua, en outre, un arbitre du plaisir,
et ce fut Pétrone qui paraît avoir rempli cette
charge difficile, au contentement de Néron. Il était
non-seulement l’arbitre du plaisir, mais encore de
l’élégance (elegantiæ arbiter, dit Tacite), et Tigellin
ne lui pardonna pas d’être si habile dans la science
des voluptés (scientiâ voluptatum potiorem). On ne
saurait croire néanmoins que Pétrone arbiter ait approuvé
[424]
les abominables impudicités que l’empereur
se permettait sans la moindre hésitation, dès que
l’idée lui en venait. Tacite, Suétone, Xiphilin, Aurelius
Victor, ont parlé de ces infamies; mais ils ont
évité de les peindre en détail et de faire comparaître
dans ce hideux tableau les lâches complaisants qui
partageaient l’orgie impériale ou qui en secondaient
les turpitudes. Suétone, après avoir signalé le commerce
pédagogique de Néron avec des ingénus
(ingenuorum pædagogia) et ses adultères avec des
femmes mariées, l’accuse simplement d’avoir violé
la Vestale Rubria. Il est plus explicite sur son mariage
exécrable avec Sporus, et sur son inceste avec
sa mère.
Sporus était un jeune garçon, d’une beauté incomparable;
Néron en devint éperdument amoureux,
et il souhaita que Sporus fût une femme; il
essaya, par un détestable égarement d’imagination,
de changer le sexe du jeune homme, qu’il fit mutiler
(ex sectis testibus etiam in muliebrem transfigurare
conatus). Alors, lui ayant constitué une dot et
le parant du voile nuptial comme une fiancée, il fit
célébrer avec pompe la cérémonie d’un mariage, où
il épousa son Sporus (celeberrimo officio deductum ad
se pro uxore habuit), sous les regards d’une nombreuse
assemblée qui applaudit à cette odieuse mascarade.
Quelqu’un qui assistait à la fête se permit
un bon mot qui aurait pu lui coûter cher: «Il aurait
été fort heureux pour le genre humain, que le
[425]
père de Néron, Domitius, eût épousé une pareille
femme!» Néron resta longtemps épris de Sporus,
qu’il avait revêtu du costume des impératrices et
qu’il n’avait pas honte de laisser paraître à ses côtés
en public; il voyagea en Grèce avec ce mignon, et
de retour à Rome, il se montra en litière avec lui
pendant les fêtes sigillaires, et on les voyait à
chaque instant s’embrasser (identidem exosculans).
Quant à sa mère, Agrippine, ce fut elle, selon Tacite,
qui sollicita la première les sens de Néron pour
se faire un crédit fondé sur une liaison impudique;
mais Néron, tout en s’abandonnant à ces criminelles
amours, n’accorda pas à sa complice le pouvoir
qu’elle convoitait, et il ne tarda pas à se lasser des
importunités qu’il s’était attirées comme un châtiment
de son inceste. Selon Suétone, il aurait aimé
follement Agrippine, sans arriver à l’accomplissement
de ses désirs coupables, soit qu’Agrippine eût
l’adresse et la force de les tenir en respect, soit
plutôt qu’il en eût été détourné par ses confidents
qui lui firent comprendre le danger de se mettre
ainsi sous la sujétion d’une femme impérieuse. Il
conserva toutefois à l’égard de sa mère une intention
libertine, qui se traduisait par des actes impurs,
lorsqu’il se promenait en litière avec elle. (Olim
etiam, quoties lectica cum matre veheretur, libidinatum
inceste, ac maculis vestis proditum, affirmant.) Bien
plus, pour que l’illusion lui présentât mieux les apparences
de la réalité, il admit au nombre de ses
[426]
concubines une courtisane qui ressemblait singulièrement
à Agrippine.
Néron se piquait d’être poëte, et il était entraîné
par les fictions de la poésie à d’incroyables caprices
de fureur érotique: ainsi, essayait-il d’imiter les
métamorphoses des dieux en se revêtant de peaux
de bêtes et en s’élançant, tantôt loup, tantôt lion,
tantôt cygne, tantôt taureau, sur des femmes ou
des hommes enchaînés ou libres, qu’il mordait,
égratignait, mutilait, à son plaisir (suam quidem
pudicitiam usque adeo prostituit, ut contaminatis
pæne omnibus membris, novissime quasi genus lusus
excogitaret, quo feræ pelle contectus emitteretur e
cavea, virorumque ac fœminarum ad stipitem deligatorum
inguina invaderet). Il renouvelait de la
sorte la fable d’Andromède, de Léda, d’Io, et de
tant d’autres contemporains des âges héroïques.
Puis, exalté par ces obscènes mascarades, il se persuadait
que les dieux favorables l’avaient changé
en femme, et il se livrait à son affranchi Diophore
en contrefaisant les cris d’une jeune vierge éperdue.
(Et quum affatim desævisset, conficeretur à Doryphoro liberto,
cui etiam, sicut ipsi Sporus, ita ipse denupsit,
voces quoque et ejulatus vim patientium virginum
imitatus.) Un pareil monstre n’était arrivé à ce
comble de turpitude, qu’en faisant rejaillir sur l’humanité
tout entière le mépris qu’il avait pour lui-même;
il était convaincu qu’aucun homme n’est
absolument chaste ni exempt de quelque souillure
[427]
corporelle (neminem hominem pudicum, aut
ulla corporis parte purum esse), mais il pensait que
la plupart savaient dissimuler le vice et le cacher
habilement: «Aussi, ajoute Suétone, pardonnait-il
tous les autres défauts à quiconque avouait sa lubricité
devant lui.» Ce misérable empereur était
bien digne de mourir, en pleurant, dans les bras de
l’infâme Sporus, qui ne mêla pas son sang à celui
de ce compagnon de débauches, qu’il détestait, car
Néron avait le corps tout couvert de taches et d’ulcères
qui exhalaient une odeur infecte et qui provenaient
de ses œuvres. Cependant ce fut sa concubine
Acté qui déposa ses cendres, en les arrosant de
larmes, dans le tombeau des Domitius.
Galba, quoiqu’il fît remonter son origine à Pasiphaé
et à son taureau, n’avait pas le tempérament
et la santé propres à continuer les énormes débordements
de Néron. Il était d’une maigreur excessive,
malgré les promesses de son nom, qui signifiait gros
en langage gaulois, et cette maigreur étique accusait
l’infamie de ses habitudes: il préférait aux jeunes
gens les hommes robustes et même déjà vieux
(libidinis in mares pronioris, et eos, non nisi præduros,
exoletosque). Quand Icilus, un de ses anciens concubins
(veteribus concubinis), vint lui annoncer en
Espagne la mort de Néron, on raconte que, non
content de l’embrasser indécemment devant tout le
monde, il le fit épiler, et l’emmena coucher avec
lui (non modo artissimis osculis palam exceptum ab
[428]
eo, sed, ut sine morâ velleretur, oratum atque seductum).
Othon, qui ne laissa pas le temps à Galba de
jouir de sa jeunesse, comme disaient les goujats de
l’armée en promenant sa tête au bout d’une lance,
était un élève et un complaisant de Néron; dès son
enfance, il avait été prodigue et débauché, coureur
de mauvais lieux et adonné à tous les excès. Dans
l’âge de l’ambition, il s’attacha, pour se mettre en
crédit, à une affranchie de cour, qui en avait beaucoup,
et il feignit même d’être amoureux d’elle,
quoiqu’elle fut vieille et décrépite. Ce fut par ce canal
qu’il s’insinua dans les bonnes grâces de Néron,
auquel il rendit d’ignominieux services. Mais il se
brouilla pourtant avec cet empereur, à cause de Poppée,
qu’ils se disputaient l’un à l’autre et qu’Othon
fut obligé d’abandonner au droit du plus fort. On
doit supposer que ses mœurs ne firent que se corrompre
davantage avec les années; et son genre de
vie peut être apprécié d’après la description de sa
toilette, qui témoigne de ses goûts efféminés: «Il se
faisait épiler tout le corps, et portait sur sa tête à
peu près chauve de faux cheveux fixés et arrangés
avec tant d’art, que personne ne s’en apercevait. Il
se rasait tous les jours la figure avec beaucoup de
soin, et se la frottait avec du pain détrempé, habitude
qu’il avait contractée dès que son menton se
couvrit d’un léger duvet, afin de ne jamais avoir de
barbe.»
[429]
Mais Othon, proclamé empereur à Rome, eut à
peine le loisir d’ordonner quelques secrètes orgies
dans le palais des Césars: il se vit contraint de marcher
à la rencontre de Vitellius, qui venait lui disputer
l’empire, et il se tua de sa propre main, après
trois défaites successives, quoique sa petite taille et
son extérieur féminin ne répondissent point à tant
de courage. Vitellius, son vainqueur et son successeur,
s’était déshonoré dans sa jeunesse par sa passion
pour une affranchie, dont il avalait la salive
mêlée de miel comme un remède souverain contre
les maux de gorge auxquels il était sujet. Il avait
été d’ailleurs élevé à l’école de la Prostitution; car il
passa son enfance à Caprée parmi les favoris de
Tibère, et il resta flétri du nom de Spinthria, parce
qu’il dirigeait les spintries du vieil empereur. Il continua
de se souiller des mêmes infamies, lorsqu’il eut
pris l’âge d’un vieux taureau, comme il le disait en
plaisantant, et il devint tour à tour l’impur familier
de Caligula, de Claude et de Néron. Mais dès lors il
était violemment épris d’un affranchi, nommé Asiaticus,
qui avait été son compagnon obscène à
Caprée (mutua libidine constupratum), et qui cherchait
toujours à lui échapper sans parvenir, à se faire
oublier. Vitellius le retrouvait, tantôt vendant de la
piquette aux muletiers, tantôt combattant parmi les
gladiateurs, et, dès qu’il l’avait revu, il se sentait
ému de ses honteux souvenirs de jeunesse; il s’emparait
de nouveau de cette victime peu docile, et il
[430]
cherchait à se l’attacher par des présents et des honneurs:
il fit de son Asiaticus un gouverneur de province
et un chevalier! Comme l’âge l’avait rendu
obèse, il sacrifia sa luxure à la gourmandise, en déclarant
que l’estomac était la partie du corps la plus
complaisante et la plus forte; contrairement aux autres,
qui s’affaiblissent par l’usage qu’on en fait. Il
développa tellement la capacité de son estomac,
qu’il mangeait presque sans interruption, lorsqu’il
ne dormait pas, et son insatiable gloutonnerie se renouvelait
à toute heure, par l’habitude qu’il avait
de ne pas attendre, pour vomir, que le travail de
la digestion fût commencé: il pouvait ainsi, tous les
jours, faire quatre repas qui remplissaient la journée
et une partie de la nuit. Ses sens s’alourdirent, et
ne se réveillèrent plus que par intervalles au milieu
de ces festins continuels où il invoquait rarement
Vénus en vidant des coupes énormes et en dévorant
des lamproies entières. Sa monstrueuse corpulence,
son visage rouge et bourgeonné, son ventre proéminent
et ses jambes grêles témoignaient qu’il avait
passé à table tout le temps de son règne et qu’il
ne s’était pas fatigué à courir après les jouissances
fugitives de l’amour.
Après avoir eu un empereur vorace, Rome eut un
empereur avare, qui s’abstint des ruineux excès de
ses prédécesseurs et qui ne tomba point dans leur
déconsidération. Vespasien, tout en persécutant les
chrétiens, ne laissa pas que de subir malgré lui l’influence
[431]
du christianisme: il comprit que la dignité
de l’homme exigeait une certaine retenue dans les
mœurs, et que le chef de l’empire devait jusqu’à un
certain point donner l’exemple du respect que chacun
est tenu d’avoir à l’égard de l’opinion publique.
La raison d’État fut le principe de cette philosophie
quasi chrétienne que Vespasien mit en pratique; son
tempérament froid et austère lui permit d’être conséquent
avec la morale. Il combattit la débauche par
quelques sages règlements, et surtout par son genre
de vie décent et régulier. Il vivait pourtant en concubinage,
depuis la mort de sa femme, Flavia Domitilla,
avec une ancienne maîtresse nommée Cénis,
affranchie d’Antonia, mère de Claude, à qui elle
avait servi de secrétaire; mais cette liaison illégitime
était devenue avec le temps aussi respectable qu’un
mariage sanctionné par la loi, et Cénis tenait auprès
de l’empereur le rang d’une véritable épouse. Vespasien
même lui resta fidèle, non-seulement parce qu’il
l’aimait, mais encore parce qu’il n’en aimait pas
d’autre. Cependant Suétone raconte qu’une femme
feignit pour lui une violente passion, et finit par
triompher de ses dédains, en lui persuadant qu’elle
mourrait inévitablement si elle n’obtenait de sa part
une preuve de tendresse. Cette preuve accordée,
Vespasien se relâcha de son avarice ordinaire, au
point de faire payer à la dame 400,000 sesterces
(77,500 fr.), et cela en l’honneur de la nouveauté
du fait. Son intendant lui ayant demandé comment
[432]
il fallait inscrire la somme dans les comptes de dépense
impériale: «Mettez, dit Vespasien: Pour une
passion inspirée par l’empereur (Vespasiano, ait,
adamato).» Tout chaste qu’il fût dans ses mœurs,
Vespasien descendait parfois à de grossières plaisanteries
et ne s’abstenait pas même des plus sales
expressions (prætextatis verbis).
Titus, avant de succéder à son père Vespasien,
s’était fait la plus mauvaise réputation dans Rome,
où sa cruauté et son intempérance lui avaient aliéné
les sympathies populaires: il prolongeait jusqu’au
milieu de la nuit ses débauches de table avec les
plus dissolus de ses familiers; on le voyait toujours
entouré d’un troupeau d’eunuques ou de gitons (exoletorum
et spadonum greges); on l’accusait aussi
de rapacité, et l’on disait ouvertement que ce serait
un autre Néron; mais il changea tout à coup
dès qu’il fut monté sur le trône, et il régna comme
un philosophe en se conformant sans le savoir aux
préceptes de l’Évangile de Jésus-Christ: à l’instar
de son père, il ne persécutait pas les chrétiens, qui
admiraient en lui le modèle de toutes les vertus
chrétiennes. Aussi, fut-il pleuré par tout son peuple,
quand il mourut prématurément, en déclarant qu’il
n’avait fait dans toute sa vie qu’une seule action
dont il dût se repentir. Suétone prétend que c’était
une liaison coupable avec Domitia, la femme du
frère de Titus mais que celle-ci protesta toujours
de son innocence en prenant les dieux à témoin:
[433]
«Elle n’était pas femme à nier un tel commerce,
ajouta-t-il, s’il eût existé, elle s’en serait plutôt
vantée la première, comme de toutes ses infamies.»
Domitia, en revanche, ne nia pas ses rapports
adultères avec l’histrion Pâris, qu’elle aimait éperdûment,
et Domitien, proclamé empereur, se vit
obligé de la répudier ou du moins de l’éloigner
quelque temps, pour satisfaire à l’indignation publique.
Il la reprit bientôt, en avouant que, malgré
tous les déportements de cette autre Messaline, il ne
savait pas se passer d’elle, et qu’elle lui tenait lieu
de cent maîtresses. Il avait donné cependant une
rivale à Domitia: c’était la propre fille de son frère
Titus; il l’avait séduite et enlevée à son mari, du
vivant même de Titus; il manifesta pour elle la passion
la plus effrénée, et il fut cause de sa mort, en la
contraignant à se faire avorter, dans le doute où il
était de sa monstrueuse paternité. Il n’était que trop
porté d’ailleurs aux plaisirs de l’amour, qu’il appelait
la gymnastique du lit (libidinis nimiæ, assiduitatem
concubitus, velut exercitationis genus, κλινοπαλην
vocabat). On assure qu’il s’amusait à épiler lui-même
ses concubines, lorsqu’il n’enfilait pas des mouches
avec un poinçon, et il se baignait dans de vastes
piscines avec les plus viles prostituées (nataretque
inter vulgatissimas meretrices). Toutefois, en dépit de
ces libertinages, Domitien s’occupa de réformer les
mœurs, et réclama l’application de plusieurs anciennes
lois de police tombées en désuétude: ainsi
[434]
pendant que Clodius Pollion, surnommé le Borgne,
faisait circuler la copie d’un billet autographe, dans
lequel Domitien, alors jeune et adonné à des vices
infâmes, lui promettait une nuit (noctem sibi pollicentis),
l’empereur faisait condamner, en vertu de
la loi Scantinia, plusieurs chevaliers romains convaincus
du crime de pédérastie. Ce fut lui qui défendit
aux femmes déshonorées l’usage de la litière
(probosis feminis lecticæ usum ademit), et qui établit
des peines terribles contre l’inceste des Vestales; il
fit enterrer vive la grande vestale, Cornélie, qui avait
eu plus d’un complice, et ceux-ci furent battus de
verges jusqu’à ce que mort s’ensuivît; d’autres vestales,
les sœurs Ocellata, Varronilla, eurent la
liberté de choisir leur genre de mort, et leurs séducteurs
allèrent en exil. Enfin, Domitien, honteux
sans doute en faisant un retour sur lui-même,
raya du tableau des juges un chevalier romain qui
avait repris sa femme, après l’avoir répudiée et traînée
devant les tribunaux comme adultère.
Mais la morale évangélique déborde de toutes
parts, et le paganisme semble rougir de ses prostitutions,
que justifiait l’histoire des faux dieux. La
philosophie chrétienne s’infiltre dans la doctrine de
Platon, et les empereurs, qui tiennent à honneur
d’être philosophes, s’appliquent à corriger leurs
vices et à mettre un frein à leurs passions. Ainsi,
le vieux Nerva qui, au dire de Suétone, avait corrompu
la jeunesse de Domitien; Trajan, qui aimait
[435]
les jeunes garçons, ce que Xiphilin ne condamne
pas; Adrien, qui eût sacrifié l’empire à son favori
Antinoüs, qu’il déifia, et qui passait pour un voluptueux
à toutes fins (quæ adultorum amore ac nuptarum
adulteriis, quibus Adrianus laborasse dicitur,
asserunt); ces trois empereurs régnèrent comme des
sages, et travaillèrent à reconstituer la société romaine
sur des bases d’honnêteté, de justice, de pudeur
et de religion, qui émanaient de la foi nouvelle.
Antonin le Pieux et Marc-Aurèle furent vraiment des
empereurs chrétiens, et sous leurs règnes glorieux,
on put croire que l’Évangile allait devenir le code
universel de l’humanité. Mais le paganisme, conspué
dans ses tendances matérielles et flétri dans sa dépravation
organique, devait tenter un dernier effort
sous Commode et sous Héliogabale, pour entraîner
le monde romain dans les dernières saturnales de la
Prostitution.

Sommaire.—Commode, empereur.—Sa jeunesse impudique.—Son
mignon Anterus.—Comment Commode employait ses
jours et ses nuits.—Anterus assassiné à l’instigation des préfets
du prétoire.—Ses trois cents concubines et ses trois cents cinædes.—Ses
orgies monstrueuses.—Incestes qu’il commit.—Hideuses
complaisances auxquelles il soumettait ses courtisans.—L’affranchi
Onon.—Commode se fait décerner par le sénat
le surnom d’Hercule.—Horribles débauches de ce monstre.—Comment
Marcia, concubine de Commode, découvrit le projet
qu’avait l’empereur de la faire périr, ainsi qu’un grand nombre
des officiers de la maison impériale.—Philocommode.—Mort
de Commode.—Héliogabale, empereur.—Célébrité unique
d’infamie laissée par lui dans l’histoire.—Héliogabale, grand-prêtre
du soleil.—Luxe macédonien des vêtements d’Héliogabale.—Semiamire
clarissima.—Petit sénat fondé par l’empereur,
pour complaire à sa mère.—Ce que c’était que le petit
sénat et de quoi l’on s’y occupait.—Goûts infâmes d’Héliogabale.—Pantomimes
indécentes qu’il faisait représenter et rôle qu’il
jouait lui-même.—Quelle sorte de gens il choisissait de préférence
pour compagnons de ses débauches.—Comment il célébrait
[438]
les Florales.—Les monobèles.—Plaisir qu’il trouvait à se
mêler incognito aux actes de la Prostitution populaire.—Sa sympathie
et sa tendresse pour les prostituées.—Convocation qu’il
fit de toutes les courtisanes inscrites et de tous les entremetteurs
de profession.—Comment il se conduisit devant cette tourbe
infâme qu’il présida et don qu’il fit à chacun des assistants.—L’empereur
courtisane.—Comment Héliogabale célébrait les
vendanges.—Femmes légitimes qu’eut cet empereur hermaphrodite.—La
veuve de Pomponius Bassus.—Cornelia Paula.—La
prêtresse de Vesta.—Maris d’Héliogabale.—Le conducteur
de chariot, Jérocle.—Aurelius Zoticus, dit le cuisinier.—Mariage
des dieux et des déesses.—Festins féeriques d’Héliogabale.—Petites
loteries qu’il faisait tirer à ces festins.—Droits
qu’avaient les courtisanes dans le palais impérial.—Mort d’Héliogabale.—Alexandre
Sévère, empereur.—Bienfaisante influence
de son règne.—Gallien, empereur.—Ses débauches.—Le
divin Claude, empereur.—Aurélien, empereur.—Tacite,
empereur.—Les mauvais lieux sont défendus dans l’intérieur
de Rome.—Probus, empereur.—Carin, empereur.—Sa vie
infâme.—Dioclétien, empereur.—C’est sous son règne que
semble s’arrêter l’histoire de la Prostitution romaine.
La famille des Antonins, après avoir mis sur le
trône impérial deux grands philosophes qui essayèrent
de régénérer le monde païen par la morale, devait
produire l’infâme Commode et s’éteindre avec
Héliogabale. Les abominations de ces deux derniers
règnes font un contraste attristant avec les belles
vertus d’Antonin et de Marc-Aurèle, qui avaient
même fait oublier leurs glorieux prédécesseurs Trajan
et Adrien. Marc-Aurèle avait prévu que son fils
Commode ressemblerait un jour à Néron, à Caligula
et à Domitien: il regretta de n’être pas mort, avant
d’avoir vu cette prévision fatale s’accomplir. Si
[439]
Commode n’avait eu que de mauvaises mœurs, son
père eût fermé les yeux sur ce qui n’était qu’un
fait ordinaire de la jeunesse et du tempérament;
ainsi Marc-Aurèle tolérait-il la vie licencieuse de
son fils adoptif Lucius Vérus, qu’il avait associé à
l’empire et qu’il savait pourtant adonné à tous les
plaisirs sensuels; mais Lucius Vérus, en se livrant à
la débauche avec des danseurs, des bouffons et des
courtisanes, avait soin de se renfermer dans l’intérieur
de son palais, et n’apportait au dehors qu’une
habitude décente, honorable et presque austère.
Les excès de sa vie privée n’influaient nullement
sur sa vie publique, et il pouvait se montrer auprès
de Marc-Aurèle, sans faire rejaillir sur ce vertueux
empereur le scandale de ses propres vices.
Mais Commode, au contraire, n’eût pas été satisfait,
si ses turpitudes n’avaient eu mille témoins et
mille échos: c’était pour lui un plaisir et un besoin
que de s’avilir aux yeux de tous. De plus, l’abus
de la luxure avait surexcité ses sens à ce point que,
pour les contenter, il eut recours à l’effusion du
sang: il était naturellement cruel, et chez lui la
cruauté se développa jusqu’à devenir une passion
brutale qui se mêlait à tous les emportements de la
fureur érotique. «Dès sa plus tendre enfance, raconte
Lampride, qui a écrit d’après des historiens grecs et
latins aujourd’hui perdus, il fut impudique, méchant,
cruel, libidineux, et il souilla même sa bouche.»
(Turpis, improbus, crudelis, libidinosus, ore quoque
[440]
pollutus, constupratus fuit.) Cependant, peu de
temps après avoir pris la robe virile, au retour de
l’expédition d’Égypte où il avait accompagné son
père, il partagea les honneurs du triomphe avec le
divin Marc-Aurèle. Il écarta les sages et dignes
précepteurs qu’on lui avait donnés et il s’entoura
des hommes les plus corrompus: un moment on les
éloigna de lui; mais, comme le chagrin de ne plus
les voir l’avait fait tomber malade, on les lui rendit,
et depuis lors il ne mit plus de frein à ses impudicités.
Il fit du palais une taverne et un lieu de débauche
(popinas et ganeas in palatinis semper ædibus
fecit); il attira dans ce lieu-là les femmes les plus remarquables
par leur beauté, comme des esclaves
attachées aux lupanars, pour les faire servir à tous
ses impurs caprices (mulierculas formæ scitioris, ut
prostibula mancipia lupanarium, ad ludibrium pudicitiæ
contraxit). Enfin, il vivait avec les gladiateurs
et les mérétrices; il hantait les maisons de Prostitution
et, déguisé en eunuque, il pénétrait dans les
cellules pour y porter de l’eau ou des rafraîchissements
(aquam gessit ut lenonum magister).
Lorsque Marc-Aurèle mourut à Rome, Commode
faisait la guerre aux Barbares sur les bords du Danube,
où il soupirait sans cesse après les délices de
l’Italie; il se hâta donc de quitter les soldats qui l’avaient
salué empereur, et il fut reçu avec acclamation
par les Romains, qui ne se souvinrent pas des
turpitudes de sa jeunesse, en le voyant si beau et si
[441]
bien fait: «Son air n’avait rien d’efféminé, dit Hérodien,
son regard était doux et vif tout ensemble;
ses cheveux frisés et fort blonds: lorsqu’il marchait
au soleil, sa chevelure jetait un éclat si éblouissant,
qu’il semblait qu’on l’eût poudré avec de la poudre
d’or.» Mais cette beauté radieuse, qui n’avait pas
d’égale, si l’on en croit Hérodien, ne tarda pas à se
flétrir dans les orgies, où Commode consultait moins
ses forces que ses désirs insatiables; sa constitution
robuste ne résista pas à des assauts continuels, et il
se trouva bientôt débile, le dos voûté, la tête tremblante,
le teint bourgeonné, les yeux rouges et les
lèvres baveuses. Il eut même, par suite de plusieurs
maladies honteuses, une tumeur si considérable aux
aines, qu’elle paraissait à travers ses vêtements de
soie. Le jour de son entrée à Rome, pendant que l’enthousiasme
du peuple s’adressait surtout à sa figure
charmante et à sa bonne mine, il avait fait monter
derrière lui, sur son char, son mignon (subactore
suo) Antérus, et, pendant toute la cérémonie du
triomphe, il se retournait à chaque instant pour
donner des baisers à ce vil personnage: leurs ignobles
caresses continuèrent en plein théâtre, aux applaudissements
des spectateurs.
Commode reprit d’abord le train de vie qu’il menait
du vivant de son père: le soir, il courait les
tavernes et les mauvais lieux (vespera etiam per tabernas
ac lupanaria volitavit); la nuit, il buvait jusqu’au
jour, en compagnie de son Antérus et de ses
[442]
autres favoris. Quant aux affaires de l’empire, il en
laissait le soin à Pérennis, qui l’engageait à ne s’occuper
que de ses plaisirs et qui le délivrait du fardeau
de son gouvernement: ce fut une convention
faite entre eux, lorsque Commode perdit Antérus,
que les préfets du prétoire firent assassiner pour
échapper aux caprices tyranniques de ce favori.
Commode ne se consola de cette perte, qu’en se
plongeant dans des voluptés plus étranges encore:
il ne se montrait presque plus en public; il vivait
enfermé dans le palais, où il avait rassemblé trois
cents concubines, que leur beauté désigna au choix
de ses pourvoyeurs, et qui furent choisies indifféremment
parmi les matrones et les prostituées. A
ces concubines, il avait adjoint, pour son usage,
trois cents jeunes cinædes choisis également dans la
noblesse et dans le peuple, et non moins remarquables
que les femmes par la perfection de leurs
formes corporelles. Ces six cents convives étaient
assis à sa table et s’offraient tour à tour à ses impures
fantaisies (in palatio per convivia et balneas
bacchatur). Quand la force physique lui faisait défaut,
il appelait à son aide toute la puissance de
l’imagination: il obligeait ses concubines à se livrer
sous ses yeux aux plaisirs qu’il n’était plus capable
de partager avec elles (ipsas concubinas suas sub oculis
suis stuprari jubebat). Ces tableaux voluptueux
avaient le pouvoir de ranimer ses sens épuisés, et il
redevenait encore une fois acteur dans ces obscènes
[443]
bacchanales, où les sexes étaient confondus, où la
Prostitution avait recours aux plus horribles artifices
(nec irruentium in se juvenum carebat infamia,
omni parte corporis atque ore in sexum utrumque pollutus).
Ce n’était plus, comme chez Tibère et Néron, l’ardeur
d’assouvir d’énormes passions matérielles; c’était
plutôt l’infatigable recherche d’une imagination
dépravée qui n’aspirait qu’à rendre la vie à des sens
défaillants. Ainsi, Commode se mettait l’esprit à la
torture pour inventer, en guise de philtres, les plus
odieuses combinaisons d’obscénités. Après avoir
violé ses sœurs et ses parentes, il donna le nom de
sa mère à une de ses concubines, afin de se persuader
qu’il commettait un inceste avec elle. Il n’épargna
aucun des affidés qui l’entouraient, et il les soumit
à de honteuses complaisances, sans refuser de
s’y prêter lui-même (omne genus hominum infamavit
quod erat secum et ab ominibus est infamatus). Malheur
à qui se permettait alors de rire ou de se moquer:
il envoyait aux bêtes le plaisant malavisé. «Il aimait
de préférence, dit Lampride, ceux qui portaient
les noms des parties honteuses de l’un ou de l’autre
sexe, et il les embrassait de préférence.» (Habuit in deliciis
homines appellatos nominibus verendorum utriusque
sexus, quos libentius suis osculis applicabat). Une variante
du texte latin, oculis au lieu d’osculis, atténue
ce passage, en donnant à entendre qu’il se contentait
de les regarder avec plus d’intérêt et de curiosité que
[444]
les porteurs de noms honnêtes. Parmi ses familiers,
il avait distingué un affranchi qu’il appelait Onon
(ονος, âne), à cause de certaine analogie obscène
avec cet animal: il l’enrichit et il le fit grand-prêtre
d’Hercule des Champs, pour le récompenser de ses
mérites. (Habuit et hominem pene prominente ultra
modum animalium, quem Onon appellavit, sibi charissimum).
Lui-même s’était fait appeler Hercule par
le sénat, qui lui avait décerné déjà les surnoms de
pieux et d’heureux.
On ne saurait se représenter sans horreur les débauches,
souillées de sang humain, que ce monstre
déifié mettait en œuvre avec une sorte de génie infernal;
il ne respectait pas même les temples des
dieux (deorum templa stupris polluit et humano sanguine).
Il aimait à porter des vêtements de femme et
à prendre des airs féminins; souvent il s’habillait
en Hercule, avec une veste brochée d’or et une peau
de lion: «C’était une chose ridicule et bizarre, dit
Hérodien, que de le voir faire parade en même
temps de l’afféterie des femmes et de la force des
héros.» Dans ses festins, il mêlait souvent des excréments
aux mets les plus délicats, et il n’hésitait
pas à y goûter lui-même, pour avoir le plaisir d’en
faire manger aux autres (dicitur sæpe pretiosissimis
cibis humana stercora miscuisse, nec abstinuisse gustu,
aliis, ut putabat, irrisis). Les grimaces que faisaient
les convives en l’imitant lui procuraient un malin divertissement
auquel il ne se bornait pas. Un jour, il
[445]
ordonna au préfet du prétoire Julien de se dépouiller
de ses habits et de danser nu, le visage barbouillé,
en jouant des cimbales, devant les concubines
et les gitons, qui l’applaudissaient; ensuite, il
le fit jeter dans un vivier, où les lamproies le dévorèrent.
Il ne manquait pas de faire inscrire solennellement
dans les actes publics de Rome tout ce qu’il
faisait de honteux, d’impur, de cruel, en un mot
toutes ses prouesses de gladiateur et de débauché
(omnia quæ turpiter, quæ impure, quæ crudeliter,
quæ gladiatorie, quæ lenonice faceret).
Enfin, cet exécrable empereur, après avoir
échappé à plusieurs conspirations tramées contre sa
vie, périt assassiné à l’instigation de Marcia, celle
de ses concubines qu’il aimait le plus. Marcia l’aimait
aussi malgré ses crimes, et elle veillait sur ses
jours, comme une mère attentive, peut-être par pitié
plutôt que par amour. Commode eut l’idée de
célébrer le premier jour de l’année par une fête dans
laquelle il irait au Cirque, armé de sa massue et
précédé de tous les gladiateurs. Marcia le conjura
de n’en rien faire, et tous les officiers de la maison
impériale le supplièrent aussi de ne pas s’exposer
de la sorte aux poignards des assassins. L’empereur,
irrité de l’opposition qu’il rencontrait de la part de
ses plus fidèles serviteurs, résolut de se débarrasser
d’eux en les condamnant à mort. Il écrivit les noms
des condamnés sur une écorce de tilleul, qu’il oublia
sous son chevet. «Il avait à sa cour, rapporte
[446]
Hérodien, un de ces petits enfants qui servent aux
plaisirs des Romains voluptueux, qu’on tient à demi
nus et dont on relève la beauté par l’éclat des
pierreries. Il aimait celui-ci éperdûment et le faisait
appeler Philocommode.» L’enfant entra dans la
chambre, trouva par terre la liste de proscription et
l’emporta comme un jouet. Marcia vit cette liste dans
les mains de l’enfant et la lui enleva, en le caressant:
«Courage! Commode, ne te démens point, s’écria-t-elle
en lisant son nom et ceux des proscrits. Voilà
donc la récompense de ma tendresse et de la longue
patience avec laquelle j’ai supporté tes brutalités et
tes débauches!... Mais il ne sera pas dit qu’un
homme toujours enseveli dans le vin préviendra une
femme sobre et qui a toute sa raison!» En effet, elle
alla sur-le-champ avertir ceux qui devaient partager
son sort et elle versa de sa main le poison dans la
coupe de Commode qui, menaçant de vivre, fut
étranglé par un esclave, nommé Narcisse, que Marcia
avait gagné à sa cause en promettant de s’abandonner
à lui. «Commode fut plus cruel que Domitien,
plus impur que Néron!» acclama le sénat qui voulait
que le cadavre fût traîné avec un croc, au spoliaire,
où l’on entassait les corps morts des gladiateurs.
On pouvait croire que Commode ne serait jamais
surpassé dans les annales de la Prostitution, mais
on avait compté sans Héliogabale, qui a laissé dans
l’histoire une souillure ineffaçable et une célébrité
[447]
unique d’infamie. Lampride, en écrivant la vie impure
(impurissimam) de ce monstre d’après les contemporains
grecs et latins qui l’avaient écrite avant
lui, a eu presque honte de son ouvrage, quoiqu’il ait
passé sous silence une foule de détails que la pudeur
ne lui permit pas de recueillir (quum multa
improba reticuerim et quæ ne dici quidem sine maximo
pudore possunt), et quoiqu’il ait voilé sous des termes
honnêtes (prætextu verborum adhibito) ceux
qu’il osait conserver dans son récit adressé à l’empereur
Constantin. Hérodien et Xiphilin, qui ont survécu
seuls à la perte des historiens originaux, nous
fournissent quelques-unes de ces particularités
odieuses que Lampride (d’autres disent Spartien)
n’a pas voulu reproduire. «On s’étonne, répéterons-nous
avec Lampride, qu’un pareil monstre ait été
élevé à l’empire, et qu’il l’ait gouverné près de trois
ans, sans qu’il se soit trouvé personne qui en ait
délivré la société romaine, lorsque jamais un tyrannicide
n’a manqué aux Néron, aux Vitellius, aux
Caligula et aux autres princes de cette espèce.» Le
règne d’Héliogabale est vraiment la dernière convulsion
du paganisme qui se meurt et qui, en mourant,
se roule avec désespoir au milieu de toutes les
fanges du monde antique.
Héliogabale, dont le nom originaire était Avitus,
prit celui qui désignait son premier état de prêtre
du soleil, et ensuite il adopta celui d’Antonin, parce
qu’il prétendait descendre de cette famille antonine,
[448]
à laquelle l’empire devait Antonin-le-Pieux et Marc-Aurèle,
mais que l’exécrable Commode avait déjà
déshonorée. Selon Héliogabale, sa mère Semiamire,
qui vécut en courtisane et qui commit à la cour des
empereurs toutes sortes de turpitudes (quum ipsa
meretricio more vivens, in aulâ omnia turpia exerceret),
avait eu avec Antonin Caracalla un commerce
honteux, dont il était le fruit. Son origine fut cependant
contestée par ceux qui l’avaient surnommé
Varius ou bigarré, à cause des nombreux amants
qui partagèrent à cette époque les faveurs de sa
mère. Quoi qu’il en fût de sa naissance, quand Macrin
eut fait assassiner Caracalla, Héliogabale craignit
d’être compris dans le meurtre de l’empereur
qu’il se donnait pour père, et il chercha un asile
inviolable dans le temple du soleil. Ce fut de ce
temple qu’il sortit, l’année suivante, pour se faire
proclamer empereur par les soldats, qui le surnommèrent
l’Assyrien et le Sardanapale: «Il portait des
habits très-somptueux, raconte Hérodien, couverts
d’or et de pourpre, avec des bracelets, un collier
et une couronne en manière de tiare enrichie de perles
et de pierres précieuses. Son habillement tenait
de celui des prêtres de Phénicie et empruntait quelque
chose du luxe de la Macédoine: il méprisait
celui des Romains et des Grecs, qui n’était que de
laine, et il ne faisait cas que des étoffes de soie.» Il
eut l’idée, pour accoutumer les Romains à son luxe
barbare et à ses parures efféminées, de se faire
[449]
peindre en costume de prêtre du soleil et d’envoyer
ce portrait à Rome, avant d’y venir lui-même. Mais
ce n’était rien que sa figure auprès de ses mœurs,
qui inspirèrent de l’effroi aux Romains les plus débauchés:
Quis enim ferre posset principem per cuncta
cava corporis libidinem recipientem, quum ne belluam
quidem talem quisquam ferat? Héliogabale n’était
pas arrivé par l’enivrement du pouvoir à cet excès
de dépravation sensuelle: l’empire l’avait trouvé
ainsi corrompu et dégradé dans le sanctuaire de
son dieu phénicien. On peut donc dire qu’en devenant
empereur, il ne devint pas plus pervers ni
plus infâme, sinon plus cruel. Qu’attendre d’un misérable
insensé, qui n’avait aucune notion de l’honnête,
et qui faisait consister le principal avantage de
la vie à être digne et capable de satisfaire l’ignoble
passion de plusieurs (cum fructum vitæ præcipuum
existimans si dignus atque aptus libidini plurimorum
videretur)? On comprend que les chrétiens aient représenté
cet empereur comme une incarnation du
diable.
Dès la première assemblée du sénat, il y parut
avec sa mère, cette vieille courtisane que plus d’un
sénateur se rappelait avoir connue dans l’exercice
de son abject métier. Semiamire prit place auprès
des consuls, et signa le sénatus-consulte rédigé dans
cette circonstance. Ce fut la seule femme qui siégea,
en qualité de clarissima, dans le sénat romain. Héliogabale
fonda aussi, pour plaire à sa mère, un petit
[450]
sénat (senaculus), composé de matrones qui s’assemblaient,
à certains jours, sur le mont Quirinal,
pour discuter des lois somptuaires relatives aux
femmes: on détermina quels habillements elles porteraient
en public; qui aurait entre elles la préséance;
quelles personnes elles admettraient au baiser
d’usage; qui d’elles se servirait de voitures suspendues;
qui, de chevaux de selle; qui, d’ânes; qui,
d’un chariot traîné par des bœufs ou par des mules;
qui, de litière, et si ces litières seraient garnies de
peau et ornées d’or, d’ivoire ou d’argent; on régla,
par sénatus-consulte, la forme et les ornements de
la chaussure que chaque classe de femmes aurait le
privilége de porter. Semiamire semblait s’être réservé
l’autorité suprême sur son sexe exclusivement;
Héliogabale, sur le sien, comme s’il bornait
son rôle d’empereur à commander aux hommes.
Pendant l’hiver qu’il passa à Nicomédie, avant de
s’établir à Rome, Héliogabale donna carrière à ses
goûts infâmes; tellement que les soldats qui l’avaient
élu rougirent de leur ouvrage, en voyant leur empereur
confondu avec de vils gitons (omnia sordide
ageret, inireturque à viris et subaret). Il n’eut garde
de changer de genre de vie, lorsqu’il fut à Rome.
«Toutes ses occupations, dit Lampride, se bornèrent
à choisir des émissaires chargés de chercher
partout et d’amener à sa cour les hommes qui devaient
remplir certaines conditions favorables à ses
plaisirs.» Xiphilin explique quelles étaient ces conditions
[451]
que la nature avait départies plus libéralement
à un petit nombre de privilégiés. Ceux qu’on
jugeait dignes d’être présentés à l’empereur figuraient
dans les pantomimes indécentes, qu’il faisait
représenter, et dans lesquelles il jouait toujours un
rôle de déesse de la fable. Il aimait surtout à mettre
en action les amours de Vénus, et pour faire ce personnage,
il se peignait le visage et il se frottait tout
le corps avec des aromates. Souvent il renouvelait,
sous le déguisement de Vénus, la scène principale
du jugement de Pâris: tout à coup ses vêtements
tombaient à ses pieds, et on le voyait nu, une main
devant son sein et l’autre devant le signe de la virilité
qu’il cachait entièrement, posterioribus eminentibus
in subactorem rejectis et oppositis.
Héliogabale choisissait, au théâtre et dans le cirque,
les compagnons de ses débauches, parmi les
athlètes les plus robustes et les gladiateurs les plus
membrus. C’est là qu’il distingua les cochers Protogène,
Gordius et Hiéroclès, qui eurent part à toutes
ses turpitudes: il avait une telle passion pour Hiéroclès
qu’il lui donnait publiquement les baisers les
plus hideux (Hieroclem vero sic amavit ut eidem oscularetur
inguina); il nommait cela célébrer les Florales.
Il avait fait construire des bains publics dans le palais,
et il n’avait pas honte de se baigner au milieu
du peuple, afin de mieux découvrir par lui-même
les qualités particulières qu’il aimait dans les hommes
(ut ex eo conditiones bene vasatorum hominum
[452]
colligeret). Il parcourait aussi les carrefours et les
bords du Tibre, pour chercher ceux qu’il appelait des
monobèles, c’est-à-dire des hommes complets (viriliores).
Il n’y avait de crédit et d’honneurs, que pour
ces sortes de gens (homines ad exercendas libidines
bene vasatos et majoris peculii). Héliogabale éleva
aussi aux premières dignités de l’empire certains
personnages qui n’avaient pas d’autres titres à ses
préférences, que leurs énormes attributs virils (commendatos
sibi pudibilium enormitate membrorum).
Dans les festins il les plaçait à ses côtés le plus près
possible, et il se délectait à leur contact et à leurs
attouchements (eorumque attrectatione et tactu præcipue
gaudebat); c’était de leurs mains qu’il voulait
prendre la coupe où il buvait en l’honneur de leurs
hauts faits et des siens.
A l’exemple de Néron et de Commode, il trouvait
un plaisir infini à se mêler incognito à tous les actes
de la Prostitution populaire: «Couvert d’un bonnet
de muletier, afin de n’être pas reconnu, raconte
Lampride, il visita, en un seul jour, dit-on, les
courtisanes du Cirque, du Théâtre, de l’Amphithéâtre
et de tous les quartiers de Rome; s’il ne se livra
pas à la débauche avec toutes ces filles (sine effectu
libidinis), il leur distribua pourtant des pièces d’or,
en disant:—Que personne ne sache qu’Antonin vous
a fait ce don!» Il se sentait plein de sympathie et
de tendresse pour ces malheureuses instigatrices de
la débauche publique. Un jour, il convoqua dans
[453]
une basilique de la ville toutes les courtisanes inscrites
sur les registres de la police édilitaire, et il
présida lui-même cette étrange assemblée, dans
laquelle il admit les entremetteuses de profession,
tous les débauchés connus, les enfants et les jeunes
gens vendus à la luxure (lenones, exoletos, undique
collectos et luxuriosissimos puerulos et juvenes). D’abord
il se présenta en costume de grand-prêtre du
soleil, pour mieux imposer à cette tourbe infâme, et
il prononça un discours de circonstance, commençant
par ce mot: Camarades (commilitones), qui revenait
à chaque instant dans son allocution impudique.
Ensuite il ouvrit la discussion sur plusieurs
questions abstraites de volupté et de libertinage
(disputavitque de generibus schematum et voluptatum).
Son immodeste auditoire battait des mains et poussait
des acclamations, chaque fois qu’il rencontrait
quelque effroyable imagination de débauche. Enivré
de son succès, il sortit un moment et reparut habillé
en femme, portant la toge et la perruque blonde des
courtisanes, découvrant une gorge postiche et montrant
sa jambe nue, avec les allures, les gestes, les
agaceries et les paroles d’une prostituée de carrefour.
Sous ce costume, il s’approcha de celles à qui
son caprice avait emprunté la livrée mérétricienne,
et il leur prouva qu’il savait leur métier aussi bien
qu’elles. Puis, se débarrassant de sa gorge d’emprunt
(papillâ ejectâ), il prit les airs et l’habit des
enfants qu’on vendait à la Prostitution (habitu puerorum
[454]
qui prostituuntur), et il se tourna vers les débauchés,
pour leur faire voir qu’il n’était pas moins
expert qu’eux dans leur art honteux. Enfin il termina
la séance, en prononçant une nouvelle harangue
plus monstrueuse que la première, en promettant
à chaque assistant un donatif de trois pièces
d’or, et en se recommandant à leurs prières pour
obtenir que les dieux lui accordassent la santé, la
vigueur et le plaisir dont il avait besoin jusqu’à sa
mort.
Ce ne fut pas la seule marque de bienveillance
spéciale qu’il accorda, par amour du métier, à la
classe des courtisanes. On le vit souvent racheter
de ses deniers toutes celles qui étaient esclaves au
pouvoir des lénons, et les affranchir ensuite, afin
qu’elles pussent continuer à leur profit l’odieux trafic
qu’elles avaient appris à exercer. On raconte même,
à ce sujet, qu’ayant racheté ainsi au prix de cent
mille sesterces (19,375 fr.) une courtisane fort belle
et très-fameuse, il ne la toucha pas et la respecta
comme une vierge (velut virginem coluisse). Quand il
voyageait, il se faisait suivre de six cents chariots,
remplis de lénons, d’appareilleuses, de mérétrices
et de cinædes bien pourvus (causa vehiculorum erat
lenonum, lenarum, meretricum, exoletorum, subactorum
etiam bene vasatorum multitudo). Il avait toujours
des femmes avec lui dans ses bains, et c’était
lui-même qui les épilait. Il se servait aussi, pour sa
barbe, d’une pâte épilatoire (psilothro), et il employait
[455]
de préférence à cet usage celle qui avait déjà
servi à l’épilation de ses femmes. Il employait également,
pour faire sa barbe, le même rasoir avec lequel
il avait rasé le poil des parties honteuses de ses gitons
(rasit et virilia subactoribus suis novacula manu suâ,
qua postea barbam fecit). «Il n’y a personne, dit
Xiphilin, qui puisse faire ni écouter le récit des
abominables saletés qu’il fit ou qu’il souffrit en son
corps.» Xiphilin répugne à entrer dans ces détails,
que Dion Cassius avait minutieusement recueillis et
que la langue grecque couvrait d’une sorte de voile
qui les rendait plus tolérables; mais l’histoire originale
de Dion Cassius n’a pas conservé le règne
d’Héliogabale, comme si les pages consacrées à ce
règne abominable avaient été déchirées par une
main pudique. Lampride dit aussi qu’on avait réuni,
dans les histoires de cette époque, un grand nombre
d’obscénités, qu’il a cru devoir passer sous silence,
parce qu’elles ne sont pas dignes de rester dans la
mémoire des hommes (digna memoratu non sunt):
«Il inventa, dit-il, plusieurs nouveaux genres de
débauche, et il surpassa les exploits des anciens
débauchés, car il connaissait toutes les pratiques de
Néron, de Caligula et de Tibère (libidinum genera
quædam invenit, ut spinthrias veterum malorum vinceret,
et omnes apparatus Tiberii et Caligulæ et Neronis
norat).»
On doit surtout regretter le texte original de Dion
Cassius, en citant ce curieux passage de l’Abrégé de
[456]
Xiphilin, prudemment affaibli dans la traduction du
président Cousin: «Héliogabale allait aux lieux de
Prostitution, en chassait les courtisanes, et s’y plongeait
dans les plus infâmes voluptés. Enfin il destina
à l’incontinence un appartement de son palais, à la
porte duquel il se tenait, tout nu, debout à la façon
des courtisanes, en tirant un rideau attaché à des
anneaux d’or et appelant les passants d’un ton mou
et efféminé. Il avait d’autres personnes attachées au
même emploi, dont il se servait pour aller chercher
des gens dont l’impudicité pût lui donner du plaisir.
Il tirait de l’argent des complices de ses débauches,
et se glorifiait d’un gain aussi infâme que celui-là.
Quand il était avec les compagnons de ses débordements,
il se vantait d’avoir un plus grand nombre
d’amants qu’eux et d’amasser plus d’argent; il est
vrai qu’il en exigeait indifféremment de tous ceux
auxquels il se prostituait. Il y en avait un, entre
autres, d’une taille fort avantageuse, et qu’il avait
dessein, pour ce sujet, de désigner César.» Le président
Cousin, dans cette pâle traduction, a évité de
rendre la naïveté cynique du texte grec, qui n’avait
pas à ménager la susceptibilité des beaux-esprits
français.
Si les appétits sensuels d’Héliogabale étaient immodérés,
son imagination dépravée avait encore
plus de puissance et d’activité. Ainsi, ce qu’il cherchait
sans cesse avec une impatiente curiosité, c’étaient
de nouvelles manières de souiller ses yeux,
[457]
ses oreilles et son âme, en souillant aussi la pudeur
d’autrui. Les prodigieux festins qu’il offrait à ses
mignons et à ses gladiateurs, mettaient entre leurs
mains des coupes aux formes obscènes, et faisaient
circuler devant eux des amphores et des vases
d’argent surchargés d’images érotiques (schematibus
libidinosissimis inquinata). Toute cette argenterie effrontée
brillait surtout dans les soupers d’apparat,
qu’il donnait à l’occasion des vendanges, et dans
lesquels il s’amusait à déshonorer les citoyens les
plus recommandables et les vieillards les plus majestueux.
Il leur demandait, pour les embarrasser,
s’ils avaient fait preuve dans leur jeunesse d’autant
de vigueur qu’il en déployait lui-même, et ces
questions, il les leur adressait avec une impudence
inouïe (impudentissime), car jamais il ne s’abstint
des expressions les plus infâmes et il y joignait souvent
des gestes et des signes plus infâmes encore
(neque enim unquam verbis pepercit infamibus, quum
et digitis impudicitiam ostentaret, nec ullus in conventu,
et audiente populo, esset pudor). Voilà comme
il entendait célébrer la liberté des vendanges. Il interrogeait
brusquement un vieux à barbe blanche
et au maintien solennel: «Es-tu fidèle au culte de
Vénus (an promptus esset in Venerem)?» Si le vieillard
rougissait, à cette impertinente question: «Il a
rougi! s’écriait-il, la chose va bien (salva res est).»
Le silence et la rougeur équivalaient pour lui à un
aveu. Il s’autorisait alors à parler de ses propres actes,
[458]
et si tous les vieillards baissaient les yeux en
rougissant, il faisait appel à ses jeunes complices,
pour les inviter à répondre sans détour sur le sujet
qu’il avait posé: ceux-ci obéissaient aussitôt et tâchaient
de renchérir encore sur la turpitude de leur
maître, qui se réjouissait de les entendre et qui leur
portait d’ignobles défis. La flatterie déliait souvent
la langue des vieillards, qui se vantaient à leur
tour de commettre les mêmes ignominies et d’avoir
des maris (qui improba quædam pati se dicerent, qui
maritos se habere jactarent). L’empereur, à ces révélations
inattendues, exultait de joie et ne s’apercevait
point que ces misérables feignaient des vices
qu’ils n’avaient pas, pour lui complaire et le divertir.
Cet empereur hermaphrodite voulut avoir plusieurs
femmes légitimes et plusieurs maris. Il épousa
d’abord la veuve de Pomponius Bassus, qu’il avait
fait condamner à mort en l’accusant de s’être fait le
censeur de la conduite privée de l’empereur. Cette
femme, aussi belle que noble, était petite-fille de
Claude Sévère et de Marc-Antonin. Héliogabale, qui
eut recours à la violence pour lui faire subir une
odieuse union, la délaissa bientôt pour ses rivales:
«Il ne les recherchait pourtant pour aucun besoin
qu’il en eût, dit Xiphilin, mais par le désir d’imiter
les débauches de ses amants.» Il se maria ensuite
avec Cornélia Paula, dans l’espoir, disait-il, d’être
plus tôt père, «lui qui n’était pas homme,» ajoute
Xiphilin, comme pour mettre à la torture les commentateurs.
[459]
Ce mariage fut célébré par des jeux et
des fêtes publiques, mais bientôt il répudia sa nouvelle
épouse, sous prétexte qu’elle avait une tache
sur le corps. La véritable cause de cette répudiation
était un autre mariage qu’il souhaitait contracter
avec plus d’éclat que les précédents. Il avait pénétré
dans le temple de Vesta, et peu s’en fallut qu’il
ne laissât s’éteindre le feu sacré (ignem perpetuum
extinguere voluit), pendant qu’il profanait le sanctuaire
par un inceste. Il enleva la vestale Aquila
Sévéra et l’épousa insolemment à la face du ciel, en
disant que les enfants qui naîtraient du grand-prêtre
du soleil et de la prêtresse de Vesta auraient sans
doute quelque chose de sacré et de divin. Mais Héliogabale
n’eut pas plus d’enfants de ce mariage sacrilége
que des autres, et il se dégoûta bientôt de sa
vestale, qu’il remplaça par deux ou trois femmes
successivement jusqu’à ce qu’il eût repris Aquila
Sévéra.
Mais, pour parler de ses mariages avec des hommes,
c’est à peine si nous oserons nous en tenir à la
traduction de Xiphilin, que le président Cousin n’a
point osé reproduire avec une fidélité scrupuleuse.
Héliogabale se maria donc en qualité de femme, et
se fit appeler madame et impératrice. «Il travaillait
en laine, portait quelquefois un réseau et se frottait
les yeux de pommade. Il se rasa le menton et en fit
une fête, prit soin qu’il ne lui parût aucun poil, pour
être plus semblable à une femme, et reçut, étant
[460]
couché, les sénateurs qui l’allaient saluer. Son mari
était un esclave natif de Carie, nommé Jérocle, conducteur
de chariots.» Il avait remarqué Jérocle,
un jour que, tombant de son chariot, ce cocher
avait laissé voir ses cheveux bouclés et son menton
sans barbe: Jérocle avait une abondante chevelure
blonde, une peau lisse et blanche, des traits fins et
un regard chatoyant, mais il joignait à ces apparences
efféminées une taille de géant et des formes
athlétiques. Héliogabale le fit enlever tout couvert
de sueur et de poussière; puis, il l’installa dans sa
chambre à coucher, au sortir du bain, et le lendemain
il l’épousa solennellement. «Il se faisait maltraiter
par son mari, raconte Xiphilin ou plutôt le
président Cousin, dire des injures et battre avec
une si grande violence qu’il avait quelquefois au
visage des marques des coups qu’il avait reçus. Il
ne l’aimait point d’une ardeur faible et passagère,
mais d’une passion forte et constante, tellement
qu’au lieu de se fâcher des mauvais traitements qu’il
recevait de lui, il l’en chérissait plus tendrement.
Il l’eût fait déclarer césar, si sa mère et son aïeule
ne s’étaient pas opposées à cet acte de démence impudique.»
Jérocle eut pourtant un rival qui balança un moment
le crédit dont il jouissait auprès de l’empereur.
C’était Aurélius Zoticus, dit le Cuisinier, parce que
son père l’avait élevé dans les cuisines, où tout enfant
il tournait la broche. Zoticus renonça de bonne
[461]
heure au métier paternel pour embrasser l’état de
lutteur: il l’emportait en bonne mine et en vigueur
corporelle sur tous les athlètes avec lesquels il se
mesurait dans les jeux du cirque. Les pourvoyeurs
d’Héliogabale reconnurent avec admiration les singuliers
mérites de ce robuste champion et s’emparèrent
de lui pour le mener à Rome avec une pompe
triomphale. Sur l’éloge qu’on avait fait de lui à Héliogabale,
qui brûlait de le voir, il avait été nommé
chambellan (cubicularius) de l’empereur. Celui-ci
l’attendait avec une impatience qui éclata de la façon
la plus indécente, quand le nouveau chambellan
fut introduit dans le palais à la clarté des flambeaux.
«Dès que cet infâme prince l’aperçut, raconte Xiphilin
en conservant les termes mêmes du récit de
Dion Cassius, il accourut à lui avec beaucoup de
rougeur sur le visage; et, parce que Zotique en le
saluant l’avait appelé seigneur et empereur selon la
coutume, il lui répondit, en tournant la tête d’un air
plein de mollesse comme une femme et en jetant
sur lui des regards lascifs:—Ne m’appelez point seigneur,
puisque je suis une dame!» Il l’emmena baigner
à l’heure même avec lui; et l’ayant trouvé tel
qu’on le lui avait représenté, il soupa entre ses bras
comme sa maîtresse.» Jérocle, jaloux de ce rival,
eut l’adresse de lui faire verser par les échansons un
breuvage réfrigératif qui lui ôta toute sa vigueur et
qui le frappa d’impuissance. Héliogabale, loin de
soupçonner le complot dont Zoticus était victime, le
[462]
regarda dès lors avec autant de colère et de mépris
qu’il lui avait témoigné d’estime et d’affection auparavant.
Peu s’en fallut qu’il l’envoyât aux bêtes,
et Zoticus, dans sa disgrâce, fut encore trop heureux
de se voir seulement dépouillé de ses honneurs et
chassé du palais, de Rome et de l’Italie.
Héliogabale, qui se jouait ainsi scandaleusement
de l’institution du mariage au double point de vue
de la morale et des lois, eut la pensée bizarre de
marier aussi les dieux et les déesses. Il commença
par donner une femme à son dieu phénicien,
comme si ce dieu avait eu besoin de femme et d’enfant,
dit Xiphilin. La femme qu’il lui avait choisie
était Pallas, et pour accomplir cette union divine, il
fit apporter dans sa chambre le palladium, cette
statue vénérée, que les Romains considéraient comme
la sauvegarde de Rome, et qui n’avait pas été
changée de place une seule fois, excepté lorsque le
feu avait pris au temple de la déesse. Mais le lendemain
de cette profanation étrange et ridicule,
qu’il avait poussée aussi loin que possible en couchant
les deux statues dans le même lit, il déclara
qu’une déesse si guerrière ne convenait pas à un dieu
si pacifique, et il fit apporter, à Rome, pour ce dieu,
la statue de Vénus Uranie, la divinité des Carthaginois.
Uranie, qui présidait à l’incubation des êtres
dans le travail mystérieux de la nature, et qui personnifiait
la lune et les autres de la nuit, devait naturellement
être l’épouse d’Héliogabale, dieu du
[463]
soleil et de la génération. L’empereur célébra donc
leurs noces avec splendeur, et il fit contribuer tous
les sujets de l’empire aux présents magnifiques qu’il
offrit aux époux; lui-même, le visage peint et fardé,
il dansa, en tunique de soie, autour des deux statues
placées côte à côte dans un lit de pourpre, et enchaînées
l’une à l’autre avec des bandelettes de lin. Cet
incroyable mariage de statues donna lieu à de grandes
réjouissances à Rome et dans toute l’Italie. Héliogabale
s’identifiait, en quelque sorte, au dieu dont
il portait le nom; il se faisait un devoir religieux de
lui soumettre, de lui sacrifier tous les dieux, même
celui des chrétiens; car il souilla leurs temples de
ses impuretés et il fit déposer leurs images dans le
panthéon du soleil: c’était là qu’il venait, au sortir
de ses monstrueuses débauches, remplir son ministère
de grand-prêtre. Il ne refusait pas néanmoins
de prendre part au culte des autres divinités, surtout
s’il avait un rôle à jouer dans les mystères de
ce culte. Ainsi, on le vit agiter sa tête échevelée
parmi les prêtres mutilés de Cybèle; il se lia comme
eux les parties génitales (genitalia sibi devinxit), et il
fit tout ce que ces impurs fanatiques avaient l’habitude
de faire. Il s’associa également aux rites bizarres
et obscènes d’Isis, de Priape, de Flore et de
Cotytto.
Rien ne peut présenter une idée exacte et complète
de ces festins féeriques, dans lesquels il rassemblait
tout ce que le luxe, la prodigalité, la gourmandise
[464]
et le caprice pouvaient inventer, pour
satisfaire ses passions, ses sens et ses instincts pervers.
Il ne vivait, pour ainsi dire, que pour découvrir
des voluptés nouvelles (exquirere novas voluptates).
Lampride a énuméré quelques-unes des folles
merveilles de ces repas, où il était toujours assis sur
des fleurs ou sur des essences précieuses, vêtu de
pourpre ou d’étoffes d’or, surchargé de pierreries
sous le poids desquelles il disait succomber de plaisir
(quum gravari se diceret onere voluptatis), et la
tête coiffée d’un lourd diadème oriental. Ces fabuleux
repas duraient des jours entiers, des nuits
entières, sans autre interruption que les intervalles
consacrés à la débauche, comme des repos accordés
à l’estomac, qui ne se lassait pas plus que
l’ardeur des sens. Les convives alors n’étaient plus
des hommes, mais des bêtes fauves: ils s’efforçaient
à l’envi d’imiter leur empereur, sans espoir de l’égaler.
Celui-ci, échauffé par le vin et les parfums,
rejetait tous ses vêtements, se couronnait de
rayons d’or, suspendait un carquois sur ses épaules,
et nu, les cheveux flottants, le corps frotté d’huile
aromatique, il montait sur un char, resplendissant
de pierres précieuses et de métaux, attelé de trois
ou quatre femmes absolument nues, qui le traînaient
autour de la salle du banquet. (Junxit et quaternas
mulieres pulcherrimas et binas ad papillam, vel ternas
et amplius, et sic vectatus est: sed plerunque nudus
quum illum nudæ traherent.) Sa générosité à l’égard
[465]
de ses compagnons de table se traduisait en présents
gigantesques ou ridicules, que le sort distribuait
souvent au hasard des lots; il riait beaucoup, quand
la fortune aveugle avait fait tomber dans les mains
d’un vieux débauché une coquille portant ces mots
qui étaient un ordre: «Se conduire en homme devant
l’empereur»; il riait davantage, si, par une de ces
chances qu’il aimait à provoquer, une vieille décrépite
devenait la maîtresse d’un beau jeune garçon.
Souvent les billets cachetés, que ses convives tiraient
de l’urne, leur ordonnaient les douze travaux d’Hercule
ou les condamnaient à des services ignobles et
dégradants. Ces espèces de loteries conviviales, où
il mettait en frais son imaginative, entraînaient parfois
avec elles l’exil, la confiscation et même la mort
pour ceux que le sort n’avait pas favorisés. Heureux
celui qui en était quitte pour dix mouches, dix
œufs, dix toiles d’araignée, à fournir ou à recevoir!
Les femmes, quelquefois les prostituées ramassées
dans les rues, qui assistaient à ces orgies et qui en
subissaient toutes les vicissitudes, étaient ordinairement
les mieux partagées et se retiraient, épuisées de
lassitude, le visage décomposé, le corps meurtri, les
vêtements en lambeaux, mais chargées de butin. La
plus misérable, et la plus déchue, que sa bonne
étoile avait amenée à la table de l’empereur, pouvait
se vanter d’avoir été un moment presque impératrice,
car Héliogabale prenait son plaisir partout,
pourvu qu’il n’eût pas affaire deux fois à la
[466]
même femme (idem mulieres nunquam iteravit, præter
uxorem). Enfin, les courtisanes de Rome avaient le
droit de venir se prostituer, au lupanar impérial
qui restait ouvert jour et nuit dans l’intérieur du
palais (lupanaria domi amicis, clientibus et servis exhibuit).
Courtisanes et gitons se recommandaient d’eux-mêmes
à sa sollicitude paternelle: un jour, il leur
fit distribuer la septième partie des approvisionnements
de blé que Trajan et Sévère avaient accumulés
dans les greniers publics, et qui pouvaient subvenir
à sept années de disette.
Ce monstre à face humaine déshonora l’Empire
pendant un règne de quatre ans où il entassa toutes
les extravagances, toutes les atrocités, toutes les débauches,
toutes les abominations qui peuvent outrager
la nature. Il se glorifiait d’imiter Apicius dans sa
vie privée, et, sur le trône, Néron, Othon et Vitellius.
Il n’avait pourtant que dix-huit ans, lorsqu’il
fut tué par des bouffons dans les latrines où il s’était
caché. Les soldats, qui avaient conspiré pour délivrer
Rome et le monde d’un pareil empereur, sévirent
aussi contre ses complices et leur firent endurer
différents supplices, arrachant aux uns les entrailles
et empalant les autres, afin, disaient-ils, que leur
mort ressemblât à leur vie (ut mors esset vitæ consentiens).
Le traîné, l’impur, comme le surnommèrent
ceux qui traînaient son corps dans les fanges de la
ville, ne devait pas avoir d’égal dans l’histoire des
empereurs, et, après lui, l’humanité sembla se reposer,
[467]
sous la bienfaisante influence d’Alexandre
Sévère, en ouvrant les yeux à la lumière de la morale
évangélique. Mais, avant que le christianisme,
qui envahissait de toutes parts la société païenne,
eût mis un frein aux passions sensuelles et constitué
la police des mœurs dans les gouvernements, on
vit encore les empereurs qui se succédaient sur le
trône, comme les histrions sur un théâtre, donner
au peuple l’exemple contagieux de tous les écarts
de la Prostitution. Presque tous s’adonnèrent à la
débauche, presque tous se laissèrent aller à de
monstrueux raffinements de dépravation. Gallien,
qui ne vécut que pour son ventre et ses plaisirs
(natus abdomini et voluptatibus), imitait quelquefois
Héliogabale: il invitait un grand nombre de femmes
à ses festins, et alors il choisissait pour lui les
plus jeunes et les plus belles, laissant les laides et
les vieilles à ses convives. Si le divin Claude, comme
pour faire oublier aux Romains l’impur Gallien
(prodigiosum), régna en philosophe chaste et modeste;
si Aurélien réprima le luxe par des lois
somptuaires et punit rigoureusement l’adultère,
même parmi les esclaves; si l’empereur Tacite défendit
d’établir des mauvais lieux dans l’intérieur de
Rome, défense qui ne put être maintenue (meritoria
intra urbem, stare vetuit, quod quidem diu tenere non
potuit); s’il fit fermer les bains publics pendant la
nuit; s’il interdit les habits de soie et les profusions
du luxe efféminé; si Probus a été vraiment digne
[468]
de son nom; Carin, prédécesseur de Dioclétien,
fut, en revanche, suivant les termes de Flavius Vopiscus,
«le plus débauché de tous les hommes, le
plus effronté des adultères et des corrupteurs de la
jeunesse, et poussa l’infamie jusqu’à se prostituer
lui-même (homo omnium contaminatissimus, adulter,
frequens corruptor juventutis, ipse quoque male usus
genio sexus sui).» Il avait pour préfet du prétoire
un vieil entremetteur, nommé Matronien; pour secrétaire,
un impur (impurum), avec lequel il faisait
toujours sa méridienne; pour amis, les êtres les
plus pervers. Il se souilla des vices les plus infects
(enormibus se vitiis et ingenti fœditate maculavit), et
il ne respecta rien (moribus absolutus). Mais Dioclétien
balaya toutes ces immondices qui avaient fait
du palais des empereurs un lupanar; et Dioclétien,
qui fut un chrétien par la chasteté de ses mœurs et
par la moralité de ses lois, quoiqu’il ait cruellement
persécuté les chrétiens, Dioclétien le sage, l’austère,
le philosophe, eut pourtant l’odieux courage
de faire de la Prostitution un des supplices qu’on
infligeait aux vierges et aux matrones chrétiennes!
C’est pourtant sous Dioclétien que semble s’arrêter
l’histoire de la Prostitution romaine.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE ET DU TOME DEUXIÈME.
TABLE DES MATIÈRES
DU DEUXIÈME VOLUME.
PREMIÈRE PARTIE.
ANTIQUITÉ.—Grèce.—Rome.
(SUITE ET FIN.)
CHAPITRE XVII.
Sommaire.—Les lieux de Prostitution à Rome.—Leurs différentes
catégories.—Les quarante-six lupanars d’utilité publique.—Les
quatre-vingts bains de la première région.—Le petit sénat
des femmes, fondé par Héliogabale.—Les lupanars de la région
Esquiline, de la région du grand Cirque, et de la région du temple
de la Paix.—La Suburre.—Les cellules voûtées du grand Cirque.—Les
Cent Chambres du port de Misène.—Description
d’un lupanar.—Les cellules des prostituées.—L’écriteau.—Ameublement
des chambres.—Peintures obscènes.—Décoration
intérieure des cellules.—Lupanars des riches.—Origine
du mot fornication.—Les stabula ou lupanars du dernier ordre.—Les
pergulæ ou balcons.—Les turturillæ ou colombiers.—Le
casaurium ou lupanar extra-muros.—Origine du mot casaurium.—Les
scrupedæ ou pierreuses.—Meritoria et Meritorii.—Les
ganeæ ou tavernes souterraines.—Origine du mot lustrum.—Personnel
d’un lupanar.—Le leno et la lena.—Les ancillæ
ornatrices.—Les aquarii ou aquarioli.—Le bacario.—Le
villicus.—Adductores, conductores et admissarii.—Costume
des meretrices dans les lupanars.—Fêtes qui avaient lieu dans
les lupanars à l’occasion des filles qui se prostituaient pour la
[470]
première fois, et lors de l’ouverture d’un nouveau lupanar.—Loi
Domitienne relative à la castration.—Les castrati, les spadones
et les thlibiæ.—Messaline au lupanar.—Le prix de la virginité
de Tarsia, et le prix courant de ses faveurs.—Tableau
d’un lupanar romain, par Pétrone.—Salaire des lupanars.—Dissertation
sur l’écriteau de Tarsia.—Prix de la location d’une
cellule.—Les quadrantariæ et les diobolares.
CHAPITRE XVIII.
Sommaire.—A quelle époque remonte l’établissement de la Prostitution
légale à Rome.—De l’inscription des prostituées.—Ce
que dit Tacite du motif de cette inscription.—Femmes et
filles de sénateurs réclamant la licencia stupri.—Avantages
que l’état et la société retiraient de l’inscription des courtisanes.—Le
taux de chaque prostituée fixé sur les registres de l’édile.—Serment
des courtisanes entre les mains de l’édile.—Pourquoi
l’inscription matriculaire des meretrices se faisait chez
l’édile.—De la compétence de l’édile, en matière de Prostitution.—Police
de la rue.—Les Prostitutions vagabondes.—Julie,
fille d’Auguste.—Police de l’édile dans les maisons publiques.—Les
édiles plébéiens et les grands édiles patriciens.—Ce qui
arriva à un édile qui voulut forcer la porte de la maison de la
meretrix Mamilia.—Des divers endroits où se pratiquait la
Prostitution frauduleuse.—Les bains publics.—La femme du
consul, aux bains de Teanum.—Luxe et corruption des bains
de Rome.—Mélange des sexes dans les bains publics.—Le bain
de Scipion.—Les balneatores et les aliptes.—Les débauchés de
la cour de Domitien, aux bains publics.—Bains gratuits pour le
bas peuple.—Bains de l’aristocratie et des gens riches.—Tolérance
de la Prostitution des bains.—Les serviteurs et servantes des
bains.—Les fellatrices et les fellatores.—Le fellateur Blattara et
la fellatrice Thaïs.—Zoïle.—La pantomime des Attélanes.—Les
cabarets.—Infamie attachée à leur fréquentation.—Description
d’une popina romaine.—Le stabulum.—Les cauponæ et
les diversoria.—Visites domiciliaires nocturnes de l’édile.—Les
caves des boulangeries.—Police édilitaire pour les lupanars.—Contraventions,
amendes et peines afflictives.—A quoi s’exposait
Messaline, en exerçant le meretricium dans un lupanar.—De
[471]
l’installation d’une femme dans un mauvais lieu.—Les
délégués de l’édile.—Heures d’ouverture et de fermeture des
lupanars et autres mauvais lieux publics.—Les meretrices au
Cirque.—La Prostitution des théâtres.—Les crieurs du théâtre.—La
Prostitution errante.—Les murs extérieurs des maisons
et des monuments, mis, par l’édilité, sous la protection d’Esculape
pour les préserver des souillures des passants.—Impudicité
publique des prostituées des carrefours et ruelles de Rome.—Catulle
retrouve sa Lesbia parmi ces femmes.—Le tribunal de
l’édile.—Distinction établie par Ulpien, entre appeler et poursuivre.—Pouvoirs
donnés par la loi aux pères et aux tuteurs
sur leurs fils et pupilles qui se livraient à la débauche.—Les
adventores.—Les venatores.—La jeunesse d’Alcinoüs.—Les
salaputii.—Le poëte Horace putissimum penem.—Les semitarii.—Adulter,
scortator et mœchus.—Mœchocinædus et
mœchisso.—Héliogabale aux lupanars.—Ordonnances somptuaires
relatives aux mérétrices.—Costume des courtisanes.—Leur
chaussure.—Leur coiffure.—Défense faite aux prostituées
de mettre de la poudre d’or dans leurs cheveux.—Les cheveux
bleus et les cheveux jaunes.—Costume national des prostituées
de Tyr et de Babylone.—L’amiculum ou petit ami.—Galbanati,
galbani et galbana.—La mitre, la tiare et le nimbe.—Origine
de ces trois coiffures.—Défense faite aux mérétrices
d’avoir des litières et des voitures.—Carmenta, inventrice des
voitures romaines.—La basterne et la litière.—La cella et l’octophore.—Les
lupanars ambulants.—La loi Oppia.
CHAPITRE XIX.
Sommaire.—La Prostitution élégante.—Les bonnes mérétrices.—Leurs
amants.—Différence des grandes courtisanes de Rome
et des hétaires grecques.—Cicéron chez Cythéris.—Les preciosæ
et les famosæ.—Leurs amateurs.—La voie Sacrée.—Promenades
des courtisanes.—Promenades des matrones.—Cortége
des matrones.—Ce que dit Juvénal des femmes romaines.—Ogulnie.—Portrait
de Sergius, le favori d’Hippia,
par Juvénal.—Le gladiateur obscène de Pétrone.—Les suppôts
de Vénus Averse.—Ce qu’à Rome on appelait plaisirs
permis.—Langue muette du meretricium.—Le doigt du milieu.—Le
[472]
signum infame.—Pourquoi le médius était voué à
l’infamie chez les Grecs.—La chasse à l’œil et le vol aux oreilles.—Les
gesticulariæ.—Pantomime amoureuse.—Réserve
habituelle du langage parlé de Rome.—De la langue érotique
latine.—Frère et sœur.—La sœur du côté gauche et le petit
frère.—Des écrits érotiques et sotadiques ou molles libri.—Bibliothèque
secrète des courtisanes et des débauchés.—Les livres
lubriques de la Grèce et de Rome détruits par les Pères de
l’Église.
CHAPITRE XX.
Sommaire.—Maladies secrètes et honteuses des anciens.—Impura
Venus.—Les auteurs anciens ont évité de parler de ces
maladies.—Invasion de la luxure asiatique à Rome.—A
quelles causes on doit attribuer la propagation des vices contre
nature chez les anciens.—Maladies sexuelles des femmes.—Les
médecins de l’antiquité se refusaient à traiter les maladies
vénériennes.—Pourquoi.—Les enchanteurs et les charlatans.—La
grande lèpre.—La petite lèpre ou mal de Vénus.—Importation
de ce mal à Rome par Cneius Manlius.—Le
morbus indecens.—La plupart des médecins étaient des esclaves
et des affranchis.—Pourquoi, dans l’antiquité, les maladies
vénériennes sont entourées de mystère.—L’existence de ces
maladies constatée dans le Traité médical de Celse.—Leur
description.—Leurs curations.—Manuscrit du treizième siècle
décrivant les affections de la syphilis.—Apparition de l’éléphantiasis
à Rome.—Asclépiade de Bithynie.—T. Aufidius.—Musa,
médecin d’Auguste.—Mégès de Sidon.—Description
effrayante de l’éléphantiasis, d’après Arétée de Cappadoce.—Son
analogie avec la syphilis du quinzième siècle.—Le campanus
morbus ou mal de Campanie.—Spinturnicium.—Les fics,
les marisques et les chies.—La Familia ficosa.—La rubigo.—Le
satyriasis.—Junon-Fluonia.—Dissertation sur l’origine des
mots ancunnuentæ, bubonium, imbubinat et imbulbitat.—Les
clazomènes.—Des maladies nationales apportées à Rome par les
étrangers.—Les médecins grecs.—Les empiriques, les antidotaires
et les pharmacopoles.—Les médecins pneumatistes.—Les
archiatres.—Archiatri pallatini et archiatri populares.—L’institution
des archiatres régularisée et complétée par Antonin-le-Pieux.—Eutychus,
[473]
médecin des jeux du matin.—Les
sages-femmes et les medicæ.—Épigramme de Martial contre
Lesbie.—Le solium ou bidet, et de son usage à Rome.—Pourquoi
les malades atteints de maladies honteuses ne se faisaient
pas soigner par les médecins romains.—Mort de Festus, ami de
Domitien.—Des drogues que vendaient les charlatans pour la
guérison des maladies vénériennes.—Superstitions religieuses.—Offrandes
aux dieux et aux déesses.—Les prêtres médecins.—La
Quartilla de Pétrone.—Abominable apophthegme des
pædicones.
CHAPITRE XXI.
Sommaire.—Les medicæ juratæ.—Origine des sages-femmes.—L’Athénienne
Agonodice.—Les sagæ.—Exposition des nouveau-nés
à Rome.—Les suppostrices ou échangeuses d’enfants.—Origine
du mot sage-femme.—Les avortements.—Julie,
fille d’Auguste.—Onguents, parfums, philtres et maléfices.—Pratiques
abominables dont les sagæ se souillaient pour fabriquer
les philtres amoureux.—La parfumeuse Gratidie.—Horribles
secrets de cette magicienne, dévoilés par Horace, dont elle fut la
maîtresse.—Le mont Esquilin, théâtre ordinaire des invocations
et des sacrifices magiques.—Gratidie et sa complice la
vieille Sagana, aux Esquilies.—Le nœud de l’aiguillette.—Comment
les sagæ s’y prenaient pour opérer ce maléfice, la terreur
des Romains.—Comment on conjurait le nœud de l’aiguillette.—Philtres
aphrodisiaques.—La potion du désir.—Composition
des philtres amoureux.—L’hippomane.—Profusion
des parfums chez les Romains.—La nicérotiane et le foliatum.—Parfums
divers.—Cosmétiques.—Le bain de lait d’ânesse
de Poppée.—La courtisane Acco.—Objets et ustensiles à
l’usage de la Prostitution, que vendaient les sagæ et les parfumeuses.—Le
fascinum.—Les fibules.—Comment s’opérait
l’infibulation.—De la castration des femmes.—Les prêtres de
Cybèle.
CHAPITRE XXII.
Sommaire.—La débauche dans la société romaine.—Pétrone
arbiter.—Aphorisme de Trimalcion.—Le verbe vivere.—Extension
donnée à ce verbe par les délicats.—La déesse Vitula.—Vitulari
[474]
et vivere.—Journée d’un voluptueux.—Pétrone
le plus habile délicat de son époque.—Les comessations ou
festins de nuit.—Étymologie du mot comessationes.—Origine
du mot missa, messe.—Infamies qui avaient lieu dans les comessations
du palais des Césars.—Mode des comessations.—Lits
pour la table.—La courtisane grecque Cytheris.—Bacchides
et ses sœurs.—Le repas de Trimalcion.—Les histrions,
les bouffons et les arétalogues.—Les baladins et les danseuses.—Danses
obscènes qui avaient lieu dans les comessations.—Comessations
de Zoïle.—Épisode du festin de Trimalcion.—Services
de table et tableaux lubriques.—Ameublement et décoration
de la salle des comessations.—Santés érotiques.—Thesaurochrysonicochrysides,
mignon du bouffon de table Galba.—Rôles
que jouaient les fleurs dans les comessations.—Dieux
et déesses qui présidaient aux comessations.—Les lares Industrie,
Bonheur et Profit.—Le verbe comissari.—Théogonie
des dieux lares de la débauche.—Conisalus, dieu de la sueur
que provoquent les luttes amoureuses.—Le dieu Tryphallus.—Pilumnus
et Picumnus, dieux gardiens des femmes en couches.—Deverra,
Deveronna et Intercidona.—Viriplaca, déesse des
raccommodements conjugaux.—Domiducus.—Suadela, Orbana,
Genita Mana, etc., etc.—Fauna, déesse favorite des matrones.—Jugatinus
et ses attributions.
CHAPITRE XXIII.
Sommaire.—Le peuple romain, le plus superstitieux de tous les
peuples.—Les libertins et les courtisanes, les plus superstitieux
des Romains.—Clédonistique de l’amour et du libertinage.—Fâcheux
présages.—Pourquoi les paroles obscènes étaient
bannies même des réunions de débauchés et de prostituées.—L’urinal
ou pot de chambre.—Présages que les Romains tiraient
du son que rendait l’urine en tombant dans l’urinal.—Matula,
matella et scaphium.—Double sens obscène du mot pot de
chambre.—Étymologie de matula.—Présages urinatoires dans
les comessations.—Hercule Urinator.—Présages des ructations.—Crepitus,
dieu des vents malhonnêtes.—Le petit dieu
Pet.—Présages tirés du son du pet.—Origine de la qualification
de vesses, donnée aux filles dans le langage populaire.—Présages
tirés de la sternutation.—Jupiter et Cybèle, dieux
[475]
des éternuments.—Heureux pronostics attribués aux éternuments
dans les affaires d’amour.—Les tintements d’oreilles et
les tressaillements subits.—La droite et la gauche du corps.—Présages
résultant de l’inspection des parties honteuses.—Présages
tirés des bruits extérieurs.—Le craquement du lit.—Lectus
adversus et lectus genialis.—Le Génie cubiculaire.—Le
pétillement de lampe.—Habileté des courtisanes à expliquer
les présages.—Présages divers.—Le coup de Vénus.—Présages
heureux ou malheureux, propres aux mérétrices.—L’empereur
Proculus et les cent vierges Sarmates.—Rencontre d’un
chien.—Rencontre d’un chat.—Superstitions singulières du
peuple de Vénus.—Jeûnes et abstinence que s’imposaient les
débauchés et les courtisanes en l’honneur des solennités religieuses.—Vœu
à Vénus.—Moyen superstitieux employé par
les Romains pour constater la virginité des filles.—La noix, allégorie
du mariage.
CHAPITRE XXIV.
Sommaire.—Pourquoi les courtisanes de Rome n’ont pas eu
d’historiens ni de panégyristes comme celles de la Grèce.—Les
poëtes commensaux et amants des courtisanes.—Amour des
courtisanes.—C’est dans les poëtes qu’il faut chercher les éléments
de l’histoire des courtisanes romaines.—Les Muses des
poëtes érotiques.—Leur vieillesse misérable.—Les amours
d’Horace.—Éloignement d’Horace pour les galanteries matronales.—Serment
de Salluste.—Philosophie épicurienne d’Horace.—Ses
conseils à Cerinthus sur l’amour des matrones.—Comparaison
qu’il fait de cet amour avec celui des courtisanes.—Nééra,
première maîtresse d’Horace.—Origo, Lycoris et Arbuscula.—Débauches
de la patricienne Catia.—Ses adultères.—Liaison
d’Horace avec une vieille matrone.—La bonne Cinara.—Gratidie
la parfumeuse.—Ses potions aphrodisiaques.—Rupture
publique d’Horace avec Gratidie.—La courtisane
Hagna et son amant Balbinus.—Amours d’Horace pour les garçons.—La
courtisane Lycé.—Pyrrha.—Lalagé.—Barine.—Tyndaris
et sa mère.—Lydie.—Myrtale.—Chloé.—Phyllis,
esclave de Xanthias.—A quelle singulière circonstance
Horace dut la révélation de la beauté de cette esclave.—Glycère,
ancienne maîtresse de Tibulle, accorde ses faveurs
[476]
à Horace. Adieux d’Horace aux amours.—La chanteuse Lydé,
dernière maîtresse d’Horace.—Honteuse passion d’Horace pour
Ligurinus.
CHAPITRE XXV.
Sommaire.—Catulle.—Licence et obscénité de ses poésies.—Ses
maîtresses et ses amies.—Clodia ou Lesbie, fille du
sénateur Métellus Céler, maîtresse de Catulle.—Le moineau de
Lesbie.—Ce que c’était que ce moineau.—Passion violente de
Catulle pour Lesbie.—Rupture des deux amants.—Résignation
de Catulle.—Mariage concubinaire de Lesbie.—Catulle
revoit Lesbie en présence de son mari.—Subterfuges
employés par Lesbie pour ne pas éveiller la jalousie de son mari.—La
courtisane Quintia au théâtre.—Vers de Catulle contre
Quintia.—La courtisane grecque Ipsithilla.—Billet galant qu’adressa
Catulle à cette courtisane.—Épigramme de Catulle aux
habitués d’une maison de débauche où s’était réfugiée une de
ses maîtresses.—Colère de Catulle contre Aufilena.—La catin
pourrie.—Vieillesse prématurée de Catulle.—Lesbie au lit de
mort de son amant.—Properce.—Cynthie ou Hostilia.—Son
amour pour Properce.—Statilius Taurus, entreteneur de Cynthie.—Résignation
de Properce à l’endroit des amours de sa
maîtresse avec Statilius Taurus.—Les oreilles de Lygdamus.—Conseils
de Properce à sa maîtresse.—La docte Cynthie.—Élégies
de Catulle sur les attraits de sa maîtresse.—Axiome de
Properce.—Nuit amoureuse avec Cynthie.—Les galants de
Cynthie.—Ses nuits à Isis et à Junon.—Gémissements de
Properce sur la conduite de Cynthie.—Les bains de Baïes.—Properce
se jette dans la débauche pour oublier sa maîtresse.—Réconciliation
de Properce avec Cynthie.—Changement de
rôles.—Acanthis l’entremetteuse.—Jalousie de Cynthie.—Lycinna.—Subterfuge
qu’employa Cynthie pour s’assurer de la
fidélité de son amant.—Phyllis et Téïa.—Properce pris au
piége.—Fureur de Cynthie.—L’empoisonneuse Nomas.—Funérailles
précipitées de Cynthie.—Mort de Properce.—Ses
cendres réunies à celles de Cynthie.
CHAPITRE XXVI.
Sommaire.—Tibulle.—Sa vie voluptueuse.—L’affranchie Plania
[477]
ou Délie.—Le mari de cette courtisane.—La mère de Délie
protége les amours de sa fille avec Tibulle.—Tendresse platonique
de Tibulle.—Recommandations du poëte à la mère de
son amante.—Philtres et enchantements.—Ennuyée des sermons
de Tibulle, Délie lui ferme sa porte.—Tibulle dénonce
au mari de Délie l’inconduite de sa femme.—Amour de Tibulle
pour Némésis.—Prix des faveurs de cette prostituée.—Cerinthe
empêche Tibulle de se ruiner pour Némésis.—Tibulle
amoureux de Néère.—Refus de Néère d’épouser Tibulle.—Néère
prend un amant.—Désespoir de Tibulle.—Déclaration
d’amour à Sulpicie, fille de Servius.—Sulpicie accorde ses faveurs
à Tibulle.—Infidélités de Tibulle.—Glycère.—Amour
sérieux de Tibulle pour cette courtisane grecque.—Dédains de
Glycère.—Mort de Tibulle.—Délie et Némésis à ses funérailles.—Cornelius
Gallus.—Lycoris.—Gallus à la guerre des Parthes.—Son
poëme à Lycoris.—Retour de Gallus.—Infidélités de
Lycoris.—Gentia et Chloé.—Lydie.—La Lycoris de Maximianus,
ambassadeur de Théodoric.—Ovide.—Corinne.—Conjectures
sur le vrai nom de cette courtisane.—Le mari de
Corinne.—Manéges amoureux que conseille Ovide à Corinne.—Corinne
chez Ovide.—Jalousie et brutalité d’Ovide.—Son
désespoir d’avoir frappé Corinne.—L’entremetteuse Dipsas.—L’eunuque
Bagoas.—Napé et Cypassis, coiffeuses de Corinne.—Amours
d’Ovide et de Cypassis.—Avortement de Corinne.—Indignation
d’Ovide à la nouvelle de cet odieux attentat.—Empressement
de Corinne pour regagner le cœur d’Ovide.—Froideur
d’Ovide.—Honte et dépit de Corinne.—Ovide est
mis à la porte.—Corinne et le capitaine romain.—Gémissements
d’Ovide.—Corinne devenue courtisane éhontée.—Dernière
lettre d’Ovide à Corinne.—Ovide compose son poëme de
l’Art d’aimer, sous les yeux et d’après les inspirations des courtisanes.—Sa
liaison secrète supposée avec la fille d’Auguste.—Ovide
est exilé au bord du Pont-Euxin.—Mort d’Ovide.
CHAPITRE XXVII.
Sommaire.—Marcus Valerius Martial, poëte complaisant des libertinages
de Néron et de ses successeurs.—Vogue immense
qu’obtinrent les Épigrammes de Martial.—Réponse de Martial
[478]
à son critique Cornélius qui lui reprochait l’obscénité de ses poésies.—Quelles
étaient les victimes ordinaires des sarcasmes de
Martial.—Mœurs déréglées de ce poëte.—Quels étaient les
lecteurs habituels des œuvres de Martial.—Portraits de courtisanes.—Lesbie.—Libertinage
éhonté de cette prostituée.—Chloé
et son amant Lupercus.—La pleureuse des sept maris.—Thaïs.—Philenis
et son concubinaire Diodore.—Horrible
dépravation de Philenis.—Épitaphe que fit Martial pour cette
infâme prostituée.—Galla.—Injustice de Martial à l’égard de
cette courtisane.—Épigrammes qu’il fit contre elle.—D’où lui
venait la haine qu’il lui avait vouée.—Les vieilles amoureuses.—Effrayant
cynisme de Phyllis.—Épigrammes contradictoires
de Martial contre cette courtisane.—Lydie.—Aversion et dégoût
de Martial pour les vieilles prostituées.—Fabulla, Lila,
Vetustilla, etc.—Les fausses courtisanes grecques.—Celia.—Épigramme
de Martial contre cette prétendue fille de la Grèce.—Lycoris.—Glycère.—Chioné
et Phlogis. De quelle façon
grossière Martial accueillit une gracieuse invitation à l’amour
que lui avait envoyée Polla.—Honteuse profession de foi qu’il
adressa à sa femme Clodia Marcella.—Son retour en Espagne.—Épigramme
expiatoire de Martial.—Sa fin champêtre.—Pétrone.—Son
Satyricon, tableau des mœurs impures de Rome
impériale.—Les Épigrammes de Pétrone.—Suicide de Pétrone.
CHAPITRE XXVIII.
Sommaire.—Les empereurs romains.—Influence perverse de leurs
mœurs dépravées.—Rigueur des lois relatives à la moralité publique
avant l’avénement des empereurs.—Le chevalier Ebutius
et sa maîtresse, la courtisane Hispala Fecenia.—Jules César.—Déportements
de cet empereur.—Femmes distinguées qu’il séduisit.—Ses
maîtresses Eunoé et Cléopâtre.—Infamie de ses
adultères.—César et Nicomède, roi de Bithynie.—Chanson
des soldats romains contre César.—Octave, empereur.—Son
impudicité.—Épisode singulier des amours tyranniques d’Auguste.—Répugnance
d’Auguste pour l’adultère.—Son inceste
avec sa fille Julie.—Son goût immodéré pour les vierges.—Sa
passion pour le jeu.—Ses femmes Claudia, Scribonia et
Livia Drusilla.—Le Festin des douze divinités.—Apollon
[479]
bourreau.—Tibère, empereur.—Son penchant pour l’ivrognerie.—Étranges
contradictions qu’offrirent la vie publique et
la vie privée de cet empereur.—Tibère Caprineus.—Le tableau
de Parrhasius.—Caligula, empereur.—Ses amours infâmes
avec Marcus Lépidus et le comédien Mnester.—Sa passion
pour la courtisane Pyrallis.—Comment cet empereur agissait
envers les femmes de distinction.—Le vectigal de la Prostitution.—Ouverture
d’un lupanar dans le palais impérial.—Le
préfet des voluptés.—Claude, empereur.—Honteuses débauches
de ses femmes Urgulanilla et Messaline.—Néron, empereur.—Sa
jeunesse.—Ses soupers publics au Champ-de-Mars
et au grand Cirque.—Les hôtelleries du golfe de Baïes.—Pétrone,
arbitre du plaisir.—Abominables impudicités de
Néron.—Son mariage avec Sporus.—Sa passion incestueuse
pour sa mère Agrippine.—Les métamorphoses des dieux.—Galba,
empereur.—Infamie de ses habitudes.—Othon, empereur.—Ses
mœurs corrompues.—Vitellius, empereur.—Ses
débordements.—Son amour pour l’affranchi Asiaticus.—Son
insatiable gloutonnerie.—Vespasien, empereur.—Retenue
de ses mœurs.—Titus, empereur.—Sa jeunesse impudique.—Son
règne exemplaire.—Domitia et l’histrion Pâris.—Domitien,
empereur.—Ses déportements.—Nerva, Trajan et
Adrien, empereurs.—Antonin-le-Pieux et Marc-Aurèle.
CHAPITRE XXIX.
Sommaire.—Commode, empereur.—Ses turpitudes et ses
cruautés.—Ses impurs caprices.—Son mignon Anterus.—Comment
Commode employait ses jours et ses nuits.—Mort
d’Anterus.—Douleur de Commode.—Ses trois cents concubines
et ses trois cents cinædes.—Ses orgies monstrueuses.—Ses
incestes.—Hideuses complaisances auxquelles il soumettait ses
courtisans.—L’affranchi Onon.—Commode se fait décerner par
le sénat le surnom d’Hercule.—Horribles débauches de ce
monstre.—Comment Marcia, concubine de Commode, découvrit
le projet qu’avait l’empereur de la faire périr, ainsi qu’un grand
nombre des officiers de la maison impériale.—Philocommode.—Mort
de Commode.—Héliogabale, empereur.—Célébrité unique
d’infamie laissée par lui dans l’histoire.—Héliogabale,
grand-prêtre du Soleil.—Sa mère Semiamire.—Luxe macédonien
[480]
des vêtements d’Héliogabale.—Semiamire clarissima.—Petit
sénat fondé par l’empereur pour complaire à sa mère.—Ce
que c’était que le petit sénat et de quoi l’on s’y occupait.—Goûts
infâmes d’Héliogabale.—Quelle sorte de gens il choisissait
de préférence pour compagnons de ses débauches.—Comment
il célébrait les Florales.—Les monobèles.—Plaisir
qu’il trouvait à se mêler incognito aux actes de la Prostitution
populaire.—Sa sympathie et sa tendresse pour les prostituées.—Convocation
qu’il fit de toutes les courtisanes inscrites et de
tous les entremetteurs de profession.—Comment il se conduisit
devant cette tourbe infâme qu’il présida et don qu’il fit à
chacun des assistants.—L’empereur courtisane.—Argenterie
érotique de ses festins.—Comment Héliogabale célébrait les vendanges.—Femmes
légitimes qu’eut cet empereur hermaphrodite.—La
veuve de Pomponius Bassus.—Cornelia Paula.—La prêtresse
de Vesta.—Maris d’Héliogabale.—Le conducteur de
chariot, Jérocle.—Aurelius Zoticus, dit le cuisinier.—Comment
Jérocle se débarrassa de ce rival.—Mariage des dieux
et des déesses.—Festins féeriques d’Héliogabale.—Petites loteries
qu’il faisait tirer à ces festins.—Droits qu’avaient les
courtisanes dans le palais impérial.—Meurtre d’Héliogabale par
les soldats.—Alexandre Sévère, empereur.—Bienfaisante influence
de son règne.—Gallien, empereur.—Ses débauches.—Le
divin Claude, empereur.—Aurélien, empereur.—Tacite,
empereur.—Les mauvais lieux sont défendus dans l’intérieur
de Rome.—Probus, empereur.—Carin, empereur.—Sa
vie infâme.—Dioclétien, empereur.—C’est sous son règne que
semble s’arrêter l’histoire de la Prostitution romaine.
FIN DE LA TABLE.
Note de transcription détaillée:
En plus des corrections des erreurs clairement introduites par le
typographe, les erreurs suivantes ont été corrigées:
- p. 14: «appellait» corrigé en «appelait» («qu’on appelait stabula»),
- p. 16: fermeture des guillemets avant «On appliquait avec raison»,
- p. 20: fermeture des guillemets après «aïeule»,
- p. 26: «Pierruges» corrigé en «Pierrugues» («le docte Pierrugues»),
- p. 30 et 471, «mœchocinœdus» corrigé en «mœchocinædus»,
- p. 75: «proéminant» corrigé en «proéminent» («et plus proéminent»),
- p. 86: «commessations» corrigé en «comessations» («excepté dans les soupers et les comessations,»),
- p. 98: fermeture des guillemets après «aucupium auribus?»,
- p. 100: fermeture des guillemets après «quam malum dicere).»,
- p. 104: «éclairé» corrigé en «éclairée» («la protection éclairée»),
- p. 104: fermeture des guillemets après «pagina, vita proba).»,
- p. 126: «ingrédiens» corrigé en «ingrédients» («les ingrédients ordinaires»),
- p. 155: «tout» corrigé en «tous» («en tous les cas»),
- p. 186: remplace «?» par «.» («des joueurs d’osselets.»),
- p. 186 et 366: «cinœdes» corrigé en «cinædes» («des portraits de cinædes»),
- p. 195, «uticæ» corrigé en «urticæ»,
- p. 230: fermeture des guillemets après «matulam datis).»,
- p. 234: «pelusiciaca» corrigé en «pelusiaca»,
- p. 237: fermeture des guillemets après «sternuit approbationem).»,
- p. 308: fermeture des guillemets après «ducere veste libet).»,
- p. 351: fermeture des guillemets après «numeros sustinuisse novem).»,
- p. 358: «Alcylle» corrigé en «Ascylte» («Ascylte et Giton.»),
- p. 362: fermeture des guillemets après «vita proba est).»,
- p. 363: «Parace» corrigé en «Parce» («Parce tuis igitur»),
- p. 394: «Alcylte» corrigé en «Ascylte» («Ascylte et Giton,»),
- p. 396: «testamenat» corrigé en «testament» («escroqué plus d’un testament»),
- p. 406: «sumpluosum» corrigé en «sumptuosum»,
- p. 409: fermeture des guillemets après «par plus d’un opprobre,»,
- p. 409: «sexterces» corrigé en «sesterces», comme dans l’édition Belge de la même année,
- p. 426: «deliagtorum» corrigé en «deligatorum».
Certaines expressions latines, contenant de possibles erreurs de
typographie, ou ayant une ortographe non usuelle, n’ont pas été corrigées:
- p. 237: «sallisationes» pour «salisationes»,
- p. 301: «futationes» pour «fututiones»,
- p. 345: «dominiæque» pour «dominæque»,
- p. 367: «sejurat» pour «se jurat»,
- p. 381: «iatu» pour «hiatu»,
- p. 383: «solecismum» pour «solœcismum»,
- p. 464: «plerunque» pour «plerumque».
En pages 195 et 396, les citations de Pétrone sont écrites différemment.
La première commence par «Profert Enothea» et ne contient pas le mot
«pipere», alors que la seconde commence par «Profert Ænothea».
Il y avait plusieurs erreurs de typographie dans les mots grecs:
- p. 65: «μοιχένω» corrigé en «μοιχεύω»,
- p. 124: «φαγέδαὶνα» corrigé en «φαγέδαινα»,
- p. 141: «βουβώνὶον» corrigé en «βουβώνιον»,
- p. 147: «ίατρονικης» corrigé en «ἰατρονικης»,
- p. 207: «κομίση» corrigé en «κομιδη»,
- p. 433: «κλυηοπαλεν» corrigé en «κλινοπαλην».
End of the Project Gutenberg EBook of Histoire de la prostitution chez tous
les peuples du monde depuis l'antiqui, by Pierre Dufour
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HISTOIRE DE LA PROSTITUTION 2/6 ***
***** This file should be named 43712-h.htm or 43712-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/3/7/1/43712/
Produced by Laurent Vogel, Bibimbop, Guy de Montpellier
and the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned
images of public domain material from the Google Print
project.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.