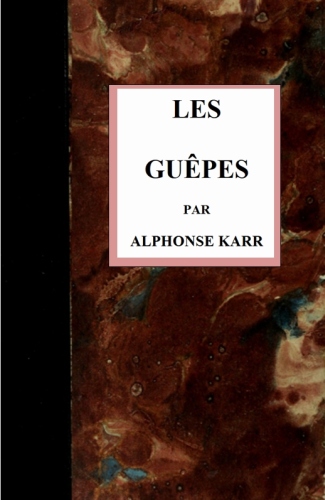
| Notes de transcription: Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L’orthographe d’origine a été conservée et n’a pas été harmonisée. |
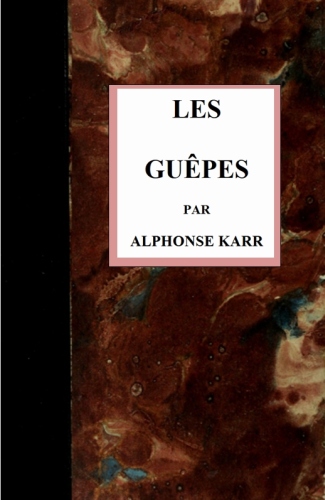
COLLECTION MICHEL LÉVY
| ŒUVRES | |
| D’ALPHONSE KARR | |
| Format grand in-18. | |
| —— | |
| LES FEMMES | 1 vol. |
| AGATHE ET CÉCILE | 1 — |
| PROMENADES HORS DE MON JARDIN | 1 — |
| SOUS LES TILLEULS | 1 — |
| LES FLEURS | 1 — |
| SOUS LES ORANGERS | 1 — |
| VOYAGE AUTOUR DE MON JARDIN | 1 — |
| UNE POIGNÉE DE VÉRITÉS | 1 — |
| LA PÉNÉLOPE NORMANDE | 1 — |
| ENCORE LES FEMMES | 1 — |
| MENUS PROPOS | 1 — |
| LES SOIRÉES DE SAINTE-ADRESSE | 1 — |
| TROIS CENTS PAGES | 1 — |
| LES GUÊPES. | 6 — |
AVIS
En attendant que le bon sens ait adopté cette loi en un article «la propriété littéraire est une propriété,» l’auteur, pour le principe, se réserve tous droits de reproduction et de traduction, sous quelque forme que ce soit.
Paris.—Typ. de A. WITTERSHEIM, 8, rue Montmorency.
PAR
ALPHONSE KARR
—TROISIÈME SÉRIE—
NOUVELLE ÉDITION

PARIS
MICHEL LÉVY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE VIVIENNE, 2 BIS
—
1858
Reproduction et traduction réservées
A Victor Hugo.—Le rossignol et les oies.—1.—40.—450.-33,000,000.—M. Conte.—Les lettres et la poste.—Les harpies.—M. Martin (du Nord).—Nouvelles de la prétendue gaieté française.—La queue de la poêle.—Un trait d’esprit du préfet de police.—Les chiens enragés.—Les journaux.—Renseignement utile aux gens d’Avignon.—Où est le tableau de M. Gudin.—M. Quenson dénoncé.—A monseigneur l’archevêque de Paris.—Mots nouveaux.—Victoria à Rachel.—Les esclaves et les domestiques.—L’Opéra.—Le Cirque-Olympique.—Le duc d’Orléans.—Le maréchal Soult.—Nouvelles frontières de la France.—Les vivants et les morts.—M. de Lamartine.—La postérité.—M. Hello accusé de meurtre.—La Fête-Dieu.—Giselle.—M. Ancelot.—M. de Pongerville.—Les vautours.—M. Villemain.—Une voix.—M. Garnier-Pagès.—Un oncle.—Le charbon de terre et les propriétaires de forêts.
Sainte-Adresse.
![]() JUILLET.—A Victor Hugo.—Il faisait hier une belle soirée, mon
cher Hugo; j’étais allé voir au bord de la mer le soleil se coucher dans
une pourpre plus splendide que ne l’a jamais été celle des rois—quand
il y avait de la pourpre—et quand il y avait des rois.
JUILLET.—A Victor Hugo.—Il faisait hier une belle soirée, mon
cher Hugo; j’étais allé voir au bord de la mer le soleil se coucher dans
une pourpre plus splendide que ne l’a jamais été celle des rois—quand
il y avait de la pourpre—et quand il y avait des rois.
On voyait passer à l’horizon—des silhouettes de navires noirs sur un fond d’or rouge, et je cherchais à reconnaître un bateau d’Étretat qui doit m’emmener dans quelques heures,—non à ses voiles brunes et tannées qu’on n’aurait pu distinguer à cette heure, où les couleurs s’effacent,—mais à la forme particulière de son beaupré incliné vers la mer.
Après les couleurs, les formes commencèrent à disparaître.—Je vis s’allumer les lumières rouges des phares sur les jetées du Havre,—les lumières bleuâtres des étoiles au ciel—et les lumières presque vertes des lucioles dans l’herbe.—J’entendais le bruit de la mer qui montait, et je reconnaissais à son parfum une petite fleur jaune qui pousse à foison sur cette côte et qui embaume l’air.
Et je pensai à un de vos anciens ouvrages, à un beau livre,—au Dernier jour d’un condamné,—dans lequel le malheureux qu’on juge,—en proie à une bizarre hallucination,—ne peut détourner ses regards et sa pensée d’une petite fleur jaune qui se balance sur une fenêtre où elle a été semée par le vent ou par quelque oiseau.
Et je pensai à ces longues promenades que j’ai faites quelquefois avec vous sur les boulevards de Paris,—à l’heure où Paris dormait,—à ces promenades où nous parlions des magnificences de la nature, que vous aimiez comme moi,—et dont vous me parliez si bien.
Et je songeai que ce jour-là vous étiez reçu membre de l’Académie française.—Vous voyez que je vous aime, Victor, puisque, sous de beaux arbres, à travers lesquels je voyais les étoiles comme des fruits de feu,—ayant à mes pieds la mer qui rejetait les varechs et les algues de ses prairies profondes où paissent les phoques,—assis sur une côte revêtue du beau manteau dont la terre se couvre l’été,—au milieu de tant de feuilles et d’herbes,—au milieu de tant de belles choses vertes,—j’ai pu penser aux deux pauvres petites palmes dont vous avez le droit maintenant d’enrichir le collet de votre habit.
Vous voilà donc enfin à l’Académie!—Vous y êtes entré comme le fils de Philippe de Macédoine entra à Babylone. Mais ne vous semblerait-il pas singulier de lire dans son historien, Quinte-Curce, qu’Alexandre ne demanda, pour prix de ses victoires, que d’être nommé citoyen de la ville de Darius?
Ne vous êtes-vous pas un peu laissé faire—ce que le père Loriquet, e societate Jesu, voulait faire de Napoléon, que, dans son Histoire de France, il appelait le marquis de Buonaparte, général en chef des armées de Louis XVIII?
Je lisais dernièrement un des romans de Walter Scott, intitulé le Pirate: c’est l’histoire de Clémont Vaughan, qui, après avoir été pendant plusieurs années le chef d’une troupe déterminée—et le maître d’une frégate au redoutable pavillon noir,—s’amende à la fin et devient officier sur un vaisseau de Sa Majesté, où ses supérieurs sont fort contents de lui.
Je regardais l’autre jour sur une feuille d’un rosier planté au bord d’un ruisseau—une goutte de pluie plus brillante qu’une opale;—tout à coup elle roula tout le long de la feuille, et tomba dans l’eau du ruisseau, où elle se perdit.
C’est par l’individualité que charme un poëte; vous étiez un tout,—pourquoi devenir une partie?
Il y a un grand nombre de pierres à la base d’une pyramide; il n’y en a qu’une au sommet.
Le rossignol chante seul dans les buissons en fleurs;—les oies volent en troupes.
Vous êtes entré à l’Académie en en enfonçant les portes;—en vain vous avez caché votre triomphe,—en vain vous avez pris une allure modeste et hypocrite:—vos confrères malgré eux—ont fait comme les vieilles femmes d’une ville prise d’assaut:—elles jettent du haut des fenêtres, sur la tête de l’ennemi, tous leurs ustensiles de ménage.
Ce n’était vraiment pas la peine de se faire Victor Hugo—pour devenir l’un des quarante.
Mon pauvre Victor,—vous voici donc enfin l’égal de M. Flourens!—tout le monde dit maintenant que vous voulez devenir député, c’est-à-dire un des quatre cent cinquante.
De succès en succès,—si on vous laisse faire, vous arriverez à être l’un des trente-trois millions qui composent la nation française.
![]() De mieux en mieux.—Le parquet, conformément à une instruction du
ministre de la justice,—a fait ouvrir, dans les bureaux de poste, des
lettres adressées à des particuliers;—lettres qui n’ont été remises à
leur destination qu’après avoir été ouvertes.
De mieux en mieux.—Le parquet, conformément à une instruction du
ministre de la justice,—a fait ouvrir, dans les bureaux de poste, des
lettres adressées à des particuliers;—lettres qui n’ont été remises à
leur destination qu’après avoir été ouvertes.
Je suis fort indulgent pour les attaques à certaines libertés inutiles, embarrassantes et assujettissantes que réclament sans cesse certains partis;—mais, quand il s’agit de véritables libertés, c’est une autre affaire.
Quoi! vous avez le monopole d’une exploitation qui rapporte des bénéfices énormes, et vous en usez pour de honteuses et criminelles investigations!—Quoi! il ne reste aucun moyen de mettre sa vie, ses affections, ses pensées, en dehors des ignobles débats que se livrent et les gens du pouvoir et ceux qui y prétendent sous divers noms et sous divers prétextes?
Quoi! ces mots que je crois écrire à un ami,—ces paroles que j’adresse à une femme,—toutes ces choses qui sortent d’un cœur pour retomber dans un autre,—c’est M. Martin (du Nord) ou l’un de ses acolytes qui les lira!
Messieurs, partagez-vous, arrachez-vous, disputez-vous les places, l’argent, les honneurs,—les rubans,—je ne m’en mets pas en peine;—je n’y prétends pas plus, après que vous les avez tiraillés, qu’à un reste de festin de harpies.
Mais je ne permets ni à M. Martin (du Nord) d’ouvrir mes lettres, ni à M. Conte, directeur des postes, de livrer lâchement les lettres que je lui confie.—Il est des choses qu’il faut respecter, messieurs,—sous peine de ne plus voir en France qu’un seul parti, le parti des gens qui ont du cœur et de l’honnêteté, et de le voir contre vous.
Pour moi,—si une semblable chose m’arrivait,—je poursuivrais par tous les moyens et M. Martin (du Nord) et M. Conte,—quand il me faudrait vendre, pour parvenir à en avoir raison,—jusqu’à mon dernier habit,—jusqu’à la montre que m’a donnée Méry.
Vous n’aurez pas besoin, messieurs, d’ouvrir frauduleusement une lettre pour savoir ce que je pense;—je le dis hautement et je l’imprime,—et je charge M. Conte de le faire porter dans toute la France et dans toute l’Europe;—c’est une trahison et une infamie, et je suis à la fois de tous les partis où l’on blâme et où l’on flétrit de semblables actes.
Le prétexte que l’on a pris est que les lettres ouvertes paraissaient contenir des billets de loteries étrangères.
Et comment le savez-vous,—et de quel droit regardez-vous ce que les lettres paraissent contenir?—Vous n’avez qu’un droit: c’est de recevoir le prix des lettres qu’on vous confie; qu’un devoir: c’est de les remettre fidèlement à leur destination.
NOUVELLES DE LA PRÉTENDUE GAIETÉ FRANÇAISE.
Le Français, né malin, créa la guillotine.
![]() Beaucoup de gens ont déjà remarqué qu’on ne s’amusait plus en
France.—Cette question, beaucoup plus grave qu’on ne semble le croire,
a dû occuper quelques-unes de mes méditations.—Voici les causes que
j’en ai trouvées: à cette époque où le gouvernement de la France était
une monarchie absolue tempérée par des chansons,—il n’y avait dans
les affaires qu’un très-petit nombre de rôles à jouer,—et ces rôles,
réservés à certaines castes, une fois remplis, le reste de la nation
était réduit naturellement à l’état de spectateurs. Les spectateurs
d’une pièce quelconque sont décidés à s’amuser;—s’ils n’en trouvent pas
dans la pièce qu’on joue devant eux un prétexte suffisant, ils
s’amuseront à se moquer de la pièce, de l’auteur et des acteurs,—ou à
les siffler, ou à leur jeter des pommes.
Beaucoup de gens ont déjà remarqué qu’on ne s’amusait plus en
France.—Cette question, beaucoup plus grave qu’on ne semble le croire,
a dû occuper quelques-unes de mes méditations.—Voici les causes que
j’en ai trouvées: à cette époque où le gouvernement de la France était
une monarchie absolue tempérée par des chansons,—il n’y avait dans
les affaires qu’un très-petit nombre de rôles à jouer,—et ces rôles,
réservés à certaines castes, une fois remplis, le reste de la nation
était réduit naturellement à l’état de spectateurs. Les spectateurs
d’une pièce quelconque sont décidés à s’amuser;—s’ils n’en trouvent pas
dans la pièce qu’on joue devant eux un prétexte suffisant, ils
s’amuseront à se moquer de la pièce, de l’auteur et des acteurs,—ou à
les siffler, ou à leur jeter des pommes.
Mais, aujourd’hui, on a fort agrandi le théâtre, et on a supprimé les banquettes et les loges;—il n’y a plus de spectateurs, et tout le monde est acteur,—même ceux qu’on en soupçonne le moins.
Prenez, au hasard, le premier homme que vous rencontrez dans la rue:—il n’est peut-être ni ministre,—ni sous-secrétaire d’État,—ni pair,—ni député;—mais il est peut-être électeur,—car, en moyenne,—chacun des quatre cent cinquante députés a été envoyé à la Chambre par quatre cent cinquante électeurs.—S’il n’est pas électeur, il est membre du conseil d’arrondissement,—ou du conseil municipal,—ou du conseil communal,—ou du conseil de salubrité,—ou de la commission de,—ou de,—ou de,—ou officier supérieur ou inférieur de la garde nationale,—ou sergent, ou caporal,—ou membre du conseil de discipline,—membre de la Légion d’honneur ou aspirant à l’être,—de la Société des naufrages ou de celle d’agriculture,—et si, par hasard, il a trouvé moyen d’échapper à quelqu’un de ces rôles si nombreux,—grâce aux journaux, il est de tel ou tel club,—de telle ou telle société;—ou bien il est, comme bureaucrate,—toujours grâce aux journaux, fonctionnaire indépendant,—ou, comme soldat, baïonnette intelligente.—Si, par hasard, cependant,—après avoir épuisé toutes les questions, vous arrivez à découvrir que l’homme que vous avez arrêté n’est revêtu d’aucun de ces rôles, ne jouit d’aucune de ces parcelles du pouvoir, débris de la puissance royale brisée; s’il n’est rien de rien,—je vous le dis, en vérité, ne cherchez pas plus longtemps, cet homme est le roi Louis-Philippe, cet homme est votre roi.
![]() A moins cependant que ce ne soit votre obéissant serviteur Alphonse
Karr.
A moins cependant que ce ne soit votre obéissant serviteur Alphonse
Karr.
![]() C’est ce qui a fait le succès de cette énorme chose appelée
gouvernement représentatif;—certes, on siffle de temps en temps
certains acteurs, mais on ne siffle pas leurs rôles,—parce qu’on ne
siffle les acteurs que pour les remplacer,—et surtout on ne siffle pas
la pièce parce qu’on y joue un rôle et parce qu’on aspire à en jouer
successivement plusieurs autres.
C’est ce qui a fait le succès de cette énorme chose appelée
gouvernement représentatif;—certes, on siffle de temps en temps
certains acteurs, mais on ne siffle pas leurs rôles,—parce qu’on ne
siffle les acteurs que pour les remplacer,—et surtout on ne siffle pas
la pièce parce qu’on y joue un rôle et parce qu’on aspire à en jouer
successivement plusieurs autres.
En un mot, le gouvernement représentatif n’a eu qu’une adresse et un esprit, c’est de faire de lui-même une poêle dont la queue est assez longue pour que chacun la tienne un peu.
![]() UN TRAIT D’ESPRIT DU PRÉFET DE POLICE.—Je ne suis pas fort
craintif, mais il y a une terreur dont je n’ai jamais pu triompher:
c’est celle que m’inspire la pensée d’être mordu par un chien
enragé.—Certes, j’ai eu un chien appelé Freyschütz, que j’aimais
beaucoup, quoiqu’il ne m’aimât guère que comme on aime le bifteck, ainsi
qu’il l’a prouvé en me dévorant deux fois;—ce qui fait que l’auteur des
Guêpes n’est que le restant de deux soupers de cette énorme bête
féroce.—Eh bien! mes amis ont pu m’entendre dire souvent que, malgré
les craintes que je ressentais pour la conservation de Freyschütz, qui
ne souffrait pas qu’on le muselât,—je n’élèverais pas la moindre
plainte s’il était quelque jour victime de quelque mesure de police
contre les chiens.
UN TRAIT D’ESPRIT DU PRÉFET DE POLICE.—Je ne suis pas fort
craintif, mais il y a une terreur dont je n’ai jamais pu triompher:
c’est celle que m’inspire la pensée d’être mordu par un chien
enragé.—Certes, j’ai eu un chien appelé Freyschütz, que j’aimais
beaucoup, quoiqu’il ne m’aimât guère que comme on aime le bifteck, ainsi
qu’il l’a prouvé en me dévorant deux fois;—ce qui fait que l’auteur des
Guêpes n’est que le restant de deux soupers de cette énorme bête
féroce.—Eh bien! mes amis ont pu m’entendre dire souvent que, malgré
les craintes que je ressentais pour la conservation de Freyschütz, qui
ne souffrait pas qu’on le muselât,—je n’élèverais pas la moindre
plainte s’il était quelque jour victime de quelque mesure de police
contre les chiens.
Pendant bien des années on s’est contenté de jeter dans les tas d’ordures des boulettes de viande empoisonnée.
Ce système était insuffisant pour deux raisons:
Première raison.—Des tombereaux parcouraient la ville dès l’aube du jour, et enlevaient les boulettes avec les ordures.
Deuxième raison.—Un des caractères de la rage est que le chien hydrophobe ne mange pas, de sorte que les chiens enragés se trouvaient précisément les seuls qui fussent à l’abri.
Il y a quelques années, un préfet de police,—je crois que c’est M. Debelleyme,—avisa cette insuffisance et fit faire de grands massacres de chiens. On jeta les hauts cris;—parce que, dans ce bienheureux pays de France, on est décidé d’avance à se prononcer contre l’autorité, quelle qu’elle soit et quoi qu’elle fasse, et principalement contre la police.
D’où il arrive ce qui suit:—que l’horreur générale contre la police éloigne de ses fonctions tous les gens un peu honnêtes et pouvant faire autre chose,—et qu’elles ne sont exercées que par des gens qui ne valent guère mieux que ceux contre lesquels on les emploie,—ce qui justifie en partie la haine d’abord injuste qu’elle inspire.
Une partie des journaux,—les hauts politiques d’estaminet—et la moitié du public, prirent alors le parti des chiens enragés contre le préfet de police.
M. Gabriel Delessert, averti par cet exemple, a pris un parti plus adroit,—invention pour laquelle je lui pardonne presque son grotesque numérotage des voitures.
Il a donné à deux ou trois journaux une anecdote épouvantable, et de son invention, d’un chien enragé qui avait mordu huit ou dix personnes dans les Champs-Élysées et plusieurs chevaux sur la place de la Concorde, où il avait été tué d’un coup de couteau par un brave citoyen.—L’histoire était parfaitement contée. On n’avait oublié aucune des circonstances qui pouvaient la rendre vraisemblable, y compris l’oubli dans lequel on laissait le dévouement admirable de l’homme qui, avec une arme aussi courte qu’un couteau, s’était exposé à d’horribles blessures et surtout à de si horribles suites.—En effet, disaient les plus incrédules, si l’histoire était apocryphe, l’inventeur eût ajouté que l’auteur de cette belle action avait eu la croix d’honneur.
Mais une telle ingratitude ne s’invente pas, il faut qu’elle soit vraie.
Il y a un genre d’amorces auquel les journaux mordent toujours:—c’est l’anecdote.—Chaque journal s’empare du petit nombre de celles que trouvent ses confrères avec une avidité qu’on ne saurait comparer qu’à celle du requin qui avale un matelot avec son chapeau, ses bottes, son couteau et son portefeuille.—Ils coupent le fait avec des ciseaux, sans même en changer la date,—de telle sorte que le journal qui tient l’anecdote de cinquième main la commence par ces mots: «Il est arrivé hier, etc.»
L’anecdote du chien, prise par tous les journaux, frappa beaucoup les esprits, et, quelques jours après, M. G. Delessert fit afficher contre les chiens d’horribles menaces,—qu’il aura, je pense, mises à exécution avec l’approbation générale.
J’avais de bonnes raisons de croire l’anecdote controuvée, attendu qu’un de mes amis croisait, pour des raisons particulières,—sur le théâtre qu’on lui prête, au jour et à l’heure indiqués,—et qu’il y attendit pendant quatre heures une personne qui l’attendait ailleurs;—mais je n’ai pas voulu, le mois dernier, atténuer l’effet de l’invention louable de M. le préfet de police;—pie mendax.
![]() Puisque je parle de la police,—je dois dire combien j’approuve
l’uniforme donné aux officiers de paix,—ainsi que celui que portent
depuis longtemps les sergents de ville;—les fonctions de police
deviendraient honorables et honorées—si cette mesure était
universelle,—et si la police cessait d’agir par guet-apens.
Puisque je parle de la police,—je dois dire combien j’approuve
l’uniforme donné aux officiers de paix,—ainsi que celui que portent
depuis longtemps les sergents de ville;—les fonctions de police
deviendraient honorables et honorées—si cette mesure était
universelle,—et si la police cessait d’agir par guet-apens.
![]() CHAPITRE TROP LONG.—Dans le premier numéro des Guêpes, publié,
il y a plus d’un an et demi, j’ai expliqué la position que s’est faite
le gouvernement actuel vis-à-vis de la presse;—je n’empêche pas de
relire ce chapitre les personnes qui veulent avoir un résumé vrai et
impartial de cette position si bêtement et si volontairement choisie. Si
j’en parle aujourd’hui, c’est que j’ai à traiter cette question sous un
autre point de vue. J’ai dit que les entraves mises à la presse
faisaient une partie de sa puissance, et je l’ai prouvé, je crois, d’une
façon claire et péremptoire.—J’ajoute que la seule ressource
aujourd’hui de la royauté de Juillet,—son dernier et unique moyen de
lutter contre la presse, qui l’attaque avec plus d’audace et
d’acharnement qu’elle ne l’a jamais fait contre Charles X,—serait de
changer brusquement son système et de promulguer une loi ainsi conçue:
CHAPITRE TROP LONG.—Dans le premier numéro des Guêpes, publié,
il y a plus d’un an et demi, j’ai expliqué la position que s’est faite
le gouvernement actuel vis-à-vis de la presse;—je n’empêche pas de
relire ce chapitre les personnes qui veulent avoir un résumé vrai et
impartial de cette position si bêtement et si volontairement choisie. Si
j’en parle aujourd’hui, c’est que j’ai à traiter cette question sous un
autre point de vue. J’ai dit que les entraves mises à la presse
faisaient une partie de sa puissance, et je l’ai prouvé, je crois, d’une
façon claire et péremptoire.—J’ajoute que la seule ressource
aujourd’hui de la royauté de Juillet,—son dernier et unique moyen de
lutter contre la presse, qui l’attaque avec plus d’audace et
d’acharnement qu’elle ne l’a jamais fait contre Charles X,—serait de
changer brusquement son système et de promulguer une loi ainsi conçue:
Art. 1er.—La presse est libre fiscalement;—le cautionnement et le timbre sont supprimés;
Art. 2.—La presse est libre moralement:—chacun peut exprimer sa pensée, quelle qu’elle soit;—aucune action ne sera dirigée contre un journal;
Art. 3.—Chaque article sera signé du nom réel de son auteur;
Art. 4.—Chaque journal sera tenu d’insérer toute réponse qu’il plaira de lui faire à toute personne nommée dans un de ses articles.—Cette réponse ne devra pas être plus du double de l’article où la personne aura été nommée.
![]() Je vais développer et défendre chacun de ces quatre articles en peu
de mots.
Je vais développer et défendre chacun de ces quatre articles en peu
de mots.
Art. 1er.—La presse est libre fiscalement:—le cautionnement et le timbre sont supprimés...
J’ai dit la maladresse d’avoir imposé aux journaux des conditions pécuniaires qui les ont mis aux mains des marchands et qui ont réuni plusieurs nuances d’opinions dans une seule couleur,—condition même nécessaire pour l’existence de feuilles qui ne pourraient sans cela réunir un nombre suffisant d’abonnés pour couvrir leurs frais.
Le cautionnement et le timbre abolis, chaque couleur se décomposera en toutes ses nuances. L’écrivain qui, pour exprimer ses idées, était obligé de s’affilier à un journal où on lui donnait asile au prix du sacrifice d’une partie de ces mêmes idées,—sacrifice auquel il ne se résignait que par impuissance pécuniaire,—lèvera son propre étendard,—des essaims nombreux partiront des plus grosses ruches.
Les journaux, vingt fois plus nombreux, se partageront et se diviseront le même nombre d’abonnés;—chacun n’aura que les gens qui pensent comme lui—et n’aura plus de ces gens si nombreux qui, plus près de lui que d’une autre couleur, se rapprochent encore de lui, faute de nuances intermédiaires,—et se laissent peu à peu entraîner.
![]() Art. 2.—La presse est libre moralement:—chacun peut exprimer sa
pensée, quelle qu’elle soit;—aucune action ne sera dirigée contre un
journal.
Art. 2.—La presse est libre moralement:—chacun peut exprimer sa
pensée, quelle qu’elle soit;—aucune action ne sera dirigée contre un
journal.
Avant de crier à l’énormité, faites-moi le plaisir d’examiner avec moi le résultat des lois répressives accumulées contre la presse.
Il n’y a pas une de ces lois qui ne soit éludée.—Il s’établit entre un journal et ses lecteurs un argot parfaitement clair, formé de réticences et de synonymes—qui permet de tout dire et de tout entendre sans danger.—Il n’y a que les maladroits de pris.
Il est défendu d’attaquer le roi,—mais il n’est pas défendu d’attaquer QUELQU’UN,—ni une PERSONNE INFLUENTE,—ni le TRÔNE,—ni la COURONNE,—ni le POUVOIR,—ni une HAUTE INFLUENCE,—ni le CHATEAU,—ni mille autres synonymes—qui obligeraient nos quatre cent cinquante faiseurs de lois à travailler en permanence.
![]() Semblables à ce maire d’une petite ville qui défendit à ses
administrés de sortir sans lanterne après neuf heures du soir.
Semblables à ce maire d’une petite ville qui défendit à ses
administrés de sortir sans lanterne après neuf heures du soir.
Le lendemain de la promulgation de l’ordonnance,—on amène à M. le maire un individu arrêté par une patrouille.
—Ne connaissez-vous pas l’ordonnance?
—Si, vraiment.
—Eh bien! où est votre lanterne?
—La voilà.
—Mais il n’y a pas de chandelle dedans!
—L’ordonnance n’en parle pas.
—C’est bien. Allez-vous-en.
Le maire se remet à l’ouvrage,—et promulgue un erratum—par lequel est expliqué qu’on doit porter une lanterne avec une chandelle dedans.
Le lendemain,—on amène un récalcitrant.
—Eh! Dieu me pardonne! c’est encore vous?
—Oui, monsieur le maire.
—Vous saviez pourtant la nouvelle ordonnance?
—Oui, monsieur le maire.
—Eh bien! où est votre lanterne?
—La voici.
—Et la chandelle?
—La voici.
—Mais elle n’est pas allumée!
—L’ordonnance n’en dit pas un mot.
Il fallut encore relâcher le réfractaire—et publier un nouvel erratum, qui annonçait que la chandelle devait être allumée.
Le dernier des synonymes au moyen desquels on traite, comme vous savez, le roi Louis-Philippe, mon illustre ami,—selon le National, le Journal du Peuple, et divers autres carrés de papier,—a été inventé par Me Partarrieu-Lafosse, dans le procès des lettres attribuées au roi.—Cet honorable accusateur public ayant eu, entre autres saugrenuités, le malheur d’établir une niaise et puérile distinction entre Louis-Philippe, duc d’Orléans, et Louis-Philippe, roi de France,—la presse s’en est emparée, et, parodiant, d’après le ministère public, le mot d’un autre duc d’Orléans devenu roi de France:—«Qu’il n’appartient pas au roi de France de venger les injures faites au duc d’Orléans,»—elle s’en donne à cœur joie sur ce sujet,—en éludant une loi dont l’extension ne pourrait lui être appliquée sans qu’on commençât par faire le procès à ce malencontreux Me Partarrieu-Lafosse;—et les journaux opposants jouent, à l’abri de la loi, depuis un mois, d’incessantes variations sur ce thème:—Louis-Philippe, duc d’Orléans, est un ci,—est un là,—et un pis encore...—le tout soit dit sans attaquer la personne de Louis-Philippe, roi de France.
![]() Ainsi donc les lois coërcitives de la presse ne préviennent rien et
ne réparent rien;—elles ne font que donner à l’expression de la pensée
des journaux un nouvel attrait de variété,—d’audace et
d’adresse,—trois choses qui ont beaucoup de partisans,—qui se laissent
facilement accoquiner au parti qui les possède ou qui paraît les
posséder.
Ainsi donc les lois coërcitives de la presse ne préviennent rien et
ne réparent rien;—elles ne font que donner à l’expression de la pensée
des journaux un nouvel attrait de variété,—d’audace et
d’adresse,—trois choses qui ont beaucoup de partisans,—qui se laissent
facilement accoquiner au parti qui les possède ou qui paraît les
posséder.
La presse libre n’aurait plus de prétexte pour la guerre de buissons qu’elle fait au pouvoir.—Chaque journal serait obligé de dire tout haut ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas;—on combattrait alors à découvert et en plaine.
![]() Art. 3.—Chaque article sera signé du nom réel de son auteur.
Art. 3.—Chaque article sera signé du nom réel de son auteur.
Ceci est une garantie qu’aucun homme qui prétend à la loyauté n’a le droit de refuser, du moins tout haut;—cela arrache à la presse ce prestige mystérieux si connu des anciennes royautés de l’Orient,—qui a, pour un journaliste, l’avantage de le dérober aux représailles d’agression et de personnalités,—masque dont la suppression forcera l’écrivain de se fixer à l’égard des autres les bornes qu’il désirera pour lui même, et donnera à chaque article sa valeur réelle,—en laissant voir que tel qui parle si haut de moralité et exerce une inquisition si sévère dans la maison de verre que la presse, retirée prudemment dans ses sombres cavernes, a faite à tous ceux qui ne sont pas avec elle,—a eu bien du mal, après un souper trop prolongé, à retrouver la porte de l’imprimerie où il venait la plume à la main exiger d’autrui toutes les perfections et toutes les vertus dont la liste est d’autant plus longue qu’elle se compose de celles qui lui manquent.
![]() Art. 4.—Chaque journal sera tenu d’insérer, etc.
Art. 4.—Chaque journal sera tenu d’insérer, etc.
Cet article existe déjà dans la loi, mais d’une manière vague qui permet de l’éluder sans cesse.—Nettement exprimé, il épargnerait au gouvernement le coq-à-l’âne volontaire, perpétuel et grotesque par lequel il se justifie sans cesse devant des gens qui ne savent rien des choses dont on l’accuse, et n’a aucun moyen de parvenir à ceux qui ont entendu l’accusation.
![]() RENSEIGNEMENTS UTILES AUX GENS D’AVIGNON.—Dans le numéro des
Guêpes du mois de mai dernier, il est fait mention d’un tableau de M.
Gudin qui, donné par le roi à la ville d’Avignon en 1836, n’était pas
encore arrivé à sa destination depuis cinq ans qu’il est en route.
RENSEIGNEMENTS UTILES AUX GENS D’AVIGNON.—Dans le numéro des
Guêpes du mois de mai dernier, il est fait mention d’un tableau de M.
Gudin qui, donné par le roi à la ville d’Avignon en 1836, n’était pas
encore arrivé à sa destination depuis cinq ans qu’il est en route.
Nous racontions, en outre, qu’on s’occupait activement de rechercher ce tableau égaré, de douze pieds de haut.
Jusqu’ici les recherches de messieurs de la liste civile et de leurs employés ont été inutiles.—Nous croyons pouvoir leur dire où est le tableau.
Le tableau est tranquillement accroché dans le musée de la ville de Douai.
Astarté,—une de nos Guêpes les plus vagabondes, prétend l’avoir parfaitement reconnu;—elle assure en outre que ce tableau, envoyé, sans autre avis, aux autorités de la ville de Douai, est resté six mois sans qu’on ouvrît la caisse qui le renfermait; enfin, au bout de ce temps, M. Quenson, conseiller à la cour royale,—grand amateur de peinture et quelque chose au musée,—prit sur lui d’ouvrir la caisse et de s’emparer,—pour le musée,—du tableau de Gudin, ne laissant aux gens d’Avignon que la reconnaissance pour le présent qu’ils n’ont pas reçu.
A MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE DE PARIS.
Paris.
![]() Note à l’appui de son discours dans lequel il tâche d’insinuer
adroitement au roi Louis-Philippe que, malgré la grandeur et la
vénération qui l’entourent, il ferait bien de se rappeler quelquefois
qu’il n’est qu’un homme.—Monseigneur, me promenant hier du côté de la
barrière de l’Étoile, j’ai vu les douaniers,—dits gabelous,—chargés
d’empêcher l’introduction frauduleuse des objets soumis au droit,
visiter les voitures de la maison du roi venant de Neuilly,—les
voitures attelées de mules de sa propre maison.
Note à l’appui de son discours dans lequel il tâche d’insinuer
adroitement au roi Louis-Philippe que, malgré la grandeur et la
vénération qui l’entourent, il ferait bien de se rappeler quelquefois
qu’il n’est qu’un homme.—Monseigneur, me promenant hier du côté de la
barrière de l’Étoile, j’ai vu les douaniers,—dits gabelous,—chargés
d’empêcher l’introduction frauduleuse des objets soumis au droit,
visiter les voitures de la maison du roi venant de Neuilly,—les
voitures attelées de mules de sa propre maison.
Agréez, monseigneur, etc.
![]() Suite des mots nouveaux introduits dans la langue française—par
MM. les membres du Club-Jockey.—Dead haet,—stags hund,—foal
stalkes,—comfort,—stud book.
Suite des mots nouveaux introduits dans la langue française—par
MM. les membres du Club-Jockey.—Dead haet,—stags hund,—foal
stalkes,—comfort,—stud book.
Une des bonnes plaisanteries de cette époque est, sans contredit, l’invention de mademoiselle Rachel.—Mademoiselle Rachel est une fille qui récite les vers assez juste,—et qui a réussi par la froideur et la sécheresse—comme il y a quelques années d’autres ont réussi par les cris, le désordre et l’exagération, et uniquement par la même raison,—c’est-à-dire parce que c’était autre chose.
Il ne faut croire qu’une petite partie des ridicules extravagances que certains journaux prêtent à nos voisins au sujet de ladite Rachel,—et de ces extravagances, ce qui est vrai a pour cause la morgue des Anglais, qui, ayant lu dans nos journaux les ridicules déclamations dont elle a été le prétexte, veulent nous surpasser dans l’admiration même de ce qu’ils ne comprennent pas.—Du reste ces récits se font à Paris.
![]() Un journal a dit que la reine avait donné à la comédienne un
bracelet avec ces mots:—VICTORIA A RACHEL.
Un journal a dit que la reine avait donné à la comédienne un
bracelet avec ces mots:—VICTORIA A RACHEL.
Douce et touchante intimité qui dépasse de bien loin celle que Henry Monnier, dans ses rêves démocratiques, voulait voir s’établir entre les fils de pairs de France et les marchands de peau de lapin.
Encore un peu, et les reines de théâtre n’accepteront plus les airs de familiarité que se donnent les reines du monde.
Voyez,—monseigneur Affre,—archevêque de Paris,—voici un sujet digne de vos méditations.—Voyez les comédiens, race autrefois proscrite,—voyez-les régner seuls aujourd’hui sur les peuples, qui ont pris au sérieux leur couronne de papier, et recevoir tous les hommages en place des rois véritables, qui ont en échange hérité de leur opprobre.—S’il est des gens, monseigneur, qu’il faut rappeler au souvenir de la condition humaine,—ce sont les comédiennes et les danseuses,—dont les peuples si fiers d’avoir brisé le joug des rois tiennent à honneur de traîner les carrosses,—tandis que maintenant, s’il est un état avili et avilissant,—c’est celui de ces anciens maîtres de la terre.
![]() Tel dans sa farouche indépendance et dans son dédain ne rend pas le
salut au roi de France,—qui se fait gloire de s’atteler au fiacre d’une
danseuse en sueur—et dispute à coups de coudes l’honneur d’être plus
près du timon dans cet attelage grotesque.
Tel dans sa farouche indépendance et dans son dédain ne rend pas le
salut au roi de France,—qui se fait gloire de s’atteler au fiacre d’une
danseuse en sueur—et dispute à coups de coudes l’honneur d’être plus
près du timon dans cet attelage grotesque.
Encouragez donc encore le peuple à reconquérir,—dans les luttes et le sang,—une liberté dont la dignité l’embarrasse si fort,—qu’après avoir arraché violemment aux rois les marques de servilité qu’il leur a rendues si longtemps,—il conserve ces priviléges dans la tradition la plus pure—pour les reporter aux pieds des danseuses,—seules aimées, seules honorées aujourd’hui, sans qu’il s’élève personne pour crier du milieu de ces triomphes ridicules—que la plus belle, la plus habile, la plus adorée, la plus fêtée des danseuses—n’est pas digne d’entrer dans la mansarde de la plus humble des femmes d’ouvrier.
Et vous voulez que le peuple se moralise—quand vous offrez à ses filles de pareils exemples,—quand vous lui montrez qu’il n’y a d’heureuses, d’aimées, de riches, que celles d’entre elles qui, renonçant à toute la pudeur, à toutes les charges et à tous les devoirs de leur sexe, ont pour état de gambader nues devant un public enthousiaste!
![]() Ne faites plus de grandes phrases avec les grands mots de joug
brisé, de fers rompus.—Allons donc,—les hommes ne sont pas des
esclaves,—ce n’est pas vrai,—ils se flattent,—ce sont des domestiques
volontaires—qui aiment à changer de place et de maître.
Ne faites plus de grandes phrases avec les grands mots de joug
brisé, de fers rompus.—Allons donc,—les hommes ne sont pas des
esclaves,—ce n’est pas vrai,—ils se flattent,—ce sont des domestiques
volontaires—qui aiment à changer de place et de maître.
![]() Certes, si je m’intéressais autrement à ces choses—je féliciterais
les conseils de mademoiselle Rachel du tact et de l’à-propos avec
lesquels ils lui ont fait choisir la pièce de Marie Stuart pour sa
représentation à bénéfice:—on sait l’admiration des Anglais pour
Élisabeth, qu’ils appellent leur reine vierge;—ils prétendent avec
indignation que l’histoire est tronquée dans cette tragédie, qui n’a eu
aucun succès.
Certes, si je m’intéressais autrement à ces choses—je féliciterais
les conseils de mademoiselle Rachel du tact et de l’à-propos avec
lesquels ils lui ont fait choisir la pièce de Marie Stuart pour sa
représentation à bénéfice:—on sait l’admiration des Anglais pour
Élisabeth, qu’ils appellent leur reine vierge;—ils prétendent avec
indignation que l’histoire est tronquée dans cette tragédie, qui n’a eu
aucun succès.
Un journaliste a dit: «Pendant toute la soirée les Anglais ont eu l’air de comprendre,—l’Hospitalité.»
![]() A MM. DE LA QUOTIDIENNE.—Messieurs du journal la Quotidienne ont
eu la bonté de vouloir bien prendre quelques pages dans les Guêpes
pour les insérer dans leurs colonnes:—ils ont bien voulu faire précéder
ce fragment de quelques mots plus ou moins obligeants,—voici le moins
obligeant—M. Karr assure n’appartenir à aucun parti.
A MM. DE LA QUOTIDIENNE.—Messieurs du journal la Quotidienne ont
eu la bonté de vouloir bien prendre quelques pages dans les Guêpes
pour les insérer dans leurs colonnes:—ils ont bien voulu faire précéder
ce fragment de quelques mots plus ou moins obligeants,—voici le moins
obligeant—M. Karr assure n’appartenir à aucun parti.
Assure est, messieurs, un mot un peu jésuitique,—surtout au moment où vous donniez vous-mêmes une preuve assez évidente de la vérité de mon assertion.
Une bonne preuve, messieurs, je crois, que je n’appartiens pas aux partis opposés au vôtre,—c’est que vous ne manquez guère de m’emprunter chaque mois des fragments assez longs. Une preuve, non moins bonne, que je n’appartiens pas non plus à votre parti, c’est que vous avez soin de tronquer ces fragments et d’en élaguer parfois des phrases qui vous embarrasseraient.
A propos, messieurs,—comment vous qui niez si fort la famille régnante,—et, à votre point de vue, cela se comprend,—vous qui appelez le prince royal duc de Chartres, pour montrer avec quelle sollicitude vous gardez à son père le titre de duc d’Orléans, voici une phrase qu’on vous fait mettre pour trois francs aux annonces,—phrase qui a pour but incontestable de donner comme attrait à une ville de bains la présence probable d’une princesse de cette maison:
«On parle du voyage de madame la duchesse de Nemours—aux eaux minérales de Forges,—où sont allés depuis Louis XIII, en le comptant, la plupart des membres de la famille royale de France.»
Je vous assure, messieurs, que je ne fais pas de ces choses-là.
![]() Arrêté d’une administration philanthropique.—Considérant que
l’orphelin N... s’est échappé de chez son maître, pour aller se
réfugier chez son père;
Arrêté d’une administration philanthropique.—Considérant que
l’orphelin N... s’est échappé de chez son maître, pour aller se
réfugier chez son père;
Qu’il importe de prendre les mesures nécessaires pour ramener ce jeune homme à de meilleurs sentiments, etc...
Arrête:
L’enfant N... sera renfermé six mois, à titre de correction paternelle, dans une maison de détention, etc., etc.
![]() Un monsieur a trouvé plaisant,—pendant qu’on célébrait la
Fête-Dieu à Auteuil, d’allumer son cigare à un cierge.—Je ne pense pas
qu’un chétif animal comme l’homme ait le pouvoir d’offenser Dieu; mais
ce genre de facétie a pour inconvénient d’offenser tous les gens qui
suivent une procession;—ledit monsieur a pu s’en apercevoir: quatre
femmes se sont saisies de lui et l’ont si considérablement houspillé,
qu’il est probable qu’il cherchera à l’avenir d’autres distractions.
Un monsieur a trouvé plaisant,—pendant qu’on célébrait la
Fête-Dieu à Auteuil, d’allumer son cigare à un cierge.—Je ne pense pas
qu’un chétif animal comme l’homme ait le pouvoir d’offenser Dieu; mais
ce genre de facétie a pour inconvénient d’offenser tous les gens qui
suivent une procession;—ledit monsieur a pu s’en apercevoir: quatre
femmes se sont saisies de lui et l’ont si considérablement houspillé,
qu’il est probable qu’il cherchera à l’avenir d’autres distractions.
![]() L’OPÉRA.—On a joué à l’Opéra le Freyschütz de Weber;—cet
ouvrage est massacré par les transpositions du fait des acteurs; il y a
un trio qui fait pitié: madame Stoltz en a tant baissé le ton, qu’elle
chante dans son busc,—ce qui oblige Boucher à chanter dans sa barbe et
Marié à chanter dans ses bottes.
L’OPÉRA.—On a joué à l’Opéra le Freyschütz de Weber;—cet
ouvrage est massacré par les transpositions du fait des acteurs; il y a
un trio qui fait pitié: madame Stoltz en a tant baissé le ton, qu’elle
chante dans son busc,—ce qui oblige Boucher à chanter dans sa barbe et
Marié à chanter dans ses bottes.
Il y avait un pas contre lequel la pudeur du public s’est révoltée. Ces nouveaux pas excitent l’indignation des dames du faubourg Saint-Germain, qui ne veulent plus mener leurs filles au ballet;—mais, en revanche, vont tous les soirs à Franconi, où les dames écuyères trouvent moyen de montrer au moins autant que les danseuses, et de plus près.—Il y a surtout une certaine danse de cerceau, où le cerceau accroche fréquemment les jupes déjà si diaphanes et les maintient en l’air un temps plus que raisonnable.
![]() Irrité du vote courageux du duc d’Orléans, à la Chambre des pairs,
contre la loi du recrutement,—le vieux Soult-Spire—s’est mis à bouder
et à offrir sa démission.—Alors grande terreur au château (mon ami,
selon le National, le Journal du Peuple et autres carrés de papier):
on a envoyé demander au président du conseil s’il voulait pardonner à la
mauvaise tête du jeune homme;—on lui a offert en outre d’envoyer son
fils, le marquis de Dalmatie, en ambassade à Rome ou à Vienne. La
seconde destination est une excellente bouffonnerie.—On sait assez que
jamais à Vienne on n’a voulu reconnaître ni admettre les noms de
bataille donnés par Napoléon à ses généraux.—Mais, dans cette occasion,
c’est encore mieux, parce que l’empereur d’Autriche, dans ses titres, se
nomme duc de Dalmatie.
Irrité du vote courageux du duc d’Orléans, à la Chambre des pairs,
contre la loi du recrutement,—le vieux Soult-Spire—s’est mis à bouder
et à offrir sa démission.—Alors grande terreur au château (mon ami,
selon le National, le Journal du Peuple et autres carrés de papier):
on a envoyé demander au président du conseil s’il voulait pardonner à la
mauvaise tête du jeune homme;—on lui a offert en outre d’envoyer son
fils, le marquis de Dalmatie, en ambassade à Rome ou à Vienne. La
seconde destination est une excellente bouffonnerie.—On sait assez que
jamais à Vienne on n’a voulu reconnaître ni admettre les noms de
bataille donnés par Napoléon à ses généraux.—Mais, dans cette occasion,
c’est encore mieux, parce que l’empereur d’Autriche, dans ses titres, se
nomme duc de Dalmatie.
On a, dit-on,—dépêché à Vienne un envoyé extraordinaire pour savoir si on s’arrangerait d’un changement de nom,—ce qui serait tout à fait misérable.
Des gens bien en cour—ont eu le malheur de trouver cela tout simple et de dire: «Mais, au fait, pourquoi l’appellerait-on autrement que monsieur l’ambassadeur de France?»
Les villes de province ne savent plus si elles font encore partie de la France,—qui, grâce à M. Thiers,—aux Chambres et à S. M. Louis-Philippe,—est désormais un pays borné,
Au levant par Charenton,
A l’ouest par le bois de Boulogne,
Au nord par Montmartre,
Au midi par Montrouge.
Aussi, beaucoup d’entre ces villes, n’espérant rien du présent ni de l’avenir,—se mettent en mesure de régler leurs comptes avec l’histoire de France.—On érige des monuments aux grands hommes morts,—à Duguesclin,—à Latour-d’Auvergne, etc.—Quoiqu’ils soient morts depuis assez longtemps, on ne s’en était pas encore avisé jusqu’ici.—Mais il n’y a de grandeur que par la comparaison,—et jamais on n’avait si bien remarqué la grandeur des morts:—c’est qu’on n’avait jamais vu de si petits vivants.
![]() M. de Lamartine a publié des vers pleins à la fois de raison et
d’un sentiment élevé;—il a eu l’adresse et l’abnégation de glisser dans
son œuvre quelques mauvaises strophes pour engager à en parler même
ceux qui sont mal disposés ou pour lui ou pour ses opinions,—et à
répandre par là des idées bonnes et utiles.—Certes, de cette courageuse
tentative contre ces idées rétrécies—qui ferait croire que l’homme n’a
inventé l’amour de la patrie, c’est-à-dire d’une petite partie de la
terre et des hommes, que pour se mettre à son aise dans sa méchanceté et
haïr tranquillement tout le reste,—je dirais plus de bien que je n’en
dis, si je n’avais, il y a bientôt un an, pris l’initiative, et traité
cette question dans les Guêpes (octobre 1840).
M. de Lamartine a publié des vers pleins à la fois de raison et
d’un sentiment élevé;—il a eu l’adresse et l’abnégation de glisser dans
son œuvre quelques mauvaises strophes pour engager à en parler même
ceux qui sont mal disposés ou pour lui ou pour ses opinions,—et à
répandre par là des idées bonnes et utiles.—Certes, de cette courageuse
tentative contre ces idées rétrécies—qui ferait croire que l’homme n’a
inventé l’amour de la patrie, c’est-à-dire d’une petite partie de la
terre et des hommes, que pour se mettre à son aise dans sa méchanceté et
haïr tranquillement tout le reste,—je dirais plus de bien que je n’en
dis, si je n’avais, il y a bientôt un an, pris l’initiative, et traité
cette question dans les Guêpes (octobre 1840).
![]() —J’en appelle à la postérité, disait l’autre jour un poëte
tombé,—je récuse un public de tailleurs.
—J’en appelle à la postérité, disait l’autre jour un poëte
tombé,—je récuse un public de tailleurs.
—Hélas! monsieur,—lui répondit quelqu’un en ouvrant la fenêtre,—voyez ces enfants qui jouent aux billes dans la cour: voilà ceux qui seront la postérité.—Les tailleurs d’aujourd’hui, dont vous vous plaignez, sont la postérité tant réclamée par les poëtes sifflés il y a cinquante ans.—En appeler à la postérité, c’est en appeler des tailleurs d’aujourd’hui aux bottiers de l’avenir.
![]() Je n’ai aucune raison de ne pas dire que ce mois-ci je m’amuse
énormément à propos des journaux et de la Fête-Dieu.—L’année dernière
déjà la même circonstance m’avait procuré quelque distraction,—comme en
peut faire foi le volume des Guêpes de juillet 1840,—où il est
question de M. Roussel, chef de bataillon de la garde nationale de la
petite commune de Montreuil.
Je n’ai aucune raison de ne pas dire que ce mois-ci je m’amuse
énormément à propos des journaux et de la Fête-Dieu.—L’année dernière
déjà la même circonstance m’avait procuré quelque distraction,—comme en
peut faire foi le volume des Guêpes de juillet 1840,—où il est
question de M. Roussel, chef de bataillon de la garde nationale de la
petite commune de Montreuil.
Plusieurs de ces bons carrés de papier racontent avec indignation que dans plusieurs villes de province—on a osé faire des processions à l’occasion de la Fête-Dieu, et que les soldats commandés pour l’escorte ont rendu au dais les honneurs ordinaires. «Nous voilà donc en pleine Restauration!» s’écrient ces organes vénérés de l’opinion publique.
![]() J’ai eu longtemps pour domestique un Indien fort noir auquel je
m’avisai un jour de demander—de quelle religion il était.
J’ai eu longtemps pour domestique un Indien fort noir auquel je
m’avisai un jour de demander—de quelle religion il était.
—Je ne sais pas.
—Qu’est-ce que tu adores?
—Oh! chez nous, nous adorons le soleil.
—Et ici?
—Ici nous n’adorons rien.
Ceci me paraît un catéchisme qui obtiendrait facilement l’approbation de M. Chambolle—et une religion peu chargée de dogmes,—fort convenable,—selon les carrés de papier précités,—pour devenir la religion de la majorité des Français.
Malheureusement pour ces doctrines, il y a chez l’homme un instinct qui le pousse invinciblement à la vénération,—et il faut qu’il adore quelque chose, quand il devrait, comme certains bonzes, adorer son propre nombril.
Il est à remarquer que les plus grands génies—sont ceux qui acceptent le plus sincèrement le culte de la Divinité,—par cela qu’un peu plus rapprochés d’elle que le vulgaire, s’ils ne voient pas Dieu—face à face—ils aperçoivent quelques-uns des rayons de la lumière qui émane de lui.
Les carrés de papier philosophiques—ont une doctrine fixe à l’égard des choses de la religion.—Quand le fils aîné du roi a épousé une princesse protestante,—ils ont parlé de notre sainte religion.—Peu s’en est fallu que M. Jay, du Constitutionnel, ne se mît à prêcher une croisade comme un nouveau Pierre l’Ermite, et que la rédaction en masse de cette feuille ne prît la croix rouge.
Mais, quand il s’agit de quelque cérémonie catholique—approuvée par l’autorité,—ils crient alors au cagotisme et aux jésuites avec une nouvelle fureur,—et maltraitent fort le bon Dieu, parce qu’ils le croient une créature du préfet de police.
Mais, comme je le disais tout à l’heure, il y a dans l’homme un besoin de vénération qui l’entraîne malgré lui,—et, si vous lui ôtez Dieu, qui, après tout, est au moins un prétexte honnête d’exercer ce sentiment, vous pouvez voir avec un peu d’attention qu’il se reportera sur d’autres objets, sur des comédiennes jaunes, sur des danseuses vertes, etc., etc.
Et, quelques torts que puisse avoir l’Être suprême,—comme je le crois volontiers,—envers M. Jay, du Constitutionnel,—M. Chambolle, du Siècle,—M. Léon Faucher, du Courrier Français, etc., ces messieurs seront forcés d’avouer que, religion pour religion, puisque l’homme est ainsi fait qu’il lui en faille une absolument, il valait autant s’en tenir à l’ancienne,—jusqu’à ce qu’à force de progrès on en vienne à tendre les maisons et à joncher les rues de fleurs à certains jours consacrés aux susdits MM. Jay, Chambolle et Léon Faucher.
Du reste, on peut voir par les clameurs des journaux,—en quoi je leur reprocherai de manquer d’adresse,—ce que ces braves papiers entendent par la liberté. Ils ont commencé par demander qu’on ne fût pas forcé d’aller à la messe, et ils avaient raison;—maintenant ils ne veulent plus permettre qu’on y aille;—en quoi j’ai raison, à mon tour, quand je dis que tous ces fervents apôtres de liberté n’attaquent les tyrannies et les abus—que comme on attaque certaines villes, non pour les détruire, mais pour s’en emparer et s’y installer à leur tour.
Au commencement de la saison, du reste,—on aurait dit que Dieu allait célébrer sa fête lui-même en se donnant un petit régal de vengeance. Les fleuves sont sortis de leurs lits et ont un moment supprimé des provinces tout entières,—puis, un peu plus tard, avec une ironie plus poignante, il a fait retirer les fleuves et a livré les hommes à des adversaires grotesques: il a paru un instant que les hannetons et les chenilles allaient manger en herbe les fruits et les moissons; et je ne sais alors ce qu’eussent fait les hommes—quelque protégés qu’ils eussent été par les carrés de papier auxquels ils sont abonnés:—ne pas oublier de renouveler avant le 15 courant.
![]() On a joué avec grand succès, à l’Opéra, un très-joli ballet de MM.
Th. Gautier et Saint-Georges,—sous le nom de Giselle ou les
Willis.—On a applaudi avec raison un clair de lune de M. Cicéri.—Je
ne vois pas pourquoi je ne dirais pas que j’ai publié, il y a sept ou
huit ans,—dans un volume appelé Vendredi soir,—un petit roman d’une
vingtaine de pages sur cette tradition allemande.
On a joué avec grand succès, à l’Opéra, un très-joli ballet de MM.
Th. Gautier et Saint-Georges,—sous le nom de Giselle ou les
Willis.—On a applaudi avec raison un clair de lune de M. Cicéri.—Je
ne vois pas pourquoi je ne dirais pas que j’ai publié, il y a sept ou
huit ans,—dans un volume appelé Vendredi soir,—un petit roman d’une
vingtaine de pages sur cette tradition allemande.
![]() On dit que M. Ancelot est fâché d’être de l’Académie.—Il ne peut
plus se mettre sur les rangs, lui qui en avait une si longue habitude,
qu’apprenant la mort de M. de Cessac, il a fait une visite à M. de
Pongerville, et que ce n’est qu’après un quart d’heure de conversation
qu’il s’est rappelé tout à coup qu’il n’avait plus rien à demander à son
mielleux confrère.
On dit que M. Ancelot est fâché d’être de l’Académie.—Il ne peut
plus se mettre sur les rangs, lui qui en avait une si longue habitude,
qu’apprenant la mort de M. de Cessac, il a fait une visite à M. de
Pongerville, et que ce n’est qu’après un quart d’heure de conversation
qu’il s’est rappelé tout à coup qu’il n’avait plus rien à demander à son
mielleux confrère.
![]() Sitôt qu’il y a de l’argent quelque part, il se rue dessus une
foule avide et insatiable.—A peine le crédit a-t il été accordé au
ministère pour les dépenses de la cérémonie funèbre de Napoléon,—que
les prétentions les plus saugrenues sont arrivées au ministère de
l’intérieur.
Sitôt qu’il y a de l’argent quelque part, il se rue dessus une
foule avide et insatiable.—A peine le crédit a-t il été accordé au
ministère pour les dépenses de la cérémonie funèbre de Napoléon,—que
les prétentions les plus saugrenues sont arrivées au ministère de
l’intérieur.
Tel veut qu’on lui rembourse le bénéfice qu’il a manqué de faire ce jour-là.—Du Havre à Paris, tous les maires font des réclamations pour leur commune et demandent des indemnités.—Ici, une cloche a été fêlée par un sonneur trop enthousiaste: là, le marché a été dépavé par la foule accourue sur le passage du convoi.
![]() On cite un monsieur qui demande une indemnité pour son habit
déchiré dans la foule.
On cite un monsieur qui demande une indemnité pour son habit
déchiré dans la foule.
L’administration de l’Hôtel des Invalides demande sept à huit mille francs pour restaurer l’orgue de son église,—engorgé,—dit-elle,—par la poussière de la cérémonie.
Or, nous savons que cet instrument est depuis dix ans dans un tel état, qu’on n’a pas pu s’en servir une seule fois,—et l’invalide qui remplissait les fonctions d’organiste a été enterré il y a cinq ou six ans sans qu’on ait songé à le remplacer.
![]() Depuis la mort de M. de Cessac,—les sollicitations académiques ont
recommencé.
Depuis la mort de M. de Cessac,—les sollicitations académiques ont
recommencé.
Un ministre a envoyé une personne de confiance à un des quarante—pour le prier de ne pas promettre sa voix.
L’académicien a répondu au messager du ministre: «Vous direz à Son Excellence que j’ai pour elle la plus haute considération,—que je suis son tout dévoué serviteur, que je voterai comme elle le voudra,—qu’il faut qu’elle m’envoie mille francs.»
![]() Il y a quelques jours, un assassin était sur le banc de la cour
d’assises.—Les jurés, après une absence de quelques minutes, viennent
dire que l’accusé est coupable,—et cette fois, par hasard, sans
circonstances atténuantes.—Il est condamné à mort.—A ce moment, un
brave homme, dans l’audience, tombe subitement frappé d’apoplexie.—On
s’empresse,—on le ramasse,—on l’entoure, il est mort. «Est-ce le père
de l’assassin?—Non, il est plus jeune que lui.—Est-ce son fils?—Non,
il est presque de même âge.—Est-ce son ami?—Nullement, dit un jeune
homme en perçant la foule, il ne le connaissait pas,—c’est un curieux
comme vous et moi.»
Il y a quelques jours, un assassin était sur le banc de la cour
d’assises.—Les jurés, après une absence de quelques minutes, viennent
dire que l’accusé est coupable,—et cette fois, par hasard, sans
circonstances atténuantes.—Il est condamné à mort.—A ce moment, un
brave homme, dans l’audience, tombe subitement frappé d’apoplexie.—On
s’empresse,—on le ramasse,—on l’entoure, il est mort. «Est-ce le père
de l’assassin?—Non, il est plus jeune que lui.—Est-ce son fils?—Non,
il est presque de même âge.—Est-ce son ami?—Nullement, dit un jeune
homme en perçant la foule, il ne le connaissait pas,—c’est un curieux
comme vous et moi.»
C’était, en effet, un homme condamné à mort par le sort commun de tous les hommes, qui n’admet pas de circonstances atténuantes.
Justice humaine,—pauvre chose! la plus forte peine qu’elle puisse imposer est une peine que tous subissent fatalement, et les innocents qu’elle absout aussi bien que les criminels qu’elle condamne.
![]() A propos de circonstances atténuantes,—le jury de la cour
d’assises du Cantal vient de les appliquer avec un discernement égal à
celui du jury de la Seine.
A propos de circonstances atténuantes,—le jury de la cour
d’assises du Cantal vient de les appliquer avec un discernement égal à
celui du jury de la Seine.
Un homme de cinquante ans, ayant déjà subi six condamnations, se prend de querelle avec ses deux beaux-frères, et, en plein jour, les tue tous les deux à coups de fusil,—menace les témoins, dont un est son beau-père, de leur faire subir le même sort, puis retourne à son village, raconte, à qui veut l’entendre, le crime qu’il vient de commettre.—Le soir, il force un des habitants de lui donner une lanterne, avec laquelle il va froidement considérer ses victimes pendant plus d’une heure. Le jury du Cantal a vu là des circonstances atténuantes.
Décidément ceci est par trop...—Comment! l’assassin condamne, de son chef, deux hommes à mort,—et lui en est quitte pour les travaux forcés!—Toutes ces décisions forment autant d’encouragements dont on n’hésite pas à profiter.
![]() Un condamné politique, M. Charles Lagrange, soumis à la
surveillance,—s’est occupé à Mulhouse d’industrie et
d’affaires.—Aujourd’hui il arrive à Paris avec un passe-port en règle,
voyageant pour faire des observations dont il est chargé par une
compagnie sur le chemin de fer de Rouen.—On l’arrête pour rupture de
ban et on lui fait un procès.—C’est une sottise:—un homme qui
travaille, un homme qui s’occupe activement de gagner sa vie, n’est pas
un homme dangereux.—Il vaut bien mieux voir vos ennemis politiques
prendre ce sage parti que de les tenir en prison.—C’est mille fois plus
sûr pour vous.—Mais vous faites de la rigueur excessive, aussi bien que
de la faiblesse extrême, toujours à contre-temps.
Un condamné politique, M. Charles Lagrange, soumis à la
surveillance,—s’est occupé à Mulhouse d’industrie et
d’affaires.—Aujourd’hui il arrive à Paris avec un passe-port en règle,
voyageant pour faire des observations dont il est chargé par une
compagnie sur le chemin de fer de Rouen.—On l’arrête pour rupture de
ban et on lui fait un procès.—C’est une sottise:—un homme qui
travaille, un homme qui s’occupe activement de gagner sa vie, n’est pas
un homme dangereux.—Il vaut bien mieux voir vos ennemis politiques
prendre ce sage parti que de les tenir en prison.—C’est mille fois plus
sûr pour vous.—Mais vous faites de la rigueur excessive, aussi bien que
de la faiblesse extrême, toujours à contre-temps.
![]() M. Garnier-Pagès est mort;—c’était un homme d’esprit et de
talent,—qui a montré, en outre, de l’énergie, de la bonne foi et de la
loyauté, en se séparant des hommes et des journaux de son parti au sujet
des fortifications, contre lesquelles il s’est courageusement élevé, au
risque de perdre une partie de sa popularité; seule et triste récompense
des luttes qui ont usé le peu d’existence que la nature lui avait
donnée.—L’autorité a sagement évité toute manifestation de force
militaire au convoi du député du Mans,—où tout s’est passé avec ordre
et décence.
M. Garnier-Pagès est mort;—c’était un homme d’esprit et de
talent,—qui a montré, en outre, de l’énergie, de la bonne foi et de la
loyauté, en se séparant des hommes et des journaux de son parti au sujet
des fortifications, contre lesquelles il s’est courageusement élevé, au
risque de perdre une partie de sa popularité; seule et triste récompense
des luttes qui ont usé le peu d’existence que la nature lui avait
donnée.—L’autorité a sagement évité toute manifestation de force
militaire au convoi du député du Mans,—où tout s’est passé avec ordre
et décence.
![]() Mon ami *** rentrait tard chez lui,—près de la Madeleine; il
voit un enfant qui pleurait près d’un tas noir.
Mon ami *** rentrait tard chez lui,—près de la Madeleine; il
voit un enfant qui pleurait près d’un tas noir.
—Qu’as-tu, petit?
—Monsieur, j’ai peur.
—Qu’est-ce que c’est que ça qui est par terre?
—Monsieur, c’est mon oncle.
—Qu’a-t-il, ton oncle?
—Monsieur, il est un peu bu.
—Est-ce qu’il ne peut pas se relever?
—Je ne crois pas, monsieur,—je ne suis pas assez fort pour le ranger sur le côté, et il sera écrasé.
Et l’enfant se remit à pleurer.
*** prend l’oncle pour le traîner auprès du mur;—mais l’oncle se développe et dit:
—Allons chez nous.
—Où demeures-tu, petit?
—Telle rue,—tel numéro.
—Crois-tu que ton oncle puisse marcher?
—Il a essayé plusieurs fois, mais il est toujours tombé;—je ne suis pas assez fort pour le soutenir.
Il n’y avait pas là de voiture,—*** ajoute que c’était à peu près son chemin.—*** est de ces gens qui colorent une bonne œuvre de quelque prétexte pour ne pas avoir à en rougir.
Il prit l’oncle sous le bras,—et lui dit:
—Allons, mon brave,—en route!
L’oncle obéit machinalement, et commença à marcher, moitié dormant, moitié trébuchant.—Cependant le mouvement rendit un peu de lucidité à ses idées,—et il dit à ***:
—Vous êtes tout de même un bon enfant,—nous allons prendre quelque chose.
Et il désigna du doigt un marchand de vins dont la boutique était encore ouverte.
Mais, comme il s’aperçut que *** ne répondait pas à son invitation, il ajouta:
—C’est moi qui paye.
—Non, vous avez au moins assez bu,—marchons.
—Ah! c’est parce que je ne suis qu’un ouvrier que tu ne veux pas boire avec moi?—Tu méprises le peuple;—j’te vas crever la gueule!
—Allons, allons, marchons!
L’oncle retomba dans l’engourdissement pendant quelques minutes et suivit son conducteur;—mais bientôt, oubliant sa colère, il reprit en voyant une autre boutique:
—Vous êtes un bon enfant,—entrons là,—c’est moi qui paye.
Cette fois *** lui dit:
—Pas là,—j’en connais un qui a du petit blanc à douze.
—Où ça?
—Au bout de la rue.
—Eh ben! allons au petit blanc.
Arrivés au bout de la rue,—il s’arrêta et dit:
—Eh ben! où est-il, votre vin blanc?
—Je ne le retrouve plus.
—Ah! c’est parce que je suis un ouvrier;—eh ben! j’te vas casser la gueule!
—Toi, me casser la gueule!—Viens-y donc!—viens donc seulement avec moi au bout de la rue!
—Tout de suite—que j’y vas,—j’te vas corriger.
On se remet en marche.—Au bout de la rue, *** lui dit:
—Si tu veux venir encore un peu,—je m’y reconnais à présent, le petit blanc est au bout de la rue.
—Eh ben! allons.
Au bout de la rue, pas de vin blanc.—*** dit:
—C’est que la boutique est fermée.
—Tu me fais aller,—répond l’oncle,—j’te vas crever la gueule!
—Allons, je le veux bien;—viens au bout de la rue.
Et, de cette façon, *** ramena l’oncle jusque chez lui.
![]() Voici ce qu’on raconte de M. Eugène Delacroix et de l’architecte de
la Chambre des députés.
Voici ce qu’on raconte de M. Eugène Delacroix et de l’architecte de
la Chambre des députés.
M. Delacroix est allé le trouver et lui a dit: «—Je ne peux pas peindre sur votre plafond, il ne tient à rien, cela ne durera pas trois ans.
—Qu’est-ce que cela vous fait,—pourvu qu’on vous paye?»
M. Delacroix n’a pas cru devoir adopter ces principes d’art moderne et a fait recrépir le plafond à ses frais.
![]() POUR LES PAUVRES.—MM. de Noailles, Dupin aîné,—marquis d’Osmond,
comte Roy, Vassal,—Rousselin, Michault,—viennent de demander, par une
pétition, que les droits qui pèsent sur le charbon de terre et la
houille soient élevés de trente centimes à quatre-vingts centimes.
POUR LES PAUVRES.—MM. de Noailles, Dupin aîné,—marquis d’Osmond,
comte Roy, Vassal,—Rousselin, Michault,—viennent de demander, par une
pétition, que les droits qui pèsent sur le charbon de terre et la
houille soient élevés de trente centimes à quatre-vingts centimes.
C’est toujours le système absurde dont j’ai parlé le mois dernier à propos de la viande.
![]() Je demanderai d’abord pourquoi l’on protége et l’on encourage
plutôt une industrie qui nous fait payer le chauffage cher qu’une
industrie qui nous le donne à bon marché.
Je demanderai d’abord pourquoi l’on protége et l’on encourage
plutôt une industrie qui nous fait payer le chauffage cher qu’une
industrie qui nous le donne à bon marché.
![]() Si les intérêts de MM. les propriétaires de forêts et de MM. les
marchands de bois sont lésés, et s’ils ne peuvent cesser de l’être qu’en
élevant le prix du chauffage économique, tant pis pour MM. les
propriétaires de forêts et pour MM. les marchands de bois.
Si les intérêts de MM. les propriétaires de forêts et de MM. les
marchands de bois sont lésés, et s’ils ne peuvent cesser de l’être qu’en
élevant le prix du chauffage économique, tant pis pour MM. les
propriétaires de forêts et pour MM. les marchands de bois.
Ils sont à coup sûr moins nombreux que les pauvres consommateurs et les intérêts des consommateurs doivent passer avant les leurs.
![]() Que diraient-ils si un monsieur ayant chez lui du bois
d’acajou,—désirant le vendre pour le chauffage, voulait qu’on élevât
les droits sur le bois ordinaire, jusqu’à ce que ce bois coûtât aussi
cher que son bois d’acajou?
Que diraient-ils si un monsieur ayant chez lui du bois
d’acajou,—désirant le vendre pour le chauffage, voulait qu’on élevât
les droits sur le bois ordinaire, jusqu’à ce que ce bois coûtât aussi
cher que son bois d’acajou?
Cela leur paraîtrait absurde.
C’est précisément ce qu’ils demandent.
Mais,—au nom du ciel!—cessez donc,—ô philanthropes! de faire tant de phrases sur le peuple, et occupez-vous un peu de lui.—Ne demandez pas tant de droits électoraux,—et donnez-lui un peu plus de moyens de n’avoir ni faim ni froid.
Vous, messieurs de Noailles, Dupin aîné,—d’Osmond, Roy, Vassal, Rousselin, Michault,—vous, dont les noms sont cités entre ceux des plus riches habitants de la France, vous osez signer une demande qui aurait pour résultat de condamner au froid le plus insupportable des milliers de familles!
Vous n’avez donc jamais vu de pauvres ouvriers avec des femmes et des enfants demi-nus,—dans des chambres sans feu pendant les rigueurs de l’hiver, grelottant et pleurant,—pour que vous osiez tenter de leur enlever—en augmentant le prix d’un combustible heureusement moins cher,—le peu de secours qu’ils peuvent espérer contre les horribles souffrances du froid?
Ce que je demanderais, moi,—ce que j’ai demandé chaque fois que j’en ai trouvé l’occasion,—ce serait le contraire;—ce serait de reporter les droits sur le luxe,—ce serait de dégrever tout ce qui est destiné au peuple et aux pauvres.—Quel bonheur, messieurs, que cela ne puisse rien vous rapporter!—Vous feriez mettre des droits sur le soleil,—sous prétexte que le peuple, l’ayant pour rien, achète moins de bois de vos riches forêts.
Les anniversaires.—Paris et Toulouse.—Les trois journées de Toulouse.—M. Floret.—M. Plougoulm.—M. Mahul.—M. de Saint-Michel.—Ce qu’en pensent Pascal, Rabelais et M. Royer-Collard.—Un quatrain.—Le peuple et l’armée.—Les Anglais.—Un pensionnat à la mode.—Les maîtres d’agrément.—A monseigneur l’archevêque de Paris.—Un projet de révolution.—Un baptême.—Une lettre de M. Dugabé.—Le berceau du gouvernement représentatif.—En faveur d’un ancien usage, excepté M. Gannal.—Parlons un peu de M. Ingres.—Un chat et quatre cents souris.—Le roi et les archevêques redevenus cousins.—A M. le vicomte de Cormenin.—M. Thiers en Hollande.—Contre l’eau.—MM. Mareschal et Souchon.—Les savants et le temps qu’il fait.—Les citoyens les plus honorables de Lévignac, selon M. Chambolle.—Triste sort d’un prix de vertu.—De l’héroïsme.—La science et la philanthropie.—Les médailles des peintres.—Les ordonnances de M. Humann.—De l’homicide légal.—AM RAUCHEN sur le bonheur.
![]() AOUT.—LES ANNIVERSAIRES.—Les Français, selon moi, ne se défient
pas assez des anniversaires, qui ont le défaut de les mettre dans de
singulières contradictions.
AOUT.—LES ANNIVERSAIRES.—Les Français, selon moi, ne se défient
pas assez des anniversaires, qui ont le défaut de les mettre dans de
singulières contradictions.
Voici, par exemple, dans le mois de juillet qui vient de finir,—des gens qui pourraient être fort embarrassés,—je parle du roi Louis-Philippe et du parti dont le journal le National est l’organe.
Le National a proclamé avec le roi et avec M. Thiers la nécessité de construire des forts contre lesquels il s’était élevé pendant plusieurs années;—j’ai dit,—quand il a été question de ces forts,—les raisons secrètes de chacun,—voici qu’aujourd’hui on les bâtit grand train,—que le roi met lui-même la main à la besogne et se fait un véritable plaisir de poser la première pierre de chacun d’eux.
![]() Malheureusement, le National est obligé, le 14 juillet, de
célébrer l’anniversaire de la prise de la Bastille avec une emphase
convenable—au moment même où cette vieille Bastille, où l’on mettait de
temps en temps un Parisien ou deux,—est remplacée avantageusement,—du
consentement du National,—par un demi-quarteron de forts qui mettent
Paris tout entier et à la fois à la Bastille.
Malheureusement, le National est obligé, le 14 juillet, de
célébrer l’anniversaire de la prise de la Bastille avec une emphase
convenable—au moment même où cette vieille Bastille, où l’on mettait de
temps en temps un Parisien ou deux,—est remplacée avantageusement,—du
consentement du National,—par un demi-quarteron de forts qui mettent
Paris tout entier et à la fois à la Bastille.
![]() D’autre part, le roi Louis-Philippe, obligé de fêter avec pompe
l’anniversaire de l’émeute réussie qui l’a mis sur le trône,—est forcé
en même temps et précisément dans le même mois, de réprimer à Toulouse
l’insurrection dont il célèbre la fête à Paris.
D’autre part, le roi Louis-Philippe, obligé de fêter avec pompe
l’anniversaire de l’émeute réussie qui l’a mis sur le trône,—est forcé
en même temps et précisément dans le même mois, de réprimer à Toulouse
l’insurrection dont il célèbre la fête à Paris.
![]() C’est une bouffonnerie qui manquait à cette époque, que je crois à
présent fort complète.
C’est une bouffonnerie qui manquait à cette époque, que je crois à
présent fort complète.
![]() LES TROIS JOURNÉES DE TOULOUSE.—J’ai plusieurs fois parlé de la
haute bêtise qui a fait imaginer de ce temps-ci—l’indépendance des
fonctionnaires et l’intelligence des baïonnettes,—c’est-à-dire une
machine politique dont chaque rouage irait au hasard de sa volonté,—un
char de l’État,—pour parler le langage du Constitutionnel, dont
chacune des quatre roues—roulerait dans un sens particulier.
LES TROIS JOURNÉES DE TOULOUSE.—J’ai plusieurs fois parlé de la
haute bêtise qui a fait imaginer de ce temps-ci—l’indépendance des
fonctionnaires et l’intelligence des baïonnettes,—c’est-à-dire une
machine politique dont chaque rouage irait au hasard de sa volonté,—un
char de l’État,—pour parler le langage du Constitutionnel, dont
chacune des quatre roues—roulerait dans un sens particulier.
M. Floret,—préfet de Toulouse,—n’approuvait pas les mesures fiscales de M. Humann;—il n’avait à prendre que deux partis honnêtes:—obéir, ou donner sa démission;—il en a pris un troisième qui a eu et qui devait avoir le plus grand succès dans certains journaux et dans certains esprits; il s’est établi fonctionnaire indépendant,—a gardé sa place et s’est opposé au nouveau recensement.
Le ministère a donné congé à M. Floret et a nommé à sa place M. Mahul.—M. Mahul aurait, je crois, de la peine à s’établir prophète quelque part,—et on l’envoie précisément dans son pays,—c’est-à-dire là où personne ne peut l’être.
Demandez, en effet, à tous les hommes qui se sont élevés par leur talent, si leurs parents et leurs amis n’ont pas attendu pour reconnaître ce talent qu’ils en aient été avertis par les applaudissements du dehors,—et demandez-leur aussi jusqu’à quel point ils l’ont reconnu.
—Un grand poëte, Pierre? disait un camarade d’enfance de Corneille:—ce n’est pas possible,—il allait à l’école avec moi.
—Voilà un fameux préfet—qu’on nous donne là,—disaient les Toulousains,—le petit Mahul,—que j’ai vu pas plus haut que ça.
—Qui ça?—celui qui demeurait dans ma rue?
—Précisément, porte à porte avec vous.
—C’est là le préfet qu’on nous envoie?—mais j’ai été en classe avec lui,—mais j’ai joué à la balle avec lui,—mais je l’ai vu vingt fois comme je vous vois là,—mais il avait une redingote marron.
—C’est impossible;—ça doit être un mauvais préfet.
![]() Il y a dans Pascal un argument terrible contre M. Mahul:—«Le
pouvoir, dit-il, ayant été établi sans raison, il faut le faire regarder
comme authentique, éternel, et en cacher le commencement, si on ne veut
qu’il prenne bientôt fin.»
Il y a dans Pascal un argument terrible contre M. Mahul:—«Le
pouvoir, dit-il, ayant été établi sans raison, il faut le faire regarder
comme authentique, éternel, et en cacher le commencement, si on ne veut
qu’il prenne bientôt fin.»
Je dénonce ledit Pascal à Me Partarrieu-Lafosse,—à cause qu’il ne serait pas impossible d’appliquer ceci à toute espèce de nouvelle royauté.
Alors on donna deux charivaris—dont l’un, sous les fenêtres de M. Floret, fut intitulé sérénade.
Je me suis souvent inquiété de l’anxiété d’un malheureux député ou fonctionnaire qui entend sous ses fenêtres une musique populaire—mêlée de cris,—et je me suis demandé:—«A quoi reconnaît-on qu’on reçoit une sérénade ou un charivari?»
![]() Puis la colère du peuple s’exaspérant sans autre cause nouvelle que
cette même colère,—on commença à tout briser dans la ville et à
assiéger l’hôtel de la préfecture et accessoirement la maison de M.
Plougoulm.
Puis la colère du peuple s’exaspérant sans autre cause nouvelle que
cette même colère,—on commença à tout briser dans la ville et à
assiéger l’hôtel de la préfecture et accessoirement la maison de M.
Plougoulm.
Alors l’esprit de vertige descendit sur la ville.
Le maire, fonctionnaire indépendant, fit relâcher les prisonniers arrêtés dans les émeutes.—M. de Saint-Michel, baïonnette intelligente commandant la place, refusa le renfort de troupes que requérait M. Mahul pour sa propre sûreté.—Les officiers de la garde nationale, baïonnettes non moins intelligentes, annoncèrent audit M. Mahul qu’ils ne répondaient pas de l’ordre tant qu’il resterait dans la ville,—et M. Mahul se retira.
En quoi personne ne fit son devoir et tout le monde manqua de courage,—le maire, le commandant militaire, les officiers de la garde nationale,—se laissant ainsi entraîner en insurrection et en émeute.—Pour M. Mahul,—sa situation était dangereuse;—mais, quand on a accepté un poste, on ne le quitte pas parce qu’il devient périlleux.
M. Mahul parti,—le commandant militaire et M. Plougoulm—publièrent un avis ainsi conçu et signé de leurs deux noms:
M. Mahul est parti, toute cause de désordre doit cesser.
On envahit la maison de M. Plougoulm et on jette ses meubles par les fenêtres,—et M. Plougoulm s’enfuit.
Le gouvernement, alors, destitua M. Mahul pour avoir quitté la ville.—Mais faire ainsi cette concession à l’émeute,—n’était-ce pas faire précisément ce qu’avait fait M. Mahul, c’est-à-dire lâcher le pied devant elle?—et, si quelqu’un était au gouvernement ce qu’est le gouvernement à M. Mahul, ce quelqu’un ne devrait-il pas destituer le gouvernement?
Certes,—le choix de M. Mahul pouvait être discuté,—mais c’était avant de l’envoyer à Toulouse;—une fois là, il devait être soutenu et installé,—à quelque prix que ce fût. Et, si on avait à le destituer,—ce qui était justice,—ce ne devait être qu’après avoir imposé silence à l’émeute, et en destituant en même temps le commandant militaire, le maire, les officiers de la garde nationale et M. Plougoulm,—et en leur faisant leur procès.
Pour celui-là du moins,—le peuple a fait justice de sa lâcheté,—et je n’ai pas le courage de blâmer l’émeute en ce point.—Ce n’était pas de là que devait venir la punition,—mais toujours est-il qu’elle est arrivée,—et, comme dit Rabelais: «Les cuisiniers du diable rêvent parfois et mettent bouillir ce qu’il destinait pour rôtir,—mais n’importe, pourvu que cela soit cuit à point.»
Si quelque poëte candidat à l’églantine veut faire une épopée sur les trois journées de Toulouse,—il trouvera son commencement dans le commencement de l’Enéide de Virgile.
Je chante les baïonnettes intelligentes (arma) et le fonctionnaire (virum) qui le premier (M. Mahul,—le second est M. Plougoulm) s’enfuit de Toulouse.
Comme on demandait à M. Royer-Collard ce qu’il pensait de l’affaire de Toulouse: «Je pense, dit-il, que le ministère s’est trompé: il a cru que les oies pourraient encore une fois sauver le Capitole;—mais il y a entre les oies d’aujourd’hui et les oies de ce temps-là la même différence qu’entre le Capitole de Toulouse et le Capitole romain.»—Je trouve le mot un peu cynique.
![]() On a affiché sur les murailles à Toulouse—ces quatre vers, dont
l’auteur a gardé l’anonyme:
On a affiché sur les murailles à Toulouse—ces quatre vers, dont
l’auteur a gardé l’anonyme:
![]() LE PEUPLE ET L’ARMÉE.—Il est une plaisanterie des journaux dont il
est temps de faire justice;—lorsque dans une émeute—la troupe, sur
l’ordre de ses chefs, se répand dans une ville pour y rétablir
l’ordre,—les malheureux soldats sont traités comme on ne traita pas les
Cosaques en 1814.—Des pierres sont lancées du haut des fenêtres;—des
coups de fusil leur sont tirés des angles des rues ou des toits, de
derrière les cheminées,—et, lorsque plusieurs ont été atteints,
lorsque, exaspérés,—ils finissent par se défendre,—les journaux du
lendemain—n’ont aucun blâme pour les habitants de la ville—et traitent
les soldats d’assassins.
LE PEUPLE ET L’ARMÉE.—Il est une plaisanterie des journaux dont il
est temps de faire justice;—lorsque dans une émeute—la troupe, sur
l’ordre de ses chefs, se répand dans une ville pour y rétablir
l’ordre,—les malheureux soldats sont traités comme on ne traita pas les
Cosaques en 1814.—Des pierres sont lancées du haut des fenêtres;—des
coups de fusil leur sont tirés des angles des rues ou des toits, de
derrière les cheminées,—et, lorsque plusieurs ont été atteints,
lorsque, exaspérés,—ils finissent par se défendre,—les journaux du
lendemain—n’ont aucun blâme pour les habitants de la ville—et traitent
les soldats d’assassins.
Certes, je suis moins partisan que personne du despotisme militaire,—qui serait le plus odieux et le plus aveugle de tous sans le despotisme populaire,—et je me félicite de n’avoir pas vécu sous l’Empire;—mais ni les journaux ni le peuple ne doivent oublier que les soldats sont des Français, leurs compatriotes, leurs frères,—et que, quand il y a quelqu’un qui assassine dans une émeute, ce n’est pas celui qui se bat à découvert et après avoir essuyé les insultes et les projectiles de tout genre, mais bien celui qui à l’abri tire à l’improviste des coups de fusil sur des soldats qui passent l’arme au bras.—Qu’on se rappelle seulement combien de vieux soldats, respectés par la mort pendant trente ans sur les champs de bataille,—ont succombé dans les rues de Paris—sous la balle d’un pistolet tiré dans le dos par un enfant.
Les journaux voudraient que nos soldats s’élevassent tous à la hauteur de ce type grotesque qu’ils ont inventé de la baïonnette intelligente, c’est-à-dire que chaque soldat, selon ses lumières, souvent plus que médiocres,—examinât les ordres qu’on lui donne avant de s’y soumettre,—c’est-à-dire qu’il fût traître à ses serments,—et qu’il se conduisît d’une façon qui le rendrait digne d’être fusillé d’après les codes militaires de tous les pays. Ils ne pensent pas—que le seul moyen qu’on n’ait rien à craindre de l’armée est qu’elle soit retenue dans les règles de la plus stricte discipline.
Mais cela est si bête, que j’aurais honte d’en parler si je ne rencontrais à chaque instant des gens qui récitent les phrases que font les journaux à ce sujet, et s’indignent d’après eux contre les soldats.
![]() Il est évident qu’une fois l’affaire engagée les soldats ne peuvent
manquer de commettre des excès;—mais les victimes de semblables
accidents ne pourraient-elles pas s’en prendre moins aux soldats qu’aux
gens qui, dans l’intérêt d’hypocrites ambitions, tiennent depuis dix ans
la France en état de guerre civile permanente,—et, par des prédications
insensées, des théories captieuses,—mettent à chaque instant aux
Français les armes à la main contre d’autres Français?
Il est évident qu’une fois l’affaire engagée les soldats ne peuvent
manquer de commettre des excès;—mais les victimes de semblables
accidents ne pourraient-elles pas s’en prendre moins aux soldats qu’aux
gens qui, dans l’intérêt d’hypocrites ambitions, tiennent depuis dix ans
la France en état de guerre civile permanente,—et, par des prédications
insensées, des théories captieuses,—mettent à chaque instant aux
Français les armes à la main contre d’autres Français?
![]() Messieurs,—vous qui vous prétendez mus par l’amour du
peuple,—n’avez-vous pas de remords quand vous comptez combien,—par vos
conseils et vos préceptes,—vous avez envoyé déjà de pauvres ouvriers au
cimetière et en prison?
Messieurs,—vous qui vous prétendez mus par l’amour du
peuple,—n’avez-vous pas de remords quand vous comptez combien,—par vos
conseils et vos préceptes,—vous avez envoyé déjà de pauvres ouvriers au
cimetière et en prison?
![]() Et vous qui vous dites de si grands politiques,—ne voyez-vous pas,
quand vous félicitez le peuple—de ce que force lui est restée,—que
vous justifiez d’avance tout succès dû à la force, et que vous perdez le
droit de blâmer une revanche si le pouvoir s’avisait d’en vouloir
prendre une?
Et vous qui vous dites de si grands politiques,—ne voyez-vous pas,
quand vous félicitez le peuple—de ce que force lui est restée,—que
vous justifiez d’avance tout succès dû à la force, et que vous perdez le
droit de blâmer une revanche si le pouvoir s’avisait d’en vouloir
prendre une?
![]() LES ANGLAIS.—Je ne sais rien de ridicule comme ces injures de
nation à nation,—comme ces épithètes qui s’appliquent à un peuple tout
entier,—comme si tous les hommes d’un pays étaient faits exactement sur
le même modèle;—comme si les qualités et les vices étaient soumis à la
surveillance de la douane et ne dépassaient pas les frontières.
LES ANGLAIS.—Je ne sais rien de ridicule comme ces injures de
nation à nation,—comme ces épithètes qui s’appliquent à un peuple tout
entier,—comme si tous les hommes d’un pays étaient faits exactement sur
le même modèle;—comme si les qualités et les vices étaient soumis à la
surveillance de la douane et ne dépassaient pas les frontières.
Aussi, en lisant les injures adressées récemment par un ministre anglais à la nation française,—n’ai-je recueilli que malgré moi ce mot qui m’a été arraché par l’orgueil de l’insulaire:
«Les Anglais sont jugés par cela seul que, pour avoir six pieds, ils ont imaginé de faire le pied de onze pouces.»
![]() M. de C... n’a qu’un fils,—je ne vous dirai pas toutes ses raisons
de ne pas le mettre au collège. Il est allé, il y a quelques jours,
visiter avec sa femme un de ces pensionnats renommés aujourd’hui parmi
les gens du monde.—Celui qu’on leur avait indiqué n’admet pas plus de
quinze élèves,—et leur fait suivre les cours les plus avancés, en
harmonie avec les progrès de la société actuelle.
M. de C... n’a qu’un fils,—je ne vous dirai pas toutes ses raisons
de ne pas le mettre au collège. Il est allé, il y a quelques jours,
visiter avec sa femme un de ces pensionnats renommés aujourd’hui parmi
les gens du monde.—Celui qu’on leur avait indiqué n’admet pas plus de
quinze élèves,—et leur fait suivre les cours les plus avancés, en
harmonie avec les progrès de la société actuelle.
M. de C..., dans sa sollicitude, prend quelques renseignements sur la nourriture de la maison:
—Ah!—monsieur, pour la nourriture, vous n’aurez pas de reproches à faire,—je donne à mes élèves du vin de Champagne le jeudi et le dimanche,—et du vin de Bordeaux toute la semaine.
—Mais mon fils n’a pas cela chez moi.
Madame de C..., femme spirituelle et pieuse, demande à son tour si l’on suit exactement les devoirs de la religion,—si l’on va à la messe tous les dimanches.
—Oh! non,—pas tous les dimanches,—quelquefois,—de temps en temps,—par-ci, par-là.
—Mais enfin, monsieur, vous avez sans doute un prêtre attaché à votre maison?
—Ah! oui, madame, certainement,—certainement, M. votre fils pourra avoir son confesseur,—rien ne l’en empêche; mais le prospectus vous a prévenue que les maîtres d’agrément se payent à part.
A MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE DE PARIS.
![]() Note à l’appui de son discours, dans lequel il tâche d’insinuer
adroitement au roi Louis-Philippe que, malgré la grandeur et la
vénération qui l’entourent, il ferait bien de se rappeler quelquefois
qu’il n’est qu’un homme.—Monseigneur, on lit dans la
Quotidienne,—le National, etc., etc.. «Le roi ne peut plus sortir
qu’au milieu des précautions les plus minutieuses.—Depuis les
Champs-Élysées jusqu’au pont Royal,—on compte, quand il sort, plus de
cent cinquante sergents de ville.—Toute la brigade de M. Delessert est
échelonnée auprès du château.»—Agréez, monseigneur, etc.
Note à l’appui de son discours, dans lequel il tâche d’insinuer
adroitement au roi Louis-Philippe que, malgré la grandeur et la
vénération qui l’entourent, il ferait bien de se rappeler quelquefois
qu’il n’est qu’un homme.—Monseigneur, on lit dans la
Quotidienne,—le National, etc., etc.. «Le roi ne peut plus sortir
qu’au milieu des précautions les plus minutieuses.—Depuis les
Champs-Élysées jusqu’au pont Royal,—on compte, quand il sort, plus de
cent cinquante sergents de ville.—Toute la brigade de M. Delessert est
échelonnée auprès du château.»—Agréez, monseigneur, etc.
![]() UN PROJET DE RÉVOLUTION.—Sous certains rapports, c’est une
singulière situation que celle du roi Louis-Philippe. En effet, il n’est
pas une de ses actions à laquelle on ne donne une fâcheuse
interprétation.—Tout ce qui lui est opposé jouit à l’instant même d’une
popularité certaine.—Tout homme accusé de ne pas être son
ennemi,—s’empresse de se justifier.—On n’ose pas tout à fait louer les
misérables qui ont tenté de l’assassiner, mais on se complaît à parler
de leur fermeté,—on l’exagère et on l’invente.—Je ne crois pas que
Néron, ni Caligula, ni Tibère, aient jamais excité, en apparence, une
haine aussi ardente et aussi implacable.
UN PROJET DE RÉVOLUTION.—Sous certains rapports, c’est une
singulière situation que celle du roi Louis-Philippe. En effet, il n’est
pas une de ses actions à laquelle on ne donne une fâcheuse
interprétation.—Tout ce qui lui est opposé jouit à l’instant même d’une
popularité certaine.—Tout homme accusé de ne pas être son
ennemi,—s’empresse de se justifier.—On n’ose pas tout à fait louer les
misérables qui ont tenté de l’assassiner, mais on se complaît à parler
de leur fermeté,—on l’exagère et on l’invente.—Je ne crois pas que
Néron, ni Caligula, ni Tibère, aient jamais excité, en apparence, une
haine aussi ardente et aussi implacable.
A quelqu’un qui verrait les choses de loin,—il semblerait qu’il faut qu’un peuple soit bien lâche pour conserver deux jours un roi aussi odieux.—Mais, de près,—il faut d’abord voir, en faisant la liste des crimes reprochés aux trois tyrans dont ma plume vient de rencontrer les noms,—qu’il n’y a pas un seul de ces forfaits qu’on puisse attribuer à Louis-Philippe.—Appliquez au contraire à Caligula tout ce qu’on reproche à Louis-Philippe,—et Caligula vous paraîtra un assez honnête homme,—ce qui vous laissera quelque étonnement de voir tant de Tacites pour si peu de Nérons,—tant de Brutus pour si peu de Césars.
Il faut diviser en trois classes ces haïsseurs de rois:
Les premiers sont des gens qui ont contribué à faire le coup de la révolution de Juillet, et qui n’ont pas eu leur part ou n’ont eu qu’une part insuffisante aux dépouilles qu’elle a produites.—Ils sont semblables aux gens qui poussent à la queue d’un théâtre,—alors qu’un bras inflexible de gendarme placé en travers ne laisse approcher le public des bureaux que par escouade d’une dizaine de personnes.—Quelques-uns ont poussé, espérant être dans les dix premiers,—mais le bras rigide s’est abaissé devant eux, et ils s’efforcent de pousser jusqu’à ce qu’on laisse passer une seconde dizaine dont ils comptent bien s’arranger cette fois pour faire partie.—Ils font contre Louis-Philippe précisément ce qu’ils ont fait contre Charles X.—S’ils réussissent, et s’ils sont plus heureux et plus adroits, ils seront à leur tour poussés par d’autres qui voudront remettre la partie,—car quelque menu hachée que soit aujourd’hui la France, on n’a pas pu faire encore les morceaux si petits qu’il y en ait pour toutes les avidités.
![]() La seconde classe se compose des gens auxquels on avait fait
croire,—sous la Restauration,—que tout le mal venait du gouvernement
d’alors;—qu’en le renversant on renverserait en même temps toutes les
dures conditions imposées à l’humanité;—que la poudre tirée en Juillet
devait faire tomber du ciel des alouettes toutes plumées, rôties,
bardées,—assaisonnées.
La seconde classe se compose des gens auxquels on avait fait
croire,—sous la Restauration,—que tout le mal venait du gouvernement
d’alors;—qu’en le renversant on renverserait en même temps toutes les
dures conditions imposées à l’humanité;—que la poudre tirée en Juillet
devait faire tomber du ciel des alouettes toutes plumées, rôties,
bardées,—assaisonnées.
![]() Aujourd’hui, ceux de la première classe leur disent, à l’égard de
Louis-Philippe, comme ils disaient à l’égard de Charles X: que si
Louis-Philippe n’était plus roi,—les ruisseaux couleraient du café à la
crème;—qu’on payerait la journée triple aux ouvriers, sans qu’ils
dussent pour cela travailler; que les petits pois seraient gros comme
des melons, qu’une tranche suffirait pour le dîner d’un homme,—et que
les fruitiers les donneraient pour rien.—Ceux-là sont une classe
éternellement bête et éternellement victime et de ceux qui possèdent et
de ceux qui veulent posséder,—ceux-ci les ruant sur les autres, ce qui
les amène habituellement à être pressés et écrasés entre les deux
partis.
Aujourd’hui, ceux de la première classe leur disent, à l’égard de
Louis-Philippe, comme ils disaient à l’égard de Charles X: que si
Louis-Philippe n’était plus roi,—les ruisseaux couleraient du café à la
crème;—qu’on payerait la journée triple aux ouvriers, sans qu’ils
dussent pour cela travailler; que les petits pois seraient gros comme
des melons, qu’une tranche suffirait pour le dîner d’un homme,—et que
les fruitiers les donneraient pour rien.—Ceux-là sont une classe
éternellement bête et éternellement victime et de ceux qui possèdent et
de ceux qui veulent posséder,—ceux-ci les ruant sur les autres, ce qui
les amène habituellement à être pressés et écrasés entre les deux
partis.
![]() La troisième classe est inoffensive:—elle se compose de gens
vaniteux, entraînés par la joie d’être audacieux sans danger.—Il y a
entre eux la distance qui existe entre les esprits forts qui plaisantent
ou insultent le ciel et les Titans qui l’escaladent.
La troisième classe est inoffensive:—elle se compose de gens
vaniteux, entraînés par la joie d’être audacieux sans danger.—Il y a
entre eux la distance qui existe entre les esprits forts qui plaisantent
ou insultent le ciel et les Titans qui l’escaladent.
![]() Mais supposez que tout cela arrive au résultat qu’on ne prend la
peine de cacher que bien juste ce qu’il faut pour que les Plougoulm ou
les Partarrieu-Lafosse ne trouvent pas à mordre; supposez qu’on
finisse par faire une nouvelle révolution,—il arrivera précisément ce
qui est arrivé de l’autre:—un parti ou quelqu’un s’en emparera,—ce
quelqu’un ou ce parti aura ses amis et sa queue,—et ce sera à
recommencer.—Il y aura toujours—des avides et des envieux.—Les
révolutions sont comme la loterie,—il y a cinq numéros gagnants sur
quatre-vingt-dix,—conséquemment, quatre-vingt-cinq qui veulent
recommencer le coup.
Mais supposez que tout cela arrive au résultat qu’on ne prend la
peine de cacher que bien juste ce qu’il faut pour que les Plougoulm ou
les Partarrieu-Lafosse ne trouvent pas à mordre; supposez qu’on
finisse par faire une nouvelle révolution,—il arrivera précisément ce
qui est arrivé de l’autre:—un parti ou quelqu’un s’en emparera,—ce
quelqu’un ou ce parti aura ses amis et sa queue,—et ce sera à
recommencer.—Il y aura toujours—des avides et des envieux.—Les
révolutions sont comme la loterie,—il y a cinq numéros gagnants sur
quatre-vingt-dix,—conséquemment, quatre-vingt-cinq qui veulent
recommencer le coup.
Pour arriver aux mêmes résultats,—il me semble qu’on paye un peu cher,—qu’on met bien de l’ardeur et qu’on joue gros jeu.—On comprend l’impétuosité du cheval de course ou du cheval de chasse, mais on ne comprendrait pas celle que manifesterait un cheval de manège tournant avec fureur toujours dans le même cercle.
![]() L’infériorité du gouvernement actuel à l’égard de celui qui l’a
précédé—vient de ce que c’est un nouveau gouvernement,—de ce qu’il
a,—pour nous servir de nos comparaisons de tout à l’heure,—proclamé
cinq numéros sortants de la loterie,—de ce qu’il a laissé passer les
dix premiers de la queue,—et, comme il n’y a pas plus d’ambition que
d’amour sans espoir,—de ce qu’il a montré qu’on pouvait gagner et qu’on
pouvait arriver.
L’infériorité du gouvernement actuel à l’égard de celui qui l’a
précédé—vient de ce que c’est un nouveau gouvernement,—de ce qu’il
a,—pour nous servir de nos comparaisons de tout à l’heure,—proclamé
cinq numéros sortants de la loterie,—de ce qu’il a laissé passer les
dix premiers de la queue,—et, comme il n’y a pas plus d’ambition que
d’amour sans espoir,—de ce qu’il a montré qu’on pouvait gagner et qu’on
pouvait arriver.
Sous ce rapport, le gouvernement qui lui succéderait serait encore pire,—attendu que les cinq numéros gagnants qu’il proclamerait, joints aux cinq de celui-ci, en feraient dix;—que les dix qu’il laisserait approcher du bureau, joints aux dix passés précédemment, en feraient vingt.
Il est bien facile pour les agitateurs—de critiquer tel ou tel acte;—mais il le serait moins d’ajouter à leur critique ce qu’ils feraient à la place du gouvernement,—de prouver qu’ils le pourraient faire, d’en déduire les conséquences nécessaires, et d’établir sans réplique qu’elles seraient bonnes.
Cette agitation furieuse contre la royauté et contre le pouvoir, qui n’aurait, en cas de succès, d’autre résultat que d’amener un autre pouvoir et une autre royauté absolument semblables, est une niaiserie.—Prenez votre temps,—ne vous occupez plus de la royauté;—faites vos plans,—présentez-les,—faites-en signer l’approbation comme vous faites signer vos projets de réforme électorale;—puis, quand vous aurez clairement établi que cette fois vous ne bercez plus les gens de contes de fées,—que vous pouvez faire le bonheur du peuple,—quand vous l’aurez prouvé d’une manière incontestable,—quand vous aurez en outre démontré que le seul obstacle, la seule digue à ces torrents de bonheur qui vont inonder le pays—est le roi Louis-Philippe ou tout autre,—que tout le monde se lève en masse,—et qu’on déclare lâches et indignes de la vie et de la liberté ceux qui ne marcheront pas,—et que le roi Louis-Philippe soit renversé, s’il ne s’en va pas de son plein gré;—et moi-même, qui ai caché ma vie dans l’herbe,—qui ai placé mes désirs et mes besoins si bas—que toutes les avidités de ce temps-ci se battent au-dessus sans pouvoir rien leur prendre,—moi-même—je saisirai alors mon innocent fusil de chasse,—et je jure sur l’honneur que je marcherai avec vous.
![]() Mais jusque-là—il faut penser que la moitié des fautes du
gouvernement viennent des obstacles dont vous jonchez sa route,—que le
meilleur gouvernement du monde, aussi harcelé que celui-ci, ne ferait
pas beaucoup mieux.
Mais jusque-là—il faut penser que la moitié des fautes du
gouvernement viennent des obstacles dont vous jonchez sa route,—que le
meilleur gouvernement du monde, aussi harcelé que celui-ci, ne ferait
pas beaucoup mieux.
Mettez dans un chapeau—les noms que vous voudrez,—M. Fulchiron, mademoiselle Déjazet,—M. Chambolle, Alcide Tousez, etc., etc., tirez au hasard,—et ensuite, quel que soit le nom qui sortira de cette urne,—laissez-vous gouverner et aidez un peu ce monarque improvisé et provisoire,—je réponds que les affaires iront un peu mieux qu’elles ne vont,—jusqu’au moment où vous serez convenus de ce que vous voulez.
![]() UN BAPTÊME. Je suis allé l’autre jour à Étretat pour une
cérémonie religieuse; on bénissait un bateau appartenant à Césaire
Blanquet et à Martin Glam:—on l’a appelé la GUÊPE D’ÉTRETAT.
UN BAPTÊME. Je suis allé l’autre jour à Étretat pour une
cérémonie religieuse; on bénissait un bateau appartenant à Césaire
Blanquet et à Martin Glam:—on l’a appelé la GUÊPE D’ÉTRETAT.
Il y avait là un homme étranger au pays, qui, tandis que je distribuais aux enfants du pays toutes les dragées de la boutique de Pierre Paumel, me dit:
—Quelle singulière superstition!
—Pas si singulière, monsieur, lui dis-je;—si, comme les marins, vous vous trouviez sans cesse dans des situations où tous les hommes de toute la terre, réunissant leurs efforts, ne pourraient rien pour vous,—vous inventeriez un dieu pour avoir recours à lui, si on ne vous avait pas appris à le prier.
Ce qui obtient de coutume votre vénération,—on n’a guère ici le loisir d’y penser;—tous les monarques du monde ne pourraient réussir à faire tourner à l’est ce vent d’ouest maudit qui empêche les bateaux de sortir et d’aller à la pêche.
Quand vous êtes dans une ville,—tout ce qui vous entoure a été construit de la main des hommes,—tous les accidents qui peuvent vous arriver, il dépend de vous ou du préfet de police et de ses agents de vous les faire éviter;—mais ici tout ce que nous voyons était là avant nous et durera après nous;—ces arbres ont abrité de leur ombre épaisse bien des générations et en abriteront d’autres encore après que nous serons morts, tous tant que nous sommes ici.—Quand la mer gronde et se livre à ses colères, vos quatre cent cinquante députés ne peuvent décréter qu’elle se calmera.
Tout ce qui a du pouvoir ailleurs,—on n’a ici aucune raison de s’en occuper.—Au-dessus de la mer il n’y a que le ciel—sans intermédiaire.
![]() CORRESPONDANCE.—M. Dugabé—me fait l’honneur de m’écrire pour
protester contre les renseignements qui m’ont été donnés à son sujet.
(Numéro de juin.)
CORRESPONDANCE.—M. Dugabé—me fait l’honneur de m’écrire pour
protester contre les renseignements qui m’ont été donnés à son sujet.
(Numéro de juin.)
«S’il faut tout dire,—me dit M. Dugabé,—j’ai été l’adversaire constant du projet qui sert de base à des attaques que votre loyauté regrettera, j’en suis certain... Il y a trois ans que j’attaque la censure, et je suis décidé à la poursuivre de mes plaintes jusqu’à ce qu’elle soit digne, élevée, morale... Vous voyez, monsieur, que mes discours ne sont pas près de finir.
»J’ai appelé l’attention du gouvernement sur l’emploi des fonds destinés aux monuments publics, et, si l’engagement pris par deux ministres devant la Chambre demeure sans résultats, je reproduirai des faits qui prouvent avec quel soin on ménage l’argent des contribuables.
»Il est bien, monsieur, de poursuivre sans trêve ni merci la corruption et ses adeptes; mais prenez garde de vous tromper d’adresse en acceptant des renseignements qui détournent vos piqûres de ceux qui ont le plus à les redouter.
»J’oublie, monsieur, les droits que la loi me donne, et je demande à votre loyauté bien connue l’insertion de ma lettre dans votre première livraison.
»Recevez, monsieur, l’assurance, etc.
»DUGABÉ, député.»
Je mets donc la dénégation de M. Dugabé en présence du renseignement qui m’avait été donné.—C’est un devoir de la presse dont j’ai parlé dans mon dernier volume.—Lorsqu’il m’est arrivé de refuser de pareilles rectifications, c’est que les personnes qui les demandaient manifestaient des exigences exagérées—ou formulaient leur demande avec un accompagnement de menaces et d’airs terribles qui ne me permettaient pas d’y faire droit.
![]() LE BERCEAU DU GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF.—A la bonne heure,—voilà
qui est clair, sans circonlocutions et sans ambages;—voilà le
gouvernement représentatif tel que je l’aime, c’est-à-dire dans toute sa
naïveté, dans toute sa pureté et dans tout son éclat.
LE BERCEAU DU GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF.—A la bonne heure,—voilà
qui est clair, sans circonlocutions et sans ambages;—voilà le
gouvernement représentatif tel que je l’aime, c’est-à-dire dans toute sa
naïveté, dans toute sa pureté et dans tout son éclat.
![]() EXTRAITS DES JOURNAUX ANGLAIS.—Un tourneur d’Huddersfield est
occupé à confectionner quatre cents bâtons ferrés qui lui ont été
commandés par les wighs libéraux, pour être employés contre leurs
adversaires politiques aux élections de Wakefield.
EXTRAITS DES JOURNAUX ANGLAIS.—Un tourneur d’Huddersfield est
occupé à confectionner quatre cents bâtons ferrés qui lui ont été
commandés par les wighs libéraux, pour être employés contre leurs
adversaires politiques aux élections de Wakefield.
A Harwick,—où deux candidats fort riches étaient en présence,—les votes se sont payés de sept à huit mille francs; les dix derniers qui devaient décider la question ont monté à cent mille francs.
A Carlow, les tories ont tiré des coups de fusil sur leurs adversaires.
A Bath, les radicaux ont traîné les officiers de police dans la boue.—Lord Duncan et M. Roebuck ont été élus, lord Powescourt et M. Bruges n’ayant pu se présenter sur les hustings, où leur vie eût été compromise. Une seule élection a coûté au candidat élu un million deux cent cinquante mille francs.
Nous n’en sommes pas encore là sous quelques rapports;—mais, sous quelques autres, nous avons de beaucoup dépassé nos voisins d’Angleterre (berceau du gouvernement représentatif).
Nous avons laissé bien loin derrière nous ce procédé naïf et vulgaire d’acheter de sa propre fortune les suffrages éclairés de ses concitoyens.—Nos candidats ne procèdent pas comme les candidats anglais, dont les amis vont grossièrement dans la foule mettre de l’argent dans la main des électeurs.—Cela est honteux et humilierait nos électeurs.
Le candidat français ne donne rien, il promet,—non pas son argent à lui,—mais à celui-ci la gloire de nos armées et un bureau de tabac;—à celui-là les frontières du Rhin et une bourse pour son fils;—à tel autre la reprise du rang que doit tenir la France dans le congrès européen et une permission de chasse dans une forêt de l’État qui avoisine sa demeure;—à M. *** la conservation de notre conquête d’Alger et une recette particulière.
![]() EN FAVEUR D’UN ANCIEN USAGE. M. Gannal,—irrité de n’avoir pas été
choisi pour empailler les cendres de l’Empereur,—s’est renfermé
longtemps dans un silence plus significatif que la tente d’Achille.—Le
voilà qui reparaît à la quatrième page des journaux, où il annonce qu’il
embaume les personnes sans soustraction des organes.
EN FAVEUR D’UN ANCIEN USAGE. M. Gannal,—irrité de n’avoir pas été
choisi pour empailler les cendres de l’Empereur,—s’est renfermé
longtemps dans un silence plus significatif que la tente d’Achille.—Le
voilà qui reparaît à la quatrième page des journaux, où il annonce qu’il
embaume les personnes sans soustraction des organes.
Oh! diable,—voici une belle nouvelle.—Les Égyptiens poursuivaient leurs embaumeurs à coups de pierres.—Nous avions laissé tomber cet usage en désuétude, faute d’en connaître l’origine et la cause.
La voilà dévoilée.
Les embaumeurs,—M. Gannal excepté,—ont la mauvaise habitude de vous soustraire des organes, je ne sais pas bien précisément quels organes ils volent,—ni ce qu’ils en font;—peut-être les revendent-ils aux morts, qui naturellement manquent de quelques-uns.
Et voilà cependant comme on est embaumé! Je demande qu’on fouille à l’avenir les embaumeurs pour voir s’ils n’ont pas dérobé quelques organes,—et qu’on ramène l’usage de les poursuivre à coups de pierres,—toujours à l’exception de M. Gannal.
![]() PARLONS UN PEU DE M. INGRES. M. Ingres est un peintre qui, pendant
bien longtemps, s’est contenté d’avoir un grand talent et une grande
réputation.—M. Ingres a sa couleur comme un autre;—à force de regarder
ses tableaux, on finit par y trouver toute la gamme de tons des
coloristes,—seulement à travers un verre bleu.
PARLONS UN PEU DE M. INGRES. M. Ingres est un peintre qui, pendant
bien longtemps, s’est contenté d’avoir un grand talent et une grande
réputation.—M. Ingres a sa couleur comme un autre;—à force de regarder
ses tableaux, on finit par y trouver toute la gamme de tons des
coloristes,—seulement à travers un verre bleu.
M. Ingres était lui-même,—on l’admirait, on l’aimait;—mais ses défauts ont amorcé des élèves qui n’ont pas tardé à devenir une école complète;—cette école a étudié sans relâche les défauts du maître et les a non-seulement atteints, mais surpassés.
En vain on leur a dit:
«Mes bons messieurs,
»Voyez les peintres de talent,—leur peinture ressemble-t-elle à la peinture de leur maître?—Géricault peint-il comme Guérin?—Decamps, Roqueplan, Delacroix, peignent-ils comme Gros et Girodet?—Robert-Fleury fait-il comme Horace Vernet?—et ledit Horace Vernet et M. Ingres lui-même peignent-ils comme David?»
![]() L’empereur Napoléon a fait sortir bien des généraux de
l’obscurité;—ces hommes, pour la plupart si distingués, n’étaient pas
des singes qui se contentaient de s’affubler d’une redingote grise pour
effaroucher l’ennemi.
L’empereur Napoléon a fait sortir bien des généraux de
l’obscurité;—ces hommes, pour la plupart si distingués, n’étaient pas
des singes qui se contentaient de s’affubler d’une redingote grise pour
effaroucher l’ennemi.
M. Ingres, à force de voir sa charge faite par ses élèves,—s’est trouvé fort laid;—il a eu de récents remords en se croyant cause de la façon dont plusieurs jolies femmes—avaient été massacrées au dernier salon par ses plus chers disciples;—il s’est pris lui-même en horreur,—et a cherché une nouvelle manière, abandonnant avec dégoût, à son école, celle qu’elle lui a gâtée et rendue odieuse même à ses propres yeux.
![]() Il vient de faire pour la cour de Russie une vierge dans laquelle
il s’est efforcé d’être coloriste,—et il y tenait tant, qu’il a été
jusqu’à lui sacrifier le dessin.—Il y a là une tête de jeune homme dont
la bouche n’est pas sous le nez;—c’est ce que les peintres appellent,
je crois, dans leur argot, ne pas être ensemble; la vierge est d’un
modèle mou et rend—(toujours le même argot).
Il vient de faire pour la cour de Russie une vierge dans laquelle
il s’est efforcé d’être coloriste,—et il y tenait tant, qu’il a été
jusqu’à lui sacrifier le dessin.—Il y a là une tête de jeune homme dont
la bouche n’est pas sous le nez;—c’est ce que les peintres appellent,
je crois, dans leur argot, ne pas être ensemble; la vierge est d’un
modèle mou et rend—(toujours le même argot).
Oh! monsieur Ingres, je vous aime mieux vous-même;—j’ai vu par hasard une étude faite par vous en une seule séance,—d’après madame E... B..., âgée de dix-sept ans; rien n’est plus pur, plus jeune, plus naïf;—le modelé est la plus admirable chose qu’on puisse voir.
Donc, comme je le disais au commencement de ces pages qui lui sont consacrées,—M. Ingres s’est longtemps contenté de son talent et de sa réputation; voilà que des amis maladroits l’ont réveillé de cette noble indifférence, et qu’ils l’ont rendu jaloux de la gloire de la pommade mélaïnocome et du journal l’Audience.
Ils ont regagné tout le temps perdu pour la réclame, et ont à la fois et brusquement entassé feuilletons sur statuettes, lithographies sur banquets.
Et ils ont déclaré que M. Ingres était coloriste.
Je ne connais, pour moi, rien de niais comme ces perpétuelles disputes sur le dessin et la couleur: la nature a donné à ses créations la richesse des tons comme la beauté de la forme;—tant pis pour les artistes s’ils sont forcés de se partager l’imitation de ses magnificences;—mais qu’ils ne nous forcent pas de nous irriter contre leur impuissance en en tirant vanité et en en faisant une prétention ridicule.
![]() Madame D*** avait un chat magnifique;—M. de C*** s’amusa un
jour à le tuer d’un coup de fusil;—faute de grives, on prend des
merles;—faute de merles, des chats.
Madame D*** avait un chat magnifique;—M. de C*** s’amusa un
jour à le tuer d’un coup de fusil;—faute de grives, on prend des
merles;—faute de merles, des chats.
Madame D*** fait dresser dans sa maison et dans celles de ses amis toutes sortes de souricières; quand elle a réuni trois ou quatre cents souris, elle les fait renfermer dans une caisse et l’adresse à madame de C***, dans son château.—Madame de C*** ouvre la caisse elle-même, comptant y trouver quelques modes nouvelles,—les souris s’échappent et remplissent la maison;—au fond de la caisse était un billet adressé à madame de C***.
«Madame, votre mari a tué mon chat, je vous envoie mes souris.»
![]() A M. LE VICOMTE DE CORMENIN. Vous, monsieur, qui avez tant
d’esprit, et qui, cependant, n’en avez pas assez pour cacher tout le bon
sens qui vous gêne,—dans votre position d’homme de parti,
A M. LE VICOMTE DE CORMENIN. Vous, monsieur, qui avez tant
d’esprit, et qui, cependant, n’en avez pas assez pour cacher tout le bon
sens qui vous gêne,—dans votre position d’homme de parti,
Dites-moi, je vous prie, ce que c’est que le peuple,—où il commence et où il finit,—car, je ne puis me contenter des définitions saugrenues qu’en donnent les journaux.
Le peuple—des journaux—est un peuple d’opéra-comique—auquel on fait dire:—Allons,—partons,—marchons;—ou bien: Célébrons ce beau jour.
L’armée recrutée dans le peuple—(car les riches s’abstiennent—et il n’y a en France que les enfants du peuple et les enfants des rois—qui ne puissent s’exempter du service militaire),—l’armée fait-elle partie du peuple d’où elle sort et où elle retourne après quelques années passées sous les drapeaux? Tout homme du peuple est, a été ou sera soldat.
Cependant, à propos des émeutes de Toulouse, vos journaux ne cessent d’opposer l’armée au peuple.
J’ai cité,—en son temps,—un article spirituel du National,—dans lequel ce carré de papier—s’indignait avec raison—contre les talons rouges de comptoir;—le commerce est donc également exclu du peuple.
Ces mêmes journaux louent parfois la garde nationale de son intervention entre le pouvoir et le peuple.
La garde nationale ne fait donc pas partie du peuple;—on ne sait que trop cependant jusqu’où les sergents-majors vont trouver les gens pour les enrôler dans cette institution. J’ai vu des garçons marchands de vin,—des maçons,—des menuisiers (le mien, M. Collaye, m’a envoyé trois jours en prison, avec l’approbation de mon fruitier).
Dans la seule garde que j’aie jamais montée,—j’ai rencontré en faction avec moi,—chacun gardant une des bornes de la mairie, un marchand de charbon de terre qui passa les deux heures de notre faction à me reprocher amèrement de lui avoir ôté ma pratique.
Mon portier dit: «Nous, nous vivons encore,—mais le peuple a bien du mal.»
Où est donc le peuple?
Je ne le trouve pas, et cependant il paraît qu’il y en a plusieurs et que chaque parti a le sien.
J’ai vu souvent les journaux raconter des revues du roi.—Les journaux ministériels disaient: «Le peuple a accueilli Sa Majesté par d’unanimes acclamations.»
Les journaux de l’opposition écrivaient: «Le peuple est resté silencieux et grave.»
Comme il s’agissait du même roi et de la même revue, il est évident qu’il ne peut s’agir du même peuple.
J’appelle peuple, monsieur, tout ce qui souffre,—tout ce qui gagne péniblement sa vie par le travail,—tout ce qui ne peut vivre qu’au moyen de la paix et des développements de l’industrie, qui en est la conséquence,—et je considère comme ses ennemis non pas seulement ceux qui laissent peser sur lui une trop lourde charge d’impôts,—mais aussi ceux qui, sous prétexte de défendre ses intérêts,—le jettent dans le découragement, en lui faisant faire des vœux impossibles à réaliser—et le précipitent dans des luttes sanglantes et criminelles—où les uns perdent la vie et la liberté, et les autres l’ouvrage et le pain de leur famille, que leur enlèvent le trouble et la défiance qui suivent toujours l’insurrection et l’émeute.
Pardonnez-moi, monsieur, de vous déranger dans vos loisirs.
On dit que vous êtes à Vichy,—et que vous pêchez à la ligne dans l’Allier;—j’ai fait justice, dans un livre publié il y a une douzaine d’années déjà,—des plaisanteries vulgaires prodiguées de tout temps à la pêche à la ligne.—Je regrette de n’avoir pu citer alors votre exemple;—au lieu d’avouer timidement que je pêchais aussi,—je l’aurais proclamé avec orgueil.
J’ai, comme vous, monsieur, passé quelque temps à Vichy,—et, comme vous,—j’y ai pêché à la ligne;—je ne crois pas y avoir fait autre chose,—mais je ne pêchais pas dans l’Allier;—je pêchais dans le Lignon. C’est une petite rivière que vous trouverez en allant de Vichy à Cusset,—et que je vous recommande: elle a dix pieds de largeur et tout au plus deux pieds de profondeur; elle coule claire et limpide sur un fond de sable, entre deux rives de gazon; des saules et des aunes qui la bordent enlacent leur feuillage par-dessus et couvrent l’eau d’un réseau d’ombre et de soleil. Par places, des touffes d’iris s’élèvent dans le lit du ruisseau. Au pied des saules, des ronces jettent d’un arbre à l’autre leurs rameaux et leurs feuilles d’un vert sombre, avec des fleurs d’un blanc rosé: la reine des prés, la filipendule, s’élance droite et svelte et balance ses thyrses semblables à des bouquets de mariées; le liseron blanc grimpe et serpente, et étend ses guirlandes d’un riche feuillage parsemé de grandes cloches; des bergeronnettes se cachent dans les saules où elles ont leur nid.
On n’y prend pas grand’chose,—c’est probablement comme dans l’Allier,—mais les fleurs, l’herbe, l’eau, y exhalent avec leurs odeurs de charmantes rêveries.
![]() CONTRE L’EAU.—On se rappelle peut-être—MM. Huret et
Fichet,—deux serruriers qui occupèrent un moment Paris par leurs
querelles à la quatrième page des journaux et sur les murailles;—chacun
d’eux prétendait ouvrir sans clef toutes les serrures, sans en excepter
celles de son rival;—à la façon dont ils parlaient des serruriers qui
les avaient précédés, il était évident qu’on n’était un peu bien fermé
qu’en s’adressant à un de ces deux messieurs,—mais auquel?—Si vous
achetiez une serrure Fichet, il y avait Huret qui pouvait ouvrir
votre serrure;—si vous preniez une serrure Huret, Fichet ne vous
cachait pas qu’il pouvait entrer chez vous à toute heure du jour et de
la nuit. Je n’ai jamais eu grand’chose à renfermer, aussi je ne m’en
souciais guère;—cependant, si j’avais été préfet de police,—je me
serais assuré de ces deux messieurs, qui sont probablement fort honnêtes
gens, mais qui pouvaient au moins troubler la sécurité des mères et
celle des époux;—peut-être le préfet de police y avait-il pensé;—mais
comment retenir enfermés ces deux messieurs? Il n’y avait même pas la
ressource de faire cadenasser Huret par Fichet, et Fichet par
Huret;—car Huret disait qu’avec un clou il ouvrirait toute serrure
construite par Fichet.
CONTRE L’EAU.—On se rappelle peut-être—MM. Huret et
Fichet,—deux serruriers qui occupèrent un moment Paris par leurs
querelles à la quatrième page des journaux et sur les murailles;—chacun
d’eux prétendait ouvrir sans clef toutes les serrures, sans en excepter
celles de son rival;—à la façon dont ils parlaient des serruriers qui
les avaient précédés, il était évident qu’on n’était un peu bien fermé
qu’en s’adressant à un de ces deux messieurs,—mais auquel?—Si vous
achetiez une serrure Fichet, il y avait Huret qui pouvait ouvrir
votre serrure;—si vous preniez une serrure Huret, Fichet ne vous
cachait pas qu’il pouvait entrer chez vous à toute heure du jour et de
la nuit. Je n’ai jamais eu grand’chose à renfermer, aussi je ne m’en
souciais guère;—cependant, si j’avais été préfet de police,—je me
serais assuré de ces deux messieurs, qui sont probablement fort honnêtes
gens, mais qui pouvaient au moins troubler la sécurité des mères et
celle des époux;—peut-être le préfet de police y avait-il pensé;—mais
comment retenir enfermés ces deux messieurs? Il n’y avait même pas la
ressource de faire cadenasser Huret par Fichet, et Fichet par
Huret;—car Huret disait qu’avec un clou il ouvrirait toute serrure
construite par Fichet.
—Et moi, disait Fichet, je ne demande qu’une épingle pour forcer une serrure de Huret.
—Mon ongle, disait Huret.
—Un cheveu, disait Fichet.
—Rien qu’en soufflant dessus, disait Huret.
—Rien qu’en la regardant, disait Fichet.
Les gens malins prétendirent que cette grande guerre n’était qu’un semblant,—un moyen de faire du bruit, de battre la caisse et de se mettre en évidence;—toujours est-il qu’on crut ces deux messieurs, non en ce que chacun disait de soi, mais en ce que chacun disait de l’autre,—et qu’on se contenta des serrures dont on s’était contenté jusque-là.
Depuis quelque temps, deux gérants de compagnies de filtrage des eaux de la Seine renouvellent toujours à la quatrième page des journaux—la guerre de MM. Huret et Fichet;—MM. Souchon et Mareschal—ont, dans cinq ou six longues lettres qu’ils ont échangées,—émis l’un contre l’autre des assertions graves.
—Vous ne mettez pas de charbon,—dit l’un.
—J’en mets plus que vous,—répond l’autre.—Et d’ailleurs vous mettez des éponges,—l’éponge est une pourriture.
—Vous mettez de la laine,—la laine est une infection.
—Votre eau n’est pas filtrée du tout.
—La vôtre est empoisonnée.
—C’est bien plutôt la vôtre.
—Non.
—Si.
—Je maintiens mon opinion.
—Je soutiens la mienne.
Que fait le public au milieu de semblables débats? Le public n’est pas chimiste, il se dit pour ce qui est de l’eau de M. Mareschal: «M. Souchon doit savoir mieux que moi ce qui en est,—c’est sa partie;—il paraît évident que M. Mareschal emploie pour filtrer son eau de l’éponge, qui est une pourriture.
«Pour ce qui est de l’eau de M. Souchon, c’est une autre affaire.—Certes, M. Mareschal, qui en fait son état, doit s’y connaître mieux que moi—qui ne m’en suis jamais occupé.—Je dois donc croire que M. Souchon filtre avec de la laine, qui est une infection.»—Croyez cela et buvez de l’eau, si vous l’osez.
Il y a à Paris une Académie des sciences,—qui, dans un débat de ce genre, devrait, il me semble, se prononcer.—Comment! la ville fait de grandes dépenses pour donner au Parisien de l’eau qu’elle fait filtrer par MM. Souchon et Mareschal, et on laisse chacun d’eux dire que l’autre ne filtre guère l’eau, mais l’empoisonne beaucoup,—sans que la ville ni l’Académie des sciences s’occupe d’établir la vérité et de rassurer le Parisien! Mais M. Humann n’est peut-être pas innocent de ceci:—il n’ose pas encore imposer l’eau;—il veut en inspirer une invincible horreur aux Parisiens—qui, n’osant plus en boire,—auront recours au vin—qui rapporte, comme on sait, raisonnablement au trésor.
![]() Au moins, pour ce qui a rapport à la température bizarre que nous
avons cet été, les savants n’ont pas laissé les journaux s’égarer en
théories absurdes et en saugrenuités:—ils ont mêlé quelques niaiseries
de leur cru à celles qui étaient en circulation.
Au moins, pour ce qui a rapport à la température bizarre que nous
avons cet été, les savants n’ont pas laissé les journaux s’égarer en
théories absurdes et en saugrenuités:—ils ont mêlé quelques niaiseries
de leur cru à celles qui étaient en circulation.
Ils ont attribué le froid et la pluie,—les uns à l’approche des montagnes de glace du pôle nord,—les autres à la vapeur des chemins de fer, qui amoncelait les nuages;—d’autres ont dit que les neiges excessives ont rendu le soleil hydropique.
![]() Cette fois-ci on ne dira pas que j’ai de la malveillance pour les
journaux;—ce n’est pas moi qui ai prié M. Chambolle de mettre dans le
sien ce qui suit.—MM. les imprimeurs des Guêpes peuvent certifier
que le fragment que je cite n’est pas dans le manuscrit écrit de ma
main, mais bien coupé dans un exemplaire du Siècle:
Cette fois-ci on ne dira pas que j’ai de la malveillance pour les
journaux;—ce n’est pas moi qui ai prié M. Chambolle de mettre dans le
sien ce qui suit.—MM. les imprimeurs des Guêpes peuvent certifier
que le fragment que je cite n’est pas dans le manuscrit écrit de ma
main, mais bien coupé dans un exemplaire du Siècle:
«La petite ville de Levignac (Haute-Garonne) a donné hier au soir dimanche des preuves de sympathie à la population toulousaine. Grand nombre D’HOMMES MARIÉS et une bonne partie de la jeunesse, à la tête desquels se trouvaient LES CITOYENS LES PLUS HONORABLES, munis de cornes et autres instruments, ont entonné la Marseillaise devant la halle, en face du lieu où étaient placardées les proclamations du nouveau préfet de la Haute-Garonne.
»Ils ont parcouru la ville, alternant les couplets de l’hymne révolutionnaire avec les ÉCLATS d’une musique PEU SONORE. Les cris: A bas Mahul! étaient proférés avec force et souvent répétés. Ils sont revenus plusieurs fois à l’endroit d’où ils étaient partis. Des groupes attendaient devant les proclamations, COUVERTES D’ORDURES depuis le moment où on les avait affichées. La soirée a été clôturée par l’incendie des proclamations, aux applaudissements de la foule.»
![]() TRISTE SORT D’UN PRIX DE VERTU.—Ceux qui ont inventé les
rosières—ont pensé, à ce qu’il paraît, que la vertu est un fruit
excellent dans sa maturité, mais qui se conserve difficilement après.
Aussi, au prix donne à la sagesse, ont-ils de tous temps, en mariant
immédiatement les rosières, ajouté le moyen le plus honnête de ne pas
avoir à la conserver plus longtemps.
TRISTE SORT D’UN PRIX DE VERTU.—Ceux qui ont inventé les
rosières—ont pensé, à ce qu’il paraît, que la vertu est un fruit
excellent dans sa maturité, mais qui se conserve difficilement après.
Aussi, au prix donne à la sagesse, ont-ils de tous temps, en mariant
immédiatement les rosières, ajouté le moyen le plus honnête de ne pas
avoir à la conserver plus longtemps.
On sait que l’Académie a reçu de M. de Montyon un legs destiné à récompenser les actes de vertu qui parviendraient à sa connaissance.—Tous les Français indistinctement sont admis à composer en vertu, comme on compose en thème au collège,—et l’Académie distribue les prix.
Il est, à ce sujet, une chose à remarquer, c’est que c’est toujours dans les classes inférieures que l’Académie exhume les traits d’héroïsme et de dévouement qu’elle est chargée de découvrir,—en quoi les classes inférieures me paraissent très-supérieures aux autres.
Mais il y a encore là quelque chose de très-incomplet—une fois un homme déclaré vertueux,—la société qui est allée le voir couronner et l’applaudir, ce qui n’est qu’un spectacle de jour, où les femmes qui ont de la fraîcheur et des chapeaux neufs vont humilier les femmes fatiguées et les chapeaux passés,—la société ne s’en occupe plus:—voilà donc la vertu payée!—Le prix est bientôt dépensé;—il ne reste alors qu’une vertu en jachère qui n’est plus susceptible d’aucun rapport.
Il faudrait faire pour la probité des hommes—ce qu’on fait pour la vertu des rosières,—ne pas obliger à recommencer sans cesse une course périlleuse à travers les dangers;—on sait la ballade allemande.
Le roi jette sa coupe dans un gouffre,—un plongeur se précipite,—et la rapporte: «La coupe est à toi, dit le roi,—mais va la chercher une seconde fois, et tu auras ma fille.» Le plongeur se jette une seconde fois,—mais ne revient plus.
Quand on trouve un homme qui est resté vainqueur dans la lutte horrible de l’honneur et de la pauvreté, il ne faut pas faire recommencer cette lutte; il ne peut pas se contenter d’un prix qui, une fois dépensé, le rend encore nécessaire:—il faut lui assurer à jamais un travail honorable.
C’est ce qu’on ne fait pas;—aussi,—le nommé Caillet, qui avait été déclaré homme vertueux en 1839, et qui avait, en cette qualité, reçu un prix de cinq cents francs, voyant que tout le produit de la vertu était mangé,—qu’il n’y avait plus rien à en attendre,—a eu recours au vice et a passé à d’autres exercices.—La cour d’assises de l’Orne vient d’avoir la douleur, le 8 juillet dernier, de le condamner à huit années de réclusion pour vol avec circonstances aggravantes.
![]() Il y a des vertus de peuple que le monde méprise naturellement et
sans affectation,—il n’y prétend pas plus qu’à porter un sac de farine.
Il y a des vertus de peuple que le monde méprise naturellement et
sans affectation,—il n’y prétend pas plus qu’à porter un sac de farine.
Ainsi, les croix d’honneur ont été acquises,—et je parle de celles qui l’ont été le plus légitimement, pour avoir tué un peu de monde.—Quand un homme du port, un marin,—un pompier,—expose sa vie pour sauver celle d’un autre homme,—on lui donne une médaille à laquelle ne sont attachés aucuns honneurs;—la conséquence morale en est bizarre.—J’ai reçu, il y a dix ans, une de ces médailles, que je porte quelquefois et dont je suis plus fier que je ne le serais d’aucune décoration que je connaisse.—Eh bien! j’ai vu dans le monde bien des gens qui auraient senti germer en eux une grande estime pour moi, s’ils m’avaient vu obtenir la croix d’honneur,—même par les moyens les moins honorables,—et qui trouvaient ma médaille ridicule.—Les journaux mêmes s’en sont parfois égayés,—quelques caricatures ont été faites à ce sujet;—il m’a été impossible de trouver le côté plaisant de cette affaire.
![]() DE L’HÉROÏSME.—Soyez donc héros,—faites donc quelque chose de
grand aujourd’hui!—Autrefois, l’histoire vous jugeait de loin,—et ne
voyait des grands hommes que ce qui avait le plus d’éclat et
d’importance.—Aujourd’hui, elle se fait chaque jour, et elle est
hostile et éplucheuse;—les âges à venir nous estimeront crétins,—car
il n’y aura pas un seul homme de ce temps-ci, quelque grand et illustre
qu’il puisse être,—dont on ne puisse trouver dans les journaux, qui
seront alors les Mémoires du temps, une histoire qui démentira sa
grandeur et détruira sa célébrité.
DE L’HÉROÏSME.—Soyez donc héros,—faites donc quelque chose de
grand aujourd’hui!—Autrefois, l’histoire vous jugeait de loin,—et ne
voyait des grands hommes que ce qui avait le plus d’éclat et
d’importance.—Aujourd’hui, elle se fait chaque jour, et elle est
hostile et éplucheuse;—les âges à venir nous estimeront crétins,—car
il n’y aura pas un seul homme de ce temps-ci, quelque grand et illustre
qu’il puisse être,—dont on ne puisse trouver dans les journaux, qui
seront alors les Mémoires du temps, une histoire qui démentira sa
grandeur et détruira sa célébrité.
Un fils du roi revient d’Afrique, où il est allé partager les dangers des soldats; les journaux annoncent avec empressement qu’il revient malade de la dyssenterie.—Voilà certes une maladie peu héroïque, et il est triste, plus qu’on ne le pourrait dire, que le seul endroit où il soit possible aujourd’hui d’acquérir un peu de gloire militaire soit un pays où la dyssenterie règne avec une effrayante obstination.
![]() LA SCIENCE.—LA PHILANTHROPIE.—Depuis quinze ans au moins,—la
philanthropie et la science, réunissant leurs efforts, avaient inventé
la gélatine,—c’est-à-dire une nouvelle alimentation, formée d’un
prétendu jus tiré des os de la viande; je me rappelle avoir dénoncé, il
y a une dizaine d’années, cette nourriture fallacieuse sous le nom de
potage de boutons de guêtres.
LA SCIENCE.—LA PHILANTHROPIE.—Depuis quinze ans au moins,—la
philanthropie et la science, réunissant leurs efforts, avaient inventé
la gélatine,—c’est-à-dire une nouvelle alimentation, formée d’un
prétendu jus tiré des os de la viande; je me rappelle avoir dénoncé, il
y a une dizaine d’années, cette nourriture fallacieuse sous le nom de
potage de boutons de guêtres.
Depuis quinze ans, on nourrissait les malades dans les hospices, les pauvres dans les établissements de charité,—les prisonniers dans les maisons de détention,—avec la fameuse gélatine.
On allait appliquer la chose aux casernes,—quelqu’un s’est avisé de dire: «Pardon, voyons donc un peu si cette nourriture est véritablement une nourriture.» On s’est ému de cette observation;—la science a haussé les épaules et a procédé, par une faiblesse qu’elle se reprochait, à de nouvelles expériences.
Et il résulte d’un rapport signé par MM. Magendie, Chevreul et Thénard, que les propriétés nutritives de la gélatine n’existent pas;—que de deux chiens nourris, l’un avec de la gélatine, l’autre avec de l’eau claire,—le second a vécu plus longtemps que le premier.
En un mot, que depuis quinze ans,—grâce aux efforts réunis de la science et de la philanthropie,—tous ceux qui, dans les prisons, les hôpitaux et les hospices,—ont été nourris avec la gélatine, sont littéralement morts de faim!
Et que l’armée l’a échappé belle!
![]() LES MÉDAILLES DES PEINTRES.—Qu’y a-t-il de plus singulier que de
voir donner clandestinement des récompenses disputées en public?
LES MÉDAILLES DES PEINTRES.—Qu’y a-t-il de plus singulier que de
voir donner clandestinement des récompenses disputées en public?
Autrefois,—le roi distribuait lui-même les médailles aux peintres après l’exposition du Louvre;—maintenant on apprend par M. de Cayeux que l’on a une médaille, et il faut aller la chercher chez lui.
Cette récompense n’a de publicité que celle que peut lui faire donner le peintre qui a des amis dans les journaux.
La clandestinité a un inconvénient,—outre celui de distribuer à huis clos la gloire qui n’existe que par la publicité,—c’est qu’on en abuse singulièrement.—Ainsi, j’ai là toutes les médailles dénoncées par les journaux,—et je n’ai pas retrouvé un seul des noms dont les ouvrages avaient attiré au Louvre l’attention et les éloges.
Cela a presque l’air d’une gageure,—à moins que les médailles ne soient aujourd’hui une consolation.
![]() LES ORDONNANCES DE M. HUMANN.—En arrivant dernièrement à Paris,
j’ai levé les yeux sur une petite fenêtre située sur un des toits qui
avoisinent mon logis,—et je l’ai vue fort changée.—A mon dernier
voyage, elle était riante et fraîche,—les capucines s’y mêlaient aux
volubilis et lui faisaient un charmant cadre de verdure et de fleurs.
LES ORDONNANCES DE M. HUMANN.—En arrivant dernièrement à Paris,
j’ai levé les yeux sur une petite fenêtre située sur un des toits qui
avoisinent mon logis,—et je l’ai vue fort changée.—A mon dernier
voyage, elle était riante et fraîche,—les capucines s’y mêlaient aux
volubilis et lui faisaient un charmant cadre de verdure et de fleurs.
Quelquefois, au milieu de ce cadre, se montrait une jolie figure, avec des bandeaux de cheveux noirs comme deux ailes de corbeau, qui travaillait là tout le jour sans lever les yeux une seule fois, si ce n’est sur ses fleurs,—ou sur quelque flatteur de papillon qui, arrivé au milieu de Paris, je ne sais comment,—traitait la fenêtre en véritable jardin,—et faisait semblant de humer, en déroulant sa trompe, un miel que n’ont pas ces pauvres fleurs, sans air, sans terre et sans soleil.
Mais alors—les fleurs étaient séchées,—la verdure était jaunie,—on voyait que depuis longtemps elles n’avaient pas été soignées.
Je rencontrai dans la rue—la Sémiramis de ce jardin suspendu.
—Ma jolie voisine,—lui dis-je,—pourquoi négligez-vous votre jardin?—Quelle passion a donc détruit celle que vous aviez pour les fleurs?
—Hélas! me dit-elle,—je ne demeure plus là-haut,—mon propriétaire m’a augmentée, parce qu’on a augmenté les impôts de sa maison,—et je n’ai pu rester.
Et alors, j’ai découvert le mauvais côté de l’ordonnance de M. Humann.
On a crié à l’illégalité, et on a eu tort,—et tout le bruit qu’on fait en France à ce sujet, en ce moment, n’est absolument que pour faire du bruit.
Dès l’instant que les Chambres ont voté un impôt, il faut qu’il soit perçu,—et tout ce qui peut en assurer la perception n’est point illégal, mais cela peut être injuste et cruel.—Le ministère prétend qu’il y a en France cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six maisons qui ne sont pas imposées;—il y a là une grosse erreur volontaire.—Une vieille loi ne soumet à l’impôt les maisons nouvellement construites que la troisième année de leur construction, et ces maisons exceptées sont comptées dans les cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six.
C’est le droit du ministère de percevoir l’impôt voté et de découvrir les maisons et les chambres qui ont échappé jusqu’ici; c’est même un devoir à certains égards, car par ce moyen on pourra faire une répartition plus égale.—S’il y en a qui ne payent pas, il y en a qui payent trop;—mais le fisc a peu l’habitude de rendre.
Il est triste seulement de penser que ce nouveau recensement dénonce aux loups du fisc une foule de pauvres mansardes dont les habitants auraient plus besoin de recevoir qu’ils ne peuvent donner;—pauvres gens qui auront à économiser sur le pain qu’ils ont tant de peine à gagner—de quoi payer l’air qu’on découvre aujourd’hui qu’ils respirent clandestinement et illégalement.
Et puis ensuite, après avoir fait rendre à l’impôt tout ce qu’il peut rendre, image qui fait ressembler le pays à un citron entre deux grosses mains,—on ne manquera pas de trouver qu’il ne rend pas assez.
C’est ainsi qu’autrefois on permettait de passer aux barrières de Paris de petites quantités de vin et de viande;—on a supprimé cette tolerance, qui ne s’appliquait qu’aux plus pauvres.
Cela est légal comme l’ordonnance de M. Humann, mais cela est injuste,—mais cela est triste,—et ce n’était pas à un gouvernement qui a pris les affaires au rabais,—qu’il convenait de râcler ainsi le fond des pauvres écuelles.
![]() Décidément le ministère Thiers coûte cher;—c’est à cause du
déficit qu’on m’a fait timbrer les Guêpes—et donner chaque mois
quelques centaines de francs au gouvernement.
Décidément le ministère Thiers coûte cher;—c’est à cause du
déficit qu’on m’a fait timbrer les Guêpes—et donner chaque mois
quelques centaines de francs au gouvernement.
Voici maintenant qu’on cherche de nouveaux expédients; un ministère Thiers est une jolie chose,—mais une chose de luxe dont il ne faut pas se passer trop souvent la fantaisie.
Voilà la vérité sur l’ordonnance Humann,—comme je vous la dis sur les autres choses de ce temps.
![]() DE L’HOMICIDE LÉGAL.—Il existe à Paris une compagnie d’assurance
contre les amendes et les dommages-intérêts que peuvent encourir les
conducteurs de voitures lorsqu’ils écrasent quelqu’un,—c’est-à-dire
que, moyennant une prime payée annuellement, on peut se livrer à cœur
joie à l’homicide par imprudence,—crime prévu, qualifié et puni par
tous les codes.—De là à une compagnie d’assurance contre les mauvaises
chances que MM. les voleurs peuvent rencontrer dans l’exercice de leur
profession, il n’y a qu’un pas, et un pas et demi à l’assurance contre
le chagrin que la justice voudrait faire à MM. les assassins.
DE L’HOMICIDE LÉGAL.—Il existe à Paris une compagnie d’assurance
contre les amendes et les dommages-intérêts que peuvent encourir les
conducteurs de voitures lorsqu’ils écrasent quelqu’un,—c’est-à-dire
que, moyennant une prime payée annuellement, on peut se livrer à cœur
joie à l’homicide par imprudence,—crime prévu, qualifié et puni par
tous les codes.—De là à une compagnie d’assurance contre les mauvaises
chances que MM. les voleurs peuvent rencontrer dans l’exercice de leur
profession, il n’y a qu’un pas, et un pas et demi à l’assurance contre
le chagrin que la justice voudrait faire à MM. les assassins.
Il faut dire que cette compagnie est autorisée par le gouvernement.
Diverses réponses.—L’auteur rassure plusieurs personnes.—M. Molé.—M. Guizot.—M. Doublet de Bois-Thibault.—La vérité sur plusieurs choses.—Les protestations.—Les adresses.—Les troubles.—Ce que c’est qu’une foule et une masse.—Le peuple des théâtres et le peuple des journaux.—L’évêque d’Évreux et l’archevêque de Paris.—Dénonciation contre les savants.—M. Montain.—En quoi M. Duchâtel ressemble à Chilpéric.—Le suffrage universel.—Naïveté.—La pudeur d’eau douce et la pudeur d’eau salée.—Les fêtes de Juillet.—Apparition de plusieurs phénomènes.—Toujours la même chose.—Les banquets.—M. Duteil et M. Champollion.—Voyage du duc d’Aumale.—Est-ce une pipe ou un cigare?—Histoire d’un député.—Sur quelques noms.—Les bureaux de tabac.—A M. Villemain.—A M. Rossi.—En faveur de M. Ledru-Rollin.—Les Parias.—Madame O’Donnell.
![]() SEPTEMBRE.—Il faut que je réponde à des lettres que je reçois de
divers côtés:
SEPTEMBRE.—Il faut que je réponde à des lettres que je reçois de
divers côtés:
On dit partout, m’écrit-on, que ce n’est plus vous qui faites les GUÊPES.
RÉPONSE.—Et qui donc alors?—Est-ce vous, mon bon monsieur!—Est-ce celui qui vous le dit? Est-ce quelque autre? Nommez-moi, désignez-moi l’auteur des Guêpes,—que je le connaisse.—Jusque-là, ayez la bonté de croire ceci:—que je n’ai jamais écrit une ligne sans la signer, et que je n’ai jamais signé une ligne sans l’avoir écrite.
Je continue à faire les GUÊPES,—je les fais seul.—Personne autre que moi n’y a jamais écrit une ligne;—personne n’y écrira jamais une ligne.
Quand il m’arrivera de ne plus vouloir faire les GUÊPES,—et nous n’en sommes pas là,—les Guêpes finiront.—Mon essaim restera avec moi;—je ne le vendrai, je ne le louerai, je ne le donnerai à personne.—S’il arrive que je n’aie plus le courage de rire de ce qui se passe,—si de dégoût j’en détourne les yeux et les oreilles, mes Guêpes resteront à butiner dans la pourpre de mes roses;—elles prendront leurs invalides avec moi, dans mon jardin;—mais jamais leur escadron aux cuirasses d’or n’obéira à un autre maître.
Ceci est clair,—n’est-ce pas?
![]() Un monsieur voyage dans le Midi,—sous votre nom,—et accepte
beaucoup de dîners.
Un monsieur voyage dans le Midi,—sous votre nom,—et accepte
beaucoup de dîners.
RÉPONSE.—1º Je ne suis jamais allé dans le Midi.—Une seule fois, en allant en Suisse,—comme j’arrivais à Lyon au mois de mai, et que je voyais le printemps à gauche et l’hiver à droite,—j’eus fort envie de descendre le Rhône au lieu de me diriger vers Genève;—mais je me rappelai à temps que j’étais attendu.
2º Je ne dîne jamais en ville.
Néanmoins,—je remercie ledit monsieur—de me mettre à même de connaître d’aussi bonnes dispositions à mon égard de la part de quelques habitants du Midi,—et je compatis d’avance au chagrin qu’il aura quelque jour d’être reconnu par quelqu’un et chassé à coups de bâton,—comme il le mérite.
![]() Votre absence de Paris vous fait le plus grand tort.
Votre absence de Paris vous fait le plus grand tort.
RÉPONSE.—Qu’appelez-vous mon absence de Paris?—Mon absence de Paris; mais voici une lettre de M. Léon Gozlan qui m’écrit: «J’ai vu hier votre barbe aux Variétés.»
En voici une de M. d’Épagny,—qui a la bonté de m’inviter à faire partie du comité de lecture du théâtre de l’Odéon.
Je ne suis pas toujours à Paris,—mais je ne suis pas toujours ailleurs.—On va vite à Paris à vol de guêpes, quand on n’en est qu’à seize heures par les messageries.—J’y suis aujourd’hui, plus près de vous que vous ne le croyez, que vous ne le voulez, peut-être. Je n’y serai pas demain;—mais savez-vous si je n’y serai pas après-demain?—m’avez-vous jamais connu autrement que libre et vagabond?—Croyez-vous que j’aie envie, comme une partie des bons Parisiens, de passer mon été à aller voir un dimanche les fortifications de Vincennes, un autre où en sont les fortifications de Belleville? Suis-je donc un forçat? pensez-vous que j’aie rompu mon ban parce que quelqu’un m’a vu pêcher des crevettes et des équilles sur les côtes de Normandie,—et croyez-vous que je ne sais plus ce qui se passe?
![]() Est-ce vous,—messieurs Soult, Humann,—monsieur Martin (du Nord),
etc., etc.; est-ce vous, messieurs, qui avez la bonté de craindre que
mon absence de Paris ne m’empêche de savoir ce que vous
faites?—Tranquillisez-vous, bonnes âmes,—je sais que vous êtes décidés
à passer la session qui vient,—que vous n’êtes pas sûrs de la Chambre,
et que, si l’adresse n’est pas favorable, vous êtes déterminés à la
dissoudre et à faire des élections.
Est-ce vous,—messieurs Soult, Humann,—monsieur Martin (du Nord),
etc., etc.; est-ce vous, messieurs, qui avez la bonté de craindre que
mon absence de Paris ne m’empêche de savoir ce que vous
faites?—Tranquillisez-vous, bonnes âmes,—je sais que vous êtes décidés
à passer la session qui vient,—que vous n’êtes pas sûrs de la Chambre,
et que, si l’adresse n’est pas favorable, vous êtes déterminés à la
dissoudre et à faire des élections.
Est-ce bien cela, messieurs?
Ai-je besoin d’être à Paris pour savoir que M. Guizot n’a, à ce sujet, qu’une seule inquiétude,—à savoir que le roi ne consente à des élections qu’autant qu’elles seraient faites par M. Molé?
Ai-je besoin d’être à Paris pour savoir que M. Molé et M. Guizot sont parfaitement d’accord sur ce point qu’ils ne peuvent s’accorder ensemble?
C’est comme si j’avais besoin d’être à Chartres pour savoir que M. Doublet de Boisthibaut, avocat du barreau de cette ville,—homme très-érudit et facétieux,—auteur d’un ouvrage estimé sur le système pénitentiaire—et de plusieurs Mémoires couronnés par des académies de province, etc., vient de mettre le comble à sa gloire en faisant distribuer à ses amis un distique latin,—commençant par ces mots:
Clam contra tabulas.....
distique que je ne puis citer, par la raison pour laquelle la Gazette des Tribunaux, dont M. Doublet est le correspondant ordinaire, n’a pu l’insérer.
![]() Les chiens lâches et hargneux aboient après vous quand vous n’êtes
pas là.
Les chiens lâches et hargneux aboient après vous quand vous n’êtes
pas là.
RÉPONSE.—Je me suis quelquefois efforcé de me mettre en colère dans de semblables circonstances, je n’ai jamais pu y réussir.—D’ailleurs, je ne puis rien infliger de pis à ces gens-là que leur propre lâcheté.
![]() LA VÉRITÉ SUR PLUSIEURS CHOSES.—L’autre jour, la mer commençait à
remonter, et le soleil achevait de se coucher derrière de gros nuages
gris;—entre les nuages et la mer il restait un espace où le ciel pur
était d’un bleu pâle, avec lequel se fondaient harmonieusement des
teintes jaunes et orangées.—A l’horizon, au-dessous de ces couleurs
brillantes, la mer était d’un bleu sombre presque noir.
LA VÉRITÉ SUR PLUSIEURS CHOSES.—L’autre jour, la mer commençait à
remonter, et le soleil achevait de se coucher derrière de gros nuages
gris;—entre les nuages et la mer il restait un espace où le ciel pur
était d’un bleu pâle, avec lequel se fondaient harmonieusement des
teintes jaunes et orangées.—A l’horizon, au-dessous de ces couleurs
brillantes, la mer était d’un bleu sombre presque noir.
Plus près de moi, éclairée obliquement par les derniers rayons du soleil affaibli,—elle était d’un azur pâle et mal glacé par grandes taches—comme de grands miroirs;—ici d’une belle couleur d’algue marine,—là d’un jaune peu lumineux.
Je revenais de pêcher des plies et des crevettes,—et, arrivé sur le sommet d’une petite colline qui conduit à ma demeure, je me retournai pour voir le beau spectacle de toutes ces belles couleurs enchâssées dans l’ombre et la nuit.
Quelqu’un me dit: «Bonsoir, voisin,» et je reconnus un habitant de la commune que j’habite,—un ancien militaire qui vit au bord de la mer avec sa petite retraite—et venait jouir comme moi de ce spectacle gratis, proportionné à ses moyens.—Nous prîmes deux stalles voisines sur le thym sauvage qui tapisse cette colline,—et nous regardâmes le ciel et la mer, puis nous parlâmes de choses et d’autres.
—Il paraît, voisin, que les choses vont bien mal là-bas, me dit-il en me désignant de la main la route que suivaient de gros nuages qui portaient de la pluie aux Parisiens.
Et, comme je ne répondis pas,—il continua:
J’ai lu LE journal ce matin,—tout va mal;—la France entière est en combustion.—Le journal était tout rempli de protestations de diverses villes et cités contre l’ordonnance de M. Humann,—et ces protestations, signées des citoyens les plus honorables, à ce que dit LE journal,—étaient faites plus contre le gouvernement actuel et contre ses allures—que contre l’ordonnance de recensement, qui n’est qu’un prétexte.—Il en arrive de tous les coins de la France.
D’autre part, les gardes nationales de partout—envoient des adresses emphatiques à la garde nationale de Toulouse, et ces adresses servent encore de cadre à des paroles de haine contre le gouvernement de Louis-Philippe.
Les élèves des écoles sont allés porter des compliments à M. de Lamennais—et faire assaut de phrases menaçantes et républicaines avec M. Ledru-Rollin, le nouveau député de la Sarthe.
D’après cela, voisin, il est évident que les citoyens les plus honorables de toutes les villes de France,—toutes les gardes nationales et toute la jeunesse,—en un mot que la France entière ne veut plus de Louis-Philippe.
Les Français sont braves, voisin; et, puisque le pays tout entier est si parfaitement d’accord, à ce que dit LE journal, et contre le gouvernement de Juillet et pour la République,—on ne s’en tiendra pas à envoyer des phrases boursouflées aux journaux.—J’en suis encore à comprendre comment, après une manifestation aussi universelle, on n’a pas renvoyé, hier soir, Louis-Philippe des Tuileries et proclamé la République ce matin.—Après cela, comme nous n’avons les nouvelles que de deux jours, nous ne savons pas bien ce qui en est à l’heure qu’il est,—et pour moi, quand je suis arrivé sur la côte,—comme il faisait encore jour, j’ai porté les yeux sur la jetée du Havre, où nous ne voyons plus maintenant que la lueur rouge du phare, pour voir si c’était toujours le drapeau tricolore qui y flottait.
—Rassurez-vous, mon voisin, lui dis-je,—les choses ne vont pas tout à fait aussi mal que vous le pensez.—Quel journal lisez-vous?
—Un journal que me prête un de mes voisins,—le National.
—Eh bien! si vous lisiez le Journal des Débats,—que ceux qui le lisent d’habitude appellent aussi «LE journal»,—vous verriez que tout est parfaitement tranquille,—que la garde nationale, les populations et les écoles, sont animées du meilleur esprit.
—Vous me rassurez.
—Je ne vous ai pas dit, mon voisin,—que cela fût non plus la vérité.
—Que voulez-vous que je croie alors?
—Ni l’un ni l’autre;—mais raisonnons un moment: la déduction que vous tirez de tout ce que vous avez vu dans le journal est parfaitement juste;—si le pays est si parfaitement d’accord, rien ne peut s’opposer à sa volonté;—je puis vous affirmer qu’on n’a, cependant, jusqu’à présent, prononcé ni la déchéance de Louis-Philippe, ni l’installation de la République;—il faut donc penser que le journal se trompe ou vous trompe;—c’est ce que nous allons examiner si vous voulez me donner du feu pour allumer ma pipe.
—Je fumerais volontiers aussi, me dit le voisin, donnez-moi du tabac.
—Tenez, en voici que je vous recommande;—il me vient d’un marchand de tabac de contrebande, fournisseur du duc d’Orléans et du duc de Nemours.—Le tabac que vend la régie, avec privilége du roi, est si mauvais, que les princes, qui devraient l’exemple de la soumission aux lois,—protégent la contrebande et fument un tabac prohibé.
Revenons aux protestations, aux lettres, aux adresses, etc.
Tantôt le journal vous dit: «Cette protestation est signée de plus de cent cinquante noms.»
Tantôt elle est revêtue de la signature des citoyens les plus honorables.
Tantôt, après la lettre, vous lisez: «Suit une foule ou une masse de signatures,» etc.
Dans une adhésion quelconque à quoi que ce soit, il faut examiner deux choses:—le nombre et la valeur des adhérents;—en effet, vous admettez que, sur dix hommes, il puisse arriver que l’opinion de quatre vaille mieux que celle des six autres—si vous composez ce nombre de dix de quatre hommes distingués par leurs connaissances, leur esprit et leur désintéressement,—et de six choisis parmi des ignorants, des avides et des fous.
Il ne faut pas se figurer qu’une ville tout entière—s’écrie: Nous le jurons!—ou Partons!—comme un peuple d’opéra.
Pour ce qui est des protestations signées de plus de cent cinquante noms, il faut songer que, même en ramenant à leurs proportions réelles les divers bourgs—appelés villes et cités par le journal depuis qu’ils ont protesté,—on ne peut supposer une population moindre de deux mille hommes.
—C’est la population d’Étretat, qui n’est qu’un village.
—Plus de cent cinquante ont signé,—cela veut dire cent cinquante et un;—c’est comme les gens qui, après avoir fait suivre leurs noms de tous leurs titres, grades et décorations,—disent, etc., etc., etc., quand ils ont fini.
Si cent cinquante et un citoyens ont signé, il s’ensuit tout naturellement que dix-huit cent quarante-neuf n’ont pas voulu signer,—ce qui fait une protestation beaucoup plus forte contre celle dont on fait tant de bruit.
Pour les protestations signées des noms les plus honorables—ou d’une foule ou d’une masse de signatures, soyez persuadé que ce ne sont qu’autant de périphrases adroites pour ne pas énoncer un nombre un peu mesquin.
Vous avez vu souvent sur les affiches de théâtre.
| LE PEUPLE: | MM. Arthur. |
| Léopold. | |
| VILLAGEOIS ET VILLAGEOISES: | M. Alcindor. |
| Mesdemoiselles Anastasie. | |
| Zéphyrine. |
Au théâtre, quand un acteur dit en scène: Le peuple demande du pain, le peuple est fait par un seul monsieur qui bourdonne et trépigne dans la coulisse;—la foule,—la masse,—le nombre considérable, doivent s’entendre ainsi.—Soyez bien sûr que, s’il y avait réellement un nombre considérable,—une foule et une masse,—on n’aurait pas manqué de vous en offrir le spectacle;—n’hésitez pas à croire que toute foule,—toute masse et tout nombre considérable, se composent d’un nombre inférieur au plus petit des nombres énoncés en chiffres.
Pour les citoyens les plus honorables... vous ne lisez pas le journal de M. Chambolle, voisin?
—Non.
—Si vous le lisiez, vous sauriez à quoi vous en tenir au sujet des citoyens les plus honorables[A]; vous y auriez vu que les CITOYENS LES PLUS HONORABLES de la ville de Levignac—ont couru la ville avec des cornes, des pincettes et des chaudrons,—chanté la Marseillaise devant la halle,—et ont COUVERT D’ORDURES les proclamations du préfet.—Voyons, de bonne foi,—représentez-vous cinq ou six seulement des citoyens honorables que vous connaissez,—et figurez-vous-les se livrant à de pareils exercices.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
![]() Ici, j’eus un tort de pédant.—Je dis: Ab uno disce omnes.—Je
parlai latin à un homme qui n’est pas obligé de le savoir et qui ne le
sait pas.—En quoi je ressemblai parfaitement au médecin malgré lui de
Molière.
Ici, j’eus un tort de pédant.—Je dis: Ab uno disce omnes.—Je
parlai latin à un homme qui n’est pas obligé de le savoir et qui ne le
sait pas.—En quoi je ressemblai parfaitement au médecin malgré lui de
Molière.
![]() Passons aux écoles. Tenez, j’ai reçu, il y a peu de temps, une
lettre d’un étudiant en droit.
Passons aux écoles. Tenez, j’ai reçu, il y a peu de temps, une
lettre d’un étudiant en droit.
«Monsieur, me dit-il, arrive-t-il qu’un démocrate exalté est envoyé, à tort ou à raison, pour quelques mois à Sainte-Pélagie,—ou qu’un avocat a crié à la Chambre plus haut que de coutume,—vous voyez le lendemain dans certains journaux:—Les délégués des écoles—ou une députation des écoles—ont été ou a été complimenter, etc., etc.»
Il y a effectivement quelques centaines d’étudiants,—toujours les mêmes, qu’on voit apparaître dans toutes les exhibitions démocratiques.—Mais ils ne sont députés délégués que par leurs convictions personnelles, sans avoir reçu pour cela aucun mandat de leurs condisciples, etc., etc.
![]() J’aime la jeunesse, parce que c’est encore ce qu’il y a de
meilleur.—Quand elle fait des folies, c’est, d’ordinaire, par
l’exagération de quelque sentiment généreux.—Dans dix ans d’ici, les
étudiants qui sont allés complimenter MM tels et tels riront bien de
cette démarche,—je n’ai pas le courage de les gourmander aujourd’hui de
cette petite manie de perdre de bonnes leçons de leurs professeurs pour
en aller donner de médiocres aux députés ou au roi.—Il faut se rappeler
les flatteries que leur a prodiguées ledit roi, il y a onze ans.—Il
est juste qu’il subisse aujourd’hui l’importance qu’il leur a donnée
alors.
J’aime la jeunesse, parce que c’est encore ce qu’il y a de
meilleur.—Quand elle fait des folies, c’est, d’ordinaire, par
l’exagération de quelque sentiment généreux.—Dans dix ans d’ici, les
étudiants qui sont allés complimenter MM tels et tels riront bien de
cette démarche,—je n’ai pas le courage de les gourmander aujourd’hui de
cette petite manie de perdre de bonnes leçons de leurs professeurs pour
en aller donner de médiocres aux députés ou au roi.—Il faut se rappeler
les flatteries que leur a prodiguées ledit roi, il y a onze ans.—Il
est juste qu’il subisse aujourd’hui l’importance qu’il leur a donnée
alors.
Nous n’avons plus à parler que des gardes nationales.—On a licencié la garde nationale de Toulouse; la première qui lui a envoyé une adresse de félicitations a été également licenciée.—J’ai d’abord cru que c’était cela qui amorçait les autres, et que c’était l’ennui de monter la garde qui poussait les gens à de semblables manifestations.—Je vous avouerai même, mon voisin,—que je méditais une protestation plus verte, plus boursouflée, plus subversive, plus louangeuse à l’égard des gardes nationales de Toulouse,—qu’aucune que vous ayez jamais lue,—ne voulant rien négliger pour arriver à un tel résultat;—mais on ne continue pas à licencier,—parce qu’on a sans doute découvert le véritable nombre des nombres considérables de signatures qui couvraient ces adresses.—J’ai donc ajourné la mienne.
![]() En mentionnant que certaines adresses et certaines protestations
étaient couvertes des signatures des citoyens les plus honorables,
les organes du parti démocratique ont avoué qu’ils ne donnaient pas la
même importance à toutes les adhésions; ils admettront donc qu’on
constate que quelques-uns des signataires n’ont pas toutes les lumières
désirables pour que leur opinion sur quoi que ce soit ait une grande
valeur,—puisqu’ils ont signé de leur croix, ne sachant écrire.
En mentionnant que certaines adresses et certaines protestations
étaient couvertes des signatures des citoyens les plus honorables,
les organes du parti démocratique ont avoué qu’ils ne donnaient pas la
même importance à toutes les adhésions; ils admettront donc qu’on
constate que quelques-uns des signataires n’ont pas toutes les lumières
désirables pour que leur opinion sur quoi que ce soit ait une grande
valeur,—puisqu’ils ont signé de leur croix, ne sachant écrire.
![]() Je ne parle que pour mémoire du renvoi par la cour royale de
Montpellier devant la cour d’assises de l’Aude de MM. V*** et
Guizard, cordonnier, pour avoir couvert une protestation de ce genre, en
faveur de la réforme électorale, d’un nombre considérable de
signatures honorables—mais fausses.
Je ne parle que pour mémoire du renvoi par la cour royale de
Montpellier devant la cour d’assises de l’Aude de MM. V*** et
Guizard, cordonnier, pour avoir couvert une protestation de ce genre, en
faveur de la réforme électorale, d’un nombre considérable de
signatures honorables—mais fausses.
Mon cher voisin, ces protestations, ces adresses, etc., sont, pour la plupart, envoyées toutes faites de Paris aux villes qui en demandent ou qui n’en demandent pas,—absolument comme faisaient, sous la Restauration, les hommes aujourd’hui au pouvoir; et bien des villes apprennent seulement par les journaux et avec un grand étonnement qu’elles sont livrées au trouble et à la discorde. Des commis voyageurs spéciaux colportent les listes et récoltent des signatures,—s’attachant plus au nombre qu’à une importance qu’il est difficile de discuter vu la distance,—toujours comme faisait, sous la Restauration, le parti libéral aujourd’hui aux affaires. Il a à subir les manœuvres qu’il a imaginées,—il les connaît pour les avoir pratiquées quinze ans; il aura donc plus de facilité pour se défendre,—mais il n’a guère le droit de se plaindre.
Mon voisin se leva, me serra la main et partit un peu rassuré,—me laissant occupé à regarder s’allumer les étoiles.
![]() Quand un fameux ministre disait:—Laissez, laissez, qu’ils
chantent, ils payeront,—c’est que de son temps ce n’était pas la
Marseillaise qu’on chantait.
Quand un fameux ministre disait:—Laissez, laissez, qu’ils
chantent, ils payeront,—c’est que de son temps ce n’était pas la
Marseillaise qu’on chantait.
![]() Quand M. Rossi a été nommé pair de France, quelqu’un a écrit à un
de ses cousins: «Cette nomination a dû vous causer une grande joie; car
moi, qui ne suis ni son parent, ni son ami, j’ai failli en mourir de
rire.»
Quand M. Rossi a été nommé pair de France, quelqu’un a écrit à un
de ses cousins: «Cette nomination a dû vous causer une grande joie; car
moi, qui ne suis ni son parent, ni son ami, j’ai failli en mourir de
rire.»
![]() Comme on parlait, devant l’archevêque de Paris, du duel, que
certains tribunaux condamnent et que d’autres acquittent,—monseigneur
Ollivier, évêque d’Évreux, dont on connaît l’impétuosité, eut
l’indiscrétion de dire à monseigneur Affre:—«Mais enfin, monsieur, si
on vous donnait un soufflet, que feriez-vous?—Monsieur, répondit
l’archevêque de Paris, je sais bien ce que je devrais faire, mais je ne
sais pas ce que je ferais.»
Comme on parlait, devant l’archevêque de Paris, du duel, que
certains tribunaux condamnent et que d’autres acquittent,—monseigneur
Ollivier, évêque d’Évreux, dont on connaît l’impétuosité, eut
l’indiscrétion de dire à monseigneur Affre:—«Mais enfin, monsieur, si
on vous donnait un soufflet, que feriez-vous?—Monsieur, répondit
l’archevêque de Paris, je sais bien ce que je devrais faire, mais je ne
sais pas ce que je ferais.»
![]() A propos, il ne faut pas que j’oublie ma note pour M. Affre.
A propos, il ne faut pas que j’oublie ma note pour M. Affre.
A MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE DE PARIS.
Note à l’appui de son discours dans lequel il tâche d’insinuer adroitement au roi Louis-Philippe que, malgré la grandeur et la vénération qui l’entourent, il ferait bien de se rappeler quelquefois qu’il n’est qu’un homme.—Plusieurs journaux racontent, de la manière suivante, une sortie du roi:
«Louis-Philippe est sorti, le 29 au soir, vers neuf heures, des Tuileries, accompagné du général Athalin. Il était précédé de M. Marut de Lombre et de deux officiers de paix. Une escouade nombreuse d’agents de police éclairait sa marche et le suivait à quelque distance. Après s’être arrêté quelques instants près de l’obélisque, le roi a gagné le rond-point des Champs-Élysées en longeant le côté droit du bois; puis il est rentré au château par le même chemin.»
![]() DÉNONCIATION CONTRE LES SAVANTS.—Il serait bon, je crois, de
commencer à surveiller les savants,—du moins dans l’application de
leurs théories.—J’ai dénoncé,—le mois dernier,—combien les savants
philanthropes ont fait mourir de faim de malades et de
prisonniers,—sous prétexte de doter l’humanité d’un nouvel aliment.
DÉNONCIATION CONTRE LES SAVANTS.—Il serait bon, je crois, de
commencer à surveiller les savants,—du moins dans l’application de
leurs théories.—J’ai dénoncé,—le mois dernier,—combien les savants
philanthropes ont fait mourir de faim de malades et de
prisonniers,—sous prétexte de doter l’humanité d’un nouvel aliment.
Voici un gaillard qui marche sur leurs traces, un peu timidement encore, il est vrai; mais soyez sûr qu’il ne lui manque qu’un peu d’encouragements, et qu’il est destiné à aller loin.
«M. Montain a mis sous les yeux de la Société d’agriculture de Lyon une nouvelle variété de pommes de terre.—L’échantillon se partage entre les membres de la Société d’agriculture, qui se proposent de propager cette nouvelle variété de solanées.»
Ceci est copié textuellement sur le rapport.
On se demande naturellement quels sont les avantages de cette importante découverte, si bien accueillie par une société savante,—et dont on va propager la culture avec tant de zèle et de sollicitude.
Sans doute, c’est un énorme tubercule renfermant plus de farine et de sucs nourriciers que tous ceux de la même espèce connus jusqu’ici?
Vous n’y êtes pas tout à fait;—reprenons le rapport fait par la Société d’agriculture de Lyon sur la pomme de terre de M. Montain:
«Cette nouvelle variété de pommes de terre, à cause de sa petitesse, est désignée sous le nom de pomme de terre haricot;—les plus grosses dépassent à peine le volume d’une noisette.»
M. Montain, sans aucun doute, encouragé par le favorable accueil de la Société d’agriculture de Lyon,—va s’efforcer de se rendre de plus en plus digne de la reconnaissance de ses contemporains et de la postérité.—Je suis d’avance persuadé que ses efforts seront couronnés de succès, et que l’année prochaine nous lirons dans les annales scientifiques:
«1842.—M. Montain a envoyé à la Société d’agriculture—une nouvelle variété de la pomme de terre haricot.—Les tubercules de celle-ci sont durs comme des cailloux et ne cuisent pas au feu; on l’appelle pomme de terre silex.—L’échantillon se partage entre les membres de la Société d’agriculture, qui se proposent de propager cette nouvelle variété de solanées.»
Puis, d’année en année, de progrès en progrès:
«1843.—M. Montain a envoyé à la Société d’agriculture—une nouvelle variété de sa pomme de terre silex.—Celle-ci n’est pas moins dure que celle de l’année dernière, elle ne cuit pas davantage,—mais elle est beaucoup plus petite;—son principal mérite est d’être rentrée dans la famille des solanées, qui se compose entièrement de plantes vénéneuses, au milieu desquelles la pomme de terre faisait une anomalie désagréable et embarrassante pour la science.—La nouvelle solanée régénérée—est un poison violent.—L’échantillon se partage entre les membres de la Société d’agriculture, qui se proposent de propager cette nouvelle variété de solanées.»
«1844.—Enfin, M. Montain est arrivé au plus haut point de perfection.—Il a envoyé à la Société d’agriculture une nouvelle variété de pommes de terre,—qui ne produit aucun tubercule.—On peut en planter autant qu’on veut,—on ne retrouve jamais rien à la place.—L’échantillon se partage entre les membres de la Société d’agriculture, qui se proposent de propager cette nouvelle variété de solanées.»
![]() C’est du reste une manie d’agriculteur et d’horticulteur dont je me
rappelle un autre exemple.—Les horticulteurs qui se respectent ont
proscrit la rose aux cent feuilles, qui reste malgré eux la plus belle
rose connue.—Il y a quelques années, j’allai voir les roses de
Hardy,—le jardinier du Luxembourg, à Paris;—c’est la plus riche et la
plus belle collection qu’il y ait en Europe.—Je vis pour la première
fois une admirable rose blanche,—aujourd’hui bien connue des amateurs,
à laquelle il a donné le nom de madame Hardy.
C’est du reste une manie d’agriculteur et d’horticulteur dont je me
rappelle un autre exemple.—Les horticulteurs qui se respectent ont
proscrit la rose aux cent feuilles, qui reste malgré eux la plus belle
rose connue.—Il y a quelques années, j’allai voir les roses de
Hardy,—le jardinier du Luxembourg, à Paris;—c’est la plus riche et la
plus belle collection qu’il y ait en Europe.—Je vis pour la première
fois une admirable rose blanche,—aujourd’hui bien connue des amateurs,
à laquelle il a donné le nom de madame Hardy.
Je fis à l’habile jardinier des compliments mérités, auxquels je dus probablement d’être introduit dans le saint des saints,—dans une partie mystérieuse du jardin, où il me fit voir la rose berberidifolia, qui est une sorte de corcoplis épineux;—puis, me conduisant un peu plus loin, il me dit: «En voici une qui, depuis trois ans que je l’ai obtenue de graines, n’a pas donné une seule fleur.»
Je n’ai pas eu occasion, depuis ce temps, de retourner au Luxembourg,—dans le beau mois des roses, et je ne sais pas si Hardy aura eu le bonheur de voir son rosier perdre ses feuilles. Le ciel lui devait cela.
![]() Voici bien longtemps que les partis crient les uns contre les
autres,—se jetant réciproquement à la tête les mêmes reproches et les
mêmes injures—comme des balles de paume;—hélas! mes braves gens,—vous
luttez contre quelque chose qui existait avant vous et qui vous
survivra,—contre l’avidité et contre l’orgueil, vous en avez tous
votre part;—si les uns n’en étaient pas infectés,—ils ne se
plaindraient pas tant d’y voir les autres en proie;—l’avidité et
l’orgueil de vos adversaires ne vous irritent tant que parce que ces
vices gênent par la concurrence votre orgueil et votre avidité.
Voici bien longtemps que les partis crient les uns contre les
autres,—se jetant réciproquement à la tête les mêmes reproches et les
mêmes injures—comme des balles de paume;—hélas! mes braves gens,—vous
luttez contre quelque chose qui existait avant vous et qui vous
survivra,—contre l’avidité et contre l’orgueil, vous en avez tous
votre part;—si les uns n’en étaient pas infectés,—ils ne se
plaindraient pas tant d’y voir les autres en proie;—l’avidité et
l’orgueil de vos adversaires ne vous irritent tant que parce que ces
vices gênent par la concurrence votre orgueil et votre avidité.
![]() On vient de condamner plusieurs marchands à l’amende pour avoir
laissé subsister dans leurs boutiques des dénominations que prohibe la
nouvelle loi des poids et mesures:—un épicier pour avoir mis sur sa
porte: sucre à vingt sous la livre;—il n’y a plus de sous ni de
livre.
On vient de condamner plusieurs marchands à l’amende pour avoir
laissé subsister dans leurs boutiques des dénominations que prohibe la
nouvelle loi des poids et mesures:—un épicier pour avoir mis sur sa
porte: sucre à vingt sous la livre;—il n’y a plus de sous ni de
livre.
Le gouvernement actuel veut prendre sa revanche de l’absurdité de 93 qui défendait de s’appeler de Saint-Cyr, parce qu’il n’y avait plus ni de, ni saints, ni sire.
Peut-être le ministre devrait-il commencer par retirer de la circulation les monnaies diverses sur lesquelles on lit:
Deux sous,—vingt sous,—etc., etc.; il devient embarrassant de ne pouvoir plus énoncer la monnaie que l’on donne par la dénomination qu’elle porte;—il faut donc à présent lire et épeler ainsi:—d—e—u—x—dix,—s—o—u—s—centimes,—dix centimes.
Longtemps avant la naissance de M. Duchâtel, Chilpéric supprima deux lettres de l’alphabet—avec défense de s’en servir, sous peine d’être essorillé,—c’est-à-dire d’avoir les oreilles coupées;—j’ai su autrefois quelles étaient ces deux lettres,—je l’ai oublié,—je n’ai jamais su le motif de l’animosité qu’avait contre elles le roi Chilpéric.
Mais ce qu’il y a de triste pour le ministre, c’est que ces deux lettres eurent leurs martyrs—comme toute chose persécutée;—deux savants, qui avaient pour elles une affection aussi mystérieuse dans ses causes que la haine du roi,—s’obstinèrent à les employer et furent essorillés;—après quoi ils s’en donnèrent à cœur joie,—le roi n’avait pas prévu la récidive,—et d’ailleurs il était au moins difficile de couper deux fois les mêmes oreilles.
![]() LE SUFFRAGE UNIVERSEL. On ne se figure pas de combien d’embarras on
se tire avec un peu d’esprit.—Voici bien longtemps qu’on fait tous les
jours des phrases en faveur du suffrage universel en matière
d’élections;—que l’on colporte des pétitions pour la réforme
électorale; que l’on compte, pour le conquérir, sur le tapage, sur
l’émeute, sur une nouvelle révolution.—Un droguiste anglais vient de
réaliser ce rêve bruyant de nos politiques.—Partisan du suffrage
universel et cependant faisant partie de la classe privilégiée des
électeurs, il a mis sur le devant de sa boutique l’avis suivant, en gros
caractères: «Tous les habitants de ce district, exclus par la loi du
droit de voter, sont engagés à vouloir bien me faire connaître quel est
celui des deux candidats,—Garnett et Brotherton,—auquel je dois donner
ma voix.»
LE SUFFRAGE UNIVERSEL. On ne se figure pas de combien d’embarras on
se tire avec un peu d’esprit.—Voici bien longtemps qu’on fait tous les
jours des phrases en faveur du suffrage universel en matière
d’élections;—que l’on colporte des pétitions pour la réforme
électorale; que l’on compte, pour le conquérir, sur le tapage, sur
l’émeute, sur une nouvelle révolution.—Un droguiste anglais vient de
réaliser ce rêve bruyant de nos politiques.—Partisan du suffrage
universel et cependant faisant partie de la classe privilégiée des
électeurs, il a mis sur le devant de sa boutique l’avis suivant, en gros
caractères: «Tous les habitants de ce district, exclus par la loi du
droit de voter, sont engagés à vouloir bien me faire connaître quel est
celui des deux candidats,—Garnett et Brotherton,—auquel je dois donner
ma voix.»
Beaucoup se rendirent à cet avis.—A chacun de ceux qui se présentaient, on ouvrait un registre sur lequel il inscrivait son nom, son adresse et le nom du candidat de son choix.—La veille des élections, l’affiche collée sur la devanture de la boutique fut remplacée par une autre ainsi conçue:
«Cent cinquante-sept citoyens m’ont engagé à voter pour Brotherton, cent vingt-trois pour Garnett.—En conséquence, demain matin je voterai pour Brotherton.»
Comme on le voit, il n’y a rien de plus simple que cet expédient.—Après un tel exemple, ceux de nos électeurs partisans du suffrage universel qui n’imiteront pas le droguiste de Salford,—et qui continueront à demander bruyamment la réforme,—seront à nos yeux convaincus de ne la point demander pour l’obtenir, mais pour faire du tapage.
![]() Et d’ailleurs que demandez-vous?—le droit de voter.—Mais il me
semble que vous le prenez assez largement—Le roi choisit un
ministre,—M. Guizot;—nomme un préfet,—M. Mahul;—vous ahurissez M.
Guizot d’un charivari;—vous chassez M. Mahul avec des pierres et des
hurlements.—Cela me semble équivaloir pour le moins à un vote contre
eux,—et une foule de carrés de papier, se prétendant les organes de
l’opinion publique,—demandant le règne de l’intelligence,—racontent
avec approbation les charivaris et les émeutes.—Prenons le journal de
M. Chambolle, par exemple.
Et d’ailleurs que demandez-vous?—le droit de voter.—Mais il me
semble que vous le prenez assez largement—Le roi choisit un
ministre,—M. Guizot;—nomme un préfet,—M. Mahul;—vous ahurissez M.
Guizot d’un charivari;—vous chassez M. Mahul avec des pierres et des
hurlements.—Cela me semble équivaloir pour le moins à un vote contre
eux,—et une foule de carrés de papier, se prétendant les organes de
l’opinion publique,—demandant le règne de l’intelligence,—racontent
avec approbation les charivaris et les émeutes.—Prenons le journal de
M. Chambolle, par exemple.
Le journal de M. Chambolle est un journal naïf. Dernièrement, le Journal des Débats ayant dit: «Une feuille banale et stérile,» sans désigner autrement la feuille dont il voulait parler,—le journal de M. Chambolle a dit le lendemain: «Nous répondrons au Journal des Débats, etc.»
![]() Le journal de M. Chambolle s’est donné au ministère de M.
Thiers.—Il l’a soutenu de toutes ses forces, de toutes ses colonnes.
Le journal de M. Chambolle s’est donné au ministère de M.
Thiers.—Il l’a soutenu de toutes ses forces, de toutes ses colonnes.
Aujourd’hui il enregistre avec joie les charivaris donnés à M. Guizot.—Il les appelle manifestations de l’opinion publique.
Mais voici qu’on en donne également à M. Thiers.—Comment appréciera-t-il ceux-ci?
![]() Le National, lors de la fameuse affaire de Saint-Bérain, a mis
tout au long dans ses colonnes toutes les pièces du procès, le
réquisitoire, la condamnation, etc., etc.
Le National, lors de la fameuse affaire de Saint-Bérain, a mis
tout au long dans ses colonnes toutes les pièces du procès, le
réquisitoire, la condamnation, etc., etc.
Il a appelé le jugement: la justice du pays.—Aujourd’hui, un jugement aussi sévère au moins vient de frapper la Société plâtrière, dirigée par MM. Higonnet et Laffitte. Le National n’insère pas le jugement et maltraite le tribunal. Il accuse le président de partialité, etc. Qu’a donc fait le National de sa vertueuse emphase? Ses amis sont-ils infaillibles et au-dessus des lois,—par cela seul qu’ils sont ses amis?—Prenez garde,—messieurs,—la presse est comme ce bourreau qui, ayant coupé toutes les têtes, finit par se guillotiner lui-même.—Jamais un tyran, en aucun temps,—ne s’est enivré de sa puissance, n’a fait des orgies de despotisme comme la presse.—Tous les pouvoirs sont tombés sous ses coups.—Elle seule peut se tuer,—elle se tuera,—elle se tue.
![]() LA PUDEUR D’EAU DOUCE ET LA PUDEUR D’EAU SALÉE.—Quelqu’un me
disait l’autre jour:
LA PUDEUR D’EAU DOUCE ET LA PUDEUR D’EAU SALÉE.—Quelqu’un me
disait l’autre jour:
«A cette époque des eaux et des bains de mer, il est une chose qui frappe nécessairement l’esprit, même le moins observateur,—c’est que la pudeur des femmes est pour beaucoup d’entre elles une question d’usage, de mode et de convention.
»J’ai vu successivement des années où il était reçu de montrer ses épaules, d’autres où c’était la gorge qu’on laissait voir.—Une femme habillée pour le bal, c’est-à-dire presque nue,—ne recevrait pas en ce costume un homme qui viendrait lui faire une visite.—Il serait réputé inconvenant de montrer à un seul ce qu’on fera voir à deux cents une heure après.
»Il y a à Paris, sur la Seine, des bains froids fort à la mode depuis quelques années pour les femmes et surtout pour les jeunes filles, qui y apprennent à nager.—Leur costume est exactement celui qu’on porte aux bains de mer.—Eh bien! on ne laisserait, sous aucun prétexte, un père y mener sa fille ni un mari y accompagner sa femme.—Un homme qui y mettrait le pied—ferait jeter des cris de paon à toutes les femmes qui y barbotent.
»Mais à la mer, c’est différent.—Au Havre, par exemple, les femmes se baignent sous les yeux des promeneurs de la jetée,—pêle-mêle avec les hommes vêtus d’un simple caleçon,—personne ne s’en offusque.—Les femmes pensent-elles que, de même qu’on a longtemps permis aux marins de jurer,—surtout au théâtre,—la mer autorise bien des choses,—et qu’il y a une pudeur d’eau douce et une pudeur d’eau salée?»
A ces paroles, je fus saisi d’une indignation convenable,—et, tout en voyant bien ce qu’avait de spécieux l’accusation de mon interlocuteur, je m’occupai de le réfuter,—ce que je fis en ces termes:
«Il faut cependant tout dire, monsieur.—S’il semble, au premier abord, que cette pudeur, si féroce dans la Seine,—soit comme les poissons de rivière qui ne peuvent vivre dans l’Océan—et remontent les fleuves sans se laisser jamais entraîner jusqu’à leur embouchure, on doit remarquer que les femmes, aux bains de mer, font à la chasteté le plus grand sacrifice qu’on puisse faire à aucune vertu:—elles lui sacrifient leur beauté.
»On sait l’histoire de cette vierge chrétienne qui se coupa le nez pour échapper à la passion d’un proconsul romain.
»Eh bien! vous voyez au Havre, à Dieppe ou à Trouville trois cents femmes qui deux fois par jour renouvellent ce trait si vanté.
»Avec leur costume de laine,—leur veste,—leur pantalon et leur bonnet de toile cirée,—elles semblent une foule de singes teigneux qui gambadent sur la plage.
»Obligées de se baigner au milieu des hommes,—elles ont ingénieusement imaginé de s’entourer d’un voile de laideur.»
Mon interlocuteur se retira humilié et me laissa fier de la belle défense que j’avais faite en faveur du beau sexe.
![]() Aux fêtes de Juillet, célébrées à Paris,—un plaisant, faisant
allusion aux affaires de Toulouse, avait mis le soir sur un transparent
ces quatre vers:
Aux fêtes de Juillet, célébrées à Paris,—un plaisant, faisant
allusion aux affaires de Toulouse, avait mis le soir sur un transparent
ces quatre vers:
La police n’a pas tardé à faire supprimer le transparent, devant lequel commençait à s’amasser une foule curieuse.
![]() Il y avait aux Champs-Élysées—des baraques pour les
spectacles,—d’autres pour les restaurateurs;—une avait sur sa façade
un large écriteau ainsi conçu: Secours aux blessés.
Il y avait aux Champs-Élysées—des baraques pour les
spectacles,—d’autres pour les restaurateurs;—une avait sur sa façade
un large écriteau ainsi conçu: Secours aux blessés.
Les journaux ministériels racontaient le lendemain avec orgueil que, dans toute la fête, il n’y avait eu personne de tué.
![]() LES PHÉNOMÈNES.—Tout ce tumulte à propos du recensement a été fort
utile aux journaux. On sait leur embarras pendant les vacances des
Chambres,—et de combien de phénomènes, de miracles et d’accidents ils
surchargent à cette époque la crédulité de leurs lecteurs. Il commençait
à mourir pas mal de mendiants dans la besace desquels on trouvait
trente-deux mille francs en or.—Les soldats français échappés de la
Sibérie reparaissaient à l’horizon,—ainsi que les enfants à deux têtes
et le grand serpent de mer, inventé par les rédacteurs du Figaro en
1829. Beaucoup de pianistes de douze ans profitaient de la situation
pour offrir cinq lignes agréables pour eux-mêmes, qu’on admettait avec
empressement,—et on rendait compte dans tous les feuilletons de
l’epppppopppéeee de M. Soumet.
LES PHÉNOMÈNES.—Tout ce tumulte à propos du recensement a été fort
utile aux journaux. On sait leur embarras pendant les vacances des
Chambres,—et de combien de phénomènes, de miracles et d’accidents ils
surchargent à cette époque la crédulité de leurs lecteurs. Il commençait
à mourir pas mal de mendiants dans la besace desquels on trouvait
trente-deux mille francs en or.—Les soldats français échappés de la
Sibérie reparaissaient à l’horizon,—ainsi que les enfants à deux têtes
et le grand serpent de mer, inventé par les rédacteurs du Figaro en
1829. Beaucoup de pianistes de douze ans profitaient de la situation
pour offrir cinq lignes agréables pour eux-mêmes, qu’on admettait avec
empressement,—et on rendait compte dans tous les feuilletons de
l’epppppopppéeee de M. Soumet.
N. B. Peut-être quelqu’un des puristes qui m’honorent de leur correspondance et qui me font des avanies périodiques au sujet des fautes d’impression qui se rencontrent dans les Guêpes va-t-il m’écrire pour me faire de justes observations sur la façon dont ce mot est écrit.—Pour lui éviter ce souci, je lui réponds d’avance que j’ai essayé ainsi de donner une idée de la manière dont M. Soumet prononce ce mot quand il parle de son ouvrage.
Les affaires de Toulouse, le recensement,—les protestations, les adresses, tout cela est venu mettre la France dans l’état normal;—les phénomènes sont momentanément rentrés dans leurs cartons.
![]() TOUJOURS LA MÊME CHOSE.—Si décidément il ne reste plus qu’à
recommencer les choses déjà faites,—ce n’est vraiment pas la peine de
s’agiter si fort.
TOUJOURS LA MÊME CHOSE.—Si décidément il ne reste plus qu’à
recommencer les choses déjà faites,—ce n’est vraiment pas la peine de
s’agiter si fort.
On l’a dit avec raison, l’esprit humain marche en cercle, et il n’y a de nouveau que ce qu’on a eu le temps d’oublier.—Plusieurs personnes en ce temps me paraissent se hâter un peu trop d’inventer certaines choses,—que l’on se rappelle fort bien.
Espartero, duc de la Victoire, que la reine Christine appelle, dit-on, maintenant, prince de la Sottise et marquis de la Trahison,—avait un discours à faire.—Il a pris et récité un discours de Bonaparte à la Convention, sans y changer un seul mot.
M. Arzac, ex-maire de Toulouse, sommé de se retirer de la mairie,—répéta le mot de Mirabeau, et dit:
—Je ne sortirai que par la violence!
—Eh bien, monsieur, lui dit M. Duval,—je vais vous faire arrêter.
M. Arzac se trouva tout à coup embarrassé dans son rôle,—comme tout acteur auquel son camarade refuserait de donner la réplique.—Le cas n’était pas prévu.—La scène de Mirabeau finissait là,—et le maire de Toulouse fut forcé de dire:
—Je trouve cette menace une violence morale suffisante, et je me retire.
Puis il sortit du théâtre.
![]() Le mot de M. Arzac—violence morale—a eu du succès.—En voici
une imitation que je trouve dans un journal de la même ville de
Toulouse:—«Le sieur Raynal, cordonnier, a été arrêté;—il a subi des
violences morales ayant pour but d’obtenir l’adresse d’un de ses
ouvriers. Sur son refus, on a menacé de l’emprisonner, et sa fermeté
n’a pas résisté à cette dernière épreuve. Il n’y a pas de termes assez
forts pour qualifier, etc., etc., etc.»
Le mot de M. Arzac—violence morale—a eu du succès.—En voici
une imitation que je trouve dans un journal de la même ville de
Toulouse:—«Le sieur Raynal, cordonnier, a été arrêté;—il a subi des
violences morales ayant pour but d’obtenir l’adresse d’un de ses
ouvriers. Sur son refus, on a menacé de l’emprisonner, et sa fermeté
n’a pas résisté à cette dernière épreuve. Il n’y a pas de termes assez
forts pour qualifier, etc., etc., etc.»
Je voudrais savoir en quoi consistent les violences morales. Une menace d’emprisonnement n’est pas violence;—c’est cependant bien plus terrible que les violences morales dont on se plaint avec tant d’éloquence, puisque la fermeté du cordonnier Raynal,—qui avait résisté aux violences morales, n’a pu résister à cette dernière épreuve:—la menace d’être mis en prison.
![]() LES BANQUETS.—Nos pères dînaient ensemble pour chanter, rire,
boire, manger, causer avec abandon et avec esprit.
LES BANQUETS.—Nos pères dînaient ensemble pour chanter, rire,
boire, manger, causer avec abandon et avec esprit.
Aujourd’hui—un dîner est une action politique; on dîne contre ou pour le gouvernement, contre ou pour un principe.
C’est une chose bien ridicule que ces banquets.—Peu importe—contre ou pour quel principe ou quel gouvernement on mange et on boit.
Un poëte latin a dit de ces festins où l’on se querelle,—de ces festins constitutionnels qu’il semblait prévoir:
Comment n’est-on pas honteux d’avouer,—que dis-je? de publier dans les journaux,—que c’est l’estomac chargé de viandes,—la tête appesantie par le vin, que l’on discute d’une langue épaisse les intérêts les plus sérieux du pays!
Mais, dans cette situation, après vos dîners de province de huit heures,—vous refuseriez de vendre ou d’acheter cent cinquante bottes de luzerne,—vous vous défieriez comme d’un voleur d’un homme qui voudrait vous faire conclure un marché ou un arrangement,—vous n’oseriez pas décider de tuer et de saler un des porcs de votre étable.
![]() M. DUTEIL ET M. CHAMPOLLION.—J’ai reçu un dictionnaire des
hiéroglyphes, par M. Camille Duteil.—C’est un livre hardiment conçu et
simplement écrit,—ayant moins pour but encore d’éclaircir les
hiéroglyphes que de mettre en lumière que M. Champollion, qui en fait
son état, n’y entend absolument rien.—Peut-être M. Champollion
prépare-t-il un livre pour prouver la même chose à l’égard de M.
Duteil.—Nous autres, ignorants, nous sommes forcés de nous en rapporter
aux érudits, même pour l’opinion qu’ils ont les uns des autres.—En
attendant, voici une petite anecdote à l’appui de l’opinion de M. Duteil
sur M. Champollion.
M. DUTEIL ET M. CHAMPOLLION.—J’ai reçu un dictionnaire des
hiéroglyphes, par M. Camille Duteil.—C’est un livre hardiment conçu et
simplement écrit,—ayant moins pour but encore d’éclaircir les
hiéroglyphes que de mettre en lumière que M. Champollion, qui en fait
son état, n’y entend absolument rien.—Peut-être M. Champollion
prépare-t-il un livre pour prouver la même chose à l’égard de M.
Duteil.—Nous autres, ignorants, nous sommes forcés de nous en rapporter
aux érudits, même pour l’opinion qu’ils ont les uns des autres.—En
attendant, voici une petite anecdote à l’appui de l’opinion de M. Duteil
sur M. Champollion.
C’était à l’époque où M. Denon s’occupait avec tant de zèle des antiquités égyptiennes;—il recevait fréquemment des cargaisons de momies et de papyrus.—Un brave garçon, peintre intelligent, nommé Machereau,—était chargé de démêler et de copier les hiéroglyphes,—auxquels il n’avait pas la prétention de comprendre la moindre chose.
Un jour M. Denon l’appela de grand matin, et lui dit: «Mon cher Machereau, voici de la besogne:—il faut que cela soit copié pour ce soir; j’attends M. Champollion à dîner,—je veux le régaler de la primeur de ces hiéroglyphes au dessert;—l’original est un peu vieux, déchiré et confus,—faites-nous-en une copie nette et soignée.»
Machereau se met à l’ouvrage avec ardeur;—mais à peine avait-il commencé, qu’il renverse un encrier sur la bande de papyrus. Il éponge, il essuie, il gratte,—impossible d’enlever l’encre et de découvrir une seule des figures qu’il avait à reproduire.—Je ne vous peindrai pas son désespoir.—«Le papyrus est perdu, disait-il,—mais si encore le malheur n’était arrivé qu’après une copie faite, M. Denon aurait pu me pardonner.»
Cette idée en enfanta une autre.—«Parbleu,—dit-il, depuis le temps que je copie ces maudites images, je ne vois pas en quoi elles diffèrent les unes des autres; c’est toujours une même kyrielle d’ibis, d’ânes, d’étoiles, d’hommes à têtes de chiens, etc.—Je ne sais vraiment pas l’importance qu’on y peut attacher;—toujours est-il que M. Denon va me mettre à la porte si je lui avoue mon accident.»—Il resta quelques instants abattu,—puis tout à coup il se décida à tenter un coup de désespoir.—«N’importe,—dit-il,—je vais leur faire une vingtaine de pages de crocodiles,—d’ibis, de taureaux,—de tout ce que je copie d’ordinaire;—peut-être M. Champollion ne viendra pas,—ou bien je puis soutenir que ma copie est exacte,—et que ce n’est pas ma faute si l’auteur du manuscrit manque de clarté dans son style.»
Machereau entasse les ibis, les ânesses,—les vases.—M. Champollion arrive; M. Denon invite à dîner Machereau, qui refuse; mais M. Denon insiste tellement, que Machereau est contraint d’accepter.—Le dîner se passe trop vite au gré du malheureux peintre. M. Denon lui dit: «Machereau, faites donc voir à M. Champollion ce que vous savez.»
Machereau fait répéter l’ordre,—c’est une minute de gagnée; mais elle se passe, il se lève et sort.—«Cent fois, disait-il en racontant sa mésaventure, j’eus envie de ne plus rentrer, de m’enfuir et de ne jamais remettre les pieds chez M. Denon.» Cependant il revient tour à tour pâle et cramoisi.—Il donne ses feuillets à M. Denon, qui les transmet à M. Champollion:—c’était encore une minute,—mais ce n’était qu’une minute pour retarder le moment où on allait découvrir l’imposture et l’expulser honteusement.—M. Champollion prend les prétendus hiéroglyphes,—les examine,—les lit, et explique sans hésiter—ce qui ne voulait absolument rien dire.
![]() Une chose digne de quelque remarque pour les esprits justes et amis
du vrai,—c’est que cette même époque où on prodigue tant d’injures au
souverain et à tout ce qui l’approche—est également celle où l’on
adresse aux princes les flatteries les plus ridicules:—cela vient de ce
que ce pays est en proie à une insatiable avidité.—Il n’y a de la
flatterie à l’injure que la différence qui existe entre la mendicité—et
l’attaque à main armée.—Toutes deux ont le même but et ne diffèrent que
par les moyens.
Une chose digne de quelque remarque pour les esprits justes et amis
du vrai,—c’est que cette même époque où on prodigue tant d’injures au
souverain et à tout ce qui l’approche—est également celle où l’on
adresse aux princes les flatteries les plus ridicules:—cela vient de ce
que ce pays est en proie à une insatiable avidité.—Il n’y a de la
flatterie à l’injure que la différence qui existe entre la mendicité—et
l’attaque à main armée.—Toutes deux ont le même but et ne diffèrent que
par les moyens.
Ceux-là soutiennent les abus pour en profiter,—ceux-là les attaquent pour les conquérir.
![]() Le 16 du mois d’août,—le duc d’Aumale passait à Valence avec son
régiment;—M. Delacroix, maire de la ville—et député de la Drôme, crut
que cela lui donnait le droit de haranguer le prince, et il en usa.—La
chose fut raisonnablement longue, et M. le maire crut qu’elle se
terminerait agréablement par un vivat énergique;—il s’écria, en agitant
son chapeau: Vive le duc... d’Angoulême!
Le 16 du mois d’août,—le duc d’Aumale passait à Valence avec son
régiment;—M. Delacroix, maire de la ville—et député de la Drôme, crut
que cela lui donnait le droit de haranguer le prince, et il en usa.—La
chose fut raisonnablement longue, et M. le maire crut qu’elle se
terminerait agréablement par un vivat énergique;—il s’écria, en agitant
son chapeau: Vive le duc... d’Angoulême!
Ce lapsus linguæ—n’est pas sans exemples:—sous la Restauration, le maire de la ville de Tain, dans le même département, termina un discours au duc d’Angoulême par le cri de Vive l’Empereur!
Vous riez,—mais j’aurais voulu vous voir à sa place.—A cette époque, en 1815,—à Tournon (Ardèche), les mêmes autorités proclamèrent trois fois, le même jour, tour à tour Napoléon le Grand et Louis le Désiré,—en se félicitant chaque fois de l’heureux événement.
![]() Revenons aux flatteries grotesques dont je voulais parler.—Les
journaux ont fort loué le jeune duc,
Revenons aux flatteries grotesques dont je voulais parler.—Les
journaux ont fort loué le jeune duc,
1º D’avoir fumé des cigares;—une lettre que je reçois m’affirme que c’était une pipe.—J’accueillerai avec gratitude les renseignements qui me seront envoyés à ce sujet;
2º D’avoir marché sans gants;
3º D’avoir,—étant descendu de cheval, gravi une côte comme un simple piéton.
Dès l’instant que vous n’êtes plus à cheval,—vous passez à l’état de piéton, quelque illustre que soit le sang qui coule dans vos veines.—De bonne foi, le prince ne pouvait faire autrement,—et il n’y a pas plus lieu de le louer de cela que de ce qu’il aurait monté la côte comme un cavalier, s’il était resté à cheval, etc., etc., etc.
Voir,—pour ce que je pense de ces voyages entremêlés de discours,—le volume de la première année,—page 15.
![]() Louis XIII disait que les harangues lui avaient fait blanchir les
cheveux de bonne heure.—Le peuple souverain entend plus de discours
qu’aucun roi de ses prédécesseurs;—jusqu’à ce jour il ne lui manque
aucun des ennuis de la royauté.
Louis XIII disait que les harangues lui avaient fait blanchir les
cheveux de bonne heure.—Le peuple souverain entend plus de discours
qu’aucun roi de ses prédécesseurs;—jusqu’à ce jour il ne lui manque
aucun des ennuis de la royauté.
![]() Il y a dans la maison du roi—plusieurs domestiques dont on est
mécontent pour des causes graves;—la reine supplie perpétuellement pour
qu’ils ne soient pas chassés;—dans sa triste préoccupation, elle craint
qu’un homme, livré au désespoir, ne renouvelle contre son mari—des
tentatives auxquelles il a jusqu’ici échappé avec tant de bonheur.
Il y a dans la maison du roi—plusieurs domestiques dont on est
mécontent pour des causes graves;—la reine supplie perpétuellement pour
qu’ils ne soient pas chassés;—dans sa triste préoccupation, elle craint
qu’un homme, livré au désespoir, ne renouvelle contre son mari—des
tentatives auxquelles il a jusqu’ici échappé avec tant de bonheur.
![]() Mademoiselle Esther, qui est une très-belle fille, a personnifié
les Guêpes dans une pièce du théâtre des Variétés.
Mademoiselle Esther, qui est une très-belle fille, a personnifié
les Guêpes dans une pièce du théâtre des Variétés.
![]() Dans une ville où passait le général Saint-Michel,—on a peint sur
un transparent un bourgeois et un soldat se donnant la main et couronnés
par un ange.—Certains journaux ont appelé cela un magnifique
transparent.—Avouez, messieurs, que si ce transparent avait été fait à
propos du roi ou de quelque prince, vous l’eussiez trouvé
burlesque,—comme il l’est.
Dans une ville où passait le général Saint-Michel,—on a peint sur
un transparent un bourgeois et un soldat se donnant la main et couronnés
par un ange.—Certains journaux ont appelé cela un magnifique
transparent.—Avouez, messieurs, que si ce transparent avait été fait à
propos du roi ou de quelque prince, vous l’eussiez trouvé
burlesque,—comme il l’est.
![]() Un journal de l’opposition,—qui enregistre d’ordinaire avec
enthousiasme les gueuletons divers de son parti—sous le nom de
banquets patriotiques, appelle un banquet ministériel—une séance
bachique.—Toutes ces ripailles sont également ridicules.
Un journal de l’opposition,—qui enregistre d’ordinaire avec
enthousiasme les gueuletons divers de son parti—sous le nom de
banquets patriotiques, appelle un banquet ministériel—une séance
bachique.—Toutes ces ripailles sont également ridicules.
![]() Un député allait quitter Paris; il s’habillait pour aller faire ses
adieux au ministre de l’intérieur lorsqu’une femme entre chez lui,—et,
avec l’accent de la province qu’il représente: «Ah! monsieur, lui
dit-elle, que je suis donc aise de vous voir!—j’espère que vous n’avez
pas oublié votre filleul,—mon fils;—il faut absolument que vous
demandiez quelque chose pour lui au ministre;—vous savez le mal que mon
mari s’est donné pour les élections, etc., etc.»—Le député promet pour
renvoyer la femme. Mais, pendant qu’il attend que le ministre soit
visible, il lui revient en l’esprit—qu’il a tenu cet enfant sur les
fonts avec sa femme avant son mariage, et qu’elle l’aime beaucoup.—Il
se décide à la démarche;—il n’a pas pensé à demander ce qu’il savait
faire;—cependant, en y réfléchissant, il avise qu’il faut qu’il
s’occupe d’arts pour que sa famille ait pensé à la protection du
ministre; d’ailleurs il se rappelle que le petit dessinait:—il demande
un tableau et l’obtient.—Le lendemain revient la mère du protégé.
Un député allait quitter Paris; il s’habillait pour aller faire ses
adieux au ministre de l’intérieur lorsqu’une femme entre chez lui,—et,
avec l’accent de la province qu’il représente: «Ah! monsieur, lui
dit-elle, que je suis donc aise de vous voir!—j’espère que vous n’avez
pas oublié votre filleul,—mon fils;—il faut absolument que vous
demandiez quelque chose pour lui au ministre;—vous savez le mal que mon
mari s’est donné pour les élections, etc., etc.»—Le député promet pour
renvoyer la femme. Mais, pendant qu’il attend que le ministre soit
visible, il lui revient en l’esprit—qu’il a tenu cet enfant sur les
fonts avec sa femme avant son mariage, et qu’elle l’aime beaucoup.—Il
se décide à la démarche;—il n’a pas pensé à demander ce qu’il savait
faire;—cependant, en y réfléchissant, il avise qu’il faut qu’il
s’occupe d’arts pour que sa famille ait pensé à la protection du
ministre; d’ailleurs il se rappelle que le petit dessinait:—il demande
un tableau et l’obtient.—Le lendemain revient la mère du protégé.
—Eh bien! j’ai votre affaire.
—Ah! monsieur.
—Oui, une copie du portrait du roi pour la ville de ***.
—Comment! une copie du portrait du roi?
—Oui; votre fils n’est-il pas peintre?
—Mais non, monsieur, il est poêlier-fumiste.
—Ah bien, vous m’avez fait faire là une jolie chose!—Pourquoi diable ne me dites-vous pas que votre fils est poêlier-fumiste?
—Vous ne m’avez rien demandé, j’ai cru que vous le saviez.
—C’est juste, j’ai tort aussi; mais alors que pouvais-je demander au ministre?
—Les travaux de son hôtel.
—C’est encore juste; mais il dessinait un peu?
—Il a fait des yeux et des nez.
—C’est égal, puisque le tableau est accordé, il faut le faire;—qu’il se fasse aider par un peintre avec lequel il partagera l’argent.
![]() Depuis quelques années, on couvre Paris de fontaines de tous
genres.—Il n’y a qu’une chose à laquelle on ne songe pas,—c’est d’y
ajouter un vase ou une écuelle au moyen desquels on puisse y boire. Je
ne sais s’il y a encore, comme autrefois, à la petite fontaine du
Luxembourg,—une coupe en fer enchaînée.—C’était un exemple à
suivre;—c’est un avis que je donne à M. le préfet de la Seine.
Depuis quelques années, on couvre Paris de fontaines de tous
genres.—Il n’y a qu’une chose à laquelle on ne songe pas,—c’est d’y
ajouter un vase ou une écuelle au moyen desquels on puisse y boire. Je
ne sais s’il y a encore, comme autrefois, à la petite fontaine du
Luxembourg,—une coupe en fer enchaînée.—C’était un exemple à
suivre;—c’est un avis que je donne à M. le préfet de la Seine.
![]() Je l’ai déjà dit,—en France,—la démocratie n’est pas un but, elle
n’est qu’un moyen.—On ne veut pas arriver à la démocratie, mais par la
démocratie.—Tout le monde proclame sur les toits son propre
désintéressement;—mais que ferait l’avidité des autres à un homme
réellement et entièrement désintéressé!—C’est comme les marchands de
tisane qui crient leur marchandise, mais n’en boivent jamais,—et vont
avec son produit boire du vin au cabaret.
Je l’ai déjà dit,—en France,—la démocratie n’est pas un but, elle
n’est qu’un moyen.—On ne veut pas arriver à la démocratie, mais par la
démocratie.—Tout le monde proclame sur les toits son propre
désintéressement;—mais que ferait l’avidité des autres à un homme
réellement et entièrement désintéressé!—C’est comme les marchands de
tisane qui crient leur marchandise, mais n’en boivent jamais,—et vont
avec son produit boire du vin au cabaret.
Voyez aujourd’hui, parmi les gens parvenus et ceux qui veulent parvenir,—toutes les velléités d’aristocratie qui percent malgré eux.—L’ancienne noblesse portait des noms de terres qui leur appartenaient;—eux, ils prennent les noms de villes auxquelles ils appartiennent. Croyez-vous que les petits-fils de MM. David,—Dubois et Ollivier d’Angers,—Martin de Strasbourg et Martin du Nord,—Dupont de l’Eure et Michel de Bourges, etc., etc., se gêneront beaucoup pour se faire des titres des sobriquets de leurs pères?—Et, quand je dis les petits-fils,—je pourrais dire les fils,—je pourrais dire ces grands hommes eux-mêmes.
J’ai connu un honnête homme—qui s’appelait quelque chose comme Dubois; ceci n’est pas son vrai nom, il n’est pas mauvais garçon du reste,—et je ne veux pas le troubler.—Il a mis sept ans à séparer la première syllabe de son nom des deux autres, et j’ai suivi sur toutes ses cartes du jour de l’an toutes les tentatives de ces deux malheureuses lettres du pour s’écarter des autres.—Les premiers essais ont été timides;—il écrivait Dubois en séparant du de bois d’une manière imperceptible,—puis il augmenta un peu l’intervalle; puis un jour il mit un B majuscule à Bois;—puis il recommença a écarter ses syllabes,—et, enfin, aujourd’hui il s’appelle tranquillement M. du Bois.
![]() A la fin de chaque session, on voit s’établir de nouveaux bureaux
de tabac accordés à la sollicitation de MM. les députés.
A la fin de chaque session, on voit s’établir de nouveaux bureaux
de tabac accordés à la sollicitation de MM. les députés.
Il faut savoir qu’il n’y a à la Chambre, sur quatre cent cinquante membres, que vingt députés qui ne demandent rien aux ministres;—ceci n’est pas un chiffre écrit au hasard, c’est le résultat d’une statistique faite par deux représentants, dont l’un avoue qu’il ne fait pas partie de ce nombre de vingt.
Cette fois, les bureaux de tabac sortent de terre dans toutes les rues.
![]() La distribution des prix de l’Université à la Sorbonne a eu lieu
comme de coutume;—c’est un M. Collet, professeur, je crois, à
Versailles,—qui a prononcé ce ridicule thème latin—que l’on est
convenu d’appeler «le discours.»—Il y a mis la phrase obligée contre la
littérature moderne;—ce discours est semblable à tous ceux du même
genre, c’est un latin contourné et prétentieux.—Les femmes, qui ne se
croient pas obligées de comprendre, se dispensent d’écouter;—mais les
hommes font des mouvements de tête aux endroits que, par le débit de
l’orateur, ils supposent être les beaux endroits.
La distribution des prix de l’Université à la Sorbonne a eu lieu
comme de coutume;—c’est un M. Collet, professeur, je crois, à
Versailles,—qui a prononcé ce ridicule thème latin—que l’on est
convenu d’appeler «le discours.»—Il y a mis la phrase obligée contre la
littérature moderne;—ce discours est semblable à tous ceux du même
genre, c’est un latin contourné et prétentieux.—Les femmes, qui ne se
croient pas obligées de comprendre, se dispensent d’écouter;—mais les
hommes font des mouvements de tête aux endroits que, par le débit de
l’orateur, ils supposent être les beaux endroits.
M. Villemain a parlé à son tour:—c’est à peu près le même discours qu’avait prononcé M. Cousin l’année dernière;—aussi je prie mes lecteurs de jeter un coup d’œil sur le volume de septembre 1840.—Et je dirai à M. Villemain,—comme je disais alors à M. Cousin: «Non, monsieur, il n’est pas vrai que les lettres conduisent à tout;—fouillez votre mémoire, monsieur, fouillez votre conscience,—et voyez si c’est seulement aux lettres que vous devez d’être aujourd’hui ministre;—rappelez-vous depuis 1815, monsieur, où vous fîtes assaut avec M. Cousin d’adulation envers l’empereur de Russie,—jusqu’à ce jour où nous sommes;—et que faites-vous, monsieur, et à quoi pensez-vous donc,—de venir jeter dans toutes ces jeunes têtes des ferments d’ambition?—Mais ne voyez-vous pas, monsieur, que c’est là la maladie de l’époque,—et que votre discours, pour être raisonnable et moral, devrait dire précisément tout le contraire de ce qu’il dit?—L’éducation exclusivement littéraire que vous donnez à la jeunesse est déjà assez ridicule et mauvaise comme cela,—et vous la poussez encore aux conséquences de cette éducation,—au lieu d’enseigner aux jeunes gens la modération, au lieu de leur faire aimer la situation où le sort les a placés,—au lieu de leur apprendre à honorer la profession de leur père.»
![]() Au collége de Bourbon, M. Rossi, qui présidait la distribution des
prix,—a traité la même question.—Eh! non, monsieur Rossi,—mille fois
non,—ce n’est pas par les lettres que vous êtes arrivé à être pair de
France,—ce n’est pas vrai, vous le savez bien.
Au collége de Bourbon, M. Rossi, qui présidait la distribution des
prix,—a traité la même question.—Eh! non, monsieur Rossi,—mille fois
non,—ce n’est pas par les lettres que vous êtes arrivé à être pair de
France,—ce n’est pas vrai, vous le savez bien.
Vous êtes plus près de la vérité quand vous dites: «Ne croyez pas que le génie des lettres soit frivole,—il régnait dans la Florence au milieu de ces marchands dont les spéculations hardies, etc., etc.»
Oui,—monsieur,—le génie des lettres n’est pas frivole,—ici, vous avez raison, et vous le savez bien,—quand on est marchand, quand on vend beaucoup de choses, et quand on fait des spéculations hardies.
![]() Messieurs Villemain et Rossi,—vous trompez tous ces jeunes gens
qui vous écoutent;—il fallait leur raconter en détail—l’histoire de
votre élévation;—il fallait leur avouer que les lettres ne suffisent
pas,—qu’il faut encore la manière de s’en servir.
Messieurs Villemain et Rossi,—vous trompez tous ces jeunes gens
qui vous écoutent;—il fallait leur raconter en détail—l’histoire de
votre élévation;—il fallait leur avouer que les lettres ne suffisent
pas,—qu’il faut encore la manière de s’en servir.
![]() Il n’y a que deux écrivains que je n’ai pas rencontrés,—disait
dernièrement un étranger, c’est M. Paul de Karr et M. Alphonse Kock.
Il n’y a que deux écrivains que je n’ai pas rencontrés,—disait
dernièrement un étranger, c’est M. Paul de Karr et M. Alphonse Kock.
![]() On parle de modifications dans l’uniforme de l’infanterie;—les
fournisseurs ne sont pas les seuls à remarquer que c’est toujours sous
le ministère de M. Soult—que le besoin de ces modifications, de ces
changements onéreux, se fait généralement sentir.
On parle de modifications dans l’uniforme de l’infanterie;—les
fournisseurs ne sont pas les seuls à remarquer que c’est toujours sous
le ministère de M. Soult—que le besoin de ces modifications, de ces
changements onéreux, se fait généralement sentir.
![]() C’est le moment des banquets:—le parti légitimiste est celui qui
boit le moins;—le parti de l’opposition libérale et républicaine a des
festins plus nombreux;—le parti ministériel, des festins plus
somptueux.—Les uns et les autres sont également ridicules.
C’est le moment des banquets:—le parti légitimiste est celui qui
boit le moins;—le parti de l’opposition libérale et républicaine a des
festins plus nombreux;—le parti ministériel, des festins plus
somptueux.—Les uns et les autres sont également ridicules.
Chaque fois qu’il se trouve que dans un repas on mange du lapin,—il se rencontre toujours quelqu’un pour faire la vieille plaisanterie usée, qui consiste à manifester des doutes sur l’authenticité de l’animal,—à laisser soupçonner que c’est peut-être un chat,—à demander à voir la tête, etc., etc. Cette facétie est tellement obligée,—qu’elle semble faire partie de la sauce du lapin.—J’ai vu les gens les plus respectables se dévouer et la faire en rougissant,—parce qu’il faut qu’elle soit faite et que personne ne la faisait.
Il en est de même d’un toast sans objet aujourd’hui comme sans résultat possible:—il ne se fait pas un banquet sans que quelqu’un se lève et boive à la délivrance de la Pologne.
![]() EN FAVEUR DE Me LEDRU-ROLLIN.—Le roi Louis-Philippe a commencé
un discours par ces mots: «J’ai toujours aimé les avocats.»—Grand
bien lui fasse!—Me Ledru-Rollin,—avocat aux conseils du roi et à la
cour de cassation,—voulait être député;—il s’est présenté, il y a deux
ou trois ans, dans un collége,—où il a fait une profession de foi—dans
le sens de l’opposition dynastique,—c’est-à-dire assez pâle et assez
modérée.—Il n’a pas été élu.
EN FAVEUR DE Me LEDRU-ROLLIN.—Le roi Louis-Philippe a commencé
un discours par ces mots: «J’ai toujours aimé les avocats.»—Grand
bien lui fasse!—Me Ledru-Rollin,—avocat aux conseils du roi et à la
cour de cassation,—voulait être député;—il s’est présenté, il y a deux
ou trois ans, dans un collége,—où il a fait une profession de foi—dans
le sens de l’opposition dynastique,—c’est-à-dire assez pâle et assez
modérée.—Il n’a pas été élu.
Cette fois,—il s’agissait de remplacer Garnier-Pagès:—il a formulé un discours furibond,—dont son prédécesseur, homme d’esprit et de goût,—n’aurait pas consenti,—au prix de sa vie,—à prononcer une seule phrase.
C’était un ramassis des lieux communs qui traînent dans tous les journaux;—la chose a eu grand succès.
On fait en ce moment un procès à Me Ledru,—on fait une sottise.—Le gouvernement de Juillet serait sauvé s’il pouvait amener tous ses adversaires à des professions de foi aussi claires et aussi précises.
Le discours de Me Ledru n’est justiciable que du ridicule.—Ce n’est pas d’aujourd’hui que je m’aperçois que le gouvernement constitutionnel est un mensonge.—S’il n’en était pas ainsi, un candidat aurait le droit de dire à des électeurs:
«Messieurs, mon intention est de hacher le roi Louis-Philippe comme chair à pâté.»
Si les électeurs ne sont pas d’avis que le roi soit mis en pâté,—ils ne donnent pas leur voix au candidat,—et tout est fini.
Si, au contraire, ils désirent que le roi Louis-Philippe soit mis en pâté,—vous aurez beau obliger l’avocat à déguiser sa pensée,—il trouvera bien moyen de se faire comprendre;—et non-seulement il aura le vote de ceux qui désirent voir le roi en pâté,—mais aussi de beaucoup de ceux qui ne le veulent pas, et qui auraient voté contre cette motion si le candidat avait pu s’expliquer clairement et sans ambages.
Je ne sais, mais il me semble que, dans la guerre que se font la presse et le gouvernement, ils agissent—comme les seigneurs japonais quand ils ont une affaire d’honneur:—chacun des adversaires se donne à soi-même un coup de couteau,—pour humilier son ennemi par le sang-froid avec lequel il mourra.—J’ai lu cela dans des livres de voyageurs.
![]() Me Ledru se plaint des priviléges,—il fait bon marché de son
privilége d’électeur, qui ne lui coûte rien, mais il ne dit mot de sa
charge d’avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation, qui lui a
coûté trois cent trente mille francs.—A la bonne heure! c’était là
une belle offrande à déposer sur l’autel de la patrie.—Mais il y a
privilége et privilége,—et c’est, en effet, une hideuse chose que les
priviléges dont jouissent les autres.
Me Ledru se plaint des priviléges,—il fait bon marché de son
privilége d’électeur, qui ne lui coûte rien, mais il ne dit mot de sa
charge d’avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation, qui lui a
coûté trois cent trente mille francs.—A la bonne heure! c’était là
une belle offrande à déposer sur l’autel de la patrie.—Mais il y a
privilége et privilége,—et c’est, en effet, une hideuse chose que les
priviléges dont jouissent les autres.
Me Ledru prend en grand’pitié les parias de la société moderne. Où sont-ils, maître Ledru?—montrez-les du doigt, que je les voie et que je m’attendrisse sur eux avec vous.—Tout le monde aujourd’hui arrive à tout,—comme vous ne l’ignorez;—tenez, maître Ledru, vous en savez un exemple:—Il existe au Palais un avocat que l’on dit petit-fils de Comus, le célèbre prestidigitateur;—ce n’est pas là une origine aristocratique,—je ne lui en fais pas un tort,—je serais plutôt disposé à lui faire un mérite de s’être créé lui-même;—mais cet avocat,—qui est aujourd’hui avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation et député,—doit bien rire en vous entendant parler des parias de la société moderne.
Ah! à propos, maître Ledru,—moi qui prétends que vous aviez le droit de faire votre discours,—je songe qu’il y a quelque chose qui a dû vous gêner un moment,—c’est que comme avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation,—vous avez prêté serment de fidélité au roi Louis-Philippe, avant votre discours, et qu’il vous faut maintenant, après le discours, répéter ce même serment de fidélité au roi Louis-Philippe en qualité de député.
![]() La comtesse O’Donnell est morte à Paris, le 8 août;—c’était une
femme tellement spirituelle, qu’on lui eût pardonné d’être un peu
méchante;—si excellente, si courageuse, si distinguée,—qu’elle n’eût
pas eu besoin de son esprit pour être recherchée et aimée.
La comtesse O’Donnell est morte à Paris, le 8 août;—c’était une
femme tellement spirituelle, qu’on lui eût pardonné d’être un peu
méchante;—si excellente, si courageuse, si distinguée,—qu’elle n’eût
pas eu besoin de son esprit pour être recherchée et aimée.
Elle exerçait une noble influence sur beaucoup des esprits les plus distingués de ce temps-ci;—j’ai vu les plus intrépides au milieu des succès les mieux établis—demander avec inquiétude: «Qu’en pense madame O’Donnell?»
Sévère avec ses amis, dans l’intérêt de leur talent et de leur réputation,—elle les défendait en leur absence avec une noble énergie;—elle était encore jeune et belle,—elle était aimée;—eh bien! au milieu de tant de raisons de plaindre une mort si inattendue,—je n’ai pu encore trouver de pitié pour elle, tant j’en ressens pour ceux qui l’ont perdue.
A M. Augustin, du café Lyonnais.—BILAN de la royauté.—M. Partarrieu-Lafosse.—La charte constitutionnelle.—L’article 12 et l’article 13.—Moyen nouveau de dégoûter les princes de la flatterie.—BILAN de la bourgeoisie.—M. Ganneron.—M***.—L’orgie et la mascarade.—Madame J. de Rots...—La chatte métamorphosée en femme.—BILAN de la pairie.—BILAN de la députation.—Une tombola.—Ce que demandent soixante-dix-sept députés.—Ce qu’obtiennent quarante-deux députés.—M. Ganneron.—BILAN des ministères.—M. Molé.—M. Buloz.—M. Duvergier de Hauranne.—M. Thiers.—M. Guizot.—Angelo, tyran de Padoue.—Un œuf à la coque.—M. Passy.—M. Dufaure.—M. Martin (du Nord).—BILAN de l’administration.—Les synonymes.—BILAN de la justice.—BILAN de la littérature.—Les Louis XVII.—La parade.—Louis XIV et les propriétaires de journaux.—M. Dumas et M. de Balzac.—BILAN de la police.—Facéties des enfants de Paris.—Trois minutes de pouvoir.—BILAN de l’Église.—Les bons curés.—M. Ollivier.—M. Châtel.—M. Auzou.—BILAN de l’armée.—BILAN du peuple.—Frédéric le Grand.—Le pays.—BILAN de la presse.—Dieu ou champignon.—La sainte ampoule et les écrouelles.—BILAN de l’auteur.
![]() OCTOBRE.—A. M. Augustin, du café Lyonnais, à Clermont.—Vous
avez une belle position, monsieur Augustin,—je ne vous connais pas
autrement,—et je ne sais si vous en userez, si vous en
abuserez.—Permettez-moi, cependant, de me tourner vers votre gloire
naissante, comme vers le soleil levant—et de vous dédier ce
volume,—qui est le dernier de la seconde année des Guêpes, et qui
contient le bilan de la France.
OCTOBRE.—A. M. Augustin, du café Lyonnais, à Clermont.—Vous
avez une belle position, monsieur Augustin,—je ne vous connais pas
autrement,—et je ne sais si vous en userez, si vous en
abuserez.—Permettez-moi, cependant, de me tourner vers votre gloire
naissante, comme vers le soleil levant—et de vous dédier ce
volume,—qui est le dernier de la seconde année des Guêpes, et qui
contient le bilan de la France.
LA ROYAUTÉ.
Ab Jove principium.
![]() Il n’y a plus de royauté.
Il n’y a plus de royauté.
Je vous défie, monsieur Augustin, de trouver au café Lyonnais un seul Français qui vous dise: «Je n’entends rien à la politique;»—tandis que vous en trouverez beaucoup qui vous avoueront qu’ils ne sont pas forts aux dominos; et qu’ils acceptent des points au billard.
(Cela vient peut-être de ce qu’au billard et aux dominos—on joue et on perd son propre argent,—tandis qu’à la politique on joue celui des autres.)
Cet homme rare que je vous demande,—cet homme qui, dis-je, n’entend rien à la politique,—vous ne le trouverez non plus dans aucune école, ni dans aucun collége,—ni dans aucun atelier.—Les Français sont naturellement si forts sur la politique, qu’ils n’ont pas besoin des études élémentaires—pour former leurs idées et leurs convictions.
Peut-être, me direz-vous ici, monsieur Augustin, que cela peut jeter quelques-uns d’entre eux dans des erreurs d’une certaine importance.
Je ne le nie pas tout à fait,—monsieur Augustin;—ainsi ils ont lu dans les journaux—que, d’après la charte, LE ROI joue le rôle que joue son buste en plâtre bronzé derrière le dos des maires,—qu’il règne et ne gouverne pas.
C’est-à-dire qu’il règne—comme une corniche règne autour d’un plafond.
Les Français n’ont pas pensé a regarder dans la charte si cela était parfaitement exact; ils auraient trouvé:
Art. 13.—Le roi est le chef suprême de l’État,—commande les forces de terre et de mer,—déclare la guerre,—fait les traités de paix, d’alliance et de commerce,—nomme à tous les emplois d’administration publique, etc.
Vous conviendrez avec moi, monsieur Augustin,—que la charte, pour laquelle tant de gens se sont fait tuer et en ont tué tant d’autres depuis quelques années,—vaut bien la peine d’être lue une petite fois dans la vie d’un homme politique,—comme l’est tout le monde;—cette ignorance ferait croire à la postérité que, comme les Égyptiens, nous avons une langue sacrée, intelligible pour les seuls initiés, et que nous avons l’habitude d’écrire les lois en hiéroglyphes.—Disons à la postérité—que la charte est écrite en langue vulgaire,—avec les vingt-quatre lettres de l’alphabet ordinaire,—et que dans les codes elle remplit, en petit texte, quatre pages d’un format à peu près semblable à celui des Guêpes.
Donc, il est parfaitement établi que, d’après la charte, le roi doit faire le mort,—que toute manifestation de sa volonté,—que toute participation aux affaires, est une violation de la charte, et un manque de foi à ses serments.
Et, si la charte paraît dire le contraire, c’est qu’elle est payée par la police.
Charte, art. 12.—La personne du roi est inviolable et sacrée, ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.
On dit: «La France est perdue par le gouvernement personnel,»
C’est-à-dire, la participation du roi aux affaires.—La charte, il est vrai, défend d’attaquer la personne du roi par l’art. 12;—mais, comme par l’art. 13 elle défend au roi de s’immiscer en rien dans les affaires, c’est lui qui le premier viole la charte; et, si on la viole contre lui, ce n’est qu’après qu’il l’a violée le premier contre nous.
Mais, me direz-vous, monsieur Augustin, l’art. 13 dit positivement le contraire.
Cela ne fait rien;—on a inventé en sus que les ministres devaient couvrir la royauté,—et on leur a reproché de la découvrir; sans songer que, par l’art. 12,—ils ne peuvent pas la découvrir, qu’ils la couvrent toujours de leur responsabilité.
Puis on a établi en principe que le roi est comme un chevreuil dans une broussaille;—tant mieux pour lui si on ne le voit pas;—mais, si les ministres (la broussaille) en laissent voir la tête ou la patte,—on a le droit de tirer dessus—(et vous avez vu qu’on ne s’en tient pas en ce genre au sens métaphorique).
![]() Je n’ai pas besoin de vous rappeler, monsieur Augustin, combien de
fois on a essayé d’assassiner le roi Louis-Philippe:—voici qu’un
monsieur membre, dit-on, d’une des sociétés qu’il serait temps de ne
plus appeler secrètes, après que depuis dix ans on n’a pas parlé d’autre
chose, a tiré sur le jeune duc d’Aumale;—un de ces jours on tirera sur
les princesses.
Je n’ai pas besoin de vous rappeler, monsieur Augustin, combien de
fois on a essayé d’assassiner le roi Louis-Philippe:—voici qu’un
monsieur membre, dit-on, d’une des sociétés qu’il serait temps de ne
plus appeler secrètes, après que depuis dix ans on n’a pas parlé d’autre
chose, a tiré sur le jeune duc d’Aumale;—un de ces jours on tirera sur
les princesses.
![]() La reine, assure-t-on, n’est jamais si heureuse que lorsque ses
fils sont en Afrique, au milieu des maladies du pays,—exposés au fer et
au feu des Arabes,—parce qu’alors ils sont à l’abri des dangers plus
grands des rues de Paris.
La reine, assure-t-on, n’est jamais si heureuse que lorsque ses
fils sont en Afrique, au milieu des maladies du pays,—exposés au fer et
au feu des Arabes,—parce qu’alors ils sont à l’abri des dangers plus
grands des rues de Paris.
Le Courrier Français,—un carré de papier dont le plus fort rédacteur en chef,—feu Châtelain, disait: «Voilà vingt ans que je fais tous les matins le même article avec le même succès.» le Courrier Français—dit que l’on a été imprudent de décerner une sorte d’ovation à un jeune prince:—car, à son avis, c’est là ce qui a éveillé la pensée de ce crime abominable.
En effet,—voici un bon moyen de faire détester aux princes les adulateurs; chaque fois qu’un prince recevra une flatterie, qu’on tire dessus comme sur une bête fauve, et je réponds que les princes redouteront les flatteries.
De bonne foi—cependant, monsieur V*** de la P***,—si, chaque fois que le Courrier Français a décerné des ovations à mademoiselle Fitzjames,—cette danseuse maigre et verte que vous savez,—un spectateur lui avait tiré un coup de pistolet du parterre de l’Opéra,—n’auriez-vous pas trouvé cela un peu sévère?
Enfin, monsieur Augustin, il y a en France plus de cent cinquante journaux qui tous les jours prodiguent au roi les injures et les sarcasmes, et plus de cent cinquante mille personnes qui répètent ces sarcasmes et ces injures;—et vous savez, monsieur Augustin, que, dans les habitués des cafés, si quelqu’un laissait remarquer qu’il prononce le nom du roi sans y joindre quelque fâcheuse épithète, on ne tarderait pas à le soupçonner d’être un mouchard.
Ce n’est pas qu’au fond ces gens lui en veuillent beaucoup; car pensez-y un peu, et vous verrez que le roi n’a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit à n’importe qui;—ce n’est pas qu’ils le connaissent,—mais c’est que cela a l’air intrépide et n’est pas dangereux.
Et moi-même, en voyant dans les journaux que le roi a fait donner un des plus beaux chevaux de ses écuries au lieutenant-colonel Levaillant,—en échange d’un cheval arabe de grand prix qui a été tué sous lui lors de l’attentat du faubourg Saint-Antoine, je ne puis m’empêcher de vous renvoyer au numéro du mois de mai 1840 des Guêpes,—où vous verrez des révélations édifiantes sur les chevaux et sur les écuries du roi.
En résumé, la couronne royale est devenue la couronne du Christ, dont chaque fleuron est une épine,—le sceptre est le roseau dérisoire qu’on met à la main du fils de Marie.
La royauté se meurt,—la royauté est morte.
Et les poëtes et les prosateurs, voyant ainsi la royauté morte en France, vont s’écrier partout:
—«C’est qu’il n’y a plus de croyances.»
Ne me laissez pas oublier, monsieur Augustin, de vous prévenir que ceci est une bêtise.
Passons à la bourgeoisie,—s’il vous plaît.
![]() LA BOURGEOISIE.—C’est la bourgeoisie qui a renversé l’ancienne
royauté et l’ancienne aristocratie; le peuple n’y a contribué que de
quelques coups de fusil tirés et reçus sans savoir pourquoi!
LA BOURGEOISIE.—C’est la bourgeoisie qui a renversé l’ancienne
royauté et l’ancienne aristocratie; le peuple n’y a contribué que de
quelques coups de fusil tirés et reçus sans savoir pourquoi!
Et cela devait être ainsi.
La haine la plus vivace est celle qui a pour origine l’envie;—l’envie est une sorte d’amour lâche et honteux;—on n’envie comme on n’aime que ce qui a un certain degré de possibilité;—le peuple n’enviait pas le faste et les dignités de l’aristocratie, parce que cela était trop loin de lui pour que ses yeux en fussent blessés.
La bourgeoisie s’est fait un roi bourgeois,—avec un chapeau gris pour couronne et un parapluie pour sceptre;—puis les talons rouges de la finance,—les roués de comptoir, s’en sont donné à cœur joie; ils se sont mis à jouer de leur mieux les rôles de ceux qu’ils avaient supplantés, manifestant ainsi qu’ils les avaient attaqués,—non par haine pour les renverser, mais par envie pour prendre leur place.
Les bourgeois sont entrés dans la société comme dans une ville prise d’assaut,—ils se sont emparés de tout, ils sont devenus tout:—gouvernement, comme députés,—l’armée, comme gardes nationaux,—la justice, comme jurés.
![]() Ils se sont gorgés de tout,—ils ont mis de vieilles armoiries sur
leurs voitures et sur leur papier à lettres:—il n’y a pas une femme de
marchand qui se refuse la couronne de comtesse;—on n’ose pas n’être que
baron, à moins de l’être réellement.
Ils se sont gorgés de tout,—ils ont mis de vieilles armoiries sur
leurs voitures et sur leur papier à lettres:—il n’y a pas une femme de
marchand qui se refuse la couronne de comtesse;—on n’ose pas n’être que
baron, à moins de l’être réellement.
Un de ces seigneurs de nouvelle date, ayant acheté de la vaisselle d’argent, la fait rouler par les escaliers pour la bossuer, et lui donner un aspect de vétusté, afin qu’elle ait l’air d’être depuis longtemps dans sa famille.
Une princesse de la finance,—madame J. de Rotsch..., a outrepassé la mode qui prescrit le luxe des appartements.—Quelqu’un admirait le nouvel arrangement de sa maison: «Je n’ai pas pu faire tout ce que je voulais,—dit-elle,—M. J. de R. n’a pas voulu dépasser cent mille francs pour ma chambre à coucher; j’ai été obligée de m’y soumettre.»
Cette chambre à laquelle madame J. de R. se résigne est arrangée avec des dentelles dont les femmes les plus élégantes portent sur elles une demi-aune en grande toilette.
Les fauteuils de son salon,—où M. J. de R. n’a pas mis la même lésinerie, sont incrustés d’argent doré, au lieu de bronze.
Malheureusement pour eux—les bourgeois n’ont pas compris leur situation: ils ressemblent à la chatte métamorphosée en femme, qui, en voyant une souris, se jeta à quatre pattes et la poursuivit sous le lit. Ils ressemblent à ce laquais enrichi par la banque de Law, qui, tandis qu’on lui ouvrait sa voiture, fut assez distrait pour monter derrière. Ils ressemblent à ce garçon de café devenu millionnaire, qui, lorsqu’il était surpris par un bruit de sonnette, ne pouvait s’empêcher de crier—voilà!
Ils se sont accoutumés pendant longtemps à attaquer la royauté.
Aussi ils ne peuvent s’empêcher de se mêler un peu par air et par habitude aux nouvelles attaques dont elle est l’objet.
Ils ne voient pas, les malheureux,—que c’est leur royauté à eux,—que c’est eux qu’on attaque,—que c’est eux qu’on détruit.
Louis-Philippe est un roi bourgeois et le roi des bourgeois.
Ils devraient se relayer autour de lui pour défendre de tout ce qu’ils ont de courage et de sang chacun des poils de sa barbe: car, s’ils le laissent renverser,—que dis-je? s’ils aident à le renverser, ils sont perdus à jamais, ils expieront leur usurpation grotesque et la mascarade et l’orgie à laquelle ils se livrent avec tant de confiance; leur puissance deviendra un rêve pour eux-mêmes, et leurs enfants refuseront d’y croire.
Le journal le National, du reste, a déclaré qu’il n’y a plus de bourgeois, qu’il n’y a plus de classes parmi nous.
La royauté se meurt;—la bourgeoisie se tue,—et les poëtes et les prosateurs vont disant partout: «C’est qu’il n’y a plus de croyances.»
Ne me laissez pas oublier, monsieur Augustin, de vous dire que ceci est une bêtise.
![]() LA PAIRIE.—On appelle la Chambre des pairs—la chambre
aristocratique,—comme on appelle Tuileries le jardin du roi, où on ne
fait plus de tuiles depuis l’an 1564.
LA PAIRIE.—On appelle la Chambre des pairs—la chambre
aristocratique,—comme on appelle Tuileries le jardin du roi, où on ne
fait plus de tuiles depuis l’an 1564.
Il n’y a plus d’aristocratie réelle en France;—l’abolition du droit d’aînesse détruit les grandes fortunes en terres et en argent, par la division; il ne resterait donc que le relief des grands noms et la considération du corps.—Pour le relief des grands noms, les héritiers, pour la plupart, y mettent bon ordre; pour la considération du corps, les journaux se chargent d’empêcher qu’elle ne soit excessive; la Chambre des pairs s’amoindrit tous les jours, et de ceux de ses membres que la mort en ôte, et surtout de ceux que les ministères y mettent.
Et les poëtes et les prosateurs s’en vont disant: «Il n’y a plus d’aristocratie, parce qu’il n’y a plus de croyances.»—Vous savez, monsieur Augustin, ce que je vous ai prié de me rappeler.
![]() LA DÉPUTATION.—Voici, monsieur Augustin, le grand triomphe de la
bourgeoisie:—quatre cent cinquante messieurs sont censés représenter
les électeurs, qui sont censés représenter le reste du pays.—C’était un
moyen d’apaiser un certain nombre de bourgeois en leur donnant part au
gâteau du pouvoir et du budget;—car il faut ajouter à ceux qui sont
élus tous ceux qui pourraient l’être,—et tous ceux qui élisent.
LA DÉPUTATION.—Voici, monsieur Augustin, le grand triomphe de la
bourgeoisie:—quatre cent cinquante messieurs sont censés représenter
les électeurs, qui sont censés représenter le reste du pays.—C’était un
moyen d’apaiser un certain nombre de bourgeois en leur donnant part au
gâteau du pouvoir et du budget;—car il faut ajouter à ceux qui sont
élus tous ceux qui pourraient l’être,—et tous ceux qui élisent.
Dans la théorie du gouvernement constitutionnel, on avait pensé qu’en donnant à presque tout le monde une petite part du pouvoir on intéressait tout le monde à la conservation de l’ordre social;—on avait compté sans ses nouveaux hôtes;—la bouchée qu’on leur a donnée leur a montré la succulence du morceau,—et chacun veut le dévorer tout entier.
Autrefois, quand un fabricant de cachemires français avait fait sa fortune en mêlant à sa laine un peu plus de coton qu’il n’en avouait,—quand il se trouvait trop vieux pour les affaires, il passait le reste de sa vie dans le repos, à jouer aux dominos, à pêcher à la ligne.
Mais, depuis l’invention de la représentation nationale,—on a remplacé ces délassements innocents de la pêche à la ligne et du jeu de dominos par la Chambre législative. On est usé pour ses affaires à soi; mais on ne l’est pas pour faire celles des autres, qui ont toujours moins d’importance que les siennes propres.
Je sais qu’il y a pour répondre à ce que je vous dis là de grandes phrases toutes faites,—je les sais par cœur comme vous,—ne me les dites pas;—si je ne les dis pas moi-même, c’est que je ne leur trouve aucun sens.
Une fortune acquise était le but de la vie;—maintenant ce n’est plus qu’un échelon;—payer le cens est un sacrement, un baptême politique;—aussi veut-on faire fortune de bonne heure;—aussi risque-t-on gros jeu dans l’industrie et dans les affaires; aussi voit-on un député et un agent de change,—M. Gervais et M. Joubert,—faire faillite dans la même semaine.
Aussi pouvait-on supprimer le jeu sans causer de grandes privations aux gens; et la fermeture des maisons autorisées n’a-t-elle pas fait beaucoup crier,—parce qu’on donnait en place une grande tombola d’honneurs, de places, de fortune, de croix, etc., etc.?
Je vous l’ai dit,—il y a moins loin pour devenir ministre quand on est député que pour devenir député quand on est marchand de chandelles,—comme l’était M. Ganneron.—Aussi la députation n’est-elle qu’une étape, et M. Ganneron se met-il, par moments, au nombre des députés mécontents, qui trouvent que les affaires ne vont pas,—je suppose qu’il ne parle pas des siennes.
M. Lebœuf a exigé que madame Lebœuf fût reçue à la cour.
Il y a des députés qui s’occupent d’améliorations matérielles... de leurs propres affaires.—En ce moment, soixante-dix-sept députés demandent soixante dix-sept places de préfet;—c’est une des sessions où ils en ont demandé le moins.
Sur soixante-douze places de premiers présidents et de procureurs généraux de cours royales, on en a donné quarante-deux à des députés.
J’ai chargé trois de mes mouches, Mégère, Alecto et Tisiphone, de me faire le compte exact des députés qui ne demandent rien, ni pour eux, ni pour leurs parents, ni pour leurs amis; je vous en donnerai le chiffre exact un de ces jours.
![]() D’autres ont une ambition plus creuse; ils veulent de la popularité
et des éloges;—ils ne veulent pas parler pour leurs quatre cent
quarante-neuf collègues, ils veulent que la France les lise.—Ceux-là
sont dans la dépendance des journaux; il faut qu’ils se donnent à un
parti.
D’autres ont une ambition plus creuse; ils veulent de la popularité
et des éloges;—ils ne veulent pas parler pour leurs quatre cent
quarante-neuf collègues, ils veulent que la France les lise.—Ceux-là
sont dans la dépendance des journaux; il faut qu’ils se donnent à un
parti.
![]() Car les journaux font de tout cela ce qui leur convient. Voyez le
même discours du même député, rapporté dans le National et dans les
Débats. Dans l’un,—l’honorable membre prouve que...;—dans
l’autre,—M. un tel essaye de prouver...—Dans le premier, vous voyez le
discours semé de parenthèses, telles que: (Sensation profonde), (Marques
d’assentiment), (Écoutez, écoutez), et, à la fin, cette remarquable
IMPROVISATION, etc., etc.—Dans l’autre journal, il y a aussi des
parenthèses, mais elles sont différentes: (Interruption), (Marques
nombreuses d’improbation) et—(Le bruit des conversations
particulières nous empêche d’entendre la fin de cette longue
élucubration), ou (La voix mal assurée de l’orateur, couverte par
le bruit des conversations particulières, ne parvient pas jusqu’à
nous).
Car les journaux font de tout cela ce qui leur convient. Voyez le
même discours du même député, rapporté dans le National et dans les
Débats. Dans l’un,—l’honorable membre prouve que...;—dans
l’autre,—M. un tel essaye de prouver...—Dans le premier, vous voyez le
discours semé de parenthèses, telles que: (Sensation profonde), (Marques
d’assentiment), (Écoutez, écoutez), et, à la fin, cette remarquable
IMPROVISATION, etc., etc.—Dans l’autre journal, il y a aussi des
parenthèses, mais elles sont différentes: (Interruption), (Marques
nombreuses d’improbation) et—(Le bruit des conversations
particulières nous empêche d’entendre la fin de cette longue
élucubration), ou (La voix mal assurée de l’orateur, couverte par
le bruit des conversations particulières, ne parvient pas jusqu’à
nous).
Etc., etc., etc.
![]() Les questions d’intérêt matériel trouvent la Chambre au moins
inattentive et souvent déserte.
Les questions d’intérêt matériel trouvent la Chambre au moins
inattentive et souvent déserte.
La sotte invention de la tribune, qui exige une longue habitude de la parole en public, empêche de parler les hommes spéciaux qui savent les choses, pour livrer toutes les discussions aux hommes qui ne savent rien, si ce n’est parler.
Il n’y a de suivi que les questions de ministère, c’est-à-dire celles qui ont pour but de savoir si une partie de la Chambre va entrer aux affaires, au pouvoir et au budget, sous le nom de M. Thiers, en renversant une autre partie qui tombera des affaires, du pouvoir et du budget—sous le nom de M. Guizot.
On a récemment imaginé les coalitions.—Une coalition est une alliance dans le genre d’une julienne,—ou plutôt du thé de madame Gibou;—alliance entre les partis les plus opposés,—les plus hétérogènes, qui n’ont entre eux d’autre rapport que celui de ne pas être au pouvoir; alliance qui a pour but de renverser le parti qui est au pouvoir, sauf à se disputer la place quand celui-ci sera par terre. Chacun des partis s’engage par des promesses, que celui qui, à la fin du grabuge, gagne la partie, a soin de ne pas tenir. Alors la fraction renversée vient, à son tour, se joindre à ceux qui l’ont renversée, mais n’ont pas obtenu sa place; et on renverse, à son tour, le dernier usurpateur.
Il n’y a aucune espèce de raison pour que les choses n’aillent pas toujours ainsi,—et il est moralement et matériellement impossible, depuis cette invention des coalitions, qu’un ministère vive plus d’une session sans être renversé, ou pour le moins modifié.
Si vous demandez aux grands moralistes,—en prose et en vers,—les causes de tout cela,—il vous répondront qu’il n’y a plus de croyances. N’oubliez pas, monsieur Augustin... vous savez?
![]() LE MINISTÈRE.—L’homme qui gouverne n’est pas précisément celui qui
est ministre,—c’est celui qui va l’être.—Avant le dernier ministère de
M. Thiers,—il y avait six mois—(les Guêpes l’ont dénoncé en ce
temps-là) qu’on n’obéissait qu’à lui, qu’il dirigeait tout, qu’il
donnait des ordres aux préfets, qu’il faisait donner des croix et des
places, et prononçait des destitutions.
LE MINISTÈRE.—L’homme qui gouverne n’est pas précisément celui qui
est ministre,—c’est celui qui va l’être.—Avant le dernier ministère de
M. Thiers,—il y avait six mois—(les Guêpes l’ont dénoncé en ce
temps-là) qu’on n’obéissait qu’à lui, qu’il dirigeait tout, qu’il
donnait des ordres aux préfets, qu’il faisait donner des croix et des
places, et prononçait des destitutions.
Je vous en donnerai pour exemple M. Buloz, homme sans aucuns titres littéraires,—directeur de deux Revues et du Théâtre-Français,—nom inventé par M. Molé.—Vous le croyez peut-être très-perplexe, entre M. Duvergier de Hauranne, qui lui impose des articles hostiles au ministère, et M. Guizot, qui lui défend de les publier sous peine de perdre sa place?—Eh bien, pas le moins du monde; M. Buloz n’est point embarrassé: il publie un à un les articles de M. Duvergier, il promet à chaque article à M. Guizot de n’en plus publier, et il recommence.
![]() Quand on dit d’un ministre:—«Il est vendu à l’étranger,—il trahit
le pays,—il amoindrit l’autorité,—il écrase le peuple,» etc.,
Quand on dit d’un ministre:—«Il est vendu à l’étranger,—il trahit
le pays,—il amoindrit l’autorité,—il écrase le peuple,» etc.,
Cela n’a rien précisément de bien injurieux; ce sont des paroles de convention, que celui qui les reçoit aujourd’hui disait hier à celui qui les lui donne;
Absolument comme lorsque, dans la pièce d’Angelo, tyran de Padoue,—madame Dorval jouait la Thisbé, et mademoiselle Mars Catarina.—Quelque temps après, mademoiselle Mars joua la Thisbé, et madame Dorval prit le rôle de Catarina.
Ce n’est jamais qu’une comédie et deux rôles; cela a cependant un assez grave inconvénient. Monsieur Augustin, permettez-moi de vous le signaler.
![]() «La France,» «la patrie,» «la gloire nationale,» «la liberté,»
«le maintien de nos institutions,» «le peuple,» «les lois,» etc., etc.;
chacun de ces mots n’est qu’un plomb, une balle ou un boulet, dont
chaque personnage politique charge son pistolet, sa canardière ou son
obusier, qu’il tire sur ses ennemis politiques, c’est-à-dire sur ceux
qui occupent la place qu’il veut avoir ou qui veulent avoir la place
qu’il occupe.
«La France,» «la patrie,» «la gloire nationale,» «la liberté,»
«le maintien de nos institutions,» «le peuple,» «les lois,» etc., etc.;
chacun de ces mots n’est qu’un plomb, une balle ou un boulet, dont
chaque personnage politique charge son pistolet, sa canardière ou son
obusier, qu’il tire sur ses ennemis politiques, c’est-à-dire sur ceux
qui occupent la place qu’il veut avoir ou qui veulent avoir la place
qu’il occupe.
Les meilleurs moyens s’usent;—il faut en trouver d’autres.—Pour cela, on ne regarde pas plus à remuer le pays que cet égoïste dont parle un auteur grec, qui avait mis le feu à la maison de son voisin pour se faire cuire un œuf; l’important est que l’œuf soit cuit à point.
![]() D’abord les petits moyens suffisaient; on attribuait au
gouvernement actuel, c’est-à-dire au ministère, la pluie qui tombait
ou qui ne tombait pas;—jamais on n’avait vu tant de chenilles que
cette année,—la récolte serait mauvaise,—le pain très-cher, etc.
D’abord les petits moyens suffisaient; on attribuait au
gouvernement actuel, c’est-à-dire au ministère, la pluie qui tombait
ou qui ne tombait pas;—jamais on n’avait vu tant de chenilles que
cette année,—la récolte serait mauvaise,—le pain très-cher, etc.
Ces petits moyens étaient bien assez grands pour les résultats auxquels ils tendaient: car tout cela, c’est toujours la question de cuire l’œuf à la coque; il ne s’agit que de savoir si M. Passy, ou M. Dufaure, ou M. Martin (du Nord) sera ministre.
Puis on y ajouta une petite émeute,—une émeute de rien, trois lanternes cassées, une pierre jetée à un commissaire.
Cela réussit.
La seconde fois,—il fallut six lanternes et deux commissaires;—puis, quand on eut inventé les coalitions, les partis extrêmes demandèrent des concessions; on agita le pays de telle sorte, qu’on fit monter la vase à la surface.
Et chaque fois les choses vont de mal en pis: pour un changement de ministère, on ne fait pas moins de trois ou quatre émeutes; et maintenant on y tue plus de monde que dans les fêtes et réjouissances publiques, où il y a toujours trois ou quatre morts et sept ou huit blessés.
L’émeute est plus fréquente, plus longue, plus meurtrière, et dégénère en guerre civile, toujours pour savoir si M. Dufaure ou M. Passy rentreront au ministère.
Le National, accusé d’avoir provoqué à la haine du roi, répond avec raison qu’il n’a fait qu’imiter en cela—M. Thiers, qui était au pouvoir hier, et M. Guizot, qui est au pouvoir aujourd’hui. Il cite leurs paroles, semblables à celles pour lesquelles il est mis en cause, et on l’acquitte;—peut-être eût-on dû au contraire faire le procès à M. Thiers et à M. Guizot; mais les lecteurs des Guêpes savent ce que je pense des procès de presse.
Mais ces pauvres grands hommes politiques, toujours occupés du seul soin de faire cuire leur œuf à la coque, continuent à mettre le feu à tout, bêtement traîtres qu’ils sont envers le pays et envers eux-mêmes: car, à force de se disputer et de s’arracher le pouvoir et de se faire aider pour le tirer à eux par des mains peu choisies, à chaque fois qu’ils le ressaisissent et l’enlèvent à leurs adversaires, ils doivent voir qu’il est plus sali et plus déchiré, qu’il en reste des lambeaux entre les mains de leurs alliés et dans la boue du champ de bataille, et qu’aujourd’hui déjà ce n’est plus qu’un déplorable lambeau.
Tout cela vient-il de ce qu’il n’y a plus de croyances?
Nous en reparlerons, monsieur Augustin.
![]() L’ADMINISTRATION.—De cette mobilité du pouvoir il arrive
nécessairement qu’il n’y a pas d’administration.
L’ADMINISTRATION.—De cette mobilité du pouvoir il arrive
nécessairement qu’il n’y a pas d’administration.
Les choses vont encore à peu près, parce que nous avons hérité de la vieille machine administrative impériale, qui était bien faite, et qui, semblable à un tourne-broche, continue à tourner,—que ce soit un chien de race qu’on mette dedans pour y remuer les pattes, ou un de ces hideux chiens devant la nomenclature desquels Buffon a reculé.—On n’est pas nommé à une place ou à des fonctions parce qu’on est capable ou qu’on a fait des études spéciales, mais parce qu’on est cousin de quelqu’un ou utile à quelque autre.
Il y a des vaudevillistes devenus préfets.
![]() On a inventé le fonctionnaire indépendant,—rouage d’une machine où
il tourne à sa fantaisie;—ceci n’a l’air que d’une bêtise. Mais c’est
plus fort que ça n’en a l’air au premier abord, quand on sait que
l’indépendance d’un fonctionnaire consiste à abandonner le ministre
qui s’en va pour se tourner vers le ministre qui vient, et que c’est un
nom honnête qu’on est convenu de donner à la trahison pour la commodité
des personnes.
On a inventé le fonctionnaire indépendant,—rouage d’une machine où
il tourne à sa fantaisie;—ceci n’a l’air que d’une bêtise. Mais c’est
plus fort que ça n’en a l’air au premier abord, quand on sait que
l’indépendance d’un fonctionnaire consiste à abandonner le ministre
qui s’en va pour se tourner vers le ministre qui vient, et que c’est un
nom honnête qu’on est convenu de donner à la trahison pour la commodité
des personnes.
Est-ce au défaut de croyances qu’il faut attribuer cela? j’en sais plus de vingt qui me diraient oui. Vous savez ce que j’en pense, monsieur Augustin, et je sais ce que vous en penserez tout à l’heure.
![]() LA JUSTICE.—Il n’y a plus de justice.
LA JUSTICE.—Il n’y a plus de justice.
Le jury a été inventé sous prétexte de bon sens; il a voulu avoir de l’esprit,—il a manqué de bon sens.
Un juré est appelé à répondre sur cette question: «Un tel a-t-il fait ceci,—ou ne l’a-t-il pas fait?»—L’application de la peine ne le regarde pas, il ne doit la prendre en aucune considération.—Ce n’est pas ainsi que fait le jury; il décide dans sa volonté—s’il lui plaît ou ne lui plaît pas qu’un tel subisse telle ou telle peine; et à un appel à son bon sens et à sa conscience sur l’existence matérielle d’un fait,—il répond par des décisions aussi arbitraires que celle d’un cadi turc.
Un journal est accusé d’avoir attaqué la personne du roi,—il avoue à l’audience qu’il a prétendu attaquer la personne du roi.
Le jury interrogé répond que l’accusé n’a pas attaqué la personne du roi.
Le journal est acquitté et explique avec les autres journaux de l’opposition que le jury avait voulu donner une leçon au gouvernement.
Les journaux trouveraient sans doute fort mauvais que le gouvernement voulût donner une leçon au jury.
Cependant, s’ils approuvent que le jury,—qu’ils appellent juges citoyens et justice du pays quand ils sont acquittés, comme ils l’appellent bourgeois sans lumières quand ils sont condamnés;—s’ils approuvent que le jury juge d’après ses opinions politiques,—c’est-à-dire d’après le hasard qui fera que la majorité des douze juges appartiendra à leur parti;—il doivent admettre et louer également qu’un jury composé autrement le condamne pour leur donner une leçon.—Et alors il n’y a plus de justice,—il n’y a même plus de semblant de justice.
Rappelez-vous, d’autre part, ce que je vous ai dit,—que, sur soixante-douze places de présidents et procureurs généraux de cour royale,—il y en a quarante-deux données à des députés.
Rappelez-vous—que depuis que les marchands rendent la justice, l’assassinat est devenu un crime moins horrible que le vol, que le jury a trouvé des circonstances atténuantes dans plusieurs parricides.
D’autre part encore,—avant qu’un procès politique ne vienne à l’audience, il y a un mois que les journaux en parlent, flattent et menacent les juges; en un mot, grâce à la presse, il faut qu’un juge aime assez la justice pour lui sacrifier jusqu’à la réputation de la justice.
![]() DE LA LITTÉRATURE.—Nous allons, un moment, s’il vous plaît,
monsieur Augustin, parler de la littérature considérée comme puissance.
DE LA LITTÉRATURE.—Nous allons, un moment, s’il vous plaît,
monsieur Augustin, parler de la littérature considérée comme puissance.
Elle n’existe pas comme puissance, et elle est en train de ne plus exister comme littérature.
La presse,—cela veut dire, les journaux,—s’est inventée un jour elle-même; elle a fait semblant d’être la littérature, tant que cela a été utile à ses projets. Elle s’est servie de la littérature comme certains intrigants ont essayé de se servir de certains Louis XVII.
La littérature sert aujourd’hui au bas des journaux à faire la parade à la porte,—c’est le paillasse de la troupe.
Un poëte qui n’est que poëte vivra pauvre, mourra de faim et mourra inconnu.
Il ne peut pas dire comme Malherbe:—«J’ai toujours gardé cette discrétion de me taire de la conduite d’un vaisseau où je ne suis que passager.»
Il faut qu’il s’agrége à un parti politique; il devra, de préférence, écrire quelques phrases contre les tyrans et l’esclavage—(vieux style), parce que les journaux du gouvernement ne sont lus par personne.—Il n’y a pas d’exemple d’éloges sans restrictions perfides donnés par un journal à un écrivain qui n’est pas de son parti.
![]() Le gouvernement, de son côté, ne fait de cas que des
journalistes.—Un roman, une pièce de théâtre, ne peuvent que détruire
la société; qu’est-ce que cela fait? mais un journal renverse un
ministère, et ceci est grave.
Le gouvernement, de son côté, ne fait de cas que des
journalistes.—Un roman, une pièce de théâtre, ne peuvent que détruire
la société; qu’est-ce que cela fait? mais un journal renverse un
ministère, et ceci est grave.
![]() Les croix données à la littérature,—ce que je vous dis là n’est
pas une plaisanterie,—mais un fait, monsieur Augustin;—les croix
données à la littérature ne viennent pas du ministère de l’instruction
publique, mais du ministère de l’intérieur, et plus souvent encore du
ministère des affaires étrangères, auquel est, en général, attachée la
présidence du conseil.
Les croix données à la littérature,—ce que je vous dis là n’est
pas une plaisanterie,—mais un fait, monsieur Augustin;—les croix
données à la littérature ne viennent pas du ministère de l’instruction
publique, mais du ministère de l’intérieur, et plus souvent encore du
ministère des affaires étrangères, auquel est, en général, attachée la
présidence du conseil.
La littérature est aujourd’hui indépendante;—on méprise Boileau et Racine à cause des pensions que leur faisait Louis XIV.—Louis XIV ne trouverait pas aujourd’hui un écrivain qui accepterait une pension de lui. Il n’y a qu’une tache à cette indépendance:—c’est que les écrivains font antichambre chez les directeurs et propriétaires des journaux.
![]() Quand la littérature n’était pas encore affranchie, un bon ouvrage
faisait la fortune d’un homme.
Quand la littérature n’était pas encore affranchie, un bon ouvrage
faisait la fortune d’un homme.
Aujourd’hui, il faut travailler et vendre tous les jours;—la plume n’obéit pas à l’esprit, mais à la faim;—on n’a rien à dire, mais on a à dîner.
Les plus grands esprits de ce temps d’indépendance et d’affranchissement sont obligés de délayer leurs plus belles pensées dans des phrases inutiles. Les marchands de ce genre de denrée se sont rendu justice, en avouant qu’ils ne pouvaient reconnaître certainement que l’étendue d’un ouvrage et non point son mérite. Il faut s’arranger pour étaler ce qu’on a d’esprit, de talent et de pensée, sur un nombre de pages suffisant pour en pouvoir vendre toute sa vie.
On fait des chefs-d’œuvre,—comme les cabaretiers font de la soupe le dimanche:—on ajoute toujours de l’eau au bouillon primitif.
On a supprimé la postérité, ce paradis des auteurs tombés ou affamés,—parce qu’il faut manger de son vivant.
Une petite anecdote pour vous distraire, monsieur Augustin; c’est une petite médisance sur deux grands talents: M. de Balzac et M. Alexandre Dumas sont brouillés.
Au dernier voyage de M. Dumas, venant à Paris de Florence d’où, à la surprise générale, il n’a rapporté aucune nouvelle décoration,—un ami commun leur fait passer la soirée ensemble;—ils ne s’adressent pas la parole;—vers minuit, M. de Balzac sort et dit en passant devant M. Dumas: «Quand je serai usé, je ferai du drame.
—Commencez donc tout de suite,»—répond M. Dumas.
![]() LA POLICE.—Je ne vous parlerai de la police que pour mémoire,
monsieur Augustin;—le Français a horreur de la police;—il s’ensuit que
les gens honorables n’y veulent pas entrer—et que cette horreur,
d’abord sans raison, finit par être assez juste.
LA POLICE.—Je ne vous parlerai de la police que pour mémoire,
monsieur Augustin;—le Français a horreur de la police;—il s’ensuit que
les gens honorables n’y veulent pas entrer—et que cette horreur,
d’abord sans raison, finit par être assez juste.
Dans une émeute, si la police arrive au commencement, on dit: «On a donné, par une intervention maladroite, le caractère sérieux d’une émeute à un rassemblement inoffensif.»—Si la police attend que l’émeute se forme, on dit: «Au lieu de réprimer dès l’origine les cris de quelques gamins, la police, par sa coupable négligence, a laissé dégénérer un léger désordre en une émeute inquiétante.»
Je vous défie, quand un mouchard arrête un voleur, de dire à la mine quel est le voleur des deux.
Tâchez, cependant, de ne pas vous tromper; car le voleur se fâcherait.
L’uniforme donné aux sergents de ville était une mesure morale et honnête.
Mais il aurait fallu que cette mesure eût été générale.
La presse aurait dû soutenir cette mesure de tout son pouvoir;—loin de là, elle n’a que peu ou point blâmé les brigands qui en ont assassiné quelques-uns dans le faubourg Saint-Antoine; mais je vous défie, monsieur Augustin, d’inventer une mesure, quelque généreuse, utile, libérale qu’elle soit, qui obtienne l’assentiment sans restriction des journaux. Il est donc resté une partie de la police et la plus grande partie,—qui procède comme les voleurs,—c’est-à-dire par surprise et par guet-apens.
Ces gens qu’on lâche dans les émeutes sans aucun insigne se meuvent indistinctement sur les curieux et sur les émeutiers, et frappent les uns et les autres avec une intolérable brutalité.
C’est de la sauvagerie:—tous les agents de l’autorité doivent être reconnaissables à des marques distinctives; on doit punir avec la plus grande sévérité tout citoyen qui leur oppose la moindre résistance; mais tout citoyen a le droit de tuer comme un chien tout homme qui, sans se faire reconnaître à un signe irrécusable comme agent avoué de l’autorité, porte la main sur lui pour le frapper ou pour l’arrêter.
![]() Les gens qui manquent de délicatesse dans l’esprit, ou
d’imagination ou de gaieté,—tâchent d’assommer les agents de la police.
Les gens qui manquent de délicatesse dans l’esprit, ou
d’imagination ou de gaieté,—tâchent d’assommer les agents de la police.
Ceux qui sont plus gais se contentent de farces plus ou moins exagérées.—A Paris, surtout, la police a toujours tort; il n’y a pas de position si élevée dans la police qui puisse sauver le magistrat qui l’exerce.
Dans les dernières émeutes,—la police avait fort à faire pour défendre le préfet contre les enfants du peuple qui voulaient absolument monter en croupe sur son cheval blanc.—A mesure qu’on en ôtait un,—il en regrimpait deux autres.
![]() Le bourgeois de Paris, du reste, s’est fort habitué aux
émeutes;—quand elle n’est pas dans sa rue ni devant sa boutique, il n’y
voit déjà plus un danger. Il viendra peut-être un jour où il n’y verra
plus un spectacle. Or, les spectateurs forment la moitié d’une
émeute,—la police y est pour un quart,—les vrais émeutiers pour
l’autre quart.
Le bourgeois de Paris, du reste, s’est fort habitué aux
émeutes;—quand elle n’est pas dans sa rue ni devant sa boutique, il n’y
voit déjà plus un danger. Il viendra peut-être un jour où il n’y verra
plus un spectacle. Or, les spectateurs forment la moitié d’une
émeute,—la police y est pour un quart,—les vrais émeutiers pour
l’autre quart.
Seulement, ceux-ci se sauvent,—et on ne prend presque que les spectateurs, qui, fiers de leur innocence, restent sur la place, où on les empoigne.
![]() Un nommé Barbet, tonnelier, est amené devant le tribunal.—Il est
accusé d’avoir porté le drapeau rouge:
Un nommé Barbet, tonnelier, est amené devant le tribunal.—Il est
accusé d’avoir porté le drapeau rouge:
«Ce drapeau était ma cravate. On voulait me la prendre à cause de la couleur pour en faire un drapeau. J’ai mieux aimé porter le drapeau que de me séparer de ma cravate, qu’on m’aurait volée.»
Qui sait où Barbet pouvait être conduit pour ne pas quitter sa cravate?—Que l’émeute eût réussi, et M. Barbet pouvait devenir roi de France sous le nom de Barbet Ier.
Vous froncez le sourcil,—monsieur Augustin;—Barbet vous semble un homme dangereux pour les droits que vous avez failli tenir de la nation.
Mais soyez sûr que tout ceci finira par une bouffonnerie de cette force-là.
![]() J’ai connu un homme qui, à la révolution de Juillet,—voyant à
l’Hôtel de Ville une table ronde où étaient assis des messieurs qui
écrivaient, s’y assit dans un coin vacant, et apprit que par ce seul
fait il faisait partie du gouvernement provisoire; il se mit donc à
écrire comme les autres; mais il eut besoin de s’absenter trois minutes.
Quelque gouvernement que l’on soit à l’improviste, quelque obligé qu’on
se trouve de consacrer son temps à son pays, la nature a des lois
inexorables;—notre homme sort et laisse son chapeau à sa place.
J’ai connu un homme qui, à la révolution de Juillet,—voyant à
l’Hôtel de Ville une table ronde où étaient assis des messieurs qui
écrivaient, s’y assit dans un coin vacant, et apprit que par ce seul
fait il faisait partie du gouvernement provisoire; il se mit donc à
écrire comme les autres; mais il eut besoin de s’absenter trois minutes.
Quelque gouvernement que l’on soit à l’improviste, quelque obligé qu’on
se trouve de consacrer son temps à son pays, la nature a des lois
inexorables;—notre homme sort et laisse son chapeau à sa place.
Il reste trois minutes et rentre,—il n’était plus gouvernement. Un autre monsieur s’était assis à la place, et le repoussa du coude.—«Au moins,—dit-il,—rendez-moi mon chapeau.»—On lui rendit son chapeau.
![]() L’ÉGLISE.—Il n’y a plus d’Église.
L’ÉGLISE.—Il n’y a plus d’Église.
Ou au moins l’Église n’a plus ni force ni action. Il y a deux classes de personnes qui vont à la messe:
Les partisans de la légitimité,—parce que c’est une protestation contre les doctrines libérales;
Les bourgeois parvenus et les danseuses,—parce que cela est comme il faut, et parce que l’ancienne aristocratie y allait.
Ah!—il y a aussi... les gens pieux qui y vont pour prier Dieu.
Il y a deux classes de prêtres:
Ceux qui ont pris pour modèle les bons curés de M. de Béranger,—qui chantent à table,—prennent le menton aux filles et vont à la chasse;
Ceux qui, au contraire, voulant s’opposer au flot du libéralisme, se sont renfermés dans les vieilles choses de l’Église,—parlent contre les juifs, contre les pharisiens, contre Luther,—traitent des questions de dogme,—ne se mêlent à rien des choses de ce temps-ci,—professent les doctrines qu’on n’attaque pas, parce qu’on ne s’en occupe guère, et une religion qui exerce précisément autant d’influence que celle du bœuf Apis,—ou celle de Teutatès.
Je n’appelle pas prêtre—M. ***, qui n’est pas chrétien,—ni M. Châtel, qui, sacré évêque par un épicier de la rue de la Verrerie, a sacré Auzou, ancien comédien de la banlieue, lequel Auzou l’a excommunié, et, qui pis est, mis à la porte;
Ce M. Châtel, primat des Gaules,—qui tour à tour dit la messe dans une église de garçon, à l’entresol,—rue de la Sourdière;—dans un local, boulevard Saint-Martin,—où il remplaçait un rhinocéros et un éléphant, et dans l’écurie des pompes funèbres.
![]() Je ne suis pas très-disposé à appeler prêtres non plus des hommes
qui ont pris ce métier comme un autre,—pour faire leurs affaires,
comme M. Ollivier,—hier curé de Saint-Roch, aujourd’hui évêque
d’Évreux, qui attirait du monde dans son église au moyen de la musique
de l’Opéra;
Je ne suis pas très-disposé à appeler prêtres non plus des hommes
qui ont pris ce métier comme un autre,—pour faire leurs affaires,
comme M. Ollivier,—hier curé de Saint-Roch, aujourd’hui évêque
d’Évreux, qui attirait du monde dans son église au moyen de la musique
de l’Opéra;
Ni celui de Notre-Dame-de-Lorette, qui travaille dans une église Musard si mal composée, que la police est obligée d’y tenir des sergents de ville;
Ni celui,—j’ai oublié son nom,—qui faisait annoncer dans les journaux (un franc la ligne), avec les sous-jupes-Oudinot,—que M. Lacordaire prêcherait dans son église en costume de dominicain;
Et, s’il n’ajoutait pas, comme le marchand de crinoline, cinq ans de durée,—c’est que ce n’est pas une qualité que l’on prise d’ordinaire dans les sermons.
![]() La prêtrise est à ces gens-là ce que la farine est au paillasse
Debureau: elle sert à les rendre plus grotesques.
La prêtrise est à ces gens-là ce que la farine est au paillasse
Debureau: elle sert à les rendre plus grotesques.
![]() L’ARMÉE.—Les baïonnettes intelligentes inventées pour l’armée
par les journaux sont le digne pendant de l’indépendance des
fonctionnaires.—L’émeute réussie de Juillet, où on a récompensé les
soldats qui avaient passé du côté du peuple, et les émeutes manquées de
Lyon et autres lieux, où on a puni ceux qui avaient fait la même chose,
ont jeté quelque perturbation dans l’armée.
L’ARMÉE.—Les baïonnettes intelligentes inventées pour l’armée
par les journaux sont le digne pendant de l’indépendance des
fonctionnaires.—L’émeute réussie de Juillet, où on a récompensé les
soldats qui avaient passé du côté du peuple, et les émeutes manquées de
Lyon et autres lieux, où on a puni ceux qui avaient fait la même chose,
ont jeté quelque perturbation dans l’armée.
Les journaux ont loué l’insubordination et attaqué violemment la discipline.
Quand il a fallu réprimer des émeutes, on a dit que les soldats assassinaient le peuple.
Pour plaire aux journaux, il faut qu’ils trahissent leur serment, manquent à leur honneur, et s’exposent à être fusillés de par un conseil de guerre, à Grenelle;—pour ne pas trahir leur serment, ne pas manquer à leur honneur, et ne pas s’exposer à être fusillés à Grenelle, il faut qu’ils s’exposent à être appelés assassins dans les journaux et fusillés par le peuple au coin des rues. La position est difficile;—quand, à Clermont, ils combattaient l’émeute, dont le recensement était le prétexte, on disait qu’ils assassinaient le peuple; comme s’ils n’étaient pas le peuple aussi, et comme si, en fait d’impôts, ils ne payaient pas le plus lourd de tous, l’impôt de la vie et du sang!
En même temps que vous vous plaignez de l’armée, vous faites tous vos efforts pour rompre tous les liens de la discipline;—mais, si vous réussissiez, c’est alors que l’armée serait redoutable et odieuse.
![]() LE PEUPLE.—Il y a un mois,—dans un chapitre des Guêpes adressé
à M. de Cormenin,—je lui demandais ce qu’était le peuple.—Cette
question a été fort débattue dans les journaux depuis quinze jours.
LE PEUPLE.—Il y a un mois,—dans un chapitre des Guêpes adressé
à M. de Cormenin,—je lui demandais ce qu’était le peuple.—Cette
question a été fort débattue dans les journaux depuis quinze jours.
Sur cette question comme sur les autres,—on a vu tomber
Le peuple, comme partie du pays tranchée et séparée, n’existe pas.—Quand une chose existe, on doit pouvoir dire où elle commence et où elle finit.
Quelques dissentiments politiques qu’il y ait entre vous et moi, vous ne pouvez pas me nier qu’une pomme est une pomme.—Si vous me montrez un soldat, et que vous me disiez: «Voici un soldat,»—je ne puis pas vous répondre: «Ce n’est pas un soldat.»
Le peuple de certains journaux se compose des gens qui font des émeutes.
Le peuple de certains autres se compose des gens qui n’en font pas.
Le «pays» a absolument le même sens.
Le pays, comme le peuple, veut dire ceux qui pensent comme nous,—ou ceux par qui nous faisons tirer les marrons du feu.
Les journaux républicains appellent le peuple la classe la plus nombreuse.
Puis, un jour d’émeute, ils disent: «Le peuple est sur la place.»
Puis, l’émeute finie, on trouve que l’émeute se composait de trois cents hommes,—dont cent cinquante spectateurs,—cinquante gamins au-dessous de seize ans,—quarante voleurs,—et cinquante agents de police,—et une dizaine de pauvres diables de bonne foi qui croient combattre pour la liberté dont ils jouissaient sans contestation, et dont ils se sont privés pour quelques mois.
Le National a déclaré qu’il n’y avait plus de bourgeois, qu’ils étaient trop mêlés au peuple pour qu’on pût les reconnaître.
Disons alors que le peuple est également trop mêlé aux bourgeois pour qu’on puisse le discerner.
Pourquoi alors le National parle-t-il si souvent du peuple, par opposition aux bourgeois?
Les gens qui se font tuer dans les émeutes sont pris généralement sur les dix pauvres diables de bonne foi dont je parlais tout à l’heure.
On brûle un peu,—on pille pas mal.
Et alors vous lisez le lendemain dans le Constitutionnel que tout cela aura pour résultat heureux de ramener M. Passy aux affaires.
Le Courrier Français préfère M. Dufaure.
Le peuple, si respecté,—si prôné, si sanctifié par les partis; le peuple, pour lequel on fait tout, pour lequel on demande tout, est une assez heureuse invention. Si on disait, par exemple, qu’on prend ou qu’on demande telle ou telle chose pour M. Augustin, du café Lyonnais, M. Augustin, du café Lyonnais, dirait le lendemain: «Mais vous ne m’en donnez pas!»
Tandis que le peuple... Qui est-ce qui peut dire: «Je suis le peuple?»
Et d’ailleurs on peut toujours répondre:—«Vous n’êtes pas le peuple.»
Voyez, du reste, monsieur Augustin, relativement au peuple, le dernier numéro des Guêpes.
![]() Songez seulement à l’importance qu’a une émeute aux yeux de la
raison—en voyant que:
Songez seulement à l’importance qu’a une émeute aux yeux de la
raison—en voyant que:
Un grand nombre des habitants des communes de Beaumont et d’Aubières se sont battus dans les rues de Clermont pour empêcher le recensement; lequel recensement avait été fait dans les communes d’Aubières et de Beaumont depuis longtemps déjà, et n’y avait rencontré aucune opposition.
![]() LA PRESSE.—C’est ici, monsieur Augustin, que vous avez à me
rappeler quelque chose.
LA PRESSE.—C’est ici, monsieur Augustin, que vous avez à me
rappeler quelque chose.
O moralistes!—ô philosophes!—ô poëtes!—qui dites: «La société tombe en dissolution,—parce qu’il n’y a plus de croyances,—parce qu’on ne croit plus à rien.»
![]() O mes braves gens! plus de croyances! Mais jamais il n’y a eu
autant de crédulité; jamais les hommes n’ont été aussi jobards et aussi
gobe-mouches; mais les peuples qui adorent et prient la fiente du grand
lama sont des incrédules et des voltairiens auprès de nous.
O mes braves gens! plus de croyances! Mais jamais il n’y a eu
autant de crédulité; jamais les hommes n’ont été aussi jobards et aussi
gobe-mouches; mais les peuples qui adorent et prient la fiente du grand
lama sont des incrédules et des voltairiens auprès de nous.
Plus de croyances!—Mais on croit à tout;—mais on se dispute pour tout;—mais on se bat pour tout.
Plus de croyances!—à une époque où un pouvoir aussi singulier que celui de la presse est le seul pouvoir!
On ne croit plus à rien!—Mais écoutez donc, monsieur Augustin.
La presse est un pouvoir qu’il faudrait comparer à Dieu si on ne connaissait pas les champignons,—car il ne procède que de lui-même.
La presse est un champignon qui s’est élevé un matin sur le détritus de tous les autres pouvoirs.
La presse est une puissance nourrie de toutes les autres puissances qu’elle a dévorées.
La liberté de la presse est engraissée du carnage de toutes les autres libertés.
Elle crève d’indigestion et de pléthore.
«On ne croit plus à rien,» dites-vous, parce qu’on ne croit plus à la sainte ampoule, parce qu’on ne prie pas Louis-Philippe de toucher les écrouelles;—on ne croit plus à rien, parce qu’on ne croit plus à nos vieux contes.
Vous dites qu’il n’y a plus de croyances, comme les vieilles femmes disent qu’il n’y a plus de galanterie et plus d’amour.
On ne croit plus à rien!—mais on croit à M. Léon Faucher,—mais on croit à M. Chambolle,—mais on croit à M. Jay.
Mais on croit aux journaux.
Mais on croit aux histoires de centenaires, de veaux à deux têtes, de mendiants millionnaires, toujours les mêmes qu’ils vous racontent quand il n’y a ni séances des Chambres, ni crime un peu corsé.
On ne croit plus à rien!—mais vous avez cru le journal le Temps quand il vous racontait que les Espagnols avaient saisi la Victorieuse; et, quand il a été obligé d’insérer le démenti du ministère, vous avez cru aux choses qu’il vous a racontées le lendemain.
On ne croit plus à rien!—mais, quand le National vous a dit:
«M. Pauchet, membre du conseil général d’Eure-et-Loir, a voté contre le recensement,»
On lui a répondu:
«M. Pauchet n’a pas voté contre le recensement, parce qu’il est MORT depuis plusieurs mois.»
Et vous avez cru ce qu’il a plu au National de vous dire le lendemain.
On ne croit plus à rien!—mais vous avez cru que le duc de Bordeaux était mort, parce que le Moniteur parisien vous l’avait dit.
On ne croit plus à rien! mais le journal le Siècle vous dit: «Le recensement va commencer à Paris; nous ne nous y soumettrons pas, nos portes seront fermées.» On lui répond: «Mais, monsieur le Siècle, il y a quatre mois que vous êtes recensé—vous et votre imprimerie et vos bureaux,—et le lendemain vous lisez le Siècle, et vous croyez ce qu’il vous dit.
On ne croit plus à rien!—mais vous croyez aux pluies de crapauds,—vous croyez au serpent de mer,—vous croyez aux revenants,—vous croyez au chou colossal,—vous croyez à tout ce que les journaux vous racontent.
Les journaux vous disent qu’il y a une émeute à la porte Saint-Denis,—vous allez voir l’émeute qui n’y est pas;—mais la police, aussi naïve que vous, qui vient de son côté, vous prend pour l’émeute et vous empoigne.
Il n’y a plus de croyance! mais trouvez-moi dans une religion,—chez les sauvages mêmes,—croyance plus bizarre à des dogmes plus absurdes.
Quoi! vingt-quatre caractères,—vingt-quatre lettres,—arrangés de certaines façons et mis sous vos yeux sur un carré de papier,—suffisent pour vous rendre gais ou furieux!
Quoi! ces vingt-quatre fétiches, ces vingt-quatre idoles, selon que celle-ci est mise avant celle-là, et celle-là avant celle-ci,—vous imposent toutes leurs volontés!
![]() La presse est un pouvoir immense qui n’en reconnaît aucun au-dessus
de lui,—ni aucun à côté de lui.
La presse est un pouvoir immense qui n’en reconnaît aucun au-dessus
de lui,—ni aucun à côté de lui.
La presse demande compte de ses actions et de ses pensées au capitaine comme au législateur, à l’agriculteur comme au marin, à l’artiste comme au savant.
La presse est donc dirigée par les savants, les artistes, les agriculteurs, les marins, les capitaines, les législateurs les plus illustres, les plus infaillibles et reconnus par tout le monde comme les plus sages et les plus érudits—pour qu’ils osent ainsi parler d’en haut à tout le monde?
Non, la presse est dirigée par des écrivains—et non pas même par les écrivains les plus illustres du pays;—il n’y en a pas dix dans tous les journalistes dont vous sachiez les noms.
Que le plus fort de tous ces autocrates parle dans une assemblée,—on ne l’écoutera pas;—mais que ses paroles arrivent par la poste, imprimées sur un carré de papier, on ne s’avisera pas de les révoquer en doute, si ce n’est sur la foi d’un autre carré de papier.
Contrairement à la religion du Christ, l’esprit est une religion qui périrait, par l’incarnation; c’est un dieu qui doit ne se manifester que par le bruit de sa colère et de sa foudre, et qui est perdu quand il se montre lui-même.
Grand Dieu! toutes les puissances donnent leur démission, parce qu’il n’y a plus de croyances à une époque où les hommes ont la charmante naïveté de se laisser gouverner par vingt-quatre morceaux de plomb, du papier et de l’encre.
![]() Mais ne faites donc plus de balles. La puissance militaire est
morte comme les autres. Je vous ai dit que la presse l’avait mangée.
Fondez donc toutes vos balles pour en faire des alphabets. Démolissez
vos arsenaux et faites des casses d’imprimerie.
Mais ne faites donc plus de balles. La puissance militaire est
morte comme les autres. Je vous ai dit que la presse l’avait mangée.
Fondez donc toutes vos balles pour en faire des alphabets. Démolissez
vos arsenaux et faites des casses d’imprimerie.
Quoi! il y a une puissance comme celle-là, et ce n’est pas la royauté qui la tient dans ses mains!—Ah! vous méritez ce qui vous arrive, et, qui pis est, ce qui vous arrivera.
Cette puissance, vous ne savez pas la prendre; et vous lui donnez de la force,—vous lui créez des priviléges par vos sottes lois fiscales, par votre avarice insatiable: ne vous plaignez donc pas d’être fouettés, puisqu’on vous paye pour cela, puisque vous faites et vendez les verges.
Liberté illimitée à la presse, plus de timbre, plus de cautionnement, plus de procès,—et elle meurt apoplectique.
![]() Vous ne savez pas la tuer,—vous ne savez pas la conquérir:—elle
vous tuera,
Vous ne savez pas la tuer,—vous ne savez pas la conquérir:—elle
vous tuera,
Puis elle se tuera après; car il faut aussi lui dire la vérité.
Elle peut tout contre les autres,—elle ne peut rien ni pour les autres, ni pour elle-même.
Elle tue, elle ne crée pas,—elle ne vit pas.
Elle mange tout et elle ne produit rien; quand elle aura tout dévoré,—elle mourra d’indigestion ou de faim.
![]() Ainsi donc, monsieur Augustin,—vous savez comment sont les choses,
je crois vous les avoir montrées avec fidélité.
Ainsi donc, monsieur Augustin,—vous savez comment sont les choses,
je crois vous les avoir montrées avec fidélité.
Permettez-moi de vous donner un conseil: tâchez qu’on tue le moins de monde possible, ne dégradez plus personne; il y a bien assez de gens qui se dégradent eux-mêmes, vous pouvez bien attendre.
Croyez-moi, restez au café Lyonnais,—ne livrez pas votre modeste existence à tout ce brouhaha.—Qui sait si votre gloire n’a pas déjà produit pour vous des fruits amers,—et si on ne dit pas de vous, au café Lyonnais,—comme du héros d’un des spirituels dessins de Daumier,—que «vous connaissez le double blanc?»
![]() L’AUTEUR. Les choses sont au fond comme elles ont toujours
été,—comme elles seront toujours.
L’AUTEUR. Les choses sont au fond comme elles ont toujours
été,—comme elles seront toujours.
Les hommes ne sont pas si frères qu’on le dit; à peine étaient-ils trois ou quatre au monde, qu’ils ont commencé à s’entre-tuer.
Et La Bruyère l’a dit:
«S’il n’y avait que deux hommes sur la terre, ils ne tarderaient pas à avoir dispute, quand ce ne serait que pour les limites.»
La perturbation actuelle vient de ce que le peuple est un peu comme l’ours du Jardin des Plantes: on lui jette au bout de son arbre un gâteau au haut d’une ficelle pour le faire monter,—puis, quand il monte, on retire la ficelle.
On lui a montré depuis onze ans le gâteau de trop près,—et il est d’autant plus irrité de ne pas le manger.
Que ce soient ceux-ci ou ceux-là,—les plus forts opprimeront toujours les autres, comme les gros poissons mangent les petits et sont eux-mêmes mangés par de plus gros.—Que ceux qu’on appelle le peuple aujourd’hui—deviennent ceux qu’on appelle le pouvoir,—ceux-ci joueront à leur tour le rôle du peuple,—qui jouera le rôle que joue le pouvoir aujourd’hui.
C’est pourquoi tout cela—m’est égal.
Les papiers brûlés.—Service rendu à la postérité.—Une phrase du Courrier français.—PREMIÈRE OBSERVATION.—De la rente.—DEUXIÈME OBSERVATION.—L’infanterie et la cavalerie.—TROISIÈME OBSERVATION.—Les que.—QUATRIÈME OBSERVATION.—Une épitaphe.—CINQUIÈME OBSERVATION.—Réponse à plusieurs lettres.—M. de Cassagnac et le mal de mer.—De la solitude.—M. Lautour-Mézeray.—Abdalonyme.—M. Eugène Sue.—M. Véry.—Louis XIII.—M. Thiers et M. Boilay.—Deux mots de M. Thiers.—Un rédacteur entre deux journaux.—Encore le roi et ses maraîchers.—M. Cuvillier-Fleury.—M. Trognon.—M. de Latour.—Charlemagne.—La Salpêtrière.—La police et les cochers.—Les cigares de Manille.—Sagacité d’un carré de papier.—SIXIÈME OBSERVATION.—SEPTIÈME OBSERVATION.—HUITIÈME OBSERVATION.—Sur l’égalité.—Un blanc domestique d’un noir.—Caisse d’Épargne.—Les mendiants.—Aperçu du Journal des Débats.—Arbor sancta, nouveau chou colossal.—NEUVIÈME OBSERVATION.—Jules Janin, poëte latin.—Une caisse.—Éducation des enfants.—DIXIÈME OBSERVATION.—La vérité sur Anacréon et sur ses sectateurs.—Une élection.—ONZIÈME OBSERVATION.—DOUZIÈME OBSERVATION.—Post-scriptum.
![]() NOVEMBRE.—Je commencerai cette troisième année par rendre un
immense service à la postérité.
NOVEMBRE.—Je commencerai cette troisième année par rendre un
immense service à la postérité.
Comme hier, à la fin du jour, il s’élevait de la terre un brouillard froid et épais, je passai la soirée devant le feu à brûler des papiers;—j’ouvris successivement plusieurs cartons, et je fis un triage sévère,—en conservant quelques-uns et livrant aux flammes le plus grand nombre. Toutes ces pensées confiées au papier à diverses époques, par diverses personnes et dans des intentions différentes, formaient un pêle-mêle assez bizarre;—il y avait des promesses et des menaces: des paroles d’amitié, d’amour, de haine, de politesse, enfouies dans ces cartons comme dans la mémoire. En y plongeant la main et en chiffonnant et faisant crier le papier, il me semblait entendre s’échapper une multitude de petites voix qui toutes à la fois me répétaient ce que ces papiers en leur temps avaient été chargés de m’apprendre.—C’était une singulière confusion: Merci des belles fleurs que vous m’avez envoyées, mon ami.—CONTRIBUTIONS DIRECTES. Sommation avec frais.—M*** prie M. Karr de lui faire le plaisir de passer la soirée chez lui le.....—Je ne sais, monsieur, à quoi attribuer.....—Eh bien, oui, je vous crois...—Louis-Philippe, Roi des Français, à tous ceux qui...
Et je les jetais au feu par poignées; puis je vins à rencontrer une liasse énorme de journaux, et je les brûlai tous sans examen.
Et je pensai que, sans doute, je n’étais pas le seul qui profitât des premiers jours où le foyer se rallume pour débarrasser sa maison de l’encombrement des journaux; je me rappelai aussi à combien d’usages domestiques on les consacre d’ordinaire,—et je me dis: «Il viendra un jour où il ne restera plus aucun de ces carrés de papier si puissants aujourd’hui,—un jour où les savants d’une autre époque tâcheront inutilement d’en recomposer un de fragments déshonorés et de cornets épars, comme CUVIER a fait pour les animaux antédiluviens, tels que les dinotherium giganteum.»—Et, dans cette triste pensée, je résolus de laisser à mes arrière-neveux, dans mes petits volumes, qui vivront éternellement, ainsi que vous l’a appris leur éditeur dans son avis du mois dernier,—un fragment important d’un des plus redoutables de ces tyrans de notre époque, en l’ornant d’un commentaire destiné à en faire ressortir les beautés, et à fixer le sens des passages qui pourraient présenter quelque obscurité à une époque plus avancée, ainsi qu’on l’a fait à l’égard de Virgile et d’Homère, qui certes n’ont jamais exercé sur leurs contemporains une puissance égale à celle du moindre des susdits carrés de papier. Ce passage ne peut être long; on sait ce que c’est qu’un commentaire. Il y a tel hémistiche de Virgile sur lequel un seul commentateur a fait trente pages d’explications.
Je prendrai donc une phrase très-courte et très-récente du Courrier français.
«Pour que cet océan reprenne son niveau, il faut que les flots montent graduellement et lentement.»
Écoutez donc, mes guêpes, la voix de votre maître qui vous rappelle des jardins.—Voici la belle saison finie:—les feuilles des arbres roulent par les chemins,—la vigne marchande au vent ses feuilles jaunes,—le cerisier ses dernières feuilles orange.—La feuille de la ronce a pris dans les bois de riches teintes de pourpre. La séve paresseuse ne monte plus jusqu’au sommet des rameaux.—Les dahlias sont décolorés et presque simples,—les astres seuls et les chrysanthèmes de l’Inde montrent encore leurs fleurs:—les premières, étoiles inodores d’un violet triste;—les secondes, houppes échevelées, exhalant une odeur qui semble appartenir à la boutique d’un parfumeur.
Une pluie froide appesantit vos ailes;—rentrez, mes guêpes, et cette fois cherchez votre butin dans la poussière des vieux livres.
![]() Première observation.—«Pour que cet océan reprenne son niveau,
il faut que les flots montent graduellement et lentement.»
Première observation.—«Pour que cet océan reprenne son niveau,
il faut que les flots montent graduellement et lentement.»
C’est de la rente qu’entend ici parler l’écrivain.—La rente est de nos jours une chose assez importante pour qu’il n’ait pas hésité à employer, à propos d’elle, une figure hardie et neuve, non pas précisément en elle-même, mais par son application.—Nous ne voyons pas, en effet, qu’aucun poëte ancien ait jamais comparé l’Océan au cinq ni au trois pour cent; et cependant on ne peut pas leur reprocher d’avoir été trop sobres de comparaisons océaniennes.
Quelques personnes demanderont quel est le célèbre financier qui traite de la rente dans les colonnes du Courrier français. Nous sommes fâché d’avoir à dire pour la centième fois à nos lecteurs que ce n’est pas un financier; on pourra m’opposer ces deux vers d’Andrieux:
Cette maxime spécieuse n’a aucun sens quand il s’agit des journaux. On est pour ou contre le pouvoir; si on est pour, tout ce qu’il fait est bien fait;—si on est contre, tout ce qu’il fait est mal fait:—il n’y a pas besoin d’être financier pour cela,—ce serait même une gêne.
Ce monsieur n’est pas non plus un marin; autrement il aurait remarqué que, lorsque l’Océan n’a plus son niveau, ce n’est pas par l’abaissement des flots, mais bien au contraire par leur élévation,—et que les flots, remontant graduellement ou autrement, ne peuvent lui rendre ce niveau.
L’écrivain a écrit cela comme madame de Pompadour traçait à sa toilette sur la carte et envoyait à l’armée au maréchal d’Estrées des plans de campagne marqués avec des mouches.—Mais, comme l’a dit Voltaire, il vaut mieux frapper fort que frapper juste.
Passons aux remarques de détail.
Deuxième observation.—POUR.
Nous retrouvons ce mot dans plusieurs écrivains.—Mais nous ne pensons pas qu’aucun s’en soit servi aussi à propos que notre auteur. Donnons quelques exemples:
«Il faut que l’homme, dans sa lutte avec la vie hostile, combatte pour arriver au bonheur.»—SCHILLER.
«Lorsque je cherche des noms pour les sentiments nouveaux que j’éprouve...»—GOETHE, Faust.
«Messieurs, je suis pour les pauvres. Tous les habitants de Paris sont mes enfants; c’est les pauvres qu’est les aînés.»
M. DE RAMBUTEAU, préfet de la Seine.
Cherchez dans RACINE la scène entre Achille et Agamemnon, vous verrez pour répété quatre ou cinq fois en sept ou huit vers.—C’est un défaut que notre auteur a sagement évité: lisez et relisez sa phrase, vous n’y verrez pour qu’une seule fois.
Le capitaine D*** me disait: «Voici un des mille avantages du cavalier sur le fantassin:—si, après dîner, le fantassin prend un morceau de sucre et un morceau de pain pour son déjeuner du lendemain,—il a l’air d’un grigou et d’un meurt-de-faim; le cavalier dit: C’est pour ma jument,—et personne ne le trouve mauvais.»
Troisième observation.—QUE.
«Ma chambre, ou plutôt une armoire qu’on a faite pour me serrer.»—CHAPELLE.
«Attendez que je chausse mes lunettes.»—RABELAIS.
«Notre envie dure plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions.»—LA ROCHEFOUCAULD.
«C’est à M. Rousselot, mon prédécesseur à la cour, que le public est redevable des premiers éléments de l’art de soigner les pieds.»—M. LAFOREST, pédicure du roi et de Monsieur, frère du roi. 1781.
De ce temps-ci le que est tombé dans une sorte de discrédit à cause des discours de S. M. Louis-Philippe, où les journalistes ont cru en remarquer plus qu’il n’est rigoureusement nécessaire. Il n’en est pas moins vrai que tous nos bons auteurs s’en sont servis, et que le rédacteur du Courrier français, est suffisamment autorisé par leur exemple. La malveillance lui reprochera peut-être de l’avoir employé deux fois dans cette phrase. Je citerai, pour le justifier, un exemple également applicable aux discours du roi:
«Ce qu’on nomme libéralité n’est le plus souvent que la vanité de donner, que nous aimons mieux que ce que nous donnons.»—LA ROCHEFOUCAULD.
![]() Quatrième observation.—CET.
Quatrième observation.—CET.
Notre auteur s’est bien gardé de commettre ici une de ces grossières erreurs si fréquentes dans la bouche ou sous la plume des hommes illettrés. Il a fait accorder le pronom cet en genre et en nombre avec le substantif auquel il se rapporte. Il n’a pas imité M. de B***, qui écrivait cette exemple,—cette horoscope.
Il a suivi, pour l’emploi de ce mot, Ovide, qui dit:
«Ablatum mediis opus in cudibus istud.»
«On m’enlève cet ouvrage encore sur le métier.»
Nous retrouvons ce pronom dans plusieurs écrivains, qui l’ont employé absolument dans le même sens.
Une femme priait Scarron de faire son épitaphe; c’était un compliment qu’elle voulait obtenir, et Scarron n’était pas disposé à le donner. «Eh bien! dit-il après s’en être défendu longtemps,—mettez-vous derrière cette porte;—il m’est impossible de faire l’épitaphe d’une personne que je vois vivante sous mes yeux.»—Elle obéit, et, après avoir rêvé un moment, il dit:
ÉPITAPHE;
«Cet aigle en cette cage.»—VICTOR HUGO.
Cinquième observation.—OCÉAN.
L’avocat MICHEL (de Bourges) a dit, en pleine Chambre des députés:—«Un océan inextricable.»—C’est une métaphore qui équivaut absolument à celle qui nous peindrait un écheveau de fil en fureur.
Me Michel n’est pas le seul avocat qui s’exprime ainsi. Consolons-le par l’exemple de deux hommes d’un grand talent.
Me BERRYER a à se reprocher:—«C’est proscrire les bases du lien social.»
Et M. le vicomte DE CORMENIN a écrit:—«Le budget est un livre qui tord les larmes et la sueur du peuple pour en tirer de l’or.»
Ajoutons, pour consoler à leur tour ces deux messieurs, que MALHERBE a dit:
«Prends ta foudre, Louis, et va comme un lion.»
M. DE CASSAGNAC a dernièrement raconté, avec beaucoup d’esprit et je dirai d’éloquence, les effets du mal de mer;—seulement il se trompe quand il dit que les anciens n’en ont pas dit un mot. PLUTARQUE, cité par MONTAIGNE, en parle dans le Traité des causes naturelles, et SÉNÈQUE a écrit à ce sujet:
Pejus vexabar quam ut periculum mihi succurreret. «Je souffrais trop pour penser au danger.»
Plus je multiplierais les exemples,—plus je prouverais que l’emploi que notre auteur a fait du mot océan est neuf et hardi.
![]() Réponse à plusieurs lettres.—Beaucoup de gens me blâment de
passer la plus grande partie de ma vie au bord de la mer. C’est
incroyable tout ce qu’on a de sagesse pour les autres,—et comme on voit
clair dans leurs affaires et dans leurs intérêts.
Réponse à plusieurs lettres.—Beaucoup de gens me blâment de
passer la plus grande partie de ma vie au bord de la mer. C’est
incroyable tout ce qu’on a de sagesse pour les autres,—et comme on voit
clair dans leurs affaires et dans leurs intérêts.
Quelqu’un m’écrivait dernièrement: «Vous n’êtes pas à Paris, vous n’allez pas dans le monde,—vous ne savez pas ce qui se passe.»—Et ce quelqu’un terminait sa lettre par me faire part de cinq ou six choses dont j’avais parlé un mois auparavant dans les Guêpes; choses qu’il n’avait apprises que de gens qui les tenaient de mes petits soldats ailés.
J’ai souvent cherché la cause qui fait qu’on est si fort irrité contre quelqu’un qui vit dans la solitude. Est-ce donc que les gens ont besoin de tant de spectateurs pour les belles choses qu’ils disent et qu’ils font, qu’ils ne vous permettent de vous absenter que pendant leurs entr’actes d’héroïsme et de grandeur?
Est-ce que l’homme qui vit seul semble dire aux autres un peu trop orgueilleusement qu’il n’a pas besoin d’eux?
Est-ce que l’homme qui vit seul est pour les autres un ami de moins à duper, à exploiter, à trahir, une victime dont on fait tort à leur avidité?
Est-ce que l’homme qui vit seul paraît dire, en se retirant du commerce des hommes: Je ne veux plus vous donner mon amitié pour votre amitié,—mon esprit pour votre esprit,—mon dévouement pour votre dévouement,—ma bonne foi pour votre bonne foi,—parce que je vois que c’est un marché dans lequel je suis toujours dupe et toujours volé?
Je me suis souvent demandé: Que cherche-t-on dans la société des hommes? Est-ce un échange de services? Vous savez bien que chacun ne fait ces échanges qu’avec l’espoir de gagner et de recevoir plus qu’il ne donne.
Est-ce la conversation? Mais combien de choses vous dit-on qui vous intéressent?—et, si vous avez le bonheur de rencontrer par hasard un mot qui vous soit agréable, par combien de phrases creuses vous faut-il l’acheter!—D’ailleurs, n’avez-vous pas les livres, qui vous parlent quand vous voulez,—qui se taisent quand vous voulez,—qui vous parlent de ce que vous voulez, puisque vous pouvez en quitter un pour en prendre un autre, aussi brusquement que bon vous semble? Il ne vous reste à regretter de la conversation que le bruit de la voix: n’avez-vous pas le souvenir qui vous raconte des histoires et l’imagination qui vous raconte des romans?
Regretterai-je les insipides représentations des théâtres,—quand je vois le ciel et la mer,—et l’herbe et les fleurs, et les insectes;—quand je suis entouré de miracles sans cesse renaissants;—quand mes journées se passent douces et calmes,—sans craintes, sans désirs?
Tenez,—rappelez vos souvenirs,—souvenez-vous des bonheurs réels que vous avez rencontrés:—n’avez-vous pas songé alors à les aller cacher dans la solitude, par un instinct secret qui vous disait que l’homme heureux est un ennemi public et un voleur, et qu’il est prudent d’être heureux tout bas?
J’ai fait avec la société—comme les marchands avec les affaires:—quand ils ont fait fortune, ils se retirent. La fortune que j’ai faite se compose de l’indifférence et du dédain de tout ce qu’on se dispute, de tout ce qui est le but de votre vie, et la cause de tous vos chagrins et de toutes vos joies, de tous vos combats, de toutes vos défaites, de tous vos triomphes.
Je ne veux rien,—je ne désire rien:—combien y a-t-il d’hommes aussi riches que moi?
![]() Pour en revenir aux Guêpes,—mes fidèles lecteurs n’ont pas
besoin de savoir comment je sais les choses, pourvu que je les leur
dise.—Il leur est égal que mes Guêpes traversent la Seine à
Quillebeuf ou sur le pont des Arts,—qu’elles se reposent dans les
fleurs sans parfum des terrasses parisiennes ou dans les ajoncs dorés
des côtes de Bretagne et de Normandie.—Ma vie et mes goûts leur sont un
garant de plus que je n’ai aucune raison ni aucun intérêt pour ne pas
leur dire vrai dans les conversations que j’ai avec eux chaque mois.
Pour en revenir aux Guêpes,—mes fidèles lecteurs n’ont pas
besoin de savoir comment je sais les choses, pourvu que je les leur
dise.—Il leur est égal que mes Guêpes traversent la Seine à
Quillebeuf ou sur le pont des Arts,—qu’elles se reposent dans les
fleurs sans parfum des terrasses parisiennes ou dans les ajoncs dorés
des côtes de Bretagne et de Normandie.—Ma vie et mes goûts leur sont un
garant de plus que je n’ai aucune raison ni aucun intérêt pour ne pas
leur dire vrai dans les conversations que j’ai avec eux chaque mois.
Écoutez bien—et vous allez voir si je sais ce qui se passe au milieu de vous.
![]() M. LAUTOUR-MÉZERAY.—Les journaux vous disent tous, les uns après
les autres, que M. Lautour-Mézeray vient d’être nommé sous-préfet à
BELLAC.
M. LAUTOUR-MÉZERAY.—Les journaux vous disent tous, les uns après
les autres, que M. Lautour-Mézeray vient d’être nommé sous-préfet à
BELLAC.
Rendez-moi grâces, habitants de Bellac, je vais vous parler de votre sous-préfet,—je vais vous donner des sujets de conversation pour quinze jours;—je vais vous dire—sa taille, ses habitudes et ses goûts.
Une de mes Guêpes (Grimalkin) arrive de Paris, de la rue Pigale, nº 19 bis,—c’est là que demeure encore votre sous-préfet au moment où je vous écris,—dans un joli appartement au rez-de-chaussée, donnant sur un jardin, qui est à lui, et qu’il cultive de ses mains,—comme faisait Abdalonyme quand Alexandre le Grand le choisit pour roi.
M. Lautour-Mézeray,—il y a une dizaine d’années, a créé le Journal des enfants. Cette entreprise, qui a eu entre ses mains un immense succès,—l’a fait passer pour un digne successeur de Berquin. M. Lautour, qui a aujourd’hui trente-six ou trente-huit ans, était alors fort jeune. Les pères de province lui écrivaient pour lui demander des avis particuliers pour l’éducation de leurs garçons;—les mères venaient le consulter pour leurs filles.
Pendant ce temps, il prenait sa place à l’Opéra, dans la loge dite des lions—et il allait dîner au Café de Paris, dans une calèche traînée par deux chevaux bais.—A quelque temps de là, il créa le Journal d’horticulture. Il ne faut pas jouer avec l’horticulture:—M. Mézeray fut mordu; il vendit sa calèche et ses chevaux, et acheta pour une calèche et deux chevaux des rosiers et des tulipes—qu’il se mit à cultiver avec amour.
Il n’abandonna pas pour cela sa place dans la loge des lions, ni ses dîners au Café de Paris;—il n’était jardinier que le matin.—Seulement, comme il avait changé de luxe, et que le luxe aime à se montrer, au lieu d’être porté à l’Opéra par ses chevaux,—qu’au bout du compte on est forcé de laisser à la porte, il y portait une fleur rare à la boutonnière de son habit.
On commença par en rire, puis on l’imita; et c’est aujourd’hui une mode presque générale parmi les jeunes élégants. Seulement, comme il est fâcheux d’être éclipsé par ses imitateurs, M. Lautour s’est vu forcé de mettre des fleurs de plus en plus éclatantes. Mais à peine avait-il imaginé un nouveau bouquet, qu’un plagiaire effronté l’obligeait à en chercher un autre; il affectionnait surtout les passiflores.
M. Lautour-Mézeray est généreux de ses fleurs: plus d’une élégante perdra, à son éloignement de Paris, des parures complètes de camélias naturels, qui, placés dans les cheveux, sur les épaules et sur la robe, faisaient un effet ravissant.
Les dames de Bellac sont appelées à hériter.
M. Lautour-Mézeray a fait des prosélytes. Mordu par le démon de l’horticulture, il a mordu, à son tour: 1º M. Eugène Sue, qui a fait construire une serre dans sa retraite de la rue de la Pépinière, et qui portait, l’hiver dernier, un camélia par-dessus les deux ou trois croix qui décorent sa boutonnière; 2º M. Véry, un riche Parisien, qui a dépensé de grosses sommes à Montmorency.
Je suis fâché,—réellement,—habitants de Bellac, de n’avoir pas plus de mal à vous dire de votre sous-préfet:—cela vous amuserait davantage;—mais voilà tout ce que j’en sais,—et j’ai la douleur de dire encore que c’est un homme d’un grand bon sens.
Je ne puis qu’ajouter, pour vous consoler, que la nature lui ayant refusé le don de l’improvisation, il ne vous ferait pas de longs discours,—quand même son bon sens ne l’en rendrait pas ennemi;—ce qui fait que l’heureuse ville de Bellac se trouve seule sous le parapluie, pendant cette averse de discours, de paroles creuses et harangues saugrenues qui inondent la France, depuis que nous avons pour maîtres les avocats et les rhéteurs.
![]() M. THIERS ET M. BOILAY.—Je sais encore que M. Thiers, qui, avant
et pendant son ministère, avait accaparé presque tous les
journaux,—les perd, en ce moment, peu à peu.—Le désintéressement
n’aime pas attendre;—il vient de subir une défection douloureuse.—M.
Boilay, qu’il avait inventé, passe à l’ennemi avec armes et bagages.
M. Boilay était celui de tous les écrivains de la presse qui convenait
le mieux à M. Thiers;—il allait, tous les matins, causer place
Saint-Georges, et, le soir, il sténographiait, de mémoire, la pensée
exacte du maître. M. Boilay a quitté le Constitutionnel pour le
Messager, où il reçoit mille francs par mois. On parle d’arrhes, que
les uns portent à vingt mille francs, les autres seulement à dix mille.
M. THIERS ET M. BOILAY.—Je sais encore que M. Thiers, qui, avant
et pendant son ministère, avait accaparé presque tous les
journaux,—les perd, en ce moment, peu à peu.—Le désintéressement
n’aime pas attendre;—il vient de subir une défection douloureuse.—M.
Boilay, qu’il avait inventé, passe à l’ennemi avec armes et bagages.
M. Boilay était celui de tous les écrivains de la presse qui convenait
le mieux à M. Thiers;—il allait, tous les matins, causer place
Saint-Georges, et, le soir, il sténographiait, de mémoire, la pensée
exacte du maître. M. Boilay a quitté le Constitutionnel pour le
Messager, où il reçoit mille francs par mois. On parle d’arrhes, que
les uns portent à vingt mille francs, les autres seulement à dix mille.
M. Thiers était obligé de faire un mot sur cette trahison,—on lui en prête deux. Quelques personnes prétendent qu’il a répété le mot de César: «Tu quoque, Brute!» C’est un mot dont on a usé et abusé.—J’aime mieux l’autre.—M. Boilay,—dit l’ex-ministre, «a fait comme font les cuisinières: aussitôt qu’il a su faire la cuisine, il a changé de maître.»
Je sais encore que S. M. Louis-Philippe continue à faire aux cultivateurs de Versailles une concurrence ruineuse pour ces derniers. Dans le volume du mois de mars 1841, j’avais raconté à M. de Montalivet ce qui se passait. Je lui avais dit les noms des jardiniers de Sa Majesté qui font ce trafic,—et les noms et les adresses des fruitiers et des marchands de comestibles auxquels ils vendent (détails que vous trouverez au susdit volume).
J’ajoutais qu’Abdalonyme avait été jardinier avant d’être roi;—que Dioclétien le fut après avoir été maître du monde;—mais que je ne voyais aucun prince qui eût cumulé les deux professions de roi et de maraîcher et qui les eût exercées simultanément. J’expliquais comment les jardiniers du roi, auxquels les fruits et les légumes de primeur ne coûtent rien, les donnent au commerce à un prix bien inférieur à celui que leur culture coûte aux cultivateurs, et que ceux-ci, par conséquent, ou ne peuvent plus placer leurs produits, ou sont obligés de les donner à perte.
Ma dénonciation eut d’abord d’heureux résultats: la vente ostensible des produits du potager royal cessa tout à coup.
Malheureusement, M. Cuvillier-Fleury,—ou M. Trognon,—ou M. Delatour,—auront trouvé un exemple pour justifier le commerce qu’on faisait faire au roi;—et, en effet,—j’ai moi-même découvert que Charlemagne,—dans un de ses Capitulaires, ordonne de vendre les poulets des basses-cours de ses domaines et les légumes de ses jardins.
Et le potager a continué d’envoyer aux Tuileries vingt fois plus de fruits et de légumes de primeur qu’on ne peut y en consommer;—et les jardiniers sont fondés à croire que, si on ne fait plus vendre, du moins on laisse vendre le surplus;—car, de même qu’avant la défense qui a été faite les jardiniers trouvent chez les fruitiers, crémiers et marchands de comestibles une grande quantité de fruits et de légumes de primeur qu’on leur offre à un prix auquel ils ne peuvent, eux, les donner sans subir une perte énorme,—les marchands ont ordre de dire que tout cela leur vient de la Belgique; mais les cultivateurs demandent par où cela leur arrive.—Les diligences de Bruxelles n’ont pu le leur dire.
![]() Je sais aussi,—Parisiens,—qu’il se fait au milieu de vous une
belle et noble chose sans que vous en sachiez rien.
Je sais aussi,—Parisiens,—qu’il se fait au milieu de vous une
belle et noble chose sans que vous en sachiez rien.
La Salpétrière est un hospice où on reçoit les vieilles femmes et les folles.
Il faudrait deux millions aux directeurs pour faire seulement les améliorations nécessaires.—C’est un établissement grand comme une ville et qui fait vivre six mille personnes,—et où sont les deux plus grandes misères de la vie humaine: la vieillesse et la folie.
Ces pauvres créatures,—secourues par une chanté impuissante,—sont mal vêtues,—mal couchées;—la maison n’est pas assez riche.
Les folles incurables ont depuis peu pour médecin M. Trélat:—c’est un homme doux et persévérant, prenant en pitié ces malheureuses et cherchant ce qu’il pourrait donner de distractions à leurs maux,—puisqu’il ne peut les guérir.—Il a imaginé de les faire chanter;—elles y ont pris goût, et s’en sont bien trouvées; aujourd’hui elles apprennent à lire.
Cette pensée, conçue par la bonté du médecin, est exécutée par deux hommes qui accomplissent gratuitement une tâche d’une difficulté qu’on se représente facilement,—et s’astreignent au spectacle le plus attristant.
Ces pauvres folles aiment leurs professeurs et leurs leçons;—elles accourent en classe dès qu’elles les voient entrer;—celles qui n’y sont pas admises encore—n’ont d’autre ambition que d’y entrer.
Quelques-unes déjà lisent couramment et déchiffrent un peu la musique.
La musique est montrée par le collaborateur de M. Wilhem.
La lecture, par un instituteur, M. Teste,—le frère du ministre.
C’est un homme de soixante ans,—qui gagne sa vie par son travail,—n’a jamais rien voulu accepter de son frère,—et, n’ayant rien à donner,—trouve moyen encore d’être généreux en donnant son temps et son travail.
D’autre part, on les fait travailler à l’aiguille, ainsi que les aveugles et les sourdes-muettes. L’ouvrage que font ces malheureuses est fait parfaitement,—plus promptement que par les ouvrières de la ville; mais il manque des acheteurs.
Voilà les annonces que j’aime à faire et que je ferai tant qu’on voudra.
![]() LA POLICE ET LES COCHERS. La police—continue à justifier les
reproches que je lui ai faits déjà bien des fois.
LA POLICE ET LES COCHERS. La police—continue à justifier les
reproches que je lui ai faits déjà bien des fois.
Elle rend une ordonnance sur un abus—et tout est fait.
Mais—Voltaire l’a dit: «Un abus est toujours le patrimoine d’une partie de la nation.»
L’abus ne dit rien,—laisse passer l’ordonnance comme une pluie de printemps,—et reparaît huit jours après;—pour l’ordonnance, il n’en est plus question.
Il y a six mois environ, on a enjoint à tout coche de place de présenter à chaque personne qui monterait dans sa voiture une carte contenant le numéro sous lequel cette voiture est inscrite à la police.
D’abord quelques-uns se soumirent à cette formalité, puis ensuite ils se contentèrent de laisser dans un coin de leur voiture un paquet de ces cartes. Maintenant on s’épargne même ce dernier soin. Disons encore à M. Gabriel Delessert que ses devoirs consistent non-seulement à prendre des mesures utiles dans l’intérêt des habitants de Paris, mais encore à en surveiller l’exécution.
![]() DEUX NOUVEAUX PARTIS. Les nouveaux cigares de Manille de la régie
ne valent pas grand’chose;—ils n’ont d’autre intérêt que les deux
partis qu’ils ont fait naître en France.—Absolument comme à Lilliput
pour les œufs,—il y a les gros boutiens et les petits boutiens.
DEUX NOUVEAUX PARTIS. Les nouveaux cigares de Manille de la régie
ne valent pas grand’chose;—ils n’ont d’autre intérêt que les deux
partis qu’ils ont fait naître en France.—Absolument comme à Lilliput
pour les œufs,—il y a les gros boutiens et les petits boutiens.
La régie a fait publier dans les journaux qu’on devait fumer les cigares de Manille par le gros bout.
Le Français, fier et indépendant, s’est révolté contre cette atteinte à sa liberté.—Beaucoup s’obstinent, pour vexer le pouvoir, à fumer les cigares de Manille par le petit bout. Il serait dangereux, dans certains estaminets, de faire autrement;—on passerait pour un courtisan et pour un agent de police.
Je connaissais depuis longtemps les cigares de Manille, qui sont bons,—forts et capiteux.—L. Corbière, mon ami, m’en faisait fumer depuis bien des années, quand je passais par le Havre.—C’est la régie qui a raison. On doit les fumer par le gros bout.—Je le dis hautement, quand je devrais me faire appeler encore ami du château.
Mais ceux de la régie ne valent rien;—et, si on me demande: «Êtes-vous gros boutien ou petit boutien; fumez-vous les cigares de Manille par le gros bout?»—je suis obligé de répondre, comme à l’égard des autres partis politiques: «Je ne les fume par aucun bout.»
![]() SAGACITÉ D’UN CARRÉ DE PAPIER. A propos—d’un article sur la
presse, où je demande qu’on supprime le timbre et le cautionnement,
et qu’on laisse tout journal dire,—sans exception,—tout ce qu’il
veut,—sans jamais lui faire un procès sous aucun prétexte,—un journal
de province qui s’appelle le Patriote de Saône-et-Loire,—tire la
conséquence que «je demande la censure.»
SAGACITÉ D’UN CARRÉ DE PAPIER. A propos—d’un article sur la
presse, où je demande qu’on supprime le timbre et le cautionnement,
et qu’on laisse tout journal dire,—sans exception,—tout ce qu’il
veut,—sans jamais lui faire un procès sous aucun prétexte,—un journal
de province qui s’appelle le Patriote de Saône-et-Loire,—tire la
conséquence que «je demande la censure.»
![]() Sixième observation.—REPRISE.
Sixième observation.—REPRISE.
«Je n’ai pas encore dit une parole devant vous sans être reprise.»—Comédie de CATHERINE II.
Septième observation.—SON.
«Quand nous résistons à une passion, c’est plus par sa faiblesse que par notre force.»—LA ROCHEFOUCAULD.
Huitième observation.—NIVEAU.
«Oui, Philippe-Égalité, songe bien que, si tu avais l’audace de t’élever au-dessus du reste des Français, songe que la faux de l’égalité est là pour rétablir le niveau.»—FAYE, Discours à la Convention.
Félicitons notre auteur de ne s’être pas servi du mot niveau pour faire une phrase aussi sauvage que celle de l’orateur de la Convention:—rien ne l’en empêchait; cela même eût eu une sorte de succès;—et il ne l’a pas fait,—il a employé le mot niveau dans son acception la plus innocente.
Vous voyez bien que je sais encore à peu près ce qui se passe,—pour un homme qui a, ce matin, pêché à la mer des morues et des limandes.
Comme l’autre jour j’allais à Paris,—il me revint à l’esprit tout ce qui se dit et s’écrit sous prétexte de l’égalité, et je me suis mis à regarder autour de moi pour vérifier certains soupçons sur ce que c’est que cette égalité et sur le besoin qu’en ont tous les hommes.
Nous étions cinq dans le milieu de la voiture, et je remarquai avec quel soin et quelle hauteur réclamèrent leurs droits ceux qui, étant venus les premiers, avaient retenu les quatre coins, et voyageaient ainsi mieux appuyés et d’une manière moins fatigante; et, entre ces quatre privilégiés, il y avait cette remarque à faire que les deux qui avaient les deux premières places ne les auraient pas laissé prendre pour les deux autres qui étaient traînés en arrière.
Je ne vis là de partisan de l’égalité que moi, qui me trouvais avoir la plus mauvaise place;—ceux qui allaient en arrière l’auraient de bonne grâce acceptée aussi, mais avec ceux qui tenaient les deux meilleurs coins et nullement avec moi;—pour moi, j’aurais volontiers consenti à avoir une place égale à une des leurs; mais j’aurais refusé une des places de la rotonde où étaient encaqués huit voyageurs,—qui auraient bien aimé, sans doute, à être aussi bien placés que moi.
Vers minuit nous descendîmes à Rouen,—où on prit un bouillon;—nous remarquâmes à l’unanimité que les voyageurs du coupé s’étaient mis à table assez loin de nous avec une sorte de dédain;—nous trouvâmes cet air parfaitement ridicule,—laissant aux voyageurs de la rotonde le soin de remarquer que nous avions vis-à-vis d’eux précisément le même air qu’avaient vis-à-vis de nous les gens du coupé.
On remonta en voiture,—et chacun s’arrangea pour dormir.—Comme nous arrivions à Magny,—le conducteur ouvrit la portière pour introduire un nouveau compagnon de voyage:—c’était une femme;—alors nous nous empressâmes d’arracher les foulards dont nous avions couvert nos têtes pour la nuit,—de passer la main dans nos cheveux,—de resserrer nos cravates;—en un mot,—chacun de nous sembla ne rien négliger pour rehausser ses avantages naturels et éclipser ses compagnons aux yeux de la nouvelle arrivée.
Notre compagne était jolie,—elle aurait pu s’en dispenser; car en voyage c’est déjà être assez jolie que d’être femme;—elle semblait fort réservée,—elle répondit poliment à quelques questions permises, mais assez froidement pour qu’on cessât de lui parler.—Les hommes alors causèrent entre eux,—non pour causer, mais pour être entendus d’elle,—chacun s’efforçant d’obliger son interlocuteur à lui servir de compère,—ou de confident de tragédie classique,—pour faire une plus éclatante exhibition de lui-même,
L’un tira une fort belle montre d’or.
Un autre dit:
—Je suis arrivé trop tard au bureau,—et je n’ai pu avoir de place de coupé.
—Monsieur, dit un troisième,—M. ***, député,—me disait dernièrement...
—Savez-vous,—répliqua le premier,—si Dumas est de retour?—Il doit être furieux contre moi:—il y a un siècle que je ne suis allé le voir.
—Parlez-moi d’une route comme celle-ci.—L’année dernière je voyageais en poste,—en Suisse:—il n’y avait pas moyen de faire plus de deux lieues à l’heure,—malgré les pourboires.
—J’espère trouver mon cabriolet au bureau.—Mon domestique est prévenu de mon retour.
Etc., etc., etc.
Pour moi, je m’aperçus, en examinant bien, que le silence majestueux dans lequel je m’enveloppais n’était qu’une autre manière de jouer le même rôle que mes compagnons,—et que j’espérais tout bas—que la voyageuse—remarquerait combien de sottises je m’abstenais de dire.
Au relais de Poissy, plusieurs mendiants entourèrent la voiture.
—Mon bon monsieur, disait l’un, je suis estropié d’une main.
—Moi des deux,—disait un autre.
—Et moi,—je suis épileptique, disait un troisième.
—Il n’est pas si épileptique que moi,—reprenait le premier.
La voiture partit au galop, et je me dis: «Ceux-ci ne veulent même pas de l’égalité d’infirmités.»
Je vous dirai tout à l’heure à quoi je pensai pendant le reste du voyage.
J’ai eu autrefois un domestique noir,—qui se plaignait sans cesse de ne pouvoir tout faire à la maison,—petite maison cependant.—Un jour, impatienté de ses jérémiades,—je crus devoir lui dire avec le ton le plus épigrammatique:
—Eh bien, prends un domestique.
Deux jours après il me dit:
—Monsieur, j’ai trouvé mon affaire.
—Et quelle affaire?—demandai-je,—car j’avais oublié mon sarcasme.
—Eh! le domestique que monsieur m’a dit de louer.
J’étais pris; je voulus faire les choses de bonne grâce.—D’ailleurs, si le drôle m’avait joué un tour, je pensais le déconcerter en n’ayant pas l’air de m’en apercevoir.
Je répondis que c’était bien,—et le jour même le domestique d’Apollon Varaï entra en fonctions.—Au bout de huit jours nous y étions parfaitement habitués l’un et l’autre;—et quand je disais: «Varaï, envoie ton domestique porter cette lettre,» ce n’était plus une plaisanterie ni pour lui, ni pour moi.—Quant à lui, du reste, il avait le sérieux imperturbable d’un singe, auquel il ressemblait sous beaucoup de rapports. Une chose m’intéressait singulièrement dans leurs relations,—c’est la rigueur extrême avec laquelle le noir traitait son domestique.—J’étais souvent obligé d’intercéder pour le pauvre blanc,—et Varaï me disait:
—Monsieur, si vous l’écoutez, il ne fera rien, il est très-paresseux.
Varaï, cependant, s’était débarrassé sur lui de toutes les corvées. C’était le blanc qui cirait et mes bottes et celles du noir quelquefois.—Je disais à Varaï:
—Ton domestique a mal ciré mes bottes.—On a été trop longtemps dehors.
Et Varaï descendait faire un bruit affreux.
Un jour,—je sonnai Varaï,—et je lui dis:
—Donne cette lettre à porter à ton domestique.
—Monsieur,—me répondit Varaï,—je la porterai moi-même.
—Et pourquoi cela? demandai-je.
—Monsieur,—c’est que je l’ai chassé ce matin.
—Ah! diable!—Et en as-tu un autre?
—Non, monsieur, celui-là m’a trop ennuyé; j’aime mieux n’en plus avoir.
![]() RÉSUMÉ.—On demande l’égalité,—comme on promet aux femmes de se
contenter d’une tendresse platonique.
RÉSUMÉ.—On demande l’égalité,—comme on promet aux femmes de se
contenter d’une tendresse platonique.
Si nous voulons arriver sur un échelon où sont ceux avec lesquels nous réclamons l’égalité, ce n’est pas pour y être à côté d’eux, mais pour les pousser et pour les rejeter à l’échelon inférieur que nous occupions.
L’égalité ne peut pas plus exister dans les positions et dans les fortunes qu’elle n’existe dans les forces du corps et dans les forces de l’esprit.
J’avertis donc mes contemporains qu’il est parfaitement bête de se faire tuer pour l’égalité, et parfaitement féroce de tuer les autres sous le même prétexte,—attendu que l’égalité n’existe pas et ne peut exister,—et que, si elle existait, vous n’en voudriez à aucun prix.
Je leur dirai encore qu’il est dangereux de donner des noms honnêtes aux passions honteuses,—ou de les leur laisser donner par des gens qui comptent les exploiter:—l’avidité et l’envie ne pourraient paraître sous leur nom véritable;—le nom d’égalité les met parfaitement à l’aise.
C’est ainsi que ce qu’on appelait autrefois faire danser l’anse du panier—s’appelle aujourd’hui mettre à la caisse d’épargne. Le vol se cachait, la prévoyance se montre avec orgueil.
![]() SUR LES MENDIANTS.—Voici les réflexions qui m’occupèrent de Poissy
à Paris.—Je ne veux pas vous parler des mendiants politiques et
littéraires:—grâce à la lâcheté des hommes en place,—il n’y a plus de
mendiants que sur le patron de celui de Gil Blas,—c’est-à-dire
appuyant leur humble requête d’une escopette chargée et amorcée. La
plupart des positions secondaires et beaucoup des autres ont été
accordées à des menaces et à des attaques conditionnelles dans les
journaux.—J’ai eu occasion d’en citer bien des exemples, depuis deux
ans que paraît mon volume mensuel.
SUR LES MENDIANTS.—Voici les réflexions qui m’occupèrent de Poissy
à Paris.—Je ne veux pas vous parler des mendiants politiques et
littéraires:—grâce à la lâcheté des hommes en place,—il n’y a plus de
mendiants que sur le patron de celui de Gil Blas,—c’est-à-dire
appuyant leur humble requête d’une escopette chargée et amorcée. La
plupart des positions secondaires et beaucoup des autres ont été
accordées à des menaces et à des attaques conditionnelles dans les
journaux.—J’ai eu occasion d’en citer bien des exemples, depuis deux
ans que paraît mon volume mensuel.
Je veux parler des mendiants des rues.
On a défendu la mendicité à Paris.
On a eu raison,—il n’y a que deux sortes de mendiants:
1º Ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus travailler, la société doit y pourvoir:—ce n’est pas seulement une justice, c’est une économie.—Un vieillard ou un infirme qui vit en communauté coûte quinze sous par jour;—l’aveugle isolé donne vingt sous par jour à la femme qui le conduit,—il faut donc que sa journée lui rapporte au moins quarante sous.—Qui les donne? Vous et moi.
2º Celui qui ne veut pas travailler,—qui existe d’une perpétuelle souscription nationale,—semblable à celles que l’on fait de temps à autre pour élever des tombeaux de marbre aux grands hommes,—ou réputés tels, que l’on a laissés mourir de faim.
Au milieu de cette agitation continuelle, de ce mouvement de fourmilière, que chacun se donne pour gagner sa vie,—vie de luttes, d’incertitudes, d’anxiétés.—lui seul ne fait rien,—reste tranquille au coin de sa borne, au soleil;—tous ces gens qui remuent,—qui se hâtent,—sont ses esclaves et ses tributaires,—ils travaillent pour lui et lui payent une dîme.
Ceux-là sont une lèpre,—et la prison où on les contraint au travail est une léproserie où on met la lèpre sans le lépreux.
Mais.....—diable de mot qui vient presque toujours après l’éloge,—comme l’insulteur après le triomphe des généraux romains;—mais,—pourquoi des priviléges,—pourquoi, tandis que la police correctionnelle envoie tous les jours vingt mendiants pris sur le fait à la maison de refuge de Saint-Denis,—pourquoi certains mendiants exploitent-ils seuls,—avec privilége et sans concurrence,—la charité et le dégoût publics?
Pourquoi un tronc d’homme,—traîné sur une charrette par un cheval,—jouant de l’orgue et promenant sur la foule de gros yeux effrontés, se promène-t-il publiquement dans Paris, et mendiant depuis plus de dix ans? Pourquoi était-il encore, il y a quelques jours, dans la rue Vivienne?
Pourquoi un petit homme, déguisé en paysan breton, avec un chapeau semblable à celui des charbonniers et une large ceinture rouge,—aborde-t-il, depuis quinze ans, les passants dans la rue,—sous prétexte de leur demander la lecture d’une adresse ou d’un papier,—et en réalité pour demander l’aumône?
Pourquoi, depuis sept ou huit ans,—une femme, couverte d’un vieux châle brun, accoste-t-elle les gens le soir, entre onze heures et minuit, sur le boulevard,—non loin du passage des Variétés,—en disant:
—Monsieur, quelque chose pour mon pauvre petit enfant, auquel je ne puis plus donner le sein faute de nourriture.
Une première fois,—cette requête me toucha,—je lui donnai quelques secours.—Trois ans après, me trouvant au même endroit, à la même heure,—je la rencontrai encore;—elle avait son même châle brun,—et me dit:
—Monsieur, quelque chose pour mon pauvre petit enfant, auquel je ne puis plus donner le sein faute de nourriture.
—Comment! dis-je dans un accès de naïf étonnement,—il tette encore?
Elle me quitta en murmurant.
A propos de pauvres plus intéressants,
A propos des ouvriers et de leur misère, le Journal des Débats a trouvé un remède:—c’est qu’ils mettent à la caisse d’épargne.
Cet aperçu rappelle le mot vrai ou faux qu’on rapporte de Marie-Antoinette: «S’il n’y a pas de pain, on mangera de la brioche.»
L’autorité a du reste fréquemment des aperçus aussi heureux.
A l’époque du choléra,—le préfet de police fit afficher UN AVIS au peuple; dans cet avis il conseillait au peuple—d’éviter la mauvaise nourriture et de boire du vin de Bordeaux.
Les journaux populaires et amis du peuple ne sont pas plus heureux:—ils ne trouvent de remède à la faim que dans la réforme électorale, et un peu aussi dans l’émeute.—Ce dernier procédé est encore le plus puissant:—les pauvres diables qui s’y font tuer n’ont plus besoin de rien,—et ceux qu’on met en prison sont nourris aux frais de l’État.
On s’étonne souvent de voir les gens qui exploitent le peuple—le prendre juste aux mêmes appeaux par lesquels ses pères ont été attrapés:—c’est que l’expérience d’autrui ne sert pas du tout, et que l’expérience personnelle ne sert guère:—un aveugle qui a perdu son bâton fait une chute,—cela ne l’empêche pas d’en faire une seconde au premier trou qu’il rencontre.
D’ailleurs, qu’est-ce que l’expérience?
Le vieillard n’a pas plus d’expérience pour la vieillesse que n’en a pour la jeunesse l’homme qui entre dans la vie;—le vieillard n’a d’expérience que celle qui ne peut plus lui servir;—la plus grande sagesse à laquelle l’homme puisse arriver ne peut s’appliquer qu’à un temps qui ne lui appartient plus.
On s’occupe, du reste, d’une réorganisation des ouvriers par l’institution de prud’hommes.—C’est une mesure qu’il faut louer.
![]() ARBOR SANCTA.—Comme le mois dernier—je vous parlais—de vos
croyances—à cette époque d’incrédulité,—je vous rappelais le chou
colossal.—Savez-vous ce qu’a produit ce souvenir?—une grande défiance
des annonces des journaux? Nullement: l’idée à un monsieur de renouveler
la plaisanterie.
ARBOR SANCTA.—Comme le mois dernier—je vous parlais—de vos
croyances—à cette époque d’incrédulité,—je vous rappelais le chou
colossal.—Savez-vous ce qu’a produit ce souvenir?—une grande défiance
des annonces des journaux? Nullement: l’idée à un monsieur de renouveler
la plaisanterie.
Il y a deux ou trois ans,—on vit, à la quatrième page de tous les journaux de toutes les couleurs, un éloge pompeux d’un nouveau chou.—Je vous ai souvent fait remarquer la touchante unanimité des organes de l’opinion publique quand il s’agit de choses se payant un franc la ligne.
Ce chou était le vrai chou:—les choux qu’on avait vus jusque-là n’étaient que des ébauches, des embryons de choux,—le chou colossale de la Nouvelle-Zélande—servait à la fois à la nourriture des hommes et des bestiaux, et donnait un ombrage agréable pendant l’été;—c’était un peu moins grand qu’un chêne,—mais un peu plus grand qu’un prunier.—On vendait chaque graine un franc.
On en achetait de tous les coins de la France.—Je me permis quelques plaisanteries à ce sujet.—«Ah! le voilà encore,—dit-on,—il ne veut croire à rien.»
Je croyais, au contraire, beaucoup à la crédulité d’une partie de mes contemporains, et à l’effronterie de l’autre partie.
Au bout de quelques mois,—les graines du chou colossal de la Nouvelle-Zélande avaient produit deux ou trois variétés de choux connues et dédaignées depuis longtemps;—la justice s’en mêla,—je ne sais trop pourquoi,—car c’est ainsi à peu près que travaille le commerce.—Le vendeur voulut soutenir que ses graines étaient réellement les graines du chou colossal de la Nouvelle-Zélande,—mais que le terrain de ce pays ne leur convenait pas,—ou qu’on les avait changées en nourrice.
Toujours est-il qu’à peine avais-je rappelé cette mystification,—on vit paraître dans les journaux,—quatrième page,—une gravure représentant un chêne—et une note ainsi conçue:
«Les pépiniéristes,—les horticulteurs et tous les amateurs des jardins—trouveront à Paris, rue Laffitte, 40,—une collection de graines de l’ORGUEIL DE LA CHINE, arbre importé par un planteur de la Louisiane en France, où il va devenir avant peu l’ornement de tous les jardins.
«Cet arbre se reproduit de graines,—et on le sème d’octobre à novembre.»
C’était moins bien fait que le chou colossal:—on n’aime pas semer des arbres qui ont besoin d’une dizaine d’années pour croître;—une seule chose me parut intelligente,—c’est le soin d’annoncer que ce chou se semait d’octobre à novembre,—pour brusquer le débit.
Je ne sais si on a acheté beaucoup de ses graines,—mais il paraît qu’il en reste encore,—car voici le mois d’octobre fini,—et conséquemment l’époque des semis passée,—selon la note,—et je vois encore l’annonce à la quatrième page des journaux; seulement on supprime cette particularité que l’arbre se sème d’octobre à novembre,—et on donne deux noms à l’arbre: Orgueil de la Chine,—Arbor sancta.
On ne sait pas encore ce qui lèvera de cette graine,—peut-être des choux;—toujours est-il que j’estime que, comme l’autre, c’est encore de la graine de niais,—ce qui n’a peut-être pas empêché d’en acheter beaucoup.
Pendant que je suis sur l’horticulture—remarquons cette note dans plusieurs journaux à propos de l’exposition de l’orangerie du Louvre:
«Nous avons remarqué de jolies plantes, telles que le strelitzia reginæ,—le tillandria pyramidalis,—le bursaria spinosa, qui répand une odeur fétide.
![]() LE JURY.—Il est arrivé du jury précisément ce que je vous avais
annoncé:—le National avait trois procès.
LE JURY.—Il est arrivé du jury précisément ce que je vous avais
annoncé:—le National avait trois procès.
Pour le premier, il a été acquitté:—le jury s’appelait juges citoyens, justice du pays,—et il donnait une leçon au pouvoir.
Deuxième procès.—Huit jours après, le National est condamné:—le jugement s’appelle une méprise et une de ces erreurs funestes qui n’accusent rien, si ce n’est l’insuffisance et la faiblesse de la raison humaine.
Troisième procès.—Huit jours après, le National est acquitté:—le jury redevient juges citoyens et justice du pays.—Le jugement est de nouveau une leçon donnée au pouvoir.
![]() LA TOUSSAINT.—A propos du prétexte que donnait la Toussaint
d’économiser un numéro sur les abonnés,—les journaux, même les plus
irréligieux, n’ont pas paru—par scrupule;—ils ont continué, comme de
coutume, à user de l’hypocrite formule que j’ai déjà fait remarquer:
LA TOUSSAINT.—A propos du prétexte que donnait la Toussaint
d’économiser un numéro sur les abonnés,—les journaux, même les plus
irréligieux, n’ont pas paru—par scrupule;—ils ont continué, comme de
coutume, à user de l’hypocrite formule que j’ai déjà fait remarquer:
«Demain, jour de la Toussaint, les ateliers étant fermés, le journal ne paraîtra pas.»
En vain je leur ai dit que c’est un gros mensonge et qu’il serait plus juste de dire:—Demain, le journal ne paraissant pas, les ateliers seront fermés.»—Il n’y a que la Quotidienne qui ait adopté une formule franche: «Les bureaux de la Quotidienne étant fermés, le journal ne paraîtra pas.»
Neuvième observation.—IL.
Notre auteur ne s’est pas servi du mot il à la légère; il savait le parti qu’en avaient tiré nos meilleurs écrivains, qui s’en sont tous servis;—son il vaut n’importe quel il, quel qu’en soit l’auteur;—je le préfère même à un il de Voltaire qui se trouve enclavé dans une phrase peu euphonique.
«Il ne faut pas être timide, de peur de commettre des fautes.»—VAUVENARGUES.
«Le premier venu peut représenter une muraille: il n’a qu’à se couvrir d’un enduit de plâtre.»—SHAKSPEARE.
«Pour l’amour, il divise les femmes en deux classes: les belles et les laides.»—Madame DUBARRY.
Il y a dans des femmes qui ne sont ni si belles ni si agréables que d’autres un charme invincible qui captive les hommes et étonne et indigne les autres femmes, qui ne peuvent s’en rendre compte, parce que ce charme ne s’exerce que sur les hommes. C’est que telle femme est bien plus femme que telle autre. De même qu’entre deux bouteilles de vin du même volume il y en a une qui contient bien plus d’arôme et d’essence de vin que l’autre, de même il y a dans telle femme bien plus de femme que dans une autre.
Janin a fait sur madame Sand un vers latin:
«Fœmina fronte patet, vir pectore, carmine musa.»
«Femme par la beauté, homme par le cœur, muse par le talent.»
Je dis homme par le cœur, contrairement au sentiment de ***, qui prétend que vir pectore veut dire qu’elle n’a pas de gorge.
«Il n’en est pas moins vrai que je vous donne un démenti.»—M. COUSIN à M. Molé en pleine Chambre des pairs.
Non ponebat enim nummos ante salutem.—«Il ne mettait pas l’argent au-dessus de la vie.»
En général, on aime trop l’argent et on en dit trop de mal.—Les hommes en médisent comme d’une maîtresse avec laquelle on est brouillé.
L’argent a son mérite, je ne trouve d’ennuyeux que les moyens de l’avoir.
Nous ne pouvons nous souvenir sans tressaillement de la première fois qu’on ouvrit devant nous une caisse, une vraie caisse en fer, avec de gros clous et une serrure à secret; une de ces caisses qui coûtent si cher, qu’une fois que nous l’aurions payée, nous n’aurions plus rien à mettre dedans. Il y avait dans cette caisse des billets de banque, de l’or et de l’argent de toutes sortes. Nous nous rappelons encore parfaitement les paroles qui retentirent à nos oreilles pendant que le caissier y fourrait la main et agitait l’or et les billets de banque. Par moments, c’était un bruit confus de voix claires et aiguës ou fêlées, et un frottement de papiers; d’autres fois, une seule voix prenait la parole, puis toutes reprenaient ensemble; et, quand la caisse fut fermée, nous entendions encore un sourd murmure. Mais voici ce que nous nous rappelons:
UNE PIÈCE DE DIX SOUS, d’une petite voix flûtée. Un bon petit livre relié en parchemin,—un Horace chez les bouquinistes,—une contre-marque au théâtre de la Gaîté.
PLUSIEURS PIÈCES DE DEUX SOUS, d’une voix de cuivre. Des aumônes aux pauvres aveugles, des petits cierges à faire brûler devant la chapelle de la Vierge à l’église.
UNE PIÈCE DE CINQ FRANCS. Une bouteille de vin d’Aï, une bouteille d’esprit et de gaieté, une bouteille d’insouciance, une bouteille d’illusions.
TROIS PIÈCES DE CINQ FRANCS, à l’unisson. Un beau bouquet pour la femme que l’on aime, des camélias rouges comme ses lèvres;—le bouquet, entre tous ceux qu’on lui a envoyés le matin, sera préféré, soigné, conservé, et le soir, au bal, on le tiendra à la main: les rivaux seront furieux. Et, en sortant, au moment où on cachera de belles épaules sous un manteau de moire grise, on rendra à l’heureux son bouquet, sur lequel il aura vu, pendant le bal, appuyer une bouche charmante; et le baiser, il va le chercher toute la nuit sur les pétales de rubis des camélias.
UN LOUIS D’OR. La discrétion de la femme de chambre de celle que tu aimes, la femme de chambre elle-même, si tu veux, et si elle est jolie;—un dîner avec un camarade que l’on n’a pas vu depuis longtemps, et que l’on rencontre sur le boulevard, marchant dans l’ombre pour que le soleil ne trahisse pas les coutures blanchies d’un habit trop vieux;—les souvenirs de l’enfance au dessert, la jeunesse, les illusions, la gaieté, le souvenir des premières amours.
UN BILLET DE CINQ CENTS FRANCS. Veux-tu ce beau bahut gothique, à figures de bois richement sculptées?
TROIS BILLETS DE MILLE FRANCS, d’une petite voix grêle et chiffonnée. Veux-tu, dis-moi, ce beau cheval aux jarrets d’acier, que tu admirais l’autre jour, et qui donnait tant de noblesse au cavalier qui le montait, sous les fenêtres de la femme que tu aimes?
Veux-tu ce châle de cachemire vert, qu’un autre va donner demain, et qui sera le prix de bien douces faveurs?
BILLETS DE MILLE FRANCS, dont nous ne dirons pas le nombre, attendu que les uns trouveraient que nous n’en mettons pas assez,—les autres que nous en mettons trop. Veux-tu une femme vertueuse, veux-tu des vierges au boisseau, veux-tu des myriades d’épouses invincibles? Ne souris pas avec cet air d’incrédulité: celles qui refuseraient de l’argent accepteront des fleurs, des plaisirs, des sérénades, des fêtes; elles accepteront l’admiration de ton luxe et la beauté qu’il te donnera.
Veux-tu des princesses?
Veux-tu des reines?
Veux-tu des impératrices?
UNE CENTAINE DE BILLETS DE MILLE FRANCS, mis en paquet. Veux-tu des prairies à toi, des arbres à toi, de l’ombre à toi; des oiseaux, de l’air, des étoiles à toi; veux-tu la terre, veux-tu le ciel?
BEAUCOUP MOINS DE BILLETS. Veux-tu des consciences d’hommes incorruptibles; veux-tu, veux-tu de la gloire, des honneurs, des croix; veux-tu être grand homme, veux-tu être homme incorruptible; veux-tu être demi-dieu, dieu, dieu et demi?
Suite de la neuvième observation.—«Il a l’oreille rouge et le teint fleuri.»—MOLIÈRE.
«Il ne mérite aucune indulgence.»—M. DESMORTIERS, procureur du roi. (Note mise de sa main au bas d’une condamnation à la prison de la garde nationale contre votre serviteur.)
«Jean s’en alla comme il était venu.»—LA FONTAINE.
Disons à ce propos que voici en quoi consiste la première éducation des enfants.
1º—On lui apprend une langue entière qu’il oublie à six ans pour en apprendre une autre.—Avec le même soin et le même temps on aurait pu lui en apprendre deux dont il pourrait se souvenir.—Cette première langue, cette langue provisoire, nous l’avons tous parlée.
Nanan,—tonton,—dada,—toutou,—tété,—tuture,—memère,—sesœur,—dodo,—faire dodo,—coco,—tata.
Qu’il faut remplacer par viande,—oncle,—cheval,—chien,—sein,—confiture,—mère,—sœur,—lit,—dormir,—soulier,—tante.
2º—Quand l’enfant, qui a deux mains, veut se servir de la main gauche, on le gronde et on le bat s’il se défend contre l’infirmité qu’on veut lui infliger; cette sottise énorme équivaut à l’amputation d’un membre.
A force de ne se servir que de la main droite, on a arrangé tous les exercices et fabriqué tous les instruments pour cette main: de sorte que la main gauche, dont on ne se sert pas, finit par être réellement plus faible et plus maladroite que l’autre.
Et on rit beaucoup des sauvages qui se mettent des anneaux au nez!
Dixième observation.—FAUT.
L’auteur aurait pu, comme bien d’autres, remplacer il faut par il est nécessaire;—mais on a déjà pu apprécier son énergique concision:—il a craint de mériter le reproche que Brutus faisait à Cicéron, dont il appelait l’éloquence—fractam et elumbem,—cassée et éreintée. Il a pensé à Montaigne, qui dit, en parlant des longues phrases de certains orateurs ou écrivains: «Ce qu’il y a de vie et de moelle est estouffé par ces longueries.»
Et il a mis il faut—qui est, de toutes les façons que possède la langue française, le tour le plus vif et le plus concis pour exprimer son idée.
Cherchons quelques exemples d’un choix d’expression aussi heureux.
«Il faut qu’un seul commande.»—HOMÈRE.
«Aux écus et aux armoiries des gentilshommes, il ne serait pas convenable de voir une poule, une oie, un canard, un veau, une brebis,—ou autre animal bénin et utile à la vie: il faut que les marques et enseignes de la noblesse tiennent de quelque bête féroce et carnassière.»
UN ANCIEN—de Vanitate scientiarum.
Δεἱ πινειν μετριως, «il faut boire avec mesure.»—ANACRÉON.
Parbleu! je profiterai de la circonstance—pour parler un peu d’Anacréon. Beaucoup trop de gens ont été trouvés la nuit au coin des bornes, qui s’en consolaient et n’en avaient nulle honte,—prétendant leur cas un simple ébat anacréontique.
Or, les trois mots que je viens de vous citer sont le titre d’une petite pièce d’Anacréon:—ces trois mots sont déjà assez significatifs;—voyons, cependant, de quelle mesure entendait parler Anacréon.
«Esclave, dit-il, mets dans ma coupe cinq mesures de vin et dix mesures d’eau.»
boisson qui me paraît être assez voisine de l’eau rougie.
J’aimais encore mieux, à vous dire franchement mon avis, les soupers où on se grisait et où on chantait—que les banquets politiques où on ne se grise pas moins et où on traite des intérêts sérieux, où l’on improvise des constitutions et des grands hommes; j’aimais mieux de bonnes grosses figures rouges, réjouies, débraillées, que des figures grimaçant la dignité et faisant de longs discours ennuyeux, empruntés à un journal, qui les reproduira le lendemain.
Hélas!—la pauvre chanson,—cette création des Français,—elle est devenue une ode, et elle en est morte;—toutes ces sociétés chantantes—des enfants du délire, des fils anacréontiques d’Apollon, qui n’étaient que ridicules, qui s’amusaient et qui n’ennuyaient personne, ont été remplacées par les gueuletons, où on parle, où on ne s’amuse pas, où on ennuie les autres, et d’où il sort des phrases boursouflées pour lesquelles nous sommes depuis onze ans en pleine guerre civile.
Le hasard m’a fait apprendre où en est réduit le Caveau, cette espèce d’académie plus buvante et chantante et souvent plus spirituelle que l’autre.
Le Français né malin a créé l’un après l’autre le vaudeville et la guillotine—et les cultive simultanément, pour me servir de l’expression d’un avocat cité par les Guêpes: «C’est en Italie qu’on cultive le poignard, mais en France jamais.»
Observation pleine de justesse.—Rappelez les grands crimes:—vous y verrez employer—le marteau,—le compas,—le couteau,—l’alène;—mais jamais le poignard.
C’est un bienfait que nous devons à la police, qui défend de tuer...... avec un poignard,—sous peine de quinze francs d’amende en sus de la mort.
Pour en revenir à la guillotine, les partisans de la gaieté française—prétendent que le Français l’a inventée, il est vrai, mais pour faire des chansons sur ce sujet nouveau,—le vin, les belles, l’amour, commençant à s’user; ainsi qu’en peuvent faire foi un grand nombre de couplets badins de ce temps-là,—et que ce n’est que par cas fortuit que l’invention a été un peu détournée de son but primitif.
Quoi qu’il en soit,—il y a eu des phrases où la gaieté française a paru éprouver du malaise et a subi des interruptions qui ont fait craindre à quelques joyeux drilles qu’elle ne disparût tout à fait.—Ils ont pensé qu’il convenait de lui créer un temple et un asile où elle pût se retirer dans les moments difficiles.—Ils se sont nommés vestales de ce feu sacré,—et, sous le titre bien connu de membres du Caveau, ils se sont réunis à jour fixe pour l’empêcher de s’éteindre et faire des libations.
Il n’y a pas bien longtemps, j’entrais pour dîner dans un cabaret;—je ne tardai pas à m’impatienter de la lenteur qu’on mettait à me servir. Je m’en plaignis au garçon.
—Voilà dix fois que je vous appelle,—vous avez l’air tout effaré,—vous allez, vous venez.—Que se passe-t-il donc dans cette maison?
—Monsieur, c’est que c’est le dîner du Caveau.
—Comment! le Caveau existe encore?
—Oui, monsieur, et il dîne;—vous ne tarderez pas à entendre ces messieurs.
—Entendre? est-ce que réellement ils chantent?
—Certainement.
—Peut-on voir la salle?
—Oui,—il n’y aura personne avant un quart d’heure.
Je suis le garçon et j’entre dans la salle du banquet.
Il y avait une vingtaine de couverts. Sur la table, en forme de surtout, étaient les vases de porcelaine avec des pyramides de fruits magnifiques,—des temples de carton doré portant des pastilles, etc., etc.—Je me récriai sur la beauté des fruits:—il y avait des oranges monstrueuses, des grenades,—des ananas.
—Je le crois bien, monsieur, que vous les admirez, me dit le garçon; c’est qu’ils sont beaux aussi,—et chacune de ces corbeilles sera comptée soixante-dix francs sur la carte de demain.
—Comment! demain?—Vous me disiez que le banquet était pour aujourd’hui.
—Oui, le banquet du Caveau;—mais il y a une noce demain:—les convives d’aujourd’hui n’y toucheront pas,—c’est seulement pour le coup d’œil;—ces fruits ont été achetés pour la noce de demain,—aujourd’hui c’est un décor.
Je détournai les yeux de ces fruits: semblables aux fruits de carton des dîners de théâtre,—ou plutôt semblables aux fruits de Gomorrhe, qui remplissaient la bouche de cendre,—ceux-ci eussent vidé la poche de trop d’écus et trop enflé la carte.
—Au moins, dis-je,—je vois que ces messieurs ne négligent pas le vin.
—C’est à la forme des bouteilles que monsieur voit cela?
—Oui, certes.
—Ce sont bien des bouteilles à vin de Bordeaux, monsieur a raison,—mais on a mis dedans du piqueton à quinze sous.
—Comment! brigand...
—Il n’y a pas de brigand,—c’est convenu avec eux,—ce sont eux qui le veulent. Ils ne donnent que cent sous par tête, vin compris;—et ils sont contents, pourvu que le festin ait l’air somptueux: aussi voyez ce poisson.
—Il est magnifique.
—On l’a servi hier à une société,—la société en a mangé la moitié:—aujourd’hui on l’a retourné, et on le sert à ces messieurs du Caveau.
—C’est un profil de poisson.
—Comme vous dites.—Mais, j’entends du monde.
![]() Sous la Restauration, les gens qui, aujourd’hui au pouvoir, jouent
le rôle que jouait la Restauration,—jouaient alors précisément le rôle
que joue aujourd’hui l’opposition.
Sous la Restauration, les gens qui, aujourd’hui au pouvoir, jouent
le rôle que jouait la Restauration,—jouaient alors précisément le rôle
que joue aujourd’hui l’opposition.
Aux époques d’élections,—on envoyait des commis voyageurs politiques courir les campagnes—et endoctriner les fermiers.—Trois jeunes gens, entre lesquels était D***, fondateur de la Gazette des Tribunaux, aujourd’hui mort,—allaient en Normandie appuyer l’élection de je ne sais qui;—on les reçut à ravir chez un gros fermier; on les fit chasser le matin;—ces messieurs n’y étaient pas habitués, ils rentrèrent à deux heures pour le dîner, complétement harassés.—On commença alors un de ces dîners normands, qui laissent loin derrière eux les festins décrits par Homère.—Celui-ci dura six heures,—c’est un repas moyen; j’en ai fait de huit heures.—On but, Dieu sait combien: nos trois amis étaient morts de fatigue et d’eau-de-vie.—D***, qui était chargé de porter la parole, avait prononcé un discours suffisamment subversif, et s’était endormi.
Le second, qui devait chanter une chanson patriotique, s’était assoupi pendant le discours de son collègue;—D*** seul veillait, mais il se sentait la tête lourde et du sable dans les yeux. Cependant il s’aperçut que les Normands avaient gardé toutes leurs forces,—et n’étaient gris qu’au point bien juste où on traite, dans les banquets, les affaires de l’État.—Il poussa du coude le chanteur,—mais l’autre ne dormit que de plus belle.—D*** ne savait pas une seule chanson du genre exigé;—cependant, quand vint son tour,—il vit qu’il fallait s’exécuter, et, après s’être recueilli, il chanta:
Ceci, messieurs, est une allusion à l’invasion et au gouvernement qui nous a été imposé par les baïonnettes étrangères.
Oui, messieurs, s’écria D***, Marceau ne disait pas assez:—la France est la première des nations, elle doit avoir le sceptre du monde.
Il y a une vingtaine de couplets.—A chaque couplet, le refrain se répétait en chœur, et on buvait un verre d’eau-de-vie de cidre;—l’enthousiasme allait croissant, comme vous pouvez le supposer. On arrive au dernier.
D*** s’arrêta et dit au maître de la maison: «Faites retirer les domestiques.»
Sur un signe du fermier, les domestiques sortirent;—D*** se leva et regarda derrière les portes s’il n’en était pas resté quelqu’un; assuré sur ce point, il revient à sa place et dit son couplet en baissant la voix:
Ceci, messieurs, est un regret de la mort de l’empereur,—oui, messieurs, la gloire de l’Empire n’est pas encore éteinte, elle n’est qu’éclipsée par une dynastie qui pèse sur le pays.
—L’empereur n’est pas mort,—dit un des fermiers.
—Vive l’empereur!—crièrent les autres.
Onzième observation.—QUE.
Ceci est le second QUE que nous avons déjà reproché à notre auteur;—il est souvent bien difficile d’éviter le que,—nous venons nous-mêmes d’en placer un immédiatement après un autre (QUE que), que l’oreille ne peut... bien! en voici un troisième à présent.
Douzième observation.—LES. (Au numéro prochain.)
![]() POST-SCRIPTUM.—En général, on gourmande beaucoup un auteur qui
parle de lui-même;—il semble, au premier abord, difficile d’accorder ce
blâme avec la curiosité qu’ont les gens de savoir les plus petits et les
plus intimes détails de la vie et les habitudes des hommes qui
s’élèvent... tant soit peu au-dessus de la foule par le hasard ou par le
talent. Ces deux choses cependant proviennent de la même cause. On aime
à trouver dans les hommes auxquels survient la célébrité des coins par
lesquels ils rentrent dans les proportions communes,—des côtés par
lesquels on reprend sur eux l’avantage qu’ils ont pris d’autres côtés.
La curiosité qu’on a pour eux n’est donc nullement bienveillante,—et
elle ne peut être satisfaite par les indications qu’ils donneraient
eux-mêmes;—il vaut mieux que les renseignements soient moins certains,
pourvu qu’ils soient plus fâcheux. Il n’est fable si grotesque sur un
homme en vue qui ne soit accueillie par le public, et avec une confiance
sans bornes.
POST-SCRIPTUM.—En général, on gourmande beaucoup un auteur qui
parle de lui-même;—il semble, au premier abord, difficile d’accorder ce
blâme avec la curiosité qu’ont les gens de savoir les plus petits et les
plus intimes détails de la vie et les habitudes des hommes qui
s’élèvent... tant soit peu au-dessus de la foule par le hasard ou par le
talent. Ces deux choses cependant proviennent de la même cause. On aime
à trouver dans les hommes auxquels survient la célébrité des coins par
lesquels ils rentrent dans les proportions communes,—des côtés par
lesquels on reprend sur eux l’avantage qu’ils ont pris d’autres côtés.
La curiosité qu’on a pour eux n’est donc nullement bienveillante,—et
elle ne peut être satisfaite par les indications qu’ils donneraient
eux-mêmes;—il vaut mieux que les renseignements soient moins certains,
pourvu qu’ils soient plus fâcheux. Il n’est fable si grotesque sur un
homme en vue qui ne soit accueillie par le public, et avec une confiance
sans bornes.
Aussi, dans mes premières observations sur l’œuvre du Courrier Français, ai-je un regret très-vif de ne pouvoir parler que de l’ouvrage, faute de connaître l’auteur: il vous eût été agréable de savoir, par exemple, s’il a le nez trop long ou trop court, s’il a une épaule un peu haute, ou une jambe un peu courte; vous aimeriez que son père fût portier et qu’il eût des dettes.
Je sais bien que, si je vous le disais, vous le croiriez sans scrupule et que vous n’admettriez aucune preuve du contraire, quelque convaincante qu’elle pût paraître; ces renseignements qui ravalent les gens sont suffisamment prouvés par le désir qu’ont ceux à qui on les donne qu’ils soient véritables.
J’aurais voulu, au moins, vous dire quel tic l’auteur a eu en écrivant; car les uns tambourinent sur la table, les autres roulent du tabac dans leurs doigts;—celui-ci siffle entre ses dents;—celui-là se gratte le front. M. Victor Hugo marche en faisant ses vers;—M. A. de Musset fume;—M. Antony Deschamps s’enfonce les poings dans les yeux;—M. Janin parle d’autre chose avec les gens qui sont autour de lui;—M. de Balzac boit des soupières de café;—M. Gautier joue avec ses chats;—M. de Vigny passe ses doigts dans ses cheveux;—M. Paul de Kock renifle du tabac;—pour votre serviteur, il tourmente ses moustaches et les tire jusqu’à se faire mal.
Malheureusement,—je n’ai aucun moyen de vous donner des renseignements de ce genre sur notre auteur,—et je comprends tout ce que mon travail à d’incomplet.—En effet, comme je vous le disais tout à l’heure, on aime à tempérer l’admiration qu’on croit ne pouvoir refuser à un homme par quelque chose d’horrible ou de ridicule qu’on sait de lui, ce qui rétablit l’équilibre; et, tout en nous le montrant supérieur par un côté, nous rend cette supériorité d’un autre côté. Il n’est pas un seul homme, si élevé qu’il soit au-dessus des autres, que nous ne nous croyions supérieur à lui en quelque point.
N’ai-je pas moi-même, tout à l’heure, dans ma première observation sur le fragment que je commente, abusé de mes habitudes sur les côtes de Normandie pour chicaner mon auteur sur une petite erreur au sujet des causes qui agitent ou qui calment la mer, et n’avais-je pas, il faut l’avouer, pour but, beaucoup moins de vous éclairer que de prendre moi-même un avantage sur cet écrivain, et de me venger des éloges que je suis forcé de lui donner, en le rabaissant sur un point où j’ai une supériorité du moins apparente?
Les tombeaux de l’empereur.—M. Marochetti.—M. Visconti.—M. Duret.—M. Lemaire.—M. Pradier.—Un nouveau métier.—L’arbre de la rue Laffitte.—Les annonces.—Les réclames.—Un rhume de cerveau.—Un menu du Constitutionnel.—D’un acte de bienfaisance qui aurait pu être fait.—Les départements vertueux et les départements corrompus.—M. Ledru-Rollin.—Un nouveau noble.—M. Ingres et M. le duc d’Orléans.—Les prévenus.—L’opinion publique.—Suite des commentaires sur l’œuvre du Courrier français.—M. Esquiros.—Le secret de la paresse.
![]() Quand un journaliste parle de la presse en général,—c’est tout
ce qu’il y a de vertueux, d’honnête, de désintéressé, de respectable.
Quand un journaliste parle de la presse en général,—c’est tout
ce qu’il y a de vertueux, d’honnête, de désintéressé, de respectable.
C’est la seule majesté qu’il soit possible de reconnaître.—Les lois doivent plier devant elle;—c’est un crime de se défendre contre ses attaques;—elle a raison sur tout et contre tout.—La presse est infaillible.
Nous pourrions un peu démêler ce faisceau serré et en examiner chaque brin et chaque fascine l’un après l’autre,—mais laissons ce soin à la presse elle-même.
La presse se divise en deux grands partis: 1º ceux qui sont pour le gouvernement, c’est-à-dire qui veulent obtenir d’amitié les places et l’argent;
2º Ceux qui sont contre le gouvernement, c’est-à-dire qui veulent prendre de force l’argent et les places. Chacun de ces deux partis traite l’autre fort mal.
Prenons un journal ministériel: Les journaux de l’opposition sont des anarchistes,—des révolutionnaires,—des fauteurs de troubles et de désordres.
Un journal de l’opposition, parlant des journaux ministériels,—les appelle des journaux corrompus et vendus au pouvoir,—des oppresseurs du peuple;—puis, si d’autre part vous recueillez les jugements portés sur les hommes parvenus de la presse par ceux qui ne sont pas parvenus, si nous admettons en principe que la presse est infaillible, nous sommes fort embarrassés quand elle se trouve ainsi divisée. Chacun des deux partis est de la presse qui est infaillible, il faudrait donc croire et admettre ce qu’ils disent tous les deux l’un de l’autre.
![]() Je ne compte pas vous entretenir du tombeau de
Napoléon;—quatre-vingt-trois projets de tombeau! Il n’y avait, selon
moi, qu’un tombeau,—pour l’empereur,—celui que la destinée lui avait
donné dans une île presque déserte, sous un arbre.
Je ne compte pas vous entretenir du tombeau de
Napoléon;—quatre-vingt-trois projets de tombeau! Il n’y avait, selon
moi, qu’un tombeau,—pour l’empereur,—celui que la destinée lui avait
donné dans une île presque déserte, sous un arbre.
Puis ensuite,—comme la pensée semble comme les vents avoir plusieurs couches à diverses hauteurs; au point de vue de la gloire humaine, de l’orgueil national,—c’est-à-dire au-dessous du point de vue poétique,—il fallait l’enterrer à Saint-Denis, là où il avait fait faire deux portes en bronze pour son tombeau; et enfin, au point de vue de l’admiration contemporaine de ses soldats, il fallait le mettre sous la colonne de la place Vendôme.
Je ne parlerai donc pas des quatre-vingt-trois projets qui tous ont la prétention d’être exécutés aux Invalides; d’ailleurs, qu’est-ce que ces concours où la plupart des artistes les plus distingués d’un pays ne se mêlent pas?—Lemaire est à Pétersbourg.—Pradier en Italie.—Duret bien plus loin, car il est au fond de son atelier, où il boude.—M. Visconti a conçu un projet qui ne manque pas de grandeur.
M. Marochetti en a présenté un qui paraît réunir plusieurs suffrages,—mais qui présente en même temps une petite difficulté qui pourrait bien faire reculer le jury d’examen:—il faudrait commencer par enlever la voûte et le dôme des Invalides.
![]() Au commencement de la saison, on a eu à enregistrer cinq ou six
morts funestes de savants,—d’artistes, etc.,—sans compter les
propriétaires et les pauvres diables, victimes de leur propre maladresse
à la chasse, ou de celles de leurs compagnons;—ceci coïncidant avec la
diminution progressive du gibier,—donne pour résultat qu’il se tue
beaucoup moins de perdreaux que de chasseurs.
Au commencement de la saison, on a eu à enregistrer cinq ou six
morts funestes de savants,—d’artistes, etc.,—sans compter les
propriétaires et les pauvres diables, victimes de leur propre maladresse
à la chasse, ou de celles de leurs compagnons;—ceci coïncidant avec la
diminution progressive du gibier,—donne pour résultat qu’il se tue
beaucoup moins de perdreaux que de chasseurs.
On lit ceci dans un journal—(N. B. C’est un sarcasme):
«Nos escadres de la Méditerranée, qui offusquaient l’Angleterre, ont été dispersées et désunies. Mais le Moniteur s’empressait hier de nous offrir une glorieuse compensation à cette humiliation maritime: il résulte d’un rapport du prince de Joinville, daté de Terre-Neuve, que nous n’avons pas cessé d’occuper un rang des plus brillants sous le rapport de la pêche de la morue et des harengs.»
De même qu’en fait de modes d’habits on voit succéder les gilets trop longs aux gilets trop courts;—de même, en fait de mode de langage, au chauvinisme qui, sous la Restauration, montrait toujours un soldat français triomphant des armées coalisées de l’Europe,—a succédé, aujourd’hui, un autre ridicule qui consiste, de la part des journaux, à montrer toujours la France humiliée et foulée aux pieds. Un journal un peu répandu doit au moins deux fois la semaine raconter qu’un Français a reçu des coups de pieds à Pétersbourg, qu’un autre a été empalé à Constantinople, et un troisième mangé quelque autre part; tant ces honnêtes journaux se complaisent dans une humiliation que le plus souvent ils inventent. Mais ici, on peut voir d’une manière manifeste ce que c’est que la politique de ces pauvres carrés de papier.
Ils seraient fort étonnés si on leur disait: «Mais cette pêche du hareng et de la morue est une des branches de commerce les plus importantes; mais c’est la vie de populations entières; mais il y avait plus de vingt ans qu’on n’avait pas fait une bonne pêche: il y avait plus de vingt ans qu’un nombre prodigieux de familles vivaient dans la misère et dans les privations.
Oui, certes, c’est une belle compensation à une diminution d’appareil militaire, et de fanfaronnades inutiles.
Mais on dit que je fais des paradoxes quand je crie, comme je le fais depuis trois ans, que le premier besoin du peuple, c’est de manger.
![]() Ah! si vous voyiez, comme moi, ces pauvres pêcheurs de la Normandie
et de la Bretagne;—leurs durs travaux,—leurs journées et leurs nuits
de fatigues avec la mort sous les pieds;—si vous voyiez, comme moi,
toutes ces blondes familles de dix enfants, à peine vêtus, à peine
nourris, quand leur père revient sans rapporter de quoi souper,
remerciant Dieu de ce qu’il n’a pas permis qu’il fût englouti dans les
vagues de l’Océan; vous ne trouveriez pas que ce soit une nouvelle si
peu importante, si ridicule même, celle qui vient vous dire que cette
année la pêche du hareng a été favorable, et que tous ces gens-là
mangeront.
Ah! si vous voyiez, comme moi, ces pauvres pêcheurs de la Normandie
et de la Bretagne;—leurs durs travaux,—leurs journées et leurs nuits
de fatigues avec la mort sous les pieds;—si vous voyiez, comme moi,
toutes ces blondes familles de dix enfants, à peine vêtus, à peine
nourris, quand leur père revient sans rapporter de quoi souper,
remerciant Dieu de ce qu’il n’a pas permis qu’il fût englouti dans les
vagues de l’Océan; vous ne trouveriez pas que ce soit une nouvelle si
peu importante, si ridicule même, celle qui vient vous dire que cette
année la pêche du hareng a été favorable, et que tous ces gens-là
mangeront.
![]() Je me rappelle un temps où Henry Monnier n’avait pas de plus grand
plaisir que de chercher les métiers bizarres et inconnus auxquels se
livrent certaines gens. Il a fait ainsi de singulières découvertes. En
voici un qu’il n’a pas trouvé, et que ni lui ni moi n’aurions inventé.
Je me rappelle un temps où Henry Monnier n’avait pas de plus grand
plaisir que de chercher les métiers bizarres et inconnus auxquels se
livrent certaines gens. Il a fait ainsi de singulières découvertes. En
voici un qu’il n’a pas trouvé, et que ni lui ni moi n’aurions inventé.
Les habitants de la campagne ne sont guère exposés, en fait de maladies, qu’à des pleurésies et des fluxions de poitrine,—on leur ordonne des sangsues.—Le village d’Augerville-Bayeul est situé à cinq lieues de Havre,—d’où il tire ses sangsues. Au Havre chaque sangsue coûte sept sous. C’est fort cher. Une brave femme du pays a imaginé de louer des sangsues,—elle en a acheté une vingtaine et elle s’est faite bergère de ce noir troupeau,—elle les soigne et les entretient; quand un malade a besoin de sangsues, elle en loue la quantité demandée à l’heure ou à la saignée;—l’opération faite, on lui rapporte ses sangsues.—Si quelqu’une de ses sangsues meurt ou fait une maladie entraînant incapacité de travail, elle se fait payer la valeur de la morte,—ou convenablement indemniser de la perte qui résulte de l’indisposition de son animal.
![]() Le monsieur qui annonçait dans les journaux—des graines de
l’orgueil de la Chine à vendre,—rue Laffitte, 40,—a profité de l’avis
que je lui ai donné dans le volume du mois dernier.
Le monsieur qui annonçait dans les journaux—des graines de
l’orgueil de la Chine à vendre,—rue Laffitte, 40,—a profité de l’avis
que je lui ai donné dans le volume du mois dernier.
Je faisais remarquer que les annonces publiées pendant le mois d’octobre—portaient que cet arbre—se semait d’octobre à novembre,—et que les annonces insérées dans les journaux—omettaient cette particularité.
Qu’a fait le monsieur,—le planteur de la Louisiane?—Il a continué à publier des annonces à la quatrième page des journaux;—seulement dans ces dernières annonces publiées tout le long du mois de novembre,—l’orgueil de la Chine—(en chinois arbor sancta) ne se sème plus du tout d’octobre à novembre,—il se sème maintenant de la mi-octobre jusqu’à la mi-mars.
Pas avant,—pas après.
Mais que feront ces braves gens qui, sur la foi de la première annonce,—ont acheté et semé de la graine de l’orgueil de la Chine?
Ces gens-là, dites-vous?
Oui.
Eh bien,—ils en achèteront d’autre, qu’ils sèmeront maintenant de la mi-octobre à la mi-mars.
Parbleu! l’ami Mars est venu là fort à propos et s’est montré un véritable ami pour prolonger le délai pendant lequel le planteur de la Louisiane—espère duper le public,—avec l’assistance des carrés de papier de toutes les couleurs et de toutes les opinions,—un franc la ligne.
Sérieusement,—carrés de papier,—croyez-vous jouer là un rôle bien honorable,—que d’être ainsi complices de toutes les friponneries contemporaines,—de tous les charlatanismes,—de vous établir compère de tous les marchands d’orviétans?
![]() Vous répondez: «On sait bien que la quatrième page des journaux
est livrée aux annonces—et que nous ne sommes pas responsables de ce
qu’elles disent.»
Vous répondez: «On sait bien que la quatrième page des journaux
est livrée aux annonces—et que nous ne sommes pas responsables de ce
qu’elles disent.»
On? qui est-ce que ce on?—vous,—moi..., et ce n’est pas ici le lieu de dire que je m’y suis laissé prendre plus d’une fois.
«Et, d’ailleurs, ajoutez-vous en général, la signature des gérants précède les annonces, ce qui explique, clair comme le jour, que nous ne garantissons pas au public la vérité des annonces que nous insérons.» Très bien;—mais alors, gens si vertueux pendant trois pages, pourquoi cette facilité de mœurs à la quatrième page? pourquoi ne pas mettre en gros caractères en haut de votre quatrième page:
«Ceci est un mur public—où on affiche ce qu’on veut,—moyennant la somme de...—Nous ne garantissons pas ce qu’il plaît aux marchands d’y mettre;—ce sont eux qui parlent—et qui crient ainsi leur marchandise—à une distance où leur voix ne parviendrait pas.»
Vous ne l’avez jamais fait, carrés de papier, vous ne le ferez pas; bien plus, quand vous avez pensé qu’on commençait à soupçonner que ce pouvait bien être cela, vous avez imaginé la réclame; la réclame est une annonce mieux déguisée, là le journal ne se contente pas de ne pas dire qu’il ne garantit pas le vérité de ce qu’il publie.
Là, il assume toute la responsabilité de la chose; là, il prend la parole, il se fait crieur public, il annonce lui même les marchandises plus ou moins honteuses, et il donne son opinion à lui, il dit je; par exemple, c’est dix sous de plus.
Il dit: «Nous ne saurions trop recommander la pommade de M. un tel.
«Nous avons vu des effets surprenants de la poudre de madame de Trois-Étoiles.»
Le tout signé du nom de chaque rédacteur ou gérant responsable.
![]() Pendant que nous parlons des annonces,—disons que le Journal des
Débats, ce rigoriste—qui prêche la morale, publie à sa quatrième page
des annonces dont je ne puis pas imprimer ici le contenu,—et une
gravure—représentant une femme qui se livre à des danses prohibées par
la police, et qui, tout en dansant, appuie son pouce sur son nez et fait
tourner sa main sur ce pivot pour narguer un garde municipal qui la
regarde.
Pendant que nous parlons des annonces,—disons que le Journal des
Débats, ce rigoriste—qui prêche la morale, publie à sa quatrième page
des annonces dont je ne puis pas imprimer ici le contenu,—et une
gravure—représentant une femme qui se livre à des danses prohibées par
la police, et qui, tout en dansant, appuie son pouce sur son nez et fait
tourner sa main sur ce pivot pour narguer un garde municipal qui la
regarde.
![]() Il est un mal horrible,—un mal qui, en quelques instants, fait de
l’homme le plus spirituel une buse et un idiot;—je veux parler du rhume
de cerveau. Un rhume de cerveau fait horriblement souffrir, et rend en
même temps parfaitement ridicule.—Un jeune homme est obligé d’attendre
la nuit, dans un jardin, un entretien longtemps désiré et demandé.—Tout
ce qui l’entoure invite à la plus douce et à la plus poétique
rêverie;—la lune monte à travers les arbres,—les clématites exhalent
de suaves odeurs.—Il entend des pas légers et le frôlement d’une
robe,—c’est elle!—son cœur bat si fort, qu’il semble qu’il va
rompre sa poitrine pour s’échapper.—Enfin, il pourra donc lui dire tout
ce qu’elle lui a inspiré depuis qu’il la connaît;—il va lui révéler
tout ce trésor d’amour qu’il a amassé dans son âme,—et les premiers
mots qu’il prononce sont ceux-ci: «Ah! badabe, cobe je vous aibe!»
Il est un mal horrible,—un mal qui, en quelques instants, fait de
l’homme le plus spirituel une buse et un idiot;—je veux parler du rhume
de cerveau. Un rhume de cerveau fait horriblement souffrir, et rend en
même temps parfaitement ridicule.—Un jeune homme est obligé d’attendre
la nuit, dans un jardin, un entretien longtemps désiré et demandé.—Tout
ce qui l’entoure invite à la plus douce et à la plus poétique
rêverie;—la lune monte à travers les arbres,—les clématites exhalent
de suaves odeurs.—Il entend des pas légers et le frôlement d’une
robe,—c’est elle!—son cœur bat si fort, qu’il semble qu’il va
rompre sa poitrine pour s’échapper.—Enfin, il pourra donc lui dire tout
ce qu’elle lui a inspiré depuis qu’il la connaît;—il va lui révéler
tout ce trésor d’amour qu’il a amassé dans son âme,—et les premiers
mots qu’il prononce sont ceux-ci: «Ah! badabe, cobe je vous aibe!»
Le malheureux s’est enrhumé à attendre sous les arbres. Un autre a à prononcer un discours en public,—un toast à porter dans un gueuleton patriotique;—il répète son toast d’avance et s’entend avec effroi dire: «Bessieurs, dous dous sobes réudis dans ude intention purebent patriotique,—ou: «Je debande la bort des tyrans.»
Comment faire? Son discours lui a coûté bien du mal—et ferait tant d’effet!—à coup sûr on le mettrait dans le journal.—Il va trouver un médecin.
—Bossieur, il faut que vous me rendiez un grand service.
—Volontiers, monsieur, si cela dépend de moi.
—J’aibe à le croire, bossieur;—j’ai ud’affreux rhube de cerbeau.
—Ah! ah! un coryza?
—Un rhube de cerbeau!
—Oui,—j’entends bien,—c’est ce que nous appelons un coryza.
Le malade est flatté de voir que la science s’est occupée assez spécialement de son mal pour lui donner un nom inconnu du vulgaire;—il se voit d’avance guéri.
—Bossieur,—c’est que, pour ud’ adiversaire, je suis bembe d’un dîder, et il d’y a pas boyen d’y banquer.
—Cela n’empêche pas de manger,—seulement les aliments vous paraîtront moins savoureux.
—Bossieur, s’il s’agissait seulebent de banger... ça de be ferait rien,—je be boque des alibents,—mais c’est que j’ai un discours à prodoncer,—et vous compredez qu’avec bon rhube de cerbeau,—on d’entendra pas le boindre bot.
—Alors, c’est fort désagréable.
—Qu’est-ce qu’il faut faire, bossieur, pour bon rhube de cerbeau?
—Oui,—bossieur,—on b’avait dit de redifler de l’eau de Cologne.
—Ça n’est pas mauvais.
—Ça n’est pas bauvais, bais j’en d’ai rediflé trois verres et ça de va pas bieux.—On m’avait dit également de be bettre du suif de chandelle autour du dez.
—On en a vu de bons effets.
—Je be suis bis deux chandelles entières sur la figure et ça de va pas bieux.—Qu’est-ce qu’il faut faire, bossieur?
—Il faut essayer d’une fumigation.
—Et ça be guérira-t-il?
—C’est possible.
—Cobent! ça d’est pas sûr!
—Non, monsieur.
—Et vous d’avez pas d’autre boyen?
—Des bains de pieds.
—Ah! et ça be guérira-t-il?
—Peut-être,—d’ailleurs, ça n’est jamais bien long, attendez que ça se passe.
Et le malade s’en va persuadé que les médecins, comme certains parrains de complaisance, se sont contentés de donner un nom au rhume de cerveau,—sans se soucier de ce qu’il deviendrait à l’avenir;
Qu’ils sont très-forts sur la lèpre qu’on n’a plus, et sur la peste qu’on n’a pas;—mais qu’ils ne savent rien sur les rhumes de cerveau et sur les cors aux pieds.
![]() Le Constitutionnel, en parlant d’un repas donné par M. O’Connell,
a fait une énumération qui a lieu d’étonner de la part d’un journal qui
compte au nombre de ses fondateurs des hommes qui passent pour savoir
manger.
Le Constitutionnel, en parlant d’un repas donné par M. O’Connell,
a fait une énumération qui a lieu d’étonner de la part d’un journal qui
compte au nombre de ses fondateurs des hommes qui passent pour savoir
manger.
On lit dans le menu du Constitutionnel: «Cent pommes de pin» (pine apple, que le Constitutionnel traduit par pommes de pin—veut dire ananas. Il y a de quoi rompre la bonne harmonie qui existe, d’après certains journaux, ou qui n’existe pas, d’après certains autres, entre la France et l’Angleterre, en prêtant de semblables nourritures à nos voisins). Le Constitutionnel ajoute: «Trente plats d’orange et autres tourtes.»
Ce mot me rappelle une locution semblable d’un portier que j’ai eu et qu’on appelait M. Gorrain. «Monsieur, disait-il, malgré les crimes des jésuites, il ne faut pas oublier que c’est à eux que nous devons l’importation des abricotiers, des dindons et d’une multitude d’autres fruits à noyau.»
![]() L’autre jour,—dans une maison—où on lisait le journal à haute
voix, le lecteur arriva à cette anecdote:
L’autre jour,—dans une maison—où on lisait le journal à haute
voix, le lecteur arriva à cette anecdote:
«Le roi était attendu hier, vers une heure, au château des Tuileries.—Tout à coup des cris: Au secours! un homme se noie! se font entendre,—dix batelets se détachent de la rive,—on saisit un homme qui allait disparaître,—on le porte au bureau de secours,—puis chez le commissaire de police,—où cet homme déclare que c’est la misère qui l’a poussé à cet acte de désespoir.»
Le lecteur s’arrêta.
—Continuez donc, lui dit la maîtresse de la maison.
—Mais c’est tout; il y a un point.
—Mais non;—il est impossible que le roi n’ait pas fait donner des secours... Tournez la page.
—Je la tourne, et je lis: «Nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs le mou de veau...»
—Assez... Comment, le roi?
—Il ne passait peut-être pas précisément à ce moment-là;—et puis, on peut ne pas lui avoir dit la chose.
—C’est égal, il n’a pas eu de bonheur cette fois-là.
![]() Il est évident que la presse est l’origine de l’horrible désordre
qui mine la société.—Quelques niais demandent à ce sujet des lois
répressives.—Je l’ai dit vingt fois,—c’est, au contraire, le moment de
lui mettre la bride sur le cou.—Laissez la presse libre,—sans
cautionnement,—sans timbre,—sans procès,—dans deux ans la presse sera
morte ou réformée et moralisée.—C’est une gageure que je tiendrais en
mettant ma tête pour enjeu.
Il est évident que la presse est l’origine de l’horrible désordre
qui mine la société.—Quelques niais demandent à ce sujet des lois
répressives.—Je l’ai dit vingt fois,—c’est, au contraire, le moment de
lui mettre la bride sur le cou.—Laissez la presse libre,—sans
cautionnement,—sans timbre,—sans procès,—dans deux ans la presse sera
morte ou réformée et moralisée.—C’est une gageure que je tiendrais en
mettant ma tête pour enjeu.
Toutes ces sociétés secrètes sont comme les mans qu’on trouve dans la terre, où ils rongent les racines; le soleil, le jour et l’air les font mourir.
![]() Si la presse était libre,—les communistes, les égalitaires, qui
sais-je, moi, chacune des trente ou quarante républiques dont se compose
le parti républicain aurait son journal et développerait ses idées.—Vos
lois répressives de la presse donnent à tous les journaux de toutes les
opinions des limites égales dans l’expression de leurs opinions,—qui
rendent leur langage presque identique, de telle sorte qu’ils se
trouvent combattre ensemble,—et dans les mêmes rangs contre vous,—pour
des causes toutes différentes, ou ennemies.
Si la presse était libre,—les communistes, les égalitaires, qui
sais-je, moi, chacune des trente ou quarante républiques dont se compose
le parti républicain aurait son journal et développerait ses idées.—Vos
lois répressives de la presse donnent à tous les journaux de toutes les
opinions des limites égales dans l’expression de leurs opinions,—qui
rendent leur langage presque identique, de telle sorte qu’ils se
trouvent combattre ensemble,—et dans les mêmes rangs contre vous,—pour
des causes toutes différentes, ou ennemies.
Laissez chacun arborer l’étendard qui lui plaît,—et vous verrez cette grande armée de l’opposition que, par vos sottes lois répressives, vous réunissez malgré elle sous un seul et même drapeau d’une couleur bizarre formée du mélange de tant de nuances,—vous la verrez se diviser en petites cohortes, chacune sous son véritable étendard, avec ses couleurs, combattant pour son compte,—et contre ses alliées d’aujourd’hui.
Le procès fait à Me Ledru-Rollin, et qui se termine par la condamnation de cet avocat,—est encore une sottise.—Votre gouvernement représentatif est un mensonge—si un candidat ne peut exprimer sa véritable opinion.—J’admets ici que Me Ledru, ou tout autre avocat, ait une véritable opinion.
Ne comprenez-vous pas, d’ailleurs, que Me Ledru ou tout autre, forcé par vos lois à l’hypocrisie,—réunira les suffrages de toutes les nuances qui avoisinent la sienne,—au lieu d’être réduit à ses véritables sectaires?
![]() Le National a eu un nouveau procès;—cette fois il a été
acquitté.—Il a appelé encore ce jugement une leçon donnée au pouvoir.
Le National a eu un nouveau procès;—cette fois il a été
acquitté.—Il a appelé encore ce jugement une leçon donnée au pouvoir.
M. Ledru-Rollin a été condamné.—On a dit que c’était une erreur du jury.
M. Quesnaut, candidat ministériel, échoue à Cherbourg.—Gloire aux électeurs,—leur bon sens et leur patriotisme sauvent la France.
M. Hébert, autre candidat ministériel, est nommé à Pont-Audemer à une grande majorité.—On crie à la corruption,—à la vénalité,—à l’ignorance.
Ainsi, il y a des départements entiers corrompus et des départements vertueux;—cela vient de l’eau ou de l’air:—on n’en sait rien.
Cela est décidément par trop leste,—et le gouvernement maintient des lois répressives contre les journaux!—Mais laissez-les donc faire,—je vous le répète,—laissez-les deux ans,—laissez-les un an,—et la presse sera morte ou réformée.
![]() Un M. Doyen, âgé de quatre-vingt-six ans, vient de faire entériner
par la cour royale des lettres patentes qui lui confèrent le titre de
baron;—ces lettres ne sont que la confirmation d’un titre qui remonte à
1628.—C’est s’aviser un peu sur le tard, et cela ressemble un peu à ce
que faisaient les seigneurs qui voulaient mourir dans un habit de moine
de quelque ordre religieux,—supposant sans doute qu’ainsi déguisés ils
ne seraient pas reconnus à la porte du paradis et y entreraient plus
sûrement;—pour ce qui est de M. Doyen, le lendemain de l’entérinement
de ses lettres patentes, il était déjà, et pour ce fait, exposé aux
avanies de quelques journaux.
Un M. Doyen, âgé de quatre-vingt-six ans, vient de faire entériner
par la cour royale des lettres patentes qui lui confèrent le titre de
baron;—ces lettres ne sont que la confirmation d’un titre qui remonte à
1628.—C’est s’aviser un peu sur le tard, et cela ressemble un peu à ce
que faisaient les seigneurs qui voulaient mourir dans un habit de moine
de quelque ordre religieux,—supposant sans doute qu’ainsi déguisés ils
ne seraient pas reconnus à la porte du paradis et y entreraient plus
sûrement;—pour ce qui est de M. Doyen, le lendemain de l’entérinement
de ses lettres patentes, il était déjà, et pour ce fait, exposé aux
avanies de quelques journaux.
Au premier abord, on pourrait s’étonner de voir à la même époque tant de manifestations de mépris pour les titres et les honneurs,—et tant d’avidité pour s’en affubler;—c’est que les gens qui crient le plus ont moins de haine pour les dignités que pour ceux qui les possèdent; que ce mépris est tout en paroles et n’est qu’une façon de dire de l’envie.
![]() Quand Jésus-Christ chassa les marchands du temple,—c’était avec
une corde;—on a employé des moyens plus doux pour M. Ollivier, qu’on a
fait évêque.—On assure que c’est sur les instances réitérées du
directeur de l’Opéra, qui voulait se débarrasser d’une dangereuse
concurrence:—Saint-Roch, succursale de l’Académie royale de musique
sous M. Ollivier, est redevenu une église sous M. l’abbé Fayet.
Quand Jésus-Christ chassa les marchands du temple,—c’était avec
une corde;—on a employé des moyens plus doux pour M. Ollivier, qu’on a
fait évêque.—On assure que c’est sur les instances réitérées du
directeur de l’Opéra, qui voulait se débarrasser d’une dangereuse
concurrence:—Saint-Roch, succursale de l’Académie royale de musique
sous M. Ollivier, est redevenu une église sous M. l’abbé Fayet.
![]() M. Ingres, un peu enflé des éloges qu’on lui a récemment donnés
avec une sorte de frénésie,—s’est laissé longtemps supplier par M. le
duc d’Orléans de faire son portrait;—il a fini par céder aux instances
du prince royal, à trois conditions: 1º que M. le duc d’Orléans poserait
chez lui, M. Ingres;—2º qu’il revêtirait tous les jours l’uniforme
adopté et qu’il poserait au moins cent cinquante fois;—3º que le
portrait ne lui serait payé que trois mille francs.—M. le duc d’Orléans
a accepté toutes ces conditions, et même la dernière.
M. Ingres, un peu enflé des éloges qu’on lui a récemment donnés
avec une sorte de frénésie,—s’est laissé longtemps supplier par M. le
duc d’Orléans de faire son portrait;—il a fini par céder aux instances
du prince royal, à trois conditions: 1º que M. le duc d’Orléans poserait
chez lui, M. Ingres;—2º qu’il revêtirait tous les jours l’uniforme
adopté et qu’il poserait au moins cent cinquante fois;—3º que le
portrait ne lui serait payé que trois mille francs.—M. le duc d’Orléans
a accepté toutes ces conditions, et même la dernière.
![]() On doit s’élever avec indignation contre le système appliqué en
France aux prévenus.
On doit s’élever avec indignation contre le système appliqué en
France aux prévenus.
D’après les statistiques des tribunaux, sur cinq accusés il n’y a pas deux condamnations;—donc, un prévenu a trois chances contre deux pour être dans quinze jours:—un homme que la société a injustement arrêté,—emprisonné,—flétri aux yeux de bien des gens,—gêné et peut-être ruiné dans ses affaires,—humilié et désespéré,—un homme pour lequel il n’est pas de réparations trop grandes.
Le prévenu doit être traité avec tous les égards possibles;—s’il est plus tard reconnu coupable,—la loi le punira;—mais, s’il est déclaré innocent,—comment réparerez-vous votre erreur? tâchez donc du moins qu’elle ait les conséquences les moins fâcheuses qu’il vous sera possible.
Personne n’a le droit d’infliger un mauvais traitement à un prévenu,—quelque léger qu’il soit;—un prévenu doit être transporté,—s’il y a lieu,—avec toutes les aises imaginables et aux frais de la société.
Que le prévenu soit homme de la presse ou cordonnier,—c’est tout un;—tant qu’il n’est pas condamné, il est innocent, il a droit à tous les égards qu’on aurait pour un innocent, bien plus: à ceux qu’on aurait pour un innocent injustement accusé.
D’ailleurs, s’il est coupable, son châtiment, sous quelque forme que ce soit, ne doit pas commencer avant que la loi l’ait prononcé.
C’est une chose qu’on ne saurait trop rappeler à messieurs de la justice dans tous les degrés de la hiérarchie,—c’est une honte pour un pays tout entier qu’il n’y ait pas de lois qui puissent préserver un innocent des ignobles traitements qu’on fait subir aux prévenus.
![]() Un matin que j’étais avec M...y,—il lui prit une sainte colère
contre la phraséologie des journaux et contre la crédulité de ceux qui
les lisent. Il nous en tomba un sous la main qui parlait de je ne sais
plus quelle mesure que l’opinion publique flétrissait.
Un matin que j’étais avec M...y,—il lui prit une sainte colère
contre la phraséologie des journaux et contre la crédulité de ceux qui
les lisent. Il nous en tomba un sous la main qui parlait de je ne sais
plus quelle mesure que l’opinion publique flétrissait.
Nous nous demandons d’abord:—Qu’est-ce que l’opinion publique? et qu’est-ce que le carré de papier que voici? Qu’entend-on par ces paroles, «l’opinion publique,» l’opinion publique veut-elle dire l’opinion de tout le monde?
Non, par deux raisons: la première, c’est qu’une mesure ou n’importe quoi qui serait blâmé par tout le monde ne pourrait pas subsister un instant; il faut donc excepter au moins de tout le monde: 1º ceux qui prennent la mesure; 2º ceux qui la soutiennent; 3º ceux qui en profitent.
![]() La seconde raison, est que voici cinq autres carrés de
papier:—trois approuvent la mesure et se disent les organes de
l’opinion publique;—deux autres,—aussi organes qu’eux de l’opinion
publique,—n’en disent pas un mot.
La seconde raison, est que voici cinq autres carrés de
papier:—trois approuvent la mesure et se disent les organes de
l’opinion publique;—deux autres,—aussi organes qu’eux de l’opinion
publique,—n’en disent pas un mot.
![]() Il y a donc plusieurs opinions publiques sur le même sujet?
Il y a donc plusieurs opinions publiques sur le même sujet?
Le résumé de notre discussion—fut qu’il n’y a pas d’opinion publique;—qu’il n’y a pas assez de bonheur dans le monde pour que tous en aient une part;—que celui des uns n’existe qu’au détriment des autres. Que, par cela qu’une mesure nuit à certains intérêts, elle sert merveilleusement à certains autres.
Que l’opinion publique se fait comme les émeutes, comme la foule.
Quand les journaux disent qu’il y a une émeute quelque part, les bourgeois et les ouvriers vont voir l’émeute,—les gendarmes s’y transportent pour la réprimer; ceux-ci prennent les curieux pour l’émeute, et les bousculent, les curieux s’irritent et se défendent,—et l’émeute se constitue.
Les gens qui vont voir une pièce où on leur dit qu’il y a foule—ne s’aperçoivent pas qu’ils forment eux-mêmes cette foule, qu’ils venaient voir autant que la pièce.
Beaucoup de gens s’empressent de se ranger à ce qu’on leur dit être l’opinion publique,—surtout quand elle est contraire au gouvernement; parce que, tout en obéissant à leur instinct de moutons de Panurge, ils ont un certain air d’audace sans danger qui flatte le bourgeois.—Ils seraient bien effrayés parfois s’ils savaient qu’ils sont à la tête de l’opinion dont ils croient suivre la queue,—et qu’ils seraient seuls de leur opinion publique—s’il n’y avait pas d’autres bourgeois pris dans le même piége.
Une chose tourmentait surtout M...y, c’était de savoir où on flétrit les mesures: car,—disait-il,—si chacun des membres de l’opinion publique,—qui doivent être nombreux,—se contente de flétrir ladite mesure chez lui,—comment le journal qui paraît ce matin a-t-il pu rassembler, dans l’espace de quelques heures, toutes ces flétrissures éparses d’une mesure prise hier matin,—pour pouvoir en former un total qui lui permette de présenter le nombre de flétrissures qu’il a réunies comme équivalant à une opinion publique?
Il doit y avoir un endroit où on flétrit les mesures,—comme il y a une halle à la viande,—comme il y a une Bourse;—il doit y avoir un endroit où on flétrit les mesures,—comme il y a un endroit où on en prend,—au bout du pont Louis XV.
Il faisait beau;—nous nous mîmes en route pour une grande promenade.—Aux Tuileries, il y avait beaucoup de monde autour d’un bassin;—M...y s’approcha pour voir si ces gens étaient réunis pour flétrir la mesure.—Ce n’était pas cela; ils n’avaient pas même l’air de savoir qu’il y eût une mesure;—ils donnaient des miettes de pain aux cygnes,—qui livraient leurs ailes entr’ouvertes au vent printanier,—semblables à de petits navires à la voile.
Dans un autre coin du jardin, beaucoup de gens qui, comme tout le monde, ont droit de considérer leur opinion comme partie intégrante de l’opinion publique,—appréciaient, en lisant les journaux, la mesure—qu’ils étaient censés avoir flétrie la veille.
Nous nous approchâmes d’un groupe fort serré,—à l’endroit appelé la Petite-Provence,—mais c’étaient des gens qui se chauffaient au soleil;—personne n’y parlait—de la mesure.
Sur les quais,—quelques Français vendaient des gâteaux de Nanterre, quelques autres en achetaient;—les uns fouettaient leurs chevaux, les autres regardaient couler l’eau.
De l’autre côté du pont, un monsieur lisait un livre mis sur le parapet à l’étalage d’un bouquiniste, et faisait une corne à la page où il restait de sa lecture, qu’il comptait continuer le lendemain.
Personne n’avait l’air de flétrir la mesure.—Ah!—voici bien du monde rassemblé devant l’Institut.—Nous perçons la foule avec peine;—c’étaient deux cochers qui se battaient. Nous demandâmes pourquoi c’était,—parce qu’après tout ce pouvait bien être à cause de la mesure:—l’un des cochers la flétrissant, l’autre ne la flétrissant pas;—mais ce n’était pas cela: l’un avait pris une demi-botte de foin à l’autre;—le volé fut rossé.
Nous prîmes alors la rue Guénégaud en suivant trois hommes qui en entraînaient un autre.
—Qu’a-t-il fait? demanda M...y.
—C’est à cause des mesures, répondit le passant interpellé.
M...y avait un air triomphant:
—Venez, me dit-il, il s’agit cette fois de la mesure.
On fit entrer notre homme au nº 9, sous une porte ronde.
—Le voilà chez David, dit alors l’homme auquel M...y avait adressé sa première question.
—Et que fait-on chez David? demanda M...y.
—C’est la fourrière, répondit l’homme.
—Est-ce là qu’on flétrit les mesures? demanda M...y.
—C’est là qu’on les vérifie.
—Comment?
—Oui, cet homme qu’on emmenait a été surpris par les agents à vendre à faux poids.—On l’amène chez David.—Si David trouve que ses mesures ne sont pas justes,—il met en fourrière les poids, les balances et tout le bataclan.—C’est sans doute ce que vous appelez flétrir les mesures.
Ce n’était pas encore là ce que nous cherchions.—Découragés, nous montâmes en voiture et nous allâmes à Saint-Ouen, comme nous faisions souvent.—Là, grand nombre de Parisiens pêchaient à la ligne.—J’appelai Bourdin, un batelier de mes amis,—qui avait l’obligeance de garder mon canot.
N. B. J’apprends que le gouvernement l’a saisi et confisqué comme n’ayant pas les dimensions qu’il lui plaît d’exiger par une ordonnance qu’il aurait dû rendre avant que je fisse faire mon bateau;—et les journaux disent qu’on désarme et qu’on disloque la flotte,—tandis qu’au contraire on prend des moyens quelque peu extrêmes pour posséder un plus grand nombre de bâtiments.—O mon pays! si mon canot peut servir à ta gloire,—s’il peut surtout augmenter l’effectif de ta flotte,—faire trembler la perfide Albion—et faire taire les journaux,—je te l’offre de grand cœur.
Mais réellement,—pour un ami du château, ainsi que m’intitulent certains carrés de papier,—on me traite assez mal;—le roi me donne douze francs par an—pour son abonnement aux Guêpes,—et on prend mon canot, qui m’a coûté cent écus.
J’appelai donc Bourdin,—Bourdin me mena près de ce pauvre canot, qui était caché dans les saules;—il était fort joli, ma foi,—tout noir avec une bordure orange,—et le plus rapide de ces doux parages;—nous montâmes dedans,—et je laissai dériver jusqu’à Saint-Denis.—Nous étions heureux comme deux poëtes que nous étions. C’était un spectacle ravissant;—la rive était bordée de grands peupliers, droits comme des clochers,—de saules bleuâtres,—de fleurs de toutes sortes, de spirées avec leurs bouquets blancs, de campanules bleues;—sur l’eau il y avait des nénufars jaunes et des anémones aquatiques.—Parfois un martin-pêcheur traversait la rivière droit et rapide comme une flèche en poussant un cri aigu;—à peine si nous avions le temps de voir son plumage vert et bleu.—Nous regardions tout cela,—et nous écoutions les bruits de l’air et de l’eau,—et, à l’heure où le soleil se couchait derrière l’église Saint-Ouen,—nous arrivions à l’île Saint-Denis, dont M. le maire,—M. Perrin,—un autre ami à moi qui joint à ses fonctions municipales celles de restaurateur, et qui cache modestement son écharpe tricolore sous un tablier de cuisine,—nous donnait un dîner excellent et un vin de Bordeaux que M...y, qui s’y connaît, déclarait irréprochable.
...J’oubliais la mesure..., personne ne la flétrissait, personne ne la connaissait.
Je voulais seulement vous dire ce qu’il faut croire de ces phrases stéréotypées dont les journaux sont si prodigues.
![]() SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ŒUVRE DU COURRIER FRANÇAIS.—Il
faut que je termine mes commentaires sur l’œuvre du Courrier
Français.
SUITE DES COMMENTAIRES SUR L’ŒUVRE DU COURRIER FRANÇAIS.—Il
faut que je termine mes commentaires sur l’œuvre du Courrier
Français.
Nous en étions à:
LES.
Douzième observation:—LES.
Les, article pluriel,—
«Je n’est qu’un singulier, vous est un pluriel.»—MOLIÈRE.
«Pluriel, terme de grammaire qui s’emploie pour caractériser un des nombres destinés à marquer la quotité.»
GIRAULT DUVIVIER.
Je trouve la définition un peu moins claire que la chose définie, mais c’est ainsi que procèdent tous les grammairiens;—Vaugelas est le premier qui ait écrit pluriel, avant lui on disait et on écrivait plurier.
On trouvera sans peine des exemples d’articles s’accordant aussi bien avec leurs substantifs,—mais je ne pense pas qu’on en puisse trouver qui s’accordent mieux. Comparez et jugez.
«Le larcin,—l’inceste,—le meurtre des enfants et des pères,—tout a eu sa place entre les actions vertueuses.»
«Il s’agit des cheveux blonds de la pécheresse dont elle essuya les pieds du Christ.
«Je hais le philosophe qui n’est pas sage pour lui-même: Μισω σοφιστην, etc.»—EURIPIDE.
![]() Treizième observation.—FLOTS.
Treizième observation.—FLOTS.
«L’auteur n’a pas répété Océan,—il n’a pas mis vagues ni lames, il a parfaitement distingué les nuances qui existent entre ces mots.—Flots est, des trois synonymes, celui qui engage le moins; les autres ont un sens plus précis. Il a pour autorités plusieurs bons écrivains.
«Quel respect ces flots mugissants ont-ils pour le nom du roi?»—SHAKSPEARE, la Tempête.
M. Alphonse Esquiros est un bon jeune homme,—autrefois poëte rêveur, ne manquant pas d’une sorte de naïveté un peu affectée, mais assez gracieuse;—c’est une de ces natures simples, semblables au fleuve limpide d’Horace:
qui reflète dans son cours tout ce qu’il voit sur ses bords,—les grands peupliers et les petites herbes, le soleil et les étoiles,—la barque qui glisse et l’oiseau qui passe.
La poésie d’Alphonse Esquiros avait des qualités naturelles,—mais elle manquait d’originalité,—elle reflétait trop ses lectures du moment;—je l’ai vu, tour à tour, sans cependant copier servilement, imiter la manière de M. Hugo,—celle de M. de Lamartine et celle de cent autres. Il y a quelques mois, il publia une nouvelle fantastique inspirée de la Larme du diable, de M. Th. Gautier, charmante création inspirée par le Faust de Goëthe.
A cette époque parut je ne sais quel livre de M. de Lamennais,—Esquiros le lut, et fit l’Évangile du peuple;—le parquet se saisit de l’affaire, et on mit Esquiros en prison,—comme M. de Lamennais;—c’était pour Esquiros pousser l’imitation plus loin qu’il ne l’avait cru.
S’il y avait en France un ministre de l’instruction publique,—il aurait connu Esquiros,—il l’aurait fait venir et lui aurait dit: «Vous faites de jolis vers aux arbres et à la lune, ne vous mêlez pas à ces choses; quand vous imitez, n’imitez pas les gens que l’on met en prison.»
C’est ce qu’on ne fit pas, et on prit le crime d’Esquiros au sérieux,—et on le mit à Sainte-Pélagie.
Qu’arriva-t-il de là? qu’il prit à son tour au sérieux le martyre et la persécution; que les journaux, qui n’avaient jamais parlé de lui tant qu’il n’avait eu que son talent, le louèrent beaucoup quand il fut mis en prison,—ce qui prouva pour la millième fois que ce n’est pas du talent, mais de la prison, qu’ils font cas.
Et encore que ce pauvre enfant innocent et doux comme une fille—s’ennuie,—s’attriste, pleure,—réclame le soleil et l’air,—fait de jolis vers là-dessus en retour desquels, comme martyr, persécuté pour le peuple, il reçoit de mauvais lieux communs emphatiques.
![]() Quatorzième observation.—REMONTENT.
Quatorzième observation.—REMONTENT.
Il n’y a ici qu’un petit défaut,—c’est que, pour que sa phrase eût un sens, l’auteur aurait dû dire descendent; cependant le mot est correctement orthographié.
Quinzième observation.—GRADUELLEMENT.
Je n’ai trouvé ce mot employé qu’autour des mirlitons.
Il y a plusieurs façons d’écrire ce mot: est,—haie,—hé,—hait.—Notre auteur ne s’y est pas trompé, et a parfaitement choisi celui de ces mots qui convenait à sa phrase.
![]() Dix-septième observation.—LENTEMENT.
Dix-septième observation.—LENTEMENT.
Ces deux adverbes,—graduellement et lentement,—sont peu agréables à l’oreille;—mais des écrivains fort châtiés n’ont pas cru devoir éviter des consonnances semblables.
«Conséquemment il perd la somme, ou il est incontestablement déchu de son droit.» LA BRUYÈRE.
Certes, commettre une faute avec La Bruyère,—ce n’est plus une faute, c’est une beauté.
Qu’est-ce que les puristes d’ailleurs,—et qu’est-ce que la langue?
L’académie-dictionnaire 1798—ne veut-elle pas qu’on prononce quatre-z-yeux?
PASCAL ne dit-il pas—«elle a couru de grandes risques
Et l’ACADÉMIE,—en faisant remarquer que risque est masculin,—n’excepte-t-elle pas—cette locution: A toute risque?
Et MOLIÈRE, dans le Florentin,—rebarbaratif?
Et VAUGELAS, sens dessus dessous?
Et M. DE PONGERVILLE, de l’Académie,—dans le dialogue familier,—sens sus dessus?
Et BOSSUET: C’est là que règne un pleur éternel?
Je termine ce travail—en constatant que l’œuvre que nous venons d’examiner est un des morceaux les plus remarquables sous les deux rapports de la pensée et du style—qu’ait produits jusqu’ici la littérature politique des carrés de papier se disant organes de l’opinion publique ou boulevard des libertés.
![]() LE SECRET DE LA PARESSE.—Il y a deux ennemis irréconciliables,
acharnés, mortels,—comme le sont les gens forcés de vivre ensemble:—ce
sont le corps et la pensée,—la partie matérielle et la partie
intellectuelle de notre être.
LE SECRET DE LA PARESSE.—Il y a deux ennemis irréconciliables,
acharnés, mortels,—comme le sont les gens forcés de vivre ensemble:—ce
sont le corps et la pensée,—la partie matérielle et la partie
intellectuelle de notre être.
Tout le monde a éprouvé, au moment de se mettre au travail,—une sourde hésitation, suite d’une lutte entre l’esprit qui veut et le corps qui ne veut pas:—tous les poëtes anciens en ont parlé;—quel est l’homme d’ailleurs qui n’a pas entendu mille fois au dedans de lui le dialogue suivant:
LA PENSÉE. Les formes incomplètes et sans contours qui passent devant moi avec des nuances douteuses et changeantes—semblent prendre un corps et une couleur,—le nuage se dissipe, le chaos a cessé de s’agiter, tout se met en ordre; travaillons.
LE CORPS. Il fait un beau soleil,—peut-être le dernier de l’année,—on trouverait, j’en suis sûr, encore une violette en fleur sous les feuilles sèches;—nous devrions aller nous promener dans le jardin.
Cette proposition maladroite, sans précautions oratoires, n’obtient d’ordinaire aucun succès; c’est comme si l’on disait à un homme qui a soif: «Voilà un excellent morceau de pâté.» La pensée ne daigne pas seulement répondre,—elle s’obstine à vouloir travailler et à contraindre le corps à prendre la plume.
Celui-ci, qui est paresseux, comme vous savez,—comprend alors qu’il ne faut pas heurter de front cette fantaisie de travail,—mais qu’il faut, au contraire, y rattacher d’une manière indirecte la distraction qui doit plus tard la détruire.
LE CORPS. Le grand air rafraîchit la tête et fait du bien à l’imagination, et puis, il y a tant de souvenirs pour vous, ma belle, dans ces fleurs que vous m’avez fait planter,—et que vous me faites arroser l’été,—que vous serez d’autant mieux disposée au travail quand vous les aurez revues quelques instants.
LA PENSÉE (à part). Peut-être ce butor a-t-il raison.—Allons au jardin.
Dès lors la pensée est perdue! Une fois au jardin, la malheureuse se divise à l’infini:—elle suit la feuille qui s’envole; ce rosier dépouillé lui rappelle un bouquet qu’elle a donné il y a longtemps;—chaque arbre, chaque plante, est habité par un souvenir comme les hamadryades de la poésie antique.
Tous l’entourent, la caressent, l’occupent, et le travail est oublié.
C’est ce qui arrive chaque fois qu’elle essaye une bataille en plaine avec le corps, qui a pour lui la paresse,—la plus puissante de toutes les passions,—celle qui triomphe de toutes les autres et les anéantit.
La pensée ne l’emporte pas; elle peut s’élever à son insu à une hauteur où il ne puisse plus l’atteindre.—Il faut qu’elle ruse,—qu’elle le trompe, pour le jeter dans une de ces occupations d’habitude, auxquelles il peut se livrer seul sans son concours à elle.
LA PENSÉE. Or ça, mon bon ami, voyons donc si vous saurez bien me tailler cinq ou six plumes?
Tailler des plumes est une chose que la main fait d’elle-même.
Pendant que le corps taille des plumes, la pensée s’échappe furtivement; mais quelquefois le corps saisit le premier prétexte venu pour ne pas tailler de plumes.
LE CORPS. Vous en aurez six toutes neuves, ma mie.—J’aime mieux faire des armes.
LA PENSÉE. Y pensez-vous, mon bon ami? vous exténuer comme hier! j’en suis encore malade,—ou prendre un rhume de cerveau,—et j’en mourrai.—Je ne vous cache pas même que je vous trouve un peu pâle aujourd’hui;—et, puisque vous ne pouvez pas rester en place,—promenez-vous dans la chambre en long et en large.
Si le corps est assez sot pour se laisser prendre à cette fausse sollicitude,—pendant qu’il s’agite machinalement dans cet étroit espace,—la pensée, qui n’a que faire à cela, s’envole et lui échappe.
Il y a, il est vrai, des corps innocents et niais qu’on peut occuper et distraire avec la moindre des choses: ils se laissent prendre à jouer du piano sur leur table;—un poëte de mes amis a un corps qui s’amuse à s’arracher un à un les cils des yeux.
Mais il en est de plus récalcitrants,—ceux-là se défient de toute occupation qui leur est indiquée par la pensée, il faut qu’elle ne compte que sur un hasard extérieur,—sur un de ces bruits monotones qu’on entend sans l’écouter; le vent qui souffle dans les feuilles,—une cloche qui tinte,—la pluie qui bat les vitres,—la mer qui gronde au loin.
Ces bruits le bercent, et il s’endort comme Argus aux sons de la flûte de Mercure;—puis tout à coup il se réveille en sursaut,—et il s’aperçoit que la pensée l’a laissé là,—il la regarde,—il la suit d’un œil hébété,—comme l’enfant entre les mains duquel vient de glisser une fauvette,—il la voit sur la plus haute branche d’un acacia secouer ses plumes au soleil,—il l’entend chanter librement.
Et le pauvre corps, qui s’ennuie alors de n’avoir plus l’esclave intelligente qui lui invente des plaisirs et l’aide à les conquérir, passe par les conditions qu’elle veut lui imposer pour la faire redescendre,—octroie une charte,—et consent à écrire sous sa dictée.
Règlement de comptes.—Un pèlerinage.—M. Aimé Martin.—M. Lebœuf et une trompette.—Un colonel et un triangle.—Jugement d’un jugement.—Le colin-maillard.—Les cantonniers des Tuileries à la place Louis XVI.—Les nouveaux pairs.—M. de Balzac et une petite chose.—La quatrième page des journaux et les brevets du roi.—M. Cherubini.—Le général Bugeaud.—A quoi ressemble la guerre d’Afrique.—Une bonne intention du duc d’Orléans.—La Chambre des députés.—Consolations à une veuve.—Un joli métier.—Aménités d’un carré de papier.—Une besogne sérieuse.—Correspondance.—Un secret d’influence.—Les écoles gratuites de dessin.
![]() A la fin de l’année,—il faut, quand on le peut,—régler ses
comptes.
A la fin de l’année,—il faut, quand on le peut,—régler ses
comptes.
Je trouve deux notes sur mon agenda:
La première contient ces mots: «Pèlerinage annuel à Honfleur;»
La seconde: «Ne pas oublier de faire un peu de chagrin à M. Aimé Martin.»
Le pèlerinage à Honfleur ne me prendra que deux heures avant de retourner à Paris.
Il s’explique par un beau distique que je fis autrefois,—et dont je n’ai gardé que le premier vers, parce que le second renfermait des longueurs:
L’homme le plus ennuyeux que j’aie jamais rencontré est un certain***, aubergiste à Honfleur;—j’ai eu à supporter ses familiarités et sa conversation opiniâtre pendant vingt-quatre heures que j’ai passées chez lui;—mais qu’est-ce que la familiarité avec un homme qui est là et qui s’efforce d’y mettre quelques bornes,—en comparaison de celle qu’il étale à l’égard des absents qui ne peuvent se défendre?
—Goûtez-moi ce vin,—mon cher ami,—me disait-il,—Méry n’en voulait pas d’autre quand il venait ici;—ah! ah!—vous ne voulez pas qu’on détache les huîtres,—c’est absolument comme Eugène Sue;—le connaissez-vous?—c’est un de mes bons amis;—et Hugo—donc!—c’est ici qu’il a fait le Gamin de Paris, son dernier vaudeville;—connaissez-vous Bérat? c’est un charmant sculpteur, vous n’êtes pas sans avoir vu son lion de marbre aux Tuileries?
Et, quand je sortais, il me suivait—et ne me quittait qu’avec peine pour dormir, de telle sorte que mon voyage avait un but qui fut tout à fait manqué.
Depuis ce temps, je vais tous les ans à Honfleur ne pas voir***.
Je m’embarque au Havre,—j’arrive à Honfleur,—je suis tout près de lui,—je me rappelle bien l’ennui qu’il m’a causé dans ses moindres circonstances, et je savoure avec friandise la joie d’en être débarrassé;—il est là,—à vingt pas de moi,—je pourrais le voir et je ne le vois pas,—je pourrais l’entendre et je ne l’entends pas.
Je ressens ce bien-être du convalescent qui vient de se raccrocher aux branches de la vie,—je regarde de loin la maison de *** comme le naufragé regarde la mer, aux fureurs de laquelle il vient d’échapper,—et moi qui ai si peur de l’ennui!—moi qui ne peux le supporter un instant!
Ailleurs,—à Paris,—ne pas voir ***, c’est un plaisir émoussé,—on ne le sent pas plus que la joie de la santé quand on se porte bien;—c’est au château de Chilon,—en sortant de ce souterrain plus bas que le lac qui baigne ses murs,—que j’ai savouré la joie de la liberté;—c’est après avoir vu le roc usé par les pas des prisonniers—que j’ai senti ma poitrine se dilater à la pensée que j’étais libre!
C’est à Honfleur—qu’on peut apprécier tout le plaisir de ne pas voir ***;—c’est dans ces rues, où il a passé peut-être un moment avant vous,—que vous comprendrez ce qu’il y a d’heureux à ne pas le rencontrer;—c’est une sorte d’assaisonnement qui ajoute à tout une saveur inusitée.
Gravissez la côte de Grâce,—jetez les yeux sur la mer,—et, si vous connaissez ***, après vous être dit: «Je vois la mer!»—dites-vous: «Et je ne vois pas ***!—et vous sentirez tout ce que le second plaisir ajoute au premier.
Pour moi, le souvenir de l’ennui que m’a causé cet homme n’a rien perdu de son âcreté:—je hais la couleur de la chambre que j’ai habitée chez lui,—je hais ce que j’y ai mangé;—j’aimais autrefois les éperlans,—maintenant je les trouve ennuyeux,—parce que j’en ai mangé avec lui,—et je n’en mange jamais.
Ç’a été pour moi une consolation dans une infinité de traverses et de tourments.—Oui, disais-je—au milieu des plus grands ennuis;—mais je suis à cinquante lieues de ***.
Pour M. Aimé Martin,—nous en parlerons une autre fois.
M. Lebœuf, député,—recevant l’autre jour la lettre de convocation pour l’ouverture de la Chambre,—dit à son domestique:
—Qu’est-ce qui apporte ça... une trompette?
—Oui, monsieur.
—Faites-la asseoir et rafraîchir.
![]() Un autre de nos honorables est colonel de la garde nationale;—un
monsieur, électeur, lui recommandait, pour obtenir je ne sais quoi, son
fils, qui fait partie de la musique dans la légion que commande le
député;—le pauvre colonel ne connaissait pas plus le fils qu’il ne
connaissait le père,—il savait seulement qu’il était électeur.
Un autre de nos honorables est colonel de la garde nationale;—un
monsieur, électeur, lui recommandait, pour obtenir je ne sais quoi, son
fils, qui fait partie de la musique dans la légion que commande le
député;—le pauvre colonel ne connaissait pas plus le fils qu’il ne
connaissait le père,—il savait seulement qu’il était électeur.
—Et comment se nomme M. votre fils, demanda-t-il (moyen adroit pour savoir en même temps le nom du père).
—Il s’appelle Gobinard.
—Gobinard?
—Oui... Gobinard.
—Ah! oui, Gobinard... j’y suis... Gobinard... très-bien!... Gobinard... je me rappelle parfaitement... Gobinard... Et qu’est-ce qu’il est, M. votre fils,—monsieur Gobinard?
—Il est triangle.
—Ah! oui,—oui,—oui,—Gobinard, parbleu! Gobinard... charmant triangle!... charmant triangle! maintenant je me le rappelle parfaitement,—charmant triangle!
![]() Les pairs ont rendu leur jugement dans l’affaire du coup de
pistolet tiré sur les princes. L’auteur du crime et deux de ses
complices sont condamnés à mort,—les autres à la détention.—M. Dupoty,
rédacteur du Journal du Peuple, a pour sa part cinq ans de prison.—On
a beaucoup parlé, du moins dans les journaux, de cette dernière
condamnation. J’ai à dire aussi mon opinion, que je n’ai exprimée que
très-incomplètement—le mois dernier.
Les pairs ont rendu leur jugement dans l’affaire du coup de
pistolet tiré sur les princes. L’auteur du crime et deux de ses
complices sont condamnés à mort,—les autres à la détention.—M. Dupoty,
rédacteur du Journal du Peuple, a pour sa part cinq ans de prison.—On
a beaucoup parlé, du moins dans les journaux, de cette dernière
condamnation. J’ai à dire aussi mon opinion, que je n’ai exprimée que
très-incomplètement—le mois dernier.
M. Dupoty a été condamné comme complice de l’attentat de Quénisset, qui a tiré un coup de pistolet sur les princes.—Eh bien! dans mon âme et conscience,—devant Dieu et devant les hommes,—comme disent les jurés,—non, M. Dupoty n’est pas complice de l’attentat de Quénisset.
La lettre qui lui a été adressée par Launois, dit Chasseur, un des conjurés, ne prouve absolument rien; il n’est pas un homme dirigeant ou écrivant quelque chose qui s’imprime et paraît périodiquement qui ne reçoive une foule de lettres de ce genre, et, si on faisait chez moi une perquisition, je suis persuadé qu’on y trouverait vingt chiffons de papier plus compromettants que la lettre adressée par Launois à M. Dupoty.
Mais à cette première question, que je résous négativement, j’en ajouterai une seconde:
Oui,—M. Dupoty est coupable d’avoir, par ses écrits, poussé au mépris des lois et du gouvernement établi,—aux conspirations et aux émeutes;—mais précisément autant que le Constitutionnel, le Courrier français,—le Temps, le Siècle, en un mot, que tous les journaux de l’opposition, quelque timide et détournée que soit l’expression de la guerre qu’ils font au gouvernement existant, les uns pour le renverser et prendre sa place,—les autres pour l’obliger à choisir des ministres dans leurs amis.
![]() Et,—pour dire toute ma pensée,—je trouve,—sinon moins
criminels,—du moins beaucoup moins bêtes,—ceux qui jettent dans le
pays des ferments de discorde avec l’intention de le bouleverser, ceux
qui jettent des torches dans la maison pour la brûler, que ceux qui
agitent tout le pays pour amener un petit revirement entre M. Dufaure et
M. Passy,—que ceux qui mettent le feu à la maison pour y allumer leur
cigare.
Et,—pour dire toute ma pensée,—je trouve,—sinon moins
criminels,—du moins beaucoup moins bêtes,—ceux qui jettent dans le
pays des ferments de discorde avec l’intention de le bouleverser, ceux
qui jettent des torches dans la maison pour la brûler, que ceux qui
agitent tout le pays pour amener un petit revirement entre M. Dufaure et
M. Passy,—que ceux qui mettent le feu à la maison pour y allumer leur
cigare.
M. Dupoty a été pris comme l’on est pris au colin-maillard ou au pied de bœuf.
![]() Si l’on veut admettre ce système, il faudra remonter bien haut, et
je ne sais vraiment où on trouvera une complète innocence.
Si l’on veut admettre ce système, il faudra remonter bien haut, et
je ne sais vraiment où on trouvera une complète innocence.
Moi-même, quand j’ai reproché à M. de Strada de laisser le roi sortir avec des chevaux dont quelques-uns ne valent pas cinquante francs; quand j’ai, à plusieurs reprises, signalé à M. de Montalivet l’abus qu’on faisait du potager royal,—ces atteintes légères ont fait admettre plus facilement des attaques plus fortes, faites par d’autres journaux, et que l’on eût trouvées de trop haut goût sans cette transition.—Le Constitutionnel conduit tout doucement les esprits au Courrier Français, le Courrier Français (quand mademoiselle Fitz-James n’est pas rengagée) les reçoit, leur fait faire un pas et les livre au Siècle, le Siècle les mène au Temps, le Temps au National, le National au Journal du Peuple, le Journal du Peuple au Populaire, le Populaire au Moniteur républicain, le Moniteur républicain aux discours de cabaret.—Chaque journal, échelonné comme les cantonniers sur les grandes routes, pave et ferre de ses phrases sa part d’un chemin qui conduit de la royauté à l’émeute et à la révolution,—DES TUILERIES A LA PLACE LOUIS XVI.
Il n’y a pas de loi sur la presse qu’on ne puisse éluder.—Chaque loi répressive est le barreau d’une cage; et, quelque serrés que soient les barreaux d’une cage, il y a toujours entre eux un espace, et la pensée, plus mince et plus ténue que la vapeur, passe facilement entre deux.
Vous ne tiendrez pas la presse avec des lois.—Il n’y a que l’arbitraire qui ait quelques chances d’en venir à bout, et encore l’arbitraire ne peut que remplacer les barreaux de la cage par les murs de la prison. Si la pensée est ténue comme la vapeur, la compression la rend terrible comme elle, et elle risque fort de faire éclater vos murs.
D’ailleurs, il ne faut pas que les gens, au pouvoir aujourd’hui, oublient leur origine. Quand on veut opposer une digue à un torrent, il faut la construire sur un terrain sec, que n’aient pas encore envahi les eaux: et vous, vous êtes le premier flot du torrent, c’est lui qui vous a poussés, qui vous a portés où vous êtes,—et qui est arrivé en même temps que vous. Vous ne pouvez l’arrêter. Peut-être, si vous l’aviez laissé passer, se fût-il divisé en une multitude de petits filets d’eau et de ruisseaux murmurants. Mais, par vos lois absurdes, vous avez forcé fleuves et ruisseaux de couler ensemble et d’accroître sans cesse, la force invincible de leurs flots.
Le réquisitoire de M. Hébert est composé précisément des mêmes arguments que les considérations qui précèdent les ordonnances de juillet 1830.
![]() Il faut que je vous le dise encore une fois,—il fallait laisser
la presse libre—sans cautionnement—sans timbre—sans procès,—vous
auriez cinq cents journaux, dont chacun aurait de cent à cent cinquante
abonnés.—Je crois l’avoir suffisamment prouvé dans le numéro d’octobre.
Il faut que je vous le dise encore une fois,—il fallait laisser
la presse libre—sans cautionnement—sans timbre—sans procès,—vous
auriez cinq cents journaux, dont chacun aurait de cent à cent cinquante
abonnés.—Je crois l’avoir suffisamment prouvé dans le numéro d’octobre.
Il fallait d’autre part, inventer pour la littérature ce qu’on a inventé pour l’armée;—il fallait, c’est-à-dire, le bâton de maréchal dans la giberne du soldat,—c’est-à-dire un espoir fondé d’arriver par le talent, et par le talent seul, aux hautes positions du pays.
Vous avez précisément—fait le contraire;—un écrivain, quel que soit son génie, n’existe pas à vos yeux s’il n’écrit pas dans les journaux,—et s’il n’écrit pas contre vous.
Vous n’avez rien que pour deux classes d’écrivains,—et ces deux classes sont renfermées dans une seule: les journalistes.—A ceux qui vous harcèlent et vous menacent, vous jetez les gros morceaux,—puis aux pauvres diables qui se rangent tristement, et faute de mieux, sous votre bannière, vous donnez à ronger les os que laissent vos adversaires repus.
![]() Depuis longtemps on méditait la nomination d’une vingtaine de
nouveaux pairs.
Depuis longtemps on méditait la nomination d’une vingtaine de
nouveaux pairs.
On avait murmuré les noms de MM. Hugo,—Casimir Delavigne,—Horace Vernet.
Les nominations ont paru,—il n’y a rien pour les arts ni pour la littérature. Pourquoi? c’était montrer aux jeunes écrivains une voie autre que celle du journalisme,—c’était séparer la presse de la littérature,—c’était abaisser la première de toute l’estime que vous montriez pour la seconde.
Mais non: vous aimez mieux dire, par vos actes, que les écrivains n’auront rien que par la violence et par le désordre.
Vous refusez de leur donner dans la société un intérêt qui les porte à combattre pour elle;—vous voulez qu’ils défendent la place et vous les tenez hors des murailles.
![]() On lit dans le dernier ouvrage de M. de Balzac:
On lit dans le dernier ouvrage de M. de Balzac:
«Il a demandé pour son gendre le grade d’officier de la Légion d’honneur; fais-moi le plaisir d’aller voir le mamamouchi quelconque que cette nomination regarde, et de veiller à cette petite chose.»
Pourquoi M. de Balzac n’a-t-il pas la croix depuis longtemps? Il ne l’appellerait pas une petite chose;—un homme du talent de M. de Balzac fabrique des pensées pour bien des gens; il ne fallait que lui rendre justice, et vous ne le verriez pas, pour sa part, discréditer un de vos moyens d’action et de gouvernement. Vous n’en avez cependant pas trop, et ceux que vous avez ne sont pas si peu usés qu’ils n’aient besoin de quelques ménagements.
![]() Vous ne lutterez contre la presse qu’avec la presse.
Vous ne lutterez contre la presse qu’avec la presse.
Vous n’avez dans la presse que des ennemis et des domestiques.
Vous n’y avez ni alliés ni amis.
![]() J’ai souvent querellé les journaux sur leur quatrième page; il
serait injuste de ne pas signaler une industrie identique qu’exerce le
gouvernement: je veux parler des brevets.
J’ai souvent querellé les journaux sur leur quatrième page; il
serait injuste de ne pas signaler une industrie identique qu’exerce le
gouvernement: je veux parler des brevets.
Il n’y a pas d’invention saugrenue,—de préparation honteuse,—qui se fasse faute d’un brevet du roi.
Le public prend ledit brevet pour une approbation spéciale de Sa Majesté, et tombe dans le panneau.—On ne sait pas assez qu’un brevet du roi n’est qu’un reçu de huit ou quinze cents francs, selon la durée que l’exploitant veut donner à son affaire;—qu’on ne demande à quiconque sollicite un brevet d’autre condition que de verser la somme ci-dessus mentionnée.
Ceci n’est qu’un guet-apens dont le gouvernement est aussi complice qu’on peut l’être; il ne peut ignorer la fausse idée qu’ont les gens d’un brevet,—et il la laisse s’accréditer:—il n’a jamais dit, par l’organe de ses journaux ni autrement, ce que c’était réellement qu’un brevet.—C’est pourquoi je le dis aujourd’hui.
J’ai déterré un bouquin que je destine en présent à mon ami le docteur Alph... L.—Ce bouquin a été imprimé avec brevet et privilége du roi, donné le quatrième jour de novembre 1668, signé par le roi et son conseil.
Il a pour titre:
Remèdes souverains et secrets expérimentés, de M. le chevalier Digby.—Paris, chez Guillaume Cavelier, au quatrième pilier de la grande salle du Palais.—MDCLXXXIV. Avec brevet et privilége du roi.
Je transcris littéralement une des recettes que j’y ai trouvées préconisées, toujours avec privilége du roi.
Remède infaillible pour arrêter le sang d’une plaie ou un saignement de nez,—éprouvé par la comtesse d’Ormont.
«Prenez deux parts de mousse qui vient sur les têtes des morts, et que ce soit une tête humaine;—tirez-la en la séparant et la rendez plus menue que pourrez avec les doigts;—mêlez-la avec une part de mastic en poudre,—puis, réduisez tout en onguent avec de la gomme tragogante trempée en eau de plaintain et eau de rose,—ensuite l’étendez sur du cuir de la longueur du pouce et non si large, et le mettrez sur la veine du front descendant sur le nez.»
On ne se figure pas comme le chevalier Digby, auteur de ce livre, et M. le docteur Jean Molbec de Tresfel, médecin auquel le privilége est accordé,—usaient, dans divers cas, de la tête de mort, apprêtée de façons variées.—Dans un article fort curieux où ils parlent légèrement de la thériaque, panacée longtemps en faveur, ils donnent la véritable recette de l’orviétan.
L’orviétan se compose de cinquante et une drogues différentes, entre lesquelles on trouve:
«De l’os du cœur de cerf pilé, un dragme.
»De fenouil, une demi-once.
»Un cœur de lièvre séché au four.
»Gentiane, une once.
»Crâne humain, une demi-once, etc.»
Ce que je trouve le plus curieux, c’est qu’après le remède indiqué contre le saignement de nez que je viens de rapporter—les auteurs en donnent un autre également bon, et que je considère comme beaucoup plus simple.
«Prenez de l’herbe nommée bursapastoris,—flairez dessus et la tenez dans la main. Il suffira de la porter sur soi en la poche.»
S’il suffit de la porter en la poche, pourquoi alors se donnerait-on la peine de la flairer?—et, à plus forte raison, pourquoi irait-on s’amuser à gratter des têtes de morts?—Je vous livre les deux recettes comme je les trouve,—avec brevet et privilége du roi;—elles sont également bonnes,—vous pouvez choisir,—je ne vous donne pas de conseil;—mais, si j’étais que vous, je préférerais la seconde.
![]() M. Lebœuf était à dîner dans une maison;—il voit un vieillard à
l’air refrogné, à côté du maître de la maison.—Il demande à son voisin
de droite:
M. Lebœuf était à dîner dans une maison;—il voit un vieillard à
l’air refrogné, à côté du maître de la maison.—Il demande à son voisin
de droite:
—Qui est ce monsieur?
—Cherubini,—répond le voisin en mangeant et la bouche pleine.
M. Lebœuf entend: C’est Rubini.
Après dîner, il s’approche de M. Cherubini, l’homme le plus féroce de France, et lui dit gentiment:
—Il faut avouer, monsieur, que vous ne paraissiez pas votre âge à la scène.—Est-ce que vous n’allez pas nous chanter quelque chose tout à l’heure?
M. Cherubini lui lance un regard froid et mortel comme une pointe d’acier,—lui tourne le dos, et s’en va au maître de la maison, auquel il dit presque haut, en lui montrant M. Lebœuf:
—Quel est, etc.
Mais je ne puis répéter ce que dit en cette circonstance M. Cherubini.
![]() Quand M. Bugeaud a été envoyé en Afrique, les Guêpes seules, au
milieu de l’indignation des journaux, ont osé prédire les succès qu’il y
obtiendrait. Dernièrement, M. Bugeaud avait, dit-on, demandé un congé
pour assister au commencement de la session.—On l’a cru en disgrâce, et
les journaux, qui avaient tant blâmé son départ, ont alors commencé à
crier contre son retour.—Il n’y avait pas assez d’éloges pour M.
Bugeaud, brouillé avec le château:—il allait passer à l’état de héros
invincible.—Quand on a su qu’il ne revenait pas, et qu’il n’était
nullement en disgrâce,—l’enthousiasme s’est refroidi aussi subitement
qu’il s’était allumé.
Quand M. Bugeaud a été envoyé en Afrique, les Guêpes seules, au
milieu de l’indignation des journaux, ont osé prédire les succès qu’il y
obtiendrait. Dernièrement, M. Bugeaud avait, dit-on, demandé un congé
pour assister au commencement de la session.—On l’a cru en disgrâce, et
les journaux, qui avaient tant blâmé son départ, ont alors commencé à
crier contre son retour.—Il n’y avait pas assez d’éloges pour M.
Bugeaud, brouillé avec le château:—il allait passer à l’état de héros
invincible.—Quand on a su qu’il ne revenait pas, et qu’il n’était
nullement en disgrâce,—l’enthousiasme s’est refroidi aussi subitement
qu’il s’était allumé.
Puisque nous parlons des affaires d’Alger, disons un mot de ce gouffre d’hommes et d’argent:—la Chambre des députés aime mieux faire à perpétuité à la terre d’Afrique une rente de six mille cadavres français—que d’accorder une fois le nombre d’hommes suffisant pour en finir.
La situation des Français en Afrique est précisément celle d’un joueur qui a deux dames quand son adversaire n’en a qu’une;—celui qui a deux dames a évidemment l’avantage,—mais il ne pourra, faute d’un pion, prendre la dame que son adversaire promène sur la grande ligne du damier;—il aura toujours l’avantage, mais il ne gagnera jamais la partie.
Le caractère et le goût des peuples changent avec l’âge.—La France a aimé longtemps la gloire militaire,—aujourd’hui elle aime l’argent, et elle veut de l’économie; la gloire est chère, on n’en a pas au rabais; il n’y a pas moyen d’allier ces deux passions.
![]() Dans le golfe de Lyon, deux braves marins, Layec et Hervé, du
navire la Marianne,—ont péri en sauvant l’équipage de la Picardie.
Dans le golfe de Lyon, deux braves marins, Layec et Hervé, du
navire la Marianne,—ont péri en sauvant l’équipage de la Picardie.
M. le duc d’Orléans a fait remettre à M. Achille Vigier, député du Morbihan, une somme de deux cents francs destinée aux veuves de ces deux héros.
Deux cents francs!—C’est de quoi retarder la mendicité de quelques mois pour les veuves de deux hommes qui sont morts de la mort la plus belle et la plus héroïque.
Il faut savoir gré à M. le duc d’Orléans de sa pensée, et le plaindre de n’avoir pas près de lui des personnes qui puissent en diriger l’application.
Mais,—voyez-vous,—jamais les hommes n’accorderont autant d’admiration et de respect à l’homme qui sauve son semblable qu’à celui qui le tue.
Le vieux proverbe «qui aime bien châtie bien» doit être retourné, et n’a été imaginé que pour donner un air vertueux de reconnaissance à l’affection naturelle qu’ont les hommes pour ceux qui leur font du mal;—il faut dire «aime bien qui est bien châtié.»
On n’aime que les gens et les choses dont on souffre,—il n’y a d’amour réel que l’amour malheureux,—il n’y a de patrie que pour les exilés.
Entre deux amants,—s’il y en a un—(et il en est toujours ainsi, ajoutons: presque, pour ne pas trop faire crier) qui accable l’autre de douleurs et de tortures, c’est celui-là qui est aimé et adoré;—l’autre, pour prix du dévouement et du sacrifice de toute la vie, consent tout au plus à se laisser aimer.
![]() Voici la session ouverte,—le besoin s’en faisait sentir pour les
journaux;—le procès de la Chambre des pairs était terminé,—ils ne
savaient plus comment remplir leurs colonnes;—quelques centenaires
commençaient à poindre;—un veau à deux têtes était né dans le
département de l’Ardèche;—j’attendais à chaque instant le grand
serpent de mer qui, depuis treize ans qu’un petit journal l’a inventé,
ne manque jamais de faire une apparition chaque année dans les journaux,
dans l’intervalle d’une session à l’autre. Quelques feuilles
commençaient à se livrer à de bizarres excès: un journal auquel il
manque cinq lignes est capable de tout; il n’y a ni parents ni amis qui
soient à l’abri de ses attaques: il fera cinq lignes contre lui-même
s’il le faut.
Voici la session ouverte,—le besoin s’en faisait sentir pour les
journaux;—le procès de la Chambre des pairs était terminé,—ils ne
savaient plus comment remplir leurs colonnes;—quelques centenaires
commençaient à poindre;—un veau à deux têtes était né dans le
département de l’Ardèche;—j’attendais à chaque instant le grand
serpent de mer qui, depuis treize ans qu’un petit journal l’a inventé,
ne manque jamais de faire une apparition chaque année dans les journaux,
dans l’intervalle d’une session à l’autre. Quelques feuilles
commençaient à se livrer à de bizarres excès: un journal auquel il
manque cinq lignes est capable de tout; il n’y a ni parents ni amis qui
soient à l’abri de ses attaques: il fera cinq lignes contre lui-même
s’il le faut.
Un de ces carrés de papier s’est mis à raconter que le neveu de Colombier,—l’un des condamnés dans l’affaire Quénisset—apprenant qu’il allait être condamné comme complice de l’attentat du 13 septembre,—s’était noyé de désespoir;—les autres feuilles se sont emparées des cinq lignes que cela produisait.
Le lendemain,—le jeune homme s’est présenté au premier carré de papier, et a demandé une rectification;—on l’a ressuscité le troisième jour avec d’autant plus d’empressement, que cela faisait cinq autres lignes.
![]() Cette session qui s’ouvre est la dernière de la législature
actuelle.—Espérons que les membres qui la composent vont en finir avec
les niaiseries qui sont, depuis l’invention du gouvernement dit
représentatif,—décorées du nom de politique,—qu’on s’occupera pour la
dernière fois de l’amoindrissement du pouvoir de M. Passy et de M.
Dufaure, de la réforme électorale, etc., etc., et de toutes ces choses
qui produisent tant de phrases et ne produisent que cela.
Cette session qui s’ouvre est la dernière de la législature
actuelle.—Espérons que les membres qui la composent vont en finir avec
les niaiseries qui sont, depuis l’invention du gouvernement dit
représentatif,—décorées du nom de politique,—qu’on s’occupera pour la
dernière fois de l’amoindrissement du pouvoir de M. Passy et de M.
Dufaure, de la réforme électorale, etc., etc., et de toutes ces choses
qui produisent tant de phrases et ne produisent que cela.
Espérons que les départements se lasseront de vivre sous le despotisme des estaminets de Paris,—les seules localités qui aient un intérêt sérieux aux discussions oiseuses qui remplissent les sessions;—qu’ils cesseront d’envoyer à la Chambre des prétendus représentants qui ne s’occupent que de tripotages de ministères,—et, sous prétexte d’intérêts généraux, ne tiennent aucun compte des intérêts particuliers, qui sont néanmoins nécessaires pour former un intérêt général quel qu’il soit.—Ceci est aussi absurde que si on contestait cette formule à la Cuisinière bourgeoise: «Pour faire du café à la crème, ayez de la crème et du café.»
Espérons que chaque département comprendra qu’il est temps de donner à ses représentants des mandats circonstanciés, c’est-à-dire de rogner un peu un libre arbitre que n’a jamais un ambassadeur, et d’imposer à tout député ses conditions; par ce moyen, on arrivera à des sessions sérieuses où on fera les affaires réelles du pays;—car on doit commencer à comprendre que cet hypocrite dédain pour les intérêts matériels ne s’applique qu’aux intérêts matériels des autres, et cache plus ou moins adroitement le soin qu’on prend de ses intérêts matériels à soi.
Mais je ne commencerai à prendre au sérieux la Chambre des députés que lorsqu’on aura brûlé publiquement la tribune;—tant qu’elle existera, il n’y aura que les avocats qui feront et qui mèneront les affaires, et voilà trois ans que je vous explique comment ils les font et comment ils les mènent.
![]() Madame *** a perdu son mari;—madame ***, célèbre par les
ridicules du sien, a cru devoir lui envoyer une lettre de condoléance
qui se termine ainsi: «Permettez-moi de vous féliciter, ma chère amie,
de ce que vous portez le nom d’un homme qui ne peut plus faire de
sottises.»
Madame *** a perdu son mari;—madame ***, célèbre par les
ridicules du sien, a cru devoir lui envoyer une lettre de condoléance
qui se termine ainsi: «Permettez-moi de vous féliciter, ma chère amie,
de ce que vous portez le nom d’un homme qui ne peut plus faire de
sottises.»
![]() Ah ça!—je faisais réellement là un joli métier. Les lecteurs de
nos petits livres savent avec quel touchant désintéressement j’ai
annoncé, il y a longtemps déjà, que je ne faisais pas partie de la
Société des gens de lettres, et que je ne prétendais recevoir aucun
argent pour la reproduction des morceaux qu’il conviendrait aux journaux
de me prendre.
Ah ça!—je faisais réellement là un joli métier. Les lecteurs de
nos petits livres savent avec quel touchant désintéressement j’ai
annoncé, il y a longtemps déjà, que je ne faisais pas partie de la
Société des gens de lettres, et que je ne prétendais recevoir aucun
argent pour la reproduction des morceaux qu’il conviendrait aux journaux
de me prendre.
Cette déclaration, qui me paraissait franche et sans arrière-pensée, a eu,—à ce que j’apprends,—de déplorables résultats pour quelques journaux innocents qui en avaient profité pour faire quelques citations qu’ils croyaient gratuites.
Il n’en est pas ainsi.
Je reçois de M. Pommier, agent central de la Société des gens de lettres, une épître ainsi conçue:
«Monsieur, je viens d’établir le compte des droits de reproduction que j’ai touchés pour vous, et je tiens à votre disposition la somme de cent soixante-cinq francs soixante-seize centimes qui vous est due.—Agréez, etc.»
D’où il ressort qu’à mesure qu’une honnête feuille, trompée par nos protestations, avait l’imprudence de copier quelques pages des Guêpes, M. Pommier arrivait avec sa quittance et la faisait financer.
Cette manœuvre, que M. Pommier et moi nous avons pratiquée jusqu’ici fort innocemment, est connue parmi les voleurs de Paris sous le nom de chaulage.
Je crois que nous devons y mettre un terme.
Dans l’origine de la Société des gens de lettres,—cédant à quelques amitiés et à quelques sollicitations, j’avais acquiescé aux statuts de ladite Société, mais je me suis abstenu de paraître à aucune séance,—et j’ai adressé à M. Pommier une lettre qu’il a oubliée ou qu’il n’a pas reçue, dans laquelle je lui signifiais ma décision négative.
Je pense que M. Pommier pensera,—comme moi,—que nous n’avons qu’un parti à prendre pour tâcher de reconquérir l’estime de nos contemporains, c’est de restituer aux feuilles victimes les sommes indûment perçues, en joignant à la somme indiquée dans la lettre de M. Pommier celle qui, probablement, aura été retenue pour ma part de contributions aux frais et dépenses de la Société.
Je prie les susdites feuilles victimes d’adresser à M. Pommier des réclamations que, sans aucun doute, il ne leur laissera pas le temps de faire.
Si parmi les journaux il en est à la reconnaissance plus ou moins volontaire desquels je dois mettre des bornes,—il en est d’autres qui me traitent tout différemment.
J’ai eu l’honneur d’être dernièrement le sujet d’une polémique assez vive entre deux journaux belges.
L’un, le Précurseur, qui donne tous les mois un extrait des Guêpes,—croyait devoir accompagner cet emprunt d’une note où il affirmait à ses lecteurs—qu’attendu que je ne suis pas un écrivain sérieux,—un écrivain politique, ce que j’écris ne doit être pris que comme une charade, une énigme, un rébus, ou tout autre hors-d’œuvre innocent que certaines feuilles donnent à leurs abonnés, et que mes idées et mes opinions ne peuvent être considérées que comme non avenues.
Le Fanal, que je remercie beaucoup de sa bienveillance, a bien voulu me défendre un peu.—Le Précurseur a répondu en ces termes:
«Nous reproduisons, il est vrai, chaque mois, quelques passages des Guêpes, mais le succès de cette production est notre excuse.—Les lecteurs de journaux aiment quelquefois à se dérider, et les piqûres de ces guêpes qui volent à l’aventure, atteignent au hasard, s’acquittent de ce devoir avec beaucoup de succès.—Il ne s’agit pas ici de la justesse des pensées, ni de la solidité des principes, ni de l’exactitude de l’observation.—M. A. Karr est un faiseur de nouvelles et de petits romans.
Quant à nous, qui avons chaque jour une besogne sérieuse à faire, etc.»
Ah! ah!—voyons donc la besogne sérieuse.
J’occupe la première colonne.—Les deux suivantes sont consacrées à une correspondance particulière, à une lettre adressée au Précurseur.—Ce n’est donc pas encore cela la besogne sérieuse en question.
Quatrième colonne,—extraits des journaux anglais,—du Morning Chronicle,—du Times,—du Morning Post,—du Standart,—ce n’est pas encore là la besogne sérieuse du Précurseur,—ce n’est pas même la besogne.—Continuons:
«Nouvelles d’Espagne.—Lettre du chargé d’affaires, etc.;»—ce n’est pas cela.
«La Sentinelle des Pyrénées contient...»
«Proclamation de Fernando Cadoz.»—Jusqu’ici, il n’y a pas une ligne appartenant à la rédaction du Précurseur.—Cherchons toujours.
Cinquième colonne.
«France.—Un journal prétend que...»—Ce ne peut être la besogne sérieuse du Précurseur qu’un autre journal prétende.
Allons toujours:
«Extraits des journaux français.»
«Hollande.—On lit dans le Noord-Brabander...»—Ceci est de la besogne du Noord-Brabander.
«On écrit de Maestricht...»—Est-ce le Précurseur? non, c’est AU Precurseur,—ce n’est pas encore cela.
Sixième colonne.
«Belgique.—On lit dans le Moniteur...» Qui cela, on?—ah! peut-être bien le Précurseur;—c’est une besogne,—mais ce ne peut être cette besogne si sérieuse.
«L’Éclair publie...» Besogne de l’Éclair.
Où est donc la besogne sérieuse du Précurseur?
«Anvers.—Comme nous ne l’avions que trop malheureusement prédit...»
Ah! ah!—la besogne consiste à prédire... non, ce n’est pas encore cela,—une parenthèse indique que c’est le Journal des Flandres qui a prédit malheureusement,—et que la besogne sérieuse du Précuaseur se borne jusqu’ici à avoir coupé l’article avec des ciseaux.
«Il paraît que...»
Ceci est pris de la Tribune de Liége.
L’article suivant appartient à l’Écho de la Frontière.
Septième colonne.
«Le Courrier des États-Unis raconte, etc...» Ceci est de la besogne du Courrier des États-Unis.
Ah! ah!—«Correspondance.»
«CORRESPONDANCE.—Monsieur le rédacteur, votre empressement à saisir toutes les occasions d’être utile au commerce de la place m’engage, comme un de vos abonnés, à vous signaler un fait fort incommode aux habitués de la Bourse; les annonces d’arrivages se placent à la Bourse dans un cadre fermé par un grillage en fil de fer; ce grillage étant déchiré par son milieu, pour qu’on ne puisse enlever ces annonces par cette déchirure, l’on place à présent ces bulletins dans la partie la plus élevée du cadre, de manière qu’à moins d’être d’une stature plus qu’ordinaire, il est impossible de les lire.
«Agréez, monsieur le rédacteur, l’assurance de ma considération.
Votre abonné.»
Ceci est utile, philanthropique;—mais, enfin, c’est encore l’abonné en question qui a fait la besogne. Mais c’est que nous voilà à la huitième colonne, qui contient le compte rendu d’un procès au tribunal de commerce et l’annonce d’un concert au profit de M. Milord, par mesdames Marneffe,—Espinasse, M. Wanden-Bobogoert, etc.
Neuvième colonne.—Annonces de marchandises et de prix courants.
Quatrième page,—et dernière.—Annonce du Poliafiloir, nouvel instrument à quatre faces pour l’effilage des rasoirs.
Annonce de la vente, par actions, du palais l’Hottagenitsckowa, avec dépendances;—c’est tout,—et je jure, sur l’honneur, que je n’ai rien omis.—Et la besogne sérieuse du Précurseur?
C’est celle de presque tous ces carrés de papier;—elle consiste à se découper les uns les autres, au moyen de ciseaux,—avec un sérieux,—une importance,—une majesté,—qui n’ont pas encore perdu leur comique à mes yeux,—quoique je les regarde faire depuis bien longtemps.
![]() M. Scribe a cent mille francs de rente.—Mon ex-ami, M. de Balzac,
gagne quarante mille francs par an,—Janin, à peu près autant.
M. Scribe a cent mille francs de rente.—Mon ex-ami, M. de Balzac,
gagne quarante mille francs par an,—Janin, à peu près autant.
Je ne pousserai pas plus loin mes citations, parce que j’arriverais à quelques noms qui ne gagnent pas tout à fait vingt mille francs,—qui en sont honteux et me sauraient mauvais gré de trahir le secret de leur pauvreté.
Mettez en regard de ceci la part de Diderot, pour l’Encyclopédie, cet ouvrage dont il a conçu le plan et exécuté une grande partie, et qui forme à lui seul une bibliothèque;—cet ouvrage, qui a donné aux libraires associés pour sa publication, outre leurs frais, qui s’élevaient à neuf cent trente-huit mille deux cent quatre-vingt-onze livres deux sous six deniers,—un honnête bénéfice de deux millions quatre cent quarante-quatre mille deux cent quatre livres dix-sept sous six deniers:
La part de Diderot fut de mille francs de rente sa vie durant.
![]() Pourquoi,—demandais-je à ***,—presque tous les hommes
deviennent-ils avares en vieillissant?—C’est, me dit-il, que l’égoïsme,
chassé des diverses positions qu’il occupait, se replie sur celle-là—en
désespoir de cause;—jeune, l’homme obtient tout par échange: l’amour
pour de l’amour,—l’amitié pour de l’amitié;—vieux, il faut qu’il
achète ce qu’on lui donnait. D’ailleurs, ne vous trompez pas sur la
générosité des jeunes gens,—l’âge auquel on partage tout est
généralement l’âge où on n’a rien.
Pourquoi,—demandais-je à ***,—presque tous les hommes
deviennent-ils avares en vieillissant?—C’est, me dit-il, que l’égoïsme,
chassé des diverses positions qu’il occupait, se replie sur celle-là—en
désespoir de cause;—jeune, l’homme obtient tout par échange: l’amour
pour de l’amour,—l’amitié pour de l’amitié;—vieux, il faut qu’il
achète ce qu’on lui donnait. D’ailleurs, ne vous trompez pas sur la
générosité des jeunes gens,—l’âge auquel on partage tout est
généralement l’âge où on n’a rien.
Ceci est une exagération.
Pas déjà tant,—vous ne me nierez pas au moins que le jeune homme donne volontiers, parce qu’il ne considère ce qu’il possède en tout genre—que comme un léger à-compte sur le trésor qu’il s’imagine que la vie lui doit;—ce sont des hors-d’œuvre avant le grand festin de joie auquel il se croit convié.
Plus tard, quand il s’aperçoit que l’héritage est moins opulent,—que le festin est moins splendide,—quand il croit avoir sa part, il compte pour voir s’il aura assez, et il ménage parce qu’il n’attend plus rien au delà de ce qu’il a.
Mais de toutes les choses c’est l’argent auquel l’homme est le plus attaché;—il n’est presque aucun homme qui ose prendre la fuite s’il voit son ami attaqué par des gens qui en veulent à sa vie,—et qui ne reste avec lui pour partager le danger;—il en est encore moins qui exposent leur argent.
Aussi, j’ai imaginé un puissant moyen d’influence sur mes amis;—il n’est aucun homme, peut-être, qui les ait à sa disposition comme moi,—et je dois cette puissance peu commune à la simple observation du fait que je viens de vous signaler; à quelque ennuyeuse corvée que je destine un ami, à quelque démarche que je l’aie condamné, à quelque réel danger que j’aie besoin de l’exposer; je suis sûr de lui trouver le plus grand empressement.
Je l’aborde d’un air piteux et flatteur,—d’un ton humble et patelin,—je mets tout en œuvre pour lui faire croire que je viens pour lui emprunter de l’argent,—je vois son embarras,—je me plais à l’accroître;—à mesure que je vois qu’il a trouvé une excuse et qu’il la tient prête pour le moment où je m’expliquerai clairement,—je la détruis à l’avance et je l’oblige à en chercher une autre,—je le presse, je l’entoure, je le harcèle;—enfin, quand je vois son anxiété au plus haut degré,—par un revirement soudain, je dévoile en peu de mots le but réel de ma visite et la véritable corvée que j’ai à lui imposer;—quelle que soit cette corvée,—je n’ai jamais vu une fois mon homme—manquer de respirer à l’aise, comme délivré d’un poids qui l’oppressait, il est si heureux d’avoir échappé au danger qu’il redoutait, que tout autre lui paraît un jeu.
![]() Les écoles gratuites de dessin ne sont pas une invention tout à
fait récente.—La première a été ouverte à Paris par M. de Sartines, en
1766 ou 1767.—On voit même dans les journaux d’alors que le sieur
Lecomte, vinaigrier ordinaire du roi, donna en 1769 trois mille livres
aux écoles gratuites de dessin.
Les écoles gratuites de dessin ne sont pas une invention tout à
fait récente.—La première a été ouverte à Paris par M. de Sartines, en
1766 ou 1767.—On voit même dans les journaux d’alors que le sieur
Lecomte, vinaigrier ordinaire du roi, donna en 1769 trois mille livres
aux écoles gratuites de dessin.
Il y a aujourd’hui à Paris deux écoles gratuites de dessin;—dans nos mœurs vaniteuses, il n’y a que les enfants des pauvres qui vont aux écoles gratuites,—c’est-à-dire les enfants destinés à être ouvriers.—Le dessin est utile dans tous les états et aiderait singulièrement à y apporter des perfectionnements; nous n’en serions pas plus malheureux—si, par suite de ce supplément d’éducation donné aux ouvriers, les objets qui nous entourent et qui servent aux usages journaliers avaient du style et de la forme.
Les réchauds et les trois-pieds, tous les ustensiles de cuisine trouvés à Herculanum, ne ressemblent guère aux choses hideuses auxquelles nous sommes arrivés, de progrès en progrès. Les bijoux et les vêtements antiques avaient un style et une beauté que les bijoux et les vêtements modernes n’imitent que de bien loin.—Il n’y a de sots métiers que parce qu’il y a de sottes gens. Nos tailleurs s’occupent trop de politique.—En effet, dans les deux écoles de dessin de Paris on ne montre aux élèves qu’à faire des têtes et des dessins ombrés, d’après la Transfiguration de Raphaël, ce qui ne peut les mener qu’à devenir de mauvais et de malheureux peintres,—comme l’éducation des colléges à devenir de mauvais et malheureux poëtes.
Au contraire, des écoles gratuites de dessin bien dirigées,—c’est-à-dire applicables aux états divers que les élèves ont à exercer, seraient un grand bienfait.
Des deux écoles gratuites, l’une devrait être consacrée aux enfants des ouvriers destinés à être ouvriers,—et l’on y apprendrait le dessin applicable aux arts et métiers;—l’autre serait comme les colléges royaux:—les riches y payeraient, les enfants d’artistes distingués y auraient des bourses ou des demi-bourses, d’après la fortune de leurs parents;—cette faveur, devenant aussi une récompense au talent, serait acceptée avec empressement.
Nous aurions ainsi moins de mauvais peintres,—et moins de mauvais tailleurs.
Les fleurs de M. de Balzac.—Mémoires de deux jeunes mariées.—Les Ananas.—La balançoire des tours Notre-Dame.—A monseigneur l’archevêque de Paris.—Un mot de M. Villemain.—Un conseil à M. Thiers, relativement à l’habit noir de l’ancien ministre.—Une annonce.—Un député justifié.—Sur quelques Nisards.—M. Michelet et Jeanne d’Arc.—M. Victor Hugo archevêque.—M. Boilay à Charenton.—Une lettre de M. Jean-Pierre Lutandu.—Une nouvelle invention.—Seulement...—Une croix d’honneur et une rose jaune.—Les Glanes de mademoiselle Bertin.—MM. Ancelot, Pasquier, Ballanche, de Vigny, Sainte-Beuve, A. Dumas, Vatout, Patin, de Balzac, l’évêque de Maroc.—Question d’Orient.—Le roi de Bohême.—M. Nodier.—M. Jaubert.—M. Liadières.—M. Joly.—M. Duvergier de Hauranne Grand-Orient.—Le général Hugo.—Naïveté de deux ministres.—M. Aimé Martin et la Rochefoucauld.—Pensées et maximes de M. Aimé Martin.—Éloge de M. Aimé Martin.—Au revoir.
![]() J’ai déjà eu occasion de parler des fleurs de quelques romanciers.
Quelque magnificence que déploie la nature dans ses productions,—ils ne
peuvent prendre sur eux de s’en contenter. Les fleurs des prairies et
celles des jardins sont si nombreuses, que la vie d’un homme serait de
beaucoup trop courte pour les regarder toutes l’une après l’autre.—Il y
en a, dans la neige éternelle des Alpes et au fond des mers, des
milliers que personne n’a jamais vues. Il y en a de toutes les
formes,—de toutes les nuances;—leurs parfums sont variés comme leurs
couleurs;—eh bien! nos romanciers n’en ont pas encore assez pour leur
consommation, ils ne peuvent s’empêcher d’en inventer quelqu’une de
temps à autre. Les fleurs du bon Dieu ne sont pas assez belles pour
leurs livres;—celles qui naissent sous la rosée du mois de mai leur
semblent trop communes; ils en tirent de leur encrier, qu’on ne voit
nulle part que là.
J’ai déjà eu occasion de parler des fleurs de quelques romanciers.
Quelque magnificence que déploie la nature dans ses productions,—ils ne
peuvent prendre sur eux de s’en contenter. Les fleurs des prairies et
celles des jardins sont si nombreuses, que la vie d’un homme serait de
beaucoup trop courte pour les regarder toutes l’une après l’autre.—Il y
en a, dans la neige éternelle des Alpes et au fond des mers, des
milliers que personne n’a jamais vues. Il y en a de toutes les
formes,—de toutes les nuances;—leurs parfums sont variés comme leurs
couleurs;—eh bien! nos romanciers n’en ont pas encore assez pour leur
consommation, ils ne peuvent s’empêcher d’en inventer quelqu’une de
temps à autre. Les fleurs du bon Dieu ne sont pas assez belles pour
leurs livres;—celles qui naissent sous la rosée du mois de mai leur
semblent trop communes; ils en tirent de leur encrier, qu’on ne voit
nulle part que là.
M. de Balzac, entre autres, si exact pour décrire les meubles,—est loin d’apporter la même sévérité dans la description des fleurs qu’il daigne mettre en scène;—il ne croit rien pouvoir ajouter à l’art du tapissier, mais il n’a pas le même respect pour les œuvres de Dieu.
Dans un roman publié dans le journal la Presse, roman qui, au milieu de certaines incohérences, renferme des passages de la plus haute beauté,—des pages d’une simplicité pleine de noblesse,—d’une vérité poignante,—dans les Mémoires de deux jeunes mariées, il s’est passé la fantaisie d’inventer une nouvelle variété d’azalea: il nous peint «une maison,—empaillée de plantes grimpantes, de houblon, de clématite, de jasmin, d’azalea, de cobæa, etc.»
On ne connaît pas d’azalea grimpante.—L’azalea est un petit arbrisseau dont quelques espèces viennent de l’Amérique,—et quelques autres de l’Inde;—mais elles ne grimpent ni dans l’Inde, ni dans l’Amérique; elles ne se livrent à ce libertinage que dans les Mémoires de deux jeunes mariées.
M. de Balzac aura trouvé le mot joli, et s’en sera servi à tout hasard, en mêlant son azalea à d’autres plantes nullement grimpantes: il a compté sur l’exemple.—Si M. de Balzac venait encore me voir, il verrait autour de ma maison des plantes grimpantes dont le nom n’est pas moins harmonieux que celui de l’azalea;—il y verrait la glycine de la Chine, qui couvre une des façades, au printemps, de ses longues grappes de fleurs bleues,—et la passiflore,—cette fleur qui ornait d’habitude la boutonnière de M. Lautour-Mézeray, aujourd’hui sous-préfet à Bellac,—et qui, de loin, ressemble à une plaque d’ordre militaire;—il verrait encore un bignonia radicans, aux grandes fleurs rouges,—et les deux roses banks, la blanche et la jaune, qui tapissent le mur de leur feuillage luisant et de leurs roses doubles, grandes comme des pièces de dix sous.
M. de Balzac, du reste, a, de tout temps, voulu faire entrer les végétaux dans la voie de la rébellion contre les décrets de la nature.
—Je me rappelle que, il y a quelques années, M. de Balzac songea à cultiver des ananas dans une propriété qu’il avait achetée près de Ville-d’Avray.—Il fit part de ses projets à un de ses amis.
—Je veux, disait l’auteur de la Vieille Fille, que le peuple mange des ananas. Pour cela, il faut qu’on puisse avoir des ananas à cinq francs.
—Mais, lui répondit l’ami, les jardiniers qui les vendent vingt francs n’y font guère de bénéfices, et quelque-uns s’y ruinent: on cite le descendant d’une grande famille de l’Empire qui n’y fait guère d’affaires.
—Laisse-moi donc tranquille, reprit M. de Balzac, il serait bien singulier qu’un homme d’intelligence, se livrant à la culture de l’ananas, ne réussît pas à le produire à meilleur marché.—J’ai une boutique en vue sur le boulevard des Italiens.—Je vais aller à Paris tantôt, et la louer.
—Mais,—interrompit l’ami,—où sont tes ananas?
—Mes ananas? je n’en ai pas encore; je vais faire construire des serres.
—Mais, dit l’ami, l’ananas ne rapporte qu’au bout de trois ans et ta boutique restera vide jusque-là.
—Ah! bah! tu vois toujours des difficultés; il est impossible que je ne trouve pas un moyen de les faire produire la première année.
Heureusement que deux jours après M. de Balzac avait oublié entièrement son projet de faire manger des ananas au peuple.
![]() C’est une chose réellement curieuse que l’aspect de fourmilière que
présente Paris vu du haut des tours de Notre-Dame:—tous ces petits
hommes allant à leurs petites affaires ou à leurs petits plaisirs,—se
pressant, se heurtant, se coudoyant presque uniquement pour s’enlever
les uns aux autres de petits ronds de métal dont le plus gros ne
pourrait de cette hauteur être distingué par l’œil le plus perçant.
C’est une chose réellement curieuse que l’aspect de fourmilière que
présente Paris vu du haut des tours de Notre-Dame:—tous ces petits
hommes allant à leurs petites affaires ou à leurs petits plaisirs,—se
pressant, se heurtant, se coudoyant presque uniquement pour s’enlever
les uns aux autres de petits ronds de métal dont le plus gros ne
pourrait de cette hauteur être distingué par l’œil le plus perçant.
Il y a dans la cage de charpente d’une des cloches une curiosité dont M. Victor Hugo n’a pas parlé, je crois, dans Notre-Dame de Paris,—c’est une balançoire très-suivie par les enfants du quartier.—On a vu plus d’une fois le poëte assister à cet exercice avec complaisance.—La balançoire a été récemment supprimée; on assure que M. Hugo a fait notifier à monseigneur Affre, archevêque de Paris, qui se met sur les rangs pour l’Académie, qu’il lui refuserait opiniâtrément sa voix tant qu’il n’aurait pas fait rétablir la balançoire.
![]() M. Thiers joue en ce moment l’austérité. Il affecte de venir seul
chez le duc d’Orléans en habit noir,—lorsque tout le monde y est en
habit habillé.
M. Thiers joue en ce moment l’austérité. Il affecte de venir seul
chez le duc d’Orléans en habit noir,—lorsque tout le monde y est en
habit habillé.
M. Thiers laisse fréquemment percer la prétention assez saugrenue de contrefaire l’empereur Napoléon,—il refait quelques-uns de ses mots.
Il devrait bien alors l’imiter en ce point.
S’il est décidé à n’avoir pas la politesse de se faire faire un habit habillé pour aller chez le prince royal,—ou si son intégrité comme ministre ne lui a pas laissé les moyens de subvenir à cette dépense,—il pourrait se présenter en costume de membre de l’Institut, c’est l’habit que portait le général Bonaparte à son retour d’Égypte.
![]() Voici l’annonce arrivée, je crois, au plus haut degré de
l’inconvenance.—M. Gannal obtient des carrés de papier, même les plus
vertueux, l’insertion de l’article nécrologique que voici:—et cela non
pas à la quatrième page, à la page vénale, mais à la deuxième,
c’est-à-dire à une des pages indépendantes et incorruptibles:
Voici l’annonce arrivée, je crois, au plus haut degré de
l’inconvenance.—M. Gannal obtient des carrés de papier, même les plus
vertueux, l’insertion de l’article nécrologique que voici:—et cela non
pas à la quatrième page, à la page vénale, mais à la deuxième,
c’est-à-dire à une des pages indépendantes et incorruptibles:
«Madame la comtesse de la Roche-Lambert vient de mourir en son hôtel à Paris. Sa famille a bien voulu confier le soin de son embaumement à l’habile chimiste, M. Gannal.»
Encore un peu, et M. Gannal fera mettre sur les monuments funèbres: Embaumé par M. Gannal.
Cette inscription même sur un corbillard serait d’un assez bon effet dans une cérémonie.
![]() Encore un mot relativement à cette annonce:—il n’est pas probable
que ce soit la famille qui ait songé à faire faire cette annonce à M.
Gannal,—et d’ailleurs, elle n’eût pas mis, le «a bien voulu» qui
dévoile la modestie de M. Gannal;—mais alors pourquoi, après cette
louable humilité, M. Gannal s’intitule-t-il lui-même habile chimiste?
Encore un mot relativement à cette annonce:—il n’est pas probable
que ce soit la famille qui ait songé à faire faire cette annonce à M.
Gannal,—et d’ailleurs, elle n’eût pas mis, le «a bien voulu» qui
dévoile la modestie de M. Gannal;—mais alors pourquoi, après cette
louable humilité, M. Gannal s’intitule-t-il lui-même habile chimiste?
![]() Un ami de M. D*** avait répandu le bruit que ce député est
impuissant.—Ceci aurait été un texte admirable pour je ne sais plus
quel carré de papier, qui s’écriait lors de l’élection de M. Fould: «Il
faut bien que les Juifs soient représentés!»
Un ami de M. D*** avait répandu le bruit que ce député est
impuissant.—Ceci aurait été un texte admirable pour je ne sais plus
quel carré de papier, qui s’écriait lors de l’élection de M. Fould: «Il
faut bien que les Juifs soient représentés!»
M. D***, décidé à arrêter ce bruit, fait écrire à un homme de sa connaissance une lettre anonyme, par laquelle on lui apprend que M. D*** est l’amant de sa femme.—L’époux outragé accourt chez M. D***, le trouve au lit, le roue de coups, et s’en va.
M. D*** s’habille, et va disant partout dans la ville: «Je ne suis pas impuissant, demandez plutôt à M***, qui m’a battu ce matin.»
![]() SUR QUELQUES NISARDS.—M. Nisard aîné avait naturellement toutes
les proportions d’un professeur de quatrième peu distingué. Il chercha
une autre voie, il imagina d’insulter, sous forme de critique, les deux
plus grandes gloires poétiques de ce temps-ci, M. Hugo et M. de
Lamartine. La chose faite, il se croisa les bras et attendit. Il
n’attendit pas longtemps: on le nomma chevalier de la Légion d’honneur,
maître des requêtes au conseil d’État, maître de conférences à l’école
normale, chef de division au ministère de l’instruction publique.
SUR QUELQUES NISARDS.—M. Nisard aîné avait naturellement toutes
les proportions d’un professeur de quatrième peu distingué. Il chercha
une autre voie, il imagina d’insulter, sous forme de critique, les deux
plus grandes gloires poétiques de ce temps-ci, M. Hugo et M. de
Lamartine. La chose faite, il se croisa les bras et attendit. Il
n’attendit pas longtemps: on le nomma chevalier de la Légion d’honneur,
maître des requêtes au conseil d’État, maître de conférences à l’école
normale, chef de division au ministère de l’instruction publique.
En ce moment, il veut être député comme tout le monde.—C’est sur l’arrondissement de Châtillon que M. Nisard a jeté les yeux.—Il remplit les bibliothèques communales de ses futurs commettants avec les souscriptions du ministère.—Tous les gamins de Châtillon ont des bourses dans les colléges de Paris.—M. Villemain laisse faire.—Sans doute M. le ministre pense qu’il faut que les professeurs de quatrième soient représentés à la Chambre.
Dernièrement, M. Nisard aîné a envoyé au roi des Belges deux volumes de sa composition, intitulés: Mélanges littéraires. S. M. Léopold, qui est un homme poli, a compris tout de suite que M. Nisard aîné en voulait à sa petite croix inoffensive, et la lui a envoyée.
Le hasard fit que le roi envoya en même temps la même croix au célèbre chimiste allemand, Berzelius.—M. Nisard aîné explique ainsi cette coïncidence: «Le roi Léopold, en jetant les yeux sur l’Europe—a voulu récompenser en même temps et le représentant de la science et celui de la haute critique littéraire.—Ier Nisard.»
M. Nisard cadet n’a pas eu beaucoup de peine à trouver la voie ouverte par monsieur son frère. Mais il s’est trouvé dans la situation d’Alexandre,—qui pleurait à chaque victoire de son père Philippe,—en disant: «Il ne me laissera rien à faire.»
Les pères Philippe en général aiment assez à tout faire eux-mêmes.
M. Nisard cadet—passa en revue les hommes de génie de l’époque;—le compte n’en est pas plus long qu’il ne faut. «Il n’y a rien à faire là, se dit-il, mon frère me les a insultés.»—Il lui fallut se rabattre sur un homme de beaucoup de mérite,—et il s’est lancé sur M. Michelet.
M. Michelet a eu la bonté de m’envoyer son livre,—qui m’a fait plaisir.—M. Nisard cadet pense autrement: «Ce livre, dit-il,—échappe à une analyse un peu forte, à cause de l’érudition extravagante de l’auteur.—De graves facéties, des peintures renforcées et graveleuses, etc.—A quoi sert, s’écrie M. Nisard cadet, cette curiosité qui se met sur la trace des moindres détails du passé?—Il n’y a qu’une manière d’écrire l’histoire de la Pucelle,—dit M. Nisard cadet, c’est que l’écrivain se laisse emporter lui et toute sa science archéologique au cours impétueux de la tradition populaire.» En un mot, l’opinion longuement exprimée par M. Nisard cadet est que l’érudition est au moins inutile pour écrire. Cela serait de l’histoire—à peu près comme en font les journaux pour la politique et les portières pour les mœurs.
L’histoire n’est déjà pas trop vraie, et l’on doit savoir gré aux savants qui s’efforcent de l’empêcher de devenir tout à fait un recueil de contes de ma mère l’Oie.
Cela fait,—M. Nisard cadet—se croise les bras et attend.—IIe Nisard.
![]() ***, qui a eu une vie fort dissipée, vient de se marier;—comme
il sortait de la mairie, après avoir prononcé le serment d’usage, sa
belle-mère le prend à part et lui dit:
***, qui a eu une vie fort dissipée, vient de se marier;—comme
il sortait de la mairie, après avoir prononcé le serment d’usage, sa
belle-mère le prend à part et lui dit:
—Voilà qui est fini; j’espère que vous ne ferez plus de sottises?
—Non, ma belle-maman, répond ***; je vous promets que celle-ci est la dernière.
![]() C’était à l’époque d’une des candidatures de M. Victor Hugo à
l’Académie.—M. Hugo s’est présenté cinq ou six fois, et cinq ou six
fois ses collègues d’aujourd’hui l’ont déclaré indigne d’entrer dans
leur compagnie.—M. Hugo se présentait cette fois pour succéder à M. de
Quélen, et il avait de grandes chances de succès.—Deux ou trois jours
avant l’élection, les journaux du soir contenaient une note conçue en
ces termes: «Il paraît à peu près certain que c’est M. Victor Hugo qui
succédera à monseigneur l’archevêque de Paris.» Cette phrase tomba, par
hasard, sous les yeux de mademoiselle Dupont, l’ancienne soubrette de la
Comédie-Française, qui lisait le journal dans sa loge, tandis qu’on la
coiffait;—elle lut la phrase,—la relut,—se frotta les yeux,—la relut
encore, puis tout à coup, elle entra, le journal à la main, où se
trouvaient dix ou douze de ses camarades.
C’était à l’époque d’une des candidatures de M. Victor Hugo à
l’Académie.—M. Hugo s’est présenté cinq ou six fois, et cinq ou six
fois ses collègues d’aujourd’hui l’ont déclaré indigne d’entrer dans
leur compagnie.—M. Hugo se présentait cette fois pour succéder à M. de
Quélen, et il avait de grandes chances de succès.—Deux ou trois jours
avant l’élection, les journaux du soir contenaient une note conçue en
ces termes: «Il paraît à peu près certain que c’est M. Victor Hugo qui
succédera à monseigneur l’archevêque de Paris.» Cette phrase tomba, par
hasard, sous les yeux de mademoiselle Dupont, l’ancienne soubrette de la
Comédie-Française, qui lisait le journal dans sa loge, tandis qu’on la
coiffait;—elle lut la phrase,—la relut,—se frotta les yeux,—la relut
encore, puis tout à coup, elle entra, le journal à la main, où se
trouvaient dix ou douze de ses camarades.
—Par exemple, voilà qui est trop fort! s’écria-t-elle, je vous annonce une drôle de nouvelle.—Certes, M. Hugo a du talent, je ne dis pas le contraire; mais c’est égal,—je n’aurais jamais cru cela.—Allons, il ne faut plus s’étonner de rien maintenant.—Ne voilà-t-il pas M. Victor Hugo qui va être nommé archevêque de Paris!
![]() M. Boilay, inventé et décoré par M. Thiers.—a, comme je vous l’ai
raconté, passé dernièrement avec armes et bagages dans le camp de M.
Guizot.
M. Boilay, inventé et décoré par M. Thiers.—a, comme je vous l’ai
raconté, passé dernièrement avec armes et bagages dans le camp de M.
Guizot.
C’est là un de ces actes qui ont besoin d’être payés magnifiquement pour cacher ce qui leur manque du côté de la noblesse et du désintéressement. M. Boilay a la prétention d’être fait conseiller référendaire à la cour des comptes.
(C’est étonnant combien il y a de gens qui usent leur vie, et commettent une foule de choses pour arriver à des buts dont je connais à peine les noms, et dont l’éclat m’échappe tout à fait.)
Le ministère fait la sourde oreille.—M. Boilay valait à ses yeux la peine d’être acheté.—Mais, une fois acheté, un homme ne peut plus vous faire du mal, et conséquemment ne vaut guère la peine qu’on le paye. On l’a nommé directeur de la prison de Charenton.
M. Boilay se débat autant pour ne pas diriger la maison de Charenton que s’il s’agissait de ne pas y être dirigé.—Peut-être craint-il que ce ne soit une de ces ruses employées par les familles pour faire entrer de bonne volonté un parent dans ces maisons.—Cependant la place est bonne; il s’agit de dix mille francs par an, avec un logement. Mais M. Boilay aime mieux être le dernier à la cour des comptes que le premier à Charenton.—D’ailleurs, il prend cette proposition pour une épigramme; le ministère, de son côté, paraît tenir à la plaisanterie.
![]() Lors du passage de M. le duc de Nemours à Vendôme,—M. Jean-Pierre
Lutandu, officier de la garde nationale, fut invité à orner de sa
présence le bal que les autorités donnaient à Son Altesse Royale; il
tomba dans la même erreur qu’un maire de la banlieue de Paris, dont j’ai
raconté l’histoire, qui avait amené son épouse au bal des Tuileries,
et qui fut obligé de la laisser en dépôt chez le portier. M. Lutandu,
heureusement, apprit à temps que ce n’était pas précisément M. Lutandu,
mais l’officier de la garde nationale qu’on invitait, et que les dames
avaient besoin d’invitations spéciales.
Lors du passage de M. le duc de Nemours à Vendôme,—M. Jean-Pierre
Lutandu, officier de la garde nationale, fut invité à orner de sa
présence le bal que les autorités donnaient à Son Altesse Royale; il
tomba dans la même erreur qu’un maire de la banlieue de Paris, dont j’ai
raconté l’histoire, qui avait amené son épouse au bal des Tuileries,
et qui fut obligé de la laisser en dépôt chez le portier. M. Lutandu,
heureusement, apprit à temps que ce n’était pas précisément M. Lutandu,
mais l’officier de la garde nationale qu’on invitait, et que les dames
avaient besoin d’invitations spéciales.
M. Jean-Pierre Lutandu crut devoir en écrire au journal le Loir; le journal le Loir n’accepta pas la collaboration de M. Jean-Pierre Lutandu,—en quoi je le trouve bien dégoûté.—M. Jean-Pierre fit imprimer sa lettre et la distribua. La voici.
Il faut, pour l’intelligence de la chose, remarquer un artifice oratoire de M. Jean-Pierre Lutandu,—qui se sépare en deux personnages,—afin que l’un, M. Lutandu, ne soit pas gêné dans l’expression de ses sentiments par l’autre, M. Jean-Pierre.—Cette facétie, imitée de Paul-Louis Courier,—a plus de piquant pour les habitants de Vendôme que pour nous,—parce qu’ils savent bien réunir les deux personnages en un seul et même Jean-Pierre Lutandu.
Lettre de M. Jean-Pierre Lutandu.—«La lettre suivante n’ayant pu être insérée au journal le Loir, j’ai cru devoir la publier moi-même, et la faire imprimer à part.»
Remarquons ici en passant la modération peu commune de M. Jean-Pierre; je sais plus d’un de ces correspondants de journaux qui, voyant leur épître repoussée, accuseraient immédiatement le carré de papier d’être vendu au pouvoir. M. Jean-Pierre Lutandu dit simplement: n’ayant pu être insérée.
«Monsieur le rédacteur du journal le Loir, j’ai lu, dans votre numéro du 19 novembre dernier, que madame la baronne X*** n’ira pas au bal donné par les autorités de Vendôme à S. A. monseigneur le duc de Nemours, si madame Jean-Pierre en est invitée; que M. Jean-Pierre, officier de la garde nationale, serait prié personnellement, et que de dépit et de rage il en donnerait sa démission.»
Hélas, monsieur Jean-Pierre, à dire vrai, il y a fort peu de différences réelles entre les femmes (on pourrait dire même qu’il n’y en a pas d’autres que la beauté); aussi, faute de différences, elles mettent des distances. Les hommes peuvent se mêler, parce qu’un homme de génie, de talent et d’esprit, ne sera jamais confondu avec un domestique.—Mais une femme a toujours raison de se défier d’une trop jolie femme de chambre.—Il est si facile de faire en six mois d’une grisette une duchesse fort présentable.
«Je connais parfaitement le nommé Jean-Pierre, je suis même un de ses intimes amis. Je vous avouerai, monsieur le rédacteur, qu’effectivement rage et dépit se sont emparés de lui. Jean-Pierre a été rudement froissé par la réalité de votre annonce. En cette circonstance, son ennemi peut donc se flatter doublement d’avoir touché en lui la corde la plus sensible. Jean-Pierre est vexé, courroucé, indigné, mystifié, mortifié au delà de toute expression. Si ce camarade, à titre de marchand ou d’artisan, si vous l’aimez mieux, n’eût pas été invité du bal de la mairie, sottise faite maladroitement à tout le commerce et dont nous devons gracieusement remercier MM. les commissaires, comme les autres, il eût subi son mécontentement sous le silence le plus absolu; il se fût dit: «J’ai des compagnons d’infortune, je suis de ceux qui n’ont pas eu le bonheur de convenir;» son amour-propre seul en eût été blessé. Mais c’est bien pis encore, monsieur le rédacteur: Jean-Pierre, officier de la garde nationale, est le seul de tout le bataillon que l’on invite personnellement. «Parais au bal, sous-lieutenant, puisque nous n’avons pas le droit de t’en chasser, mais laisse ta dame à la maison;» tel est le sens de cette sotte invitation; et, je le répète, il reste seul, accablé sous le poids de cette humiliante assignation. Si, comme moi, monsieur le journaliste, vous connaissiez Jean-Pierre, vous prendriez part à sa peine, elle est poignante. Pour vous aider à compatir à sa douleur, laissez-moi vous tracer un croquis moral de mon infortuné camarade.»
Une petite observation seulement: M. Jean-Pierre Lutandu a un ennemi;—il ne nous donne pas de grands détails à ce sujet «son ennemi.» Sans doute, on sait à Vendôme quel est le guelfe du gibelin Jean-Pierre Lutandu. Passons au croquis moral.
«Jean-Pierre, natif de Vendôme, est âgé de trente-huit ans, issu d’artisans honnêtes, qui ont emporté dans la tombe les regrets des Vendômois de leur classe et de leur âge; Jean-Pierre en a hérité la probité, l’honneur et quelque peu d’éducation. N’ayant de sa vie dévié des principes qui lui ont été transmis par ses ancêtres, il croit devoir marcher la tête levée. Un tel bouclier, que n’a jamais terni la moindre des taches, espérons-le, saura parer les coups de ses ennemis. A tout prix il demande aujourd’hui une réparation; MM. les commissaires la lui doivent publiquement.»
Apprécions la modestie avec laquelle M. Jean-Pierre avoue que ses ancêtres étaient d’honnêtes artisans.—Mais il y a dix lignes, M. Jean-Pierre Lutaundu n’avait qu’un ennemi, voici maintenant qu’il en a plusieurs.—Il ne nous dit pas combien,—et l’imagination s’effraye du nombre possible que peut désigner ce pluriel.
«Jean-Pierre est socialement ce qu’on appelle un bon enfant; il est de ces gens qui, pour tout au monde, ne commettraient une action désobligeante; c’est un homme calme, paisible, rond en esprit, rond en affaires, qui vit retiré, trouvant son plaisir, son unique bonheur, au sein de sa famille. Voilà, monsieur le rédacteur, bien exactement l’esquisse morale de mon frère d’armes, de celui que MM. les commissaires vexent aujourd’hui si audacieusement.
»Votre dévoué serviteur,
LUTANDU.»
Vous vivez retiré, monsieur Jean-Pierre, c’est fort bien; vous trouvez votre unique bonheur au sein de votre famille, c’est encore mieux;—mais avouez que ces vertus paisibles se sont bien développées depuis votre mésaventure du bal. Du reste, c’est tant mieux pour vous; les gens qui se sont servis de la petite bourgeoisie ne lui pardonneront jamais les égards qu’ils se croient forcés d’avoir pour elle,—et ils ne négligeront jamais une occasion de saupoudrer d’un peu d’avanie les gracieusetés qu’ils n’osent pas ne pas lui faire.
«P. S. Jean-Pierre étant indigne de paraître avec sa femme au bal que la mairie offre, etc., prie son commandant, qui est un des commissaires, de le dispenser de service pendant le séjour du prince à Vendôme; voilà le seul motif qui a empêché mon pauvre Jean-Pierre de se rendre aujourd’hui au corps d’officiers de la garde nationale pour une visite à laquelle il aurait dû participer. Jean-Pierre ne donnera point sa démission, il finira tranquillement son triennal pour rentrer voltigeur dans sa compagnie qu’il vénère.
»Vendôme, ce 1er décembre 1841.»
Dans ce post-scriptum plein de mélancolie,—M. Jean-Pierre Lutandu nous montre une fatigue du pouvoir et des honneurs—qui n’est pas sans exemple.—Sylla, Dioclétien,—Christine de Suède,—ont agi, en leur temps, comme M. Jean-Pierre Lutandu.
Après tout,—je gage tout ce qu’on voudra que M. Lutandu est un très-brave et très-honnête homme.
![]() J’ai annoncé, il y a quelques mois, à propos de la découverte faite
par un savant d’une nouvelle pomme de terre, un peu plus mauvaise et
beaucoup plus petite que celles que nous possédons déjà,—que je
surveillerais à l’avenir MM. les savants et mesdames leurs inventions.
J’ai annoncé, il y a quelques mois, à propos de la découverte faite
par un savant d’une nouvelle pomme de terre, un peu plus mauvaise et
beaucoup plus petite que celles que nous possédons déjà,—que je
surveillerais à l’avenir MM. les savants et mesdames leurs inventions.
En voici une assez curieuse:
La pyrale est un insecte qui fait quelque tort à la vigne dans certaines localités.—Voici le moyen qu’une réunion d’érudits a trouvé pour en délivrer les ceps:
«Il suffit, disent-ils, d’enduire les treillages et les échalas d’une certaine quantité d’eau provenant de l’épuration du gaz destiné à l’éclairage.—SEULEMENT cette eau peut brûler et faire périr les jeunes pousses.
»DE PLUS, elle agit sur la peau comme des cantharides, et les cloches qu’elle fait venir sont douloureuses.»
![]() On ne saurait trop admirer avec quelle héroïque patience les
Français, qu’on prétend si légers, se résignent à entendre les mêmes
choses rebattues pendant si longtemps.
On ne saurait trop admirer avec quelle héroïque patience les
Français, qu’on prétend si légers, se résignent à entendre les mêmes
choses rebattues pendant si longtemps.
Quand il se passe quelque chose d’un peu important pendant les vacances des Chambres, chaque journal rapporte la chose sous forme d’un on dit.
Le lendemain, il découpe avec des ciseaux et imprime le on dit de tous ses confrères sur le même sujet.
Le surlendemain—on recommence avec cette phrase préliminaire: «Nous ne nous étions pas trompés; il n’est que trop vrai, etc.»
Le jour d’après,—opinions des confrères coupées aux ciseaux.
Le jour d’après,—réponse des journaux ministériels.
Le jour d’après,—réponse aux journaux ministériels.
Le jour d’après,—les journaux ministériels répliquent.
Le jour d’après,—les journaux dits indépendants répliquent à leur tour.—Ce n’est qu’au bout de quinze jours qu’on laisse la chose en repos—et qu’on commence à retrouver des araignées dilettantes, des médailles de Tetricus.—des mâchoires de dynotherium giganteum.—Les enfants tombent d’un sixième étage dans une voiture de poussier de mottes à brûler, et leur mère les remonte sans accident avec le boisseau qu’elle marchandait.—Les chiens se signalent par des actions vertueuses.—Le grand serpent de mer est rencontré par un navire hollandais.—Des bûcherons coupent un arbre et trouvent dedans—une croix peinte en bleu, etc., etc.
A ces signes, on se rassure, on se dit: «Allons! c’en est fini de telle ou telle question.»
Pas le moins du monde.
La session s’ouvre,—les députés récitent à la tribune les articles des journaux sur la chose que vous espériez oubliée:—les journaux impriment les discours des députés, et on recommence tout.
![]() Quelques jeunes gens des écoles sont allés visiter M. de
Lamennais,—et lui ont tenu ce langage:
Quelques jeunes gens des écoles sont allés visiter M. de
Lamennais,—et lui ont tenu ce langage:
«Citoyen, il y a un an, votre condamnation marquait d’un sceau indélébile les tendances réactionnaires d’un pouvoir oppresseur. Ce pouvoir avait démontré depuis longtemps ses vues antipopulaires, antinationales; mais il nous a appris, depuis votre captivité, qu’il n’avait pas achevé son œuvre; lâcheté au dehors, corruption et arbitraire au dedans, déchaînement de la force contre la presse, construction de bastilles, aversion pour l’organisation du travail: tout nous dit assez haut qu’il veut renverser l’édifice révolutionnaire de 1830.
«Mais sait-il bien, ce pouvoir, que son audace peut le perdre? Sait-il bien que les victimes qu’il atteint viennent réchauffer le zèle des patriotes, et grandir leur cause?... Il ne l’ignore pas, sans doute, et d’ailleurs nous sommes moins jaloux de le lui apprendre que de venir ici vous témoigner, citoyen, quel est l’esprit de réprobation que ce système inspire généralement.»
Il est difficile de trouver une plus grande preuve d’une liberté illimitée—que cette façon de se plaindre de n’en pas avoir.
![]() Depuis quelques mois, mes amis se plaisent à orner les collets de
leurs habits de toutes sortes de couleurs:—M. Hugo a mis du vert à son
habit sous forme de petites palmes d’académicien;—voici que M.
Théophile Gautier met au sien un peu de rouge, sous prétexte de croix
d’honneur;—j’ai un jeune camarade qu’on avait obligé, lui, de revêtir
un collet entièrement rouge,—mais c’était le plus mécontent des trois;
il s’est fait réformer et est rentré avec joie dans la vie civile et
dans sa redingote noire.
Depuis quelques mois, mes amis se plaisent à orner les collets de
leurs habits de toutes sortes de couleurs:—M. Hugo a mis du vert à son
habit sous forme de petites palmes d’académicien;—voici que M.
Théophile Gautier met au sien un peu de rouge, sous prétexte de croix
d’honneur;—j’ai un jeune camarade qu’on avait obligé, lui, de revêtir
un collet entièrement rouge,—mais c’était le plus mécontent des trois;
il s’est fait réformer et est rentré avec joie dans la vie civile et
dans sa redingote noire.
M. Théophile Gautier est un jeune poëte qui a fait d’abord de fort beaux vers:—on ne lui a pas donné la croix pour cela;—il s’est mis à faire dans les journaux de la prose spirituelle. C’était aux yeux des gens déjà un peu mieux, en cela que c’était déjà moins; mais on ne pouvait pas encore lui donner la croix.—Il la désirait, cependant, parce qu’il aime le rouge, et que c’était, disait-il, un moyen légal d’en porter sur ses habits.—Il avait une fois, dans sa jeunesse, essayé d’un gilet de soie ponceau, mais cela avait mis ses voisins dans une telle fureur, qu’il avait été obligé d’y renoncer.
On lui fit faire alors un long dithyrambe sur la naissance d’un fils du prince royal:—cela commençait à aller assez bien;—on avait promis la croix, et je crus même alors qu’on l’avait donnée.—Malheureusement, par suite d’une fâcheuse habitude dès longtemps contractée, il avait par mégarde laissé tomber encore quelques beaux vers dans son ode; cela fit peur aux gens, et on vit qu’il n’était pas encore mûr pour les récompenses du pouvoir.
On attendit une meilleure occasion.
Elle se présenta à propos du concours pour le tombeau de l’empereur Napoléon.—M. Gautier fut chargé de rédiger le rapport de la commission, et, sur cette pièce d’écriture, où on lui a donné plusieurs collaborateurs pour qu’il ne s’échappât pas trop en esprit, on lui a donné enfin le ruban rouge.
J’approuve, on ne saurait davantage, qu’on ait accordé cette distinction à un jeune homme d’esprit et de talent,—mais je demande pourquoi on la lui a donnée après le rapport de la commission sur le concours pour le tombeau de Napoléon, au lieu de la lui donner après la publication de la Comédie de la Mort, volume plein de charmantes fantaisies et de vers du plus grand mérite.
Et je me réponds: C’est que le pouvoir a toujours un peu peur des supériorités.—Tant qu’on les tient au pied de l’échelle, on paraît toujours plus grand qu’elles, parce qu’on est plus élevé, et, pour le public, c’est la même chose.—Mais, si une fois on les laisse se hisser sur les mêmes tréteaux, alors les médiocrités qui les y ont précédées, réduites à leur taille réelle, risquent fort de ne pas conserver leur avantage.—C’est pourquoi on exige des gens de talent une foule de conditions préalables relatives au niveau.—On ne les laisse entrer dans les faveurs du pouvoir—que comme les chevaux de remonte entrent dans les régiments; il faut qu’ils prouvent par des papiers bien en règle qu’ils sont hongres comme tout le monde.
Pour cette fois, cependant, je ne leur conseille pas de s’y fier.
Je suis sûr, néanmoins, mon cher Théophile, que vous ne vous êtes pas, à beaucoup près, donné tant de mal pour obtenir la croix—que j’en ai depuis huit jours à décider mon voisin à me vendre un rosier à fleurs jaunes qu’il avait dans sa haie.—Je n’ose repasser dans ma mémoire—tout ce que j’ai fait de bassesses, ce que j’ai commis de fourberies, pour décider mon homme; et j’ose moins penser à ce que j’en aurais fait de plus s’il n’avait pas cédé aussitôt. Il faut dire que c’est la grosse rose jaune double,—et que le rosier a sept pieds de haut.
![]() On vient de publier, sous le titre de Glanes, un volume de
mademoiselle Louise Bertin.
On vient de publier, sous le titre de Glanes, un volume de
mademoiselle Louise Bertin.
En voici huit vers pleins d’une exquise délicatesse:
![]() L’Académie, la vieille coquette, semble ne vouloir céder qu’à un de
ces beaux feux, qu’à une de ces longues passions sur lesquelles
mademoiselle de Scudéri faisait dix volumes. Il faut lui faire longtemps
la cour pour obtenir ses faveurs.—On trouve, dans le Journal des
Débats de 1824, la candidature de M. Ancelot officiellement
annoncée.—Cette candidature a duré quinze ans. M. le chancelier
Pasquier date de plus de vingt ans. Il y a vingt ans, du moins, que,
sans se présenter tout à fait, il tâte le terrain et attend le moment.
L’Académie, la vieille coquette, semble ne vouloir céder qu’à un de
ces beaux feux, qu’à une de ces longues passions sur lesquelles
mademoiselle de Scudéri faisait dix volumes. Il faut lui faire longtemps
la cour pour obtenir ses faveurs.—On trouve, dans le Journal des
Débats de 1824, la candidature de M. Ancelot officiellement
annoncée.—Cette candidature a duré quinze ans. M. le chancelier
Pasquier date de plus de vingt ans. Il y a vingt ans, du moins, que,
sans se présenter tout à fait, il tâte le terrain et attend le moment.
D’après toutes les probabilités, M. Pasquier succédera à M. de Cessac, et M. Ballanche à M. Duval.
Les autres candidats, fruits secs, sont: MM. de Vigny,—Sainte-Beuve,—Alexandre Dumas,—Casimir Bonjour,—Vatout,—l’évêque de Maroc,—Patin,—M. de Balzac et M. Aimé Martin.—L’Académie est le prix de l’obstination; elle n’est pas pour celui qui arrive le premier, mais pour celui qui court le plus longtemps. Tous les concurrents y arriveront.
![]() Les trois ou quatre académiciens qui ont assisté à l’enterrement de
M. Duval ont fait une assez bonne journée: il y a des jetons de présence
pour ces cérémonies, comme pour les séances; c’est-à-dire deux cent
quarante francs à partager entre les assistants. Les jeunes s’occupent
de vivre, les vieux ont peur de mourir; de sorte qu’on ne va aux
enterrements qu’en petit nombre.
Les trois ou quatre académiciens qui ont assisté à l’enterrement de
M. Duval ont fait une assez bonne journée: il y a des jetons de présence
pour ces cérémonies, comme pour les séances; c’est-à-dire deux cent
quarante francs à partager entre les assistants. Les jeunes s’occupent
de vivre, les vieux ont peur de mourir; de sorte qu’on ne va aux
enterrements qu’en petit nombre.
Autrefois, pour les séances, on fermait la porte à trois heures. On raconte qu’un jour l’abbé Delille, se trouvant seul à cette séance, et entendant des pas, ferma promptement la porte, empocha les jetons, et s’en alla.
![]() QUESTION D’ORIENT.—Relire ici les différentes sorties auxquelles
je me suis laissé aller à diverses reprises contre la tribune.
QUESTION D’ORIENT.—Relire ici les différentes sorties auxquelles
je me suis laissé aller à diverses reprises contre la tribune.
Connaissez-vous l’Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux, par M. Nodier? A la première page du volume, qui est fort gros, le roi de Bohême part pour visiter tous ses châteaux, et à la dernière page il n’est pas encore arrivé au premier.
C’est absolument ce qui s’est passé à la Chambre des députés dans les séances consacrées à ce qu’on a appelé la question d’Orient. Voici une partie du programme:
QUESTION D’ORIENT.—M. Jaubert—parle du recensement de Toulouse.
M. Liadières—reproche à M. Joly d’avoir parlé des canons de Brunehaut.
M. Jaubert—remonte à la tribune et parle légèrement des tragédies de M. Liadières.
SUITE DE LA QUESTION D’ORIENT.—M. Joly monte à la tribune et explique les canons de Brunehaut.
M. Liadières—monte à la tribune et se déclare satisfait de l’explication;—il répond aux critiques de M. Jaubert sur ses tragédies.
M. Jaubert—monte à la tribune et menace M. Liadières de le faire chasser de la Chambre, attendu qu’il y a incompatibilité entre son service auprès du roi et ses fonctions de député.
(Ce qui est une niaiserie, attendu que les électeurs qui ont envoyé M. Liadières à la Chambre l’ont accepté et choisi comme cela, et que M. Jaubert n’a rien à y voir.)
M. Liadières—remonte à la tribune, et dit qu’il donnera, si cela est nécessaire, sa démission au roi, mais qu’il restera député.
M. Joly—donne de nouvelles explications; il n’a pas dit précisément qu’il y eût des canons dans l’armée de Brunehaut.
M. Jaubert—se plaint de M. Guizot.
Pendant que ces choses se passent—la Chambre n’écoute pas par discrétion les conversations particulières de ces trois messieurs qui occupent la tribune, se livre à des dialogues variés,—on devise sur la rareté du gibier,—des actions du chemin de fer de Rouen,—du pavage en bois, et on échange quelques prises de tabac, on raconte l’aventure de l’honorable M. D*** de seize manières différentes.
FIN DE LA QUESTION D’ORIENT.—A ce propos, disons que M. Duvergier de Hauranne colporte partout ses paperasseries fastidieuses, sous prétexte de la question d’Orient.—A la Chambre, on ne l’appelle plus, dans les couloirs et dans la salle des conférences, que le Grand-Orient.
![]() M. LE GÉNÉRAL COMTE HUGO.—Lorsqu’il fut question d’inscrire sur
l’arc de triomphe de l’Étoile les noms des gloires de l’Empire,—on
avait lieu de croire que la chose se ferait sans étourderie, et que la
liste des noms à graver serait la suite d’un mûr examen.
M. LE GÉNÉRAL COMTE HUGO.—Lorsqu’il fut question d’inscrire sur
l’arc de triomphe de l’Étoile les noms des gloires de l’Empire,—on
avait lieu de croire que la chose se ferait sans étourderie, et que la
liste des noms à graver serait la suite d’un mûr examen.
Pas le moins du monde:—on a écrit des noms d’abondance et au fil de la mémoire,—de telle sorte que les réclamations sur de graves oublis se sont fait entendre de tous côtés.
D’une lettre adressée à la postérité, on n’aurait pas dû écrire le brouillon sur la pierre.—C’est élever à l’état de monument et la gloire d’une génération et la saugrenuité d’une autre. Toujours est-il que cela fut fait ainsi.
Une réclamation surtout fit beaucoup d’effet: c’était celle de M. Victor Hugo, au nom de son père.
Il y a un des plus nobles et des plus honorables généraux de la République et de l’Empire, que l’ancien roi de Naples et d’Espagne, le frère de l’empereur, le roi Joseph, appelle encore dans ses correspondances particulières son meilleur ami; un homme qui se distingua brillamment au siége de Gaëte, qui organisa le royaume de Naples de concert avec Joseph Bonaparte; qui, gouverneur de la province d’Avellino, chassa, battit et saisit au corps le fameux Fra Diavolo, qui le jugea l’homme le plus tenace et le plus redoutable auquel il ait jamais eu affaire; un homme que le roi Joseph Bonaparte, fait par son frère roi des Espagnes et des Indes, crut indispensable à l’affermissement de la domination française en Espagne, et qu’il appela à Madrid en qualité de majordome du palais, d’abord, et ensuite en qualité de gouverneur des provinces d’Avila et de Guadalajara; un homme qui donna à son pays, son sang, ses jours, ses nuits, sa vie entière; qui se montra avec éclat à Cifuentes, à Siguenza, à Valdajos, à Hita, à Caldiero; un de ces fiers et intègres généraux de la République, qui refusa avec indignation, plusieurs fois et au vu de ses soldats, des millions que lui fit offrir l’ennemi pour livrer le drapeau de la France; qui ne reçut ses grades que un à un, qui ne se laissa qu’à son corps défendant créer par le roi d’Espagne comte de Cifuentes et marquis de Siguenza; un homme, enfin, auquel l’empereur, à deux reprises différentes, confia, comme au seul capable de la bien défendre, Thionville, un des boulevards de la frontière, en 1814 et en 1815; qui s’y immortalisa deux fois, qui y soutint un bombardement, et se défendit jusqu’à la dernière heure avec un courage héroïque, après avoir fait dire aux parlementaires ennemis: «Qu’il s’ensevelirait sous les ruines de Thionville plutôt que de livrer la place aux généraux prussiens.»—Cet homme, ce noble et modeste soldat, c’est M. le général comte Hugo.
Le second fils du général, M. V. Hugo,—vit avec tristesse que le nom de son père n’était pas inscrit entre les généraux de l’empereur Napoléon.—Il publia un volume de poésies,—les Voix intérieures, et le dédia à son père, Joseph-Léopold-Sigisbert, comte Hugo, oublié sur l’arc de triomphe de l’Étoile.
![]() Le volume paraît le 24 juin 1837.
Le volume paraît le 24 juin 1837.
Le 27 juin, M. Victor Hugo, en rentrant chez lui, trouve dans son salon un tableau que M. le duc et madame la duchesse d’Orléans lui envoient en signe d’admiration et de sympathie.
On s’occupe beaucoup de cette dédicace.—Peu de temps après, le gouvernement se voit forcé de faire un erratum,—un post-scriptum de pierre à son monument; il compulse ses états de service, s’agite, se remue, creuse ses archives, recueille ça et là les réclamations, et finit par inscrire soixante nouveaux noms sur l’arc de triomphe de l’Étoile. Il n’en oublie qu’un seul, le nom du général Hugo.
M. le maréchal Soult, président du conseil, a pourtant été le compagnon d’armes de M. le général Hugo!
Un ancien ministre reprochait à l’un des ministres actuels cette incroyable légèreté, et cette grave maladresse. «Que voulez-vous?—répondit le ministre en question, M. Victor Hugo n’a pas réclamé.»
Il est inutile de dire que le ministre capable d’une pareille réponse n’est ni M. Guizot, ni M. Villemain, qui sont les amis particuliers de M. Victor Hugo.
![]() De notre temps se sont réalisées ces paroles de l’Écriture: «Les
premiers seront les derniers.» Il y a une haine insatiable contre tout
ce qui est grand;—c’est de cette haine que se forme la ridicule et
fausse admiration pour tout ce qui est petit. Mais une chose doit
consoler les bons esprits,—c’est qu’à force d’élever les petites
choses,—on finira par les croire grandes, on les haïra comme telles, et
on les renversera pour remettre en place les grandes choses, si basses
aujourd’hui.
De notre temps se sont réalisées ces paroles de l’Écriture: «Les
premiers seront les derniers.» Il y a une haine insatiable contre tout
ce qui est grand;—c’est de cette haine que se forme la ridicule et
fausse admiration pour tout ce qui est petit. Mais une chose doit
consoler les bons esprits,—c’est qu’à force d’élever les petites
choses,—on finira par les croire grandes, on les haïra comme telles, et
on les renversera pour remettre en place les grandes choses, si basses
aujourd’hui.
![]() A nous deux, monsieur Aimé Martin!
A nous deux, monsieur Aimé Martin!
D’abord, monsieur Aimé Martin, ne me prenez pas pour un homme méchant et hargneux, et ne croyez pas que je déchaîne sur vous mes guêpes—au hasard et par malice. Vous m’avez attaqué et blessé, monsieur, dans un des livres que j’aime et dans les fleurs, que j’aime toutes. J’ai retenu si peu de choses pour ma part de celles qu’on se dispute dans la vie, que j’en suis horriblement avare,—et que je deviens féroce quand on y touche.
Un des plus beaux livres qui soient sortis de la cervelle humaine—est le livre des Maximes de la Rochefoucauld. Ce livre se compose d’une trentaine de pages;—c’est, sans contredit, celui de tous les livres qui renferme le moins de mots, mais c’est aussi celui de tous les livres qui renferme le plus de choses, c’est un livre qui dit la vérité sur tout.
Certes, si Dieu,—en un jour de colère, ou plutôt, de bonté, avait mis tous les livres et toutes les actions des hommes dans une immense cornue, et qu’il eût fait évaporer par la distillation tous les mensonges, tous les semblants, toutes les hypocrisies—on n’eût trouvé pour résidu au fond de l’alambic que les trente pages de la Rochefoucauld.
Le livre de la Rochefoucauld me raconte l’histoire publique et secrète de tous les temps et de tous les siècles,—l’histoire du passé et l’histoire de l’avenir.—Loin de m’irriter contre l’homme en me le dévoilant, il me rend au contraire bon et indulgent.
Il m’apprend à ne pas demander à la vie plus qu’elle ne contient, à ne pas attendre de l’homme plus qu’il ne possède. Les Samoyèdes, j’en suis sûr, ne ressentent qu’un médiocre chagrin de ne pas manger d’ananas;—je n’ai plus sujet d’en vouloir aux hommes de ce qu’ils n’exercent pas à mon bénéfice une foule de noms de vertus qui, en réalité, ne mûrissent pas dans leur cœur;—l’homme le plus laid du monde est au même point que la plus jolie fille du monde;—il suffit de bien établir qu’un pommier est un pommier pour qu’on renonce à la fantaisie de cueillir dessus des pêches; on s’arrange des pommes et on n’en veut pas au pommier.
Ce livre, M. Aimé Martin me l’a gâté.
![]() M. Aimé Martin a publié une édition de la Rochefoucauld.—La chose
commence par une préface beaucoup plus longue que tout le livre des
Maximes,—où ledit M. Aimé Martin établit sa prééminence,
incontestable à lui Aimé Martin, sur Marc-Aurèle et sur la
Rochefoucauld. Puis il s’emporte en une longue diatribe contre son
auteur,—puis il passe à l’examen critique des maximes. C’est, à vrai
dire, une chose curieuse par son excès. Il prend chaque maxime une à
une, et il met au-dessous toutes les vieilles rapsodies, toutes les
inepties, toutes les phrases vides et hypocrites,—tous les grands mots
creux, tous les lieux communs rapiécés, qui traînent depuis des siècles
dans les mauvais livres de cette vieille bavarde, menteuse, cohue de
prétendus moralistes qui n’ont plus aucun prétexte de vivre depuis
l’instant où la Rochefoucauld a taillé sa plume pour écrire le premier
mot de la première phrase de ses Maximes, c’est ce qu’il appelle
réfuter les maximes et leur fausse philosophie.
M. Aimé Martin a publié une édition de la Rochefoucauld.—La chose
commence par une préface beaucoup plus longue que tout le livre des
Maximes,—où ledit M. Aimé Martin établit sa prééminence,
incontestable à lui Aimé Martin, sur Marc-Aurèle et sur la
Rochefoucauld. Puis il s’emporte en une longue diatribe contre son
auteur,—puis il passe à l’examen critique des maximes. C’est, à vrai
dire, une chose curieuse par son excès. Il prend chaque maxime une à
une, et il met au-dessous toutes les vieilles rapsodies, toutes les
inepties, toutes les phrases vides et hypocrites,—tous les grands mots
creux, tous les lieux communs rapiécés, qui traînent depuis des siècles
dans les mauvais livres de cette vieille bavarde, menteuse, cohue de
prétendus moralistes qui n’ont plus aucun prétexte de vivre depuis
l’instant où la Rochefoucauld a taillé sa plume pour écrire le premier
mot de la première phrase de ses Maximes, c’est ce qu’il appelle
réfuter les maximes et leur fausse philosophie.
Je voudrais vous donner un spécimen de la manière de travailler de M. Aimé Martin;—mais le choix m’embarrasse, je prends au hasard:
«La constance des sages, dit la Rochefoucauld, n’est que l’art de renfermer leur agitation dans leur cœur.»
«Ainsi donc, s’écrie M. Aimé Martin, la sagesse n’est que de l’hypocrisie. Ainsi donc, etc., quelles seraient les conséquences, etc.?» La valeur de six pages de conséquences.
![]() «La philosophie, dit la Rochefoucauld, triomphe aisément des maux
passés et des maux à venir, mais les maux présents triomphent d’elle.»
«La philosophie, dit la Rochefoucauld, triomphe aisément des maux
passés et des maux à venir, mais les maux présents triomphent d’elle.»
«Anaxarque, répond M. Aimé Martin, Diogène, Épictète, Socrate, apprirent au monde, etc. La Rochefoucauld prétendrait-t-il nier ces grands exemples?» (Quatre pages.)
Le tout lardé des termes du plus profond mépris, de la plus vertueuse horreur pour la Rochefoucauld.—Le volume finit par un post-scriptum deux fois long comme le livre des Maximes, où M. Martin s’applaudit d’avoir écrasé son auteur et de l’avoir réduit à néant.
Certes, l’idée de M. Aimé Martin était dans son origine assez ingénieuse et assez sensée; il a compris que ce serait une bonne affaire que de s’accrocher à la Rochefoucauld—comme le gui au chêne,—de s’y cramponner des ongles et des dents, de telle sorte qu’on ne pût les séparer,—et d’obliger ainsi les lecteurs et les acheteurs à cette alternative, ou n’avoir pas la Rochefoucauld ou avoir M. Aimé Martin.
Ce résultat a été ce qu’il devait être,—quelque lourde, creuse, pommadée, que soit la prose de M. Aimé Martin, on aime encore mieux s’en charger que d’être privé des Maximes, et la spéculation a réussi à un certain point;—mais peut-être aurait-elle pu le faire également sans insulter un des plus grands génies que la France ait possédés.
Pour moi, je cherche en ce moment un exemplaire de la Rochefoucauld,—sans M. Aimé Martin.
Le résumé du travail susmentionné est que le livre de la Rochefoucauld est un livre absurde, immoral et ridicule.—J’ai pensé que la destruction de cet ouvrage laisserait dans les bibliothèques une lacune fâcheuse:—j’ai songé à la combler.—Il m’a semblé que la place abandonnée par la Rochefoucauld vaincu revenait de droit à M. Aimé Martin vainqueur, et j’ai énucléé de ses œuvres quelques maximes qui remplaceront celles qu’il a détruites d’une manière si triomphante.—MM. les imprimeurs peuvent affirmer que le manuscrit desdites pensées est formé de lignes imprimées coupées avec des ciseaux dans un ouvrage de M. Aimé Martin—et que ces maximes sont authentiques;—à la première réclamation d’un ayant droit, j’indiquerai le volume et la page de chacune.
PENSÉES ET MAXIMES
De M. Louis-Aimé Martin.
I. De tous les maux de la vie, l’absence est le plus douloureux.
II. Une jeune fille est une rose encore en bouton.
III. Heureux berger! vous pouvez danser dans la prairie, vous couronner des épis de Cérès, vous enivrer des dons de Bacchus.
IV. L’amour se plaît quelquefois à unir une timide bergère à un superbe guerrier.
V. Avant que le souffle de l’amour eût animé le monde, toutes les roses étaient blanches, et toutes les filles insensibles.
VI. Les personnes dédaigneuses sont pour la plupart exigeantes et peu aimables.
VII. Une jeune fille loin de sa mère est, au milieu du monde, comme une rose qui a perdu sa fraîcheur.
VIII. A son aspect (la luzerne), la génisse se réjouit; aimée de la brebis, elle fait les délices de la chèvre et la joie du cheval.
IX. IL Y A TOUT A GAGNER AVEC LA BONNE COMPAGNIE.
X. Nous quittons trop souvent un bonheur certain pour courir après de vains plaisirs qui fuient et s’envolent.
XI. Pour orner les leçons de la sagesse, souvent les muses ont emprunté une rose aux amours.
XII. La faiblesse plaît à la force, et souvent elle lui prête ses grâces.
XIII. Il faut à l’amour des ailes et un bandeau.
XIV. Il faut que l’amour dérobe tout à l’innocence, il méprise les dons volontaires.
Ah! mon Dieu! est-ce bien M. Louis-Aimé Martin qui dit cela? mais c’est horrible,—mais on ferait sur ces maximes un commentaire plus sérieux que celui qu’il a fait sur les maximes de la Rochefoucauld!—mais ce que M. Aimé Martin nous conseille là,—ce n’est ni plus ni moins que le viol!
Est-ce que ces maximes seraient moins innocentes que je ne l’avais cru d’abord?—je me rappelle le numéro III, qui renferme des tendances un peu bachiques.
Mais rassurez-vous, mères prudentes, qui songiez à mettre les maximes de M. Aimé Martin aux mains de vos filles,—ce n’est que par hasard qu’il s’échappe ainsi en pensées inquiétantes; les idées de M. Aimé Martin sur l’amour sont tout autres que celles que vous pourriez lui supposer d’après le numéro XIV.
M. Aimé Martin est partisan de l’amour platonique: «Les autres passions, dit-il, cherchent leurs jouissances dans les choses de la terre, le véritable amour ne s’attache qu’aux choses du ciel. Ce n’est pas la beauté physique qu’on aime, mais la douceur, la générosité, etc., ou quelques autres beautés morales.»
«Ce ne sont pas les plus belles femmes qui inspirent les plus grandes passions, mais celles qui possèdent les vertus dans un degré éminent, voilà ce qu’on aime.»
«Un demi-aveu enchante bien plus qu’une certitude entière.»
Il est évident que M. Aimé Martin parle de l’amour comme les anciens acteurs tyrannisés par l’Opéra,—qui récitaient leurs rôles dans la coulisse et laissaient faire les gestes à d’autres.
Voici ce que m’a fait M. Aimé Martin relativement à la Rochefoucauld. Je vous dirai une autre fois ce qu’il m’a fait relativement aux fleurs.
M. Louis-Aimé Martin se présente pour un des fauteuils vacants à l’Académie française.
Les bals de l’Opéra.—Une rupture.—M. Thiers et les Guêpes.—Le bal du duc d’Orléans.—Plusieurs adultères.—Grosse scélérate.—Une gamine.—Sur quelques Nisards (suite).—Les capacités.—M. Ducos.—M. Pelletier-Dulas.—A. M. Guizot.—L’acarus du pouvoir.—Grattez-vous.—M. Ballanche.—M. de Vigny.—M. Vatout.—M. Patin.—Le droit de visite.—M. de Salvandy et M. de Lamartine.—Les chaises du jardin des Tuileries.—Une prompte fuite à Waterloo.—Le capitaine Bonardin.—M. Gannal au beurre d’anchois.—A. M. E. de Girardin.—M. Dumas.—M. Ballanche.—M. Pasquier.—M. Dubignac.
![]() Les bals de l’Opéra ont fini par se moraliser, et cela d’une
singulière manière;—ils sont arrivés à un point de sans-façon tel,
qu’une femme comme il faut ne peut plus trouver aucun prétexte pour s’y
faire conduire.
Les bals de l’Opéra ont fini par se moraliser, et cela d’une
singulière manière;—ils sont arrivés à un point de sans-façon tel,
qu’une femme comme il faut ne peut plus trouver aucun prétexte pour s’y
faire conduire.
C’est du reste une époque qui sert de raison à bien des brouilles.—Nous avons parlé l’année dernière d’une femme qui avait chassé son amant pendant le carême, et en avait repris un autre pour obéir à cet usage populaire qui veut qu’on ait quelque chose de neuf à Pâques.—Cette année, madame *** a écrit au sien, qu’elle soupçonnait d’une infidélité:
«Certainement ce n’est pas contre vous que je suis irritée, mais bien contre celle qui a accepté votre hommage: vous n’avez ni figure ni esprit, et la femme qui vous prend pour amant ne peut avoir eu pour but que de me contrarier.»
![]() M. THIERS ET LES GUÊPES.—Le dernier numéro des Guêpes a paru le
1er février; le 5 du même mois, M. Thiers portait au bal de M. le duc
d’Orléans l’habit de membre de l’Institut,—absolument comme le général
Bonaparte à son retour d’Égypte. On ne saurait mieux ni plus vite
profiter d’un bon avis.
M. THIERS ET LES GUÊPES.—Le dernier numéro des Guêpes a paru le
1er février; le 5 du même mois, M. Thiers portait au bal de M. le duc
d’Orléans l’habit de membre de l’Institut,—absolument comme le général
Bonaparte à son retour d’Égypte. On ne saurait mieux ni plus vite
profiter d’un bon avis.
Tous les morceaux de papier imprimé ont donné, sous le bon plaisir de leurs imprimeurs respectifs, des détails plus ou moins circonstanciés, plus ou moins apocryphes, sur le bal des Tuileries;—l’ensemble était riche et piquant;—on a critiqué avec raison le quadrille des bergères;—toutes les bergères étaient vêtues en rose et tous les bergers en bleu, je crois. Il eût été bien plus vrai et bien plus charmant de donner à chaque couple une couleur particulière,—ainsi qu’on le voit dans les bons Vatteau. Chaque bergère doit avoir son berger vêtu de sa couleur.—Il aurait dû y avoir un couple rose, un autre tourterelle, un autre gris-de-la-reine, etc., etc.
![]() M. Hugo avait le costume de membre de l’Institut,—habit aussi
glorieux pour les combats qu’il a livrés pour l’obtenir que par la
grandeur de la chose elle-même,—habit qui faisait allusion à la peau du
lion dont se couvrait Alcide;—il causait fort galamment avec la belle
madame de ***, il se livrait aux madrigaux et aux concettis les plus
rocailles.
M. Hugo avait le costume de membre de l’Institut,—habit aussi
glorieux pour les combats qu’il a livrés pour l’obtenir que par la
grandeur de la chose elle-même,—habit qui faisait allusion à la peau du
lion dont se couvrait Alcide;—il causait fort galamment avec la belle
madame de ***, il se livrait aux madrigaux et aux concettis les plus
rocailles.
—Vraiment, lui dit madame de ***, votre esprit complète pour moi l’illusion, il semble que nous soyons à une des belles nuits de Versailles.
—Madame, répondit l’académicien, il me manque pour cela bien des choses:—tenez, par exemple,—un costume d’abbé,—la poudre, le petit collet, le rabat et une rose à la main.
![]() QUE LE VRAI N’EST PRESQUE JAMAIS VRAISEMBLABLE.—Quand un pauvre
romancier veut mettre en scène une femme adultère, il se creuse la
cervelle pour orner de fleurs,—adoucir et rendre insensible la pente
qui conduit une femme, une épouse, une mère, du milieu des vertus
domestiques—à l’oubli de tous ses devoirs.
QUE LE VRAI N’EST PRESQUE JAMAIS VRAISEMBLABLE.—Quand un pauvre
romancier veut mettre en scène une femme adultère, il se creuse la
cervelle pour orner de fleurs,—adoucir et rendre insensible la pente
qui conduit une femme, une épouse, une mère, du milieu des vertus
domestiques—à l’oubli de tous ses devoirs.
Le vrai, le réel, ne se donnent pas tant de peine;—il semble que la plupart des femmes qui trompent leur mari ne sont nullement abusées, aveuglées, etc., etc.;—qu’elles trahissent la foi conjugale, tout simplement parce qu’il leur plaît de trahir la foi conjugale;—car les amants que la vengeance des maris produit au grand jour de la police correctionnelle ne paraissent d’ordinaire, ni par les agréments de leur personne, ni par l’astuce de leurs moyens, justifier ni même expliquer ce qu’on appelle un entraînement.
Il y a dans un adultère beaucoup plus de haine contre le mari que d’amour pour l’amant,—qui n’est, le plus souvent, qu’un élément désagréable, mais malheureusement nécessaire d’un crime qu’on est décidé à commettre.
Quelques procès récents viennent à l’appui de ce que nous avançons.
Le jeune Charles *** est traîné devant les juges par un époux justement irrité;—ledit époux a des preuves accablantes,—il a trouvé la correspondance.
(Les amoureux sont comme les conspirateurs, ils se donnent une peine incroyable pour fabriquer des preuves contre eux. Dans tous les procès en adultère,—on trouve des correspondances. Dernièrement, M. D***, ancien notaire, qui, surprenant sa femme en flagrant délit, s’est contenté de faire signer au docteur R..., son complice, une lettre de change de soixante mille francs,—avait découvert la correspondance,—où?—sur le parquet de son salon.)
Dans l’affaire du jeune Charles ***, le ministère public s’est élevé avec force contre le séducteur qui, par des manœuvres coupables, un art perfide, avait détourné de ses devoirs les plus sacrés une femme jusque-là pure et innocente:—à l’appui de sa vertueuse indignation, il lisait une lettre où on remarquait ce passage:
«Penses-tu un peu à moi? Combien fais-tu de toilettes par jour? Mais écris-moi donc tout cela, GROSSE SCÉLÉRATE.»
En effet, comme dit M. le procureur du roi, résistez donc à cela;—on comprend qu’une mère de famille, une femme honnête et distinguée, risque tout et perde tout—pour recevoir de semblables lettres.
Nous appelons sur ce sujet l’attention des femmes adultères ou sur le point de le devenir.—Certes, pour un semblable usage,—pour s’entendre appeler grosse scélérate, un mari est bien suffisant, et on peut se dispenser de prendre un amant.
Voici un autre exemple que nous tirons des mœurs de magasin:
Un marchand aime la femme d’un autre marchand, son voisin, le sieur D***.
Une première fois, M. D*** surprend une correspondance coupable,—il pardonne.
Mais, une seconde fois, il s’irrite, fait incarcérer sa femme et son complice, et demande judiciairement à ce dernier quarante mille francs de dommages-intérêts, somme à laquelle il évalue les avaries et dégâts causés dans son honneur.—Débat devant la... je ne sais combienme chambre,—comme d’usage, M. D*** produit les lettres.
Une de ces lettres, que nous allons citer textuellement,—est écrite par le marchand amoureux à l’objet criminel de sa flamme adultère,—tout simplement sur une de ses factures, laquelle porte au tiers de la page son nom, sa profession, son adresse.
N*** TIENT MAGASIN ET ASSORTIMENT
DE COUVERTURES
de laines de toutes qualités,
MÉRINOS, SOLOGNE et AUTRES;
Il remet les vieilles à neuf,
Rue ***, nº ***, Paris.
N. B. Autrefois les amoureux appelaient leur maîtresse leur dame ou leur souveraine,—et s’intitulaient leur chevalier ou leur esclave.
M. N*** appelle celle qu’il aime sa gamine, et se donne à lui-même le titre de gamin.—Mais quels sont les amoureux qui seraient charmés de voir imprimés les jolis noms qu’ils ont donnés et reçus?
L’individu, c’est le mari.
Voici la lettre.
«A ma meilleure amie, mon ange idolâtré du plus sincère des amis jusqu’au tombeau, plutôt mourir que de vivre sans Éléonore. Jurement indissoluble, ton gamin ne peut vivre plus longtemps sans te voir; je suis bani de ta maison. J’ai reçu une lettre de l’individu. Je lui ai répondu. Mais, comme je mettais bien des civilités respectueuses pour toi, il n’aura pas manqué de déchirer la lettre en fronsant le sourcil. Ah! ma pauvre gamine, supportent avec courage tes
N*** TIENT MAGASIN ET ASSORTIMENT
DE COUVERTURES
de laines de toutes qualités,
MÉRINOS, SOLOGNE et AUTRES;
Il remet les vieilles à neuf,
Rue ***, nº ***, Paris.
maux, ayant devant nous un chemin qui nous conduira où nos cœurs haspirent. Ah! mon idole, quand tu entends monter des sabots, c’est dit, il n’y a pas moyen de presser la main de ma gamine sur mon cœur, car c’est les sabots de l’individu. Je redoulte l’individu. Tâche, lorsque je passerai et que je pourrai monter, de ne faire qu’un signe de tête en la baissant pour le oui, et en la tournant pour le non. Quand nous sommes ensemble, c’est tant de pris sur l’ennemi. Mais, comme dit le proverbe, un bon os tombe toujours à un mauvais chien. O bonne amie! nos cœurs ne demandent qu’à prendre leur volé, il y a des hommes comme le tient, par exemple, qui regardent leur femme comme leur pissalé.
«Adieu, chère trésore, reçois les serment inextinguibles à la vie à la mort de ton ami. J’ai tant lu et baisé ma lettre, qu’elle est salle. Reçois-la avec ton indulgence et ta bonté accoutumez. Vaincre ou mourir!»
![]() SUR QUELQUES NISARDS[C] (suite).—Voici une note qui a paru ces
jours-ci dans les journaux:
SUR QUELQUES NISARDS[C] (suite).—Voici une note qui a paru ces
jours-ci dans les journaux:
«M. CHARLES Nisard, auteur des traductions de, etc., etc., et particulièrement des discours de Cicéron qu’il a épurés d’après une méthode nouvelle, vient de traduire en dernier, et a eu l’honneur de présenter à S. A. R. le duc d’Aumale, les Histoires philippiques de Justin. Son Altesse Royale a bien voulu encourager le traducteur dans l’étude de ces écrivains sérieux qui seront toujours les éternels modèles de tous les littérateurs.»
Il faut savoir gré au jeune prince, qui, ayant sans doute remarqué que M. Désiré Nisard et M. Auguste Nisard se sont donné la mission de dépecer les vivants, a pensé à garantir les contemporains de ce troisième Nisard, et tâché de l’amener par des gracieusetés à se contenter d’écorcher les morts; mais les critiques sont comme les médecins, leur travail sur le cadavre n’est qu’une étude préparatoire.
![]() SUR LES CAPACITÉS.—M. Ducos a présenté à la Chambre une
proposition ayant pour but d’admettre les capacités dans son sein.
SUR LES CAPACITÉS.—M. Ducos a présenté à la Chambre une
proposition ayant pour but d’admettre les capacités dans son sein.
Les discours qui ont été prononcés en faveur de la proposition ne pouvaient être agréables à la Chambre;—en effet, ils peuvent tous se résumer par cette phrase:
«Il est temps d’appeler l’intelligence au pouvoir. Je demande à MM. les députés qu’ils reconnaissent et certifient par un vote solennel, que le système électoral actuel n’envoie à la Chambre que des buses et des oisons.»
Le plus grand nombre des députés a refusé de faire cette profession de foi humiliante.
Je dois dire à mes lecteurs ce que ce serait que l’adjonction des capacités.
Au premier abord et en théorie, il n’y a pas un seul argument raisonnable contre cette proposition: appeler au pouvoir les hommes d’intelligence! Qui osera faire une objection? Il faudra seulement, pour l’honneur de la France,—faire un carton au Moniteur,—antidater et intercaler cette loi pour la mettre au premier jour du gouvernement représentatif,—afin que la postérité ne croie pas que la France a hésité vingt-cinq ans sur ce sujet; je dirai plus,—toujours en théorie et au premier abord,—ce n’est pas assez d’admettre le sens à partager les honneurs du cens,—il faut se dépêcher de substituer entièrement le premier au second.
Quelles seront vos bases pour reconnaître l’intelligence et la capacité? Quels seront les juges et les électeurs? Pourrez-vous garder encore pour électeurs des gens qui ne seront pas éligibles? Puisque tout homme intelligent et capable sera éligible, les électeurs, c’est-à-dire ceux qui ne seront ni capables ni intelligents, seront des juges médiocres pour apprécier l’intelligence et la capacité des autres. Il faudra abolir l’élection de bas en haut.
Si vous lui substituez l’élection de haut en bas,—quels seront alors les juges? C’est un sentier qui vous conduit à l’arbitraire ou gouvernement absolu et nullement représentatif.
On peut prouver qu’on paye le cens d’éligibilité;—mais il est difficile de prouver sans réplique qu’on est un homme capable.
Vous pouvez dire à un homme: «Monsieur, vous ne payez pas cinq cents francs de contributions.»
Ou bien, comme on a dit dans le temps à M. Pelletier-Dulas: «Monsieur, il s’en faut de trente-quatre sous que vous payiez le cens.»
Et M. Lepelletier ou Pelletier-Dulas s’en est retourné avec ses pareils,—c’est-à-dire avec ceux qui payent trente-quatre sous de moins que M. Ganneron.
Et, s’il a tenu à faire des discours,—il n’a eu d’autres ressources,—ainsi que je le lui ai conseillé dans le temps,—que de se faire philanthrope,—agronome, membre d’une Académie pour l’éducation des vers à soie, ou du comité des prisons, etc.,—toutes ces choses qui, sous divers prétextes, n’ont qu’un seul et même but, qui est de monter sur quelque chose et de faire des discours sur n’importe quoi!
Mais prenez dans l’intelligence de M. Ganneron une fraction équivalente à trente-quatre sous dans le cens d’éligibilité, et osez dire à M. Pelletier-Dulas: «Monsieur, vous êtes moins intelligent de cela que M. Ganneron.»
Qui est-ce qui se chargera de cette commission?—Ce n’est pas moi,—car le M. Pelletier-Dulas, auquel on adresserait ce compliment, pourrait le trouver mauvais et me faire un mauvais parti.
Voulez-vous seulement (et c’était ce qu’on demandait) admettre les capacités et l’intelligence parmi les électeurs? Quel sera le rôle des éligibles? Dans quelle position secondaire les placez-vous? L’intelligence par votre vote sera déclarée valoir deux cents francs,—mais pas un sou de plus.
Et puis encore le même inconvénient: comment dresserez-vous vos listes?
Quand on dit à un commis: «Monsieur, d’où vient que je ne suis pas sur la liste électorale?» il vous répond: «Monsieur, c’est que vous ne payez pas le cens.»
Vous n’avez pas le moindre prétexte de vous fâcher,—et d’ailleurs, vous avez, pour consolation, des phrases toutes faites contre l’argent et les richesses,—et vous dites: «J.-J. Rousseau n’aurait pas été électeur,—je suis comme J.-J. Rousseau.»
Mais, si vous admettez le sens au lieu du cens, ou si vous admettez l’un avec l’autre, la chose change de face.
Le commis vous répond d’abord: «Monsieur, c’est que vous ne payez pas le cens.»
Vous répliquez: «Parbleu, monsieur,—mais ce n’est pas à ce titre.
—Monsieur, répond alors le commis, c’est que...»
De quelque euphémisme que s’avise le commis pour dire: «Vous n’êtes pas électeur,» il est impossible qu’on ne lui réponde pas: «Imbécile vous-même,» car sa réponse négative ne veut pas dire autre chose.
Et, c’est alors que vous verriez bien d’autres réclamations encore dans les journaux.
C’est alors qu’on lirait:—«Notre grand Aristide Bachault n’a pas été inscrit sur les listes électorales,—c’est ainsi que les gens qui nous gouvernent répudient toutes nos gloires! etc., etc.»
On constate facilement qu’un homme a cessé de payer le cens; mais comment constater d’une année à l’autre qu’il est devenu un peu plus bête, et comment surtout le lui faire comprendre et admettre?
«Mais, dit M. Ducos en m’interrompant, j’ai prévu toutes ces objections,—je fais représenter l’intelligence par la seconde liste du jury,—par les médecins, les avocats, etc., etc.»
Oh! oh! monsieur Ducos, les médecins! votre proposition est donc bien malade! les avocats,—n’en avez-vous donc pas assez à la Chambre, bon Dieu! et qu’en voulez-vous faire? ou plutôt, que voulez-vous qu’ils fassent de vous et de nous?
M. Ducos ne fait pas semblant d’entendre ce lazzi d’un goût médiocre, et il continue:
«Les citoyens qui ont assez de lumières pour décider, comme jurés, de la vie, de la fortune et de l’honneur de leurs compatriotes, n’en ont-ils pas assez?.....»
Pardon, monsieur Ducos, et qui vous dit qu’ils en ont assez pour décider de l’honneur et de la vie de leurs compatriotes?
Et d’ailleurs, l’intelligence, reconnue seulement dans certaines professions, n’est-ce pas encore un mensonge, et un faux semblant, et un privilége absurde?
Prenez garde à votre édifice de gouvernement représentatif; il est,—comme disent les maçons, soufflé;—n’y mettez pas trop la truelle pour le réparer, parce qu’il tombera sur vous.
Les institutions politiques sont comme les vieux chênes,—elles se creusent au dedans, et il vient un moment où elles ont encore la forme, l’écorce et l’apparence, un moment où elles sont debout,—et où il ne faut pas grand’chose pour les abattre.
![]() Si vous vouliez appeler réellement l’intelligence au pouvoir,—il
ne faudrait pas seulement que les hommes intelligents fussent électeurs,
il faudrait qu’ils fussent éligibles, et qu’ils le fussent seuls.—Je
viens de vous dire ce que vous auriez d’impossibilités dans
l’application.
Si vous vouliez appeler réellement l’intelligence au pouvoir,—il
ne faudrait pas seulement que les hommes intelligents fussent électeurs,
il faudrait qu’ils fussent éligibles, et qu’ils le fussent seuls.—Je
viens de vous dire ce que vous auriez d’impossibilités dans
l’application.
![]() A. M. GUIZOT.—M. Guizot a dit dans le débat relatif à la
proposition Ducos: «Ce n’est pas un besoin réel du pays de se mêler
ainsi aux affaires publiques, c’est une certaine démangeaison, une
maladie de la peau.» L’histoire naturelle devra à M. Guizot la
découverte de l’acarus de l’ambition,—qu’elle rangera à la suite de
l’acarus de la gale.
A. M. GUIZOT.—M. Guizot a dit dans le débat relatif à la
proposition Ducos: «Ce n’est pas un besoin réel du pays de se mêler
ainsi aux affaires publiques, c’est une certaine démangeaison, une
maladie de la peau.» L’histoire naturelle devra à M. Guizot la
découverte de l’acarus de l’ambition,—qu’elle rangera à la suite de
l’acarus de la gale.
M. de Lamartine, qui soutenait l’adjonction des capacités, parce qu’en effet il n’y a pas, en théorie, d’objection possible,—a trouvé peu parlementaire cette façon de dire à ses adversaires: Vous êtes des galeux, grattez-vous les uns les autres et laissez-nous tranquilles;» et il a dit en parlant de M. Guizot: «Je ne répéterai pas l’expression dont s’est servi M. le ministre.»
Je répondrai, moi, à M. Guizot: «Monsieur, vous avez parfaitement raison, c’est une démangeaison qu’ont aujourd’hui toutes les classes de la société;—mais vous l’avez eue aussi cette démangeaison, et vous vous êtes fait gratter par ces mêmes gens qui veulent que vous les grattiez aujourd’hui qu’ils ont gagné votre acarus en vous grattant.»
Sérieusement,—si les gens ont cette démangeaison, c’est vous autres, aujourd’hui au pouvoir, qui la leur avez donnée en les chatouillant pendant quinze ans.
![]() L’élection de M. Ballanche a présenté un singulier hasard; les
candidats étaient M. Ballanche, M. de Vigny, M. Vatout, M. Patin. M. de
Barante a tiré les noms de l’urne, et ils sortis dans l’ordre que voici:
L’élection de M. Ballanche a présenté un singulier hasard; les
candidats étaient M. Ballanche, M. de Vigny, M. Vatout, M. Patin. M. de
Barante a tiré les noms de l’urne, et ils sortis dans l’ordre que voici:
![]() Voici une affaire qui fait bien du bruit à la Chambre et dans les
journaux, et qui me paraît la plus simple du monde.
Voici une affaire qui fait bien du bruit à la Chambre et dans les
journaux, et qui me paraît la plus simple du monde.
Il s’agit du droit mutuel que s’accorderaient la France et l’Angleterre,—pour les croiseurs des deux nations, de visiter les vaisseaux de l’une et de l’autre.
Cette convention a pour prétexte d’empêcher la traite des nègres.
1º On n’empêchera pas la traite tant qu’on n’aura pas aboli l’esclavage,—et ceci n’est pas une petite question,—si ce n’est pour les philanthropes qui ne voient aucune difficulté à affranchir les nègres des autres. Le prix des esclaves augmente au moins à proportion des risques.
2º Si la France ne fait pas la traite,—c’est qu’elle ne veut pas la faire;—elle n’a pas besoin que l’Angleterre l’aide à faire la police de ses vaisseaux.
3º Permettre la visite, c’est admettre que la France ne fait pas la traite parce que l’Angleterre ne le veut pas.
4º Ce serait tout simplement une lâcheté.
![]() On lit dans les journaux:
On lit dans les journaux:
«Le ministre de la marine a alloué aux auteurs de divers faits de sauvetage, des gratifications montant, en totalité! à neuf cents francs.
Le pouvoir ne veut pas ôter à la vertu et au courage le mérite du désintéressement.
La totalité de ces récompenses serait loin de satisfaire la plus modérée des corruptions pendant trois mois.
![]() Notre âge aura dans l’histoire un éclat tout particulier. A toutes
les époques on a dit et fait des sottises;—mais le temps et l’oubli en
effaçaient le plus grand nombre. Aujourd’hui, on écrit, on imprime, on
enregistre tout, et ceux qui viendront après nous nous prendront pour
une génération d’insensés.
Notre âge aura dans l’histoire un éclat tout particulier. A toutes
les époques on a dit et fait des sottises;—mais le temps et l’oubli en
effaçaient le plus grand nombre. Aujourd’hui, on écrit, on imprime, on
enregistre tout, et ceux qui viendront après nous nous prendront pour
une génération d’insensés.
![]() L’ambassade de M. de Salvandy a duré une semaine; à son retour,
il parut à la Chambre.—La première personne qu’il rencontra fut M. de
Lamartine. M. de Lamartine va à lui: «Ah! vous voilà, mon cher Salvandy!
comment allez-vous?»
L’ambassade de M. de Salvandy a duré une semaine; à son retour,
il parut à la Chambre.—La première personne qu’il rencontra fut M. de
Lamartine. M. de Lamartine va à lui: «Ah! vous voilà, mon cher Salvandy!
comment allez-vous?»
M. de Salvandy s’apprête à répondre agréablement. M. de Lamartine, qui est la politesse et l’aménité même, l’interrompt cependant et lui dit d’un air distrait: «Eh bien! avez-vous fait un bon voyage... physiquement?»
Physiquement voulait si bien dire: Bien entendu, qu’en homme bien élevé je ne vous parle pas de votre voyage sous le rapport politique,—que M. de Salvandy en fut un moment embarrassé; et M. de Lamartine, voyant son embarras,—était prêt d’en avoir plus que lui.
![]() D’où venez-vous, Grimalkin, et dans quelle fleur déjà ouverte vous
êtes-vous vautrée que vous m’arrivez toute jaune de pollen?
D’où venez-vous, Grimalkin, et dans quelle fleur déjà ouverte vous
êtes-vous vautrée que vous m’arrivez toute jaune de pollen?
Il n’y a au jardin que des primevères,—des violettes et des perce-neige, et le colicothus.
Ah! je devine;—j’ai vu en me promenant tout à l’heure les noisetiers qui sont déjà couverts de leurs fleurs mâles et femelles;—les fleurs femelles sont un petit pinceau du plus beau pourpre, les fleurs mâles semblent des chenilles couvertes d’une poussière jaune.—Vous venez des coudriers.—Pourquoi paraissez-vous si pressée?
—Maître,—dit Grimalkin,—c’est que j’ai quelque chose à dire sur les Tuileries.
Voici ce que m’a rapporté Grimalkin:
«Le jardin des Tuileries est un jardin royal; comment se fait-il qu’on y paye les chaises; ne serait-il pas convenable qu’on pût s’y asseoir gratuitement?—Est-il royal de donner à bail,—à des vieilles femmes à châles bruns,—les chaises du jardin des Tuileries,—et le roi doit-il tirer un bénéfice des gens qu’il laisse entrer chez lui?
«Les bancs de pierre et de bois,—qui du reste sont fort rares,—ne sont occupés que par les bonnes d’enfants,—parce que s’asseoir sur un banc gratuit,—quand il y a des chaises qui se payent,—c’est avouer qu’on n’a pas deux sous ou qu’on les destine à un autre usage.»
—Grimalkin,—vous avez raison;—retournez à vos noisetiers.
![]() On m’écrit: «Monsieur, je vois, dans vos Guêpes du mois dernier,
que le duc d’Orléans n’a remis que deux cents francs pour être partagés
entre les veuves des malheureux Layec et Hervé, victimes de leur noble
dévouement lors du naufrage dans la Méditerranée du brick la
Picardie.—Ajoutez, monsieur, que le roi a envoyé quatre mille cinq
cents francs.»
On m’écrit: «Monsieur, je vois, dans vos Guêpes du mois dernier,
que le duc d’Orléans n’a remis que deux cents francs pour être partagés
entre les veuves des malheureux Layec et Hervé, victimes de leur noble
dévouement lors du naufrage dans la Méditerranée du brick la
Picardie.—Ajoutez, monsieur, que le roi a envoyé quatre mille cinq
cents francs.»
Allons, allons,—cela me rend un peu plus indulgent pour les chaises du jardin des Tuileries.—Néanmoins, mon observation subsiste.
![]() A la bataille de Waterloo, vers la fin de la journée, un régiment
français fut forcé de mettre bas les armes. Un officier, nommé
Bonnardin, fut comme les autres emmené au bivac,—ou plutôt emporté, car
il était grièvement blessé et évanoui.—En reprenant ses sens, il se
trouva comme de raison complètement dépouillé; mais ce qui le mit au
désespoir, ce fut de voir qu’une croix, qui lui avait été donnée par
l’empereur à Wagram, était devenue la proie des lanciers anglais.—Il
s’adressa à un officier, et le supplia, les larmes aux yeux, de la lui
faire restituer. L’officier prit son nom et lui donna sa parole de
gentilhomme qu’il ferait toutes les recherches nécessaires.
A la bataille de Waterloo, vers la fin de la journée, un régiment
français fut forcé de mettre bas les armes. Un officier, nommé
Bonnardin, fut comme les autres emmené au bivac,—ou plutôt emporté, car
il était grièvement blessé et évanoui.—En reprenant ses sens, il se
trouva comme de raison complètement dépouillé; mais ce qui le mit au
désespoir, ce fut de voir qu’une croix, qui lui avait été donnée par
l’empereur à Wagram, était devenue la proie des lanciers anglais.—Il
s’adressa à un officier, et le supplia, les larmes aux yeux, de la lui
faire restituer. L’officier prit son nom et lui donna sa parole de
gentilhomme qu’il ferait toutes les recherches nécessaires.
Le pauvre Bonnardin alla comme tant d’autres souffrir sur les pontons; puis, à la paix, il rentra en France.—Mais, quoiqu’il n’eût plus que quelques années de service à faire pour obtenir sa retraite, il refusa de prendre du service sous les Bourbons.
Lorsqu’en 1830—il revit le drapeau tricolore, il pensa à gagner sa retraite;—quelques affaires, un voyage, une maladie, retardèrent ce projet de plusieurs années; enfin, il y a un an,—il entra comme capitaine dans un régiment (le 41e, je crois). Il n’y avait que peu de temps qu’il avait repris son ancien métier, lorsqu’il reçut de Londres une lettre ainsi conçue:
«Monsieur, il y a vingt-trois ans que j’achète tous les ans et que je lis avec la plus complète attention l’Annuaire militaire de France—pour y découvrir le nom de Bonnardin.—Êtes-vous le Bonnardin auquel un officier anglais fit une promesse solennelle après la bataille de Waterloo? Si c’est vous, faites-le-moi savoir et donnez-m’en la preuve: il y a vingt-trois ans que je suis en mesure de remplir ma promesse;—si ce n’est pas vous, je me remettrai à lire l’Annuaire.»
Le bon capitaine répond en toute hâte, et quelques jours après reçoit par l’ambassade anglaise—le don regretté de l’empereur Napoléon.
![]() LES SAVANTS SOUS LA HAUTE SURVEILLANCE DES GUÊPES.—En général, je
ne suis pas partisan de l’embaumement mis à la portée de tout le
monde.—Si l’on réfléchit que sur la surface de la terre il meurt un
homme par seconde, c’est-à-dire à chaque battement de pouls; si l’on
songe que cette terre, sur laquelle nous vivons, est tout entière formée
de la poussière humaine,—il deviendrait vite difficile de savoir où
mettre les morts,—ou du moins où mettre les vivants, qui, eux, ne sont
pas embaumés.
LES SAVANTS SOUS LA HAUTE SURVEILLANCE DES GUÊPES.—En général, je
ne suis pas partisan de l’embaumement mis à la portée de tout le
monde.—Si l’on réfléchit que sur la surface de la terre il meurt un
homme par seconde, c’est-à-dire à chaque battement de pouls; si l’on
songe que cette terre, sur laquelle nous vivons, est tout entière formée
de la poussière humaine,—il deviendrait vite difficile de savoir où
mettre les morts,—ou du moins où mettre les vivants, qui, eux, ne sont
pas embaumés.
A quoi a-t-il servi à cinq pharaons d’Égypte, un peu avariés, du musée Charles X, d’avoir été embaumés en leur temps?—Ils ont été jetés sur la place du Louvre à la révolution de 1830, et ensuite enterrés sous la colonne comme héros de Juillet.
![]() Les enfants conserveraient leur père.—Très-bien.—Les
petits-enfants conserveraient leur père et leur grand-père,—mais la
troisième génération serait encombrée.—Les administrations des
cimetières n’accepteraient pas les morts embaumés aux fosses
communes,—parce que le temps pendant lequel ils doivent occuper la
terre,—qui ne leur est que louée, est prévu;—le temps après lequel ils
doivent avoir divisé leurs molécules entre les éléments entre en ligne
de compte:—les cimetières seraient trop petits.
Les enfants conserveraient leur père.—Très-bien.—Les
petits-enfants conserveraient leur père et leur grand-père,—mais la
troisième génération serait encombrée.—Les administrations des
cimetières n’accepteraient pas les morts embaumés aux fosses
communes,—parce que le temps pendant lequel ils doivent occuper la
terre,—qui ne leur est que louée, est prévu;—le temps après lequel ils
doivent avoir divisé leurs molécules entre les éléments entre en ligne
de compte:—les cimetières seraient trop petits.
![]() D’ailleurs, pour les idées pieuses attachées à la mort de ceux que
l’on a aimés,—tant que le corps garde la forme, l’imagination ne voit
qu’un cadavre sous la terre;—quand il n’en reste plus rien,—elle songe
à une âme dans le ciel.
D’ailleurs, pour les idées pieuses attachées à la mort de ceux que
l’on a aimés,—tant que le corps garde la forme, l’imagination ne voit
qu’un cadavre sous la terre;—quand il n’en reste plus rien,—elle songe
à une âme dans le ciel.
Aussi les anciens avaient-ils bien raison de brûler leurs morts.—Il n’y avait pas dans un sentiment pieux un mélange de dégoût dont on ne peut se défendre—pour un mort enterré.
Mais voici quelque chose de plus dangereux.—On lit dans un journal de Nantes, du 16 février:
»Jeudi dernier, 12 février, M. Cornillier a fait une expérience publique du procédé Gannal. MM. le commissaire général et le directeur des subsistances de la marine, le directeur et l’inspecteur des douanes, le sous-intendant militaire, plusieurs de MM. les membres de la chambre de commerce et M. Guépin, docteur-médecin, étaient présents.
«M. Cornillier leur a montré du mouton conservé depuis deux mois, qui avait l’aspect de viande fraîche.»
Je déclare qu’à compter de ce jour—je perds toute confiance à l’égard de la viande. A quelles côtelettes se fier, bon Dieu!—Un homme de trente ans ne sera pas assuré contre la chance de manger un bifteck plus âgé que lui,—ou recevra en héritage un pot-au-feu octogénaire et patrimonial,—resté de père en fils dans la famille;—les gigots seront des momies, et nous aurons, au lieu de côtelettes panées, des côtelettes empaillées.
Horace dit à Mécènes: «Nous boirons d’un vin mis en pot—le jour où le peuple salua par trois fois Mécènes, chevalier, à son entrée au théâtre.»
Dans vingt ans d’ici, un poëte de ceux qui tettent aujourd’hui, écrira, non pas à M. Mécènes,—les Mécènes aujourd’hui coûtent trop cher et minent les poëtes,—mais à un simple ami: «Viens manger des côtelettes d’un mouton tué le jour où M. Pasquier fut élu membre de l’Académie française.»
![]() Je m’élève contre l’embaumement de la viande de la boucherie.—Les
bœufs de Poissy ne doivent pas être traités comme le bœuf Apis,
parce que celui-là on ne le mangeait pas. Et puis, à force d’embaumer
et d’empailler tout le monde,—les pharaons, les doyens, les bourgeois,
les moutons, les gardes nationaux,—il se mettra dans la boucherie une
confusion fâcheuse.—Je ne veux pas être exposé à manger un jour, au
café de Paris, M. Gannal au beurre d’anchois.
Je m’élève contre l’embaumement de la viande de la boucherie.—Les
bœufs de Poissy ne doivent pas être traités comme le bœuf Apis,
parce que celui-là on ne le mangeait pas. Et puis, à force d’embaumer
et d’empailler tout le monde,—les pharaons, les doyens, les bourgeois,
les moutons, les gardes nationaux,—il se mettra dans la boucherie une
confusion fâcheuse.—Je ne veux pas être exposé à manger un jour, au
café de Paris, M. Gannal au beurre d’anchois.
![]() J’ai donné place de si bonne grâce aux réclamations, qu’on ne me
saura pas mauvais gré d’en faire une moi-même,—et je l’adresse à M.
Émile de Girardin, qui, j’en suis convaincu, aura la loyauté de la
mettre dans la Presse,—autrement ce serait imiter ce prédicateur,
qui, voulant réfuter les doctrines de Rousseau, adressait ses objections
foudroyantes à son propre bonnet placé sur le bord de sa
chaire,—sommait ledit bonnet de répondre;—et après quelques instants,
disait: «Tu ne réponds pas, philosophe de Genève, donc tu es convaincu
sur ce point.—Passons à un autre.»
J’ai donné place de si bonne grâce aux réclamations, qu’on ne me
saura pas mauvais gré d’en faire une moi-même,—et je l’adresse à M.
Émile de Girardin, qui, j’en suis convaincu, aura la loyauté de la
mettre dans la Presse,—autrement ce serait imiter ce prédicateur,
qui, voulant réfuter les doctrines de Rousseau, adressait ses objections
foudroyantes à son propre bonnet placé sur le bord de sa
chaire,—sommait ledit bonnet de répondre;—et après quelques instants,
disait: «Tu ne réponds pas, philosophe de Genève, donc tu es convaincu
sur ce point.—Passons à un autre.»
«Monsieur, je lis dans un des derniers numéros de la Presse, après quelques lignes où il est question de moi:
«Si nous citons ici le nom de M. Alphonse Karr, c’est que, contrairement, cette fois, à son habitude, il a insisté avec plus d’esprit que de bon sens, dans plusieurs numéros des Guêpes, sur la nécessité d’obliger les auteurs à signer leurs articles, comme la meilleure base qu’on pût donner à une nouvelle loi sur la presse.»
«Je vous remercie d’abord, monsieur, d’avoir bien voulu mentionner mon opinion dans un article où vous passez en revue celle des publicistes les plus distingués,—même quand vous ne faites paraître la mienne que pour déclarer qu’elle n’a pas le sens commun.
»Je n’appellerais pas de ce jugement, monsieur, car je sais que, pour les hommes même les plus sincères, «il a tort,» veut dire «il ne pense pas comme moi;»—«il a raison» signifie «il est de mon avis;»—nous sommes les antipodes des Chinois comme ils sont les nôtres.
»Mais l’opinion que vous me prêtez n’est nullement exprimée dans les Guêpes;—voici le résumé de celle que j’y ai émise en diverses circonstances.
»J’ai dit aux hommes du pouvoir:
»Il n’y a pas de loi sur la presse qu’on ne puisse éluder et qu’on n’élude.—Chaque loi répressive est le barreau d’une cage; quelque serrés que soient les barreaux, il y a toujours un espace entre eux, et la pensée, plus mince et plus ténue que la vapeur, passe aisément entre deux.—Osez-vous supprimer la liberté de la presse? c’est-à-dire fermer la cage par un mur au lieu de la fermer par des barreaux; c’est un coup qui peut se jouer, mais l’enjeu en est cher,—et d’ailleurs, il ne faut pas oublier votre origine.—Quand on veut opposer une digue à un torrent, il faut la construire sur un terrain sec que les eaux n’ont pas encore envahi;—et vous, vous êtes le premier flot du torrent.
»Laissez-le passer libre;—il se divisera en une multitude de petits filets d’eau et de ruisseaux murmurants.
«Loin de là;—par vos lois fiscales,—par le timbre, par le cautionnement, vous mettez la presse aux mains des marchands, et vous créez pour elle des priviléges qui font sa puissance.—Vous vendez les verges cher, mais vous les vendez pour vous fouetter.—La presse libre,—chaque nuance, quelque bizarre qu’elle soit, aurait son organe—et son petit pavillon.—La presse, sous les lois fiscales, est obligée, pour vivre, de réunir douze ou quinze nuances sur un gros drapeau d’une couleur fausse.
»Vous lui donnez, malgré elle, l’unité qui vous tue et la fait vivre.
»Vous réunissez les ruisseaux en un lit profond entre des berges de lois,—et cela devient un torrent.
»Laissez la presse sans timbre, sans procès pendant un an, et elle sera morte ou réformée.»
«Voilà ce que je dis depuis trois ans dans les Guêpes, monsieur, je n’ai jamais donné l’obligation de signer les articles comme la meilleure base à une nouvelle loi sur la presse.
»J’en ai parlé comme d’un des moyens de la moraliser et de la réduire en même temps à son importance réelle—en lui ôtant le prisme des royautés anciennes dont on ne voyait jamais le visage,—et vous savez par quelles transitions,—du jour où les rois se sont laissé voir, on est arrivé, par une pente lente, mais continue, à les guillotiner ou à leur tirer des coups de fusil.
»Un article signé n’aura plus que l’influence qui lui est due, c’est-à-dire celle du raisonnement et de l’esprit.—Une opinion mise en avant ne sera plus l’opinion de la presse, mais l’opinion de monsieur un tel.—Un livre est amèrement déchiré,—dans un article anonyme,—le public dit: «La critique est défavorable à l’ouvrage,» et il passe condamnation.—Si l’article est signé, le public dit: «Ah! ah!—c’est ce monsieur,—un petit,—très-frisé.—Ah! très-bien!—c’est son idée à lui,—eh bien! je vais lire pour avoir la mienne.»
«Tout journaliste qui signe n’a plus de pouvoir que celui qu’il se donne par son talent et par son bon droit.—Ses opinions sont celles de monsieur un tel;—on les discute et on les repousse si elles ne sont pas bonnes.—Mais un article non signé,—c’est l’opinion de la presse,—du boulevard de nos droits, de la plus vivace de nos libertés.—(Dieu sait toutes les phrases emphatiques imaginées à ce sujet.)—On accepte l’opinion toute faite,—comme article de foi.
»D’ailleurs, pour un écrivain, signer un écrit politique ou littéraire, c’est dire:
Me me adsum qui feci.
»C’est moi,—me voilà,—ce que je vous reproche de faire, vous pouvez chercher si je l’ai fait.—Je loue tel homme, vous pouvez dire s’il m’a donné quelque chose,—j’attaque tel autre, dites s’il m’a refusé.
»Signer un article, c’est sortir des remparts d’où la presse tire depuis longtemps contre les autres pouvoirs combattant en rase campagne.
»C’est renoncer au bénéfice des cavernes sombres d’où elle exerce une inquisition si sévère dans les maisons de verre qu’elle a faites à tous ceux qui ne sont pas avec elle.
»Voilà mes raisons pour que les articles soient signés, monsieur, vous en avez donné de meilleures, vous prouvez qu’il est plus commode de ne pas signer.
»Au fond, monsieur, vous savez bien que l’autre parti est plus loyal, et vous signez les vôtres.
»Agréez, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Alph. KARR.»
![]() M. Alexandre Dumas, voyant que ce n’était pas encore son tour
d’être de l’Académie, a dit en s’en retournant à Florence, où il demeure
depuis quelque temps: «Je demande a être le quarantième,—mais il paraît
qu’on veut me faire faire quarantaine.»
M. Alexandre Dumas, voyant que ce n’était pas encore son tour
d’être de l’Académie, a dit en s’en retournant à Florence, où il demeure
depuis quelque temps: «Je demande a être le quarantième,—mais il paraît
qu’on veut me faire faire quarantaine.»
On a nommé,—comme nous l’avions annoncé à l’avance,—M. Pasquier et M. Ballanche.—Je me rends d’ordinaire peu volontiers complice des criailleries vulgaires;—mais, cette fois, je dois dire que je ne comprends pas l’étrange aplomb avec lequel l’Académie ouvre de si bonne grâce les bras d’un de ses fauteuils à un homme qui n’a jamais rien écrit; le pauvre M. Cuvillier-Fleury, obligé de faire, dans le Journal des Débats, l’éloge de M. Pasquier, s’est avisé de faire remonter sa gloire littéraire à Étienne Pasquier,—il ne nous dit pas qu’Étienne Pasquier, né à Paris en 1529, y est mort le 31 août 1615. Gloire, dit M. Cuvillier, discrettement cultivée par M. Pasquier le président.
La candidature de M. Pasquier a dû singulièrement encourager, sinon faire naître celle de M. Dubignac, qui a envoyé à chacun des membres de l’Institut les deux pièces authentiques et imprimées que voici:
«Monsieur, désireux d’avoir l’honneur de devenir membre de l’Académie française ou de l’Institut, et voulant vous épargner une visite de moins, que je regarde comme importune ou peu agréable, j’ai l’honneur de vous écrire et de vous adresser ci-joint l’analyse de mes ouvrages; daignez avoir la bonté de la lire, vous jugerez de leur utilité pour ma patrie; c’est pour éclairer votre religion et impartialité pour le choix d’un membre digne de l’Institut.
»Daignez agréer l’hommage de ma considération distinguée.
DUB.»
![]() M. Dubignac, qui ne garde dans sa lettre que le tiers de l’anonyme,
est agronome—comme M. Pasquier est président de la Chambre des pairs;
ces deux positions, qui ont peu de rapports entre elles, au premier
abord, en ont cependant un qui va jusqu’à la plus parfaite ressemblance,
c’est leur égale et commune et complète absence de rapports avec
l’Académie française.—M. Dubignac n’écrit pas bien, il serait naturel
qu’on lui préférât un homme qui écrit mieux,—mais non un homme qui
n’écrit pas. Voici les documents destinés à éclairer la religion et
impartialité de MM. les trente-huit (qu’ils étaient
alors);—j’élaguerai les passages les moins importants.
M. Dubignac, qui ne garde dans sa lettre que le tiers de l’anonyme,
est agronome—comme M. Pasquier est président de la Chambre des pairs;
ces deux positions, qui ont peu de rapports entre elles, au premier
abord, en ont cependant un qui va jusqu’à la plus parfaite ressemblance,
c’est leur égale et commune et complète absence de rapports avec
l’Académie française.—M. Dubignac n’écrit pas bien, il serait naturel
qu’on lui préférât un homme qui écrit mieux,—mais non un homme qui
n’écrit pas. Voici les documents destinés à éclairer la religion et
impartialité de MM. les trente-huit (qu’ils étaient
alors);—j’élaguerai les passages les moins importants.
ANALYSE DE L’AGRONOME DUBIGNAC.—«Cet ouvrage se composera de deux volumes in-12.
»Son style est simple, tout naturel, à la portée de tout le monde, notamment des communes rurales, pour lesquelles il a été fait.
»Méthode pour la composition des différentes espèces de fumiers, engrais, terreaux, et les moyens de leur conservation d’un an à l’autre en étant meilleurs. C’est l’âme de toute ferme.
»Très-bonne méthode pour donner une excellente éducation aux chevaux, à qui il ne manquait que la parole; et notion sur la parfaite connaissance de leurs défauts, vices, comme de leurs bonnes qualités et de leurs âges, qu’on connaît jusqu’à dix ans.
»Notion sur la vraie et bonne position d’un jardin, sur sa fermeture, sa distribution, plantation; car, quoi de plus agréable qu’un joli jardin à la campagne; mais sa culture, d’un jardinier, talents, expérience, soin, travail, comme une surveillance de tout propriétaire.
»Notion très-étendue sur la vraie culture de tout légume, fèves, pois, nantilles, notamment des haricots à donner cent pour cent, comme sur la conservation de la plupart en verdure d’un an à l’autre.
»Notion sur la culture des pommes de terre, sur sa grande utilité pour les bestiaux et volailles, comme pour les hommes.
»Il en est de même du blé de Turquie, dont la culture est la même, qui également est d’une très-grande ressource pour les gens de la campagne, dont la nourriture est un régal pour eux.
»Notion sur le chanvre, denrée très-précieuse par sa grande utilité, dont le commerce en est très-grand,—ainsi que sa graine très-bonne pour la volaille, dont la farine est utilisée dans le commerce.
»Il en est de même du lin, dont la graine est très-précieuse pour l’espèce humaine; l’un et l’autre exigent que la terre soit bonne, bien amendée, bien préparée,
»Notion sur une excellente méthode pour conserver le blé au moins d’une année à l’autre, au moyen des appareils lithographiés joints à l’ouvrage, qui, une fois encaissé, ne donne aucuns soucis pour sa conservation.
»Notion sur la vigne et le vin, qui est une branche de commerce et d’industrie la plus étendue par sa grande utilité; nécessaire à l’homme pour la conservation de sa santé, préférable à tout, et lui procurant plaisir, jouissance, joie, gaieté.
»Excellente méthode pour avoir du beau fruit et améliorer l’espèce et qualité, comme d’en varier, multiplier les espèces sur le même arbre, et de préférence sur l’amandier, qu’on doit regarder comme la mère de tous les arbres fruitiers à noyaux.
»Grand nombre d’autres expériences curieuses; enfin, le joli tableau de la France et de sa belle capitale couronne le premier volume en disant:
»Dans le second volume, deuxième édition, corrigée, augmentée, le Vrai Guide de la Santé, dédié à l’humanité, dont le but de l’auteur a été de faire connaître combien est grand le malheur de perdre la santé, si difficile à rétablir, et à, etc., etc.
»Résultat d’une expérience pratique pendant les dix-huit ans qu’il a été maire de sa commune, où il avait de grandes propriétés, dont tous les habitants le regardaient comme leur père et lui comme ses enfants.
»Amateur de la médecine, il s’occupait à en lire les meilleurs ouvrages sur le botanique, herborisant dans ses bois et champs, il se familiarisait avec les simples, dont il parvint à en connaître les propriétés; il était leur médecin, pharmacien, avocat, aussi n’y avait-il jamais de procès; il se faisait un vrai plaisir de leur donner des soins, et avait-il la bien grande jouissance de les soulager, et bien souvent la douce consolation de les guérir, et par des moyens consistant en infusions, en décoctions de quelques simples dont il connaissait les propriétés et vertus (les remèdes les plus simples sont souvent les meilleurs), des nombreuses maladies qui les affligeaient, plus exposés que les habitants des villes par leurs travaux ou par leurs imprudences.
»L’auteur, dans cet ouvrage, s’est regardé comme un vrai père de famille, aimant tous ses enfants, voulant, désirant leurs prospérités, bonheurs, félicité, et leur procurer cette chère santé sans laquelle on ne peut être heureux, et qui, à cet effet, l’a écrit et fait d’après la théorie-pratique la mieux suivie, et des expériences très-réfléchies et avec soin; aussi peut-on dire:
»S’adresser à l’auteur, passage de la Treille, 5, près l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.»
Imprimerie de DUCESSOIS, quai des Augustins, 55.
Une pension de mille écus et M. Hébert.—Longchamps.—M. de Vigny.—M. Patin.—M. Royer-Collard.—Remède contre le froid aux pieds.—M. C. Bonjour, le roi Louis-Philippe, M. Rudder et M. Cayeux.—EXPOSITION DU LOUVRE: M. Hébert à propos du portrait de la reine.—Louis XVIII et un suisse d’église.—M. Vickemberg et M. Biard.—M. Meissonnier et M. Béranger.—M. Gudin.—Le lion de M. Fragonard.—M. Affre.—Monseigneur de Chartres.—M. Ollivier et une dinde truffée.—La Vierge de Bouchot.—Les ânes peints par eux-mêmes.—Question des sucres.—Un tailleur à façon.—Lorenzino de M. Al. Dumas.—Un vendeur de beau temps.—M. Listz.—Le cancan, la béquillade, la chaloupe, dansés par M. de B... au dernier bal de madame la duchesse de M...—M. Dubignac sur Napoléon, les femmes et l’amour, etc., etc.—Succès pour le commerce français, obtenu sur la plaidoirie de Me Ledru-Rollin.
AVANT-PROPOS.—On savait depuis longtemps que j’étais vendu au gouvernement.—Quelques carrés de papier m’appelaient, par euphémisme, ami du château;—mais dans plusieurs estaminets ou disait nettement la chose. Cependant on n’était pas d’accord sur certains détails. Quelques personnes portaient la somme dont on m’avait acheté à une importance qui pouvait devenir une dangereuse amorce pour les désintéressements les plus inabordables.
Mais l’autre jour, comme j’arrivais à Paris pour voir l’exposition de peinture,—une des premières choses que m’a dites un des premiers hommes que j’ai rencontrés a été qu’on sait maintenant à quoi s’en tenir: «M. Cavé est venu me trouver au bord de la mer, où je péchais des soles et des barbues, et là nous avons fixé le prix à trois mille francs de pension annuelle.»
D’autre part, je reçois une lettre signée Pauline, où on me dit de prendre garde à moi,—parce que M. Hébert surveille attentivement les Guêpes, dont quelques aiguillons lui ont percé l’épiderme.—Est-ce que M. Hébert serait chargé de me reprendre, sous forme d’amende périodique, les trois mille francs de pension dont je vous parlais tout à l’heure?—Tout cela m’inquiète fort, et ne me laisse prendre la plume qu’avec une extrême timidité.
En effet, on comprendra facilement mon embarras:—je voudrais bien dire des choses extrêmement hardies,—pour démentir le bruit de la pension;—mais j’ai peur que M. Hébert ne profite de la circonstance pour me faire un procès.—Heureusement que j’ai à parler du Salon et de l’exposition de peinture: il n’y a là rien de politique, et je pourrai naviguer entre les deux écueils que je redoute.
![]() Voici les quatre choses qui m’ont le plus frappé à Longchamps:
Voici les quatre choses qui m’ont le plus frappé à Longchamps:
Un marchand de briquets promenait six voitures rouges;
Un marchand de chemises, en cabriolet, faisait tomber sur la foule une neige d’adresses et de prospectus;
Plusieurs messieurs à pied—étaient vêtus de toiles représentant des cheminées, avec l’adresse et l’éloge des fabricants;—ils étaient coiffés d’un tuyau de poêle;—un de ces malheureux a été chassé de l’administration parce qu’il s’était permis de fumer;
La garde municipale était en petite tenue,—ce dont on était généralement fâché, parce que la grande tenue est d’un aspect magnifique. (Peut-être ceci, à propos de la garde municipale, va-t-il confirmer l’affaire des mille écus:—je l’effacerai sur les épreuves.)
![]() M. de Vigny refait en ce moment ses visites à ses futurs collègues.
Cette fois, les chances sont pour lui, quoique cependant la rivalité de
M. Patin présente quelques dangers.—On a généralement trouvé de mauvais
goût qu’en parlant de son concurrent M. de Vigny feignît de ne pas
savoir son nom et affectât de l’appeler M. Pantin.
M. de Vigny refait en ce moment ses visites à ses futurs collègues.
Cette fois, les chances sont pour lui, quoique cependant la rivalité de
M. Patin présente quelques dangers.—On a généralement trouvé de mauvais
goût qu’en parlant de son concurrent M. de Vigny feignît de ne pas
savoir son nom et affectât de l’appeler M. Pantin.
![]() M. Royer-Collard tient singulièrement à la vie. M. Andr..., son
gendre et son médecin, lui a recommandé, avec la plus grande sévérité,
d’apporter à ses repas une régularité inflexible. Un de ces jours
derniers, au moment où la pendule marquait six heures,—M. Royer-Collard
mettait la main sur le bras de son fauteuil pour se lever et s’approcher
de la cheminée devant laquelle on venait de lui servir une sole
fumante,—lorsqu’un domestique maladroit annonce brusquement M. le comte
Alfred de Vigny.—M. de Vigny suivait le domestique de fort près et
entendit parfaitement la réponse de M. Royer-Collard, qui s’écria:—«Je
n’y suis pas.»—Il entra néanmoins, et allait ouvrir la bouche quand
l’académicien lui dit:
M. Royer-Collard tient singulièrement à la vie. M. Andr..., son
gendre et son médecin, lui a recommandé, avec la plus grande sévérité,
d’apporter à ses repas une régularité inflexible. Un de ces jours
derniers, au moment où la pendule marquait six heures,—M. Royer-Collard
mettait la main sur le bras de son fauteuil pour se lever et s’approcher
de la cheminée devant laquelle on venait de lui servir une sole
fumante,—lorsqu’un domestique maladroit annonce brusquement M. le comte
Alfred de Vigny.—M. de Vigny suivait le domestique de fort près et
entendit parfaitement la réponse de M. Royer-Collard, qui s’écria:—«Je
n’y suis pas.»—Il entra néanmoins, et allait ouvrir la bouche quand
l’académicien lui dit:
—Monsieur, vous reviendrez une autre fois.
—Mais, monsieur,—reprit M. de Vigny,—l’affaire dont j’ai à vous entretenir est sérieuse.
—Eh bien! vous reviendrez une autre fois.
—Je pense, monsieur,—que l’on m’a mal annoncé:—je suis le comte A. de Vigny.
—Eh bien!—dit M. Royer-Collard,—qui regardait avec anxiété,—et la pendule qui marquait six heures dix minutes,—et la sole, dont la fumée paraissait déjà moins intense;—eh bien! vous reviendrez un autre jour.
—Mais, monsieur...
—Mais, monsieur,—je vous dis de revenir;—je ne vous connais pas.
—Je croyais, monsieur, que mon nom était parvenu jusqu’à vous; il a fait un peu de bruit dans la littérature.
—Eh bien, monsieur, c’est pour cela;—il n’a fait qu’un peu de bruit, et il en faut faire beaucoup pour venir jusqu’à moi.—Je suis vieux; j’ai besoin de régularité:—faites-moi le plaisir de me laisser dîner tranquillement.
![]() A une parade, le marquis de ***, un des jeunes officiers les
plus élégants de l’armée,—se plaignait du froid aux pieds qu’il
ressentait à cheval:
A une parade, le marquis de ***, un des jeunes officiers les
plus élégants de l’armée,—se plaignait du froid aux pieds qu’il
ressentait à cheval:
—Vous avez froid aux pieds, capitaine? lui dit un vieux maréchal des logis.
—Je t’en réponds.
—Je sais ce que c’est, capitaine; j’y ai eu froid pendant vingt ans.
—Eh bien, tu as dû avoir du plaisir.
—Mais, maintenant, c’est fini;—on m’a indiqué un moyen...
—Ah! quel est ton moyen?
—C’est bien simple, allez, capitaine,—vous ne vous figurez pas comme je souffrais:—c’est-à-dire que les larmes m’en venaient aux yeux.
—Eh bien, qu’as-tu fait?
—Ce n’est presque rien.—On va toujours chercher midi à quatorze heures; j’ai vu des jours où je serais tombé de cheval.
—Mais, enfin, quel est ton moyen?
—Le plus simple du monde, comme je vous dis, capitaine,—presque rien;—moi, j’ai eu froid pendant vingt ans, et, quand on m’a eu donné ce moyen-là, ç’a été fini,—je n’ai plus jamais eu froid aux pieds de ma vie; et, comme je vous dis,—ce qu’il y a de meilleur,—c’est que c’est un moyen aussi simple qu’il est excellent.—Vous n’y avez pas froid comme j’y ai eu froid pendant vingt ans;—et aujourd’hui...
—Eh bien?
—Si vous avez froid aux pieds,—il ne faut pas aller s’ingérer ça ou ça;—le moyen est bien simple... il faut mettre des chaussettes dans vos bottes.
![]() M. Casimir Bonjour,—auteur des Deux Cousins et de la mort de M.
Alexandre Duval, qu’il a forcé d’aller, mourant, voter pour lui à
l’Institut,—n’ose plus se mettre sur les rangs depuis qu’un académicien
lui a dit: «Franchement, mon cher ami, votre candidature n’a plus de
chances:—tous les jours la Gazette des Tribunaux met l’Académie en
garde contre le vol au bonjour.»
M. Casimir Bonjour,—auteur des Deux Cousins et de la mort de M.
Alexandre Duval, qu’il a forcé d’aller, mourant, voter pour lui à
l’Institut,—n’ose plus se mettre sur les rangs depuis qu’un académicien
lui a dit: «Franchement, mon cher ami, votre candidature n’a plus de
chances:—tous les jours la Gazette des Tribunaux met l’Académie en
garde contre le vol au bonjour.»
![]() Un de mes amis reçoit hier une lettre de son jardinier;—cette
lettre est datée d’une charmante retraite qu’il possède dans le midi de
la France;—le jardinier lui dit:
Un de mes amis reçoit hier une lettre de son jardinier;—cette
lettre est datée d’une charmante retraite qu’il possède dans le midi de
la France;—le jardinier lui dit:
«Monsieur, voici le printemps,—il va m’arriver comme l’année passée.—Permettez-moi d’aller demeurer à la ferme; il y a dans le jardin des rossignols qui gueulent toute la nuit: il n’y a pas moyen de fermer l’œil.»
![]() Il y a au Musée un portrait du roi Louis-Philippe,—que l’auteur,
M. de Rudder, avait fait de son chef, sans en prévenir personne,—et
d’après d’autres portraits.—M. de Cayeux offrit à l’artiste de lui
obtenir du roi une ou deux séances pour arriver à une plus complète
ressemblance.—Il est facile de voir, à l’aspect du portrait, que M. de
Rudder a ajouté des cheveux blancs—qui ne se mêlent nullement aux
autres.
Il y a au Musée un portrait du roi Louis-Philippe,—que l’auteur,
M. de Rudder, avait fait de son chef, sans en prévenir personne,—et
d’après d’autres portraits.—M. de Cayeux offrit à l’artiste de lui
obtenir du roi une ou deux séances pour arriver à une plus complète
ressemblance.—Il est facile de voir, à l’aspect du portrait, que M. de
Rudder a ajouté des cheveux blancs—qui ne se mêlent nullement aux
autres.
Un jour que le roi donnait séance à M. de Rudder, il prit envie à Sa Majesté de faire le tour du Musée,—et elle pria M. de Rudder de l’accompagner avec M. de Cayeux, qui se trouvait là.
Pendant qu’on traversait les appartements, M. de Cayeux, qui aime beaucoup les conseils... quand il les donne,—avait pris M. de Rudder à part, et lui avait dit à voix basse: «Il y a une chose dont il faut que je vous avertisse: le roi n’aime pas qu’on soit trop près de lui,—restez un peu en arrière.»
M. de Rudder croit la chose et n’en demande pas davantage.
On arrive dans les galeries;—le roi tourne souvent la tête à droite et à gauche pour parler à M. de Rudder,—mais c’était M. Cayeux qui interceptait les questions et faisait les réponses.
Il faut dire que c’était un manége assez fatigant pour le roi, qui a la fâcheuse habitude de porter deux cravates fort serrées,—dont ses médecins ne peuvent pas obtenir de lui qu’il affranchisse son cou.
Enfin, Sa Majesté, impatientée de ne pas voir M. de Rudder, avec qui elle voulait causer, lui cria d’un peu loin: «Mais, monsieur, je vous en prie, venez à côté de moi!»
M. de Rudder obéit et resta près du roi, avec lequel il causa quelque temps.
Ce jour-là, du reste, une fenêtre tomba avec fracas aux pieds du roi pendant cette promenade.
Cette anecdote sur le roi,—M. de Rudder et M. de Cayeux,—nous amène naturellement au Musée.—Entrons au Musée.
![]() EXPOSITION DU LOUVRE.—Constatons d’abord une chose: c’est que les
expositions du Louvre ont singulièrement l’air de ne plus amuser le
public, et que, excepté moi, je n’ai vu là personne qui fît un peu plus
de cent lieues pour se promener dans les galeries en renversant les
vertèbres du cou d’une façon si douloureuse et si fatigante.
EXPOSITION DU LOUVRE.—Constatons d’abord une chose: c’est que les
expositions du Louvre ont singulièrement l’air de ne plus amuser le
public, et que, excepté moi, je n’ai vu là personne qui fît un peu plus
de cent lieues pour se promener dans les galeries en renversant les
vertèbres du cou d’une façon si douloureuse et si fatigante.
Je ne reparlerai pas des membres du jury, doctores non docti. Deux fois déjà à pareille époque les Guêpes se sont expliquées à leur sujet.
Je vais vous dire ce que j’ai remarqué en me promenant dans les galeries.
D’abord un portrait de la reine;—ce portrait est fait avec soin, par M. Winterhalter.—Je voudrais seulement savoir pourquoi les mains sont aussi bleues,—est-ce le velours qui déteint?
N. B. (Phrase à refaire tout entière: d’un bout, elle est exposée aux estaminets et aux carrés de papier, et de l’autre à M. Hébert,—en effet «d’abord la reine» c’est le ab Jove principium des Latins.—Il est évident que j’ai la pension de mille écus.
Puis à la fin—une critique: les mains sont bleues—les mains de la reine.—M. Lévy ne voudra peut-être pas imprimer cela,—et, s’il l’imprime, M. Hébert, qui me surveille, selon madame ou mademoiselle Pauline,—peut se fâcher.—J’aurai soin, pour les estaminets et les carrés de papier, de parler de quelque bourgeoise ou bien de la cuisinière piquant un fricandeau de M. Chollet, avant de parler de S. M. la reine Amélie.—A l’égard de M. Hébert, j’expliquerai que j’entends parler des mains du tableau.)
Il y a dans ce même salon carré, une grande image ainsi intitulée au livret:
M. VINCHON. 1831. Séance royale pour l’ouverture des Chambres et la proclamation de la Charte constitutionnelle (14 juin 1814).
Maison du Roi.
Qu’est-ce que la peinture historique si elle n’ose pas poétiser un peu les figures? Pourquoi donner à Louis XVIII cet air de suisse d’église?—pourquoi avoir présenté de face un homme d’une grosseur extraordinaire qu’on pouvait dissimuler sans mensonge en changeant sa position? pourquoi faire la lumière de ce blanc pâteux?—la lumière se compose de toutes les couleurs.
En voyant ce tableau, M. Villemain a dit:
—Il faudra donner cinq cents francs à l’auteur.
—Mais, a répondu quelqu’un,—cinq cents francs! le cadre les vaut!
—Aussi est-ce en comptant le cadre, a répondu M. Villemain.
![]() M. Lestang-Parade a à se reprocher une Bethsabée très-décolletée,
dont la peau est couleur gorge de pigeon.
M. Lestang-Parade a à se reprocher une Bethsabée très-décolletée,
dont la peau est couleur gorge de pigeon.
![]() Au-dessus de la Bethsabée est un petit tableau de M.
Wickemberg,—c’est un étang gelé, sur lequel des enfants jouent avec un
traîneau; deux autres enfants apportent des fagots;—c’est d’une vérité
charmante et d’un fini précieux. C’est une comparaison fâcheuse pour les
glaces bleu de ciel de M. Biard.—Il n’y avait pas besoin d’aller en
Laponie,—un baquet de blanchisseuse oublié dans une cour, une nuit de
décembre, donne une glace de cette couleur.—Je ne pense pas qu’il y en
ait ailleurs.
Au-dessus de la Bethsabée est un petit tableau de M.
Wickemberg,—c’est un étang gelé, sur lequel des enfants jouent avec un
traîneau; deux autres enfants apportent des fagots;—c’est d’une vérité
charmante et d’un fini précieux. C’est une comparaison fâcheuse pour les
glaces bleu de ciel de M. Biard.—Il n’y avait pas besoin d’aller en
Laponie,—un baquet de blanchisseuse oublié dans une cour, une nuit de
décembre, donne une glace de cette couleur.—Je ne pense pas qu’il y en
ait ailleurs.
Au-dessous d’un Combat naval de M. Th. Gudin,—toujours dans le salon carré,—sont deux tableaux, grands comme des tabatières, et qui méritent l’attention,—un Fumeur, de M. Meissonnier, et surtout un Lièvre et une Perdrix, de M. Béranger.—Je ne pense pas que la peinture soit jamais allée plus loin comme imitation.
Un monsieur, voulant savoir si c’était peint sur toile, a donné un coup violent de la pointe de son doigt sur le tableau. «Heureusement qu’il est peint sur bois, me disait A. L***, qui était avec moi.—Du reste, ajoutait-il, ce monsieur avait pris un bon moyen de satisfaire sa curiosité,—car, si le tableau avait été sur toile, il l’aurait vu tout de suite; son doigt aurait passé au travers.»
A propos de M. Gudin, sa Barque de pêche danoise est un de ses meilleurs tableaux.
Au-dessus est un tableau de M. Fragonard, ainsi nommé au livret: Femmes chrétiennes livrées aux bêtes féroces dans le Cirque.
Or, il n’y a qu’une femme,—il n’y a qu’une bête, et il n’y a pas de cirque.
La bête est un lion qui, par sa forme et sa pose, ressemble singulièrement aux lions qui servent d’enseigne à beaucoup de marchands de vins.—La femme est renversée, et une des pattes du lion est levée, arrondie, un peu au-dessus d’un des seins nus de la malheureuse chrétienne. Ce sein nu fait tout à fait l’effet de la boule que la tradition place sous la patte des lions d’or et des lions d’argent. M. Fragonard a senti la chose, et, pour éviter l’application, pour empêcher d’appeler son tableau le Lion d’or, il a fait son lion brun.
![]() Deux taureaux appuyés l’un sur l’autre dans une grande prairie.
Ce tableau est une de ces fenêtres que M. Brascassat ouvre de temps en
temps dans les murs du Louvre sur les prairies de Normandie. Son tableau
a une étendue immense dans un cadre de quelques pieds.
Deux taureaux appuyés l’un sur l’autre dans une grande prairie.
Ce tableau est une de ces fenêtres que M. Brascassat ouvre de temps en
temps dans les murs du Louvre sur les prairies de Normandie. Son tableau
a une étendue immense dans un cadre de quelques pieds.
![]() Il y a énormément de femmes nues et laides, ce qui constitue la
véritable et la plus haute indécence.—Parmi celles qui ont eu le regret
de se faire peindre habillées, plusieurs ont imaginé une autre
indécence; elles se sont fait peindre entières, vues de dos, sur des
sièges sans dossiers, qui ne permettent de rien perdre des formes
Oudinot (crinoline—cinq ans de durée), que les femmes exagèrent
singulièrement depuis quelques années.—Je prendrai, pour l’exemple le
plus frappant de ce que je dis, le portrait de S. A. I. la
grande-duchesse Hélène Paulowna, peint par M. Court, portrait détestable
du reste, dont la guipure, parfaitement imitée par des procédés connus
des derniers rapins,—excite au musée une assez vive admiration.
Il y a énormément de femmes nues et laides, ce qui constitue la
véritable et la plus haute indécence.—Parmi celles qui ont eu le regret
de se faire peindre habillées, plusieurs ont imaginé une autre
indécence; elles se sont fait peindre entières, vues de dos, sur des
sièges sans dossiers, qui ne permettent de rien perdre des formes
Oudinot (crinoline—cinq ans de durée), que les femmes exagèrent
singulièrement depuis quelques années.—Je prendrai, pour l’exemple le
plus frappant de ce que je dis, le portrait de S. A. I. la
grande-duchesse Hélène Paulowna, peint par M. Court, portrait détestable
du reste, dont la guipure, parfaitement imitée par des procédés connus
des derniers rapins,—excite au musée une assez vive admiration.
![]() Madame. G*** (84) est rouge;—madame G. est jaune;—mademoiselle
R. est violette;—madame *** est grosse comme un muid;—mademoiselle
de R. est orange;—Madame de ***, gris-bleu;—M. R*** est chauve,
etc. Je pense que c’est là ce que veulent faire savoir au public les
diverses personnes qui ont fait mettre leurs portraits au Louvre.
Madame. G*** (84) est rouge;—madame G. est jaune;—mademoiselle
R. est violette;—madame *** est grosse comme un muid;—mademoiselle
de R. est orange;—Madame de ***, gris-bleu;—M. R*** est chauve,
etc. Je pense que c’est là ce que veulent faire savoir au public les
diverses personnes qui ont fait mettre leurs portraits au Louvre.
![]() A propos de portraits,—il y a un peintre qui a fait le portrait de
sa femme; sa femme est, dit-on, jolie, et le portrait semble avoir pour
but de le cacher au public;—quelqu’un disait à l’original: «Votre mari
est jaloux, c’est pour cela qu’il vous a faite si laide; ils sont tous
comme cela.—Oui-da, répondit-elle, et à quoi cela les avance-t-il?
A propos de portraits,—il y a un peintre qui a fait le portrait de
sa femme; sa femme est, dit-on, jolie, et le portrait semble avoir pour
but de le cacher au public;—quelqu’un disait à l’original: «Votre mari
est jaloux, c’est pour cela qu’il vous a faite si laide; ils sont tous
comme cela.—Oui-da, répondit-elle, et à quoi cela les avance-t-il?
![]() UN CHANOINE DE SAINT-DENIS.—Nous venons de voir M. Affre,
archevêque de Paris.—M. Ollivier, ancien curé de Saint-Roch,—puis un
évêque de je ne sais où;—il y a au moins quinze prélats attifés avec
une coquetterie féminine,—des recherches de parures inouïes, des
raffinements d’élégance inimaginables, des dentelles qui font envie aux
femmes.
UN CHANOINE DE SAINT-DENIS.—Nous venons de voir M. Affre,
archevêque de Paris.—M. Ollivier, ancien curé de Saint-Roch,—puis un
évêque de je ne sais où;—il y a au moins quinze prélats attifés avec
une coquetterie féminine,—des recherches de parures inouïes, des
raffinements d’élégance inimaginables, des dentelles qui font envie aux
femmes.
L’Église est pour le moment assez mondaine; monseigneur de Chartres fait depuis quelque temps des feuilletons dans les journaux.
![]() Madame la comtesse de B*** n’a pas suffisamment compté sur ses
charmes,—elle a fait mettre son écusson dans un coin du tableau.
Madame la comtesse de B*** n’a pas suffisamment compté sur ses
charmes,—elle a fait mettre son écusson dans un coin du tableau.
Ah! mon bon monsieur Lévy,—laissez-moi une fois dire ce que je pense sur cette odieuse galerie de bois.
Quel est le malheureux qui a eu l’idée d’accrocher cette hideuse baraque au flanc d’un monument comme le Louvre? Jamais les peuples barbares n’ont rien imaginé de cette force.—Les Vandales eussent peut-être détruit le Louvre, mais ils ne l’eussent pas ainsi déshonoré.—Ah! diable,—et M. Hébert... à ce que dit madame ou mademoiselle Pauline.
![]() Près de ce portrait blasonné est celui d’une femme vêtue de
noir,—c’est une figure intéressante et un tableau remarquablement
peint.—Il faut lui reprocher un fond d’un bleu dur et uniforme,—comme
le papier de tenture d’un appartement;—mais ce n’est pas, à ce qu’il
paraît, si facile de faire des fonds.
Près de ce portrait blasonné est celui d’une femme vêtue de
noir,—c’est une figure intéressante et un tableau remarquablement
peint.—Il faut lui reprocher un fond d’un bleu dur et uniforme,—comme
le papier de tenture d’un appartement;—mais ce n’est pas, à ce qu’il
paraît, si facile de faire des fonds.
Du vivant de Rubens,—une femme alla le trouver et lui dit:
—Monsieur Rubens—(on l’appelait monsieur), mon fils a d’heureuses dispositions (c’est incroyable combien ont d’heureuses dispositions les enfants dont on est la mère): il faut absolument qu’il travaille auprès de vous.
Rubens, qui n’en voulait à aucun prix, s’excuse sur ses occupations.
—Oh! monsieur Rubens, il ne vous fera pas perdre de temps; au contraire, il vous aidera: il y a un tas de petites choses qu’il fera à votre place, il vous fera vos fonds...
—Ah! parbleu, madame, s’écrie Rubens, il me rendra là un vrai service, car je ne sais pas encore les faire!
![]() —Pardon, la grosse mère qui êtes en face, serrez un peu vos gros
bras contre votre gros corps, vous me cachez trop de ce beau papier qui
sert de fond à votre portrait.
—Pardon, la grosse mère qui êtes en face, serrez un peu vos gros
bras contre votre gros corps, vous me cachez trop de ce beau papier qui
sert de fond à votre portrait.
Dans l’épisode du Combat de Trafalgar, de M. Caussé,—on remarque un fragment de mât brisé,—sur lequel quelques matelots sont debout ou assis comme dans des fauteuils.—Je voudrais vous y voir, monsieur Caussé;—je gage que, par une mer un petit peu houleuse, vous ne vous tenez pas sur le bateau du Havre à Honfleur comme vos matelots se tiennent sur leur morceau de mât.—Tenez-vous la gageure?
![]() Mademoiselle Dimier a peint son propre portrait (567), cela m’a
rappelé ce que fit Phryné:—Accusée devant l’aréopage,—elle se
contenta, pour toute réponse, de montrer sa gorge aux juges,—et elle
obtint son acquittement par cette plaidoirie d’un genre tout
particulier, qui n’aurait guère de succès aujourd’hui..., du moins en
audience publique.—Mademoiselle Dimier paraît appeler son visage au
secours de son pinceau; ils sont agréables l’un et l’autre.
Mademoiselle Dimier a peint son propre portrait (567), cela m’a
rappelé ce que fit Phryné:—Accusée devant l’aréopage,—elle se
contenta, pour toute réponse, de montrer sa gorge aux juges,—et elle
obtint son acquittement par cette plaidoirie d’un genre tout
particulier, qui n’aurait guère de succès aujourd’hui..., du moins en
audience publique.—Mademoiselle Dimier paraît appeler son visage au
secours de son pinceau; ils sont agréables l’un et l’autre.
![]() Tiens,—deux singes!
Tiens,—deux singes!
Ah! non... pardon; mille pardons.—C’est un ménage vert—dans une forêt.—Cela s’appelle portrait de M. et de madame ***; mais je serai plus discret que le peintre, M. Defer, je ne mettrai pas les initiales;—j’intitulerai l’objet: Portrait du livret du salon, tenu à la main par M***, qui est dans une forêt; c’est du reste ce que cela représente.—Le livret est fort ressemblant.—J’espère que M. et madame*** le sont moins.
![]() M. Lafond a peint nue—une femme grosse de sept mois;—c’est laid.
M. Lafond a peint nue—une femme grosse de sept mois;—c’est laid.
![]() Je ne sais pourquoi certains carrés de papier ne font pas plus
attention à la manière dont on peint les villes de la conquête d’Alger.
Le jury qui admet ces tableaux ne peut avoir pour but que de dégoûter
les Français de leurs possessions d’Afrique.
Je ne sais pourquoi certains carrés de papier ne font pas plus
attention à la manière dont on peint les villes de la conquête d’Alger.
Le jury qui admet ces tableaux ne peut avoir pour but que de dégoûter
les Français de leurs possessions d’Afrique.
Selon M. Frère, Constantine est couleur chocolat à l’eau et Alger couleur chocolat au lait.
Joignez à cela un Combat de M. Guyon, et dites-moi si vous vous sentez envie d’aller être héros là-bas, pour qu’on vous peigne comme cela ici.
![]() Le 4 avril 1840, dit M. Chazal dans le livret,—il se passait dans
le port de Cherbourg un de ces rares et majestueux événements où se
révèle la puissance du génie de l’homme: on lançait à la mer le vaisseau
le Friedland.
Le 4 avril 1840, dit M. Chazal dans le livret,—il se passait dans
le port de Cherbourg un de ces rares et majestueux événements où se
révèle la puissance du génie de l’homme: on lançait à la mer le vaisseau
le Friedland.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans ce tableau, c’est une sorte de dressoir où sont figurées les autorités de Cherbourg, et qui ressemble, à s’y méprendre, à l’un des côtés de la boutique d’un pharmacien avec les fioles de diverses couleurs qui y sont rangées sur des tablettes.
Quelques-unes des fleurs de M. Chazal, dans le tableau qui est près du portrait de la reine, dans le salon carré, valent mieux que son tableau du Friedland; cependant je ne les aime guère;—au reste,—je dois dire pour consoler M. Chazal, en lui donnant le moyen de se réfugier dans un grand mépris de mon opinion,—que la plupart des fleurs, même des maîtres en ce genre,—me paraissent un barbouillage de convention.
Il y a cependant au Salon, dans la galerie de bois, un remarquable tableau de fleurs de madame Chantereine:—c’est à peu près la seule fois que j’ai vu aussi bien reproduire l’étoffe des fleurs;—c’est un charmant tableau et un charmant talent.
Disons encore, toujours pour consoler M. Chazal et les autres peintres de fleurs, que j’ai quitté mes pêchers et mes abricotiers en fleurs pour venir voir leurs tableaux, et que cela me rend difficile et un peu de mauvaise humeur.
![]() M. Villiers a peint un bœuf bleu, sous le nº 1847.
M. Villiers a peint un bœuf bleu, sous le nº 1847.
M. Raynaud a représenté une famille se réjouissant de la convalescence d’un homme que je déclare mort depuis six semaines;—voir le visage dudit.
![]() 614. Tobie et l’Ange.—Sur le livret, on croirait que c’est une
marchande de poisson à laquelle un ange marchande sa denrée.
614. Tobie et l’Ange.—Sur le livret, on croirait que c’est une
marchande de poisson à laquelle un ange marchande sa denrée.
Au bout de la galerie de pierre, en tournant pour entrer dans la galerie de bois,—je vous recommande une très-drôle de dame jouant du tambour de basque,—et une Cléopâtre de quatorze pieds.
![]() Puisque M. Olivier, évêque d’Évreux et ancien curé de Saint-Roch, a
fait mettre son portrait au Musée,—c’est qu’il n’est pas ennemi de la
publicité;—nous pensons lui être agréable en citant un mot de lui. Au
commencement de l’hiver qui finit, il avait, je ne sais à quel sujet,
fait une gageure avec un de ses vicaires:—l’enjeu était une dinde
truffée;—le vicaire perdit, et ne montra aucun empressement pour
s’acquitter;—en vain M. Ollivier portait au pari des allusions chaque
jour plus directes;—le vicaire paraissait décidé à ne pas
comprendre.—M. Ollivier, poussé à bout, résolut de s’expliquer
clairement et lui dit:
Puisque M. Olivier, évêque d’Évreux et ancien curé de Saint-Roch, a
fait mettre son portrait au Musée,—c’est qu’il n’est pas ennemi de la
publicité;—nous pensons lui être agréable en citant un mot de lui. Au
commencement de l’hiver qui finit, il avait, je ne sais à quel sujet,
fait une gageure avec un de ses vicaires:—l’enjeu était une dinde
truffée;—le vicaire perdit, et ne montra aucun empressement pour
s’acquitter;—en vain M. Ollivier portait au pari des allusions chaque
jour plus directes;—le vicaire paraissait décidé à ne pas
comprendre.—M. Ollivier, poussé à bout, résolut de s’expliquer
clairement et lui dit:
—Ah ça! monsieur le vicaire,—je voudrais bien vous rappeler adroitement que vous me devez une dinde truffée?
—Je le sais bien, monseigneur, dit le vicaire,—et, si je ne me suis pas acquitté plus tôt, c’est que les truffes sont de mauvaise qualité cette année.
—Allons donc, mon cher vicaire!—s’écria M. Ollivier, n’en croyez donc pas un mot: c’est un bruit que les dindons font courir.
![]() Je voudrais voir le Passage d’Honfleur de M. Biard.—J’ai lu dans
tous les journaux qu’une foule compacte stationnait devant le
tableau.—Je n’aurai pas de peine à le reconnaître.—Où est-ce qu’il y a
une foule compacte?—Je ne vois pas de foule compacte:—c’était pourtant
dans les journaux.
Je voudrais voir le Passage d’Honfleur de M. Biard.—J’ai lu dans
tous les journaux qu’une foule compacte stationnait devant le
tableau.—Je n’aurai pas de peine à le reconnaître.—Où est-ce qu’il y a
une foule compacte?—Je ne vois pas de foule compacte:—c’était pourtant
dans les journaux.
Où peut être le tableau de M. Biard?
En attendant, voici celui de M. Decamps, la Sortie de l’école turque;—on m’a dit d’admirer cela;—eh bien! je n’admire pas;—je soupçonne fort les qualités de ce tableau de consister principalement en difficultés plus ou moins vaincues, en adresse, en habileté,—toutes choses qui peuvent intéresser les peintres.—M. Decamps a beau lever les jambes de ses petits bonshommes, il n’en est pas moins vrai qu’ils ne sautent pas,—qu’ils ne courent pas, qu’ils ne jouent pas;—rapprochez de cela cette si spirituelle gravure de vacarme dans l’école que nous avons tant vue sur les boulevards,—rappelez-vous-en la vie et la malice, et vous comprendrez la froideur du tableau de M. Decamps,—pour les qualités probables que j’ai mentionnées plus haut,—je suis tout à fait incapable de les apprécier, et, si elles existent, elles n’en existent pas moins pour cela.
C’est un argument qu’on m’oppose habituellement pour la peinture et pour la musique.—En fait de musique, je n’ai jamais que sonné de la trompe,—et, en dessin, je n’ai jamais fait un nez au profil.—Je réponds que les peintres et les musiciens ne faisant pas de la peinture et de la musique entre eux, et postulant au contraire les suffrages du public, on doit attendre d’eux des ouvrages qui aient un charme qu’on puisse éprouver sans être peintre ou musicien.—Si, pour admirer un tableau de M. Decamps, ou la musique de M. Meyer-Beer, il me faut travailler huit ans au Conservatoire et à l’atelier,—je ne vous cache pas que je me priverai d’un plaisir aussi laborieux.—Heureusement que ces messieurs ont assez souvent le bonheur de n’avoir pas besoin que nous soyons aussi savants. Quand un ignorant comme moi leur adresse un éloge, ils n’élèvent pas de réclamation.—Je ne juge que ce qui est à ma portée,—je laisse toutes réserves pour les arcanes de l’art.
Par exemple, je demanderai à M. Decamps comment il y a tant de poussière sur un sol aussi pierreux,—et pourquoi elle est si lourde.—Il faudrait un escadron de cavalerie pour soulever cette poussière de plomb.
Deux grands dessins de M. Decamps, placés en face de la sortie de l’école, ont des parties remarquables et d’un beau style;—mais pourquoi s’avise-t-il de faire ses chevaux d’après des bas-reliefs et non d’après des chevaux?—Les chevaux de profil, bas sur leurs jambes, à encolure roide des bas-reliefs, sont une impuissance;—si le sculpteur savait leur donner de la vie, du mouvement et de la couleur, je suppose qu’il s’en ferait un vrai plaisir. Pourquoi alors ne pas faire les lions d’après les lions du blason?
![]() M. Chevaudier est auteur d’un tableau qu’il appelle un Ruisseau
dans la campagne de Rome.—L’eau est bleue, les arbres sont
bleus,—l’herbe est bleue,—et l’auteur, voulant mettre un oiseau dans
un coin, a cherché un oiseau bleu et a peint un martin-pêcheur un peu
plus bleu qu’il ne faut.—Le paysage est animé par une bacchante qui se
laisse aller à de singulières exagérations.
M. Chevaudier est auteur d’un tableau qu’il appelle un Ruisseau
dans la campagne de Rome.—L’eau est bleue, les arbres sont
bleus,—l’herbe est bleue,—et l’auteur, voulant mettre un oiseau dans
un coin, a cherché un oiseau bleu et a peint un martin-pêcheur un peu
plus bleu qu’il ne faut.—Le paysage est animé par une bacchante qui se
laisse aller à de singulières exagérations.
![]() Je ne sais plus de qui est une Niobé vert-pomme qui pleure ses
enfants vert-choux.
Je ne sais plus de qui est une Niobé vert-pomme qui pleure ses
enfants vert-choux.
![]() Mais où est donc la foule compacte qui m’empêche de voir le tableau
de M. Biard? «Voici le tableau,» me dit quelqu’un qui
m’accompagnait;—pour la foule, elle se compose d’un monsieur en
redingote verte qui se presse devant.
Mais où est donc la foule compacte qui m’empêche de voir le tableau
de M. Biard? «Voici le tableau,» me dit quelqu’un qui
m’accompagnait;—pour la foule, elle se compose d’un monsieur en
redingote verte qui se presse devant.
J’attends que ce monsieur se soit écoulé, et je me presse à mon tour devant le Passage du Havre à Honfleur; c’est tout simplement une caricature triviale.
![]() Mais voici une chose véritablement intéressante,—et qui vous
laisse longtemps pensif.—Voici un tableau inachevé,—la Vierge et saint
Joseph sont endormis et l’enfant-Dieu lève ses yeux au ciel;—la tête de
la Vierge, pleine d’une angélique suavité, est seule terminée.—Bouchot
est mort sans pouvoir achever son tableau;—on voit encore les lignes
faites à la craie de l’esquisse:—ce qui est fait est d’une grande
beauté.
Mais voici une chose véritablement intéressante,—et qui vous
laisse longtemps pensif.—Voici un tableau inachevé,—la Vierge et saint
Joseph sont endormis et l’enfant-Dieu lève ses yeux au ciel;—la tête de
la Vierge, pleine d’une angélique suavité, est seule terminée.—Bouchot
est mort sans pouvoir achever son tableau;—on voit encore les lignes
faites à la craie de l’esquisse:—ce qui est fait est d’une grande
beauté.
Trois autres tableaux offrent le même intérêt et une partie des mêmes qualités.
![]() Ceci est un tableau de M. Bidault, de l’Institut,—et l’un des
membres de ce jury d’admission; ou, si vous voulez, de ce jury de
refus—contre lequel on élève un si magnifique concert de malédictions.
Ceci est un tableau de M. Bidault, de l’Institut,—et l’un des
membres de ce jury d’admission; ou, si vous voulez, de ce jury de
refus—contre lequel on élève un si magnifique concert de malédictions.
Je renvoie encore mes lecteurs pour ce sujet aux volumes qui ont parlé des deux dernières expositions.
Disons seulement que deux tableaux de M. Gudin, qu’il avait oublié de signer, ont été parfaitement refusés.
M. Bidault est, assure-t-on, l’un des plus grands refuseurs du jury;—c’est donc à lui un louable courage d’exposer ainsi son tableau au jugement de ses victimes.
J’aurais voulu voir plus de monde devant un tableau aussi curieux.—Les peintres refusés devraient au moins étudier, dans une contemplation assidue de l’œuvre de M. Bidault, quelles beautés il faut chercher, quels défauts il faut fuir pour mériter l’indulgence du jury. Voici le sujet du tableau 137:—Vue de Mycènes et d’une partie de la ville d’Argos.
«Le site que le peintre a voulu représenter est celui qui se trouve indiqué dans les premiers vers de l’Electre de Sophocle. Oreste, son gouverneur et Pylade, tous trois partis de la Phocide, arrivent à Mycènes, et le gouverneur indique à Oreste les temples et les principaux monuments qui composent cette ville. Pendant un dialogue entre ces deux héros, Pylade est occupé à cacher dans les broussailles le vase d’airain qui est censé renfermer les cendres d’Oreste.»
Je crois devoir, de l’étude que j’ai faite du tableau en question, pouvoir tirer une poétique à l’usage des jeunes peintres. Homère n’a pas fait ses poëmes d’après les règles d’Aristote,—comme il serait facile de le démontrer.—C’est, au contraire, Aristote qui a fait sa poétique d’après l’Iliade et l’Odyssée.—Voici le résumé de mon travail:
Voulez-vous peindre Mycènes?—Beaucoup croiraient travailler d’après nature et suivraient tout pensifs le chemin de Mycènes.—C’est une voie parfaitement fausse.—M. Bidault peint d’après des vers de Sophocle.—Il veut représenter Mycènes,—il place dans son tableau la Madeleine, la Chambre des députés, l’Hôtel-Dieu,—l’église Notre-Dame-de-Lorette et cinq ou six bornes-fontaines.—Si Mycènes n’est pas comme cela, tant pis pour Mycènes,—C’est elle qui a tort.
Pour l’eau,—vous croyez peut-être devoir lui donner de la transparence et de la limpidité?—Autre erreur, ce serait alors comme de l’eau véritable.—Quoi de plus commun que de l’eau?—Si vous faites de l’eau semblable à la vraie eau, j’aime mieux regarder couler l’eau de la Seine que de regarder votre tableau.
Pour les personnages,—il est bon d’attacher quelquefois un bras à l’oreille pour mettre un peu de variété dans les bras attachés à l’épaule, ce qui est du dernier commun. (Voir le gouverneur.)
Il est des parties du corps humain qu’on est convenu de dérober aux yeux,—et que beaucoup de peintres représentent cependant comme tout le reste.—Vous comprenez, dans un personnage, vu de dos, tout ce qu’on évite d’inconvenant en lui faisant partir les jambes du milieu des reins. (Voir le personnage, en char, dans le fond, traînant, avec un cheval de bois, un petit canon de cuivre comme en font les enfants.)
Vous trouverez un nouvel exemple de la variété qu’il est bon de mettre dans les bras dans Pylade, qui cache le vase d’airain;—vous tâchez sans cesse de donner à vos personnages des bras de longueur égale,—eh bien! cela n’est pas vrai; il y a beaucoup de gens qui ont des bras inégaux.
J’ai entendu dire,—par un mauvais plaisant, que le vase d’airain était une casserole de cuivre; par un autre, que Pylade cueille une citrouille sur un olivier; ces critiques n’ont aucun sens,—attendu que le livret dit positivement que c’est un vase d’airain que Pylade cache dans des broussailles;—si c’était une casserole, il ne coûtait pas plus à M. Bidault de mettre au livret que c’était une casserole;—également, si c’était une citrouille, rien ne l’empêchait de mettre une citrouille; il est donc évident que c’est un vase d’airain.
Je désire que ces quelques conseils puissent servir aux jeunes peintres.
![]() Il y a une impression que d’autres ont dû ressentir comme moi;—en
tout cas la voici:
Il y a une impression que d’autres ont dû ressentir comme moi;—en
tout cas la voici:
L’autre jour, je vis ouverte la partie de la galerie, séparée par un rideau, qui ne renferme que des tableaux des maîtres anciens;—j’y entrai et je sentis à l’instant même un grand calme dans tous mes sens.
Dans les galeries que je venais de quitter,—c’était à l’œil une confusion presque bruyante; la lumière, divisée violemment entre les tableaux qui se disputaient les rayons, s’éparpillait en tons durs et heurtés;—il semblait qu’elle fût mise au pillage,—et que toutes ces images, comme une peuplade d’Esquimaux, s’arrachassent les lambeaux de lumière, les rouges et les bleus les plus féroces.—C’était un charivari de couleurs,—un tintamarre de tons crus et hostiles.
Mais tout à coup succéda une harmonie calme et paisible; il semblait qu’on passât d’un cabaret en tumulte dans un salon de bonne compagnie.
J’y restai quelque temps pour me reposer, et je pris la fuite.
![]() Qu’ai-je encore vu?—un turban dans une baignoire, par M.
Court,—un paysage vrai, mais un peu commun, de M. Flers;—de bien jolis
enfants de madame Boulanger;—un beau tableau par Troyon;—des marines
très-estimables de M. Gilbert de Brest;—un gué de M. Loubon, vrai et
d’une bonne couleur;—un joli tableau de mademoiselle Colin;—beaucoup
d’ânes dont quelques-uns semblent peints par eux-mêmes, comme les
Français de M. Curmer;—des bonshommes en fer-blanc par M. Hesse.
Qu’ai-je encore vu?—un turban dans une baignoire, par M.
Court,—un paysage vrai, mais un peu commun, de M. Flers;—de bien jolis
enfants de madame Boulanger;—un beau tableau par Troyon;—des marines
très-estimables de M. Gilbert de Brest;—un gué de M. Loubon, vrai et
d’une bonne couleur;—un joli tableau de mademoiselle Colin;—beaucoup
d’ânes dont quelques-uns semblent peints par eux-mêmes, comme les
Français de M. Curmer;—des bonshommes en fer-blanc par M. Hesse.
![]() J’ai déjà parlé, il y a un an, de cette question des sucres qui
cause aujourd’hui tant de rumeur;—je ne la mentionne aujourd’hui que
parce qu’elle me rappelle une caricature faite sous l’Empire, à l’époque
où Napoléon voulait absolument du sucre de n’importe quoi.
J’ai déjà parlé, il y a un an, de cette question des sucres qui
cause aujourd’hui tant de rumeur;—je ne la mentionne aujourd’hui que
parce qu’elle me rappelle une caricature faite sous l’Empire, à l’époque
où Napoléon voulait absolument du sucre de n’importe quoi.
On voyait le petit roi de Rome—faisant une grimace horrible à une betterave qu’il tenait à la main,—sa nourrice lui disait: «Mange donc, petit, ton papa dit que c’est du sucre.»
![]() M*** est un homme économe qui se défie des tailleurs—achète son
drap lui-même et donne ses habits à façon. Dernièrement, il demande
son tailleur,—qui prend mesure en tous sens et lui déclare qu’il n’y a
pas moyen de lui faire une redingote avec le coupon d’étoffe qu’il a
acheté. Il le chasse ignominieusement et en demande un autre.—Celui-ci
arrive, prend l’étoffe et promet l’habit pour dans deux jours.
M*** est un homme économe qui se défie des tailleurs—achète son
drap lui-même et donne ses habits à façon. Dernièrement, il demande
son tailleur,—qui prend mesure en tous sens et lui déclare qu’il n’y a
pas moyen de lui faire une redingote avec le coupon d’étoffe qu’il a
acheté. Il le chasse ignominieusement et en demande un autre.—Celui-ci
arrive, prend l’étoffe et promet l’habit pour dans deux jours.
—Apportez la note.
—Volontiers.
Le troisième jour, le tailleur arrive avec l’habit, qui est bien fait et d’une ampleur suffisante.
—Et la note?
—Ah! mon Dieu, je l’ai oubliée;—je l’avais mise sur l’établi avec mes gants, j’ai laissé les gants et la note.
On sonne. Un domestique arrive et dit:
—C’est le fils du tailleur.
Celui-ci se trouble.
—Que veut-il? demande M. M***.
—Il demande son père.
—Faites-le entrer.
Le tailleur s’oppose à ce qu’on fasse entrer son fils:
—Sans doute, c’est la note qu’il m’apporte.
—Eh bien! qu’il entre.
—Le tailleur se trouble de plus en plus,—surtout quand entre le gamin orné d’une veste d’un drap tout à fait pareil à celui de la redingote.
—Que viens-tu faire, brigand?
—C’est maman qui m’a envoyé à cause de la note.
—Donne et sauve-toi.
Mais, pendant ce temps, M. M*** tient l’enfant par la veste et s’assure de l’identité du drap.
—Oh ça! maître,—comment se fait-il que mon autre tailleur n’ait pas pu me faire une redingote—quand, vous, vous m’avez fait une redingote et une veste à votre fils.
—Monsieur,—dit le tailleur, qui a repris tout son sang-froid,—c’est qu’il a probablement un fils plus grand que le mien.
![]() Voici ce qu’on lit dans un journal:
Voici ce qu’on lit dans un journal:
Au recto.
«Le nouveau drame de M. Alexandre Dumas, Lorenzino, qui a été représenté hier au Théâtre-Français, est une de ces compositions romantiques qui n’ont aucune chance de durée. C’est une véritable chute, et cependant, M. Alexandre Dumas aurait recueilli tous les traits de génie qui caractérisent la nouvelle école: duel, enterrement, procession de religieuses, confession, absolution, empoisonnement, guet-apens et assassinat.
«On s’étonne à bon droit que les comédiens français, dont le répertoire se compose de tant de chefs-d’œuvre, consentent encore à jouer le drame romantique, qui n’est plus maintenant qu’une vieillerie. Les meilleurs acteurs perdent leur talent en jouant ces pièces, dont le style trivial ne peut prêter qu’au ridicule et à l’ennui. Nous reviendrons sur ce drame, si l’on prétend l’IMPOSER encore au public.»
Au verso:
«Lorenzino, drame nouveau de M. Alexandre Dumas, a produit le PLUS GRAND EFFET avant-hier soir au Théâtre-Français. Ce soir, on donne la deuxième représentation de ce BEL OUVRAGE. Il sera précédé des Rivaux d’eux-mêmes.»
![]() Il existe à Rouen—un homme appelé Lebarbier—qui vend du beau
temps;—on a jusqu’ici vendu bien des choses; mais c’est, je crois, la
première fois qu’on imagine de vendre du soleil.—Il répand des
prospectus—dont je donne un à copier à MM. les imprimeurs.
Il existe à Rouen—un homme appelé Lebarbier—qui vend du beau
temps;—on a jusqu’ici vendu bien des choses; mais c’est, je crois, la
première fois qu’on imagine de vendre du soleil.—Il répand des
prospectus—dont je donne un à copier à MM. les imprimeurs.
PIERRE-LOUIS LEBARBIER,
FRANÇAIS,
DOMINATMOSPHÉRISATEUR,
DOMINATURALISATEUR,
Rue aux Ours, nº 32, à Rouen.
Souscription par chaque Boutique à la Foire, Étalagistes, Débitants, Aubergistes, à l’effet d’obtenir du beau temps la veille, le jour de Fête donnée par un Particulier, jour de Noce,
Cette Souscription sera payée d’avance dans les mains dudit sieur LEBARBIER, à son domicile précité, sauf par lui de la rendre, dans le cas contraire.
| IL FAUT AU MOINS CINQUANTE SOUSCRIPTEURS. | ||||
| IL Y A UN DIXIÈME POUR LES PAUVRES. | ||||
| La veille de la Foire | » | fr. | 75 | c. |
| Le jour de la Foire | 1 | » | ||
| Jours suivants | » | 50 | ||
| Jour de marché | » | 50 | ||
| Jour de Fête donnée par un Particulier, ou jour de Noce | 10 | » | ||
| Entretien ou conférence sur une infinité d’objets d’intérêt particulier ou public, par quart d’heure | » | 75 | ||
| Réponse et moyens écrits, la page | 5 | » | ||
Le même Louis Lebarbier—donne des séances de moralisation;—le prospectus de ces séances contient une particularité que je recommande aux donneurs de concerts, etc.
«En attendant la séance, les hommes sont servis d’un verre de cognac, et les dames d’un verre de bavaroise.»
![]() M. Listz est un homme de talent;—mais lui, qui, en France, était
devenu Français,—qui a reçu à Paris une si grande hospitalité, qui se
disait avec orgueil le frère de tous nos grands hommes, quels qu’ils
fussent,—devrait démentir, dans les journaux où il fait dire tant de
choses,—le bruit qu’on répand—qu’il chante dans des banquets, en
Allemagne, des chansons où les Français sont traités un peu plus mal que
des chiens.
M. Listz est un homme de talent;—mais lui, qui, en France, était
devenu Français,—qui a reçu à Paris une si grande hospitalité, qui se
disait avec orgueil le frère de tous nos grands hommes, quels qu’ils
fussent,—devrait démentir, dans les journaux où il fait dire tant de
choses,—le bruit qu’on répand—qu’il chante dans des banquets, en
Allemagne, des chansons où les Français sont traités un peu plus mal que
des chiens.
Les lecteurs des Guêpes savent, du reste, ce que je pense, pour ma part, de ces chansons dites patriotiques, sur quelque air et dans quelque pays qu’on les chante.
![]() Un écrivain a épousé une Anglaise;—il y a, dans le contrat de
mariage, une clause qui dit que les enfants naîtront
Anglais.—Quelqu’un, prenant singulièrement à la lettre—cette
formule,—disait:
Un écrivain a épousé une Anglaise;—il y a, dans le contrat de
mariage, une clause qui dit que les enfants naîtront
Anglais.—Quelqu’un, prenant singulièrement à la lettre—cette
formule,—disait:
—Ah ça, c’est bien embarrassant d’aller comme cela faire ses enfants en Angleterre.
—Surtout pour M***, répondit-on, qui n’en peut faire en France.
![]() Au dernier bal donné par madame la duchesse de M.,
Au dernier bal donné par madame la duchesse de M.,
—M. de B.—s’est laissé aller, après le souper, aux danses les plus hasardées.—Rien, du reste, de si imminent que l’invasion dans la haute société, des danses bizarres,—telles que le cancan,—la béquillade,—la chaloupe, etc.
![]() On lisait dernièrement dans les journaux l’horrible phrase que
voici:
On lisait dernièrement dans les journaux l’horrible phrase que
voici:
«NANTES, mars.—Près de cent idiots ou aliénés non furieux vont être, d’ici à quelques jours, expulsés de l’hospice de Saint-Jacques, par suite de l’insuffisance de l’allocation faite par le conseil général pour cet exercice;—tous ces malheureux vont errer dans la ville, sans asile et sans pain.»
Je serais assez d’avis qu’on profitât de ce que l’hôpital est libre pour y renfermer ledit conseil général.
![]() Plusieurs personnes m’ont écrit que j’avais inventé M. Dubignac; M.
Dubignac m’a fait l’honneur de venir me voir en personne:—c’est un
homme un peu âgé, mais parfaitement conservé.—Il a bien voulu m’offrir
quelques-uns de ses ouvrages,—en remercîment, m’a-t-il dit, de la
mention équitable que j’ai faite de lui.—M. Dubignac paraît décidé à ne
pas faire de visites à messieurs de l’Académie: je ne sais si je puis me
flatter d’avoir ébranlé sa résolution.—Je veux faire partager à mes
lecteurs, par quelques citations prises ça et là, le plaisir que m’a
procuré le présent de M. Dubignac.
Plusieurs personnes m’ont écrit que j’avais inventé M. Dubignac; M.
Dubignac m’a fait l’honneur de venir me voir en personne:—c’est un
homme un peu âgé, mais parfaitement conservé.—Il a bien voulu m’offrir
quelques-uns de ses ouvrages,—en remercîment, m’a-t-il dit, de la
mention équitable que j’ai faite de lui.—M. Dubignac paraît décidé à ne
pas faire de visites à messieurs de l’Académie: je ne sais si je puis me
flatter d’avoir ébranlé sa résolution.—Je veux faire partager à mes
lecteurs, par quelques citations prises ça et là, le plaisir que m’a
procuré le présent de M. Dubignac.
![]() Une vieille femme est traduite en police correctionnelle sous
prévention de mendicité;—on fait une perquisition à son domicile,—on
trouve dix-huit cents francs dans sa paillasse.
Une vieille femme est traduite en police correctionnelle sous
prévention de mendicité;—on fait une perquisition à son domicile,—on
trouve dix-huit cents francs dans sa paillasse.
Les mendiants ont pris depuis quelques années, s’il faut en croire les journaux, l’habitude d’avoir dix-huit cents francs dans leur paillasse.
![]() Les journaux sont dans un abattement profond,—l’ordre de choses
actuel se consolide;—tous les arrivés tirent chacun sa PETITE
ÉCHELLE.—C’est en vain que ceux qui voulaient monter après eux
s’efforcent de les retenir. Les gens arrivés maintenant—auront
probablement à passer par toutes les phases qu’ont franchies les castes
qui ont disparu en juillet 1830. Ils agissent à découvert;—ils avouent
par leurs actes que leur patriotisme était de l’envie,—et que ce qu’ils
ont renversé, ils n’ont jamais voulu le détruire, mais s’en emparer.
D’autre part, comme ceux qui les attaquent feraient juste les mêmes
choses,—nous n’y perdons et nous n’y gagnons rien;—seulement il se
glisse dans les esprits une grande indifférence politique.—Les têtes,
comme le thermomètre, ont baissé en France de dix degrés.
Les journaux sont dans un abattement profond,—l’ordre de choses
actuel se consolide;—tous les arrivés tirent chacun sa PETITE
ÉCHELLE.—C’est en vain que ceux qui voulaient monter après eux
s’efforcent de les retenir. Les gens arrivés maintenant—auront
probablement à passer par toutes les phases qu’ont franchies les castes
qui ont disparu en juillet 1830. Ils agissent à découvert;—ils avouent
par leurs actes que leur patriotisme était de l’envie,—et que ce qu’ils
ont renversé, ils n’ont jamais voulu le détruire, mais s’en emparer.
D’autre part, comme ceux qui les attaquent feraient juste les mêmes
choses,—nous n’y perdons et nous n’y gagnons rien;—seulement il se
glisse dans les esprits une grande indifférence politique.—Les têtes,
comme le thermomètre, ont baissé en France de dix degrés.
![]() Voici la copie authentique d’un certificat délivré à un domestique:
Voici la copie authentique d’un certificat délivré à un domestique:
«Je soussigné, doyen des colonels, des chevaliers de Saint-Louis et des gentilshommes domiciliés dans l’arrondissement communal du***, électeur du département de la Seine-Inférieure, otage et volontaire royal, ancien commissaire de la noblesse aux états de Bretagne et en d’autres assemblées légalement délibérantes, associé de plusieurs Académies royales d’histoire, sciences et belles-lettres, commissaire de l’association paternelle des chevaliers de Saint-Louis et du mérite militaire pour le canton municipal de***, certifie que Pierre*** m’a toujours servi fidèlement et avec zèle, en foi de tout quoi j’ai délivré le présent avec apposition de l’empreinte du cachet de mes armes.
»Fait ce..., au château de***, commune dont feu mon père, aussi officier supérieur et chevalier de Saint-Louis, était, par longue dépendance et succession patrimoniale, seigneur paroissial et haut justicier au 4 août 1789, et dont je suis depuis plusieurs années doyen du conseil municipal, n’en ayant point accepté la mairie, que les règlements ne rendaient pas compatible avec ma place de chef d’une légion nationale par laquelle j’ai longtemps exercé un commandement à la fois régulier, paternel et fraternel, supprimé par les dernières ordonnances relatives à ce corps ou à cette arme.
»Le vicomte T. de R.»
![]() En ce moment où les nouvelles routes et les tracés de chemins de
fer entraînent de nombreuses expropriations,—il est assez curieux
d’entendre les doléances des propriétaires dont les terrains sont
écornés.
En ce moment où les nouvelles routes et les tracés de chemins de
fer entraînent de nombreuses expropriations,—il est assez curieux
d’entendre les doléances des propriétaires dont les terrains sont
écornés.
Voici quelques-uns de ces cris, partant de l’âme, que j’ai recueillis:
Un propriétaire auquel on prend trois pommiers parfaitement payés sur estimation légale:
«Ah! monsieur, vous prenez ces trois-là;—mais, monsieur, il n’y a pas de pommiers comme ceux-là pour faire le bonheur d’une famille. Le cidre qu’ils donnent est parfait; je n’ai acheté tout le verger que pour ces trois pommiers.»
Un autre auquel on prend sa haie—(toujours en payant):
«Il peut bien prendre tout,—ça m’est bien égal.—Qu’est-ce que c’est qu’un champ qui n’a pas de haie?—j’aime mieux ne rien avoir.»
Un autre auquel on achète la moitié d’un champ:
«Quelle terre je vous abandonne!—l’année dernière j’y ai récolté des pommes de terre grosses comme les deux poings;—dans la moitié qui me reste, il n’y a que de la pierraille.»
A entendre les propriétaires, on croirait qu’il n’y avait de fertilité dans le pays que précisément sur une longueur de huit mètres et sur une largeur de douze cents, et que tout le reste n’est que landes et steppes.
![]() «Il s’est agité devant la chambre des requêtes une question d’une
haute gravité pour le commerce de France.
«Il s’est agité devant la chambre des requêtes une question d’une
haute gravité pour le commerce de France.
«On sait avec quelle avidité le commerce étranger contrefait les objets de notre fabrication, emprunte les marques, le nom des maisons les plus renommées de France dans les différents genres d’industrie.
»Quelques-uns de nos négociants ont pensé que le seul moyen de neutraliser les funestes effets de cette déloyale rivalité était d’user de représailles envers le commerce étranger.
»C’est ainsi que la maison Guélaud, de Paris, avait vendu en France un article recherché de parfumerie, sous l’adresse de la maison Rewland, de Londres.
»Cette dernière maison s’adressa aux tribunaux français pour obtenir des dommages-intérêts, qui lui furent accordés, par arrêt de la Cour de Paris du 30 novembre 1840.
»Sur le pourvoi formé contre cet arrêt s’élevait la question, fort importante, de savoir si les fabricants étrangers peuvent poursuivre en France la contrefaçon de leur marque ou de leur nom.
»La Cour, sur la plaidoirie de Me Ledru-Rollin, au rapport de M. le conseiller Hervé, et sur les conclusions de M. l’avocat général Delangle, a admis le pourvoi.
»C’est un succès pour le commerce français.»
Je trouve le succès assez joli.—Les succès de ce genre sont prévus par les codes de tous les pays.
Le roi Louis-Philippe et le jardinier de Monceaux.—Un concurrent à M. Émile Marco de Saint-Hilaire.—Propos légers d’une Dame.—M. de Lamartine au château.—M. Aimé Martin et la reine d’Espagne.—Le sucre.—Les rues de Paris.—Les morts d’avril.—M. Boursault.—Le duc de Joinville.—Un costume complet.—M. Lacave-Laplagne et M. Royer-Collard.—Un bon livre.—Dialogue de M. d’Arlincourt.—Un vicaire général et un curé.—M. Surgis.—Éloge d’un tailleur.—M. Nodier et M. Flourens.—Les eaux.—M. Perlet.—M. Romieu et le Cid.—Un triomphe de M. de Balzac.—M. Roger de Beauvoir au contrôle des Folies-Dramatiques.—Un bruit sur M. Hugo.—De M. Delecluse.—Comme quoi il est brouillé avec la nature.—Un souvenir historique.—Opinion d’un journaliste de 1780 sur les fortifications de Paris.—Encore le droit de visite.—Une nouvelle muse.—Bévue d’une Académie.—Un homme qui a de l’huile à vendre.—Le premier mai.
On dit que le roi va vendre son jardin de Monceaux,—et qu’on y bâtira un nouveau quartier;—des maisons vont remplacer les arbres séculaires, et des rues pavées les belles pelouses du jardin dirigé par Schœne.—Je ne sais pourquoi cela m’attriste:—j’y suis allé plusieurs fois dans ma première jeunesse,—en mon avril,—comme disaient les vieux poëtes,—et je me rappelle les pensées et les rêves que j’ai portés dans les silencieuses allées de ce pauvre jardin;—il me semble que ces souvenirs, ces rêveries,—ces méditations—vont être, avec les chênes et les acacias,—débités en rondins et en fagots, et vendus au stère et à la voie.
J’ai prononcé le nom de Schœne,—je vais vous parler un peu de lui:—c’est un caractère remarquable,—un philosophe pratique,—un homme simple, bon et fier;—vous le connaîtrez mieux par deux ou trois petites anecdotes que par les phrases que je pourrais vous faire.
Schœne se lève le matin, revêt une veste de la plus grossière étoffe qui n’a pas changé de mode depuis vingt ans,—et allume sa pipe;—cette pipe ne s’éteint que le soir lorsque Schœne s’endort.
Il travaille avec ses garçons jardiniers, et réserve pour lui les travaux les plus durs, et ceux que l’on donne d’ordinaire au plus ignorant de ses ouvriers.
Un jour, le roi, visitant Monceaux, lui dit:
—Ah ça! Schœne, quel diable de tabac fumez-vous? les serres en sont infectées, c’est ce qui fait que la reine n’ose pas y entrer.
—C’est vrai, sire, répondit Schœne, mais cela ne peut pas être autrement,—tout le monde sait que les plantes de serres sont exposées à un ennemi dangereux, qui est le puceron vert;—le seul moyen de les écarter est la fumée du tabac;—or, comme j’aime que mes plantes soient propres et non pas mangées par les pucerons,—je dois faire, dans les serres, des fumigations de tabac;—comme d’autre part j’aime beaucoup à fumer, je fais passer cette fumée par ma bouche,—les plantes ne s’en trouvent pas plus mal, et moi je m’en trouve mieux;—si cependant Votre Majesté ne veut pas que je fume dans son domaine de Monceaux, j’irai tous les jours fumer dehors, mais cela doublera ma dépense en tabac.
Le roi lui dit:
—Fumez où vous voudrez.
![]() Un autre jour, un chien, ordinairement d’assez mauvais caractère,
brisa sa chaîne et vint auprès de la reine, dont il lécha les
souliers.—Le roi dit à Schœne:
Un autre jour, un chien, ordinairement d’assez mauvais caractère,
brisa sa chaîne et vint auprès de la reine, dont il lécha les
souliers.—Le roi dit à Schœne:
—Votre chien est bien doux pour la reine.
—Oui, sire, répondit le jardinier, qui est Allemand et parle assez difficilement français; oui, il a des dispositions à la servilitude.
![]() Le roi donna l’ordre de construire un énorme manége; l’architecte
choisit pour cette construction précisément la partie du jardin où
Schœne mettait sa magnifique collection d’œillets allemands et ses
plantes de terre de bruyère, ses rhododendrums, ses magnalia, kalmia,
azalea.
Le roi donna l’ordre de construire un énorme manége; l’architecte
choisit pour cette construction précisément la partie du jardin où
Schœne mettait sa magnifique collection d’œillets allemands et ses
plantes de terre de bruyère, ses rhododendrums, ses magnalia, kalmia,
azalea.
(A propos, on n’a pas encore trouvé l’azalea grimpant de M. de Balzac.)
On vint dire à Schœne,—de la part du roi,—d’arracher toutes ses plantes de terre de bruyère, de les placer ailleurs et d’en avoir le plus grand soin.
—Dites de ma part au roi, répondit Schœne indigné, que les soins que je prendrai ne me fatigueront pas; j’arracherai tout,—et je f..... tout par-dessus le mur, dans la rue.—Dites encore au roi—que je veux partir et qu’il me fasse mon compte.
Depuis ce temps on n’a jamais revu à Monceaux d’œillets ni de plantes de terre de bruyère;—c’est une singularité que bien des promeneurs ont sans doute remarquée sans en deviner la raison.
Je ne sais si on rendit bien fidèlement au roi la réponse de Schœne; mais j’ignore si le roi répliqua.
Toujours est-il qu’à quelque temps de là le roi alla voir le manége qu’il avait fait faire.
Schœne, qui n’était pas consolé du sort de ses plantes, aperçut le roi et se sauva d’un autre côté. Le roi s’en aperçut et l’appela; mais Schœne feignit d’être fort occupé et ne répondit pas.—Le roi appela une seconde fois sans plus de succès; à la troisième il appela si fort, qu’il n’y avait pas moyen de ne pas entendre.—D’ailleurs Schœne était attendri de cette persévérance.—Il se retourna et dit brusquement:
—Qu’est-ce que vous me voulez, sire?
Le roi, qui n’ignorait pas la cause de sa mauvaise humeur,—voulut essayer de l’adoucir et lui dit:
—Ah ça! qu’est-ce qu’ils m’ont fait là? On dirait une église du temps de Louis XIII;—ce n’est pas ce que j’avais demandé.
—Si vous ne l’aviez pas ordonné, dit Schœne, on ne l’aurait pas fait.—Votre Majesté a perdu Monceaux avec cette affreuse baraque; elle en est bien le maître.
(Que dirait donc Schœne, bon Dieu! s’il voyait la galerie de bois pendue et accrochée comme un garde-manger de bonne femme, contre une galerie du Louvre?)
Cette fois cependant on causa et on se raccommoda. Lorsque Louis-Philippe était encore duc d’Orléans, longtemps avant les anecdotes que je viens de vous raconter, on avait beaucoup tourmenté Schœne pour qu’il portât la livrée du prince;—il refusa positivement.—Quand le duc d’Orléans fut roi de France,—un jour qu’il se promenait à Monceaux, il dit à Schœne:
—Schœne, vous n’avez pas voulu porter la livrée du duc d’Orléans, porterez-vous celle du roi des Français?
—Pas davantage, sire, je ne suis pas domestique, je suis jardinier;—vous seriez empereur, que ce serait la même chose:—j’aime mieux m’en aller.
Le roi rend justice à Schœne et l’aime beaucoup;—il a défendu qu’on lui fît jamais aucune plainte contre son favori.
![]() J’avertis—M. E. Marco—de Saint-Hilaire—qu’il y a dans la commune
que j’habite un pêcheur qui lui fait une assez sérieuse
concurrence.—Voici un souvenir intime de l’Empire—qu’il m’a conté
l’autre jour, et qui ne le cède en rien à ceux de l’ancien page du
palais:
J’avertis—M. E. Marco—de Saint-Hilaire—qu’il y a dans la commune
que j’habite un pêcheur qui lui fait une assez sérieuse
concurrence.—Voici un souvenir intime de l’Empire—qu’il m’a conté
l’autre jour, et qui ne le cède en rien à ceux de l’ancien page du
palais:
—Eh bien, maître Vincent, lui dis-je, avons-nous quelque chose ce matin?
—Un peu de bouquet, me dit-il.
—Le vendez-vous bien?
—Mais, oui;—deux sous chaque.
—J’en ai vendu plus cher que ça.—C’était du temps de l’empereur;—je revenais de mon parc,—et l’empereur montait voir les phares avec toute l’armée et plusieurs officiers.
Comme je passais près de lui avec mes lanets et mes candelettes sur une épaule et une manne de bouquets sur l’autre,—quelques généraux s’arrêtèrent pour voir ce que je portais; l’empereur revint au galop pour voir ce que regardaient ses maréchaux.
—S.... n.. de D....—me dit-il,—qu’est-ce que tu portes là?
—Votre Majesté,—que je lui répondis—en ôtant mon chapeau,—c’est du bouquet que par le Nord ils appellent selicoque.
—S.... n.. de D...,—répliqua l’empereur;—voilà de beau bouquet,—porte-le à mon hôtel.
Il remit son cheval au galop et alla voir les phares.
Moi, j’allai le soir à l’hôtel,—où l’empereur me fit donner quatre sous pour chaque bouquet, avec beaucoup de viande.
![]() Le S.... n.. de D...,—que prête maître Vincent à l’empereur,—sera
peut-être révoqué en doute par M. Émile Marco. Je lui avouerai—que ce
pourrait bien être un agrément qu’ajoutent volontiers au récit les gens
de la localité.
Le S.... n.. de D...,—que prête maître Vincent à l’empereur,—sera
peut-être révoqué en doute par M. Émile Marco. Je lui avouerai—que ce
pourrait bien être un agrément qu’ajoutent volontiers au récit les gens
de la localité.
Il y a un jardinier que je vais voir quelquefois et qui a de fort belles plantes; dernièrement,—je lui marchandais un delphinium azureum:
—Il est fort beau,—disais-je.
—J’en avais deux pareils,—répondit-il,—mais madame *** (je ne mets pas le nom, qui est fort connu), madame *** est venue l’autre jour, et m’a dit:
—Ah, sacredieu!—il faut que vous me vendiez un de vos delphiniums.
![]() Chapelain était, sous Louis XIV,
Chapelain était, sous Louis XIV,
de même le roi Louis-Philippe ne reconnaît d’écrivain moderne que M. Casimir Delavigne.—Sa Majesté pousse si loin ce dédain pour la littérature contemporaine, que, dans un dîner où se trouvait invité M. de Lamartine comme député de Mâcon, le roi fit semblant d’ignorer qu’il eût jamais écrit, lui parla de choses indifférentes,—mais ne prononça pas un mot qui eût trait à la littérature ni à la poésie.
![]() On cite un mot assez singulier de la reine Christine.—Quelques-uns
disent que c’est fort spirituel; d’autres, que c’est fort naïf.—M. Aimé
Martin, admis à la faveur de lui être présenté, lui offrit obligeamment
ses ouvrages: «Merci, monsieur, dit-elle; je ne veux pas vous en
priver.»
On cite un mot assez singulier de la reine Christine.—Quelques-uns
disent que c’est fort spirituel; d’autres, que c’est fort naïf.—M. Aimé
Martin, admis à la faveur de lui être présenté, lui offrit obligeamment
ses ouvrages: «Merci, monsieur, dit-elle; je ne veux pas vous en
priver.»
![]() A propos des phares—dont je parlais tout à l’heure,—quelqu’un que
je ne nommerai pas, mais qui ne demeure pas loin de là, avait pris à la
fois un cheval et un domestique.—Il s’ensuivait que le domestique avait
un cheval, et que le cheval avait un domestique; mais lui n’avait ni
domestique ni cheval.
A propos des phares—dont je parlais tout à l’heure,—quelqu’un que
je ne nommerai pas, mais qui ne demeure pas loin de là, avait pris à la
fois un cheval et un domestique.—Il s’ensuivait que le domestique avait
un cheval, et que le cheval avait un domestique; mais lui n’avait ni
domestique ni cheval.
Un jour, le cheval et le domestique disparurent pendant quatre heures. Au retour, le maître, fâché, demanda au domestique:
—Ah ça! qu’as-tu fait et d’où viens-tu?
—Monsieur, répondit tranquillement celui-ci, cette pauvre bête... je l’ai menée voir les phares.
![]() Voici un résumé plus curieux qu’il n’en a l’air:
Voici un résumé plus curieux qu’il n’en a l’air:
Sous le règne de Henri IV, le sucre se vendait à l’once chez les apothicaires. En 1700, la consommation du sucre s’éleva, en France, à un million de kilogrammes.—La population était alors de seize millions d’hommes.—Cela faisait pour l’année, par personne, à peu près deux onces.—En 1815, on en consomma seize millions de kilogrammes.—Et, en 1841, cette consommation s’est élevée à plus de cent millions de kilogrammes.
Ceci peut donner le secret des embarras de la position actuelle.—Le sucre n’est pas la seule friandise dont l’usage se soit ainsi répandu.—Tout le monde veut être quelque chose dans l’État, comme tout le monde veut manger du sucre.
Il faut, à chaque période politique, trouver moyen de multiplier les parts de bonbons;—les anciennes grosses parts en sont fort diminuées.—Ceux qui les possédaient autrefois se contentent aujourd’hui d’avoir de gros cornets dans lesquels il n’y a presque rien; on les a vidés pour faire de petites parts à presque tout le monde.
En effet, il n’est aujourd’hui presque personne qui n’ait, sous un titre quelconque,—un petit morceau du sucre du pouvoir,—député,—électeur,—juré,—garde national,—membre de tel ou tel conseil,—de tel ou tel comité,—rédacteur de tel ou tel journal, etc.
Eh bien! il y a encore des gens qui n’ont pas leur part et qui crient,—qui demandent une réforme électorale;—ceux qui ont les grosses parts, tirées du cornet de la puissance royale,—ont peur qu’on ne tire de leur cornet pour faire de nouvelles petites parts:—comment faire?
On a déjà usé, en fait de pouvoir, de tous les expédients dont on a usé en fait de sucre pour égaliser la production et la consommation;—on a imaginé des équivalents au sucre de betteraves, au sucre brut,—à la cassonade et à la mélasse.
Mais tout le monde veut du sucre blanc;—mais tout le monde en veut beaucoup:—les nouveaux cornets se ferment avec frénésie, le cornet royal est vide ou peu s’en faut.
Comment faire?
![]() J’avais remarqué déjà la négligence de l’autorité qui permet au
monsieur chargé d’inscrire les noms des rues de Paris aux coins
d’icelles, de retrancher certains de au bénéfice probablement des
opinions politiques dudit monsieur peintre en lettres;—j’ai cité, je
crois, la rue Rohan, la rue Grammont et quelques autres;—mais on
m’a fait observer que cette suppression, loin d’être blâmable, provenait
au contraire d’un louable sentiment d’économie de la part des
administrateurs des deniers publics.—On sait, en effet, que ces
inscriptions se payent à tant la lettre,—et que toutes celles qu’on
peut retrancher sont un bénéfice net pour l’État.
J’avais remarqué déjà la négligence de l’autorité qui permet au
monsieur chargé d’inscrire les noms des rues de Paris aux coins
d’icelles, de retrancher certains de au bénéfice probablement des
opinions politiques dudit monsieur peintre en lettres;—j’ai cité, je
crois, la rue Rohan, la rue Grammont et quelques autres;—mais on
m’a fait observer que cette suppression, loin d’être blâmable, provenait
au contraire d’un louable sentiment d’économie de la part des
administrateurs des deniers publics.—On sait, en effet, que ces
inscriptions se payent à tant la lettre,—et que toutes celles qu’on
peut retrancher sont un bénéfice net pour l’État.
Je m’étais expliqué de même la désignation d’avenue Gabrielle donnée à cette allée des Champs-Élysées, dédiée jadis par la duchesse de Berry à la belle Gabrielle d’Estrées,—qui, certes, n’avait rien en son temps de l’existence incorporelle des archanges.
Mais je ne peux plus appliquer la même excuse à une transposition de lettres sans bénéfice, comme celle qu’on a fait subir sur l’arc de l’Étoile au glorieux nom d’Eckmuhl,—que l’on a écrit Eckmulh,—mais heureusement à une hauteur inaccessible à l’œil nu.
Mais comment expliquer surtout qu’on ait fait présent d’une lettre à l’historique famille de Beauvau, et que l’on ait écrit place Beauveau;—passe encore si l’on avait écrit Bovo,—l’économie justifiait la hardiesse;—mais Beauveau,—cette lettre n’a rien d’agréable et coûte de l’argent.
Je soumets cette nouvelle observation comme la première, et avec le même respect, à l’autorité compétente.
![]() Le mois d’avril, qui vient de finir, a vu mourir M. le ministre des
finances Humann; M. le maréchal Moncey; M. le maréchal Clauzel; M. le
général Castex; M. le général Heymès; M. Bertin de Vaux, pair de France;
M. de Rigny, conseiller d’État; M. le comte de Mesnard, premier écuyer
de la duchesse de Berry; M. Bouilly, doyen des auteurs dramatiques; M.
l’abbé Boyer, directeur du séminaire Saint-Sulpice; M. Aguado, marquis
de las Marismas, M. Boursault, membre de la Convention; M. le comte de
Sesmaisons; madame la baronne Virginie de Gazan, fille de Bernardin de
Saint-Pierre; madame la comtesse de Balby; madame la marquise de
Boisgelin; madame la comtesse de Sallaberry; madame Wanlerberghe, mère
de madame Jacqueminot et grand’mère de madame Duchâtel; M. de Lur
Saluces, ancien député; M. Beaupré, ancien danseur de l’Opéra; M.
Wilhem, inspecteur des écoles de chant; Antonio Espartero, frère du
régent d’Espagne, etc., etc.
Le mois d’avril, qui vient de finir, a vu mourir M. le ministre des
finances Humann; M. le maréchal Moncey; M. le maréchal Clauzel; M. le
général Castex; M. le général Heymès; M. Bertin de Vaux, pair de France;
M. de Rigny, conseiller d’État; M. le comte de Mesnard, premier écuyer
de la duchesse de Berry; M. Bouilly, doyen des auteurs dramatiques; M.
l’abbé Boyer, directeur du séminaire Saint-Sulpice; M. Aguado, marquis
de las Marismas, M. Boursault, membre de la Convention; M. le comte de
Sesmaisons; madame la baronne Virginie de Gazan, fille de Bernardin de
Saint-Pierre; madame la comtesse de Balby; madame la marquise de
Boisgelin; madame la comtesse de Sallaberry; madame Wanlerberghe, mère
de madame Jacqueminot et grand’mère de madame Duchâtel; M. de Lur
Saluces, ancien député; M. Beaupré, ancien danseur de l’Opéra; M.
Wilhem, inspecteur des écoles de chant; Antonio Espartero, frère du
régent d’Espagne, etc., etc.
Je ne cite que les personnages très-connus.
En général, on ne se rend pas bien compte de la mort même ou plutôt surtout de la sienne.—J’ai vu mourir, ces jours derniers, une pauvre fille qui souffrait beaucoup et qui disait: je serai bien contente quand ça sera fini.»
Je lis en même temps,—dans le testament du roi Gústave de Suède, mort il y a cinquante ans: «Si quelque auteur veut écrire des anecdotes concernant l’histoire de mon règne, je le verrai avec plaisir.»
![]() Un jour du printemps dernier, comme j’allais à Versailles déjeuner
avec quelques amis, je pris place dans un waggon du chemin de
fer.—Assis à côté de moi, se trouvait un vieillard d’une belle figure
avec de longs cheveux blancs,—coiffé d’une toque de velours noir et
vêtu d’une douillette violette,—un domestique était en face de nous et
tenait sur ses genoux une petite plante que mon voisin ne quittait pas
des yeux;—bientôt même, craignant quelque maladresse, il la prit et la
garda entre ses mains.
Un jour du printemps dernier, comme j’allais à Versailles déjeuner
avec quelques amis, je pris place dans un waggon du chemin de
fer.—Assis à côté de moi, se trouvait un vieillard d’une belle figure
avec de longs cheveux blancs,—coiffé d’une toque de velours noir et
vêtu d’une douillette violette,—un domestique était en face de nous et
tenait sur ses genoux une petite plante que mon voisin ne quittait pas
des yeux;—bientôt même, craignant quelque maladresse, il la prit et la
garda entre ses mains.
—Vous avez là, lui dis-je, un rhododendron qui n’est pas encore dans le commerce.
—C’est vrai, me répondit le vieillard; est-ce que vous êtes jardinier?
—Un peu, lui dis-je.
Notre connaissance se trouva faite.—Nous regardâmes ensemble les cerisiers qui étaient encore en fleurs sur la route. Comme nous étions près d’arriver, il me dit:
—J’ai de beaux rhododendrons en fleurs,—voulez-vous les venir voir?
—Volontiers, repris-je?
Je lui offris le bras pour descendre du waggon.
—Je vous remercie de votre politesse, me dit-il, mais je n’en ai pas encore besoin.
En effet, il était leste et dispos;—il remit le petit rhododendron au domestique, nous prîmes une sorte de fiacre dont le cocher le connaissait sans doute, car il ne demanda pas où il fallait le conduire.—Au bout d’un quart d’heure, on nous descendit devant une fort jolie maison;—je dis au cocher de m’attendre, et j’entrai avec l’inconnu dans un magnifique jardin.—Nous nous mîmes alors à parcourir de grandes et nombreuses serres remplies de plantes précieuses et parfaitement soignées;—chemin faisant, nous parlions de fleurs;—quelquefois il me racontait une anecdote curieuse de la Révolution.—Toujours est-il qu’il vint un moment où il me dit:
—Il est tard, voulez-vous déjeuner avec moi?
—Non,—répondis-je,—car vous me rappelez en ce moment—que l’on m’attend pour déjeuner depuis plus de deux heures—et que je suis sans doute l’homme le plus maudit du monde.
—Eh bien! me dit-il, venez me voir rue Blanche, à Paris,—nous reparlerons des fleurs, et, puisque vous avez un jardin,—je vous ferai quelques cadeaux;—je m’appelle Boursault.
Je le saluai et lui donnai ma carte.
—Oh bien! dit-il en la lisant, cela se trouve bien, je suis abonné aux Guêpes et j’avais envie de vous connaître.
Je ne l’ai jamais revu—depuis ce temps. J’ai si peu resté en place, que je n’ai pas trouvé le moment de lui faire ma visite. Il est au nombre des morts du mois d’avril.
![]() Lors d’un des derniers retours du duc de Joinville,—sa sœur, la
princesse Clémentine, lui fit de vifs reproches de n’avoir pas rapporté
quelque costume de femme des pays qu’il avait visités.
Lors d’un des derniers retours du duc de Joinville,—sa sœur, la
princesse Clémentine, lui fit de vifs reproches de n’avoir pas rapporté
quelque costume de femme des pays qu’il avait visités.
—J’aurais aimé,—dit-elle,—à en essayer un.
—Rien n’est plus facile,—ma sœur,—répondit le jeune prince,—car vos reproches sont injustes, et j’ai précisément acheté le costume complet d’une reine sauvage,—qui était à peu près de votre taille.
—Voyons-le.
—Je vous le ferai apporter demain.
Le lendemain,—le prince arrive et dit à sa sœur:
—Je n’ai pas oublié ma promesse,—me voici!
—Et le costume?
Le duc de Joinville, sans répondre,—tire de sa poche un collier fort bizarre formé d’un rang de graines rouges mêlées de morceaux de verre bleu.
La princesse Clémentine le regarde avec attention, le trouve assez joli malgré sa simplicité,—puis le place sur un meuble et attend.
Mais le prince s’occupe à regarder un tableau.
—Mais, Joinville, lui dit-elle,—à quoi pensez-vous?
—Pourquoi cette question, ma sœur?
—C’est parce que vous savez bien que j’attends.
—Et qu’attendez-vous?
—Le costume.
—Est-ce que je ne vous ai pas donné...
—Un collier.
—Eh bien?
—Eh bien! j’attends le reste.
—Mais il n’y a pas de reste.
—Comment?
—Je vous jure que c’est le costume complet,—et que la reine dont je vous parle ne portait rien de plus.
![]() M. Humann—mort, on a mis à sa place M. Lacave-Laplagne.—M.
Royer-Collard, en apprenant cette nomination,—a parodié un mot connu,
et a dit: «Il n’y a rien de changé, ce n’est qu’un gascon de plus.»
M. Humann—mort, on a mis à sa place M. Lacave-Laplagne.—M.
Royer-Collard, en apprenant cette nomination,—a parodié un mot connu,
et a dit: «Il n’y a rien de changé, ce n’est qu’un gascon de plus.»
![]() Je vous ai quelquefois parlé de la quatrième page des
journaux,—vous savez, celle où on met tout ce qu’on veut, cette sorte
de mur où on affiche librement—et contre lequel il n’est défendu de
déposer quoi que ce soit.—Eh bien!—le Journal des Débats a, le 10
avril dernier, admis,—en gros caractères,—une annonce dont je
n’oserais à aucun prix écrire ici le premier mot. (Voir le Journal des
Débats dudit jour.)
Je vous ai quelquefois parlé de la quatrième page des
journaux,—vous savez, celle où on met tout ce qu’on veut, cette sorte
de mur où on affiche librement—et contre lequel il n’est défendu de
déposer quoi que ce soit.—Eh bien!—le Journal des Débats a, le 10
avril dernier, admis,—en gros caractères,—une annonce dont je
n’oserais à aucun prix écrire ici le premier mot. (Voir le Journal des
Débats dudit jour.)
![]() Un autre journal a imaginé une forme assez heureuse de critique
pour les ouvrages modernes.
Un autre journal a imaginé une forme assez heureuse de critique
pour les ouvrages modernes.
«AVIS IMPORTANT.—Au milieu de cette inondation de livres de tous genres, dont beaucoup sont inutiles ou dangereux, il est de la dernière importance d’en signaler un qui mérite les plus grands éloges et qui intéresse au plus haut degré une immense quantité de personnes.
»Les auteurs, hommes du métier, sans aucun charlatanisme, avec une conscience et une modestie qui devraient faire la règle de tous les écrivains, enseignent dans cet ouvrage si éminemment utile:
»A obtenir à la fonte du suif en rame une plus grande quantité de suif que par l’ancien procédé.»
En effet, qu’apprend-on dans nos romans?—lisez-en tant que vous voudrez,—Balzac, Hugo, Dumas, madame Sand,—que saurez-vous après cela? vous y brûlerez quelques bougies,—mais vous n’en ferez pas mieux une chandelle.
![]() On lit dans un nouveau roman de M. d’Arlincourt, un roman inutile
comme nous disions tout à l’heure,—un dialogue qui rappelle celui de
l’ancien mélodrame dans ses beaux jours.
On lit dans un nouveau roman de M. d’Arlincourt, un roman inutile
comme nous disions tout à l’heure,—un dialogue qui rappelle celui de
l’ancien mélodrame dans ses beaux jours.
—Il a été mérité!
—Un prêtre!!
—Il n’en avait que l’habit.
—Lui! pas plus ministre du ciel...
—Que je ne suis religieux.
Dans ce genre de dialogue, il faut qu’il y ait eu plusieurs répétitions et que celui qui parle le premier sache parfaitement ce que lui répondra son interlocuteur.
Car jamais un homme ne s’aviserait de dire: «Lui! pas plus ministre du ciel...» si on ne lui a promis par les plus grands serments et sous les plus certaines garanties d’ajouter immédiatement: «Que je ne suis religieux;» sans cela la phrase serait absurde.
![]() L’autre jour, dans un procès en adultère, deux avocats dont je
regrette de ne pas savoir le nom, ont donné un nouvel exemple de
l’audace de ces messieurs.
L’autre jour, dans un procès en adultère, deux avocats dont je
regrette de ne pas savoir le nom, ont donné un nouvel exemple de
l’audace de ces messieurs.
Il s’agissait d’un escalier et du nombre de marches dont il est composé:—l’un l’évaluait à trente et l’autre à quatre-vingt-deux.—Tous deux ont affirmé les avoir comptées.
![]() Il existe dans la hiérarchie ecclésiastique de grands abus à
l’encontre des petits, c’est-à-dire des curés et des pauvres
desservants de campagne,—de la part de messeigneurs les évêques, et
surtout,—comme cela ne manque jamais,—de la part des grandeurs
subalternes, c’est-à-dire de M.M les vicaires généraux;—une guêpe est
spécialement chargée en ce moment—de recueillir sur les tracasseries
subies par ces pauvres curés, sur ces fleurs amères de leur
vie,—quelque chose qui ressemblera moins au miel qu’à l’absinthe.
Il existe dans la hiérarchie ecclésiastique de grands abus à
l’encontre des petits, c’est-à-dire des curés et des pauvres
desservants de campagne,—de la part de messeigneurs les évêques, et
surtout,—comme cela ne manque jamais,—de la part des grandeurs
subalternes, c’est-à-dire de M.M les vicaires généraux;—une guêpe est
spécialement chargée en ce moment—de recueillir sur les tracasseries
subies par ces pauvres curés, sur ces fleurs amères de leur
vie,—quelque chose qui ressemblera moins au miel qu’à l’absinthe.
En attendant mieux, voici un fait récent—qui ne manque pas d’une certaine bouffonnerie.
Le desservant d’une pauvre commune qui ressort de l’archevêché de Rouen—s’est vu brusquement suspendu de ses fonctions,—sans qu’on lui en fît connaître la cause.
Les interprétations n’ont pas manqué,—et naturellement on n’a examiné les versions diverses que strictement le temps nécessaire pour adopter exclusivement les plus fâcheuses,—en quoi les gens se sont montrés fort ignorants de la discipline ecclésiastique.
Car ce n’est pas l’oubli des devoirs ni des serments que l’Église punit le plus sévèrement dans ses ministres, c’est l’indiscipline,—tout autre péché, quelque gros qu’il soit,—n’est qu’un péché véniel.
Les commandements de Dieu passent après les ordres de l’Église.
Il n’y a rien dans ce que je dis ici qui ait la moindre exagération;—ceux qui ont lu les Guêpes depuis bientôt trois ans,—et mes autres écrits depuis douze ans, savent que je n’ai jamais mêlé ma voix aux criailleries si à la mode contre les prêtres.
Notre desservant donc, lassé de voir son malheur aggravé de toutes sortes d’interprétations peu bienveillantes, s’est avisé de demander à l’archevêché une sorte de certificat de bonnes vie et mœurs;—il a paru désagréable et embarrassant aux vicaires de monseigneur de Croy d’avoir à donner un certificat favorable;—ils n’ont pas répondu;—le curé a insisté pour que son certificat lui fût envoyé ou pour qu’on lui accordât un refus motivé.
Enfin on s’est décidé, et voilà ce qu’il a reçu.
«Nous, soussigné, prêtre vicaire général de S. A. E. le cardinal prince de Croy, archevêque de Rouen, certifions que M*** a exercé pendant à peu près l’espace de douze ans les fonctions du ministère ecclésiastique en différents endroits et en différentes qualités, et que, pendant ce temps, il n’a jamais été accusé de mauvaises mœurs, ni connu pour avoir une conduite scandaleuse; le présent certificat lui a été accordé conforme à sa demande—pour lui servir et valoir ce que de droit.
«Rouen..... 1842.
«Signé SURGIS, vic. génér.»
Le desservant était après cette lettre plus blanc que neige,—il n’avait pas même été accusé; c’était la vertu poussée au degré que César exigeait de sa femme.
Mais le malheureux curé, innocent aux yeux du monde, devenait par cela même coupable aux yeux de ses supérieurs—qui considèrent comme une rébellion ouverte son audace de demander un certificat d’innocence précisément au moment où on le punissait;—aussi M. Surgis, le même vicaire général, joignit-il au certificat la lettre que voici:
«Monsieur, le temps jusqu’à ce moment m’a à peu près manqué pour vous envoyer la pièce que vous avez demandée à S. A. E.; j’éprouve aussi quelque embarras, ne sachant trop comment formuler le certificat objet de vos désirs. Enfin, je vous l’envoie aujourd’hui et je souhaite qu’il remplisse vos vues.
»Je suppose que votre départ devant avoir lieu incessamment, et ne vous comptant plus vous-même comme faisant partie du clergé du diocèse de Rouen, vous avez déjà cessé toute espèce de fonctions ecclésiastiques, même de célébrer les saints mystères. Vous sentez qu’un certificat aussi extraordinaire que celui que vous sollicitez vous étant accordé, S. A. E. ne peut plus que vous plaindre et vous regarder comme étranger au sacerdoce,—et vous ne pouvez plus désormais dire la messe dans son diocèse.—Vous trouverez ci-inclus le certificat, comme j’ai cru devoir le faire pour suivre vos intentions.
»Recevez l’assurance, etc.
«Signé SURGIS.»
Ces deux pièces sont authentiques,—je les tiens dans les mains et je les copie.
M. le vicaire général Surgis me permettra de trouver sa lettre beaucoup plus extraordinaire que le certificat qui lui cause tant d’étonnement.
En effet, quel est ce certificat après lequel celui qui l’obtient ne peut plus dire la messe—ni faire partie du clergé du diocèse,—et cela d’une manière si évidente, que M. Surgis ne croit pas avoir à en donner de raison,—qu’il se contente de dire: «Vous sentez que vous devenez par ce certificat étranger au sacerdoce?»
Tout ce certificat est incompatible avec la prêtrise; ce certificat est un certificat de vie honnête et de mœurs décentes.
Savez-vous, monsieur le vicaire général, qu’on pourrait tirer de là de singulières conséquences pour le clergé;—car enfin, monsieur Surgis, vous ne pouvez échapper à ce raisonnement: si ce prêtre auquel on accorde ce certificat extraordinaire (un certificat de bonne vie et de bonnes mœurs), par cela même devient étranger au sacerdoce, ne peut plus célébrer les saints mystères (c’est tout simplement une excommunication), les qualités nécessaires et habituelles pour faire partie du clergé sont les contraires de celles (énoncées en cet extraordinaire certificat) et qui entraînent nécessairement et évidemment l’exclusion, l’anathème et l’excommunication.
![]() Pendant le carême, les églises de Paris étaient curieuses à
observer;—les jours où un prédicateur plus ou moins célèbre devait
travailler, on disposait les places comme au théâtre.—On se rappelle,
du reste, la fameuse annonce: M. LACORDAIRE PRÊCHERA EN COSTUME DE
DOMINICAN. Il y avait des places où on voyait et où on
entendait,—d’autres où on entendait sans voir,—d’autres où on voyait
sans entendre,—enfin un quatrième ordre de places où on ne voyait ni
n’entendait absolument rien;—pour faire le service de ces diverses
places, il y avait des contrôleurs, des ouvreuses, etc., qui faisaient
valoir les meilleures.
Pendant le carême, les églises de Paris étaient curieuses à
observer;—les jours où un prédicateur plus ou moins célèbre devait
travailler, on disposait les places comme au théâtre.—On se rappelle,
du reste, la fameuse annonce: M. LACORDAIRE PRÊCHERA EN COSTUME DE
DOMINICAN. Il y avait des places où on voyait et où on
entendait,—d’autres où on entendait sans voir,—d’autres où on voyait
sans entendre,—enfin un quatrième ordre de places où on ne voyait ni
n’entendait absolument rien;—pour faire le service de ces diverses
places, il y avait des contrôleurs, des ouvreuses, etc., qui faisaient
valoir les meilleures.
![]() Les lois sont faites par des avocats;—on ne le saurait pas, qu’on
s’en douterait à la façon dont ils se sont ménagés: ils se sont bien
gardés de se placer dans la catégorie des patentés, dans laquelle ils
ont rangé les médecins;—on serait probablement embarrassé d’en trouver
une bonne raison. Le médecin, avant d’obtenir son diplôme, a à faire
des études bien plus chères, bien plus dangereuses, il gagne beaucoup
moins,—et n’a d’avenir que dans ses économies;—l’avocat, au contraire,
n’est en rapport qu’avec des gens qui ont quelque chose; d’ailleurs ils
se sont prudemment interdit tout recours judiciaire pour leurs
honoraires, pour avoir un prétexte honnête de se faire payer d’avance.
Quand ils vieillissent ils se transforment en ce qu’ils veulent,
magistrats,—députés,—que sais-je? ils ne payent pas patente.
Les lois sont faites par des avocats;—on ne le saurait pas, qu’on
s’en douterait à la façon dont ils se sont ménagés: ils se sont bien
gardés de se placer dans la catégorie des patentés, dans laquelle ils
ont rangé les médecins;—on serait probablement embarrassé d’en trouver
une bonne raison. Le médecin, avant d’obtenir son diplôme, a à faire
des études bien plus chères, bien plus dangereuses, il gagne beaucoup
moins,—et n’a d’avenir que dans ses économies;—l’avocat, au contraire,
n’est en rapport qu’avec des gens qui ont quelque chose; d’ailleurs ils
se sont prudemment interdit tout recours judiciaire pour leurs
honoraires, pour avoir un prétexte honnête de se faire payer d’avance.
Quand ils vieillissent ils se transforment en ce qu’ils veulent,
magistrats,—députés,—que sais-je? ils ne payent pas patente.
![]() Un pauvre malade demande son admission dans un hôpital,—on lui
dit: «Présentez-vous au bureau central, parvis Notre-Dame.» Comme il ne
peut pas marcher, il prend une voiture. Arrivé, il attend deux heures,
quelquefois quatre heures, son tour de visite,—bien heureux lorsque
l’encombrement de la salle d’attente—ne le force pas de se tenir debout
sur la place, exposé aux injures du temps.
Un pauvre malade demande son admission dans un hôpital,—on lui
dit: «Présentez-vous au bureau central, parvis Notre-Dame.» Comme il ne
peut pas marcher, il prend une voiture. Arrivé, il attend deux heures,
quelquefois quatre heures, son tour de visite,—bien heureux lorsque
l’encombrement de la salle d’attente—ne le force pas de se tenir debout
sur la place, exposé aux injures du temps.
Enfin son tour arrive, et le médecin lui dit qu’il n’y a pas de place ou qu’il n’est pas assez malade,—ou bien encore, ce qui vous paraîtra plus singulier, qu’il est trop malade.
En effet, les affections chroniques sont exclues des hôpitaux:—qu’un pauvre phthisique se présente, aucun hôpital ne s’ouvrira pour lui;—le malade refusé prend une seconde voiture et rentre dans son triste logis, plus malade, plus pauvre et surtout plus découragé.
Pendant ce temps-là, vingt sociétés—mangent, boivent, parlent, parlent surtout, car c’est la manie de ce temps-ci,—tout cela sous prétexte de philanthropie.
![]() Les journaux les plus indépendants,—je n’en excepte pas un, ne
se font aucun scrupule de se rendre complices des mensonges et du
charlatanisme de tous les marchands de n’importe quoi,—complicité
honteuse, puisqu’elle se fait en partageant les bénéfices de ces
industriels.—Un de ces journaux, obligé de faire l’éloge d’un tailleur,
n’a trouvé à dire sur son compte que ceci: «Ses redingotes sont plus
que jamais à deux rangs de boutons.»
Les journaux les plus indépendants,—je n’en excepte pas un, ne
se font aucun scrupule de se rendre complices des mensonges et du
charlatanisme de tous les marchands de n’importe quoi,—complicité
honteuse, puisqu’elle se fait en partageant les bénéfices de ces
industriels.—Un de ces journaux, obligé de faire l’éloge d’un tailleur,
n’a trouvé à dire sur son compte que ceci: «Ses redingotes sont plus
que jamais à deux rangs de boutons.»
![]() Voici une épigramme échappée à M. Nodier.
Voici une épigramme échappée à M. Nodier.
Comme il se trouvait l’autre jour avec M. Flourens, son collègue à l’Académie,—il lui dit:
—Ah ça! M. de Balzac se présente.
—Je ne crois pas, répondit M. Flourens; il n’a pas fait de visites.
—Pardon, il est venu me voir.
—Moi, je ne l’ai pas vu.
—C’est que peut-être il ne vous croit pas de l’Académie.
![]() Au moment de la saison des bains, il me revient à l’esprit une
anecdote assez édifiante à ce sujet.
Au moment de la saison des bains, il me revient à l’esprit une
anecdote assez édifiante à ce sujet.
L’acteur Perlet était triste et malade;—quelques personnes lui conseillèrent les eaux d’Enghien. Perlet alla trouver le docteur Bouland, médecin des eaux, et lui exposa piteusement sa situation en lui demandant franchement son avis.
—Croyez-vous, lui dit-il, que vos eaux me donneront un peu d’embonpoint?
—Certainement, monsieur, certainement;—baignez-vous, et vous engraisserez.
Perlet se baigne, se baigne, et n’engraisse pas; il se plaint au docteur.
—Oh! mais, monsieur Perlet, il faut de la persévérance, il faut un peu de temps;—baignez-vous, monsieur, baignez-vous, et vous engraisserez.
Mais un jour que, conformément aux conseils du docteur Bouland, Perlet était dans sa baignoire,—il entend parler dans le cabinet voisin et reconnaît la voix du docteur.
—Certainement, monsieur, disait le docteur.
—Mais, répondait l’interlocuteur,—j’ai beau me baigner, je ne maigris pas.—Je crois que je suis plus énorme encore qu’à mon arrivée.
—Ah! mais, monsieur, il faut de la persévérance, il faut du temps;—baignez-vous, et vous maigrirez.
Perlet se leva effrayé, jeta un regard sur lui-même.—Il lui sembla qu’il était maigri.—Il se précipita hors de son bain, et s’enfuit.
![]() Un ancien administré de M. Romieu est venu le voir un de ces
jours,—et il lui racontait ce qu’il avait vu à Paris.
Un ancien administré de M. Romieu est venu le voir un de ces
jours,—et il lui racontait ce qu’il avait vu à Paris.
—A propos, dit-il, j’ai été au Théâtre-Français.
—Et qu’avez-vous vu?
—Ma foi, une fort belle pièce;—ça peut bien durer de cinq quarts d’heure à une heure et demie.
—Mais quelle pièce?
—Je vous dis... une très-belle pièce, mais je ne sais plus le nom;—tout ce que je peux vous dire, c’est que mademoiselle Rachel en joue.
—Qu’est-ce qu’on dit dans cette pièce?
—Je ne sais pas trop... je me rappelle seulement qu’il y a un vieux, au commencement, à qui on donne un soufflet.
—Ah! c’est le Cid.
—Oui, ça peut bien être ça... comment dites-vous? le Cid!—Pardon, avez-vous un morceau de papier, que j’écrive ça.—C—i—d—le Cid,—c’est bien ça.
![]() L’éditeur d’une série d’ouvrages, sur divers sujets, a publié dans
les journaux une annonce dans laquelle il proclame et les titres des
ouvrages qu’il met en vente, et les noms des auteurs qui les ont
composés;—ces noms sont au nombre de vingt ou vingt-cinq, et tous,
moins un, sont écrits sans le M. dont on se sert pour les simples
hommes.—Paul de Kock, Maurice Alhoy, Deyeux, Marco Saint
Hilaire,—monsieur de Balzac,—etc.
L’éditeur d’une série d’ouvrages, sur divers sujets, a publié dans
les journaux une annonce dans laquelle il proclame et les titres des
ouvrages qu’il met en vente, et les noms des auteurs qui les ont
composés;—ces noms sont au nombre de vingt ou vingt-cinq, et tous,
moins un, sont écrits sans le M. dont on se sert pour les simples
hommes.—Paul de Kock, Maurice Alhoy, Deyeux, Marco Saint
Hilaire,—monsieur de Balzac,—etc.
M. de Balzac est, du reste, accoutumé à de pareilles distinctions.—Je me rappelle qu’il y a une huitaine d’années l’éditeur Werdet, avec lequel je me trouvais en relations,—m’annonça que M. de Balzac lui faisait l’honneur de dîner chez lui,—et voulut bien m’inviter à prendre ma part du festin et du spectacle de ce célèbre écrivain;—j’acceptai volontiers, et je trouvai là, en outre, Jules Sandeau et Michel Masson, qui étaient de mes amis, et M. Paul de Kock, que je ne connaissais pas plus que je ne connaissais alors l’auteur de la Vieille fille et d’Eugénie Grandet.
On était tous sur des chaises.—M. de Balzac seul, faute d’un trône, que probablement M. Werdet ne possédait pas dans son mobilier, était assis sur un fauteuil élevé—et mangeait dans un couvert de vermeil,—tandis que les autres n’avaient que des couverts d’argent. M. de Balzac ne manifesta ni le moindre étonnement ni le moindre embarras.
![]() On lit dans le Moniteur:
On lit dans le Moniteur:
«Dans le mois dernier, le ministre de la marine a alloué aux auteurs de DIVERS actes de sauvetage des gratifications, montant en totalité à DEUX CENT QUARANTE FRANCS.»
Je l’ai déjà remarqué,—les hommes n’ont de respect, de vénération, que pour ceux qui leur font du mal.—Une croix d’honneur, je parle de celles qui sont bien gagnées, est le prix de quelques têtes fendues;—on accorde à celui qui en est porteur toutes sortes d’honneurs et de considération,—au contraire, celui qui sauve la vie d’un homme au péril de la sienne est traité avec un remarquable dédain.—On appelle son action—acte de sauvetage.—Cette formule s’applique également à celui qui repêche des barriques ou des morceaux de bois,—au courant de l’eau.
Gratification est le terme dont on use à l’égard des expéditionnaires des bureaux dont on veut récompenser l’écriture propre et soignée; du reste, il en a toujours été ainsi.
Sous Louis XVI,—le pilote Boussard, de Dieppe, sauva seul huit hommes sur dix, qui périssaient sur un bâtiment naufragé.—On lui donna une pension de trois cents francs.
![]() Il a été arrêté à l’Académie qu’on inviterait les académiciens à se
rendre aux séances en costume.—Il y a bien longtemps que les Guêpes
ont provoqué cette mesure;—il est douteux qu’elles obtiennent le même
succès auprès des députés.
Il a été arrêté à l’Académie qu’on inviterait les académiciens à se
rendre aux séances en costume.—Il y a bien longtemps que les Guêpes
ont provoqué cette mesure;—il est douteux qu’elles obtiennent le même
succès auprès des députés.
![]() Il y a à Paris, sur le boulevard, un petit théâtre qui fait
d’excellentes affaires, sous la direction de M. Mourier: c’est le
théâtre des Folies-Dramatiques.—Voici une économie que l’on n’aurait
pas imaginée.—Les contrôleurs qui reçoivent les billets au commencement
du spectacle sont des acteurs dont la présence est nécessaire ensuite
sur ce théâtre.
Il y a à Paris, sur le boulevard, un petit théâtre qui fait
d’excellentes affaires, sous la direction de M. Mourier: c’est le
théâtre des Folies-Dramatiques.—Voici une économie que l’on n’aurait
pas imaginée.—Les contrôleurs qui reçoivent les billets au commencement
du spectacle sont des acteurs dont la présence est nécessaire ensuite
sur ce théâtre.
L’autre jour,—M. Roger de Beauvoir—s’avisa de se présenter vers neuf heures;—il prit un billet au bureau et se présenta au contrôle, où il ne trouva qu’un énorme chien qui voulut le manger.
![]() Le vieux prince T***, usé, contrefait, et ayant l’air d’être
tombé sur la tête d’un troisième étage,—se promenait à pieds dans les
Champs-Élysées, péniblement soutenu par un domestique;—il rencontra un
de ses amis qui lui dit:
Le vieux prince T***, usé, contrefait, et ayant l’air d’être
tombé sur la tête d’un troisième étage,—se promenait à pieds dans les
Champs-Élysées, péniblement soutenu par un domestique;—il rencontra un
de ses amis qui lui dit:
—Eh bien! que faites-vous de G***?
(Madame G*** est une maîtresse fort connue du prince en question.)
—Ma foi, mon cher, répond le prince en toussant,—son règne est passé, le cœur n’y est plus pour rien, il n’y a plus entre nous que l’amour physique.
![]() On a essayé dernièrement de répandre le bruit que M. Victor Hugo
avait éprouvé une attaque de folie.—Ce n’est pas la première édition de
cette plaisanterie.
On a essayé dernièrement de répandre le bruit que M. Victor Hugo
avait éprouvé une attaque de folie.—Ce n’est pas la première édition de
cette plaisanterie.
On se rappelle encore le bruit qui avait eu lieu à la première représentation du Roi s’amuse: on chanta la Marseillaise,—on hurla le Chant du Départ, on demanda deux ou trois têtes et plusieurs perruques.—Le lendemain, la pièce fut défendue.—M. Hugo fit un procès, et, dans le cours de ce procès, fut peu bienveillant pour M. d’Argout, qui n’a laissé au ministère d’autre souvenir que celui de son nez plus qu’humain, ce dont M. d’Argout conserve encore un vif ressentiment.
Plus tard, on représenta Lucrèce Borgia.—Le lendemain de la représentation, un grand nombre d’amis de M. Hugo vinrent le féliciter de son succès.—Au nombre des visiteurs était un jeune poëte,—fils d’un imprimeur et compositeur dans l’imprimerie de son père;—ledit père, qui est mort aujourd’hui, imprimait un journal ayant pour titre: le Télégraphe des départements.
Après être resté une heure chez M. Hugo, le jeune homme le quitta pour aller composer le journal;—il se met à l’ouvrage; mais quel est son étonnement lorsque, dans la part de manuscrit qui lui est échue, il voit cette phrase:
«M. Victor Hugo vient d’être attaqué d’une folie furieuse; sa famille a dû le faire transporter à Charenton.»
Il laissa cette phrase sans la composer, et chargea le prote de l’avertir quand M. ***, rédacteur du journal et secrétaire de M. d’Argout, viendrait ce qu’on appelle corriger les épreuves.
En effet, ce monsieur arrive, il va le trouver et lui dit qu’il n’avait pas composé la phrase parce que le renseignement était faux, qu’il quittait M. Hugo à l’instant même, etc., etc.
M. *** lui répondit qu’il eût à garder ses avis pour quand on les lui demanderait, qu’il s’occupât de son ouvrage, et eût la bonté de ne pas se mêler du reste.
Le jeune homme s’y refuse et va trouver son père.
Le père répond majestueusement que cela ne le regarde pas; que, s’il lui fallait s’assurer de la vérité de ce que les journaux lui donnaient à imprimer, le papier sortirait souvent de chez lui plus blanc qu’il n’y était entré.
Enfin la nouvelle fut insérée et copiée les jours suivants par tous les journaux de départements.
Je l’ai déjà fait remarquer,—si on vous dit: «L’épicier du coin a battu sa femme,» vous direz: «En êtes-vous bien sûr?» Mais si l’on vous dit qu’un homme célèbre par son talent est devenu enragé et a mordu trois personnes, vous dites: «Il paraît que le grand poëte un tel a mangé beaucoup de monde dans un accès d’hydrophobie.»—Il est si doux pour les envieux de rabaisser par quelque côté celui qui s’élève au-dessus d’eux,—qu’ils ne s’avisent jamais de prendre la moindre information: la chose n’aurait qu’à ne pas être vraie!
![]() L’autre jour il me tomba sous les yeux un article de M. Delecluse,
qui est chargé dans le Journal des Débats de la critique d’art.
L’autre jour il me tomba sous les yeux un article de M. Delecluse,
qui est chargé dans le Journal des Débats de la critique d’art.
Je parcourus cet article et je vis avec chagrin que je ne me trouvais d’accord presque en rien dans mes jugements sur le Salon de cette année avec le révérend M. Delecluse.
L’article commençait par un grand éloge de M. Bidault, dont je vous ai signalé le tableau à propos de l’exposition de peinture,—et par une attaque violente contre la nature.
En effet, selon M. Delecluse, le plus grand tort des paysagistes, c’est de s’asservir à l’imitation servile de la nature;—ceux qui font le contraire et qui ne se préoccupent pas trop de ladite nature ont, aux yeux de M. Delecluse, par cela même un avantage unique et un mérite inestimable.
En effet—et je suis honteux de mon erreur,—il n’y a pas trop de dédain possible pour ces peintures timides et sans génie—qui s’asservissent ainsi à l’imitation de la nature au lieu de lutter avec elle, et d’inventer un autre soleil.—M. Delecluse n’est pas content de la nature: je ne sais s’il a à se plaindre d’elle, je n’ai jamais vu cet écrivain;—toujours est-il qu’il veut qu’on lui fasse mieux que cela.
![]() Parlez-moi de M. Bidault—à la bonne heure—et de M. Victor Bertin,
et de M. Édouard Bertin, et de M. Aligny.—Voilà des hommes! Croyez-vous
qu’ils s’amusent à copier servilement un arbre—un de ces mauvais vieux
arbres communs comme la nature, cette vieille radoteuse, en met
partout?—Regardez les paysages de ces messieurs,—je veux mourir si
j’ai jamais vu d’arbres comme les leurs—et les montagnes—et les
hommes—et les chevaux—et la lumière,—voilà qui n’est pas copié
servilement!—voilà qui est une création!—voilà qui n’appartient qu’à
ces grands peintres! voilà où la nature n’a rien à réclamer!—Vous ne
verrez pas là de ces chevaux vivants, souples, bondissant dans les
prairies—de ces chevaux comme on en voit partout.—Fi donc!
Parlez-moi de M. Bidault—à la bonne heure—et de M. Victor Bertin,
et de M. Édouard Bertin, et de M. Aligny.—Voilà des hommes! Croyez-vous
qu’ils s’amusent à copier servilement un arbre—un de ces mauvais vieux
arbres communs comme la nature, cette vieille radoteuse, en met
partout?—Regardez les paysages de ces messieurs,—je veux mourir si
j’ai jamais vu d’arbres comme les leurs—et les montagnes—et les
hommes—et les chevaux—et la lumière,—voilà qui n’est pas copié
servilement!—voilà qui est une création!—voilà qui n’appartient qu’à
ces grands peintres! voilà où la nature n’a rien à réclamer!—Vous ne
verrez pas là de ces chevaux vivants, souples, bondissant dans les
prairies—de ces chevaux comme on en voit partout.—Fi donc!
Vous ne verrez pas des hommes ayant les bras attachés aux épaules—et la tête sur le cou.—C’est trop commun.
Vous ne verrez pas là de ces arbres qui balancent dans l’air leurs beaux panaches pleins d’oiseaux, pleins de chants et pleins d’amours—allons donc!—on ne voit que ça au mois de mai.
Vous ne verrez pas dans les tableaux de ces grands peintres selon le cœur de M. Delecluse cette lumière commune qui donne aux objets leurs couleurs diverses—fi donc! la lumière de M. Bidault est grise;—celle de M. E. Bertin est brune, chacun a la sienne.
Parlez-moi donc auprès de cela de rapins comme Brascassat, qui vous fait honteusement de l’herbe qu’un mouton viendrait brouter, et des moutons sur lesquels se jetterait un loup.
Parlez-moi de malheureux comme M. Wickemberg qui vous fait de la glace devant laquelle on a froid—et de vrais enfants comme vous en avez vu sur la place du Louvre avant d’entrer.
Et ce pauvre M. Béranger avec son lièvre et sa perdrix,—quelle misérable et servile imitation de la nature!—c’est à s’y méprendre;—et cet autre,—j’ose à peine le nommer, Meissonnier—avec son fumeur! Comment le jury admet-il de semblables choses au Salon?
![]() Le jury se montre cependant tous les ans bien digne de comprendre
et d’appliquer la théorie de M. Delecluse, belle et ravissante théorie!
En effet, qu’est-ce que l’imitation de la nature dans le paysage?—c’est
aussi méprisable que la ressemblance dans un portrait.
Le jury se montre cependant tous les ans bien digne de comprendre
et d’appliquer la théorie de M. Delecluse, belle et ravissante théorie!
En effet, qu’est-ce que l’imitation de la nature dans le paysage?—c’est
aussi méprisable que la ressemblance dans un portrait.
Ah! monsieur Delecluse,—vous venez de publier un roman qui s’appelle Olympia,—vite qu’on m’envoie Olympia,—que je lise Olympia! j’espère bien ne pas trouver là de ces serviles imitations de la nature,—de ces communes études du cœur humain;—au nom du ciel, que l’on m’envoie bien vite Olympia!
![]() M. R*** vient, dit-on, de faire un riche héritage; sur ce, il a
invité un certain nombre de ses anciens amis à un dîner au Rocher de
Cancale.—Le choix du lieu,—la renommée gastronomique de l’amphitryon,
sa nouvelle position financière,—tout avait alléché les amis;—mais
quel ne fut pas leur triste étonnement quand ils virent que le festin se
composait d’une soupe à l’oignon,—de veau aux carottes! Les figures se
sont allongées,—et même, à un des bouts de la table, un des amis
désappointés se mit à dire: «R*** a passé la première moitié de sa
vie à cacher sa misère; il va passer la seconde moitié à cacher sa
fortune.»—Heureusement que le vin de Champagne, qui fut servi à
profusion, vint égayer la fin du dîner.
M. R*** vient, dit-on, de faire un riche héritage; sur ce, il a
invité un certain nombre de ses anciens amis à un dîner au Rocher de
Cancale.—Le choix du lieu,—la renommée gastronomique de l’amphitryon,
sa nouvelle position financière,—tout avait alléché les amis;—mais
quel ne fut pas leur triste étonnement quand ils virent que le festin se
composait d’une soupe à l’oignon,—de veau aux carottes! Les figures se
sont allongées,—et même, à un des bouts de la table, un des amis
désappointés se mit à dire: «R*** a passé la première moitié de sa
vie à cacher sa misère; il va passer la seconde moitié à cacher sa
fortune.»—Heureusement que le vin de Champagne, qui fut servi à
profusion, vint égayer la fin du dîner.
![]() Quand on lit l’histoire avec un peu d’attention, on voit qu’elle se
compose en général d’événements imprévus et impossibles,—que le plus
hardi romancier n’oserait admettre dans ses livres.
Quand on lit l’histoire avec un peu d’attention, on voit qu’elle se
compose en général d’événements imprévus et impossibles,—que le plus
hardi romancier n’oserait admettre dans ses livres.
S. M. Louis-Philippe est aujourd’hui roi des Français;—voici une petite anecdote que je trouve dans un bouquin de 1780, et qui constate à quel point cela paraissait impossible alors: «M. le duc de Chartres[D] étant allé, suivant l’usage, prendre les ordres du roi[E] au sujet de son intention d’instituer gouverneur de ses enfants[F] madame la comtesse de Genlis,—Sa Majesté a fait un moment de réflexion, puis a dit: «J’ai un dauphin[G]; Madame[H] pourrait être grosse.—Le comte d’Artois[I] a plusieurs princes[J], vous pouvez faire ce que vous voudrez.»
![]() Voici, dans le même bouquin,—des phrases assez singulières:
Voici, dans le même bouquin,—des phrases assez singulières:
«Les Parisiens, qui devraient s’indigner de se voir insensiblement constitués prisonniers et renverser cette muraille extravagante, ne font qu’en rire; elle leur sert de spectacle et de but de promenade; ils s’amusent à la voir croître par degrés.»
Remarquez qu’il ne s’agit ni des forts, ni de l’enceinte continue,—on veut parler de la muraille et des barrières de Paris, construites en 1780.
![]() Le droit de visite, dont abuse si étrangement l’Angleterre et que
tolère plus étrangement encore le gouvernement français,—est une
question plus sérieuse qu’on ne pense.
Le droit de visite, dont abuse si étrangement l’Angleterre et que
tolère plus étrangement encore le gouvernement français,—est une
question plus sérieuse qu’on ne pense.
J’ai été le premier à attaquer par le ridicule—les besoins que les journaux prêtaient au peuple,—la réforme électorale,—et autres marrons qu’on voulait lui faire tirer du feu;—mais ici ce n’est plus le cas de plaisanter:—le peuple français est orgueilleux,—cet orgueil est un arbre dont sortent deux branches:—l’une produit les vaudevilles,—où il écoute et applaudit avec fureur l’éloge de sa propre bravoure;—elle produit le rappel à l’ordre d’un député qui ose dire à la Chambre que les Français ont quelquefois été vaincus.
Mais l’autre donne pour fruits les traits d’héroïsme et de dévouement des guerres de la Révolution et de l’Empire,—et les belles actions qu’on a admirées dans les récentes campagnes d’Afrique.
C’est un arbre qu’il faut laisser debout.
Il ne faut pas attaquer les Français dans leur vanité.
Jusqu’au fond des boutiques et des campagnes, on voit des épiciers et des paysans humiliés, tristes, furieux,—des affaires du Marabout et de la Sénégambie.
L’opposition au recensement était une sottise,—c’était du bruit pour du bruit;—mais dans l’affaire du droit de visite, l’orgueil national est blessé,—car, il faut le redire, c’est une lâcheté.
![]() Je dénonce à l’admiration des contemporains une nouvelle femme de
lettres, mademoiselle Godin. Cette muse annonce à la fois une épître en
vers et du chocolat.—On trouve les deux objets à la même
adresse.—L’épître se vend à la livre, et le chocolat au
cent.—Peut-être, cependant, est-ce le chocolat qui se vend à la
livre.—Du reste, voici l’annonce telle qu’elle est faite:
Je dénonce à l’admiration des contemporains une nouvelle femme de
lettres, mademoiselle Godin. Cette muse annonce à la fois une épître en
vers et du chocolat.—On trouve les deux objets à la même
adresse.—L’épître se vend à la livre, et le chocolat au
cent.—Peut-être, cependant, est-ce le chocolat qui se vend à la
livre.—Du reste, voici l’annonce telle qu’elle est faite:
«Demoiselle GODIN, rue..... CORRESPONDANCE AMOUREUSE, en vers, d’un Pêcheur picard avec une cuisinière de la rue Saint-Honoré; 25 c. Par la poste, 30 c.; le cent 15 fr.—CHOCOLAT fin, 1 fr.; surfin, 2 fr. 40 c.; Caraque, 3 fr.; praliné, le plus exquis des bonbons, 4 fr.»
![]() Une académie propose un prix pour la destruction de la pyrale,
insecte qui attaque la vigne, au vigneron qui aura découvert le meilleur
moyen.
Une académie propose un prix pour la destruction de la pyrale,
insecte qui attaque la vigne, au vigneron qui aura découvert le meilleur
moyen.
Or, quel est ce prix? Un ouvrage du savant M. Audoin sur la pyrale.
Si l’ouvrage est bon, pourquoi mettre au concours des moyens préférables à ceux qu’il indique?
Si l’on a besoin d’autres moyens, si ceux donnés par M. Audoin sont insuffisants—que sera-ce pour le vigneron qu’un prix consistant en un ouvrage inférieur à celui qu’on demande de lui sur le même sujet?
Est-ce que par hasard cela ne serait pas absurde?
![]() Voici un exemple frappant des excès auxquels peut se porter un
homme qui a de l’huile à vendre.—La plupart des journaux ont reproduit
(un franc la ligne) l’annonce que voici.
Voici un exemple frappant des excès auxquels peut se porter un
homme qui a de l’huile à vendre.—La plupart des journaux ont reproduit
(un franc la ligne) l’annonce que voici.
L’homme qui a de l’huile à vendre commence par des conseils sévères et d’amers reproches au gouvernement de son pays. Il met son huile dans l’opposition; je copie textuellement:
«La tolérance du gouvernement, qui après avoir reconnu que la religion catholique était celle de la majorité des Français, et qui néanmoins par son indifférence et surtout par son exemple, en faisant travailler aux édifices publics les dimanches et les fêtes solennelles de l’année, est cause que cette interdiction est sur ce point généralement transgressée; cette infraction au troisième commandement de Dieu, loin d’ébranler nos croyances, les raffermit plus que jamais. Comme il ne suffit pas de rendre à César ce qui appartient à César, et qu’il faut aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu, nous sommes fier de résister à un entraînement qui n’est imité par aucun autre gouvernement, attendu qu’ils savent tous très-bien que, quand Dieu n’a plus d’empire sur les hommes, les gouvernements n’ont plus d’action sur les esprits.
«Pour nous, ajoute l’homme qui a de l’huile à vendre, conséquent avec nos croyances, fidèle à la ligne que nos pères nous ont tracée, nous nous interdisons toute œuvre servile le dimanche.
«Nous sommes resté stationnaire malgré l’entraînement des siècles.»
L’homme qui a de l’huile à vendre se jette dans d’amers regrets du passé. «Les usages du bon vieux temps, dit-il, étaient en harmonie avec les usages de nos pères, qui, plus sages que nous, apportaient dans leurs relations, intimes ou commerciales, une franchise et une urbanité, qui malheureusement se sont éloignées de nos mœurs.—Mais le goût ancien reprend dans les objets matériels, dans les ameublements, les constructions et les édifices publics.»
L’homme qui a de l’huile à vendre—entrevoit de flatteuses espérances pour l’avenir de sa patrie. «Les nobles et antiques usages du bon vieux temps renaîtront aussi dans la morale publique;—et déjà ne voyez-vous pas un retour aux mœurs de nos pères dans la direction d’un établissement où, tout en s’abstenant scrupuleusement de travailler le dimanche,—la vieille loyauté, les croyances religieuses et les principes de son fondateur forment une puissante garantie, et lui font un commandement de ne livrer aux consommateurs en huile à manger que celles provenant uniquement de l’olivier!»
Voilà l’huile annoncée!—Cela se fait un peu plus attendre que le chapon de Petit-Jean;—mais nous n’y perdons pas;—certes, il est un des héros de comédie auquel Molière n’aurait pas prêté un meilleur langage, si Tartufe avait eu de l’huile à vendre.
![]() Je suis sûr que M. Aymès se consolera de cette remarque innocente,
en songeant que les Guêpes lui font en même temps une annonce,—et une
annonce qui ne lui coûte rien.
Je suis sûr que M. Aymès se consolera de cette remarque innocente,
en songeant que les Guêpes lui font en même temps une annonce,—et une
annonce qui ne lui coûte rien.
1er mai.
![]() Comme il fait beau dans la campagne!—Les pommiers sont couverts de
leurs fleurs blanches et roses;—les fauvettes chantent dans les
feuilles,—les insectes bourdonnent dans les fleurs.—Comment dire tout
ce qui s’épanouit,—tout ce qui chante dans le cœur?—Le soir, les
yeux quittent la terre et les fleurs,—et contemplent le ciel et les
étoiles;—mais les campagnes sont désertes;—il y a fête à la ville;
c’est la fête du roi;—et le peuple se soucie bien des étoiles et des
parfums du soir quand il peut voir des lampions et respirer l’odeur du
suif.
Comme il fait beau dans la campagne!—Les pommiers sont couverts de
leurs fleurs blanches et roses;—les fauvettes chantent dans les
feuilles,—les insectes bourdonnent dans les fleurs.—Comment dire tout
ce qui s’épanouit,—tout ce qui chante dans le cœur?—Le soir, les
yeux quittent la terre et les fleurs,—et contemplent le ciel et les
étoiles;—mais les campagnes sont désertes;—il y a fête à la ville;
c’est la fête du roi;—et le peuple se soucie bien des étoiles et des
parfums du soir quand il peut voir des lampions et respirer l’odeur du
suif.
| 1841 | |
|---|---|
JUILLET.—A Victor Hugo.—Le rossignol et les oies.—1.—40.—450.—33,000,000.—M. Conte.—Les lettres et la poste.—Les harpies.—M. Martin (du Nord).—Nouvelles de la prétendue gaieté française.—La queue de la poêle.—Un trait d’esprit du préfet de police.—Les chiens enragés.—Les journaux.—Renseignement utile aux gens d’Avignon.—Où est le tableau de M. Gudin.—M. Quenson dénoncé.—A monseigneur l’archevêque de Paris.—Mots nouveaux.—Victoria à Rachel.—Les esclaves et les domestiques.—L’Opéra.—Le Cirque-Olympique.—Le duc d’Orléans.—Le maréchal Soult.—Nouvelles frontières de la France.—Les vivants et les morts.—M. de Lamartine.—La postérité.—M. Hello accusé de meurtre.—La Fête-Dieu.—Giselle.—M. Ancelot.—M. de Pongerville.—Les vautours.—M. Villemain.—Une voix.—M. Garnier-Pagès.—Un oncle.—Le charbon de terre et les propriétaires de forêts | 1 |
AOUT.—Les anniversaires.—Paris et Toulouse.—Les trois journées de Toulouse.—M. Floret.—M. Plougoulm.—M. Mahul.—M. de Saint-Michel.—Ce qu’en pensent Pascal, Rabelais et M. Royer-Collard.—Un quatrain.—Le peuple et l’armée.—Les Anglais.—Un pensionnat à la mode.—Les maîtres d’agrément.—A monseigneur l’archevêque de Paris.—Un projet de révolution.—Un baptême.—Une lettre de M. Dugabé.—Le berceau du gouvernement représentatif.—En faveur d’un ancien usage, excepté M. Gannal.—Parlons un peu de M. Ingres.—Un chat et quatre cents souris.—Le roi et les archevêques redevenus cousins.—A M. le vicomte de Cormenin.—M. Thiers en Hollande.—Contre l’eau.—MM. Mareschal et Souchon.—Les savants et le temps qu’il fait.—Les citoyens les plus honorables de Lévignac, selon M. Chambolle.—Triste sort d’un prix de vertu.—De l’héroïsme.—La science et la philanthropie.—Les médailles des peintres.—Les ordonnances de M. Humann.—De l’homicide légal.—AM RAUCHEN sur le bonheur | 31 |
SEPTEMBRE.—Diverses réponses.—L’auteur rassure plusieurs personnes.—M. Molé.—M. Guizot.—M. Doublet de Bois-Thibault.—La vérité sur plusieurs choses.—Les protestations.—Les adresses.—Les troubles.—Ce que c’est qu’une foule et une masse.—Le peuple des théâtres et le peuple des journaux.—L’évêque d’Évreux et l’archevêque de Paris.—Dénonciation contre les savants.—M. Montain.—En quoi M. Duchâtel ressemble à Chilpéric.—Le suffrage universel.—Naïveté.—La pudeur d’eau douce et la pudeur d’eau salée.—Les fêtes de Juillet.—Apparition de plusieurs phénomènes.—Toujours la même chose.—Les banquets.—M Duteil et M. Champollion.—Voyage du duc d’Aumale.—Est-ce une pipe ou un cigare?—Histoire d’un député.—Sur quelques noms.—Les bureaux de tabac.—A M. Villemain.—A M. Rossi.—En faveur de M. Ledru-Rollin.—Les Parias.—Madame O’Donnell | 61 |
OCTOBRE.—A M. Augustin, du café Lyonnais.—BILAN de la royauté.— M. Partarrieu-Lafosse.—La charte constitutionnelle.—L’article 12 et l’article 13.—Moyen nouveau de dégoûter les princes de la flatterie.—BILAN de la bourgeoisie.—M. Ganneron.—M***.—L’orgie et la mascarade.—Madame J. de Rots...—La chatte métamorphosée en femme.—BILAN de la pairie.—BILAN de la députation.—Une tombola.—Ce que demandent soixante-dix-sept députés.—Ce qu’obtiennent quarante-deux députés.—M. Ganneron.—BILAN des ministères.—M. Molé.—M. Buloz.—M. Duvergier de Hauranne.—M. Thiers.—M. Guizot.—Angelo, tyran de Padoue.—Un œuf à la coque.—M. Passy.—M. Dufaure.—M. Martin (du Nord).—BILAN de l’administration.—Les synonymes.—Bilan de la justice.—BILAN de la littérature.—Les Louis XVII.—La parade.—Louis XIV et les propriétaires de journaux.—M. Dumas et M. de Balzac.—BILAN de la police.—Facéties des enfants de Paris.—Trois minutes de pouvoir.—BILAN de l’Église.—Les bons curés.—M. Ollivier.—M. Châtel.—M. Auzou.—BILAN de l’armée.—BILAN du peuple.—Frédéric le Grand.—Le pays.—BILAN de la presse.—Dieu ou champignon.—La sainte ampoule et les écrouelles.—BILAN de l’auteur | 94 |
NOVEMBRE.—Les papiers brûlés.—Service rendu à la postérité.—Une phrase du Courrier français.—PREMIÈRE OBSERVATION.—De la rente.—DEUXIÈME OBSERVATION.—L’infanterie et la cavalerie.—TROISIÈME OBSERVATION.—Les que.—QUATRIÈME OBSERVATION.—Une épitaphe.—CINQUIÈME OBSERVATION.—Réponse à plusieurs lettres.—M. de Cassagnac et le mal de mer.—De la solitude.—M. Lautour-Mézeray.—Abdalonyme.—M. Eugène Sue.—M. Véry.—Louis XIII.—M. Thiers et M. Boilay.—Deux mots de M. Thiers.—Un rédacteur entre deux journaux.—Encore le roi et ses maraîchers.—M. Cuvillier-Fleury.—M. Trognon.—M. de Latour.—Charlemagne.—La Salpêtrière.—La police et les cochers.—Les cigares de Manille.—Sagacité d’un carré de papier.—SIXIÈME OBSERVATION.—SEPTIÈME OBSERVATION.—HUITIÈME OBSERVATION.—Sur l’égalité.—Un blanc domestique d’un noir.—Caisse d’Épargne.—Les mendiants.—Aperçu du Journal des Débats.—Arbor sancta, nouveau chou colossal.—NEUVIÈME OBSERVATION.—Jules Janin, poëte latin.—Une caisse.—Éducation des enfants.—DIXIÈME OBSERVATION.—La vérité sur Anacréon et sur ses sectateurs.—Une élection.—ONZIÈME OBSERVATION.—DOUZIÈME OBSERVATION.—Post-scriptum. | 123 |
DÉCEMBRE.—Les tombeaux de l’empereur.—M. Marochetti.—M. Visconti.—M. Duret.—M. Lemaire.—M. Pradier.—Un nouveau métier.—L’arbre de la rue Laffitte.—Les annonces.—Les réclames.—Un rhume de cerveau.—Un menu du Constitutionnel.—D’un acte de bienfaisance qui aurait pu être fait.—Les départements vertueux et les départements corrompus.—M. Ledru-Rollin.—Un nouveau noble.—M. Ingres et M. le duc d’Orléans.—Les prévenus.—L’opinion publique.—Suite des commentaires sur l’œuvre du Courrier français.—M. Esquiros.—Le secret de la paresse. | 163 |
| 1842 | |
JANVIER.—Règlement de comptes.—Un pèlerinage.—M. Aimé Martin—M. Lebœuf et une trompette.—Un colonel et un triangle.—Jugement d’un jugement.—Le colin-maillard.—Les cantonniers des Tuileries à la place Louis XVI.—Les nouveaux pairs.—M. de Balzac et une petite chose.—La quatrième page des journaux et les brevets du roi.—M. Cherubini.—Le général Bugeaud.—A quoi ressemble la guerre d’Afrique.—Une bonne intention du duc d’Orléans.—La Chambre des députés.—Consolations à une veuve.—Un joli métier.—Aménités d’un carré de papier.—Une besogne sérieuse.—Correspondance.—Un secret d’influence.—Les écoles gratuites de dessin. | 188 |
FÉVRIER.—Les fleurs de M. de Balzac.—Mémoires de deux jeunes mariées.—Les ananas.—La balançoire des tours Notre-Dame.—A monseigneur l’archevêque de Paris.—Un mot de M. Villemain.—Un conseil à M. Thiers, relativement à l’habit noir de l’ancien ministre.—Une annonce.—Un député justifié.—Sur quelques Nisards.—M. Michelet et Jeanne d’Arc.—M. Victor Hugo archevêque.—M. Boilay à Charenton.—Une lettre de M. Jean-Pierre Lutandu.—Une nouvelle invention.—Seulement...—Une croix d’honneur et une rose jaune.—Les Glanes de mademoiselle Bertin.—MM. Ancelot, Pasquier, Ballanche, de Vigny, Sainte-Beuve, A. Dumas, Vatout, Patin, de Balzac, l’évêque de Maroc.—Question d’Orient.—Le roi de Bohême.—M. Nodier.—M. Jaubert.—M. Liadières.—M. Joly.—M. Duvergier de Hauranne Grand-Orient.—Le général Hugo.—Naïveté de deux ministres.—M. Aimé Martin et la Rochefoucauld.—Pensées et maximes de M. Aimé Martin.—Éloge de M. Aimé Martin.—Au revoir | 209 |
MARS.—Les bals de l’Opéra.—Une rupture.—M. Thiers et les Guêpes.—Le bal du duc d’Orléans.—Plusieurs adultères.—Grosse scélérate.—Une gamine.—Sur quelques Nisards (suite).—Les capacités.—M. Ducos.—M. Pelletier-Dulas.—A. M. Guizot.—L’acarus du pouvoir.—Grattez-vous.—M. Ballanche.—M. de Vigny.—M. Vatout.—M. Patin.—Le droit de visite.—M. de Salvandy et M. de Lamartine.—Les chaises du jardin des Tuileries.—Une prompte fuite à Waterloo.—Le capitaine Bonnardin.—M. Gannal au beurre d’anchois.—A M. E. de Girardin.—M. Dumas.—M. Ballanche.—M. Pasquier.—M. Dubignac | 233 |
AVRIL.—Une pension de mille écus et M. Hébert.—Longchamps.—M. de Vigny.—M. Patin.—M. Royer-Collard.—Remède contre le froid aux pieds.—M. C. Bonjour, le roi Louis-Philippe, M. Rudder et M. Cayeux.—EXPOSITION DU LOUVRE: M. Hébert à propos du portrait de la reine.—Louis XVIII et un suisse d’église.—M. Vickemberg et M. Biard.—M. Meissonnier et M. Béranger.—M. Gudin.—Le lion de M. Fragonard.—M. Affre.—Monseigneur de Chartres.—M. Olivier et une dinde truffée.—La Vierge de Bouchot.—Les ânes peints par eux-mêmes.—Question des sucres.—Un tailleur à façon.—Lorenzino de M. Al. Dumas.—Un vendeur de beau temps.—M. Listz.—Le cancan, la béquillade, la chaloupe, dansés par M. de B., au dernier bal de madame la duchesse de M...—M. Dubignac sur Napoléon, les femmes et l’amour, etc., etc.—Succès pour le commerce français, obtenu sur la plaidoirie de Me Ledru-Rollin | 259 |
MAI.—Le roi Louis-Philippe et le jardinier de Monceaux.—Un concurrent à M. Emile Marco de Saint-Hilaire.—Propos légers d’une Dame.—M. de Lamartine au château.—M. Aimé Martin et la reine d’Espagne.—Le sucre.—Les rues de Paris.—Les morts d’avril.—M. Boursault.—Le duc de Joinville.—Un costume complet.—M. Lacave-Laplagne et M. Royer-Collard.—Un bon livre.—Dialogue de M. d’Arlincourt.—Un vicaire général et un curé.—M. Surgis.—Éloge d’un tailleur.—M. Nodier et M. Flourens.—Les eaux.—M. Perlet.—M. Romieu et le Cid.—Un triomphe de M. de Balzac.—M. Roger de Beauvoir au contrôle des Folies-Dramatiques.—Un bruit sur M. Hugo.—De M. Delecluse.—Comme quoi il est brouillé avec la nature.—Un souvenir historique.—Opinion d’un journaliste de 1780 sur les fortifications de Paris.—Encore le droit de visite.—Une nouvelle muse.—Bévue d’une Académie.—Un homme qui a de l’huile à vendre.—Le 1er mai. | 286 |
FIN DE LA TABLE DU TROISIÈME VOLUME.
Paris.—Typ. de A. WITTERSHEIM, 8, rue Montmorency.
| ŒUVRES D’ALPHONSE KARR Format grand in-18. | |
| LES FEMMES | 1 vol. |
| AGATHE ET CÉCILE | 1 — |
| PROMENADES HORS DE MON JARDIN | 1 — |
| SOUS LES TILLEULS | 1 — |
| LES FLEURS | 1 — |
| SOUS LES ORANGERS | 1 — |
| VOYAGE AUTOUR DE MON JARDIN | 1 — |
| UNE POIGNÉE DE VÉRITÉS | 1 — |
| LA PÉNÉLOPE NORMANDE | 1 — |
| ENCORE LES FEMMES | 1 — |
| MENUS PROPOS | 1 — |
| LES SOIRÉES DE SAINTE-ADRESSE | 1 — |
| TROIS CENTS PAGES | 1 — |
| LES GUÊPES | 6 — |
En attendant que le bon sens ait adopté cette loi en un article, «la propriété littéraire est une propriété,» l’auteur, pour le principe, se réserve tous droits de reproduction et de traduction, sous quelque forme que ce soit.
Paris.—Typ. de A. WITTERSHEIM, 8, rue Montmorency.
PAR
ALPHONSE KARR
—QUATRIÈME SÉRIE—
NOUVELLE ÉDITION

PARIS
MICHEL LÉVY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE VIVIENNE, 2 BIS
—
1859
Reproduction et traduction réservées
Un feuilleton de M. Jars, membre de la Chambre des députés.—Les vieilles phrases et les vieux décors.—Les enseignements du théâtre.—Un nouveau cerfeuil.—Les circonstances atténuantes.—M. Jasmin.—Un peintre de portraits.—La refonte des monnaies.—M. Lerminier.—M. Ganneron.—M. Dosne.—M. l’Herbette.—M. Ingres.—M. Boilay.—M. Duvergier de Hauranne.—M. Étienne.—M. Enfantin.—M. Enouf.—M. Rossi.—Le droit de pétition.—M. l’Hérault.—M. Taschereau.—M. d’Haubersaert.—M. Bazin de Raucou.—Madame Dauriat.—Les tailleurs.—M. Flourens.—Le Journal des Débats, Fourier et Saint-Simon.—Pétition de M. Arago.—Le droit de visite.—Un éloge.
![]() On a trouvé d’assez mauvais goût un feuilleton fait par M. Jars à
la Chambre des députés;—ce feuilleton, outre des compliments à
mademoiselle Georges—et une déclaration d’amour à mademoiselle Rachel,
renferme une particularité assez curieuse.—Selon M. Jars, les
directeurs des théâtres vont chaque matin chez les auteurs, et leur
disent: Voici de l’or! travaillez pour nous, travaillez vite!
On a trouvé d’assez mauvais goût un feuilleton fait par M. Jars à
la Chambre des députés;—ce feuilleton, outre des compliments à
mademoiselle Georges—et une déclaration d’amour à mademoiselle Rachel,
renferme une particularité assez curieuse.—Selon M. Jars, les
directeurs des théâtres vont chaque matin chez les auteurs, et leur
disent: Voici de l’or! travaillez pour nous, travaillez vite!
M. Jars—adresse ensuite quelques reproches et quelques conseils aux auteurs.
Quand on a à porter un nom comme celui de M. Jars, on devrait, ce nous semble,—l’exposer beaucoup moins aux hasards du calembour.
![]() Il est, selon nous, à la fois odieux et ridicule de voir cette même
Chambre, qui traite si légèrement tant d’autres choses,—accorder chaque
année une si grotesque importance aux divers tréteaux comiques et
tragiques de Paris.
Il est, selon nous, à la fois odieux et ridicule de voir cette même
Chambre, qui traite si légèrement tant d’autres choses,—accorder chaque
année une si grotesque importance aux divers tréteaux comiques et
tragiques de Paris.
![]() M. Auguis a demandé une chose presque raisonnable,—à savoir: que
la ville de Paris fût chargée de payer les subventions des théâtres qui
la divertissent plus ou moins.—N’est-il pas en effet singulier que le
pauvre paysan breton ou alsacien—soit obligé de payer sa part de la
subvention accordée à l’Opéra, au Théâtre-Français, à
l’Opéra-Comique—de Paris!
M. Auguis a demandé une chose presque raisonnable,—à savoir: que
la ville de Paris fût chargée de payer les subventions des théâtres qui
la divertissent plus ou moins.—N’est-il pas en effet singulier que le
pauvre paysan breton ou alsacien—soit obligé de payer sa part de la
subvention accordée à l’Opéra, au Théâtre-Français, à
l’Opéra-Comique—de Paris!
![]() Du reste, je signalerai ici une tactique assez habile de la part de
la direction de l’Opéra.
Du reste, je signalerai ici une tactique assez habile de la part de
la direction de l’Opéra.
Beaucoup de MM. les députés et de MM. les journalistes jouissent d’une entrée gratuite à l’Opéra.
Il y a un article du règlement qui défend d’accorder ces entrées. Or, au moment où la Chambre arrive à ce qu’on appelle ussion de la subvention de l’Opéra,—pour que les députés et les journalistes qui ont promis de l’appuyer n’oublient pas leur engagement, pour que les autres aient au moins le soin de rester neutres et muets,—la direction de l’Opéra—fait mettre dans tous les journaux une note qui rappelle la prohibition de l’article tant du règlement—et invite les personnes ayant droit aux entrées à faire établir ce droit sous bref délai.
Ce qui, pour les privilégiés, veut dire: «Vous voyez que vous n’avez aucun droit à la faveur dont vous jouissez; vous voyez qu’il nous est même défendu de vous l’accorder;—une faveur surtout gratuite ne peut pas se donner pour rien;—ayez donc soin de la mériter et faites votre devoir.»
![]() Et alors, députés et journalistes sortent d’une des cases de leur
cervelle cinq ou six phrases vermoulues consacrées à cette
question,—absolument comme on sort de temps en temps du magasin les
vieux décors de la Vestale et de Fernand Cortez. «L’Opéra est une
gloire nationale;—le Théâtre-Français est l’école des mœurs;—la
comédie est le miroir des vices: castigat ridendo mores; c’est
l’utile dulci d’Horace; c’est la morale embellie par les grâces;
c’est un magasin de hauts enseignements,» etc., etc.
Et alors, députés et journalistes sortent d’une des cases de leur
cervelle cinq ou six phrases vermoulues consacrées à cette
question,—absolument comme on sort de temps en temps du magasin les
vieux décors de la Vestale et de Fernand Cortez. «L’Opéra est une
gloire nationale;—le Théâtre-Français est l’école des mœurs;—la
comédie est le miroir des vices: castigat ridendo mores; c’est
l’utile dulci d’Horace; c’est la morale embellie par les grâces;
c’est un magasin de hauts enseignements,» etc., etc.
![]() Cette fois-ci, je résolus de savoir ce qu’il en était—et de
m’assurer par moi-même des heureux effets que produit le théâtre sur la
morale publique.
Cette fois-ci, je résolus de savoir ce qu’il en était—et de
m’assurer par moi-même des heureux effets que produit le théâtre sur la
morale publique.
A cet effet, j’allai me mêler aux groupes qui, à la sortie du spectacle, se pressent autour de la statue de Voltaire, sous le péristyle du Théâtre-Français,—pour surprendre les impressions que venaient de recevoir les spectateurs des hauts enseignements qui leur étaient présentés.
ENSEIGNEMENT DU THÉÂTRE.
Premier groupe.
—Je ne comprends pas que mademoiselle *** mette une robe verte avec des rubans bleus.
—Quel âge peut bien avoir ***?
—Vous croyez....
—J’ai vu ses débuts....
—Il est changé.
Deuxième groupe.
—J’aimerais bien mademoiselle ***.
—Elle a un amant,
—C’est lui qui a donné les diamants qu’elle portait ce soir.
—Ah! ah!—ils sont fort beaux.
—Ce gaillard-là ne laisse aux autres que la ressource d’être aimés pour rien.
Troisième groupe.
—Quand je pense que je demeure sur le carré de cet homme-là et qu’il est si tranquille!
—Vous ne l’entendez jamais déclamer?
—Non. Il est toujours à cultiver ses œillets.
Quatrième groupe.
—Où allez-vous, demain matin?
—J’irai au bois de Boulogne.
—A cheval?
—Non!—en voiture.—Et vous?
—Moi je comptais aller à cheval,—mais si vous voulez me donner une place, prenez-moi en passant,
—Avez-vous encore de ces cigares?...
—Oui!—j’en apporterai.
Cinquième groupe.
—Au nom du ciel, ne m’envoyez plus de bouquets, mon mari s’en inquiète.
—A quelle heure serez-vous...
—Chut!—le voilà.
Sixième groupe.
—Mais, monsieur, pourquoi me poussez-vous comme cela?
—Monsieur, je vous demande mille pardons.
—Monsieur, il n’y a pas de quoi.
—Ah! mon Dieu! le coquin avait de bonnes raisons pour me pousser, il m’a volé ma montre.
Septième groupe.
—Certainement, je ne m’en irai pas à pied.
—Mais, ma bonne, il fait un temps superbe,
—C’est égal, je suis fatiguée.
Huitième groupe.
—Mademoiselle *** est faite comme un ange.
—Elle n’a pas de gorge.
—Il m’a semblé, cependant...
—Je te dis que je sais à quoi m’en tenir.
Neuvième groupe.
—Croiriez-vous qu’on ne m’a envoyé qu’une stalle d’orchestre!
—C’est comme à moi,
—Je vais joliment éreinter la pièce.
—Et moi donc!
—Avec ça que le cinquième acte est trop long.
—Et puis cela traîne partout.
—Je vais faire mon article tout de suite.
Dixième groupe.
—Les banquettes sont furieusement dures.
—On peut dire qu’elles sont rembourrées avec des noyaux de pêches.
—Hi! hi! hi!
![]() Le péristyle se désemplissait peu à peu;—dans le dernier flot de
foule qui sortait une femme jeta un cri;—son mari, qui lui donnait le
bras,—lui demanda ce qu’elle avait.
Le péristyle se désemplissait peu à peu;—dans le dernier flot de
foule qui sortait une femme jeta un cri;—son mari, qui lui donnait le
bras,—lui demanda ce qu’elle avait.
—Tu n’aurais pas crié pour rien.
—C’est quelqu’un qui m’a poussée.
Le mari jette autour de lui un regard menaçant.
Un homme qui était derrière eux a déjà disparu.
Je savais à quoi m’en tenir sur les hauts enseignements de cette école des mœurs.—J’allumai un cigare et je rentrai chez moi.
![]() Laquelle est-ce de vous, mes guêpes,—que j’ai chargée de la
surveillance de messieurs les savants et de mesdames leurs inventions?
Laquelle est-ce de vous, mes guêpes,—que j’ai chargée de la
surveillance de messieurs les savants et de mesdames leurs inventions?
—C’est vous, Grimalkin...—N’avez-vous rien à me dire?
—Si, vraiment, maître;—M. Lissa a envoyé à la Société royale d’horticulture de Paris des graines de cerfeuil bulbeux,—plante qu’il a introduite en France—et dont il enrichit nos jardins.
—C’est donc un fameux cerfeuil, Grimalkin?
—Je le crois bien, maître.—On l’appelle chacrophyllum bulbosum.
—Et qu’a dit la Société royale d’horticulture?
—Elle a reçu avec plaisir et reconnaissance...
—Mais enfin quels avantages présente ce cerfeuil?
—Je ne sais pas, maître.
—Vous me direz au moins quelle différence?
—Oh! il y en a une:—le rédacteur des Annales de la Société, tout en conseillant de le cultiver, conseille de n’en pas trop manger, parce que plusieurs raisons lui font penser qu’il pourrait bien être vénéneux.
«Il faut le semer en automne—ou en février au plus tard.»
—A moins qu’on ne le sème pas du tout, Grimalkin.
![]() Le jury et les circonstances atténuantes vont toujours leur
train.
Le jury et les circonstances atténuantes vont toujours leur
train.
DÉPARTEMENTS (Isère).—Pont-de-Beauvoisin.—Une accusation de parricide accompagnée de circonstances horribles était portée aux assises de l’Isère contre Jean Boudrier, de Pont-de-Beauvoisin, accusé d’avoir mis le feu à une grange où dormait son père, vieillard octogénaire et paralytique. A peine si le lendemain, dans les décombres de l’incendie, on a retrouvé quelques ossements humains calcinés.
Les péripéties de ce drame, qui s’est terminé par une scène aussi terrible, duraient depuis quinze ans, époque à laquelle Jean Boudrier, fuyant la maison paternelle, avait proféré pour dernier adieu ces atroces paroles: «Je voudrais voir rôtir mon père comme un crapaud sur une pelle.»
Le jury a reconnu Jean Boudrier coupable du crime dont il était accusé, mais avec des circonstances atténuantes. En conséquence, Jean Boudrier a été condamné aux travaux forcés à perpétuité.
![]() Je vous le disais bien, il y a un an,—que vous seriez honteux
d’avoir soutenu les fortifications:—et vous, monsieur Barrot, qui les
attaquez maintenant à la tribune,—et vous journalistes qui les
invectivez dans vos feuilles,
Je vous le disais bien, il y a un an,—que vous seriez honteux
d’avoir soutenu les fortifications:—et vous, monsieur Barrot, qui les
attaquez maintenant à la tribune,—et vous journalistes qui les
invectivez dans vos feuilles,
![]() M. Jasmin, coiffeur et poëte, est arrivé à Paris où il a dîné avec
le roi Louis-Philippe, et avec MM. les coiffeurs de la capitale;—il a
été invité et reçu dans plusieurs maisons du faubourg Saint-Germain.
M. Jasmin, coiffeur et poëte, est arrivé à Paris où il a dîné avec
le roi Louis-Philippe, et avec MM. les coiffeurs de la capitale;—il a
été invité et reçu dans plusieurs maisons du faubourg Saint-Germain.
Rapprochez ceci de ce que je vous ai dit de ce dîner où le roi fit semblant de ne pas savoir que M. de Lamartine fait des vers, et vous en tirerez pour conséquence ce que je vous ai répété déjà bien des fois.
O poëtes,—vous serez toujours méprisés et dédaignés.—La presse est arrivée aux affaires, aux honneurs (quels honneurs!) mais la presse n’est pas plus la poésie, que les Cosaques ne sont l’armée russe.
Les ravages qu’a causés la presse sur son passage—n’ont fait qu’ajouter un peu de haine au mépris que l’on avait pour vous.
On n’accueillerait pas ainsi au château un poëte qui ne serait pas en même temps perruquier.
Peut-être,—par suite de cette affaire,—quelques poëtes vont se faire coiffeurs,—et je n’y verrai pas grand mal;—mais je suis sûr que depuis huit jours les jeunes coiffeurs inoccupés ont fait plus de trois millions de vers.
![]() Voici ce qui arrive à un peintre qui fait un portrait, sauf les
nuances qu’apportent nécessairement la position sociale et l’éducation
du modèle.
Voici ce qui arrive à un peintre qui fait un portrait, sauf les
nuances qu’apportent nécessairement la position sociale et l’éducation
du modèle.
—Monsieur, suis-je bien ainsi?
—Madame, je ne saurais trop vous recommander de prendre une position naturelle.
—Mais, monsieur, je ne crois pas me maniérer.
—Ce n’est pas ce que je veux dire, madame; je veux simplement vous engager à prendre la pose qui vous est la plus habituelle; je ne puis peindre que ce que je vois, et il faut avant tout que la personne que l’on peint tâche de se ressembler à elle-même.
La femme considère cette observation comme non avenue: elle garde une pose prétentieuse et maniérée; elle lève les yeux au ciel, ou les ferme languissamment; elle serre les lèvres pour se rapetisser la bouche; elle est naturellement enjouée, elle prend un air majestueux.
Le peintre fait son esquisse.
—Dites-moi, monsieur, ne serais-je pas mieux ainsi?
—Je ne pense pas.
—Cependant, je pense que cela fera mieux.
Elle prend une pose toute différente de la première, sans être pour cela moins affectée.
Le peintre efface son esquisse. Comme il va en commencer uns autre:
—Décidément, vous aviez raison, la première pose valait mieux.
Et le malheureux artiste recommence ce qu’il a effacé.
—Je vous recommanderai la couleur de mes yeux; j’ai la faiblesse d’y tenir. Cela est excusable quand on a si peu de chose de bien.
—Madame est trop modeste; car au contraire...
Pendant ce temps, elle a encore changé de position.
—Voudriez-vous avoir la bonté, madame, de reprendre la position où vous étiez tout à l’heure?
—C’est qu’elle me gêne un peu.
—Alors, madame, prenez-en une que vous puissiez garder, car il me faut recommencer mon ouvrage chaque fois que vous remuez.
—Alors je vais reprendre celle de tout à l’heure. Suis-je bien comme cela?
—Très-bien, si vous y restez.
—Bérénice!
Entre la femme de chambre, laquelle est aussi la cuisinière.
—Bérénice, apportez-moi mon écrin.
Écrin est un mot qui n’est pas d’un usage habituel entre la maîtresse et la domestique, et dont on ne se sert que pour le peintre et pour lui donner une brillante idée de sa distinction.
—Comment dit madame?
—Ma boîte à bijoux, imbécile.
Bérénice apporte une boîte.
—Dites-moi, monsieur, quel collier et quels pendants d’oreilles me conseillez-vous de mettre?
—Ceux qui vous plairont le mieux, madame.
—Mais il me semble qu’un peintre doit avoir là-dessus des idées?
—J’aimerais assez le corail.
—Cependant, ce sont ordinairement les femmes brunes qui affectionnent le corail, et, si j’ai quelque chose de passable, c’est la blancheur de la peau.
—Je n’en ai jamais vu de plus belle.
—Je vais mettre des diamants.
—Bérénice!
—Madame?
—Avez-vous pensé à prévenir le coiffeur pour ce soir?
—Non, madame.
—A quoi sert-il alors que je vous parle? allez-y tout de suite.
—Ah! monsieur, on est bien malheureux d’avoir des domestiques; je me surprends quelquefois à envier la position d’un artiste: au moins vous êtes indépendant, vous faites vos affaires vous-même.
—Hélas! madame, je suis forcé de vous ôter cette illusion: je ne suis pas assez heureux pour cirer mes bottes moi-même;—mais je vous supplierai de tourner la tête un peu plus à droite, comme vous étiez tout à l’heure.
—Mon Dieu! monsieur, je ne sais pourquoi on n’a jamais pu me faire ressemblante; j’ai deux portraits de moi, ce sont deux horreurs. Sur le dernier, j’ai une bouche qui n’en finit pas; je vous recommanderai la bouche, ce n’est pas que j’y tienne. Quand on a une grande fille de six ans... (La fille en a neuf.)—quand on a une grande fille de six ans, il faut renoncer à toutes les prétentions; mon mari aime beaucoup ma bouche, et il serait désolé de la voir trop grande sur le portrait.
—Je vous la ferai aussi petite que vous voudrez, madame.
—Surtout, monsieur, je ne veux pas être flattée; je ne suis pas comme ces femmes qui exigent qu’on donne à leurs portraits tous les charmes qui leur manquent.—Je fais demander le coiffeur pour une soirée, pour un bal où je vais ce soir. Je n’aime guère le monde, mais on ne peut se dérober aux exigences et aux devoirs de la société. Et puis mon mari veut que je sorte un peu de la solitude, qui me plaît infiniment. Je ne sais comment m’habiller ce soir, car il ne faut pas faire peur.
—Pensez-vous que je ferai bien de mettre du bleu?
—Le bleu doit vous aller à ravir.
—Cependant, toutes réflexions faites, je mettrai une robe de crêpe rose.—Remarquez, s’il vous plaît, que j’ai le nez assez délicat; c’est même tout ce que j’ai de remarquable dans la figure.
—Ah! madame!
—Permettez que je voie.
—Il n’y a presque rien de fait.
—C’est égal, c’est très-joli; mais pourquoi ai-je ainsi le cou noir et bleu?
—Ce sont des ombres indiquées.
—Mais c’est que je passe au contraire pour avoir le cou très-blanc, je vous avouerai même que c’est ma prétention.
—Je vois mieux que personne, madame, que vous avez le cou d’une blancheur éblouissante; mais j’ai eu l’honneur de vous dire que ce sont des ombres que j’indique; d’ailleurs, cela ne restera pas ainsi.
—A la bonne heure.
—Voulez-vous, madame, vous remettre en place?
—Très-volontiers: suis-je bien ainsi?
—Vous êtes charmante de toutes les manières, madame; mais, si vous préférez maintenant cette pose, il va falloir que j’efface tout pour recommencer.—La tête un peu à droite,—baissez les yeux un peu plus.
—Est-ce que je n’avais pas les yeux au ciel?
—Non, madame.
—C’est singulier! c’est que c’est un mouvement qui m’est très-familier.
—Il est alors facile de changer le mouvement des yeux.
Entre un monsieur; ce monsieur est un courtier marron que madame décore du titre d’agent de change.
—Tenez, monsieur T***, mon mari veut que je me fasse peindre encore une fois.
—On ne saurait trop reproduire un aussi charmant visage.
—Voyons, T***, vous savez que j’ai horreur des compliments. Trouvez-vous que je sois ressemblante?
—Certainement, la peinture de monsieur est fort bien; je dirai plus... elle est... fort bien; mais vous êtes plus jolie que cela.
Le peintre se retourne avec l’intention de faire observer au connaisseur que le portrait n’est qu’ébauché; mais il s’arrête, et sa pensée se dessine sur ses lèvres en un sourire ironique. Le connaisseur continue:
—Il y a, ou plutôt il n’y a pas... un je ne sais quoi; enfin, monsieur, je voudrais voir ici, dans les yeux, plus de... vous comprenez, et aussi quelque chose dans le front.
—Et, dit la femme, ne trouvez-vous pas aussi que le cou est un peu noir?
—J’ai eu l’honneur, dit le peintre un peu impatienté, de dire à madame que, si je ne marque pas d’ombres, elle aura la figure plate comme une silhouette; avec plus d’attention, madame apercevrait ces ombres sur la nature.
—Ah! pour cela, dit le connaisseur, monsieur a raison: ce sont les ombres;—on ne peut chicaner les peintres là-dessus; c’est une imperfection, mais ils ne peuvent faire autrement; l’art a ses limites. Les madones de Raphaël ont peut-être un peu moins d’ombres que le portrait que fait monsieur, mais elles en ont cependant.
Le peintre, pour cette fois, se lève et annonce qu’il reviendra le lendemain. Le lendemain, on le fait attendre une heure; plus, on ne veut plus mettre de diamants, et la coiffure a été changée.
Toujours préoccupée des ombres de son cou, la dame a clandestinement enlevé et jeté ce que le peintre avait mis de bleu sur la palette.
![]() Au moment où on s’occupe de la refonte des monnaies, M. Anténor
Joly a adressé au gouvernement un mémoire dans lequel il propose un
système qui a reçu l’approbation d’une grande partie des
journaux.—D’après ce système,—on échapperait à la monotonie de voir
sans cesse sur les gros sous la même figure de roi d’un côté, et de
l’autre l’invariable couronne de chêne.
Au moment où on s’occupe de la refonte des monnaies, M. Anténor
Joly a adressé au gouvernement un mémoire dans lequel il propose un
système qui a reçu l’approbation d’une grande partie des
journaux.—D’après ce système,—on échapperait à la monotonie de voir
sans cesse sur les gros sous la même figure de roi d’un côté, et de
l’autre l’invariable couronne de chêne.
On se rappelle ce paysan qui exilait Aristide seulement parce que cela l’ennuyait de l’entendre appeler le Juste. Qui sait si les révolutions n’ont pas pour principe l’ennui de voir toujours la même figure sur les pièces de monnaie?
Selon le nouveau système, nos sous seraient frappés aux diverses effigies des grands hommes:—d’un côté le visage,—de l’autre les vertus et belles actions.—De même qu’on dit un louis,—un napoléon,—un philippe,—on dirait un martin,—un chambolle,—un lerminier.—J’aurais bien quelques objections à faire à cette innovation:
1º Nous avons beaucoup de grands hommes fort laids;—l’aspect trop fréquent de leur figure pourrait diminuer sensiblement le respect que méritent leurs actes.
2º Ce serait donner au pouvoir un nouveau et terrible moyen de corruption;—tant de gens échangent volontiers l’honneur contre les honneurs;—que ne fera-t-on pas pour devenir gros sou! Quelle gloire d’être gros sous, et devant quelle infamie reculera-t-on si elle aide à y parvenir?
3º Ne serait-ce pas donner à la fois un nouvel aliment et un nouveau prétexte à l’amour de l’argent?
4º N’a-t-on pas à craindre un fâcheux agiotage,—une dépréciation de certains gros sous et un enchérissement de quelques autres;—tandis qu’un système monétaire bien établi doit être fondé sur un rapport quelconque entre le signe et la valeur représentée?—Ne verra-t-on pas,—et cela—à l’arbitraire des goûts, des sympathies et des caprices,—donner trois ledru pour un jars,—et vice versa?
Néanmoins,—et malgré ces objections et plusieurs autres encore qu’il serait facile de faire,—nous donnons un spécimen de quelques-unes des nouvelles monnaies qui proviendraient de l’application de ce système.—Je prends une pièce au hasard;—pour savoir de quel côté je la présenterai à mes lecteurs,—je la jette en l’air:
—Pile ou face?
La pièce tombe pile:—c’est le côté des vertus et des belles actions.
M. LERMINIER.
1830 Démocrate assez farouche.
1840 Dévoué à la dynastie, nommé professeur.
1841 On lui jette des pommes cuites.
1842 Idem crues.
Dieu protége la France.
M. GANNERON.
1820 Épicier. Apporte à la chandelle de notables perfectionnements.
1832 Député, colonel de la deuxième légion.
1840 Écrit: «Plusieurs compagnies ont ouverTES des souscriptions.»
1841 Danse avec les filles du roi.
1842 Est mécontent.
Dieu protége la France.
M. JARS.
Est envoyé à la Chambre pour le maintien des droits et des
libertés de la France.
—Monte à la tribune et dit des douceurs à mademoiselle
Rachel.
—Le Moniteur est chargé de porter le poulet.
Dieu protége la France.
M. DOSNE.
1825 Reçoit gratuitement une charge d’agent de change de la
duchesse d’Angoulême.
1840 Parie à la Bourse contre la politique de son gendre.—S’en
retourne à Lille.
Dieu protége la France.
M. L’HERBETTE.
1839 Se coupe les cheveux en brosse.
1840 Demande à la Chambre des députés que les femmes de
lettres puissent écrire malgré leurs maris.
Dieu protége la France.
M. INGRES.
1828 Supprime le rouge.
1832 Nettoie sa palette du jaune.
1841 Ne sait pas où Dieu avait la tête quand il a mis tant de
vert dans la nature.
Dieu protége la France.
M. BOILAY.
1839 Est inventé par M. Thiers.
1841 Passe à M. Guizot.
1842 Est mis à Charenton.
Dieu protége la France.
M. DUVERGIER DE HAURANNE.
1828 Fait des vaudevilles.
1829 La fameuse chanson de la redingote; après la révolution
de Juillet, se donne à M. Guizot.
1840 Passe à M. Thiers.
Dieu protége la France.
M. DE RAMBUTEAU.
1837 Prononce le fameux discours: «Les habitants de Paris
sont mes enfants.—C’est les pauvres qu’est les aînés.»
1838 Reprononce le fameux discours.
1839 Prononce le discours où il appelle donataire celui qui
donne.
1840-41-42 Fait paver la rue Vivienne perpétuellement.
Dieu protége la France.
M. CHAMBOLLE.
1840 S’en va-t-en guerre.—Le 25 août 1840,—imprime
que M. de Lamartine est un niais.
Dieu protége la France.
M. ÉTIENNE.
Fait des vaudevilles et des chansons bachiques; est reçu
membre du Caveau et de plusieurs sociétés buvantes et chantantes.
Est nommé pair de France.
Trouve mauvais qu’un poëte (M. de Lamartine) se mêle de
politique.
Écrit: «C’est avec une plume trempée dans notre cœur.»
Dieu protége la France.
M. COUSIN.
1815 Baise la botte de l’empereur de Russie.
Dit à M. Molé, à la Chambre des pairs: «Je vous donne
un démenti.»
1840 Cire les souliers de M. Thiers.
Se lave les mains.
Laisse tomber la littérature en quenouille.
1841 Refuse un titre vain.
Dieu protége la France.
M. DUPIN L’AINÉ.
1830 A très-peur.
1835 Insulte M. Clauzel.—M. Clauzel demande raison.—Me
Dupin s’excuse.—Fait trois discours contre le
duel.
Est très-audacieux.—Son audace n’effraye que lui.—Il
va le soir en demander pardon au château.
Dieu protége la France.
M. ENFANTIN.
1827 Invente un nouveau bleu pour le billard.
1828 Rend un point au garçon de billard du Grand-Balcon.
1830 Se déclare dieu.
1840 Découvre un nouveau crapaud.
Dieu protége la France.
M. ENOUF.
1826 Elève des veaux à Carentan.
1838 Fait à la Chambre une proposition hardie qui n’est pas
appuyée;—à savoir: de ne parler pas plus de quatre
à la fois.
Dieu protége la France.
M. VIVIEN.
1828 Ecrit le Code des théâtres et le Mercure des salons,—journal
des modes.
—Est ministre après la révolution de Juillet.
Dieu protége la France.
M. AUGUIS.
1832 Fait mettre une paire de manches à son habit vert.
1833 Fait retourner ledit habit.
1835 Le donne à son portier.
1837 Le reprend à son portier pour ses étrennes.
1840 Y fait mettre des pans neufs.
1841 Y fait mettre des boutons.
Dieu protége la France.
M. ROSSI.
En 17»» naît Autrichien.
En 1808 devient Français.
En 1812—Italien.
1814—Napolitain.
1820—Genevois.
1830—Refrançais.
Dieu protége la France.
M. ARAGO.
18»» Annonce que des étoiles fileront, les étoiles ne filent pas.
1840 Dîne beaucoup à Perpignan.
Dieu protége la France.
DROIT DE PÉTITION.
1828 Les garçons de bureau vendent les pétitions à la livre.
1842 Les garçons de bureau vendent les pétitions au kilogramme.
Dieu protége la France.
M. L’HÉRAULT.
Est envoyé à la Chambre pour le maintien des droits et des
libertés de la France.
Il porte une redingote gris-crapaud.
Dieu protége la France.
JOURNAL DES DÉBATS.
Epouse successivement et non sans dot les intérêts de tous les
gouvernements, prouve qu’il n’a jamais varié dans ses opinions
et qu’il a été de tout temps pour le gouvernement actuel.
Conseille aux pauvres de mettre à la Caisse d’épargne.
Dieu protége la France.
M. DE BALZAC.
Se livre à diverses incarnations comme Vichnou.
—Imprimeur.
—Viellerglé.
—Horace de Saint-Aubin.
—Balzac.
—De Balzac.
—Le plus fécond de nos romanciers.
—Cultive des ananas.
—Défend Peytel, qui lui pardonne en mourant.
—Tombe du théâtre, et se remet à faire de beaux romans.
Dieu protége la France.
M. TASCHEREAU.
1839 Dit: «Oh! oh!»
1840 «Allons donc!»
1841 «La clôture!»
1842 «L’appel nominal!!!»
Dieu protége la France.
M. TROGNON.
Est nommé professeur du duc de Joinville.
1833 Son élève le force de s’habiller en Turc.
1840 Le fait mettre à terre à l’île de Wight, parce que sa figure
attristait un bal que le prince donnait sur son
vaisseau.
Dieu protége la France.
M. D’HAUBERSAERT.
1830 Il avait le nez couleur cerise.
1833 cramoisi.
1835 ponceau.
1840 écarlate.
1842 Beaucoup plus rouge qu’en 1840.
Dieu protége la France.
M. BAZIN DE ROCOU.
Manifeste l’intention d’écrire plusieurs ouvrages.
Est nommé par le roi chevalier de la Légion d’honneur.
Dieu protége la France.
M. LEDRU-ROLLIN.
—Achète un privilége trois cent trente mille francs.
—Fait un discours contre les priviléges.
1840 Se présente comme candidat dynastique.
1842 Se présente comme candidat républicain.
Dieu protége la France.
M. AMILHAU.
1820 Conspire.
1840 Juge les conspirateurs.
Dieu protége la France.
M. CHAPUYS DE MONTLAVILLE.
1840 Ne salue pas la reine.
1841 Fait son grand discours contre les épingles de la duchesse
d’Orléans.
—Demande une réduction de huit cent mille francs sur un
article de cent quarante mille.
1842 Découvre qu’un greffier de justice de paix grève le Trésor
de cinquante francs par an.
Dieu protége la France.
S. M. LOUIS-PHILIPPE.
1842, 20 février. Vend les premiers haricots verts de l’année.
Dieu protége la France.
M. COULMAN.
—Se présente aux Tuileries fort mal vêtu.
Demande si on le prend pour un marquis.
Dieu protége la France.
LE PETIT MARTIN.
Origine de sa grandeur.—Il a un pouce de moins que
M. Thiers.
Il fait les commissions.
Il entre au conseil d’Etat.
Dieu protége la France.
LE DANDYSME.
Enrichit la langue française des mots: «deat heat,—stagss
hund,—joal stalkes,—comfort,—stud book,—new betting
room stakes,—two years old stakes,—sport,—sportmen,—sportwomen,—gentlemen
riders,—turf,—sport,—steeple
chase, etc.»
—En 1839 invente les gilets trop courts.
Dieu protége la France.
MADAME DAURIAT.
A neuf ans commence à fumer des cigares.
A quarante ans se déclare contre un gouvernement sous lequel
on n’est plus jeune.
Prêche publiquement la liberté de la femme.
Demande à être députée.
Laisse croître sa barbe.
Dieu protége la France.
M. LEBŒUF.
Fait la banque à Fontainebleau.—Donne sa voix en échange
d’une invitation aux bals de la cour pour madame Lebœuf.
Dieu protége la France.
LES TAILLEURS.
1831 Demandent des droits politiques.
1838 Se prononcent pour le sans-culottisme avec une touchante
abnégation.
1840 Veulent fumer en travaillant.
Dieu protége la France.
M. GANNAL.
Veut empailler les cendres de l’empereur.
—Écrit clandestinement sur les pierres tumulaires à la suite
des vertus des défunts: «Empaillé par M. Gannal.»
—Un de ses élèves empaille les côtelettes et les petits pois—qui
seront mangés par nos descendants.—Nous pouvons
aujourd’hui faire à dîner pour nos arrière-neveux.
Dieu protége la France.
LE COURRIER FRANÇAIS.
1840 Veut qu’on chasse à coups de pieds le roi de Sardaigne.
1842 Pense que le roi de Sardaigne est un grand prince,—puisqu’il
a su apprécier mademoiselle Fitz-James.
Dieu protége la France.
LA SCIENCE.
On s’obstine à nourrir de gélatine les malades des hôpitaux
qui s’obstinent à en mourir de faim.
On découvre un nouveau cerfeuil vénéneux.
On attaque la pyrale, insecte qui nuit à la vigne, au moyen
d’une composition qui détruit les ceps—et brûle les mains qui
l’emploient.
Le gaz éclate.
Les chemins de fer causent d’horribles catastrophes.
On propose d’employer la vapeur et les rails à marcher plus
lentement qu’un fiacre sur le pavé.
Dieu protége la France.
JUSTICE.
Une douzaine d’empoisonneurs, d’assassins, de parricides,
éprouvent chaque année l’indulgence du jury.
Ces encouragements réussissent autant qu’on devait s’y attendre.
Dieu protége la France.
M. FLOURENS.
Élève des canards.
Est élu membre de l’Académie française.
Dieu protége la France.
On voit que, malgré quelques inconvénients, ce système monétaire n’est pas sans agréments.—Je joins ma voix à celle de la plupart des journaux pour conseiller au ministère d’en user; on dit que cela coûtera cher et que chaque pièce de deux sous reviendra à cinq cents francs.—Mais cela fera une galerie curieuse, et il faudrait, pour s’en priver, n’avoir pas une centaine de millions dans la poche des autres.
![]() Le Journal des Débats avait à rendre compte d’un ouvrage où il
est question de quelques dieux qui se sont révélés à la France dans ces
dernières années,—entre autres de Fourier et du père Enfantin,—le
Journal des Débats s’est trouvé un peu embarrassé;—il a attaché à sa
rédaction trois ou quatre saint-simoniens;—qu’est-il arrivé de
là?—Fourier, qui n’aurait eu que six colonnes tout au plus d’amertumes
et de sarcasmes sur les douze colonnes du feuilleton, a empoché en outre
la part de facéties et de reproches à laquelle avait droit le
saint-simonisme, dont l’article ne dit pas un mot.
Le Journal des Débats avait à rendre compte d’un ouvrage où il
est question de quelques dieux qui se sont révélés à la France dans ces
dernières années,—entre autres de Fourier et du père Enfantin,—le
Journal des Débats s’est trouvé un peu embarrassé;—il a attaché à sa
rédaction trois ou quatre saint-simoniens;—qu’est-il arrivé de
là?—Fourier, qui n’aurait eu que six colonnes tout au plus d’amertumes
et de sarcasmes sur les douze colonnes du feuilleton, a empoché en outre
la part de facéties et de reproches à laquelle avait droit le
saint-simonisme, dont l’article ne dit pas un mot.
![]() Dans plusieurs départements, le ciel s’est fait d’airain, les
nuages ne laissent pas échapper une goutte d’eau;—quelques
personnes,—frappées du bouleversement qui a eu lieu depuis quelques
années dans l’ordre des saisons,—veulent s’en prendre à M. Arago.
Dans plusieurs départements, le ciel s’est fait d’airain, les
nuages ne laissent pas échapper une goutte d’eau;—quelques
personnes,—frappées du bouleversement qui a eu lieu depuis quelques
années dans l’ordre des saisons,—veulent s’en prendre à M. Arago.
Voici leurs raisons:
Il y a des artisans qui mettent sur leur enseigne: fait tout ce qui concerne son état.
Il serait à désirer que ce principe,—et la négation qui en est le corollaire obligé, reçût son application dans toutes les positions sociales.—On verrait beaucoup mieux aller l’état particulier dont chacun s’occuperait, et ainsi l’état en général, dont chacun ne s’occuperait pas.
Malheureusement beaucoup de gens semblent avoir adopté aujourd’hui une enseigne contraire:
FAIT TOUT CE QUI CONCERNE L’ÉTAT DES AUTRES.
On en voit surtout de fréquents exemples à la Chambre des députés.
Entre autres, M. Arago.—M. Arago est un savant célèbre; pendant longtemps, on s’est habitué à n’avoir chaud ou froid en France que sur l’avis de M. Arago. Les journaux considéraient M. Arago comme un capucin hygromètre; on disait: M. Arago a ôté ou a remis son capuchon,—c’est-à-dire il fait beau ou il pleut.
En ce temps-là, les affaires du ciel allaient on ne peut mieux.—La nuit succédait au jour régulièrement et le jour à la nuit,—et l’on savait gré à M. Arago;—l’année avait ses cinquante-deux dimanches, et l’on disait: «Cet excellent M. Arago!»
Pour les affaires de la terre, elles allaient comme elles ont toujours été et comme elles iront toujours:—fort mal pour le plus grand nombre,—au bénéfice de quelques-uns.
Mais voici qu’un jour M. Arago se laissa choir dans le puits des affaires politiques,—qu’il se fit député et grand citoyen.
De ce jour, les affaires de la terre se mirent à aller absolument comme elles allaient auparavant;—pour les affaires du ciel, ce fut autre chose: l’anarchie se mit dans les astres;—la voix même de M. Arago ne fut plus écoutée:—M. Arago avait dit: «Les étoiles fileront.»
Et les étoiles ne filèrent pas:—il y eut au ciel des étoiles intelligentes,—comme sur terre des baïonnettes intelligentes;—il pleut l’hiver, il ne pleut pas l’été;—il fait chaud en février et froid en mai; enfin, on s’attend à voir arriver, d’un moment à l’autre, la fameuse semaine des trois jeudis, tant prédite par les prophètes.
Voilà sur quoi se fondent les personnes qui veulent s’en prendre à M. Arago de ce qu’il ne pleut pas.
![]() A force de récriminations, il est et il demeure avéré que tous les
ministres que nous avons eus depuis douze ans—se sont au moins laissé
jouer par l’Angleterre, et que quelques-uns en vue de la
traite,—d’autres en vue de l’alliance anglaise,—quelques autres par
pusillanimité,—tous ont plus ou moins consenti au droit de visite qui
institue les Anglais commissaires de police des mers. Le soin que les
ministres, ceux d’aujourd’hui et ceux qui les ont précédés, prennent de
se rejeter la chose les uns sur les autres, montre au moins qu’ils
reconnaissent unanimement que l’état de choses actuel ne peut
durer,—que ratifier le traité serait une lâcheté,—que, si la France ne
veut pas que les vaisseaux fassent la traite, c’est elle seule qui
surveillera l’exécution des lois qu’elle s’impose à elle-même et qu’elle
seule a le droit de s’imposer.
A force de récriminations, il est et il demeure avéré que tous les
ministres que nous avons eus depuis douze ans—se sont au moins laissé
jouer par l’Angleterre, et que quelques-uns en vue de la
traite,—d’autres en vue de l’alliance anglaise,—quelques autres par
pusillanimité,—tous ont plus ou moins consenti au droit de visite qui
institue les Anglais commissaires de police des mers. Le soin que les
ministres, ceux d’aujourd’hui et ceux qui les ont précédés, prennent de
se rejeter la chose les uns sur les autres, montre au moins qu’ils
reconnaissent unanimement que l’état de choses actuel ne peut
durer,—que ratifier le traité serait une lâcheté,—que, si la France ne
veut pas que les vaisseaux fassent la traite, c’est elle seule qui
surveillera l’exécution des lois qu’elle s’impose à elle-même et qu’elle
seule a le droit de s’imposer.
Je vous l’ai déjà dit: il ne faut pas jouer avec l’orgueil national; la Chambre des députés a voté un supplément de fonds pour la marine,—c’est une bonne et sage manifestation;—tenez-vous pour avertis,—car cette guerre que vous redoutez trop,—vous l’aurez par les moyens mêmes que vous employez pour l’éviter; peut-être, au moment où j’écris ces lignes, commence-t-elle par un coup de poing entre deux matelots.
Dédicace à la reine Pomaré.—Dissertation sur les tabatières.—La cuisine électorale.—Am Rauchen.
![]() Pourquoi et comment ce numéro est offert et dédié à la reine
Pomaré, et ce que c’est que la reine Pomaré.—Une digression peu étendue
au sujet de MM. Hatstard, Piati, Mamoi, Priter et Tate.—A une date
récente, on lit dans le Journal d’Anvers—que S. M. Pomaré, reine
d’Otaïti,—par l’organe de ses ministres;
Pourquoi et comment ce numéro est offert et dédié à la reine
Pomaré, et ce que c’est que la reine Pomaré.—Une digression peu étendue
au sujet de MM. Hatstard, Piati, Mamoi, Priter et Tate.—A une date
récente, on lit dans le Journal d’Anvers—que S. M. Pomaré, reine
d’Otaïti,—par l’organe de ses ministres;
Hatstard, président du conseil et ministre des relations extérieures;
Piati, secrétaire d’État au département de l’instruction publique;
Mamoi, ministre de la justice et des cultes;
Priter, ministre de la guerre;
Et Tate, ministre de l’intérieur,
Reconnaît à S. M. Louis-Philippe et à la nation française la souveraineté sur son pays.—On ne donne pas le nom du ministre des finances,—parce qu’il n’y a pas de finances à Otaïti, ou parce que le secrétaire d’État qui en est chargé—est quelque Gouin ou quelque Passy,—ou quelque autre ministre de remplissage,—quelque cheville comme en met M. de Pongerville dans ses vers hexamètres,—auxquels on n’a cependant jamais fait le reproche de ne pas être assez longs.
![]() DÉDICACE A S. M. LA REINE POMARÉ, SOUVERAINE DE L’ILE
D’OTAÏTI.—«Madame, j’ignore ce que vous avez l’habitude de donner pour
les dédicaces.—Autrefois, en France, le roi donnait une tabatière
enrichie de diamants;—il y avait des poëtes qui avaient ainsi un revenu
fixe de quatre ou cinq tabatières de rente.—On ne s’informait pas si
l’auteur de la dédicace prenait ou non du tabac, parce qu’on était sûr
que, ne prît-il pas de tabac, il prendrait néanmoins volontiers des
tabatières—enrichies de diamants.
DÉDICACE A S. M. LA REINE POMARÉ, SOUVERAINE DE L’ILE
D’OTAÏTI.—«Madame, j’ignore ce que vous avez l’habitude de donner pour
les dédicaces.—Autrefois, en France, le roi donnait une tabatière
enrichie de diamants;—il y avait des poëtes qui avaient ainsi un revenu
fixe de quatre ou cinq tabatières de rente.—On ne s’informait pas si
l’auteur de la dédicace prenait ou non du tabac, parce qu’on était sûr
que, ne prît-il pas de tabac, il prendrait néanmoins volontiers des
tabatières—enrichies de diamants.
»La tabatière est ici tombée en désuétude;—la dédicace aussi;—les académies en province, qui proposent,—pour de magnifiques prix de trois cents francs,—tant de questions saugrenues à résoudre, devraient bien encourager à des recherches ayant pour but de fixer l’histoire du cœur humain sur ce point: «a-t-on cessé de donner des tabatières après qu’on a cessé de faire des dédicaces, ou a-t-on cessé de faire des dédicaces aux rois depuis qu’ils ne donnent plus de tabatières—enrichies de diamants?»
»Il ne faut pas croire cependant que la source des faveurs royales soit tout à fait tarie et desséchée.
»Le public,—le peuple roi,—est jaloux des autres rois;—par ses trente-trois millions de mains, il donne plus,—chacune ne donnât-elle qu’un liard,—que ne peut donner le prince le plus magnifique.
»Il n’y a donc plus que quelques poëtes, mal avec ledit public,—qui risquent de temps en temps la dédicace.
»Non pas au roi,—ce serait trop hardi.
»Autrefois, pour insulter le roi de France, on allait un peu pourrir à la Bastille;—mais aujourd’hui, pour ne pas l’insulter,—le public vous condamne à mourir de faim.
»C’est pourquoi les plus audacieux—cherchent des objets pour les dédicaces à l’ombre du trône;—M. Fouinet a dédié, il y a quelques années, quelque chose au fils du duc d’Orléans; la duchesse lui a envoyé un porte-crayon en or.—La portière de la maison qu’habite M. Fouinet, à laquelle madame Fouinet a montré le porte-crayon, m’a assuré que le porte-crayon était contrôlé par la Monnaie.
»Le porte-crayon est le présent ordinaire de la duchesse d’Orléans.
»La reine de France—donne des épingles.
»La duchesse de Nemours ne donne rien.
»Personne ne donne de tabatière;—la tabatière est une forme réservée à la munificence personnelle du roi,—lequel n’en donne jamais[K].
»Quelques autres,—comme M. Nisard,—je ne sais, princesse, si vous connaissez M. Nisard,—dédient leurs ouvrages à des princes étrangers, au roi Léopold, par exemple, qui leur donne en échange—son innocente contrefaçon de la croix d’honneur française.
»J’ignore, princesse, quelle forme prendra votre munificence pour répondre à la dédicace que je lui fais de ce volume in-32;—je n’ose espérer votre portrait en pied:—c’est une faveur par trop intime, si, comme l’assurent plusieurs navigateurs, vous ne portez pour vêtement qu’une paire de boucles d’oreilles.
»Je crois donc devoir avertir Votre Majesté que je serais certainement flatté d’une décoration—quoique la vôtre se compose d’un clou de girofle comme on sait:—cela se met dans la sauce, il est vrai, mais c’est un sort commun avec le laurier des poëtes.
»Je serais donc flatté—d’être grand girofle,—à moins cependant que vous n’aimiez autant m’envoyer un peu de bon tabac[L].
»De progrès en progrès, de liberté en liberté, nous en sommes arrivés à ce point que le gouvernement ne permet d’acheter ni de vendre du tabac que dans ses propres boutiques, dans lesquelles il entasse avec soin toutes sortes d’herbes âcres et nauséabondes qu’il nous vend fort cher.
»Vous voulez, grande reine, donner vous et vos États au roi des Français et à la nation française[M].—Vous voulez prendre votre part des bienfaits du régime constitutionnel.—Permettez-moi de vous détailler quelques-uns de ces bienfaits,—et de vous donner ainsi un avant-goût des félicités auxquelles vous et vos sujets vous vous dévouez avec tant d’empressement.
»J’ai l’honneur d’être, madame, de Votre Majesté, etc.
»A. K.»
NOTES SUR LA DÉDICACE.
1 Il faut dire cependant—que j’ai eu une fois dans ma vie l’occasion de demander quelque chose à la famille royale,—c’était pour de pauvres pêcheurs de mes amis,—pour un village entier que le ciel et la mer avaient ruiné;—deux jours après, j’avais reçu des secours pour mes amis.
Tandis que plusieurs amis du peuple auxquels je m’étais adressé en même temps n’avaient pas jugé à propos de me répondre.
2 Le tabac que vend le gouvernement est tellement mauvais, que les fils du roi fument du tabac de contrebande, qu’ils achètent pas bien loin de la rue Vivienne, à Paris.
3 A dire le vrai, je ne suis pas fâché que le peuple français—se trouve un peu roi—et roi constitutionnel, je désire qu’il reçoive à son tour, pendant quelque temps, toutes les avanies qu’il prodigue aux siens depuis une vingtaine d’années.
Il est bon que les épiciers, bonnetiers, marchands d’allumettes chimiques, cessent un moment d’être tyrans pour devenir rois constitutionnels, et trempent un peu leurs grosses lèvres dans les breuvages amers qu’ils font boire à leurs rois.
Je commencerai, madame, par vous parler d’une invention qui a produit le gouvernement constitutionnel.
Vos sujets ont été bien étonnés la première fois qu’ils ont entendu un coup de fusil et qu’ils en ont vu les résultats.—Leur étonnement n’a pas diminué—quand ils ont vu que ce bruit et cette mort soudaine—se produisaient—en mettant dans un tube une ou deux pincées d’une petite graine noire ressemblant fort à la graine de pavots;—que cette graine, au lieu de germer et de produire des feuilles et des fleurs,—éclatait et allait tuer les gens à de grandes distances,—ressemblant encore en cela à la graine de pavots, qui endort de certaine façon, mais l’emportant de beaucoup sur les qualités de cette graine, en cela que le sommeil qu’elle procure est éternel.
Eh bien, l’invention de cette graine noire,—qui a donné au nombre, à la lâcheté et à l’adresse,—un avantage invincible sur la force et le courage,—cette invention n’est rien en comparaison de celle dont j’ai à vous entretenir.
La première se fait avec du charbon et du salpêtre.—Voici comment on use de la seconde:
Plusieurs milliers d’hommes vont chercher aux coins des bornes, dans les tas d’ordures,—dans les endroits les plus boueux,—tout ce qu’il y a de chiffons misérables, de lambeaux infects, de haillons pourris.—On les entasse dans des caves, on les fait pourrir encore,—puis on en fait une pâte que l’on étale et que l’on fait sécher en feuilles minces.
![]() D’un autre côté,—on concasse un poison violent que l’on appelle
noix de galle;—on y mêle un peu d’un autre poison qu’on nomme
vitriol,—et on en fait un liquide d’une couleur triste et funeste, de
la couleur du deuil et de la mort.
D’un autre côté,—on concasse un poison violent que l’on appelle
noix de galle;—on y mêle un peu d’un autre poison qu’on nomme
vitriol,—et on en fait un liquide d’une couleur triste et funeste, de
la couleur du deuil et de la mort.
D’autre part, on a rassemblé curieusement les plumes d’un animal, emblème de la sottise, et dont le nom est devenu une injure;—on les taille en forme de dard.—Quand cela est fait,—des milliers de gens—s’établissent sur les tables et se livrent au singulier exercice que voici.
![]() Cette liqueur noire, composée du mélange de deux poisons, est dans
un petit vase,—devant eux; ils s’arment de leur harpon de plume
d’oie,—et ils se livrent à la pêche de vingt-quatre petits signes
qu’ils mettent sécher, à mesure qu’ils les ont pêchés, l’un après
l’autre sur les feuilles minces provenant des pourritures diverses dont
je vous parlais tout à l’heure,—c’est-à-dire, pour parler plus
clairement, que de leur plume d’oie, trempée dans ce poison noir,—ils
dessinent sur leur papier vingt-quatre petits dessins, toujours les
mêmes, mais dans un ordre différent,—mettant l’un avant l’autre, ou
celui-ci après celui-là.
Cette liqueur noire, composée du mélange de deux poisons, est dans
un petit vase,—devant eux; ils s’arment de leur harpon de plume
d’oie,—et ils se livrent à la pêche de vingt-quatre petits signes
qu’ils mettent sécher, à mesure qu’ils les ont pêchés, l’un après
l’autre sur les feuilles minces provenant des pourritures diverses dont
je vous parlais tout à l’heure,—c’est-à-dire, pour parler plus
clairement, que de leur plume d’oie, trempée dans ce poison noir,—ils
dessinent sur leur papier vingt-quatre petits dessins, toujours les
mêmes, mais dans un ordre différent,—mettant l’un avant l’autre, ou
celui-ci après celui-là.
C’est par ce moyen qu’on détruit les religions, qu’on renverse les rois,—qu’on déshonore ou ridiculise les particuliers, qu’on excite les haines, qu’on allume les guerres, qu’on engendre des flots de bile,—et qu’on fait répandre des flots de sang.
C’est bien pis que les caractères magiques, que les signes cabalistiques des sorciers.
Vous voyez un homme qui vit calme, heureux, sans désirs, dans la retraite, à cent lieues de vous;—vous tracez deux ou trois douzaines de ces signes choisis entre les vingt-quatre:—cet homme pâlit, ses yeux s’animent d’un feu sombre; il repousse les caresses de ses enfants,—il cesse d’arroser son jardin, ses fleurs sont flétries,—son dîner est empoisonné, les mets qu’il aime ne lui inspirent plus que le dégoût,—son oreiller est rembourré d’épines;—il est sous des arbres frais, il ne goûte plus la fraîcheur,—il ne sent plus les parfums du chèvrefeuille,—il n’entend plus la voix de la fauvette cachée dans les feuilles;—son chien vient le flatter, il repousse le chien d’un coup de pied;—il n’oserait sortir, tout le monde rirait sur sa route;—il avait commencé un ouvrage avec ardeur, il y avait déposé ses plus doux souvenirs, ses plus fraîches sensations, il jette l’ouvrage au feu;—tout cela parce que vous avez tracé ces maudits signes dans tel ou tel ordre.
Maintenant, regardez ailleurs, à cent lieues d’un autre côté: un pauvre jeune homme, dans une mansarde sans meubles, grignotte quelques mauvaises croûtes de pain;—quelques grosses larmes roulent dans ses yeux,—rougis par les veilles et par la misère;—il n’oserait sortir de chez lui,—il est timide,—de cette timidité des orgueilleux;—il lui semble que tout le monde voit sa misère et y insulte;—d’ailleurs, il trouve qu’on a raison, il est découragé, il ne se sent ni talent ni esprit,—il n’est bon à rien, il ne fera rien.
Prenez alors les mêmes signes dont vous vous êtes servis tout à l’heure:—mettez celui-ci avant celui-là,—bien;—ôtez celui-là d’où il est, rapportez-le ici,—très-bien;—changez de place ces deux autres,—c’est bien cela;—mettez au commencement celui-là qui est à la fin,—mettez à la fin celui-là qui est au milieu,—séparez ces deux-ci par celui-là, mettez cet autre à côté:—on ne peut mieux,—eh bien!
![]() Voyez,—il relève la tête;—les couleurs de la santé, de la vie, de
l’espoir, reviennent sur son visage;—il lève les yeux au ciel;—son
sang coule à pleine veine, il se sent fort,—il sait qu’il arrivera à
son but;—toutes les misères du passé et du présent sont effacées, il ne
voit que les gloires et les joies de l’avenir;—son pain dur est plus
savoureux que le meilleur salmis de bécasses;—son lit de
sangle—devient un moelleux divan recouvert des étoffes les plus
riches;—l’eau de sa cruche se change en vin du Rhin;—les belles filles
qu’il n’osait regarder dans la rue sont maintenant à lui;—son ouvrage,
il le continue avec confiance;—il sort pour qu’on le voie, pour qu’on
le salue, pour qu’on l’admire, et il baisse la tête en passant sous la
porte cochère, tant il se sent grandi.—Il se baisserait sous le ciel
pour ne pas décrocher quelques étoiles.
Voyez,—il relève la tête;—les couleurs de la santé, de la vie, de
l’espoir, reviennent sur son visage;—il lève les yeux au ciel;—son
sang coule à pleine veine, il se sent fort,—il sait qu’il arrivera à
son but;—toutes les misères du passé et du présent sont effacées, il ne
voit que les gloires et les joies de l’avenir;—son pain dur est plus
savoureux que le meilleur salmis de bécasses;—son lit de
sangle—devient un moelleux divan recouvert des étoffes les plus
riches;—l’eau de sa cruche se change en vin du Rhin;—les belles filles
qu’il n’osait regarder dans la rue sont maintenant à lui;—son ouvrage,
il le continue avec confiance;—il sort pour qu’on le voie, pour qu’on
le salue, pour qu’on l’admire, et il baisse la tête en passant sous la
porte cochère, tant il se sent grandi.—Il se baisserait sous le ciel
pour ne pas décrocher quelques étoiles.
Voilà, madame, avec quoi et comment on gouverne aujourd’hui le pays.—Il y a beaucoup d’écoles où on apprend aux enfants à tremper des plumes d’oie dans le poison en question et à tracer les vingt-quatre signes;—avec ces vingt-quatre signes,—que tous savent tracer,—on s’attaque, on se fait maigrir, on se blesse les uns les autres,—on renverse et on détruit tout.
Nous allons parler un peu de l’éducation des enfants.
![]() On renferme les enfants au nombre de soixante dans une chambre; on
les empêche de jouer à la balle ou à la toupie—jeux de leur âge—pour
leur faire apprendre les belles-lettres, qui sont les récréations de
l’âge mûr.
On renferme les enfants au nombre de soixante dans une chambre; on
les empêche de jouer à la balle ou à la toupie—jeux de leur âge—pour
leur faire apprendre les belles-lettres, qui sont les récréations de
l’âge mûr.
On leur fait passer huit années d’ennui, de chagrin, de pleurs, de privations,—pour leur apprendre une langue que personne ne parle plus sur toute la surface de la terre.
De telle sorte que le but de l’éducation, le résultat de ces années de tristesse et de travail—est de se trouver à vingt ans beaucoup moins habile que ne l’était un jeune Romain à six ans.
On a trouvé singulier que Caton s’avisât d’apprendre le grec dans un âge avancé.—Il est, selon moi, bien plus singulier qu’on force de pauvres petits enfants à apprendre le latin.—Caton apprenait le grec parce qu’il avait envie de le savoir—et d’ailleurs il y avait encore des Grecs.
L’éducation consiste tout entière dans le langage;—on récompensera l’enfant qui dépeindra la débauche en beau style; celui qui exprimerait, avec des solécismes, les plus nobles et les plus purs sentiments, aurait nécessairement des pensums et serait mis en retenue.
On vous fait traduire toutes les vertus républicaines;—on ne vous parle pendant huit ans que de république;—on vous fait admirer Mucius Scævola. D’autre part—on ne vous apprend qu’à écrire de belle prose et à faire des vers.
Après quoi, ceux qui sont trop poëtes meurent de faim dans les greniers; ceux qui sont trop républicains meurent dans les rues—en prison ou au bagne:—aussi, parmi ces enfants devenus hommes,—tout ne consiste-t-il qu’en paroles.
Qu’un procureur du roi passe dix ans—à envoyer le plus possible les gens au bagne ou à l’échafaud, que pendant dix ans il s’efforce de faire condamner trois innocents contre deux coupables, et cela avec la même ardeur,—il n’en sera pas moins considéré;—mais qu’il s’avise d’écrire homme sans h—omme,—il est perdu, il ne peut plus se montrer,—on le désigne du doigt,—il faut qu’il change de nom et qu’il quitte la ville;—il vaut mieux, pour sa fortune et sa considération, qu’il fasse couper la tête à un homme sur l’échafaud—que de lui retrancher une lettre sur le papier.
![]() Parlons un peu, madame, du gouvernement.
Parlons un peu, madame, du gouvernement.
Un droguiste qui voudrait se faire bonnetier ferait hausser les épaules à tous les bonnetiers de son quartier. «Eh? s’écrierait-on de toutes parts, où a-t-il appris notre état? quand s’en est-il occupé,—et comment veut-il le faire s’il ne l’a pas appris?»
Mais qu’un droguiste ou qu’un bonnetier ait amassé une fortune suffisante—dans les raccourcissantes préoccupations du commerce qui consistent à payer les choses au-dessous de leur valeur et à les revendre au-dessus,—il aspire à gouverner son pays, et personne ne le trouve mauvais.
Notez qu’il ne s’avise de cela qu’à l’âge où ses facultés s’effacent au point qu’il n’est plus capable de tenir sa maison comme par le passé.—Ses enfants alors et ses gendres craignent qu’il ne patauge d’une manière désastreuse dans ses affaires, et ils lui font venir l’idée d’être député.—Peu leur importe qu’il aille porter sa part de sottises dans l’administration du pays,—pourvu qu’il ne fasse plus de fautes dans l’achat et la vente du coton.
Certes, si un homme de cinquante ans était venu trouver M. Ganneron ou M. Cunin-Gridaine—et avait dit à l’un: «Je veux être épicier,»—ou à l’autre: «Je me destine à la fabrication des draps,»—M. Ganneron ou M. Gridaine aurait dit à cet homme:
—Mon bon ami, vous êtes-vous occupé de la partie?
—Non, monsieur, aurait-il répondu.
—Alors, mon bon ami, vous êtes fou.
![]() Eh bien, M. Ganneron et M. Cunin ont passé leur jeunesse et une
bonne moitié de leur âge mûr dans les préoccupations de l’épicerie et de
la fabrication des draps.—Après quoi un jour ils se sont mis dans le
gouvernement,—l’un comme député, l’autre comme ministre.
Eh bien, M. Ganneron et M. Cunin ont passé leur jeunesse et une
bonne moitié de leur âge mûr dans les préoccupations de l’épicerie et de
la fabrication des draps.—Après quoi un jour ils se sont mis dans le
gouvernement,—l’un comme député, l’autre comme ministre.
Il n’y a pas un seul métier pour lequel on n’exige un apprentissage:—un maçon,—un coiffeur,—un cordonnier,—apprennent leur état.—Mais le Français qui, autrefois, se contentait de naître malin,—naît aujourd’hui profond politique et parfaitement capable de gouverner son pays,—ce talent lui vient si bien tout seul, qu’en attendant les occasions de l’exercer il fait comme les chevaux qu’on va lancer sur l’hippodrome, il s’amuse à galoper en sens contraire du chemin qu’il a à parcourir.
Il s’occupe en attendant l’âge ou le cens,—de toutes les choses qui n’ont aucun rapport avec la politique.
On ne tient aucun compte des connaissances spéciales, tel ministre passe de l’intérieur aux affaires étrangères ou aux finances.—M. Thiers n’a pas été bien loin de prendre le portefeuille de la guerre, et c’est parce qu’on n’a pas voulu le lui confier qu’il n’a pas eu celui des finances.
La Chambre des députés—c’est-à-dire le véritable gouvernement du pays—se compose donc, pour les deux tiers, d’épiciers retirés, de bonnetiers fatigués, de rôtisseurs fourbus, d’étuvistes édentés, de marchands de vin usés;—l’autre tiers, à très-peu d’exceptions près, est formé d’avocats—accoutumés à plaider sur tous les sujets le pour ou le contre, souvent même le pour et le contre.
Mais en ce moment, madame, la France vous présente un aspect assez curieux:—on prépare des élections générales;—il s’agit, pour les uns, de se faire réélire; pour les autres, d’arriver à la députation.
Certes, à voir la quatrième page de tous les journaux sans cesse remplie de remèdes pour les maladies les plus horribles,—on pourrait croire que la France est un pays particulièrement malsain, qui ne produit que des êtres chétifs et livrés aux maux les plus variés, aux affections les plus déplorables et les plus dégoûtantes.—Mais, quand on lit les autres pages, on est bien consolé, en voyant les professions de foi des candidats,—de quel fervent amour de la patrie tout le monde est ici possédé,—avec quel désintéressement, quelle abnégation—on se résigne à la députation!
C’est partout le même langage et les mêmes vertus,—à proprement parler, il n’y a, pour tous les candidats, qu’une seule et même profession de foi.
C’est celle exactement—que font sur les places publiques les arracheurs de dents,—les extirpateurs de cors, les destructeurs de punaises.
«Ce n’est pas leur intérêt particulier qui les attire sur cette place; non, messieurs, c’est l’amour de l’humanité, c’est l’amour de la patrie!—c’est pour faire profiter leurs compatriotes de ce précieux citoyen,—qui va ramener l’âge d’or, proscrire les abus,—diminuer les impôts, etc.
«Et combien le vends-tu?—Je ne le vends pas vingt sous—je ne le vends pas dix sous, messieurs,—je ne le vends pas, je le donne.»
Que l’antiquité vienne donc encore nous parler de son Décius,—qui se jette à cheval dans un gouffre pour sauver la république;—nous avons en ce moment sept ou huit cents Décius—qui, pour sauver la France,—se pressent, se bousculent, se battent comme des crocheteurs aux bords du gouffre—où leur patriotisme et leur dévouement les précipitent;—mais l’ardeur de tous est la même,—et comme le gouffre ne peut contenir qu’un nombre fixe de victimes,—il n’est pas de moyen qu’on n’emploie pour supplanter les autres qui veulent aussi se dévouer,—les crocs-en-jambe,—les coups portés par derrière,—etc.—Heureuse France!
![]() Je me rappelle un bal masqué où il se trouva vingt-deux
polichinelles;—c’est un peu l’aspect que présentent les candidats;—ils
ont tous pris le même costume,—la robe blanche et sans tache des
candidats de l’antiquité;—les mêmes paroles,—le même masque;—tous les
intérêts particuliers se transforment en intérêts du pays;—c’est bien
l’histoire de mes vingt-deux polichinelles. Celui-ci, cependant, veut
être député pour quitter sa province et son ménage;—celui-là veut avoir
la croix;—cet autre une place:—tout cela s’appelle, pour l’instant,
dévouement et intérêt du pays. Vingt-deux polichinelles!
Je me rappelle un bal masqué où il se trouva vingt-deux
polichinelles;—c’est un peu l’aspect que présentent les candidats;—ils
ont tous pris le même costume,—la robe blanche et sans tache des
candidats de l’antiquité;—les mêmes paroles,—le même masque;—tous les
intérêts particuliers se transforment en intérêts du pays;—c’est bien
l’histoire de mes vingt-deux polichinelles. Celui-ci, cependant, veut
être député pour quitter sa province et son ménage;—celui-là veut avoir
la croix;—cet autre une place:—tout cela s’appelle, pour l’instant,
dévouement et intérêt du pays. Vingt-deux polichinelles!
Les électeurs sont comme le public des théâtres;—il leur faut du commun;—il faut que le candidat ressemble à un type de candidat qu’ils ont dans la tête.
Quelque chose d’indépendant en paroles,—quelque chose qui fasse de l’opposition,—mais sans succès,—parce que l’électeur ne veut pas de révolution ni d’émeute.—Il aime la provocation, mais il n’aime pas le combat.
Aussi les républicains, dans leurs professions de foi, se font doux comme des moutons;—leur drapeau n’est plus rouge, il est rose.
Les candidats du ministère mettent au contraire leur chapeau sur l’oreille et font les crânes et les tapageurs;—ils ont de grandes cannes—et font la grosse voix.
Le ministère a permis à ses candidats de s’élever contre le droit de visite;—l’opposition a autorisé les siens à ne pas s’élever contre le recensement, dont elle a tant fait de bruit.
La profession de foi est ce qui se crie sur les toits, ce qui s’imprime;—mais les candidats sont loin de se fier à ce programme de leurs vertus,—ils ont soin de caresser tout bas les vices de leurs commettants.—Ils achètent les voix une à une, l’opposition par des promesses et des menaces,—le ministère par des promesses et des à-compte. Une fois ces marchés passés à voix basse,—on met tout haut la chose aux enchères;—les professions de foi servent alors de prétexte;—celui qui a obtenu une bourse dans un collége pour son fils, ou un bureau de tabac pour lui-même, ne peut pas dire que c’est pour cela qu’il vote de telle ou telle manière. Il choisit dans la profession de foi de son candidat la phrase la plus ronflante—et il dit «Voilà pourquoi je vote pour lui.»
![]() Un spectacle qui ne manque pas non plus de gaieté, c’est l’attitude
des journaux au moment des élections.
Un spectacle qui ne manque pas non plus de gaieté, c’est l’attitude
des journaux au moment des élections.
Les professions de foi de tous les candidats sont identiquement les mêmes.
UN JOURNAL DE L’OPPOSITIONS:
«Voici, vous dit-il,—la profession de foi du candidat de l’opposition, de M. Évariste Bavoux:
«Nous voulons au dedans la sage répartition des impôts,—le règne des lois et le progrès.
»Au dehors, la force et la dignité.»
»Ces nobles paroles, ajoute le journal, sont une garantie plus que suffisante,—tous les patriotes doivent voter pour M. Bavoux.»—Voici maintenant ce que dit M. Chevalier;—comparez et jugez:
«Nous voulons au dedans la sage répartition des impôts,—le règne des lois et le progrès.
»Au dehors, la force et la dignité.»
«Certes, si c’est avec de telles paroles, respirant le servilisme et le dévouement au ministère, que M. Michel Chevalier croit abuser les électeurs, il est dans une erreur dont nous devons l’avertir.—Les électeurs comprennent à demi-mot et traduisent la profession de foi de M. Michel Chevalier par soutenir le ministère de l’étranger,—l’aider à augmenter encore les impôts—et voter pour le droit de visite.
»M. Chevalier n’est pas pour M. Bavoux un concurrent sérieux.»
UN JOURNAL MINISTÉRIEL:
«Nous donnons la profession de foi de M. Michel Chevalier;—ce sont de nobles paroles.—L’élection de M. Chevalier est certaine.
«Nous voulons, dit M. Michel Chevalier,—au dedans, la sage répartition des impôts,—le règne des lois et le progrès.
»Au dehors, la force et la dignité.»
»On s’expliquera facilement l’échec assuré de M. Bavoux en comparant sa profession de foi à celle de M. Michel Chevalier.
»La voici:
«Nous voulons, au dedans, la sage répartition des impôts,—le règne des lois et le progrès.
»Au dehors, la force et la dignité.»
»C’est le langage audacieux du désordre et de l’anarchie.—Les électeurs en feront justice.»
Quelques personnes désœuvrées se rassemblent dans diverses salles de concert,—chez M. Herz, chez M. Érard,—non pour y entendre ou y faire de la musique,—mais pour y proposer divers rébus aux candidats.—C’est, pour le candidat, une situation analogue à celle d’Œdipe devant l’énigme du sphinx; s’il ne devine pas, il est mis en pièces.
![]() Cependant, les phénomènes que j’ai déjà signalés reparaissent dans
les journaux—qui ont à remplir à quelque prix que ce soit—la place
réservée d’ordinaire aux débats des Chambres.—On attribue à divers
cochers de fiacre contemporains certaines actions que nous avons
autrefois vues en thème attribuées à Épaminondas ou à Périclès.
Cependant, les phénomènes que j’ai déjà signalés reparaissent dans
les journaux—qui ont à remplir à quelque prix que ce soit—la place
réservée d’ordinaire aux débats des Chambres.—On attribue à divers
cochers de fiacre contemporains certaines actions que nous avons
autrefois vues en thème attribuées à Épaminondas ou à Périclès.
On rend compte de livres envoyés au journal il y a sept ou huit mois.
On annonce un concert qui a eu lieu l’hiver dernier—et dont le bénéficiaire n’a jamais pu obtenir une mention en temps utile, comme on dit au Palais.
Voici encore deux de ces histoires qu’on peut retrouver tous les ans dans les journaux à la même époque:
«Une femme de trente-huit ans est accouchée à Caen, le 14 mai, de son vingtième enfant, en second mariage. Sa fille aînée a épousé le frère de son second mari; elle se trouve donc la belle-sœur de sa fille, qui a un enfant de trois ans; l’accouchée est la grand’mère et la tante de l’enfant, sa fille devient la tante de son frère, et le nouveau-né devient oncle de sa tante et frère de son cousin germain.»
«EURE.—Dernièrement, un enfant de trois ans est tombé dans l’Avre, éloigné de tout secours. Fort heureusement, un chien qui était avec lui se précipite à l’eau et ramène sur la rive ce pauvre enfant. L’animal avait mis une telle prudence dans cet acte instinctif, qu’on n’a pas même retrouvé l’indice de ses crocs sur le bras de l’enfant, qu’il avait saisi pour le retirer de la rivière.»
N. B.—L’année passée, l’enfant était tombé dans la Marne.
Nous conseillons la Nièvre pour l’année prochaine: c’est une rivière encore vierge de belles actions.
![]() Il n’est pas de recueil de vers de jeune homme—Premières rimes,
Fleurs d’Avril, Premiers élans, etc., etc.,—premiers essais si
méprisés, d’ordinaire, dans les bureaux de journaux, qui n’obtienne en
ce moment une mention honorable.
Il n’est pas de recueil de vers de jeune homme—Premières rimes,
Fleurs d’Avril, Premiers élans, etc., etc.,—premiers essais si
méprisés, d’ordinaire, dans les bureaux de journaux, qui n’obtienne en
ce moment une mention honorable.
C’est la belle saison pour se livrer fructueusement à des actions recommandables.—En temps ordinaire, les journaux n’en disent mot;—mais pour le moment, sauvez la vie à une mouche qui se noie;—dites à un passant: «Monsieur, vous allez perdre votre foulard;»—avertissez une femme que le cordon de son soulier est dénoué,—vous voyez votre nom en toutes lettres dans les feuilles publiques avec le récit de votre belle action et un convenable éloge d’icelle.
Les journaux se sentent pris d’un goût subit pour les sciences,—pour l’agriculture,—pour tout ce qu’on trouve dans les recueils spéciaux et qui fournit des lignes.
Voici, par exemple, une histoire qui reparaît tous les ans à la même époque, c’est-à-dire dans l’intervalle d’une session à l’autre,—en même temps que les centenaires, les veaux à deux têtes,—les détails circonstanciés d’incendies dans des pays qui n’existent pas, etc.
«Un monsieur qui est en ce moment à Bruxelles, et qui s’appelle le baron Frédéric d’A..., a l’honneur d’exposer au public qu’étant doué d’un talent de conversation fort distingué, nourri d’études solides (ce qui devient de plus en plus rare), ayant recueilli dans ses nombreux voyages une foule d’observations instructives et intéressantes, il met son temps au service des maîtres et maîtresses de maison, ainsi que des personnes qui s’ennuieraient de ne savoir avec qui causer agréablement.
»Le baron Frédéric d’A... fait la conversation en ville et chez lui. Son salon, ouvert aux abonnés deux fois par jour, est le rendez-vous d’une société choisie (vingt-cinq francs par mois). Trois heures de ses journées sont consacrées à une causerie instructive, mais aimable. Les nouvelles, les sujets littéraires et d’arts, des observations de mœurs où domine une malice sans aigreur, quelques discussions polies sur divers sujets, toujours étrangers à la politique, font les frais des séances du soir.
»Les séances de conversation en ville se règlent à raison de dix francs l’heure. M. le baron Frédéric d’A... n’accepte que trois invitations par semaine, à vingt francs (sans la soirée). L’esprit de sa causerie est gradué selon les services. (Les calembourgs et jeux de mots sont l’objet d’arrangements particuliers.)
»M. le baron Frédéric d’A... se charge de fournir des causeurs convenablement vêtus pour soutenir et varier la conversation, dans le cas où les personnes qui l’emploieraient ne voudraient pas avoir l’embarras des répliques, observations ou réponses. Il les offre également comme amis aux étrangers et aux particuliers peu répandus dans la société.»
Cette plaisanterie a été inventée il y a six ans par Gérard, l’auteur de la traduction de Faust,—un jour que nous mangions ensemble du macaroni fait par Théophile Gautier.
![]() Je n’ai pas encore vu cette année le serpent de mer,—mais il ne
peut tarder à faire son apparition annuelle;—le serpent de mer a été
imaginé par Léon Gozlan, je crois, il y a treize ou quatorze
ans.—Depuis ce temps, les journaux en ont annoncé une nouvelle
apparition chaque année,—toujours entre deux sessions.
Je n’ai pas encore vu cette année le serpent de mer,—mais il ne
peut tarder à faire son apparition annuelle;—le serpent de mer a été
imaginé par Léon Gozlan, je crois, il y a treize ou quatorze
ans.—Depuis ce temps, les journaux en ont annoncé une nouvelle
apparition chaque année,—toujours entre deux sessions.
Pour en revenir aux élections,—selon les journaux de l’opposition, toutes les candidatures hostiles au gouvernement sont assurées;—les amis du ministère n’ont aucune espèce de chance;—d’après les journaux ministériels, les candidats de l’opposition n’ont aucun succès à attendre, et ne sont pas même des rivaux sérieux pour les conservateurs.
On appelle conservateurs—ceux qui sont aux affaires, qui tiennent les places et l’argent et voudraient les conserver:—cela, dans les journaux du parti, est représenté comme une vertu civique.
On appelle indépendants ceux qui voudraient les places et l’argent,—qui attaquent les places, les abus, l’argent, les sinécures, non pour les détruire, mais pour les conquérir, et qui, à mesure qu’ils arrivent, deviennent les conservateurs les plus énergiques et les plus féroces.
Selon les journaux ministériels, tous les candidats de l’opposition sont des anarchistes, des gens sans portée, des brouillons,—en un mot, tout ce qu’étaient, sous la Restauration, les gens appelés aujourd’hui conservateurs.
Selon les journaux de l’opposition, tous les candidats conservateurs sont des gens gorgés d’or, abreuvés de la sueur du peuple et ignorant complètement l’orthographe.
Or, conservateurs ou indépendants,—les journaux de toutes les couleurs, de toutes les nuances, sont d’accord sur ceci: c’est que la presse a toujours raison.
Il n’y a pas un journal cependant dont un autre journal ne dise,—ou qu’il est vendu au pouvoir,—ou qu’il veut rétablir la guillotine en permanence.
La presse en général ne souffre pas d’appel de ses décisions, comment cependant de tant de journaux vendus, absurdes, féroces (d’après ses propres paroles), former une presse noble, indépendante, courageuse,—désintéressée,—amie de la nation, qu’elle prétend être?—Comment faire un édifice de marbre avec de la boue et du sable?—C’est une observation que je leur soumets.
![]() Il se fait en ce moment pour les élections une alliance qu’il m’est
impossible de ne pas trouver singulière:—c’est celle des républicains
et des légitimistes.
Il se fait en ce moment pour les élections une alliance qu’il m’est
impossible de ne pas trouver singulière:—c’est celle des républicains
et des légitimistes.
C’est une alliance bizarre et fondée sur ceci: le parti qui est le plus fort est évidemment le parti conservateur.—Le parti légitimiste, livré à ses propres forces, ne peut espérer le renverser;—le parti républicain est dans la même situation,—mais tous deux réunis peuvent l’emporter sur le parti conservateur.—Le parti conservateur une fois abattu, les deux partis alliés se sépareront, prendront du champ et se battront entre eux.
Ils ne se réunissent provisoirement que pour conquérir le champ de bataille où chacun des deux alliés espère écraser l’autre.
Quel que soit le résultat des élections,—tous les candidats, dont les deux tiers à peu près n’ont pour but que de renverser le roi Louis-Philippe,—sont prêts à lui prêter le serment de fidélité exigé par la loi.
![]() Il n’y a donc d’aucun côté—ni bonne foi, ni probité, ni
convictions sérieuses.
Il n’y a donc d’aucun côté—ni bonne foi, ni probité, ni
convictions sérieuses.
Sans parler des ruses, des perfidies, des intrigues de toutes sortes,—sans parler de la corruption qu’emploient tous les partis.
C’est la plus sale cuisine qu’on puisse imaginer;—pendant ce temps le pays est encore plus embarrassé que celui qui tient la queue de la poêle,—car c’est lui qu’on fait frire.
Et—des gens m’écrivent chaque mois pour me reprocher de ne pas prendre de couleur, de n’appartenir à aucun parti;—montrez-m’en un qui soit honnête—et nous verrons.
Les couleurs politiques sont comme les couleurs du peintre, elles n’ont qu’une surface mince, et cachent toutes la même toile.
En peinture,—grattez le rouge,—le blanc,—le vert,—le bleu: vous trouverez la toile—et la même toile.
En politique,—grattez les rouges,—les verts,—les bleus,—vous trouverez des ambitieux, des vaniteux, des avides.
Il s’imprime en ce moment—assez et plus qu’assez de journaux, de brochures, de revues, de pamphlets, de circulaires, de comptes rendus, de lettres, de professions de foi, etc., etc.
Tout cela est au service des ambitions, des orgueils, des avidités dont je vous parle,
Il n’y a que ce petit livre qui vous dise la vérité.
Mais on ne le reconnaîtra que plus tard, quand une autre folie aura remplacé celle d’aujourd’hui et permettra de la juger.
Continuez,—reine Pomaré,—à demander pour votre peuple et pour vous—les bienfaits du gouvernement constitutionnel.
Pour moi, je vous ai avertie,—il ne me reste qu’à me dire itérativement de Votre Majesté le très-humble et très-obéissant serviteur.
![]() Certes,—on a bien dit des choses contre certains musiciens et
certains instruments,—contre la clarinette, qui rend sourds ceux qui
l’entendent et aveugles ceux qui en jouent, contre les trompes de
chasse—qui se disent de l’une à l’autre,—depuis si longtemps, que le
roi Dagobert a mis sa culotte à l’envers,—ce qui a nécessairement donné
à M. Sudre l’idée première de son télégraphe musical.
Certes,—on a bien dit des choses contre certains musiciens et
certains instruments,—contre la clarinette, qui rend sourds ceux qui
l’entendent et aveugles ceux qui en jouent, contre les trompes de
chasse—qui se disent de l’une à l’autre,—depuis si longtemps, que le
roi Dagobert a mis sa culotte à l’envers,—ce qui a nécessairement donné
à M. Sudre l’idée première de son télégraphe musical.
Contre l’orgue de Barbarie, dans lequel on a l’air de moudre un air—comme on moud du café;—mais je ne sais rien de plus terrible contre les instruments de cuivre que ce qu’on trouve dans un journal anglais:
«On vient d’imaginer, pour les régiments, un instrument pour la marque.»
Cet instrument, substitué au fer brûlant, est en cuivre, et représente la lettre D. Cette lettre est percée d’une multitude de trous, à travers chacun desquels le mouvement d’un ressort fait sortir autant d’aiguilles acérées.
Après avoir appliqué l’instrument sur le bras ou dans le creux de la main du déserteur, selon que le porte la sentence, on fait, à l’aide d’une pression, sortir des pointes qui pénètrent dans l’épidermie à la profondeur requise, et y tracent l’empreinte sanglante de la lettre D. Pour rendre la marque indélébile, on frotte la plaie avec une brosse imbibée d’indigo en poudre et d’encre de la Chine délayée dans une quantité d’eau suffisante.
D’après le règlement, la marque ne peut être infligée qu’en présence de la troupe rassemblée sous les armes, et sous les yeux du chirurgien, par le trompette-major pour la cavalerie, et par le musicien qui joue du cor dans l’infanterie.
Les joueurs de cor—et de trompette remplacent le bourreau!
![]() Cette année sera tristement célèbre par les grandes catastrophes et
les accidents sans nombre qui ont frappé tous les pays. Mais, au milieu
des massacres, des incendies, des orages, des tempêtes et des
tremblements de terre, les trois derniers jours de la première semaine
du mois de mai doivent marquer parmi les jours néfastes, parce qu’ils
rappellent les trois plus grands malheurs de l’année: 6 mai, l’incendie
de Hambourg laisse sans asile vingt-deux mille habitants; le 7 mai, le
tremblement de Saint-Domingue écrase dans la ville du Cap dix mille
personnes sur une population de quinze mille; et le 8 mai, l’événement
du chemin de fer de Versailles jette dans le deuil deux cents familles,
et porte l’effroi et l’inquiétude dans toutes les provinces. On
trouverait difficilement le triste pendant de ces trois journées.
Cette année sera tristement célèbre par les grandes catastrophes et
les accidents sans nombre qui ont frappé tous les pays. Mais, au milieu
des massacres, des incendies, des orages, des tempêtes et des
tremblements de terre, les trois derniers jours de la première semaine
du mois de mai doivent marquer parmi les jours néfastes, parce qu’ils
rappellent les trois plus grands malheurs de l’année: 6 mai, l’incendie
de Hambourg laisse sans asile vingt-deux mille habitants; le 7 mai, le
tremblement de Saint-Domingue écrase dans la ville du Cap dix mille
personnes sur une population de quinze mille; et le 8 mai, l’événement
du chemin de fer de Versailles jette dans le deuil deux cents familles,
et porte l’effroi et l’inquiétude dans toutes les provinces. On
trouverait difficilement le triste pendant de ces trois journées.
![]() Un des prétextes sous lesquels on m’écrit le plus habituellement
des injures,—c’est qu’il m’arrive parfois de parler un peu de moi. J’ai
essayé de prendre ce reproche en considération—et de suivre le conseil
qu’on me donnait en même temps,—c’est-à-dire d’en laisser parler les
autres;—j’avouerai franchement que je ne suis pas parfaitement
satisfait de l’épreuve.
Un des prétextes sous lesquels on m’écrit le plus habituellement
des injures,—c’est qu’il m’arrive parfois de parler un peu de moi. J’ai
essayé de prendre ce reproche en considération—et de suivre le conseil
qu’on me donnait en même temps,—c’est-à-dire d’en laisser parler les
autres;—j’avouerai franchement que je ne suis pas parfaitement
satisfait de l’épreuve.
En effet, sans parler de ceux qui ne m’aiment pas—et qui m’appellent «ami du château,» je n’ai pas fort à me louer de ceux qui n’ont pour moi que des sentiments de bienveillance.—L’éditeur Souverain—a fait imprimer une fois à la quatrième page des journaux une annonce dans laquelle j’étais traité d’arc-en-ciel.
Un autre éditeur—y fait dire (toujours à la quatrième page) que je suis médisant, cancanier et un peu venimeux.
Il y a un brave homme qui gagne sa vie à vendre mes petits livres, et qui fait mieux que cela encore.
Si je suis éloigné de Paris,—si je pêche des maquereaux à Étretat ou des sardines à Sainte-Adresse, si le volume arrive un peu trop tard,—ce pauvre homme s’inquiète, conçoit contre moi une vive malveillance,—et commence à dire à tout venant que les Guêpes ne paraissent plus,—que l’on ne sait pas où je suis, etc., etc.
Cela ne le console que pendant les deux ou trois premiers jours de retard;—au quatrième, il dit aux gens qu’il rencontre: «Il paraît que les Guêpes se sont arrangées avec le ministère.» Le lendemain, il sait le chiffre de ma honte: «l’auteur reçoit trois mille francs par an.»
—Ah! ah!
—Oui, c’est M. Cavé qui a arrangé l’affaire.
—Mais cependant je ne vois pas qu’il soit bien complaisant pour le ministère...
—Aussi on a suspendu la pension.
—Alors il s’est vendu pour l’honneur?—c’est singulier!
—Vous savez qu’il est très-bizarre.
Le surlendemain,—ce n’est plus trois mille, mais six mille francs que je reçois par an.—Ce mois-ci,—diverses circonstances retardent l’envoi du manuscrit, je suis persuadé que ma subvention, que le prix de mon infamie, est monté à un chiffre qui pourrait me tenter.
Les gens qui ont lu les différentes sottises que quelques journaux ont écrites contre moi—seraient bien désappointés si, par hasard, ils me rencontraient.
Comment reconnaître en effet un ami du château,—un familier du duc d’Orléans,—un écrivain vendu au pouvoir, dans un homme qui vit seul au bord de la mer,—qui a le visage brûlé par le soleil, les mains durcies par la bêche et par la rame,—que l’on trouverait mêlé avec les autres pêcheurs,—vêtu comme eux,—les aidant à mettre les bateaux à la mer,—ou à virer au cabestan—pour les monter sur la terre,—quand la mer est en colère.
Dans le plus dur pêcheur de crevettes de la commune.
Dans un homme qui, si on lui demandait ses papiers,—n’aurait à présenter que celui dont voici la copie exacte:
FRANCE.
POLICE DE NAVIGATION.
Nom du navire, n. 7.
L’ARSELIN. Tonnage,
Nom du patron, »95/100.
ALPHONSE KARR.
Congé valable pour un an.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous ceux qui les présentes verront, salut.
«Vu les articles 2-4-5-11 et 22 de la loi du 27 vendémiaire an XI,—et l’article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 1838;
»Nous déclarons qu’il est donné congé au sieur Alphonse Karr de sortir du port avec le bateau nommé l’Arselin,—à charge par ledit sieur de se conformer aux lois et règlements de l’État;—ledit navire a été reconnu du tonnage de—»tonneaux—quatre-vingt-quinze centièmes,—non ponté,—deux mâts,—et il est actuellement attaché au port de Fécamp.
»Prions et requérons tous souverains, États, amis et alliés de la France et leurs subordonnés, mandons à tous fonctionnaires publics, aux commandants des bâtiments de l’État, et à tous autres qu’il appartiendra,—de le laisser sûrement et librement passer avec son bâtiment,—sans lui faire ni souffrir qu’il lui soit fait aucun trouble ni empêchement quelconque,—mais, au contraire, de lui donner toute faveur, secours et assistance partout où besoin sera.
»Reçu soixante-quinze centimes.»
Certes, voilà qui n’est pas cher! protégé par tant d’États, de souverains, d’officiers publics, de fonctionnaires—et vaisseaux de l’État pour soixante-quinze centimes.
Je donnerais volontiers soixante-quinze autres centimes pour être protégé comme écrivain aussi bien que je le suis comme pêcheur;—malheureusement il n’en est pas ainsi,—j’en raconterai une autre fois—une preuve convaincante.
![]() AM RAUCHEN.—L’amour est comme ces arbres à l’ombre desquels meurt
toute végétation.—L’homme qui aime une femme, non-seulement n’aime rien
autre chose, mais finit par ne rien haïr non plus; c’est en vain qu’il
cherche dans les replis de son cœur toutes les préférences, toutes
les sympathies, toutes les répugnances, tout cela est mort, mort
d’indifférence.
AM RAUCHEN.—L’amour est comme ces arbres à l’ombre desquels meurt
toute végétation.—L’homme qui aime une femme, non-seulement n’aime rien
autre chose, mais finit par ne rien haïr non plus; c’est en vain qu’il
cherche dans les replis de son cœur toutes les préférences, toutes
les sympathies, toutes les répugnances, tout cela est mort, mort
d’indifférence.
![]() Il faut qu’un jeune homme—jette ses gourmes,—qu’il fasse un poëme
épique en seconde.
Il faut qu’un jeune homme—jette ses gourmes,—qu’il fasse un poëme
épique en seconde.
Qu’il porte des souliers lacés, dissimulés par des sous-pieds très-tirés, des éperons si longs qu’on devrait, pour la sûreté des passants, y attacher de petites lanternes et crier: «Gare!»—qu’il s’écrive à lui-même des lettres de comtesse et se les envoie par la poste;—qu’il ait pour ami un acteur de mélodrame et le tutoie très-haut dans la rue;—qu’il mette un œillet rouge à sa boutonnière pour simuler à vingt pas le ruban de la croix d’honneur; qu’il parle de créanciers et de dettes qu’il n’a pas; qu’il plaisante beaucoup sur les femmes et sur l’amour, tandis que le moindre geste de la femme de chambre de sa mère le fait pâlir ou devenir cramoisi, et que le son de sa voix le fait frissonner;—qu’il appelle, en parlant d’eux, tous les hommes remarquables de l’époque simplement par leur nom sans y joindre le monsieur;—qu’il se dise désillusionné quand il n’a encore rien vu de la vie;—qu’il parle avec dédain de l’amour, de l’amitié, de la vertu, à cette riche époque de l’existence où le cœur, gonflé de bienveillance et d’exaltation, laisse déborder toutes les tendresses et tous les beaux sentiments;—qu’il prétende fumer avec le glus grand plaisir des cigares violents qui lui font vomir, dans une allée écartée du jardin, jusqu’aux clous de ses souliers;—qu’il parle avec un enthousiasme grotesque des choses à la mode qu’il ne sent pas, et cache avec soin les beaux et vertueux enthousiasmes de son âge;—qu’il vole dans les maisons des cartes de visite de personnages qu’il n’a jamais vus—et les accroche à sa propre glace, pour donner à son portier et à sa femme de ménage—une haute opinion de ses relations;—qu’il parle tout haut avec un ami qu’il rencontre au théâtre ou à la promenade,—et ne lui dise rien qui l’intéresse,—toute la conversation n’ayant d’autre but que d’être entendu des promeneurs et des spectateurs sur lesquels on veut faire de l’effet;—qu’il porte un lorgnon avec des yeux excellents;—qu’en parlant de ses parents, il les appelle ganaches, quand, le matin même, trouvant dans la chambre de sa mère un de ses vêtements tombé sur un tapis, il l’a baisé en le ramassant précieusement;
Toutes choses dont les gens les plus sensés, les meilleurs, les plus spirituels, trouveront quelques-unes dans leurs souvenirs.
Je ne parle pas de ceux qui recommencent ces sottises toute leur vie;—ce ne sont plus des gourmes: c’est la teigne.
![]() Il n’y a rien d’égal à la petitesse de l’homme, si ce n’est sa
vanité.—Il a jugé à propos de se créer un Dieu;—de lui imposer ses
passions,—de le mêler à ses querelles,—de lui donner sa sotte
figure,—de l’affubler de vêtements roses et bleus;—il existe des
discussions écrites où deux auteurs soutiennent deux opinions touchant
la chevelure de Dieu.—L’un, dont j’ai oublié le nom, prétend qu’elle
est rousse;—l’autre, l’historien Josèphe, soutient qu’elle est couleur
noisette.
Il n’y a rien d’égal à la petitesse de l’homme, si ce n’est sa
vanité.—Il a jugé à propos de se créer un Dieu;—de lui imposer ses
passions,—de le mêler à ses querelles,—de lui donner sa sotte
figure,—de l’affubler de vêtements roses et bleus;—il existe des
discussions écrites où deux auteurs soutiennent deux opinions touchant
la chevelure de Dieu.—L’un, dont j’ai oublié le nom, prétend qu’elle
est rousse;—l’autre, l’historien Josèphe, soutient qu’elle est couleur
noisette.
Il y a des hommes qui ont protégé Dieu—contre d’autres hommes,—et qui les ont brûlés pour les forcer de croire.
Mais ce qui me semble le plus singulier, c’est quand un homme croit avoir offensé Dieu.
L’homme qui ne peut anéantir ni une goutte d’eau ni un grain de poussière,—lui, toujours enfermé dans les mêmes passions, dans les mêmes joies, dans les mêmes douleurs.
O homme! mon pauvre ami, avec quelles armes penses-tu offenser Dieu,—et quelle est donc sa partie vulnérable? a-t-il, comme Achille, quelque bout de talon qu’il ait négligé de rendre éternel?
O homme! Dieu est tout ce qui est; Dieu est la mer, le ciel, et les étoiles;—Dieu est la terre et l’herbe qui la couvre;—Dieu est à la fois les forêts et le feu qui dévore les forêts;—Dieu est l’amour qui rend les tigres caressants, et qui force les papillons à se poursuivre dans les luzernes,—et l’amour des fleurs qui se fécondent en mêlant leurs parfums;—Dieu est les hommes qui pourrissent dans la terre et les violettes qui tirent leurs couleurs et leurs parfums de la putréfaction des hommes;—Dieu est l’air bleu, les nuages, le soleil,—les hautes montagnes—et les insectes qui vivent huit cents dans une goutte d’eau.
Et tu crois offenser Dieu! tu crois offenser Dieu! mais regarde celui qui, selon toi, a le plus offensé Dieu,—le soleil cesse-t-il de caresser son front?—les parfums des fleurs deviennent-ils fétides pour lui?—l’eau des fleuves recule-t-elle devant ses lèvres sèches?—les fruits deviennent-ils de la cendre dans sa bouche?—l’herbe jaunit-elle sous ses pieds? Non, pas que je sache.
Dieu t’a jeté dans la vie et t’a renfermé dans des limites infranchissables;—ta chaîne te permet de cueillir quelques fleurs à droite et à gauche et de te piquer les doigts à leurs épines, mais il ne t’en faut pas moins parcourir la même route que ceux qui t’ont précédé et ceux qui te suivront;—il te faut mettre tes pieds dans l’empreinte de leurs pieds.
Toi-même tu es en Dieu,—mais tu es moins que n’est un grain de sable dans la mer.
Et cependant te figures-tu ce que serait la révolte d’un grain de sable—dans les profondeurs de l’Océan?
![]() Les femmes n’aiment réellement que les hommes qui sont plus forts
qu’elles.
Les femmes n’aiment réellement que les hommes qui sont plus forts
qu’elles.
Car, si leur plaisir le plus vif est de plaire et de commander,—leur bonheur est d’aimer et d’obéir.
En général, les rêveries des femmes ne sortent guère des espaces réels;—il faut que toute idée puisse se traduire à leurs yeux par une forme visible.—Pour les conduire au ciel, Dieu doit faire la moitié du chemin;—leur religion est l’amour pour un Dieu fait homme.
Il ne faut croire l’indulgence des gens que lorsqu’elle s’exerce dans les choses qui leur sont personnelles.—Tel homme se prend de pitié pour un empoisonneur,—pour un assassin,—vous le croyez indulgent;—attendez pour le juger qu’on lui marche sur le pied dans une foule,—ou qu’on casse par maladresse—une de ses tasses du Japon.
![]() La lune montait au ciel derrière les peupliers,—un rossignol fit
entendre ces trois sons graves et pleins sur la même note,—prélude
ordinaire de son hymne à la nuit et à l’amour.
La lune montait au ciel derrière les peupliers,—un rossignol fit
entendre ces trois sons graves et pleins sur la même note,—prélude
ordinaire de son hymne à la nuit et à l’amour.
LE ROSSIGNOL. La lune monte au ciel en silence,—le travail,—l’ambition,—l’avidité, sont endormis,—ne les réveillons pas;—ils ont pris tout le jour, mais la nuit est à nous.
Beaux acacias dont les panaches verts s’étendent sur nos têtes, secouez vos grappes de fleurs blanches, arrosez la terre de vos douces odeurs.
Brunes violettes, roses éclatantes, le parfum que vous ne dépensiez le jour qu’avec avarice,—exhalez-le de vos corolles, comme les âmes exhalent leur parfum, qui est l’amour.
Les lucioles se cherchent dans l’herbe, ils semblent voir des amours d’étoiles tombées du ciel.
LA CHOUETTE. Il n’y a dans l’année que quelques nuits comme celle-ci. Il n’y a que quelques étés dans la jeunesse. Il n’y a qu’un amour dans le cœur.
Tout est envieux de l’amour, et le ciel lui-même, car il n’a pas de félicités égales à donner à ses élus.
Le malheur veille et cherche;—cachez votre bonheur, soyez heureux tout bas.
Tout bonheur se compose de deux sensations tristes: le souvenir de la privation dans le passé, et la crainte de perdre dans l’avenir.
LE ROSSIGNOL. Beaux acacias, dont les panaches verts s’étendent sur nos têtes, secouez vos grappes de fleurs blanches, arrosez la terre de vos douces odeurs.
Chèvrefeuilles, jasmins, cachez sous vos enlacements les amants qui vous ont demandé asile. Faites-leur des nids de fleurs et de parfums.
LA CHOUETTE. Le malheur veille et cherche, cachez votre bonheur, soyez heureux tout bas.
Et toi, l’amoureux, tes yeux auront perdu leur éclat.
Soyez heureux bien vite, car toi, la belle fille, bientôt le duvet de pêche de tes joues sera remplacé par des rides.
LE ROSSIGNOL. Qu’est-ce que le passé, qu’est-ce que l’avenir? les rudes épreuves de la vie ne payent pas trop cher une heure d’amour.
Mille ans de supplice pour un baiser,
LA CHOUETTE. Cette existence qui déborde de vos âmes, vous en deviendrez avares,—et vous la cacherez dans votre cœur comme si vous enfouissiez de l’or.
Vos mains sèches se toucheront, sans faire tressaillir votre cœur,—vous ne vous rappellerez cette nuit d’aujourd’hui, si vous vous la rappelez jamais, que comme une folie, une imprudence, et vous frémirez de l’idée que vous auriez pu vous enrhumer,—puis vous mourrez.
LE ROSSIGNOL. Oui, nous mourrons, mais la mort n’est qu’une transformation.
Nous ressortirons de la terre fécondée par nos corps—tubéreuses, roses, jasmins—et nous exhalerons nos parfums toujours dans de belles nuits comme celle-ci.
Et toi, chouette, n’es-tu pas aussi amoureuse, et n’échanges-tu pas de tristes caresses dans les ruines et les tombeaux?
Beaux acacias, dont les panaches verts s’étendent sur nos têtes, secouez vos grappes de fleurs blanches,—arrosez la terre de vos douces odeurs.
Mort du duc d’Orléans.—La Régence.—Le duc de Nemours et la duchesse d’Orléans.—M. Guizot.—Un curé de trop.—Humbles remontrances à monseigneur Blancart de Bailleul.—Un violon de Stra, dit Varius.—Fragilité des douleurs humaines.—Sur les domestiques.—Correspondance.—M. Dormeuil.—Une foule d’autres choses.—M. Simonet.—Une Société en commandite.—Quelques annonces.—M. Trognon. M. Barbet.—M. Martin.—M. Poulle.—M. Pierrot.—M. Lebœuf.—M. Michel (de Bourges).—M. Dupont (de l’Eure).—M. Boulay (de la Meurthe).—M. Martin (du Nord), etc.—Am Rauchen.—Wergiss-mein-nicht.
Le 13 juillet 1842, le duc d’Orléans allant à Neuilly—a été jeté hors de sa voiture par des chevaux emportés.—Il est tombé sur les pavés de la route—qui lui ont brisé la tête en plusieurs parties. Il est mort à quatre heures du soir,—sans avoir repris connaissance, dans une pauvre boutique d’épicier.—Le roi et la reine, qui étaient accourus, ont suivi le corps de leur fils porté par les soldats, sur un brancard.
Toute la France a compris cette immense douleur et l’a respectée.—Tout le monde a été frappé à la fois de compassion et de respect—en voyant que, de toutes les grandeurs qui séparent des autres la famille royale, il n’y en a qu’une seule qu’on lui ait laissée;—qu’elle ne dépasse aujourd’hui le commun des hommes que par la grandeur de ses misères et de son affliction.
Beaucoup de gens ne se souciaient guère des attaques au trône, à la couronne, à la pourpre,—et à cent autres métaphores, qui ont senti ce coup qui s’adressait au cœur—et qui en ont tressailli.—Un roi avait paru quelque chose d’autre qu’eux-mêmes, qui n’a ni les mêmes joies, ni les mêmes douleurs; mais alors, en pensant au roi, à la reine, à la duchesse d’Orléans, on a dit: «Pauvre père! pauvre mère! pauvre femme!» et on a compris, et on a pleuré avec eux.
On parlait surtout de la reine, qui avait à creuser dans son cœur une nouvelle tombe à côté de celle de sa fille Marie;—de la reine—qui, dans la partie politique qui se joue depuis tant d’années, a vu mettre en jeu si souvent déjà la vie de tous ceux qu’elle aime,—et qui croyait les avoir regagnés et rachetés, tant elle avait craint, pleuré et prié pour eux.—On a compté les épines qui forment les fleurons de sa couronne royale.
Puis, quand le duc d’Orléans a été mort—tout le monde a vu ce que presque personne n’avait songé à remarquer auparavant: c’est que c’était un des hommes les plus distingués de ce temps-ci; on a vu qu’il tenait, par des liens qu’on n’a sentis que lorsqu’ils se sont rompus, à tout ce qui a de la vie, de la force et de la jeunesse en France.
On a vu que son absence laissait un vide, et, en regardant autour de soi parmi les grands hommes que les journaux inventent et annoncent pêle-mêle avec les pommades pour teindre les cheveux, et l’eau pour détruire les punaises,—on a vu que parmi ces héros de réclame—il n’y avait personne pour remplacer le prince mort.
Puis ensuite on a songé aux conséquences politiques de ce triste événement.
On a vu que le roi Louis-Philippe a soixante-dix ans et que son successeur n’a pas encore quatre ans.
Et on a compté tout ce qu’entre ces deux règnes il peut tenir de troubles, de désordres et de malheurs.
Après ce moment de stupeur—les avidités, les rapacités ardentes des partis se sont ranimées.—Le duc d’Orléans n’était pas encore enterré—que chaque parti a voulu tirer avantage de sa mort.
![]() L’opposition s’en est servie d’argument contre M. Guizot:—M.
Guizot s’en est servi d’argument contre l’opposition.
L’opposition s’en est servie d’argument contre M. Guizot:—M.
Guizot s’en est servi d’argument contre l’opposition.
M. Guizot a fait venir le roi à la Chambre des députés;—il ne lui a pas laissé le temps d’être père quelques jours au milieu de sa famille; et l’a forcé de reprendre son rôle de roi; il était trop tôt;—cet homme,—éprouvé par des fortunes si diverses, auquel ses ennemis les plus acharnés n’ont pu refuser le courage et la fermeté,—n’a pu jouer, au bénéfice de M. Guizot, son rôle jusqu’au bout; il a pleuré devant les envoyés de la nation.
Les uns ont dit: «Le duc d’Orléans est mort, donc il faut renvoyer M. Guizot.»
Les autres: «Le duc d’Orléans est mort, donc il faut garder M. Guizot.»
Le raisonnement des uns était aussi insolemment absurde que celui des autres.
Puis vint la question de la régence.—Les journaux de l’opposition demandèrent une loi spéciale, personnelle et provisoire,—c’est-à-dire un petit nid à débats, à troubles et à émeutes.
![]() Les journaux du ministère commencèrent à demander, de leur côté, la
régence pour M. le duc de Nemours.
Les journaux du ministère commencèrent à demander, de leur côté, la
régence pour M. le duc de Nemours.
C’était justement tomber dans l’écueil où voulaient les amener leurs ennemis.
Ils se ravisèrent et demandèrent la régence pour le plus proche parent ascendant mâle du roi mineur,—c’est encore le duc Nemours;—mais c’est en même temps un principe et une loi fondamentale.—Il est déjà assez honteux pour quatre cent cinquante législateurs de n’avoir pas prévu le cas d’une minorité et d’une régence, sans que lesdits quatre cent cinquante législateurs hésitent à en faire une quand la nécessité le commande.
Les journaux de l’opposition avaient crié très-fort quand le duc d’Orléans avait épousé une luthérienne,—ce qui ne les avait pas empêchés dans le temps de soutenir l’élection de M. Fould par cette raison remarquable qu’il fallait bien avoir un juif à la Chambre,—ce qui amènerait un jour à dire: «Il faut bien qu’il y ait un ferblantier au Palais-Bourbon,» s’il n’y en avait déjà plusieurs.
Lesdits journaux demandèrent alors la régence pour la duchesse d’Orléans.
![]() Cette tendresse subite ne voulait pas dire autre chose que l’espoir
de voir des troubles plus faciles sous l’administration d’une femme.
Cette tendresse subite ne voulait pas dire autre chose que l’espoir
de voir des troubles plus faciles sous l’administration d’une femme.
![]() C’est un procès qui peut honnêtement se plaider,—car les raisons
pour chacun des deux prétendants peuvent se balancer.
C’est un procès qui peut honnêtement se plaider,—car les raisons
pour chacun des deux prétendants peuvent se balancer.
On peut dire pour le duc de Nemours—qu’il s’est bien battu en Afrique,—que c’est un caractère ferme et froid,—que la régence est une royauté provisoire, qu’une des lois fondamentales du royaume exclut les femmes du trône,—que d’ailleurs, à l’époque où nous vivons, il peut arriver qu’il y ait besoin, chez le régent, des qualités que la plus noble des femmes n’est pas forcée d’avoir.
On peut dire pour la duchesse d’Orléans—que, à tort ou à raison,—le duc de Nemours n’est pas populaire,—que cette impopularité vient en partie de cette malheureuse dotation qu’on a eu la sottise de demander pour lui,—ce qui est cause qu’il s’est répandu dans le public plusieurs centaines de phrases toutes faites contre lui.
![]() Et on ne sait pas avec quelle facilité le gros du public adopte
d’abord les phrases, puis ensuite les sentiments qu’elles expriment.
Et on ne sait pas avec quelle facilité le gros du public adopte
d’abord les phrases, puis ensuite les sentiments qu’elles expriment.
![]() On pourrait dire—qu’il ne serait peut-être pas d’une mauvaise
politique—que le régent fût dans une position à ne pouvoir être roi
dans aucun cas; de telle façon que le roi mineur fût pour lui un pupille
et non une barrière.
On pourrait dire—qu’il ne serait peut-être pas d’une mauvaise
politique—que le régent fût dans une position à ne pouvoir être roi
dans aucun cas; de telle façon que le roi mineur fût pour lui un pupille
et non une barrière.
![]() On pourrait encore faire une longue énumération des brillantes et
solides qualités que reconnaissent à la duchesse d’Orléans—ceux qui
l’ont approchée.
On pourrait encore faire une longue énumération des brillantes et
solides qualités que reconnaissent à la duchesse d’Orléans—ceux qui
l’ont approchée.
Pour moi, j’ai sur la régence l’opinion que j’ai sur la royauté: nommez n’importe qui,—pourvu que ce soit d’une manière stable;—faites une loi sérieuse,—une loi fondamentale que vous n’ayez pas besoin de rapiécer, de ressemeler à chaque événement imprévu,—et réellement je trouve qu’il ne devrait pas y avoir autant d’événements imprévus pour près de cinq cents que vous êtes qui devez les prévoir.
![]() «M. le général Rulhières,—commandant la dixième division
militaire, était dans son appartement lorsque, le pied lui ayant glissé
sur le parquet,—il est tombé et s’est grièvement blessé au genou.»
«M. le général Rulhières,—commandant la dixième division
militaire, était dans son appartement lorsque, le pied lui ayant glissé
sur le parquet,—il est tombé et s’est grièvement blessé au genou.»
Je saisis cette occasion pour remarquer une fois tout haut qu’il n’existe dans aucun pays sauvage,—dans aucun pays de la Nouvelle-Zélande,—un usage aussi barbare, aussi saugrenu,—aussi grotesque, aussi bête,—que celui qui consiste à rendre laborieusement—les appartements et les escaliers glissants.—En les cirant et en les frottant, les gens auxquels il m’est arrivé de dire cela—m’ont répondu: «C’est plus propre.»
Ces gens qui exposent eux et leurs connaissances à se rompre la colonne vertébrale sous prétexte de propreté—regarderaient à deux fois à se laver les mains l’hiver, s’ils ne pouvaient avoir d’eau chaude.
On rit beaucoup en France des sauvages qui se peignent les oreilles en rouge,—pourquoi? Parce qu’en France—on se peint les sourcils en noir,—et que ce n’est que sur les joues qu’on met du rouge.—On rit des Hottentots tatoués,—quoique la moitié de nos soldats et les deux tiers de nos serruriers portent sur les bras, peints en bleu ineffaçable,—des cœurs percés—et des Napoléons.
![]() Mais on rirait bien plus si un voyageur venait d’un pays récemment
découvert—et nous disait:
Mais on rirait bien plus si un voyageur venait d’un pays récemment
découvert—et nous disait:
«Les naturels—ont un usage dont il est difficile de s’expliquer la raison.
»Au moyen de certaines préparations, ils rendent le plancher de leurs habitations tellement glissant, qu’il est impossible d’y faire un pas sans tomber, à moins d’une grande habitude et d’une extrême attention.
»Leurs escaliers, qui, par leur forme et leur disposition, présentent déjà assez de chances pour des chutes graves,—sont également enduits de la même façon,—pour rendre les accidents inévitables, de fréquents qu’ils seraient seulement sans cette précaution.
»Nous avons tâché de découvrir le but secret de cette préparation,—mais ils gardent à ce sujet un secret impénétrable;—quelqu’un de nous avait pensé d’abord que cette habitude singulière avait le même but que celui qu’ont adopté les Chinois de ferrer et de déformer les pieds de leurs femmes au point de leur en rendre l’usage impossible;—mais nous n’avons pu admettre cette explication,—parce que les hommes, chez nos naturels, ne sont pas moins exposés que les femmes aux accidents qui résultent fréquemment de cette coutume.
»La seule explication un peu plausible que nous avons pu trouver est qu’ils attachent probablement quelque idée superstitieuse aux chutes imprévues,—de même qu’en France les bonnes femmes prennent pour un heureux présage le hasard qui leur fait mettre un de leurs bas à l’envers.—Peut-être les naturels dont nous parlons, considérant comme d’un favorable augure les chutes violentes, ont-ils cru ne devoir négliger aucun moyen de les rendre fréquentes et dangereuses.»
![]() La douleur que cause la mort d’une personne aimée est tellement
profonde,—que la Providence a mis l’oubli le plus près possible, par
pitié pour l’homme, qui ne pourrait supporter longtemps ce désespoir à
un égal degré.
La douleur que cause la mort d’une personne aimée est tellement
profonde,—que la Providence a mis l’oubli le plus près possible, par
pitié pour l’homme, qui ne pourrait supporter longtemps ce désespoir à
un égal degré.
![]() On fêtait l’autre jour un des saints du mois de juillet chez un de
nos peintres les plus connus;—un de nos amis se trouvait parmi les
convives bruyants—qui sablaient, comme on disait jadis, le vin de
Champagne dans la chambre à coucher du peintre, transformée pour la
circonstance en salle à manger.
On fêtait l’autre jour un des saints du mois de juillet chez un de
nos peintres les plus connus;—un de nos amis se trouvait parmi les
convives bruyants—qui sablaient, comme on disait jadis, le vin de
Champagne dans la chambre à coucher du peintre, transformée pour la
circonstance en salle à manger.
Mon ami était à la droite de la maîtresse de la maison,—seconde femme du peintre en question,—remarié depuis quelques mois seulement. Il avait en face de lui le maître de la maison, derrière lequel s’élevait un beau dressoir gothique en bois sculpté,—chargé de porcelaines de Chine—et surmonté de quelque chose comme une urne funéraire de très-mauvais goût.
Les verres et les paroles s’entre-choquaient, la gaieté était à son comble,—le maître de la maison surtout paraissait en proie à une hilarité indicible;—le contentement de soi et le bonheur de vivre se lisaient sur ses traits:—il souriait à ses amis—et paraissait fier de sa femme, dont la beauté, la grâce et l’enjouement—faisaient du reste le plus bel ornement de cette étourdie et étourdissante assemblée.
Tout à coup,—mon ami lève les yeux par hasard, probablement en suivant le vol d’une mouche—et, apercevant cette urne de mauvais goût, dont je vous ai parlé,—s’écrie: «Ah mon Dieu!—qu’est-ce que c’est donc que cet abominable machin que vous avez là-haut?»
Heureusement le bruit des verres et des conversations couvrit la question, qui ne fut entendue que de la maîtresse de la maison; elle se pencha à l’oreille de mon ami, et lui dit: «Taisez-vous donc! c’est le cœur de la première femme.»
![]() Monseigneur Blancart de Bailleul, évêque de Versailles, se trouve
en ce moment dans un grand embarras:—voici l’histoire:
Monseigneur Blancart de Bailleul, évêque de Versailles, se trouve
en ce moment dans un grand embarras:—voici l’histoire:
Il y a dans une commune de Seine-et-Oise—appelée Santeny,—un vieux curé—qui dessert la commune, je crois, depuis une trentaine d’années. C’est un bon vieux prêtre, qui a pris au sérieux le vœu de pauvreté,—qui ne possède rien au monde—et qui met tous ses plaisirs mondains—à faire pousser dans le jardin du presbytère des petits pois qu’à force de soins—il réussit presque toujours à voir en cosses avant tous ceux du pays,—et il met alors sa joie à en faire de petits présents.
Il y a quelque temps, un jeune prêtre allemand se présente au presbytère—et demande à parler à M. le curé,—M. le curé était à table—se lève, le force à prendre place, et l’oblige à dîner avec lui—en affirmant qu’il ne l’écoutera pas sans cela.
—Vous êtes ici pour quelques jours?
—Mais... oui, répond le jeune prêtre avec embarras.
—Marianne, dit le curé à sa vieille servante,—il faut faire un bon lit à monsieur, vous le bassinerez,—car il doit être fatigué.—A propos, Marianne, donnez-moi cette bouteille de vin—que l’on nous a envoyée.
Le jeune prêtre se repent amèrement d’avoir cédé aux instances du curé—et de s’être ainsi exposé à cet excellent accueil;—comment lui dire qu’il ne vient pas lui faire une de ces visites que se font les prêtres entre eux, mais qu’il se présente—de par monseigneur Blancart de Bailleul, pour le remplacer.
D’ailleurs—le vieux curé cause avec tant d’abandon,—tant de bonté!—Le jeune homme remet au lendemain à déclarer l’objet de sa visite. Ils font ensemble la prière du soir, le curé conduit son hôte à sa chambre,—l’hôte ne tarde pas à s’endormir.
Le lendemain matin, il découvre en se levant qu’il a occupé le seul lit de la maison—et que le curé a passé la nuit sur un vieux canapé;—il se sent touché,—il veut partir sans rien dire,—et de quelque autre maison envoyer au bonhomme la dure nouvelle qu’il n’ose lui dire de vive voix.
Mais le déjeuner est prêt,—le bon curé a cueilli lui-même le dernier plat de ses petits pois;—il aborde son hôte avec tant de bienveillance, il lui serre la main avec tant de bonhomie, que l’autre n’ose refuser;—il s’assied;—le bonhomme parle des trente ans qu’il a passés dans sa cure,—de l’amitié qu’il a pour ses paroissiens et de celle qu’il pense leur avoir inspirée:—il est heureux, mille fois plus heureux qu’il ne peut le dire;—il aime sa maison, il aime son jardin—qui est si heureusement exposé, où les petits pois viennent si bien et sont si précoces!—le puits a une eau excellente et n’est pas profond:—c’est si commode pour arroser!
Comment précipiter le bon curé de tout ce bonheur-là?—comment lui arracher tous ses trésors d’un seul mot? Le jeune prêtre remet au tantôt à faire sa révélation; mais à dîner le vieux lui dit: «Vous ne m’avez pas encore dit ce que vous venez faire ici.—Je ne vous le demande pas; mais, voyez-vous,—je parie que vous n’êtes pas riche;—eh bien! vous pouvez rester ici tant que vous voudrez;—regardez cette maison comme la vôtre;—l’ordinaire n’est pas somptueux, mais il y a assez pour nous deux et pour Marianne.»
Comment prendre brutalement à un homme qui offre tout de si bon cœur?
Toujours est-il que huit jours se passent ainsi,—au bout desquels—le jeune prêtre se trouve mille fois plus embarrassé que le premier.—Enfin il prend le parti qu’il avait imaginé le premier jour;—il quitte sans rien dire le presbytère, et envoie au curé une lettre dans laquelle—il lui raconte—et la cause de son arrivée—et son embarras et son chagrin.
Le vieux curé relit la lettre à plusieurs reprises;—n’en peut croire ses lunettes, se la fait relire par Marianne,—des pleurs s’échappent de ses yeux.—Il fait chercher le jeune homme et lui dit:
—Qu’ai-je fait à monseigneur?—on ne déloge plus à mon âge que pour prendre son dernier logement;—je suis vieux,—il ne pouvait donc pas attendre un peu?—Où veut-il que j’aille?
—Je n’en sais rien, répondit le jeune homme;—mais les ordres sont formels, et les voici.
—Mon Dieu! s’écria le curé,—comment y a-t-il tant de dureté dans le cœur des chefs de votre Église!—Que veut-on que je devienne,—vieux et pauvre comme je suis?—Mais obéir, ce serait un suicide, et je n’obéirai pas.—Monsieur, dit-il au jeune prêtre,—allez dire à monseigneur de Bailleul que je n’abandonnerai pas mon église;—que, si l’on veut m’en arracher, il faudra qu’on emploie la violence.
Voici un schisme à Santeny.
Le jeune curé in partibus—va loger chez le charpentier de l’endroit.
L’ancien curé reste au presbytère—et refuse les clefs du tabernacle et le calice,—dont il continue à faire usage.—Le jeune dit aussi la messe,—mais avec des ornements loués ou empruntés.
Que va faire monseigneur Blancart de Bailleul?—Va-t-il révoquer ses ordres,—ou les faire exécuter en employant la force?
Peut-être monseigneur, distrait par d’autres préoccupations, ne sait-il pas qu’il y a en France beaucoup de villages qui n’ont pas de curé,—ce qui ne rend nullement nécessaire d’en mettre deux à Santeny.
![]() On rapporta dernièrement à deux hommes bien placés dans
l’administration que M. Passy avait dit, en parlant d’eux: «L’un est un
fou, l’autre est un voleur.»
On rapporta dernièrement à deux hommes bien placés dans
l’administration que M. Passy avait dit, en parlant d’eux: «L’un est un
fou, l’autre est un voleur.»
—Cela ne se passera pas ainsi! s’écria M. ***.
—Et comment voulez-vous donc que ça se passe?—lui demanda son compagnon d’infortune.
—J’obtiendrai raison de M. Passy;—je me battrai avec lui.
—Il refusera de se battre avec son subordonné.
—Oui, eh bien! je vais donner ma démission.
—Vous êtes fou!
—Comment dites-vous?
—Allons, allez-vous me chercher querelle aussi à moi?
—Non, je veux savoir ce que vous m’avez dit.
—Je vous ai dit: «Vous êtes fou.»
—Alors, je suis content, et je ne demanderai rien à M. Passy.
—Comment? que voulez-vous dire?
—M. Passy a dit de nous deux—«l’un est un fou, l’autre est un voleur.»—Vous dites que c’est moi le fou,—donc c’est vous qui êtes... l’autre; c’est à vous à vous fâcher.
![]() M. ***,—commissaire-priseur,—a, l’autre jour, mis sur la
table, comme on dit à l’hôtel de la place de la Bourse, un violon de
Stradivarius,—avec toutes les attestations nécessaires à l’authenticité
de son origine.—M. *** l’a ainsi nommé: «Un violon de Stra, dit
VARIUS.»
M. ***,—commissaire-priseur,—a, l’autre jour, mis sur la
table, comme on dit à l’hôtel de la place de la Bourse, un violon de
Stradivarius,—avec toutes les attestations nécessaires à l’authenticité
de son origine.—M. *** l’a ainsi nommé: «Un violon de Stra, dit
VARIUS.»
![]() Comme on présentait à M. Guizot pour une place de consul qui se
trouvait vacante un homme qui réunissait les deux conditions principales
de l’ancienneté et de la capacité,—M. Guizot répondit: «C’est vrai,
mais que voulez-vous, il faut avant tout obéir aux exigences
parlementaires; dites à votre candidat de se faire appuyer par des
députés de l’opposition.
Comme on présentait à M. Guizot pour une place de consul qui se
trouvait vacante un homme qui réunissait les deux conditions principales
de l’ancienneté et de la capacité,—M. Guizot répondit: «C’est vrai,
mais que voulez-vous, il faut avant tout obéir aux exigences
parlementaires; dites à votre candidat de se faire appuyer par des
députés de l’opposition.
![]() On trouve à la quatrième page des journaux une annonce ainsi
conçue:
On trouve à la quatrième page des journaux une annonce ainsi
conçue:
MAISON SUSSE.
ENCRE ROYALE DE JOHNSON.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cette encre préserve les plumes métalliques de l’oxydation, quand elles sont de bonne qualité comme celles de Bookman.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLUMES ROYALES DE BOOKMAN.
Ces plumes sont inoxydables.
C’est-à-dire que les plumes royales de Bookman sont inoxydables dans une encre qui préserve de l’oxydation, comme l’encre royale de Johnson.
Et que, de son côté, l’encre royale de Johnson préserve de l’oxydation—les plumes qui sont inoxydables,—comme les plumes royales de Bookman.
![]() On trouve encore à la quatrième page des mêmes journaux une autre
annonce qui n’est pas indigne de l’attention:
On trouve encore à la quatrième page des mêmes journaux une autre
annonce qui n’est pas indigne de l’attention:
LOTION DE GOWLAUW.
«Le célèbre inventeur de cette lotion, le docteur Gowlauw, médecin du prince de GALLES en 1755,—rencontra dans l’exercice de ses fonctions élevées des circonstances particulières qui exigèrent qu’il dévouât longtemps ses talents à l’étude des maladies de la peau.»
Je l’ai dit,—l’annonce ne respecte rien;—la voilà qui jette sur la mémoire du prince qui fut depuis roi d’Angleterre—une dégoûtante insinuation.—Mais ce qu’on ne saurait trop admirer,—c’est le sérieux et l’industrie de celui qui imagine que le médecin du prince de Galles a dû, plus que tout autre, avoir à s’occuper des maladies de la peau.
![]() Voici un aperçu de M. Vivien—qui n’a pas semblé heureux.—Il était
question de l’élection de M. Pauwels,—élection qui a été
ajournée—parce qu’il y a eu deux bulletins signés qui ont été comptés
à M. Pauwels contrairement à l’intention de la loi, qui veut que les
votes soient secrets.
Voici un aperçu de M. Vivien—qui n’a pas semblé heureux.—Il était
question de l’élection de M. Pauwels,—élection qui a été
ajournée—parce qu’il y a eu deux bulletins signés qui ont été comptés
à M. Pauwels contrairement à l’intention de la loi, qui veut que les
votes soient secrets.
D’autre part, M. Pauwels est accusé d’avoir amené deux électeurs en voiture.
Là-dessus—M. Vivien s’écrie—contre M. Pauwels:
«Messieurs, le fait des deux bulletins signés est grave, mais ce n’est pas tout; et, à propos de ce fait, un rapprochement me frappe: il y a eu deux bulletins signés, et M. Pauwels avoue avoir été chercher deux électeurs.»
Il ne s’est trouvé personne—pas même M. Pauwels, pour dire à M. Vivien: «Mais, monsieur, tout le monde sait que la loi défend de voter avec des bulletins signés; donc M. Pauwels serait allé chercher exprès, en voiture, les deux électeurs qui devaient entacher son élection d’illégalité et en faire prononcer au moins l’ajournement.»
![]() Les quatre-vingt-six départements de la France—envoient à Paris
quatre cent cinquante-neuf députés—qui ouvrent la session—en faisant
un serment qui n’est pas formulé en français.
Les quatre-vingt-six départements de la France—envoient à Paris
quatre cent cinquante-neuf députés—qui ouvrent la session—en faisant
un serment qui n’est pas formulé en français.
«Je jure fidélité... etc... et de me conduire en bon et loyal député.»
Il faudrait dire: «Je jure d’être fidèle,»—ou répéter «je jure»—au second membre de la phrase.
![]() Tous les partis se sont accusés mutuellement d’avoir corrompu des
électeurs pour faire nommer leurs candidats,—cela me paraît un terrible
argument contre le suffrage universel et l’abaissement du cens
électoral.—En effet, s’il est si facile de corrompre des gens qui sont
riches, puisqu’un électeur doit payer deux cents francs de contributions
directes,—qu’adviendra-t-il quand vous admettrez au scrutin des hommes
pauvres et besogneux,—sinon ce que je vous ai annoncé déjà plusieurs
fois,—c’est-à-dire des électeurs à trois francs,—à deux francs
cinquante centimes, si on prend une certaine quantité, avec le treizième
en sus?
Tous les partis se sont accusés mutuellement d’avoir corrompu des
électeurs pour faire nommer leurs candidats,—cela me paraît un terrible
argument contre le suffrage universel et l’abaissement du cens
électoral.—En effet, s’il est si facile de corrompre des gens qui sont
riches, puisqu’un électeur doit payer deux cents francs de contributions
directes,—qu’adviendra-t-il quand vous admettrez au scrutin des hommes
pauvres et besogneux,—sinon ce que je vous ai annoncé déjà plusieurs
fois,—c’est-à-dire des électeurs à trois francs,—à deux francs
cinquante centimes, si on prend une certaine quantité, avec le treizième
en sus?
![]() Un député a été accusé d’avoir fait boire deux électeurs; la chose
était attestée par une protestation signée de plusieurs
électeurs;—c’est une jolie chose que le gouvernement représentatif, si
les représentants du pays pensent eux-mêmes qu’on peut obtenir les
suffrages de ses concitoyens au moyen de quelques verres de
vin.—Toujours est-il que le député accusé a apporté à la Chambre un
certificat de ses deux électeurs, qui affirment sur l’honneur qu’ils
étaient un peu gais, mais nullement ivres au point de n’avoir pas su
ce qu’ils faisaient.
Un député a été accusé d’avoir fait boire deux électeurs; la chose
était attestée par une protestation signée de plusieurs
électeurs;—c’est une jolie chose que le gouvernement représentatif, si
les représentants du pays pensent eux-mêmes qu’on peut obtenir les
suffrages de ses concitoyens au moyen de quelques verres de
vin.—Toujours est-il que le député accusé a apporté à la Chambre un
certificat de ses deux électeurs, qui affirment sur l’honneur qu’ils
étaient un peu gais, mais nullement ivres au point de n’avoir pas su
ce qu’ils faisaient.
![]() M. Pauwels a été convaincu d’avoir emmené deux électeurs dans sa
voiture;
M. Pauwels a été convaincu d’avoir emmené deux électeurs dans sa
voiture;
Conséquemment de les avoir corrompus.
Ah ça! messieurs les députés, sérieusement, c’est donc en France une chose déjà bien avancée et bien faisandée que la masse électorale,—puisqu’elle n’attend qu’un aussi futile prétexte pour se corrompre?
Parlez-moi de l’Angleterre,—où une élection coûte pour le moins un demi-million;—à la bonne heure,—mais en France, c’est honteux:—un litre de vin ou une promenade en voiture.
![]() Qui osera maintenant saluer un électeur,—ou sa femme, ou sa nièce,
si l’électeur est chose si fragile qu’on ne puisse le rencontrer sans
risquer de le corrompre!
Qui osera maintenant saluer un électeur,—ou sa femme, ou sa nièce,
si l’électeur est chose si fragile qu’on ne puisse le rencontrer sans
risquer de le corrompre!
Les divers partis qui composent la Chambre se sont reproché, avec preuves à l’appui,—une foule de manœuvres peu honorables.—Le ministère n’a pu nier que maladroitement certaines munificences qu’un hasard malheureux a placées quelques jours avant les élections.—Le parti de la République et le tiers-parti—se sont, de leur côté, fort mal défendus de leur alliance avec les légitimistes.—M. Barrot, entre autres, a remarquablement pataugé à ce sujet.
![]() Mais,—au nom du ciel,—que prouve tout ceci?—que les hommes sont
avides et rapaces.—Ne le savions-nous pas déjà?—Commencez donc par
être une fois tous d’accord pour décréter—le désintéressement, le
patriotisme, l’abnégation; jusque-là ce sera la plus laide et la plus
sotte chose du monde que votre gouvernement représentatif.
Mais,—au nom du ciel,—que prouve tout ceci?—que les hommes sont
avides et rapaces.—Ne le savions-nous pas déjà?—Commencez donc par
être une fois tous d’accord pour décréter—le désintéressement, le
patriotisme, l’abnégation; jusque-là ce sera la plus laide et la plus
sotte chose du monde que votre gouvernement représentatif.
![]() Le Siècle a eu dernièrement à soutenir un procès—parce qu’un de
ses rédacteurs s’était permis quelques critiques à l’égard des produits
d’une madame H...,—marchande de modes,—je crois,—ou de quelque chose
d’analogue.
Le Siècle a eu dernièrement à soutenir un procès—parce qu’un de
ses rédacteurs s’était permis quelques critiques à l’égard des produits
d’une madame H...,—marchande de modes,—je crois,—ou de quelque chose
d’analogue.
Plusieurs procès de ce genre avaient déjà été jugés en faveur des marchands contre les journalistes.
Cette fois, cependant, le tribunal a pensé sagement—qu’il ne fallait pas punir les rares effets des remords qui peuvent s’emparer des journalistes à l’occasion de leur complicité quotidienne avec les marchands de n’importe quoi. Le jugement qui a acquitté le Siècle—est d’autant plus remarquable, que cent exemples dans un an viennent démontrer que les tribunaux, qui ne reconnaissent pas en fait la propriété littéraire,—n’appliquent les lois que contre les écrivains—et point pour eux.
En effet, une marchande de modes a cru pouvoir intenter un procès à un journal, parce que ledit journal avait trouvé qu’elle faisait pencher ses plumes un peu trop à gauche,—ou que ses capotes n’avaient pas tout à fait aussi bon air que celles de mademoiselle une telle.
Et en cela elle était encouragée par des précédents nombreux de procès ainsi intentés et gagnés.
Mais qu’un écrivain pâlisse sur un ouvrage, qu’il y consacre de longues veilles, qu’il y mette les études et les souffrances de toute sa vie;
Le moindre grimaud,—le petit jeune homme auquel on confie des articles d’essai pour son admission à un journal, dit impunément que le livre est mauvais, que l’auteur n’a pas le sens commun, etc., etc.
![]() Un tribunal rirait beaucoup,—et croirait qu’on lui apporte une
cause grasse,—si un auteur s’avisait de lui déférer une plainte
relativement à un fait de ce genre.
Un tribunal rirait beaucoup,—et croirait qu’on lui apporte une
cause grasse,—si un auteur s’avisait de lui déférer une plainte
relativement à un fait de ce genre.
Et cependant—c’est assez quelquefois pour influencer un grand nombre de lecteurs,—pour empêcher l’auteur de trouver un libraire, c’est assez pour le ruiner.
Mais la justice ne reconnaît que la propriété des choses matérielles.—M. Hugo et M. de Lamartine, s’ils veulent être pris par elle au sérieux, devront se faire marchands d’allumettes chimiques ou fabricants de cirage podophile.
En énumérant le mois passé tout ce que j’avais obtenu de protection de la part des rois, d’États, de vaisseaux, pour la somme de soixante-quinze centimes, je disais que je donnerais volontiers soixante-quinze autres centimes pour trouver comme écrivain la protection dont je jouis comme pêcheur.—Voilà un exemple de ce que j’avançais:
Il y a environ deux mois, j’appris, par deux feuilletons de Janin et de Théophile Gautier, que trois ou quatre messieurs avaient bien voulu prendre dans un petit roman de moi, qui s’appelle Hortense,—le sujet d’une pièce jouée sur le théâtre du Vaudeville.
Quelques jours après je vis, dans un autre journal, l’analyse d’une autre pièce jouée sur le théâtre du Palais-Royal,—et intitulée: Dans une armoire. Cette pièce est entièrement prise dans un petit conte qui a été imprimé sous le titre de: Histoire de tant de charmes ou de la Vertu même.
Je ne fais pas partie de la Société des gens de lettres,—d’aucune autre société.—Je n’aime pas qu’un musicien ou poëte puisse aller prendre au collet un homme qui fredonne dans la rue une romance de lui,—en lui disant: «C’est trois francs.»
Je me contentai donc d’écrire à M. Dormeuil,—directeur du théâtre du Palais-Royal,—et le soir accessoirement père noble et jouant les rôles à canne, les utilités, etc.
Je disais à ce M. Dormeuil—que je ne venais pas inquiéter ses auteurs—dans leurs droits et recettes, mais que, sachant peu leur nom,—et pas du tout leur adresse, je le priais de me rendre, d’accord avec eux, une justice qui ne leur coûterait rien.
Le même sujet, avec les mêmes détails, paraissant à la fois sur le théâtre du Palais-Royal—et dans un livre de moi,—je ne voulais pas que le public,—qui ne s’amuserait pas à consulter les dates,—m’accusât d’avoir pris l’ouvrage de MM. Laurencin et... je ne sais qui...
Il me semblait donc qu’il serait honnête à ces messieurs de mettre sur l’affiche que leur pièce était tirée d’un ouvrage de moi.
M. Dormeuil ne crut pas devoir me répondre.
Sur ces entrefaites j’arrivai à Paris, et j’allai, avec un de mes amis, demander une réponse à M. Dormeuil; j’eus beaucoup de peine à rencontrer cet acteur,—qui s’excusa de ne pas m’avoir répondu, et m’affirma qu’il avait cru en être dispensé parce qu’il avait fait droit à ma réclamation immédiatement en mettant sur l’affiche la note que j’avais demandée.
«Du reste, me dit-il, la pièce n’a pas eu grand succès, elle est mal écrite,—comme tout ce que fait M. Laurencin.»
Je me retirai—et ne pensai plus à la chose.
Mais voilà que j’apprends que M. Dormeuil—n’a point mis sur ses affiches ce qu’il m’a dit y avoir mis.
Pour moi je suis assez embarrassé;—que puis-je faire à M. Dormeuil pour le punir de jouer le jour des Scapins, les Lafleur, les rôles les plus honteux du répertoire comique? Rien, sinon de le siffler en plein jour et en pleine rue,—quand je le rencontrerai, comme si j’avais encore dix-huit ans.
Ce n’est pas par une semblable conduite que messieurs les comédiens plaideront avec succès contre le préjugé qui les sépare de la société, et dont ils se plaignent si amèrement.
Je me défie beaucoup des grands hommes, des héros de désintéressement et de dévouement à la patrie, dont les organes de certains partis veulent aujourd’hui nous imposer l’admiration et le joug,—quand je relis dans les journaux et les brochures; publiés il y a treize ou quatorze ans,—précisément les mêmes éloges pour des gens à l’égard desquels ils ne trouvent pas aujourd’hui assez d’injures.
![]() Voici quelques lignes prises au hasard dans un gros livre publié
sous les auspices de ce qu’on appelait alors le Comité
directeur,—sous le titre de BIOGRAPHIE DES DÉPUTÉS.
Voici quelques lignes prises au hasard dans un gros livre publié
sous les auspices de ce qu’on appelait alors le Comité
directeur,—sous le titre de BIOGRAPHIE DES DÉPUTÉS.
Session de 1828.
Imprimerie de Anthelme Boucher,—rue des Bons-Enfants, 34.
«L’opposition d’aujourd’hui (1828) peut être regardée comme le type d’une véritable représentation nationale; elle renferme l’élite de la France.»
N. B. C’est cette opposition qui est aujourd’hui aux affaires.—Le langage des journaux et des brochures a un peu changé à leur égard.
![]() M. de Chantelauze est un homme de courage et de patriotisme qui ne
cédera jamais aux suggestions de l’autorité.»
M. de Chantelauze est un homme de courage et de patriotisme qui ne
cédera jamais aux suggestions de l’autorité.»
![]() Un des hommes sur lesquels, depuis dix ans, il a tombé l’averse la
plus drue d’injures et de quolibets, est M. Etienne.—Le journal le plus
bafoué est sans contredit le Constitutionnel.—Lisez:
Un des hommes sur lesquels, depuis dix ans, il a tombé l’averse la
plus drue d’injures et de quolibets, est M. Etienne.—Le journal le plus
bafoué est sans contredit le Constitutionnel.—Lisez:
«ÉTIENNE (Meuse, candidat libéral). C’est un député dont le nom seul vaut la biographie la plus étendue. Homme de lettres distingué, rédacteur du Constitutionnel et de la Minerve, ses titres à la députation sont bien connus de tous les amis des libertés publiques. Comme littérateur, M. Étienne, ancien membre de l’Institut, éliminé par M. de Vaublanc, a fait ses preuves de telle manière, qu’il serait puéril de les rappeler: comme publiciste, il a assuré à la Minerve le succès de vogue qu’elle a obtenu, par les délicieuses lettres sur Paris dont il a enrichi cet important ouvrage. Il a également assuré le succès du Constitutionnel, répandu aujourd’hui dans les quatre parties du monde. Comme député, il a soutenu les intérêts de ses concitoyens avec autant d’énergie que de talent. On se rappelle surtout sa belle et touchante improvisation en faveur de son honorable collègue et ami Manuel, expulsé, par l’arbitraire et la tyrannie, d’un poste où il avait été porté par la volonté libre du peuple français. M. Étienne n’a pas fait partie de la Chambre septennale. Il viendra jeter une nouvelle lumière sur la nouvelle Assemblée, chère à tant de titres aux véritables libéraux.»
![]() Et M. Jacques Lefebvre,—qu’on appelle aujourd’hui
loup-cervier,—Fesse-Mathieu,—gorgé des sueurs du peuple, etc., voici
son article:
Et M. Jacques Lefebvre,—qu’on appelle aujourd’hui
loup-cervier,—Fesse-Mathieu,—gorgé des sueurs du peuple, etc., voici
son article:
«M. Jacques Lefebvre (ferme libéral):
»Ce banquier est connu depuis longtemps pour un des membres les plus éclairés du commerce français.
»Les opinions politiques de M. J. Lefebvre ne sont pas douteuses: indépendant par sa position comme par son caractère, il sera l’un des plus fermes défenseurs de la monarchie constitutionnelle.
»Mandataire exact et scrupuleux dans les transactions privées, M. J. Lefebvre s’acquittera avec la même fidélité de la grande mission qui lui est confiée. Il sera un de ces hommes nouveaux, libres de tous fâcheux antécédents et destinés à faire revivre parmi nous la probité politique, vertu si nécessaire pour mettre fin aux agitations de notre patrie.»
Et M. Sébastiani,—comment le traitent aujourd’hui ceux qui disaient alors de lui:
«Nous devons nous borner à remercier les électeurs de l’Aisne. La France leur doit la nomination d’un des plus illustres et des plus généreux défenseurs de ses droits, etc.»
D’où dérive naturellement ce petit raisonnement:—ou messieurs les publicistes se sont étrangement trompés à cette époque,—et nous ne sommes pas obligés de nous en rapporter aujourd’hui à leur clairvoyance;
Ou ils étaient simplement les compères de leurs grands hommes d’alors,—et leur grande colère vient de ce que les compères, au jour de la curée, n’ont pas voulu partager la recette.
Ce qui fait qu’ils recommencent le même jeu,—avec les mêmes paroles,—absolument comme aux parades des escamoteurs;—dans l’un et l’autre cas, qu’ils soient dupes ou complices,—on a aujourd’hui le droit d’avoir quelque défiance et de s’en servir.
![]() Qu’est devenu l’ancien serviteur dont le type se retrouve si
fréquemment dans les romans et dans les comédies?—ce domestique
vertueux, sensible et désintéressé, qui pleure des chagrins de ses
maîtres, qui pleure de leur joie,—qui pleure en embrassant l’enfant de
la maison,—qui pleure en conduisant le grand-père au cimetière,—qui
pleure en suivant la petite-fille à l’autel?
Qu’est devenu l’ancien serviteur dont le type se retrouve si
fréquemment dans les romans et dans les comédies?—ce domestique
vertueux, sensible et désintéressé, qui pleure des chagrins de ses
maîtres, qui pleure de leur joie,—qui pleure en embrassant l’enfant de
la maison,—qui pleure en conduisant le grand-père au cimetière,—qui
pleure en suivant la petite-fille à l’autel?
Où est-il, ce domestique,—presque toujours un vieillard à cheveux blancs, qui, lorsque la fortune de ses maîtres vient à s’écrouler, pleure encore, pour qu’on lui permette de servir sans gages,—et vient, avec des larmes de joie, offrir le résultat de ses petites économies?
Sans parler des assassinats assez fréquents de maîtres par leurs domestiques dont sont remplies les colonnes de la Gazette des Tribunaux,—les domestiques n’introduisent-ils pas avec eux dans les maisons toutes sortes de dangers—et par leurs petits pillages habituels et par leurs trahisons—et par leurs complaisances intéressées, etc.?
Pourquoi la police n’impose-t-elle pas aux domestiques des livrets, comme elle en impose aux ouvriers?
Il est peut-être utile que les ouvriers présentent cette garantie, mais elle est indispensable pour les domestiques.
On introduit et on enferme avec soi dans sa maison,—dans sa famille, au milieu de sa femme et de ses enfants,—dans son intérieur, dans ses secrets,—des gens qui ne sont sous aucune surveillance spéciale,—qui ne vous donnent comme garantie que de vagues certificats arrachés le plus souvent par l’importunité à l’égoïsme et à l’insouciance,—certificats tellement insignifiants, que la plupart des maîtres ne les demandent plus et s’en rapportent au hasard.
J’ai vu une lettre d’un homme qui écrivait à un de ses amis:
«Envoyez-moi un domestique qui s’appelle Pierre.»
Un autre qui a une riche livrée disait: «Trouvez-moi un laquais qui ait: hauteur, cinq pieds quatre pouces;—épaisseur, trois pouces six lignes,—afin qu’il puisse entrer dans les habits que j’avais fait faire pour son prédécesseur.»
![]() Beaucoup d’esprits poétiques et un peu superficiels se sont laissé
séduire par tout ce que présente de gracieux le gouvernement d’une
femme; ils ont rêvé une cour brillante et chevaleresque,—un nouveau
règne pour les arts, pour les lettres, pour les plaisirs.—Non, non, le
règne des marchands, des avocats et des bourgeois n’est pas fini, il
faut qu’il ait son cours.—C’est une dynastie qui doit avoir sa
durée.—Vous l’avez voulue, mes braves gens, vous l’aurez, vous la
subirez, vous la garderez.—Vous savez l’histoire des grenouilles de la
Fontaine;—vous avez été plus heureux qu’elles,—vous avez obtenu du
premier coup des soliveaux qui vous mangent.
Beaucoup d’esprits poétiques et un peu superficiels se sont laissé
séduire par tout ce que présente de gracieux le gouvernement d’une
femme; ils ont rêvé une cour brillante et chevaleresque,—un nouveau
règne pour les arts, pour les lettres, pour les plaisirs.—Non, non, le
règne des marchands, des avocats et des bourgeois n’est pas fini, il
faut qu’il ait son cours.—C’est une dynastie qui doit avoir sa
durée.—Vous l’avez voulue, mes braves gens, vous l’aurez, vous la
subirez, vous la garderez.—Vous savez l’histoire des grenouilles de la
Fontaine;—vous avez été plus heureux qu’elles,—vous avez obtenu du
premier coup des soliveaux qui vous mangent.
![]() Faites une cour bien galante avec des noms tels que
Lebœuf,—Poulle,—Martin,—Barbet,—Pierrot!
Faites une cour bien galante avec des noms tels que
Lebœuf,—Poulle,—Martin,—Barbet,—Pierrot!
Et M. Trognon, le trouvez-vous joli? Je sais que, parodiant un mot de Sylla, on a dit de lui: Je vois dans Trognon plusieurs pépins.
Mais voulait-on parler de Pépin le Bref ou de Pépin l’auteur de un,—deux,—trois,—quatre, etc., ans de règne, qui est au contraire fort long.
Il est vrai qu’en prévision de tout ceci—M. Barbet, maire de Rouen,—est en instance près du garde des sceaux pour se faire appeler de Valmont.
Et M. Pierrot—prend tout doucement le nom de Selligny.
![]() Les journaux de l’opposition se sont beaucoup moqués de ces
changements de noms, et ils ont eu raison; mais, pendant qu’ils y
étaient, ils auraient pu faire justice—de quelques dynasties
bourgeoises,—qui usurpent certaines villes,—certaines
rivières,—certains départements:—MM. Martin, de Strasbourg,—idem, du
Nord,—Michel, de Bourges,—Dupont, de l’Eure,—David,
d’Angers,—Boulay, de la Meurthe, etc.
Les journaux de l’opposition se sont beaucoup moqués de ces
changements de noms, et ils ont eu raison; mais, pendant qu’ils y
étaient, ils auraient pu faire justice—de quelques dynasties
bourgeoises,—qui usurpent certaines villes,—certaines
rivières,—certains départements:—MM. Martin, de Strasbourg,—idem, du
Nord,—Michel, de Bourges,—Dupont, de l’Eure,—David,
d’Angers,—Boulay, de la Meurthe, etc.
Pendant quelque temps on a renfermé la ville ou le département conquis dans une parenthèse; quelques-uns ont déjà supprimé la parenthèse, les autres suivent sans bruit leur exemple.
Ainsi, quand on avait l’air de crier si fort, si longtemps, contre les préjugés, contre les castes, contre les noms, contre tout, ce n’était pas contre les choses qu’on était réellement si fort en colère, c’était contre ceux qui les possédaient.
Aussi, après avoir renversé les gens,—les a-t-on dépouillés le plus promptement possible et les dépouille-t-on tous les jours.
Les vainqueurs s’arrachent entre eux les lambeaux conquis—et se font de bizarres ornements des morceaux qu’ils peuvent s’approprier.
![]() La curée qui a lieu depuis douze ans de places, d’honneurs, de
titres, ressemble tout à fait à un tableau que fait le capitaine Cook
d’une horde sauvage qui a surpris et massacré l’équipage d’un
navire.—L’un passe ses jambes dans les manches d’un habit,—un autre,
tout nu, se revêt d’une perruque et d’un chapeau;—un autre met des
lunettes—ceux-ci s’attachent au nez les boutons de cuivre des habits
des matelots.
La curée qui a lieu depuis douze ans de places, d’honneurs, de
titres, ressemble tout à fait à un tableau que fait le capitaine Cook
d’une horde sauvage qui a surpris et massacré l’équipage d’un
navire.—L’un passe ses jambes dans les manches d’un habit,—un autre,
tout nu, se revêt d’une perruque et d’un chapeau;—un autre met des
lunettes—ceux-ci s’attachent au nez les boutons de cuivre des habits
des matelots.
Puis ils se croient bien mis,—et se promènent avec fierté.
![]() Une régente, bon Dieu! c’était bon quand les Français étaient polis
et bien élevés.—Est-ce qu’il n’y a pas deux députés, dont j’ai consigné
le nom dans quelque volume des Guêpes, qui ont refusé de saluer la
reine!—Une régente!—livrez donc une pauvre femme aux insultes de
certains journaux et à la protection de certains autres!—Une
régente!—Dieu vous en garde, pauvre princesse, déjà assez éprouvée!
Une régente, bon Dieu! c’était bon quand les Français étaient polis
et bien élevés.—Est-ce qu’il n’y a pas deux députés, dont j’ai consigné
le nom dans quelque volume des Guêpes, qui ont refusé de saluer la
reine!—Une régente!—livrez donc une pauvre femme aux insultes de
certains journaux et à la protection de certains autres!—Une
régente!—Dieu vous en garde, pauvre princesse, déjà assez éprouvée!
![]() Une régence et une régente!—on vous en donnera,—roués
d’arrière-boutiques,—talons rouges de comptoir,—raffinés d’estaminet!
Une régence et une régente!—on vous en donnera,—roués
d’arrière-boutiques,—talons rouges de comptoir,—raffinés d’estaminet!
AM RAUCHEN. Celui qui n’est rien—est l’égal de tout le monde.
![]() Tous les hommes aiment le repos.
Tous les hommes aiment le repos.
—Vous me permettrez d’en excepter quelques-uns.
—Lesquels?
—Ceux qui le possèdent.
—Pour que je ne trouve pas la discussion une chose ridicule, il faudrait qu’on me montrât un seul homme—depuis l’origine du monde, que la discussion eût fait changer d’opinion.
![]() Souvent, par une matinée d’automne, alors qu’il fait si bon de
flâner par les plaines, un fusil sur l’épaule, vous avez aperçu à
l’horizon un lac immense; vous avez continué votre route, et, arrivé au
point où vous aviez vu le lac, vous marchez sur l’herbe et vous ne voyez
que des vapeurs qui s’exhalaient de la terre;—plus loin, vous vous êtes
retourné et vous avez revu le lac avec sa surface unie.
Souvent, par une matinée d’automne, alors qu’il fait si bon de
flâner par les plaines, un fusil sur l’épaule, vous avez aperçu à
l’horizon un lac immense; vous avez continué votre route, et, arrivé au
point où vous aviez vu le lac, vous marchez sur l’herbe et vous ne voyez
que des vapeurs qui s’exhalaient de la terre;—plus loin, vous vous êtes
retourné et vous avez revu le lac avec sa surface unie.
Telle est la vie; on mourrait de désespoir quand on découvre que ce qu’on avait pris pour but de ses pensées, de ses désirs, de ses rêves, n’existe pas, ou n’est qu’un brouillard auquel la distance donne des formes gigantesques.—Mais, comme il faut marcher, entraîné que l’on est par la vie, il vient un moment où, en se retournant, on voit les mêmes prestiges, et jusqu’au bout de la route on jette de temps à autre un regard d’adieu à ce qu’on croit avoir possédé; la vie est toute dans ce qui n’est pas encore et dans ce qui n’est plus:—désirs et regrets.
Aussi, avec quelle ténacité nous nous rattachons aux moindres souvenirs! Quelle influence gardent sur nous une mélodie quelquefois sans couleur pour tous,—certains aspects du ciel,—la fleur que d’autres foulent aux pieds avec indifférence!
C’est pour cela—que je me suis laissé plus d’une fois reprocher de parler trop souvent d’une petite fleur bleue—que les Suisses appellent herbe aux perles—et les botanistes mosotipioïdes.
Voici pourquoi les Allemands les ont appelées vergissmeinnicht, c’est-à-dire ne m’oubliez pas.
Dussions-nous nuire à l’intérêt de notre histoire, nous dirons que c’est une des traditions les plus intéressantes que nous ayons jamais entendues.
Il y a un tombeau à Mayence;—comme le nom que l’on y avait gravé a été effacé, le tombeau est à la disposition du premier venu d’entre les morts; mais, attendu qu’il est simple, et qu’aucune famille ne pourrait s’enorgueillir de l’attribuer à un de ses membres morts, l’opinion générale le laisse à un poëte, dont on n’a pas même conservé le nom de famille.
![]() Il s’appelait Henreich; et comme ses vers, dont nous ne croyons pas
qu’il soit rien resté, étaient tous à la louange des femmes, et surtout
à celle de Marie, on l’appelait Henreich Frauenlob, c’est-à-dire le
poëte des femmes.
Il s’appelait Henreich; et comme ses vers, dont nous ne croyons pas
qu’il soit rien resté, étaient tous à la louange des femmes, et surtout
à celle de Marie, on l’appelait Henreich Frauenlob, c’est-à-dire le
poëte des femmes.
Quand il était parti pauvre pour courir l’Allemagne et chercher fortune au moyen de ses romances et de son talent, Henreich avait laissé à Mayence une fille qui attendait son retour, s’éveillait pâle, dans les nuits d’orage, et priait pour lui.
Après trois ans, il revint riche et renommé. Longtemps avant son retour, Marie avait entendu son nom mêlé à la louange et à l’admiration; et, par une noble confiance, elle savait que ni la louange ni l’admiration n’avaient donné à son amant autant de bonheur et d’orgueil que lui en donnerait le premier regard de la jeune fille qui l’attendait depuis si longtemps.
Quand Henreich vit de loin la fumée des maisons de Mayence, il s’arrêta oppressé, s’assit sur un tertre d’herbe verte, et fit entendre un chant simple et mélancolique—comme le bonheur.
Le lendemain, vers le coucher du soleil, les cloches tintèrent pour annoncer le mariage de Henreich et de Marie à la première aurore.
A ce moment, tous deux se promenaient seuls sur l’allée qui s’étend le long du Rhin.
Ils s’assirent l’un près de l’autre sur un tapis de mousse, et passèrent de longs et fugitifs instants à se regarder, à se serrer les mains sans rien dire,—tant ce qui remplissait leurs âmes était intraduisible par des paroles.
La teinte de pourpre que le soleil avait laissée à l’horizon était devenue d’un jaune pâle, et l’ombre s’avançait sur le ciel, du levant au couchant.
Tous deux comprirent qu’il fallait se quitter: Marie voulut fixer le souvenir de cette belle soirée, et montra de la main à Henreich des fleurs bleues sur le bord du fleuve.
Henreich la comprit et cueillit les fleurs, mais son pied glissa, il disparut sous l’eau; deux fois l’eau s’agita, et il reparut, se débattant, écumant, les yeux hors de la tête,—mais deux fois elle ressaisit sa proie.
Il voulut crier; mais l’eau le suffoquait. A la seconde fois qu’il reparut, il tourna un dernier regard vers la rive où était Marie, et, sortant un bras, il lui jeta les fleurs bleues qu’une contraction nerveuse avait retenues dans sa main; main ce mouvement le fit enfoncer: il disparut, l’eau reprit son cours, et le fleuve resta uni comme une glace. Ainsi mourut Henreich Frauenlob.
Pour Marie, elle mourut fille, dans une communauté religieuse.
On a traduit l’éloquent adieu de Henreich, et on a appelé la fleur bleue: vergissmeinnicht, c’est-à-dire ne m’oubliez pas.
La justice.—Ce qu’elle coûte.—Et pour combien nous en avons.—De quelques gargotiers faussement désignés sous d’autres noms.—Un directeur des postes.—Un gendarme et un voyageur.—Sur les chiens enragés.—La Régence.—Le duc de Nemours.—La Chambre des pairs.—M. Thiers.—M. de Lamartine.—Crime d’un carré de papier.—La Tour de François 1er et le Journal du Commerce.—Une montagne.
![]() SEPTEMBRE.—Il m’est arrivé quelquefois de soutenir que nous
marchions en rond—comme les chevaux de manége—et de nier le progrès.
Je suis obligé de me rétracter—quand je vois, d’après le rapport de M.
le garde des sceaux, que nous n’avions eu que pour trois millions quatre
cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois francs de justice
en 1831.
SEPTEMBRE.—Il m’est arrivé quelquefois de soutenir que nous
marchions en rond—comme les chevaux de manége—et de nier le progrès.
Je suis obligé de me rétracter—quand je vois, d’après le rapport de M.
le garde des sceaux, que nous n’avions eu que pour trois millions quatre
cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois francs de justice
en 1831.
Tandis qu’aujourd’hui on nous en donne pour quatre millions cinq cent soixante et onze mille trois cent vingt-cinq francs.
![]() Que vouliez-vous qu’on nous donnât de justice pour trois millions,
quand pour les quatre millions que nous en avons aujourd’hui—il
resterait encore bien des petites choses à dire?
Que vouliez-vous qu’on nous donnât de justice pour trois millions,
quand pour les quatre millions que nous en avons aujourd’hui—il
resterait encore bien des petites choses à dire?
![]() Disons quelques-unes de ces petites choses.
Disons quelques-unes de ces petites choses.
![]() D’abord parlons des prévenus,—des accusés.
D’abord parlons des prévenus,—des accusés.
Un prévenu est peut-être innocent:—si même vous comptez combien il y a de condamnés sur un certain nombre de prévenus, vous serez presque forcé de dire, qu’un prévenu est probablement innocent;—en effet, parmi les accusés il y en a beaucoup plus d’acquittés que de condamnés.
Un prévenu est donc peut-être un homme innocent,—auquel, par erreur, vous faites subir une situation plus que fâcheuse.—Vous l’enlevez à sa famille, à ses affaires—pendant plusieurs mois; pendant plusieurs mois vous faites peser sur lui un soupçon de déshonneur;—pendant plusieurs mois vous le condamnez à toutes les angoisses de l’imagination.
Un magistrat disait que, s’il était par hasard accusé d’avoir volé les tours de Notre-Dame,—il commencerait par prendre la fuite.
Et, d’autre part, pas mal de gens rompus, guillotinés, roués, marqués par erreur,—ont laissé leur triste histoire pour montrer que la justice peut quelquefois se tromper.
Il me semble que c’est bien assez pour le pauvre diable de prévenu.
Loin de là,—vous le traitez précisément comme s’il était condamné;—vous le mettez dans la même prison où il sera renfermé s’il est reconnu coupable; il reçoit la même nourriture et les mêmes brutalités.
Cependant vient le jour du jugement:—trois prévenus sur cinq sont ordinairement acquittés.—Notre homme est du nombre; au premier moment,—il se réjouit,—il embrasse avec joie sa femme, ses enfants, ses amis;—ses amis... je me trompe, la plupart se sont retirés.—Il rentre chez lui,—ses voisins l’évitent,—on a associé pendant quatre mois son nom à l’idée du crime dont il était accusé,—et pendant quatre heures le procureur du roi s’est efforcé d’entasser tous les arguments possibles pour prouver sa culpabilité.—Quelques-uns le croient plus heureux qu’innocent—le voilà dans son logement avec sa femme et ses enfants: «Où est donc la pendule—et la petite montre,—et nos deux couverts d’argent, tout ce que nous avions acheté à force d’économie?
—Hélas! il a fallu vendre tout cela,—comment aurions-nous vécu, tes enfants et moi pendant ta détention?
—C’est vrai; mais me voilà libre,—je vais travailler, nous allons réparer cela.»
Mais le lendemain—ceux qui lui donnaient de l’ouvrage l’ont remplacé;—il faut chercher, attendre, souffrir, faire des dettes,—et ce n’est peut-être qu’au bout de plusieurs années qu’il aura réparé le mal que lui a fait la justice.
Il me semble que voilà cependant un homme auquel on devrait la plus grande et la plus solennelle réparation.—Nullement.—Le président psalmodie d’un ton monotone:—«Ordonne que le prévenu sera mis en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause.»
Et on le renvoie avec son honneur compromis par une accusation flétrissante,—sa tête fatiguée par l’instruction et l’anxiété, son corps malade par la prison, sa fortune et son industrie perdues par les dépenses et les pertes qui accompagnent nécessairement une accusation criminelle.
Et le procureur du roi ne lui dit pas seulement: «Pardon de vous avoir dérangé.»
Et il n’y a pour lui aucune réparation à attendre de tant de malheurs.
![]() Je voudrais qu’on fît à ce sujet deux choses:
Je voudrais qu’on fît à ce sujet deux choses:
1º Que l’on donnât à l’acquittement, autant que possible, la publicité et l’éclat de l’accusation;—que le procureur du roi ou le président des assises—demandât pardon à l’accusé innocent, au nom de la société et de la justice;—que tous les journaux sans exception fussent chargés de dire: «Un tel, injustement accusé—de tel crime,—a été reconnu innocent.»
2º Qu’une caisse publique fût établie, sur laquelle les tribunaux décerneraient, suivant l’exigence des cas,—des indemnités à ceux qui, après une longue prévention, seraient reconnus innocents.
Eh quoi! me direz-vous? vous en parlez à votre aise. Une caisse! et avec quel argent, s’il vous plaît?
—Je vais vous le dire: tous les jours les tribunaux prononcent des amendes sur les biens des condamnés.—N’est-il pas juste que cet argent dont bénéficie le trésor soit consacré à indemniser, autant que possible,—les malheureux injustement accusés, emprisonnés et ruinés?
![]() Mais il paraît que la justice est fort chère,—puisque malgré ces
choses et bien d’autres qu’on pourrait lui reprocher, et les
circonstances atténuantes du jury, et tous ces crimes à propos desquels
on nous dit: «La justice informe,» après quoi il n’en est plus jamais
question, pas plus que du meurtre d’Abel par Caïn, etc.;—puisque le peu
que nous en avons revient à quatre millions cinq cent soixante et onze
mille trois cent vingt-cinq francs. Il n’y a pas moyen de nous en donner
davantage pour ce prix-là: le gouvernement y perdrait.
Mais il paraît que la justice est fort chère,—puisque malgré ces
choses et bien d’autres qu’on pourrait lui reprocher, et les
circonstances atténuantes du jury, et tous ces crimes à propos desquels
on nous dit: «La justice informe,» après quoi il n’en est plus jamais
question, pas plus que du meurtre d’Abel par Caïn, etc.;—puisque le peu
que nous en avons revient à quatre millions cinq cent soixante et onze
mille trois cent vingt-cinq francs. Il n’y a pas moyen de nous en donner
davantage pour ce prix-là: le gouvernement y perdrait.
![]() Il est vrai de dire que le garde des sceaux—accuse les huissiers
de dévorer pour leur part plus d’un tiers des quatre millions en
question,—au moyen de toutes sortes d’abus, inventés par leur
ingénieuse avidité.
Il est vrai de dire que le garde des sceaux—accuse les huissiers
de dévorer pour leur part plus d’un tiers des quatre millions en
question,—au moyen de toutes sortes d’abus, inventés par leur
ingénieuse avidité.
![]() Il est fâcheux de voir ainsi plus qu’écorner cette pauvre somme de
quatre millions cinq cent soixante et onze mille trois cent vingt-cinq
francs.—Sans cela, bien des choses ne se passeraient pas comme elles se
passent,—mais la France n’a pas le moyen.
Il est fâcheux de voir ainsi plus qu’écorner cette pauvre somme de
quatre millions cinq cent soixante et onze mille trois cent vingt-cinq
francs.—Sans cela, bien des choses ne se passeraient pas comme elles se
passent,—mais la France n’a pas le moyen.
![]() EXEMPLE.—A*** un M. de Marcellange, vivant avec sa femme et sa
belle-mère,—comme on vit avec une femme et une
belle-mère,—c’est-à-dire assez mal,—se plaint qu’un de ses domestiques
a voulu l’assassiner et le chasse.—Sa belle-mère et sa femme prennent
immédiatement le domestique à leur service particulier; quelque temps
après, ce domestique, Jacques Besson, tue en effet M. de Marcellange
d’un coup de fusil;—il est accusé et mis en prison.—La femme de M.
Marcellange envoie à ce pauvre Besson, dans la prison, un lit pour qu’il
ne soit pas trop mal couché,—et un dîner par jour.
EXEMPLE.—A*** un M. de Marcellange, vivant avec sa femme et sa
belle-mère,—comme on vit avec une femme et une
belle-mère,—c’est-à-dire assez mal,—se plaint qu’un de ses domestiques
a voulu l’assassiner et le chasse.—Sa belle-mère et sa femme prennent
immédiatement le domestique à leur service particulier; quelque temps
après, ce domestique, Jacques Besson, tue en effet M. de Marcellange
d’un coup de fusil;—il est accusé et mis en prison.—La femme de M.
Marcellange envoie à ce pauvre Besson, dans la prison, un lit pour qu’il
ne soit pas trop mal couché,—et un dîner par jour.
Aux débats, il est établi qu’une femme de chambre, témoin important et de plus accusée de quelques peccadilles à l’endroit de M. de Marcellange, entre autres de l’avoir un peu empoisonné, a été emmenée en Savoie et laissée là par la belle-mère.
En outre, des propos plus que singuliers sont prêtés à ces dames par plusieurs témoins.
Eh bien!—ces malheureuses femmes restent sous le coup d’une fâcheuse impression, parce que le ministère public ne leur donne pas l’occasion de se justifier et d’expliquer des apparences fatales—en les accusant directement—comme c’était son devoir.
![]() Probablement à cause que la justice, qui n’a que quatre millions
cinq cent soixante et onze mille trois cent vingt-cinq francs à
consacrer à ses menus frais,—n’a pas le moyen—d’entrer plus avant dans
la question.
Probablement à cause que la justice, qui n’a que quatre millions
cinq cent soixante et onze mille trois cent vingt-cinq francs à
consacrer à ses menus frais,—n’a pas le moyen—d’entrer plus avant dans
la question.
![]() AUTRE EXEMPLE.—On veut supprimer le duel;—bien!—mais—voici un
M. Herpin qui reçoit un soufflet d’un M. Dissard,—affaires d’élections.
AUTRE EXEMPLE.—On veut supprimer le duel;—bien!—mais—voici un
M. Herpin qui reçoit un soufflet d’un M. Dissard,—affaires d’élections.
M. Dissard est condamné à six jours de prison.
![]() Ah! j’oubliais; il y a aussi seize francs d’amende.
Ah! j’oubliais; il y a aussi seize francs d’amende.
—Au bénéfice de M. Herpin?
—Non! au bénéfice de S. M. Louis-Phifippe.
—Comment! Est-ce que c’est Sa Majesté?...
—Non!—c’est M. Herpin.
—Eh bien! alors, comment se fait-il que ce soit S. M. Louis-Philippe qui reçoive les seize francs.
![]() L’homme qui reçoit un soufflet—est en proie à deux
impressions:—1º il est en colère et il veut se venger;—2º il songe
qu’il a été convenu, je ne sais pourquoi ni comment,—qu’un homme qui a
reçu un soufflet doit s’exposer, en outre, à recevoir un coup
d’épée,—sans quoi il serait déshonoré.
L’homme qui reçoit un soufflet—est en proie à deux
impressions:—1º il est en colère et il veut se venger;—2º il songe
qu’il a été convenu, je ne sais pourquoi ni comment,—qu’un homme qui a
reçu un soufflet doit s’exposer, en outre, à recevoir un coup
d’épée,—sans quoi il serait déshonoré.
Il serait possible que le souffleté fît le sacrifice de son impression nº 2,—s’il était parfaitement satisfait sur l’impression nº 1.
D’ailleurs, avec le raisonnement le plus vulgaire, il est évident que si l’on veut proscrire le duel—il faut punir avec plus de rigueur que le duel lui-même—une insulte qui rend le duel nécessaire pour l’insulté, sous peine de déshonneur.
Il faudrait qu’un homme qui donne un soufflet à un autre—fût traduit en cour d’assises—sous prévention de tentative d’homicide.
Vous ne le ferez pas.—Eh bien! vous ne proscrirez le duel—qu’entre gens qui ne se battraient pas,—même sans votre défense.
Il est vrai que, pour traduire l’insulteur en cour d’assises, cela entraînerait quelques frais; et, je vous l’ai dit, la justice n’a que quatre millions cinq cent soixante et onze mille trois cent vingt-cinq francs à dépenser;—elle est forcée d’avoir de l’ordre.
Je me suis expliqué, il y a longtemps,—dans les Guêpes,—sur cette prohibition du duel par les avocats.
![]() Voici une anecdote qui montre en son jour l’empire des préjugés:
Voici une anecdote qui montre en son jour l’empire des préjugés:
M ***, bien connu à la Bourse, va trouver un de ses amis, et lui dit:
—Va chez M. B...—il m’a hier donné un soufflet:—il faut qu’il m’en rende raison.
L’ami se met en route, et trouve M. B...—qui déjeunait avec quelqu’un.
—Monsieur, je désirerais avoir avec vous quelques instants d’entretien?
—Monsieur,—monsieur qui déjeune avec moi est mon ami, vous pouvez parler devant lui.
—Monsieur, je viens de la part de ***.
—Ah! c’est vrai, nous nous sommes querellés hier soir;—j’espère qu’il n’y pense plus.—Moi, j’ai tout oublié!
—Au contraire, il y pense,—et je viens vous demander à quelle heure il pourrait vous rencontrer aujourd’hui à Vincennes.
—Comment! comment!
—Il a naturellement le choix des armes;—il prendra le pistolet.
—Mais pardon, monsieur, nous ne nous entendons pas du tout.
—Je crois pourtant être clair, monsieur; vous avez hier insulté M ***, et il vous en demande aujourd’hui réparation.
—Mais c’est que je ne l’ai pas du tout insulté!
—Allons donc! monsieur!
—Parole d’honneur!
—Allons donc! ce n’est pas là une de ces insultes arbitraires qui peuvent se discuter;—celle que vous avez faite à *** est telle, qu’il est convenu de tout temps qu’elle ne peut se laver que dans le sang.
—Mais que voulez-vous dire?—Quelle insulte?
—Mon Dieu! monsieur,—vous tenez donc bien à me faire dire le mot?—Vous lui avez donné un soufflet!
—Moi! j’en suis incapable.
—Monsieur, avoir reçu un soufflet n’est pas une chose dont on se vante pour son plaisir, c’est un genre de fatuité qu’on n’a pas encore inventé; c’est M. *** qui m’envoie vous demander raison d’un soufflet qu’il a reçu de vous hier.
—Monsieur, je ne lui ai pas donné de soufflet, je ne lui ai donné QU’un coup de poing sur le visage, je vous en donne ma parole d’honneur, et je vous le ferai attester par dix témoins.
—Alors c’est bien différent, je vais aller le retrouver et prendre de nouvelles instructions.
—Avez-vous une voiture?
—Oui.
—Eh bien, mon ami et moi nous allons aller avec vous.
On part,—on arrive chez M. ***.—M. B... va à lui et lui répète ce qu’il a dit à son témoin:
—Mon cher ami, je ne vous ai pas donné de soufflet, mais un coup de poing.
—Au fait, cela m’a cassé deux dents!
—Qu’est-ce que je disais! un soufflet ne casse pas deux dents.
—Il faut que ce soit un coup de poing, et un bon coup de poing!
—C’est possible,—j’étais en colère.
Pendant ce temps, les deux témoins confèrent dans l’embrasure d’une fenêtre;—il est établi que M. *** n’a pas reçu un soufflet, mais un simple coup de poing.—Donc il n’y a pas de mal.—B...—fait quelques excuses, et tout est fini.
![]() Revenons à la justice.
Revenons à la justice.
![]() AUTRE EXEMPLE.—A Dieppe, le sieur Leteurtre, boulanger, chargé par
l’administration municipale de fournir le pain qui devait être distribué
aux pauvres de la ville—est convaincu d’avoir volé les pauvres en
fournissant du pain de mauvaise qualité.
AUTRE EXEMPLE.—A Dieppe, le sieur Leteurtre, boulanger, chargé par
l’administration municipale de fournir le pain qui devait être distribué
aux pauvres de la ville—est convaincu d’avoir volé les pauvres en
fournissant du pain de mauvaise qualité.
Il est condamné à trois jours de prison.
Chaque jour, à Paris, de semblables délits sont punis par de semblables peines,—ce qui est loin de les réprimer:—les boulangers qui vendent le pain à faux poids—en sont quittes pour cinq francs d’amende—et un ou deux jours de prison,—tandis que le malheureux qui,—poussé par la faim,—leur déroberait, la nuit, un pain d’un sou en cassant un carreau,—pourrait être condamné au moins à un an de prison.
Il semble nécessaire—de revenir sur un pareil ordre de choses.—Le vol du boulanger doit être puni au moins comme tout autre vol.
Pourquoi—ne ferait-on pas peindre sur l’enseigne du boulanger pris en fraude, au-dessus de sa boutique,—pendant un temps fixé par le tribunal, selon la gravité du délit, au lieu de: «Un tel, boulanger,
«UN TEL, VOLEUR.»
Ou, encore, pourquoi ne fermerait-on pas sa boutique pendant quelques jours,—en faisant écrire sur les volets fermés: «Boutique fermée pour tant de jours—pour vol—et vente à faux poids.»
Ah! si la justice n’était pas forcée de se renfermer dans ses pauvres quatre millions cinq cent soixante et onze mille trois cent vingt-cinq francs!
![]() AUTRE EXEMPLE.—A Tulle, un directeur des postes et un gendarme
arrêtent un voyageur,—lui prennent de force son portefeuille—pour y
chercher des lettres,—sous prétexte qu’il est en contravention à la loi
sur le transport des lettres.
AUTRE EXEMPLE.—A Tulle, un directeur des postes et un gendarme
arrêtent un voyageur,—lui prennent de force son portefeuille—pour y
chercher des lettres,—sous prétexte qu’il est en contravention à la loi
sur le transport des lettres.
Le voyageur est traduit en justice;—le tribunal déclare que la saisie faite sur lui est illégale—et le renvoie de la plainte.
—Oh! très-bien!
—Et le directeur de la poste,—que lui fait-on?
—Rien.
—Ah!—Et le gendarme, que lui fait-on?
—Rien.
—Cependant, si le voyageur avait été condamné,—ç’aurait été pour contravention à la loi, qui protége le directeur de la poste;—est-ce qu’il n’y a pas quelque part quelque bout de loi—qui protége les citoyens et les voyageurs?
—Il y en a plusieurs.
—Comment se fait-il alors qu’on n’ait pas mis en jugement le directeur de la poste et le gendarme, quand on y mettait un homme faussement accusé d’attentat à un privilége fiscal, eux qui violaient ouvertement la plus respectable, la plus sainte des choses humaines: la liberté d’un citoyen?
—Ah! c’est que cela coûterait de l’argent.
—N’importe!
—Je voudrais vous y voir, si vous n’aviez que quatre mauvais millions cinq cent soixante et onze mille trois cent vingt-cinq francs!
![]() Dans les années précédentes des Guêpes,—j’ai adressé à M. Cousin
et à M. Villemain, tour à tour ministres de l’instruction publique,—de
respectueuses remontrances au sujet des choses peu vraies qu’ils ont
débitées à la distribution des prix du concours général.
Dans les années précédentes des Guêpes,—j’ai adressé à M. Cousin
et à M. Villemain, tour à tour ministres de l’instruction publique,—de
respectueuses remontrances au sujet des choses peu vraies qu’ils ont
débitées à la distribution des prix du concours général.
Il y a une de ces choses peu vraies dont je n’ai pas parlé;—c’est la tendresse mutuelle qu’éprouvent les maîtres et les élèves.
C’est une chose qu’on dit tous les ans—pour terminer dignement douze mois de guerre acharnée, de luttes, de ruses ourdies et déjouées, de perfidie et de vengeance.
Je me rappelle, à ce sujet, la petite anecdote que voici: Victor Hugo habitait avec une charmante famille le quartier des Champs-Élysées.—Un jour il descendit, le matin, l’escalier de sa maison pour aller faire une promenade et respirer sous les arbres.
Il entend un grand bruit au bas de l’escalier,—il reconnaît le bruit de ses deux petits enfants, comme une femme reconnaît le pas de son amant;—cependant ils ne reviennent ordinairement de l’école voisine qu’à quatre heures de l’après-midi et il n’est que neuf heures du matin.—Ce sont cependant bien eux,—ils se tiennent par la main, et ils montent bruyamment l’escalier—en chantant sur une sorte d’air de leur invention, sur une espèce de ton de psalmodie, les paroles suivantes:
«Le maître est mort; il n’y a pas d’école,—il n’y a pas d’école; le maître est mort,—le maître est mort, il n’y a pas d’école.»
![]() A peine les députés partis,—les centenaires reparaissent dans les
journaux,—et comme d’ordinaire,—ils lisent sans lunettes.
A peine les députés partis,—les centenaires reparaissent dans les
journaux,—et comme d’ordinaire,—ils lisent sans lunettes.
C’est à ce moment que les journaux, si incrédules d’ordinaire, croient à tout ce qui peut remplir leurs colonnes.—Un plaisant s’avise d’écrire à un journal (le Commerce, je crois)—qu’un navire entrant dans le port du Havre a coulé bas en frappant la tour de François Ier,—et a démoli une partie de la tour.
Tous les journaux répètent la nouvelle.
J’étais alors à une demi-lieue du Havre:—c’était une grande marée, et je pêchais des limandes.—Tout en pêchant je m’étonnais, parce que l’événement était assez singulier pour qu’on en parlât un peu au Havre et dans les environs.
Un journal du Havre reproche alors aux journaux de Paris leur crédulité et leur explique que la tour de François Ier, démolie par un navire,—était une nouvelle de la force de celle-ci:
«Un fiacre ayant accroché l’arc de triomphe de l’Étoile, l’a en partie démoli.»
Si j’en avais eu le temps, j’aurais fait dessiner et graver pour les Guêpes—un dessin représentant la tour de François Ier renversée par une de ces galiotes de papier que font les enfants.—La galiote eût été faite d’un morceau d’un des journaux qui ont répandu la nouvelle.—Je livre le sujet à Daumier.
![]() Depuis le 1er septembre dernier,—on a imprimé en France un peu
plus de trois millions de volumes.—Il y a des montagnes qui ne sont pas
si grosses.
Depuis le 1er septembre dernier,—on a imprimé en France un peu
plus de trois millions de volumes.—Il y a des montagnes qui ne sont pas
si grosses.
![]() Plusieurs fonctionnaires indépendants ont donné dans diverses
branches de l’administration des preuves d’indépendance malheureusement
prévues par plusieurs codes,—et malhonnêtement qualifiées par iceux.
Plusieurs fonctionnaires indépendants ont donné dans diverses
branches de l’administration des preuves d’indépendance malheureusement
prévues par plusieurs codes,—et malhonnêtement qualifiées par iceux.
![]() Tu disais donc tout à l’heure, Théophile, que tu es amoureux?
Tu disais donc tout à l’heure, Théophile, que tu es amoureux?
—Hélas oui!—ô Gérard!
—Et à quoi vois-tu donc que tu es amoureux? ô Théophile!
—Parbleu! cela est bien facile à reconnaître,—et je n’ai pas eu de peine à en être convaincu, attendu le symptôme grave qui s’est manifesté ces jours passés.
—Et quel est ce symptôme? ô Théophile!
—O Gérard! j’ai senti le besoin de m’acheter un chapeau neuf.
![]() Un artiste, l’un des plus connus de ce temps-ci,—est adressé à M.
de Rambuteau,—préfet de la Seine,—par quelqu’un de sa famille, pour
avoir part aux travaux de l’Hôtel de Ville. Il arrive avec la lettre
autographe de M. de Rambuteau, qui désigne le jour d’audience. M. de
Rambuteau le reçoit comme un écolier.—L’artiste est très-embarrassé et
visiblement au supplice. Il voudrait pour tout au monde renoncer aux
travaux, et n’être pas venu là. M. de Rambuteau—lui répétait sans
cesse ces deux phrases sans attendre de réponse,—et prenait à peine le
temps de respirer: «Monsieur, êtes-vous élève de l’école de Rome? Il
faut être bien connu pour être connu de moi;—je ne connais que ce qui
est très-connu.—Il paraît, monsieur, que vous n’êtes pas un grand prix
de Rome, etc.»
Un artiste, l’un des plus connus de ce temps-ci,—est adressé à M.
de Rambuteau,—préfet de la Seine,—par quelqu’un de sa famille, pour
avoir part aux travaux de l’Hôtel de Ville. Il arrive avec la lettre
autographe de M. de Rambuteau, qui désigne le jour d’audience. M. de
Rambuteau le reçoit comme un écolier.—L’artiste est très-embarrassé et
visiblement au supplice. Il voudrait pour tout au monde renoncer aux
travaux, et n’être pas venu là. M. de Rambuteau—lui répétait sans
cesse ces deux phrases sans attendre de réponse,—et prenait à peine le
temps de respirer: «Monsieur, êtes-vous élève de l’école de Rome? Il
faut être bien connu pour être connu de moi;—je ne connais que ce qui
est très-connu.—Il paraît, monsieur, que vous n’êtes pas un grand prix
de Rome, etc.»
L’artiste veut répliquer et parler un peu à M. le préfet de ses travaux que tout Paris connaît.—M. de Rambuteau lui coupe la parole en répétant les deux phrases ci-dessus.
Alors l’artiste exaspéré lui dit:
—En vérité, monsieur, vous m’obligez à relever une grande erreur dans ce que vous dites.—Vous prétendez ne connaître que ce qui est très-connu!—il y a pourtant, monsieur, quelque chose de bien connu que vous ne connaissez pas.
—Quelle chose?
—L’orthographe, monsieur,—et voici votre lettre.
![]() Il y a différentes espèces de restaurateurs et de marchands de
soupe, depuis le hasard de la fourchette, où, pour un sou, on plonge
un trident dans une marmite de laquelle on retire, selon sa chance, un
morceau de viande, un oignon, ou rien, jusqu’au Café anglais; c’est une
longue échelle qui a tous ses échelons.
Il y a différentes espèces de restaurateurs et de marchands de
soupe, depuis le hasard de la fourchette, où, pour un sou, on plonge
un trident dans une marmite de laquelle on retire, selon sa chance, un
morceau de viande, un oignon, ou rien, jusqu’au Café anglais; c’est une
longue échelle qui a tous ses échelons.
Il faut signaler entre ces divers restaurants le maître de pension, le chef d’institution; si vous aimez mieux, celui auquel vous confiez votre fils pour lui faire donner la ridicule éducation que je vous ai déjà plus d’une fois signalée.
M. Villemain disait à un homme d’esprit, qui s’était ruiné dans une exploitation de ce genre:
—Mon cher, votre malheur m’afflige sans m’étonner; vous avez cru qu’un maître de pension est un instituteur qui accessoirement nourrit ses élèves; vous ne seriez pas ruiné si vous aviez compris, au contraire: un maître de pension est un restaurateur qui, entre les repas, fait copier à ses élèves la Cigale et la Fourmi, de la Fontaine, et le récit de Théramène, de Racine.
C’est sur la soupe, sur le beurre qu’on peut y épargner,—sur le prix de la viande et des légumes,—sur le choix d’un vin qui supporte beaucoup d’eau, que devait se baser votre spéculation, que devaient se porter vos soins et vos études; vous avez fait un accessoire de ce qui est le principal,—et vous êtes ruiné.
![]() Je ferai quelqu’un de ces jours—un petit livre sur
l’éducation;—je vous dirai une bonne fois,—mes braves gens,—ce que
c’est que l’éducation que vous faites donner à vos petits.
Je ferai quelqu’un de ces jours—un petit livre sur
l’éducation;—je vous dirai une bonne fois,—mes braves gens,—ce que
c’est que l’éducation que vous faites donner à vos petits.
En attendant,
Les susdits marchands de soupe s’y prennent de toutes les manières pour achalander leurs établissements:—à la manière de ces escamoteurs des boulevards, qui essayent de détourner votre attention de leurs mains—par des paroles pressées,—tandis qu’ils font disparaître la muscade.
Les marchands de soupe,—dits maîtres de pension,—tâchent de vous occuper des lettres et des sciences, dont ils ne se soucient pas, pour détourner votre attention de l’affreux potage, qui est le véritable but de leur spéculation.
Ils ont, depuis quelques années, inventé de faire imprimer dans les annonces des journaux les noms de ceux de leurs innocentes victimes qui ont obtenu un prix de thème ou un accessit de vers latins,—ces deux choses ridicules auxquelles on consacre tristement plusieurs années de la vie des enfants.
Les pauvres enfants voient leurs noms imprimés—entre les annonces honteuses du docteur Charles Albert—et la pommade mélaïnocome.
Il y a des parents qui trouvent cela charmant.
![]() J’entends chaque jour parler avec terreur de toutes sortes de
dangers—métaphoriques:—les chaînes de la tyrannie et l’hydre de
l’anarchie sont tour à tour déclarées imminentes;—on parle,—on écrit,
on dispute pour les prévenir.
J’entends chaque jour parler avec terreur de toutes sortes de
dangers—métaphoriques:—les chaînes de la tyrannie et l’hydre de
l’anarchie sont tour à tour déclarées imminentes;—on parle,—on écrit,
on dispute pour les prévenir.
Je ne sais pourquoi, au milieu de ce bruit,—je réserve mes craintes pour des dangers plus immédiats;—de même que je n’aime pas à me laisser prendre à des espérances trop lointaines,—ayant depuis longtemps remarqué qu’il en est des bonheurs comme des perdrix: quand on les vise de trop loin, on court grand risque de ne pas les atteindre.
Cet été a été d’une âpre sécheresse;—le nombre des chiens enragés s’est singulièrement accru. On a pris à Paris quelques précautions insuffisantes;—hors de Paris, on en a pris de moins en moins à proportion de la distance,—à dix lieues de Paris on n’en prend aucune.
Je demanderai pourtant aux gens de bonne foi s’il est quelque chose de plus horrible à l’imagination que le danger d’être mordu par un chien hydrophobe?—On frémit aux récits des voyageurs qui racontent qu’ils ont, au détour d’un chemin, rencontré un ours ou un tigre,—et cependant contre ces animaux on peut se défendre, on peut combattre.—Il est des exemples qui peuvent faire espérer la victoire; dans le cas contraire, la mort est cruelle, mais elle n’excite que la compassion, et d’ailleurs elle est mêlée d’une sorte de grandeur et de noblesse—qui, sans la rendre moins terrible—la rend moins hideuse à envisager.
Mais si vous êtes attaqué par un chien enragé,—la force, le courage, l’adresse,—le sang-froid,—rien ne peut vous sauver;—vous êtes vainqueur, vous avez tué l’animal; mais il vous a, de ses dents, effleuré l’épiderme.—Eh bien! vous êtes perdu,—et vous mourez dans d’affreuses convulsions, répandant par la bouche—une écume contagieuse,—objet d’horreur, d’épouvante et de dégoût pour votre femme, pour vos enfants, pour vos amis;—un délire de bête féroce s’empare de vous,—vous mordez,—vous devenez presque un chien enragé vous-même.
C’est la mort la plus désespérée, la plus horrible de toutes les morts.
Eh bien!—chaque jour,—à chaque heure, à chaque instant vous vous exposez à ce sort épouvantable.—L’animal qui, par un funeste privilége, est, avec le loup, la seule espèce chez laquelle la rage puisse se déclarer spontanément,—cet animal,—on le donne pour jouet aux enfants,—on le laisse vaquer par la ville et par les chemins,—on le laisse se multiplier sans mesure,—on n’exige aucune responsabilité de la part de ceux qui ont des chiens.
Si l’on vous disait, cependant, qu’il court par les rues un animal dont le contact peut vous donner la fièvre, vous jetteriez les hauts cris.
S’il se répand—faussement le bruit d’une maladie contagieuse et épidémique—vous êtes frappé de terreur.
Et tous les ans—un grand nombre de personnes sont mordues par des chiens enragés, deviennent elles-mêmes hydrophobes, et meurent de la plus funeste mort.
Et on n’y fait aucune attention.
Ah! pardon:
La police fait répandre des boulettes empoisonnées dans les tas d’ordures.
INCONVÉNIENTS DE CE SYSTÈME:—1º On en fait payer à la police beaucoup plus qu’on n’en jette;
2º Les boueux enlèvent chaque matin les ordures et les boulettes;
3º Un des symptômes de la rage étant que l’animal ne veut plus manger,—les chiens enragés sont précisément les seuls à l’abri des boulettes.
Ensuite,—au milieu de cette destruction des chiens errants que la police prétend faire,—allez-vous-en sur la place du Louvre,—sur celle de la Concorde,—sur celle de la Bastille,—et je vous promets que vous en verrez quarante,—de ceux auxquels il serait aussi difficile d’assigner un maître qu’une espèce.
Qui de vous,—et je m’adresse aux plus braves,—qui de vous se soucierait d’habiter une ville où on laisserait errer librement trente ou quarante mille tigres?—qui de vous n’aimerait mieux dix mille fois cependant rencontrer un tigre qu’un chien enragé.
Tout homme qui a un cabriolet—prend un numéro—et est responsable de tous les accidents qui peuvent résulter de son cabriolet.—En effet, on ne peut être exposé sans garantie à une maladresse ou à une imprudence qui peut vous renverser sur le pavé et vous blesser grièvement.
Mais, par exemple, on s’expose très-bien à être mordu par un chien hydrophobe:—on n’a aucun moyen de reconnaître le maître du chien;—peut-être d’ailleurs est-il sans maître,—et personne n’est responsable.
Et cependant—j’appuierai encore sur ce point:—est-il une maladie,—est-il une mort plus épouvantable que celle à laquelle vous vous exposer à chaque coin de rue?
Chaque fois que vous sortez de chez vous—vous ne pouvez pas être sûr que cet horrible accident ne vous arrivera pas sur la route.
Plusieurs accidents de ce genre arrivent chaque année à Paris.
On ne saurait compter ceux qui arrivent dans les campagnes.
Si j’écrivais ici que le gouvernement menace l’indépendance d’un commis surnuméraire dans l’administration des tabacs,—on ferait attention à ma réclamation;—les journaux s’en empareraient—et feraient beaucoup de tapage,—tandis que ce sera grand hasard si quelqu’un s’avise de lire ces pages.
![]() Il faudrait cependant prendre une mesure universelle et énergique.
Il faudrait cependant prendre une mesure universelle et énergique.
Il faudrait d’abord dans chaque ville, comme dans chaque bourg,—qu’on fixât—un espace de temps (une semaine ou davantage si c’est nécessaire)—pendant lequel les propriétaires de chiens seraient tenus de les renfermer chez eux.—On profiterait de cet espace pour faire abattre sans exception tous ceux qu’on trouverait dehors.
Ensuite,—on exigerait de ceux qui veulent garder des chiens d’en faire une déclaration à la police et de leur mettre au cou—un collier poinçonné portant leur nom et leur adresse.
Tout propriétaire de chien aurait ainsi une responsabilité qu’il ne pourrait éluder, si l’on prenait cependant deux précautions.
La première, de ne pas punir l’infraction à l’ordonnance de cinq on de dix francs d’amende,—comme on fait en d’autres cas, mais de cinq cents à mille francs,—en y ajoutant un emprisonnement de trois à six mois.
La seconde, de condamner à une peine très-forte et très-redoutable—tout propriétaire de chien—qui, devenant hydrophobe,—causerait des accidents.
Aucun chien,—sans exception,—par aucun temps, ne devrait être rencontré dehors sans être muselé.
Je sais qu’il existe dans les ordonnances de police certaines dispositions qui ont quelque rapport avec quelques-unes de celles que je propose ici;—mais on ne les fait pas observer,—et le risque que l’on court à ne pas les observer est tellement faible, qu’il n’oblige personne.
En ne supposant qu’un chien par vingt personnes dans une ville comme Paris, où presque tout le monde en a,—et en supposant que tous les chiens ont des maîtres,—chez chacun desquels il ne faut que la réunion de deux ou trois petites circonstances très-ordinaires pour faire déclarer l’hydrophobie;—je voudrais bien savoir si l’on découvrira quelque jour que cela mérite qu’on s’en occupe.
![]() Ajoutons que, si l’on voulait remplacer par un impôt sur les
chiens—quelques-uns de ceux qui pèsent si cruellement sur les objets de
première consommation, cet impôt serait un gros revenu,—et dégrèverait
des objets qu’il est odieux d’imposer.—En Angleterre, un impôt de ce
genre rapporte par an plus de quarante millions.
Ajoutons que, si l’on voulait remplacer par un impôt sur les
chiens—quelques-uns de ceux qui pèsent si cruellement sur les objets de
première consommation, cet impôt serait un gros revenu,—et dégrèverait
des objets qu’il est odieux d’imposer.—En Angleterre, un impôt de ce
genre rapporte par an plus de quarante millions.
![]() Le duc d’Orléans mort,—une nuée de corbeaux s’est abattue sur
lui,—puis chacun de ces oiseaux a tiré une plume de son aile noire,—et
s’est mis à dessiner, à écrire,—et surtout à vendre.
Le duc d’Orléans mort,—une nuée de corbeaux s’est abattue sur
lui,—puis chacun de ces oiseaux a tiré une plume de son aile noire,—et
s’est mis à dessiner, à écrire,—et surtout à vendre.
Il y a tant de gens qui ne voient dans un naufrage que les épaves.
M. Gannal a élevé la voix; il a accusé les médecins qui avaient embaumé le prince mort de l’avoir mal embaumé,—il les a accusés d’avoir dérobé des organes.
![]() La quantité innombrable de mauvais vers dont la mort du duc
d’Orléans a été le prétexte—nous rappelle la prudente épitaphe que fit
pour lui-même le poëte Passerat—et qui finissait par ces deux vers:
La quantité innombrable de mauvais vers dont la mort du duc
d’Orléans a été le prétexte—nous rappelle la prudente épitaphe que fit
pour lui-même le poëte Passerat—et qui finissait par ces deux vers:
![]() Le 26 juin dernier,—vers une heure et demie de
l’après-midi,—Sophie Ollivier, jeune fille de dix-sept ans, journalière
à Faumont, prés de Douai,—partit de chez elle pour aller voir une de
ses sœurs à quelques lieues de là.—Un misérable, appelé Mogren,—la
rencontre dans le bois de Faumont,—lui adresse des propositions
insultantes,—et, sur son refus,—se précipite sur elle,—la
renverse,—la saisit par les cheveux et lui coupe le cou avec une
serpe;—elle est morte, il la déshabille,—et s’enfuit en emportant
jusqu’aux souliers de la malheureuse Sophie Ollivier.
Le 26 juin dernier,—vers une heure et demie de
l’après-midi,—Sophie Ollivier, jeune fille de dix-sept ans, journalière
à Faumont, prés de Douai,—partit de chez elle pour aller voir une de
ses sœurs à quelques lieues de là.—Un misérable, appelé Mogren,—la
rencontre dans le bois de Faumont,—lui adresse des propositions
insultantes,—et, sur son refus,—se précipite sur elle,—la
renverse,—la saisit par les cheveux et lui coupe le cou avec une
serpe;—elle est morte, il la déshabille,—et s’enfuit en emportant
jusqu’aux souliers de la malheureuse Sophie Ollivier.
Le criminel, arrêté,—est reconnu coupable d’assassinat et de vol par le jury des assises du Nord;—mais le jury reconnaît en sa faveur des circonstances atténuantes.
On dit que le ridicule tue en France;—il faut croire qu’il ne tue pas vite,—peut-être ce qu’a de ridicule la fréquence de pareils jugements est-il atténué par ce qu’ils ont d’horrible et de dangereux.
![]() Un malheureux est traduit en police correctionnelle sous la
prévention d’avoir volé une tabatière.
Un malheureux est traduit en police correctionnelle sous la
prévention d’avoir volé une tabatière.
M. le président le tance vertement—avant de prononcer sa condamnation.—Entre autres choses remarquables que renfermait la petite harangue du président, j’ai remarqué spécialement celle-ci:
«Prévenu, quand vous avez été arrêté, on a trouvé sur vous UNE SOMME de un franc vingt-cinq centimes; vous ne direz DONC pas que c’est la misère qui vous a poussé à commettre ce délit.»
En effet, comme cette somme de un franc vingt-cinq centimes vous met un homme au-dessus de la misère!—Pourquoi, en effet, ne plaçait-il pas son franc vingt-cinq centimes pour vivre avec les intérêts de ladite SOMME?
Ajoutez que le prévenu était un pauvre diable d’Italien arrivé depuis peu à Paris de Parme, son pays natal.—Il avait fait la route à pied—et n’avait pas d’ailleurs de mauvais antécédents.
A propos de pauvres,—rappelons-nous ici—que le Journal des Débats a un jour conseillé aux pauvres de mettre leurs économies à la caisse d’épargne.
C’est dommage que l’abonnèment un peu cher au Journal des Débats—prive les pauvres de puiser dans sa lecture d’aussi utiles conseils.
Il est vrai de dire que cette recette contre la misère avait pu être inspirée au Journal des Débats par une ordonnance de police que l’on a vue placardée sur tous les murs de Paris à l’époque du choléra.
M. le préfet de police recommandait au peuple de manger de bonne viande et de boire du vin de Bordeaux.
![]() A propos de la loi de régence, on a fait à la loi de régence des
objections que les Guêpes avaient prévues.—M. de Lamartine s’est
séparé du parti conservateur—et s’est prononcé contre la loi.—Il a dit
que, dans l’histoire des régences, sur vingt-huit régences d’hommes, il
y a eu vingt-trois usurpations.—Le parti de l’opposition avait bien
besoin de cette conquête pour se consoler un peu de sa défaite et de ses
maladresses.—Quelques-uns veulent que M. de Lamartine ait abandonné les
conservateurs par mauvaise humeur de ce qu’il n’avait pas été soutenu
par eux lorsqu’il s’était laissé porter à la présidence de la Chambre
par ses amis;—d’autres ont dit que, comme Caton, il s’était mis par une
sorte de courage—du parti des vaincus.
A propos de la loi de régence, on a fait à la loi de régence des
objections que les Guêpes avaient prévues.—M. de Lamartine s’est
séparé du parti conservateur—et s’est prononcé contre la loi.—Il a dit
que, dans l’histoire des régences, sur vingt-huit régences d’hommes, il
y a eu vingt-trois usurpations.—Le parti de l’opposition avait bien
besoin de cette conquête pour se consoler un peu de sa défaite et de ses
maladresses.—Quelques-uns veulent que M. de Lamartine ait abandonné les
conservateurs par mauvaise humeur de ce qu’il n’avait pas été soutenu
par eux lorsqu’il s’était laissé porter à la présidence de la Chambre
par ses amis;—d’autres ont dit que, comme Caton, il s’était mis par une
sorte de courage—du parti des vaincus.
![]() M. Thiers, lui, a abandonné l’opposition et a voté avec les
conservateurs en faveur de la loi de régence.
M. Thiers, lui, a abandonné l’opposition et a voté avec les
conservateurs en faveur de la loi de régence.
C’était une position difficile;—mais M. Thiers l’a attaquée hardiment.
Il se résignait à peu près de bonne grâce à se voir presque impossible pour le présent,—mais il comptait sur le règne suivant;—la mort du duc d’Orléans et la loi de régence, qui en est la conséquence,—venaient l’embarrasser;—pour rester dans l’opposition, il fallait voter contre la loi de la régence—et s’aliéner le futur régent.
M. Thiers a reconquis d’un seul vote et d’une seule palinodie—le présent et l’avenir.
![]() C’est un peu honteux, mais cela s’oublie vite de ce temps-ci, et ne
nuit à personne;—que je voie.
C’est un peu honteux, mais cela s’oublie vite de ce temps-ci, et ne
nuit à personne;—que je voie.
![]() Les journaux de l’opposition,—qui renvoyaient d’ordinaire M. de
Lamartine à sa lyre, à sa barque, à Elvire, quand il ’n’était pas de
leur avis,—l’ont déclaré grand poëte et homme d’État distingué.
Les journaux de l’opposition,—qui renvoyaient d’ordinaire M. de
Lamartine à sa lyre, à sa barque, à Elvire, quand il ’n’était pas de
leur avis,—l’ont déclaré grand poëte et homme d’État distingué.
En quoi ils ont assez raison.—La position de M. de Lamartine à la Chambre est belle et grande, et elle ne peut manquer de prendre dans l’avenir une plus grande importance encore,—s’il sait la conserver intacte;—il ne reconnaît de drapeau que celui de la raison et des intérêts nobles du pays;—il n’appartient à aucun parti, mais cependant—j’ai trouvé un peu d’exagération dans ses coquetteries à M. Odilon Barrot.
![]() Les conservateurs ont, de leur côté,—loué la haute raison de M.
Thiers,—ils savent mieux que personne à quoi s’en tenir sur les mobiles
de la politique du Mirabeau-mouche.
Les conservateurs ont, de leur côté,—loué la haute raison de M.
Thiers,—ils savent mieux que personne à quoi s’en tenir sur les mobiles
de la politique du Mirabeau-mouche.
![]() M. Fulchiron a dit: «M. de Lamartine nous quitte,—mais M. Thiers
nous revient, c’est une fiche de consolation.—Vous voulez dire, reprit
M. Vatry,—c’est une fichue consolation.»
M. Fulchiron a dit: «M. de Lamartine nous quitte,—mais M. Thiers
nous revient, c’est une fiche de consolation.—Vous voulez dire, reprit
M. Vatry,—c’est une fichue consolation.»
![]() Le parti des conservateurs est victorieux; s’il veut garder sa
victoire et en profiter, il faut qu’il marche, il faut qu’il lève, comme
faisaient ses adversaires, le drapeau du progrès, mais d’un progrès
réel, raisonnable; qu’il fasse des choses et pas de métaphores, des
améliorations et pas de bouleversements; qu’il s’occupe de questions
sociales et pas de questions de portefeuilles.
Le parti des conservateurs est victorieux; s’il veut garder sa
victoire et en profiter, il faut qu’il marche, il faut qu’il lève, comme
faisaient ses adversaires, le drapeau du progrès, mais d’un progrès
réel, raisonnable; qu’il fasse des choses et pas de métaphores, des
améliorations et pas de bouleversements; qu’il s’occupe de questions
sociales et pas de questions de portefeuilles.
On a traité dans toute cette affaire la Chambre des pairs avec le dédain le plus insultant, avec l’inconvenance la plus révoltante.
Une fois la loi votée par la Chambre basse,—on a envoyé par le télégraphe et par les journaux la nouvelle que la loi était votée;—les autorités ont harangué le duc de Nemours—en l’appelant régent de France.
Les pairs ont paru peu sensibles à cet affront: ils ont voté la loi—comme un clerc d’huissier copie un acte.
![]() Le Journal des Débats a commencé à enregistrer les harangues
faites au duc de Nemours et les réponses du prince.
Le Journal des Débats a commencé à enregistrer les harangues
faites au duc de Nemours et les réponses du prince.
Il a dit que le prince avait parfaitement réussi à Strasbourg.
On s’est élevé avec raison contre l’inconvenance choquante de cette expression.
Outre l’inconvenance, cela avait un inconvénient dont on n’a pas tardé à s’apercevoir.
On a invité le Journal des Débats—à modérer ou à mieux diriger son zèle.
Le Journal des Débats, subitement calmé,—s’est contenté de dire: «Le prince est entré dans telle ville,»—et de relater les discours.
Alors les journaux de l’opposition ont dit: «Le prince n’a donc pas réussi,—il a donc eu du désagrément?»
On nous disait qu’il avait réussi à Strasbourg,—et les journaux du ministère ne nous disent rien des autres villes. Il faut qu’il n’ait pas réussi.—Et on tirait de là une foule de conséquences et d’hypothèses—extrêmement fâcheuses.
![]() Au moment où les divers restaurateurs et gargotiers, se disant
maîtres de pension,—remplissent les journaux d’annonces et de réclames
dans lesquelles ils font figurer de pauvres enfants qui n’en peuvent
mais, je crois leur être agréable en leur donnant un remarquable modèle
en ce genre.
Au moment où les divers restaurateurs et gargotiers, se disant
maîtres de pension,—remplissent les journaux d’annonces et de réclames
dans lesquelles ils font figurer de pauvres enfants qui n’en peuvent
mais, je crois leur être agréable en leur donnant un remarquable modèle
en ce genre.
L’Indicateur pour la ville de Strasbourg, imprimé en ladite ville par Daunbach,—contient les lignes que voici:
«Charles-Conservé OBERLIN fils, et selon le système de feu Jean-Frédéric Oberlin, de son vivant très-digne et très-zélé pasteur à Waldbach, au Ban-de-la-Roche, dont la maison était constamment remplie d’élèves et dont ils aiment toujours à se rappeler avec plaisir, donnera son cours d’éducation physique et morale des enfants, en français et en allemand, pour les messieurs et pour les dames, séparément, sans distinction de culte ni de condition, aussitôt qu’il y aura assez de souscripteurs. Le prix est de douze francs. Ce serait vraiment bien triste si dans ma ville natale, dont je me fais gloire, dans une cité de cinquante à soixante mille âmes, il n’y avait pas cinquante ou soixante personnes sensées et équitables qui veuillent bien consacrer pendant trois mois environ, toutes les semaines, une heure de temps et en tout douze francs en argent pour le salut, le véritable salut temporel et éternel, corporel et spirituel de leurs enfants actuels ou futurs. Oui, ce serait en vérité bien triste!
»Auditor et altera pars. Il est impossible de pouvoir juger de ce que l’on n’a pas entendu et bien entendu soi-même. Il est interdit de prendre des notes au cours. Mais il sera permis de faire des questions par écrit. L’on paye en souscrivant. L’on souscrit à Strasbourg, chez EHRMANN, libraire, place de la Grande-Boucherie, nº 28.
OBERLIN fils.»
Waldbach, 1842.
![]() M. V. Hugo a un barbier—qui cause beaucoup;—entre autres sujets
de discours, il parle fréquemment de sa femme—et ne manque jamais de
dire: Mon épouse.
M. V. Hugo a un barbier—qui cause beaucoup;—entre autres sujets
de discours, il parle fréquemment de sa femme—et ne manque jamais de
dire: Mon épouse.
Un jour, M. V. Hugo, impatienté, lui dit: «Pourquoi donc appelez-vous toujours ainsi madame ***?—Comment voulez-vous donc que j’appelle ma femme?» répondit le barbier.
![]() Le même barbier fut fort effrayé lorsqu’il apprit, en 1839,—des
commères de son quartier que le monde allait finir.
Le même barbier fut fort effrayé lorsqu’il apprit, en 1839,—des
commères de son quartier que le monde allait finir.
Tout en rasant M. V. Hugo, il lui fit part de ses terreurs.
—Ah! mon Dieu! disait-il,—on assure que l’année prochaine le monde va finir.—Le deux janvier les bêtes mourront, et le quatre ce sera le tour des hommes.
—Vous m’effrayez, dit M. V. Hugo; qui donc alors me rasera le trois?
![]() Madame Louise Dauriat, qui a figuré en effigie dans les
Guêpes,—a eu la bonté de m’adresser d’avance une lettre—qu’elle se
propose de publier. Je crois pouvoir considérer cette déclaration
comme une permission tacite de citer quelques fragments de la lettre de
madame Dauriat. C’est d’ailleurs une justice, puisque madame Dauriat me
l’a écrite dans l’intention de rectifier ce que j’ai avancé sur elle.
Madame Louise Dauriat, qui a figuré en effigie dans les
Guêpes,—a eu la bonté de m’adresser d’avance une lettre—qu’elle se
propose de publier. Je crois pouvoir considérer cette déclaration
comme une permission tacite de citer quelques fragments de la lettre de
madame Dauriat. C’est d’ailleurs une justice, puisque madame Dauriat me
l’a écrite dans l’intention de rectifier ce que j’ai avancé sur elle.
FRAGMENTS D’UNE LETTRE DE MADAME LOUISE DAURIAT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ainsi, vous dites: «Madame Dauriat à neuf ans commence à fumer des cigares, à quarante ans se déclare contre un gouvernement sous lequel on n’est plus jeune; prêche publiquement la liberté de la femme, demande à être députée, laisse croître sa barbe.—Dieu protége la France.»
Eh bien! cette transformation en partie d’une femme en un homme, notamment quand il s’agit de cigares et de longues barbes, est tout l’opposé de mes principes: il faut mettre au rang de mes antipathies la fumée de tabac et les barbes longues et touffues, toujours fort sales, et donnant aux hommes une figure semblable à celle de la brute des forêts. On se fait la barbe comme on se coupe les ongles; cela est un indice de civilisation.
Je ne veux rien qui ne soit selon la nature et l’équité: j’ai donc raison de prêcher publiquement la liberté de la femme, que l’on n’a pas le droit de lui ôter.
Vous trouvez qu’une femme n’est plus jeune à quarante ans; on ne voit pas quel gouvernement la déclare vieille à cet âge, en aurait-elle même quarante-cinq. Quant à moi, je ne m’en cache pas, je suis en plein automne; et il est des automnes qui valent mieux que de certains étés. Et les femmes de cet âge sont plus jeunes que messieurs les hommes, comme les appelle un de mes amis, qui y sont arrivés. Ils sont la plupart tout gris, tout chauves; ils n’ont plus de dents qu’en petit nombre: leur démarche est pesante; et nous autres femmes, à cet âge, nous nous coiffons encore de notre chevelure; notre bouche est encore fraîche et meublée. Nous sommes vives, alertes, et toujours prêtes à nous donner bien du mal pour secourir, assister la race masculine, que la moindre maladie abat, qu’un rien déconcerte, anéantit. Qui osera nier cela? Il y a bien d’autres choses qu’il ne faut pas nier!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOUISE DAURIAT.
![]() Au commencement du mois de septembre a eu lieu, à la mer, une des
grandes marées de cette année.—La mer s’est retirée à un quart de lieue
de nos côtes, laissant à découvert des roches au-dessus desquelles il y
a d’ordinaire plus de trente pieds d’eau,—et montrant des prairies
d’herbes marines, d’algues et de varechs d’un vert sombre presque
noir,—et des mousses d’un beau rouge de pourpre,—les herbes et les
mousses aussi variées que celles que nous voyons sur la terre.
Au commencement du mois de septembre a eu lieu, à la mer, une des
grandes marées de cette année.—La mer s’est retirée à un quart de lieue
de nos côtes, laissant à découvert des roches au-dessus desquelles il y
a d’ordinaire plus de trente pieds d’eau,—et montrant des prairies
d’herbes marines, d’algues et de varechs d’un vert sombre presque
noir,—et des mousses d’un beau rouge de pourpre,—les herbes et les
mousses aussi variées que celles que nous voyons sur la terre.
Nous étions sur ces roches au moins une soixantaine de pêcheurs, occupés à chercher et à prendre quelques huîtres, quelques poissons négligents, et aussi, au risque de se faire vigoureusement pincer les doigts,—des étrilles,—sorte de crabes qui en diffèrent cependant par cette nuance—que les hommes mangent les étrilles, et que les crabes mangent les hommes.
Le soleil se couchait derrière de gros nuages qui semblaient se reposer sur la mer comme s’ils eussent été fatigués de leurs courses de la journée.—Les bords de ces nuages, plus minces que le centre,—étaient transparents—et semblaient une frange d’or, de pourpre et de feu.—Du soleil jusqu’à nos pieds,—un sillon de feu s’étendait sur la mer.
Je suspendis un peu la pêche pour contempler ces magnificences,—et je m’assis sur une roche;—je rétablis en pensée le niveau de la mer,—tel qu’il allait se refaire deux ou trois heures plus tard,—et je me figurai resté sur ces prairies, où reviendraient alors les gros poissons;—je me figurai les navires au-dessus de ma tête, sillonnant la mer en tous sens.
Nos yeux s’arrêtèrent par hasard sur quelque chose qui me parut être un fragment de roche d’une forme singulière; c’était la moitié d’une boule creuse.—Je l’examinai de plus près, et je reconnus la moitié d’une bombe,—une de ces gentillesses imaginées par les hommes pour s’entre-détruire avec le plus de facilité.
Il serait difficile de dire depuis combien de temps cette bombe est là, au fond de la mer.—Les Anglais en ont tiré un assez grand nombre sur le Havre du temps de l’Empire, avec l’intention de brûler les vaisseaux,—et ils n’ont réussi qu’à abattre quelques maisons.—On a dû leur en renvoyer quelques-unes.
J’examinai la bombe;—plusieurs sortes de petites plantes marines végétaient entre les fentes du fer;—une entre autres était rude, granuleuse,—rose,—et semblait au moins autant un très petit polype dans le genre du corail qu’une plante réelle.
Mais ce qui me frappa le plus,—ce fut de voir appliquée, contre la paroi intérieure de la bombe,—une huître,—une véritable huître,—parfaitement vivante,—qui y avait élu son domicile, qui y demeurait,—qui y bâillait,—qui s’y engraissait depuis longtemps.
Ce n’était pas la première fois que j’avais occasion de remarquer l’indifférence profonde de la nature à l’endroit de l’homme et de ses passions.
L’homme qui meurt,—et la feuille jaunie qui tombe ont précisément la même importance.—Dans la nature, la mort n’est pas une chose triste plus que la naissance;—c’est un des pas du cercle perpétuel que font les choses créées.—Tout meurt pour que tout vive:—la mort n’est que l’engrais de la vie.—Mais je fus cependant, cette fois, particulièrement surpris de ce que je voyais.
Certes, il n’est pas de la colère humaine une plus terrible expression qu’une bombe.—Cette horrible boîte dans laquelle l’homme renferme mille cruelles blessures et la mort,—qui vient à travers les airs,—et, arrivée à sa destination, s’ouvre et vomit la destruction.—Eh bien,—il a suffi de quelques années,—et ceux qui ont tué les autres ont été tués par le temps,—par la vie;—car la vie est le poison qui tue le plus inévitablement de tous quand il est pris à grandes doses.
Sur cet horrible instrument de destruction—ont poussé des herbes innocentes,—et une huître,—une sorte de caillou un peu vivant,—de toutes les choses vivantes, celle qui l’est le moins,—l’emblème du calme, de l’apathie,—y a fixé son domicile.
C’est une grande et belle ironie.
C’est une chose bizarre que de voir les inventions variées qu’ont eues les hommes pour s’entre-tuer.—C’est une dépense de génie que je trouve exorbitante pour des gens implacablement condamnés à mort par le fait de leur naissance.
La vie renferme le germe de la mort,—et la mort le germe de la vie,—comme la graine renferme une fleur, laquelle renferme une graine à son tour. C’est un cercle fatal et inévitable.
![]() Un crime a été commis il y a deux ans.—Deux accusés étaient, il y
a huit jours, sur les bancs de la cour d’assises.—Un des deux seul est
coupable;—il est condamné à mort par les juges.—L’autre est
acquitté;—mais, quand on va les chercher pour leur lire leur arrêt,
l’innocent est trouvé étendu par terre,—frappé subitement d’une attaque
d’apoplexie.—Le condamné vivra donc huit jours de plus que celui qui a
été acquitté.
Un crime a été commis il y a deux ans.—Deux accusés étaient, il y
a huit jours, sur les bancs de la cour d’assises.—Un des deux seul est
coupable;—il est condamné à mort par les juges.—L’autre est
acquitté;—mais, quand on va les chercher pour leur lire leur arrêt,
l’innocent est trouvé étendu par terre,—frappé subitement d’une attaque
d’apoplexie.—Le condamné vivra donc huit jours de plus que celui qui a
été acquitté.
Mais supposez qu’il en eût été autrement.—Attendez une cinquantaine d’années,—et l’innocent, les juges, les spectateurs, le bourreau, vous et moi,—nous serons précisément aussi morts que le condamné.—C’est ce qui frappe, quand on lit dans l’histoire le récit de quelque combat fameux.—Que d’adresse, que de sang-froid déployés pour tuer et ne pas être tué!—Ah! voici le combat fini,—en voilà un de tué; et l’autre, le vainqueur?—Oh! il est mort il y a cent ans.
On se plaint de la brièveté de la vie.—Mais prenez un mort illustre;—supposez que François Ier ait vécu trois cents ans:—quelle serait la différence aujourd’hui avec celui qui n’aurait vécu que jusqu’aux limites ordinaires?
![]() Mais à qui est-ce que je raconte cela? Il meurt sur la terre un
homme par seconde, c’est-à-dire trois mille par heure. La journée n’est
pas terminée, et depuis que j’écris ce volume quatre-vingt-six mille
quatre cents des hommes qui vivaient quand je l’ai commencé ne sont déjà
plus au monde.—Quand il sera imprimé,—quand vous l’aurez entre les
mains,—près de quatre cent mille de ceux auxquels je m’adressais en le
commençant auront cessé d’exister.
Mais à qui est-ce que je raconte cela? Il meurt sur la terre un
homme par seconde, c’est-à-dire trois mille par heure. La journée n’est
pas terminée, et depuis que j’écris ce volume quatre-vingt-six mille
quatre cents des hommes qui vivaient quand je l’ai commencé ne sont déjà
plus au monde.—Quand il sera imprimé,—quand vous l’aurez entre les
mains,—près de quatre cent mille de ceux auxquels je m’adressais en le
commençant auront cessé d’exister.
![]() OCTOBRE.—Voici l’hiver,—mes chers petits oiseaux d’or,—les
feuilles jaunes des poiriers, les feuilles rouges de la vigne s’en vont
au souffle du vent aigre d’octobre.—Voici les fleurs qui meurent de
froid.—Vous allez quitter la campagne et vos douces paresses;—vous
allez rentrer dans cette immense ruche, dans ce grand bourdonnement de
Paris.
OCTOBRE.—Voici l’hiver,—mes chers petits oiseaux d’or,—les
feuilles jaunes des poiriers, les feuilles rouges de la vigne s’en vont
au souffle du vent aigre d’octobre.—Voici les fleurs qui meurent de
froid.—Vous allez quitter la campagne et vos douces paresses;—vous
allez rentrer dans cette immense ruche, dans ce grand bourdonnement de
Paris.
On se plaint de vous,—mes petits soldats ailés;—rassemblez-vous autour de moi,—que je vous répète ces plaintes.—Allons, Padocke,—venez donc; que faites-vous dans cette austère violette sans parfum?—Et vous, Grimalkin, quittez ce chrysanthème qui sent la pommade:—abandonnez sans regrets ces tristes et dernières fleurs.
On se plaint de vous;—il ne s’agit pas ici des plaintes de vos ennemis:—je sais que vous vous en souciez médiocrement.
Mais ce sont, cette fois, vos amis qui se plaignent,—et cela mérite attention.—Il est bien de ne craindre personne,—excepté cependant ceux qui nous aiment et ceux que nous aimons.
On vous trouve assez peu disciplinées,—chères filles de l’air;—on croit que, tout en combattant les saugrenuités de ce temps,—vous avez cependant adopté sur l’indépendance certaines idées exagérées. Quand on a besoin de vous, on ne sait où vous êtes;—on vous attend à Paris,—et vous bourdonnez dans les fleurs jaunes des ajoncs de la Normandie,—ou dans les fleurs roses des bruyères de la Bretagne;—vous vous jouez dans l’écume de la mer,—ou vous vous endormez dans le fond du nénufar, ce beau lis des étangs.
Il n’en peut plus être ainsi;—il faut que je ramène la discipline parmi vous;—il faut qu’à l’heure où je sonne la retraite chacune de vous, sans tarder, arrive à tire-d’aile avec son butin.
Vous ne devez pas fâcher vos amis;—vos amis sont les gens qui aiment la vérité, le bon sens, la loyauté;—vos amis sont des gens qu’on doit respecter.—Vous devez arriver quand ils vous attendent—et ne pas leur manquer de parole,—comme vous le faites si souvent.
Vous arrivez encore ce mois-ci,—je ne sais comment,—je ne sais quand,—je ne sais d’où.—C’est pour la dernière fois, mes petits archers,—que je tolère de semblables incartades.
![]() Le roi Louis-Philippe, qui, lorsqu’il invite M. de Lamartine à
dîner comme député,—feint d’ignorer que M. de Lamartine fait des
vers,—ignore également l’existence de M. Scribe.
Le roi Louis-Philippe, qui, lorsqu’il invite M. de Lamartine à
dîner comme député,—feint d’ignorer que M. de Lamartine fait des
vers,—ignore également l’existence de M. Scribe.
Il est difficile de s’expliquer de semblables faiblesses de la part d’un homme aussi habile que le roi.—Un gouvernement fort,—je dirai plus, un gouvernement réel,—se compose ou doit se composer—de toutes les supériorités, de toutes les puissances, de toutes les influences du pays.—De semblables maladresses mettent sinon dans l’opposition, du moins dans l’indifférence, beaucoup de gens qui par leur talent exercent une influence extrêmement grande sur les esprits.
Charles IX, qui n’était pas un roi constitutionnel, me semble avoir mieux compris les choses de ce genre.—On connaît les vers qu’il adresse à Ronsard:
Autrefois,—quand le roi de France faisait la guerre,—il appelait à lui ses barons.
Chaque baron arrivait avec ses vassaux marchant sous son étendard et avec son cri de guerre.
Il y a une guerre incessante aujourd’hui qu’a à soutenir le roi de France:—c’est une guerre contre les idées.
![]() Ce ne sont plus des barons couverts de fer et armés de lances et de
haches d’armes—que le roi doit appeler autour de lui,—ce sont d’autres
barons et d’autres suzerains,—ce sont tous les hommes qui, par leur
talent, ont trouvé moyen de rassembler sous leur drapeau,—quelque petit
qu’il soit,—ne fût-ce qu’un simple guidon,—un certain nombre de gens.
Ce ne sont plus des barons couverts de fer et armés de lances et de
haches d’armes—que le roi doit appeler autour de lui,—ce sont d’autres
barons et d’autres suzerains,—ce sont tous les hommes qui, par leur
talent, ont trouvé moyen de rassembler sous leur drapeau,—quelque petit
qu’il soit,—ne fût-ce qu’un simple guidon,—un certain nombre de gens.
Mais,—je l’ai déjà dit,—ce n’est pas par la corruption qu’il faut les avoir;—la corruption tue à la fois l’homme, le talent et l’influence.—Il faut les avoir pour associés et non pour domestiques.
![]() Il faut avoir plusieurs cordes à son arc.
Il faut avoir plusieurs cordes à son arc.
M. Duchâtel,—ministre de l’intérieur,—vient de joindre à cette industrie celle de marchand de vins.
Il a acheté,—moyennant huit cent mille francs,—un vignoble appelé Lagrange.—Cette propriété, située du côté de Médoc,—tire de ce voisinage des prétentions peu justifiées par un vin de cinquième cru.
![]() Nous avons parlé récemment des divers cris que font entendre dans
les journaux les maîtres de pension, à l’instar de ceux que font
entendre dans les rues les marchands de salade et les marchands de
cages, pour annoncer leurs marchandises.
Nous avons parlé récemment des divers cris que font entendre dans
les journaux les maîtres de pension, à l’instar de ceux que font
entendre dans les rues les marchands de salade et les marchands de
cages, pour annoncer leurs marchandises.
En voici un qui mérite, entre tous, une mention honorable.
On trouve à la quatrième page de la plupart des carrés de papier,—se disant les organes de l’opinion publique, l’annonce que voici (un franc vingt-cinq centimes la ligne en nonpareille,—un franc cinquante centimes en mignonne):
«L’institution J. Dillon, faubourg Poissonnière, 105, a fait sa rentrée le 1er octobre.—Le directeur de cet établissement, jaloux de mériter de plus en plus la confiance publique,—s’est entouré d’hommes spéciaux.»
Voyons un peu,—monsieur J. Dillon,—je ne veux rien vous dire de désagréable,—mais il ressort de vos propres paroles une chose incontestable.
Vous vous êtes entouré d’hommes spéciaux pour mériter de plus en plus la confiance publique.
C’est-à-dire que vous aviez déjà obtenu cette confiance avant de vous être entouré d’hommes spéciaux.
C’est-à-dire que, l’année dernière, vous n’aviez pas, pour instruire vos élèves, songé à vous entourer d’hommes spéciaux.
C’est-à-dire que, pendant les vacances,—vous vous êtes dit: «Tiens! une idée. Je vais m’entourer d’hommes spéciaux;—c’est-à-dire—j’aurai, pour montrer les mathématiques, un mathématicien,—un latiniste pour enseigner le latin.»
C’est-à-dire que, l’année dernière,—vous aviez peut-être pour professeur de latin—un marchand de briquets phosphoriques;
Pour maître de dessin, un frotteur;
Pour maître de musique, un ébéniste;
Pour professeur d’histoire, un coiffeur.
Réellement,—monsieur J. Dillon,—vous avez eu là une excellente idée;—il est malheureux qu’elle ne vous soit pas venue plus tôt.
Nous avons signalé déjà—une variété d’indépendance politique extrêmement curieuse.
Un certain carré de papier aime une danseuse maigre;—de temps à autre, il faut faire rengager ladite danseuse.
La chose ne se fait pas toute seule.—M. le directeur du théâtre—ni le public ne s’en souvient;—il faut que le gouvernement intervienne:—voici comment s’exécute le tour.
Lorsque l’engagement précédemment obtenu est sur sa fin,—ledit carré de papier fronce le sourcil—et devient très-rigide, il s’aperçoit que le ministère trahit la France; il découvre que le gouvernement nous avilit aux yeux de l’étranger;—le pays penche vers sa ruine.—Toutes nos libertés sont audacieusement attaquées;—les courtisans envahissent le pouvoir et boivent la sueur du peuple;—on a oublié les promesses de Juillet et le programme,—le fameux programme de l’Hôtel de Ville, etc.—Tout cela ne suffirait peut-être pas; on ajoute quelques attaques contre tel ami ou telle amie de tel ministre.—L’ami a reçu un pot-de-vin:—l’amie a trois fausses dents.
L’ami ou l’amie vient se plaindre au ministre, et lui dit, sous forme de conseil, que le carré de papier fait un grand tort au gouvernement;—qu’il faut l’apaiser, etc.
On entame les conférences.—Le carré de papier est d’une férocité croissante;—il ne peut rien accorder.—On insiste; il laisse échapper—que, dans l’intérêt de l’art, on devrait rengager mademoiselle Trois-Étoiles.
On fait chercher le directeur,—on le force de rengager ladite demoiselle.
Or, l’écrivain recommandable—qui protége ainsi les arts n’a dans le carré de papier en question qu’une portion d’influence. On lui permet bien de vendre le journal,—mais on ne lui permet pas de le livrer.—Or, comme le bruit du rengagement de la danseuse peut transpirer, comme la malveillance en pourrait tirer de fâcheuses inductions relativement à l’indépendance de la feuille,—cette indépendance doit se manifester et se manifeste par l’injure à l’endroit du gouvernement.
La dernière fois que ce tour a été exécuté,—la danseuse a été rengagée pour quinze ans;—le lendemain, on citait dans le carré de papier, comme proverbiale, la stupidité de M. de Gasparin.
![]() STATISTIQUE.—D’après le docteur Julius, qui s’est livré à un
volumineux travail sur les aveugles et les établissements qui leur sont
destinés, on compte:
STATISTIQUE.—D’après le docteur Julius, qui s’est livré à un
volumineux travail sur les aveugles et les établissements qui leur sont
destinés, on compte:
| En Prusse, | 1 | aveugle sur | 1,600 | habitants. |
| En France, | 1 | 1,650 | ||
| En Belgique, | 1 | 1,009 | ||
| En Danemark, | 1 | 738 | ||
| En Angleterre, | 1 | 800 | ||
| En Autriche, | 1 | 800 | ||
| Aux États-Unis, | 1 | 1,200 |
D’après beaucoup de choses qui se passent, on ne devinerait pas que la France est le pays d’Europe où il y a le moins d’aveugles.
![]() Plusieurs journaux reprochent amèrement à M. Duchâtel le refus
qu’il a fait de donner à M. Rubini, chanteur, la croix d’honneur qu’il
demandait pour reparaître au Théâtre-Italien.—Comme on parlait de ce
refus devant M. de Rémusat, on vint à lui demander si, à la place de M.
de Duchâtel, il eût agi comme lui. «Non, répondit M. de
Rémusat,—j’aurais fait tout le contraire; j’aurais donné deux croix à
M. Rubini, en exigeant qu’il les portât toujours toutes deux, l’une à
gauche, l’autre à droite de la poitrine.»
Plusieurs journaux reprochent amèrement à M. Duchâtel le refus
qu’il a fait de donner à M. Rubini, chanteur, la croix d’honneur qu’il
demandait pour reparaître au Théâtre-Italien.—Comme on parlait de ce
refus devant M. de Rémusat, on vint à lui demander si, à la place de M.
de Duchâtel, il eût agi comme lui. «Non, répondit M. de
Rémusat,—j’aurais fait tout le contraire; j’aurais donné deux croix à
M. Rubini, en exigeant qu’il les portât toujours toutes deux, l’une à
gauche, l’autre à droite de la poitrine.»
![]() Quelques-uns des plus gros traitements du ministère des
finances—sont industriellement gonflés par des indemnités,—des
gratifications,—des faux frais,—des suppléments pour pertes et
erreurs, etc., etc.
Quelques-uns des plus gros traitements du ministère des
finances—sont industriellement gonflés par des indemnités,—des
gratifications,—des faux frais,—des suppléments pour pertes et
erreurs, etc., etc.
Ainsi, on assure que le caissier central du Trésor—reçoit une indemnité de quarante mille francs pour couvrir les erreurs que peuvent commettre les garçons de caisse chargés des payements et des recettes.
Les garçons, en effet, se trompent quelquefois (le cas est cependant extrêmement rare).—Toutefois, le cas échéant, M. le caissier fait appeler le garçon en défaut, le prévient qu’il s’est trompé, que son erreur est de... tout,—et que, par conséquent, cette somme lui sera retenue sur ses appointements; et ceci n’est pas une menace, la retenue s’effectue réellement; et, au bout de l’année, M. le caissier a touché quatorze mille francs en sus de son traitement.
Si je commets une erreur, je prie M. le caissier de m’en avertir, avec preuves à l’appui.
![]() De ce temps-ci, toutes les professions sont encombrées,—même la
profession de Dieu. Les Guêpes en ont déjà signalé
quelques-unes.—Voici venir un homme plus modeste—qui se contente
d’être prophète.—On ne saurait trop louer une semblable abnégation.
De ce temps-ci, toutes les professions sont encombrées,—même la
profession de Dieu. Les Guêpes en ont déjà signalé
quelques-unes.—Voici venir un homme plus modeste—qui se contente
d’être prophète.—On ne saurait trop louer une semblable abnégation.
Cet homme s’appelle M. Cheneau ou Chaînon, lui-même paraît incertain sur le meilleur de ces deux noms;—il les offre tous deux à la vénération publique. On est libre de l’invoquer sous les deux noms; chacun là-dessus peut s’en rapporter à son goût. Il est prophète et négociant. Il publie en ce moment la Troisième et dernière alliance du ciel avec sa créature (4 vol. grand in-8º). Ainsi, pour la troisième et dernière fois, le ciel ne le répétera plus:—Voulez-vous, oui ou non, vous allier avec lui?
«J’ai reçu, dit M. Cheneau ou Chaînon,—j’ai reçu du ciel le pouvoir d’édifier la vérité; le Seigneur m’a dit: «Établis le baptême spirituel, enseigne la religion d’amour, que je t’ai révélée pour former mon alliance éternelle avec mes enfants; accomplis ta mission; heureux celui qui la gravera dans son cœur.»
Gravons dans notre cœur la mission de M. Chaînon ou Cheneau,—sans nous arrêter au langage peu correct du ciel.
M. Chaînon ou Cheneau—a deux amis qui le visitent—familièrement: l’empereur Napoléon, qui lui a encore fait visite, dit-il, en janvier 1841 (page 295), et saint Jean-Baptiste qu’il appelle «son ami sincère.»
M. Chaînon ou Cheneau—raconte ensuite que c’est à Lyon, en février 1838,—à l’Hôtel du Nord,—chambre 32,—de six heures et demie du soir jusqu’à six heures trois quarts du matin qu’il a combattu et vaincu toute l’armée infernale et Satan lui-même.
«J’ai promis,—dit-il à l’Éternel, de désarmer tous ceux qui combattent contre la vérité;—l’on attentera à mes jours, et une somme sera offerte pour me faire détruire, mais tous leurs projets seront détruits,—et le serpent viendra m’offrir lui-même sa langue pour que je l’arrache.»
Nous n’analysons pas la nouvelle religion proposée par M. Cheneau ou Chaînon,—attendu que nous n’y comprenons rien,—ni lui non plus; nous ne reproduirons que quelques conseils donnés aux femmes, et qui pourront paraître à nos lectrices de quelque utilité.
CONSEILS AUX FEMMES. «Sachez vous servir des faveurs que le ciel vous a confiées, vous rendrez doux et aimable l’homme méchant et irraisonnable.
»Observez si votre époux est travailleur, courageux, préparez-lui quelques agréables distractions et contrariez-le un jour sur vingt, afin que son cœur ne devienne point insensible à vos intentions.
»Prodiguez-lui les moyens de consolation qui vous sont spécialement confiés par le Créateur.
»Je répandrai de mon esprit sur toutes sortes de personnes.»
Gare de dessous!
On lit dans un gros livre de M. A. Pépin que l’auteur de Lélia porte sur son cœur des cheveux d’un des assassins de Louis-Philippe. Le livre de M. A. Pépin, qui est fait, du reste, avec courage, a été peu lu.—Sans doute madame Sand ignore ce passage qui la concerne.
![]() Je n’ai pas voulu m’en rapporter, à propos des essais de pavage en
bois,—aux réclames des journaux, à un franc la ligne,—j’ai consulté
cinq ou six cochers de cabriolets, qui m’ont affirmé que par un temps de
pluie, il est impossible aux chevaux de tenir pied sur ce nouveau pavé.
Je n’ai pas voulu m’en rapporter, à propos des essais de pavage en
bois,—aux réclames des journaux, à un franc la ligne,—j’ai consulté
cinq ou six cochers de cabriolets, qui m’ont affirmé que par un temps de
pluie, il est impossible aux chevaux de tenir pied sur ce nouveau pavé.
![]() Voici un mot que je ne raconte qu’à cause de son authenticité:
Voici un mot que je ne raconte qu’à cause de son authenticité:
Au sujet d’une nouvelle fournée de pairs,—qui va, assure-t-on, se faire prochainement,—beaucoup de candidats se remuent outre mesure. On cite entre autres le maire d’un des plus nombreux arrondissements de Paris,—ancien député conservateur, tristement repoussé aux dernières élections. Comme il causait avec M. Sauzet sur ses bonnes et ses mauvaises chances:
—Hélas! mon cher monsieur, reprit le président, comment voulez-vous qu’on vous fasse pair?—La chose, quant à moi, me semble tout à fait impossible.
—Comment cela? impossible! et pourquoi?
—Parce que, répondit le facétieux M. Sauzet, vous ne pouvez pas être à la fois pair et maire.
M. de Rambuteau, qui se trouvait là,—c’est chez lui que la conversation avait lieu,—réfléchit un instant, et dit: «Au fait, c’est vrai.»
![]() PARENTHÈSE RELATIVEMENT AU TIMBRE.—(Il y a d’honnêtes gens qui
ont imaginé d’acheter des numéros des Guêpes,—d’arracher la page sur
laquelle est le timbre,—et d’envoyer à la direction ces exemplaires
ainsi mutilés.
PARENTHÈSE RELATIVEMENT AU TIMBRE.—(Il y a d’honnêtes gens qui
ont imaginé d’acheter des numéros des Guêpes,—d’arracher la page sur
laquelle est le timbre,—et d’envoyer à la direction ces exemplaires
ainsi mutilés.
La direction n’est pas fâchée de prendre les Guêpes en défaut,—et dresse un procès-verbal,—pour absence de timbre.
On a prouvé à la direction du timbre,—par les reçus du timbre, par les livres de l’imprimeur, par les livres de l’éditeur, par ceux du marchand de papier,—qu’il n’a jamais, à aucune époque, été imprimé un exemplaire de plus qu’il n’y a eu de feuilles timbrées.
La direction a maintenu son procès-verbal,—on a appelé de ce jugement au ministre;—le ministre a confirmé.
Les Guêpes viennent encore une fois d’être condamnées à une amende assez forte au profit du Trésor.
L’auteur des Guêpes ne croyait pas devoir se soumettre au timbre, il a plaidé il y a deux ans contre l’administration,—et a perdu son procès. Il s’est contenté de protester contre la sotte obstination de l’administration, qui veut absolument mettre sur de petits livres—une tache d’encre égale, en grosseur,—au timbre qu’on met sur les cabriolets,—tandis qu’un poinçon, quelque petit qu’il fût, atteindrait parfaitement le but.
Mais—en même temps il a formellement interdit à son éditeur—d’essayer contre l’administration aucune de ces fraudes que font presque tous les journaux.
L’auteur des Guêpes a agi loyalement;—il ne pense pas que ni l’administration ni le ministre aient suivi son exemple—en maintenant des amendes—contre les preuves sans réplique qui leur étaient fournies;—l’administration du timbre—a plusieurs fois fait demander à l’auteur des Guêpes—la suppression de la petite phrase qui accompagne depuis deux ans la sale tache d’encre qu’elle a imposée à ses petits livres;—l’administration a cru devoir lui fournir une occasion de la remplacer—par la dénonciation de ses petites persécutions.)
![]() De 1791 à 1794, il y a eu en France les aristocrates, les
monarchiens, les constitutionnels, les républicains, les démocrates, les
hommes du 14 juillet, les fayettistes, les orléanistes, les cordeliers,
les jacobins, les feuillants, les maratistes, les chevaliers du
poignard, les septembriseurs, les égorgeurs, les girondins, les
brissotins, les fédéralistes, les modérés, les suspects, les hommes
d’État, les membres de la plaine, les crapauds du Marais, les
montagnards, les accapareurs, les alarmistes, les apitoyeurs, les
endormeurs, les dantonistes, les hébertistes, les sans-culottes, les
habitants de la Crète, les terroristes, les patriotes de 89, les
thermidoriens, une jeunesse dorée, etc., etc.
De 1791 à 1794, il y a eu en France les aristocrates, les
monarchiens, les constitutionnels, les républicains, les démocrates, les
hommes du 14 juillet, les fayettistes, les orléanistes, les cordeliers,
les jacobins, les feuillants, les maratistes, les chevaliers du
poignard, les septembriseurs, les égorgeurs, les girondins, les
brissotins, les fédéralistes, les modérés, les suspects, les hommes
d’État, les membres de la plaine, les crapauds du Marais, les
montagnards, les accapareurs, les alarmistes, les apitoyeurs, les
endormeurs, les dantonistes, les hébertistes, les sans-culottes, les
habitants de la Crète, les terroristes, les patriotes de 89, les
thermidoriens, une jeunesse dorée, etc., etc.
Sous l’Empire, les bourbonistes, les émigrés, les jacobins, les idéologues, les hommes de 89, les nopoléonistes, les fédérés, etc.
Sous la Restauration nous avons eu les bonapartistes, les royalistes, les libéraux, les blancs et les bleus, un côté gauche, un côté droit, un centre gauche, un centre droit, les ventrus, les absolutistes, les ultra, les révolutionnaires, le parti de la défection, les constitutionnels, les carbonari, la société Aide-toi, le Ciel t’aidera, etc., etc.
Depuis la Révolution de juillet, nous avons eu des carlistes, des légitimistes, des philippistes, des henriquinquistes, des impérialistes, des hommes du mouvement, des hommes de la résistance, le parti de l’avenir, des républicains de 93, des républicains à l’américaine, des saint-simoniens, des fouriéristes, des phalanstériens, des humanitaires, des bousingots, des radicaux, des patriotes, des hommes du progrès, des juste-milieu, des modérés, des politiques, des doctrinaires, des amis de l’ordre, des hommes du tiers-parti, un côté gauche, un côté droit, un centre droit, un centre gauche, des monarchistes, des amis du peuple, des anarchistes, des réformistes, des jeunes-France, la société des Droits de l’Homme, la société des Familles, des réactionnaires, les conservateurs, le parti social, etc., etc.
![]() Beaucoup de gens font semblant de prendre les Guêpes pour une
facétie sans but.
Beaucoup de gens font semblant de prendre les Guêpes pour une
facétie sans but.
Voici un grand journal—qui imprimait avant-hier quelques lignes dans lesquelles il demande que l’impôt pèse sur les objets de luxe et cesse d’augmenter le prix des objets de première nécessité.
Il y a trois ans que les Guêpes ont, pour la première fois, émis le même vœu.
Ce journal est un de ceux qui appelaient si plaisamment l’auteur des Guêpes—ami du château, et qui s’intitulent eux-mêmes, mais plus plaisamment, amis du peuple.
![]() Il vient de mourir à Paris un homme d’un grand talent;—le public,
après avoir suffisamment cuvé son admiration frénétique pour Paganini,
en était revenu à dire: «Eh bien, j’aime mieux le violon de
Baillot.»—Baillot est mort à soixante-onze ans. En 1821, Baillot avait
été nommé premier violon solo à l’Académie royale de musique; dix ans
après, quand l’Opéra devint une spéculation particulière,—Baillot parut
un luxe trop cher;—depuis cette époque on ne l’entendit plus que
rarement,—et depuis plus d’une année il avait cessé de toucher à son
violon.
Il vient de mourir à Paris un homme d’un grand talent;—le public,
après avoir suffisamment cuvé son admiration frénétique pour Paganini,
en était revenu à dire: «Eh bien, j’aime mieux le violon de
Baillot.»—Baillot est mort à soixante-onze ans. En 1821, Baillot avait
été nommé premier violon solo à l’Académie royale de musique; dix ans
après, quand l’Opéra devint une spéculation particulière,—Baillot parut
un luxe trop cher;—depuis cette époque on ne l’entendit plus que
rarement,—et depuis plus d’une année il avait cessé de toucher à son
violon.
Tout le monde connaissait son talent, mais voici une petite anecdote—qui montre mieux que du talent,—qui montre du désintéressement et de la noblesse.
Baillot avait une pension sur la liste civile de Charles X,—après 1830,—on avisa par toutes sortes de moyens à soulager ces pauvres pensionnaires ruinés.—Un jour Baillot reçut une lettre des commissaires de l’ancienne liste civile, qui l’invitaient à venir toucher une partie de sa pension.—Baillot se présente et demande si tout le monde est payé.
—Tant s’en faut, lui répond-on,—nous donnons seulement quelques à-compte.
—Oh! alors,—répond noblement l’artiste,—le grand artiste,—ne me donnez rien, les autres ont plus besoin que moi.
—Mais, monsieur Baillot,—vous n’êtes pas riche.
—C’est égal, je travaille et je gagne de l’argent.
![]() On lit dans les journaux:
On lit dans les journaux:
«M. le ministre de l’intérieur, ayant appris que feu Baillot laisse une veuve et une fille sans autres ressources qu’une pension de huit cents francs, vient d’ACCORDER—une indemnité annuelle de douze cents francs à madame veuve Baillot.»
Je ne parlerai pas de cette indemnité annuelle qui n’est pas même une pension—et qui s’élève majestueusement à la somme de douze cents francs pour la veuve—d’un des plus grands artistes de ce temps-ci.
Le gouvernement est pauvre,—il faut faire des engagements de quinze ans et de quinze mille francs par an à des danseuses maigres—pour se concilier la bienveillance douteuse d’écrivains sans talent qui les protégent.
Mais il aurait été plus décent, sans que cela coûtât un sou de plus—de faire mettre dans les journaux: «Monsieur le ministre de l’intérieur vient de prier madame veuve Baillot d’accepter une pension de douze cents francs.»
![]() Un célèbre vaudevilliste vient de se marier—presque à la même
époque que J. Janin, le fléau des vaudevilles;—tous deux ont fini comme
tous les vaudevilles que l’un a faits, que l’autre a critiqués.
Un célèbre vaudevilliste vient de se marier—presque à la même
époque que J. Janin, le fléau des vaudevilles;—tous deux ont fini comme
tous les vaudevilles que l’un a faits, que l’autre a critiqués.
On a beaucoup parlé de ce mariage;—j’ai recueilli deux versions différentes.
Voici la première:
M. ***, il y a sept ou huit ans, rencontra chez son notaire une jeune dame dont la figure et les manières l’intéressaient:—il demande qui elle est.
—C’est la femme d’un négociant en vins, son mari est embarrassé,—elle cherche de l’argent.
—Serait-ce un placement sûr?
—Oui, sans doute.
—J’ai des capitaux disponibles; je prête l’argent.
De temps en temps, M. *** s’informait de la dame;—un jour il apprend qu’elle est veuve.—Cette fois ce n’est plus de l’argent, mais sa personne, son cœur et sa fortune, qu’il fait offrir,—il est accepté,—et les rideaux tombent.
![]() Voici la seconde version:
Voici la seconde version:
M. *** aimait les femmes.—Que diable aimerait-on?—il en aimait plusieurs,—je ne m’aviserai pas de le défendre sur ce point.—Un jour après dîner, il va voir une de ces dames. «Ah! vous êtes le bienvenu, vous allez me mener voir les Pilules du Diable.—Volontiers.»
Le lendemain, il était chez une autre.
—Je vous attendais, j’ai fait retenir une loge, nous allons au spectacle.
—Ah!—et où?
—Franconi.
—Les Pilules du Diable.
—Diable!
—Pourquoi?
M. *** comprend qu’il faut s’exécuter; s’il dit qu’il a vu la veille les maudites pilules,—on lui demandera avec qui.
—Seul.
—Vous pouviez bien venir me chercher.
Il se contente de dire: «Je vous accompagnerai avec plaisir.»
Le lendemain, troisième dame,—troisième invitation.
—J’aurais bien voulu vous voir hier.
—Vous êtes trop bonne.
—Oh! c’était intéressé:—j’avais besoin de vous.
—Il m’a été impossible de venir, j’ai travaillé toute la soirée.
—C’est égal,—aujourd’hui est aussi bon; je veux aller voir les Pilules du Diable.
M. *** frémit.—Mais il vient de dire qu’il a passé la soirée à travailler, il ne peut plus dire qu’il était aux Pilules,—et d’ailleurs,—avec qui?
Il s’ennuya tellement,—qu’il passa la nuit à énumérer tous les inconvénients de la vie qu’il menait,—il vit qu’il y avait dans la vie de garçon et d’homme à bonnes fortunes par trop de choses à faire trois fois;—un mois après il était marié.
![]() M. Gannal a de nouveau paru sur la place, et je crois être agréable
à la fois au public et à lui—en contribuant, pour ma part, à donner la
publicité à une brochure qu’il vient de mettre au jour.
M. Gannal a de nouveau paru sur la place, et je crois être agréable
à la fois au public et à lui—en contribuant, pour ma part, à donner la
publicité à une brochure qu’il vient de mettre au jour.
M. Gannal commence par dire pourquoi il prend la parole.
C’est parce que tant de personnes sont étonnées qu’il n’ait pas embaumé le prince royal,—qu’il croit devoir leur expliquer le mauvais vouloir qui lui a ôté à lui, M. Gannal, cette consolation.
![]() M. Gannal en est d’autant plus affligé, qu’il savait à part
lui—que le prince royal désirait vivement être embaumé par lui.
M. Gannal en est d’autant plus affligé, qu’il savait à part
lui—que le prince royal désirait vivement être embaumé par lui.
Consolation est une expression toute nouvelle, appliquée à l’industrie, et qui ne pouvait manquer de faire fortune.
Les marchands fashionables disent déjà, à l’imitation de M. Gannal: «Permettez, monsieur, que j’aie la consolation de vous vendre cette paire de bas.»
«Ne me refusez pas la consolation de vous vendre ce briquet phosphorique.»
«Madame, je ne puis céder ce châle au prix que vous m’en offrez, je renoncerais plutôt à la consolation de vous le vendre.»
Il faut dire que M. Gannal et M. le docteur Pasquier, chirurgien du duc d’Orléans, s’étaient rencontrés lorsque M. Gannal a embaumé le maréchal Moncey.
C’est ce qui fait le sujet de la lettre ou plutôt des lettres adressées à M. le docteur Pasquier par M. Gannal,—doctores ambo.
Remarquons en passant—une tendance de notre époque qui ne peut tarder à diminuer singulièrement les revenus de la poste aux lettres.—Autrefois quand on avait une communication à faire à quelqu’un qui se trouvait éloigné,—on lui écrivait une petite lettre que l’on pliait proprement,—on l’enfermait dans une enveloppe,—on la cachetait,—on mettait dessus le nom et l’adresse de la personne à laquelle on avait à faire,—et on jetait le tout à la boîte d’un bureau de poste.
Il n’en est plus ainsi aujourd’hui:—on fait imprimer sa lettre à mille exemplaires,—on la répand dans Paris et la province,—on la fait annoncer dans les journaux,—et un jour ou un autre celui auquel la lettre est adressée—rencontre un de ses amis qui lui dit:
—Eh bien! M. un tel vous a écrit?
—Ah!
—Oui, j’ai lu la lettre hier au café.
Où s’arrêtera ce besoin de notre époque de tout faire ainsi en public?
![]() Nous allons maintenant citer des fragments de la lettre de M.
Gannal;—nous mettrons entre parenthèses les quelques petites
observations qui nous paraîtront indispensables pour éclaircir le texte.
Nous allons maintenant citer des fragments de la lettre de M.
Gannal;—nous mettrons entre parenthèses les quelques petites
observations qui nous paraîtront indispensables pour éclaircir le texte.
«Monsieur,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»J’eus l’honneur d’accepter a proposition faite par vous d’une expérience solennelle.
»J’attendais avec patience les circonstances favorables. (C’est-à-dire la mort d’un grand personnage. La pensée est un peu féroce, monsieur Gannal.)
»Je croyais que le temps et l’occasion seuls avaient manqué; mais la décision prise au sujet des restes du prince royal, indépendamment des sentiments douloureux que sa perte m’inspire, comme à tout le monde,—m’a amené à penser très-sérieusement que sa volonté exprimée dès longtemps ne peut avoir dicté la décision prise; J’AI LA PREUVE CONTRAIRE ENTRE LES MAINS.»
![]() (Voici donc arrivée une de ces circonstances favorables que M.
Gannal attendait avec patience.—Le duc d’Orléans meurt,—M. Gannal
s’en afflige comme tout le monde, mais il espère avoir la
consolation de l’embaumer. M Gannal n’est pas comme cette mère éperdue
qui ne veut pas être consolée:—noluit consolari;—ce qu’il demande,
au contraire, c’est d’être consolé.
(Voici donc arrivée une de ces circonstances favorables que M.
Gannal attendait avec patience.—Le duc d’Orléans meurt,—M. Gannal
s’en afflige comme tout le monde, mais il espère avoir la
consolation de l’embaumer. M Gannal n’est pas comme cette mère éperdue
qui ne veut pas être consolée:—noluit consolari;—ce qu’il demande,
au contraire, c’est d’être consolé.
On ne prend aucun souci de consoler M. Gannal,—on ne le charge pas de l’embaumement du prince.—M. Gannal fait entendre ses gémissements,—il donne à penser que le prince royal lui avait promis de se faire embaumer par lui.
M. Gannal avait déjà demandé la consolation d’embaumer l’empereur Napoléon.—Il lui a été refusé également d’enregistrer cette consolation sur ses livres en partie double. M. Gannal alors jette son gant dans l’arène,—il adresse à M. Pasquier un superbe défi.)
»Pour arriver à un résultat comparatif et certain, voici comment je pense que devront être faites les expériences, en présence de MM. Ribes, Cornac et Gimelle, que je choisis pour mes juges, et trois autres docteurs que vous choisirez à votre volonté.
»Je ferai un embaumement sans autopsie, et un second embaumement après une autopsie, en tout semblable à celle pratiquée sur le corps de M. le maréchal Moncey. Vous, monsieur le docteur, vous pratiquerez un embaumement en tout point semblable à celui que vous venez de faire pour le corps du malheureux prince dont toute la France déplore la perte. Je m’en rapporte entièrement à votre bonne foi sur l’identité des deux opérations.
»Les trois corps ainsi embaumés et déposés dans trois cercueils seront mis sous la surveillance de M. l’intendant des Invalides, et la clef de la pièce où ils seront placés sera confiée à la garde de M. le lieutenant général baron Petit; tous les mois les commissaires voudront bien vérifier les corps et constater l’état de leur conservation.
GANNAL, rue de Seine.»
![]() (Cette fois on n’attendra pas une occasion favorable.—On prendra
trois corps—au jour dit;—où les prendra-t-on?—c’est peu
important.—M. Gannal ne s’arrête pas à ces menus détails; il nomme de
son autorité privée le gouverneur des Invalides et M. le général Petit à
d’étranges fonctions.—Il se réserve également de désigner les sujets à
embaumer, et j’aime à croire que son choix tombera sur des
morts.—Remarquons la petite phrase chevillée de mauvaise grâce, dont
toute la France déplore la perte.—Il est évident que M. Gannal
déplore cette perte comme tout le monde, ainsi qu’il nous l’a déjà
dit,—mais qu’il déplore bien plus encore la perte de
l’embaumement,—et cela non plus comme tout le monde,—mais d’une façon
tout à fait spéciale,—puisque c’était la seule consolation qu’il pût
recevoir.—Qu’arrive-t-il, cependant? M. Pasquier ne vient pas sur le
terrain,—et M. Gannal lui écrit une autre lettre.—Passons à l’autre
lettre.)
(Cette fois on n’attendra pas une occasion favorable.—On prendra
trois corps—au jour dit;—où les prendra-t-on?—c’est peu
important.—M. Gannal ne s’arrête pas à ces menus détails; il nomme de
son autorité privée le gouverneur des Invalides et M. le général Petit à
d’étranges fonctions.—Il se réserve également de désigner les sujets à
embaumer, et j’aime à croire que son choix tombera sur des
morts.—Remarquons la petite phrase chevillée de mauvaise grâce, dont
toute la France déplore la perte.—Il est évident que M. Gannal
déplore cette perte comme tout le monde, ainsi qu’il nous l’a déjà
dit,—mais qu’il déplore bien plus encore la perte de
l’embaumement,—et cela non plus comme tout le monde,—mais d’une façon
tout à fait spéciale,—puisque c’était la seule consolation qu’il pût
recevoir.—Qu’arrive-t-il, cependant? M. Pasquier ne vient pas sur le
terrain,—et M. Gannal lui écrit une autre lettre.—Passons à l’autre
lettre.)
![]() Le commencement de la lettre est d’un style virulent,—c’est
pourquoi nous ne le transcrirons pas ici;—on connaît les aménités des
savants.—Molière nous en a donné un type indélébile dans Trissotin et
Vadius.
Le commencement de la lettre est d’un style virulent,—c’est
pourquoi nous ne le transcrirons pas ici;—on connaît les aménités des
savants.—Molière nous en a donné un type indélébile dans Trissotin et
Vadius.
«Vous m’appelez charlatan,—dit M. Gannal,—eh bien! vous en êtes un autre.»
(M. Gannal passe ensuite à l’examen de sa vie entière, il cite ses travaux.)
«J’ai perfectionné la fabrication de la colle.
«J’ai fait un travail sur la conservation des viandes alimentaires.»
(Les Guêpes se sont déjà expliquées et sur l’embaumement en général, et en particulier sur l’embaumement des côtelettes de mouton—et les momifications des gigots entamés;—elles ont surtout insisté sur le danger d’une conclusion fâcheuse.—Si on se met ainsi à tout embaumer et à tout conserver,—il deviendra inévitable de manger de temps en temps des côtelettes d’homme.—Le moindre malheur qui pourra arriver sera de se nourrir de biftecks centenaires.—Un cuisinier de ce temps-ci fera tranquillement un rosbif—qu’il lèguera à sa troisième génération;—tout ceci est inquiétant.)
«Pourtant l’embaumement, c’est votre père, votre femme, votre enfant, que vous voulez voir encore, que vous désirez embrasser sans effroi.»
(Vous me faites peur, monsieur Gannal.)
![]() «M. Double était médecin du duc de Choiseul;—je n’ai point embaumé
le duc de Choiseul, mais j’ai embaumé M. Double.»
«M. Double était médecin du duc de Choiseul;—je n’ai point embaumé
le duc de Choiseul, mais j’ai embaumé M. Double.»
(Entendez-vous bien, monsieur Pasquier, l’apologue me semble clair.—M. Double a empêché M. Gannal d’embaumer le duc de Choiseul; qu’a fait M. Gannal? il a embaumé M. Double.)
Vous avez empêché M. Gannal d’embaumer le duc d’Orléans;—eh bien!—M. Gannal vous embaumera;—cela vous apprendra.—Oui, il faut que M. Gannal embaume,—si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
![]() Vous serez embaumé, monsieur Pasquier, vous serez embaumé par M.
Gannal: évitez-le,—sortez armé et accompagné.—Si M. Gannal vous
rencontre un soir—au coin d’une rue,—votre affaire est faite,—il vous
embaume,—et le lendemain il vous dira que vous êtes venu au monde comme
cela.
Vous serez embaumé, monsieur Pasquier, vous serez embaumé par M.
Gannal: évitez-le,—sortez armé et accompagné.—Si M. Gannal vous
rencontre un soir—au coin d’une rue,—votre affaire est faite,—il vous
embaume,—et le lendemain il vous dira que vous êtes venu au monde comme
cela.
Vous avez raison, monsieur Gannal,—embaumez-moi un peu M. Pasquier—et gardez-le dans votre cabinet, comme vous le dites dans votre lettre,—avec les autres sujets qui depuis tant d’années en font l’ornement et peut-être l’ameublement,—cela apprendra aux autres à se conduire;—erudimini.
Ici—une légère annonce.
«L’embaumement est une affaire de sentiment, de famille, une quasi-cérémonie religieuse: c’est du moins ainsi que je l’ai compris, et c’est aussi par cette raison que je le fais, comme vous dites, à vil prix. Oui, monsieur, zéro est mon minimum, deux mille francs mon maximum, et je suis aux ordres des familles; c’est aux familles à me demander le travail qu’elles désirent, toujours heureux d’exécuter leur volonté.»
(Combien vends-tu ton baume?—Je ne le vends pas, je le donne:—approchez, faites-vous servir.) M. Gannal revient à M. Pasquier.
![]() «Je sais que vous avez un titre, un diplôme terrible, qui vous
confère le droit de vie et de mort sur vos semblables, qui vous permet
de tailler, de rogner cette chétive espèce humaine; vous avez le droit
de mutiler votre semblable et de lui faire payer la mutilation.—C’est
bien.—Ce droit est absolu sur les vivants; mais sur les
morts?—Halte-là, monsieur; pour les vivants, je les abandonne à leur
malheureux sort; mais quant aux morts, je les réclame comme ma
propriété exclusive.»
«Je sais que vous avez un titre, un diplôme terrible, qui vous
confère le droit de vie et de mort sur vos semblables, qui vous permet
de tailler, de rogner cette chétive espèce humaine; vous avez le droit
de mutiler votre semblable et de lui faire payer la mutilation.—C’est
bien.—Ce droit est absolu sur les vivants; mais sur les
morts?—Halte-là, monsieur; pour les vivants, je les abandonne à leur
malheureux sort; mais quant aux morts, je les réclame comme ma
propriété exclusive.»
(Ainsi nous voilà nous, le pauvre monde, partagés entre M. Pasquier et M. Gannal:—les vivants à M. Pasquier, les morts à M. Gannal.—M. Gannal abandonne généreusement les vivants à M. Pasquier; il s’en rapporte à lui du soin de lui faire des morts.
M. Gannal est le roi des morts!)
![]() M. Gannal passe ensuite à l’examen de l’embaumement, dont la
consolation (maximum deux mille francs) lui a été refusée. Il fait
quelques questions à M. Pasquier.
M. Gannal passe ensuite à l’examen de l’embaumement, dont la
consolation (maximum deux mille francs) lui a été refusée. Il fait
quelques questions à M. Pasquier.
«Où avez-vous pris le natrum pour saponifier la graisse?»
(Ah! oui, où M. Pasquier a-t-il pris le natrum? Voilà ce que nous voudrions savoir,—l’a-t-il acheté, l’a-t-il volé?—où l’a-t-il pris?—qu’il nous dise un peu où il a pris le natrum.)
![]() «—Où avez-vous été chercher l’huile de cèdre, qui devenait un
objet aussi indispensable que le soleil d’Égypte?—Le natrum, vous
l’avez remplacé par TRENTE-HUIT KILOGRAMMES de sublimé corrosif; l’huile
de cèdre a été remplacée par de la teinture de benjoin, et le soleil a
été éclipsé par quatre vingts kilogrammes de poudres aromatiques.
Enfin les bandelettes elles-mêmes ont dû céder la place au sparadrap.
Qu’y a-t-il donc d’égyptien dans votre travail? Vous avez mutilé,
écorché le cadavre, et il vous a fallu trente-six aiguilles à suture
pour recoudre vos nombreuses lacérations. Trente-six aiguilles pour un
embaumement! Mais j’en fais cent avec la même et qui reste en bon état.»
«—Où avez-vous été chercher l’huile de cèdre, qui devenait un
objet aussi indispensable que le soleil d’Égypte?—Le natrum, vous
l’avez remplacé par TRENTE-HUIT KILOGRAMMES de sublimé corrosif; l’huile
de cèdre a été remplacée par de la teinture de benjoin, et le soleil a
été éclipsé par quatre vingts kilogrammes de poudres aromatiques.
Enfin les bandelettes elles-mêmes ont dû céder la place au sparadrap.
Qu’y a-t-il donc d’égyptien dans votre travail? Vous avez mutilé,
écorché le cadavre, et il vous a fallu trente-six aiguilles à suture
pour recoudre vos nombreuses lacérations. Trente-six aiguilles pour un
embaumement! Mais j’en fais cent avec la même et qui reste en bon état.»
(Niez donc, monsieur Pasquier,—qu’il y ait dans le procédé de M. Gannal une grande économie d’aiguilles!)
Ici M. Gannal ne menace plus M. Pasquier seulement de l’embaumer, il lui annonce en même temps la réprobation générale.
«—Mais, monsieur, avez-vous donc songé à la réprobation générale qui doit tomber sur vous quand la population saura que, sans égards pour les dépouilles de l’illustre défunt, dans des vues que je ne veux pas qualifier, vous avez haché en lambeaux l’héritier présomptif de la couronne?—Votre procédé est sauvage.»
(Quel malheur que M. Gannal ne qualifie pas les vues de M. Pasquier: nous en aurions appris de belles.)
![]() Nous nous arrêtons ici—et nous donnons notre avis et sur le
procédé de M. Gannal et sur sa brochure.—Son procédé est évidemment
supérieur à tout ce qu’on a fait jusqu’ici.—Nos lecteurs savent ce que
nous pensons de l’embaumement universel auquel tend M. Gannal, mais on
aurait dû l’adopter pour le prince royal.
Nous nous arrêtons ici—et nous donnons notre avis et sur le
procédé de M. Gannal et sur sa brochure.—Son procédé est évidemment
supérieur à tout ce qu’on a fait jusqu’ici.—Nos lecteurs savent ce que
nous pensons de l’embaumement universel auquel tend M. Gannal, mais on
aurait dû l’adopter pour le prince royal.
Pour la brochure,—elle est ridicule et indécente au plus haut degré.
![]() Il y a à Paris une société de gens d’esprit, une charmante petite
coterie,—où lorsque l’on veut dire qu’une chose est impraticable on
donne avec le plus imperturbable sérieux la raison que voici:
Il y a à Paris une société de gens d’esprit, une charmante petite
coterie,—où lorsque l’on veut dire qu’une chose est impraticable on
donne avec le plus imperturbable sérieux la raison que voici:
«Le roi de Sardaigne est bien sévère, madame.»
Voici l’explication et l’origine de cette locution devenue proverbiale:
Mon ex-ami,—M. de Balzac,—a voyagé dans les États sardes;—entre autres aventures, il plut à une douairière du pays—qui se mit à le combler d’attentions inquiétantes.
M. de Balzac a juste la vertu de la chaste Suzanne, laquelle ne voulut jamais prendre pour amants—deux vieillards chassieux et repoussants.
J’aime ces grands exemples qui ne sont pas trop difficiles à imiter.
Il eut peur—et un jour—il s’avisa de raconter à la respectable matrone—une histoire de son invention, qu’il attribua sans façon au roi de Sardaigne.—Ce monarque, selon le romancier, ayant surpris deux jeunes amants occupés à s’aimer et à se le dire, leur fit trancher la tête, sans autre forme de procès. La belle ne se décourageant pas par les respects du plus fécond de nos romanciers,—dépassa une à une les limites de la timidité de son sexe,—et finit par devenir très-embarrassante; mais quand M. de Balzac voyait le danger trop imminent, il prenait la figure patibulaire d’un condamné à mort, et disait avec un grand soupir: «Ah! madame, le roi de Sardaigne est bien sévère.»
![]() Entre autres phrases toutes faites—qui se reproduisent plus
souvent qu’à leur tour,—comme dit la portière d’Henry Monnier, il faut
citer celle-ci dont les journaux du gouvernement ont fait pendant
longtemps un usage que j’appellerais presque abusif.
Entre autres phrases toutes faites—qui se reproduisent plus
souvent qu’à leur tour,—comme dit la portière d’Henry Monnier, il faut
citer celle-ci dont les journaux du gouvernement ont fait pendant
longtemps un usage que j’appellerais presque abusif.
«Il faut trancher les têtes sans cesse renaissantes de l’hydre de l’anarchie.»
Un de ces journaux disait hier:
«Il faut museler à jamais le monstre de l’anarchie.»
Les bourgeois timorés nous sauront sans doute gré de porter autant qu’il est en nous cette phrase à leur connaissance.
Lesdits bourgeois remarqueront avec plaisir à quel degré d’abjection est descendue l’ancienne hydre de l’anarchie, ou plutôt l’anarchie elle-même.
Autrefois, en effet, on ne savait comment trouver pour la peindre de métaphore suffisamment magnifique;—l’hydre avec ses sept têtes renaissantes avait fini par être l’image consacrée.—Mais aujourd’hui—le gouvernement semble, en se servant du mot museler, adopter une expression moins ambitieuse, qui semble ravaler l’ancienne hydre de l’anarchie aux mesquines proportions d’un caniche suspect.
![]() L’autre jour,—j’entre dans un salon de figures de cire établi aux
Champs-Élysées;—un vieillard sec invitait les passants; un jeune
homme, avec un chapeau gris sur l’oreille et une baguette à la main,
était chargé de la démonstration des figures.—Sa démonstration était
évidemment une pièce apprise de mémoire, il la récitait sur cet air
traînant des écoliers qui, allongeant du dernier mot les syllabes
honteuses, tâchent de faire un chemin de euh, euh, euh, entre le mot
qu’ils se rappellent et celui qu’ils ne se rappellent pas.
L’autre jour,—j’entre dans un salon de figures de cire établi aux
Champs-Élysées;—un vieillard sec invitait les passants; un jeune
homme, avec un chapeau gris sur l’oreille et une baguette à la main,
était chargé de la démonstration des figures.—Sa démonstration était
évidemment une pièce apprise de mémoire, il la récitait sur cet air
traînant des écoliers qui, allongeant du dernier mot les syllabes
honteuses, tâchent de faire un chemin de euh, euh, euh, entre le mot
qu’ils se rappellent et celui qu’ils ne se rappellent pas.
Quand je l’interrompais pour lui faire une question, il parlait de sa voix naturelle;—puis, sa réponse faite, il reprenait sa leçon où il l’avait laissée, en répétant les derniers mots,—toujours sur le même air.
![]() Il nous montra cinq ou six fois Napoléon dans diverses
circonstances et avec diverses figures,—en faisant, chaque fois,
précéder son récit de ces mots: «Ceci, messieurs, est la plus belle
action de l’empereur Napoléon.»—Nous arrivâmes au maréchal
Moncey.—«Voici le maréchal Moncey,—nous dit-il,—gouverneur des
Invalides,—leurs insignes meurent avec eux; il a été interré avec
toutes ses croix et ganalisé.»
Il nous montra cinq ou six fois Napoléon dans diverses
circonstances et avec diverses figures,—en faisant, chaque fois,
précéder son récit de ces mots: «Ceci, messieurs, est la plus belle
action de l’empereur Napoléon.»—Nous arrivâmes au maréchal
Moncey.—«Voici le maréchal Moncey,—nous dit-il,—gouverneur des
Invalides,—leurs insignes meurent avec eux; il a été interré avec
toutes ses croix et ganalisé.»
Nous arrivâmes à un coin où les figures plus anciennes avaient toutes une remarquable teinte: «Dans ce coin sont tous les personnages qui ont attenté à la vie les uns des autres.»
Nous y trouvâmes en effet les assassins de Fualdès—et celui de la bergère d’Ivry; Lacenaire, voleur et homme de lettres, etc.
Dans ce coin,—on avait mêlé à ces monstres des monstres d’une autre espèce:—un veau à deux têtes, un enfant à quatre jambes, les jumeaux siamois, etc., etc.—Témoignage évident des principes philosophiques du propriétaire des figures de cire,—qui met sur la même ligne toutes les monstruosités que la nature crée par distraction.
—Mais, demandai-je au démonstrateur,—vous n’avez rien de plus nouveau?
—Ah! monsieur, reprit-il de sa voix de conversation,—on nous a arraché le pain de la main;—on nous a fait enlever la mort de monseigneur le duc d’Orléans.—C’était pour nous une excellente affaire:—la mort d’un prince, c’est de l’histoire, et l’histoire appartient aux figures de cire.
—Peut-être, lui dis-je,—votre explication n’était-elle pas convenable?
—Oh! que si, monsieur, la voici:—Monsieur (et il me désignait le vieillard qui criait à la porte: «Entrez, entrez, trois cents sujets différents!») monsieur avait pris la démonstration dans le Journal des Débats;—du reste la voici:
J’ôtais mon chapeau—et je disais:...
Ici il se remit à chanter les vingt lignes empruntées au Journal des Débats.
—C’est une injustice,—monsieur,—ajouta-t-il en remettant son chapeau et en reprenant sa voix naturelle,—j’avais envie d’en écrire aux journaux,—mais je n’ai pas le temps—et je ne sais pas écrire;—monsieur,—c’est comme cela que les gouvernements se font détester; je ne vous dis que cela parce qu’on ne sait pas toujours à qui on parle.
Je ne voulus pas achever d’exaspérer ce pauvre diable en lui disant qu’à Rouen un confiseur a fait deux tableaux en sucre représentant la chute de voiture du prince royal—et sa mort chez l’épicier;—que ces deux tableaux, exposés publiquement dans sa boutique, excitent à la fois la moquerie et l’indignation;—que le talent du sculpteur en sucre n’a pu s’élever qu’à faire des personnages de ces deux tristes scènes de révoltantes caricatures,—et que la police en a toléré l’exhibition indécente.
En effet, l’artiste,—à l’imitation des sculpteurs grecs,—qui mêlaient au marbre l’or et l’ivoire,—l’artiste a usé de toutes les ressources que lui présentait sa boutique: le chocolat joue un grand rôle et représente à la fois et le tuyau de poêle dans l’arrière-boutique—et la perruque de Sa Majesté Louis-Philippe.
Je quittai le salon après avoir offert au démonstrateur quelques consolations,—et je repris ma route en songeant à une de ses phrases:
«Voilà comme les gouvernements se font détester.»
On a beaucoup parlé du fameux mot de Louis XIV: L’Etat, c’est moi.
Hélas! c’est aujourd’hui la pensée déguisée de nos gouvernants ou de ceux qui aspirent à l’être sous divers titres et sous divers prétextes.—Quand on nous crie: «La patrie souffre,—le peuple se plaint, le pays est dans l’anxiété;—nous qui avons un peu creusé les choses,—qui avons étudié les hommes de ce temps, nous ne pouvons nous empêcher d’entendre: «—J’ai besoin d’argent;—je voudrais une place,—je ne sais comment arriver;» ou: «Mes bottes ont besoin d’être ressemelées.»
![]() M. Adolphe Dumas—qui n’est nullement parent d’Alexandre
Dumas,—rencontra celui-ci dans un couloir le jour de la première
représentation du Camp des Croisés,—pièce dudit M. Adolphe
Dumas—dans laquelle—les ennemis de l’auteur ont prétendu avoir entendu
ce vers:
M. Adolphe Dumas—qui n’est nullement parent d’Alexandre
Dumas,—rencontra celui-ci dans un couloir le jour de la première
représentation du Camp des Croisés,—pièce dudit M. Adolphe
Dumas—dans laquelle—les ennemis de l’auteur ont prétendu avoir entendu
ce vers:
qu’ils écrivent et prononcent:
—Monsieur, dit M. Adolphe à M. Alexandre,—pardonnez-moi de prendre un peu de votre place au soleil, mais il peut bien y avoir deux Dumas, comme il y a eu deux Corneille.
—Bonsoir Thomas, dit Alexandre en s’éloignant.
![]() Un ami de M. Alfred de Musset—insistait beaucoup auprès de M.
Villemain pour qu’il donnât la croix d’honneur à l’auteur de
Namouna.—L’ami de M. de Musset est influent, très-influent,—il a
fait vingt démarches auprès du ministre de l’instruction publique:—on
ne s’explique pas l’obstination de M. Villemain dans son refus
d’accorder une récompense méritée à un poëte aussi original et aussi
distingué que M. de Musset.
Un ami de M. Alfred de Musset—insistait beaucoup auprès de M.
Villemain pour qu’il donnât la croix d’honneur à l’auteur de
Namouna.—L’ami de M. de Musset est influent, très-influent,—il a
fait vingt démarches auprès du ministre de l’instruction publique:—on
ne s’explique pas l’obstination de M. Villemain dans son refus
d’accorder une récompense méritée à un poëte aussi original et aussi
distingué que M. de Musset.
Pour moi, je suis presque sûr que le ministre académicien ne donne pas la croix à M. de Musset parce qu’il a écrit ce vers:
![]() A propos de certaines réceptions de la cour,—réceptions, du reste,
peu nombreuses et surtout peu divertissantes à cause du deuil de la
famille royale, qui cette fois n’est pas seulement en deuil
d’étiquette,—un carré de papier—publie une nouvelle homélie contre
le costume décent—que la tyrannie—veut imposer aux invités.—Nous
sommes parfaitement d’accord avec lui s’il nous dit qu’il y aura des
hommes et des habits fort ridicules;—mais nous différons avec lui quand
il veut qu’on aille à la cour et qu’on y aille en habit de ville.
A propos de certaines réceptions de la cour,—réceptions, du reste,
peu nombreuses et surtout peu divertissantes à cause du deuil de la
famille royale, qui cette fois n’est pas seulement en deuil
d’étiquette,—un carré de papier—publie une nouvelle homélie contre
le costume décent—que la tyrannie—veut imposer aux invités.—Nous
sommes parfaitement d’accord avec lui s’il nous dit qu’il y aura des
hommes et des habits fort ridicules;—mais nous différons avec lui quand
il veut qu’on aille à la cour et qu’on y aille en habit de ville.
Nous comprenons parfaitement que ledit carré de papier dise à ses abonnés (et il ne le leur dit pas): «Que diable! ô mes abonnés et mes abonnées, allez-vous faire à la cour?—Il y a une foule de choses qu’il faut savoir là, et que vous n’avez apprises ni derrière votre comptoir, ni dans votre arrière-boutique; vous n’en êtes pas moins des gens parfaitement honorables, mais vous ne saurez entrer, ni sortir.—Vous, madame l’épicière, vous êtes une belle femme bien conservée;—mais, si vous vous habillez à la cour comme de coutume, vous serez ridicule et humiliée, et, si vous vous habillez autrement, vous serez un peu plus humiliée, parce que vous n’aurez aucun droit à l’indulgence,—et infiniment plus ridicule,—vos pieds feront crever le satin,—vos façons de danser, qui en valent bien d’autres, feront rire tout le monde, comme ferait rire vous et vos amis une femme de la cour qui viendrait danser avec vous à votre entresol.—Cette soirée de gêne, d’humiliation, d’ennui, vous coûtera en toilettes et voitures ce que vous coûteraient à peine trente soirées de plaisir—où vous seriez la reine et la belle de la fête.
»Et vous, monsieur l’épicier, devrait toujours dire le susdit carré de papier, monsieur l’officier de la garde nationale (car c’est la garde nationale qui introduit l’épicier aux Tuileries), vous êtes un gaillard de belle humeur;—vous êtes adoré à l’estaminet du coin;—vous n’avez pas votre égal au billard pour le bloc fumant et le carambolage de douceur;—vous avez tous les soirs le même succès avec les mêmes plaisanteries que vous faites depuis dix ans sur les numéros des billes de poule.—Quand on tire 22, et que vous avez dit: «Les cocottes» toute la galerie rit aux éclats, et votre partenaire dit: «Tais-toi donc, tu es trop drôle, tu m’empêches de jouer tant je ris.»—Personne ne sait, comme vous, rendre en fumant la fumée par le nez.
»Et votre habit noir,—comme il vous fait respecter!—et, quand vous l’ôtez pour jouer au billard, comme on admire vos bretelles rouges!
»Pourquoi aller de gaieté de cœur perdre vos succès et votre importance?—Ce luxe excessif qui vous distingue, il paraîtra là-bas mesquin et ridicule.
»Restez donc chez vous, ou allez chez vos amis;—faites des crêpes, jouez au loto.»
Voilà ce que le carré de papier devrait dire à ses abonnés; mais, non: le carré de papier veut que ses abonnés aillent aux Tuileries;—mais il veut qu’ils y aillent en soques, en vestes et sans gants.—C’est l’égalité pour le carré de papier.—Nous soutenons, nous, que c’est la plus sotte et la plus grande inégalité.—Montez si vous pouvez, mais ne faites pas descendre les autres;—tâchez, si vous le croyez amusant, d’ajouter des pans aux vestes, mais ne coupez pas les pans des habits.
O carré de papier!—que dirait votre abonnée l’épicière, si la fruitière sa voisine,—invitée (si elle l’invitait, ce que je ne crois pas) à une soirée d’as qui court ou de vingt-et-un,—que dirait votre abonnée l’épicière, si sa voisine et son inférieure la fruitière venait chez elle en marmotte et en sabots?—Ne trouverait-elle pas indécent qu’elle n’eût pas mis un bonnet et des souliers?
![]() Un des plus beaux rêves dont l’homme doit successivement se
réveiller, c’est sans contredit la liberté.
Un des plus beaux rêves dont l’homme doit successivement se
réveiller, c’est sans contredit la liberté.
Hélas!—tous ces bonheurs après lesquels nous soupirons ne sont que des êtres de raison,—tout simplement le contraire fictif des malheurs réels que nous éprouvons dans la vie.
La liberté en politique est une grande pensée et un grand mot misérablement exploité par quelques-uns qui veulent être les maîtres à leur tour;—la liberté en politique veut dire l’esclavage des autres;—l’égalité—n’est qu’un échelon—pour arriver à marcher sur la tête d’autrui.
La liberté! où est-elle? Cherchez l’homme le plus libre de tous,—et comptez à combien de maîtres durs et inflexibles il doit obéir.
Approchez ici,—vous, monsieur, qui avez tout sacrifié à la liberté,—voyons un peu,—montrez-nous ce joyau précieux que vous avez conquis si laborieusement,—montrez-nous cette liberté dont vous êtes si fier.
Sortez de chez vous, et venez causer un moment.
Vous vous levez;—mais j’aperçois—un homme gros, court et pâle,—nu jusqu’à la ceinture et vêtu uniquement d’un cotillon de toile grise.
«Arrête!—vous crie-t-il, arrête! Ne faut-il pas que tu m’apportes demain le prix de ton travail,—ne faut-il pas que tu payes le pain que je te vendrai? ne suis-je pas ton maître? ne suis-je pas le boulanger?»
En voici un autre,—plein de santé,—le visage d’un rose vif,—un tablier est devant lui,—il semble fier des taches de sang qui le couvrent.
«Eh! eh!—dit-il,—à l’ouvrage, malheureux, à l’ouvrage! Ne faut-il pas que tu m’apportes demain le prix de ton travail?—ne faut-il pas que tu m’apportes demain ton tribut quotidien?—ne suis-je pas ton maître? ne suis-je pas le boucher.»
Et celui-ci:—il a des habits neufs,—coupés à la mode du jour, ou plutôt à la mode de demain;—mais il n’a pas de gants,—et ses bottes éculées n’ont pas été cirées depuis cinq semaines,—son chapeau est partie chauve, partie ébouriffé.
«Tiaple—mein herr!—s’écrie-t-il,—trafaillez pour moi,—trafaillez.—il me faut de l’argent;—que che fous foie ainsi fumer tes ciquarrettes! trafaillez, fous tis-je,—trafaillez! che suis votre maître, che suis le tailleur!»
Et celui-ci, avec un galon d’or à son chapeau: «Allons, maître, dit-il,—il me faut une belle livrée,—il me faut à manger et à boire,—il me faut un chapeau neuf;—travaillez,—travaillez;—ne me reconnaissez-vous pas,—que vous continuez à faire ainsi tourner vos pouces?—je suis votre maître, je suis votre domestique. Obéissez-moi!»
Il n’y a d’un peu plus libre que celui qui a moins de maîtres que les autres, que celui qui a moins de besoins.
Chaque besoin, chaque goût, est une chaîne dont quelqu’un tient le bout quelque part.
Comptez de bonne foi combien vous en avez.
Les inondés d’Étretat, d’Yport et de Vaucotte.—Le roi Louis-Philippe et M. Poultier, de l’Opéra.—Un philosophe moderne.—Les femmes et les lapins.—Une mesure inqualifiable.—M. Lestiboudois.—M. de Saint-Aignan.—Un dictionnaire.—Le véritable sens de plusieurs mots.—A. et B.
![]() LES INONDÉS.—J’ai voulu aller voir ces pauvres gens d’Étretat et
d’Yport, auxquels une trombe d’eau a fait tant de mal, il y a un peu
plus d’un mois.—Gatayes se trouvait avec moi dans la vieille masure que
j’habite aux bords de la mer; nous nous sommes mis en route une heure
avant le jour—pour prendre au passage une voiture qui nous a conduits à
Fécamp.
LES INONDÉS.—J’ai voulu aller voir ces pauvres gens d’Étretat et
d’Yport, auxquels une trombe d’eau a fait tant de mal, il y a un peu
plus d’un mois.—Gatayes se trouvait avec moi dans la vieille masure que
j’habite aux bords de la mer; nous nous sommes mis en route une heure
avant le jour—pour prendre au passage une voiture qui nous a conduits à
Fécamp.
Fécamp a également souffert de l’inondation,—mais le sinistre n’a attaqué que les gens riches.—Nous n’avons fait que traverser Fécamp, et, en suivant les sinuosités de la falaise, nous nous sommes dirigés vers Yport—en gardant la mer à notre droite, mais à trois cents pieds au-dessous de nous.
Après deux heures de marche, nous avons vu le grand bouquet d’arbres qui cache Yport.—On entre dans les arbres, et, par des chemins escarpés, on descend dans le fond d’une petite vallée où est situé Yport.
Dès lors on commence à voir quelques traces de l’inondation: les chemins sont élargis et violemment creusés, tantôt à deux, tantôt à trois pieds dans le roc;—quelques champs sont encore couverts de limon. De la paille, du menu bois, de grandes herbes, sont restés accrochés dans les branches des arbres, à sept ou huit pieds de hauteur;—c’est l’eau qui les a portés là en se précipitant du sommet des côtes qui entourent Yport de toutes parts.
Nous entrons dans les rues:—les maisons portent encore l’empreinte de l’eau à une grande hauteur, les haies les plus élevées qui entourent les jardins sont remplis de paille;—l’eau a passé par-dessus;—puis, à mesure qu’on avance,—le désastre a laissé des marques plus visibles: voici un mur renversé,—là une maison à moitié démolie, ici un arbre déraciné.
Mais une fois arrivés aux deux tiers de la grande rue qui conduit à la mer,—nos yeux sont frappés d’un horrible spectacle:—le torrent a emporté la terre et les pierres qui formaient le chemin à une profondeur de six ou huit pieds; des deux côtés les maisons se sont écroulées.—Nous descendons dans le ravin formé par l’eau,—et nous voyons des restes de maisons suspendus au-dessus de nos têtes;—presque partout—le mur qui était sur la rue—et la façade de la maison ont été emportés avec leurs fondations et le terrain qui les soutenait.—Les maisons sont coupées et déchirées en deux,—depuis le toit jusqu’au sol; les débris ont été entraînés à la mer.—On voit, depuis le haut jusqu’en bas,—l’intérieur des chambres coupées en deux;—des meubles encore en place,—des lits, des tables, sont à moitié en dehors de ce qui reste d’un plancher incliné qui vacille et qui va s’écrouler d’un instant à l’autre;—des toits, qui ne sont plus supportés que par un pan de muraille, restent suspendus sans qu’on comprenne comment,—et vont tomber au moindre vent.
Nous avançons parmi les décombres et les inégalités du lit que s’est creusé l’eau;—nous voici au bord de la mer:—la trombe a renversé et jeté en bas un parapet de granit large de plus de deux pieds.—«Tenez, nous dit un pêcheur, regardez cette grande place à gauche:—il y avait là huit maisons;—eh bien, il n’y en reste pas mention.»
Les débris ont été jetés à la mer,—pêle-mêle avec cinq malheureuses femmes qui n’ont pas eu le temps de se sauver.—On n’en a retrouvé qu’une, morte sous la vase et le limon.
Nous cherchons la maison de Huet.—Huet est un aubergiste—chez lequel autrefois je m’arrêtais pour déjeuner quand j’allais d’Étretat à Fécamp;—nous avons peine à retrouver l’auberge, tant le pays est dévasté et changé.—Le grand puits qui était devant la porte a presque disparu sous la terre que la trombe a enlevée du haut de la côte.
Huet était riche,—il a beaucoup perdu;—le torrent a passé entre ses deux maisons, qui se touchaient,—et a emporté des morceaux de murailles et tous ses meubles, jusqu’à d’énormes armoires en bois sculpté pleines de linge,—qu’on n’a retrouvées qu’au bord de la mer: «c’était comme si on eût tout balayé.» Là on nous raconte le commencement du désastre.—C’était deux heures avant le jour;—on entendait «hogner» l’eau dans les bois au-dessus d’Yport;—l’eau s’était enfermée elle-même dans une digue de paille, d’herbe, de branchages, de feuilles arrêtées dans les arbres; mais cette digue ne put résister longtemps,—l’eau la rompit—et se précipita de trois côtés du haut des côtes—sur Yport, qui est dans le fond d’un entonnoir, entraînant avec elle—des arbres,—des pierres énormes,—emportant les chemins jusqu’à deux et trois pieds de profondeur;—alors on entendit de grands cris poussés par ceux qui, plus près de la côte, étaient les premières victimes de ce désastre.—En quelques instants les maisons commencèrent à crouler avec fracas;—les habitants s’échappaient par les toits et passaient d’une maison à l’autre. «Pour nous, disait Huet, nous étions, comme les autres, réfugiés dans nos greniers;—là, nous voyions nos voisins montés sur leurs toits, et nous nous disions adieu les uns aux autres en nous criant: «Adieu, voisins, il faut mourir.»—Songez qu’il ne faisait pas encore jour,—que nous entendions le bruit de l’eau roulant du haut des côtes et des maisons qui tombaient,—les cris de frayeur de ceux qui se sauvaient,—les cris de désespoir des pauvres femmes qui ont été noyées,—et que nous sentions notre maison trembler par secousses.—Je m’attendais d’un moment à l’autre à être écrasé avec ma femme et ma fille;—elles s’étaient jetées le visage à terre,—pleuraient et priaient Dieu;—elles me disaient de prier aussi,—mais je ne m’en sentais pas le courage,—je jurais;—je sais bien qu’il faut prier Dieu,—mais,—monsieur, ça n’était pas du bien qu’il nous faisait, ça;—je l’aurais prié que ça n’aurait pas été de bon cœur.—Pour ne prier que de la bouche, j’aime mieux ne pas prier;—je dis à la femme et à la fille de continuer à prier pour elles et pour moi, et je me remis à jurer.»
Nous étions, Gatayes et moi, auprès de la grande cheminée de la cuisine,—et nous rallumions nos pipes pour nous remettre en route—quand il entra une grande fille pâle, vêtue de noir;—la fille de Huet nous la montra,—et nous dit: «Tenez, c’est sa mère qu’on a retrouvée dans la vase—trois jours après l’événement.»
Nous disons adieu à toute la famille, et nous serrons la main au père Huet, qui nous accompagne un bout de chemin.
Nous gravissons la côte pour sortir d’Yport par l’autre côté de l’entonnoir—en nous entretenant tristement du spectacle que nous venons d’avoir sous les yeux. Nous nous étonnons de la négligence de l’autorité.—Il y a cinq semaines que le malheur est arrivé,—et depuis cinq semaines on laisse une trentaine de maisons à moitié démolies suspendues au-dessus des chemins de la manière la plus menaçante;—les chemins eux-mêmes creusés inégalement jusqu’à sept et huit pieds de profondeur,—impraticables pour les voitures,—difficiles et dangereux pour les hommes,—et l’autorité supérieure ne s’est mêlée de rien.—Il était urgent de faire démolir ces restes de maisons, qui, d’un moment à l’autre, au premier vent, peuvent causer de nouveaux malheurs; il était urgent de faire remblayer les chemins:—il n’y a rien de fait, rien de commencé.
![]() Le roi, aussitôt le sinistre arrivé, a envoyé sur sa cassette trois
mille francs—à chacun des pays ravagés.
Le roi, aussitôt le sinistre arrivé, a envoyé sur sa cassette trois
mille francs—à chacun des pays ravagés.
M. Poultier, le chanteur,—qui était en représentation à Rouen,—est arrivé en toute hâte au Havre, où il a donné une représentation au bénéfice des inondés.—Il n’a rien voulu prélever sur la recette ni pour son déplacement ni pour ses frais de voyage;—il a fait envoyer aux victimes de l’inondation les sept ou huit cents francs qui lui revenaient pour sa part.
Des souscriptions ont été ouvertes de tous côtés.
![]() Nous voici arrivés sur la côte,—il faut redescendre dans une autre
vallée, pour passer par le petit village de Vaucotte.—Le soleil s’est
dégagé des nuages,—et éclaire gaiement les lieux témoins naguère d’une
si grande désolation. Du reste, tout le pays est ici
ravissant.—Vaucotte est au fond de la vallée comme Yport, comme
Étretat;—les collines qui entourent Vaucotte sont couvertes d’ajoncs et
de bois taillis en pentes escarpées, auxquels l’automne prête les
couleurs les plus splendides;—les feuilles des chênes sont d’un jaune
orangé,—celles des châtaigniers sont jaune clair;—les cornouillers
sont rouges,—les ajoncs et les genêts sont restés d’un vert vif et
vigoureux.
Nous voici arrivés sur la côte,—il faut redescendre dans une autre
vallée, pour passer par le petit village de Vaucotte.—Le soleil s’est
dégagé des nuages,—et éclaire gaiement les lieux témoins naguère d’une
si grande désolation. Du reste, tout le pays est ici
ravissant.—Vaucotte est au fond de la vallée comme Yport, comme
Étretat;—les collines qui entourent Vaucotte sont couvertes d’ajoncs et
de bois taillis en pentes escarpées, auxquels l’automne prête les
couleurs les plus splendides;—les feuilles des chênes sont d’un jaune
orangé,—celles des châtaigniers sont jaune clair;—les cornouillers
sont rouges,—les ajoncs et les genêts sont restés d’un vert vif et
vigoureux.
Mais bientôt nous voyons le chemin qu’a suivi le torrent:—c’est une de ces cavées normandes,—si charmantes d’ordinaire,—un chemin creusé entre des rangées d’arbres, de façon qu’on a la tête à peine au pied des arbres et que le regard est emprisonné sous un berceau de verdure;—mais le torrent a creusé le chemin en certaines places jusqu’à quinze pieds de profondeur;—des arbres sont arrachés et jetés çà et là;—quand on marche au fond des chemins,—on voit loin au-dessus de sa tête les racines nues et dépouillées des arbres qui restent.
Il y avait à Vaucotte une dizaine de personnes: il n’en reste plus que la moitié,—quatre ou cinq personnes ont été noyées.—Une femme emportait sur son dos sa fille malade, une fille de dix-neuf ans.—Elles sont renversées par la trombe,—entraînées, roulées avec les pierres, et noyées toutes les deux.
De l’autre côté de Vaucotte, nous étions à Étigues;—à Étigues, un chemin creusé dans le roc permet de descendre jusqu’à la mer;—la mer était basse:—nous ferons jusqu’à Étretat le chemin par les roches qu’elle laisse à découvert;—c’est un chemin un peu difficile,—mais magnifique. A gauche, la falaise, blanche et droite comme une muraille, s’élève à la hauteur de cinq maisons qui seraient placées les unes sur les autres. A droite, la mer, qui remonte en grondant.—Il y a une lieue et demie à faire,—il ne faut pas trop flâner;—il faut marcher sur des pointes de roches revêtues d’herbe verte et de mousses cramoisies, qui sont du plus bel effet,—mais aussi fort glissantes;—il faut franchir des flaques d’eau que la mer a laissées dans des trous de roc semblables à des bassins de marbre blanc. Puis, de temps en temps, le chemin est barré par de gros rochers dont il faut faire le tour.
Dans les flaques d’eau, transparentes comme l’air, des crabes, des loches, sont restés et se cachent à notre approche.—On s’arrête, on les regarde;—on les prend;—on ramasse des galets ronds et transparents comme des billes d’agate,—et des cailloux couverts de teintes rouges et vertes,—et les mousses cramoisies,—et de petits madrépores,—des coraux lie-de-vin,—serrés et rudes comme du velours d’Utrecht.
Bon! voici un cormoran—qui bat l’air de ses petites ailes noires,—et qui, sans se hâter, mais sans s’arrêter et surtout sans se détourner, suit son vol droit et paisible.—Gatayes prétend qu’il a l’air d’un employé qui va à son bureau.
De grandes mouettes plongent et remontent dans l’air avec un poisson qu’elles ont saisi dans l’eau.
Le temps se passe,—le jour baisse. Je me rappelle alors qu’il y a neuf ans,—précisément le même jour,—le 2 novembre, allant d’Étretat à Étigues,—je me suis fait surprendre par la nuit et par la marée.
La mer était houleuse ce jour-là—et montait avec grand bruit.—Il vint un moment où je fus obligé de m’arrêter. Devant moi la mer en colère se brisait contre la falaise;—je retournai sur mes pas.—A cent toises de là, elle battait également contre le rocher.—J’étais renfermé dans un cercle que la mer rétrécissait à chaque instant.—Il faisait nuit.—Je savais que dans une heure il y aurait quinze pieds d’eau là où j’étais encore à pied sec,—entre la mer écumante et une muraille droite de trois cents pieds,—soixante fois la hauteur d’un homme.—Je nage bien; mais de quel côté me diriger, c’était la première fois que je venais dans ce pays,—et d’ailleurs les lames m’auraient bientôt broyé contre le rocher.
Un douanier, qui m’observait depuis longtemps, m’appela du haut de la falaise quand il me perdit dans la nuit. Il descendit à moitié chemin par un sentier à peu près taillé dans le roc—et me jeta une corde au moyen de laquelle j’allai le rejoindre.
Il y avait précisément neuf ans;—je revoyais la falaise contre laquelle la mer, en se brisant, m’avait emprisonné;—mais maintenant—je sais des abris et des chemins que les oiseaux ont appris aux pêcheurs et que les pêcheurs m’ont montrés;—d’ailleurs la mer n’est encore remontée qu’à moitié, et elle n’est pas en colère.
Nous marchons,—nous rencontrons un vieux pêcheur d’Étretat.
—Peut-on encore passer sous la porte d’Aval?
—Non, il y a au moins huit pieds d’eau.
—Alors, nous monterons par la Valleuse.
La Valleuse est un de ces chemins serpentant dans le roc, dont je parlais tout à l’heure. Ils ont le défaut d’être un peu étroits.—En touchant le roc d’une épaule,—on a la moitié du corps en dehors du chemin—et deux ou trois cents pieds au-dessous;—il faut s’y accoutumer.
—Vous connaissez le pays,—dit le pêcheur,—vous n’avez pas l’air embarrassés.
—Est-ce que vous ne nous reconnaissez pas? père Aubry, demanda Gatayes.
—Tiens, c’est M. Léon—et M. Alphonche.—Ah bien! je ne m’attendais guère à vous voir aujourd’hui.
Nous faisons route avec le père Aubry, qui nous donne des nouvelles de tout le monde.
Ce n’est que le lendemain que nous avons pu visiter les désastres causés par la trombe.
A Yport et à Vaucotte l’eau a creusé le chemin et emporté les maisons;—à Étretat, elle a entraîné la terre et a englouti les habitations.—Notre ami Valin, le garde-pêche, nous mène voir un grand terrain où il y avait six maisons, dont deux à son frère Benoît;—l’eau y a apporté huit pieds de terre,—on ne voit plus que le toit de chaume,—c’est une inondation de terre qui est restée après l’inondation d’eau. On a percé les toits pour sauver les habitants;—il y a eu plusieurs noyés.—M. Fauvel,—maire d’Étretat,—qui a montré le plus grand zèle, est allé en bateau pour sauver une pauvre femme.—On a ouvert le toit de la maison;—la maison était pleine de vase—qui était montée à plus de dix pieds de haut.—On a vu une main qui sortait de la vase,—on a exhumé la malheureuse femme: elle était morte!—Plus de cinquante maisons sont restées entourées et pleines de limon jusqu’au toit; il en coûterait dix fois la valeur des maisons pour les dégager.
On nous disait encore avec un sentiment de terreur,—en nous montrant ce que la trombe avait enlevé de terre sur les côtés,—que, sans un pan de mur qui avait forcé l’eau à se diviser autour du cimetière, qui est à moitié de la colline,—le torrent aurait déterré tous les morts et les aurait roulés jusque dans la commune.
![]() A Étretat, comme à Yport, comme à Vaucotte, l’autorité supérieure
n’a fait commencer aucuns travaux. Il y a cinquante familles sans asile.
A Étretat, comme à Yport, comme à Vaucotte, l’autorité supérieure
n’a fait commencer aucuns travaux. Il y a cinquante familles sans asile.
Les maires de ces trois malheureuses communes—ont reçu déjà des dons assez importants.—Le maire d’Elbeuf a envoyé une quantité considérable de vêtements de toutes sortes,—mais aucun des hommes qui, à Paris, sont les rois de l’argent—n’a jusqu’ici envoyé son offrande.
![]() Je crois vous avoir déjà entretenu d’un philosophe—de ce temps-ci
qui a mis au jour plusieurs ouvrages d’une réelle importance; je veux
parler de M. Maldan, auteur de l’ART d’élever les lapins et de s’en
faire trois mille francs de revenu.
Je crois vous avoir déjà entretenu d’un philosophe—de ce temps-ci
qui a mis au jour plusieurs ouvrages d’une réelle importance; je veux
parler de M. Maldan, auteur de l’ART d’élever les lapins et de s’en
faire trois mille francs de revenu.
M. Maldan est également auteur de: L’ART de se faire aimer des femmes.—Moyen certain de les rendre heureuses pour la vie.
Je ne vois point dans la littérature d’ouvrages plus sérieux et plus utile.—Que peut désirer un homme qui possède à la fois l’art d’élever les lapins et de s’en faire trois mille francs de rente,—et en même temps l’art de se faire aimer des femmes?
Une chose triste pour notre époque,—c’est que l’art d’élever les lapins a eu déjà huit éditions, et que l’art de se faire aimer des femmes et de les rendre heureuses pour la vie n’en a eu que deux.
Réparons cette injustice du public—en citant quelques fragments de ce dernier ouvrage.—Je me trompe fort, ou les lecteurs des Guêpes s’y intéresseront plus qu’à l’art d’élever des lapins, quelque perfectionné qu’il puisse être.
L’auteur de l’Art d’élever les lapins n’admet l’amour que dans le mariage;—il propose, en conséquence, un projet de loi dont voici les termes:
«Tout être qui se fréquenterait ne pourrait habiter ensemble qu’autant qu’ils auraient contracté leur union par-devant les lois.
»Aucun locataire, n’importe le sexe,—même dans ses propriétés, ne pourrait vivre deux comme mari et femme.»
L’auteur de l’Art d’élever les lapins—passe ensuite aux divisions qu’il a établies entre les femmes.
«La beauté étant le cadre qui nous flatte le plus, il attire à lui la société en général; le prince comme l’artisan espère l’obtenir; le prince a, pour arriver, ses titres et sa galanterie; le riche, sa fortune et les agréments qu’elle procure; l’artisan, pour qu’il réussisse auprès d’une belle, il lui faut de l’usage, de la douceur, de la prévenance, et surtout de la fidélité, car la beauté sait ce qu’elle vaut, et se voir préférer pour moins belle n’est pas pardonnable; et du plus bel ornement de la nature, par votre faute, vous en faites quelquefois un rebut.
»Vous voici, dit-il, au moment de votre choix.
»La haute société étant séparée des autres, j’ai peu d’observations à faire pour elle: l’éducation, la beauté, les grâces, la fortune, devant s’y trouver, le bonheur doit s’ensuivre; si cependant vous voulez le conserver, n’ayez jamais d’amis auprès de votre épouse, qui vous remplace; emmenez-la toujours avec vous partout où vous allez; elle voit vos actions, et la jalousie ne la dispose pas à vous manquer: les fêtes, plaisir et toilette variés; ajoutez à cela amitié, douceur et prévenance, vous y trouverez la félicité.
»Insouciante; cette classe de femmes est très-nombreuse, vous les trouvez partout, depuis le noble jusqu’au roturier; riche, pauvre, bonne ou méchante, elle est facile à séduire pour le bon motif, car ce n’est que l’occasion qui la fait accepter votre main; cependant, pour être heureux avec elle, voilà ce qu’il vous faut en partage; s’il est impossible, une qualité de plus ou de moins ne la fera pas décider plus tôt; pourvu que la douceur, le courage, la richesse, la beauté, l’esprit, les prévenances, la santé, et surtout ne pas lui promettre pour sa toilette, ses plaisirs ou son avenir que vous ne teniez parole; avec des chatteries et une bonne table, vous serez accepté pour époux et elle vous sera fidèle.
»Caractère difficile; ce genre de femmes est non-seulement rare, mais il se trouve dans toutes les classes de la société; celle protégée par la fortune et le rang, le personnel de sa maison souffre beaucoup, et il faut avoir faim pour y rester; l’homme assez hardi pour chercher à lui plaire doit être ferré à la glace. Celle douée de la beauté ne peut faire que des victimes; pour la séduire, il faut faire tout l’opposé de ce caractère; je vous dirai à tous: «Sauve qui peut, malheureux qui est pris.»
»Malingre; mon opinion est que c’est plutôt manie que maladie; la femme a pour prétexte les nerfs, la migraine, la poitrine, les coliques. L’agrément qu’il y a dans cette classe est qu’elle reste presque toujours chez elle ou sort fort peu, cela garantit de leur conduite; l’homme dont le choix tombe sur elle doit apporter, de rigueur, fortune ou courage, douceur et patience, esprit et fidélité; en dire davantage serait vous ennuyer; j’ai vu par moi-même que la femme peut faire et défaire le sort d’une maison; vous qui voulez vous établir, avant de vous présenter, faites votre entrée dans le monde, fréquentez toutes les classes de la société si votre fortune le permet; nous savons que le hasard fait beaucoup, ne comptons pas sur lui; la fidélité n’a qu’un habit, celui qui le met s’en sert jusqu’au tombeau: après lui le souvenir.»
Imprimerie de A. Saintain, rue Saint-Jacques, 38.
![]() Il faut croire que j’ai des ennemis bien acharnés dans l’imprimerie
de M. Lange Lévy.
Il faut croire que j’ai des ennemis bien acharnés dans l’imprimerie
de M. Lange Lévy.
Je ne puis obtenir qu’on imprime dans mes petits livres ce que je mets sur mon manuscrit.
Le dernier volume de la troisième année est rempli de fautes;—on écrit société pour facétie,—dix mille deux cents—pour douze cents. On mêle ensemble des choses qui n’ont aucun rapport entre elles;—on en sépare d’autres qui devraient être réunies, etc., etc.
![]() UNE MESURE INQUALIFIABLE.—M. Lestiboudois est à la fois député du
Nord—et médecin de l’hospice des aliénées à Lille.
UNE MESURE INQUALIFIABLE.—M. Lestiboudois est à la fois député du
Nord—et médecin de l’hospice des aliénées à Lille.
Un arrêté ministériel, provoqué par M. de Saint-Aignan, préfet du Nord, vient de destituer ce fonctionnaire.
Quelques journaux s’élèvent contre «cette inqualifiable mesure,—contre cette destitution faite, disent-ils, sous prétexte—que l’ordonnance du 18 décembre 1839—exige que les médecins restent dans l’asile des aliénées,—tandis que les fonctions législatives de M. Lestiboudois le retiennent à Paris pendant la plus grande partie de l’année.»
Ils ajoutent—«que l’ordonnance du 18 décembre,—bien interprétée,—ne fait pas une obligation impérieuse de la résidence.»
Il est incroyable que l’on ose ainsi chaque jour attaquer de front le plus simple bon sens. L’ordonnance du 18 décembre 1839 n’a qu’un tort à nos yeux,—c’est de ne pas avoir été rendue dès le jour où on a nommé un médecin pour l’hospice des aliénées.
Elle a un second tort si elle «ne fait pas une obligation impérieuse de la résidence.»
Il n’y a en effet là ni besoin d’ordonnance, ni d’arrêté, ni d’interprétation,—il n’y a besoin que de bonne foi et de bon sens.
Pourquoi donne-t-on un médecin aux aliénées? pour qu’il les soigne, probablement.
M. Lestiboudois soigne-t-il les aliénées de Lille—pendant les cinq ou six mois qu’il passe chaque année au Palais-Bourbon, à Paris?
Ceci est une question facile à résoudre.
On a assez ri du séjour habituel en Égypte et en Espagne de M. Taylor,—commissaire royal PRÈS le Théâtre-Français.
![]() Une aliénée est malade.
Une aliénée est malade.
«Où est le médecin?—A Paris.—Diable, c’est qu’elle a un coup de sang.—La session n’est plus bien longue; M. Lestiboudois sera de retour avant quatre mois d’ici.—En voici une qui est à la diète et qui demande à manger.—Le docteur n’y est pas.—Où est-il?—A Paris; qu’elle attende; il ne peut maintenant rester plus de deux mois ou deux mois et demi.»
![]() On dit, il est vrai, que M. Lestiboudois a un suppléant pendant ses
absences,—mais le suppléant vaut comme médecin M. Lestiboudois ou ne le
vaut pas.
On dit, il est vrai, que M. Lestiboudois a un suppléant pendant ses
absences,—mais le suppléant vaut comme médecin M. Lestiboudois ou ne le
vaut pas.
S’il le vaut, il a sur lui l’avantage de la résidence,—et alors il faut lui donner la place.
S’il ne le vaut pas,—il faut ou obliger M. Lestiboudois à remplir ses fonctions lui-même—ou donner la place à un homme qui inspire une confiance suffisante.
On a donc eu raison de destituer M. Lestiboudois.
Malheureusement,—les journaux qui disent une sottise en blâmant cette destitution—ont raison sur un autre point, ou du moins—je suis parfaitement de leur avis sur ledit point (c’est ce qu’on entend toujours quand on dit que quelqu’un a raison).
Ils disent que M. Lestiboudois est député de l’opposition, et que, s’il appartenait au ministère, on aurait fermé les yeux sur l’incompatibilité de ses fonctions.
Je le crois comme eux,—et j’en donnerais pour exemple les nombreux procureurs généraux et procureurs du roi qui abandonnent leurs postes pour venir siéger et surtout voter à Paris.
On a eu raison de destituer M. Lestiboudois, et on a eu tort de ne pas destituer ceux qui sont dans le même cas.
![]() Il y a un ouvrage qu’on devrait faire tous les quarts de
siècle,—c’est un dictionnaire, non pas un dictionnaire contenant
seulement les mots de la langue,—mais un dictionnaire servant à
traduire les dictionnaires précédents.—Les mots restent les mêmes, mais
ils changent de sens.—Chaque génération les prend dans une
acception:—il n’y a plus moyen de s’entendre.
Il y a un ouvrage qu’on devrait faire tous les quarts de
siècle,—c’est un dictionnaire, non pas un dictionnaire contenant
seulement les mots de la langue,—mais un dictionnaire servant à
traduire les dictionnaires précédents.—Les mots restent les mêmes, mais
ils changent de sens.—Chaque génération les prend dans une
acception:—il n’y a plus moyen de s’entendre.
Prenez le mot indépendance:
Un homme indépendant était autrefois celui qui, ne demandant rien,—n’acceptant rien,—n’espérant rien,—n’avait rien à craindre ni à rendre.
Si vous attachez le même sens au mot indépendant appliqué à nos hommes d’aujourd’hui,—vous ferez de lourds contre-sens.—En effet, l’indépendance n’est qu’un moyen de surfaire sa marchandise; c’est un bouchon de paille un peu plus gros que celui des autres.
Demandez dans les bureaux du ministère,—vous saurez que les députés indépendants sont ceux qui font le plus de demandes—et montrent le plus d’exigence.
Les électeurs envoient à la Chambre une foule de députés sous condition d’obtenir publiquement pour la ville un pont et un embranchement de chemin de fer, et tout bas pour tel et tel électeur un bureau de tabac, une bourse dans un collége, une croix, etc.
En ajoutant la recommandation d’être indépendant.
Il est évident que dans ce sens l’indépendance recommandée est destinée à être le prix des choses à obtenir.
![]() Pour le mot liberté:
Pour le mot liberté:
Si vous vous attachez au sens qu’il avait autrefois,—vous commettez les plus graves erreurs.
Il est bon d’être averti que la liberté est un mot au moyen duquel—les amis du peuple (autre mot à traduire) font faire au peuple des choses qui n’ont pour résultat possible que de le conduire en prison.
![]() Le dictionnaire dont le besoin se fait sentir, comme disent les
annonces, est un dictionnaire sur le modèle des dictionnaires
français-latin, c’est-à-dire traduisant les mots d’une langue dans une
autre langue,—du français d’autrefois au français d’aujourd’hui. C’est
un dictionnaire—français-français.
Le dictionnaire dont le besoin se fait sentir, comme disent les
annonces, est un dictionnaire sur le modèle des dictionnaires
français-latin, c’est-à-dire traduisant les mots d’une langue dans une
autre langue,—du français d’autrefois au français d’aujourd’hui. C’est
un dictionnaire—français-français.
Nous ferons donc un essai du dictionnaire—français-français, dont nous donnerons de temps en temps des fragments.
DICTIONNAIRE FRANÇAIS-FRANÇAIS.—A—Troisième personne du verbe avoir;—a aujourd’hui le même sens que le verbe être,—quand on dit: «Qu’est-ce que cet homme? on répond le plus souvent: «Il a cinquante mille livres de rente.»—C’est donc comme si on demandait: «Qu’est-ce que a cet homme? «—C’est l’application d’un vieux proverbe italien: «Chi non ha non è,—qui n’a pas n’est pas.»
![]() ABUS.—Les abus sont le patrimoine des deux tiers de la
nation;—ceux qui crient contre les abus ne veulent pas les détruire,
mais les confisquer à leur profit.—Il en est de même d’un homme qui,
couché avec un autre, se plaint qu’il tire à lui toute la couverture,
et, en même temps, la tirant de son côté, tâche d’en avoir à son tour un
peu plus que sa part.
ABUS.—Les abus sont le patrimoine des deux tiers de la
nation;—ceux qui crient contre les abus ne veulent pas les détruire,
mais les confisquer à leur profit.—Il en est de même d’un homme qui,
couché avec un autre, se plaint qu’il tire à lui toute la couverture,
et, en même temps, la tirant de son côté, tâche d’en avoir à son tour un
peu plus que sa part.
![]() ADMIRATION.—Vieux mot.—On n’admire plus;—il n’y a pas d’homme,
quels que soient son talent, son désintéressement, sa noblesse,—qui ne
soit de temps en temps fort maltraité dans quelque carré de
papier.—Quelques personnes affectent encore d’admirer les morts, mais
c’est pour déprécier les vivants plus à leur aise.
ADMIRATION.—Vieux mot.—On n’admire plus;—il n’y a pas d’homme,
quels que soient son talent, son désintéressement, sa noblesse,—qui ne
soit de temps en temps fort maltraité dans quelque carré de
papier.—Quelques personnes affectent encore d’admirer les morts, mais
c’est pour déprécier les vivants plus à leur aise.
![]() AMYGDALES.—Ne servaient autrefois qu’à sécréter la
salive;—aujourd’hui elles sécrètent force pièces d’or et d’argent pour
certains individus:—il y a tel chanteur auquel chaque son échappé de
son gosier rapporte une pièce de cinq francs,—c’est-à-dire la journée
de deux ouvriers.
AMYGDALES.—Ne servaient autrefois qu’à sécréter la
salive;—aujourd’hui elles sécrètent force pièces d’or et d’argent pour
certains individus:—il y a tel chanteur auquel chaque son échappé de
son gosier rapporte une pièce de cinq francs,—c’est-à-dire la journée
de deux ouvriers.
![]() ARBRE.—On peut lire dans les poëtes ce qu’étaient autrefois les
arbres avec leurs panaches verts pleins d’oiseaux et
d’amours;—aujourd’hui, depuis le gaz et l’asphalte, les arbres sont à
Paris de grands poteaux noirs,—sur lesquels on colle des affiches.
ARBRE.—On peut lire dans les poëtes ce qu’étaient autrefois les
arbres avec leurs panaches verts pleins d’oiseaux et
d’amours;—aujourd’hui, depuis le gaz et l’asphalte, les arbres sont à
Paris de grands poteaux noirs,—sur lesquels on colle des affiches.
![]() ARSENIC.—On a de tout temps un peu empoisonné ses parents, amis et
connaissances;—mais il est singulier que cette industrie, loin d’avoir
fait des progrès, soit au contraire retombée dans la
grossièreté.—Autrefois, on empoisonnait en faisant respirer une fleur,
en offrant des gants.—Aujourd’hui, vous voyez à chaque instant une
femme se défaire d’un mari incommode—au moyen de ce poison rustique,
appelé arsenic, dont les symptômes sont connus,—et que l’on retrouve à
l’instant même dans l’estomac;—quelqu’un, auquel j’ai soumis cette
observation, m’a répondu d’une manière peu consolante—qu’il semblait
qu’on empoisonne maladroitement, parce que les empoisonnements
maladroits sont les seuls découverts et punis.
ARSENIC.—On a de tout temps un peu empoisonné ses parents, amis et
connaissances;—mais il est singulier que cette industrie, loin d’avoir
fait des progrès, soit au contraire retombée dans la
grossièreté.—Autrefois, on empoisonnait en faisant respirer une fleur,
en offrant des gants.—Aujourd’hui, vous voyez à chaque instant une
femme se défaire d’un mari incommode—au moyen de ce poison rustique,
appelé arsenic, dont les symptômes sont connus,—et que l’on retrouve à
l’instant même dans l’estomac;—quelqu’un, auquel j’ai soumis cette
observation, m’a répondu d’une manière peu consolante—qu’il semblait
qu’on empoisonne maladroitement, parce que les empoisonnements
maladroits sont les seuls découverts et punis.
![]() ANNIVERSAIRE.—Vieux mot représentant un vieil usage dont la
suppression est inévitablement prochaine.—En effet, en ces temps de
revirement politique, les anniversaires présentent perpétuellement des
circonstances odieuses et ridicules à la fois.
ANNIVERSAIRE.—Vieux mot représentant un vieil usage dont la
suppression est inévitablement prochaine.—En effet, en ces temps de
revirement politique, les anniversaires présentent perpétuellement des
circonstances odieuses et ridicules à la fois.
Comment célébrer l’anniversaire des journées de Juillet quand un grand nombre des héros de Juillet sont en prison?
Comment célébrer l’anniversaire de la démolition de la Bastille quand on en bâtit quatorze?
![]() C’est un des inconvénients d’un gouvernement fondé sur la révolte
qu’il lui faut combattre ses propres éléments.
C’est un des inconvénients d’un gouvernement fondé sur la révolte
qu’il lui faut combattre ses propres éléments.
![]() AFFAIRES.—Un homme d’affaires est un monsieur qui a pour état de
faire ses affaires dans les vôtres.
AFFAIRES.—Un homme d’affaires est un monsieur qui a pour état de
faire ses affaires dans les vôtres.
![]() ABAISSEMENT DU PAYS.—Quand un journal, un député, un homme
politique, gémit sur l’abaissement du pays,—cela ne veut rien dire,
sinon—qu’il voudrait partager avec ses amis les places, les dignités et
l’argent.—En effet, si ledit homme politique renverse ses adversaires,
vous les entendez à leur tour pousser de semblables gémissements sur
l’abaissement du pays.—Abaissement du pays veut dire: déception de
ceux qui s’en plaignent.
ABAISSEMENT DU PAYS.—Quand un journal, un député, un homme
politique, gémit sur l’abaissement du pays,—cela ne veut rien dire,
sinon—qu’il voudrait partager avec ses amis les places, les dignités et
l’argent.—En effet, si ledit homme politique renverse ses adversaires,
vous les entendez à leur tour pousser de semblables gémissements sur
l’abaissement du pays.—Abaissement du pays veut dire: déception de
ceux qui s’en plaignent.
![]() ACTEUR.—Métier bizarre, qui consiste à venir grimacer devant
quinze cents personnes pour les faire rire ou pleurer par des lazzi
appris par cœur. On payait fort cher ces gens-là quand leur métier
était réputé infâme;—mais aujourd’hui qu’il est spécialement
considéré,—aujourd’hui que le peuple traîne le fiacre des
danseuses,—que la femme d’un ministre de l’intérieur reçoit une actrice
comme son amie intime,—il n’y a peut-être plus les mêmes raisons de les
payer aussi cher.
ACTEUR.—Métier bizarre, qui consiste à venir grimacer devant
quinze cents personnes pour les faire rire ou pleurer par des lazzi
appris par cœur. On payait fort cher ces gens-là quand leur métier
était réputé infâme;—mais aujourd’hui qu’il est spécialement
considéré,—aujourd’hui que le peuple traîne le fiacre des
danseuses,—que la femme d’un ministre de l’intérieur reçoit une actrice
comme son amie intime,—il n’y a peut-être plus les mêmes raisons de les
payer aussi cher.
Il peut paraître singulier en effet de comparer la magistrature au théâtre,—ce que l’on peut oser aujourd’hui que les comédiens sont reçus dans la société et y sont recherchés et prisés au moins à l’égal de tout le monde.
Un juge d’instruction reçoit quinze cents francs par an.
Un conseiller de cour royale trois mille francs.
Un président trois mille huit cents.
Et ces pauvres magistrats, obligés à une représentation convenable,—ne pouvant se livrer à aucune industrie, à aucun trafic, à aucun commerce, vivent dans la gêne; disons le mot, dans la pauvreté.
Voici, de ce que nous avançons, un exemple d’hier:
Il y a des comédiens qui n’ont pour tout talent qu’une infirmité ou une défectuosité.
Ils me rappellent ce saltimbanque qui, dans un tour d’équilibre, laisse tomber son enfant sur le pavé et lui casse une jambe: «Ah! maintenant, dit-il, tu as un bon état dans les mains,—tu te feras mendiant.»
Ainsi, Odry a l’air bête, Arnal a l’air sot, Alcide Tousez a l’air niais!—ôtez-leur cet air-là: ils sont ruinés.
M. Arnal plaidait l’autre jour pour faire rompre un engagement qui ne lui donnait que vingt-quatre mille francs par an, plus vingt francs par jour.
Eh bien! si, au lieu de paraître au tribunal de commerce, il se fût trouvé devant des juges ordinaires, on eût vu des magistrats, dont le plus cher payé ne reçoit pas quatre mille francs par an, invités à déclarer que trente et quelques mille francs ne payent pas suffisamment M. Arnal.
Joignez,—comme on veut absolument le faire de ce temps-ci,—de la considération à ces appointements exorbitants, les magistrats envieront les comédiens,—n’auront aucune raison, pour ne pas exploiter comme eux les négligences que la nature peut avoir commises en les créant, et voudront monter sur le théâtre.—Qui les remplacera?—Ce ne seront certes pas les acteurs,—ils ne le voudraient pas.
![]() ADULTÈRE.—Les peines infligées à la femme adultère—ont
singulièrement varié jusqu’à nos jours.
ADULTÈRE.—Les peines infligées à la femme adultère—ont
singulièrement varié jusqu’à nos jours.
Les Locriens—lui arrachaient les yeux.—La loi de Moïse la condamnait à mort.—Chez les anciens Saxons, on la pendait et on la brûlait.—Le roi Canut, chez les Anglais,—ordonna que la femme adultère eût les oreilles coupées.—Chez les Égyptiens, on lui coupait le nez.—Par la loi Julia, chez les Romains, on lui coupait la tête.—En Crête, on l’obligeait à porter une couronne de laine et on la faisait esclave.
Aujourd’hui, en France, quand une femme est surprise en adultère, on se moque de son mari.
![]() AUSTÈRE.—Austérité.—Quand un parti est obligé d’accepter, pour
faire nombre,—quelque allié d’une stupidité proverbiale,—qui n’a ni
talent, ni caractère,—on dit de lui qu’il est austère ou vertueux.
(Voir BONNE, une bonne personne.)
AUSTÈRE.—Austérité.—Quand un parti est obligé d’accepter, pour
faire nombre,—quelque allié d’une stupidité proverbiale,—qui n’a ni
talent, ni caractère,—on dit de lui qu’il est austère ou vertueux.
(Voir BONNE, une bonne personne.)
Être austère n’engage absolument à rien;—j’en sais des plus austères dont un mineur n’avouerait pas les fredaines.—Je connais un vertueux personnage politique qui a pour spécialité—de boire douze verres de vin de Champagne pendant que minuit sonne à une horloge.
![]() ADOLESCENCE.—Autrefois, printemps de la vie, plein de fleurs
suaves et charmantes.—C’est aujourd’hui un mot qui ne peut manquer de
tomber en désuétude, la chose qu’il exprimait n’existant plus.—La
jeunesse a cru montrer de la maturité en n’étant plus jeune; elle s’est
fort trompée; il n’y a point de fruits qui n’aient été précédés par les
fleurs; secouez l’arbre pour en faire tomber les fleurs au printemps, il
ne produira pas de fruits à l’automne.
ADOLESCENCE.—Autrefois, printemps de la vie, plein de fleurs
suaves et charmantes.—C’est aujourd’hui un mot qui ne peut manquer de
tomber en désuétude, la chose qu’il exprimait n’existant plus.—La
jeunesse a cru montrer de la maturité en n’étant plus jeune; elle s’est
fort trompée; il n’y a point de fruits qui n’aient été précédés par les
fleurs; secouez l’arbre pour en faire tomber les fleurs au printemps, il
ne produira pas de fruits à l’automne.
![]() AMADOU.—On ne trouve plus l’amadou que chez les pharmaciens,
sous le nom d’agaric,—pour arrêter l’hémorragie que cause quelquefois
la piqûre des sangsues. L’ancien briquet, si curieusement décrit par
Boileau, n’existe plus,—il a été remplacé par des allumettes
chimiques, des briquets phosphoriques, etc., etc., et toutes sortes
d’autres inventions infectes et dangereuses. La pierre et l’amadou—ne
donnaient du feu que quand on leur en demandait,—quelquefois même en se
faisant un peu solliciter;—mais les nouveaux briquets s’allument
d’eux-mêmes au moindre frottement dans une poche ou dans une malle;—une
allumette ne prend pas, on la jette par terre,—sous une table,—sur de
la paille, elle s’allume un quart d’heure après.—Un grand nombre des
incendies dont on parle si fréquemment aujourd’hui doit être attribué à
ce progrès de l’industrie.
AMADOU.—On ne trouve plus l’amadou que chez les pharmaciens,
sous le nom d’agaric,—pour arrêter l’hémorragie que cause quelquefois
la piqûre des sangsues. L’ancien briquet, si curieusement décrit par
Boileau, n’existe plus,—il a été remplacé par des allumettes
chimiques, des briquets phosphoriques, etc., etc., et toutes sortes
d’autres inventions infectes et dangereuses. La pierre et l’amadou—ne
donnaient du feu que quand on leur en demandait,—quelquefois même en se
faisant un peu solliciter;—mais les nouveaux briquets s’allument
d’eux-mêmes au moindre frottement dans une poche ou dans une malle;—une
allumette ne prend pas, on la jette par terre,—sous une table,—sur de
la paille, elle s’allume un quart d’heure après.—Un grand nombre des
incendies dont on parle si fréquemment aujourd’hui doit être attribué à
ce progrès de l’industrie.
![]() AGRAIRE.—Loi agraire.—La première loi agraire parut en l’an de
Rome 268;—elle avait pour but de partager entre les citoyens les terres
conquises sur l’ennemi.—Les citoyens y prirent goût, et, une quinzaine
de fois depuis, de nouveaux partages de terres furent proposés par
quelques tribuns qui n’en avaient pas. Les terres à partager, cette
fois, étaient celles des plus riches citoyens.
AGRAIRE.—Loi agraire.—La première loi agraire parut en l’an de
Rome 268;—elle avait pour but de partager entre les citoyens les terres
conquises sur l’ennemi.—Les citoyens y prirent goût, et, une quinzaine
de fois depuis, de nouveaux partages de terres furent proposés par
quelques tribuns qui n’en avaient pas. Les terres à partager, cette
fois, étaient celles des plus riches citoyens.
La loi agraire a été de tous temps le rêve de beaucoup d’amis du peuple, gênés dans leurs affaires particulières; on aime assez à partager les biens des autres.—Un des inconvénients d’une loi agraire,—et un des moindres,—serait de ne rien changer absolument. Faites aujourd’hui un partage égal entre tous—et, avant dix ans, le travail, l’astuce, l’avidité, l’industrie, l’avarice d’une part,—la paresse, l’insouciance, la droiture, la prodigalité d’autre part, le hasard des deux côtés,—auront rétabli les choses en l’état où elles sont aujourd’hui.
![]() ARCHITECTE.—Un architecte apprend pendant dix ans à faire des
temples grecs—pour finir par construire péniblement des appartements de
cinq cents francs de loyer, sous la direction d’un maître maçon; je ne
me rends pas bien compte de l’art des architectes:—leurs plus sublimes
inventions sont renfermées dans les combinaisons peu variées que l’on
peut faire avec cinq chapiteaux de colonnes qui, du reste, font un effet
affreux quand ils sont mélangés,—comme on le fait assez volontiers
aujourd’hui;—ce qui réduit l’art de l’architecte à décider quel ordre
il adoptera entre cinq,—ou plutôt, si l’on regarde nos monuments
modernes, quel monument ancien il copiera honteusement.
ARCHITECTE.—Un architecte apprend pendant dix ans à faire des
temples grecs—pour finir par construire péniblement des appartements de
cinq cents francs de loyer, sous la direction d’un maître maçon; je ne
me rends pas bien compte de l’art des architectes:—leurs plus sublimes
inventions sont renfermées dans les combinaisons peu variées que l’on
peut faire avec cinq chapiteaux de colonnes qui, du reste, font un effet
affreux quand ils sont mélangés,—comme on le fait assez volontiers
aujourd’hui;—ce qui réduit l’art de l’architecte à décider quel ordre
il adoptera entre cinq,—ou plutôt, si l’on regarde nos monuments
modernes, quel monument ancien il copiera honteusement.
![]() AIR.—L’air est au moins aussi indispensable à la vie que les
aliments.—En conséquence, il a été longtemps considéré comme chose de
première nécessité.
AIR.—L’air est au moins aussi indispensable à la vie que les
aliments.—En conséquence, il a été longtemps considéré comme chose de
première nécessité.
On serait fort étonné si l’on savait que des gens, pour un avantage quelconque, se résignent à ne manger habituellement que le tiers ou le quart de ce qui leur est nécessaire;—on ne s’étonne pas que des gens passent une partie de leur vie à s’efforcer d’arriver à avoir le droit de s’enfermer cinq heures par jour dans une grande chambre où ils sont quatre cent cinquante à se disputer l’air qui suffirait à peine à cent cinquante hommes.
Il est prouvé par la chimie que, pour qu’un homme respire librement et sans souffrance, il lui faut au moins six mètres cubes d’air par heure.
Dans les théâtres, on n’a pas le quart de cette quantité d’air, pas le cinquième à la Chambre des députés.
Ceci est le résultat d’analyses exactes faites par les chimistes les plus distingués.
![]() APÔTRES.—Les apôtres deviennent fort rares,—tout le monde se
déclarant dieu dans sa petite sphère—et personne n’admettant plus ni
hiérarchie ni autorité.
APÔTRES.—Les apôtres deviennent fort rares,—tout le monde se
déclarant dieu dans sa petite sphère—et personne n’admettant plus ni
hiérarchie ni autorité.
![]() ASSASSINS.—Jouissent d’une assez grande considération.—Beaucoup
de femmes ont obtenu des autographes de Fieschi.—Nous parlions, le
mois dernier, d’une femme célèbre, qui, dit-on, porte sur son cœur
des cheveux d’un autre assassin.—On a imprimé de fort mauvais vers d’un
nommé Lacenaire, et les éditeurs de ces vers ont raconté avec orgueil
leurs conversations avec ce Mandrin prétentieux.
ASSASSINS.—Jouissent d’une assez grande considération.—Beaucoup
de femmes ont obtenu des autographes de Fieschi.—Nous parlions, le
mois dernier, d’une femme célèbre, qui, dit-on, porte sur son cœur
des cheveux d’un autre assassin.—On a imprimé de fort mauvais vers d’un
nommé Lacenaire, et les éditeurs de ces vers ont raconté avec orgueil
leurs conversations avec ce Mandrin prétentieux.
On a vu récemment de quels égards,—disons plus,—de quelle admiration était entourée une femme qui avait empoisonné son mari.
Nous avons signalé plusieurs fois deux classes de philanthropes, dont Dieu devrait bien délivrer la France,—si la protection qu’il lui accorde n’est pas simplement un faux bruit que font courir et M. Persil, en sa qualité de directeur de la Monnaie, et les pièces de cent sous.
L’une de ces deux classes de philanthropes fait des essais qui aggravent d’une façon horrible les peines infligées par la loi, essais qui condamnent au désespoir, à la folie, au suicide, des gens que la loi et la vengeance publique ne condamnent qu’à quelques années de prison.
![]() La seconde classe des philanthropes, au contraire, est prise d’une
tendre pitié pour les assassins; elle ne songe qu’à les entourer de
toutes les douceurs de la vie, ce qui ne contribue pas peu à les
maintenir dans leur voie.
La seconde classe des philanthropes, au contraire, est prise d’une
tendre pitié pour les assassins; elle ne songe qu’à les entourer de
toutes les douceurs de la vie, ce qui ne contribue pas peu à les
maintenir dans leur voie.
![]() Le jury, de son côté,—trouve presque toujours dans les crimes les
plus horribles des circonstances dites atténuantes,—qui ne laissent pas
de donner ainsi quelques encouragements.
Le jury, de son côté,—trouve presque toujours dans les crimes les
plus horribles des circonstances dites atténuantes,—qui ne laissent pas
de donner ainsi quelques encouragements.
![]() ASSISES.—Cour d’assises.—Je ne sais pourquoi on ne donne pas un
peu plus de majesté aux chambres de justice, invariablement ornées, pour
le fond, d’une sorte de paravent en papier bleu de l’effet le plus
déplorable.—C’est bien assez des avocats, et quelquefois du jury, pour
y mêler du mesquin et du ridicule.
ASSISES.—Cour d’assises.—Je ne sais pourquoi on ne donne pas un
peu plus de majesté aux chambres de justice, invariablement ornées, pour
le fond, d’une sorte de paravent en papier bleu de l’effet le plus
déplorable.—C’est bien assez des avocats, et quelquefois du jury, pour
y mêler du mesquin et du ridicule.
![]() ALCHIMIE.—Cette science, qui consistait autrefois à chercher les
moyens de faire de l’or,—par la transsubstantiation des métaux,—a fait
aujourd’hui de notables progrès;—elle consiste encore aujourd’hui à
faire de l’or,—mais on y arrive d’une manière certaine,—et ce ne sont
plus des métaux que l’on met dans la cornue,—mais bien toutes sortes
d’un rare usage,—telles que—la probité, la liberté, les douces
affections, l’amour-propre, la dignité, la justice, etc., etc.
ALCHIMIE.—Cette science, qui consistait autrefois à chercher les
moyens de faire de l’or,—par la transsubstantiation des métaux,—a fait
aujourd’hui de notables progrès;—elle consiste encore aujourd’hui à
faire de l’or,—mais on y arrive d’une manière certaine,—et ce ne sont
plus des métaux que l’on met dans la cornue,—mais bien toutes sortes
d’un rare usage,—telles que—la probité, la liberté, les douces
affections, l’amour-propre, la dignité, la justice, etc., etc.
![]() AMARYLLIS.—Voir AMBROISIE.
AMARYLLIS.—Voir AMBROISIE.
![]() ANNONCES.—Procédé par lequel—les journaux—se font les paillasses
chargés d’attirer la foule par leurs lazzis, autour de tous les
charlatans de l’époque.
ANNONCES.—Procédé par lequel—les journaux—se font les paillasses
chargés d’attirer la foule par leurs lazzis, autour de tous les
charlatans de l’époque.
![]() AUTEL.—Manière vicieuse dont M. de Rambuteau, préfet de la Seine,
écrit le mot hôtel.
AUTEL.—Manière vicieuse dont M. de Rambuteau, préfet de la Seine,
écrit le mot hôtel.
![]() AMAZONES.—Les anciennes amazones se brûlaient, dit-on, le
sein—pour tirer plus commodément de l’arc;—les amazones modernes, au
contraire,—loin de diminuer aussi brutalement leurs attraits,—ont
adopté un costume qui en montre—au moyen des jupes de crinoline ou de
la ouate, un peu plus que la plupart n’en ont réellement.
AMAZONES.—Les anciennes amazones se brûlaient, dit-on, le
sein—pour tirer plus commodément de l’arc;—les amazones modernes, au
contraire,—loin de diminuer aussi brutalement leurs attraits,—ont
adopté un costume qui en montre—au moyen des jupes de crinoline ou de
la ouate, un peu plus que la plupart n’en ont réellement.
![]() AMBROISIE.—Liqueur dont parlaient beaucoup les poëtes—à l’époque
où, mis en dehors des plaisirs de la vie,—ils étaient obligés de les
suppléer par des fictions.—L’ambroisie est aujourd’hui remplacée par
le vin de Champagne, qu’ils boivent réellement.—Ils ont également
remplacé les Amaryllis, les Iris, Églé,—auxquelles ils
adressaient autrefois leurs vers, par des comtesses de***, des marquises
de*** et des duchesses également de trois étoiles; je désire pour eux
que les unes soient plus réelles que n’étaient les autres.
AMBROISIE.—Liqueur dont parlaient beaucoup les poëtes—à l’époque
où, mis en dehors des plaisirs de la vie,—ils étaient obligés de les
suppléer par des fictions.—L’ambroisie est aujourd’hui remplacée par
le vin de Champagne, qu’ils boivent réellement.—Ils ont également
remplacé les Amaryllis, les Iris, Églé,—auxquelles ils
adressaient autrefois leurs vers, par des comtesses de***, des marquises
de*** et des duchesses également de trois étoiles; je désire pour eux
que les unes soient plus réelles que n’étaient les autres.
![]() AIGUILLE.—Les femmes s’en servaient à une époque où elles
comprenaient qu’il était plus beau d’inspirer des vers que d’en faire
soi-même.—Beaucoup ont remplacé l’aiguille par la plume,—quelques-unes
par le cigare.
AIGUILLE.—Les femmes s’en servaient à une époque où elles
comprenaient qu’il était plus beau d’inspirer des vers que d’en faire
soi-même.—Beaucoup ont remplacé l’aiguille par la plume,—quelques-unes
par le cigare.
![]() ALMANACH.—Un almanach a été longtemps—un petit livre ou un
carré de carton—spécialement destiné à dire le jour du mois,—le
quartier de la lune—et les éclipses de soleil.
ALMANACH.—Un almanach a été longtemps—un petit livre ou un
carré de carton—spécialement destiné à dire le jour du mois,—le
quartier de la lune—et les éclipses de soleil.
Le double Liégeois—y ajoutait «l’art de savoir l’heure qu’il est à midi au moyen d’une paille» et un certain nombre de bons mots attribués à des Gascons—et commençant toujours par cadédis!
On fait aujourd’hui pour le peuple des almanachs politiques assez curieux.
En voici un dans lequel on trouve les phrases que voici;—quoiqu’elles soient de M. le vicomte de Cormenin,—elles font regretter les cadédis du double Liégeois:
«De tous les gouvernocrates sous lesquels nous avons eu depuis cinquante ans le bonheur de vivre, il n’y en a pas de plus inconséquents que ceux de ce quart d’heure-ci.»
Que veut dire gouvernocratie?
Nous avons démocratie, qui veut dire gouvernement du peuple;—aristocratie, qui veut dire gouvernement des meilleurs ou de la noblesse.
Ces deux mots sont formés de deux mots grecs.
Gouvernocratie—est formé d’un mot grec et d’un mot de l’invention de M. de Cormenin:—la gouvernocratie est le gouvernement des gouvernements.
«Si la loi se tait, ils la font parler:—si elle ne dit pas un mot de ce qu’ils veulent qu’elle dise, ils la tordent, ils la tirent dans tous les carrefours pour en frapper au visage tous les citoyens, ils montent à l’échelle—et ils placardent leur loi.»
Quel langage! bon Dieu!
![]() AVOCAT.—Lire les Guêpes depuis trois ans.
AVOCAT.—Lire les Guêpes depuis trois ans.
![]() APPRENTISSAGE.—Mot qui n’a plus aucun sens dans la langue:—on
n’apprend plus, on sait.
APPRENTISSAGE.—Mot qui n’a plus aucun sens dans la langue:—on
n’apprend plus, on sait.
Qu’un adolescent,—ayant l’intention d’écrire, se présente dans un journal;—la première chose qu’on lui confiera, c’est la critique littéraire;—il fera paraître à sa barre tous les plus grands talents et il les traitera dédaigneusement,—leur reprochant leurs fautes et leur enseignant comment il faut faire.
On prend les législateurs et les ministres dans la classe des fabricants de drap, des épiciers, des raffineurs de sucre.
![]() ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE.—L’agent d’une société d’assurances
contre l’incendie vous persécute pendant trois mois, s’introduit chez
vous sous cent prétextes, vous envoie sous bande les récits des
incendies que racontent les journaux;—enfin, vous cédez, vous vous
faites assurer. L’agent vous aide dans l’estimation de votre mobilier.
ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE.—L’agent d’une société d’assurances
contre l’incendie vous persécute pendant trois mois, s’introduit chez
vous sous cent prétextes, vous envoie sous bande les récits des
incendies que racontent les journaux;—enfin, vous cédez, vous vous
faites assurer. L’agent vous aide dans l’estimation de votre mobilier.
—Pour combien faites-vous assurer vos tableaux?
—Mes tableaux?—je n’ai pas de tableaux.
—Eh bien! et ces cadres?
—De mauvaises croûtes.
—Mais non,—mais non, c’est meilleur que vous ne pensez;—faites-moi assurer ça pour dix mille francs.
—Mais ils ne valent pas cinq cents francs. Je ne veux pas voler votre Compagnie, qui aurait à me rembourser en cas d’incendie—une somme dix fois égale à la valeur de mes images.
—Vous ne la volez pas le moins du monde, la spéculation consiste à payer peut-être une forte somme—et à recevoir certainement un grand nombre de petites—proportionnées à la grosse somme qu’on espère bien ne pas payer;—les risques et les chances sont calculés.—L’assurance est un pari:—je parie dix mille francs une fois pour toutes que vos tableaux ne brûleront pas;—vous pariez tous les ans une certaine somme qu’ils brûleront. Ceci est comme l’ex-loterie:—on vous donnait soixante-quinze mille francs pour vingt sous,—mais il y avait tant de chances contre vous, que vous apportiez pendant toute votre vie vos vingt sous tous les deux jours—et qu’on ne vous donnait jamais les soixante-quinze mille francs.
Vous cédez,—votre conscience est calmée, vous n’avez plus peur de voler la Compagnie.
Au bout d’un an, de cinq ans, de dix ans, vos tableaux brûlent.
La Compagnie cherche d’abord si elle ne pourrait pas vous faire guillotiner,—ou au moins vous envoyer aux galères, en établissant que vous y avez mis le feu à dessein;—si elle ne réussit pas,—comme on a sauvé quelques morceaux de cadre, dans lesquels restent une jambe ou une tête, on vous explique que vous n’avez subi qu’un sinistre partiel, et qu’il est juste de procéder à une estimation.—On vous défend alors de rentrer chez vous; on met les scellés sur votre logis;—si vous dérangez une épingle, l’assurance ne répond plus de rien,—vous rendez son expertise impossible.
On traîne en longueur,—on élève des difficultés;—beaucoup de gens se découragent, s’impatientent,—ou sont obligés de se servir des choses qu’ils ont chez eux,—et renoncent à l’assurance.
Vous êtes plus persévérant, vous ne vous rebutez ni des retards ni des ambages.
La Compagnie fait évaluer par des experts la valeur réelle des tableaux qui sont brûlés;—on a recours aux marchands qui vous les ont vendus. Et on vous indemnise sur cette estimation,—après que vous avez payé pendant dix ans une somme proportionnée à la valeur fictive à laquelle on vous avait fait porter vos tableaux; et le tour est fait.
![]() AVANT-SCÈNE.—L’avant-scène, dans certains théâtres,—remplace les
bancs qu’on mettait autrefois sur le théâtre et sur lesquels les
élégants d’alors venaient prendre place, se mêlant aux acteurs par leurs
gestes et par leur voix, empêchant le public de voir et d’entendre.
AVANT-SCÈNE.—L’avant-scène, dans certains théâtres,—remplace les
bancs qu’on mettait autrefois sur le théâtre et sur lesquels les
élégants d’alors venaient prendre place, se mêlant aux acteurs par leurs
gestes et par leur voix, empêchant le public de voir et d’entendre.
Les spectateurs de l’avant-scène—paraissent décidés à faire partie du spectacle;—leur mise, leurs gestes affectés, leurs poses, leur ton de voix élevé, tout l’annonce d’une manière certaine.
![]() ADMINISTRATION.—Aucun ministre ne se mêle
d’administration,—tous sont absorbés par ce qu’on appelle les
questions politiques,—c’est-à-dire par le soin de rester en place.
ADMINISTRATION.—Aucun ministre ne se mêle
d’administration,—tous sont absorbés par ce qu’on appelle les
questions politiques,—c’est-à-dire par le soin de rester en place.
L’administration est faite au moyen de quelques vieilles routines et de quelques vieux chefs de bureau.
Il n’en peut, du reste, être autrement à une époque où un ferblantier ambitieux—ou un marchand de parapluies qui sent baisser son aptitude, peuvent devenir députés et ministres, pourvu qu’ils soient attachés à un parti qui arrive aux affaires.
![]() AMOUR.—Il est bien rare qu’on n’éprouve pas un étonnement mêlé de
désappointement en voyant pour la première fois l’objet d’une grande
passion.—On cherche le plus souvent en vain dans les charmes de la
personne aimée—l’explication de l’amour qu’elle a inspiré.
AMOUR.—Il est bien rare qu’on n’éprouve pas un étonnement mêlé de
désappointement en voyant pour la première fois l’objet d’une grande
passion.—On cherche le plus souvent en vain dans les charmes de la
personne aimée—l’explication de l’amour qu’elle a inspiré.
En effet, l’amour est tout dans celui qui aime;—l’aimé n’est qu’un prétexte.
Voici une statue,—le sculpteur a voulu en faire un dieu;—peu importe qu’il ait réussi à lui donner l’air de la majesté et de la puissance:—ce n’est pas le sculpteur qui fait le dieu,—c’est le premier manant qui se mettra à genoux devant la statue et qui la priera.—Faites un Jupiter plus beau que le Jupiter Olympien,—ce ne sera qu’une belle statue.—Allez voir dans l’église d’Étretat une bûche peinte en bleu et en rouge et appelée saint Sauveur,—vous verrez un dieu.
![]() AMOUR DU PEUPLE.—C’est un rôle qu’on joue et pas autre
chose;—c’est un emploi qu’on adopte en montant sur la scène politique;
on joue les amis du peuple, comme sur d’autres théâtres on joue les
Trial ou les Elleviou.
AMOUR DU PEUPLE.—C’est un rôle qu’on joue et pas autre
chose;—c’est un emploi qu’on adopte en montant sur la scène politique;
on joue les amis du peuple, comme sur d’autres théâtres on joue les
Trial ou les Elleviou.
Les prétendus amis du peuple—l’ont de tout temps poussé à la paresse, à la pauvreté, à la révolte, à la prison et à la mort.
![]() AMITIÉ.—Il n’est personne qui ne veuille avoir un ami;—mais où
sont les gens qui s’occupent d’en être un!
AMITIÉ.—Il n’est personne qui ne veuille avoir un ami;—mais où
sont les gens qui s’occupent d’en être un!
On se construit un type de Pylade—devoué, humble, obéissant, prêt à toutes les corvées,—et on gémit de ne pas le trouver.—Demander un ami ainsi fait, sans avoir bien examiné si on est prêt à être ce qu’on veut qu’il soit,—ce n’est pas montrer une âme tendre, comme le croient ceux qui remplissent l’air de leurs plaintes à ce sujet,—c’est faire un vœu d’avare pareil à celui de désirer cent mille livres de rente.
![]() AMITIÉ DES FEMMES.—A la rigueur, il pourrait y avoir de l’amitié
entre deux hommes qui n’auraient ni le même état ni les mêmes
prétentions,—et dont aucun n’aurait rendu de services importants à
l’autre.
AMITIÉ DES FEMMES.—A la rigueur, il pourrait y avoir de l’amitié
entre deux hommes qui n’auraient ni le même état ni les mêmes
prétentions,—et dont aucun n’aurait rendu de services importants à
l’autre.
Mais, les femmes ayant toutes le même état, qui est celui d’être jolies et de plaire,—il ne peut y avoir d’amitié entre deux femmes, à moins qu’une des deux ne soit laide et vieille, le sache, le croie,—ne veuille le cacher à personne, et ait de bonne foi donné sa démission de femme.
![]() B.—Lettre qui remplace momentanément la lettre M pour l’austère
M. Passy, qui est depuis huit jours enrhumé du cerveau,—ce qui le
condamnait, il y a deux ou trois jours, à dire: «Je ne peux pas banger
de bouton.»
B.—Lettre qui remplace momentanément la lettre M pour l’austère
M. Passy, qui est depuis huit jours enrhumé du cerveau,—ce qui le
condamnait, il y a deux ou trois jours, à dire: «Je ne peux pas banger
de bouton.»
![]() BALADIN.—BATELEUR.—(Voyez ACTEUR.)
BALADIN.—BATELEUR.—(Voyez ACTEUR.)
![]() BAÏONNETTES.—Un officier français assistant à l’exercice à feu
d’un régiment prussien—ne put s’empêcher d’admirer la précision des
tireurs.
BAÏONNETTES.—Un officier français assistant à l’exercice à feu
d’un régiment prussien—ne put s’empêcher d’admirer la précision des
tireurs.
—Eh bien! lui dit un général prussien,—que pensez-vous de cela?
—Je pense, reprit le Français, que je suis de l’avis de beaucoup de mes camarades;—nous voulons proposer au ministre de la guerre de supprimer la poudre dans l’armée française,—et de ne plus admettre que l’usage de la baïonnette.
Nous avons parlé déjà, à plusieurs reprises, de l’admirable invention des politiques de ce temps-ci,—qui ont imaginé les baïonnettes intelligentes,—c’est-à-dire une armée composée de quatre cent mille hommes,—chacun agissant à sa guise et d’après ses idées particulières.
Un digne pendant a été presque en même temps trouvé à cette remarquable découverte,—c’est-à-dire une administration dans laquelle personne n’obéit à personne.
On jouit en ce moment d’un spécimen agréable de fonctionnaires indépendants.—MM. Hourdequin, Morin et autres employés de la préfecture de la Seine sont occupés à répondre en cour d’assises au sujet d’actes d’INDÉPENDANCE poussée jusqu’à la prévarication et la concussion.
![]() BADE.—Autrefois était une ville d’Allemagne. Aujourd’hui ce nom
s’applique à deux ou trois villages des environs de Paris,—où certains
élégants peu riches vont se cacher pendant trois mois,—pour dire à leur
rentrée à Paris—qu’ils viennent de Baden-Baden—ou de quelque autre
lieu de plaisir et de faste.
BADE.—Autrefois était une ville d’Allemagne. Aujourd’hui ce nom
s’applique à deux ou trois villages des environs de Paris,—où certains
élégants peu riches vont se cacher pendant trois mois,—pour dire à leur
rentrée à Paris—qu’ils viennent de Baden-Baden—ou de quelque autre
lieu de plaisir et de faste.
![]() BAILLONNER.—Ce mot, autrefois, signifiait l’action de mettre à un
homme un bâillon qui l’empêchait de parler.—Aujourd’hui un journal
injurie le roi, les ministres, provoque un peu le peuple à la révolte et
se plaint à sa troisième page de ce que l’on bâillonne la presse.—Un
avocat ayant à défendre un voleur, défend en même temps le vol, et
propose une loi agraire à main armée;—il termine en disant: «Je
m’arrête, bâillonné que je suis par la partialité du ministère
public.»
BAILLONNER.—Ce mot, autrefois, signifiait l’action de mettre à un
homme un bâillon qui l’empêchait de parler.—Aujourd’hui un journal
injurie le roi, les ministres, provoque un peu le peuple à la révolte et
se plaint à sa troisième page de ce que l’on bâillonne la presse.—Un
avocat ayant à défendre un voleur, défend en même temps le vol, et
propose une loi agraire à main armée;—il termine en disant: «Je
m’arrête, bâillonné que je suis par la partialité du ministère
public.»
Bâillonné n’a donc plus le sens qu’il avait autrefois; un homme bâillonné est un homme qui n’a plus rien à dire et qui veut faire croire qu’il s’arrête volontairement.
![]() BANLIEUE.—Campagne des Parisiens,—le Parisien, fatigué de l’air
épais de la ville,—va respirer l’air pur des champs;—il va dans un
village où les maisons sont entassées dans la boue,—il dîne dans un
salon de cent cinquante couverts,—et revient enchanté de sa journée—et
de ses plaisirs champêtres.
BANLIEUE.—Campagne des Parisiens,—le Parisien, fatigué de l’air
épais de la ville,—va respirer l’air pur des champs;—il va dans un
village où les maisons sont entassées dans la boue,—il dîne dans un
salon de cent cinquante couverts,—et revient enchanté de sa journée—et
de ses plaisirs champêtres.
![]() BÉNIR.—L’autorité, qui poursuit avec tant d’exactitude des
publications politiques, ennuyeuses, que personne ne lirait sans cela, a
laissé représenter des pièces d’une immoralité plus effrayante qu’on n’a
voulu le voir.
BÉNIR.—L’autorité, qui poursuit avec tant d’exactitude des
publications politiques, ennuyeuses, que personne ne lirait sans cela, a
laissé représenter des pièces d’une immoralité plus effrayante qu’on n’a
voulu le voir.
La fameuse pièce de Robert-Macaire—a fourni des formules facétieuses pour une foule de choses, dont ceux mêmes qui les faisaient n’osaient pas parler;—la police correctionnelle présente chaque jour des épreuves nouvelles de ce modèle offert au peuple.
La bénédiction paternelle,—une des choses les plus touchantes et les plus respectables,—est tombée dans le domaine du ridicule;—il y a bien des jeunes gens braves et courageux, prêts à se faire tuer pour une bagatelle,—combien y en a-t-il qui oseraient dire tout haut, dans une société d’autres gens: «Mon père m’a donné hier soir sa bénédiction,» depuis qu’on nous a représenté le baron de Wormspire bénissant sa fille,—et Robert-Macaire disant: «Voilà un gaillard qui bénit bien.»
![]() BÉSICLES.—Les bésicles ou les lunettes—sont la marque d’une
infirmité fâcheuse.—D’où vient que ceux qui en portent en tirent à
leurs propres yeux une grande importance, montrent par leur attitude,
leur manière de porter la tête, de parler, et, en un mot, par un air
capable et dédaigneux, qu’ils prennent cela pour une supériorité sur
ceux qui ont de bons yeux?
BÉSICLES.—Les bésicles ou les lunettes—sont la marque d’une
infirmité fâcheuse.—D’où vient que ceux qui en portent en tirent à
leurs propres yeux une grande importance, montrent par leur attitude,
leur manière de porter la tête, de parler, et, en un mot, par un air
capable et dédaigneux, qu’ils prennent cela pour une supériorité sur
ceux qui ont de bons yeux?
C’est une chose réelle,—que j’ai remarquée cent fois, mais dont je n’ai pu jusqu’ici deviner la raison.
![]() BAVARDER.—Le pays a été saisi depuis un certain nombre d’années
d’une fièvre de bavardage inouïe dans les fastes de la sottise
humaine.—Tout le monde veut parler,—on a recours pour cela à des
subterfuges incroyables.—On veut être député,—ou membre du conseil
municipal,—ou membre d’une société savante,—ou d’une société
philanthropique,—ou littéraire, ou de sauvetage,—ou
d’horticulture,—non pour sauver des naufragés, non pour faire des
recherches, mais pour parler; on ne cause plus, on ne rit plus, on ne
chante plus;—on parle,—tout le monde parle et tout le monde parle à la
fois;—les gens de la tour de Babel,—gens peu avancés, se séparèrent
quand ils virent qu’ils ne s’entendaient plus,—aujourd’hui, grâce aux
progrès, on ne s’arrête pas pour si peu.—Qu’est-ce que fait de ne pas
comprendre à des gens qui n’écoutent pas, et qui ne veulent que parler?
(Voir AVOCAT.)
BAVARDER.—Le pays a été saisi depuis un certain nombre d’années
d’une fièvre de bavardage inouïe dans les fastes de la sottise
humaine.—Tout le monde veut parler,—on a recours pour cela à des
subterfuges incroyables.—On veut être député,—ou membre du conseil
municipal,—ou membre d’une société savante,—ou d’une société
philanthropique,—ou littéraire, ou de sauvetage,—ou
d’horticulture,—non pour sauver des naufragés, non pour faire des
recherches, mais pour parler; on ne cause plus, on ne rit plus, on ne
chante plus;—on parle,—tout le monde parle et tout le monde parle à la
fois;—les gens de la tour de Babel,—gens peu avancés, se séparèrent
quand ils virent qu’ils ne s’entendaient plus,—aujourd’hui, grâce aux
progrès, on ne s’arrête pas pour si peu.—Qu’est-ce que fait de ne pas
comprendre à des gens qui n’écoutent pas, et qui ne veulent que parler?
(Voir AVOCAT.)
![]() BARON.—Tout le monde prenant à son gré aujourd’hui des titres de
comte et de marquis,—celui de baron ne vaut pas la peine d’être
usurpé,—et c’est le seul qui m’inspire quelque confiance; il n’y a que
ceux qui l’ont réellement qui s’avisent de le porter:—les autres ont
aussitôt fait de prendre un titre plus élevé.
BARON.—Tout le monde prenant à son gré aujourd’hui des titres de
comte et de marquis,—celui de baron ne vaut pas la peine d’être
usurpé,—et c’est le seul qui m’inspire quelque confiance; il n’y a que
ceux qui l’ont réellement qui s’avisent de le porter:—les autres ont
aussitôt fait de prendre un titre plus élevé.
![]() BALAYER.—Les portiers de Paris ont l’ordre de balayer le devant de
leur porte.
BALAYER.—Les portiers de Paris ont l’ordre de balayer le devant de
leur porte.
En conséquence, tout portier du côté des numéros pairs—pousse ses ordures de l’autre côté du ruisseau contre les numéros impairs;—les portiers des numéros impairs poussent leurs ordures contre les bornes des numéros pairs.
![]() BANAL.—Banalités.—On n’applaudit pas la plus belle chose du
monde la première fois qu’elle est dite;—pour cela il faut juger
soi-même et risquer d’applaudir seul:—c’est un courage qui est
peut-être le moins vulgaire de tous les courages.
BANAL.—Banalités.—On n’applaudit pas la plus belle chose du
monde la première fois qu’elle est dite;—pour cela il faut juger
soi-même et risquer d’applaudir seul:—c’est un courage qui est
peut-être le moins vulgaire de tous les courages.
Il y a des sottises banales,—que les gens d’esprit ne veulent pas dire et qui rapportent gros aux imbéciles.
![]() BABEL.—(Voir BAVARDER.)
BABEL.—(Voir BAVARDER.)
![]() BAPTÊME.—Quelqu’un, je ne sais qui,—a imaginé une assez belle
expression—pour les soldats qui pour la première fois assistent à une
bataille:—ce quelqu’un a dit qu’ils recevaient le baptême du feu.
BAPTÊME.—Quelqu’un, je ne sais qui,—a imaginé une assez belle
expression—pour les soldats qui pour la première fois assistent à une
bataille:—ce quelqu’un a dit qu’ils recevaient le baptême du feu.
On a abusé de ce mot,—ou plutôt on l’a parodié sérieusement;—il y a un parti en France,—qui dans son opposition au gouvernement a accepté une position si dangereuse et si radicale à la fois, qu’il lui faut prendre la défense de tout ce que le gouvernement attaque,—à tort ou à raison.—Quelques voleurs ont dû à ce système un grand appui—et une importance politique assez curieuse;—on en est venu à faire à un homme un mérite de tout démêlé avec la justice,—et l’on a créé cette expression, qui a été à plusieurs reprises employée sérieusement par des gens qui affichent des prétentions à la gravité: «—Il a reçu le baptême de la police correctionnelle.»—Ce qui a fait un peu de tort à cette phrase, c’est que plusieurs des héros auxquels on l’avait attribuée—ont reçu ultérieurement la confirmation des travaux forcés.
![]() BANQUET.—Il y a une dizaine d’années—que j’ai dit pour la
première fois ce que je pensais des banquets politiques, alors fort en
honneur;—j’ai dit la vérité sur ces ripailles où les chansons à boire
étaient remplacées par des discours mêlés de hoquets;—je peignis nos
représentants se disant entre eux: «La patrie est en danger, mangeons du
veau.» Je fis une image fidèle de ces gueuletons où tout le monde parle,
où personne n’écoute, et où on commence à régler les plus graves
intérêts du pays à un moment où il serait fort difficile aux convives de
regagner leur demeure sans le secours d’un fiacre, et de gagner le
fiacre sans le secours d’un garçon.
BANQUET.—Il y a une dizaine d’années—que j’ai dit pour la
première fois ce que je pensais des banquets politiques, alors fort en
honneur;—j’ai dit la vérité sur ces ripailles où les chansons à boire
étaient remplacées par des discours mêlés de hoquets;—je peignis nos
représentants se disant entre eux: «La patrie est en danger, mangeons du
veau.» Je fis une image fidèle de ces gueuletons où tout le monde parle,
où personne n’écoute, et où on commence à régler les plus graves
intérêts du pays à un moment où il serait fort difficile aux convives de
regagner leur demeure sans le secours d’un fiacre, et de gagner le
fiacre sans le secours d’un garçon.
Je n’ai atteint qu’un but:—chaque parti a adopté mon appréciation pour les banquets de ses adversaires,—mais non pour les siens.
![]() BOURGEOIS.—Dans les procès de la presse, le jury qui prononce a
aussi un jugement à entendre à son tour. Si le journal incriminé gagne
son procès, il appelle les jurés sauvegardes des libertés de la
France—et raconte comme quoi il a été acquitté par l’élite du
pays.—S’il est au contraire condamné,—le jury est une institution
usée, et le journal a succombé devant de stupides bourgeois.
BOURGEOIS.—Dans les procès de la presse, le jury qui prononce a
aussi un jugement à entendre à son tour. Si le journal incriminé gagne
son procès, il appelle les jurés sauvegardes des libertés de la
France—et raconte comme quoi il a été acquitté par l’élite du
pays.—S’il est au contraire condamné,—le jury est une institution
usée, et le journal a succombé devant de stupides bourgeois.
![]() BATIFOLER.—On connaît la façon dont les paysans entendent
l’amour:—des coups de coude, des tapes bien appliquées,—toutes sortes
de niches brutales,—sont pour eux les premières expressions d’une
véritable flamme; mais la plupart des filles des champs savent que ce
n’est qu’un prélude.
BATIFOLER.—On connaît la façon dont les paysans entendent
l’amour:—des coups de coude, des tapes bien appliquées,—toutes sortes
de niches brutales,—sont pour eux les premières expressions d’une
véritable flamme; mais la plupart des filles des champs savent que ce
n’est qu’un prélude.
Je rencontre l’autre jour une petite fille de douze ans,—à la mine éveillée;—elle avait le teint animé.—Je lui demande d’où elle vient!
—Eh! des bois donc.
—Et qu’allais-tu faire aux bois?
—J’étais avec mon amoureux donc.
—Et qu’est-ce que tu faisais au bois avec ton amoureux.
—Et vous l’savais ben.
Je me sentis un peu embarrassé,—effrayé même de la précocité de la bergère.
—Non, vraiment, je ne le sais pas.
—Vous riais,—je vous dis q’vous l’savais ben.
—Je t’assure que non.
—Vous voulais m’faire croire qu’vous n’savais point c’qu’une fille va fare au bois avec son amoureux?
—Peut-être les autres, mais toi.
—Moi, comme les aut’donc!
—Enfin que faisais-tu?
—Vous l’savais ben—que je vous dis.
—Eh! non.
—Eh ben,—j’nous j’tions d’la tarre—donc.
![]() BONNE.—Une bonne personne, dans la bouche d’une femme qui parle
d’une autre femme,—veut dire que la femme dont elle parle—est laide,
mal faite et bête.
BONNE.—Une bonne personne, dans la bouche d’une femme qui parle
d’une autre femme,—veut dire que la femme dont elle parle—est laide,
mal faite et bête.
C’est dire qu’elle a la bonté de n’être pas une rivale possible.
Une femme bien faite—est une femme qui est maigre et qui a des marques de petite vérole. (Voir AUSTÈRE,—AUSTÉRITÉ.)
Économie de bouts de chandelles.—Les alinéa.—Une lettre de faire part.—Qui est le mort?—Le Télémaque et M. Victor Hugo.—Le procès Hourdequin.—M. Froidefond de Farge.—Un poëte.—Les philanthropes et les prisonniers de Loos.—M. Dumas, M. Jadin, et Milord.—Une lettre de M. Gannal.—M. Gannal et la gélatine.—Une récompense.—Le privilége de M. Ancelot.—Amours.—Les chemins de fer.—L’auteur des GUÊPES excommunié.—Un Dieu-mercier.—Ciel dudit.—Un marchand de nouveautés donne la croix d’honneur à son enseigne.—Le chantage.—Histoire d’une innocente.—Histoire d’une femme du monde et d’un cocher.—Dictionnaire français-français.—Suite de la lettre B.
![]() Il n’y a qu’un sot qui puisse se moquer d’un homme qui a un mauvais
habit, mais on a le droit de rire de celui qui porte des bijoux faux, ou
qui se promène au bois de Boulogne sur un mauvais cheval.—On est obligé
d’avoir un habit,—donc on l’a comme on peut, et tel qu’on peut;—mais
on n’est pas obligé d’avoir des diamants ni d’avoir un cheval.
Il n’y a qu’un sot qui puisse se moquer d’un homme qui a un mauvais
habit, mais on a le droit de rire de celui qui porte des bijoux faux, ou
qui se promène au bois de Boulogne sur un mauvais cheval.—On est obligé
d’avoir un habit,—donc on l’a comme on peut, et tel qu’on peut;—mais
on n’est pas obligé d’avoir des diamants ni d’avoir un cheval.
La pauvreté fastueuse est la plus triste et la plus ridicule chose qui soit au monde.
Voyez, à Paris, cette place qui a si souvent changé de nom et qu’on appelle, je crois, aujourd’hui, place de la Concorde.—Je ne veux pas vous parler des fontaines mal dorées,—qui ne donnent d’eau qu’à une certaine heure,—ni des détestables statues qui les décorent;—je ne prétends mentionner ici que le nombre prodigieux de lanternes de mauvais goût dont est parsemée la place.
Certes, ces lanternes,—telles qu’elles ont été établies dans l’origine sur cette place immense, laissant échapper chacune une quantité de gaz,—de beaucoup inférieure à celle qui éclaire les plus petites boutiques de Paris,—ces lanternes répandaient une clarté déjà fort douteuse.
On regrettait qu’on n’eût pas imaginé de placer sur cette place—quelque grand foyer de lumière.
Mais aujourd’hui—on en est venu,—par une hideuse lésine, à fermer aux deux tiers les tuyaux déjà insuffisants du gaz,—et il ne reste sur la place de la Révolution qu’une vingtaine de veilleuses vacillantes,—qui ne servent qu’à augmenter, par une morne scintillation, l’incertitude et les hésitations de l’obscurité.
De plus, attendu qu’il y a beaucoup de lanternes sur la place de la Concorde,—on n’allume pas, ou on n’allume qu’à moitié les lanternes des rues adjacentes.
Ceci nous paraît être fait dans l’intérêt d’autres voleurs encore—que les voleurs qui travaillent le soir dans les rues.
![]() Deux de nos journalistes les plus spirituels—causaient
dernièrement ensemble à l’Opéra.—L’un des deux est nouvellement marié,
l’autre est depuis peu célibataire.
Deux de nos journalistes les plus spirituels—causaient
dernièrement ensemble à l’Opéra.—L’un des deux est nouvellement marié,
l’autre est depuis peu célibataire.
—Comment trouvez-vous votre nouvelle situation? demanda le premier.
—Mais, fort bonne... et vous, que dites-vous de la vôtre?
—Ah! mon bon ami, il n’y a que d’être marié, voyez-vous; je travaille et j’ai ma femme à côté de moi; à chaque alinéa, je l’embrasse,—c’est charmant!
—Ah! je comprends,—dit l’autre en s’inclinant vers la femme de son confrère, qui paraissait fort attentive au spectacle,—je comprends pourquoi votre style est maintenant si haché.
Le célibataire a raconté les confidences du nouveau marié.—Ceux auxquels il en a parlé les ont, à leur tour, racontées à d’autres,—et chaque lundi—on compte curieusement combien il y a d’alinéas dans le feuilleton de l’heureux époux.—Il s’établit à ce sujet les discussions les plus singulières pour ceux qui ne sont pas initiés.
—Comment! il n’a mis là que point et virgule?
—Oui.
—Comme les hommes sont inconstants! Il pouvait mettre un point.
—Le sens n’indique que point virgule.
—Oui,—mais sa femme est si jolie,—j’aurais mis un point.
—Pauvre petite femme! le dernier feuilleton est bien compacte!
![]() J’ai déjà parlé de cet usage peu décent qui se glisse, depuis
quelque temps, à propos des lettres de faire part.
J’ai déjà parlé de cet usage peu décent qui se glisse, depuis
quelque temps, à propos des lettres de faire part.
Autrefois le mort avait la place d’honneur, et c’était au bas de la lettre—qu’on mettait: de la part de ***, de *** et de ***.
Aujourd’hui les parents et héritiers—commencent par vous annoncer leurs noms et prénoms, titres, emplois, décorations, etc.; puis, quand tout est fini, quand il ne reste plus rien à dire sur eux-mêmes, ils vous apprennent accessoirement en deux lignes que monsieur un tel est mort,—et que ce monsieur un tel avait pour titres et dignités l’honneur d’être père, oncle et cousin des remarquables personnages mentionnés plus haut.
Voici de cette inconvenance un des exemples les plus frappants qui me soient encore tombés sous la main.
«M. S*** Mais***, négociant à Lesay, ancien militaire, ancien notaire, ancien maire, ancien suppléant du juge de paix, ancien membre du conseil d’arrondissement, ancien membre du conseil général, et actuellement membre du conseil municipal de sa commune, du comice agricole de Melle et de la Société d’agriculture de Niort; M. L*** R***, notaire à Sauzé, membre du conseil d’arrondissement et du conseil municipal de sa commune, et mademoiselle Louise L*** R***, ont l’honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu’ils viennent de faire, le 19 de ce mois, de madame S*** Mai***, L*** M*** Berl***, leur épouse, belle-mère et grand’mère.»
![]() Ce nouveau mode a plusieurs inconvénients:
Ce nouveau mode a plusieurs inconvénients:
1º En lisant: «M. M***, ancien militaire, ancien notaire, ancien maire, ancien suppléant du juge de paix, ancien membre du conseil d’arrondissement, ancien membre du conseil général,» vous pouvez supposer que ce monsieur, qui n’est plus tant de choses, n’est peut-être plus vivant,—a quitté la vie avec tous ses honneurs et que c’est lui que vous êtes invité à pleurer;—vous vous le tenez pour dit—et vous n’en lisez pas davantage.—Quelque temps après vous le rencontrez dans la rue,—quand vous l’avez suffisamment regretté et quand vous êtes entièrement consolé de sa perte.
2º Ennuyé de tant de parents, de tant de dignités, de tant de gloire,—vous n’allez pas jusqu’au bout, vous jetez le papier au feu,—et, deux mois après, vous allez tranquillement faire une visite à madame Berl***—la vraie défunte,—vous la demandez au concierge, lequel vous répond qu’elle est toujours morte. Il est vrai que la lettre de faire part est à deux fins,—et qu’elle annonce à la fois la perte douloureuse de madame Berl*** et celle des titres de notaire, de suppléant de juge de paix,—de maire, etc., etc.
Rapprochez cette lettre d’une autre lettre publiée par le même M. Mais*** le 26 juillet 1842—et où l’on trouve—après deux ou trois pages consacrées à l’éloge de son administration comme maire de Lesay:—«Si j’ai parlé de ce que j’ai fait pour mon endroit, qu’on n’aille pas croire que j’y mets de la vanité;—non, je n’en ai jamais été affublé.»
![]() Vers 1793,—je crois, un navire appelé Télémaque—sombra devant
Quillebœuf,—près du Havre-de-Grâce. On fit plusieurs récits à ce
sujet. D’immenses richesses, dit-on, avaient été cachées dans ce navire,
dont le chargement de bois de construction n’était qu’un
prétexte.—Plusieurs millions et une énorme quantité de vaisselle
d’argent étaient enfouis dans les flancs du vaisseau submergé.—Deux
Sociétés par actions se sont, depuis quelques années, fondées pour le
sauvetage du Télémaque.—Le gouvernement a mis de son côté toute la
bonne grâce possible:—il a fait l’abandon de la part que la loi lui
accorde,—ne réservant qu’un cinquième pour les invalides de la
marine,—et «le droit d’acheter, par préférence, les objets d’art qui
pouvaient se trouver dans le vaisseau.»
Vers 1793,—je crois, un navire appelé Télémaque—sombra devant
Quillebœuf,—près du Havre-de-Grâce. On fit plusieurs récits à ce
sujet. D’immenses richesses, dit-on, avaient été cachées dans ce navire,
dont le chargement de bois de construction n’était qu’un
prétexte.—Plusieurs millions et une énorme quantité de vaisselle
d’argent étaient enfouis dans les flancs du vaisseau submergé.—Deux
Sociétés par actions se sont, depuis quelques années, fondées pour le
sauvetage du Télémaque.—Le gouvernement a mis de son côté toute la
bonne grâce possible:—il a fait l’abandon de la part que la loi lui
accorde,—ne réservant qu’un cinquième pour les invalides de la
marine,—et «le droit d’acheter, par préférence, les objets d’art qui
pouvaient se trouver dans le vaisseau.»
La première tentative n’a pas réussi.—La seconde Société a été plus heureuse, et on a vu le navire sortir du sable—et paraître à fleur d’eau.
On a pensé alors à émettre les actions qui restaient encore. «Allons, messieurs, on voit le navire.—Voulez-vous marcher sur le pont? vous n’aurez de l’eau que jusqu’aux genoux. Prenez des actions.—Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans les immenses richesses probablement cachées dans le Télémaque—dans le Télémaque sur lequel vous marchez; prrrrenez les actions!»
Mais bientôt un bruit courut dans la ville du Havre: «M. Victor Hugo ne veut pas qu’on achève le sauvetage du Télémaque.»
Et pourquoi M. Victor Hugo ne veut-il pas?
Voilà la chose:
M. Victor Hugo s’est présenté avec son frère, M. Abel Hugo, chez l’agent de la Société à Paris, et il a fait opposition au sauvetage du Télémaque—parce qu’il y a dedans quelques millions y déposés par un oncle de ces messieurs, appelé archevêque Hugo.—Ils réclament leurs millions.
Ceci fit grand effet. «M. Hugo a tort, disaient les uns.—M. Hugo a raison, répondaient les autres.—Il y a prescription, s’écriaient ceux-là.—Il n’y a pas prescription, répliquaient ceux-ci.—Il y a plus de trente ans.—Oui, mais il n’y a pas eu de nouveau propriétaire en faveur duquel on puisse invoquer la prescription; l’espace écoulé n’est qu’une parenthèse dans la propriété: M. Hugo est dans son droit.»
Et quelques-uns disaient: «Vous voyez bien qu’il y a dans ce navire des richesses infinies,—puisque la famille Hugo réclame déjà des sommes énormes.—Prrrrenez des actions!»
J’allai alors à Paris,—et je demandai à M. Hugo,—comme on le demandait au Havre: «Ah ça! pourquoi ne voulez-vous pas qu’on amène à terre le Télémaque?»
A quoi M. Hugo me répondit qu’il ne connaissait d’autre Télémaque que le fils d’Ulysse;—le Télémaque de Fénelon, qu’on en pouvait bien faire ce qu’on voulait, qu’il ne s’en souciait en aucune façon,—et ne le lisait pas.
Je lui appris alors de quoi il était question;—il fut très-étonné, ne renia pas son oncle l’archevêque, mais m’apprit qu’il était mort depuis plus de cent cinquante ans, et que, par conséquent, il n’était pas probable qu’il eût mis ses richesses sur le Télémaque en 1793.
Le Télémaque est toujours entre deux eaux,—mais je suis heureux de faire savoir aux habitants du Havre que M. Hugo—ne s’oppose pas à ce qu’on amène le Télémaque à terre,—ne fût-ce que pour voir en quel état se trouvent les tableaux que le gouvernement s’est réservé le droit d’acheter.
Ce qui m’inquiète pour la conservation de ces tableaux, c’est qu’un marin m’a apporté un anneau de la chaîne de l’ancre du Télémaque, et que cet anneau est plus d’à moitié rongé.
![]() Le procès des employés de la ville de Paris—accusés de
prévarication s’est terminé par la condamnation des principaux accusés à
trois et à quatre ans de prison.
Le procès des employés de la ville de Paris—accusés de
prévarication s’est terminé par la condamnation des principaux accusés à
trois et à quatre ans de prison.
Mais, par un oubli plus singulier, il n’est nullement question de restitution envers les propriétaires que ces messieurs, de leur autorité et par leurs manœuvres, ont condamnés à la misère à perpétuité.
![]() Un témoin—auquel, dans l’affaire Hourdequin,—le président
demandait s’il reconnaissait le principal accusé—n’a pu contenir un
mouvement d’indignation en voyant l’auteur de sa ruine—et a ajouté à sa
réponse affirmative une épithète plus juste qu’agréable.
Un témoin—auquel, dans l’affaire Hourdequin,—le président
demandait s’il reconnaissait le principal accusé—n’a pu contenir un
mouvement d’indignation en voyant l’auteur de sa ruine—et a ajouté à sa
réponse affirmative une épithète plus juste qu’agréable.
Le président, M. Froidefond de Farge, a été assez malheureux pour dire: «Témoin, taisez-vous, et RESPECTEZ LE MALHEUR.»
![]() Il résulte de ceci, entre autres choses,—qu’il y a en France trop
de fonctionnaires et qu’ils ne sont pas assez payés;—qu’il y a un
danger qui se glisse dans toutes les existences:—c’est que toutes les
classes de la société ont augmenté leurs besoins et leurs dépenses,—et
que les salaires diminuent partout;—plus mille autre choses que je
dirai une autre fois.
Il résulte de ceci, entre autres choses,—qu’il y a en France trop
de fonctionnaires et qu’ils ne sont pas assez payés;—qu’il y a un
danger qui se glisse dans toutes les existences:—c’est que toutes les
classes de la société ont augmenté leurs besoins et leurs dépenses,—et
que les salaires diminuent partout;—plus mille autre choses que je
dirai une autre fois.
![]() Pendant le procès Hourdequin, le président, le procureur du roi et
tous les avocats—ont fait des allusions plus ou moins directes—à ceci:
Pendant le procès Hourdequin, le président, le procureur du roi et
tous les avocats—ont fait des allusions plus ou moins directes—à ceci:
«La loi reconnaît coupable et punit le corrupteur comme le corrompu.—Pourquoi ceux qui ont corrompu les accusés ne sont-ils pas assis à côté d’eux et enveloppés dans la même accusation?»
Le président, le procureur du roi et les avocats avaient raison sur une des faces de la question.
Les gens qui avaient donné de l’argent aux employés de la ville doivent être divisés en deux classes.—Les uns sont des spéculateurs—qui donnaient à ces messieurs une partie de leurs bénéfices;—l’avidité et la corruption entraient dans leurs calculs:—ceux-là sont complices et devaient être jugés.—Les autres sont des propriétaires menacés dans leur fortune et persuadés avec raison qu’ils ne sauveraient une partie de leur patrimoine qu’en sacrifiant l’autre partie; ils ont fait la part du feu:—ceux-ci sont des victimes, ils devraient être indemnisés.
On n’a ni jugé les premiers ni indemnisé les seconds.
![]() On m’envoie un livre belge qui explique suffisamment le besoin
qu’éprouvent les libraires belges de n’imprimer que des livres
français;—voici quelques échantillons des vers français de M. K.
Kersch.
On m’envoie un livre belge qui explique suffisamment le besoin
qu’éprouvent les libraires belges de n’imprimer que des livres
français;—voici quelques échantillons des vers français de M. K.
Kersch.
Pardon, monsieur Kersch,—je ne veux pas vous chicaner sur votre second vers, qui a deux syllabes de trop,—mais je désire vous demander une explication sur le sens des deux vers.—Votre criminel dit qu’il a tué son semblable—et il s’intitule lui-même monstre dégoûtant:—le semblable d’un monstre dégoûtant est un autre monstre dégoûtant,—alors ce semblable ne peut pas être un homme bien innocent.
Ou, s’il est un homme bien innocent et en même temps le semblable de votre parricide,—votre parricide est forcément le semblable de ce semblable;—donc il serait également un homme bien innocent—et en même temps un monstre dégoûtant et un parricide.—Tout cela est difficile à arranger.
Encore un vers un peu long;—mais si M. Kersch fait des vers trop longs assez souvent, il n’en fait jamais de courts,—ce qui prouve que ce n’est pas par défaut de fécondité,—mais que, au contraire, son génie est à l’étroit dans les douze syllabes de notre vers français.
«Ensanglante le sable» n’est pas très-exact.—M. Kersch ne connaît pas une horrible histoire qu’on raconte dans les ateliers,—histoire où le grotesque est singulièrement mêlé à l’horrible;—histoire que je vous dirai quelque jour où elle me paraîtra plus grotesque qu’horrible.—Dans cette histoire, le criminel—arrive sur l’échafaud, regarde le panier qui va recevoir sa tête—et il s’écrie: «Minute, minute!—qu’est-ce que c’est que ça?—qu’est-ce qu’il y a dans le panier? c’est pas de la sciure de bois, au moins; j’ai droit à du son, j’exige du son.»
Qu’est-ce, me direz-vous, qu’un air centicolore?—Vous n’avez jamais vu de pareil air au ciel; je le crois bien, mon bon ami;—mais vous n’êtes pas poëte;—vous croyez qu’un poëte qui ne dort pas—va voir simplement ce que vous voyez.*—Quoi! les étoiles, fleurs de feu, dans les peupliers noirs,—les lucioles, violettes de feu sous l’herbe!—vous croyez qu’il entendra, comme vous et moi,—le bruit lointain de la mer, qu’il respirera—les odeurs des fleurs qui s’ouvrent le soir pour les papillons de nuit!—Allons donc, c’est à la portée de tout le monde, cela: c’est commun, c’est vulgaire;—parlez-moi, à la bonne heure, de voir un ciel qui a l’air centicolore; voilà ce qui vaut la peine de ne pas dormir, de prendre du café ou de ne pas lire les vers de M. Kersch.
Il paraît qu’il y a quelque part un philosophe, belge probablement,—qui a osé dire qu’il fallait dormir la nuit;—mais, comme notre poëte le réfute, comme il le traite de philosophe arbitraire,—c’est-à-dire de tyran, comme il réclame hautement le droit de ne pas dormir,
Après avoir remarqué cette image neuve du trépas à la large crinière, passons à un sujet moins triste;—passons à l’éloge de M. le comte de Liedekerke-Beaufort, ancien gouverneur de Liége:
Mais aussi quand M. Liedekerke cessa d’occuper le banc de père des Liégeois, ce fut un grand chagrin dans la ville:
Voici des peintures riantes:—c’est le printemps:
Les jeunes hommes se baignent.
Il paraît qu’en Belgique les étangs sont comme le trépas: ils ont la crinière extrêmement large.
Ce que c’est que de voyager!—j’ai vraiment regret de toutes les irrévérences que j’ai laissé échapper maintes fois à l’égard des voyages—et du gros livre que je fais en ce moment contre eux.
Si j’étais allé en Belgique,—j’aurais vu des zéphyrs velus;—j’ai passé presque toute ma vie aux bords de la mer,—dans mon jardin,—et je n’ai jamais vu de zéphyrs velus.
Mais continuons:
M. Kersch—sort de chez lui et va errer dans le bois; il raconte ce qu’il y trouva:
Je ne pense pas que M. Kersch prétende que la belle noire qu’il rencontre ait des corbeaux pour cheveux,—comme les furies avaient des serpents.—Si nous cherchons un autre sens, nous trouvons que les cheveux de corbeaux sont des plumes,—donc il faut ne voir ici qu’une figure hardie pour exprimer que la belle avait des cheveux noirs comme l’aile d’un corbeau.
Ah! ah!—la belle noire est une blanche. Eh bien! tant mieux.
Le vers est long;—mais faites donc entrer tant de perfections dans un vers de sept syllabes!
Pourquoi blanchâtre—quand la gorge est d’albâtre?—Ah çà! définitivement, de quelle couleur est la belle noire? Pourquoi blanchâtre?—Peut-être la belle a du duvet sur ses bras d’albâtre, ce qui les rend blanchâtres ou grisâtres; je n’aime pas trop cela, mais c’est peut-être très-bien porté en Belgique.
M. Kersch—s’approche,
Alors la bergère exhale son désespoir:
Dit-elle,
La bergère ne fait rien de tout cela cependant, et il faut convenir que c’est bien de sa part.
Quand elle a mugi et déchiré ses habits, elle tire un poignard.—M. Kersch s’élance, la désarme
La bergère lui raconte ses malheurs:—elle veut mourir parce que son amant ne vient pas; mais tout à coup,—derrière M. Kersch, paraît l’amant injustement accusé;—la bergère renaît au bonheur, et dit à M. Kersch:
Je dirai comme la bergère,—comme la belle noire aux bras blanchâtres:
L’ouvrage se trouve à Liége,—imprimerie de DESSAIN, libraire, place Saint-Lambert.
![]() ENCORE LES PHILANTHROPES!—A une lieue de Lille est l’abbaye de
Loos;—c’est une des principales maisons de détention de France: elle
contient trois mille prisonniers.
ENCORE LES PHILANTHROPES!—A une lieue de Lille est l’abbaye de
Loos;—c’est une des principales maisons de détention de France: elle
contient trois mille prisonniers.
Si on lisait les condamnations des malheureux qui y sont renfermés,—on verrait qu’ils sont simplement condamnés à tant de mois ou d’années de prison.
Mais cette prison est livrée aux philanthropes de la seconde classe,—c’est-à-dire à ceux qui ont imaginé le régime cellulaire,—au moyen duquel les prisonniers deviennent, en moins de deux ans, fous ou enragés.
On condamne les prisonniers de l’abbaye de Loos au silence absolu,—qui est une nuance du régime cellulaire.
Le directeur actuel a,—dit-on,—demandé plusieurs fois l’autorisation d’accorder, comme récompense, aux prisonniers qui le mériteraient par leur conduite, un petit morceau de tabac et un verre de bière.
Il assure—que la passion de ces malheureux pour le tabac et la peine qu’ils éprouvent de s’en voir privés sont si grandes, que l’espoir d’en obtenir pour deux sous par semaine sur le prix de leur travail remplacerait—et avec plus d’efficacité, chez tous, tous sans exception, la crainte des châtiments et du cachot.
Cette demande du directeur est jusqu’ici restée sans résultats.
Je ne crois pas que l’administration ait le droit d’aggraver ainsi le régime des prisons.—Le régime cellulaire est une atrocité.
Un ministre ne peut l’autoriser sans l’assentiment des Chambres.—Quand un homme est condamné à la prison, on n’a pas plus le droit de l’isoler ainsi,—surtout après les horribles résultats qu’on en a vus,—que de lui faire trancher la tête.
![]() Les Impressions de voyage de Dumas sont le plus souvent un petit
drame—dans lequel paraissent invariablement, comme personnages
principaux, d’abord Dumas lui-même,—puis Jadin le peintre,—puis
Milord, le chien de Jadin.
Les Impressions de voyage de Dumas sont le plus souvent un petit
drame—dans lequel paraissent invariablement, comme personnages
principaux, d’abord Dumas lui-même,—puis Jadin le peintre,—puis
Milord, le chien de Jadin.
Dumas transporte ses deux compagnons, non pas seulement dans tous les pays où il va,—mais encore dans tous ceux où il lui plaît d’être allé.
Ainsi, il n’est pas rare que Jadin, dans son atelier de la rue des Dames, lise avec autant de plaisir que de surprise quelques reparties heureuses que lui, Jadin, aurait faites la veille à un pâtre sicilien. A chaque instant il lui faut endosser des responsabilités imprévues.
Il rencontre un ami—qui lui dit:
—Nous avons fait, il y a quinze jours, un souper ravissant;—nous voulions t’inviter, mais nous avons vu, par un feuilleton de Dumas, que tu étais en Suisse avec lui.
—Eh bien! monsieur, lui dit une femme,—je comprends à présent pourquoi vous n’aviez pas le temps de m’écrire,—moi qui vous croyais malade à Paris,—quand j’apprends par un feuilleton de M. Alexandre Dumas—que vous étiez avec lui à Livourne,—où vous preniez le menton d’une fille d’auberge.
—Pourquoi, diable, mon cher ami, faites-vous ainsi des plaisanteries sur le gouvernement pontifical?
—Moi, je n’ai jamais parlé du gouvernement pontifical.
—Allons donc,—c’est dans le journal.
Un soir,—j’étais alors voisin de Jadin,—il vint me chercher pour souper:—il avait un certain pâté.—Nous partons,—nous entrons à l’atelier, nous ne trouvons que Milord tenant entre ses pattes un restant de la croûte de pâté qu’il achevait de manger.—Quelques jours après,—je lus dans un feuilleton de Dumas que ce même jour où Milord, pour Jadin et pour moi, n’avait été que trop à Paris,—le même Milord avait montré les dents à un lazarone à Naples.
Si Milord avait su lire,—cela lui aurait servi à prouver à Jadin son alibi au moment du crime, et à ne pas recevoir une certaine quantité de coups de cravache.
Ceux qui voient souvent reparaître Milord dans les Impressions de voyage d’Alexandre Dumas ne seront peut-être pas fâchés de savoir que c’est un affreux bouledogue blanc.
![]() J’ai reçu de M. Gannal une lettre raisonnablement longue,—avec
deux présents: l’un est un ouvrage de lui, accompagné de plusieurs
brochures sur divers sujets;—l’autre, «une promesse formelle de
m’embaumer pour rien, après ma mort.»—Je remercie M. Gannal de ses
gracieusetés, je suis surtout sensible à la délicate attention qui lui a
fait ainsi fixer la date de son bienfait à une époque aussi convenable.
J’ai reçu de M. Gannal une lettre raisonnablement longue,—avec
deux présents: l’un est un ouvrage de lui, accompagné de plusieurs
brochures sur divers sujets;—l’autre, «une promesse formelle de
m’embaumer pour rien, après ma mort.»—Je remercie M. Gannal de ses
gracieusetés, je suis surtout sensible à la délicate attention qui lui a
fait ainsi fixer la date de son bienfait à une époque aussi convenable.
M. Gannal me reproche mes coupables plaisanteries.
Je plaisante, le plus souvent, beaucoup moins que je ne le parais.
Si vous sautez à pieds joints sur une vessie pleine d’air,—la vessie glissera sous vos pieds, et vous fera tomber;—si, au contraire, vous la piquez tout doucement de la pointe d’une épingle, l’air qui la gonflait s’échappera—et elle restera plate et vide.
La plupart des grandes choses de ce temps-ci—sont des vessies gonflées de vent, de paroles de vanité;—j’ai choisi l’arme que m’a paru contre elles la plus efficace.
D’ailleurs,—placé par mes goûts,—par mes idées,—par mes habitudes,—en dehors de toutes les ambitions; ne désirant rien, et, par conséquent, ne redoutant rien—de ce qu’on désire et de ce qu’on redoute,—je vois les choses à peu près ce qu’elles sont, et il en est bien peu que je puisse prendre au sérieux.
Néanmoins, j’ai blâmé qu’on ne se fût pas servi pour l’embaumement du duc d’Orléans du procédé de M. Gannal,—qui paraît être, sous plusieurs rapports,—préférable à ceux connus antérieurement,—mais j’ai blâmé également la forme peu convenable des réclamations de M. Gannal.
Je n’ai même pas voulu parler alors d’un bruit qui a couru sur le dernier archevêque de Paris, lequel, embaumé par M. Gannal,—aurait été cependant enterré, exhalant une odeur qui ne doit pas être—ce qu’on appelle «odeur de sainteté,»—parce que ce n’était qu’un bruit.
J’ai vu dans les brochures que M. Gannal a bien voulu m’envoyer—sa lutte longue et ardente contre les préjugés de l’Académie de médecine—à propos de la gélatine.—Il a été reconnu depuis dix ans que la gélatine ne contient aucun principe nutritif—et qu’elle est, au contraire, fort malsaine,—au point que les animaux soumis à ce régime, dit alimentaire,—meurent plus promptement de faim que ceux auxquels on ne donne que de l’eau claire.
L’Académie de médecine—n’en a pas encore prescrit l’emploi dans les hôpitaux.
On ne saurait dire combien de malheureux ont ainsi été condamnés à la mort la plus horrible.
On doit louer M. Gannal—de sa courageuse persistance.—Je lui rappellerai à ce sujet que, depuis plus de trois ans, les Guêpes—se sont élevées à plusieurs reprises—contre cette désastreuse philanthropie,—et qu’il y a dix ans,—j’ai parlé dans un livre—appelé le Chemin le plus court—des philanthropes—qui, dans les hôpitaux,—font mourir les malades de faim en se glorifiant d’avoir inventé à leur usage—du bouillon de boutons de guêtres.
Ces plaisanteries paraîtront sans doute moins coupables à M. Gannal—que celles que je me suis permises envers ses brochures à M. Pasquier.
![]() On lisait cette semaine dans presque tous les journaux de Paris:
«La crue rapide des eaux de la Seine a failli coûter, avant-hier au
soir, la vie à un vieillard qui, monté sur un petit batelet amarré près
du pont de Beau-Grenelle, avait été renversé dans le fleuve par un
violent coup de vent. Le malheureux vieillard allait périr lorsqu’un
ouvrier maçon, nommé Renaud, se jeta aussitôt à la nage et parvint
jusqu’au vieillard qu’il soutint d’un bras, tandis que de l’autre il
nagea jusqu’à la rive. Ses courageux efforts eurent un plein succès; il
déposa son précieux fardeau sur la berge, et bientôt après il conduisit
le vieillard dans sa demeure, où les bénédictions d’une famille
reconnaissante l’ont PAYÉ de sa généreuse action.»
On lisait cette semaine dans presque tous les journaux de Paris:
«La crue rapide des eaux de la Seine a failli coûter, avant-hier au
soir, la vie à un vieillard qui, monté sur un petit batelet amarré près
du pont de Beau-Grenelle, avait été renversé dans le fleuve par un
violent coup de vent. Le malheureux vieillard allait périr lorsqu’un
ouvrier maçon, nommé Renaud, se jeta aussitôt à la nage et parvint
jusqu’au vieillard qu’il soutint d’un bras, tandis que de l’autre il
nagea jusqu’à la rive. Ses courageux efforts eurent un plein succès; il
déposa son précieux fardeau sur la berge, et bientôt après il conduisit
le vieillard dans sa demeure, où les bénédictions d’une famille
reconnaissante l’ont PAYÉ de sa généreuse action.»
Les actions de ce genre,—il faut le dire,—sont assez fréquentes,—et c’est un genre de courage que les gens bien élevés paraissent abandonner au peuple—comme une vertu trop robuste;—toujours est-il que nous n’entendons jamais dire à la suite de ces récits—que l’autorité—soit intervenue pour récompenser cette belle action;—pardon,—je me trompe,—si le maçon Renaud—l’exige, la préfecture de police—lui donnera vingt-cinq francs.
Vingt-cinq francs pour avoir sauvé la vie d’un autre homme au péril de la sienne!
Il n’y a donc plus que les actions honteuses et infâmes qui soient récompensées en France?
Mais faites le compte des désintéressements qu’il faut acheter, des incorruptibilités qu’il faut payer,—des indépendances qu’il faut soudoyer,—et vous verrez qu’il ne reste pour PAYER le dévouement du maçon Renaud que les bénédictions d’une famille reconnaissante.
Certes, je ne suis pas d’avis qu’un trait de ce genre soit récompensé par une somme fixe et par l’argent;—mais regorge-t-on donc d’honnêtes gens au point qu’il n’y ait pas une place à donner à un homme brave et généreux?
![]() Des personnes,—ordinairement bien informées,—assurent que le
privilége du Vaudeville donné à M. Ancelot—a pour cause des
considérations toutes politiques. Il s’agissait d’assurer à l’élection
de M. Jacqueminot deux voix de deux amis de madame Ancelot.
Des personnes,—ordinairement bien informées,—assurent que le
privilége du Vaudeville donné à M. Ancelot—a pour cause des
considérations toutes politiques. Il s’agissait d’assurer à l’élection
de M. Jacqueminot deux voix de deux amis de madame Ancelot.
![]() On parle beaucoup de la passion d’une Excellence d’un âge mûr pour
une princesse d’un âge avancé.—Il faut que jeunesse se passe; mais il
est fâcheux que ce soit si longtemps après qu’elle est passée.
On parle beaucoup de la passion d’une Excellence d’un âge mûr pour
une princesse d’un âge avancé.—Il faut que jeunesse se passe; mais il
est fâcheux que ce soit si longtemps après qu’elle est passée.
![]() On assure que c’est le roi qui a imaginé l’union commerciale de la
France avec la Belgique.—M. Guizot a reçu, par les divers ambassadeurs
des puissances étrangères, des protestations très-sérieuses à ce sujet.
Le roi a alors compris que, cédant à un entraînement trop juvénile, il
était sorti des limites ordinaires de sa politique prudente.
On assure que c’est le roi qui a imaginé l’union commerciale de la
France avec la Belgique.—M. Guizot a reçu, par les divers ambassadeurs
des puissances étrangères, des protestations très-sérieuses à ce sujet.
Le roi a alors compris que, cédant à un entraînement trop juvénile, il
était sorti des limites ordinaires de sa politique prudente.
Le projet a été abandonné tout bas et ajourné tout haut.
![]() Ce qu’il y a de plus curieux dans les chemins de fer,—et de plus
admirable, ce n’est pas de voir ces deux terribles éléments, l’eau et le
feu, s’accorder et se réunir au service de l’homme sous un seul joug;
c’est de voir dans ceux qui ordonnent les chemins de fer et dans ceux
qui les font une ignorance profonde des résultats qu’ils doivent avoir.
Ce qu’il y a de plus curieux dans les chemins de fer,—et de plus
admirable, ce n’est pas de voir ces deux terribles éléments, l’eau et le
feu, s’accorder et se réunir au service de l’homme sous un seul joug;
c’est de voir dans ceux qui ordonnent les chemins de fer et dans ceux
qui les font une ignorance profonde des résultats qu’ils doivent avoir.
Les uns voient là une satisfaction à donner à l’opinion publique et à l’orgueil national,—et quelque peu aussi quelques modifications stratégiques;—les autres, des actions à acheter et à vendre;—les autres, des fournitures de rails à obtenir;—les autres,—quelques voix d’électeurs à acheter,—soit en faisant passer les chemins par telles et telles villes,—soit en concédant des fournitures, soit en donnant des emplois;—ceux-ci pensent qu’ils auront le poisson plus frais; ceux-là, qu’ils iront manger des huîtres au bord de la mer.
Mais personne ne s’aperçoit que c’est non pas seulement dans le commerce, mais dans les relations de peuple à peuple,—dans la société entière,—une révolution au moins égale à celle qu’a produite la poudre dans l’art militaire.
Commençons par le projet ajourné de l’union commerciale de la France avec la Belgique.
Quand le chemin de fer sera en activité,—il y aura des convois qui porteront quinze mille voyageurs;—les voici à la frontière;—aurez-vous là une armée de quinze mille douaniers pour les visiter et pour fouiller leurs malles?—C’est difficile.
Mais s’il n’en est pas ainsi,—vous faites perdre aux voyageurs au moins le temps qu’ils ont gagné en venant par le chemin de fer.—En prenant les voitures ordinaires, ils sont plus longtemps en route, mais en ne se présentant à la frontière qu’une douzaine en même temps, ils n’éprouvent de la part de la douane qu’un retard presque insignifiant.—Votre chemin de fer est ridicule et inutile,—si vous laissez subsister votre système de douane tel qu’il est aujourd’hui.
Mais ceci n’est qu’une considération commerciale;—passons à quelques considérations sociales.
On fait des chemins de fer partout;—avec cette facilité et cette rapidité de communication par toute l’Europe,—les relations de peuple à peuple ne tarderont pas à changer entièrement.—Tel allait passer la belle saison à l’île Saint-Denis, qui ira sur les bords du Rhin;—il y aura des connaissances, des amis; il y mariera sa fille; il s’y associera à quelque industrie;—d’autre part, nécessairement et par suite de relations fréquentes,—on apprendra partout les langues de tous les pays de l’Europe,—ou peut-être le français deviendra la langue universelle,—pour deux causes:—d’abord, parce qu’on le parle déjà dans le monde entier et que c’est la langue du bel air,—ensuite, parce que les Français aiment mieux apprendre pendant dix ans le latin,—qu’au bout de dix ans ils ne savent pas, et qui d’ailleurs ne leur servirait à rien;—et naturellement le peuple dont la langue deviendra universelle sera celui qui s’obstinera à ne pas apprendre celle des autres peuples.
Un homme aura sa maison de ville à Paris, sa maison de campagne à Mayence, sa maison de commerce à Londres,—sa maîtresse à Naples, ses garçons à l’université de Leipsick, des amis et des intérêts d’affaires dans toutes les villes.
Les intérêts, les relations de tous les peuples de l’Europe se mêleront, s’entrelaceront, se confondront d’une manière inextricable;—les intérêts communs remplaceront les intérêts contraires,—la guerre sera impossible,—les frontières n’auront plus de sens,—les distances et l’étendue n’existent que par le temps qu’on met à les parcourir;—avec les chemins de fer, la France n’aura pas l’étendue qu’avait autrefois une de ses provinces,—le continent européen—ne sera pas plus grand que n’est la France aujourd’hui.—La Belgique sera de Paris à la distance qu’en était Versailles avant l’application de la vapeur.
Il y aura un royaume d’Europe ou une république européenne;—toutes les vieilles laisses par lesquelles on tient les peuples,—toutes les vieilles ficelles par lesquelles on fait jouer les ressorts politiques,—tout cela se brisera.—Il faudra un code universel comme une langue universelle. Ce qui est aujourd’hui un crime à Paris n’en est pas un à cinq cents lieues de là, et cela n’est qu’absurde,—mais peut aller encore parce que ce sont différents hommes qui sont soumis à différentes lois;—mais quand, par la rapidité et la fréquence des communications, on aura remarqué que le même homme se lève criminel, déjeune innocent, dîne coupable,—et se couche blanc comme neige,—à cause des différentes lois des pays qu’il aura traversés en vingt-quatre heures,—on comprendra qu’il faut faire une seule et même chose des deux choses qui, aujourd’hui, n’ont aucun rapport entre elles,—la justice et l’équité,—qu’il faut faire des lois basées sur une seule et même raison, sur une seule et même équité.
Ce n’est pas nous qui verrons tout cela.—Nous n’assisterons qu’à l’agonie des vieilles choses.
Mais il viendra un jour où on s’étonnera de voir dans les livres qu’il y a eu un royaume de France,—un royaume de Prusse,—un royaume d’Espagne; comme nous nous étonnons aujourd’hui quand nous lisons qu’en France, en 511, Thierry était roi de Metz, Clodomir, roi d’Orléans, Childebert roi de Paris, et Clotaire roi de Soissons, parce qu’alors l’Europe, par les distances qui en sépareront les différents peuples,—par le mélange des intérêts et des mœurs,—n’aura pas plus d’étendue et aura plus d’homogénéité que n’en avait la France en 511.
Un avocat à la cour royale de Paris, appelé M. Gagne—paraît seul jusqu’ici avoir eu un pressentiment de ce qui doit arriver par suite de l’établissement des chemins de fer:—il a prévu le besoin d’une langue universelle.
Il est évident que, dans un temps donné, celui des peuples de l’Europe qui s’obstinera à ne pas apprendre les langues des autres peuples verra la sienne universellement adoptée.
![]() Vous connaissez bon nombre de ferblantiers ambitieux, de droguistes
retirés des affaires, qui consacrent la fin de leur vie à gouverner
l’Etat,—quand ils s’aperçoivent qu’ils commencent à ne plus trop bien
diriger leurs propres affaires. C’est ce qui fait que la Chambre des
députés n’est pas entièrement composée d’avocats.
Vous connaissez bon nombre de ferblantiers ambitieux, de droguistes
retirés des affaires, qui consacrent la fin de leur vie à gouverner
l’Etat,—quand ils s’aperçoivent qu’ils commencent à ne plus trop bien
diriger leurs propres affaires. C’est ce qui fait que la Chambre des
députés n’est pas entièrement composée d’avocats.
Voici un mercier qui porte plus loin ses vues:—il n’attend pas à ne plus être mercier pour se présenter aux suffrages de son arrondissement;—il n’a pas besoin de suffrages, il s’élit lui-même, et il s’élit dieu. Je veux parler de M. Cheneau ou Chaînon,—qui a publié, il y a quelque temps, un gros livre dont je vous ai entretenu, sur la Troisième et dernière alliance de Dieu avec sa créature.—J’ai eu la patience de lire cet ouvrage,—et j’ai donné consciencieusement mon résumé,—en disant que la religion nouvelle que propose M. Cheneau est une religion a galimatias double,—c’est-à-dire à laquelle ni les lecteurs ni l’auteur ne comprennent absolument rien. A l’appui de mon opinion, j’ai cité quelques passages du livre, qui ont généralement paru ne laisser aucun doute à ce sujet.
Je vous avouerai que je ne pensais plus ni à M. Cheneau ni à sa religion,—quand je reçus de la direction de la poste de Paris—une lettre m’invitant à aller retirer moi-même un paquet chargé à mon adresse.—C’est une précaution qu’on ne prend d’ordinaire qu’à l’égard de lettres contenant de fortes sommes ou des papiers très-importants.
Je me transportai à la poste, et l’on me remit une lettre, qui n’était chargée que des foudres du dieu Cheneau. Voyez comme les religions se simplifient.—Autrefois un dieu irrité faisait pour punir un seul homme un grand bruit mêlé d’éclairs, qui effrayait les populations innocentes.—Voici un dieu qui met tranquillement ses foudres vengeresses à la poste et les affranchit.—La Fontaine l’a dit:
Le Dieu me foudroie, mais il affranchit son tonnerre.
![]() Voici comment parla le dieu Cheneau: «Que les humains se
souviennent que je ne suis point pour condamner les personnes égarées,
mais pour les aimer.
Voici comment parla le dieu Cheneau: «Que les humains se
souviennent que je ne suis point pour condamner les personnes égarées,
mais pour les aimer.
»Les Guêpes sont les insectes qui piquent et qui pincent; si, par malheur pour elles, elles veulent piquer au-dessus de leurs facultés, elles se détruisent d’elles-mêmes.
»Je m’aperçois à l’instant que les Guêpes légères viennent de se déclarer très-faibles en logique ainsi quen conception en déclarant que la faculté de comprendre leur manquait.
»Vous n’êtes pas théologiens, laissez donc ce soin aux apprentis papes; que les Guêpes soient légères, c’est vrai, mais qu’elles apprennent que je ne suis point comme elles inconséquent avec les règles de la raison. Les Guêpes ont dit: «Nous n’analyserons pas l’ouvrage de M. Cheneau, attendu que nous n’y comprenons rien, ni lui non plus.»
»Les Guêpes sauront à l’avenir qu’elles manquent de sens en plaisantant sur mon ouvrage.»
![]() Pardon, monsieur Cheneau, n’y a-t-il pas dans votre réponse un peu
d’aigreur?—et êtes-vous bien conséquent avec votre première phrase:
Pardon, monsieur Cheneau, n’y a-t-il pas dans votre réponse un peu
d’aigreur?—et êtes-vous bien conséquent avec votre première phrase:
«Que les humains se souviennent que je ne suis point pour condamner les personnes égarées, mais pour les aimer.»
De bonne foi, dieu Cheneau, avez-vous l’air, dans votre lettre, de m’aimer beaucoup?
«Que les humains se souviennent,» dites-vous; c’est très-bien; mais souvenez-vous-en aussi, monsieur le dieu. Continuons la lecture des tables de la loi.
«Vous avez fait connaître aux négociants et aux autres les mesures de votre esprit, monsieur Karr,:—vous vous moquez de l’Évangile.»
![]() De votre Évangile, dieu Cheneau, n’oublions pas que c’est de votre
Évangile,—quand vous dites: «En ce temps-là, je chassai les démons.
De votre Évangile, dieu Cheneau, n’oublions pas que c’est de votre
Évangile,—quand vous dites: «En ce temps-là, je chassai les démons.
»En ce temps-là, mon bon ami saint Jean-Baptiste vint me voir avec mon autre ami Napoléon.»
![]() «Suivez mon conseil, relisez mon ouvrage.»
«Suivez mon conseil, relisez mon ouvrage.»
Merci, monsieur Cheneau,—merci,—détournez de moi ce calice, ou plutôt permettez-moi de le détourner moi-même.
![]() «Vous découvrirez que j’ai rendu sensible à tous les hommes le vrai
principe théologique, philosophique et la religion d’amour qui est
destinée à produire la foi éclairée par le raisonnement et la liberté
intellectuelle.»
«Vous découvrirez que j’ai rendu sensible à tous les hommes le vrai
principe théologique, philosophique et la religion d’amour qui est
destinée à produire la foi éclairée par le raisonnement et la liberté
intellectuelle.»
(Encore ici, dieu Cheneau, vous n’êtes pas conséquent, mon bon dieu: vous appelez la liberté d’examen,—et vous me maltraitez parce que j’examine votre religion.—Vous dites que vous rendez votre religion sensible à tous les hommes, et vous ajoutez que je ne la comprends pas.—Il y a un autre Dieu, Dieu l’ancien, vous savez, celui qui s’est fait homme,—mais qui, il faut l’avouer, n’avait pas songé à se faire mercier;—il avait, pour éclairer les choses et les gens, un procédé que je vous recommande;—pour les choses, «Dieu dit: Que la lumière soit,—et la lumière fut.»—Pour les hommes, il fit descendre le Saint-Esprit sur les apôtres.—Pourquoi, mon bon dieu Cheneau, ne m’éclairez-vous pas, au lieu de me reprocher ma stupidité avec autant d’amertume?)
![]() «Vous m’avez supposé, monsieur A. Karr, que j’avais écrit sans
base, cela ne prouve pas une grande profondeur d’intelligence en vous.»
«Vous m’avez supposé, monsieur A. Karr, que j’avais écrit sans
base, cela ne prouve pas une grande profondeur d’intelligence en vous.»
![]() (Je vous assure, dieu Cheneau, que, lorsque vous me parlez ainsi,
vous n’avez pas l’air de m’aimer du tout,—malgré votre première
phrase.)
(Je vous assure, dieu Cheneau, que, lorsque vous me parlez ainsi,
vous n’avez pas l’air de m’aimer du tout,—malgré votre première
phrase.)
![]() «Je n’ai pas fait comme les Augustin, les Fénelon, les Bossuet, les
Chateaubriand,—les Lamartine, les Victor Hugo, qui n’ont pas compris
leur religion: j’écris pour que l’on comprenne.»
«Je n’ai pas fait comme les Augustin, les Fénelon, les Bossuet, les
Chateaubriand,—les Lamartine, les Victor Hugo, qui n’ont pas compris
leur religion: j’écris pour que l’on comprenne.»
Vous savez que j’en excepte toujours vous et moi.
![]() «Je me trouve donc directement en opposition avec leur
avilissante doctrine et leur science honteuse; les jeunes auteurs ne
pourront régénérer la littérature, la société même, qu’après avoir
adopté la nouvelle religion que j’ai manifestée. Qu’ils en sonde la
profondeur!»
«Je me trouve donc directement en opposition avec leur
avilissante doctrine et leur science honteuse; les jeunes auteurs ne
pourront régénérer la littérature, la société même, qu’après avoir
adopté la nouvelle religion que j’ai manifestée. Qu’ils en sonde la
profondeur!»
—Pardon encore une fois, mais peut-être fallait-il ne pas donner tant de profondeur à une religion qui doit être comprise de tous.
![]() «J’ai encore bien des choses à dire,—mais j’attendrai votre
réponse pour savoir si elles sont au-dessus de votre portée.»
«J’ai encore bien des choses à dire,—mais j’attendrai votre
réponse pour savoir si elles sont au-dessus de votre portée.»
![]() Ainsi fulmina le dieu.—Je mis la foudre dans ma poche,—et je me
sentis touché d’un grand désir de voir M. Cheneau. Voici l’avantage d’un
dieu—mercier,—c’est que la joie de voir Dieu face à face était
autrefois réservée aux élus,—tandis qu’avec un dieu mercier on peut se
procurer cette félicité en allant acheter chez lui pour quatre sous de
n’importe quoi.
Ainsi fulmina le dieu.—Je mis la foudre dans ma poche,—et je me
sentis touché d’un grand désir de voir M. Cheneau. Voici l’avantage d’un
dieu—mercier,—c’est que la joie de voir Dieu face à face était
autrefois réservée aux élus,—tandis qu’avec un dieu mercier on peut se
procurer cette félicité en allant acheter chez lui pour quatre sous de
n’importe quoi.
![]() Je me transportai à l’adresse indiquée,—l’olympe du dieu Cheneau
est rue Croix-des-Petits-Champs, 15, au rez-de-chaussée,—ce que je
trouve un peu bas pour un ciel.
Je me transportai à l’adresse indiquée,—l’olympe du dieu Cheneau
est rue Croix-des-Petits-Champs, 15, au rez-de-chaussée,—ce que je
trouve un peu bas pour un ciel.
Le ciel de M. Cheneau est peint en jaune; j’aime mieux le bleu. Je lus sur la porte:
CHENEAU ET P. JOUIN.
Fournitures pour tailleurs.
Doublures, fabrique de boutons, dépôt de boutons anglais,
mercerie, soierie en gros et en détail.
Dieu l’ancien avait fait le ciel et la terre—il était réservé au dieu Cheneau de faire les boutons.
Mais qu’est-ce que P. Jouin?—N’est-il associé de M. Cheneau que pour les boutons?—n’est-il que comercier,—ou est-il en même temps codieu?—Pourquoi M. Cheneau ne parle-t-il pas de M. P. Jouin?
J’entre dans le ciel;—de chaque côté de la porte est un comptoir de noyer;—au fond est un escalier en forme de fourche, qui monte à droite et à gauche.
Pas la moindre houri dans les comptoirs.—Je crie: «A la boutique!»—Il arrive un chérubin crépu.
—Donnez-moi un écheveau de fil.
—Voilà.
—M. Cheneau est-il ici?
—Non, monsieur, il est sorti.
Le dieu va en ville.
Je me retire en pensant que si un dieu mercier a quelques avantages, il regagne l’infériorité sous d’autres points.—Dieu l’ancien est partout à la fois,—tandis que le dieu Cheneau,—quand il est sorti, n’est pas à son comptoir.—Les affaires du dieu doivent nuire à celles du mercier.—Ainsi ne soit-il pas.
![]() Comme j’allais voir Janin, l’autre jour,—je m’arrêtai surpris au
coin de la rue de Tournon.—J’étais au milieu de la rue:—deux ou trois
cochers me crièrent: «Gare!»—J’allai m’adosser à une boutique pour voir
si mes yeux ne m’avaient pas trompé.
Comme j’allais voir Janin, l’autre jour,—je m’arrêtai surpris au
coin de la rue de Tournon.—J’étais au milieu de la rue:—deux ou trois
cochers me crièrent: «Gare!»—J’allai m’adosser à une boutique pour voir
si mes yeux ne m’avaient pas trompé.
Vous savez cette vieille enseigne, autrefois célèbre, de M. Pigeon? Elle représente un garde national en costume bourgeois, par-dessus lequel il a endossé la giberne et le sabre avec leurs larges courroies blanches en croix: c’est une caricature assez bien faite.
Ce qui causait ma surprise,—c’était de voir que le marchand de nouveautés avait décoré, de son autorité privée, son enseigne de la croix de Juillet et de la croix d’honneur.
Je ne suis pas partisan effréné de la garde nationale;—trente-huit volumes des Guêpes en feraient foi au besoin;—mais si j’étais préfet de police ou ministre donnant des ordres au préfet de police,—et ayant besoin de la garde nationale, je ne voudrais pas avoir signé une autorisation—pour qu’on mît ainsi au-devant d’une maison une caricature permanente contre la garde nationale.
Mais ceci n’est qu’une considération secondaire.
Certes, c’est une belle et puissante chose—que d’avoir persuadé aux hommes que les plus grands dévouements, le risque perpétuel de la vie, la perte d’un bras ou d’une jambe, étaient plus que récompensés par quelques centimètres de ruban d’une certaine couleur.
Et un gouvernement qui possède une pareille monnaie est assez bête pour l’avilir!—d’abord en la prodiguant sottement et en en payant des services honteux,—mais encore en la laissant insulter par qui le veut.
Certes, si j’écrivais aujourd’hui que le gouvernement rogne les pièces de cent sous ou mêle un tiers d’alliage aux pièces de vingt francs,—le procureur du roi exigerait une rectification ou mieux encore me ferait un procès.—«Quoi! me dirait-il, vous dépréciez la monnaie, vous cherchez à tuer la confiance, à détruire la sécurité des transactions!—mais vous faites là une mauvaise action, monsieur,—une action dangereuse.»
Et on permet à une marchande de foulards de coton de tourner en ridicule cette noble et belle monnaie avec laquelle on paye les braves sans les déshonorer!
C’est une lâcheté et une sottise.
![]() Il est une chose honteuse, infâme, qui n’est assez flétrie ni par
les tribunaux ni par l’opinion.
Il est une chose honteuse, infâme, qui n’est assez flétrie ni par
les tribunaux ni par l’opinion.
Je veux parler d’une sorte de vol lâche et ignoble—que les filous appellent chantage, et que l’on retrouve aujourd’hui, sans interruption, depuis les carrefours les plus mal famés jusque dans les administrations, dans les ministères,—dans les lieux les plus élevés et les plus respectés.
PREMIER EXEMPLE.—Une petite fille de quatorze ans s’introduit chez un homme, sous prétexte de lui vendre des cure-dents;—un quart d’heure après, le père et la mère,—ou un oncle,—ou un frère aîné,—arrivent en fureur,—menacent, crient, pleurent: la fille était, jusqu’ici, vertueuse;—elle n’a pas seize ans;—on va faire un procès criminel;—l’honneur de la malheureuse enfant est perdu;—toute une famille désolée ne pourra se calmer que par cent écus; on marchande la consolation de la famille,—on s’arrange à soixante francs: le tour est fait,—et la jeune innocente—va continuer ses exercices dans un autre quartier.
![]() DEUXIÈME EXEMPLE.—Un cocher de fiacre a conduit une femme bien
mise dans un quartier éloigné;—elle était pâle, troublée;—elle est
restée plusieurs heures, s’est fait descendre au coin d’une rue et a
payé le cocher généreusement—sans compter.
DEUXIÈME EXEMPLE.—Un cocher de fiacre a conduit une femme bien
mise dans un quartier éloigné;—elle était pâle, troublée;—elle est
restée plusieurs heures, s’est fait descendre au coin d’une rue et a
payé le cocher généreusement—sans compter.
Le cocher la suit, voit où elle demeure,—apprend son nom du portier,—et le lendemain vient demander à lui parler;—il s’adresse à une femme de chambre;—la femme de chambre avertit sa maîtresse qu’une sorte d’ouvrier vêtu d’un carrick veut lui parler.
—Demandez ce qu’il veut.
—Il ne veut répondre qu’à madame.
—Alors je ne le reçois pas,—renvoyez-le.
—C’est le cocher qui a conduit madame hier.
—Ah! mon Dieu!
Elle pâlit,—s’appuie sur un meuble.
—Faites-le entrer,—bien vite,—que personne ne le voie!
La femme de chambre, étonnée, obéit.
—Madame, dit le cocher, je suis bien fâché qu’on ait dérangé madame, j’aurais aussi bien parlé à monsieur,
—Grand Dieu!—ne vous en avisez pas;—que me voulez-vous?
—C’est qu’hier madame s’est trompée d’un quart d’heure;—nous sommes restés trois heures là-bas,—et...
—Vite, combien est-ce?
—C’est à la générosité de madame.
—Tenez, voilà cent sous; allez-vous-en bien vite!
—J’ai eu bien froid à attendre madame; je suis sûr que M... aurait été plus généreux.
—Voilà vingt francs.
Le cocher s’en va:—mais de temps en temps—il vient mystérieusement trouver la femme de chambre—et demande si madame n’a rien à lui ordonner.—La malheureuse femme,—à demi morte de frayeur,—lui fait chaque fois remettre un louis.
Une fois—elle a voulu refuser cet impôt;—le cocher a alors demandé si M... y était.—Elle a envoyé le louis à l’instant même.
![]() TROISIÈME EXEMPLE.—Un acteur va débuter,—un journal lui est
apporté avec la carte du directeur.—S’il ne va pas trouver le directeur
pour s’arranger avec lui,—on l’ÉREINTE,—on l’insulte, on le bafoue
dans le journal—jusqu’à ce qu’il se soumette,—et alors on
constate—que l’artiste, docile aux conseils de la CRITIQUE,—a fait
de notables progrès, qu’il est juste d’encourager ses efforts, etc.—Le
prix d’un abonnement—à quatre ou cinq billets de mille
francs,—suivant la sensibilité de l’acteur et de ses appointements.
TROISIÈME EXEMPLE.—Un acteur va débuter,—un journal lui est
apporté avec la carte du directeur.—S’il ne va pas trouver le directeur
pour s’arranger avec lui,—on l’ÉREINTE,—on l’insulte, on le bafoue
dans le journal—jusqu’à ce qu’il se soumette,—et alors on
constate—que l’artiste, docile aux conseils de la CRITIQUE,—a fait
de notables progrès, qu’il est juste d’encourager ses efforts, etc.—Le
prix d’un abonnement—à quatre ou cinq billets de mille
francs,—suivant la sensibilité de l’acteur et de ses appointements.
COROLLAIRE.—Quelquefois un journaliste aime une actrice:—il la maltraite jusqu’à ce qu’il ait obtenu du retour.
D’autres fois—il s’agit d’obtenir ses entrées à un théâtre:—directeur, auteurs, acteurs,—tout est insulté sans pitié jusqu’à ce que la direction se soit exécutée.
D’autres fois,—après les entrées, on exige des subventions annuelles.
![]() QUATRIÈME EXEMPLE.—Un homme politique ou autre veut une place pour
lui ou pour un de ses amis;—on attaque dans deux ou trois journaux,—et
le ministre duquel elle dépend,—et le roi,—«la France marche à sa
perte,—les ministres nous déshonorent,» jusqu’à obtention de la
place—ou du bureau de tabac demandé.
QUATRIÈME EXEMPLE.—Un homme politique ou autre veut une place pour
lui ou pour un de ses amis;—on attaque dans deux ou trois journaux,—et
le ministre duquel elle dépend,—et le roi,—«la France marche à sa
perte,—les ministres nous déshonorent,» jusqu’à obtention de la
place—ou du bureau de tabac demandé.
![]() CINQUIÈME EXEMPLE.—Une trentaine d’hommes occupent depuis douze
ans les ministères,—il ne peut y en avoir que huit aux affaires à la
fois.—Les vingt-deux autres les attaquent, les insultent, les
calomnient—jusqu’à ce qu’ils les aient renversés;—huit des vingt-deux
prennent leur place, les huit renversés se joignent alors aux quatorze
qui ont fait la guerre à leurs dépens,—et on attaque, insulte et
calomnie les huit nouveaux arrivés.
CINQUIÈME EXEMPLE.—Une trentaine d’hommes occupent depuis douze
ans les ministères,—il ne peut y en avoir que huit aux affaires à la
fois.—Les vingt-deux autres les attaquent, les insultent, les
calomnient—jusqu’à ce qu’ils les aient renversés;—huit des vingt-deux
prennent leur place, les huit renversés se joignent alors aux quatorze
qui ont fait la guerre à leurs dépens,—et on attaque, insulte et
calomnie les huit nouveaux arrivés.
![]() SIXIÈME EXEMPLE.—Il y a des gens qui ont pour profession—de
savoir une anecdote ridicule,—une fantaisie vicieuse, une liaison
cachée—d’un ministre ou d’un homme en place;—cette profession les fait
vivre dans le luxe et les plaisirs, attendu que l’homme en place leur
fait confier une mission scientifique ou accorder une pension pour
services rendus à l’État, etc., etc., etc., etc.
SIXIÈME EXEMPLE.—Il y a des gens qui ont pour profession—de
savoir une anecdote ridicule,—une fantaisie vicieuse, une liaison
cachée—d’un ministre ou d’un homme en place;—cette profession les fait
vivre dans le luxe et les plaisirs, attendu que l’homme en place leur
fait confier une mission scientifique ou accorder une pension pour
services rendus à l’État, etc., etc., etc., etc.
![]() Il serait facile de multiplier à l’infini des exemples de ce genre.
Il serait facile de multiplier à l’infini des exemples de ce genre.
Seulement, je ne sais pourquoi les auteurs de ces faits ignominieux ne sont pas punis d’un juste et égal mépris—dans quelque classe qu’ils se trouvent,—quelque but qu’ils veuillent atteindre.
Au bas de l’échelle, la justice intervient; à mesure que l’objet de ce honteux trafic prend de l’importance, les opérateurs sont salués, reçus dans le monde, recherchés, courtisés et enviés.
![]() DICTIONNAIRE FRANÇAIS-FRANÇAIS.—BOUCHER, boucherie.—Sorte de
morgue où sont étalés publiquement des cadavres sur des linges tachés de
sang.—C’est là que chacun va choisir le morceau de cadavre qu’il aime
le mieux pour s’en repaître le soir avec sa famille et ses amis.
DICTIONNAIRE FRANÇAIS-FRANÇAIS.—BOUCHER, boucherie.—Sorte de
morgue où sont étalés publiquement des cadavres sur des linges tachés de
sang.—C’est là que chacun va choisir le morceau de cadavre qu’il aime
le mieux pour s’en repaître le soir avec sa famille et ses amis.
![]() BOUCON, voyez ARSENIC.
BOUCON, voyez ARSENIC.
![]() BREVET.—Un brevet est un morceau de papier ou de parchemin que
tout le monde obtient moyennant une somme de sept cent cinquante ou de
quinze cents francs.
BREVET.—Un brevet est un morceau de papier ou de parchemin que
tout le monde obtient moyennant une somme de sept cent cinquante ou de
quinze cents francs.
Il n’y a pas de pilules inconvenantes, de pâtes obscènes, de mécanique ridicule,—qui ne commence par se munir d’un brevet;—après quoi on met dans les journaux: «A obtenu un brevet du roi.»
Ce qui a tout à fait l’air d’une approbation spéciale de Sa Majesté.—Le public achète, et se trouve volé ou empoisonné.
Il serait de la dignité du gouvernement de ne pas laisser ainsi le roi complice des marchands d’orviétan de son royaume,—et d’expliquer d’une manière formelle ce que c’est qu’un brevet;—mais il s’agit bien de dignité aujourd’hui!
Si le public savait ce que c’est qu’un brevet, il ne s’y laisserait plus prendre.—Si le public ne se laissait plus prendre à ce gluau, les charlatans ne le tendraient plus.—Conséquemment, cela ferait un certain nombre de pièces de sept cent cinquante francs et de quinze cents francs qui cesseraient de tomber dans les coffres de l’État[N].
![]() BROUILLARD.—Interrompt toujours les dépêches télégraphiques dont
le gouvernement ne veut faire connaître que la moitié.
BROUILLARD.—Interrompt toujours les dépêches télégraphiques dont
le gouvernement ne veut faire connaître que la moitié.
![]() BOUILLON.—Les savants sont des gens qui, sur la route des choses
inconnues, s’embourbent un peu plus loin que les autres,—mais restent
embourbés, parce qu’ils ne veulent pas avouer qu’ils le sont,—et se
gardent bien de crier au secours.
BOUILLON.—Les savants sont des gens qui, sur la route des choses
inconnues, s’embourbent un peu plus loin que les autres,—mais restent
embourbés, parce qu’ils ne veulent pas avouer qu’ils le sont,—et se
gardent bien de crier au secours.
Il y a vingt-cinq ans, M. Darcet imagina de faire du bouillon avec de la gélatine,—c’est-à-dire en soumettant les os dépouillés de viande à l’action de la vapeur.
Le bouillon ainsi produit était fade,—donnait des nausées, etc.; mais l’Académie—représentée par une commission—le trouva et le déclara excellent. En conséquence,—on en donna, sans réclamation, pendant quinze ans aux malades des hôpitaux.
Au bout de quinze ans,—on crut s’apercevoir de quelque chose.—On fit de nouvelles expériences sur la gélatine,—et on découvrit cette fois que la gélatine et le bouillon qui en est fait sont d’une mauvaise odeur et d’un mauvais goût, ne contiennent aucun principe alimentaire, mais chargent et fatiguent l’estomac, qui ne peut les digérer.—Un élève des hôpitaux se soumit à la gélatine pour toute nourriture, il ne put continuer ce régime que quatre jours et resta avec une gastralgie intense.
M. Gannal a essayé d’en nourrir lui et sa famille. Au bout de quelques jours, ils étaient tous malades et mourant de faim.
Eh bien! il y a dix ans de cela, et on n’a pas encore défendu l’emploi de la gélatine dans les hôpitaux.—Les malheureux malades—reçoivent encore comme bouillon—un liquide mauvais au goût, malsain et sans aucuns principes nutritifs.
Parce que M. Darcet ne veut pas s’être trompé.
Parce que l’Académie des sciences ne veut pas avouer qu’elle s’est laissé tromper.
Parce que les divers ministres qui se succèdent ont bien d’autres choses à faire.
![]() BRUNE.—C’est le nom qu’une femme blonde donne à la maîtresse
présumée de son mari.—«Il est allé voir sa brune.»
BRUNE.—C’est le nom qu’une femme blonde donne à la maîtresse
présumée de son mari.—«Il est allé voir sa brune.»
Une femme brune, au contraire, dit—en pareille circonstance: «Il est allé voir sa blonde.»
Toutes les femmes savent, par un merveilleux instinct,—que l’infidélité n’est pas pour une femme plus jolie, mieux faite ou plus spirituelle, mais simplement pour une autre femme.
Ceci devrait mettre leur amour-propre à son aise: on peut être blessée de se voir préférer une femme—pour l’esprit ou pour la figure,—mais il est en ce cas une supériorité incontestable dont on ne peut se fâcher—et à laquelle on ne peut prétendre,—c’est celle d’être une autre femme.
![]() JANVIER.—On sème sur couche et sous châssis les radis, la laitue
et le cresson.—On continue à récolter le produit des tendresses, des
soins, des bassesses semés dans la seconde quinzaine de
décembre.—Arrivée de beaucoup d’oies et de très-peu de
cygnes.—Ouverture de la session des Chambres.—Les avocats enrichiront
le français de plusieurs barbarismes et appauvriront les Français de
plusieurs millions.—On taille les pommiers et les poiriers.—Le
Journal des Débats renouvellera l’avis qu’il a donné, il y a quelques
années, aux pauvres, au milieu de la saison rigoureuse: il leur
conseillera de mettre leurs économies à la caisse d’épargne.—M. Armand
Bertin sera incommodé à la suite d’un dîner.—Vers la seconde moitié du
mois, on voit cesser assez brusquement certaines tendresses, certains
soins, qui avaient signalé la fin du mois de décembre.
JANVIER.—On sème sur couche et sous châssis les radis, la laitue
et le cresson.—On continue à récolter le produit des tendresses, des
soins, des bassesses semés dans la seconde quinzaine de
décembre.—Arrivée de beaucoup d’oies et de très-peu de
cygnes.—Ouverture de la session des Chambres.—Les avocats enrichiront
le français de plusieurs barbarismes et appauvriront les Français de
plusieurs millions.—On taille les pommiers et les poiriers.—Le
Journal des Débats renouvellera l’avis qu’il a donné, il y a quelques
années, aux pauvres, au milieu de la saison rigoureuse: il leur
conseillera de mettre leurs économies à la caisse d’épargne.—M. Armand
Bertin sera incommodé à la suite d’un dîner.—Vers la seconde moitié du
mois, on voit cesser assez brusquement certaines tendresses, certains
soins, qui avaient signalé la fin du mois de décembre.
![]() On remarquera avec amertume que les diablotins et les papillotes
continuent à marcher dans une voie de progrès.
On remarquera avec amertume que les diablotins et les papillotes
continuent à marcher dans une voie de progrès.
Autrefois les devises des bonbons étaient de la plus charmante naïveté:—c’étaient d’innocents madrigaux adressés à la beauté,—des énigmes et des logogriphes proposés à tout le monde.—J’en ai gardé quelques-uns qui ne datent pas de plus de quinze ans:
![]() Tout cela n’était pas bien neuf, mais ne chargeait pas plus
l’esprit que les bonbons ne chargeaient l’estomac.—Cette poésie même
excitait généralement un léger sourire.—Aujourd’hui les diablotins ont
entrepris de former le cœur et l’esprit:—les papillotes ont leur
mission sociale.—Je vous signale surtout les pastilles de chocolat
recouvertes de petites graines blanches et enfermées deux à deux dans
des papiers blancs;—leur tendance est tout à fait déplorable,—elles
paraissent avoir pour but de dégoûter les enfants et les femmes de
l’existence.
Tout cela n’était pas bien neuf, mais ne chargeait pas plus
l’esprit que les bonbons ne chargeaient l’estomac.—Cette poésie même
excitait généralement un léger sourire.—Aujourd’hui les diablotins ont
entrepris de former le cœur et l’esprit:—les papillotes ont leur
mission sociale.—Je vous signale surtout les pastilles de chocolat
recouvertes de petites graines blanches et enfermées deux à deux dans
des papiers blancs;—leur tendance est tout à fait déplorable,—elles
paraissent avoir pour but de dégoûter les enfants et les femmes de
l’existence.
Si les diablotins donnent à leurs lecteurs quelques pièces de Pascal et de Larochefoucauld qui montrent la fausseté et le vide des choses humaines, les pastilles de chocolat vous disent des choses dans le genre de celles-ci:
Le gouvernement ne paraît en aucune manière s’inquiéter de cette marche inquiétante;—je suppose donc qu’il exerce une censure cachée et scrupuleuse sur les devises de bonbons, et qu’il y a quelque homme de lettres attaché spécialement à la surveillance des écarts politiques que pourraient se permettre les diablotins.
Autrement, je ne comprends pas comment ils n’arriveraient pas très-prochainement à traiter les plus graves questions politiques.—Les pralines donneraient dans l’opposition;—le chocolat abandonnerait ses lugubres méditations et ferait des théories humanitaires contre la propriété;—le roi Louis-Philippe, malgré son inviolabilité, serait personnellement attaqué par les pistaches.
![]() Je pense que les poëtes qui faisaient autrefois, l’hiver, les
devises innocentes des papillotes étaient les mêmes qui, l’été,
composaient la poésie qui s’enroule autour des mirlitons;—je n’ai pas
eu occasion de suivre les révolutions de cette dernière poésie—comme
j’ai observé les phases de celle des bonbons,—mais tout me porte à
croire qu’elles marchent d’un pas égal dans la voie du sérieux et du
lamentable!
Je pense que les poëtes qui faisaient autrefois, l’hiver, les
devises innocentes des papillotes étaient les mêmes qui, l’été,
composaient la poésie qui s’enroule autour des mirlitons;—je n’ai pas
eu occasion de suivre les révolutions de cette dernière poésie—comme
j’ai observé les phases de celle des bonbons,—mais tout me porte à
croire qu’elles marchent d’un pas égal dans la voie du sérieux et du
lamentable!
![]() Je suppose que le gouvernement étend sur les mirlitons sa
sollicitude à l’égard des papillotes.
Je suppose que le gouvernement étend sur les mirlitons sa
sollicitude à l’égard des papillotes.
![]() Je suis persuadé qu’une des causes qui ont poussé les confiseurs à
faire des bonbons aussi mélancoliques est une honteuse parcimonie, pour
éviter de payer les droits d’auteur aux poëtes qui jusqu’ici leur
avaient prêté leur concours.
Je suis persuadé qu’une des causes qui ont poussé les confiseurs à
faire des bonbons aussi mélancoliques est une honteuse parcimonie, pour
éviter de payer les droits d’auteur aux poëtes qui jusqu’ici leur
avaient prêté leur concours.
Que deviendront ces malheureux poëtes?
![]() Monsieur ***,—ex-parvenu assez insolent,—enrichi par des
spéculations hasardées,—a fini par se ruiner,—par suite d’un bilan
dont le passif a été fidèlement déclaré, mais l’actif scrupuleusement
gardé dans sa poche; il offrira—rien pour cent à ses créanciers;—il
sera un peu inquiété à ce sujet:—obligé de se cacher pendant le
jour,—il vivra somptueusement la nuit.—Nous le prévenons que, pendant
le mois de janvier, le soleil se couchera légalement à quatre heures
trente-trois minutes et se lèvera à sept heures cinquante minutes.
Monsieur ***,—ex-parvenu assez insolent,—enrichi par des
spéculations hasardées,—a fini par se ruiner,—par suite d’un bilan
dont le passif a été fidèlement déclaré, mais l’actif scrupuleusement
gardé dans sa poche; il offrira—rien pour cent à ses créanciers;—il
sera un peu inquiété à ce sujet:—obligé de se cacher pendant le
jour,—il vivra somptueusement la nuit.—Nous le prévenons que, pendant
le mois de janvier, le soleil se couchera légalement à quatre heures
trente-trois minutes et se lèvera à sept heures cinquante minutes.
![]() FÉVRIER.—Vers la moitié de ce mois, S. M. Louis-Philippe—vendra,
comme l’année précédente (20 février 1842),—les premiers haricots verts
de l’année.—Fureur de M. de Rothschild, qui n’en pourra livrer au
commerce que plusieurs jours après le roi des Français.—CARNAVAL, bals
de l’Opéra; attendu que dix théâtres et établissements publics seront
pleins chaque soir de masques, qui s’y encaqueront par milliers, et que
lesdits masques dormiront le jour, les journaux de l’opposition feront
remarquer qu’on ne voit pas un seul masque sur les boulevards, signe
évident de la misère, des souffrances et de la tristesse du peuple.—On
ne rira pas assez des grandes phrases que ces braves journaux feront sur
ce thème.—Plusieurs législateurs seront mis au violon pour danses un
peu trop risquées.—Quelques femmes libres également cesseront
momentanément de l’être pour l’avoir été trop dans leurs
attitudes.—Quelques vieilles femmes abuseront du masque pour séduire et
mener à mal des jeunes gens sans expérience.
FÉVRIER.—Vers la moitié de ce mois, S. M. Louis-Philippe—vendra,
comme l’année précédente (20 février 1842),—les premiers haricots verts
de l’année.—Fureur de M. de Rothschild, qui n’en pourra livrer au
commerce que plusieurs jours après le roi des Français.—CARNAVAL, bals
de l’Opéra; attendu que dix théâtres et établissements publics seront
pleins chaque soir de masques, qui s’y encaqueront par milliers, et que
lesdits masques dormiront le jour, les journaux de l’opposition feront
remarquer qu’on ne voit pas un seul masque sur les boulevards, signe
évident de la misère, des souffrances et de la tristesse du peuple.—On
ne rira pas assez des grandes phrases que ces braves journaux feront sur
ce thème.—Plusieurs législateurs seront mis au violon pour danses un
peu trop risquées.—Quelques femmes libres également cesseront
momentanément de l’être pour l’avoir été trop dans leurs
attitudes.—Quelques vieilles femmes abuseront du masque pour séduire et
mener à mal des jeunes gens sans expérience.
![]() Plusieurs auront des aventures du genre que voici:
Plusieurs auront des aventures du genre que voici:
UN DOMINO. Je te connais, tu t’appelles Charles.
UN AUTRE. Je te reconnais, tu es employé au ministère des finances.
UN AUTRE. Je te connais, tu avais avant-hier un pantalon bleu.
Et le jeune homme est le plus heureux des mortels; il se dit: «Comme on m’intrigue donc! comme je suis donc connu! comme on s’occupe donc de moi!»
![]() Un domino lui prend brusquement le bras et marche avec lui sans
parler.
Un domino lui prend brusquement le bras et marche avec lui sans
parler.
—Eh bien! dit le jeune homme s’arrêtant enfin dans un coin, est-ce là tout? n’as-tu rien à me dire?
—Absolument rien, répond le domino.
Et le jeune homme lève les yeux au plafond et se ronge un ongle, ce qui lui donne pour les passants l’air de dire: «Où diable a-t-elle appris tout cela? je suis le plus intrigué des hommes.»
—Je ne te connais pas, ajoute le domino, je ne t’ai jamais vu.
Et le jeune homme frappe du pied avec l’air dépité d’un homme auquel on raconterait ses aventures les plus secrètes;*—un de ses amis, voyant ses gestes, dit: «Il paraît qu’on en dit de dures à Charles.»
—Je t’ai pris le bras, continue le domino, parce que tu passais près de moi, et que c’était le seul moyen de me débarrasser d’un de mes amis qui s’était cramponné à moi et ne voulait pas me quitter,—je le remercie et je te laisse.
Le jeune homme reste seul, garde quelque temps l’air d’un homme très-préoccupé des révélations qu’on vient de lui faire.
L’ami qui l’avait observé l’aborde et lui dit:
—Eh bien, tu parais intrigué?
—Ne m’en parle pas! une femme charmante! un lutin pour l’esprit et la malice!—oh! elle ne m’a pas ménagé;—elle sait de moi des choses... et je ne puis savoir qui elle est;—je lui ai fait les questions les plus insidieuses, elle s’en est tirée avec un sang-froid, un tact, une présence d’esprit admirables!—Oh! je la connaîtrai.
—Heureux coquin! dit l’ami.
![]() MARS.—Le 21, commence le printemps des astronomes, des almanachs
et des poëtes.
MARS.—Le 21, commence le printemps des astronomes, des almanachs
et des poëtes.
Le 21, gelée.—Le 22, gelée.—Le 23, neige.—Le 24, pluie.—Le 25, bise.—Le 26, gelée.—Le 27, pluie.—Le 28, pluie.—Le 29, neige.—Le 30, gelée.—Le 31, froid.
![]() L’homme tourne dans un cercle bizarre de désirs et de crainte;—le
printemps, que nous attendons avec tant d’impatience, nous rapproche de
l’hiver prochain, que nous redoutons.
L’homme tourne dans un cercle bizarre de désirs et de crainte;—le
printemps, que nous attendons avec tant d’impatience, nous rapproche de
l’hiver prochain, que nous redoutons.
![]() AVRIL.—Semer les betteraves et les haricots,—et prendre garde aux
poissons d’avril.
AVRIL.—Semer les betteraves et les haricots,—et prendre garde aux
poissons d’avril.
Un ministre renversé fera à la tribune un grand discours sur la misère du peuple; s’il veut rentrer aux affaires, s’il veut reprendre le fardeau du pouvoir, c’est uniquement dans l’intérêt du pays, etc.
Il y aura des proclamations,—des professions de foi—et une foule d’autres choses de circonstance:—les philosophes, les philanthropes, les savants,—tout le monde se moquera de vous et cherchera à vous attraper.
![]() MAI.—Tout fleurit:—les fraisiers au pied de la haie d’épines
blanches;—les papillons fleurissent dans l’air,—et cherchent, fleurs
vivantes, une tige vacante parmi toutes les fleurs qu’ils visitent en
voltigeant.
MAI.—Tout fleurit:—les fraisiers au pied de la haie d’épines
blanches;—les papillons fleurissent dans l’air,—et cherchent, fleurs
vivantes, une tige vacante parmi toutes les fleurs qu’ils visitent en
voltigeant.
Les insectes cherchent, sur cette table opulente et toujours mise que la terre offre à toutes les créatures, chacun la plante qui lui est destinée.
![]() L’air,—silencieux pendant l’hiver,—se remplit de chants d’oiseaux
et de bourdonnements d’abeilles.
L’air,—silencieux pendant l’hiver,—se remplit de chants d’oiseaux
et de bourdonnements d’abeilles.
Partout—sur l’herbe, dans les arbres, dans l’air, dans l’eau,—sous la mousse, dans la corolle éclatante des fleurs,—tout est plein de nouvelles amours,—tout aime,—comme tout fleurit.
![]() Mais rien ne bourgeonne,—rien ne fleurit comme le nez de M.
d’Haubersaert.
Mais rien ne bourgeonne,—rien ne fleurit comme le nez de M.
d’Haubersaert.
![]() C’est au commencement de ce mois que paraissent les
hannetons,—c’est une nouvelle indifférente pour un siècle où il n’y a
plus d’enfants;—on fume aujourd’hui à l’âge où autrefois on chantait la
fameuse romance:
C’est au commencement de ce mois que paraissent les
hannetons,—c’est une nouvelle indifférente pour un siècle où il n’y a
plus d’enfants;—on fume aujourd’hui à l’âge où autrefois on chantait la
fameuse romance:
![]() Vers le 25, floraison des fèves de marais!
Vers le 25, floraison des fèves de marais!
C’est un préjugé populaire—que le moment de la floraison des fèves—agit singulièrement sur le cerveau des gens;—on dit même souvent d’un homme qui fait quelque grande sottise: «Il a passé un champ de fèves en fleurs.»
Il existe à ce sujet un proverbe latin consigné dans un assez mauvais vers.
La floraison des fèves exercera cette année—une fâcheuse et remarquable influence.
M. Lherbette, député,—montera encore une fois à la tribune pour défendre les femmes de lettres—contre la tyrannie des époux—qui mettent de force dans leur existence la prose des enfants, du pot-au-feu—et de deux ou trois petits devoirs gênants et surannés.
M. Chapuys de Montlaville reprochera amèrement au roi sa mauvaise habitude de mettre des cravates blanches qui coûtent énormément cher de blanchissage,—tandis que Sa Majesté elle-même a breveté, moyennant huit cents francs, les cols en crinoline Oudinot (cinq ans de durée).
![]() Un ministre qui ne le sera plus alors—s’inspirera, pour ressaisir
le pouvoir, d’une Égérie—que l’on croit être la même qui autrefois
donna de si bons conseils à Numa Pompilius,—l’an 714 avant
Jésus-Christ.
Un ministre qui ne le sera plus alors—s’inspirera, pour ressaisir
le pouvoir, d’une Égérie—que l’on croit être la même qui autrefois
donna de si bons conseils à Numa Pompilius,—l’an 714 avant
Jésus-Christ.
![]() La rue Laffitte, parquetée depuis un an,—sera cirée et frottée.
La rue Laffitte, parquetée depuis un an,—sera cirée et frottée.
![]() Les Anglais imagineront de vendre des coups de bâton.—S’apercevant
au bout de quelque temps que cet article d’exportation est en
souffrance, ils feront la guerre à une petite puissance du
Nord.—L’Europe entière regardera sans rien dire.—La petite puissance,
après avoir perdu quelques milliers d’hommes,—viendra à composition et
fera un traité par lequel elle s’engagera à acheter tous les ans pour
sept ou huit millions de coups de bâton.
Les Anglais imagineront de vendre des coups de bâton.—S’apercevant
au bout de quelque temps que cet article d’exportation est en
souffrance, ils feront la guerre à une petite puissance du
Nord.—L’Europe entière regardera sans rien dire.—La petite puissance,
après avoir perdu quelques milliers d’hommes,—viendra à composition et
fera un traité par lequel elle s’engagera à acheter tous les ans pour
sept ou huit millions de coups de bâton.
![]() M. de Balzac continuera à pousser les fleurs dans la voie de la
révolte ouverte contre la nature.—Il naîtra dans un de ses livres—une
violette de haute futaie.
M. de Balzac continuera à pousser les fleurs dans la voie de la
révolte ouverte contre la nature.—Il naîtra dans un de ses livres—une
violette de haute futaie.
Une foule de nouveaux auteurs paraîtront à l’horizon littéraire. Autrefois les gens qui avaient échoué dans leurs projets,—qui pleuraient les objets d’une grande affection,—qui avaient quelque faute à expier, entraient en religion;—ces gens-là, aujourd’hui, entrent en feuilleton.—A cette époque de la floraison des fèves, des beautés fanées, des administrateurs destitués, des femmes du monde qui auront trop voyagé avec des pianistes, encombreront de leur prose et de leurs vers les revues de journaux.
![]() Au mois de mai,—on sème des choux de Bruxelles;—retour des
bécasses, floraison du serpolet.—Le petit Martin perd sa faveur, fondée
sur ce qu’il a un pouce de moins que M. Thiers,—par l’imprudence qu’il
a de regagner ce pouce au moyen de bottes à talons.—Vers le 25, on sème
le chanvre; il lève si bien, qu’en songeant aux belles cordes qu’on en
fera et en voyant certains actes administratifs, on regrette qu’on ne
pende plus.—On met des dahlias en place. Premiers melons.
Au mois de mai,—on sème des choux de Bruxelles;—retour des
bécasses, floraison du serpolet.—Le petit Martin perd sa faveur, fondée
sur ce qu’il a un pouce de moins que M. Thiers,—par l’imprudence qu’il
a de regagner ce pouce au moyen de bottes à talons.—Vers le 25, on sème
le chanvre; il lève si bien, qu’en songeant aux belles cordes qu’on en
fera et en voyant certains actes administratifs, on regrette qu’on ne
pende plus.—On met des dahlias en place. Premiers melons.
![]() JUIN.—Il faut éclaircir l’oignon et repiquer les poireaux.—Un
assassin empoisonne toute une famille;—mais, comme il est établi aux
débats que c’est chez lui une mauvaise habitude, puisqu’il est constant
que c’est la troisième fois qu’il se livre à de pareils écarts,—le
jury, reconnaissant la force irrésistible des habitudes,—admet des
circonstances atténuantes, et l’accusé en est quitte pour quinze jours
de prison;—tous les jurés signent un recours en grâce.—Une révolution
avorte et s’appelle émeute criminelle,—attendu que ce sont les
vainqueurs qui sont parrains.—On plante des pois qui doivent produire
en septembre; on repique les ciboules pour l’hiver.—M. Jars, député,
adresse à la tribune ses madrigaux à une actrice maigre.—Quelques
fonctionnaires indépendants méritent d’être pendus.—Plusieurs villes
par lesquelles passent les chemins de fer—voient les voyageurs leur
tomber tout rôtis;—en effet, sur quelques rails on va fort vite, mais
on arrive cuit;—sur d’autres, on arrive en bon état, mais on va un peu
moins vite qu’en fiacre à l’heure.—M. Jay fait dans le
Constitutionnel un article pour lequel, ainsi qu’il l’a dit dans ce
carré de papier, «il trempe sa plume dans son cœur.»—Arroser
abondamment et seulement le soir;—faucher les gazons et greffer les
rosiers; on tond les moutons; on établira sur le lait un impôt dont on
parle depuis longtemps.
JUIN.—Il faut éclaircir l’oignon et repiquer les poireaux.—Un
assassin empoisonne toute une famille;—mais, comme il est établi aux
débats que c’est chez lui une mauvaise habitude, puisqu’il est constant
que c’est la troisième fois qu’il se livre à de pareils écarts,—le
jury, reconnaissant la force irrésistible des habitudes,—admet des
circonstances atténuantes, et l’accusé en est quitte pour quinze jours
de prison;—tous les jurés signent un recours en grâce.—Une révolution
avorte et s’appelle émeute criminelle,—attendu que ce sont les
vainqueurs qui sont parrains.—On plante des pois qui doivent produire
en septembre; on repique les ciboules pour l’hiver.—M. Jars, député,
adresse à la tribune ses madrigaux à une actrice maigre.—Quelques
fonctionnaires indépendants méritent d’être pendus.—Plusieurs villes
par lesquelles passent les chemins de fer—voient les voyageurs leur
tomber tout rôtis;—en effet, sur quelques rails on va fort vite, mais
on arrive cuit;—sur d’autres, on arrive en bon état, mais on va un peu
moins vite qu’en fiacre à l’heure.—M. Jay fait dans le
Constitutionnel un article pour lequel, ainsi qu’il l’a dit dans ce
carré de papier, «il trempe sa plume dans son cœur.»—Arroser
abondamment et seulement le soir;—faucher les gazons et greffer les
rosiers; on tond les moutons; on établira sur le lait un impôt dont on
parle depuis longtemps.
![]() M. Lesourd, directeur de l’octroi de Paris,—tombé en
disgrâce,—débutera à l’Opéra.—On connaît dans le monde la magnifique
voix de cet administrateur.
M. Lesourd, directeur de l’octroi de Paris,—tombé en
disgrâce,—débutera à l’Opéra.—On connaît dans le monde la magnifique
voix de cet administrateur.
![]() JUILLET.—On sème les carottes pour l’hiver.
JUILLET.—On sème les carottes pour l’hiver.
—Anniversaire de la prise de la Bastille—et consécration des quatorze petites bastilles qui entourent Paris.
—On sème des radis, des oignons blancs et plusieurs espèces de choux.
—Une émeute réussit et s’appelle glorieuse révolution.—Vers le 15, on marcotte les œillets.—On sait que Napoléon avait bravé les œillets rouges, et que la Restauration en a eu fort peur, moins cependant que des violettes.—Une fleur se fera une mauvaise affaire avec la police.—Saison des bains et des eaux;—plus d’un dandy sans argent ira passer l’été à Saint-Denis pour raconter l’hiver suivant qu’il a perdu un argent fou à Baden-Baden.—Les femmes nagent, les hommes ne nagent plus.—Une des causes de cette bizarrerie est que les filles portent leurs cheveux nattés ou lissés en bandeau, et que les hommes se font friser;—les jeunes garçons fument et lisent les journaux,—tandis que les jeunes filles font de la gymnastique.—Avant trente ans, les hommes seront devenus à leur tour le sexe faible et timide.
![]() AOUT.—Récolte des cornichons,—troisième labour de la
vigne.—Moisson des céréales: quelles que soient la qualité et la
quantité des blés cette année, les journaux ministériels diront que
jamais on n’a vu une aussi belle récolte, et qu’il en faut rendre grâce
au gouvernement paternel sous lequel nous avons le bonheur de vivre;—et
les journaux de l’opposition, que les épis sont vides, que la moisson
est misérable, et que c’est la faute du gouvernement tyrannique sous
lequel nous avons le malheur de vivre.
AOUT.—Récolte des cornichons,—troisième labour de la
vigne.—Moisson des céréales: quelles que soient la qualité et la
quantité des blés cette année, les journaux ministériels diront que
jamais on n’a vu une aussi belle récolte, et qu’il en faut rendre grâce
au gouvernement paternel sous lequel nous avons le bonheur de vivre;—et
les journaux de l’opposition, que les épis sont vides, que la moisson
est misérable, et que c’est la faute du gouvernement tyrannique sous
lequel nous avons le malheur de vivre.
—Jours caniculaires.—La police continuera à jeter des boulettes pour les chiens attaqués de la rage, dont le signe caractéristique est que l’animal atteint ne mange pas.—Des citoyens, voyant la patrie en danger, se réuniront chez Véfour et feront un excellent dîner;—les journaux de leur parti célébreront avec enthousiasme le courage et le généreux dévouement dont ils auront fait preuve dans cette occasion.—Ceux du parti opposé traiteront la chose de gueuleton, mais feront à leur tour une ripaille semblable, à propos de laquelle ils feront à leur tour éclater leur courage et leur généreux dévouement.
![]() SEPTEMBRE.—Des phénomènes sans nombre viennent étonner la France:
de tous côtés il naît des veaux à deux têtes—et des enfants
prodigieux.—On creuse les fondations d’une maison et l’on trouve un
trésor.—On rencontre une fille sauvage dans la forêt de
Montmorency;—d’innombrables centenaires sont cités dans tous les
départements.—Il tombe dans plusieurs localités des grêlons gros comme
des melons.—Un sansonnet,—commensal d’un savetier des faubourgs,
récite aux passants la Charte constitutionnelle.—Plusieurs cochers de
place rapportent des bourses oubliées dans leurs voitures.—Si un
mendiant meurt,—on trouve chez lui sept cent mille francs en or cachés
dans une vieille chaussette.—Un chasseur tue un cygne,—il porte au cou
un collier en argent,—sur lequel sont écrites plusieurs choses qui
prouvent qu’il a appartenu à Charles XII, roi de Suède.—Si une femme
accouche,—ce ne peut être de moins que de douze enfants,—tous bien
portants et parfaitement conformés.
SEPTEMBRE.—Des phénomènes sans nombre viennent étonner la France:
de tous côtés il naît des veaux à deux têtes—et des enfants
prodigieux.—On creuse les fondations d’une maison et l’on trouve un
trésor.—On rencontre une fille sauvage dans la forêt de
Montmorency;—d’innombrables centenaires sont cités dans tous les
départements.—Il tombe dans plusieurs localités des grêlons gros comme
des melons.—Un sansonnet,—commensal d’un savetier des faubourgs,
récite aux passants la Charte constitutionnelle.—Plusieurs cochers de
place rapportent des bourses oubliées dans leurs voitures.—Si un
mendiant meurt,—on trouve chez lui sept cent mille francs en or cachés
dans une vieille chaussette.—Un chasseur tue un cygne,—il porte au cou
un collier en argent,—sur lequel sont écrites plusieurs choses qui
prouvent qu’il a appartenu à Charles XII, roi de Suède.—Si une femme
accouche,—ce ne peut être de moins que de douze enfants,—tous bien
portants et parfaitement conformés.
En un mot,—de toutes parts, on n’entend parler que de miracles et de prodiges;—tout cela parce que, la session des Chambres étant terminée,—les journaux ne savent comment remplir les deux colonnes qu’ils avaient l’habitude de consacrer au compte rendu des débats législatifs.
![]() OCTOBRE.—Ouverture de la chasse.—Vu le prix des ports d’armes, la
division des propriétés et la destruction des forêts,—il sera mangé des
mésanges et des pinsons qui reviendront à l’heureux chasseur qui en aura
chargé son carnier à trois francs la pièce.—Les feuilles de la vigne
deviennent pourpres,—celles des poiriers oranges,—celles des ormes
jaunes.—Les philanthropes inventeront un nouveau pain de sciure de
bois.—M. Gannal embaumera plusieurs médecins.—La récolte de vins de M.
Duchâtel sera de médiocre qualité.—Vers le 15, chute des
feuilles;—plusieurs journaux de toutes couleurs seront victimes de
cette époque fatale.—Le 28 octobre,—selon un vieux proverbe,—on ne
trouve plus une seule mouche vivante:
OCTOBRE.—Ouverture de la chasse.—Vu le prix des ports d’armes, la
division des propriétés et la destruction des forêts,—il sera mangé des
mésanges et des pinsons qui reviendront à l’heureux chasseur qui en aura
chargé son carnier à trois francs la pièce.—Les feuilles de la vigne
deviennent pourpres,—celles des poiriers oranges,—celles des ormes
jaunes.—Les philanthropes inventeront un nouveau pain de sciure de
bois.—M. Gannal embaumera plusieurs médecins.—La récolte de vins de M.
Duchâtel sera de médiocre qualité.—Vers le 15, chute des
feuilles;—plusieurs journaux de toutes couleurs seront victimes de
cette époque fatale.—Le 28 octobre,—selon un vieux proverbe,—on ne
trouve plus une seule mouche vivante:
Nous demandons la permission d’excepter les Guêpes de cette condamnation.
![]() NOVEMBRE.—Récolte des nèfles et des pommes d’api;—plantation des
arbres fruitiers;—la régie des tabacs imaginera de vendre dix sous
(cinquante centimes) de nouveaux cigares en feuilles de
betteraves;—elle sollicitera du gouvernement l’autorisation pour les
collégiens de fumer en classe;—cette extension augmentera
considérablement ses recettes, qui se sont élevées l’année dernière à
quatre-vingts millions.—On rira beaucoup d’un mot de M. de Rambuteau;
voici ce mot, que le préfet de la Seine prononcera du 17 au 20
novembre:—quelqu’un lui demandera quel est l’inventeur de la régie.
«C’est Tabaca, répondra M. de Rambuteau.
NOVEMBRE.—Récolte des nèfles et des pommes d’api;—plantation des
arbres fruitiers;—la régie des tabacs imaginera de vendre dix sous
(cinquante centimes) de nouveaux cigares en feuilles de
betteraves;—elle sollicitera du gouvernement l’autorisation pour les
collégiens de fumer en classe;—cette extension augmentera
considérablement ses recettes, qui se sont élevées l’année dernière à
quatre-vingts millions.—On rira beaucoup d’un mot de M. de Rambuteau;
voici ce mot, que le préfet de la Seine prononcera du 17 au 20
novembre:—quelqu’un lui demandera quel est l’inventeur de la régie.
«C’est Tabaca, répondra M. de Rambuteau.
—Comment? que voulez-vous dire?
—Ne voyez-vous pas sur tous les bureaux: TABACA FUT MÈRE DE LA RÉGIE?»
C’est ainsi que M. de Rambuteau écrit et prononce ce qu’on lit en effet sur les vitres des bureaux de tabac: Tabac à fumer de la régie.
Le 25 novembre, la Sainte-Catherine, fête des filles,—comme le dit une vieille chanson:
![]() Quand on voit une de ces belles jeunes filles au visage calme, au
maintien modeste, aux cheveux lissés sur le front, aux regards doux et
incertains,—l’imagination ne la sépare guère de son vêtement, il semble
qu’elle ait des pieds de satin,—et que ce nuage bleu que forment autour
d’elle les plis de la gaze qui descendent jusqu’à terre—soit son corps.
Quand on voit une de ces belles jeunes filles au visage calme, au
maintien modeste, aux cheveux lissés sur le front, aux regards doux et
incertains,—l’imagination ne la sépare guère de son vêtement, il semble
qu’elle ait des pieds de satin,—et que ce nuage bleu que forment autour
d’elle les plis de la gaze qui descendent jusqu’à terre—soit son corps.
Mais qu’il est difficile de ne pas rompre ce charme mystérieux,—cet amour sans désir,—cet amour religieux et poétique!
Il suffit d’une mère qui vienne dire: «Ma fille est un peu malade,—elle a monté à cheval, elle a les cuisses rompues.» Ou: «Ne cours pas, on verrait tes jambes.» Ou: «Je lui ai acheté des chemises de batiste—ou des jarretières.» Et combien peu de mères savent se priver de pareilles mentions!
![]() DÉCEMBRE.—Il semble que l’âge d’or va renaître:—les femmes aiment
leurs maris, les enfants entourent leurs parents de respect, les
domestiques sont empressés et laborieux, les portiers sont polis.—C’est
surtout à prendre du 15 de ce mois que ces changements se font
apercevoir d’une manière sensible;—toutes sortes de beaux sentiments
sont tirés du cœur comme les fourrures des cartons;—les uns comme
les autres secoués, brossés et remis à neuf.—En ce mois finira une
année qui aura eu, comme celles qui la suivront et celles qui l’ont
précédée, cinquante-deux dimanches, et aura été remplie des mêmes
passions, des mêmes sottises, des mêmes craintes, des mêmes désirs;—la
forme seule change un peu,—le fond reste toujours le même,—malgré les
opinions contradictoires et de ceux qui se félicitent du progrès—et de
ceux qui se plaignent que le monde dégénère.
DÉCEMBRE.—Il semble que l’âge d’or va renaître:—les femmes aiment
leurs maris, les enfants entourent leurs parents de respect, les
domestiques sont empressés et laborieux, les portiers sont polis.—C’est
surtout à prendre du 15 de ce mois que ces changements se font
apercevoir d’une manière sensible;—toutes sortes de beaux sentiments
sont tirés du cœur comme les fourrures des cartons;—les uns comme
les autres secoués, brossés et remis à neuf.—En ce mois finira une
année qui aura eu, comme celles qui la suivront et celles qui l’ont
précédée, cinquante-deux dimanches, et aura été remplie des mêmes
passions, des mêmes sottises, des mêmes craintes, des mêmes désirs;—la
forme seule change un peu,—le fond reste toujours le même,—malgré les
opinions contradictoires et de ceux qui se félicitent du progrès—et de
ceux qui se plaignent que le monde dégénère.
![]() FOIRES ET MARCHÉS.—Plusieurs réélections auront lieu à la Chambre
des députés. Les journaux avertiront de l’époque des foires et marchés
qui seront tenus à cet effet dans divers départements;—les voix y
seront payées à leur valeur.—MM. les maires garantissent aide et
protection aux marchands.—Une danseuse verte sera rengagée au théâtre
de l’Opéra.—Un publiciste, ardent ennemi du pouvoir, sera nommé
sous-préfet dans une ville du Nord.—Une jeune cantatrice enlèvera à une
rivale qui a plus de talent qu’elle,—mais qui a du talent depuis
longtemps, un rôle écrit pour ladite rivale dans un opéra-comique de M.
Auber.—Plusieurs bureaux de tabac seront accordés à plusieurs femmes
quelconques, sur la recommandation des honorables MM.
***,—***,—***, etc.—Madame Lebœuf, femme du député de ce nom,
sera invitée aux bals de la cour.—Un jeune peintre sans talent,—neveu
d’un député de l’opposition, recevra du ministère de l’intérieur des
travaux extrêmement importants.—Il sera accordé une nouvelle direction
de théâtre.—Le Journal des Débats protégera le gouvernement
actuel.—Mademoiselle de ***, qui est si belle,—épousera M.
***, qui est si laid.—Des places seront données en foule à toute
sorte de gens.—Des croix d’honneur seront distribuées.
FOIRES ET MARCHÉS.—Plusieurs réélections auront lieu à la Chambre
des députés. Les journaux avertiront de l’époque des foires et marchés
qui seront tenus à cet effet dans divers départements;—les voix y
seront payées à leur valeur.—MM. les maires garantissent aide et
protection aux marchands.—Une danseuse verte sera rengagée au théâtre
de l’Opéra.—Un publiciste, ardent ennemi du pouvoir, sera nommé
sous-préfet dans une ville du Nord.—Une jeune cantatrice enlèvera à une
rivale qui a plus de talent qu’elle,—mais qui a du talent depuis
longtemps, un rôle écrit pour ladite rivale dans un opéra-comique de M.
Auber.—Plusieurs bureaux de tabac seront accordés à plusieurs femmes
quelconques, sur la recommandation des honorables MM.
***,—***,—***, etc.—Madame Lebœuf, femme du député de ce nom,
sera invitée aux bals de la cour.—Un jeune peintre sans talent,—neveu
d’un député de l’opposition, recevra du ministère de l’intérieur des
travaux extrêmement importants.—Il sera accordé une nouvelle direction
de théâtre.—Le Journal des Débats protégera le gouvernement
actuel.—Mademoiselle de ***, qui est si belle,—épousera M.
***, qui est si laid.—Des places seront données en foule à toute
sorte de gens.—Des croix d’honneur seront distribuées.
![]() ANECDOTES.—Un ancien administrateur poursuivait depuis quelques
mois M. Villemain de ses demandes et de ses réclamations.—Il y a
quelques jours, le ministre reçoit une dernière lettre dans laquelle
l’ex-fonctionnaire annonce qu’il est désespéré,—qu’il est réduit à la
plus affreuse misère, etc., etc.
ANECDOTES.—Un ancien administrateur poursuivait depuis quelques
mois M. Villemain de ses demandes et de ses réclamations.—Il y a
quelques jours, le ministre reçoit une dernière lettre dans laquelle
l’ex-fonctionnaire annonce qu’il est désespéré,—qu’il est réduit à la
plus affreuse misère, etc., etc.
M. Villemain envoie sous enveloppe une réponse consistant en un billet de cinq cents francs.
Le lendemain, il lui est remis une lettre ainsi conçue:
«Monsieur, je demandais justice,—mais je ne demandais pas l’aumône; ne croyez pas acheter mon indépendance par vos bienfaits.—Je vous renvoie votre billet de cinq cents francs, pour lequel, sans doute, vous vous êtes trompé d’adresse.—Votre serviteur, etc.»
M. Villemain admire—et tourne le feuillet pour reprendre le billet de cinq cents francs annoncé.—Il ne le voit pas; il cherche à ses pieds,—peut-être l’a-t-il fait tomber en ouvrant précipitamment la lettre:—il n’est pas à ses pieds.—Il cherche dans ses poches,—peut-être l’y a-t-il mis par distraction:—il n’est pas dans ses poches.
L’ex-fonctionnaire n’avait pas renvoyé le billet. Il s’était contenté de l’envoi de la lettre superbe—qu’il avait montrée à trente personnes.
![]() Un jeune écrivain, le baron T***, nous contait dernièrement des
particularités curieuses sur les chemins de fer aux États-Unis.—Je
regrette de ne me rappeler que les choses sans me rappeler la façon dont
il les disait.
Un jeune écrivain, le baron T***, nous contait dernièrement des
particularités curieuses sur les chemins de fer aux États-Unis.—Je
regrette de ne me rappeler que les choses sans me rappeler la façon dont
il les disait.
Aux États-Unis on ne s’amuse pas à niveler le terrain,—à aplanir des côtes, à supprimer des montagnes;—on jette deux rails d’un endroit à un autre,—sur les montées, sur les vallons, dans l’herbe,—puis on lance les wagons sur ces rails et l’on va le plus vite possible;—les vaches et les bœufs—paissent sur le chemin;—les wagons sont précédés d’une sorte de proue qui les ramasse, qui les entraîne et les jette plus ou moins broyés à droite et à gauche.
![]() Tout cela donne lieu à une foule d’accidents; souvent un rail se
brise,—le bout brisé—alors se redresse, et dernièrement une de ces
lances de fer a percé un wagon et blessé plusieurs voyageurs.
Tout cela donne lieu à une foule d’accidents; souvent un rail se
brise,—le bout brisé—alors se redresse, et dernièrement une de ces
lances de fer a percé un wagon et blessé plusieurs voyageurs.
On remarquait, à ce sujet, à quel point les choses changent sous nos yeux chaque jour,—mais tout progrès n’est pas une amélioration;—pendant bien longtemps, il est vrai, les voyageurs ont traversé les chemins;—mais, quelque ami que l’on soit du changement,—on ne saurait approuver cette tendance révolutionnaire que manifestent les chemins à traverser à leur tour les voyageurs.
Lorsqu’il s’agit, à l’Académie, de distribuer les derniers prix de vertu,—un académicien, M. D***,—racontant à ses collègues—la belle conduite d’une pauvre fille qui, sur son travail, avait, pendant plusieurs années, nourri une famille à laquelle elle n’était alliée que par sa générosité,—dit par distraction: «Et cette vertueuse fille—trouvait moyen, sur son faible gain, de donner chaque jour à cette misérable famille deux kilomètres de pain.»
Tout le monde se mit à rire de ce lapsus linguæ—et à s’extasier sur cette immense tartine.—Un des confrères de l’académicien prit la parole et dit: «Messieurs, loin de rire comme vous de la distraction qui a fait dire à notre collègue kilomètres pour kilogrammes,—je le féliciterai de cette protestation contre une langue barbare imposée à l’Académie française par la police de Paris.»
![]() André entre chez M***, qui peint dans son atelier.
«Bonjour.—Bonjour.—Comment vas-tu?—Bien, et toi?—Très-bien.—Tu n’en
as pas l’air.—Tu as raison,—ça va mal.—Diable! est-ce que tu es
malade?—Non.»
André entre chez M***, qui peint dans son atelier.
«Bonjour.—Bonjour.—Comment vas-tu?—Bien, et toi?—Très-bien.—Tu n’en
as pas l’air.—Tu as raison,—ça va mal.—Diable! est-ce que tu es
malade?—Non.»
André prend une pipe, la bourre de tabac,—l’allume, la laisse éteindre,—la rallume, fredonne un air.—Pendant ce temps, M*** continue à travailler. «Rien ne me réussit,—dit André,—je n’ai pas de travaux, je n’ai pas d’argent,—j’ai des dettes,—je voudrais être mort.» M*** alors pose son pinceau sur son chevalet,—le regarde d’un air surpris—et dit: «Ah! tu voudrais être mort!—eh bien! tu n’es pas dégoûté.»
![]() L’enseigne du marchand de nouveautés du coin de la rue de Seine est
toujours décorée de l’ordre de la Légion d’honneur.
L’enseigne du marchand de nouveautés du coin de la rue de Seine est
toujours décorée de l’ordre de la Légion d’honneur.
![]() Comme on parlait de M***,—quelqu’un demanda: «A-t-il des
filles?—Non, répondit M. Romieu,—et tant mieux pour elles.»
Comme on parlait de M***,—quelqu’un demanda: «A-t-il des
filles?—Non, répondit M. Romieu,—et tant mieux pour elles.»
![]() Un journal qui a publié les portraits d’un grand nombre de
célébrités contemporaines, en mettant au-dessous quelques vers souvent
assez heureux,—nous a paru s’être trompé en faisant imprimer ceux-ci
au-dessous du portrait de M. Étienne Arago, vaudevilliste, et frère de
M. François Arago, l’astronome:
Un journal qui a publié les portraits d’un grand nombre de
célébrités contemporaines, en mettant au-dessous quelques vers souvent
assez heureux,—nous a paru s’être trompé en faisant imprimer ceux-ci
au-dessous du portrait de M. Étienne Arago, vaudevilliste, et frère de
M. François Arago, l’astronome:
Ce qu’il y a de remarquable en ceci, c’est que le journal en question suit une ligne politique dans laquelle l’admiration sans bornes pour M. François Arago est de rigueur.
Or, si l’on s’en rapportait aux susdits vers, M. Étienne ayant gardé tout l’esprit,—M. François n’en aurait aucun vestige;—il est vrai que, ledit M. François ayant pris toute la science, M. Étienne resterait avec la plus profonde ignorance de toutes choses;—je crois que chacun de ces deux messieurs serait en droit de se plaindre;—mais que dira M. Jacques, un troisième frère, qui fait des livres et des vaudevilles?—que lui restera-t-il? Et n’y a-t-il pas aussi un quatrième frère, M. Emmanuel, qui est avocat? quel est son lot?—et je ne sais combien d’autres, car la famille des Arago est nombreuse comme celle des Atrides,—et elle a fait autant de vaudevilles que celle des Atrides a causé de tragédies.
![]() J’aurai, quelque jour, à vous parler longuement d’un monsieur qui
sera quelqu’un de ces jours député,—et qui n’est pour le moment que
membre du conseil municipal de Nîmes—et chevalier de la Légion
d’honneur, comme tout le monde.
J’aurai, quelque jour, à vous parler longuement d’un monsieur qui
sera quelqu’un de ces jours député,—et qui n’est pour le moment que
membre du conseil municipal de Nîmes—et chevalier de la Légion
d’honneur, comme tout le monde.
Ce monsieur a été bonnetier,—comme M. Ganneron a été fabricant de chandelles;—comme M. Ganneron, il a fait une belle fortune dans son commerce.
On raconte qu’à un voyage de quelques jours que fit à Nîmes une des princesses de la branche aînée—l’ex-bonnetier trouva moyen d’être, par le conseil municipal, nommé chevalier d’honneur de la duchesse.—Il était au comble de la joie,—il prenait tous les prétextes pour parler à voix basse à la princesse. «Mais que dit-il donc ainsi? demanda quelqu’un.—Vous le voyez, répondit-on, il parle bas.»
Jusqu’ici cela me serait parfaitement égal,—mais ce qui me l’est moins,—c’est que ce monsieur, qui arrivera un jour à la Chambre—comme défenseur des intérêts populaires—comme dévoué à la classe malheureuse,—loue sept francs par an à de pauvres diables le droit de ramasser des escargots dans ses bois.
![]() A une des dernières élections—l’affaire était chaudement
disputée.—Le parti de l’opposition fit boire un électeur outre mesure.
A une des dernières élections—l’affaire était chaudement
disputée.—Le parti de l’opposition fit boire un électeur outre mesure.
Le parti contraire s’aperçut de la chose,—et, pensant, selon toutes probabilités, que ce serait une voix gagnée pour ses adversaires,—prit sans façon l’électeur aviné, et le mit comme un paquet dans la diligence de Paris qui passait.
Le lendemain—on vote—et tout s’explique:—l’électeur envoyé à Paris devait voter pour le candidat conservateur.—Les amis du candidat de l’opposition n’avaient pas voulu le griser pour qu’il votât avec eux,—mais l’enivrer tout à fait pour qu’il ne votât pas,—n’ayant pu, par aucun moyen, le décider à passer sur leur bord.—Les conservateurs avaient donc fait, dans l’intérêt de leurs adversaires, ce que ceux-ci n’avaient pas osé faire pour eux-mêmes.
![]() Le procès de Besson est terminé—il a été condamné à mort.
Le procès de Besson est terminé—il a été condamné à mort.
Nous avons déjà donné notre opinion sur cette scandaleuse affaire.—Besson, domestique de M. de Marcellange, est chassé par lui pour avoir menacé de le tuer;—la femme et la belle-mère de M. de Marcellange prennent Besson à leur service particulier.—M. de Marcellange est assassiné, la rumeur publique accuse Besson,—on le mêt en prison;—là, les dames de Chamblas lui envoient un lit,—et chaque jour un plat de leur table;—un témoin—plus qu’un témoin peut-être,—Marie Boudon,—a été emmenée en Suisse par les dames de Chamblas et n’a pas reparu.
Des charges tellement fortes s’élèvent, aux débats, contre les dames de Chamblas, que le procureur du roi en est atterré et se trouve presque mal à l’audience.
Cependant je ne sais quelle égide protège ces femmes,—on arrête et on condamne des témoins pour faux témoignage,—on ne surveille même pas les dames de Chamblas;—cependant Besson est condamné à mort, donc la plus grande indulgence accuse les dames de Chamblas au moins de faux témoignage,—puisqu’elles ont juré qu’il n’avait pas quitté leur maison le jour où il assassinait son maître à six lieues de là.
Les journaux de toutes parts avertissent le ministère public que les dames de Chamblas sont en fuite,—le ministère public fait la sourde oreille—le procès s’instruit de nouveau:—on ne trouve plus les dames de Chamblas,—le ministère public n’ose pas élever la voix contre elles,—l’avocat de la famille Marcellange, qui demande vengeance de la mort du malheureux assassiné,—n’ose risquer que des allusions;—enfin, vaincu par la rumeur, par l’indignation publiques,—le procureur du roi—finit par parler; mais sa pensée est entourée de nuages.
Il parle des dames de Chamblas avec une respectueuse terreur:—«Elles sont en fuite, dit-il,—elles ont une punition terrible, seule punition que le monde puisse leur infliger,—l’exil et les remords.»
Vraiment, monsieur, croyez-vous que Besson, que vous venez de faire condamner à mort; Arzac, qui est aux galères, ne s’arrangeraient pas parfaitement de cette terrible punition, l’exil et les remords?—Laissez seulement ouverte un instant la porte de leur prison, et vous verrez avec quel empressement ils se condamneront eux-mêmes aux remords et à l’exil,—cette terrible punition.
En un mot, voici le résultat de votre jugement:—je parle ici au procureur du roi, aux juges et aux jurés.
Arzac est condamné aux travaux forcés—pour avoir porté un faux témoignage en faveur de Besson.
Ce qui est prouvé aux débats,—prouvé pour vous jusqu’à l’évidence,—puisque vous avez condamné Besson à la peine de mort,—puisque pour vous Besson a assassiné M. de Marcellange,—c’est que les dames de Chamblas ont,—comme Arzac,—rendu un faux témoignage en faveur de Besson—et qu’elles ont rendu ce témoignage pour sauver l’assassin de leur gendre et de leur mari.
Je ne vous donne pas ici mon opinion,—je vous donne la vôtre,—la vôtre approuvée par un jugement terrible,—par une condamnation à mort.
Et si vous rapprochez de ce fait les autres circonstances des débats,—ne vous naît-il pas d’autres pensées dans l’esprit?—D’où vient donc que ces pensées que tout le monde a, personne,—ni au tribunal ni dans la presse, n’a osé les formuler tout haut?—Quelle puissance invisible protége donc ces deux femmes?—quel danger mystérieux court donc l’imprudent qui parlerait hautement? quel prestige vous frappe donc tous de terreur?—Ce danger, je veux le connaître,—et je vais m’y exposer pour le connaître.
Dans ma conviction, sur mon âme et sur ma conscience,—ou Besson est innocent,—ou madame de Chamblas et madame de Marcellange sont ses complices.
Par votre jugement vous avez déclaré qu’elles avaient rendu, comme Arzac, le pauvre berger qui est aux galères pour ce fait, un faux témoignage en faveur de Besson. Et quand ce faux témoignage a pour but de sauver l’assassin du gendre de l’une, du mari de l’autre,—comment l’appelez-vous?
«Ou Besson est innocent, ou les dames de Chamblas sont ses complices.»
![]() Un homme fort petit—parlait de sa force prodigieuse devant M.
Dorsay,—qui est d’une taille élevée: «Monsieur, disait-il avec ce ton
haineux qu’ont les hommes de petite taille quand ils parlent des
grands,—il n’y a pas un exercice de force ou d’adresse,—il n’y a rien,
en un mot, que fasse un homme aussi grand que vous—que je ne m’engage à
faire aussi bien que lui.»
Un homme fort petit—parlait de sa force prodigieuse devant M.
Dorsay,—qui est d’une taille élevée: «Monsieur, disait-il avec ce ton
haineux qu’ont les hommes de petite taille quand ils parlent des
grands,—il n’y a pas un exercice de force ou d’adresse,—il n’y a rien,
en un mot, que fasse un homme aussi grand que vous—que je ne m’engage à
faire aussi bien que lui.»
M. Dorsay,—levant le bras,—toucha du bout du doigt le plafond du salon et lui dit: «Faites cela.»
![]() Le dieu Cheneau prépare contre moi des foudres imprimées;—je suis
entré dans le sanctuaire à deux reprises différentes: la première fois,
j’avais retrouvé dans une armoire un vieux paletot auquel il manquait
des boutons.—Je suis allé chez M. Cheneau,—là je n’ai vu que son
co-mercier. Je dois ici faire l’éloge desdits boutons,—je serai forcé
de faire mettre un paletot neuf à ces boutons-là.
Le dieu Cheneau prépare contre moi des foudres imprimées;—je suis
entré dans le sanctuaire à deux reprises différentes: la première fois,
j’avais retrouvé dans une armoire un vieux paletot auquel il manquait
des boutons.—Je suis allé chez M. Cheneau,—là je n’ai vu que son
co-mercier. Je dois ici faire l’éloge desdits boutons,—je serai forcé
de faire mettre un paletot neuf à ces boutons-là.
La seconde fois, j’ai pénétré dans l’arrière-ciel du dieu mercier, cette partie de l’Olympe chauffée par le charbon de terre,—éclairée par le gaz,—donne par son excessive chaleur un avant-goût des peines de l’enfer.—Le dieu serait blond—s’il avait des cheveux.
![]() C’est un métier très-couru aujourd’hui que celui de
Mécène;—beaucoup de gens riches protégent les écrivains et les
artistes de talent ou de réputation. Les écrivains leur font présent de
leurs livres,—ou leur donnent des loges le jour qu’on représente leurs
pièces; les artistes jouent gratuitement à leurs soirées.
C’est un métier très-couru aujourd’hui que celui de
Mécène;—beaucoup de gens riches protégent les écrivains et les
artistes de talent ou de réputation. Les écrivains leur font présent de
leurs livres,—ou leur donnent des loges le jour qu’on représente leurs
pièces; les artistes jouent gratuitement à leurs soirées.
Ah! c’est là ce que vous appelez des Mécènes; mais c’est une spéculation sordide.—Je ne vous empêche pas d’apprécier la chose comme vous l’entendez,—mais c’est comme cela.
Mademoiselle R*** est une jeune artiste qui jouit en ce moment d’une grande réputation.—Il est d’assez bon genre de l’avoir dans son salon.—Si elle se faisait payer, cela serait fort cher,—on pourrait encore ne pas la payer,—on m’a dit qu’elle ne le veut pas;—mais il faudrait lui faire de riches cadeaux.—Il faut donc la recevoir comme amie.
Mademoiselle R*** est dans une position qui l’expose à beaucoup de récits;—on accepte facilement sur elle, comme sur tous les gens en évidence, les anecdotes les plus saugrenues.—Quelques-unes sont vraies,—la plupart sont fausses;—beaucoup de gens les croient toutes.
Mais chez madame Réc*** on ne souffre pas la moindre atteinte à la renommée de la jeune actrice;—si vous l’accusiez même de la moindre légèreté, vous seriez fort mal venu.—M. de Châ***, habitué de la maison, est prêt à prendre la cuirasse et la lance contre le téméraire qui parlerait imprudemment de la vertu sans tache de mademoiselle R***: elle serait, hors de là, mère d’une nombreuse famille, qu’elle serait chez madame Réc*** vierge immaculée jusqu’à la fin de ses jours.
Parce que mademoiselle R*** lit chez madame Réc*** les vers de M. de Châ***, que si on admettait sur elle la moindre des choses, on ne pourrait plus la recevoir comme amie,—parce que, ne la recevant pas comme amie, il faudrait lui faire des cadeaux ou ne la plus avoir à ses soirées.
![]() Dans une pièce appelée les Abeilles, que l’on a dernièrement
représentée aux Variétés;—chacune des abeilles porte un nom de
fleur;—la censure a fait débaptiser l’une d’elles, qui s’appelait
Capucine, parce que, M. Guizot demeurant sur le boulevard des
Capucines, le public, en y mettant un peu de malice, pourrait trouver
dans ce nom une allusion politique.
Dans une pièce appelée les Abeilles, que l’on a dernièrement
représentée aux Variétés;—chacune des abeilles porte un nom de
fleur;—la censure a fait débaptiser l’une d’elles, qui s’appelait
Capucine, parce que, M. Guizot demeurant sur le boulevard des
Capucines, le public, en y mettant un peu de malice, pourrait trouver
dans ce nom une allusion politique.
![]() Le Télémaque, dont nous avons parlé dans le dernier numéro des
Guêpes,—est encore sous l’eau avec ses immenses richesses, y compris
les millions de M. Hugo; M. Taylor, entrepreneur du sauvetage, a pris la
fuite, abandonnant, sans les payer, trente-cinq ouvriers qu’il avait
fait venir d’Angleterre; ces malheureux ont travaillé pendant cinq ou
six mois, et restent sans pain, sans ressources et dans l’impossibilité
de retourner chez eux.—On assure que le Télémaque n’a pas bougé de
place et qu’il est tout aussi enterré dans le sable qu’au commencement
de l’opération;—au dernier moment et pour faire prendre encore quelques
actions, on aurait fait marcher quelques personnes sur un plancher
soutenu entre deux eaux, en leur persuadant que c’était le pont du
navire.
Le Télémaque, dont nous avons parlé dans le dernier numéro des
Guêpes,—est encore sous l’eau avec ses immenses richesses, y compris
les millions de M. Hugo; M. Taylor, entrepreneur du sauvetage, a pris la
fuite, abandonnant, sans les payer, trente-cinq ouvriers qu’il avait
fait venir d’Angleterre; ces malheureux ont travaillé pendant cinq ou
six mois, et restent sans pain, sans ressources et dans l’impossibilité
de retourner chez eux.—On assure que le Télémaque n’a pas bougé de
place et qu’il est tout aussi enterré dans le sable qu’au commencement
de l’opération;—au dernier moment et pour faire prendre encore quelques
actions, on aurait fait marcher quelques personnes sur un plancher
soutenu entre deux eaux, en leur persuadant que c’était le pont du
navire.
![]() Il y a dans chaque administration des heures fixes pour l’ouverture
et la fermeture des bureaux; messieurs les employés du ministère des
finances s’enferment au verrou dix minutes ou un quart d’heure avant
l’heure fixée pour la fermeture, dans la crainte que quelqu’un, arrivant
à l’extrême limite de l’heure indiquée, ne vienne retarder leur départ
de quelques instants;—des intérêts graves sont à chaque instant
compromis par l’indépendance de ces fonctionnaires
subalternes;—chaque jour, des personnes croyant pouvoir se fier au
règlement affiché, arrivent cinq ou six minutes avant l’heure fatale et
trouvent les portes fermées.
Il y a dans chaque administration des heures fixes pour l’ouverture
et la fermeture des bureaux; messieurs les employés du ministère des
finances s’enferment au verrou dix minutes ou un quart d’heure avant
l’heure fixée pour la fermeture, dans la crainte que quelqu’un, arrivant
à l’extrême limite de l’heure indiquée, ne vienne retarder leur départ
de quelques instants;—des intérêts graves sont à chaque instant
compromis par l’indépendance de ces fonctionnaires
subalternes;—chaque jour, des personnes croyant pouvoir se fier au
règlement affiché, arrivent cinq ou six minutes avant l’heure fatale et
trouvent les portes fermées.
![]() Comme je parlais tout à l’heure des Mécènes, j’en ai oublié un et
un véritable, un homme qui rendait des services réels à des gens de
lettres. Il est vrai qu’il est mort, et c’est précisément pour cela que
j’ai à vous parler de lui. C’était M. A***. M. A*** protégeait les
arts et quelquefois, en particulier, celui de la danse;—quelques
journalistes avaient trouvé moyen de lui faire redouter une appréciation
fâcheuse de cette protection.—D’autres menaçaient l’objet de la
protection.—Puis, ils empruntaient de l’argent à M. A***; celui-ci
consentait à prêter, mais seulement contre des lettres de change,—les
lettres de change étaient enfermées au fond d’un secrétaire, et le
bienfaiteur ne songeait nullement à s’en faire jamais payer: seulement,
à l’échéance, il avait soin de les faire protester—et de faire de temps
en temps ce qu’il fallait pour que ses titres ne fussent pas périmés,
afin de conserver une garantie contre de trop fortes exigences ou contre
quelques excès d’ingratitude. «La reconnaissance, disait-il, est un
sentiment délicat qui a besoin d’être étayé d’un peu de crainte.» M.
A*** est mort subitement; ses héritiers ont trouvé les lettres de
change parfaitement en règle, et ont annoncé l’intention formelle de les
faire payer,—par suite de quoi plusieurs personnes ont cru devoir
passer cet hiver à la campagne.
Comme je parlais tout à l’heure des Mécènes, j’en ai oublié un et
un véritable, un homme qui rendait des services réels à des gens de
lettres. Il est vrai qu’il est mort, et c’est précisément pour cela que
j’ai à vous parler de lui. C’était M. A***. M. A*** protégeait les
arts et quelquefois, en particulier, celui de la danse;—quelques
journalistes avaient trouvé moyen de lui faire redouter une appréciation
fâcheuse de cette protection.—D’autres menaçaient l’objet de la
protection.—Puis, ils empruntaient de l’argent à M. A***; celui-ci
consentait à prêter, mais seulement contre des lettres de change,—les
lettres de change étaient enfermées au fond d’un secrétaire, et le
bienfaiteur ne songeait nullement à s’en faire jamais payer: seulement,
à l’échéance, il avait soin de les faire protester—et de faire de temps
en temps ce qu’il fallait pour que ses titres ne fussent pas périmés,
afin de conserver une garantie contre de trop fortes exigences ou contre
quelques excès d’ingratitude. «La reconnaissance, disait-il, est un
sentiment délicat qui a besoin d’être étayé d’un peu de crainte.» M.
A*** est mort subitement; ses héritiers ont trouvé les lettres de
change parfaitement en règle, et ont annoncé l’intention formelle de les
faire payer,—par suite de quoi plusieurs personnes ont cru devoir
passer cet hiver à la campagne.
![]() FÉVRIER.—Ce mois-là—mon cher père mourut; Gatayes alla trouver
quelques-uns de mes amis et leur dit: «Nous allons faire le numéro des
Guêpes.—Alphonse Karr s’en est allé au bord de la mer.»
FÉVRIER.—Ce mois-là—mon cher père mourut; Gatayes alla trouver
quelques-uns de mes amis et leur dit: «Nous allons faire le numéro des
Guêpes.—Alphonse Karr s’en est allé au bord de la mer.»
Ce numéro fut fait par Ad. Adam.—E. d’Anglemont.—Le vicomte d’Arlincourt.—R. de Beauvoir.—H. Berthoud.—L. Desnoyers.—J. Ferrand.—Th. Gautier.—Gavarni.—L. Gozlan.—V. Hugo.—J. Janin.—A. de Lamartine.—Vicomte de Launay.—H. Lucas.—Mallefille.—Méry.—H. Monnier.—A. Soumet.—E. Sue.
Je leur renouvelle ici mes remercîments;—je ne crois pas devoir, pour cette nouvelle édition, m’emparer de ce qui me fut prêté alors et a sa place dans leurs œuvres. Je conserve seulement la notice écrite par Ad. Adam.
![]() HENRI KARR.—Henri Karr est né vers 1780, à Deux-Ponts (Bavière);
son père, maître de chapelle du duc de Bavière, était aussi son ami.
Cela nous surprendra peut-être un peu, nous autres habitants d’un pays
où, dit-on, règne l’égalité; mais cela paraît fort ordinaire en
Allemagne, pays d’aristocratie et de préjugés, où l’on a celui de croire
que par la raison que l’on est musicien on n’est pas nécessairement un
imbécile et que l’on peut être bon à donner quelques conseils, fût-ce
même à un prince. Celui dont nous parlons affectionnait donc
particulièrement son maître de chapelle, et comme la Révolution
française venait d’éclater, il le chargea d’une mission délicate auprès
du gouvernement révolutionnaire et l’y envoya en qualité de légat. En ce
bon temps, le respect dû aux personnages diplomatiques n’était pas la
vertu dominante des favoris du pouvoir. On avait l’usage alors de vous
emprisonner dès que vous étiez suspect, suspect de quoi? on
l’ignorait, on l’ignore à peu près encore: quoi de plus suspect qu’un
Bavarois? Le père d’Henri Karr fut donc emprisonné au palais du
Luxembourg. Peu habitué à ce genre de réception, il tomba malade et ne
tarda pas à succomber à une hydropisie de poitrine, à l’âge de
trente-six ans.
HENRI KARR.—Henri Karr est né vers 1780, à Deux-Ponts (Bavière);
son père, maître de chapelle du duc de Bavière, était aussi son ami.
Cela nous surprendra peut-être un peu, nous autres habitants d’un pays
où, dit-on, règne l’égalité; mais cela paraît fort ordinaire en
Allemagne, pays d’aristocratie et de préjugés, où l’on a celui de croire
que par la raison que l’on est musicien on n’est pas nécessairement un
imbécile et que l’on peut être bon à donner quelques conseils, fût-ce
même à un prince. Celui dont nous parlons affectionnait donc
particulièrement son maître de chapelle, et comme la Révolution
française venait d’éclater, il le chargea d’une mission délicate auprès
du gouvernement révolutionnaire et l’y envoya en qualité de légat. En ce
bon temps, le respect dû aux personnages diplomatiques n’était pas la
vertu dominante des favoris du pouvoir. On avait l’usage alors de vous
emprisonner dès que vous étiez suspect, suspect de quoi? on
l’ignorait, on l’ignore à peu près encore: quoi de plus suspect qu’un
Bavarois? Le père d’Henri Karr fut donc emprisonné au palais du
Luxembourg. Peu habitué à ce genre de réception, il tomba malade et ne
tarda pas à succomber à une hydropisie de poitrine, à l’âge de
trente-six ans.
Voici donc Henri Karr, à peine âgé de quinze ans, seul soutien de sa mère et de ses frères et sœurs, sans aucune ressource. A l’aide de son piano et de son violon, car, dans sa jeunesse, il jouait aussi très-bien de cet instrument, il combattit la mauvaise fortune; mais les affaires politiques prirent une tournure très-défavorable en Bavière, tandis qu’elles commençaient à s’améliorer en France. Henri Karr partit alors pour Paris, où il arriva à l’âge de vingt-deux ans, sans protection, ignorant même la langue du pays, et plus embarrassé dans la nouvelle patrie qu’il voulait se faire qu’il ne l’avait jamais été dans son pays natal. Heureusement il y avait, à cette époque, une providence pour les artistes: c’était la maison des frères Érard; là, la plus généreuse hospitalité accueillait les étrangers et les nationaux, il n’y avait nulle distinction, nulle étiquette, point de différence d’opinions; vous étiez artiste, donc vous étiez de la maison. Ce fut à cette porte qu’alla frapper Henri Karr; elle s’ouvrit à deux battants devant lui, et dès lors il eut une famille. Mais que pouvait-on faire pour le pauvre artiste? Ignorant notre langue, il ne pouvait donner de leçons, et il n’avait point encore essayé de composer. Les frères Érard eurent l’idée d’offrir à Karr de rester à demeure chez eux pour faire entendre leurs instruments aux étrangers qui venaient pour les acheter. Soit que cette nécessité eût développé chez leur protégé une spécialité dont ils étaient loin de se douter, soit que les qualités naturelles de l’artiste le portassent à la perfection de cette branche de l’art, toujours est-il que Karr se trouva sans rival pour faire valoir un instrument. On ne peut se faire une idée du talent qu’il déployait dans ces occasions. Je vous conterai tout à l’heure comme quoi il donna une preuve éclatante de sa supériorité. Karr resta pendant vingt ans, je crois, dans la maison Érard, autant comme ami que comme employé; mais ses ressources s’étaient accrues; dès qu’il put parler français, les leçons ne lui manquèrent plus, et puis il se mit à composer des morceaux de piano d’un style facile et à la portée des moyennes forces. Leur succès fut immense. On ne peut en expliquer la prodigieuse quantité que par l’inexplicable facilité avec laquelle il les composait. Nous l’avons vu souvent, chez les marchands de musique, achevant d’écrire, sans même l’avoir essayée, la fantaisie qu’on venait de lui commander une heure auparavant. Ces morceaux avaient une grande qualité: c’était, outre la facilité d’exécution, un naturel et une conséquence parfaite, ce qui s’explique naturellement, puisque c’était, pour ainsi dire, de l’improvisation écrite. Mais, quel que fût leur succès, Karr faisait trop voir aux éditeurs le peu de peine qu’il se donnait pour produire ces œuvres qui s’enlevaient par centaines, et on ne peut se figurer les prix fabuleux de mesquinerie avec lesquels on le rétribuait; d’ailleurs l’insouciance de Karr était telle, qu’il ne s’inquiétait jamais de la modicité de ce prix, et qu’il avait l’air de remercier l’éditeur qu’il venait d’enrichir. C’est ainsi que s’est écoulée la douce vie d’Henri Karr. Il y a peu de temps qu’il reçut la décoration de la Légion d’honneur, en même temps que Thalberg, ce favori de la fortune à qui aucun bonheur n’a manqué: talent, naissance, richesse; celui-là a eu tout en partage; et, de plus, son caractère est si aimable, qu’il ne compte que des amis. Mais revenons à Henri Karr. J’ai parlé de sa supériorité pour faire entendre un piano; je veux vous raconter une circonstance où il eut l’occasion de déployer tout son talent.
C’était en 1827. L’exposition de l’industrie avait lieu au Louvre. Érard avait fait disposer un orgue magnifique (le premier qui ait paru en France avec les mutations de jeu à la pédale) dans une des salles basses où se fait maintenant l’exhibition des travaux de sculpture. Outre l’orgue, les pianos et les harpes occupaient une partie de ce local. Karr touchait les pianos, Léon Gatayes jouait les harpes, et moi je jouais l’orgue. Te rappelles-tu, Gatayes, comme nous étions heureux alors? Et pourtant tu n’avais pas de chevaux à monter, tu courais le cachet, quand tu trouvais des leçons, et moi j’étais bien fier quand un éditeur me donnait quinze francs d’une romance et cinquante francs d’un morceau de piano: nous avons eu depuis ce temps-là presque tout ce que nous avions rêvé, et cependant nous regrettons cette époque d’insouciance et de folle vie où nous voudrions bien revenir. Nous avons bien des choses de plus aujourd’hui, mais alors nous avions seize ans de moins.
Notre concert attirait une foule immense: le Français est fou de musique gratis. Le fait est que nous faisions de fort jolies choses, et je ne sais pas s’il y a eu beaucoup d’exemples d’improvisations à trois, surtout aussi heureusement réussies. Nous avions surtout une fantaisie sur l’air: Il pleut, bergère, où chacun faisait sa variation, puis l’orgue simulait un orage avec une vérité parfaite, et nos trois instruments se réunissaient dans un finale qui n’était jamais le même, et qui avait un succès fou. Tout Paris venait nous entendre: Rossini y vint aussi, ce fut là que je le vis pour la première fois: je voulus me distinguer et je jouai d’une manière déplorable; j’étais si troublé de me sentir ce colosse sur les épaules, que je ne savais plus ce que je faisais, mes doigts barbotaient sur le clavier, mes pieds s’embarrassaient dans les pédales, c’était une cacophonie épouvantable. Jamais je ne fus si malheureux.
Le jour de la visite du jury d’exposition arriva. Les autres facteurs de pianos avaient leurs instruments exposés dans les salles du premier étage, encombrées d’étoffes et de tapis et d’une sonorité bien moins favorable que les salles basses, où étaient les pianos d’Érard. Déjà les pianos d’Érard avaient été examinés, les membres du jury étaient dans les salles du premier étage, lorsqu’un facteur de pianos, et des plus renommés, demanda que ses instruments fussent entendus à côté de ceux d’Érard et dans les mêmes conditions. On accéda à sa demande. Lorsqu’on vint proposer au père Érard de faire porter un de ses pianos au premier étage pour être comparé à ceux d’un rival, il bondit de fureur: cet homme de génie, qui, en fait de pianos, a presque tout inventé, sentait si bien sa supériorité sur ses confrères, qu’il n’en voulait reconnaître aucun; pour lui les deux mots piano Érard étaient inséparables; hors de sa maison il ne se fabriquait pas de pianos; il n’y avait que les envieux qui pussent propager un bruit si exorbitant. Il ne voulut jamais laisser emporter son instrument, et nous eûmes toutes les peines du monde à le faire consentir à laisser descendre celui de son rival. «Eh bien! s’écria-t-il, puisque vous le voulez tous, qu’il vienne; qu’on apporte son plus grand piano à queue, et je le combattrai avec un petit piano à deux cordes.»—Pour le coup nous le crûmes fou, mais il n’y eut pas moyen de le dissuader. Notre effroi pour l’honneur de la maison s’augmenta encore lorsque nous vîmes que le piano à queue du rival d’Érard allait être joué par un des plus célèbres pianistes. Pendant dix minutes, celui-ci tint ses auditeurs sous le charme de son jeu savant et harmonieux. Quand il eut fini, Érard fit un signe à Karr, qui alla se placer devant le piano à deux cordes. Gatayes et moi nous tremblions pour Érard et pour Karr: mais ni l’un ni l’autre n’avaient peur; la belle tête d’Érard avait perdu la contraction de colère qui l’agitait un instant auparavant, pour reprendre cette dignité calme qui était son expression habituelle; la bonne grosse figure de Karr était riante et narquoise; il y avait déjà du triomphe dans son malin sourire. Je ne sais ce que ce diable d’homme avait dans ses doigts, mais nul pianiste n’avait cette élégante facilité, ce charme brillant que l’on croyait venir de l’instrument et qui n’avait pas l’air d’appartenir à l’exécutant, dont il était pourtant la qualité essentielle. Il ne faisait pas de grandes difficultés, mais il surmontait la plus grande de toutes, celle de plaire, et il réussissait toujours. Le morceau qu’il improvisa n’était pas si savant que celui de son adversaire; il se serait gardé, sur ce petit instrument, d’aborder le style grandiose qui en eût démontré l’insuffisance; il fut gracieux, léger, coquet; bref, au bout d’une trentaine de mesures, il avait gagné la partie.
Érard eut encore cette année la médaille d’or; mais cette fois ce fut bien à Henri Karr qu’il la dut.
Henri Karr vient de mourir d’une attaque d’apoplexie, dans sa soixante-troisième année. Sur la fin de sa vie, tout son bonheur était dans les succès et la réputation de son fils: je ne le rencontrais pas de fois qu’il ne m’en parlât: il avait fait abnégation de sa personne et de sa réputation, il vivait tout entier dans celles d’Alphonse. Consolons-nous donc de la perte de cet artiste estimable en songeant aux jouissances qu’il a su trouver pendant ses dernières années dans les succès de celui en qui il se sentait revivre, et puisse l’hommage d’amitié que nous rendons tous au fils rejaillir encore sur la mémoire du père!
Ad. ADAM.
Le vendredi 13 janvier.—A monseigneur l’archevêque de Paris, pour les besoins de l’Église.—La grande politique et la petite politique.—Chandelle et lumière.—M. Lehoc.—Le dieu Cheneau.—Les Guêpes refoudroyées.—Messieurs les savants et mesdames leurs inventions.—M. de Lamartine et les journaux.—Sur quelques décorations.—Chiromancie.—Catholique.—M. Jouy.—M. Jay.—Ciguë.—Confiscation.
A MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE DE PARIS.
Vendredi 13 janvier.
![]() «13.—Jésus monta à Jérusalem.
«13.—Jésus monta à Jérusalem.
»14.—Et trouva au temple des gens qui vendaient des bœufs et des brebis et des pigeons,—et les changeurs qui y étaient assis.
»15.—Et ayant fait un fouet de cordelettes, il les jeta tous hors du temple,—et les brebis et les bœufs,—et répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables.
»16.—Et dit à ceux qui vendaient des pigeons: Otez ces choses d’ici et ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché.» (Évangile selon saint Jean.)
Monseigneur, le vendredi—treize janvier de cette année, un fils suivait avec quelques amis le corps de son père, le cortége s’arrêta rue Saint-Louis, vis-à-vis l’église de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, et on porta le corps dans l’église.
Des menuisiers travaillaient dans l’église, sciaient des planches et enfonçaient des clous à coup de marteau;—il ne se trouva personne pour leur imposer silence; il y avait bien là un homme, mais il offrait de l’eau bénite et tendait la main; il y avait bien là une femme, mais elle passait dans les rangs des chaises, et tendait la main. Un des amis du mort alla trouver les ouvriers et ne put leur faire suspendre leur travail qu’en leur donnant de l’argent. Le suisse vint chercher le fils du mort et un de ses amis et les mena à la sacristie.—La sacristie leur parut répondre à ce qu’on appelle les coulisses dans les théâtres.—En effet, il y avait là deux hommes dont l’un s’habillait et revêtait le costume du rôle qu’il avait à jouer.—L’autre, qui avait fini le sien, remettait l’habit bourgeois.
Un vieux prêtre—faisait au fils du mort—quelques questions dont il inscrivait les réponses sur un registre;—pendant ce temps les deux hommes qui changeaient de vêtement causaient et riaient tout haut.—Je remarquai surtout celui qui allait entrer en scène;—c’était un grand drôle—déguisé en prêtre;—il avait des cheveux noirs huilés—prétentieusement aplatis sur les tempes;—il riait et parlait comme personne de bien élevé n’oserait rire et parler dans un endroit où il y a quelqu’un qui fait des questions et quelqu’un qui répond. Je ne parle ni de la solennité du lieu,—ni de la solennité de la cérémonie; et pendant ce temps—le fils, arraché à son profond recueillement, sentait dans son âme la douleur s’aigrir en colère et en haine.—Son ami l’entraîna—à la triste stalle—où il devait assister à cette représentation.—En effet, la chose commença.
Le personnage aux cheveux huilés ne tarda pas à faire son entrée; il avait revêtu avec la chasuble—un air contrit, humble et béat; il tenait les yeux modestement baissés à terre;—il portait à la main une bourse—et allait à chaque personne demander quelques sous—en faisant des révérences;—il ne riait plus, car c’était le moment sérieux de la cérémonie,—le moment de la recette.—Quelque riche que soit devenue l’Église, elle n’a pas pour cela cessé d’être humble, et, pour montrer cette humilité, elle ne laisse jamais passer une occasion de demander l’aumône. Le drôle aux cheveux huilés,—d’une voix cauteleuse et caressante,—bien différente de sa voix de la sacristie,—accompagnait chacune de ses révérences de ces mots: «Pour les besoins de l’église, s’il vous plaît.»
Ces paroles m’ont frappé, monseigneur, et j’ai songé que l’Église est dans une mauvaise voie.
Ce n’est pas des quelques gros sous—que cet homme recueille dans sa bourse—que l’Église a besoin,—pensai-je alors,—mais c’est de croyance et de foi dans son propre sein.
Quoi! monseigneur, c’est au moment où un fils et des amis brisés par la douleur vont demander à l’Église et à la religion des consolations pour eux et des prières pour leur père et leur ami,—qu’ils ne trouvent que de mauvais comédiens qui ne prennent pas la peine de savoir leur rôle—et de le jouer décemment!
Il y avait là des poëtes, des musiciens, des soldats,—et tout ce monde-là était décent et recueilli,—tous, excepté les prêtres, monseigneur.
Tout le monde priait pour le mort,—excepté les prêtres, qui l’insultaient.
Tout le monde avait l’air de croire et d’espérer en Dieu,—tout le monde...—excepté les prêtres.
Jamais, dans mes écrits et dans mes paroles, je ne me suis mêlé aux attaques vulgaires contre la religion du pays—et contre l’Église;—loin de là, j’ai souvent élevé la voix contre leurs ennemis;—mais jamais l’Église et la religion n’ont eu d’ennemis aussi dangereux que de semblables ministres;—jamais l’impiété ne leur a porté d’aussi terribles coups que de pareils prêtres.
Pour les besoins de l’Église, monseigneur,—je vous demande justice.
Pour les besoins de l’Église, monseigneur, je vous demande un désaveu de semblables choses et de semblables gens.
Pour les besoins de l’Église, monseigneur, que les prêtres aient l’air de croire en Dieu.
Pour les besoins de l’Église, si ce sont des comédiens, qu’ils apprennent leur rôle; qu’ils respectent leur public—et qu’ils ne laissent personne dans les coulisses.
Pour les besoins de l’Église, déguisez mieux les marchands que Jésus-Christ a chassés du temple, qui y sont rentrés et en ont fait une boutique—où ils ne vendent, il est vrai, ni bœufs, ni brebis, ni pigeons,—mais des prières qui ne partent que des lèvres.
J’aimais mieux ceux qui vendaient des bœufs et des brebis et des pigeons: ils n’étaient que marchands;—ceux-ci sont marchands—et voleurs.
Pour les besoins de l’Église,—monseigneur,—montrez que vous ne voulez pas que les prêtres agissent ainsi;—montrez que l’Église peut être un asile sûr pour la douleur,—et qu’elle n’y doit pas rencontrer l’insulte et le mépris.
Pour les besoins de l’Église,—faites, comme Jésus-Christ votre Maître, un fouet de cordelettes—et chassez ceux-ci du temple—pour qu’on n’abatte pas un jour le temple lui-même sur vous tous.
Pour le fils du mort,—il est allé pleurer et prier,—loin de là dans la campagne—au bord de la mer,—là—où tout parle de Dieu,—sous la voûte bleue de cette belle et grande église—qui est toute la nature,—là où il n’y a pas de prêtres impies et sacriléges.
![]() Il se dit depuis quelque temps des choses plus qu’étranges—à
propos du droit de visite,—sur lequel les Guêpes se sont expliquées
assez clairement.
Il se dit depuis quelque temps des choses plus qu’étranges—à
propos du droit de visite,—sur lequel les Guêpes se sont expliquées
assez clairement.
On a un peu parlé de dignité nationale, d’honneur et de fierté légitime.—A quoi un pair d’abord, puis tous les partisans et tous les journaux du ministère ont dit:—«Ce sont des préoccupations étrangères à la grande politique.»
Ce mot m’a expliqué bien des choses qui se sont passées sous mes yeux, et que je n’avais pas parfaitement comprises en leur temps.
De brusques revirements d’opinions,—des principes défendus aujourd’hui et attaqués demain, des personnes vénérées et adulées d’abord, puis ensuite traînées dans la boue.
Des haines irréconciliables se terminent par des alliances honteuses au profit d’autres haines communes.
Le mensonge,—la mauvaise foi,—l’injustice,—tout cela, c’est de la grande politique.
Au contraire,—ne se vendre ni aux avantages d’un parti ni aux promesses d’un autre,—petite politique.
Juger d’après sa conscience et parler d’après son jugement,—petite politique.
Dire la vérité à tout le monde, sur tout le monde et sur toute chose,—petite politique.
N’admettre ni la fourberie ni la lâcheté,—petite politique.
Dieu nous délivre de ces grands Machiavels de comptoir et de leur grande politique—et de leurs grandes phrases, et de leurs grandes sottises, et de leurs grandes apostasies,—et de leurs grandes lâchetés.
![]() Sur messieurs les savants et sur mesdames leurs inventions.—Nous
avons à plusieurs reprises signalé certains progrès de la science qu’il
nous a paru utile de dénoncer à la prudence publique.
Sur messieurs les savants et sur mesdames leurs inventions.—Nous
avons à plusieurs reprises signalé certains progrès de la science qu’il
nous a paru utile de dénoncer à la prudence publique.
La gélatine moins nourrissante que l’eau claire, mais plus malsaine,—que l’on continue à donner aux malades dans les hôpitaux.
Une nouvelle pomme de terre—grosse comme un pois.
Un cerfeuil nouveau, mais vénéneux, etc.
Voici quelque chose d’aussi nouveau,—mais de plus inquiétant.
Les moutons et les bœufs sont sujets à la pleurésie; on a imaginé depuis quelque temps de leur faire avaler, quand ils en sont atteints,—une once d’arsenic.
C’est-à-dire de quoi empoisonner cinquante personnes.
Les moutons et les bœufs guérissent,—mais ceux qui les mangent ensuite courent le plus grand risque d’être empoisonnés et de mourir.
On ne peut plus se fier aux côtelettes de mouton, ni aux biftecks.
De bonnes gens qui ont passé toute leur vie à se priver de champignons—dans la crainte d’un accident—se trouveront empoisonnés par la soupe et le bouilli,—cette nourriture considérée jusqu’ici comme au moins assez innocente.
Ce n’était pas assez que M. Gannal et ses disciples—eussent trouvé le moyen d’empailler le rosbif,—d’embaumer les rognons de mouton—et de nous faire manger des côtelettes qui sont nos aînées—et des œufs frais—dont les poulets auraient quarante ans;
Il faut qu’on empoisonne la viande.
Cette découverte des savants serait réputée une infamie si quelqu’un l’exerçait même à la guerre contre ses ennemis.
![]() Le parti conservateur qui est arrivé aux affaires—a horreur de
toute supériorité d’un de ses membres: il veut que les choses restent ce
qu’elles sont;—tout homme d’action et de puissance le gêne,
l’embarrasse et lui inspire de l’ombrage.
Le parti conservateur qui est arrivé aux affaires—a horreur de
toute supériorité d’un de ses membres: il veut que les choses restent ce
qu’elles sont;—tout homme d’action et de puissance le gêne,
l’embarrasse et lui inspire de l’ombrage.
L’opposition, au contraire,—qui veut arriver,—accepte volontiers des recrues,—sauf à faire plus tard,—en cas de succès,—précisément ce que font aujourd’hui les conservateurs.
Toujours est-il que lorsque M. de Lamartine vint apporter aux conservateurs l’appui d’un nom célèbre, d’un beau talent, d’un beau caractère,—il fut accueilli d’abord assez froidement,—puis ensuite, l’objet de la jalousie et de la malveillance de son parti, qui ne le trouvait pas assez médiocre, et dans lequel il voyait plus d’adversaires réels que dans l’opposition qu’il combattait avec eux.
Il a abandonné solennellement ce parti et s’est rangé dans l’opposition.
L’opposition l’a laissé se placer à sa tête,—à côté de ses chefs les plus prônés.
Ce qu’il y a d’assez singulier en ceci, c’est de rapprocher ce que disent aujourd’hui les journaux de l’opposition sur M. de Lamartine de ce qu’ils en disaient alors.
«Il se perdait dans les nuages...., il ferait mieux de chanter Elvire.—..... On l’avertissait de reprendre sa harpe ou son téorbe,» etc., etc.
Aujourd’hui,—c’est un concert d’éloges mérités: «M. de Lamartine est un homme—sérieux,—éloquent.»
Le vendredi,—3 mars 1843, M. Chambolle a dit dans le journal le Siècle:
«M. de Lamartine a parlé,—il ne faut pas prétendre à analyser ce majestueux tableau de la situation de la France vis-à-vis de l’Europe; il ne faut point tenter de reproduire les élans, les images de cette parole souveraine.
»M. de Lamartine serait notre adversaire que nous payerions à son talent le même tribut d’éloges; ce talent laissera après lui une trace lumineuse, éclatante, et honorera à jamais notre pays.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»Les nobles intérêts qu’il sait si bien comprendre,» etc.
Nous aimons à voir cette impartialité dans un député et dans un journaliste;—c’est comprendre et exercer convenablement et la dignité de la presse, et celle de la représentation nationale.
«Nous payerions LE MÊME tribut d’éloges à M. de Lamartine—quand il serait notre adversaire.»
A la bonne heure, ce n’est plus là cet aveuglement, cette mauvaise foi de l’esprit de parti—qui accordent tout le talent, toutes les lumières, toutes les vertus, aux gens dont on se sert,—et qui accablent d’injures les gens qu’on rencontre dans un parti opposé au sien.—Voilà comment des hommes à conviction font une guerre loyale et honnête,—voilà des sentiments qui font plaisir à entendre professer.—M. de Lamartine serait l’adversaire de M. Chambolle, que M. Chambolle lui payerait le même tribut d’éloges.
Félicitons M. Chambolle—.....
PADOCKE. Ah çà! maître, à quoi pensez-vous? que faites-vous?
LE MAITRE DES GUÊPES.—Ce que je fais, Padocke, je fais comme ferait M. Chambolle, je rends justice à un homme dont je ne partage pas les idées.—M. Chambolle payerait à M. de Lamartine le même tribut d’éloges, quand même M. de Lamartine serait son adversaire.
Je paye à M. Chambolle un tribut d’éloges...
PADOCKE. Pardon, maître, mais vous n’avez pas de mémoire. Ouvrez le numéro des Guêpes qui a paru le 1er septembre 1840.
LE MAITRE DES GUÊPES. Pourquoi faire, Padocke?
PADOCKE. Ouvrez-le,—vous verrez.
LE MAITRE DES GUÊPES.—Le voici ouvert, Padocke.
PADOCKE. Cherchez à la page 365.
LE MAITRE DES GUÊPES. Page 365,—nous y voici!
PADOCKE. Très-bien!... lisez...
LE MAITRE DES GUÊPES. «25 août.—Il est arrivé un grand malheur à ce pauvre M. Chambolle,—député et rédacteur en chef du journal le Siècle.
«Ledit M. Chambolle, dans le numéro du Siècle d’aujourd’hui 25 août 1840,—numéro tiré à soixante-douze mille exemplaires,—ainsi que le journal l’affirme lui-même,—M. Chambolle a imprimé que... «M. de Lamartine est un niais.»—Ce pauvre M. Chambolle,—je prends la plus grande part à l’accident qui lui arrive,—et je le prie d’agréer favorablement mes compliments de condoléance.»
PADOCKE. Eh bien! maître?
LE MAITRE DES GUÊPES. Eh bien! Padocke!
PADOCKE. Eh bien! maître, M. de Lamartine était alors l’adversaire de M. Chambolle, et il me semble que M. Chambolle ne lui payait pas tout à fait le même tribut d’éloges.
![]() Le dieu Cheneau vient de fulminer contre moi une seconde
lettre.—La foudre du dieu, cette fois, n’est pas tirée à un seul
exemplaire, comme le dernier tonnerre.—Ce céleste carreau—a pris la
forme d’une brochure de trente-deux pages,—format in-8º,—imprimée chez
Paul Dupont, rue de Grenelle-Saint-Honoré, 53.
Le dieu Cheneau vient de fulminer contre moi une seconde
lettre.—La foudre du dieu, cette fois, n’est pas tirée à un seul
exemplaire, comme le dernier tonnerre.—Ce céleste carreau—a pris la
forme d’une brochure de trente-deux pages,—format in-8º,—imprimée chez
Paul Dupont, rue de Grenelle-Saint-Honoré, 53.
Jamais mortel n’a été aussi complétement réduit en poudre—que celui qui fut l’auteur des Guêpes;—laissons fulminer le dieu:
«Je ne donnerai pas de nouveaux développements—pour me faire comprendre de M. A. Karr; je vois bien que la faculté de comprendre manque aux Guêpes.—Les Guêpes sont légères,—tellement légères, qu’elles ne peuvent, à ce qu’il paraît, changer leur nature;—pourquoi se cassent-elles le nez elles-mêmes! Ces insectes ne font que produire la douleur et le désordre.—Pauvres Guêpes, vous vous servez encore de plumes d’oie pour écrire.—Les Guêpes n’ont vraiment reçu que le baptême d’eau,—je ne saurais trop le répéter.
»Oui, monsieur A. Karr,—je suis mercier;—si j’étais Dieu, comme vous le dites, je ne serais pas le Dieu des Guêpes;—j’emploierais mieux mon loisir!
»Je me sens la force de soutenir les hostilités des Guêpes, car je défie même les corbeaux.
»Votre réponse du mois dernier ne se conservera pas, je vous en préviens!...
»J’espère que vous serez pardonné, vu votre manque de conception.
»Je vous plains de ne pas comprendre.—M. Jouin, sur lequel vous demandez des renseignements, n’est pas à Paris;—laissez les absents tranquilles.
»Depuis longtemps le monde est la dupe de prétendus savants qui, comme vous, se posent sur le premier piédestal venu pour juger la faculté de chacun,—comme s’ils en avaient les capacités;—ils déblatèrent,—ils battent la campagne;—ils sifflent comme des serpents.
»Il est temps que l’on brise ces fausses muses qui produisent la démence—dans le jugement,—dans l’entendement humain;—que les Guêpes restent Guêpes.
»Si M. A. Karr se fût annoncé quand il est venu chez moi, je me serais procuré le plaisir de le recevoir.—CHENEAU.»
«AVIS.—Toute critique qui ne me sera pas adressée sera considérée comme critique honteuse.—CHENEAU.»
Une autre brochure,—cette fois en vers, m’appelle: «atroce frelon.»
Un troisième monsieur—a découvert dans les livres hébreux—que Beelzebuth—veut dire roi des mouches,—et il en tire la conséquence que je suis Beelzebuth.
![]() Un M. Prosper Lehoc,—épicier, propriétaire et fils unique de feu
M. Lehoc,—décédé notaire royal,—a publié récemment deux
ouvrages;—l’un est un Traité de l’Épicerie avec un Traité spécial de
la chandelle en forme d’appendice.
Un M. Prosper Lehoc,—épicier, propriétaire et fils unique de feu
M. Lehoc,—décédé notaire royal,—a publié récemment deux
ouvrages;—l’un est un Traité de l’Épicerie avec un Traité spécial de
la chandelle en forme d’appendice.
L’autre ouvrage est un Traité du véritable gouvernement représentatif, basé sur la force, la prudence et la justice.
«Mon travail, dit M. Prosper Lehoc, a eu pour but de faire des peuples de la terre un seul et même peuple de frères.—Je pense y être parvenu.»
Des deux livres de M. Lehoc, l’un est consacré à la chandelle,—l’autre aux lumières.
Il répand à la fois la clarté—dans les appartements et dans les âmes;—il épure le suif et les lois.
M. Lehoc nous permettra cependant de nous étonner un peu de voir le gouvernement actuel,—le gouvernement représentatif dont nous jouissons,—nié et sapé dans sa base par un épicier.—Que peuvent donc encore demander les épiciers,—aujourd’hui que leur règne est arrivé,—aujourd’hui qu’ils se sont emparés du royaume de la terre en échange du royaume des cieux, qui semblait leur avoir été spécialement réservé?
Pour la préparation de la graisse, M. Lehoc ne se sert pas de l’huile de vitriol,—comme on fait à Rouen.
UN LECTEUR. Ah çà! que voulez-vous dire,—Grimalkin?
GRIMALKIN. Je parle du Traité de la chandelle de M. Lehoc.
LE LECTEUR. Ah! je croyais que nous en étions au Traité du gouvernement représentatif.
GRIMALKIN. Aimez-vous mieux parler du gouvernement représentatif?—parlons du gouvernement représentatif.
Nous disions donc que M. Lehoc ne veut plus du gouvernement représentatif tel qu’il est aujourd’hui;—il n’en veut pas plus que de l’huile de vitriol pour préparer la graisse de ses chandelles.
M. Lehoc est pour l’extension illimitée du vote électoral—«Un rayon de la divinité constitue le sentiment et la conscience de chaque citoyen (épicier ou autre); c’est ce qui fait que les hommes doivent nécessairement tous concourir à la représentation nationale.»
On ouvre la porte,—le vent emporte la brochure de M. Lehoc,—Où en étais-je?...—Ah! m’y voici.
«La théorie que j’ai écrite est pour l’instruction des jeunes gens qui se destinent à cette carrière.—Ma méthode est simple et empêche la chandelle de couler...»
Ah! me voici encore à la chandelle!—il me semblait cependant que j’en étais à une phrase pareille dans la partie politique des œuvres de M. Lehoc.
Ah! la voici:
«C’est spécialement pour servir de guide aux électeurs que j’ai composé cet ouvrage.
»Tel est en peu de mots, ce que l’on s’empresse d’offrir à tous les États.»
De la chandelle?
Non, le gouvernement représentatif, le véritable gouvernement représentatif,—le gouvernement représentatif de M. Lehoc.
«Le gouvernement représentatif (le vrai, celui de M. Lehoc), met infiniment d’ordre et d’économie dans sa trésorerie (pourquoi pas dans son comptoir!);—il règle la dépense sur la modicité des revenus,» etc.
Cette fois, je crois que c’est M. Lehoc qui a confondu la chandelle et le gouvernement représentatif. Ces préceptes, mêlés, par erreur à la partie politique, appartiennent sans aucun doute—à l’épicerie en demi-gros et en détail.
![]() Certes, jamais à aucune époque les hommes n’ont eu autant de chefs
pour les conduire, autant de philosophes pour les réformer,—autant de
rois disponibles pour les gouverner, autant de dieux et de
prophètes—pour recevoir leur encens ou leur moquerie.
Certes, jamais à aucune époque les hommes n’ont eu autant de chefs
pour les conduire, autant de philosophes pour les réformer,—autant de
rois disponibles pour les gouverner, autant de dieux et de
prophètes—pour recevoir leur encens ou leur moquerie.
Ce qui manque aujourd’hui,—ce sont des hommes qui veuillent bien être gouvernés,—c’est une place à prendre, une spécialité à occuper.
![]() On voit de temps à autre dans les journaux que différents citoyens
ont reçu d’un ministre des médailles—pour avoir, au péril de leur vie,
sauvé celle d’autres citoyens.—Ces citoyens sont toujours des hommes du
peuple—et des ouvriers.
On voit de temps à autre dans les journaux que différents citoyens
ont reçu d’un ministre des médailles—pour avoir, au péril de leur vie,
sauvé celle d’autres citoyens.—Ces citoyens sont toujours des hommes du
peuple—et des ouvriers.
Le cœur et le bon sens disent que, de toutes les décorations, ces médailles sont sans contredit les plus honorables.
En effet,—les mieux méritées d’entre les autres croix ont été données pour des traits de courage et de dévouement,—qu’il est juste de récompenser par des honneurs;—mais ce n’est pas trop que de demander qu’on traite aussi bien l’homme qui a exposé sa vie pour en sauver un autre—que celui qui a mis la sienne au hasard—pour en tuer trois ou quatre.
J’ai parlé plus d’une fois de la sottise et de l’infamie qui ont récompensé tant de fois des services honteux—du même signe que d’autres ont payé de vingt blessures et de mille dangers.
Je ne parle aujourd’hui que des médailles d’honneur;—comme il faut nécessairement les mériter pour les obtenir, comme on ne peut les obtenir que d’une seule manière,—comme il est écrit dessus la cause pour laquelle on les donne,—comme elles ne sont guère gagnées, ainsi que je le disais tout à l’heure, que par des gens du peuple et des ouvriers,—comme on n’en peut récompenser aucune infamie, le pouvoir les donne avec une négligence et un dédain honteux.
Le ruban qui les attache n’est pas même un ruban qui leur soit spécialement affecté,—c’est un ruban tricolore—que tout le monde a le droit de porter,—aussi bien que les femmes portent des rubans roses et lilas.
Chez les Romains, qui donnaient des couronnes pour récompenses honorifiques,—la couronne civique, qui était une couronne de chêne,—était particulièrement estimée.—Cicéron eut soin de la demander après avoir découvert la conspiration de Catilina,—et Auguste fut si fier de l’obtenir, qu’il fit graver une médaille sur laquelle il était représenté couronné de chêne avec ces mots:
Il n’y avait que deux couronnes qui fussent mises au-dessus de celle-là:—c’était la couronne obsidionale, qu’on obtenait pour avoir délivré une armée romaine assiégée,—et la couronne triomphale,—qui était, pour un général en chef, le prix d’une victoire complète en bataille rangée.
Toutes les autres étaient au-dessous;—la couronne de chêne avait même certains priviléges et certains honneurs qu’on ne rendait à aucune des autres.
En général, on ne fait pas grand cas de la croix d’honneur tant qu’on ne voit pas pour soi des chances de l’obtenir;—mais vous voyez tout doucement les journalistes qui en ont le plus médit s’abstenir ou en parler avec plus de respect à mesure qu’ils s’approchent d’une position qui leur permet d’y aspirer.
Il est singulier, de notre temps, de savoir qu’au même instant, à la même minute, un soldat s’expose au feu ennemi,—se précipite à travers les dangers et affronte la mort en Afrique;
Tandis qu’à Paris un monsieur—vend sa voix ou sa plume à un ministre,—ou l’accable de basses adulations,—et que tous deux sont également récompensés par une même et identique croix d’honneur. Pour ce qui est des médailles dont nous parlons, elles sont toujours l’objet du dédain, parce que, je le répète, on ne peut compter ni sur un hasard, ni sur une lâcheté, pour les obtenir.
Je connais un homme qui a été l’objet, depuis quinze ans, de cent brocards et de mille lazzi, et dans le monde et dans les journaux,—parce qu’il porte quelquefois une médaille de ce genre, même de la part de gens qui seraient plus qu’embarrassés s’il leur fallait écrire sur leur croix,—comme c’est écrit sur les médailles,—la cause qui la leur a fait obtenir.
Je n’ai jamais pu découvrir le côté plaisant de la chose.
Je pense qu’il serait du bon sens, de la justice, de la philosophie,—et je dirais de la philanthropie, si les spéculateurs n’avaient rendu ce mot ridicule,—de ne pas montrer de dédain officiel pour cette décoration;—serait-ce trop demander que d’abord on cessât de l’attacher au ruban tricolore,—qui appartient à la politique,—et ensuite qu’on lui affectât un ruban particulier?
Je suis assez curieux de savoir ce que répondra à cette demande le ministre dans les attributions duquel se trouve la chose, et auquel je vais faire adresser cette réclamation.
![]() DICTIONNAIRE FRANÇAIS-FRANÇAIS.—BOURSE.—On a institué dans les
colléges royaux—des bourses et des demi-bourses—au moyen
desquelles les enfants de vieux soldats ou de vieux fonctionnaires qui
ont servi l’État avec distinction et sont restés pauvres—peuvent être
élevés gratuitement.
DICTIONNAIRE FRANÇAIS-FRANÇAIS.—BOURSE.—On a institué dans les
colléges royaux—des bourses et des demi-bourses—au moyen
desquelles les enfants de vieux soldats ou de vieux fonctionnaires qui
ont servi l’État avec distinction et sont restés pauvres—peuvent être
élevés gratuitement.
Ce bienfait était également destiné à permettre de faire leurs études à des enfants de parents pauvres, mais dont l’intelligence promettait des citoyens utiles.
Je prie M. Villemain, ministre de l’instruction publique, de me démentir si je me trompe en affirmant—que la moitié des bourses est donnée uniquement, sur la demande des députés,—à des enfants qui ne sont dans aucun des cas ci-dessus mentionnés,—à des enfants même dont souvent les parents sont riches,—et dont quelques-uns ont cinquante mille livres de rente.—Une bourse est donnée, non pas à un enfant pour qu’il fasse ses études, mais à un électeur ou à un député, pour qu’il donne sa voix.
![]() CABALE.—Un auteur appelle cabale tout public qui siffle;—eût-il
rempli la salle de gens salariés ou d’amis furibonds; eût-on insulté et
un peu rossé les vrais spectateurs, l’auteur appelle alors les
souteneurs de sa muse—un public éclairé.—(Voir ce mot.)
CABALE.—Un auteur appelle cabale tout public qui siffle;—eût-il
rempli la salle de gens salariés ou d’amis furibonds; eût-on insulté et
un peu rossé les vrais spectateurs, l’auteur appelle alors les
souteneurs de sa muse—un public éclairé.—(Voir ce mot.)
![]() CABARET.—Nos ancêtres allaient dîner au cabaret.—Les cabarets
étaient des asiles fort décents présidés par d’excellents cuisiniers et
où ils causaient librement.—On dîne aujourd’hui dans des temples de
mauvais goût, remplis de dorures et de glaces,—où tout est si cher que
les pauvres gens qui les fréquentent affectent des goûts bizarres ou des
maladies plus que fâcheuses—pour y restreindre convenablement leur
écot: l’un adore le bœuf bouilli,—un autre n’aime plus que les
choux;—la plupart, par raison de santé, ne boivent que de l’eau.—On
allait au cabaret pour dîner; on va au Café Anglais ou au Café de Paris
pour être vu y dîner.
CABARET.—Nos ancêtres allaient dîner au cabaret.—Les cabarets
étaient des asiles fort décents présidés par d’excellents cuisiniers et
où ils causaient librement.—On dîne aujourd’hui dans des temples de
mauvais goût, remplis de dorures et de glaces,—où tout est si cher que
les pauvres gens qui les fréquentent affectent des goûts bizarres ou des
maladies plus que fâcheuses—pour y restreindre convenablement leur
écot: l’un adore le bœuf bouilli,—un autre n’aime plus que les
choux;—la plupart, par raison de santé, ne boivent que de l’eau.—On
allait au cabaret pour dîner; on va au Café Anglais ou au Café de Paris
pour être vu y dîner.
![]() CADMUS.—Le Phénicien Cadmus a inventé la guerre civile et
l’alphabet.—Son alphabet se composait seulement de seize lettres; il
serait curieux de calculer combien de sottises on écrit tous les jours
rien qu’avec les huit lettres que les modernes y ont ajoutées.
CADMUS.—Le Phénicien Cadmus a inventé la guerre civile et
l’alphabet.—Son alphabet se composait seulement de seize lettres; il
serait curieux de calculer combien de sottises on écrit tous les jours
rien qu’avec les huit lettres que les modernes y ont ajoutées.
![]() CADRAN.—Il n’y a rien de si faux que les heures du cadran et ses
divisions; le temps ne peut avoir jamais qu’une durée relative.—Un jour
peut se traîner plus lentement qu’un mois,—un mois échapper plus rapide
qu’un jour.—Le temps doit se jauger et non se mesurer, c’est-à-dire
non s’apprécier par ses dimensions extérieures, mais par ce qu’il
contient.—Il y a telle année qui, si on l’épluchait comme une noix,—si
l’on en retranchait les cartilages et les pellicules amères, tiendrait à
l’aise dans certains jours.—Il y a une heure dans notre vie pendant
laquelle nous avons plus vécu que dans le reste de nos jours.
CADRAN.—Il n’y a rien de si faux que les heures du cadran et ses
divisions; le temps ne peut avoir jamais qu’une durée relative.—Un jour
peut se traîner plus lentement qu’un mois,—un mois échapper plus rapide
qu’un jour.—Le temps doit se jauger et non se mesurer, c’est-à-dire
non s’apprécier par ses dimensions extérieures, mais par ce qu’il
contient.—Il y a telle année qui, si on l’épluchait comme une noix,—si
l’on en retranchait les cartilages et les pellicules amères, tiendrait à
l’aise dans certains jours.—Il y a une heure dans notre vie pendant
laquelle nous avons plus vécu que dans le reste de nos jours.
Le cadran encore met de la préméditation dans toute la vie.—C’est un tyran qui vous prescrit la faim, la soif, le sommeil.—C’est aussi un reproche perpétuel.—Jamais je n’ai regardé un cadran sans m’apercevoir que j’étais en retard pour quelque chose.
![]() CALOMNIE.—Quand vous avez passé toute votre vie dans une
perpétuelle surveillance sur vous-même, pour ne pas donner prise à la
médisance, vous n’avez atteint qu’un seul but, c’est de forcer les gens
à vous calomnier.
CALOMNIE.—Quand vous avez passé toute votre vie dans une
perpétuelle surveillance sur vous-même, pour ne pas donner prise à la
médisance, vous n’avez atteint qu’un seul but, c’est de forcer les gens
à vous calomnier.
![]() CONDAMNATION.—Pour avoir donné un soufflet à Paul, Pierre est
condamné à payer une amende.
CONDAMNATION.—Pour avoir donné un soufflet à Paul, Pierre est
condamné à payer une amende.
—Qui reçoit cette amende? Paul, sans doute?
—Non, c’est S. M. Louis-Philippe Ier, roi des Français.
—Comment! est-ce toujours ainsi?
—Oui... à moins cependant que ce ne soit Paul qui paye l’amende.
—Paul... qui a reçu le soufflet?
—Cela arrive quelquefois.
![]() CHEVALIER.—Un chevalier était autrefois un homme d’armes couvert
d’acier,—à la démarche noble et puissante,—au poignet de fer, à la
poitrine large,—prêt à affronter les périls les plus extravagants pour
sa dame et pour son roi.
CHEVALIER.—Un chevalier était autrefois un homme d’armes couvert
d’acier,—à la démarche noble et puissante,—au poignet de fer, à la
poitrine large,—prêt à affronter les périls les plus extravagants pour
sa dame et pour son roi.
Aujourd’hui on ne peut entrer dans un salon—sans voir une vingtaine d’hommes vêtus de noir,—maigres, chauves, chétifs,—et qui sont des chevaliers.—M. Sainte-Beuve est chevalier.
![]() CAFÉ.—Endroit où, sous prétexte de prendre du café à la crème, on
va tous les matins apprendre les sottises, les niaiseries et les
calomnies qu’on répétera toute la journée.
CAFÉ.—Endroit où, sous prétexte de prendre du café à la crème, on
va tous les matins apprendre les sottises, les niaiseries et les
calomnies qu’on répétera toute la journée.
![]() CATHOLIQUE.—Certains carrés de papier,—le Constitutionel], par
exemple,—si célèbre par sa crédulité—en excepte la religion du
pays,—il protége de son égide—tout ce qui s’élève contre
elle:—l’abbé Chatel, sacré par un épicier,—l’abbé Auzou, ancien
comédien, ont droit à ses éloges;—il est protestant, il est mahométan,
il est guèbre,—il est tout, excepté catholique;—il demande la liberté
des cultes pour les autres religions,—mais il ne veut pas l’accorder à
la religion de la majorité des Français;—si l’on fait une procession à
l’époque de la Fête-Dieu,—il dénonce Dieu à la police—et signale ses
tendances contre-révolutionnaires.
CATHOLIQUE.—Certains carrés de papier,—le Constitutionel], par
exemple,—si célèbre par sa crédulité—en excepte la religion du
pays,—il protége de son égide—tout ce qui s’élève contre
elle:—l’abbé Chatel, sacré par un épicier,—l’abbé Auzou, ancien
comédien, ont droit à ses éloges;—il est protestant, il est mahométan,
il est guèbre,—il est tout, excepté catholique;—il demande la liberté
des cultes pour les autres religions,—mais il ne veut pas l’accorder à
la religion de la majorité des Français;—si l’on fait une procession à
l’époque de la Fête-Dieu,—il dénonce Dieu à la police—et signale ses
tendances contre-révolutionnaires.
Mais—à l’époque où le duc d’Orléans épousa une princesse luthérienne,—tous les journaux de cette couleur jetèrent feu et flammes,—ils invoquèrent la religion du pays,—et peu s’en faillut que MM. Jay et Jouy ne prissent les croix des croisés.
![]() CIGUE.—Autrefois, quand un homme s’élevait au-dessus de la
foule—et excitait l’envie et la haine de ses concitoyens, il arrivait
quelquefois qu’on l’exilait ou qu’on lui faisait boire la ciguë;—ce
sort, dont il n’y a que des exemples peu nombreux,—est aujourd’hui
non-seulement fréquent, mais inévitable.
CIGUE.—Autrefois, quand un homme s’élevait au-dessus de la
foule—et excitait l’envie et la haine de ses concitoyens, il arrivait
quelquefois qu’on l’exilait ou qu’on lui faisait boire la ciguë;—ce
sort, dont il n’y a que des exemples peu nombreux,—est aujourd’hui
non-seulement fréquent, mais inévitable.
Aussitôt qu’un homme se manifeste au public par quelque talent,—tout le monde se rue sur lui en fureur,—on le tire par les pieds et par les vêtements pour le remettre au niveau de la foule,—si toutefois on ne peut le renverser sous les pieds et l’écraser;—puis chaque jour, au moyen des journaux,—on lui fait boire quelques gorgées d’injures et de calomnies;—le public qui, sans s’en rendre bien compte,—n’est pas fâché de voir le grand homme amené aux proportions humaines,—croit alors tout ce qu’on lui raconte, sans examen et sans restriction.
![]() CONFISCATION.—Il n’y a plus de confiscation;—seulement on peut
condamner n’importe qui à des amendes et à des frais dépassant dix fois
la valeur de ce qu’il possède,—et que la justice fait vendre. C’est
absolument—comme l’abolition de la conscription, si heureusement
remplacée par le recrutement;—c’est absolument comme ce mot qu’on a
prêté à un roi: Plus de hallebardes.—En effet, le roi est escorté par
des hommes armés de sabres et de carabines,—ce qui, du reste, est à
peine suffisant.
CONFISCATION.—Il n’y a plus de confiscation;—seulement on peut
condamner n’importe qui à des amendes et à des frais dépassant dix fois
la valeur de ce qu’il possède,—et que la justice fait vendre. C’est
absolument—comme l’abolition de la conscription, si heureusement
remplacée par le recrutement;—c’est absolument comme ce mot qu’on a
prêté à un roi: Plus de hallebardes.—En effet, le roi est escorté par
des hommes armés de sabres et de carabines,—ce qui, du reste, est à
peine suffisant.
A. M. Arago (François).—Le dieu Cheneau.—M. de Balza.—Quirinus. Un mot.—Une ordonnance du ministre de la guerre.—A M. le rédacteur en chef du journal l’Univers religieux.
![]() A. M. ARAGO (François).—Je me proposais, monsieur, de vous
taquiner un peu sur cette comète—que vous n’avez pas vue,—et qui me
donnait beau jeu—pour dire une fois de plus à quoi s’exposent les
astronomes qui s’occupent trop des choses de la terre. La Fontaine a
gourmandé l’astrologue qui ne regarde pas assez à ses pieds;—je vous ai
souvent reproché de regarder trop aux vôtres,—et d’être plus sensible à
la fumée et au bruit de ce monde où nous sommes qu’il ne paraît convenir
à un homme auquel la science permet de vivre au ciel.
A. M. ARAGO (François).—Je me proposais, monsieur, de vous
taquiner un peu sur cette comète—que vous n’avez pas vue,—et qui me
donnait beau jeu—pour dire une fois de plus à quoi s’exposent les
astronomes qui s’occupent trop des choses de la terre. La Fontaine a
gourmandé l’astrologue qui ne regarde pas assez à ses pieds;—je vous ai
souvent reproché de regarder trop aux vôtres,—et d’être plus sensible à
la fumée et au bruit de ce monde où nous sommes qu’il ne paraît convenir
à un homme auquel la science permet de vivre au ciel.
Mais vous avez soutenu à la Chambre des députés, sur une chose terrestre,—une thèse que je dirais parfaitement juste et raisonnable,—avec des mots plus ambitieux que ceux que j’emploie,—si les Guêpes n’avaient à diverses reprises soutenu la même thèse depuis quatre ans,—à savoir le ridicule profond qu’il y a à faire passer dix ans aux jeunes gens à apprendre les deux seules langues qui ne se parlent pas; j’ai de plus prouvé que ces langues seraient inutiles au plus grand nombre si on les savait,—mais qu’on ne les sait pas après les avoir apprises pendant dix ans;—à savoir—la sottise qu’il y a à donner à tout un pays une éducation littéraire et républicaine.
![]() Éducation dont la première moitié conduit à l’hôpital,—et la
seconde au mont Saint-Michel,—quelquefois aux galères,—quelquefois à
l’échafaud.
Éducation dont la première moitié conduit à l’hôpital,—et la
seconde au mont Saint-Michel,—quelquefois aux galères,—quelquefois à
l’échafaud.
![]() Éducation qui, si elle réussissait, ferait de la France un pays de
poëtes,—et qui, ne réussissant pas, en fait un pays d’avocats—et
d’ambitieux mécontents,—un pays de gens dont personne ne se trouve bien
à sa place,—de gens qui tous ont des désirs et des besoins impossibles
à satisfaire.
Éducation qui, si elle réussissait, ferait de la France un pays de
poëtes,—et qui, ne réussissant pas, en fait un pays d’avocats—et
d’ambitieux mécontents,—un pays de gens dont personne ne se trouve bien
à sa place,—de gens qui tous ont des désirs et des besoins impossibles
à satisfaire.
![]() Vous avez eu raison et mille fois raison,—monsieur,—et vous avez
eu raison avec esprit.—Il y a bien des gens auprès desquels cela a dû
faire tort à vous et à votre opinion.
Vous avez eu raison et mille fois raison,—monsieur,—et vous avez
eu raison avec esprit.—Il y a bien des gens auprès desquels cela a dû
faire tort à vous et à votre opinion.
L’homme en général n’aime et ne respecte que ce qui fait un peu de mal.—Il y a longtemps déjà que j’ai retourné le vieux et faux proverbe: «Qui aime bien châtie bien» en celui-ci: «Aime bien qui est bien châtié.»
Il n’y a de grandes passions que les passions malheureuses.—L’homme n’aime pas d’ordinaire la femme dont il est aimé.—Ses vœux, ses désirs, ses soumissions, sont presque toujours pour celle qui le maltraite, l’humilie,—le sacrifie et l’insulte.—Les anciens adoraient les furies,—la guerre,—la peste,—la fièvre,—la mort, et autres divinités peu aimables.—Les modernes rendent un culte semblable à l’ennui,—qui est pis que toutes les autres ensemble.
Ce dieu infernal—a sur la terre des temples qui sont toujours pleins,—et des ministres qui sont entre tous vénérés, écoutés, engraissés et enrichis.—Presque toutes les places, les dignités, les honneurs, reviennent de droit aux gens qui ennuient leurs contemporains, aux gens qui débitent de longs discours, qui écrivent de gros livres—également ennuyeux,—qu’on aime mieux admirer que de les écouter ou de les lire.—Ceux-là seuls paraissent avoir raison,—et sont écoutés;—on a respecté en eux—le dieu—le dieu terrible—dont ils prononcent les oracles et dont ils célèbrent les sacrés mystères.
Mais si on s’avise de mêler quelque enjouement à la raison;—si l’on combat le faux, l’absurde et le mauvais avec les armes légères et terribles de l’ironie et du sarcasme,—les gens sourient,—vous trouvent très-drôle,—vous lisent ou vous écoutent volontiers,—mais prennent tout ce que vous dites ou tout ce que vous écrivez pour des calembours et des coq-à-l’âne.
Ils vous mettent au nombre des bouffons et des jocrisses,—de Brunet, ou d’Arnal, ou d’Alcide Touzet.
Ces braves gens—ne se représentent le bon sens et la raison—qu’avec l’air refrogné—et de mauvaise humeur; si vous souriez, tout est perdu.
![]() Vous avez eu raison,—monsieur,—et vous avez eu l’imprudence
d’avoir raison avec esprit,—et d’employer l’ironie—contre une chose
plus ridicule qu’aucune qui ait jamais succombé sous les coups du bon
sens. Quelle est donc, en effet, cette langue, ce latin,—qui jouit de
tant de priviléges?—il n’est pas de sottises et de saletés qui ne
soient admises, religieusement apprises et admirées,—si elles sont
écrites en latin:—en latin on livre aux jeunes gens la fameuse églogue
de Virgile:—Formosum pastor Corydon.
Vous avez eu raison,—monsieur,—et vous avez eu l’imprudence
d’avoir raison avec esprit,—et d’employer l’ironie—contre une chose
plus ridicule qu’aucune qui ait jamais succombé sous les coups du bon
sens. Quelle est donc, en effet, cette langue, ce latin,—qui jouit de
tant de priviléges?—il n’est pas de sottises et de saletés qui ne
soient admises, religieusement apprises et admirées,—si elles sont
écrites en latin:—en latin on livre aux jeunes gens la fameuse églogue
de Virgile:—Formosum pastor Corydon.
![]() En latin,—on apprend que les abeilles naissent de la corruption
d’un animal mort.
En latin,—on apprend que les abeilles naissent de la corruption
d’un animal mort.
![]() En latin,—on apprend par cœur toutes les faussetés sur la
physique, sur la chimie.
En latin,—on apprend par cœur toutes les faussetés sur la
physique, sur la chimie.
L’églogue Formosum est une chose infâme,—ainsi que celle du bel Yolas; le livre d’Aristée et des abeilles—est une sottise insigne.
Mais c’est écrit en latin,—c’est écrit en beaux vers!
Étonnez-vous donc ensuite si vous faites une nation de bavards et d’avocats;—plus tard—on apprend si on peut,—et combien en ont le temps—puisque le latin prend toute la première jeunesse—et vous conduit aux portes de la vie civile et sérieuse?—on apprend—quelques-uns, du moins, un sur trois cents,—que les abeilles ne viennent pas de bœuf pourri.
Absolument comme les gens qui font apprendre deux langues aux enfants:—l’une, composée de mots ainsi faits: Maman,—nanan,—dada,—papa,—dodo,—lolo, etc.;—l’autre, qui dit les mots: Mère,—friandise,—cheval,—père,—lit,—lait, etc.
Certes,—et je puis parler ici sans qu’on m’accuse de ressembler au renard qui avait perdu sa queue dans un piége,—j’ai été ce qu’on appelle un élève distingué dans l’Université,—j’ai ensuite professé le latin et le grec,—j’ai rendu, sous ce prétexte,—à de pauvres enfants que je retrouve hommes aujourd’hui éparpillés dans les diverses conditions de la vie,—je leur ai rendu une partie de l’ennui que m’avaient donné mes professeurs;—je serais fâché de ne pas savoir ces langues,—qui, de temps en temps, me permettent de lire de belles pensées écrites en beau style.
Mais si c’est une des choses les plus agréables qu’on puisse savoir,—c’est une des moins utiles—dans les besoins et les nécessités de la vie.
Sur soixante élèves qui composent d’ordinaire une classe de collége, c’est un grand malheur s’il doit y avoir un poëte.—Eh bien! toute l’éducation pendant dix ans n’est faite que pour ce poëte.
Les autres—qui seront—notaires,—ou ferblantiers,—médecins—ou droguistes,—suivent les mêmes cours,—et passent, entre autres choses, trois ans à apprendre à faire des vers latins, et quels vers, bon Dieu!
J’aimerais autant les voir jouer à la balle pendant dix ans,—au moins cela ne leur donnerait pas d’idées fausses—et serait tout aussi utile aux diverses professions qu’ils doivent embrasser.
Quoi!—on passe dix ans à apprendre,—que dis-je? à ne pas apprendre le latin.
En effet,—demandez à vous-même, demandez à ceux que vous connaissez: «Êtes-vous capable de lire Martial en latin?—êtes-vous capable d’écrire une lettre en latin?» Trouvez-moi dix hommes de quarante ans—qui fassent sans faute un thème—qu’on donnerait à des élèves de cinquième,—et qui obtiendraient la première place dans une composition avec des enfants de dix à douze ans!
On passe dix ans—à ne pas apprendre le latin.
Et on ne connaît pas—les lois de son pays;—on entre dans la vie sans savoir ni ses droits, ni ses devoirs en rien.
Mais on sait,—non, je veux dire, on a appris le latin.
Et c’est avec ce bagage—qu’on vous lâche les jeunes gens à même la vie.
Ne perdez pas courage,—monsieur,—ceci est plus grand que de renverser un ministre;—ceci doit renverser une sottise funeste.
Pour moi,—monsieur,—je ne vous dirai rien de la fameuse comète,—vous ne l’avez pas vue,—mais vous avez découvert une grosse bêtise sur la terre.
La comète continue sa route absolument comme si vous l’aviez vue.—J’ai peur que la grosse bêtise ne poursuive la sienne absolument comme si vous ne l’aviez pas vue.
Néanmoins, monsieur, vos paroles ne seront pas perdues,—de même que je n’ai pas regretté celles que j’ai laissé échapper sur ce sujet—depuis quelques années.
Il est bon de dire de temps en temps aux pédants qu’ils sont des pédants,—aux sots qu’ils sont des sots, quand ce ne serait que pour que la sottise n’invoque pas un jour le bénéfice de la prescription contre la logique et le bon sens.
![]() «Monsieur Alphonce Karr, je me vois forcé de faire ressortir
la différance de vos habitudes. Je remarque à l’instant que votre
critique de jenvier dernier contre moi dégénère en compliments,
je vous avoue que j’attache peu de prix aux éloges que vous faites
de mes boutons; j’aime mieux votre critique: jusqu’à ce que vous
fassiez usage de votre conception (1)!
«Monsieur Alphonce Karr, je me vois forcé de faire ressortir
la différance de vos habitudes. Je remarque à l’instant que votre
critique de jenvier dernier contre moi dégénère en compliments,
je vous avoue que j’attache peu de prix aux éloges que vous faites
de mes boutons; j’aime mieux votre critique: jusqu’à ce que vous
fassiez usage de votre conception (1)!
»Puis-je être estimé des écrivains de notre époque? moi je ne les flattes pas: mais je leur dit de cruelles vérités! je ne leur ressemble ni en style (2) ni en principe; ils sarrêtent à la forme, et moi au fond (3). Je n’écrit pas pour flatter, pour plaire, ni pour faire un trafic (4): ma plume ne s’exerce pas à tracés (5) des choses légères ou futiles: excepté quand je m’y trouve forcé, par exemple, pour me faire comprendre des Guêpes, je ne pui (6) m’en dispenser.
»Monsieur Alphonce Karr, vous êtes venu chez moi, vous m’avez parlé sans vous faire connaître: rougissez-vous de prononcer votre nom? Pourquoi gardez-vous l’incognito? C’est s’introduire dans les maisons comme le font les Guêpes, etc. Quel mérite, monsieur A. Karr, vous êtes-vous reconnus en avouant vos démarches honteuses (7)?
»Vos émules je le sai ne se promènent pas toujour couvertes de chapeaux à trois cornes (8); d’après vous, si le dieu Cheneau ou Chaînon avait des cheveux, il serait blond (9).
»Les Guêpes avaient sans doute formé le projet, de me saisir ou de mattaquer par ma partie supérieur, car vous annoncez monsieur A. Karr que je nai pas de cheveux. C’est encore une nouvelle métode pour adesser des compliments. On voit par les paroles ci-dessus que M. A. Karr se résigne à son sort, et son introduction incognito chez moi la conduit à prévoir et à déclarer qu’il n’avait pas prise sur ma partie supérieur, en disant que je n’ai pas de cheveux.
»Je ne désespère pas de vous monsieur Car dans cette pensée il y a du sel.
»Mais puisque vous vous introduisez en secret, je suis étonné que vous nayez pas parlé au public (10) de...
»Si je parle ainsi c’est que je crois utile de me mettre à la porté des Guêpes.
»Au revoir monsieur Alphonse Karr.
»CHENEAU, 15, rue Croix-des-Petits-Champs.»
4 mars 1843.
![]() (1) Vous avez tort, dieu Cheneau;—vous n’avez fait, que je sache,
ni le soleil, ni la lune,—ni le ciel, ni la terre:—vous faites des
boutons, je ne puis parler que de vos boutons.
(1) Vous avez tort, dieu Cheneau;—vous n’avez fait, que je sache,
ni le soleil, ni la lune,—ni le ciel, ni la terre:—vous faites des
boutons, je ne puis parler que de vos boutons.
![]() (2) En effet, dieu Cheneau, j’avais remarqué déjà que vous
n’écriviez ni comme Hugo, ni comme Lamartine.—Hugo ne met pas d’s à
je flatte, et Lamartine ne met pas de t à je dis.
(2) En effet, dieu Cheneau, j’avais remarqué déjà que vous
n’écriviez ni comme Hugo, ni comme Lamartine.—Hugo ne met pas d’s à
je flatte, et Lamartine ne met pas de t à je dis.
![]() (3) Que ne vous arrêtez-vous à votre fonds de boutonnier?
(3) Que ne vous arrêtez-vous à votre fonds de boutonnier?
![]() (4) Il est vrai que votre libraire M.*** met vos livres dans un
grenier,—et a répondu à quelqu’un, qui est allé les demander de ma
part,—qu’il n’avait pas le temps de monter là-haut et de chercher
ça.—En effet, ça n’a pas trop l’air d’un trafic;—pour le second
point,—vos livres plaisent plus aux lecteurs des Guêpes que vous ne
l’imaginez.
(4) Il est vrai que votre libraire M.*** met vos livres dans un
grenier,—et a répondu à quelqu’un, qui est allé les demander de ma
part,—qu’il n’avait pas le temps de monter là-haut et de chercher
ça.—En effet, ça n’a pas trop l’air d’un trafic;—pour le second
point,—vos livres plaisent plus aux lecteurs des Guêpes que vous ne
l’imaginez.
![]() (5) Madame de Girardin écrit l’infinitif tracer avec un r.
(5) Madame de Girardin écrit l’infinitif tracer avec un r.
![]() (6) J’ai ici une lettre de M. Eugène Sue, un autre écrivain de
notre époque;—il écrit:—je ne peux.—Décidément vous avez raison,
vous n’écrivez pas comme eux.
(6) J’ai ici une lettre de M. Eugène Sue, un autre écrivain de
notre époque;—il écrit:—je ne peux.—Décidément vous avez raison,
vous n’écrivez pas comme eux.
![]() (7) Démarche honteuse! J’allais acheter des boutons—et un peu dans
son temple adorer l’Éternel,—mais accessoirement, et pouvais-je croire
votre puissance aussi bornée, dieu Cheneau, que de supposer que j’avais
besoin de vous dire mon nom? D’ailleurs—je venais d’être foudroyé par
la poste,—et je n’étais pas trop rassuré en votre présence. Je vous ai
parlé,—mais pour vous dire timidement: «Deux douzaines de boutons,
combien?» Et, dieu Cheneau,—à l’exemple des rois mages,—je vous ai
offert L’OR;—pardonnez-moi de n’avoir pas joint l’encens et la
myrrhe.—Vous m’avez rendu ma monnaie,—tout est dans l’ordre. Je ne me
suis reconnu là aucun mérite,—seulement quelques personnes me
paraissent avoir la bonté de m’en reconnaître un peu plus depuis que
j’ai remplacé les vieux boutons de mon paletot par les deux douzaines
que j’ai achetées chez vous.
(7) Démarche honteuse! J’allais acheter des boutons—et un peu dans
son temple adorer l’Éternel,—mais accessoirement, et pouvais-je croire
votre puissance aussi bornée, dieu Cheneau, que de supposer que j’avais
besoin de vous dire mon nom? D’ailleurs—je venais d’être foudroyé par
la poste,—et je n’étais pas trop rassuré en votre présence. Je vous ai
parlé,—mais pour vous dire timidement: «Deux douzaines de boutons,
combien?» Et, dieu Cheneau,—à l’exemple des rois mages,—je vous ai
offert L’OR;—pardonnez-moi de n’avoir pas joint l’encens et la
myrrhe.—Vous m’avez rendu ma monnaie,—tout est dans l’ordre. Je ne me
suis reconnu là aucun mérite,—seulement quelques personnes me
paraissent avoir la bonté de m’en reconnaître un peu plus depuis que
j’ai remplacé les vieux boutons de mon paletot par les deux douzaines
que j’ai achetées chez vous.
![]() (8) Je crois, Dieu me pardonne (pas le dieu Cheneau,—l’autre), je
crois que le dieu Cheneau m’appelle mouchard.
(8) Je crois, Dieu me pardonne (pas le dieu Cheneau,—l’autre), je
crois que le dieu Cheneau m’appelle mouchard.
![]() (9) Ah! voilà où le dieu est blessé.—Achille était invulnérable
partout, excepté au talon.—Mais il avait un talon:—le dieu Cheneau est
vulnérable aux cheveux qu’il n’a pas.
(9) Ah! voilà où le dieu est blessé.—Achille était invulnérable
partout, excepté au talon.—Mais il avait un talon:—le dieu Cheneau est
vulnérable aux cheveux qu’il n’a pas.
Samson avait sa force dans ses cheveux;—c’est au contraire dans les cheveux—qu’il n’a pas—que le dieu Cheneau a toute sa faiblesse.
![]() (10) Ici je suis obligé d’effacer deux lignes pleines de gros
mots;—le dieu se laisse aller à une colère d’un genre tout particulier,
et dont je ne trouve d’analogie dans aucuns souvenirs.
(10) Ici je suis obligé d’effacer deux lignes pleines de gros
mots;—le dieu se laisse aller à une colère d’un genre tout particulier,
et dont je ne trouve d’analogie dans aucuns souvenirs.
Prométhée fut attaché à un rocher, et condamné à être le souper immortel d’un vautour.—Les paysans qui se moquèrent de Latone furent changés en grenouilles.—Apollon écorcha Marsyas.—Jupiter se servait de la foudre, Hercule d’une massue, Diane de ses flèches; Saturne avait une faux, Neptune un trident.
La foudre, l’arme vengeresse du dieu Cheneau,—n’a aucun rapport avec toutes celles-là. Je suis plus qu’embarrassé pour la désigner,—de même que la vengeance qu’il tire de moi. Je ne puis vous le dire, et il faut pourtant que je vous le fasse comprendre. Je voudrais trouver quelque analogie.
Phaëton fut précipité dans le Pô.
La vengeance rêvée par le dieu Cheneau contre moi est toute contraire: sa foudre est de celles qu’on est exposé à recevoir sur la tête le soir quand on rentre tard et qu’on passe trop près des maisons;—mais comme le dieu Cheneau fait de temps en temps imprimer en brochures les lettres qu’il m’écrit,—on pourra voir quelque jour—ce qu’il m’est impossible d’écrire et de faire imprimer,—à savoir les menaces du dieu:
AVRIL 1843.—Il faut que je fasse amende honorable à M. de Balzac[O].
J’avais fait prier Janin de m’envoyer—un écrit récent de M. de Balzac.—Janin,—par oubli—ou pour ménager ma sensibilité,—m’avait envoyé la chose moins quatre feuillets:—ces quatre feuillets qu’on m’envoie parlent de moi;—les paragraphes y sont séparés par huit portraits,—c’est-à-dire quelque chose comme ma tête avec un corps de guêpe.—Cette plaisanterie a été imaginée il y a un an par un dessinateur appelé M. Benjamin.
Ce qui est entre les portraits est copié sur une plaisanterie faite sur les Guêpes par le Charivari, il y a deux ans.
Décidément,—mon pauvre monsieur de Balzac, votre muse est réellement fille de mémoire,—vous n’inventez que ce que vous vous rappelez.
La plaisanterie du Charivari était bonne; j’avais raconté un voyage bien innocent que j’avais fait avec Gatayes, et où il n’était question que de la mer,—de l’herbe,—du soleil,—et des premières fleurs des cerisiers.—La parodie de ce voyage fut rapprochée de mon épigraphe,—que je crois avoir plus d’une fois justifiée depuis quatre ans.
«Ces petits livres contiendront l’expression franche et inexorable de ma pensée sur les hommes et sur les choses, en dehors de toute idée d’ambition, de toute influence de parti.
»Il n’y a pas un seul journal qui oserait faire imprimer mes petits livres.»
La plaisanterie,—dis-je,—était bonne comme plaisanterie,—et j’en ai ri en son temps.
Mais, répétée par M. de Balzac, et répétée sérieusement, elle exige une réponse.
Voici ce que dit M. de Balzac:
«Aussitôt dix ou douze soldats ont levé la bannière de l’in-32, en imitant l’inventeur,—dont l’invention consistait à tâcher d’avoir de l’esprit tous les mois.—Ce fut une épidémie,» etc.
Voilà ce que dit M. de Balzac.
![]() Or, ce n’est pas douze, mais vingt-huit in-32 qui ont surgi après
les Guêpes.—Le second était fait par M. de Balzac,—lequel n’a pu en
faire que trois.
Or, ce n’est pas douze, mais vingt-huit in-32 qui ont surgi après
les Guêpes.—Le second était fait par M. de Balzac,—lequel n’a pu en
faire que trois.
Il manquait à M. de Balzac plusieurs choses pour réussir.
![]() Les Guêpes ont été une publication honorable;—elles n’ont jamais
rien attaqué—ni rien loué pour aucun intérêt.
Les Guêpes ont été une publication honorable;—elles n’ont jamais
rien attaqué—ni rien loué pour aucun intérêt.
Elles ont dit à tous ce qu’elles ont cru la vérité sur tout et sur tous.
Rien ne les a fait reculer quand elles ont cru soutenir ce qui était juste et vrai.
Elles n’ont jamais hésité à rectifier les quelques erreurs dans lesquelles elles sont tombées.
Le National et le Journal du Peuple, journaux démocratiques,*—ont avoué qu’elles avaient été plus loin qu’eux dans l’appréciation sévère de certains faits politiques.
Tous les partis les ont citées ou attaquées tour à tour,—parce qu’elles n’appartenaient qu’à un seul parti,—à celui du grand, du juste et du vrai,—et qu’elles rendaient justice à tout le monde.
![]() Elles n’ont à se reprocher que d’avoir été un peu trop indulgentes
pour certaines extravagances de M. de Balzac,—dont elles aiment le
talent; ce qui fut cause qu’à une époque où le directeur de la Revue de
Paris plaidant contre M. de Balzac—pour un prétendu abus que celui-ci
faisait d’un ouvrage vendu à la Revue,—pria la plupart des écrivains
contemporains de signer un blâme formel contre M. de Balzac,—l’auteur
des Guêpes fut, je crois, le seul qui refusa sa signature.
Elles n’ont à se reprocher que d’avoir été un peu trop indulgentes
pour certaines extravagances de M. de Balzac,—dont elles aiment le
talent; ce qui fut cause qu’à une époque où le directeur de la Revue de
Paris plaidant contre M. de Balzac—pour un prétendu abus que celui-ci
faisait d’un ouvrage vendu à la Revue,—pria la plupart des écrivains
contemporains de signer un blâme formel contre M. de Balzac,—l’auteur
des Guêpes fut, je crois, le seul qui refusa sa signature.
Or,—quand M. de Balzac fit sous le nom de Petite Revue parisienne—une imitation des Guêpes,—c’était tout simplement, comme il ne s’en cachait pas, dans l’intention bénigne d’écraser ma publication sous la sienne.
Mais, comme je l’ai dit,—il manquait à M. de Balzac plusieurs choses pour réussir. La fin prématurée de la Petite Revue parisienne—peut en faire soupçonner quelques-unes. Voici quelle fut cette fin.
M. Roger de Beauvoir, attaqué gratuitement et violemment dans le deuxième numéro de la Petite Revue, envoya deux amis à M. de Balzac. Deux amis de M. de Balzac convinrent avec ceux de M. de Beauvoir—que M. de Balzac mettrait une rectification dans son prochain numéro, qui était le troisième.—Ce numéro parut sans la rectification imposée et promise.—Les amis de M. de Beauvoir revinrent à la charge;—ceux de M. de Balzac refusèrent de l’assister après son manque de parole.
Deux autres témoins s’engagèrent à une nouvelle rectification: la Petite Revue cessa de paraître.
![]() M. de Balzac a donc tort de parler avec tant de dédain d’une
publication—que, quelle qu’elle soit, il a essayé d’imiter.
M. de Balzac a donc tort de parler avec tant de dédain d’une
publication—que, quelle qu’elle soit, il a essayé d’imiter.
![]() Malgré les sages avertissements que les Guêpes avaient donnés à
la reine Pomaré,—en lui décrivant exactement les bienfaits du
gouvernement constitutionnel,—cette souveraine sauvage—a décidément
donné elle et son royaume à la France;—les grands journaux l’annoncent
un an après les Guêpes.
Malgré les sages avertissements que les Guêpes avaient donnés à
la reine Pomaré,—en lui décrivant exactement les bienfaits du
gouvernement constitutionnel,—cette souveraine sauvage—a décidément
donné elle et son royaume à la France;—les grands journaux l’annoncent
un an après les Guêpes.
![]() Quirinus by Felix out of dam.—Of Hercule. Ce doit être un
cheval, mais je ne suis pas sportman. Eh bien! Quirinus est un cheval
d’assez noble origine, mais mal élevé, c’est-à-dire qu’il est arrivé à
cinq ans sans avoir été dressé, exercé, ni éprouvé, et de plus qu’il a
été soumis toute sa vie à un système aussi débilitant qu’économique;
foin, un peu; eau et air, à discrétion; avoine, il a pu en entendre
parler. Cet animal, de formes fantastiques, d’un caractère atroce de
sauvagerie, en un mot de l’extérieur le plus repoussant, fut exhibé il y
a quelques mois à une vente publique, pour la plus grande délectation de
la gent maquigonne et de la jeunesse dorée. Un jeune étranger faillit
être expulsé du Jockey-Club, pour en avoir voulu donner mille francs.
Heureux d’en être quitte pour mille brocards.
Quirinus by Felix out of dam.—Of Hercule. Ce doit être un
cheval, mais je ne suis pas sportman. Eh bien! Quirinus est un cheval
d’assez noble origine, mais mal élevé, c’est-à-dire qu’il est arrivé à
cinq ans sans avoir été dressé, exercé, ni éprouvé, et de plus qu’il a
été soumis toute sa vie à un système aussi débilitant qu’économique;
foin, un peu; eau et air, à discrétion; avoine, il a pu en entendre
parler. Cet animal, de formes fantastiques, d’un caractère atroce de
sauvagerie, en un mot de l’extérieur le plus repoussant, fut exhibé il y
a quelques mois à une vente publique, pour la plus grande délectation de
la gent maquigonne et de la jeunesse dorée. Un jeune étranger faillit
être expulsé du Jockey-Club, pour en avoir voulu donner mille francs.
Heureux d’en être quitte pour mille brocards.
![]() Eh bien! ce Quirinus, qui, malgré tout cela, est de pur sang,
vient d’être acheté comme étalon par l’administration des haras.
Combien?—Nous l’ignorons.—Si c’est plus de mille francs, pourquoi ne
pas l’avoir poussé à la vente coram populo? Si moins, doit-on donner
aux éleveurs de pareils étalons, et notez qu’un très-beau et très-bon
cheval, mieux né et mieux élevé, Pourceaugnac, a été refusé en vertu
d’un règlement qui ordonne que tout cheval de pur sang doit, avant de se
reproduire, faire ses preuves parce que noblesse oblige. Pourquoi donc
refuser Pourceaugnac, bon en apparence, et prendre Quirinus, mauvais
en apparence; tous deux sans preuves? Ah! voilà.
Eh bien! ce Quirinus, qui, malgré tout cela, est de pur sang,
vient d’être acheté comme étalon par l’administration des haras.
Combien?—Nous l’ignorons.—Si c’est plus de mille francs, pourquoi ne
pas l’avoir poussé à la vente coram populo? Si moins, doit-on donner
aux éleveurs de pareils étalons, et notez qu’un très-beau et très-bon
cheval, mieux né et mieux élevé, Pourceaugnac, a été refusé en vertu
d’un règlement qui ordonne que tout cheval de pur sang doit, avant de se
reproduire, faire ses preuves parce que noblesse oblige. Pourquoi donc
refuser Pourceaugnac, bon en apparence, et prendre Quirinus, mauvais
en apparence; tous deux sans preuves? Ah! voilà.
Quirinus sort du haras de Viroflay, acquisition récente de M. Talabot, gendre du ministre du commerce.
![]() On se rappelle quelle indignation on excita, dans le temps, contre
la malheureuse reine Marie-Antoinette—en faisant courir le bruit—que,
entendant dire que le peuple était malheureux et qu’il n’avait pas de
pain,—elle avait répondu: «Eh bien! qu’il mange de la brioche.» Le
hasard m’a fait un de ces jours derniers rencontrer un livre daté de
1760—où on raconte le même mot d’une duchesse de Toscane,—ce qui me
paraît prouver à peu près que le mot n’a pas été dit par
Marie-Antoinette, mais retrouvé et mis en circulation contre elle.
On se rappelle quelle indignation on excita, dans le temps, contre
la malheureuse reine Marie-Antoinette—en faisant courir le bruit—que,
entendant dire que le peuple était malheureux et qu’il n’avait pas de
pain,—elle avait répondu: «Eh bien! qu’il mange de la brioche.» Le
hasard m’a fait un de ces jours derniers rencontrer un livre daté de
1760—où on raconte le même mot d’une duchesse de Toscane,—ce qui me
paraît prouver à peu près que le mot n’a pas été dit par
Marie-Antoinette, mais retrouvé et mis en circulation contre elle.
![]() Il est impossible d’avoir une idée plus malheureuse et plus
inopportune que celle qu’a eue récemment le maréchal Soult en faisant
couper les moustaches de l’armée,—on sait la peine qu’eut
Napoléon,—qui était Napoléon,—à faire couper les tresses de ses
soldats:—la moustache est une coquetterie qui sied bien au soldat.—Je
suis fort partisan d’une discipline sévère, mais je trouve ridicule et
odieux de faire aussi inutilement sentir le joug aux militaires par des
ennuis et des tracasseries qui n’ont aucun but utile, même en apparence.
Quelques personnes croient que M. Soult a été poussé à cette exécution
par une raison, et cette raison la voici: on avait remarqué souvent que
chaque ministère de M. Soult était signalé par des révolutions dans les
armes et dans les costumes de l’armée.—Chaque changement donne lieu à
des fournitures, chaque fourniture à des marchés,—chaque marché à des
tripotages; on en médisait.—M. le maréchal aura voulu faire passer
quelque changement de ce genre à la faveur d’un changement sur lequel il
n’y a rien à gagner pour personne.
Il est impossible d’avoir une idée plus malheureuse et plus
inopportune que celle qu’a eue récemment le maréchal Soult en faisant
couper les moustaches de l’armée,—on sait la peine qu’eut
Napoléon,—qui était Napoléon,—à faire couper les tresses de ses
soldats:—la moustache est une coquetterie qui sied bien au soldat.—Je
suis fort partisan d’une discipline sévère, mais je trouve ridicule et
odieux de faire aussi inutilement sentir le joug aux militaires par des
ennuis et des tracasseries qui n’ont aucun but utile, même en apparence.
Quelques personnes croient que M. Soult a été poussé à cette exécution
par une raison, et cette raison la voici: on avait remarqué souvent que
chaque ministère de M. Soult était signalé par des révolutions dans les
armes et dans les costumes de l’armée.—Chaque changement donne lieu à
des fournitures, chaque fourniture à des marchés,—chaque marché à des
tripotages; on en médisait.—M. le maréchal aura voulu faire passer
quelque changement de ce genre à la faveur d’un changement sur lequel il
n’y a rien à gagner pour personne.
![]() Une lettre signée: un membre du clergé de
Saint-Denis-du-Saint-Sacrement—a été accueillie par plusieurs journaux.
Cette lettre, qui a la prétention d’être une réponse à celle que j’ai
adressée dans le dernier numéro des Guêpes—à l’archevêque de Paris,
est pleine d’invectives grossières contre moi.—Les jupes, quel que soit
le sexe qui les porte,—sont censées désigner la faiblesse,—laquelle
abuse souvent même de l’abri.—Voici donc la seule réponse que j’y
puisse faire, et que j’invite à publier les journaux qui ont inséré
cette lettre.
Une lettre signée: un membre du clergé de
Saint-Denis-du-Saint-Sacrement—a été accueillie par plusieurs journaux.
Cette lettre, qui a la prétention d’être une réponse à celle que j’ai
adressée dans le dernier numéro des Guêpes—à l’archevêque de Paris,
est pleine d’invectives grossières contre moi.—Les jupes, quel que soit
le sexe qui les porte,—sont censées désigner la faiblesse,—laquelle
abuse souvent même de l’abri.—Voici donc la seule réponse que j’y
puisse faire, et que j’invite à publier les journaux qui ont inséré
cette lettre.
«Monsieur, vous avez admis dans votre journal—une lettre signée: un membre du clergé de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement.—Je compte sur la sagacité de vos lecteurs—pour leur faire comprendre combien les invectives que m’adresse l’auteur de cette lettre—répondent peu victorieusement à la juste plainte que j’ai élevée; cependant il est trois points sur lesquels j’ai quelques mots à dire;—je vous prie,—et au besoin je vous somme de publier dans un prochain numéro—la réponse que je vous envoie,—et qui est nécessitée par le reproche de calomnie qui m’est adressé.
»1º Votre correspondant ne nie pas que des ouvriers aient bruyamment travaillé pendant une cérémonie funèbre;
»2º Il ne nie pas non plus que,—à la sacristie, pendant que le fils du mort donnait des explications nécessaires,—un sacristain et un autre homme habillé en prêtre—se soient livrés à des excès de gaieté plus qu’indécents.
»3º La grotesque provinciale du membre du clergé de l’église de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement me menace du procureur du roi,—et moi, monsieur, je maintiens la vérité de ce que j’ai avancé.—Je défie votre correspondant, et avec lui les certains paroissiens dont il parle,—de m’attaquer en justice sur la lettre que j’ai adressée à l’archevêque de Paris.—De nombreux témoins sont prêts à proclamer la vérité.
»Je ne ferai aucune remarque sur les phrases dans lesquelles ce pauvre homme se plaint avec tant de cynisme et de colère qu’on ait donné peu d’argent à l’église, et avoue si naïvement—que, de recueillement et de décence, on n’en pouvait pas faire davantage pour le prix.
»Le fils du mort n’avait pas vu dans cette circonstance douloureuse une occasion de faste;—il n’avait fait demander qu’une simple présentation à l’église. Un de ses amis avait pris ce soin et avait payé pour lui ce que l’église avait demandé.—Il ne savait pas,—comme le membre du clergé de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement nous l’apprend aujourd’hui, qu’il fallait payer à part pour que le mort ne fût pas insulté—et que cela était l’objet d’un tarif particulier.
»Agréez, monsieur, etc.»
Exécution de Besson.—Un rouleau d’or sauvé.—Invitation à déjeuner noblement refusée.—La Trappe.—Saint Philippe et saint Jacques.—Une idée érotique du préfet de police.—Discours de l’archevêque de Paris et réponse du roi.—Le peuple et les badauds.—M. Pasquier et M. Séguier.—D’un voleur qui voit la mauvaise société.—Une profession nouvelle.—Un député aimable.—M. Arago a rompu avec les comètes.—L’enquête de la Chambre sur les élections de Langres, d’Embrun et de Carpentras.—Le député de Langres et le député de Saint-Pons.
![]() Je crois avoir démontré d’une manière inattaquable—que, dans le
procès qui a suivi l’assassinat de M. de Marcellange,—si Besson était
l’auteur du meurtre, les dames de Chamblas en étaient les
complices.—Besson a été condamné, comme on sait.—Les dames de Chamblas
continuent, selon la remarquable expression du ministère public,—à être
condamnées à des remords perpétuels,—Besson a été guillotiné
également à perpétuité.
Je crois avoir démontré d’une manière inattaquable—que, dans le
procès qui a suivi l’assassinat de M. de Marcellange,—si Besson était
l’auteur du meurtre, les dames de Chamblas en étaient les
complices.—Besson a été condamné, comme on sait.—Les dames de Chamblas
continuent, selon la remarquable expression du ministère public,—à être
condamnées à des remords perpétuels,—Besson a été guillotiné
également à perpétuité.
![]() M. de C*** voyageait, il y a quelques jours, avec sa femme et un
domestique.—Ils sont arrêtés par des voleurs et aussi dépouillés qu’on
le peut être.—On ne leur laisse que leurs chevaux, leur voiture et leur
domestique,—probablement faute d’un moyen sûr de s’en défaire
avantageusement. «Qu’allons-nous faire maintenant? dit M. de C***, il
y a loin d’ici à une ville d’où je puisse écrire à Paris pour me faire
envoyer de l’argent.—Monsieur, dit madame de C***,—j’ai sauvé un
petit rouleau d’or.—Vraiment, ma chère amie? vous avez fort bien
agi;—mais comment avez-vous fait pour le dérober à la curiosité plus
qu’impertinente de ces messieurs? Je vous avouerai que, même comme mari,
j’ai été fort contrarié de la minutie de leurs investigations sur votre
personne.—Oh! j’avais bien caché mon or,—dit madame de C*** en
devenant fort rouge.—Il paraît que vous l’aviez bien caché; mais,
enfin, ce devait être quelque part, et ils m’ont paru chercher
partout.—Oh! partout!...» Et madame de C*** devint encore beaucoup
plus rouge. «Mais, oui, ma chère amie, partout;—c’est du moins ce qu’il
m’a semblé.»
M. de C*** voyageait, il y a quelques jours, avec sa femme et un
domestique.—Ils sont arrêtés par des voleurs et aussi dépouillés qu’on
le peut être.—On ne leur laisse que leurs chevaux, leur voiture et leur
domestique,—probablement faute d’un moyen sûr de s’en défaire
avantageusement. «Qu’allons-nous faire maintenant? dit M. de C***, il
y a loin d’ici à une ville d’où je puisse écrire à Paris pour me faire
envoyer de l’argent.—Monsieur, dit madame de C***,—j’ai sauvé un
petit rouleau d’or.—Vraiment, ma chère amie? vous avez fort bien
agi;—mais comment avez-vous fait pour le dérober à la curiosité plus
qu’impertinente de ces messieurs? Je vous avouerai que, même comme mari,
j’ai été fort contrarié de la minutie de leurs investigations sur votre
personne.—Oh! j’avais bien caché mon or,—dit madame de C*** en
devenant fort rouge.—Il paraît que vous l’aviez bien caché; mais,
enfin, ce devait être quelque part, et ils m’ont paru chercher
partout.—Oh! partout!...» Et madame de C*** devint encore beaucoup
plus rouge. «Mais, oui, ma chère amie, partout;—c’est du moins ce qu’il
m’a semblé.»
M. de C*** insiste encore beaucoup, malgré l’embarras de sa femme;—enfin, après une réponse qui probablement l’éclaire, il lui dit: «Diable! pourquoi ne m’avez-vous pas dit cela, je vous aurais priée de cacher aussi ma tabatière, que je regrette infiniment.»
![]() Nouvelle lettre du dieu Cheneau,—qui me déclare «qu’il est forcé,
dans ses épîtres, de descendre à la hauteur de ma conception;»—que «je
ferais bien d’employer toutes mes facultés, attendu que je n’en ai déjà
pas trop.»
Nouvelle lettre du dieu Cheneau,—qui me déclare «qu’il est forcé,
dans ses épîtres, de descendre à la hauteur de ma conception;»—que «je
ferais bien d’employer toutes mes facultés, attendu que je n’en ai déjà
pas trop.»
Le dieu Cheneau ajoute que «mes inspirations sont froides et stupides;»—si je trouve «quelques partisans, c’est parce que—un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire.»
Après quoi M. Cheneau—me dit «qu’il n’y a pas de fiel dans son cœur, et qu’il ne m’en veut pas le moins du monde.»
En effet, M. Cheneau termine sa lettre de la façon la plus paternelle.
«Je vous autorise à venir avec un de vos amis me demander à déjeuner; je m’arrangerai pour que vous soyez plus satisfait de ma table que de mes réponses.»
Voilà ce que j’appelle se conduire en dieu.
Mille remercîments, dieu Cheneau; mais j’ai peu de confiance dans les festins donnés par le ciel;—ceux qui sont restés dans la mémoire des hommes ne sont pas, vous l’avouerez, encourageants, sans parler des divers festins dont je ne parle pas par respect, tels que la manne du désert,—nourriture purgative.
Cinq pains et deux poissons pour cinq mille hommes;
La célèbre tartine d’Ézéchiel,—les noces de Cana où on fait du vin avec de l’eau;
Les pains apportés par un corbeau à un autre prophète.
Je rappellerai Saturne—mangeant des pierres;—Proserpine condamnée à l’enfer pour un grain de grenade;—Tantale qui ne mange pas du tout—et Prométhée qui est mangé!—Permettez-moi, dieu Cheneau, de ne pas accepter votre nectar et votre ambroisie, et de me contenter de vos réponses.
![]() On lit dans plusieurs journaux l’anecdote que voici:
On lit dans plusieurs journaux l’anecdote que voici:
«Un Anglais de distinction visitait le couvent de la Trappe. L’abbé lui présenta successivement tous les religieux condamnés à un silence perpétuel. Arrivé près de l’un d’eux, il dit: «Vous voyez ici, milord, un malheureux soldat qui, ayant eu grand’peur du canon à la journée de Waterloo, déserta le champ de bataille, et vint ensuite, désespérant de son honneur, se jeter dans notre ordre.» A ces mots, le frère changea de couleur, le combat terrible qu’il éprouvait dans son âme se peignait sur ses traits altérés; mais, fixant tout à coup le crucifix, il joignit les mains, tomba humblement à genoux devant l’abbé, et se retira pâle et silencieux de la salle.
»L’Anglais, ému de cette scène, demanda à l’abbé pourquoi il avait si durement accusé ce malheureux. «Milord, répondit l’abbé, je l’ai fait pour vous prouver l’empire que la religion peut exercer sur l’homme. Ce frère a été un des plus braves officiers de l’armée; il a fait des prodiges de valeur dans cette bataille; vous avez vu le combat qu’a excité en lui ma fausse accusation; mais, en même temps, vous avez été témoin de sa résignation et de son humilité.»
Il n’y a à tout cela qu’un petit inconvénient,—c’est qu’il n’est pas vrai que les trappistes soient condamnés à un silence perpétuel.—Je suis allé à la Trappe,—et j’ai été reçu par un frère qui cause fort bien; je lui ai demandé si, en qualité de frère hospitalier chargé de recevoir les voyageurs, il avait une permission spéciale pour rompre le silence auquel les trappistes sont soumis.—Il sourit et me dit: «Je sais qu’on fait sur nous d’étranges histoires dans le monde;—notre silence consiste à ne pas avoir entre nous de conversations futiles,—à ne pas parler en traversant l’église,—ou le cimetière,—ou d’autres lieux consacrés,—ou pendant certaines prières.—Ne dit-on pas aussi, ajouta-t-il en souriant de nouveau, que nous creusons nous-mêmes notre tombe, et qu’en nous rencontrant nous nous disons l’un à l’autre: «Frère, il faut mourir!»—Vous pouvez voir par vous-même qu’il n’en est rien.»
![]() S. M. le roi Louis-Philippe ayant découvert qu’il y avait encore
une trentaine de Français qui ne portaient pas la croix d’honneur,—a
réparé cette omission involontaire et a daigné l’envoyer à quinze
proviseurs de colléges de province et à quinze substituts et
procureurs—à l’occasion de sa fête.
S. M. le roi Louis-Philippe ayant découvert qu’il y avait encore
une trentaine de Français qui ne portaient pas la croix d’honneur,—a
réparé cette omission involontaire et a daigné l’envoyer à quinze
proviseurs de colléges de province et à quinze substituts et
procureurs—à l’occasion de sa fête.
![]() La Saint-Jacques tombe le même jour que la Saint-Philippe;—les
almanachs, obligés de mettre la Saint-Philippe en lettres
majuscules,—ont supprimé saint Jacques,—mis à la porte ainsi du
calendrier.—La Saint-Jacques est la fête de M. Laffitte.
La Saint-Jacques tombe le même jour que la Saint-Philippe;—les
almanachs, obligés de mettre la Saint-Philippe en lettres
majuscules,—ont supprimé saint Jacques,—mis à la porte ainsi du
calendrier.—La Saint-Jacques est la fête de M. Laffitte.
Le préfet de police—a imaginé un singulier moyen de célébrer la fête du roi;—il a accordé amnistie pleine et entière à cent cinquante filles publiques détenues à Saint-Lazare—pour avoir aimé hors des heures permises par la police.—Ces cent cinquante demoiselles, rendues aux félicités publiques,—ont pris une part active à la fête,—et quelques-unes ont orné le soir le carré Marigny, aux Champs-Élysées, de danses un peu risquées.
![]() Monseigneur Affre—a tenu au roi un discours un peu
entortillé,—dont le vrai sens est qu’il conseille à Sa Majesté de
rétablir les colléges de jésuites;—à quoi Sa Majesté a répondu par un
discours non moins entortillé qu’elle priait monseigneur Affre de se
tenir tranquille et de se mêler de ses affaires.
Monseigneur Affre—a tenu au roi un discours un peu
entortillé,—dont le vrai sens est qu’il conseille à Sa Majesté de
rétablir les colléges de jésuites;—à quoi Sa Majesté a répondu par un
discours non moins entortillé qu’elle priait monseigneur Affre de se
tenir tranquille et de se mêler de ses affaires.
![]() Certains journaux traitent un peu le peuple en comparses
d’opéra-comique.—On lit dans le National:—«Il y avait aux
Champs-Élysées un débordement de badauds.»
Certains journaux traitent un peu le peuple en comparses
d’opéra-comique.—On lit dans le National:—«Il y avait aux
Champs-Élysées un débordement de badauds.»
Je prendrai la liberté de demander au National—si ces badauds—ne sont pas les mêmes figurants qu’il intitule le grand peuple et le pays dans d’autres circonstances.
![]() Dans les discours que MM. Pasquier et Séguier ont adressés au roi à
l’occasion de sa fête,—quelques personnes ont paru regretter que ces
messieurs n’aient pas trouvé moyen de mettre dans ces discours un peu de
la variété qu’ils ont mise dans leurs serments et dans leur dévouement
depuis trente ans.
Dans les discours que MM. Pasquier et Séguier ont adressés au roi à
l’occasion de sa fête,—quelques personnes ont paru regretter que ces
messieurs n’aient pas trouvé moyen de mettre dans ces discours un peu de
la variété qu’ils ont mise dans leurs serments et dans leur dévouement
depuis trente ans.
![]() Un homme accusé de vol est interrogé par le président sur l’emploi
de son temps; il répond qu’il a passé quelques heures dans un estaminet
du boulevard du Temple. «Voilà un joli endroit et une belle société!»
dit le président!
Un homme accusé de vol est interrogé par le président sur l’emploi
de son temps; il répond qu’il a passé quelques heures dans un estaminet
du boulevard du Temple. «Voilà un joli endroit et une belle société!»
dit le président!
Nous demanderons à M. le président s’il a jamais invité ce pauvre diable à venir passer la soirée chez lui—et s’il pense qu’il ait le choix d’une société plus relevée.
![]() Un voleur, interrogé sur ses moyens d’existence, répond qu’il
joue la poule au billard et qu’il est heureux;—c’est un état tout
nouveau:—heureux au billard.
Un voleur, interrogé sur ses moyens d’existence, répond qu’il
joue la poule au billard et qu’il est heureux;—c’est un état tout
nouveau:—heureux au billard.
![]() Un électeur a avoué qu’il s’était décidé à nommer M. Pauwels, parce
qu’on lui avait dit que c’était le plus aimable.—Il y a tant de
choses représentées à la Chambre—qu’on ne saurait trop se féliciter de
voir un député élu comme aimable.
Un électeur a avoué qu’il s’était décidé à nommer M. Pauwels, parce
qu’on lui avait dit que c’était le plus aimable.—Il y a tant de
choses représentées à la Chambre—qu’on ne saurait trop se féliciter de
voir un député élu comme aimable.
![]() M. Arago a annoncé qu’un de ses élèves venait de découvrir une
nouvelle comète.—M. Arago, fâché contre les comètes, ne daigne plus
s’en occuper lui-même.—Cela rappelle un peu M. Willaume, qui mariait
les gens et annonçait en post-scriptum dans les journaux que son
secrétaire plaçait les domestiques.
M. Arago a annoncé qu’un de ses élèves venait de découvrir une
nouvelle comète.—M. Arago, fâché contre les comètes, ne daigne plus
s’en occuper lui-même.—Cela rappelle un peu M. Willaume, qui mariait
les gens et annonçait en post-scriptum dans les journaux que son
secrétaire plaçait les domestiques.
![]() Lors de la présentation des tableaux devant le jury de
l’exposition, un des membres de cet aréopage juste et éclairé, M.
Bidault, s’absenta pendant quelques instants.—Pendant son absence, cinq
de ses paysages furent étourdiment refusés.—A son retour, il trouva la
besogne fort avancée. «Ah! ah! dit-il, vous avez fini les paysages! eh
bien, j’espère que vous êtes contents de moi cette année.» Les juges
comprirent qu’ils venaient de faire une sottise en repoussant par
mégarde les œuvres d’un de leurs complices.—Sur un signe
d’intelligence, le gardien alla prendre dans le tas refusé les cinq
tableaux Bidault et les glissa avec ceux acceptés.
Lors de la présentation des tableaux devant le jury de
l’exposition, un des membres de cet aréopage juste et éclairé, M.
Bidault, s’absenta pendant quelques instants.—Pendant son absence, cinq
de ses paysages furent étourdiment refusés.—A son retour, il trouva la
besogne fort avancée. «Ah! ah! dit-il, vous avez fini les paysages! eh
bien, j’espère que vous êtes contents de moi cette année.» Les juges
comprirent qu’ils venaient de faire une sottise en repoussant par
mégarde les œuvres d’un de leurs complices.—Sur un signe
d’intelligence, le gardien alla prendre dans le tas refusé les cinq
tableaux Bidault et les glissa avec ceux acceptés.
![]() A la bonne heure,—nous y voilà;—je suis un peu comme la plupart
de nos amis et de nos parents,—qui trouvent une douce consolation pour
les malheurs qui nous frappent—dans la joie de les avoir prédits et de
nous l’avoir bien dit.
A la bonne heure,—nous y voilà;—je suis un peu comme la plupart
de nos amis et de nos parents,—qui trouvent une douce consolation pour
les malheurs qui nous frappent—dans la joie de les avoir prédits et de
nous l’avoir bien dit.
L’enquête sur les élections contestées,—livrée à l’impression par la Chambre des députés,—nous donne déjà un avant-goût de ce que deviendra la vie privée en France,—où tout le monde veut arriver à la vie politique.—Une partie de la Chambre s’est épouvantée de ce quelle avait fait elle-même;—la commission a émis le vœu qu’on ne fît plus d’enquêtes de ce genre;—la moitié de la Chambre a gémi sur une publicité qu’elle avait autorisée elle-même;—les coulisses de la ville de Carpentras et autres lieux ont été ouvertes au public,—qui a pu y voir plusieurs autres petites pièces,—non destinées à la représentation.
Beaucoup de députés se sont récriés contre une publicité à laquelle chacun d’eux servira de pâture.
Ah! vous voulez du gouvernement représentatif, messieurs! ah! vous voulez qu’on vous envoie à la Chambre pour discuter tous les intérêts du pays!—Vous voulez qu’on mette entre vos mains la fortune publique et l’honneur du pays,—et vous ne voulez pas qu’on examine si les moyens qui vous ont fait envoyer à la Chambre ne sont pas précisément ceux qui vous devraient faire exclure de toute participation au gouvernement du pays.
Vous voulez faire dire dans les journaux qui vous poussent que vous avez toutes les vertus—et vous ne songez pas que c’est autoriser d’autres journaux à faire observer qu’il vous en manque quelques-unes et à dire lesquelles!—Vous n’êtes pas encore au bout, messieurs.—Vous en verrez bien d’autres.
Attendez un peu,—et l’on voudra savoir à quelle époque chacun de vous mange des pois verts,—et à quelle femme du monde ou d’ailleurs il adresse des hommages,—et s’il est aimé pour lui-même;—et, dans le cas où il achèterait son bonheur,—quel est le prix qu’il y met.—On voudra savoir où vous allez le soir—ou d’où vous sortez le matin;—on le dira,—on l’imprimera, et l’on aura raison.
Quoi!—messieurs,—de temps en temps—un homme inconnu,—ayant fait une fortune dont on ne connaît pas plus le chiffre que les éléments,—viendra prendre sa part du gouvernement du pays,—et la seule chose dont vous voulez qu’on s’enquière, c’est combien il y a de portes, combien il y a de fenêtres à sa maison!
Vous voulez qu’on dise: «Monsieur un tel possède trois portes cochères,—deux bâtardes,—vingt-cinq fenêtres;—qu’il gouverne la France: dignus est intrare.—Vive M. un tel! soumettons-nous à ses lois!» Vous voulez que l’on se contente d’être gouverné par le plus grand nombre des portes—et par la majorité des fenêtres.
Toute autre investigation qui ne porte pas sur vos portes et fenêtres vous semble indiscrète—et de mauvais goût.
Pardon, messieurs, il n’en peut être ainsi.—Vous voulez à la fois les bénéfices et les splendeurs de la vie politique et les douceurs secrètes de la vie privée.
Non, messieurs, les vertus politiques ne consistent pas seulement dans l’entêtement aveugle à suivre telle ou telle bannière,—il y a encore deux ou trois petites choses accessoires dont il est prudent de s’informer, et on s’en informera.
Je sais bien, messieurs, que c’est désagréable—pour des bourgeois,—encore hier marchands de n’importe quoi, de voir ainsi produire au grand jour—des détails, des habitudes, des mœurs qu’on n’a pas préparés pour le public à une époque où on ne savait pas qu’on deviendrait gouvernement.—Mais soyez de bonne foi,—vous direz qu’il n’en peut être autrement.
Voyons,—monsieur Ganneron,—quand vous vendiez des lumières des huit à vos concitoyens,—auriez-vous fait un long crédit à un épicier qui vous eût paru faire des dépenses au-dessus de sa fortune, ou qui vous eût semblé inepte,—ou peu exact,—et auriez-vous refusé de savoir ce qu’il en était?
Non, certes, monsieur Ganneron.
Et vous,—monsieur Cunin-Gridaine,—auriez-vous confié une partie de draps un peu forte—à un commis voyageur qu’on vous aurait assuré seulement jouer un peu trop aux dominos?
Et ne pensez-vous pas que les denrées que vous confie la France à tous sont un peu plus précieuses que celles vous débitiez au compte de vos commettants?
Ce n’est pas ma faute,—messieurs,—si vous avez pensé que l’art de gouverner les hommes et les pays—fût le seul qu’il n’y eût pas besoin d’apprendre,—et pour lequel il n’y eût pas de nécessité de préparer sa vie.—Restez dans la vie privée,—vous qui aimez la vie privée,—personne ne vous force d’entrer dans la vie politique.
Pour ce qui est des enquêtes de la Chambre, du reste,—cela ne servira à rien,—si ce n’est à produire de temps à autres quelques scandales.
Les hommes sont les mêmes partout et toujours,—tous à vendre,—seulement pour différents prix,—payables en diverses monnaies.—Mais, si vous ne voulez plus d’enquête,—ô représentants du pays! ou si vous voulez que vos enquêtes, servent à quelque chose, rendez un décret—par lequel—l’avidité et l’avarice sont abolies, ainsi que la vanité et l’ambition.—Ordonnez que tous les Français soient également vertueux, probes, désintéressés.—Ordonnez que personne ne vende son suffrage—ni pour de l’argent, ni pour des honneurs (des honneurs au prix de l’honneur), ni pour aucun intérêt.—Et ensuite vous n’aurez plus à craindre qu’on achète des suffrages,—quand il n’y en aura plus à vendre. La difficulté est seulement de réussir sur le premier point.—En attendant,—voici quelques-unes des plus innocentes révélations amenées par l’enquête.
M. de Cajoc, sous-préfet,—a écrit une lettre dont voici un extrait: «Je ne veux pas qu’on mette tous les préfets à la porte, il y en a de bons, mais je demande seulement qu’on m’en trouve une petite.»—Probablement une préfecture.
![]() Madame de Cajoc—a écrit: «Les ministres ne veulent que des
assassins et des gueux pour agents.»
Madame de Cajoc—a écrit: «Les ministres ne veulent que des
assassins et des gueux pour agents.»
![]() ÉLECTION DE CARPENTRAS.—«Le sieur Rosty a constamment soutenu que,
le jour du scrutin de ballottage, M. le sous-préfet de Carpentras,
l’ayant pris à part, lui avait témoigné des doutes sur son vote, et
avait voulu exiger de lui, sous peine de destitution, qu’il mît une
marque particulière sur son bulletin.»
ÉLECTION DE CARPENTRAS.—«Le sieur Rosty a constamment soutenu que,
le jour du scrutin de ballottage, M. le sous-préfet de Carpentras,
l’ayant pris à part, lui avait témoigné des doutes sur son vote, et
avait voulu exiger de lui, sous peine de destitution, qu’il mît une
marque particulière sur son bulletin.»
Ce n’est pas tout à fait conforme au vœu de la loi, qui exige le secret des votes.
«Le sieur Roubaud, électeur, nous a dit que, le 12 juillet au matin, le sieur Rosty fils, notaire, lui avait offert la somme de deux cents francs s’il voulait consentir à donner sa voix à M. Floret.»
Voici un notaire qui fait là un joli trafic!—et c’est une charmante chose à faire par-devant notaire qu’un marché de ce genre.
![]() «Les partisans de M. Floret imputent, au contraire, à ceux de M. de
Gérente d’avoir acheté pour cinquante francs le vote de Roubaud.»
«Les partisans de M. Floret imputent, au contraire, à ceux de M. de
Gérente d’avoir acheté pour cinquante francs le vote de Roubaud.»
M. Floret a offert deux cents francs à Roubaud—et M. de Gérente seulement cinquante francs.—Il y a bien du risque que M. de Gérente soit innocent de la corruption.—Roubaud a dû préférer être corrompu par M. Floret,—attendu qu’on ne se fait pas corrompre pour l’honneur.
![]() «Le sieur Bonnet aurait répondu qu’il s’était engagé à voter pour
M. Floret, parce que celui-ci lui avait promis la veille une place de
douze cents francs pour son neveu, dont il désirait se débarrasser.»
«Le sieur Bonnet aurait répondu qu’il s’était engagé à voter pour
M. Floret, parce que celui-ci lui avait promis la veille une place de
douze cents francs pour son neveu, dont il désirait se débarrasser.»
Quelque coquin de neveu probablement—comme on en voit tant.—M. Bonnet, j’en suis sûr, n’aurait rien accepté pour lui-même,—mais pour son neveu, qui ne sera plus à sa charge et qui l’embarrasse,—c’est bien différent!
![]() «Si l’élection de Carpentras est validée, ce n’est pas parce que
cette élection a été exempte de manœuvres, mais uniquement parce que
les griefs les plus graves ne sont pas imputables au candidat élu. Et la
meilleure manière d’atteindre ce but, ne serait-elle pas de proposer à
la Chambre, en même temps qu’elle admet le député, d’infliger un blâme à
ces manœuvres?»
«Si l’élection de Carpentras est validée, ce n’est pas parce que
cette élection a été exempte de manœuvres, mais uniquement parce que
les griefs les plus graves ne sont pas imputables au candidat élu. Et la
meilleure manière d’atteindre ce but, ne serait-elle pas de proposer à
la Chambre, en même temps qu’elle admet le député, d’infliger un blâme à
ces manœuvres?»
Pardon, messieurs de la commission,—c’est-à-dire que ce n’est pas le meilleur, mais le moins mauvais qui est élu;—ce n’est pas celui qui n’a pas fait le moins—qui est déclaré honorable;—disons donc l’honorable M. Floret.
![]() ÉLECTION D’EMBRUN.—«L’élection d’Embrun présente deux caractères
bien marqués: tentatives de corruption pécuniaire de la part de M.
Ardoin; essai d’intimidation et violation du secret des votes de la part
des amis de M. Allier.»
ÉLECTION D’EMBRUN.—«L’élection d’Embrun présente deux caractères
bien marqués: tentatives de corruption pécuniaire de la part de M.
Ardoin; essai d’intimidation et violation du secret des votes de la part
des amis de M. Allier.»
C’est gentil;—voyons un peu lequel sera déclaré honorable de ces deux messieurs.
![]() «Il s’est élevé, de l’ensemble des témoignages recueillis, la
preuve morale des tentatives de corruption auxquelles avaient eu
malheureusement recours les amis de M. Allier, et peut-être ce
concurrent lui-même. Nous produirons, à cet égard, des déclarations et
des aveux déplorables.»
«Il s’est élevé, de l’ensemble des témoignages recueillis, la
preuve morale des tentatives de corruption auxquelles avaient eu
malheureusement recours les amis de M. Allier, et peut-être ce
concurrent lui-même. Nous produirons, à cet égard, des déclarations et
des aveux déplorables.»
Ce sera peut-être M. Ardoin.
![]() «Le secret des votes a-t-il été violé par les désignations qui
accompagnaient, sur la plupart des bulletins, les noms des deux
candidats? Car ce procédé a été employé par les deux partis, c’est le
procès-verbal de l’élection qui le déclare: «Le bureau (y est-il dit),
après en avoir délibéré, a, en effet, remarqué que, de part et d’autre,
les désignations inscrites sur les bulletins des électeurs porteraient
atteinte au secret des votes et pourraient être contraires au vœu de
la loi.»
«Le secret des votes a-t-il été violé par les désignations qui
accompagnaient, sur la plupart des bulletins, les noms des deux
candidats? Car ce procédé a été employé par les deux partis, c’est le
procès-verbal de l’élection qui le déclare: «Le bureau (y est-il dit),
après en avoir délibéré, a, en effet, remarqué que, de part et d’autre,
les désignations inscrites sur les bulletins des électeurs porteraient
atteinte au secret des votes et pourraient être contraires au vœu de
la loi.»
La chose redevient douteuse.
![]() «Vous avez sous les yeux les dépositions des témoins; ils ne sont
pas d’accord sur le nombre des bulletins avec des désignations. M.
Bertrand de Rémollon a dit que tous les bulletins pour M. Allier, ou
presque tous, soixante-dix-sept sur soixante-dix-huit, portaient des
désignations. M. Janneau-Lagrave a dit qu’il y en avait un quart ou un
tiers du côté de M. Allier. M. Achille Fourrat: les trois quarts des
bulletins à peu près, dont cinquante environ du côté de M. Allier, et
peut-être quarante-cinq pour M. Ardoin. M. Cézanne un tiers, et pour les
deux candidats. M. Didier: des deux côtés à peu près en nombre égal.»
«Vous avez sous les yeux les dépositions des témoins; ils ne sont
pas d’accord sur le nombre des bulletins avec des désignations. M.
Bertrand de Rémollon a dit que tous les bulletins pour M. Allier, ou
presque tous, soixante-dix-sept sur soixante-dix-huit, portaient des
désignations. M. Janneau-Lagrave a dit qu’il y en avait un quart ou un
tiers du côté de M. Allier. M. Achille Fourrat: les trois quarts des
bulletins à peu près, dont cinquante environ du côté de M. Allier, et
peut-être quarante-cinq pour M. Ardoin. M. Cézanne un tiers, et pour les
deux candidats. M. Didier: des deux côtés à peu près en nombre égal.»
M. Ardoin a des chances pour être honorable; mais il n’en a guère de plus que M. Allier.—Voyons encore:
![]() «Le sieur Bonaffoux père a eu à déplorer des propos inconvenants et
des coups de son fils; le fils était dans un état d’ivresse complet, et
ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que les témoins qui ont
reproduit les griefs de Bonaffoux ont déclaré, les uns, qu’il leur avait
dit que son fils l’avait menacé pour arracher son vote en faveur de M.
Ardoin; les autres, en faveur de M. Allier, d’où résulte une grande
incertitude sur les faits en eux-mêmes, et par conséquent sur la valeur
des témoignages et sur l’intention des plaintes.»
«Le sieur Bonaffoux père a eu à déplorer des propos inconvenants et
des coups de son fils; le fils était dans un état d’ivresse complet, et
ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que les témoins qui ont
reproduit les griefs de Bonaffoux ont déclaré, les uns, qu’il leur avait
dit que son fils l’avait menacé pour arracher son vote en faveur de M.
Ardoin; les autres, en faveur de M. Allier, d’où résulte une grande
incertitude sur les faits en eux-mêmes, et par conséquent sur la valeur
des témoignages et sur l’intention des plaintes.»
Bonaffoux a battu son père;—mais pour qui et pourquoi a-t-il battu son père?—en général, quand on bat son père, c’est pour quelqu’un ou pour quelque chose.
![]() «Cet arrêt déclare simulés les actes en vertu desquels ces sept
électeurs auraient acquis, en mars et avril 1841, de M. Ardoin,
candidat, l’usufruit, pendant neuf années, de pièces de terre situées à
Saint-Ouen et à Clichy, et reconnaît fausses et contradictoires les
explications données par eux.»
«Cet arrêt déclare simulés les actes en vertu desquels ces sept
électeurs auraient acquis, en mars et avril 1841, de M. Ardoin,
candidat, l’usufruit, pendant neuf années, de pièces de terre situées à
Saint-Ouen et à Clichy, et reconnaît fausses et contradictoires les
explications données par eux.»
Oh! diable, ceci est laid;—c’est, je crois, maintenant,—M. Allier qui est le plus honorable de ces deux messieurs.
![]() «On disait que M. Ardoin était venu de Paris avec deux cent mille
francs pour gagner les électeurs; et l’un d’eux, en effet, était venu
chez Jouve lui demander trois mille francs sur cette somme. J’en veux
ma part, aurait-il dit naïvement.
«On disait que M. Ardoin était venu de Paris avec deux cent mille
francs pour gagner les électeurs; et l’un d’eux, en effet, était venu
chez Jouve lui demander trois mille francs sur cette somme. J’en veux
ma part, aurait-il dit naïvement.
![]() «Chevalier, adjoint. Celui-ci avait reçu en prêt, de M. Ardoin, une
somme de huit cents francs pour trois ans, sans intérêts. Il vota, le
premier jour, pour M. de Bellegarde, que les amis de M. Allier portaient
à la présidence du collége. Il paraîtrait qu’on avait donné à cet
électeur un mot d’ordre qui ne se serait pas retrouvé dans les bulletins
énoncés. Aux reproches de M. Jouve, le sieur Chevalier aurait répondu:
«Je ne voterai pour M. Ardoin que si, au lieu d’un prêt de huit cents
francs, on le convertit en don, en déchirant mon obligation.»
«Chevalier, adjoint. Celui-ci avait reçu en prêt, de M. Ardoin, une
somme de huit cents francs pour trois ans, sans intérêts. Il vota, le
premier jour, pour M. de Bellegarde, que les amis de M. Allier portaient
à la présidence du collége. Il paraîtrait qu’on avait donné à cet
électeur un mot d’ordre qui ne se serait pas retrouvé dans les bulletins
énoncés. Aux reproches de M. Jouve, le sieur Chevalier aurait répondu:
«Je ne voterai pour M. Ardoin que si, au lieu d’un prêt de huit cents
francs, on le convertit en don, en déchirant mon obligation.»
»Chevalier aurait raconté ce fait en présence de cinq à six témoins. Et l’obligation a été déchirée. Chevalier aurait même ajouté: «Je dois mille francs à M. Julien, et j’aurais voulu acquitter cette dette.» Il a voté le deuxième jour pour M. Ardoin.»
Les parts ne sont pas égales,—nous avons vu tout à l’heure un électeur qui demande trois mille francs. M. Chevalier fait la chose pour huit cents francs.—C’est un gâte-métier.
![]() «Si M. Ardoin ne faisait rien par lui-même, il laissait faire des
agents dévoués. Le nommé Martin, repris de justice; le nommé Trinquier,
sous le coup des réserves du ministère public pour altération de
signature, allaient l’un et l’autre offrant de l’argent à qui voudrait
en recevoir.»
«Si M. Ardoin ne faisait rien par lui-même, il laissait faire des
agents dévoués. Le nommé Martin, repris de justice; le nommé Trinquier,
sous le coup des réserves du ministère public pour altération de
signature, allaient l’un et l’autre offrant de l’argent à qui voudrait
en recevoir.»
C’est peut-être la première fois que ces deux messieurs offraient de l’argent au monde,—leurs antécédents judiciaires semblent, en effet, annoncer des exercices tout opposés.
![]() «Ces personnes ont ajouté: «Si nous ne votions pas pour M. Ardoin,
dès le lendemain même de l’élection nous serions poursuivis à
outrance.»
«Ces personnes ont ajouté: «Si nous ne votions pas pour M. Ardoin,
dès le lendemain même de l’élection nous serions poursuivis à
outrance.»
Il est bon de se faire corrompre, mais il faut être honnête.—Vous avez promis de vous déshonorer; un honnête homme n’a que sa parole,—si vous y manquez et que ça tourne mal,—tant pis pour vous.
![]() M. Ardoin lui-même s’en est expliqué devant nous en ces termes:
«Les électeurs qui votaient pour moi étaient hébergés chez Gauthier et
chez Bellotte. Il y avait table ouverte pour dîner et pour déjeuner, à
mes frais. C’était connu, je ne m’en suis pas caché. On peut bien
traiter ses amis. Le préfet m’a fait une affaire en 1839, parce que
j’avais amené mon cuisinier. Je crois que je le ferai encore.» M. Ardoin
a ajouté qu’il avait habité l’Angleterre, et que là on faisait bien
autre chose.»
M. Ardoin lui-même s’en est expliqué devant nous en ces termes:
«Les électeurs qui votaient pour moi étaient hébergés chez Gauthier et
chez Bellotte. Il y avait table ouverte pour dîner et pour déjeuner, à
mes frais. C’était connu, je ne m’en suis pas caché. On peut bien
traiter ses amis. Le préfet m’a fait une affaire en 1839, parce que
j’avais amené mon cuisinier. Je crois que je le ferai encore.» M. Ardoin
a ajouté qu’il avait habité l’Angleterre, et que là on faisait bien
autre chose.»
Attendez un peu,—nous ne faisons que commencer,—et nous commençons bien;—l’Angleterre n’est pas arrivée du premier coup où elle en est.
![]() «Il n’a pu s’élever d’hésitation dès lors parmi les membres de la
commission d’enquête que sur la manière de caractériser ces actes, et
l’intention qui les avait inspirés. Les uns ont voulu les qualifier de
manœuvres coupables, les autres de tentatives de corruption. La
majorité de la commission a adopté une expression générale, qui comprend
cette double pensée, et les a déclarés faits de corruption
électorale.»
«Il n’a pu s’élever d’hésitation dès lors parmi les membres de la
commission d’enquête que sur la manière de caractériser ces actes, et
l’intention qui les avait inspirés. Les uns ont voulu les qualifier de
manœuvres coupables, les autres de tentatives de corruption. La
majorité de la commission a adopté une expression générale, qui comprend
cette double pensée, et les a déclarés faits de corruption
électorale.»
Cette pauvre commission a dû, en effet, se trouver bien embarrassée;—il paraît que ce que ces messieurs ont fait ne constitue pas des manœuvres coupables,—ni des tentatives de corruption.—Quel bonheur que la commission ait enfin trouvé—le mot,—le vrai mot,—le seul mot qui rende exactement la chose!—Cependant cette phrase rappelle un peu la fameuse distinction d’Odry entre les chiquenaudes, les pichenettes et les croquignoles.
![]() «La minorité a dit qu’elle désapprouvait hautement, comme la
majorité, les faits à la charge du concurrent de M. Allier (ah! c’est
M. Ardoin qui ne sera pas honorable), mais qu’il lui était impossible de
ne pas voir des actes d’intimidation dans l’ensemble des faits qui
avaient caractérisé l’élection, notamment les actes relatifs à Ardoin de
Briançon, à Bonnaffoux et à Chevalier. Ces actes ont été en quelque
sorte avoués par M. de Bellegarde et par Joubert (M. Ardoin redevient
honorable). La minorité a ajouté qu’il résultait de l’enquête qu’un
grand nombre de bulletins, portant des désignations particulières,
avaient été écrits en faveur de M. Allier; et que si on n’avait pas
découvert la preuve matérielle d’un concert, d’un registre et d’un
contrôle, tout portait à croire que ce concert et ce contrôle avaient
existé, particulièrement de la part des trois membres composant le
comité électoral de M. Allier, placés tous trois auprès du bureau du
président du collége, au moment du dépouillement du scrutin, de manière
à pouvoir lire tous les bulletins qui portaient des désignations et à
constater leur origine. (M. Ardoin continue à redevenir honorable.)
Cette circonstance, réunie à d’autres indices, fortifiait la minorité
dans la conviction où elle était qu’une atteinte sérieuse avait été
portée au secret des votes, à la liberté de l’élection; et que, pour
mettre un terme à l’abus possible des bulletins avec des désignations,
par une sanction sérieuse, elle était d’avis d’annuler l’élection de M.
Allier. (Honorable M. Ardoin!)
«La minorité a dit qu’elle désapprouvait hautement, comme la
majorité, les faits à la charge du concurrent de M. Allier (ah! c’est
M. Ardoin qui ne sera pas honorable), mais qu’il lui était impossible de
ne pas voir des actes d’intimidation dans l’ensemble des faits qui
avaient caractérisé l’élection, notamment les actes relatifs à Ardoin de
Briançon, à Bonnaffoux et à Chevalier. Ces actes ont été en quelque
sorte avoués par M. de Bellegarde et par Joubert (M. Ardoin redevient
honorable). La minorité a ajouté qu’il résultait de l’enquête qu’un
grand nombre de bulletins, portant des désignations particulières,
avaient été écrits en faveur de M. Allier; et que si on n’avait pas
découvert la preuve matérielle d’un concert, d’un registre et d’un
contrôle, tout portait à croire que ce concert et ce contrôle avaient
existé, particulièrement de la part des trois membres composant le
comité électoral de M. Allier, placés tous trois auprès du bureau du
président du collége, au moment du dépouillement du scrutin, de manière
à pouvoir lire tous les bulletins qui portaient des désignations et à
constater leur origine. (M. Ardoin continue à redevenir honorable.)
Cette circonstance, réunie à d’autres indices, fortifiait la minorité
dans la conviction où elle était qu’une atteinte sérieuse avait été
portée au secret des votes, à la liberté de l’élection; et que, pour
mettre un terme à l’abus possible des bulletins avec des désignations,
par une sanction sérieuse, elle était d’avis d’annuler l’élection de M.
Allier. (Honorable M. Ardoin!)
»La majorité, au contraire, est d’avis que l’élection a été libre et pure, et vous propose l’admission de M. Allier.»
Oh! mon Dieu!—voilà M. Ardoin qui n’est plus honorable du tout;—c’est maintenant M. Allier,—qui, du reste, a bien manqué de ne l’être pas.
On a trouvé généralement cette conclusion de la commission: l’élection a été libre et pure,—un peu facétieuse.
![]() ÉLECTION DE LANGRES.—Parlez-moi de Langres, à la bonne
heure,—voilà un endroit où les choses se passent beaucoup mieux.
ÉLECTION DE LANGRES.—Parlez-moi de Langres, à la bonne
heure,—voilà un endroit où les choses se passent beaucoup mieux.
«Une multitude d’agents parcoururent la ville et les campagnes, obsédant les électeurs de promesses, de menaces, offrant des voitures pour se rendre à l’élection, et leur indiquant les auberges et les cafés où ils devaient être défrayés, et, de plus, dénigrant les compétiteurs de M. Pauwels, en les qualifiant d’aristocrates et de gentilshommes voulant la ruine du pays.
»La veille de l’élection on avait accaparé toutes les voitures et les chevaux de louage du chef-lieu pour amener, dès le matin, tous les électeurs de la campagne dont on redoutait l’indépendance du vote; et ensuite, placés dans les maisons et auberges où ils étaient gardés à vue, on les extrayait de leur retraite dans un état voisin de l’ivresse, et on les accompagnait ainsi au bureau de l’élection.»
M. Ardoin et M. Allier hébergeaient les électeurs d’Embrun;—mais M. Pauwels fait mieux: il grise les électeurs de Langres.
![]() «M. Chauchart, membre du conseil général, a déclaré devant la
commission qu’il avait vu dans le sein du collége un sieur Carbillet,
chef d’instruction, amenant un électeur qu’il soutenait, attendu qu’il
ne pouvait presque plus marcher. M. Beguinot de Montrol en a vu un tout
à fait ivre, dont le billet a été écrit par un autre électeur. M.
Renard, substitut du procureur du roi à Vassy, nous a dit: «Les
électeurs dont M. Abreuveux écrivait les billets n’étaient pas ivres,
mais ils étaient appesantis par le vin.»
«M. Chauchart, membre du conseil général, a déclaré devant la
commission qu’il avait vu dans le sein du collége un sieur Carbillet,
chef d’instruction, amenant un électeur qu’il soutenait, attendu qu’il
ne pouvait presque plus marcher. M. Beguinot de Montrol en a vu un tout
à fait ivre, dont le billet a été écrit par un autre électeur. M.
Renard, substitut du procureur du roi à Vassy, nous a dit: «Les
électeurs dont M. Abreuveux écrivait les billets n’étaient pas ivres,
mais ils étaient appesantis par le vin.»
Distinguons:—regardez un peu comme on est méchant dans les petits endroits;—on disait avoir vu ivres de pauvres électeurs qui n’étaient qu’appesantis par le vin;—ce serait honteux d’avoir été exercer ivre un droit aussi sérieux.
![]() OBSERVATIONS GÉNÉRALES.—«Treizième question. M. de Gérante
a-t-il demandé et obtenu une demi-bourse dans un collége royal pour
l’enfant de Raspail, petit-fils d’un électeur, et une autre pour
l’enfant de Guillaume Siffrein, électeur?—R. Oui, à l’unanimité.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.—«Treizième question. M. de Gérante
a-t-il demandé et obtenu une demi-bourse dans un collége royal pour
l’enfant de Raspail, petit-fils d’un électeur, et une autre pour
l’enfant de Guillaume Siffrein, électeur?—R. Oui, à l’unanimité.
»Quatorzième question. Ces démarches ont-elles eu lieu en vue de l’élection, et faut-il exprimer un regret que le candidat les ait faites?—R. Non, sept voix contre deux. Il ne doit pas même être exprimé un blâme implicite.
»La majorité demande que le rapport énonce une crainte générale, et sans application aux faits actuels, qu’il ne soit fait abus des demi-bourses.»
Sans application aux faits actuels est un joli mot.—En effet; qui est-ce qui pourrait voir là le moindre rapport?—Les Guêpes ont récemment parlé des bourses de collége; à la commission la gloire d’avoir parlé des demi-bourses.—Est-ce qu’elle croit qu’on ne pourrait pas abuser un peu aussi des bourses entières?
![]() «Dix-neuvième question. M. Floret a-t-il, le 11 juillet, déclaré
à l’électeur Fabry qu’il donnerait des garanties, par écrit, des
promesses qu’il lui ferait si cet électeur voulait voter pour lui?—R.
Non, six voix contre trois. Exprimer un regret à raison de la démarche
de M. Floret dans cette circonstance. A l’unanimité.»
«Dix-neuvième question. M. Floret a-t-il, le 11 juillet, déclaré
à l’électeur Fabry qu’il donnerait des garanties, par écrit, des
promesses qu’il lui ferait si cet électeur voulait voter pour lui?—R.
Non, six voix contre trois. Exprimer un regret à raison de la démarche
de M. Floret dans cette circonstance. A l’unanimité.»
Exprimer un regret que M. Floret ait fait une démarche que vous déclarez qu’il n’a pas faite;—commission, ma mie, ceci n’est pas bien clair.
«Quatrième question. Des électeurs ont-ils été défrayés à l’auberge, pendant l’élection, par le même candidat? Est-ce là une manœuvre électorale?—R. Oui, à l’unanimité.»
J’espère bien que MM. les députés, surtout les membres de la commission, n’accepteront pendant la session aucun dîner, ni chez le roi, ni chez aucun ministre;—c’est une belle chose que l’indépendance,—mais qui ne résiste pas à un dîner,—selon la commission.
![]() FAITS DE VIOLENCE IMPUTÉS A DES PERSONNES DU PARTI
ALLIER.—Sixième question. L’électeur Bonnaffoux, de Caleyères, a-t-il
été menacé et battu par son fils parce qu’il annonçait devoir voter pour
M. Allier? Au contraire, les violences dont il s’est plaint
avaient-elles pour objet de le forcer à voter pour M. Ardoin?—R.
Quatre voix sont d’avis que, d’après l’enquête, des violences ont eu
lieu parce que Bonnaffoux voulait voter pour M. Ardoin. Cinq voix, qu’il
n’est pas prouvé dans quelle intention des violences ont été exercées.»
FAITS DE VIOLENCE IMPUTÉS A DES PERSONNES DU PARTI
ALLIER.—Sixième question. L’électeur Bonnaffoux, de Caleyères, a-t-il
été menacé et battu par son fils parce qu’il annonçait devoir voter pour
M. Allier? Au contraire, les violences dont il s’est plaint
avaient-elles pour objet de le forcer à voter pour M. Ardoin?—R.
Quatre voix sont d’avis que, d’après l’enquête, des violences ont eu
lieu parce que Bonnaffoux voulait voter pour M. Ardoin. Cinq voix, qu’il
n’est pas prouvé dans quelle intention des violences ont été exercées.»
Décidément, Bonnaffoux fils n’a battu Bonnaffoux père que pour le battre.
![]() CONCLUSION.—«Dixième question. Faut-il proposer à la Chambre
d’annuler l’élection d’Embrun?—R. Non, cinq voix contre quatre.»
CONCLUSION.—«Dixième question. Faut-il proposer à la Chambre
d’annuler l’élection d’Embrun?—R. Non, cinq voix contre quatre.»
En effet, pourquoi annuler l’élection d’Embrun?—Est-ce qu’elle n’est pas pure?—Qu’est-ce qu’on demande à une élection?—D’être libre et pure.—Est-il rien d’aussi pur que l’élection d’Embrun?
![]() «M. Pauwels et ses amis cherchent en vain à couvrir ces abus du
prétexte des usages du pays: «On n’y fait pas un marché, nous a dit M.
Pauwels, sans que cela se passe au cabaret.» Nous pensions, nous, qu’il
n’en est que plus nécessaire d’apprendre aux électeurs qu’on ne se
prépare pas ainsi à l’accomplissement d’un devoir civique aussi sérieux
que l’exercice du droit électoral.»
«M. Pauwels et ses amis cherchent en vain à couvrir ces abus du
prétexte des usages du pays: «On n’y fait pas un marché, nous a dit M.
Pauwels, sans que cela se passe au cabaret.» Nous pensions, nous, qu’il
n’en est que plus nécessaire d’apprendre aux électeurs qu’on ne se
prépare pas ainsi à l’accomplissement d’un devoir civique aussi sérieux
que l’exercice du droit électoral.»
Ah! prenez garde, messieurs, il y a alors bien des gens qui ne viendront pas aux élections.
![]() «Ce qui caractérise l’intimidation, c’est l’absence forcée des
électeurs, empêchés, par une terreur répandue à dessein, de venir
exercer leur droit; et l’élection d’Embrun présente, moins que toute
autre, ce caractère, puisque quatre électeurs seulement se sont
abstenus, et que leur absence a été justifiée.»
«Ce qui caractérise l’intimidation, c’est l’absence forcée des
électeurs, empêchés, par une terreur répandue à dessein, de venir
exercer leur droit; et l’élection d’Embrun présente, moins que toute
autre, ce caractère, puisque quatre électeurs seulement se sont
abstenus, et que leur absence a été justifiée.»
Est-ce que messieurs de la commission n’appellent pas intimidation—l’action d’obliger un employé par la peur de perdre sa place;—un débiteur par la peur des poursuites, à voter autrement qu’ils ne veulent?—vrai, je ne suis pas satisfait de cette définition de l’intimidation.
![]() «Là se borne, messieurs, l’examen des quatre griefs imputés par M.
Floret à l’administration, dans une des séances du mois d’août dernier.
Passons à la discussion des trois faits reprochés à M. Floret dans la
même séance, en réponse à ses accusations.»
«Là se borne, messieurs, l’examen des quatre griefs imputés par M.
Floret à l’administration, dans une des séances du mois d’août dernier.
Passons à la discussion des trois faits reprochés à M. Floret dans la
même séance, en réponse à ses accusations.»
Comme nous l’avions remarqué,—quatre faits contre l’administration, trois faits seulement contre M. Floret.—M. Floret est vertueux; mais voici quelque chose à quoi, j’en suis sûr, personne ne s’attend, c’est qu’après le développement des jolies choses que je viens de vous dire en abrégé,—la commission ravie—s’écrie en finissant:
«Conservons précieusement cet esprit constitutionnel; il y va de tout notre avenir.»
Voilà de ces choses qu’on n’oserait pas inventer.
![]() Le lendemain, la Chambre n’a pas été de l’avis de la
commission,—elle a, il est vrai, annulé l’élection de M. Pauwels,—mais
elle a également mis à néant celle de M. Floret.—Au moment où nous
mettons sous presse, on ne sait pas encore ce qu’il sera fait de M.
Allier.
Le lendemain, la Chambre n’a pas été de l’avis de la
commission,—elle a, il est vrai, annulé l’élection de M. Pauwels,—mais
elle a également mis à néant celle de M. Floret.—Au moment où nous
mettons sous presse, on ne sait pas encore ce qu’il sera fait de M.
Allier.
![]() Très-bien, messieurs, voici la Chambre purifiée.—Deux élections
annulées d’un coup.—Maintenant, il ne reste pas à la Chambre un seul
député qui ait employé la moindre brigue,—la moindre promesse,—pour se
faire élire;—tous, sans exception, ont été violemment arrachés de la
charrue ou de leur maison des champs.
Très-bien, messieurs, voici la Chambre purifiée.—Deux élections
annulées d’un coup.—Maintenant, il ne reste pas à la Chambre un seul
député qui ait employé la moindre brigue,—la moindre promesse,—pour se
faire élire;—tous, sans exception, ont été violemment arrachés de la
charrue ou de leur maison des champs.
![]() Tous, sans exception, ont quitté avec regret la vie privée et les
douceurs de la famille;—tous ont été élevés malgré eux à une dignité
dont ils gémissent;—tous ont accepté ce mandat uniquement dans
l’intérêt du pays et de leurs concitoyens.
Tous, sans exception, ont quitté avec regret la vie privée et les
douceurs de la famille;—tous ont été élevés malgré eux à une dignité
dont ils gémissent;—tous ont accepté ce mandat uniquement dans
l’intérêt du pays et de leurs concitoyens.
![]() Une chose seulement paraît un peu singulière;—voilà M. Pauwels
exclu de la Chambre—comme corrupteur des électeurs, comme auteur de
manœuvres coupables:—Très-bien, mais M. Pauwels était à la fois élu
à Langres et à Saint-Pons.—L’élection de Langres est annulée;—mais
celle de Saint-Pons est maintenue.—Disons ce que nous voulons de l’élu
indigne de Langres;—mais respect à l’honorable député de Saint-Pons.
Une chose seulement paraît un peu singulière;—voilà M. Pauwels
exclu de la Chambre—comme corrupteur des électeurs, comme auteur de
manœuvres coupables:—Très-bien, mais M. Pauwels était à la fois élu
à Langres et à Saint-Pons.—L’élection de Langres est annulée;—mais
celle de Saint-Pons est maintenue.—Disons ce que nous voulons de l’élu
indigne de Langres;—mais respect à l’honorable député de Saint-Pons.
Le déluge.—On demande une famille honnête.—Suppression du mois de mai.—La rançon du mois de mai.—Plus de mal de mer!—Opinion de madame Ancelot sur une pièce de madame Ancelot.—Les douaniers de M. Greterin.—Utilité de la langue latine pour une profession.—M. le préfet de police faisant de la popularité.—La liste civile.—Les hommes du pouvoir et le peuple.—Le jury.—Les circonstances atténuantes.—Le bagne.—Brest.—Le duc d’Aumale.—Noble impartialité des journaux.—De la liberté des cultes en France.—M. Fould.
![]() SAINTE-ADRESSE.—NORMANDIE.—Au moment où j’écris ces lignes,—une
chose paraît complètement évidente;—c’est que le ciel veut, par un
nouveau déluge, en finir encore une fois avec le genre humain.—Si la
chose ne va pas plus vite, c’est que Dieu n’a pas encore pu trouver une
famille de justes à préserver—une famille de justes comme celle de
Noé;—une famille de quatre justes dont un gredin.
SAINTE-ADRESSE.—NORMANDIE.—Au moment où j’écris ces lignes,—une
chose paraît complètement évidente;—c’est que le ciel veut, par un
nouveau déluge, en finir encore une fois avec le genre humain.—Si la
chose ne va pas plus vite, c’est que Dieu n’a pas encore pu trouver une
famille de justes à préserver—une famille de justes comme celle de
Noé;—une famille de quatre justes dont un gredin.
![]() La composition de l’arche sera cette fois soumise à des
modifications;—il est parfaitement inutile d’y mettre un
cheval,—espèce prochainement inutile et tombée en désuétude,—et dont
le nom seul restera comme mesure de puissance pour exprimer la force des
machines—en attendant que de nouveaux perfectionnements apportés à la
vapeur et aux machines fassent éprouver le même sort à l’homme,—ce qui
est déjà fort bien commencé en Angleterre et promet de s’établir en
France.
La composition de l’arche sera cette fois soumise à des
modifications;—il est parfaitement inutile d’y mettre un
cheval,—espèce prochainement inutile et tombée en désuétude,—et dont
le nom seul restera comme mesure de puissance pour exprimer la force des
machines—en attendant que de nouveaux perfectionnements apportés à la
vapeur et aux machines fassent éprouver le même sort à l’homme,—ce qui
est déjà fort bien commencé en Angleterre et promet de s’établir en
France.
![]() En effet, qu’est-ce qu’un ouvrier aujourd’hui? une machine qui
n’est pas même de la force d’un cheval, et qu’il faut alimenter avec du
pain, avec du vin, avec de la viande,—tandis qu’on a de si bonnes
machines qui ont la force de trois cents—de quatre cents, de mille
chevaux, et qui ne mangent que de la tourbe!—L’homme avant peu
deviendra un simple encombrement,—un préjugé.
En effet, qu’est-ce qu’un ouvrier aujourd’hui? une machine qui
n’est pas même de la force d’un cheval, et qu’il faut alimenter avec du
pain, avec du vin, avec de la viande,—tandis qu’on a de si bonnes
machines qui ont la force de trois cents—de quatre cents, de mille
chevaux, et qui ne mangent que de la tourbe!—L’homme avant peu
deviendra un simple encombrement,—un préjugé.
![]() Dieu, instruit par son premier déluge,—se gardera bien cette fois
d’ordonner à la famille préservée de faire entrer dans l’arche un couple
de tout ce qui existe.
Dieu, instruit par son premier déluge,—se gardera bien cette fois
d’ordonner à la famille préservée de faire entrer dans l’arche un couple
de tout ce qui existe.
Ce que, du reste, Noé ne fit pas autrefois, malgré l’ordre qu’il en avait reçu.
Ainsi que l’ont prouvé les savants qui ont retrouvé dans la terre des ossements d’animaux antédiluviens—qu’on n’a jamais vus vivants depuis le déluge,—ce qui prouve que Noé ne les avait pas fait entrer dans l’arche,—et il n’a pas l’excuse de les avoir oubliés par mégarde ou de ne pas les avoir vus,—attendu que quelques-uns de ces fossiles sont un peu plus grands que des éléphants.
Nous espérons pour les peuples de l’avenir que, dans ce nouveau déluge, plusieurs espèces aujourd’hui existantes seront perdues et supprimées;
Et qu’un jour viendra où on ne verra plus ces espèces que dans les musées et les cabinets d’histoire naturelle, à mesure qu’on les découvrira dans les couches de terre glaise;
Comme j’ai vu l’été dernier l’excellent et savant M. Lesueur—chercher,—trouver et reconstruire,—dans nos falaises de Normandie,—os à os, vertèbre à vertèbre,—une sorte de crocodile bizarre, appelée, je crois, ichtyosaurus.
![]() Les peuples qui seront créés après ce déluge—reconstruiront
ainsi,—morceaux par morceaux,—une foule d’espèces aujourd’hui vivantes
et régnantes et alors fossiles et antédiluviennes,—qui, j’espère bien
pour eux, ne seront pas admises dans la nouvelle arche d’alliance.
Les peuples qui seront créés après ce déluge—reconstruiront
ainsi,—morceaux par morceaux,—une foule d’espèces aujourd’hui vivantes
et régnantes et alors fossiles et antédiluviennes,—qui, j’espère bien
pour eux, ne seront pas admises dans la nouvelle arche d’alliance.
![]() Alors on ira voir le dimanche, dans quelque muséum, un avocat
antédiluvien—parfaitement conservé, donné au cabinet par M. ***; un
colonel de la garde nationale fossile:—ce morceau curieux n’est pas
complet,—il lui manque la partie de la tête connue sous le nom de
bonnet à poil, etc., et autres icthyosaurus.
Alors on ira voir le dimanche, dans quelque muséum, un avocat
antédiluvien—parfaitement conservé, donné au cabinet par M. ***; un
colonel de la garde nationale fossile:—ce morceau curieux n’est pas
complet,—il lui manque la partie de la tête connue sous le nom de
bonnet à poil, etc., et autres icthyosaurus.
![]() Mais peut-être serons-nous sauvés d’un nouveau déluge, faute de
pouvoir trouver la famille des justes en question:—quatre justes dont
un gredin.
Mais peut-être serons-nous sauvés d’un nouveau déluge, faute de
pouvoir trouver la famille des justes en question:—quatre justes dont
un gredin.
![]() En attendant, Dieu nous a supprimé le mois de mai.
En attendant, Dieu nous a supprimé le mois de mai.
Le mois de mai autrefois mois de soleil,—de fleurs, de parfums, d’amour et de rêveries, maintenant mois de pluie et de boue—et de froid—et de giboulées.
Les fleurs—se sont ouvertes sans s’épanouir, pâles, tristes,—affaissées, sans éclat et sans parfum,—les abeilles ont été noyées dans le nectaire vide des fleurs,—et aussi toutes ces charmantes fleurs qui, en même temps que celles de la terre, s’épanouissent dans le cœur au retour du printemps—elles n’ont pas fleuri faute de soleil.
![]() Dieu nous a supprimé le mois de mai—le mois de mai! Le
printemps—un de ses plus précieux dons—les fleurs! à la fois les
pierreries et les parfums du pauvre.
Dieu nous a supprimé le mois de mai—le mois de mai! Le
printemps—un de ses plus précieux dons—les fleurs! à la fois les
pierreries et les parfums du pauvre.
![]() Les fleurs—la fête de la vue,—comme disaient les Grecs.
Les fleurs—la fête de la vue,—comme disaient les Grecs.
![]() Les fleurs, qui exhalent avec leurs odeurs tant de si douces
pensées, de si charmantes rêveries—les fleurs pleines d’un nectar qu’on
respire et qui enivre d’une ivresse calme et heureuse;—Dieu nous a
caché le ciel bleu—et les étoiles.
Les fleurs, qui exhalent avec leurs odeurs tant de si douces
pensées, de si charmantes rêveries—les fleurs pleines d’un nectar qu’on
respire et qui enivre d’une ivresse calme et heureuse;—Dieu nous a
caché le ciel bleu—et les étoiles.
![]() Dieu a mis un voile de nuages sur son soleil, et un voile de
tristesse sur nos cœurs.
Dieu a mis un voile de nuages sur son soleil, et un voile de
tristesse sur nos cœurs.
![]() Comme j’ai fait une triste litanie de toutes les fleurs qui
devaient fleurir dans le mois de mai—et qui se sont misérablement
entr’ouvertes—sur la terre boueuse.
Comme j’ai fait une triste litanie de toutes les fleurs qui
devaient fleurir dans le mois de mai—et qui se sont misérablement
entr’ouvertes—sur la terre boueuse.
Nous étions trop riches, à ce que disaient les journaux et les hommes politiques.
![]() Notre siècle, si fécond en progrès—selon eux, avait trop acquis et
trop gagné;—il avait toujours, selon eux, trop d’avantages sur les
siècles précédents.
Notre siècle, si fécond en progrès—selon eux, avait trop acquis et
trop gagné;—il avait toujours, selon eux, trop d’avantages sur les
siècles précédents.
Il avait trop de lumières et trop de grands hommes; il fallait expier tout cela.
![]() Il fallait, comme le tyran de Syracuse, jeter à la mer notre plus
belle bague;—le malheur est un usurier et un créancier intraitable.—Ce
que nous ne lui payons pas porte intérêt, et c’est un capital qui
s’accroît.
Il fallait, comme le tyran de Syracuse, jeter à la mer notre plus
belle bague;—le malheur est un usurier et un créancier intraitable.—Ce
que nous ne lui payons pas porte intérêt, et c’est un capital qui
s’accroît.
![]() O mon Dieu! parmi les bienfaits dont vous nous avez comblés dans
ces derniers temps,—n’auriez-vous pu nous reprendre autre chose que le
mois de mai?—Sans compter que voici le mois de juin, le mois des
roses,—qui commence par des pluies diluviennes.
O mon Dieu! parmi les bienfaits dont vous nous avez comblés dans
ces derniers temps,—n’auriez-vous pu nous reprendre autre chose que le
mois de mai?—Sans compter que voici le mois de juin, le mois des
roses,—qui commence par des pluies diluviennes.
![]() O mon Dieu! rendez-nous le mois de mai—et reprenez-nous en place
tout autre bienfait de la Providence—comme qui dirait, par exemple,—la
pondération des trois pouvoirs.
O mon Dieu! rendez-nous le mois de mai—et reprenez-nous en place
tout autre bienfait de la Providence—comme qui dirait, par exemple,—la
pondération des trois pouvoirs.
![]() Mon Dieu, rendez-nous le soleil—et reprenez-nous M. Ganneron.
Mon Dieu, rendez-nous le soleil—et reprenez-nous M. Ganneron.
![]() Rendez-nous les fleurs et reprenez les philanthropes qui ont
inventé le régime cellulaire et le mutisme dans les prisons.
Rendez-nous les fleurs et reprenez les philanthropes qui ont
inventé le régime cellulaire et le mutisme dans les prisons.
![]() Rendez-nous les parfums des fleurs, et reprenez-nous le jury avec
ses circonstances atténuantes.
Rendez-nous les parfums des fleurs, et reprenez-nous le jury avec
ses circonstances atténuantes.
![]() Mon Dieu, rendez-nous le muguet avec ses perles embaumées, et
reprenez-nous M. Chambolle.
Mon Dieu, rendez-nous le muguet avec ses perles embaumées, et
reprenez-nous M. Chambolle.
![]() Rendez-nous les pivoines, ces roses géantes,—dont la pluie a,
cette année, dispersé les pétales de pourpre,—et reprenez-nous les
pièces de théâtre de M. Empis, représentées par autorité de la liste
civile.
Rendez-nous les pivoines, ces roses géantes,—dont la pluie a,
cette année, dispersé les pétales de pourpre,—et reprenez-nous les
pièces de théâtre de M. Empis, représentées par autorité de la liste
civile.
![]() Rendez-nous les iris dont le vent a brisé les tiges et déchiré les
fleurs violettes, et reprenez-nous—M. Edmond Blanc,—cet intègre
administrateur.
Rendez-nous les iris dont le vent a brisé les tiges et déchiré les
fleurs violettes, et reprenez-nous—M. Edmond Blanc,—cet intègre
administrateur.
Rendez-nous notre mois de mai,—mon Dieu! Rendez-nous notre beau mois de mai,—et reprenez-nous quelques autres choses entre les plus précieuses que nous ayons.—Rendez-nous les glaïeuls aux fleurs roses et blanches, au port si gracieux, et reprenez-nous, si vous voulez, le dieu Cheneau avec son culte et ses boutons, avec son fil, ses aiguilles et son Évangile.
![]() Rendez-nous ces belles juliennes aux rameaux blancs si parfumés le
soir,—et reprenez-nous M. Cousin.
Rendez-nous ces belles juliennes aux rameaux blancs si parfumés le
soir,—et reprenez-nous M. Cousin.
![]() Rendez-nous nos beaux rhododendrons, et nos chèvrefeuilles;—et,
s’il faut une rançon,—reprenez-nous, mon Dieu! M. Dosne, le grand
financier dont la France est si fière.
Rendez-nous nos beaux rhododendrons, et nos chèvrefeuilles;—et,
s’il faut une rançon,—reprenez-nous, mon Dieu! M. Dosne, le grand
financier dont la France est si fière.
![]() Rendez-nous nos azalées—qui grimpent et tapissent les maisons dans
les romans de M. de Balzac,—mais qui, ici, se contentent de se charger
humblement, à trois pieds du sol,—de belles fleurs jaunes, rouges,
roses ou blanches,—et, reprenez-nous, mon Dieu! M. Dupin et ses
pasquinades sans courage.
Rendez-nous nos azalées—qui grimpent et tapissent les maisons dans
les romans de M. de Balzac,—mais qui, ici, se contentent de se charger
humblement, à trois pieds du sol,—de belles fleurs jaunes, rouges,
roses ou blanches,—et, reprenez-nous, mon Dieu! M. Dupin et ses
pasquinades sans courage.
![]() Rendez-nous, mon Dieu! les amours des oiseaux dans les feuilles—et
reprenez-nous le prêtre haineux,—si fort sur la mythologie des Persans,
si faible sur les devoirs et les croyances du christianisme.
Rendez-nous, mon Dieu! les amours des oiseaux dans les feuilles—et
reprenez-nous le prêtre haineux,—si fort sur la mythologie des Persans,
si faible sur les devoirs et les croyances du christianisme.
![]() Mon Dieu! rendez-nous nos seringats,—qui sont les orangers des
pauvres jardins, et reprenez-nous les bedeaux frénétiques et les
sacristains convulsionnaires qui rédigent le journal religieux
l’Univers.
Mon Dieu! rendez-nous nos seringats,—qui sont les orangers des
pauvres jardins, et reprenez-nous les bedeaux frénétiques et les
sacristains convulsionnaires qui rédigent le journal religieux
l’Univers.
![]() Mon Dieu! rendez-nous les digitales, les marguerites blanches et
les boutons d’or,—et reprenez toutes ces belles choses,—les
baïonnettes intelligentes, les fonctionnaires indépendants, les
monarchies entourées d’institutions républicaines, etc., etc.
Mon Dieu! rendez-nous les digitales, les marguerites blanches et
les boutons d’or,—et reprenez toutes ces belles choses,—les
baïonnettes intelligentes, les fonctionnaires indépendants, les
monarchies entourées d’institutions républicaines, etc., etc.
![]() Rendez-nous les beaux thyrses blancs des marronniers et les haies
d’aubépine,—et resserrez dans votre trésor M. Fulchiron, qui a
découvert le mousson—que, jusqu’à lui, on avait appelé la mousson.
Rendez-nous les beaux thyrses blancs des marronniers et les haies
d’aubépine,—et resserrez dans votre trésor M. Fulchiron, qui a
découvert le mousson—que, jusqu’à lui, on avait appelé la mousson.
![]() Rendez-nous les grappes d’or des ébéniers—et reprenez-nous M.
Partarrieu-Lafosse,—le malencontreux défenseur du roi Louis-Philippe
dans l’affaire dite des lettres attribuées au roi.
Rendez-nous les grappes d’or des ébéniers—et reprenez-nous M.
Partarrieu-Lafosse,—le malencontreux défenseur du roi Louis-Philippe
dans l’affaire dite des lettres attribuées au roi.
![]() Rendez-nous, mon Dieu!—les vers luisants dans l’herbe,—et
reprenez-nous M. Aimé Martin, qui ne luit nulle part, et a fait sur la
Rochefoucauld le beau commentaire dont les Guêpes ont fait une
appréciation convenable.
Rendez-nous, mon Dieu!—les vers luisants dans l’herbe,—et
reprenez-nous M. Aimé Martin, qui ne luit nulle part, et a fait sur la
Rochefoucauld le beau commentaire dont les Guêpes ont fait une
appréciation convenable.
![]() Je guettais avec tant d’anxiété et de joie—la première rose d’un
charmant rosier-noisette, qui me donne chaque année la première
fleur!—Eh bien, la pluie a détruit le bouton encore fermé. Que ne
donnerais-je pas des splendeurs de ce temps-ci—pour racheter ma pauvre
petite rose!
Je guettais avec tant d’anxiété et de joie—la première rose d’un
charmant rosier-noisette, qui me donne chaque année la première
fleur!—Eh bien, la pluie a détruit le bouton encore fermé. Que ne
donnerais-je pas des splendeurs de ce temps-ci—pour racheter ma pauvre
petite rose!
Rendez-nous, mon Dieu! les premières roses, les roses de mai,—et reprenez-nous les différents accapareurs de consonnes—que les journaux appellent de grands, célèbres, d’illustres pianistes,—et qui consentent à se faire entendre si souvent chaque hiver.
![]() Pour ma petite rose, mon Dieu!—je donnerais M. Delessert, cet
ingénieux préfet de police que vous savez;—je donnerais cette belle
galerie de bois que l’on a accrochée au flanc du Louvre!—je donnerais
les comédies de M. Bonjour—et l’institution de la garde nationale, et
les fortifications de Paris.—Je ne sais ce que je donnerais pour ma
petite rose.—Reprenez tout cela, mon Dieu!—et rendez-nous les roses
de mai.
Pour ma petite rose, mon Dieu!—je donnerais M. Delessert, cet
ingénieux préfet de police que vous savez;—je donnerais cette belle
galerie de bois que l’on a accrochée au flanc du Louvre!—je donnerais
les comédies de M. Bonjour—et l’institution de la garde nationale, et
les fortifications de Paris.—Je ne sais ce que je donnerais pour ma
petite rose.—Reprenez tout cela, mon Dieu!—et rendez-nous les roses
de mai.
Pourvu que vous ne nous supprimiez pas les roses de juin!
![]() Mon Dieu! rendez-nous le printemps,—rendez-nous le ciel bleu,—le
soleil,—les nuits parfumées et les étoiles.—Rendez-nous ces éternelles
magnificences,—et reprenez-nous les deux tiers au moins de nos grands
citoyens,—de nos illustres, de nos célèbres, etc., etc., etc.
Mon Dieu! rendez-nous le printemps,—rendez-nous le ciel bleu,—le
soleil,—les nuits parfumées et les étoiles.—Rendez-nous ces éternelles
magnificences,—et reprenez-nous les deux tiers au moins de nos grands
citoyens,—de nos illustres, de nos célèbres, etc., etc., etc.
![]() Les journaux font à l’envi depuis deux ans l’éloge le plus pompeux
des bonbons de Malte contre le mal de mer,—le mal de mer n’existe
plus.—M. Granier de Cassagnac—qui en a fait une peinture si
énergique,—qui en a tant souffert, et qui n’a eu que le tort d’affirmer
que les anciens n’en avaient jamais parlé,—à quoi les Guêpes en ce
temps-là—lui ont cité des passages de divers anciens qui s’en
plaignaient amèrement,—M. Cassagnac lui-même ne peut voyager impunément
sur mer.
Les journaux font à l’envi depuis deux ans l’éloge le plus pompeux
des bonbons de Malte contre le mal de mer,—le mal de mer n’existe
plus.—M. Granier de Cassagnac—qui en a fait une peinture si
énergique,—qui en a tant souffert, et qui n’a eu que le tort d’affirmer
que les anciens n’en avaient jamais parlé,—à quoi les Guêpes en ce
temps-là—lui ont cité des passages de divers anciens qui s’en
plaignaient amèrement,—M. Cassagnac lui-même ne peut voyager impunément
sur mer.
![]() Ton baume est merveilleux;—mais combien le vends-tu?
Ton baume est merveilleux;—mais combien le vends-tu?
Je ne le vends pas, je le donne, car c’est le donner que de ne vendre que trois francs des bonbons aussi miraculeux;—trois francs, messieurs—rien que trois francs! tous les journaux de tous les partis, de toutes les couleurs, sont unanimes sur ce point:—le mal de mer, que M. Granier de Cassagnac croit une découverte moderne comme l’imprimerie,—le mal de mer n’existe plus:—tous les journaux le disent en chœur tous les matins—comme des paysans ou des guerriers d’opéra-comique.—Plus de mal de mer! il faudrait n’avoir pas trois francs dans la poche pour avoir le mal de mer aujourd’hui:—ouvrez un journal au hasard,—ouvrez-les tous, vous les verrez tous dire—de leur plus grosse voix—c’est-à-dire en lettres d’un demi-pouce:—«PLUS DE MAL DE MER.»—Il n’y a plus que les pauvres diables, les gens de peu,—qui vomissent.
![]() Vous avez le mal de mer:—donc vous n’avez pas trois francs;—donc
vous êtes un va-nu-pieds.
Vous avez le mal de mer:—donc vous n’avez pas trois francs;—donc
vous êtes un va-nu-pieds.
Les hommes au-dessous de trois francs sont les seuls aujourd’hui qui aient le mal de mer. On ne vomit plus qu’aux secondes places—sur l’avant du bateau.
![]() Opinion de madame Ancelot sur une pièce de madame Ancelot.
Opinion de madame Ancelot sur une pièce de madame Ancelot.
«... Hermance ou un an trop tard,—drame ou comédie, car cet intéressant ouvrage participe de l’un et de l’autre genre.—Madame Ancelot s’y livre, avec la finesse d’observation et avec la grâce du style qui la distinguent, à la peinture vraie et animée de la société,—c’est une admirable investigation de tous les mystères de l’âme;—c’est, en un mot, un ouvrage de longue et haute portée, etc.
![]() Voilà bien des fois qu’on élève des plaintes sérieuses et légitimes
sur certaines façons des subordonnés de M. Greterin, directeur des
douanes, à l’endroit des voyageurs et surtout des voyageuses.
Voilà bien des fois qu’on élève des plaintes sérieuses et légitimes
sur certaines façons des subordonnés de M. Greterin, directeur des
douanes, à l’endroit des voyageurs et surtout des voyageuses.
On prétend que les femmes sont soumises, sur quelques points de la frontière, à des visites minutieuses sur leurs personnes—et... (je cherche des mots pour dire décemment ce que font les employés de M. Greterin) à ces plaintes, il a répondu froidement que ces visites sont faites par des femmes.
Il me paraît que M. Greterin ne considère la pudeur des femmes que comme une coquetterie—qui n’existe qu’à l’égard des hommes—et qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que des femmes portent les mains les plus hardies sur d’autres femmes.—M. Greterin se trompe: ces façons d’agir sont odieuses—et dignes d’un peuple sauvage.
![]() J’avais tort, dernièrement, et j’avais tort avec M. Arago, lorsque
pour la centième fois je parlais avec irrévérence de cette éducation
exclusivement littéraire donnée à tout un peuple, et de ces deux
langues, les deux seules qui ne se parlent pas.—Les plus forts
hellénistes ne comprennent pas un mot du grec moderne;—et le latin
d’église,—et le latin des savants, ne sont que deux variétés de cette
langue connue sous le nom de latin de cuisine.—J’avais tort quand je
demandais à quoi servait cette éducation.
J’avais tort, dernièrement, et j’avais tort avec M. Arago, lorsque
pour la centième fois je parlais avec irrévérence de cette éducation
exclusivement littéraire donnée à tout un peuple, et de ces deux
langues, les deux seules qui ne se parlent pas.—Les plus forts
hellénistes ne comprennent pas un mot du grec moderne;—et le latin
d’église,—et le latin des savants, ne sont que deux variétés de cette
langue connue sous le nom de latin de cuisine.—J’avais tort quand je
demandais à quoi servait cette éducation.
On écrit de Presbourg, à la date du 20 mai: «L’empereur a ouvert aujourd’hui la diète de Hongrie par un discours en latin.
»L’assemblée était très-nombreuse et très-brillante.—presque tous les ambassadeurs résidant à Vienne avaient suivi l’empereur à Presbourg pour assister à cette solennité.»
Cette étude du latin pendant huit ans, contre laquelle je me suis imprudemment élevé,—sous prétexte qu’aucun professeur,—pas même M. le ministre de l’instruction publique,—n’oserait affirmer qu’il y a huit hommes sur cent qui sachent le latin après l’avoir appris huit ans,—sous prétexte encore que pour les quatre-vingt-douze autres il ne servirait absolument à rien s’ils l’apprenaient;—cette étude de latin, je dois le reconnaître aujourd’hui, est utile pour une profession de quelque importance:—elle est indispensable pour être empereur d’Autriche.—Si la couronne d’Autriche venait à manquer d’héritiers,—on la donnerait pour prix d’une composition en thème, et elle reviendrait de droit—optimo—au plus fort en thème.
![]() J’ai d’abord failli ajouter que le latin était également utile pour
la profession d’ambassadeur.—Mais, après quelques instants de
réflexion, j’ai pensé qu’il faudrait connaître le discours de S. M.
l’empereur pour décider si les ambassadeurs résidant à Vienne se sont
plus ennuyés en ne comprenant pas ce que disait le prince—qu’ils ne se
seraient ennuyés en comprenant son discours.
J’ai d’abord failli ajouter que le latin était également utile pour
la profession d’ambassadeur.—Mais, après quelques instants de
réflexion, j’ai pensé qu’il faudrait connaître le discours de S. M.
l’empereur pour décider si les ambassadeurs résidant à Vienne se sont
plus ennuyés en ne comprenant pas ce que disait le prince—qu’ils ne se
seraient ennuyés en comprenant son discours.
Néanmoins, les ambassadeurs devaient faire une bonne figure,—à peu près celle que font aux distributions des prix aux concours de la Sorbonne—les parents des lauréats, qui écoutent attentivement le discours latin d’usage, dont ils ne comprennent pas un mot,—sourient ou balancent la tête aux beaux endroits et applaudissent à la fin.
![]() Comme l’autre jour j’entendais parler avec indignation de la liste
civile—et du peuple écrasé par elle,—je ne fus pas fâché de savoir à
quoi m’en tenir quant à moi,—et bien établir ce que me coûte le roi—et
si je suis écrasé.
Comme l’autre jour j’entendais parler avec indignation de la liste
civile—et du peuple écrasé par elle,—je ne fus pas fâché de savoir à
quoi m’en tenir quant à moi,—et bien établir ce que me coûte le roi—et
si je suis écrasé.
Parce que, dans le cas où je serais écrasé,—je joindrais naturellement ma voix aux cris qui se font entendre à ce sujet.
Or, voici mon compte exact avec le roi:—je paye mon trente-deux millionième des douze millions de sa liste civile, c’est-à-dire à peu près neuf sous par an.
D’autre part, comme abonné aux Guêpes, le roi me donne douze francs, sur lesquels,—après que j’ai payé—le papier, l’impression, le timbre, la poste, etc., etc., quand les libraires ont prélevé leur remise, etc., etc.,—il me revient pour ma part la somme de trois francs.
Le roi me coûte neuf sous par an et me donne trois francs,—c’est cinquante et un sous de bénéfice net pour moi.
Je ne puis, en conscience, joindre ma voix aux cris qui se font entendre à propos de la liste civile.
S’il est quelque chose dont on ait abusé de ce temps-ci, c’est sans contredit le peuple.
A entendre les gens,—tant ceux du pouvoir que ceux de l’opposition,—tant ceux qui ne veulent pas lâcher les places et l’argent que ceux qui voudraient s’en emparer,—rien ne se fait que pour le peuple.
Ces pauvres gens ne veulent rien pour eux,—ils n’ont besoin de rien, ils n’accepteraient rien;—s’ils font tant de bruit, tant d’intrigues, tant de lâchetés, tant d’infamies, tant de trahisons, tant de mensonges,—ne croyez pas qu’ils en espèrent tirer le moindre bénéfice;—vous ne les connaissez pas:—c’est pour le peuple.
Certes, on en doit croire sur parole tant d’honorables personnages,—et je ne m’aviserais pas d’aller éplucher leurs actions pour voir si elles sont en tout conformes à leurs paroles. Mais un hasard m’a cependant forcé de faire une observation.
Je lisais, en même temps que cinq ou six autres badauds,—l’affiche qui indique les prix du chemin de fer de Paris à Rouen, et je ne pus m’empêcher de remarquer—que—le prix des dernières places, fixé à dix francs, est déjà trop élevé, attendu qu’il est à peu près égal à celui que prenaient les messageries,—et supérieur à celui que prennent aujourd’hui certaines administrations;—de plus, les waggons affectés à ces dernières places ne partent qu’à certains voyages et pas à d’autres, et cela, je crois, dans la proportion de deux voyages sur six ou sept.
![]() Un assassin nommé Caffin vient d’être condamné par la cour
d’assises de la Seine;—mais, le jury ayant reconnu en sa faveur des
circonstances atténuantes, il n’a été condamné qu’aux travaux forcés.
Un assassin nommé Caffin vient d’être condamné par la cour
d’assises de la Seine;—mais, le jury ayant reconnu en sa faveur des
circonstances atténuantes, il n’a été condamné qu’aux travaux forcés.
Il serait à désirer que MM. les jurés trouvassent moyen d’appliquer également les circonstances atténuantes aux victimes aussi bien qu’aux assassins.
La peine de mort est supprimée à peu près généralement pour MM. les assassins, par l’omnipotence du jury.
J’ai déjà expliqué qu’il en devait être ainsi dans un temps où la justice criminelle est rendue en très-grande partie par des marchands.—Le vol est devenu le crime le plus grave de tous et est relativement puni aujourd’hui bien plus sévèrement en France que l’assassinat.
![]() C’est cependant le seul cas pour lequel il ne soit pas possible de
demander l’abolition de la peine de mort.
C’est cependant le seul cas pour lequel il ne soit pas possible de
demander l’abolition de la peine de mort.
En effet,—la loi, en fait de vol, ne se contente pas à beaucoup près de la peine du talion,—par exemple, de prendre sur les biens du voleur une somme égale à la somme dérobée par lui:—elle le frappe d’emprisonnement et de travaux forcés.
Mais, quand il s’agit d’assassinat,—il se trouve que le criminel, pris, convaincu, condamné,—trois chances que beaucoup évitent et qui sont les plus mauvaises qu’ils aient à redouter,—le criminel,—grâce aux circonstances atténuantes,—si fréquemment, disons plus, si généralement appliquées aujourd’hui, subit une peine beaucoup moindre que celle qu’il a infligée à sa victime innocente.
Beaucoup de gens, il est vrai, disent qu’ils aimeraient mieux la mort que le bagne, etc., etc.
C’est une phrase toute faite,—et on sait l’avantage des phrases faites;—la plupart des gens ne se font pas une opinion à eux, mais choisissent entre deux ou trois opinions des autres.
![]() Quoique beaucoup de ceux qui répètent cette phrase n’hésitassent
pas à changer d’avis s’il leur fallait sérieusement choisir entre le
bagne et l’échafaud,—je veux bien admettre que, pour eux, la mort
paraisse et soit préférable aux travaux forcés; mais je veux une fois
leur montrer la chose de son véritable point de vue,—qui n’est pas le
leur,—à beaucoup près.
Quoique beaucoup de ceux qui répètent cette phrase n’hésitassent
pas à changer d’avis s’il leur fallait sérieusement choisir entre le
bagne et l’échafaud,—je veux bien admettre que, pour eux, la mort
paraisse et soit préférable aux travaux forcés; mais je veux une fois
leur montrer la chose de son véritable point de vue,—qui n’est pas le
leur,—à beaucoup près.
Certes, pour vous, monsieur, issu d’une famille honorable, jouissant de la considération générale,—accoutumé aux manières d’une certaine société,—habitué à certaines aisances, à certaines délicatesses, plaçant non-seulement votre honneur, mais aussi votre crédit, c’est-à-dire le principal instrument de votre fortune,—dans votre réputation et dans l’estime que font de vous les honnêtes gens,—certes, ce serait cruel—d’être, par jugement public, condamné aux travaux forcés et affublé de la chemise rouge et du bonnet vert.
Mais telle n’est pas la chute que fait le condamné ordinaire.—Avant sa condamnation,—en général,—il avait déjà eu quelques démêlés avec la justice et fait au moins une légère connaissance avec les prisons.—Sa société se composait de voleurs et de bandits comme lui, qui n’accordent leur considération qu’aux voleurs et aux bandits plus habiles ou plus hardis qu’eux.
Pour ses habitudes d’existence, il couchait dans quelque horrible rue de la Cité, à deux sous la nuit, sur quelque grabat dont il n’avait que la moitié;—l’objet de ses amours était quelque courtisane du plus bas étage,—qui lui donnait sa part du revenu de sa prostitution—en échange d’une part dans ses vols; il était poursuivi, traqué par la police.
Il ne faut donc pas lui attribuer l’horreur morale que l’idée du bagne vous inspire.—Il ne faut voir que le changement arrivé dans sa condition physique.—Eh bien, au bagne, il est logé, habillé, nourri;—au bagne, il retrouve précisément la société qu’il choisissait lorsqu’il était libre;—au bagne, lui, qui n’a ni honte ni repentir, il a, assurés, les avantages que conquièrent péniblement le tiers au moins des ouvriers honnêtes,—et il travaille beaucoup moins qu’eux.
![]() Ceux qui sont à la tâche ont fini leur journée entre midi et une
heure;—il n’y a pas un ouvrier, quelle que soit sa profession, qui
puisse vivre en ne travaillant pas davantage;—passé cette heure, le
forçat dort, se repose—ou travaille à tous ces petits ouvrages dont
l’argent sert à lui acheter du tabac, du vin, de l’eau-de-vie—et à lui
former une masse qu’on lui remettra à l’expiration de sa peine.
Ceux qui sont à la tâche ont fini leur journée entre midi et une
heure;—il n’y a pas un ouvrier, quelle que soit sa profession, qui
puisse vivre en ne travaillant pas davantage;—passé cette heure, le
forçat dort, se repose—ou travaille à tous ces petits ouvrages dont
l’argent sert à lui acheter du tabac, du vin, de l’eau-de-vie—et à lui
former une masse qu’on lui remettra à l’expiration de sa peine.
![]() Ceux qui ne sont pas à la tâche passent les deux tiers de la
journée à regarder l’eau,—à causer entre eux,—à exécuter lentement et
mollement des travaux insignifiants.—Au commencement du mois de
mai,—comme je me trouvais à Brest, j’allai voir dans le port lancer une
frégate;—il y avait là une grande affluence de monde:—au premier rang,
parmi les spectateurs les mieux placés, étaient les forçats—assis sur
des bateaux ou sur le quai—et échangeant entre eux et avec les
gardes-chiourmes des plaisanteries qui n’étaient pas toujours du
meilleur goût.
Ceux qui ne sont pas à la tâche passent les deux tiers de la
journée à regarder l’eau,—à causer entre eux,—à exécuter lentement et
mollement des travaux insignifiants.—Au commencement du mois de
mai,—comme je me trouvais à Brest, j’allai voir dans le port lancer une
frégate;—il y avait là une grande affluence de monde:—au premier rang,
parmi les spectateurs les mieux placés, étaient les forçats—assis sur
des bateaux ou sur le quai—et échangeant entre eux et avec les
gardes-chiourmes des plaisanteries qui n’étaient pas toujours du
meilleur goût.
Personne ne travaillait;—je crus un moment qu’à cause de la fête on avait donné aux condamnés une sorte de relâche et de congé;—je le demandai à un garde-chiourme,—qui me répondit froidement que non,—sans me donner de raison de l’inaction de ces hommes, à laquelle sans doute il est accoutumé.
Du reste,—je ne connais rien de triste et de mort à l’égal du port de Brest;—tout y dort, tout y languit,—les travaux qui s’y exécutent sont conduits avec mollesse et lenteur;—un ouvrier passe la journée—et la moindre journée d’ouvrier est de trente-deux sous—à raboter un manche de gaffe,—qui coûte ainsi trente-deux sous de façon—et n’a, le bois compris, que six sous de valeur réelle.
![]() Le duc d’Aumale vient d’être très-brave et très-heureux en
Afrique;—il a envoyé à M. Bugeaud une relation de l’affaire dans
laquelle il a remporté, dit-on, des avantages très-importants.—Cette
relation publiée n’a pu éviter la critique.—On lui a reproché un peu
d’emphase.—Certes, l’emphase était permise à un jeune homme qui ne dit
pas un mot de lui et ne parle que de ses compagnons d’armes.—Mais un
pareil reproche sied bien aux journaux—de trouver qu’on parle avec
emphase d’un combat livré avec une audace qui, sans le succès, aurait
été de la témérité,—d’une victoire disputée avec acharnement,
Le duc d’Aumale vient d’être très-brave et très-heureux en
Afrique;—il a envoyé à M. Bugeaud une relation de l’affaire dans
laquelle il a remporté, dit-on, des avantages très-importants.—Cette
relation publiée n’a pu éviter la critique.—On lui a reproché un peu
d’emphase.—Certes, l’emphase était permise à un jeune homme qui ne dit
pas un mot de lui et ne parle que de ses compagnons d’armes.—Mais un
pareil reproche sied bien aux journaux—de trouver qu’on parle avec
emphase d’un combat livré avec une audace qui, sans le succès, aurait
été de la témérité,—d’une victoire disputée avec acharnement,
![]() Quand eux ne publient pas un numéro sans pousser au delà des
limites du ridicule la plus monstrueuse hyperbole—pour leurs amis et
leurs alliés pendant trois pages,—pour ceux qui les payent, tout le
long et tout le large de la quatrième.
Quand eux ne publient pas un numéro sans pousser au delà des
limites du ridicule la plus monstrueuse hyperbole—pour leurs amis et
leurs alliés pendant trois pages,—pour ceux qui les payent, tout le
long et tout le large de la quatrième.
Qu’un député,—aussi innocent que vous voudrez le supposer, ait prononcé un oh! oh! ou un ah! ah!—favorable à la cause que plaide un journal,—ou ait toussé pendant qu’un député d’un parti contraire était à la tribune, les noms de grand citoyen, de courageux défenseur des libertés publiques, ne sont bientôt plus assez bons pour lui.
![]() Que n’importe quel écrivain spécialement chargé de découper les
faits Paris dans les autres journaux,—et d’y ajouter, selon la
couleur du journal, ou: «On peut voir ici la mauvaise foi de
l’opposition,—ou: «Que répondront à de pareils faits les soutiens
honteux du ministère?»—que ce publiciste s’avise de publier un recueil
de vers saugrenus,—il passe à l’état de grand poëte et de gloire de la
littérature contemporaine.
Que n’importe quel écrivain spécialement chargé de découper les
faits Paris dans les autres journaux,—et d’y ajouter, selon la
couleur du journal, ou: «On peut voir ici la mauvaise foi de
l’opposition,—ou: «Que répondront à de pareils faits les soutiens
honteux du ministère?»—que ce publiciste s’avise de publier un recueil
de vers saugrenus,—il passe à l’état de grand poëte et de gloire de la
littérature contemporaine.
![]() Qu’un mauvais musicien,—portant les cheveux d’une façon destinée à
renverser le gouvernement, tape pendant deux heures sur un mauvais
piano,—dans quelque bouge, devant trente personnes assourdies, «l’élite
de la société parisienne assistait à cette solennité;—la belle salle de
M. M *** ne pouvait contenir la foule accourue pour admirer notre
grand pianiste n’importe qui, etc.»—Et à la quatrième page: «S’il est
une renommée légitime et bien acquise, c’est celle d’un tel, giletier.»
Qu’un mauvais musicien,—portant les cheveux d’une façon destinée à
renverser le gouvernement, tape pendant deux heures sur un mauvais
piano,—dans quelque bouge, devant trente personnes assourdies, «l’élite
de la société parisienne assistait à cette solennité;—la belle salle de
M. M *** ne pouvait contenir la foule accourue pour admirer notre
grand pianiste n’importe qui, etc.»—Et à la quatrième page: «S’il est
une renommée légitime et bien acquise, c’est celle d’un tel, giletier.»
![]() «La science n’avait jamais fait une découverte aussi précieuse que
celle de la pommade de n’importe quoi, qui empêche les cheveux de
tomber.»
«La science n’avait jamais fait une découverte aussi précieuse que
celle de la pommade de n’importe quoi, qui empêche les cheveux de
tomber.»
![]() Il n’est pas de meuble bizarre, de bonbon honteux, de pâte
suspecte,—qui ne rencontre là des éloges poussés jusqu’à la
frénésie,—sans oublier les formules qui ne permettent pas de croire que
c’est le marchand qui parle lui-même:
Il n’est pas de meuble bizarre, de bonbon honteux, de pâte
suspecte,—qui ne rencontre là des éloges poussés jusqu’à la
frénésie,—sans oublier les formules qui ne permettent pas de croire que
c’est le marchand qui parle lui-même:
«Nous ne saurions trop recommander à nos abonnés;—Nous nous faisons un devoir d’indiquer...»
Et ces vertueux carrés de papier parlent d’emphase!
![]() DE LA LIBERTÉ DES CULTES EN FRANCE.—Exemple: Il a été défendu
aux habitants de Senneville de se réunir pour célébrer leur religion,
qui est le culte protestant,—ils ont objecté que la charte établissait
la liberté des cultes,—on leur a répondu par l’article 291 du Code
pénal et la loi de 1834 sur les associations.
DE LA LIBERTÉ DES CULTES EN FRANCE.—Exemple: Il a été défendu
aux habitants de Senneville de se réunir pour célébrer leur religion,
qui est le culte protestant,—ils ont objecté que la charte établissait
la liberté des cultes,—on leur a répondu par l’article 291 du Code
pénal et la loi de 1834 sur les associations.
C’est-à-dire—que les cultes sont libres—pourvu qu’ils n’entraînent pas une réunion de plus de vingt personnes,—ce qui ne peut guère s’appliquer qu’aux petites religions dans le genre de celle du dieu Cheneau, qui n’a encore pour disciples que ses deux commis et sa femme de ménage, et qui refuse jusqu’ici, même dans les brochures dont il m’a accablé, de me dire si son associé—P. Jouin—est ou non son codieu.
![]() J’avais cru jusqu’ici que la police n’avait pour but que de prêter
force et appui à l’exécution des lois,—et que les ordonnances qui lui
sont spécialement relatives ne devaient en conséquence jamais la faire
agir à l’encontre desdites lois.
J’avais cru jusqu’ici que la police n’avait pour but que de prêter
force et appui à l’exécution des lois,—et que les ordonnances qui lui
sont spécialement relatives ne devaient en conséquence jamais la faire
agir à l’encontre desdites lois.
Une ordonnance de police défend les associations et les rassemblements de plus de vingt personnes sans une autorisation spéciale;—mais la loi qui a établi le libre exercice des cultes doit être respectée par la police.
La cour de cassation, qui, dans une circonstance parfaitement identique, avait jugé que les associations pour l’exercice d’un culte autorisé par l’État—n’étaient pas sous le coup de l’article 291,—déclare aujourd’hui précisément le contraire.
![]() Dans ce même numéro où je viens d’écrire quelques mots en faveur de
la liberté des cultes, je crois devoir dire également que les cultes
autrefois persécutés,—puis tolérés,—puis autorisés,—ne doivent pas se
faire persécuteurs et intolérants.
Dans ce même numéro où je viens d’écrire quelques mots en faveur de
la liberté des cultes, je crois devoir dire également que les cultes
autrefois persécutés,—puis tolérés,—puis autorisés,—ne doivent pas se
faire persécuteurs et intolérants.
Le culte juif, par exemple, me paraît aller trop vite dans la réaction. Est-il de bon goût que M. Fould donne par dérision à ses chevaux des noms qui sont une moquerie—et une insulte pour les chrétiens et pour le culte catholique?
M. Fould a dans ses écuries: Contrition, Repentir, Péché-mortel.
La rançon acceptée.—Une nouvelle fleur.—Suppression de l’homme. Les défenseurs de la veuve et de l’orphelin.—Jugement de Salomon.—Une conspiration.—Le Napoléon—Les anciens et les modernes.—MM. Ponsard, Hugo, Dumas, etc.—Lucrèce.—M. Odilon Barrot.—Les oiseaux sinistres.—M. Villemain.—Honneurs clandestins.—Trouville.—Une annonce.—Les circonstances atténuantes.—Le dieu Cheneau.—Une invitation.
![]() JUILLET.—Tout va un peu mieux que je ne l’avais espéré:—le soleil
est venu rendre à tout la vie, la joie et la lumière,—mon jardin est
plein de parfums et de fleurs. Il paraît que le ciel a accepté la rançon
de l’été que je lui avais offerte au nom de la France, et que les beaux
jours nous sont rendus.
JUILLET.—Tout va un peu mieux que je ne l’avais espéré:—le soleil
est venu rendre à tout la vie, la joie et la lumière,—mon jardin est
plein de parfums et de fleurs. Il paraît que le ciel a accepté la rançon
de l’été que je lui avais offerte au nom de la France, et que les beaux
jours nous sont rendus.
Et, pour tout dire, nous n’avons rien perdu pour attendre—non-seulement nous avons vu fleurir toutes les fleurs aimées,—mais une nouvelle fleur s’est épanouie au bas du journal le National.—M. Rolle s’est livré à une comparaison entre la pâquerette et le camellia: «Tantôt, dit-il, le camellia l’emporte par son parfum enivrant, tantôt la pâquerette par son odeur innocente et champêtre.»
![]() Le camellia à odeur enivrante de M. Rolle, espèce jusqu’ici
inconnue, manque à la collection des fleurs fantastiques de M. de
Balzac,—le camellia à odeur enivrante est le digne pendant de
l’azalée grimpante de l’auteur de la Petite Revue parisienne.
Le camellia à odeur enivrante de M. Rolle, espèce jusqu’ici
inconnue, manque à la collection des fleurs fantastiques de M. de
Balzac,—le camellia à odeur enivrante est le digne pendant de
l’azalée grimpante de l’auteur de la Petite Revue parisienne.
![]() Est-ce que par hasard les temps prédits par les poëtes seraient
arrivés?
Est-ce que par hasard les temps prédits par les poëtes seraient
arrivés?
Virgile, dans l’églogue adressée à Pollion—sur la naissance de son fils: «Des chênes, dit-il, il coulera du miel,—on verra dans les prairies des moutons rouges et des moutons jaunes.
Nous avons déjà—le camellia à odeur enivrante de M. Rolle et l’azalée grimpante de M. de Balzac,—nous en verrons bien d’autres.
![]() Quand je disais dernièrement que, les chevaux abolis,—on allait
bientôt s’occuper de supprimer l’homme et de le remplacer par des
machines, je ne sais si j’étais prophète ou si j’ai ouvert une idée à
quelqu’un.
Quand je disais dernièrement que, les chevaux abolis,—on allait
bientôt s’occuper de supprimer l’homme et de le remplacer par des
machines, je ne sais si j’étais prophète ou si j’ai ouvert une idée à
quelqu’un.
Toujours est-il que je vois depuis quelques jours dans tous les journaux une annonce ainsi conçue:
LE COMPTEUR MÉCANIQUE,—adopté par tous les ministères,—au moyen duquel on peut faire tous les calculs possibles sans le secours de la plume ni de l’intelligence.
Voici les employés des ministères remplacés déjà par une mécanique simple et peu coûteuse.
Je ne désespère pas de voir, d’ici à peu de temps, tout le gouvernement représentatif—fonctionner au moyen d’une seule et unique machine,—surtout si l’on accepte définitivement le principe de M. Thiers, si bien adopté par une partie de la Chambre et par une partie des journaux: «Le roi règne et ne gouverne pas.»—Ce ne sera certes pas le roi qui embarrassera beaucoup le mécanicien.
![]() Je ne sais vraiment pas comment on est assez hardi en France pour
ne pas être de l’opposition.
Je ne sais vraiment pas comment on est assez hardi en France pour
ne pas être de l’opposition.
L’opposition accepte tous ceux qui se donnent à elle, les prône, les loue, les pousse autant qu’elle peut.—Il s’agit pour elle de combattre et de conquérir:—elle veut des soldats; ceux qui n’ont pas une grande valeur, elle tâche de leur en donner une.
Les conservateurs, au contraire, possèdent;—ceux qui se donnent ou se sont donnés à eux leur semblent des associés qui veulent partager les dividendes.
De sorte que ceux qui s’allient aux conservateurs—reçoivent à la fois les injures de l’opposition et les mauvais procédés de leurs amis.
![]() Les Guêpes se félicitent de se trouver si parfaitement d’accord
avec M. de Kératry,—dans le fond et dans la forme de la pensée.
Les Guêpes se félicitent de se trouver si parfaitement d’accord
avec M. de Kératry,—dans le fond et dans la forme de la pensée.
Les Guêpes ont dit, il y a deux ou trois ans,—à propos de la prétention qu’ont les avocats d’être les défenseurs de la veuve et de l’orphelin:
«Il n’y aurait pas besoin d’avocats pour défendre la veuve et l’orphelin, s’il n’y avait pas d’abord d’avocats qui les attaquent.»
M. de Kératry a dit ces jours passés dans la Presse:
«Je suis tenté de sourire de pitié quand ces messieurs s’arrogent fastueusement le titre de défenseurs de la veuve et de l’orphelin, qui pourraient se dispenser de recourir à cette tutelle parfois assez onéreuse, si d’autres avocats, pour un même salaire, n’avaient auparavant fait irruption dans le champ de cette même veuve et de ce même orphelin.»
![]() Voici encore un fait analogue à un que j’ai cité il y a quelques
mois:—J. Boulard, rencontré par trois hommes ivres, est attaqué et
rudement battu,—par suite de quoi il passe cinq jours au lit et dépose
une plainte contre ses agresseurs;—ceux-ci, amenés devant le tribunal,
ne nient pas le fait et cherchent à s’excuser en rejetant leurs torts
sur le vin.—Le tribunal, usant d’indulgence,—écarte la prison et les
condamne chacun à cent francs d’amende.
Voici encore un fait analogue à un que j’ai cité il y a quelques
mois:—J. Boulard, rencontré par trois hommes ivres, est attaqué et
rudement battu,—par suite de quoi il passe cinq jours au lit et dépose
une plainte contre ses agresseurs;—ceux-ci, amenés devant le tribunal,
ne nient pas le fait et cherchent à s’excuser en rejetant leurs torts
sur le vin.—Le tribunal, usant d’indulgence,—écarte la prison et les
condamne chacun à cent francs d’amende.
—Au profit de J. Boulard, sans doute?
—Non,—au profit du trésor,—au profit du gouvernement,—faible consolation encore pour un gouvernement vraiment paternel qui a eu la douleur de voir battre ainsi brutalement un de ses enfants dans la personne de Jean Boulard.
![]() Il était question depuis quelque temps d’une grande fête
chevaleresque et d’un magnifique tournoi qui devaient avoir lieu dans le
Champ de Mars.—M. le préfet de police a refusé son autorisation;—nous
nous permettrons de trouver que cette mesure de M. Delessert n’est pas
adroite.—Les gouvernements ne peuvent que gagner à ce que le peuple
s’amuse,—surtout,—comme dit l’héroïne de je ne sais quelle chanson
bouffone,—surtout quand il n’en coûte rien.
Il était question depuis quelque temps d’une grande fête
chevaleresque et d’un magnifique tournoi qui devaient avoir lieu dans le
Champ de Mars.—M. le préfet de police a refusé son autorisation;—nous
nous permettrons de trouver que cette mesure de M. Delessert n’est pas
adroite.—Les gouvernements ne peuvent que gagner à ce que le peuple
s’amuse,—surtout,—comme dit l’héroïne de je ne sais quelle chanson
bouffone,—surtout quand il n’en coûte rien.
A moins que M. le préfet,—jaloux de ses droits, ne veuille contribuer seul et exclusivement aux plaisirs et à l’amusement des Parisiens.
On raconte cependant que M. Delessert avait été, dans cette circonstance, victime d’une mystification.
On aurait fait croire ce qui suit à M. le préfet de police:
![]() Ce tournoi, où des chevaliers armés de toutes pièces devaient
jouter devant les dames,—selon les us et coutumes de l’ancien
temps,—cachait des desseins plus sérieux.—Un chevalier mystérieux
devait être au nombre des tenants,—vêtu d’une cotte de mailles et la
visière sévèrement baissée, absolument comme Richard Cœur-de-Lion
dans l’Ivanhoé de Walter Scott.—Sur son bouclier aurait été écrite la
devise—Déshérité.
Ce tournoi, où des chevaliers armés de toutes pièces devaient
jouter devant les dames,—selon les us et coutumes de l’ancien
temps,—cachait des desseins plus sérieux.—Un chevalier mystérieux
devait être au nombre des tenants,—vêtu d’une cotte de mailles et la
visière sévèrement baissée, absolument comme Richard Cœur-de-Lion
dans l’Ivanhoé de Walter Scott.—Sur son bouclier aurait été écrite la
devise—Déshérité.
Après que le jeune prince aurait eu vaincu tous les champions qui se seraient exposés à ses coups redoutables, tous, par un coup de théâtre, se rangeant sous ses ordres, il aurait levé la visière de son casque, et laissé voir aux spectateurs assemblés le duc de Bordeaux.
Alors, à la tête de ses fidèles chevaliers, il se serait porté sur le château des Tuileries,—en essayant de soulever le peuple.
C’est ce que, assure-t-on, on a fait croire à M. Delessert.
![]() La mer commençait à remonter;—le soleil couchant colorait de
teintes rouges et violettes le sable humide de la plage;—la mer unie et
calme,—blanchie seulement sur ses bords par la marée
montante,—semblait un grand manteau couleur d’aigue-marine avec une
frange d’argent,—mais que signifient de pareilles comparaisons?—A quoi
comparer la mer qui ne soit plus petit et moins beau qu’elle?—Elle
était d’un bleu pâle et verdâtre,—du soleil à mes yeux, s’étendait sur
l’eau un large sillon d’un jaune lumineux.
La mer commençait à remonter;—le soleil couchant colorait de
teintes rouges et violettes le sable humide de la plage;—la mer unie et
calme,—blanchie seulement sur ses bords par la marée
montante,—semblait un grand manteau couleur d’aigue-marine avec une
frange d’argent,—mais que signifient de pareilles comparaisons?—A quoi
comparer la mer qui ne soit plus petit et moins beau qu’elle?—Elle
était d’un bleu pâle et verdâtre,—du soleil à mes yeux, s’étendait sur
l’eau un large sillon d’un jaune lumineux.
Le ciel,—au couchant,—entre des bandes de nuages, était du vert de certaines turquoises,—les falaises se découpaient en noir sur la mer et sur l’horizon.
Tout à coup,—au détour de la hève,—parut un bâtiment d’une forme noble et majestueuse:—c’était le Napoléon, qui revenait au Havre.
Le Napoléon,—c’est-à-dire le bateau à vapeur à hélice,—le bateau à vapeur sans ces roues incommodes qui ont rendu jusqu’ici les bâtiments à vapeur impropres à la guerre;—le bateau à vapeur—qui marche à la voile, quand le vent lui est favorable, aussi vite qu’un autre navire, et qui continue sa marche avec son charbon et ses hélices sans se ralentir quand le vent devient contraire,—en un mot, la réalisation d’un problème longtemps nié et traité d’absurdité et de folie.
On lisait le lendemain dans plusieurs journaux:
«Le bateau à vapeur, nouveau modèle, le Napoléon, construit au Havre, pour le compte de l’État, par M. Normand, est arrivé du Havre à Cherbourg mercredi 21, dans l’après-midi, pour éprouver sa marche et ses machines; il a fait ce trajet en sept heures. On sait que c’est le premier bâtiment français auquel est appliqué le nouveau système de propulsion consistant en une vis ou hélice mue par la vapeur, et qui, placée à l’arrière et immergée, tourne dans l’eau avec une vitesse considérable, de manière à faire filer au navire dix à onze nœuds en temps favorable. La force de cette hélice équivaut à un appareil ordinaire de cent vingt chevaux.
»Il y avait à bord du Napoléon, pour constater le résultat des expériences, une commission présidée par M. Conte, directeur général des postes, et composée de MM. de la Gatinerie, chef du service de la marine au Havre; Moissard, ingénieur des constructions navales et agent général du service des paquebots de la Méditerranée; Allix, sous-ingénieur; Bellanger, capitaine de corvette; Normand, constructeur, et Conte fils, secrétaire.
»Le bâtiment a parcouru trois fois notre rade dans toute sa longueur. MM. l’amiral préfet maritime, le sous-préfet de l’arrondissement, les chefs de service du port, les ingénieurs des constructions navales, et plusieurs officiers de la marine militaire et administrative, ont assisté à ces essais. Le sillage a été de onze nœuds. Cette grande vitesse témoigne assurément en faveur du nouveau propulseur.
»Le steamer le Napoléon, après avoir touché à Cherbourg et y avoir pris quelques pièces d’artillerie, s’est rendu devant Portsmouth et Southampton, où il a salué les forts. Ses saluts lui ont été rendus, et, après avoir fait l’admiration des nombreux visiteurs qu’il a reçus à son bord, il devait retourner au Havre, où il est attendu ce soir.»
Il y avait un homme qui n’était pas sur le Napoléon,—un homme qui n’avait pas été admis à prendre sa part de cette promenade triomphale,—un homme que les journaux ne nomment pas.
Cet homme était tout simplement Sauvage, l’inventeur des hélices;—Sauvage, qui, depuis treize ans, travaille et lutte: [mot illisible] deux ans, d’abord, pour trouver et appliquer son hélice; ensuite, onze ans contre l’incrédulité, l’envie et la malveillance.
C’était Sauvage,—l’homme qui, depuis treize ans, a dépensé tout l’argent qu’il avait,—toute la santé qu’il avait,—pour arriver à son but.
D’abord, en construisant le Napoléon, on avait essayé, à grands frais, de perfectionner l’hélice de Sauvage,—perfectionner, c’est-à-dire dépouiller l’inventeur;—c’est-à-dire faire en sorte—que son brevet, qui n’a plus que quelques années à courir,—ne lui eût rapporté que la ruine et les avanies de toutes sortes,—tandis que le triomphe et l’argent seraient pour d’autres.
De perfectionnements en perfectionnements—on en est arrivé précisément au point de départ, c’est-à-dire à l’hélice de Sauvage,—à l’hélice du Napoléon.
J’eus en ce moment une des impressions les plus tristes que j’aie ressenties de ma vie.
Je savais que Sauvage—était enfermé dans la prison du Havre pour une misérable dette, contractée, sans doute, pour l’hélice, alors niée et aujourd’hui triomphante.
On regardait avec fierté rentrer le Napoléon,—et personne, excepté moi, peut-être, ne pensait à l’inventeur.
Le lendemain, les journaux disaient ce que je viens de copier plus haut.
J’allai voir Sauvage dans sa prison;—il s’était parfaitement installé,—seulement, comme il étouffe dans une chambre fermée,—il laissait ouverte, la nuit, la fenêtre de sa cellule;—mais les chiens de la prison—aboyaient avec fureur contre cette fenêtre ouverte et troublaient le repos de tous les prisonniers.—On lui enjoignit de fermer sa fenêtre: il essaya d’obéir, mais en vain, à chaque instant, se sentant suffoqué,—il se levait, ouvrait sa fenêtre, et les molosses recommençaient leur vacarme.
Il prit un couteau et un morceau de bois,—et fit une machine qui, lançant de très-loin aux chiens de l’eau et des boulettes de terre, les obligea à se réfugier dans leur niche et les réduisit au silence.—Il était heureux comme un roi de ce triomphe.
![]() Depuis qu’il est en prison,—il joue du violon,—et il met de côté
les cordes qui se cassent—pour en faire toutes sortes de machines
ingénieuses.—Je trouvai sur sa fenêtre un bassin fait par lui avec une
feuille de zinc.—Dans ce bassin était un bateau construit avec un
couteau. Il avait trouvé tout simplement un moyen de diminuer et de
réduire à presque rien le poids d’un bâtiment à remorquer.
Depuis qu’il est en prison,—il joue du violon,—et il met de côté
les cordes qui se cassent—pour en faire toutes sortes de machines
ingénieuses.—Je trouvai sur sa fenêtre un bassin fait par lui avec une
feuille de zinc.—Dans ce bassin était un bateau construit avec un
couteau. Il avait trouvé tout simplement un moyen de diminuer et de
réduire à presque rien le poids d’un bâtiment à remorquer.
Sur des bouteilles—était un modèle d’hélices appliquées à l’air pour faire un moulin;—l’une était en papier noirci; l’autre était formée avec les plumes d’oiseaux qu’il avait attrapés sur le toit de la prison.
Et je le trouvai là ne se plaignant que d’une chose,—que le Napoléon—ne répondît pas encore à ses espérances et à ce qu’il veut de son hélice.
Quoi! M. Conte est venu au Havre et a monté le bateau à hélice, et il n’a pas demandé où était l’inventeur de l’hélice!
Quoi! il ne s’est trouvé personne parmi tous ces hommes riches qui étaient fiers d’aller montrer aux Anglais cette invention française, qui allât demander à Sauvage la permission de lui prêter la somme nécessaire pour sa mise en liberté!—Quoi! le ministre de la marine,—quoi! le roi de France,—le laissent en prison depuis deux mois!
Est-ce donc ainsi qu’on récompense, en France, le génie et le dévouement à une idée féconde?
C’est une tache pour un pays,—c’est une tache pour une époque,—c’est une tache pour un règne.
![]() Lorsque Molière, Boileau, Racine, Corneille écrivaient,—on les
comparait à Térence, à Juvénal, à Euripide et à Sophocle;—puis on
établissait clair comme le jour—qu’on n’avait jamais eu de bon sens
qu’en grec,—que toutes les idées grandes et nobles avaient été
exprimées en latin;—que, depuis la mort des auteurs anciens, le genre
humain était complètement idiot,—qu’il était incapable, désormais, de
faire une phrase de son cru—et que la seule chose qu’il pût essayer
était, à l’avenir, de traduire, de copier, d’imiter—les anciens.
Lorsque Molière, Boileau, Racine, Corneille écrivaient,—on les
comparait à Térence, à Juvénal, à Euripide et à Sophocle;—puis on
établissait clair comme le jour—qu’on n’avait jamais eu de bon sens
qu’en grec,—que toutes les idées grandes et nobles avaient été
exprimées en latin;—que, depuis la mort des auteurs anciens, le genre
humain était complètement idiot,—qu’il était incapable, désormais, de
faire une phrase de son cru—et que la seule chose qu’il pût essayer
était, à l’avenir, de traduire, de copier, d’imiter—les anciens.
Non pas que cette décadence eût été annoncée par quelque prodige;—le soleil continuait à faire épanouir les fleurs,—à mûrir les fruits des arbres;—l’intelligence humaine était seule arrêtée dans sa séve—et ne produisait plus que des fleurs pâles et sans parfum, des fruits âpres ou sans saveur.
Sous certains rapports, cependant,—on avait moins de modestie;—en effet, on essayait bien parfois de rabaisser un peintre, en le comparant à Apelles;—d’écraser un sculpteur avec Praxitèle,—mais cette tentative ne réussissait que médiocrement.
On racontait bien des prodiges—de la flûte de roseaux de Marsyas, de l’écaille de tortue à trois cordes (testudo), qui servait de lyre à Orphée;
Des brins d’avoine (avena) et des tiges de ciguë (cicuta) sur lesquels les anciens faisaient de si belle musique.
Mais cela n’avait que peu de succès,—les violons d’alors ne s’en inquiétaient pas plus que les pianistes d’aujourd’hui; on se croyait en progrès pour la musique;
Et ainsi pour l’art militaire,—et ainsi pour l’industrie et ainsi pour les sciences.
Mais pour la poésie,—pour la littérature,—les modernes (Racine, Molière, Corneille) n’étaient que tout au plus dignes d’imiter les anciens,—ou d’expliquer leurs beautés.
Racine,—Molière,—Boileau,—Corneille, sont morts,—ils ont passé à l’état d’anciens,—c’est-à-dire d’hommes qui ne prennent pas de part de soleil, de gloire, ni d’argent;—ils servent aujourd’hui—précisément à ce que servaient contre eux les anciens.
L’admiration exclamée pour les morts—n’est qu’un déguisement ordinaire de la haine pour les vivants.
Un autre procédé qu’emploie quelquefois l’envie,—mais dont elle use sobrement à cause qu’il est dangereux,—consiste à prendre un inconnu et à l’élever contre ceux dont l’éclat l’offusque et l’irrite.
Le succès de M. Ponsard et de sa Lucrèce—a été fait beaucoup moins pour lui que contre MM. Hugo, Dumas, etc.
Le procédé, comme je le disais, était dangereux—parce que M. Ponsard a du talent.
Aussi l’envie a-t-elle d’avance attaché des cordes à son idole pour abattre plus tard la statue qu’elle était forcée d’élever.
On n’a pas fait le succès de M. Ponsard seulement avec son talent;—pas si imprudente! l’envie veut bien détruire quelqu’un, et pour cela rien ne lui coûte, même de donner des louanges à un autre;—mais son instrument d’aujourd’hui deviendra plus tard son ennemi, si, vu la gravité des circonstances,—elle s’est crue forcée de se servir d’un homme de quelque valeur, ce qu’elle évite dans les cas ordinaires.—Les plus grands apologistes de la nouvelle Lucrèce—ont donc attribué une partie du succès au choix du sujet, aux sentiments vertueux, à l’imitation religieuse de Corneille;—de sorte que plus tard,—si M. Ponsard s’avise de vouloir prendre tout de bon la place à laquelle on l’élève aujourd’hui, on saura bien l’abattre au moyen de ses réserves prudentes.
![]() Je respecte tous les bonheurs;—je fais un détour dans la rue pour
ne pas déranger les enfants qui jouent aux billes;—dans la campagne,
pour ne pas effaroucher un oiseau qui a trouvé deux grains de chènevis.
Je respecte tous les bonheurs;—je fais un détour dans la rue pour
ne pas déranger les enfants qui jouent aux billes;—dans la campagne,
pour ne pas effaroucher un oiseau qui a trouvé deux grains de chènevis.
C’est pourquoi j’ai hésité à dire ce que je pense de la pièce de M. Ponsard.—Les hommes de talent se découragent facilement et on doit les flatter.—Les ravissantes choses qu’ils ont conçues,—les rêves brillants de leur imagination—sont toujours une critique assez terrible de ce qu’ils ont écrit—pour qu’on puisse sans grand danger leur en épargner d’autre;—ils savent assez—et ils sentent avec désespoir—combien l’exécution d’une œuvre d’imagination reste au-dessous de sa conception.
Telle une femme, après avoir conçu dans des extases célestes, enfante avec douleur un enfant quelquefois assez laid;—et certes je me serais tu, si l’on avait simplement proclamé M. Ponsard un des hommes de talent de ce temps-ci.
Mais, loin de là, on a voulu dresser au nouveau venu une statue faite des débris des statues brisées des dieux contemporains,—au lieu de la lui tailler simplement dans un bloc neuf.
Je dirai donc ce qu’il me semble de la Lucrèce de M. Ponsard.
La pièce manque totalement d’intérêt;—l’histoire de Lucrèce, trop de fois prodiguée en thème à notre jeunesse, ne permet ni craintes ni hésitations;—on sait parfaitement comment cela finira en prenant son billet au bureau.
Je ne ferai pas à l’auteur une grande chicane sur ce défaut, qui appartient à son sujet;—mais n’a-t-il pas contribué lui-même à perdre les chances d’intérêt qui pouvaient rester à sa pièce—en mettant les principaux personnages et le public dans la confidence de la feinte folie de Brutus?—n’a-t-il pas renoncé volontairement à l’effet qu’eut produit cette révélation, si,—la sibylle la faisant seulement soupçonner quand elle lui dit:
elle n’avait lieu qu’à la dernière scène?
Pour ce qui est du style,—je ne déteste pas ces latinismes que l’on a trop reprochés à l’auteur;—cela a une force et une grâce particulières.—Le vers de M. Ponsard, un peu traînant, a néanmoins une sorte de noblesse et d’élégance bourgeoise qui ne s’élèvent pas au-dessus d’un certain degré, mais qui ne descendent pas non plus au-dessous.—Le sens est généralement clair.—Quelques pensées, les unes spirituelles, les autres raisonnables et nettement exprimées,—m’ont, avec quelques autres indices, laissé l’impression que, si la pièce de M. Ponsard est loin de mériter l’enthousiasme dont elle a été l’objet,—M. Ponsard a beaucoup plus de talent qu’il n’en a mis dans son ouvrage, qui reste cependant une œuvre estimable sous beaucoup de rapports,—et je serai bien étonné si M. Ponsard ne joue pas à l’envie, qui a cru se servir de lui comme d’un instrument, le petit désagrément d’avoir bientôt à chercher des instruments contre lui.
![]() Il n’y avait rien de touchant comme d’entendre les gens de ce
temps-ci, qui donnent de si charmants exemples,—s’écrier que le
principal mérite de la tragédie nouvelle était dans les sentiments
d’honnêteté et de vertu qu’elle renferme.
Il n’y avait rien de touchant comme d’entendre les gens de ce
temps-ci, qui donnent de si charmants exemples,—s’écrier que le
principal mérite de la tragédie nouvelle était dans les sentiments
d’honnêteté et de vertu qu’elle renferme.
Je ne crois pas qu’il y ait au théâtre une seule tragédie qui ne soit fondée sur l’opposition du vice et de la vertu.—Les pièces de ce temps réputées les plus immorales ont leurs personnages honnêtes et leurs phrases vertueuses.—L’Auberge des Adrets n’a-t-elle pas la femme de Robert Macaire et son fils,—qui, avec le bon M. Germeuil,—offrent l’ensemble de toutes les vertus sans en excepter une seule?
![]() Si vous voulez ne voir dans cette pièce que Robert Macaire et
Bertrand,—reprochez alors à l’auteur de Lucrèce le personnage de
Sextus Tarquin et celui de Tullie.
Si vous voulez ne voir dans cette pièce que Robert Macaire et
Bertrand,—reprochez alors à l’auteur de Lucrèce le personnage de
Sextus Tarquin et celui de Tullie.
De tout temps la vertu a été au théâtre un emploi—et il y a eu des acteurs engagés exprès pour les rôles vertueux—tant ils sont un des éléments nécessaires et habituels du drame;—certes, les drames de la Porte-Saint-Martin, tant décriés sous ce rapport,—ont produit plus d’effet que l’on n’en attend d’ordinaire de bons exemples et surtout de bons préceptes,—M. Moëssard,—ce bon M. Germeuil,—a tant joué de rôles honnêtes dans les plus terribles mélodrames,—qu’il a fini par mériter à la ville un prix Montyon pour des actes très-sérieusement honorables.
![]() Je profiterai de la circonstance pour dire une fois dans ma vie ce
que je pense de Lucrèce,—comme femme,—après avoir dit ce que j’en
pense comme tragédie.
Je profiterai de la circonstance pour dire une fois dans ma vie ce
que je pense de Lucrèce,—comme femme,—après avoir dit ce que j’en
pense comme tragédie.
Cet exemple éternel de la chasteté antique me paraît aussi mal choisi que possible.
Sextus Tarquin menaçait Lucrèce, si elle résistait à ses désirs,—de la tuer, et de tuer ensuite et de mettre auprès d’elle un esclave qu’il assurerait avoir surpris dans ses bras; c’est à cette menace que céda la femme de Collatin.
C’est-à-dire que Lucrèce sacrifia la chasteté à la réputation,—la vertu à la vanité; qu’elle aima mieux être souillée que de passer pour l’être.
Je reviens un moment aux sentiments vertueux étalés, sous prétexte de Lucrèce, par nos contemporains.—La Chambre des députés a été plus loin;—elle s’est élevée contre un roman de M. E. Sue, publié dans le Journal des Débats;—elle qui venait de nous offrir une foule d’honnêtes exemples dans les élections de Langres, de Carpentras, etc.; c’est, du reste, aux époques d’égoïsme et de corruption qu’on a vu de tout temps afficher la pruderie féroce—et la vertu tigresse.
![]() Au moment du malheur qui vient de frapper M. Odilon Barrot,—il m’a
été fait des révélations que j’ai recueillies avec empressement:—j’ai
vu pleurer sur ce pauvre père et prier pour lui en même temps que pour
sa fille Marie—des gens pour lesquels il a été bon et généreux dans
l’ombre et dans le silence.—S’il était des consolations pour une
pareille douleur, c’en seraient de plus sérieuses que celles qu’ont
voulu lui offrir quelques journaux dans les débats creux, dans les
luttes verbeuses de la tribune.
Au moment du malheur qui vient de frapper M. Odilon Barrot,—il m’a
été fait des révélations que j’ai recueillies avec empressement:—j’ai
vu pleurer sur ce pauvre père et prier pour lui en même temps que pour
sa fille Marie—des gens pour lesquels il a été bon et généreux dans
l’ombre et dans le silence.—S’il était des consolations pour une
pareille douleur, c’en seraient de plus sérieuses que celles qu’ont
voulu lui offrir quelques journaux dans les débats creux, dans les
luttes verbeuses de la tribune.
On assure que le roi a eu le bon goût et le bon cœur d’envoyer porter des paroles de sympathie à ce père accablé—au sujet de la mort de cette autre Marie,—qui laisse, comme la première, tant de regrets après elle.
![]() Il y a des sortes d’oiseaux sinistres qui ne sont pas, à mon gré,
poursuivis d’assez de haine et de mépris.
Il y a des sortes d’oiseaux sinistres qui ne sont pas, à mon gré,
poursuivis d’assez de haine et de mépris.
Chaque année, si des pluies inopportunes, si des chaleurs trop ardentes viennent inspirer quelques craintes sur la récolte prochaine,—ils espèrent une disette,—même peut-être une famine.—Mais ils n’ont pas la patience de l’attendre,—ils accaparent les grains,—et, par toutes sortes de ruses et de moyens honteux de leur part,—aidés de la sottise publique—et de l’incurie de l’administration,—ils trouvent moyen de donner tout de suite au peuple un avant-goût de misère et de jeûne.
Quoi!—parce que le blé de cette année n’est pas encore en fleurs,—parce que les pluies font craindre qu’il ne fleurisse pas bien,—cela augmente la rareté et le prix du blé récolté il y a un an!
Comment ne recherche-t-on pas,—comment ne poursuit-on pas avec persévérance les coupables auteurs de ces infâmes manœuvres, pour les livrer à des peines sévères et méritées?
![]() M. Villemain a dit: «Les professeurs de l’Université ne manquent
jamais une occasion de rappeler aux élèves ce qu’ils doivent à Dieu,—à
leurs parents,—au roi et à leur pays.»
M. Villemain a dit: «Les professeurs de l’Université ne manquent
jamais une occasion de rappeler aux élèves ce qu’ils doivent à Dieu,—à
leurs parents,—au roi et à leur pays.»
M. Villemain sait bien que ce n’est pas vrai. En septième, on traduit l’Epitome historiæ græcæ, et l’on fait des pensums;—en sixième, le de Viris illustribus,—et l’on fait des pensums;—en cinquième, Cornelius Nepos,—et le Selectæ e profanis scriptoribus historiæ,—et l’on fait des pensums, etc., etc.—Mais de morale,—mais de devoirs, mais de raison, pas un mot.—On appelle devoirs, au collége, les thèmes et les versions,—et on n’en connaît pas d’autres.
![]() Il est une alliance d’idées monstrueuses,—qu’il était réservé à
notre époque d’oser faire,—je veux parler d’honneurs clandestins.
Il est une alliance d’idées monstrueuses,—qu’il était réservé à
notre époque d’oser faire,—je veux parler d’honneurs clandestins.
Les Guêpes ont déjà parlé de la manière honteuse dont on distribue aujourd’hui les médailles après l’exposition de peinture.—Autrefois, le roi lui-même—les distribuait publiquement,—et le Moniteur—imprimait les noms heureux.—Aujourd’hui on apprend de temps en temps, tantôt par un journal, tantôt par un autre, que M. un tel ou madame trois étoiles a reçu une médaille d’or pour un tableau remarqué à l’exposition.
On ne saurait croire combien d’images grotesques sont ainsi honorées d’une récompense que l’on déshonore. Quelques médailles méritées—sont données par je ne sais quel subalterne, qui écrit au peintre désigné de venir chercher sa médaille chez lui. Si le peintre n’a pas d’amis dans quelque journal,—personne ne sait rien du prix qu’il a obtenu.
Il en est de même de la croix d’honneur.—Il arrive à chaque instant qu’on la voit si grotesquement figurer à certaines boutonnières,—qu’on n’ose pas même féliciter les nouveaux décorés, qu’on suppose embarrassés de leur première sortie. On en est venu au point, cependant, d’être un peu honteux d’une semblable prostitution;—beaucoup de noms de légionnaires ne sont pas inscrits au Moniteur. Mais cet effet de la honte tourne au profit de l’audace. C’est par pudeur que l’on évite le contrôle qu’amènerait la publicité. Mais une fois ce contrôle évité, on n’a plus besoin de se gêner. Et on ne se gêne plus.
M. Donatien-Marquis et M. Lherbette, députés, ont demandé hautement à la Chambre la suppression de ces honneurs honteux et clandestins,—et l’insertion au Moniteur de tous les noms des légionnaires.—La Chambre n’a tenu aucun compte de cette proposition.
Pendant qu’on imprime les Guêpes, je remarque que le National est revenu avec une honorable humilité sur ce qu’il avait dit au sujet du malheur arrivé à M. Lacave-Laplagne.
![]() Les journaux annoncent que Trouville fait construire un
théâtre;—je ne crois pas que Trouville ait raison. Ce qu’on va voir à
Trouville, c’est la mer, c’est le départ et l’arrivée des
pêcheurs;—c’est la Touque, cette jolie petite rivière qui tombe dans la
mer; c’est la belle plage découverte à la marée basse, et placée si
admirablement pour voir coucher le soleil.—Mais que voulez-vous que
fassent les Parisiens d’une troupe de comédiens de huitième ordre que
vous rassemblerez avec grande peine?
Les journaux annoncent que Trouville fait construire un
théâtre;—je ne crois pas que Trouville ait raison. Ce qu’on va voir à
Trouville, c’est la mer, c’est le départ et l’arrivée des
pêcheurs;—c’est la Touque, cette jolie petite rivière qui tombe dans la
mer; c’est la belle plage découverte à la marée basse, et placée si
admirablement pour voir coucher le soleil.—Mais que voulez-vous que
fassent les Parisiens d’une troupe de comédiens de huitième ordre que
vous rassemblerez avec grande peine?
Savez-vous ce qui a fait depuis dix ans la fortune de Trouville? C’est son isolement, c’est son aspect calme, c’est tout ce que vous vous efforcez de lui faire perdre.—C’est que ce n’étaient pas des bains de mer.
Trouville est déjà loin d’avoir le charme que nous y trouvions il y a une douzaine d’années,—à l’époque où nous découvrions Trouville et Étretat,—sans compter que tout y est maintenant aussi cher qu’à Dieppe ou au Havre.—Le conseil municipal de Trouville semble avoir en vue ce que disait une femme du monde en traversant une grande forêt;—on lui en faisait admirer la fraîcheur, le calme et le silence; on lui faisait admirer les dômes de verdure d’où tombaient des chants d’oiseaux.
—Oui, dit-elle, c’est très-joli; j’aime, comme vous, les forêts et les rivages;—mais quel malheur que ces choses-là ne se rencontrent qu’à la campagne!
Comme on ne peut guère amener la mer à Paris, on cherche à mettre au bord de la mer tout ce qu’on peut de Paris.
![]() Il est remarquable que, dans un siècle où l’on se pique
d’incrédulité, les journaux publient l’annonce qu’on va lire—et que la
profession de pythonisse soit encore une profession lucrative.
Il est remarquable que, dans un siècle où l’on se pique
d’incrédulité, les journaux publient l’annonce qu’on va lire—et que la
profession de pythonisse soit encore une profession lucrative.
«Madame Declaire-Alzin, phrénologue-nécromancienne,—telle rue, tel numéro, reçoit depuis neuf heures du matin jusqu’à sept heures du soir;—prix modérés.»
![]() Les circonstances atténuantes vont leur train.
Les circonstances atténuantes vont leur train.
André Petit frappe son père à plusieurs reprises—et le menace de le tuer devant de nombreux témoins.—Le jury, ayant égard à ce que si l’accusé a frappé et menacé un homme—cet homme est son père,—et que ce sont des affaires de famille, et, en outre, considérant qu’André Petit a déjà été deux fois condamné pour vol; que c’est un très-mauvais sujet;—qu’on ne peut attendre d’un voleur obstiné et d’un mauvais sujet des actions bien vertueuses,—et qu’il serait même injuste de les exiger de lui;—le jury s’empresse d’admettre en sa faveur des circonstances atténuantes.
Une fille a volé une montre,—ce n’est pas le besoin qui l’a poussée à cette action coupable.—Le jury eût sans doute été sévère;—un vol commis par pauvreté, par besoin, peut se renouveler souvent;—mais cette pauvre fille n’a pris la montre que parce qu’elle était si belle;—ce n’est donc qu’un caprice,—qu’un vol isolé qui n’aura plus lieu;—on admet en conséquence des circonstances atténuantes.
Il est à regretter que la cour, se joignant à la manière du jury, n’ait pas ordonné que l’accusée garderait la montre.
Auprès de Tulle,—Chassague offre à son ami Mathieu-Basile de l’accompagner dans une course nocturne;—ils arrivent dans un endroit désert;—Chassague renverse son ami à coups de bâton,—lui écrase la poitrine avec une pierre énorme,—croit devoir ajouter quelques coups de pied sur la tête,—après quoi il porte son ami dans un ruisseau—et lui enfonce la tête dans la vase à coups de botte.
On doit être bien malheureux d’avoir agi ainsi à l’égard d’un ami.—Le 17 juin, le jury, prenant en considération les regrets que doit éprouver l’infortuné Chassague,—regrets d’autant plus violents qu’il les dissimule,—admet en sa faveur des circonstances atténuantes.
![]() Cour d’assises de la Seine.—(Audience du 1er juillet.
Présidence de M. Montmerqué.)—Annette Boulet est accusée de plusieurs
vols domestiques.—Le jury, tenant compte de ce que la fréquence des
larcins reprochés à l’accusée établit clairement que le vol est devenu
une habitude;—que l’empire de l’habitude est irrésistible sur beaucoup
de personnes;—admet, en faveur d’Annette Boulet, des circonstances
atténuantes.
Cour d’assises de la Seine.—(Audience du 1er juillet.
Présidence de M. Montmerqué.)—Annette Boulet est accusée de plusieurs
vols domestiques.—Le jury, tenant compte de ce que la fréquence des
larcins reprochés à l’accusée établit clairement que le vol est devenu
une habitude;—que l’empire de l’habitude est irrésistible sur beaucoup
de personnes;—admet, en faveur d’Annette Boulet, des circonstances
atténuantes.
Cour d’assises de la Loire:—Damiens Grangeon, admis à l’hospice de Saint-Bonnet-le-Château,—achète des allumettes phosphoriques et croit devoir mettre le feu à l’hôpital.—Le jury, appréciant que le feu mis avec des allumettes phosphoriques, qui s’allument avec une promptitude aussi grande que celle de la pensée,—ne suppose pas la préméditation dont on pourrait accuser Grangeon s’il avait mis le feu à l’hospice au moyen de l’ancien briquet, qui donne le temps de la réflexion,—en conséquence,—admet des circonstances atténuantes.
Ces faits divers ne sont ni inventés—ni cherchés avec soin, je les extrais de DEUX numéros de la Gazette des Tribunaux,—et ils ne sont pas les seuls.
![]() «Monsieur, j’ai l’honneur de vous inviter à une réunion qui aura
lieu chez moi dimanche prochain; l’heure est fixée à midi. Je donnerai
des explications et développerai ces mots: Effort, Action,
Providence; je crois pouvoir rendre sensible à chacun la loi immuable
des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes et de Dieu lui-même.
«Monsieur, j’ai l’honneur de vous inviter à une réunion qui aura
lieu chez moi dimanche prochain; l’heure est fixée à midi. Je donnerai
des explications et développerai ces mots: Effort, Action,
Providence; je crois pouvoir rendre sensible à chacun la loi immuable
des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes et de Dieu lui-même.
»Votre serviteur compte sur vous pour la satisfaction de tous ses amis.
»Votre frère en Jésus-Christ, seul Dieu du ciel et de la terre.
»CHENEAU, C., rue Montesquieu, 2.»
Telle est la lettre que j’ai reçue de M. Cheneau et Ce, seul dieu du ciel et de la terre, comme il nous l’apprend.
Je regrettai de ne pouvoir contribuer par ma présence à la satisfaction des amis du dieu.
D’autres auraient craint d’être invités là comme une sorte d’agneau pascal,—sous les espèces duquel le dieu Cheneau se proposait de communier avec ses amis;—je sais que l’on attribuera mon absence à cette terreur; je sais qu’on m’accusera de lâcheté, mais j’ai pour moi ma conscience.
Heureusement que Grimalkin voltigeait par là, de sorte que j’ai su ce qui s’est passé dans le ciel Cheneau.
C’est le dieu lui-même qui ouvre la porte; au milieu de quelques assistants étaient deux chérubins—que Grimalkin a reconnus pour les deux commis qui sur la terre,—c’est-à-dire à la boutique, servent de commis à la maison Cheneau et P. Jouin.—Au milieu de la pièce était une belle table avec un tapis rouge,—un chérubin apporte une Bible;—le chérubin est jugé laid.—Le ciel Cheneau est tapissé de papier collé,—à peu près comme les chambres ordinaires.—Grimalkin frémit en voyant une porte murée,—le plâtre était encore frais.—Est-ce là l’enfer où le dieu Cheneau jette ceux qui doutent?—Le dieu Cheneau reparaît au bout d’un quart d’heure, et dit: «Fiat lux.»—Les chérubins ouvrirent les rideaux, les fenêtres et les jalousies,—et la lumière fut faite.—Elle ressemble beaucoup à celle faite par Dieu—l’ancien;—le dieu Cheneau ne paraît pas y avoir apporté de perfectionnement.
Voici celles des choses dites par le dieu auxquelles Grimalkin a cru trouver un sens:
«Dieu ayant reconnu qu’il ne serait pas convenable qu’il chantât ses louanges lui-même,—a créé les hommes pour cet usage.—Si l’homme était parfait, il n’y aurait ni maladies,—ni tremblements de terre, ni orages.—Les apôtres ont annoncé un nouvel avénement, une nouvelle manifestation;—cet avénement, cette manifestation, c’est le dieu Cheneau.—Nous ne recevrons pas l’esprit de Dieu directement,—cet esprit tombe de Dieu sur une région supérieure à nous,—d’où, sur un degré angélique;—enfin, de chute en chute, jusqu’à un troisième degré qui est la tombe,—lequel en fait ce qu’il peut.»
Dieu en trois personnes est une monstruosité.—Si Dieu le Fils a un père qui est Dieu, nous ne dirons pas: Notre père, mais grand papa.—Au reste, la parole par laquelle le dieu Cheneau se manifesta a quelques légères variantes avec celle que nous employons; ainsi il dit: «Un ac (acte),—ce qui fut fé,—voér (voir),—onl’l’a,—r’pondre (répondre)—l’euspril,—euspérituilement,—etc.
![]() Des hommes sont assis ou plutôt couchés sur des coussins aux deux
coins d’une cheminée. Ils fument dans de longues pipes turques et
boivent de la bière.
Des hommes sont assis ou plutôt couchés sur des coussins aux deux
coins d’une cheminée. Ils fument dans de longues pipes turques et
boivent de la bière.
—Qu’as-tu, Alfred, que tu ne dis rien?
—Moi?—rien; j’attends que tu parles.
—Alors cela pourrait durer longtemps.
—Je pense à une ravissante aventure.
—Penses-y tout haut.
—Je le voudrais bien, mais c’est que j’y joue un rôle un peu trop brillant et que cela t’humiliera.
—Raconte toujours, je n’en croirai que la moitié.
—Il y a huit jours, je reçus une invitation à une soirée,—ou plutôt à un bal modestement annoncé par ce post-scriptum: «On dansera.» Le nom de la personne m’était inconnu;—j’allumai ma pipe avec l’invitation... Mais attends un peu que je remette du tabac dans celle-ci.
—Bien.
—A quelques jours de là, j’étais triste et ennuyé, il me prit des idées mondaines. «Ma foi, dis-je, je serais bien allé à ce bal.» Puis, un peu après,—je me dis: «J’irais bien à ce bal. Tiens,—mais c’est aujourd’hui! Est-ce bien aujourd’hui?—Oui, ma foi. Parbleu! je vais y aller.» Je m’habille; ceci était le plus difficile; une fois moi habillé, le reste allait tout seul; je m’habille, je fais demander un fiacre par le portier, j’arrive à la maison indiquée, tu sais une belle maison rue ***, qui a deux magnifiques statues de Coysevox, je m’étais arrêté cent fois devant cette maison; on m’annonce, mon nom produit le plus grand effet, je vais saluer la maîtresse de la maison, qui rougit et paraît embarrassée. Un moment je me trouve seul avec elle, elle me dit: «C’est M. Ernest qui vous a amené, ne l’oubliez pas.» Puis elle me quitte et s’occupe d’une femme qui entre. Ah! c’est M. Ernest qui m’a amené, et qui est ce M. Ernest, et pourquoi m’a-t-il amené? Un gros homme vient à moi et me dit: «Vous ne prenez rien? il y a un buffet.» Je m’incline; il ajoute: «Où est donc Ernest? je veux le remercier de vous avoir amené.—Monsieur, c’est moi au contraire qui lui dois mille remercîments.—Eh bien, savez-vous où en est son affaire!—Quelle affaire?—Eh! la grande affaire!—Ah! la grande affaire...? elle va bien.—Tant mieux!—Avez-vous salué ma femme?—J’ai eu cet honneur.—Dites donc,—êtes-vous comme Ernest, vous!» Me voici, cette fois, bien embarrassé; comment est Ernest? c’est égal, une réponse évasive: «Hum, hum, c’est selon.—C’est qu’il n’est bon à rien, il ne joue pas, il ne danse pas.—Je danserais volontiers, et, si je ne craignais d’arriver trop tard, j’inviterais la maîtresse de la maison.—En effet, son carnet doit être plein; mais elle se réserve toujours quelques contredanses pour les retardataires qu’elle veut favoriser; venez.» Il me conduit auprès de la maîtresse de la maison, qui me dit: «N’oubliez pas que je vous ai promis la seconde contredanse.—Mais que me disiez-vous? dit le gros homme.—J’avais engagé madame, mais elle m’avait quitté tout à coup pour aller au-devant d’une femme qui entrait, et je pensais qu’elle ne m’avait pas entendu.—Eh bien! sans moi, vous auriez fait une jolie chose; vous voilà maintenant occupé, je vous quitte: si vous retrouvez Ernest, dites-lui que j’ai à lui parler.» Me voilà seul au milieu de ce monde, je cherche à mettre un peu d’ordre dans mes idées. Tout le monde me connaît ici et je ne connais personne. La maîtresse de la maison veut me ménager un entretien avec elle; que va-t-elle me dire?—Je le saurai bientôt; mais moi, que vais-je dire? Si je connaissais Ernest seulement! La musique annonce qu’on va recommencer à danser. Je vais prendre la main de la maîtresse de la maison: c’est une femme de trente ans, jolie et bien faite, nous faisons la première figure sans parler; pendant que les autres dansent à leur tour, elle me dit: «Pour mon mari, il n’y a pas de danger; mais méfiez-vous d’Ernest: il ne sait rien, comme vous pouvez bien penser, c’est un ami, un véritable ami, mais devant lequel je rougirais trop; d’ailleurs, il ne se serait prêté à rien; il fallait cependant que nous eussions une explication; parlez maintenant.» Heureusement qu’il—faut faire l’été; nous dansons; quand nous nous arrêtons, elle a heureusement oublié que nous en étions resté à une question qu’elle me faisait et elle me dit: «D’abord je veux vous rendre vos lettres.» Mon Dieu! pensais-je; mais je n’ai pas écrit de lettres, que je sache! Elle continua: «Il n’y a rien de si imprudent que d’écrire ainsi, je ne reçois pas une lettre, c’est par un grand hasard que je n’ai pas donné les deux vôtres à mon mari avant de les lire; je n’ai pas voulu vous répondre; j’ai pensé qu’il valait mieux vous parler; mais seule, je ne l’aurais jamais osé; dans un salon, au milieu du monde, je suis plus hardie; il ne faut plus m’écrire, il ne faut plus passer des heures entières devant ma porte, c’est à me perdre.» Ah! mon Dieu! moi qui n’étais là que pour regarder la porte!—voilà un singulier quiproquo; c’est égal, je réponds effrontément que maintenant que je puis me présenter chez elle, je n’ai plus de raison de rester devant la porte; que je veux bien ne plus lui écrire, si elle me permet de lui parler.—La pastourelle! «Non, écoutez, il vaut mieux ne plus nous voir;—je suis mariée... vous le savez... j’aime et je respecte mes devoirs.» (Ah! très-bien;—dès qu’une femme appelle cela ses devoirs,—il n’y a pas à se décourager pour l’amour.) «Quoi, madame, ne plus vous revoir, après que depuis si longtemps ma vie entière vous est consacrée, après que je me suis accoutumé à mettre en vous toutes mes pensées, toutes mes espérances; non jamais! Si vous ne voulez pas que je vous dise que je vous aime, je vous l’écrirai dix fois par jour; si vous ne voulez pas que je vienne vous voir chez vous, je m’installerai en face de votre porte, dans une échoppe d’écrivain public, et je n’en sortirai pas.—Vous m’effrayez!—Eh quoi! est-ce le sentiment que je devrais m’attendre à vous inspirer en échange de tant d’amour et de tant de respect?—Qui vous dit que ce soit le seul que j’éprouve? Mais ce que je puis vous dire, c’est que c’est le seul qu’il me convienne de montrer.» Après la contredanse, je la reconduis à sa place, je lui dis: «Pensez à l’échoppe.» Elle sourit, et je me perds dans la foule. Je cherche à deviner ce qui se passe, et ce dont je me fais l’effet d’être le héros. Quel rôle joue cet Ernest, et qui est-il lui-même? Quoi qu’il en soit, je ne vois dans tout cela rien que de fort agréable, et je vais aller jusqu’à ce qu’on m’arrête. On m’a dit qu’on danserait avec moi après trois contredanses consacrées à tout le monde. Nous reprenons notre conversation «Je pense beaucoup à mon échoppe, madame.—Et moi aussi, monsieur, mais vous me faites peur.—Défendez-moi de la faire, madame.—Oui, certes, je vous le défends bien.—Je vous remercie, madame.—De quoi donc, monsieur?—De la permission que vous me donnez de vous venir voir souvent.—Au fait, vous pouvez bien venir comme vingt autres hommes qui viennent chez moi; mais renouvelez-moi le serment que vous m’avez fait dans votre dernière lettre.» Me voici plus embarrassé que jamais: quel serment ai-je fait? N’importe, il ne faut pas hésiter. «Je le jure, madame, sur mon amour.» Elle rit. «Voilà une jolie manière de m’inspirer de la confiance!—Comment cela! je jure sur ce que j’ai de plus précieux.—C’est sur votre amour que vous jurez de ne me jamais parler d’amour!» (Ah! c’est là ce que j’avais juré!) «Écoutez, madame, je ne veux pas vous tromper, je dirai ce que vous voudrez, je vous entretiendrai de ce qu’il vous plaira, mais rappelez-vous que tout ce que je vous dirai, sur quelque sujet que ce soit, voudra dire: Je vous aime.—Mais comment ferons-nous pour Ernest?—Et que m’importe Ernest?—Il m’importe beaucoup à moi, il faut le ménager.—Oh! je le ménagerai tant que vous voudrez.—A la bonne heure!—Oui, mais je ne le connais pas.—Comment! vous ne le connaissez pas! il n’a pas été vous porter une invitation?—On m’a remis l’invitation sans me dire qui l’avait apportée.—Il m’avait dit qu’il vous connaissait beaucoup.—Je ne connais personne qui s’appelle Ernest.» Enfin, mon cher ami,—à force de causer, j’apprends une partie du mystère et je devine l’autre. Madame de*** m’avait vu sept ou huit fois arrêté devant sa porte, occupé à regarder les statues; elle a reçu deux lettres renfermant des déclarations d’amour où il y avait cette phrase banale: «Les instants les plus doux de ma vie sont ceux que je passe à contempler les lieux où vous êtes.» Elle me soupçonnait amoureux d’elle, elle m’a attribué des lettres. A quelques jours de là, comme elle sortait en voiture avec une femme, sa compagne m’a vu et a dit: «Tiens! M. Alfred de Bussault!—Qui! ce jeune homme?—Oui, vous ne le connaissez pas?—Non, vous le connaissez?—Oui, un jeune artiste,—un homme de talent.—Une figure noble et intéressante.»
—Ohé! monsieur Alfred, interrompit ici l’auditoire, qui vous a rapporté ce dialogue?
—Personne, cela fait partie de ce que je devine.
—Ah! très-bien, je comprends.
—On ne veut pas répondre par écrit; comme on me l’a dit, on sera plus hardie en plein salon; il faut m’inviter à une soirée; mais comment faire? A quelques jours de là, on amène la conversation sur les jeunes artistes; on dit qu’on a entendu dire de moi le plus grand bien. M. Ernest,—sorte de sigisbée, de patito, dont on accepte l’amour, les soins et les corvées, sans lui rien rendre, mais qui, étant toujours là, finira peut-être par trouver un moment, M. Ernest a une manie, c’est de se dire lié avec toutes les personnes qui jouissent de quelque réputation, pour se donner du relief, il dit: «Ah! Bussault, je le connais beaucoup.—Amenez-le donc à une de nos soirées; mais prenez la chose sur vous auprès de mon mari: je lui ai refusé d’inviter quelques personnes, et je ne tiens pas assez à voir M. Bussault pour m’exposer à ce que monseigneur m’impose des conditions.—Très-bien, je vous l’amènerai;—je demanderai à votre mari une invitation pour un de mes amis.» Or, il arrive que M. Ernest, qui ne me connaît pas, a mis simplement la lettre d’invitation chez moi, se proposant de trouver quelqu’un qui me le présente avant le jour du bal. Une affaire de famille l’a obligé de quitter Paris pour quelques jours. Enfin, j’ai obtenu, pour ce soir, la permission d’aller passer un quart d’heure, rien qu’un quart d’heure, auprès de madame de ***, qui est souffrante et fermera sa porte. Charmante soirée!
—Je comprends alors ta préoccupation; mais tout me paraît un peu bien invraisemblable. Franchement, découds la broderie, et dis-moi ce qu’il y a de vrai au fond de ton histoire.
—Je le veux bien; voici l’exacte vérité, sans broderie, sans le moindre ornement. Je pensais, en fumant, à une lettre d’invitation que j’ai reçue pour une soirée chez madame de ***, que je ne connais pas, ce qui m’a étonné. La soirée était pour avant-hier, et ce que je viens de te dire est ce que je pensais qui serait peut-être arrivé si j’avais eu un habit noir, et si, par conséquent, j’avais pu y aller.
| 1842 | |
|---|---|
JUIN.—Un feuilleton de M. Jars, membre de la Chambre des députés.—Les vieilles phrases et les vieux décors.—Les enseignements du théâtre.—Un nouveau cerfeuil.—Les circonstances atténuantes.—M. Jasmin.—Un peintre de portraits.—La refonte des monnaies.—M. Lerminier.—M. Ganneron.—M. Dosne.—M. l’Herbette.—M. Ingres.—M. Boilay.—M. Duvergier de Hauranne.—M. Étienne.—M. Enfantin.—M. Enouf.—M. Rossi.—Le droit de pétition.—M. l’Hérault.—M. Taschereau.—M. d’Haubersaert.—M. Bazin de Raucou.—Madame Dauriat.—Les tailleurs.—M. Flourens.—Le Journal des Débats, Fourier et Saint-Simon.—Pétition de M. Arago.—Le droit de visite.—Un éloge. | 1 |
JUILLET.—Dédicace à la reine Pomaré.—Dissertation sur les tabatières.—La cuisine électorale.—Am Rauchen | 26 |
AOUT.—Mort du duc d’Orléans.—La Régence.—Le duc de Nemours et la duchesse d’Orléans.—M. Guizot.—Un curé de trop.—Humbles remontrances à monseigneur Blancart de Bailleul.—Un violon de Stra, dit Varius.—Fragilité des douleurs humaines.—Sur les domestiques.—Correspondance.—M. Dormeuil.—Une foule d’autres choses.—M. Simonet.—Une Société en commandite.—Quelques annonces.—M. Trognon. M. Barbet.—M. Martin.—M. Poulle.—M. Pierrot.—M. Lebœuf.—M. Michel (de Bourges).—M. Dupont (de l’Eure).—M. Boulay (de la Meurthe).—M. Martin (du Nord), etc.—Am Rauchen.—Wergiss-mein-nicht. | 54 |
SEPTEMBRE.—La justice.—Ce qu’elle coûte.—Et pour combien nous en avons.—De quelques gargotiers faussement désignés sous d’autres noms.—Un directeur des postes.—Un gendarme et un voyageur.—Sur les chiens enragés.—La Régence.—Le duc de Nemours.—La Chambre des pairs.—M. Thiers.—M. de Lamartine.—Crime d’un carré de papier.—La Tour de François 1er et le Journal du Commerce.—Une montagne. | 79 |
OCTOBRE. | 107 |
NOVEMBRE.—Les inondés d’Étretat, d’Yport et de Vaucotte.—Le roi Louis-Philippe et M. Poultier, de l’Opéra.—Un philosophe moderne.—Les femmes et les lapins.—Une mesure inqualifiable.—M. Lestiboudois.—M. de Saint-Aignan.—Un dictionnaire.—Le véritable sens de plusieurs mots.—A. et B. | 137 |
DÉCEMBRE.—Économie de bouts de chandelles.—Les alinéa.—Une lettre de faire part.—Qui est le mort?—Le Télémaque et M. Victor Hugo.—Le procès Hourdequin.—M. Froidefond de Farge.—Un poëte.—Les philanthropes et les prisonniers de Loos.—M. Dumas, M. Jadin, et Milord.—Une lettre de M. Gannal.—M. Gannal et la gélatine.—Une récompense.—Le privilége de M. Ancelot.—Amours.—Les chemins de fer.—L’auteur des GUÊPES excommunié.—Un Dieu-mercier.—Ciel dudit.—Un marchand de nouveautés donne la croix d’honneur à son enseigne.—Le chantage.—Histoire d’une innocente.—Histoire d’une femme du monde et d’un cocher.—Dictionnaire français-français.—Suite de la lettre B. | 169 |
| 1843 | |
JANVIER. | 201 |
FÉVRIER. | 224 |
MARS.—Le vendredi 13 janvier.—A monseigneur l’archevêque de Paris, pour les besoins de l’Église.—La grande politique et la petite politique.—Chandelle et lumière.—M. Lehoc.—Le dieu Cheneau.—Les Guêpes refroudroyées.—Messieurs les savants et mesdames leurs inventions.—M. de Lamartine et les journaux.—Sur quelques décorations.—Chiromancie.—Catholique.—M. Jouy.—Ciguë.—Confiscation. | 230 |
AVRIL.—A M. Arago (François).—Le dieu Cheneau.—M. de Balzac.—Quirinus.—Un mot.—Une ordonnance du ministre de la guerre.—A M. le rédacteur en chef du journal l’Univers religieux. | 248 |
MAI.—Exécution de Besson.—Un rouleau d’or sauvé.—Invitation à déjeuner noblement refusée.—La Trappe.—Saint Philippe et saint Jacques.—Une idée érotique du préfet de police.—Discours de l’archevêque de Paris et réponse du roi.—Le peuple et les badauds.—M. Pasquier et M. Seguier.—D’un voleur qui voit la mauvaise société.—Une profession nouvelle.—Un député aimable.—M. Arago a rompu avec les comètes.—L’enquête de la Chambre sur les élections de Langres, d’Embrun et de Carpentras.—Le député de Langres et le député de Saint-Pons. | 262 |
JUIN.—Le déluge.—On demande une famille honnête.—Suppression du mois de mai.—La rançon du mois de mai.—Plus de mal de mer!—Opinion de madame Ancelot sur une pièce de madame Ancelot.—Les douaniers de M. Gréterin.—Utilité de la langue latine pour une profession.—M. le préfet de police faisant de la popularité.—La liste civile.—Les hommes du pouvoir et le peuple.—Le jury.—Les circonstances atténuantes.—Le bagne.—Brest.—Le duc d’Aumale.—Noble impartialité des journaux.—De la liberté des cultes en France.—M. Fould. | 281 |
JUILLET.—La rançon acceptée.—Une nouvelle fleur.—Suppression de l’homme.—Les défenseurs de la veuve et de l’orphelin.—Jugement de Salomon.—Une conspiration.—Le Napoléon.—Les anciens et les modernes.—MM. Ponsard, Hugo, Dumas, etc.—Lucrèce.—M. Odilon Barrot.—Les oiseaux sinistres.—M. Villemain.—Honneurs clandestins.—Trouville.—Une annonce.—Les circonstances atténuantes.—Le dieu Cheneau.—Une invitation. | 297 |
FIN DE LA TABLE DU QUATRIÈME VOLUME.
Paris.—Typ. de A. WITTERSHEIM, 8, rue Montmorency.
NOTES:
[A] Voir les Guêpes du mois dernier, page 54.
[B] Pour fait ici partie d’un vers qui fait partie d’une épigramme licencieuse. Le Courrier français a mis pour, au contraire, dans une phrase on ne saurait plus décente, et dont la mère peut, sans danger, permettre la lecture à sa fille.
[C] Voir, pour les précédents Nisards, le numéro de février.
[D] Le père du roi Louis-Philippe.
[E] Louis XVI.
[F] Le roi actuel.
[G] Louis XVII, mort au Temple.
[H] Femme du comte de Provence, depuis Louis XVIII.
[I] Depuis Charles X.
[J] Le duc de Berri et le duc d’Angoulême.
[K] Voir aux notes de la Dédicace.
[L] Voir les notes.
[M] Voir les notes.
[N] Cela a été pris en considération, mais on a dépassé le but.
[O] En relisant les Guêpes pour cette nouvelle édition,—j’avais effacé ce chapitre, qui n’est qu’une réponse à une attaque faite un peu légèrement en ce temps-là contre moi dans un journal. Les lecteurs des Guêpes savent mon admiration pour Balzac.—Le journal n’existait plus; il ne m’était resté aucune aigreur contre le grand écrivain.—Mais un hasard m’apprend que l’article du journal auquel je réponds ici a été recueilli et figurera dans les œuvres complètes de Balzac.—Je dois donc, à mon grand regret, conserver la réponse comme on conserve l’attaque.
| On a effectué les corrections suivantes: |
| RERAIN=> REFRAIN {pg v1-159} |
| faiblessee xtrême=> faiblesse extrême {pg v1-26} |
| r enfermer dans une caisse=> renfermer dans une caisse {pg v1-48} |
| la verdure était aunie=> la verdure était jaunie {pg v1-59} |
| danses poohibées par la police=> danses prohibées par la police {pg v1-169} |
| l’oiseau qui passse=> l’oiseau qui passe {pg v1-182} |
| Un pélerinage=> Un pèlerinage {pg v1-188} |
| Failes-la asseoir et rafraîchir=> Faites-la asseoir et rafraîchir {pg v1-190} |
| pas camplice de l’attentat=> pas complice de l’attentat {pg v1-191} |
| les utensiles de cuisine=> les ustensiles de cuisine {pg v1-208} |
| M. Jean-Pierre Lutaudu=> M. Jean-Pierre Lutandu {pg v1-219} |
| corps d’ofciers=> corps d’officiers {pg v1-220} |
| à propos de la découverte fatie par un savant=> à propos de la découverte faite par un savant {pg v1-220} |
| tragédies de M. Ladières=> tragédies de M. Liadières. {pg v1-226} |
| Vous m’avez attaquez=> Vous m’avez attaqué {pg v1-230} |
| disonc donc=> disons donc {pg v1-272} |
| débités en rondins en en fagots=> débités en rondins et en fagots {pg v1-286} |
| pendue et accrochéee=> pendue et accrochée {pg v1-289} |
| peu d’embonpoit=> peu d’embonpoint {pg v1-303} |
| peu repandus dans la société=> peu repandus dans la société {pg v2-42} |
| nn libraire=> un libraire {pg v2-69} |
| qn’on appelait=> qu’on appelait {pg v2-71} |
| les journanx sans exception=> les journaux sans exception {pg v2-82} |
| le sang-frod=> le sang-froid {pg v2-93} |
| ni le pubic ne s’en souvient=> ni le public ne s’en souvient {pg v2-111} |
| J’eus l’honneur d’acepter=> J’eus l’honneur d’accepter {pg v2-123} |
| Le seconde classe des philanthropes=> La seconde classe des philanthropes {pg v2-157} |
| Le double Liégois=> Le double Liégeois {pg v2-159} |
| Un hommme politique=> Un homme politique {pg v2-198} |
| moi je jouais l’orque=> moi je jouais l’orgue {pg v2-227} |
| mois c’est de croyance=> mais c’est de croyance {pg v2-232} |
| s’en failllut que=> s’en faillut que {pg v2-247} |
| coq-à-l’ane=> coq-à-l’âne {pg v2-250} |
| pendant neuf annés=> pendant neuf années {pg v2-273} |
| donne par dérison=> donne par dérision {pg v2-296} |