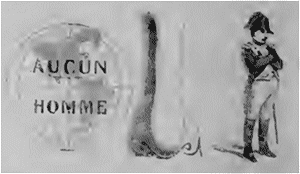L'Illustration, No. 0028, 9 Septembre 1843
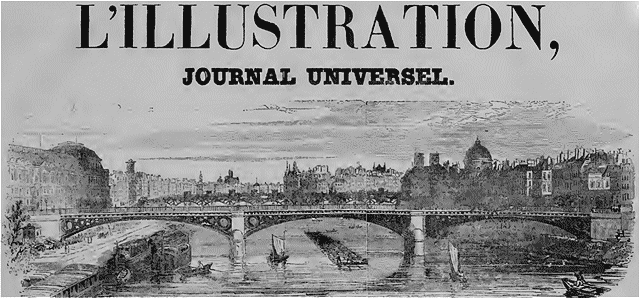
Nº 27. Vol. II--SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1843.
Bureaux, rue de Seine, 33.
Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois. 16 fr.--Un an, 30 fr.
Prix de chaque Nº, 75 c.--La collection mensuelle br. 1 fr. 75.
Ab. pour les Dép..--3 mois, 9 fr.--6 mois. 17 fr.--Un an, 33 fr.
pour l'Étranger. 10 20 40
SOMMAIRE.
La Fête des Loges. 3 septembre. Gravure.--De l'autre côté de l'Eau, souvenirs d'une promenade, par O. N. (Suite,)--Les Régates du Havre. 27 août. Courses des grandes embarcations; Course des Baleiniers.--Inauguration de la Statue de Henri IV, à Pau. Statue de Henri IV, par M. Raggi; Inauguration de la Statue; Berceau et Lit de Henri IV, au château de Pau; Maison à Bithères, près de Pau, où Henri IV a été nourri.--De la Médecine chez les Arabes,--Courrier de Paris, La reine d'Angleterre, conduite par Louis-Philippe, entre dans le canot royal; Arrivée de la reine au Débarcadère; Matelot anglais; Portrait de lord Aberdeen; la reine Victoria et le prince Albert.--Romanciers contemporains. Charles Dickens. Portrait. Un chapitre de son dernier roman.--Margherita Pusterla. Roman de M. César Cantù. Chapitre VI. Une Imprudence. Dix Gravures.--Annonces.--Modes. Gravure.--Amusements des sciences. Gravure. Voiture de mariage de l'empereur du Brésil, Gravure.--Météorologie.--Rébus.
Fête des Loges
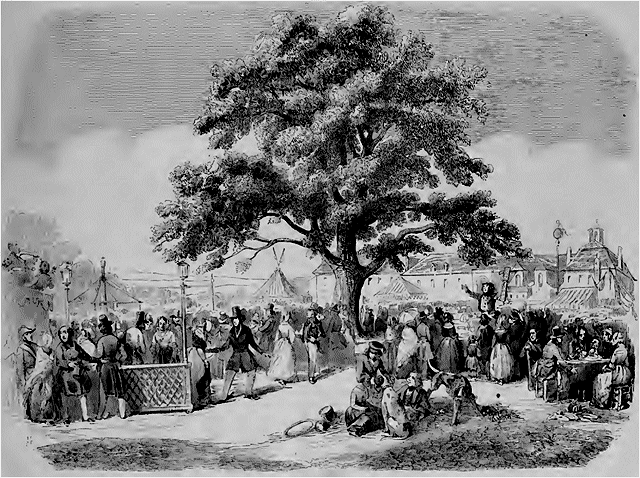
Fête des Loges.
Les fêtes de la Saint-Louis, à Saint-Germain-en-Laye, sont à peine terminées, les dernières fusées fument encore, les derniers groupes de danseurs regagnent la capitale, et déjà une autre fête, plus brillante, plus animée plus pittoresque, rappelle vers ces parages la population parisienne; des affiches, placardées à profusion dans Paris et dans la banlieue, au nom de. M. Petit-Hardel, maire du Saint-Germain, annoncent que la fête des Loges s'ouvre le 3 septembre, pour durer jusqu'au 5 inclusivement. Les chemins de fer organisent des départs supplémentaires; de demi-heure en demi-heure, vingt wagons déversent au Pecq des milliers de voyageurs; et non-seulement des voyageurs, mais encore des fiacres, des cabriolets, des omnibus, qui vont stationner à l'embarcadère, pour conduire de là les curieux dans la forêt, Partons aussi, suivons la foule, foule compacte, diaprée, bigarrée, citadine ou rustique, en frac ou en veste, en chapeau ou en bavolet; partons, le ciel est sans nuages; l'arrière-saison se revêt des splendeurs de l'été; et les arbres de la forêt, déjà nuancés par l'automne, nous assurent de frais abris contre la chaleur du jour.
Il importe d'abord de savoir où nous allons, et quelle est l'origine de cette fête si joyeusement chômée. Les Loges, situées dans la forêt de Saint-Germain, à trois kilomètres de la ville, sont aujourd'hui une succursale de la Maison Royale de Saint-Denis. Au seizième siècle, les rois y avaient fait construire un rendez-vous de chasse, qu'ils abandonnèrent, et dont un cénobite prit possession. En 1644, la reine Anne d'Autriche transforma le modeste ermitage en un couvent d'augustins déchaussés, qu'on appela les pères des Loges; elle se réserva, au milieu du jardin du monastère, un petit pavillon, où elle aimait à se retirer; elle y conduisait parfois Louis XIII, et obtenait de lui des dotations pour la fondation nouvelle. Par degrés, le couvent acquit de l'importance et des terres. Les courtisans, pour plaire au roi, vinrent tous les dimanches entendre la messe à l'église des Loges, et la confrérie de Saint-Fiacre prit l'habitude de s'y rendre processionnellement le 30 août, jour de la fête de son patron.
Les curés de Saint-Germain consentirent, pendant plus de cinquante ans, à marcher à la tête du pieux cortège; mais l'un d'eux, nommé Benoît, eut des discussions avec le prieur des Loges, et suspendit la procession. Il en fut de ce pèlerinage comme de celui de Longchamp: les motifs religieux disparurent, la promenade resta: on était venu aux Loges pour prier, ou y vint pour se divertir. La Révolution expulsa les moines, et fit de leur résidence une fabrique de poudre à canon. Le Directoire vendit les bâtiments à un particulier qui y fonda un pensionnat. Napoléon les racheta en 1811, pour y installer de jeunes orphelines, filles de membres de la Légion-d'Honneur. Ces changements de destination n'interrompirent point la fête des Loges, qui commence annuellement le premier dimanche après la Saint-Fiacre.
Vers cette époque, la pelouse des Loges s'anime à l'improviste; une colonie passagère y débarque; d'innombrables charrettes sont remisées dans les bois, et les chevaux, errants sous les ombrages, paissent sans contrôle l'herbe et les feuilles. Bientôt marchands forains et saltimbanques, sous la direction d'un commissaire de police spécial, travaillent à dresser leurs tentes; cafés, restaurants, boutiques, salles de bal ou de spectacle, s'élèvent connue par magie. Le matin du 3 septembre, un village de planches et de toiles occupe l'espace, naguère solitaire et vide, qui s'arrondit devant la Maison Royale. En y arrivant par Saint-Germain, on aperçoit tout d'abord des charrettes, des fiacres et des omnibus; on avance encore, et l'on découvre des fiacres, des omnibus et des charrettes. C'est seulement après avoir franchi d'épaisses murailles de véhicules, qu'on parvient au théâtre des ébats populaires. Pénétrons dans la foule: que de tapage, de poussière, de cliquetis, du sons discordants! Quelle variété de saltimbanques! Ici l'Hercule du Nord s'acquiert le surnom de bras-de-fer; là, un neveu de M. Auriol s'efforce de justifier, en se disloquant, du la parenté qu'il assume; plus loin, une grande collection de serpents et de crocodiles vivants s'agite avec furie... sur une toile peinte. Vous voyez dans cette baraque le successeur de Bébe; dans cette autre, un phénomène qui porte sur le blanc de l'oeil un cadran d'horloge. D'un côté est un manège desservi par la troupe amériquaine, de l'autre, un tir au pistolet et à la carabine. Vous pouvez opter entre les jeux d'adresse et les loteries foraines, entre la femme forte et l'albinos, entre la cervante de Palezau et le grand jugement du roi Salomon, mélodrames historiques. Le soir, tout cela s'illumine; les orchestres appellent à la danse; l'élégant et le maraîcher, le bourgeoise et la paysanne figurent face à face dans des quadrilles. Le bruit, les rires, les gambades, les libations, se prolongent: il est une heure du matin, et l'on songe à peine à la retraite. D'ailleurs, une grande partie de cette population flottante campe dans la forêt, dans les lentes, sous les charrettes, comme une bande d'Arabes ou de Gaskirs.
En ces journées de plaisir, les pensionnaires de la Maison Royale sont seules à plaindre, car elles doivent se contenter de regarder la fête par les fenêtres, à travers un réseau de barreaux solides. Comme elles briseraient volontiers les portes de leur prison! Qu'il leur serait doux de se perdre dans la foule, de s'arrêter aux étalages des boutiques, de se promener un bande joyeuse et babillarde, si la règle austère ne les retenait captives dans leur sombre cloître!
Les cuisines en plein vent sont au nombre des traits caractéristiques de la fête des Loges. Ou trouve en d'autres lieux des banquistes et des bimbelotiers, mais les cuisines des Loges n'ont point d'égales dans l'univers; elles sont établies par les aubergistes de Poissy, Maisons, Conflans, Andrésy et autres lieux. Chaque foyer se compose d'un monticule en terre revêtu d'un mur en pierres sèches, et flanqué aux deux extrémités d'assises en pierres. Devant le feu tournent, à l'aide de contre-poids, deux ou trois broches chargées de viandes de toutes sortes, que, pour répondre à l'avidité des consommateurs, on transporte à moitié cuites à la salle du festin. Des draps et des rideaux de lit, décorés de guirlandes de fleurs et de gigots crus, festonnés de branchages et de longes de veau, couvrent d'un dais blanc la tête des convives. Sur des tables placées au premier plan sont exposés des quartiers de boeuf, des lapins de garenne, des pains de deux kilogrammes empilés, des melons et autres appétissants comestibles. Vous connaissez ces noces de Gamache, où Sancho Pança écumait de grosses poulardes: les restaurants des Loges présentent un spectacle analogue; seulement, loin que l'hospitalité, s'y donne, on y dîne grossièrement et à grands frais; on a de plus l'inconvénient d'être assailli, pendant le repas, par des chanteurs, des guitaristes, des joueurs de vielle, des montreurs de souris blanches, des enfants qui exécutait les quatre premières souplesses du corps. Si donc la danse n'est pas ce que vous aimez, si vous ne désirez jouir du coup d'oeil de la pelouse illuminée, remontez en voiture et allez, chercher un repas confortable au pavillon Henri IV.
A propos de cet établissement, cher aux gourmets, nous nous empressons de faire droit à une réclamation du propriétaire, M. Gallois, que, dans un précédent article, nous avions qualifié de restaurateur. A la vérité, M. Gallois dirige le restaurant du pavillon Henri IV, mais il n'exerce point la profession de restaurateur, M. Gallois est un spéculateur qui a employé une partie de ses fonds dans une entreprise gastronomique, mais il nous assure que nous le verrons briller incessamment sur un plus vaste théâtre.
De l'autre côté de l'Eau.
SOUVENIRS D'UNE PROMENADE.
(Suite.--V. t. II, p. 6.)
EXCURSION CRITIQUE.
Ce sont ces rochers de Douvres, en effet, que Shakspeare a décrits dans le Roi Lear: ces rochers crayeux--ces chalky bourns:--
Whose high and bending head
Looks fearfully in the confined deep.
C'est là que Gloster, les yeux crevés par la farouche Régane veut être conduit pour se précipiter dans les flots. Mais Edgar a deviné ce projet sinistre, et sa pieuse désobéissance recourt à la ruse pour sauver de sa propre fureur le père qui l'a maudit. Ils sont encore en rase campagne lorsqu'il s'écrie:
«Arrêtez, seigneur... n'allez pas plus loin: voici l'endroit. Spectacle terrible, étourdissant, en vérité, qu'on aperçoit en regardant à nos pieds. Les corbeaux, les choucas, qui volent entre nous et la terre paraissent à peine de la grosseur des escargots... à mi-chemin, pend au bout de sa corde un chercheur de crête marine: moisson périlleuse!... ou le dirait à peine aussi gros que sa tête; les pêcheurs qui se promènent sur le rivage semblent autant de souris; cette grosse barque à l'ancre est réduite aux proportions du son batelet; son batelet lui-même à celles d'une bouée presque impossible à distinguer; la lame sonore, qui brise en frémissant sa colère sur les cailloux paresseux de la grève, n'envoie pas à la hauteur où nous sommes son puissant murmure.»
Sans être un commentateur forcené, n'est-il pas naturel de suivre ici la trace du poète et de se le représenter errant, par quelque belle journée d'été, sur la cime de ces noirs promontoires? Qui sait s'il n'y rencontra pas un pauvre mendiant aveugle guidé par un jeune clown, figures insignifiantes qui, s'amalgamant à son rêve poétique, y firent germer comme une fleur brillante l'épisode touchant de Gloster et du son fils méconnu?
Quant à la scène même, elle a, sous une apparence de puérilité, cette portée ironique des prétendues facéties shakspeariennes. Le vieillard aveugle veut en finir avec la vie; dès qu'il se croit au bord de l'ardu précipice, il renvoie son guide, qui feint de s'éloigner; il adresse une dernière prière à Dieu, il s'élance... et tombe seulement de sa hauteur sur les bruyères de la plaine. Son fils le relève insensible, et craint un instant que l'imagination, la pensée du fait, n'aient, de concert avec la volonté, dérobé le trésor de vie.
And yet I know not how conceit may rob
The treasury of life, when life itself
Yields to the theft.
Remarquons ou passant qu'Edgar se pose ici un des problèmes les plus insolubles de la physiologie. De même se montre-t-il ensuite grand philosophe, lorsqu'au lieu de heurter de front le désespoir suicide de son père, il le trompe pieusement et lui fait croire à ses jours conservés par un miracle. Le vieillard ne se fût pas résigné à être dupe; dès qu'il se croit protégé par un bienfait inouï de la Providence, enorgueilli, consolé, flatté de cette illusion, il voudra vivre, il souffrira sans se plaindre.
..........Henceforth I'll bear
Affliction, till it do cry out itself,
Enough, enough, and die.
DANS UN OMNIBUS.
Ils sont doux et riants les paysages du comté de Kent. Lorsque les haies vertes qui bordent la route étroite laissent un instant l'oeil du voyageur s'égarer sur le vaste horizon, rien ne trouble la riche harmonie de ce tableau consolant. De tous côtés ondulent mollement les croupes vertes des collines indécises; de tous côtés les grands parcs groupent leurs massifs ombrages autour des demeures seigneuriales, et les hameaux proprets que nous traversions au galop semblaient s'être mis en frais de coquetterie pour nous arrêter un moment. Chaque maisonnette, tapissée au dehors de rosiers et de cobéas, nous laissait entrevoir au dedans, derrière le sceen entr'ouvert, d'autres fleurs plus rares épanouies dans la porcelaine peinte. La porte des plus modestes habitations est d'un vert aussi vif et revêtue; d'un vernis aussi frais que celle du château voisin. Leur fenêtre a cinq pans, qui s'avance en relief sur la route, comme ces logettes pratiquées naguère aux flancs des épais donjons, semble dire aux passant, en leur montrant ses vitres étincelantes et chaque jour lavées: «Vous voyez qu'on pense à vous.» Il n'est pas jusqu'aux grands capots noirs des petites filles jouant au bord du chemin qui ne donnent l'idée du décorum caractéristique et du respect d'autrui si fort en honneur chez nos voisins.
Le premier abord, dans un pays étranger, a ceci de charmant qu'il donne du prix aux incidents les plus simples, aux types les plus vulgaires. Je contemplai longtemps la bonne femme de Douvres qui s'était embarquée avec nous dans l'omnibus de Cantorbéry, avant de m'apercevoir quelle ressemblait de tout point à une Bourgeoise du Marais: c'était le même chapeau de paille à passes de gros de Naples fané, la même robe d'indienne à rayures multicolores, le même col de mousseline brodée, rabattu sur le même châle café au lait, les mêmes gants de fil d'Écosse gris et trop larges, autour des mêmes mains,--trop larges aussi,--les mêmes pieds enflés et débordant sur les mêmes souliers de prunelle éraillée à cothurnes.
Je pus apprécier, en écoutant la conversation engagée entre elle et mon ami, cette disposition toute bienveillante que l'Anglais témoigne aux étrangers, pour peu que ceux-ci ne l'effarouchent point par des manières trop étourdies. Après, s'être assurée que nous prendrions ses renseignements au sérieux, notre compagne de voyage nous fit les honneurs de son pays avec zèle, intelligence et cordialité. Nous ne passions jamais dans un village sans qu'elle ne nous en dit le nom, devant un parc ou un gentleman's seat sans qu'elle ne nous en fit connaître le propriétaire. Elle poussa la préoccupation de nos intérêts jusqu'à s'informer de l'auberge où nous allions descendre, et parut apprendre avec satisfaction que nous avions le projet de nous arrêter au Star-Hotel,--établissement, selon elle, très-respectable.
MINE HOST RICHARDSON.
Nous longions au petit trot les premières maisons de Cantorbéry, lorsqu'un homme âgé, vêtu de noir, figure d'ecclésiastique, et dans lequel je voulais à toute force reconnaître le ministre de Wakefield, sortit d'un jardin et se mit à suivre l'omnibus. Il donnait la main à une petite fille qui pouvait à grand'peine, en courant, tenir tête aux rapides allures, aux longues enjambées de son vénérable guide. Tous deux, cependant allaient aussi vite que nous, et je compris le motif de leur empressement, lorsque je vis le prétendu ministre, debout sur la porte du Star-Hotel, nous accueillir avec la déférence à demi souriante qui caractérise l'aubergiste anglais. Sa femme était à coté de lui, également vêtue de noir, et rappelant assez, par la dignité étudiée de son maintien, les charmantes veuves du Gymnase. Quant à la petite fille, elle avait disparu; mais, derrière un rideau de porte furtivement soulevé, j'entrevis deux yeux bleus pétillants de curiosité. Je fis honneur de ce sentiment, qu'on est toujours bien aise d'inspirer, au ruban ronge que mon compagnon portait à sa boutonnière; il le renvoya poliment à mes favoris et à mes moustaches, qui sont aussi, de l'autre coté du détroit, une décoration étrangère. Quoi qu'il en soit, cette importante question ne nous fit pas oublier de commander le dîner. Quand je dis nous, c'est uniquement par habitude; ce soin regardait exclusivement mon ami, qui, à titre de voyageur émérite, avait naturellement la direction absolue et la responsabilité complète de notre campagne.
Je l'entendis très-distinctement demander du roast-beef, du stock-fisch et un New College pudding. A chacune de ces indications, le grave hôtelier s'inclinait respectueusement et semblait loger nos ordres dans sa mémoire avec la plus exemplaire soumission. Cette précaution prise, et sans même nous donner le temps de secouer la poudre du voyage, nous courûmes à la cathédrale.
SAINT THOMAS DE CANTORBÉRY.
Ceux qui voudront accepter docilement les inspirations du Guide du voyageur feront un grand détour pour aller rejoindre par George-street. Guidhall-street et Palace-street, ce qu'on appelle la Cour-Verte (Green-court); ils y trouveront une porte surbaissée,--l'ancienne porta Prioratas,--ornée de quelques sculptures grotesques et surchargée après coup de fortifications massives qui en ont fait disparaître le caractère originel. Ces arceaux romains à forme demi-circulaire se retrouvent encore encastrés dans les murs de quelques constructions récentes, et enfin, toujours au nord de cette cour, on découvre l'escalier normand, échantillon presque unique d'une architecture admirablement appropriée au climat. Cet escalier couvert, et dont le toit est soutenu par des piliers de hauteur décroissante, conduisait jadis à ce que les vieux plans appellent Aula-Nova, ou la Salle-du-Nord. Les antiquaires ne sont point d'accord sur l'usage primitif de ce bâtiment, démoli en partie vers 1730, et dont les derniers débris ont disparu récemment. L'hypothèse la plus vraisemblable en fait néanmoins la salle des séances de la Haute-Cour. Tout ceci est affaire aux Oldbuck contemporains.
Sans prendre tant de souci de la méthode et du savoir historique, nous vous mènerons par le chemin le plus court à l'extrémité S.-O. de la cathédrale, et nous entrerons dans le cimetière par la porte basse qui ouvre sur le Marché au Beurre, à l'extrémité de Burgate-street.
Une fois là, nous sommes sur une place étroite, irrégulière, pressée entre les maisons basses des prebandiers, çà et là séparées par quelques vieux arbres, et le vaste édifice qui lance hardiment vers le ciel ses trois tours carrées.
Il est impossible, à leur aspect, de ne pas comprendre la vérité de cet axiome qui se popularise peu à peu parmi les architectes modernes, à savoir: que la ligne horizontale domine dans les constructions grecques, la ligne verticale dans celles du Moyen-Age (1). Peut-être faudrait-il ajouter que cette tendance eut pour cause la nécessité des contrastes; l'idée-mère du temple grec semble éclose dans le cerveau d'un montagnard, qui veut opposer la ligne pure, harmonieuse et droite aux rudes contours, aux formes massives et irrégulières des rochers voisins. Il pose son édifice sur une hase élevée qui le dispense de donner à l'édifice lui-même une hauteur considérable; enfin, en l'isolant comme il le fait, il se crée la nécessité de le concevoir dès le principe dans un ensemble complet, et tel, qu'il ne fois réalisé, aucune addition après coup ne peut en altérer l'unité puissante.
Note 1: Horizontalism, if the expression may be used, is the characteristic of the Grecian.--Verticalism of the Gothic.--Quarterly Review, for December 1811.
La cathédrale gothique, tout au contraire, jaillit pour ainsi dire de terre, au centre d'une étroite enceinte; elle doit dominer, pour l'oeil qui va la chercher dans la plaine, et les murailles fortifiées qui la protègent, et le groupe sans cesse exhaussé des maisons qui se pressent autour d'elle. Bâtie sous un ciel inclément, elle a besoin d'offrir de tous côtés à la pluie des pentes glissantes où nulle humidité ne puisse séjourner longtemps; enfin, entourée à sa base ou de verdure ou de constructions bourgeoises, elle imite la fleur qui, pour épanouir son calice, le porte fièrement au-dessus du feuillage envieux. Les ornements recherchés, les sculptures délicates, les enroulements capricieux, les fines ciselures de la pierre, sont ou réservés à la façade, qui s'ouvre toujours sur quelque, place, ou jetés à profusion au haut des tours, ou plaqués en arêtes le long des flèches.
Puis, comme c'est une oeuvre gigantesque qu'une génération qui la commence est certaine de léguer inachevée aux générations à venir;--comme l'ambition ecclésiastique prévoit d'avance l'accroissement des richesses du clergé, l'agrandissement nécessaire des monuments qu'il élève, une sorte d'instinct avertit l'ouvrier qu'il emploie de ne pas donner à son premier plan un caractère définitif. C'est l'agrégation des détails toujours plus magnifiques à mesure que la cathédrale s'exhausse et se développe, c'est cette agrégation qui doit constituer sa beauté; or ces détails ne peuvent être préconçus; ils subiront la loi des temps et des événements humains. Une part doit être faite à l'influence agrandie du culte, une autre aux progrès de l'art, aux variations de la mode, aux caprices mêmes des individus.
Quiconque voudrait étudier à fond le jeu de ces influences diverses trouverait amplement de quoi satisfaire sa curiosité sous les voûtes de cette magnifique église, dont la fondation remonte au premier roi chrétien du la Bretagne (le Romain Lucius, en l'année 181 de l'ère chrétienne), et qui devint cathédrale quatre siècles plus tard, sous le Saxon Ethelbert. Consumée deux fois par l'incendie, en 1011, lors de l'invasion danoise, et en 1070, elle fut reconstruite sur le plan actuel par l'archevêque Lanfranc (1075-1080). Les orgueilleux successeurs de ce prélat renversèrent une partie de l'édifice qu'ils ne trouvaient pas digne d'eux. Le choeur tout entier disparut et fut réédifié à grands frais(1114), puis soixante ans après, survint un troisième incendie qui dévora le nouveau choeur et toute la partie orientale de l'église.
Ici commence à se débrouiller l'histoire architecturale de Cantorbéry. On a la description de l'édifice bâti par Lanfranc(2). On sait, par des vers écrits en 1172, que la grande tour du centre, élevée entre la nef et le choeur, était surmontée d'un faite et d'un ange doré qui lui donnait son nom.
Note 2: Par le moine Gervais.--Decem scriptores, vol. 1295.A bright and glorious cherub is advanced
On this high tower like angel guardian,
That from the neighbouring sky swiftly descends,
Over this sacred place strict watch to keep.
On sait encore que la voûte peinte du choeur de Conrad représentait le ciel; qu'il était rempli de croix et d'images en or et en argent; que dans l'une de ces croix soixante pierres précieuses étaient incrustées. Les mêmes documents nous apprennent qu'en reconstruisant ce choeur incendié, si l'on en conserva les dispositions principales, ou changea, pour les embellir, presque tous les détails; les piliers furent allongés de douze pieds; leurs chapiteaux, simples autrefois, s'évidèrent sous le ciseau des sculpteurs; les arceaux, qui semblaient coupés à la hache, s'adoucirent et s'ornèrent. On remplaça les colonnes de pierre par des colonnes de marbre; les voûtes du choeur et de ses alettes étaient unies, on les broda de nervures délicates et de clefs adroitement sculptées. Un mur lourdement appuyé sur des piliers séparait les transepts du choeur, on détruisit ce mur; ou maria le choeur et les transepts; l'oeil circula librement de l'un aux autres, et monta sans obstacles vers l'énorme voûte qu'ils forment aujourd'hui. Cette voûte était revêtue de boiseries peintes, on y substitua la pierre taillée, le ciment, et cette espèce de stuc qu'on appelle toph, etc.
Nous n'insisterons pas sur toutes ces modifications, essentielles cependant aux jeux de quiconque étudie sérieusement l'histoire de l'art; mais nous serions entraînés trop loin si nous descendions à ces questions de détails. Avertissons seulement le lecteur superficiel qu'en traversant la cathédrale de l'est à l'ouest, il peut prendre une idée sommaire des variations de l'architecture ecclésiastique en Angleterre pendant plus de cinq cents ans. A l'orient, où les formes primitives se sont conservées, il trouve en abondance les piliers courts, trapus, solides, les arceaux ronds et ramassés de l'ère saxonne ou normande: l'édifice n'a pas encore pris son vol hardi, le temple tient encore à la terre. Mais à mesure que vous avancez dans le choeur, vous voyez s'allonger peu à peu l'arceau Romanesque. La transition se fait sentir; tout le choeur, ouvrage de Guillaume de Sens, et surtout la couronne de Becket, en portent la curieuse empreinte. Cette dernière partie de l'édifice, bâtie sous Henri II (1173-1175), est sans contredit une des plus remarquables comme échantillon des premières tentatives faites pour substituer les formes sveltes, les lancettes gothiques, l'ogive pointue, la flèche-fusée aux demi-cercles arrondis, aux supports circulaires, aux parastates romains. L'arceau aigu se marie, dans la couronne de Becket, à l'imitation normande des colonnes corinthiennes. Mans le transept du nord-est, vous trouvez l'ogive supportée par les mêmes piliers où posait naguère l'arceau Romanesque. Vous en trouvez, de ces piliers, dont le feuillage est conforme aux dessins que Palladio nous a conservés du temple au-dessous de Trévi; l'astragale romaine, le rouleau selon Vitruve, le tortis, etc., se retrouvent encore à chaque pas; mais à mesure que vous avancez vers l'admirable screen qui sépare lu choeur de la nef, le vrai gothique, le gothique décoré, comme on l'appelle, semble ouvrir ses ailes et s'élancer. Guillaume l'Anglais,--le premier architecte national,--renchérit sur les leçons de Guillaume de Sens, son maître; la ligne se redresse, la colonne mincit et s'élève, l'ogive s'aiguise, les tours montent; rien n'arrête plus cet essor étrange qui ne compte pas avec les précédents, tient l'unité en mépris et semble n'avoir pour but que de résoudre, à force d'audace, les problèmes capricieux proposés par la fantaisie à la matière.
Le screen avait été construit par le prieur Henri de Estria, sous Édouard 1er, en 1304. Il fallut soixante-dix-neuf ans pour y ajouter les transepts occidentaux et la chapelle de saint Michel; puis trente on quarante ans encore pour élever la nef, longue de deux cent quatorze pieds, haute de quatre-vingts, large de quatre-vingt-quatorze. Elle fut finie sous Henri IV. O. N.
(La suite à un prochain numéro.)
Les Régates du Havre.
27 AOÛT.
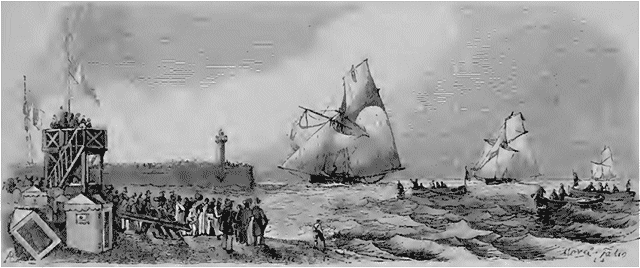
Courses des grandes embarcations.
Ce n'est que depuis peu d'années que les régates, courses d'embarcations à la voile ou à la rame, se sont introduites dans nos ports. Leur origine est vénitienne, car il est d'usage immémorial, dans la cité-reine de l'Adriatique, que les gondoles et les barques dites peote se disputent des prix de vitesse appelés regates. Les gondoliers sont habiles à cette lutte décrite avec tant de poésie par Fenimore Cooper dans son roman du Bravo. De Venise, les régates ont passé en Angleterre, et récemment en France, à la vive satisfaction des habitants du littoral.
Les régates du Havre sont sans contredit les plus brillantes et les plus suivies, grâce à la position de ce port. La proximité de la Grande-Bretagne permet aux Anglais d'y prendre part; la facilité des communications y attire bon nombre de riverains de la Seine, depuis Honfleur jusqu'à Paris. Une population flottante considérable, des étrangers de tous les coins du globe, des navires de toutes les nations, impriment à ces régates un caractère cosmopolite qu'on rencontrerait difficilement ailleurs, fût-ce à Venise on à Marseille. Nous doutons que l'une ou l'autre de ces villes offre aux chaloupes, concurrentes une lice aussi spacieuse, aussi commode, aussi pittoresquement encadrée. La plage, qui forme un hémicycle depuis la jetée jusqu'au cap de la Hève, peut recevoir d'innombrables spectateurs; ils ont en face d'eux la mer sans limites; derrière eux, le Havre, flanqué au nord par les villas d'Ingouville; à droite, les collines de Sainte-Adresse et le phare de la Hève; à gauche, dans un vaporeux lointain, les blanches falaises qui s'étendent entre l'embouchure de la Seine et celle de l'Orne. Il n'y a dans aucun port de France un site comparable à celui-ci, surtout quand l'amphithéâtre du rivage est garni d'une foule tumultueuse, quand des navires franchissent le goulet pour entrer ou sortir, quand des flottilles de canots circulent sur les vagues, quand des navires en panne, mouillés ça et là comme les sentinelles avancées d'un camp maritime, dessinent au bout de l'horizon leurs quilles ventrues et leurs mâtures anguleuses.
Les régates du 27 août 1843 ont dû une solennité inaccoutumée au patronage du contre-amiral prince de Joinville et du duc d'Aumale, A sept heures, l'artillerie du port a salué l'entrée en rade des corvettes à vapeur le Pluton, l'Archimède et le Napoléon, dont la première portait les membres de la famille royale; ils sont descendus à terre une heure après, et ont été conduits par les autorités à l'église de Notre-Dame-de-Grâce. Puis ils ont pris place sur le dôme de la galerie des bains Frascati, près le pavillon aux signaux, déjà les bateaux à voiles qui devaient concourir étaient mouillés à leur place, les voiles appareillées; déjà les canots des juges commissaires couraient des bordées le long de la côte pour établir l'ordre entre les jouteurs. Aussitôt que les princes ont paru sur leur observatoire, le Rôdeur a tiré deux coups de canon, et six bateaux pontés à voile, chacun d'environ douze mètres de longueur à la flottaison, se sont élancés dans la liquide carrière; ils étaient montés par des pêcheurs du Havre et de Honfleur, et quelques-uns avaient encore à bord leurs chaluts parés à mouiller; ils avaient à décrire un orbe à peu près régulier autour des bouées qui servaient de limites. Ils doublèrent facilement la première bouée, vent sous vergue, et la seconde grand large; mais la brise du sud-est qui les avait favorisés vint à mollir subitement. En vain ils poussèrent leur bordée au sud-est pour gagner le vent, un calme plat les laissa à la merci du courant, qu'il leur était imposable de refouler. Pendant que les autres courses commençaient, ils demeurèrent immobiles, et leurs voiles battirent inutilement les mâts; on ne songeait plus à eux, et le calme régnait encore à terre, lorsqu'une fraîcheur, s'élevant du nord-est, les ramena vers leur point de départ avec tant de vitesse qu'on eut à peine le temps d'apprécier leur marche et leur évolution. La Victorine, de Honfleur, patron Pollet, conservant l'avance qu'elle avait eue constamment, arriva au but la première, suivie de près par les Deux-Cousins, du Havre, patron Guilbert. Toutefois l'épreuve fut considérée comme nulle, parce que les vainqueurs n'avaient pas, disait-on, conformément aux règles prescrites, doublé la troisième bouée au vent.
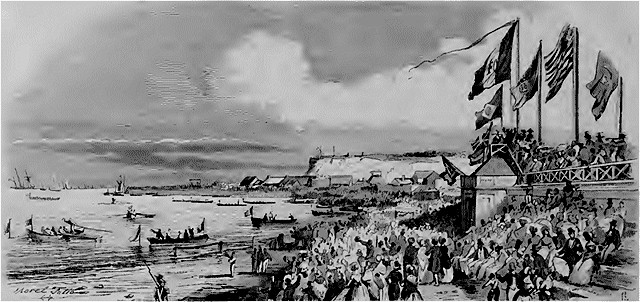
Régates du Havre.--Courses des Baleiniers.
Durant cette contestation, les canots à la rame, à six avirons, couraient parallèlement au rivage: cinq s'étaient inscrits, mais quatre seulement se présentèrent, et l'un d'eux, l'Émulation, cassa son gouvernail à la première bouée; la lutte s'engagea entre l'Éclair, la Riposte et la Fine, et, dès le début, les distances furent marquées. L'Eclair, patron Riconard aîné, gagna le premier prix de 500 fr.; le second, de 100 fr., fut adjugé à la Riposte, patron Léopold Mazerat.
Les bateaux à voiles non pontés, courant d'abord vent arrière, doublèrent aisément la nouée du nord; mais comme leurs devanciers, ils furent longtemps retenus au large, et surpris inopinément par la brise du nord-ouest; cette variation plaça les derniers, ceux qui avaient obtenu l'avantage. Le Vite; qui avait dépassé les huit autres concurrents, se trouva sous le vent presque cap pour cap; le Havre-et-Guadeloupe prit la tête et atteignit le premier le but; le Général-Vandamme marchait le second; tous deux s'attendaient à une ovation, mais les juges-commissaires annulèrent la course, alléguant que le changement du vent, en nécessitant des combinaisons imprévues, avait jeté du doute sur quelques manoeuvres; que l'un des bateaux avait fait usage de l'aviron, et qu'un autre avait mouillé pour se soutenir, contrairement aux prohibitions établies.
Les trois dernières courses ont eu de plus complets résultats; quatre pirogues baleinières sont parties ensemble: l'Hirondelle, patron Alexandre Mauconduit, a pris la tête; la Vaillante, le Petit-Eugène et la Blonde suivaient à quelque distance. A une encablure du but, l'Hirondelle, trop rapprochée, aborda la Vaillante, et pendant que les nageurs s'efforçaient de dégager leurs avirons, le Petit-Eugène, aux acclamations des spectateurs, franchit rapidement le lieu de la collision. L'Hirondelle ne perdit point courage; débarrassée de l'obstacle qui la retenait, laissant derrière elle la Vaillante et la blonde, elle, poursuivit son concurrent, et parvint à le dépasser à la première bouée: elle a remporté le premier prix de 500 fr.; le prix de 10 francs n'a pas été disputé au Petit-Eugène, patron Morin.
Dans la course de canots de fantaisie, deux gigs anglais, le Sphinx et le Grand-Turc, ont lutté contre la Belle-Poule; la Sylphide et Lustucru; le Sphinx, monté par Robert Coombs et quatre mineurs expérimentés, l'a emporté sur la Belle-Poule; l'autre gig anglais n'est arrivé que le dernier; la Sylphide, embarcation de forme nouvelle, et construite en fer, n'a pu soutenir l'épreuve jusqu'au bout.
La dernière course, celle des amateurs, n'avait pour acteurs que des membres de la Société des Régates; la Rouge, Lustucru, Gipsy, le Clown, ont fait assaut d'adresse et d'agilité; le prix unique, qu'à obtenu Gipsy, à M. Cor, était une paire de magnifiques vases en porcelaine de Saxe.
Ainsi se sont terminées les cinquièmes régates du Havre. Les princes sont descendus sur l'estrade du grand salon de Frascati, où le maire a successivement appelé les vainqueurs. Le prince de Joinville a annoncé qu'il accordait à la ville une somme annuelle de 2,000 fr., destinée à fonder de nouveaux prix. Le soir, un feu d'artifice a été tiré en mer, et quoique les pontons fussent trop rapprochés de terre, c'était un beau spectacle que les bombes, dont la courbe se reproduisait dans les eaux, les serpenteaux et les fusées qui tombaient en pluie sur les vagues illuminées, et les flammes du Bengale, dont les reflets multicolores faisaient resplendir la haute mer.
Les deux courses déclarées nulles ont été recommencées conformément à la décision des juges-commissaires. Les Deux-Cousins, patron Sabolle, ont gagné le prix de 1,000 fr.; le Bon-Père, patron Berney, celui de 250 fr.; la Victorine, triomphante la veille, s'est échouée en allant prendre son mouillage. Le premier prix des bateaux à voiles non pontés a été décerné au Vite, appartenant à M. Barbe; le second à La Lionne, appartenant à M. Cor. La Louise, la Mosquita, le Général-Vandamme et l'Ariel ont renoncé. Le Havre-et-Guadeloupe n'a pas couru.
Inauguration de la statue de Henri IV.
A PAU.
L'arrivée de la reine d'Angleterre a trop détourné l'attention publique de cette grande fête nationale, qui semblait justement destinée à avoir un grand retentissement dans toute la France.

Statue de Henri IV, par M Raggi.
Le 25 août, à onze heures et demie, une salve de vingt-un coups de canon a annoncé l'entrée de M, le duc de Montpensier dans la ville de Pau. Le Corps municipal s'est rendu au pont de Jurançon pour recevoir le prince, qui, bientôt après, mettait pied à terre au château où naquit son aïeul, le 15 décembre 1553. Des courses de chevaux, un concert, un bal, deux jours de fêtes préliminaires, ont précédé la grande solennité de l'inauguration, célébrée avec une magnificence digne de son objet. Ce jour-là, le département des Basses-Pyrénées était tout entier concentré dans son chef-lieu, et la population quadruplée ondulait aux abords de la place Royale. Le duc de Montpensier y est arrivé à dix heures, accompagné du conseil-général du département, de l'état-major de la division, des membres de la cour royale et des tribunaux, de M. le duc de Cazes, grand-référendaire de la Chambre des Pairs, du marquis de Lusignan, pair de France, et du lieutenant-général Harispe. A l'approche du cortège, un orchestre dirigé par M. Habeneck a exécuté la Bataille d'Ivry; des choeurs ont chanté d'une voix retentissante une ballade de circonstance dont M. Aube avait composé la musique, et M. Liadères les paroles. Après le dernier couplet, la statue de Henri IV était débarrassée des draperies blanches qui la dérobaient aux regards. Vingt-un coups de canon ont annoncé au loin que le Béarn possédait enfin ce monument tant désiré; les acclamations de vingt mille spectateurs se sont mêlées au bruit de l'artillerie; les choeurs ont fait entendre: Vive Henri IV, et l'orchestre, après avoir accompagné le vieux refrain français, a joué l'air béarnais Là haut sur les montagnes. Alors ont commencé les formes sacramentelles de l'inauguration. Le duc et les principaux fonctionnaires en ont signé le procès-verbal, que l'on a déposé dans un caveau pratiqué sous le piédestal, en y joignant l'histoire de Henri IV, par Pérétixe (édition elzévirienne), le recueil du ses lettres, publié par la Société de l'Histoire de France (2 vol. in-4º), la Henriade, des médailles, et diverses monnaies frappées au seizième siècle. Le comte de Saint-Grieq, président du conseil-général du département, le préfet, le duc de Montpensier, prenant tour à tour la parole, ont rappelé à l'envi les qualités d' Henri le Grand. L'impression produite par ces discours durait encore, quand le duc de Montpensier s'est approché du monument, a scellé la pierre du caveau, et a fait d'un pas lent le tour de la statue, pendant que la musique des régiments répétaient: Vive Henri IV!
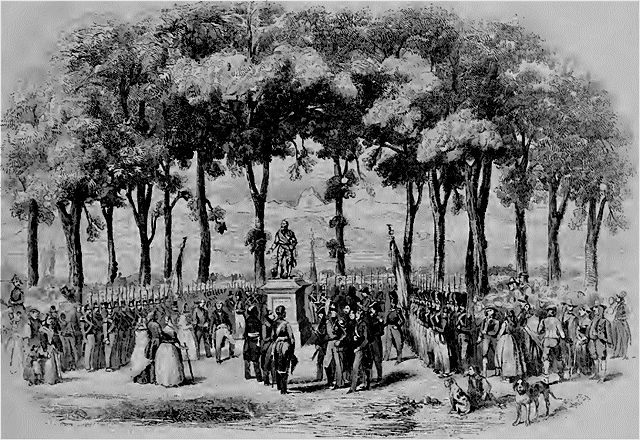
Inauguration de la statue de Henri IV, à Pau.
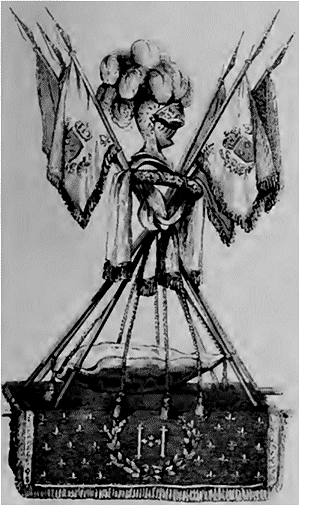
Berceau de Henri IV, au château de Pau.
Les journaux, en rendant compte du cette fête à la fois nationale et locale, ont parlé d'enthousiasme indéfinissable, de cris d'allégresse, de sentiments de bonheur débordant de toutes les âmes, si bien que le lecteur de sang-froid est naturellement tenté de les taxer d'exagération. Rien de plus réel cependant que les transports de joie des habitants de Pau, à la vue du marbre qui reproduit les traits de leur royal concitoyen. On a toujours aimé Henri IV dans toute la France; mais on lui a voué, une espèce de culte dans l'ex-province du Béarn. Là régna longtemps sa famille. Ce fut sa mère, Jeanne d'Albret, qui donna le titre de ville à la bourgade de Pau, le 4 novembre 1502. Les devises d'Henri d'Albret et de son épouse Marguerite sont encore visibles dans les appartements du château qu'ils ont fait bâtir. L'enfance de leur petit-fils Henri IV s'écoula sur les rives du Gave; il fit à Pau l'apprentissage de la vie et du pouvoir; et lorsque les destinées l'eurent appelé au trône de France, il n'oublia point ses chers compatriotes. Aussi écrivait-il, le 20 décembre 1593, en donnant à son lieutenant commission de tenir les états de son royaume de Navarre et du pays souverain de Béarn: «Vous avez déjà assez séjourné dans le pays pour avoir reconnu et observé les moeurs de mes sujets, lesquels je désire que vous mainteniez, en cette ferme créance, que, comme ils sont les premiers sur qui Dieu m'a donné autorité, je veux continuer envers eux ce soin et cette affection singulière que j'ai portés dès ma naissance.»
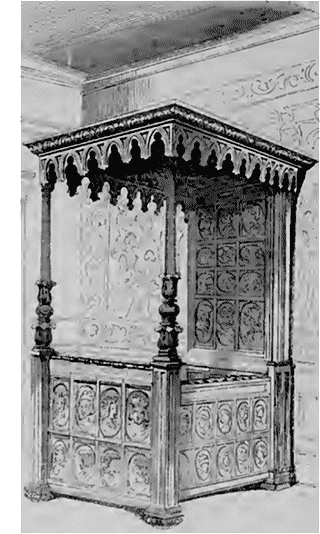
Lit de Henri IV, au château de Pau.
Les Béarnais ont répondu à ces protestations par un attachement inviolable, qui s'est perpétué d'âge en âge. Les paysans des environs montrent encore avec orgueil les lieux qu'il fréquentait de préférence, les rochers qu'il gravissait, les fontaines où il se désaltérait durant ses promenades. On voit, au château de Pau, pour les réparations duquel on a dépensé récemment plus de 500,000 francs, la chambre à coucher où Jeanne d'Albret enfanta en chanta le cantique national: Nouste-Dame deii cap deii Pont, ajudat me d'aqueste hore. On conserve religieusement son lit de bois sculpté, et l'écaille de tortue qui lui servit de berceau. Cette dernière relique, menacée par la Révolution, fut sauvée par M. de Beauregard, qui lui substitua une écaille à peu près semblable dont il était possesseur. L'écaille authentique est placée sur une espèce d'estrade, et surmontée de trophées, qui ne contribuent pas à l'embellir.
Les souvenirs du Béarn peuplent toute la contrée. Au village de Billières situé à l'extrémité occidentale du parc du château, est la maison de Lassensaa, père nourricier de Henri IV. Par un arrêt du Grand Conseil, en l'an 1772, Louis XV accorda cent arpents, sur la plaine de Pont-Long, à la famille Lassensaa; le vieux bâtiment, qui tombait en ruines, fut réparé sous la Restauration. Quand la duchesse de Berri le visita, le 20 juillet 1828, les descendant du nourricier lui présentèrent le bâton sur lequel le jeune Henri s'appuyait dans ses excursions pédestres. Le duc de Montpensier n'a pas voulu quitter les Basses-Pyrénées sans aller en pèlerinage à Billières, et c'est le dernier rejeton de Lassensaa qui lui a fait les honneurs de l'habitation patrimoniale.
Voilà déjà un siècle que les habitants de Pau avaient eu la pensée de consacrer un monument à Henri IV. Les états-provinciaux en votèrent le fonds, et demandèrent une autorisation au gouvernement, qui, pour répondre à leurs voeux, s'empressa de leur envoyer une statue en bronze de Louis XIV. Les malins Béarnais s'en vengèrent en inscrivant sur le piédestal des vers patois qui débutaient ainsi: «A ciou qu'ey l'arrahil den nouste gran Henri (à celui-ci qui est l'arrière-fils de notre grand Henri).» En 1793, ou fondit des canons avec l'image de l'arrahil, et comme on n'eût pas traité moins cavalièrement celle du trisaïeul, les Béarnais durent se féliciter de ne l'avoir pas obtenue. Le monument actuel a été érigé à la place du bronze détruit; il est l'oeuvre de M. Raggi, et a été exposé au Salon de 1842. Le statuaire a consigné sur le livret de cette année les intentions qui ont présidé à sa composition: «Henri IV témoigne à ses nobles guerriers sa volonté de marcher avec son armée au secours de Henri III, et les engage à rassembler autour de lui tous ses vassaux armés pour accomplir ce projet.» En accordant des éloges à l'exécution sévère de la statue, nous croyons qu'il est un peu ambitieux d'avoir voulu exprimer tant de choses complexes par les gestes et l'attitude d'une seule figure.

Maison A Bilhèros, près de Pau, où Henri IV a été nourri.
Il n'est pas sans intérêt de donner quelques détails biographiques sur un sculpteur que Lapérouse et Henri IV achèvent de mettre en évidence. M. Raggi (Nicolas-Bernard) est un Italien naturalisé Français depuis longues années. Né à Carrare, en 1791, il y remporta le second grand prix en 1809. Il étudia à Paris sous la direction de M. Bosio, et se fit remarquer, en 1817, par un jeune discobole prêt à lancer son disque: il obtint la médaille d'or au Salon de 1819, pour un groupe et deux statues, que le livret indique en ces termes: «L'Amour, s'approchant du lit de Psyché, entend soupirer cette, nymphe,» groupe en marbre.--Montesquieu méditant sur l'Esprit des Lois,--Henri IV, statue commandée par le comte Dijon, pour en faire hommage au roi. Ce prince, n'étant encore que roi de Navarre, manifeste à ses sujets le projet du reconquérir le trône de ses ancêtres; il les engage à se réunir autour de lui. La main droite qu'il leur tend exprime sa clémence, et la main gauche, portée sur son sabre, est l'emblème de sa puissance.
L'Amour s'approchant du lit de Psyché est au Luxembourg, le Henri IV à Nérac, et le Montesquieu au Palais-de-Justice de Bordeaux. Nous connaissons de M. Raggi plusieurs travaux remarquables, répartis en divers édifices: à Saint-Étienne-du-Mont, la Vierge tenant l'Enfant-Jésus; à Grenoble, Bayard mourant, statue en bronze; dans la salle d'exposition des sculptures, au Louvre, Hercule retirant de la mer le corps d'Icare; à Versailles, Hugues Capet, statue en marbre; Jean Boucicault et Jacques de Bourbon, en plâtre; à la Madeleine, saint Vincent de Paule et saint Michel.
La fête de Pau a été une ovation pour cet honorable statuaire, que le préfet avait officiellement invité à y assister. Le duc de Montpensier s'est fait présenter M. Raggi ainsi que M. Latapie, qui, en qualité d'architecte de la ville, a coopéré à l'érection du monument.
De la Médecine chez les Arabes (3).
Note 3: Extrait du Rapport officiel de M. le docteur Furnais sur les Causes, la Nature et le traitement des Maladies des Yeux en Afrique.
Malgré le fatalisme inhérent à leur religion, les Arabes accordent une grande confiance à la médecine; et c'est à tort que, certains auteurs ont avancé que les musulmans craignaient de tenter la divinité, en croyant à l'art de guérir.
Les bains sont la panacée universelle des indigènes de l'Algérie; ils les emploient dans toutes les maladies, quels que soient l'âge et le tempérament des malades.
L'application du feu joue un grand rôle dans leur thérapeutique chirurgicale; c'est à l'aide de ce moyen violent qu'ils prétendent guérir les engorgements du foie et de la rate, et une grande partie des maladies d'estomac.
Pour les blessures d'armes à feu, ils rougissent à blanc un anneau ou bague de fer qu'on applique à l'orifice de la plaie, et s'établit ainsi une suppuration et des bourgeonnements de bonne nature, l'introduction de l'air devient difficile, et la guérison est très-prompte.
Pour les foulures, les entorses, les tumeurs et les engorgements des articulations, leur médecine n'est pas moins violente.
M. le gouverneur-général Bugeaud a bien voulu nous communiquer le fait suivant: Un chef arabe nommé Ben-Kadour-Ben-Ismaël, qui accompagnait le général en qualité d'aide-de-camp dans une partie de chasse aux environs d'Oran, tomba de son cheval qui s'abattit sur lui; on releva le cavalier tout foulé, broyé, et on le fit transporter sans connaissance dans une tribu voisine. Quatre jours après, le général, qui le croyait blessé mortellement, ou tout au moins estropié pour toute sa vie, ne fut pas peu surpris de le voir reparaître à cheval dans une revue. On lui apprit qu'un tehib (médecin) appelé près de l'Arabe aussitôt après l'accident, lui avait promené un fer rouge sur les articulations principales des membres supérieurs et inférieurs, après quoi il avait fait bassiner les brûlures avec la teinture du henné, espèce de solution astringente du Lausonia inermis dont les indigènes se servent pour donner une teinte jaunâtre aux ongles, aux mains et quelquefois aux bras et aux jambes. C'était à l'emploi de ces moyens énergiques qu'était due une guérison si prompte et si merveilleuse.
On comprend que de semblable cures, si rares qu'elles soient, suffisent pour perpétuer la foi des Arabes dans les traditions médicales de leurs ancêtres.
L'appareil que les Arabes emploient pour les fractures consiste en une peau de la largeur du membre fracturé; ou pratique sur cette peau des trous suivant une ligue perpendiculaire, et dans ces trous on introduit une lame de roseau on de bois flexible pour chaque colonne; on forme ainsi un appareil complet, pouvant servir à la fois d'attelle et de bandage, qu'on solidifie avec, un amalgame d'étoupe et de mousse, quelquefois de terre glaise et de filasse.
L'entropium, ou renversement des paupières et des cils en dedans, est une maladie très-fréquente en Afrique. Les anciens chirurgiens avaient déjà compris que le seul moyen de guérir radicalement l'entropium était de détruire d'une manière quelconque l'excès de peau de la paupière qui, en se relâchant, se roulait dans l'oeil; pour cela ils se servaient d'un morceau de potasse caustique qu'ils promenaient le long de la paupière; la plaie et la forte, cicatrice qui résultaient de cette brûlure rapetissaient la paupière, qui se dégageait alors du globe de l'oeil, et la guérison était plus on moins complète.
Le procédé arabe, rempli d'une foule d'inconvénients, a été préconise dans ces derniers temps par Helling et par le nommé Quader: ce dernier se l'est approprié en substituant tout simplement de l'acide sulfurique à la potasse caustique.
Quelques Arabes de l'ouest de l'Algérie guérissent l'entropium en faisant un pli à la peau des paupières et en la traversant avec plusieurs soies de cochon, qu'on noue sur le pli, et qu'on serre jusqu'à ce que le bord libre des paupières soit complètement en dehors.
Dans l'Algérie, les barbiers sont les chirurgiens des Maures, et les thalebs savants leurs médecins; quelques secrétistes juifs font aussi de la médecine parmi les habitants des ville».
Les saignées se pratiquent avec des rasoirs, en faisant des mouchetures aux jambes, après les avoir serrées fortement au-dessous du genou avec la corde de leur turban; quant aux saignées du bras, ils les font comme nous, seulement la plupart, ne connaissant pas la position de l'artère brachiale et du tendon du biceps, blessent souvent l'un et l'autre, d'autant plus qu'ils ne se servent que d'une lancette très-longue comme celle des abcès; nous avons été témoins de quelques accidents de ce genre pendant notre séjour en Algérie. Pour saigner à la tête, les tehibs maures serrent le cou à d'aide d'une corde en poil de chameau, de manière à former une turgescence de la face; cette turgescence obtenue, ils incisent la veine qui passe au-dessus de la racine du nez. Pour faciliter l'effusion du sang, les tehibs roulent un bâton sur les incisions; et, pour arrêter la saignée, ils se servent d'une espèce d'emplâtre fait avec de la terre argileuse par-dessus lequel on attache un mouchoir.
Pour les Arabes les plus superstitieux de quelques douairs, les défenses d'un sanglier réduites en poudre, et prises dans un breuvage, guérissent la fièvre.
Le cerveau du chacal donne à l'enfant qui en a mangé la méfiance et la ruse nécessaires à un guerrier maraudeur.
La tête de l'hyène rendrait fou l'homme qui en aurait mangé, et, lancée au milieu d'un troupeau, elle produirait le vertige chez les boeufs, les moutons et les chevaux, etc., etc. Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer toutes les aberrations de cette singulière thérapeutique des indignes des douers.
Les Arabes n'ont aucune notion d'une science toute moderne, l'orthopédie; il est vrai de dire qu'on ne rencontre pas parmi eux cette multitude de difformités qu'on observe en Europe; cela tient à la nature de leur organisation forte et vigoureuse, à leur vie très-sobre, exempte de ces travaux pénibles et assidus qui déforment la taille, et surtout à ce que les enfants rachitiques et scrofuleux, manquant presque toujours de soins, meurent de très-bonne heure; on prétend même que les enfants qui, d'après leur vice de conformation, ne paraissent pas destinés à vivre, n'ont pas à souffrir ou à végéter longuement... les Arabes de quelques tribus passent pour suivre, à l'égard de ces malheureux, la coutume des Spartiates... Nous ne garantissons pas le fait, mais il semble probable, d'autant plus que l'infanticide peut se commettre avec une grande impunité, par la raison qu'on n'a pas pu obtenir, même des indigènes des villes, la déclaration des morts et des naissances et un état civil en règle.
L'art des accouchements est la partie médicale la plus arriérée en Afrique. Dans un grand nombre de tribu les femmes, pour accoucher, s'asseyent sur une espèce de chaise, se tenant par les deux mains à une corde fixée au plafond ou au sommet d'une tente, tandis qu'une matrone, placée derrière, comprime le ventre du haut en bas avec une serviette pliée en long.
Pour les maladies des yeux, malgré leur fréquence en Afrique, la médication arabe n'est guère plus progressive. De temps immémorial, même avant Averrhoës, Albucasis et les anciens médecins de ce pays, on avait cru remarquer que certaines chairs avaient la propriété de fortifier et d'éclaircir la vue, comme par exemple celles de pied d'hirondelle, d'oie, de vipère, de loup, de bouc et d'oiseaux de proie. Aujourd'hui, les Arabes, aussitôt qu'une ophthalmie grave se manifeste, ne songent qu'à deux choses: 1º soustraire l'oeil à l'action de la lumière; 2º le préserver du contact de l'air. Pour cela, ils couvrent, tamponnent et compriment l'oeil avec plusieurs compresses et des mouchoirs de coton fortement serrés autour de la tête. Ils ne touchent pas à cet appareil pendant une semaine; les personnes qui le peuvent restent en repos, et celles qui sont obligées de sortir pour travailler, et qui n'ont qu'un oeil malade, arrangent leur mouchoir de façon à le couvrir complètement, en laissant l'oeil sain à découvert. Au bout de huit jours on ôte les compresses: quelquefois le malade est guéri, d'autres fois l'oeil est fondu et l'on ne trouve qu'un moignon charnu.
Cette médication, quelque étrange qu'elle paraisse, pourrait néanmoins être employé avec succès dans quelques cas; i! s'agirait alors de faire une compression graduelle et de bien choisir l'époque de la maladie; car, dans la période aiguë, lorsque l'oeil se trouve dans un état d'irritation et de turgescence très-prononcées, ce moyen thérapeutique n'aurait d'autre résultat que la perte de l'oeil. Les égyptiens, d'ailleurs, se servent souvent de cette compression au début même de l'ophthalmie purulente, et quelquefois ils guérissent. On sait en outre que cette médication a été employée avec avantage à Paris, dans la maison de refuge des orphelins du choléra. Les Arabes font rarement usage de collyres et de pommades; le plus souvent ils lavent les yeux encore tout enflammés avec du jus de plantes astringentes on avec de l'eau froide, ce qui contribue quelquefois à faire passer des conjonctivites simples à l'état catarrhe purulent.
Il m'est arrivé (et cela est sans doute arrivé à d'autres praticiens qui ont exercé la médecine en Afrique) de faire des prescriptions à des indigènes malades, et de les rencontrer une ou deux semaines après avaient l'ordonnance pendue au cou comme un scapulaire, on bien religieusement cachée sous leurs vêlements, sans avoir fait aucun usage des médicaments présents.
Au mois de juillet dernier, j'ai été chargé par M. le directeur de l'intérieur de l'Algérie d'examiner et de classer, d'après la nature de leurs maladies, les musulmans affectés de maux d'yeux ou de cécité complets, qui pourraient être reçus dans l'établissement qu'on projette de fonder à Alger pour ces malheureux indigènes. Parmi le nombre des personnes qui nous ont été amenées au bureau de Mecque et Médine par les employés de la police maure, il y avait le nommé Mohammed-ben-Quassen, Arabe affecté de fonte de l'oeil droit et de leucoma complet sur l'oeil gauche; la vision était abolie. Ce malheureux portait sur le front, autour de la corde en poil de chameau, quatorze amulettes en peau de la forme d'un carré allongé, et sur lequel on remarque des carrés magiques, quelques lignes écrites en arabe et un grand nombre de signes cabalistiques et de chiffres rangés dans une espère de table pythagoréenne; c'est par leurs différentes combinaisons que les thalebs croient découvrir les choses les plus mystérieuses et opérer les miracles de la sorcellerie.
Voici la traduction libre d'une de ces amulettes,--nous devons cette traduction à l'obligeance de M. Reinaud, membre de l'institut:
On lit en tête: «Au nom du Dieu clément et miséricordieux; que Dieu soit propice à notre seigneur Mahomet, à sa famille et à ses compagnons.»
Vient ensuite le commencement de la sourate XXXVIe du Coran, où Dieu est supposé parler ainsi à Mahomet: «Y.-S., par le Coran sage, tu es du nombre des envoyés divins, et tu marches dans une voie droite. C'est une révélation que l'Être glorieux et clément t'a faite, afin que tu avertisses ton peuple de ce dont leurs pères avaient été avertis et à quoi ils ne songent guère. Notre parole a été prononcée contre la plupart d'entre eux, et ils ne croiront pas. Nous avons chargé leurs cous de chaînes qui leur serrent le menton, et ils ne peuvent plus lever la tête. Nous avons placé une barrière devant eux et une barrière derrière. Nous avons couvert leurs yeux d'un voile, et ils ne voient pas.»
Ces dernières paroles font évidemment allusion à l'état de la personne pour laquelle on les a mises en usage. La suite de l'écrit est destinée à procurer au malade la guérison. Elle commence ainsi: «Au nom de Dieu, par Dieu... Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu; il n'y a de force qu'en Dieu...» Malheureusement l'écriture est si mauvaise, qu'il serait bien difficile d'offrir un sens complet.
Les deux carrés placés au milieu de l'écrit et celui qui est au bas à droite, sont ce qu'on appelle du nom de carrés magiques. Il en est parlé dans nos livres de mathématiques, et ils appartiennent à la science des nombres, qui tenait une si grande place dans les doctrines de Pythagore. Seulement ici, au lieu de chiffres, on a employé des lettres de l'alphabet arabe, qui, à l'exemple des lettres des alphabets hébreu et grec, ont une valeur numérale.
Le carré du milieu, du côté gauche, renferme les lettres  ou 492,
ou 492,
 ou 357 et
ou 357 et  ou 816. Ces neuf signes représentent les neuf
unités, les seules qui, pendant longtemps, ont été exprimées dans le
calcul, jusqu'au moment où l'on a marqué le zéro. Si, comme cela se
rencontre souvent dans les traités arabes de magie, on se borne à
marquer les lettres qui occupent les quatre angles, on a
ou 816. Ces neuf signes représentent les neuf
unités, les seules qui, pendant longtemps, ont été exprimées dans le
calcul, jusqu'au moment où l'on a marqué le zéro. Si, comme cela se
rencontre souvent dans les traités arabes de magie, on se borne à
marquer les lettres qui occupent les quatre angles, on a  ou
8642; ce qui, en procédant comme font les Arabes, de droite à gauche,
présente une progression arithmétique. Le groupe
ou
8642; ce qui, en procédant comme font les Arabes, de droite à gauche,
présente une progression arithmétique. Le groupe  8642 est
précisément celui qui occupe le carré du bas, et ce groupe est répété
quatre fois, chaque fois dans un ordre différent. Sur les divers usages
de ces carrés chez les Orientaux, on peut consulter le deuxième volume
de mon ouvrage intitulé: Monuments arabes, persans et turcs du cabinet
de M. le duc de Blacas.»
8642 est
précisément celui qui occupe le carré du bas, et ce groupe est répété
quatre fois, chaque fois dans un ordre différent. Sur les divers usages
de ces carrés chez les Orientaux, on peut consulter le deuxième volume
de mon ouvrage intitulé: Monuments arabes, persans et turcs du cabinet
de M. le duc de Blacas.»
Chacune de ces amulettes, vendue par les savants ou par les marabouts, coûte aux Arabes de dix à douze sous; quelquefois le panier mystérieux est simplement couvert de sparadrap, et dans ce cas l'ordonnance ne vaut que six sous.
A voir ce charlatanisme superstitieux, croirait-on que ces hommes sont les successeurs d'Aetius, d'Avicenne, d'Haly-Abbas, de Ithaxès, d'Albucasis, d'Averrhoës, et de tant d'autres praticiens arabes qui ont illustré la médecine et la chirurgie dans ce même pays?
La croyance religieuse des Arabes est tellement puissante, que quelquefois, malgré la désorganisation des yeux et la cécité complète, ils ont beaucoup de confiance dans ces sortes de remèdes, et ne désespèrent pas de leur guérison. Eh bien! ces idées absurdes, ces pratiques contraires au bon sens et à la raison, nous étonneraient beaucoup chez un peuple barbare, si l'histoire ne nous avait pas transmis des absurdités pareilles, qui furent longtemps en crédit chez des nations civilisées et parmi les plus hautes classes de la société. N'a-t-on pas vu une reine de France (Catherine de Médicis), qui, pour se préserver des malheurs physiques et moraux, portait sur son ventre une peau de vélin étrangement bariolée, semée de figures et de caractères grecs diversement enluminés? Cette peau avait été préparée par Nostradamus, et plusieurs auteurs contemporains prétendent que c'était la peau d'un enfant égorgé.

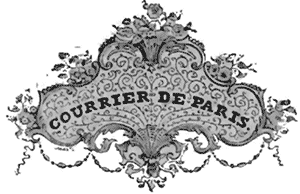
Viendra-t-elle ou ne viendra-t-elle pas?--Telle est la question qui circulait de proche en proche.--Oui, dit l'un. --Non, dit l'autre.--J'en suis sûr.--J'en ai la certitude. --Je le tiens d'une source authentique.--Une personne digne de foi vient de me l'assurer.--Elle sera demain de retour à Brighton.--Elle arrivera demain à Paris.--Son yacht l'attend pour partir.--Sa loge est toute, prête à l'Opéra, --Elle visitera Versailles.--Elle ne le visitera pas.--Vous verrez!--Je ne verrai rien du tout.
Ainsi parlaient les curieux, les donneurs de nouvelles et les oisifs; mais, pour être véridique historien, je dois dire qu'au milieu de tout ce cliquetis de demandes et de réponses, Paris restait indifférent. Le grand éclat qui se faisait à Eu, le grand bruit qui arrivait des bords de l'Océan s'éteignait, pour ainsi dire, aux portes de la ville et n'y apportait qu'un écho affaibli et presque imperceptible.
Vous dites cependant qu'on se questionnait de tous côtés. Oui, sans doute; dans ce Paris immense et perpétuellement agité, il y a eu tout temps, une foule qui se tient aux écoutes et saisit à la volée les nouvelles qui passent dans l'air, pour en causer et s'en distraire; cette population, toujours prête à se mettre à sa fenêtre ou sur sa porte, s'occupe souvent de la première bagatelle venue, d'une tuile qui se détache du toit d'une maison, ou d'un oiseau échappé de sa cage. Comment ne s'occuperait-elle pas de la visite problématique d'une reine étrangère? D'ailleurs, la reine Victoria est jeune, à coup sur, et aimable, dit-on; c'est un hameçon suffisant pour amorcer cette bonne ville de Paris, qui n'aurait pas manqué de lorgner S. M. britannique avec une attention particulière, afin de savoir à quoi s'en tenir sur son compte.
Je ne prétends donc pas que l'arrivée à Paris de la reine d'Angleterre n'eût pas produit un certain effet, comme on doit s'y attendre de tout spectacle singulier et rare; ce que je veux dire, c'est une Paris ne s'est une médiocrement inquiété de cette arrivée, et que, ne la désirant pas, il n'a jamais eu l'air un seul instant d'y croire; la grande scène du Tréport ne lui faisait nulle envie: il en parlait comme, d'une pièce dramatique toute locale et représentée sur un théâtre particulier; quant à prendre, à son tour, sa part de la représentation, encore un coup, c'était le moindre de ses soucis.
Quoi donc! est-ce que Paris aurait perdu la tradition de son antique galanterie et de son hospitalité si renommée? est-ce manque de chevalerie? est-ce rancune?
Pour la galanterie et pour l'hospitalité, je crois, quoiqu'un en dise, que le Paris d'aujourd'hui vaut bien le Paris d'autrefois; ce sont toujours les mêmes moeurs confiantes, affables et faciles; Paris offre volontiers la main à qui vient le visiter; il n'y a pas de ville qui sourie de plus loin à un étranger, et se livre à lui avec plus d'abandon. Ce n'est certes pas Londres qui lui disputera le prix de l'aménité, et de la bienveillance. La reine Victoria aurait donc pu se rendre à Paris à coup sûr; comme femme et comme jeune femme, elle n'y eût rencontré qu'égards et que politesse; Paris, que l'Opéra-Comique a surnommé le paradis des femmes, ne se serait pas changé en enfer tout exprès pour notre royale voisine; et même il aurait loué de grand coeur ses belles dents blanches et jusqu'à sa robe puce, son chapeau de paille, ses rubans jaunes et sa plume d'autruche.
Mais être poli ou empressé, ce sont deux affaires différentes, et certainement Paris n'eût pas poussé les choses jusqu'à l'empressement. Or, pour une jolie femme et pour une reine qui vient à travers la mer vous rendre visite, la froide politesse est-elle une indemnité de voyage suffisante et suffisamment agréable?
Paris a donc de la rancune?--Non vraiment, dans la triste acception du mot; mais Paris a de la mémoire; on l'a souvent traité de ville légère et oublieuse; à la surface, soit! mais dans le fond, Paris est plus sérieux qu'on ne le dit, et se souvient longtemps. Pendant quinze ans, ne semblait-il pas avoir oublié la Restauration? Au 27 juillet 1830, on a vu si la mémoire lui était revenue! d'autres ressentiments, qui datent de la même époque, vivent toujours dans son souvenir, et le présent n'a pas contribué à effarer le passé; il vaut donc mieux que la reine d'Angleterre n'ait pas prolongé son voyage jusqu'à cette ville de mémoire tenace.
Là-bas, où elle est descendue, sur le rivage de la mer, le terrain est neutre en quelque sorte: ce n'est, pour ainsi dire, ni la France ni l'Angleterre; mais ne vous semble-t-il pas que si une reine anglaise, même pour quelques jours de courtoisie et de fête, se fut avancée au coeur du pays et dans la capitale, la terre de France eût éprouvé un douloureux saisissement?
Ah! je vois; vous êtes de ces gens à passions aveugles et inflexibles qui veulent que les peuples se regardent toujours d'un oeil plein de soupçons et de haine. Ne deviniez-vous donc pas que ces entrevues royales rapprochent les gouvernements, adoucissent les ressentiments de nation à nation, et travaillent à l'harmonie générale? Je n'en crois pas un mot:
Le flot les apporta, et le flot les remporte!
Quant à l'amitié des peuples, il est sans doute de leur intérêt de s'entendre le mieux possible, mais de ne pas trop s'aimer. L'amitié extrême est comme l'amour excessif; elle se donne tout entière, sans garantie et sans sûreté, et dans ces passions à deux, il y en a presque toujours un qui perd sa volonté, tandis que l'autre la garde, et celui-là finit par être la dupe de l'autre. Il est bon aussi que les peuples se souviennent.
Paris n'aura fait ainsi aucune avance à la reine d'Angleterre. Quant aux frais de sa solennelle réception, il y a contribué pour une portion bien petite; tandis que le vieux château des Guises étalait un grand luxe d'hospitalité, Paris, la ville souveraine, la capitale du monde civilisé, comme on l'appelle, se contentait d'envoyer à la reine Victoria, pour sa contribution de galanterie, l'Opéra-Comique et le théâtre du Vaudeville, mademoiselle Darcier et M. Moreau-Sainti, d'une part, de l'autre, madame Doche et M. Arnal. Il est difficile de faire moins d'étalage.
Je dois dire que si Paris n'a rien offert de plus, ce n'est pas la faute de messieurs les directeurs et de messieurs les comédiens; tous se sont proposés pour chanter, danser ou déclamer en l'honneur de Sa Majesté Britannique.
Le Théâtre-Français appuyait sa demande sur son vieux blason et son vieux titre de comédien ordinaire du roi; l'Académie royale de Musique parlait de sa couronne lyrique, et semblait vouloir faire des roulades de puissance à puissance; M. Delestre-Poirson s'écriait: «Prenez mon Gymnase!» M. Ancelot: «Mon Vaudeville, je vous en supplie!» tandis que M. Crosnier mettait son Opéra-Comique aux pieds de l'Angleterre; M. Crosnier et M. Ancelot l'ont emporté. Le Théâtre-Français, l'Académie royale de Musique, quittant la partie d'assez mauvaise humeur, se plaignent de leur grandeur méconnue; quant au Gymnase et à M. Poirson, ils déclarent vouloir en référer à madame la duchesse de Berri. M. Crosnier a soutenu sa bonne fortune avec modestie; le jour ou l'Opéra-Comique s'est transporté au château d'Eu, une affiche, placardée sur les grands murs de Paris, disait tout bonnement aux passants: «Théâtre de l'Opéra-Comique, aujourd'hui, relâche.»
M. Ancelot, ancien lecteur de Charles X. n'a pas su contenir sa joie et la garder à huis clos; il a fallu qu'il l'étalât au dehors et la fit déborder. On a pu lire pendant deux jours, sur l'affiche du Vaudeville, ces mots en lettres colossales: «Relâche, pour le service du roi.» Cette formule, pour le service du roi, n'est d'ordinaire employée que pour les ambassadeurs en mission et pour les officiers qui risquent de se faire tuer à la tête d'un régiment ou d'une armée. M. Ancelot, avec le tact et la convenance qui le caractérisent, en a fait emploi à propos d'Arnal et des Cabinets particuliers; c'est une déviation un peu forte de l'usage consacré, qui a d'abord surpris tout le monde; mais on s'est rappelé bien vite que M. Ancelot était fourré dans cette affaire-là, et aussitôt la surprise a cessé; on connaît M. Ancelot; on sait depuis longtemps, qu'il est naturellement porté à entrer en service.
Il s'est passé une singulière aventure au Tréport, le lendemain du débarquement de la reine: la foule avait disparu dès la veille avec le cortège royal: il ne restait plus que de simples mortels, venus là depuis quelques jours pour prendre des bains de mer, et parmi eux des jeunes femmes revêtues de la blouse de toile grise, que les garçons baigneurs plongeaient dans le flot mugissant. Les navires qui avaient accompagné S. M. Victoria ce voyaient, du rivage, immobiles et à l'ancre; quelques matelots seulement étaient à terre. Un d'eux, apercevant cette foule charmante qui s'abandonnait au flot, et séduit sans doute par l'exemple, s'arrêta tout à coup, jeta bas son chapeau, puis sa veste, puis ses vêlements un à un, jusqu'au plus intime, si bien qu'en un clin d'oeil il se montra dans un costume qui n'aurait causé aucune sensation aux îles Marquises ou chez les Hottentots, mais qui parut, au Tréport, d'une mode un peu hasardée. Des holà! partirent de tous côtés, et les naïades scandalisées se plongèrent de plus belle dans le sein d'Amphitrite. A ce bruit, un gendarme chargé de veiller au vestiaire s'avança vers le délinquant. Je ne dirai pas précisément qu'il le saisit par le collet, il n'y avait pas prise; mais il l'apostropha en ces termes;
LE GENDARME.--Que faites-vous là, monsieur?
LE MATELOT.--Moà vôloir promener moà.
LE GENDARME.--Dans ce costume?
LE MATELOT.--Moà vôloir baigner moà.
LE GENDARME.--A la bonne heure! mais on ne se baigne pas ainsi. C'est un peu trop négligé, mon vieux!
LE MATELOT.--Moà vôloir baigner.
LE GENDARME.--M. le maire le défend.
LE MATELOT.--Moà vôloir baigner.
LE GENDARME.--Vous voyez bien que vous faites honte à ces pauvre petits anges.
LE MATELOT.--Moà vôloir baigner.
LE GENDARME.--Allons! vous allez, me suivre.
LE MATELOT.--Moà vôloir...
LE GENDARME.--Finirez-vous?
LE MATELOT, se débattant.--Goddam! Moà pas Français, no French!
LE GENDARME.--Vous n'êtes pas Français, ça se devine; mais vous êtes encore moins vêtu, ça se voit. Et zeste! plus vite que ça. Qu'on se mette en tenue, mon bonhomme, ou sinon...
--By God! s'écria le matelot, moà plus jamais venir en France pour baigner moà, never, never!
Et il reprit sa veste et le reste en jurant, et le gendarme de sourire d'un air vainqueur, et naïades de revenir sur l'eau.
--Il existe depuis quelque temps une bande de malfaiteurs dont l'autorité suit les traces avec vigilance; déjà plusieurs affiliés sont tombés entre les mains des sergents de ville et des hommes de police. Ces misérables sont désignés sous le nom d'endormeurs; c'est aussi à ce qu'il paraît, qu'ils s'appellent eux-mêmes; ils exercent principalement leur industrie scélérate hors barrière, sur les boulevard extérieurs, dans les chemins de ronde ou dans les quartiers les plus déserts; l'heure qui leur convient est l'heure préférée des larrons, la unit! Dès que les ténèbres enveloppent la ville, nos bandits se mettent à l'oeuvre; pareils à des bêtes féroces alléchées par l'odeur d'une proie, ils rodent çà et là; un pauvre ouvrier revenant du travail vient-il à passer, ou quelque soldat attardé, ils l'accostent, lui parlent avec douceur, et de propos en propos, de tendresse en tendresses, lui proposent de sceller leur nouvelle fraternité dans le premier bouchon venu. Notre crédule se laisse faire; on entre dans quelque horrible bouge isolé; puis arrivent les bouteilles et les verres; au moment où les fumées du vin commencent à troubler le cerveau du convive, l'endormeur lui glisse dans son verre une poudre narcotique qui le plonge en quelques minutes dans un sommeil profond. Quand il s'éveille, il se trouve dépouillé des pieds à la tête; on lui a volé son petit pécule, son chapeau, son habit et sa montre d'argent. Puis, cours après, mon pauvre diable!
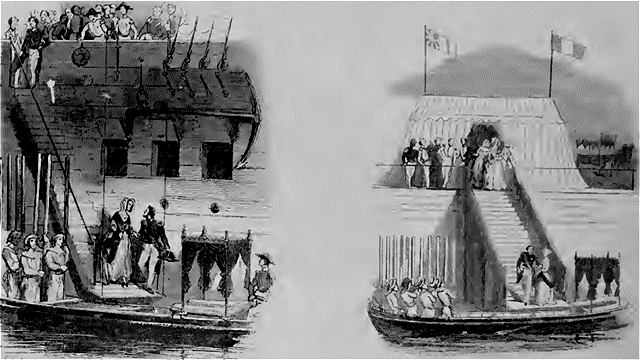
|
La reine d'Angleterre, conduite par Louis-Philippe, entre
dans le canot du brick Marie-Amélie. |
Arrivée de la reine Victoria au débarcadère. |

Matelot du yacht Victoria and
Albert.
La police n'est, heureusement, pas aussi facile à endormir. Nous verrons bientôt une partie de ces endormeurs devant la justice, aux prises avec M. le procureur du roi.
Du reste, il ne faut pas s'y tromper: la race des endormeurs est excessivement étendue: ils ne ressemblent pas tous à ces endormeurs farouches dont nous venons de raconter les misérables exploits; beaucoup même sont de très-honnêtes gens; mais ils n'endorment pas moins. L'endormeur se glisse partout et se cache sous tous les visages et sous tous les habits: vous allez à la Chambre des Députés; un orateur monte à la tribune; vous comptez sur Barnave ou sur Mirabeau: c'est un endormeur.--Césias vous invite à venir entendre la lecture de son poème ou de sa tragédie; quelque grand poète sans doute, pensez-vous chemin faisant.--Quel endormeur! dites-vous au retour.
Et tenez, dans ce procès qui va s'engager devant la Cour d'assises, Dieu sait comme les endormeurs vont être traités par le procureur du roi et par M. le président, qui ne sont peut-être eux-mêmes que des endormeurs en toge et en bonnet carré!
--Il y a beaucoup de galettes ici-bas et de faiseurs de galettes,--je ne compte pas le Salon annuel;-mais il n'y a vraiment qu'une Galette au monde, c'est la galette du Gymnase. Sur le boulevard Bonne-Nouvelle, à l'angle du théâtre pour lequel M. Scribe a pétri tant de petits gâteaux délicats, croustillants et parfumés, s'élève cette fabrique de galettes d'une réputation européenne. Qui n'a pas goûté de la galette du Gymnase, n'a pas vécu; c'est à s'en manger les doigts. Toute galette pâlit à côté de celle-là: supposez une galette cent fois meilleure, les gourmets la déclareront détestable; la vogue y est, cela suffit; la vogue est connue l'amour, elle fait trouver excellentes les plus plates palettes.
On a souvent dit qu'on avait vu des rois épouser des bergères: je n'en ai pas la preuve, mais je suis bien tenté de croire que des rois ont tâté de la galette du Gymnase; j'ai vu, de mes propres yeux vu, un prince héréditaire d'Allemagne qui en achetait un soir pour ses deux sous: M. le duc de Brunswick!
Il y a des gens qui viennent de la barrière de l'Étoile et de la barrière du Trône pour en manger: que de fois le gamin de Paris, la grisette, le clerc d'huissier, la marchande de modes, le commis marchand, se sont détournés de leur route pour arriver à cette admirable galette par un long circuit.
Voyez où deux sous de galette peuvent vous mener! L'inventeur de cette merveilleuse galette est devenu un riche propriétaire: il possède trois ou quatre maisons à Paris et un château en Normandie; il est électeur, éligible, et quelque arrondissement de bonne pâte en fera tôt ou tard son représentant.
Cette richesse commence à éclater sur le boulevard Bonne-Nouvelle même. Tout à côté de l'humble échoppe où il a fait fortune en débitant sa denrée sou à sou, notre homme vient d'ouvrir une élégante boutique de pâtisserie. Que dis-je, une boutique? C'est un vrai boudoir éclatant de lumière, mignon, coquet, paré; on le regarde, on s'extasie, mais personne n'y entre; la pâtisserie y sèche sur place. Heureusement que le marchand de galette, plus avisé que tant de parvenus et d'enrichis, n'a pas tué sa poule aux oeufs d'or; son échoppe à galette est toujours là, et tout le monde y court. Que cela vous serve de leçon, ô pâtissiers!
--La famille Félix est une mine à tirades: elle a produit mademoiselle Rachel, et, après un tel trésor, on aurait pu la croire épuisée; mais point du tout; on y découvre tous les jours, à ce qu'il paraît, quelques filons inattendus promettent d'autres richesses. Ici, mademoiselle Sarah, soeur puînée; là, mademoiselle Rébecca, soeur cadette; plus loin, M. Raphaël, frère imberbe, sans compter les Eliacin, les Joas et les Jéroboam qui sont peut-être encore au berceau.
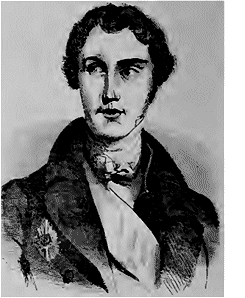
Lord Aberdeen.
Mademoiselle Sarah annonce une cantatrice; M. Raphaël sera un don Rodrigue, et mademoiselle Rébecca une Chimène. Laissez pousser toute cette Judée, et dans deux ou trois ans, mademoiselle Rachel, assemblant sa tribu, lui donnera le Théâtre-Français pour empire, et pour arche sainte le trou du souffleur.
--Nous avons fait dernièrement au Don Pasquale de Donizetti un cadeau que nous sommes très-heureux de lui reprendre; le bruit que ce charmant ouvrage avait été froidement accueilli à Vienne, nous était arrivé je ne sais de quel coin de l'horizon, et nous avions annoncé le fait ingénument. Entre nous, loin d'en vouloir à Don Pasquale, c'était aux Allemands de Vienne, qui n'avaient pas eu le goût de l'applaudir, que nous en voulions; nouvelle erreur! Vienne ne méritait pas cette rancune; Vienne s'était conduite pour Don Pasquale en ville musicale qu'elle est, et Don Pasquale l'avait ravie; peut-être même, à l'heure où je vous parle, bat-elle encore des mains en l'honneur de ce spirituel ouvrage.
La France, il est vrai, avait donné le signal l'hiver dernier; et, depuis, Don Pasquale a fait son tour de France escorté de bravos.
Bon augure pour le Don Sébastien que l'Opéra nous prépare à grands frais, et pour la Maria di Rohan qui charmera bientôt les dilettanti de notre Théâtre-Italien. Pour le coup, Vienne a eu la primeur du succès; Vienne, en saluant dernièrement Maria avec enthousiasme, a regagné l'avance que nous avions prise pour Don Pasquale: Paris et Vienne sont maintenant manche à manche. Voyons! à qui gagnera la belle!
--Revenons cependant à la reine Victoria: puisque Paris ne saurait en parler de visu, c'est-à-dire après l'avoir vue de sa propre personne, il faut bien que quelqu'un y supplée et fournisse au moins l'image, si l'original fait défaut. Ce quelqu'un-là, qui se charge aussi de procurer aux amateurs le profil des Majestés absentes, ce complaisant daguerréotype sera l'Illustration. Et ce n'est pas une vaine promesse que je fais: aussitôt promis, aussitôt exécuté. Voici, en effet, le portrait de Sa gracieuse Majesté britannique, que l'Illustration a l'honneur de le présenter, chéri lecteur. Examine, prends-en tout à ton aise, et tu seras presque aussi avancé que si tu avais entrepris le voyage d'Eu et bivouaqué au Tréport.
Le mot roi ou reine est un mot qui séduit les imaginations. Qui dit roi, pour beaucoup d'honnêtes gens, parle d'un être surnaturel, doué de la fierté de Mars, de la force d'Hercule, et du sourcil de Jupiter; une reine, de son côté, n'est pas reine à moins d'avoir le profil de Junon et la stature de mademoiselle Georges. Les rois et les reines de théâtre en sont cause.
Mais, en réalité, rois et reines se rapprochent singulièrement des simples mortels, et ils ont raison. On peut s'en convaincre de jour en jour davantage, maintenant qu'on les touche de si près.
La reine Victoria en donne une nouvelle preuve. Voyez ses traits! Malgré la triple couronne qui ceint son front, est-ce une Junon terrible'! Non pas, vraiment, mais une aimable personne, au visage enjoué et doux, ce qu'on appellerait ici une agréable petite femme. A quoi bon autre chose?
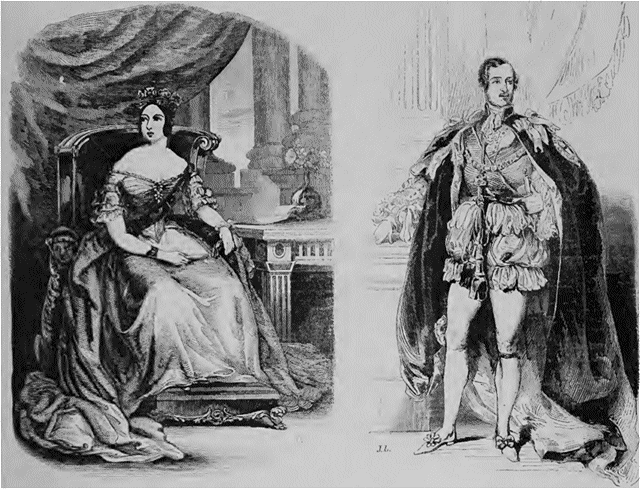
| La reine Victoria. | Le prince Albert. |
A côté de Victoria nous vous offrons le prince Albert; la fonction du prince consistant spécialement à être le mari de la reine, Dieu nous garde de les séparer!--Le prince appartient à l'espèce des beaux hommes: il est grand, élancé, résolu, et possède toutes les qualité de son emploi. Le prince Albert sort de la famille des Saxe-Cobourg, qui peuple, depuis quelque temps, la plupart des trônes d'Europe.
Après la reine et le mari de la reine, quoi de plus juste et de plus nécessaire que de monsieur le ministre? Or, entre toutes les excellences qui composent le conseil de S. M. la reine des trois royaumes unis, lord Aberdeen était naturellement désigné par ses fonctions pour l'accompagner au château d'Eu; pour un voyage à l'étranger, rien ne vaut, ce me semble, un ministre des affaires étrangères.
Ce n'est pas la première fois que lord Aberdeen tient le portefeuille des relations extérieures, comme on disait du temps de Napoléon; il a eu deux fois cet honneur. En outre, milord a été ministre des colonies, sous la présidence de Wellington.
Sa noblesse n'est pas des plus anciennes; il n'est que le quatrième comte de sa race; quant à ses titres, lord Aberdeen en a plus d'un conseiller privé, membre de la Société Royale, président de la Société des Antiquaires, chevalier du Chardon, etc., etc.
Il ne hait pas le mariage, puisqu'il a été marié deux fois; la première fois avec la fille du marquis d'Abercon, la seconde fois avec la fille de l'honorable J. Douglas.
Au physique, lord Aberdeen est du moyenne taille, sans grâce et peu recherché dans sa parure; on en ferait très-difficilement un lion. Son vêtement est toujours trop large et mal coupé; mais en revanche il est rarement neuf.
Bien que milord tienne habituellement ses mains croisées derrière le dos, il ne se donne pas pour Napoléon. A tout prendre, c'est un homme calme, prudent, patient, discret, laborieux, qui parle bas et se dandine sur ses talons; en France on dirait de lui: Cet homme-là entend les affaires.
Je finis en vous priant de jeter les yeux sur un simple matelot fait à l'image des matelots employés sur le yacht de la reine; peut-être est-ce le héros de l'aventure nautique que j'ai eu l'honneur de vous raconter là-haut; ici, du moins, notre homme est d'une tenue convenable, et le gendarme n'a point à intervenir.
Item deux petits dessins représentant l'un le débarquement de la reine, l'autre son passage du yacht dans le navire français.
Mais ce n'est là, ô lecteur! mon ami, qu'une dragée pour te faire prendre, patience; l'Illustration te réserve d'autres dessins pour la semaine prochaine. Au revoir!

Romanciers contemporains.
CHARLES DICKENS.

C'est en quelque sorte un devoir que de mettre en honneur le nom, que de répandre les oeuvres d'un romancier dont les ouvrages laissent le lecteur plus sympathique, plus heureux, meilleur enfin à la dernière page qu'il ne l'était à l'ouverture du livre. C'est là le premier, le plus bel éloge dû à Charles Dickens. En quelque obscur séjour qu'il aperçoive un homme, quelque profondes que soient les rides qui le défigurent, il sait démêler en lui ce qui s'y trouve encore de l'empreinte divine, pour le faire éclater à nos yeux. Des grâces vraiment naïves et ignorées se décèlent à son regard observateur sous l'enveloppe de la laideur même; le battement de coeur du Samaritain vibre dans sa poitrine, et c'est pourquoi il nous intéresse à chaque passant, et partout nous fait voir et aimer notre prochain, notre frère.
Dickens n'est pas au nombre de ces flatteurs que l'aurore de la souveraineté du peuple a fait si rapidement éclore, et qui, traitant, les masses rumine les courtisans du temps jadis traitaient les monarques, louent la foule, afin de l'égarer, et, s'ils n'en peuvent tirer pied ou aile, cherchent du moins à s'en faire une échelle. Ami sincère et compatissant du pauvre et du délaissé, il plaint ses vices, stimule ses vertus, qu'il admire et qu'il peint avec une tendre complaisance. Son oeil attendri plonge dans tous les réceptacles de la misère, et les haillons ne lui sauraient cacher la noblesse native, l'énergie, la pureté, le dévouement, la charité, qui, tels que des métaux précieux, d'inestimables pierreries, restent souvent enfouis dans l'ombre. C'est plaisir de le voir fouiller la mine, enlever le diamant et l'enchâsser dans son style à facéties brillantes, qui réfléchissent tant de nuances, qui concentrent et renvoient tant d'errantes lueurs. Dickens tient une haute place dans cette élite de hardis prosateurs qui ont su découvrir la poésie domestique assise au coin du foyer obscur, comme la Cendrillon du conte; mais il n'emprunte point les baguettes des fées pour la revêtir d'habits magnifiques et la douer d'un éclat étranger; il la drape dans sa souquenille de tous les jours, et vous rend amoureux de sa grâce modeste, de son charme ingénu.
Jamais palais somptueux ne me pourrait plaire autant que les humbles demeures que Dickens nous fait voir à l'aide de son bienveillant microscope. Il me souvient, entre autres, de la pauvre maison d'une blanchisseuse; demeure qui n'avait pour parure que l'ordre, le travail, la bonne humeur, et qu'il fait apparaître toute rayonnante de l'amour et du dévouement quotidien d'une mère, tout enchantée de la tendresse d'un fils, parée des grâces de l'enfance, résonnante de ses rires joyeux, et égayée encore par les gentillesses bouffonnes et les grimaces boudeuses du bambin, qui berce un frère nouveau-né. Il me semble, en vérité, voir dans Dickens un Homère du foyer domestique, guidé par Wordsworth et Crabbe, dans les cabanes éparses, au chevet du pauvre, et jusque dans l'asile, poétique encore, de l'idiot et du fou.
Les premiers essais de Dickens furent des scènes détachées lancées dans un journal mensuel. Elles annonçaient un esprit satirique et mordant, habile à saisir le ridicule, sollicitant le rire par des traits moqueurs fortement accentués; mais le coeur sympathique et tendre du romancier se fit jour bientôt dans les créations badines de sa verve moqueuse. Voyez, entre autres, Pickwick. D'abord Dickens s'amuse, impitoyable railleur, de la solennelle vanité du personnage, de ses prétentions de touriste, de ses tablettes, de ses futiles observations, de la niaiserie de ses amis; mais à mesure que ce type de l'importance puérile du bourgeois clubiste de Londres acquiert sous sa plume de l'individualité, à mesure qu'il vit avec lui, il se prend à l'aimer. A force de travailler sa statue, l'ancien statuaire la pénétra de son âme, et, voyant palpiter la vie, il aima. Il en est de même de Dickens: il découvre les qualités de Pickwick. Cette vanité ne couvre-t-elle pas de la bonhomie du coeur? Cet entêtement n'est-il pas fondé sur la droiture? Cette puérilité même n'a-t-elle pas son charme enfantin. Car, si le vieillard se rapproche de l'enfance par la faiblesse, il emprunte parfois quelques-unes de ses touchantes grâces. Dickens le sait, il le sent, et voilà que les scènes détachées deviennent une histoire, et joignent au plaisant de la caricature l'intérêt de la vie du roman.
A mes yeux, ce mouvement, ce procédé du talent de Dickens se retrouve plus ou moins dans tout ce qu'il fait. C'est constamment son coeur qui s'empare de ce qu'avaient préparé son esprit et son imagination. De là nait sans doute cette alternative de rires et de pleurs qui tient l'âme de son lecteur en balance. Et tandis qu'on éprouve un vif plaisir à le lire, rien ne vous pousse à chercher avec anxiété un dénouement, une catastrophe. Ses ouvrages (est-ce un défaut?) n'ont pas les conditions exigées par l'ancienne poétique, qui veut que tout tende à un même but, et que toutes les parties d'une oeuvre se coordonnent pour y arriver. Dickens ne construit pas une pyramide dont toutes les pierres, faites l'une pour l'autre, ont leur place marquée, et, par les quatre côtés, conduisent au faîte. Il sculpte des statues animées que l'oeil aime à considérer sous toutes leurs faces, sans qu'une partie force nécessairement à en désirer une autre. Mais pourquoi la poésie, la littérature, l'art, n'auraient-ils pas des formes et des procédés aussi variés que la nature qu'ils sont appelés à reproduire?
Il nous serait, du reste, impossible de reprocher à l'auteur anglais une disposition de talent qui nous permet d'isoler quelques parties de son dernier ouvrage sans en diminuer l'intérêt. Quoi qu'en puissent dire les critiques, le meilleur moyen de connaître un auteur, c'est de le lire. Nous suivrons donc l'orgueilleux et égoïste Martin et le bienveillant Mark dans leur voyage au Nouveau-Monde, curieux de voir avec Dickens les moeurs d'une terre nouvelle, et l'Amérique jugée par un Anglais doué d'une si perçante et si fine observation.
TRAVERSÉE
DE MARTIN ET DE SON SERVITEUR
MARK TAPLEY.
SUR LE VAISSEAU DE TRANSPORT LE SCREW.
La nuit était lugubre, obscure; c'était l'heure où chacun s'enfonce plus profondément dans son lit où le cercle attardé se resserre autour du foyer, où, plus froide même que la charité, la misère grelotte au coin des rues; les cloches vibraient encore du redoutable son d'une heure que venaient de frapper leurs ballants; la terre, revêtue d'un linceul noir, portait le deuil du jour écoulé, et, plumes gigantesques de la pompe funèbre, de sombres groupes d'arbres agitaient tristement leurs cimes. Tout était repos, silence. Seuls, les nuages traversaient l'air devant la lune voilée, et le vent, rampant à leur suite, s'arrêtait pour écouter, repartait avec un léger bruit, s'arrêtait de nouveau et repartait encore, comme l'Indien qui poursuit une piste.
Vents, nuages, où fuyez-vous si vite? Semblables aux esprits du mal, les éléments volent-ils à quelque effrayant rendez-vous? Dans quelles régions sauvages tiennent-ils conseil? En quels lieux se livrent-ils à leurs terribles jeux?
Ici, affranchis de cette prison qu'on appelle terre, ils se ruent sur l'espace immense des eaux. C'est là qu'ils rugissent, crient, hurlent, tempêtent toute la longue nuit. Là, les cavernes qui bordent les flancs de cette île lointaine, si paisiblement endormie au sein des flots écumeux, lancent leurs voix retentissantes, au-devant desquelles accourent, du fond de déserts inconnus, les souffles dévastateurs. Là, dans l'emportement d'une licence effrénée, ils s'ébattent, luttent, guerroient, jusqu'à ce que la mer, émue à leur appel, bondisse plus furieuse qu'eux tous, et que l'air et l'eau se confondent en une tourbillonnante rage.
En avant! en avant! sur l'espace sans humes où roulent les pesantes vagues. Là sont des monts, là des vallées; mais non, l'un devient l'autre, et bientôt tout n'est plus qu'un bouillonnant amas d'ondes fugitives. Chasse et fuite, et retour emporté de la vague sur la vague, lutte sauvage, terminée par de rejaillissantes écumes qui blanchissent la noire nuit. Formes, places, couleurs, tout incessamment varie: rien de stable, éternel combat. En avant! en avant!... Les flots roulent obscurcissant la nuit, les vents hurlent avec plus de furie, et les voix de l'abîme s'élèvent plus terribles, quand ce cri sauvage: «Un vaisseau!» vient dominer la tempête.
La nef s'avance, rapide; ses hauts mâts ont vibré, ses flancs tressaillent à l'unisson. Elle s'avance, tantôt montée sur les flots recourbés, tantôt plongeant dans les profondeurs de la mer, comme pour se soustraire un instant à sa rage, et chaque mugissement des eaux, chaque sifflement des vents, d'une voix plus tonnante encore, a crié: «un vaisseau!»
Il marche; il lutte. Pour voir sa course audacieuse, les vagues dressent l'une par-dessus l'autre leurs têtes blanchissantes. Aussi loin que l'oeil du matelot perce l'ombre, il les voit accourir, se ruant, se poussant l'une l'autre dans leur formidable curiosité. Elles se dressent, mugissent, retombent, et la nef avance toujours. La nuit a contemplé ces houles grossissantes, l'aurore les retrouve assiégeant le vaisseau. N'importe, il marche encore, il marche toujours. En avant! il chevauche avec ses douteuses lueurs avec la cargaison de passagers endormis dans ses flancs. Ils donnent comme s'ils n'avaient rien à craindre des éléments acharnés à leur perte, comme si l'abîme, tombe sans fond de tant de braves marins, ne se pouvait rouvrir!
An nombre de ces voyageurs endormis se trouvaient Martin et son humble serviteur, Mark Tapley. Bercés, par ce roulis inaccoutumé, dans un sommeil léthargique, ils demeuraient tous deux aussi insensibles à l'atmosphère fétide du dedans qu'au fracas assourdissant du dehors. Il faisait grand jour quand Mark s'éveilla enfin, rêvant à demi qu'il s'était assoupi la veille dans un lit à baldaquin, lequel, par une soudaine culbute, s'était retourné la nuit sens dessus dessous. Et, admirez l'infaillibilité des songes! les premiers objets qui frappèrent les yeux à demi ouverts de Mark Tapley, ce furent ses propres talons qui, d'une élévation presque perpendiculaire, le toisaient, comme il le remarqua plus tard, tout à fait de haut en bas.
«Bon! dit Mark, lorsque, luttant avec des chances diverses contre le tangage du vaisseau, il fut parvenu à reprendre son aplomb; c'est pourtant la première fois que j'aurai passé toute la sainte nuit debout sur ma tête!
--Vous n'aviez qu'à ne pas vous coucher la tête sous le vent, en regard des amures(3), grommela un homme du fond de sa cabane(4).
Note 3: Amures, cordages qui tiennent la voile en la rattachant du côté d'où vient le vent.
Note 4: Cabanes, couchettes fixées l'une au-dessus de l'autre tout autour d'une cabine, et qui servent de lit aux matelots et aux passagers de seconde classe.
--En regard de quoi?» demanda Mark.
L'homme répéta son observation.
«Soit, je m'en garderai bien, quand je saurai sur quelle partie de la carte se trouvent ces contrées, reprit Mark. En attendant, vous ne risquez rien d'accepter aussi mon petit bout d'avis, et, si vous voulez m'en croire, ni vous, ni aucun autre ami des miens, jouissant d'une tête sur ses deux épaules, n'ira s'exposer désormais à dormir dans un vaisseau.»
L'homme approuva avec un sourd grognement, et se retourna en ramenant la couverture sur sa tête.
«Car, poursuit à demi-voix Mark Tapley en manière de monologue, de toutes les choses stupides, la plus absurde, à mon gré, c'est la mer. Jamais elle ne sait que faire et que devenir; comme elle n'a pas d'emploi qui vaille, elle passe son temps à se tourmenter en vraie furieuse; elle ne sait pas plus se tenir tranquille que les ours du pôle, qui, dans une ménagerie, ne font que secouer leur crinière blanche de ci de là; ce qui ne vient, voyez-vous, que d'une étrange stupidité!
--Est-ce vous. Mark? demanda une voix faible du fond d'une autre cabane.
--C'est du moins tout ce qui reste de moi, monsieur, après une quinzaine de cette rude besogne, répliqua Mark Tapley. Ajoutez que depuis que je suis à bord, je passe les trois quarts de mon temps la tête en bas, les jambes en haut, accroché, à la façon des mouches, à tout ce qui se rencontre. Avec cela, monsieur, que je ne fais presque plus rien entrer dans ma carcasse, et que tout en sort par toutes sortes de chemins. Certes, il ne reste pas assez du pauvre Mark pour que je puisse jurer de par lui! Mais, vous-même, monsieur, comment vous sentez-vous ce matin?
--Très-misérable, répondit Martin avec un gémissement humoriste, Ouf! la pitoyable vie!
--Oui-da! cela commence à compter, murmura Mark, appuyant sa main sur sa tête endolorie et regardant tout autour avec une bizarre grimace. Il y a plaisir ici à présent, et l'on peut au moins se savoir gré de s'y maintenir gaillard. La vertu est sa propre récompense; la joyeuse humeur idem.»
Mark avait raison. Assurément, quiconque pouvait conserver sa bonne humeur dans le logement d'avant du noble et rapide vaisseau le Screw, n'en était redevable qu'à ses propres ressources, et avait du s'approvisionner de gaieté comme de vivres, sans la plus légère assistance des propriétaires du navire. Une cabine sombre, basse, étouffée, entourée de couchettes qui regorgent d'hommes, de femmes, d'enfants, en proie à tous les degrés de misère ou de maladie, n'est guère un lieu de joyeuse réunion. Mais lorsque la foule s'y entasse, comme il arrive dans l'avant du Screw, à chaque traversée de l'Ancien-Monde au Nouveau, lorsque, couchettes et matelas s'amoncellent sur le plancher, dans le plus complet oubli de tout bien-être, de toute propreté, de toute décence, le séjour d'un pareil antre n'est plus seulement un obstacle à toute gaieté, à toute aménité, c'est encore un encouragement à l'égoïsme et à la mauvaise humeur. Mark le sentait, tandis qu'assis sur son séant, il promenait ses regards autour de lui, et ses esprits s'exaltèrent en proportion.
Il y avait là des Anglais, des Irlandais, des Gallois, des Écossais, tous munis de leur petite provision de mauvais vivres et de méchants effets, la plupart avec toute une maisonnée d'enfants: il s'en trouvait la de tout âge depuis le nourrisson à la mamelle jusqu'à la fille dégingandée presque aussi grande que sa mère; toutes les variétés de maux qu'engendre la misère, la maladie, l'excès, les chagrins et une longue traversée par un gros temps, pullulaient dans l'étroit espace. Et pourtant cette arche fétide renfermait moins de lamentations et de plaintes, et beaucoup plus d'assistance mutuelle et de bienveillance que nombre de salles de bal.
L'oeil attendri de Mark parcourut la noire enceinte, et sa figure éclaircie rayonna, ici, une bonne vieille grand'mère chantonnait sur l'enfant malade qu'elle dandinait et berçait entre des bras à peine moins décharnés que les membres rachitiques du jeune innocent. Là, une pauvre femme lavait les langes d'un tout petit nourrisson, tandis qu'elle en apaisait un autre échappé du lit étroit pour venir ramper autour d'elle sur le carreau, et qu'elle retenait en son giron un troisième marmot. Plus loin, c'étaient des vieillards gauchement occupés à remplir un millier de petits offices domestiques, dans lesquels ils eussent paru ridicules, si la tendresse et la bonté pouvaient l'être jamais. Ailleurs, des gaillards basanés, espèces de robustes géants, s'escrimaient à rendre d'affectueux et tendres services, tels qu'on aurait pu les espérer à peine des plus frêles, des plus délicates organisations. L'idiot même, assis tout le long du jour à marmotter dans son coin, éveillé à l'imitation par tout ce qui se passait autour de lui, s'essayait à faire claquer ses doigts pour amuser un petit pleureur.
«A mon tour,» dit Mark, hochant la tête, à une femme qui habillait ses trois enfants dans le voisinage. En parlant, il étendait gracieusement les deux coins de sa bouche d'une oreille à l'autre.» Allons! passez-moi vite une de mes jeunes pratiques.
--S'il vous plaisait sonner à mon déjeuner, Mark, au lieu de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas?» dit Martin avec impatience.
«Juste! reprit Mark; elle va le faire. Voilà la vraie division du travail, monsieur: je débarbouille sa marmaille pendant qu'elle prépare notre thé. Jamais je n'ai su faire du thé potable, moi, et tout le monde sait laver le nez, à un marmot.»
La femme, faible et malade, sentait, et à juste titre, toute la bonté de Mark, dont le large manteau l'enveloppait, elle et sa couvée, toutes les nuits, tandis qu'il se contentait pour lui-même d'une planche unie et d'une grossière couverture. Quant à Martin, qui se levait rarement et s'inquiétait peu de ce qui se passait autour de lui, poussé à bout par l'extravagante sympathie de son domestique, il exhala son humeur en un juron inarticulé.
«C'est cela même, à dit Mark continuant de brosser les cheveux de l'enfant qu'il avait sous la main avec tout le sang-froid d'un perruquier de profession.
«Comment? de quoi parlez-vous? demanda Martin.
--De ce que vous dites, monsieur, répliqua Mark. Assurément il y a de quoi jurer quand on y songe, et je sens tout juste comme vous, monsieur: c'est bien dur pour elle.
--Dur! quoi?
--Eh! oui, de faire ce voyage toute seule, avec ces petits embarras d'enfants que voilà. S'en aller si loin par des temps pareils et pour rejoindre son mari!... Allons donc, monsieur l'Éveillé, ajouta Mark Tapley s'adressant au second enfant dont il tenait la tête au-dessus d'une cuvette; si vous ne voulez pas que le savon vous fasse cuire les yeux à vous rendre fou, ayez, la bouté de les fermer bien vite!
--Elle va rejoindre son mari? répéta Martin en bâillant; et où?
--C'est ce que j'ai peur qu'elle ne sache pas bien elle-même, répondit Mark en baissant la voix. Pourvu qu'elle ne le manque pas encore! car elle a envoyé sa dernière lettre par une occasion, et il ne paraît pas qu'auparavant ils fussent convenus de rien; de sorte que si, en débarquant, elle ne le voit pas, comme dans l'image du Chansonnier des Dames, faisant flotter sur la rive son mouchoir, signal du bonheur, elle est capable de tomber roide morte.
--Comment! De par tout ce qu'il y a de fous au monde! cette femme a-t-elle bien pu s'embarquer ainsi à tout hasard, comme une vraie oie sauvage?» s'écria Martin.
Mark Tapley jeta un coup d'oeil à son maître, étendu tout de son long dans sa cabane, et reprit tranquillement:
«Ah! oui, au fait. Comment a-t-elle pu?... Je ne devine pas. Il y avait deux ans qu'il l'avait quittée; depuis lors, toujours seule et pauvre en son pays, elle ne rêvait qu'au moment où elle le rejoindrait. C'est étrange qu'elle se soit décidée à s'embarquer!--Bizarre tout à fait. Peut-être est-elle quelque peu timbrée.--Impossible de l'expliquer autrement.»
Martin s'était laissé trop affaisser par le mal de mer pour répliquer davantage, et même pour prêter la moindre attention au sentiment qui avait dicté ces paroles; et la femme, objet de leur conversation, apportant le thé, empêcha Mark de poursuivre. Le déjeuner fini, ce dernier ayant accommodé le lit de son maître, alla sur le pont laver le service de table, qui consistait en deux petites demi-pintes de fer-blanc et un pot à barbe de même métal.
Pour rendre justice à Mark Tapley, il souffrait du mal de mer au moins autant qu'homme, femme ou enfant à bord, et avait de plus une propension toute particulière à se heurter et à perdre l'équilibre à chaque embardée(5)du vaisseau; mais, résolu, selon son dicton ordinaire, à se montrer fort en dépit des circonstances, il était l'âme et la vie de la chambrée d'avant, et ne se gênait en nulle sorte pour s'interrompre au milieu de la conversation la plus enjouée, aller se trouver mal à son aise, et revenir reprendre un joyeux propos juste où il l'avait laissé, aussi allègre, aussi en train que si c'était le cours ordinaire des choses.
Note 5: Embardée, secousse donnée aux navires à chaque mouvement qu'on imprime au gouvernail.
A mesure que Mark se faisait au mal de mer, on ne peut dire que sa gaieté et son bon naturel se montrassent avec plus d'avantage; la chose eut été difficile; mais; l'activité de son service auprès des plus frêles individus de la troupe y gagnait prodigieusement. Mare Tapley, à toute heure, en tout temps, pour toute affaire et tout plaisir, était mis en réquisition. Un rayon de soleil venait-il à briller sur le ciel obscur. Mark dégringolait au plus vite dans la cabine, et reparaissait traînant, conduisant où portant quelquefois une femme, une demi-douzaine d'enfants, parfois un homme, un lit, un matelas, un poêlon, un panier, n'importe, tout ce qui, animé ou inanimé, lui paraissait devoir se trouver bien du grand air. Si une heure ou deux de beau temps venait tenter, au milieu du jour, ceux qui, autrement, ne montaient que peu ou point sur le pont, et les décidait à grimper dans la chaloupe ou à s'établir sur les espars de rechange, afin de s'essayer à retrouver quelque appétit, Mark Tapley, au milieu du cercle, faisait circuler les tranches de boeuf salé, le biscuit, les petits verres de grog. C'était lui qui coupait par petits morceaux, avec son couteau de poche, la provende des marmots; lui qui régalait l'assemblée de nouvelles surannées, lues haut dans quelque vénérable gazette; ou bien encore, entouré d'un groupe choisi, il chantait à tue-tête une bonne vieille, chanson. C'était Mark qui, pour ceux qui ne savaient pas écrire, traçait des commencements de lettres adressées aux chers amis laissés au pays; lui qui faisait assaut de quolibets et de bons mots avec les gens de l'équipage; lui qui, venant de risquer d'être enlevé par un coup de mer, ou sortant tout ruisselant d'une pluie d'écume salée, tendait à tous une main secourable, et toujours faisait une chose ou l'autre pour l'utilité commune. A la nuit, quand le feu du cuisinier brillait sur le pont, et que de pétillantes étincelles voltigeant à travers les agrès et les nuages de voiles, menaçaient le vaisseau du feu, au cas où l'air et l'eau n'eussent pas suffi à sa destruction, là. encore on retrouvait Mark Tapley, habit bas, manches retroussées, plongé dans toutes sortes de travaux culinaires, composant les plus prodigieuses sauces, les plus fantastiques ragoûts, reconnu pour autorité légitime par tous, aidant chacun à faire ou à terminer quelque oeuvre que personne n'eût rêvé d'entreprendre sans son aide universelle: bref, jamais on ne vit popularité semblable à celle que Mark avait su acquérir sur le noble et excellent voilier, le Screw. L'admiration générale finit même par monter à un point tel, qu'en son for intérieur le pauvre Mark commença à s'inquiéter et à douter qu'un homme put, avec quelque raison, tirer vanité de se maintenir en belle et joviale humeur, avec de pareils encouragements.
«S'il en va ainsi jusqu'au bout, dit Mark Tapley, sa pensée le reportant vers une des plus heureuses situations de sa vie, je ne vois pas grande différence entre l'auberge du Dragon et la cabine du Screw. Jamais, à ce compte, je n'aurai le moindre mérite à conserver ma bonne humeur; c'est un sort, qu'il faille que tout me vienne constamment à souhait!
--Ah çà, Mark, demanda impatiemment Martin à son domestique, qui ruminait ainsi auprès de sa cabane, en avons-nous encore pour longtemps?
--Encore une semaine, et nous serons au port, à ce qu'on dit; le vaisseau marche aussi bien maintenant qu'un vaisseau peut marcher, ce qui n'est pas trop dire.
--Non, certes, et j'en réponds, soupira Martin avec amertume.
--Je vous assure que si vous allier faire un tour là-haut, vous ne vous en trouveriez pas plus mal, monsieur, au contraire.
--Oui! aller passer en revue devant ces messieurs et dames qui se promènent sur le gaillard d'arrière,» reprit Martin, appuyant emphatiquement sur chaque mot; «pour qu'ils me voient mêlé à toute la tourbe de mendiants arrimée dans cet ignoble trou! oui, je m'en trouverais mieux, en vérité!
--Je ne puis connaître par moi-même la façon de sentir d'un homme comme il faut, reprit Mark humblement; mais pourtant, monsieur, il me semble qu'il n'y a pas de gentleman qui ne se trouvât beaucoup mieux à l'air frais là-haut qu'ici dedans; et quant aux messieurs et dames de l'arrière, ils n'en savent pas plus sur votre compte que vous n'en savez sur le leur, et s'en inquiètent à l'avenant. C'est là ce qui me semblerait.
--Et je vous dis, moi, qu'il vous semblerait et qu'il vous semble fort mal, répliqua Martin.
--Très-probable, monsieur, répondit Mark avec son inaltérable bonne humeur. C'est ce qui m'arrive souvent.
--Croyez-vous, s'il vous plaît, poursuivit Martin se soulevant appuyé sur son coude, croyez-vous que je trouve grand plaisir à demeurer couché ici?
--Il faudrait être archifou pour se le figurer, répondit Mark Tapley.
--A qui donc en avez-vous alors? pourquoi m'aiguillonner, me persécuter sans cesse, afin que je me lève? demanda Martin. Je reste couché ici, parce que je ne veux pas courir risque d'être reconnu dans de meilleurs jours par quelqu'un de ces orgueilleux richards pour un misérable passager de seconde classe. Je reste couché ici, parce que je veux cacher ma position et moi-même, et ne pas arriver dans le Nouveau-Monde déjà flétri et stigmatisé du nom de pauvre. Si j'avais pu payer mon passage dans la première cabine, j'aurais levé la tête avec les autre; je ne le puis pas, je la cache. Commencez-vous à comprendre, maintenant?
--J'en suis désolé, monsieur, dit Mark; je n'imaginais pas que vous prissiez la chose si fort à coeur.
--Je le crois parbleu bien que vous ne l'imaginiez pas, reprit son maître. Qu'en sauriez-vous, si je ne vous le disais? Il ne vous en coûte rien, à vous, Mark. Aller, venir, mener joyeuse vie, vous est chose aussi naturelle qu'il l'est pour moi d'agir différemment. Vous ne présumez pas, sans doute, qu'il y ait à bord une créature vivante qui souffre et que j'ai à souffrir, moi, dans ce vaisseau: dites un peu?» Et Martin, se soulevant droit sur son séant, attachait sur Mark Tapley un regard fixe et profond.
Le visage de Mark se contracta en toutes sortes de grimaces; il pencha sa tête de côté, absorbé en apparence dans l'insoluble problème. Ce fut son maître enfin qui le tira d'affaire en se rejetant sur le dos, reprenant son livre et disant:
«A quoi bon vous faire une question pareille, quand tout ce que je viens de dire prouve que vous n'êtes pas de taille à la comprendre?--Apprêtez-moi un verre d'eau et d'eau-de-vie,--très-faible et froid:--donnez aussi un biscuit, et dites à votre amie, qui est notre voisine de plus près que je ne voudrais, qu'elle ait à tenir ses enfants, si c'est possible, moins bruyants que la nuit dernière. Dépêchez, et vous serez un bon diable.»
Mark obéit avec la dernière promptitude; et tandis qu'il exécutait avec zèle les ordres de son maître, ses esprits abattus se ranimèrent. Plus d'une fois il murmura tout bas que décidément il y avait plus de mérite à conserver sa gaieté à bord du Screw qu'il ne l'avait supposé. Et, ce qui n'était pas une mince satisfaction, il était sûr de retrouver à terre la pierre de louche de sa bonne humeur pour ne plus s'en séparer partout où son destin l'allait conduire. Néanmoins, il ne jugea pas à propos d'expliquer à qui ou à quoi ces consolantes pensées faisaient allusion.
Maintenant l'agitation était devenue générale à bord; les prédictions sur le jour précis, l'heure même où l'on atteindrait New-York, circulaient parmi les passagers; la foule se portait sur le pont; un oeil curieux était embusqué à chaque ouverture des flancs du navire, et la manie de faire des paquets le matin pour les défaire le soir gagnait comme une épidémie. Ceux qui avaient des missives à remettre, des amis à embrasser; ceux qui savaient où ils allaient et ce qu'ils comptaient faire, ne tarissaient pas sur leurs projets et sur leurs plans. Du reste, comme cette classe de passagers était de beaucoup la moins nombreuse, et que ceux qui n'avaient point de but fixe, étaient en majorité, l'auditoire ne manquait point aux orateurs. Les voyageurs qui s'étaient mal portés durant toute la traversée commençaient à aller bien, et les bien portants allaient mieux.
Un Américain de la première chambrée, jusqu'alors enseveli dans ses fourrures et son chapeau ciré, apparut soudain coiffé d'un haut et brillant castor noir, et ne cessa plus d'inspecter la petite valise de cuir jaune qui contenait ses habits, son linge, ses brosses, son nécessaire, ses livres, ses breloques et autres bagatelles. Ou le vit aussi arpenter le pont, les mains profondément enfoncées dans ses poches, les narines dilatées, humant par avance l'air de la Liberté, «mortel aux tyrans, et que jamais esclave n'a respiré» (sauf dans des circonstances tout à fait insignifiantes). Un Anglais, véhémentement soupçonné de s'être enfui d'une banque, emportant avec lui mieux que la clef de la caisse, devenu éloquent sur le beau sujet des droits de l'homme, fredonnait perpétuellement la Marseillaise; bref, une même sensation faisait vibrer toutes les âmes; le continent américain était proche, si proche que, par une belle nuit étoilée, un pilote fut pris à bord. Peu d'heures après, le vaisseau jeta l'ancre, attendant l'arrivée du bateau à vapeur qui devait transporter les passagers à terre.
Quand il parut, le jour brillait à peine, et pendant une heure ou plus qu'il passa côte à côte avec le vaisseau (temps durant lequel le chauffeur et le machiniste excitèrent autant de curiosité que s'ils eussent été des anges bons ou mauvais), le bateau se chargea de tout ce qu'il y avait à bord de cargaison vivante, y compris Mark, toujours en souci de protéger sa pauvre amie avec ses trois enfants, et Martin qui avait enfin repris son costume habituel, recouvert seulement, jusqu'à ce qu'il eût pour jamais quitté ses compagnons de voyage, d'un sale et vieux manteau.
Le grand bateau, avec sa machine sur le pont et les avirons qui se mouvaient rapidement en remontant la magnifique, baie de New-York, avait assez l'air d'un monstre antédiluvien ou de quelque insecte gigantesque vu à travers une loupe, et fuyant sur ses longues jambes. Bientôt des collines apparurent, puis des sites, enfin la ville longue et plate, avec ses maisons éparses sur la rive.
«La voilà donc! dit Mark Tapley debout à l'avant du bateau, voilà la terre de la Liberté! de la bonne heure; j'en suis charmé. Toute terre me sera bonne après tant d'eau!»
MARGHERITA PUSTERLA.
Lecteur, as-tu souffert?--Non.
--Ce livre n'est pas pour loi.
CHAPITRE VI.
UNE IMPRUDENCE.
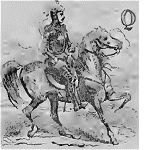 uand ils tinrent cette assemblée, on était au 13 juin 1340.
Le plus grand nombre de ceux oui s'y étaient rendus oublièrent, après
une nuit, les discours qu'ils avaient prononcés; Pusterla lui-même les
avait probablement mis en oubli; mais ils avaient laissé bien d'autres
traces dans la brûlante imagination d'Alpinolo. A force de retourner
dans son esprit les discours des conjurés, de les reprendre, de les
interpréter, il leur donna du corps. Là où il n'y avait que des paroles,
il imagina des faits; il changea les menaces en desseins arrêtés, en
machinations de vagues espérances. Il obéissait ainsi à son impétuosité
naturelle et à cette passion insensée qui tourmente ses pareils, de se
grandir à leurs propres yeux lorsqu'ils sont enveloppés dans quelque
périlleuse, entreprise, lorsqu'ils se croient les dépositaires d'une
conspiration mystérieuse que peut, d'un moment à l'autre, amener la
chute des tyrans: «Certes, disait-il en lui-même, Pusterla en a plus dit
qu'il ne semblait dire. Un homme de cette valeur voudrait-il nourrir des
espérances et en venir aux menaces, s'il ne se sentait solidement
appuyé? On ne m'a pas tout découvert, et j'approuve cette réserve. Quels
sont mes titres pour entrer dans ces grands desseins qui tiennent
suspendus les destins de la Lombardie? Mais qu'on me laisse agir, je
saurai montrer ce que je vaux, et je me rendrai digne de leur confiance,
en gagnant un monde de prosélytes à la plus sainte des causes.»
uand ils tinrent cette assemblée, on était au 13 juin 1340.
Le plus grand nombre de ceux oui s'y étaient rendus oublièrent, après
une nuit, les discours qu'ils avaient prononcés; Pusterla lui-même les
avait probablement mis en oubli; mais ils avaient laissé bien d'autres
traces dans la brûlante imagination d'Alpinolo. A force de retourner
dans son esprit les discours des conjurés, de les reprendre, de les
interpréter, il leur donna du corps. Là où il n'y avait que des paroles,
il imagina des faits; il changea les menaces en desseins arrêtés, en
machinations de vagues espérances. Il obéissait ainsi à son impétuosité
naturelle et à cette passion insensée qui tourmente ses pareils, de se
grandir à leurs propres yeux lorsqu'ils sont enveloppés dans quelque
périlleuse, entreprise, lorsqu'ils se croient les dépositaires d'une
conspiration mystérieuse que peut, d'un moment à l'autre, amener la
chute des tyrans: «Certes, disait-il en lui-même, Pusterla en a plus dit
qu'il ne semblait dire. Un homme de cette valeur voudrait-il nourrir des
espérances et en venir aux menaces, s'il ne se sentait solidement
appuyé? On ne m'a pas tout découvert, et j'approuve cette réserve. Quels
sont mes titres pour entrer dans ces grands desseins qui tiennent
suspendus les destins de la Lombardie? Mais qu'on me laisse agir, je
saurai montrer ce que je vaux, et je me rendrai digne de leur confiance,
en gagnant un monde de prosélytes à la plus sainte des causes.»
Dans de tels sentiments, il se réunit à ses amis les plus affidés, à ceux qu'il connaissait hommes de coeur et d'énergie, et qui s'étaient montrés les plus ardents pour la liberté, allumés de changements, et avides d'en venir aux mains. Il échauffa leur zèle, s'efforça de les pénétrer du fanatisme de sa conviction, et leur donna à entendre que des nuages qui chargeaient le ciel la foudre allait bientôt sortir Quelques-uns prêtèrent, à ces discours une oreille complaisante: il y a toujours un grand nombre d'hommes, et ce nombre était alors plus grand que jamais, pour qui toute nouveauté, tout cataclysme, contient un rêve de fortune et de bonheur; d'autres haussaient les épaules, en disant: «S'il y a des roses, elles fleuriront.» Il y en eut qui le traitèrent d'insensé, ou de vantard, comme s'il eût rêvé, ou qu'il eût voulu se donner de l'importance. Ces derniers étaient les plus dangereux. Piqué de l'incrédulité ou de l'insulte, il s'emportait en de nouvelles fureurs pour qu'on ajoutât foi à sa parole. Dans la chaleur de la discussion, il laissait échapper les noms des Pusterla, des Aliprandi, du seigneur Galeas et de Barnabé, et de quelques autres personnes qui étaient entrées, ou qui, selon sa manière de raisonner, entreraient certainement dans la conjuration. Aussi son secret, secret d'une entreprise qui n'existait que dans son imagination, devint le secret d'une foule de jeunes gens, langues indomptées, légères cervelles, qui le propagèrent parmi leurs amis. Passé de bouche en bouche, ce qui n'était que probable lut donné pour certain, et pour terminé ce qui était à peine entrepris, en même temps que chacun, par oubli, par vanité, ou par jactance, grossissait la nouvelle de quelque invention.
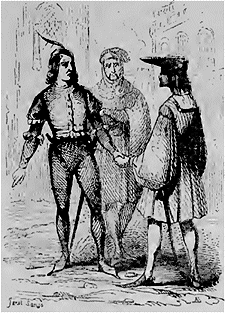
Il suffisait de jeter les yeux sur Alpinolo pour deviner les agitations de son âme. On sait qu'à force de répéter un mensonge, il n'est pas rare qu'on arrive à le prendre pour la vérité. En outre, si la conjuration était chimérique, Alpinolo l'avait rendue réelle pour sa part. Il avait péroré, il s'était concerté tout un jour avec ses amis; et, s'enflammant au feu de ses propres paroles, il s'était plus violemment épris et persuadé de la réalité de ses visions; il avait serré la main à ses amis pour leur dire: «Nous nous reverrons, nous agirons, nous parlerons.» Avec quelques-uns d'entre eux, il avait juré haine aux Visconti et mort aux tyrans, sur le nom du Seigneur et sur sa part de paradis; il avait fourbi ses armes, et calculé combien il pouvait y en avoir chez ses amis, combien on pourrait en tirer des magasins d'armures, Galvano Fiamma, alors professeur de théologie aux Dominicains de saint Eustorge, depuis chapelain et chancelier de Giovanni Visconti, nous apprend dans son histoire de Milan que cette ville comptait bien cent fabriques d'armes, sans parler des moindres ateliers de fer, qui employaient dix mille ouvriers. On faisait, ajoute-t-il, des armures luisantes comme des miroirs, qu'on expédiait jusqu'en Tartarie et chez les Sarrasins. Tour faciliter la surveillance exercée par les syndics et les consuls, les divers arts étaient distribués dans des quartiers et des rues qui leur étaient propres; c'est ce qu'indiquent les noms, aujourd'hui conservés, des rues des Orfèvres, des Marchands-d'Or, des Marchands-de-Futaine. Toutes les boutiques des fabricants d'armes s'ouvraient alors dans les rues que nous appelons aujourd'hui des Armuriers, des Espadonniers, des Éperonniers.
Je ne saurais dire combien de fois Alpinolo passait, ou, plus justement, se promenait par ces rues, fouillant de ses regards l'intérieur des boutiques, ou comptant combien d'hommes elles pourraient armer. La cadence redoublée des marteaux, le cri strident des limes, la puissante respiration des forges, le tournoiement des meules d'émoulage, le frémissement du fer rouge plongé dans l'eau ou dans l'huile, au milieu de ce bruit, le commandement des patrons, les sifflets joyeux ou les chansons des ouvriers, tout ce vacarme était plus harmonieux à l'oreille d'Alpinolo que les accords d'un orchestre habile à l'oreille d'une jeune fille de quinze ans, qui assiste à une première fête. A voir au dedans et au dehors des magasins, ou suspendus en désordre, ou disposés en trophées, ces rondaches, ces pertuisanes, ces dagues, ces estocs, ces épieux, ces arbalètes, espadons à deux mains, javelots, cuirasses à lames, à mailles, à écailles, visières, morions, écus ronds, échancrés, de cuir, de frêne, de métal, un frisson de joie parcourait les membres du jeune homme; une émotion le saisissait, pareille à celle de l'avare contemplant des tas de sequins sur la table d'un brelan, ou, pour employer une comparaison plus innocente, il ressemblait à un savant qui, traversant une rue pleine de livres, les achète en pensée, les lit, les étudie, les emploie pour faire d'autres livres, qui le mèneront à l'immortalité.
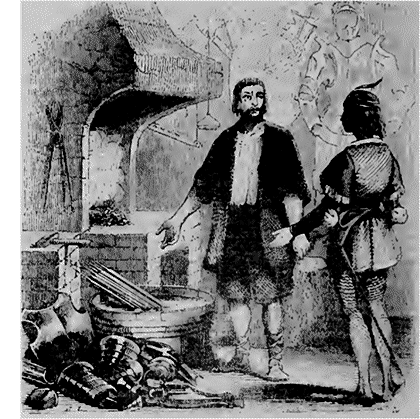
Alpinolo entrait dans quelques-unes de ces fabriques; et demandait le prix d'une cuirasse, d'une cervelière, d'une armure complète en lames de fer et en mailles, depuis le cimier jusqu'aux éperons; il n'achetait rien, mais laissait entendre, à travers des nuages, que le temps de ces achats pourrait venir bien vite.
Dans le quartier des Espadonniers, près du lieu où était alors l'unique four au pain blanc, fameux sous le nom de prestin della rosa, on voyait la boutique d'un certain Malliglioccio della Cochirola, dont le père s'était acquis dans son métier assez de crédit et une grande fortune. Lorsque ce Malliglioccio lui succéda, pensant que, puisque son père avait réussi, il ne devait pas s'écarter d'un trait des traces qu'il avait suivies, il se garda bien d'ouvrir son atelier aux améliorations que le temps et l'expérience avaient introduites dans son métier: il les raillait comme des nouveautés, des bizarreries de la mode, qui deviendraient caduques dès le lendemain de leur apparition: «Cela s'est toujours fait ainsi, disait-il; nos pères en savaient plus long que nous, eux qui revenaient déjà de l'apprentissage lorsque ces gâte-métier ne l'avaient pas encore commencé.» Cette conduite eut ses effets ordinaires; les pratiques s'éloignèrent: et tandis que les autres étendaient leur fabrication, il ne lui arrivait plus que le raccommodage des anciennes armures de quelque Milanais de la vieille roche, observateur entêté des antiques coutumes.
Alpinolo le voyant seul dans la boutique, occupé à tirer paisiblement le soufflet de la forge, et à tourner, sans se presser davantage, un morceau de fer dans les charbons, ne craignit pas d'interrompre son travail; il commença donc à lui parler plus longuement, et après avoir déploré la misère des temps, il lui fit entrevoir qu'elle pourrait bientôt prendre fin.
«Plût au ciel! s'écria Malliglioccio; on peut dire qu'on ne gagne pas l'eau qu'on boit; celui qui a une famille aujourd'hui, doit lésiner sou sur sou et ronger un pain bien suc! Ah! quelle différence dans le temps où ma bonne âme de père était syndic de notre maîtrise! Quel travail! quel pays de cocagne! les florins pleuvaient chez nous! Là, un bouclier; ici, un gantelet; un fronton pour un autre, et des cuissards. Trois contre-maître et cinquante garçons étaient à notre service, et ils auraient eu cent bras qu'il leur aurait fallu travailler tous de jour et de nuit, sans avoir à peine le temps de manger un morceau. Aujourd'hui la paix partout, partout l'eau stagnante. Il paraît que ces gens-là n'ont plus de sang dans les veines. Ces moines ne savent que prêcher la paix! Croient-ils donc que le Seigneur Dieu nous a fait des bras pour les tenir croisés? Si les choses vont de ce train, il n'y a qu'à fermer boutique, et à se faire marchand de vieille ferraille.
--Il vous plairait donc de voir revenir le passé? demandait Alpinolo.
--Si cela me plairait! Je donnerais la moitié du peu que j'ai pour voir une brave guerre; et il y en a beaucoup, sachez-le bien, dans Milan, à qui les mains démangent. Et, vive Dieu! qui n'aimerait la guerre? c'est là qu'on voit ce que vaut un homme; elle nous donne honneur et profit, on gagne un peu d'un côté, on vole un peu de l'autre, et il y en a pour tout le monde.»
Alpinolo, ravi d'avoir aussi pour lui le voeu des artisans: «Eh bien! ajoutait-il, prenez bon courage, le remède n'est pas loin; mettez en ordre les fers de votre magasin, vous aurez bientôt à travailler, je vous le promets.
--Quoi! vraiment! insistait l'armurier; tant mieux! Ma maison a toujours été en crédit, et il n'y a pas d'armes qui puissent se comparer aux miennes. Quant au prix, galanterie avec tous, et dévoué, avec vous, qui êtes de nos pratiques.»
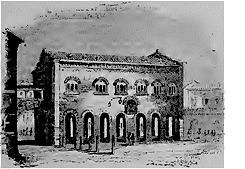
Puis, saluant Alpinolo qui s'en allait, il lui disait, en ôtant son béret: «Je me recommande à vous;» puis il se mettait sur sa porte, les mains dans les mains, pour blâmer les innovations et ruminer ses espérances.
Je ne me serais point risqué à dégrader la dignité de l'histoire par de semblables trivialités, si elles eussent été envisagées par Alpinolo comme par le grand nombre; mais, à ses yeux, c'était interroger le voeu public, c'était la manifestation de la volonté populaire, c'étaient autant de nouveaux fils ajoutés à la trame de ses espérances, c'étaient autant de preuves de l'existence de la conspiration qui devait bouleverser le gouvernement de fond en comble.
On imagine facilement quelle place ses affections particulières tenaient dans ces songes. Renverser ce juge et lui donner cet autre pour successeur, réserver à tout Visconti la fin de Reno des Gozzadini, c'est à dire le traîner par la ville, puis le jeter dans le canal; mettre en pièces Luchino, Luchino le maudit, et élever à sa place Pusterla et Marguerite. Alors tout serait justice: plus d'impôts, plus d'intrigues, alors les bons seraient élevés, et humiliés les méchants; alors... quelle belle époque! quel âge d'or! que de gloires nouvelles! quelle universelle félicité!
Échauffé, enivré par ces pensées qui déjà lui semblaient la réalité, Alpinolo entra dans le Roletto Nuovo, que nous appelons aujourd'hui la place des marchands. Je crois que beaucoup d'admirateurs se seront arrêtés, comme moi, des heures entières à contempler le mélange des styles dans ce monument grandiose, et à y lire l'histoire des arts et des révolutions de cette ville; mais ce mélange n'existait pas lorsque Alpinolo vint dans cet endroit de la cité.
L'esprit des dépenses généreuses et l'ardeur de bâtir ne sont pas nés d'hier chez les Milanais. Animés de la noble libéralité d'un peuple libre, ils achetèrent les maisons et le terrain qui occupaient le centre de leur ville, pour y rassembler les principaux édifices. En 1228, ils bâtirent la place quadrangulaire, avec cinq portes s'ouvrant sur cinq rues pavées de cailloux, appartenant aux principaux quartiers. L'une s'appelait Porte du Dôme, l'autre la Porte Neuve, la troisième de Côme, la quatrième de Vercelli; la dernière s'ouvrait sur le quartier des orfèvres, et se nommait la Porte des Prisons, parce que la geôle dite Malastalla était voisine. On y renfermait les créanciers frauduleux et la jeunesse indisciplinée, remède extrême pour solder les dettes des uns et rendre le bon sens aux autres. Au milieu de cette place, sous le podestat Oldrado des Grassi de Trezzene, à qui son zèle à brûler les hérétiques mérita une statue équestre qu'on voit encore encadrée dans le mur, on érigea le palais de la liaison. Sa partie supérieure contenait une vaste salle destinée aux tribunaux; l'inférieure, un espace couvert où se jouait le triple enlacement de sept arcades, et tel qu'il convenait à la commodité du peuple dans le temps où le peuple gouvernait la cité.

Grâce à la sainte manie, de restauration qui nous possède, il ne nous reste plus grand'chose de ces monuments de l'antiquité. Le palais de la Raison, converti en archives, est aujourd'hui fermé et tellement décrépi, que c'est à peine si on peut distinguer, sous la couche épaisse de chaux qui les recouvre, la forme de ses anciennes arcades; ainsi une mâle pensée se cache sous l'enveloppe d'un langage artificieux. Les loges sont aussi abattues; mais, par fortune, on n'a pu, en six cents ans, achever l'édifice des écoles palatines du côté de la rue des Orfèvres, et dont il reste encore ou partie la galerie degli Osii, commencée en 1316 par Matteo le Grand. Ce monument était revêtu de carreaux de marbre blanc et noir, et divisé en deux galeries superposées, qui se composaient chacune de cinq arches. Au parapet supérieur on avait sculpté sur autant d'écus les armes des six principaux suzerains de la cité. Une tribune en saillie occupait le milieu de cette galerie; sur le balcon, on voyait un aigle tenant une truie dans ses serres, symbole du haut patronage de l'empire sur la ville, qui, ainsi que le savent tous les enfants de Milan, tire son nom d'une truie à longues soies. C'était à cette tribune, vulgairement nommée Parlera, qu'apparaissaient le podestat ou les consuls pour proclamer devant le peuple convoqué les ordonnances et les lois, et pour écouter les avis des moyens. Aujourd'hui on ne voit au-dessous que des marchands de fuseaux et de rouets, et une sentinelle allemande, qui passe et repasse lentement devant et derrière les canons.

A cette époque, on voyait donc là une multitude de gens, les uns marchandant sou par sou, les autres s'enquérant des nouvelles, les autres se promenant désoeuvrés, ou louant et comparant des faucons de Norvège, de Danemark, d'Irlande; et cet autre côté on répétait des miracles qui, dans les deux dernières années, avaient commencé à mettre en réputation la madone de Saint-Celse, et aussi celle de Saint-Satire, de Saint-Simplicien et de Saint-Ambroise. Un pèlerin muni du bourdon et du saurechetto attirait l'attention d'un groupe qui, se, pressant autour de la table où l'orateur était monté, écoutait la merveilleuse histoire de Paolozzo de Rimini, qui vécut à Venise plusieurs carêmes sans rien prendre que de l'eau chaude. Les inquisiteurs le mirent en prison, et ne firent que confirmer la vérité du prodige. Plus loin un charlatan montrait un écriteau portant une foule de figures qu'il décorait de l'épithète d'humaines; il expliquait qu'elles représentaient les vingt-cinq mille personnes qui, le 25 mars passé, s'étaient rassemblées à Corrigisior dans le Crémonais, déchaussées et demi-nues, se fouettant jusqu'au sang et faisant des aumônes, sous la conduite d'une belle jeune fille qu'on regardait comme une sainte. Plus tard on découvrit qu'elle n'était inspirée que par le démon, et on la condamna au feu.
Qu'on s'imagine un bal: la foule y est immense; chacun, plein d'allégresse, ne pense qu'au plaisir, à la fête, au spectacle qu'il a sous les yeux. Qu'on s'imagine, au milieu de cette foule, un homme qui a creusé une mine sous le théâtre de la fête, qui, dans un moment, va y mettre le feu, et lancer en débris dans les airs la salle, les musiciens, les danseurs, les spectateurs, et on se fera une idée assez juste de ce qu'éprouvait Alpinolo au milieu de la multitude rassemblée sur la place dont nous avons parlé. Sous ces portiques, où se tiennent les libraires qui revendent d'occasion nos ouvrages, lorsqu'ils ont ennuyé ceux qui les avaient achetés neufs chez l'éditeur, ou qui les avaient reçus comme un hommage de l'amitié de l'auteur, Alpinolo se promenait d'un pas théâtral, mesurant de l'oeil et regardant jusqu'au fond de l'âme tous ceux qu'il rencontrait, comme pour dire: «Es-tu des miens ou de mes ennemis?» Malheureusement pour lui, il vint se jeter sur le passage, de ce Menelozzo Basabelletta, qui, s'il vous en souvient, pour avoir un jour plaisanté sur les visites de Luchino à Marguerite, avait reçu d'Alpinolo une si violente rebuffade. A cette vue, celui-ci sentit se réveiller dans son coeur tout le mépris qu'il avait alors éprouvé, avec quelque ressentiment de la honte dont il fut saisi un instant après, lorsque l'apparence sembla donner raison au mauvais plaisant. Il lui parut qu'un regard malicieux, qu'un sourire ironique de Basabelletta voulait lui dire: «N'avais-je pas raison alors?» Il l'accosta en répondant à haute voix au reproche qu'il croyait lire dans les yeux de Menelozzo. «Eh bien, lui dit-il, était-ce avec assez, d'injustice que vous essayiez de ternir la réputation de madame Marguerite?
--Il me semble que tu dois le savoir mieux que moi,» répondit l'autre avec une froide ironie.
Alpinolo réprima à grand'peine sa fureur. «Prends garde, s'écria-t-il, je te ferais rentrer ces insultes dans la gorge, si le moment n'était pas proche qui te désillera les yeux mieux que toutes mes paroles.
--Brave jeune homme! répliquait Basabelletta, il faut faire ton profit de la science du monde. Crois-moi, promets toujours des choses générales; autrement, si tu venais à préciser des détails, tu t'exposerais à rencontrer de nouveaux démentis et a été dupe de tes vanteries.
--Eh! non, répondait Alpinolo s'échauffant de plus en plus; ce ne sont point des mensonges; je ne crains point la dérision. Je te dis, en vérité, que les choses branlent au manche, et que nos maîtres ne le seront pas longtemps.»
Et Basabelletta: «Ils le seront plus que tu ne penses, parce que le diable aide les siens, et qu'il y en a trop qui, comme toi, chantent bien haut, mais ne valent pas à l'oeuvre la moitié de ce que montraient leurs paroles.»
On sent de quel coup ce langage frappa Alpinolo. Mais croyant, dans ses expressions, démêler un partisan de cette révolution idéale qu'il caressait il lui serra convulsivement la main, et, l'attirant vers un coin solitaire, il lui dit à voix basse et en regardant s'ils n'étaient point écoutés: «Ce qui est fait est fait. Mais, puisque tu es pour la bonne cause, apprends que les paroles prendront un corps; les espérances ne seront pas vaines cette fois. Quand tout le peuple est mécontent, quand le tyran est exécré, il suffit d'une étincelle pour allumer un effroyable incendie, et cette étincelle, crois-moi, il en est qui ballent la pierre pour la faire jaillir.
--Bah! répliquait Menelozzo, il faudrait que les nobles eussent moins de souplesse dans les reins, moins de servilité et plus d'amour du peuple. Sois-en sur, les hommes sont comme les années, ils ne mûrissent que sur la paille. Sur la paille des chaumières, on trouve encore des coeurs généreux; mais pendant que l'âme du manant se trempe aux rudes travaux de la glèbe et de l'atelier, les riches s'énervent dans les jeux et dans les tournois, dans les chasses, dans les bals, à tenir table et à faire gloire de leur bassesse à la cour. Nos ancêtres incitaient leur orgueil à soutenir le peuple dans la croyance de saint Ambroise, à défendre ses droits contre ceux qui voulaient l'abuser; mais le monde empire en vieillissant, et de cette génération sainte, il ne reste plus rien, Qu'est-ce que ton Pusterla, par exemple? A peine Luchino lui a-t-il jeté un os, une ambassade, il plie son âme à la servitude, il se fait doux comme miel et s'en va à Vérone sans une pensée ni pour lui-même, ni pour la patrie, ni pour quelque autre chose qui devait pourtant lui faire démanger plus vivement la peau.
--Halte-là! ne le crois pas, s'écria Alpinolo tout enflammé. Sache, au contraire, mais garde-le pour loi, sache que mon seigneur n'est point, à Vérone. S'il y a été, ce ne fut que pour nouer des intelligences avec Mastino. A l'heure qu'il est, il est ici, à Milan, ici, de sa personne. Cela te suffit-il? es-tu convaincu?
--Belles sornettes! disait en riant Menelozzo. Pauvre garçon! que tu es bon, et qu'on t'en fait avaler de cruelles! Quelque domestique t'aura donné à entendre cette fausse nouvelle. Quelqu'un aura chanté pour te faire chanter...
--A qui en faire accroire? interrompait Alpinolo, rouge comme le feu. Pour qui me prends-tu? Ne dois-je plus en croire mes yeux? Je le dis qu'hier soir, dans le palais, moi, moi tout le premier, j'ai parlé à Pusterla, à Zurione, dans une assemblée de personnes de haut rang. On y a traité de ce qu'il fallait faire, et déjà ils ont tout disposé. L'autre semaine ne passera pas sans que nos dettes ne soient pavées...» Et il poursuivit, mêlant à la vérité les songes de son imagination. Mais l'autre, incrédule et seulement poussé par son humeur disputeuse:
«Tout beau! tout beau! disait-il, il se trouvera tien quelque chose qui les arrêtera. Et la signera Marguerite, cette eau dormante...
--Quoi! Marguerite? Quel badinage? continua l'imprudent. Elle pense que le temps n'est pas venu de laver le pays de ses souillures. Elle nous a raconté l'histoire de son aïeul Galvano Visconti, qui, au temps de Barberousse, courait la ville en habit de bouffon, un porte-voix à la main, en feignant de s'occuper d'astrologie, pendant qu'il conspirait pour délivrer sa patrie. Alors, ajoutait-elle, les sages simulaient la folie; aujourd'hui les fous se croient trop sages.»
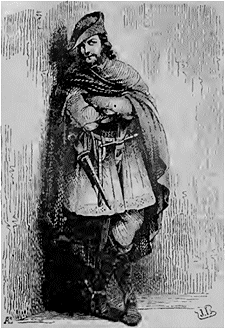
Il faut savoir que par un effet de l'habileté de l'architecte, ou plutôt par celui du hasard, les arceaux du portique sous lequel discouraient Alpinolo et Menelozzo, sont disposés de manière à produire le phénomène des salles parlantes. Quelques-uns de mes lecteurs ont pu l'observer à Saint-Paul de Londres, dans la galerie de Glocester, dans la cathédrale de Girgenti, ou, dans des lieux plus voisins de Milan, au palais ducal de Plaisance, et à Mantoue, dans la salle des géants. Il consiste en ce qu'un homme placé à l'un des quatre angles du portique ne peut prononcer une parole, si voilée qu'elle soit, qu'elle ne parvienne, en suivant une diagonale, à l'angle opposé. Les physiciens donnent facilement l'explication de ce phénomène. Notre récit se contente de dire que quelqu'un en tirait profit. Tranquille comme si l'objet de leur conversation lui eût été tout à fait indifférent, Ramengo de Casale écoutait de cette manière la discussion d'Alpinolo et de Basabelletta.
Ce Ramengo, comme nous avons eu plus d'une fois occasion de le dire, était un des flatteurs de Luchino; mais il savait assez bien nager entre deux eaux pour ne point être l'ennemi des ennemis du prince. Ses paroles étaient mielleuses et ses actions ambiguës, mais il ne se déclarait ouvertement contre personne, cherchait à se faire admettre partout, et réussissait à faire un grand nombre d'aveugles. Parmi ceux qui ne pénétraient point la scélératesse de Ramengo, on comptait Alpinolo, qui, entièrement persuadé de la bonté de sa cause, croyait qu'il était impossible qu'on ne partageât point son opinion. Aussi l'ombre d'un soupçon n'entra-t-elle point dans son esprit lorsque, Menelozzo s'étant éloigné, il se vit accosté par Ramengo, qui en avait assez entendu pour deviner le reste. «Imprudent! dit ce dernier, tu parlais tout à l'heure avec Menelozzo... lui aurais-tu dit?...» et il lui faisait un signe amical d'un air d'intelligence «Es-tu bien certain qu'il soit des nôtres? Franciscolo n'a-t-il pas donné quelque mot de ralliement pour le reconnaître?
--Non, répondit Alpinolo.
Et l'autre continua: «Zurione me l'a donné, et je ne crois point avoir perdu ma journée, quoique j'espère m'être conduit avec plus de prudence que toi. A qui as-tu parlé?»
Alpinolo lui nomma plusieurs de ceux à qui il avait fait ses confidences et de ceux à qui il comptait les faire. Ramengo, qui ne perdait pas une parole, lui dit: «Mais ne t'es-tu pas entendu avec Galeas et Barnabé?
--Non, mais d'autres que moi l'auront fait parmi ceux de la dernière soirée.
--Eh! ne sais-tu pas, parmi ces derniers, des hommes qui auraient assez de liaison avec les princes pour se mettre en rapport avec eux, ou les jeunes gens déterminés à se jeter à corps perdu dans l'entreprise comme toi et moi?
--Comment? poursuivait l'imprudent; les deux Aliprandi ne sont-ils pas fort bien avec eux? Où trouver des coeurs plus généreux que Besorro et que le seigneur de Castelletto?
--Des Milanais! s'écriait l'autre en secouant la tête. Noble race! pleine de coeur! mais, pour donner le signal du mouvement, pour vouloir avec résolution, elle est sans force, il faut recourir à ceux de la province.
--C'est pourquoi, ajoutait le page, nous avons avec nous Torniello de Novare. Ce matin, je l'ai vu parler avec...»
Il déroulait ainsi ce qu'il savait et ce qu'il imaginait, donnant pour des réalités ce qui n'était que les chimères de sa fantaisie. Puis, ravi d'avoir rencontré un nouvel apôtre, il embrassa Ramengo avec cordialité, et s'éloigna pour chercher d'autres prosélytes. Cependant Marengo se dirigea vers le palais, et bientôt après il y était reçu par Luchino, à qui il avait fait dire qu'il avait à lui communiquer des choses de la plus haute importance. Mais il est temps de faire mieux connaître à nos lecteurs ce qu'était ce misérable.
Ramengo avait pris le nom de Casale de la ville où il était né, dans le Montferrat, et d'où il avait été emporté, enfant au berceau, lorsqu'en 1299 ce pays s'était révolté contre Matteo Visconti pour se donner aux Pisans et à Giovanni, marquis de Montferrat. Son père, soldat de fortune, sans nulle richesse que son épée, était venu à Milan se mettre à la solde des Visconti. Lorsqu'il eut trouvé la mort sur le champ de bataille, Ramengo marcha dans la même voie que son père; c'était la seule qui put le conduire à la renommée et à l'opulence qu'il convoitait dans ses rêves ambitieux.
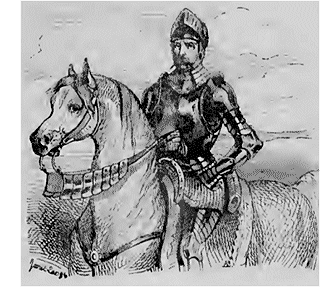
Les Pusterla, dont la puissance était grande dans le Montferrat, avaient pris sous leur protection le père de Ramengo et Ramengo lui-même; par eux, il avait acquis de l'influence et un commandement dans la milice, mais il était de ces âmes mal nées pour qui la reconnaissance est un insupportable fardeau, et les bienfaits des Pusterla avaient amassé dans son coeur une effroyable haine.
Cependant la guerre éclata entre les Guelfes et les Gobelins, lorsque le pape, ayant excommunié Matteo Visconti, leva une armée, pour soutenir son anathème. Matteo remit le pouvoir aux mains de son fils Galeas, qui pressa vivement les hostilités. Comme on craignait que l'ennemi ne franchit l'Adda pour pénétré dans Milan, on disposa des corps d'observation sur les rives de ce fleuve, et on fortifia les forteresses qui l'avoisinaient. Le père de Franciscolo Pusterla tenait le château de Brivio, un fort élevé à Olginale, et la citadelle du Lecco. Il désirait vivement que son fils commençât le noviciat des arme, il lui remit le commandement de cette dernière place, en lui donnant pour lieutenant Ramengo. Cela se passait en 1322.
Lecco n'était guère, à cette époque, qu'un amas de ruines. Victime d'une de ces vengeances de parti, alors si fréquentes, cette ville avait été punie, par une destruction totale, du crime d'avoir embrassé la cause des Torriani. Parmi les habitants de Lecco les plus dévoués à cette famille, on remarquait surtout Gualdo della Maddalena. Les malheurs de ces temps avaient éteint sa maison: il fut tué en combattant. Son fils unique, Giroldello, pris comme otage, avait réussi à s'échapper, et venait récemment de prendre service dans les troupes guelfes. Il ne restait à Lecco, de cette famille, qu'une soeur de Giroldello, la jeune Rosalia, qu'il avait toujours tendrement aimée, et qu'il aimait encore plus vivement depuis que le malheur le tenait éloigné d'elle, Rosalia avait crû en beauté, et son âme s'était éprise de ce violent besoin d'aimer que le malheur fait naître dans les coeurs délicats, et qui s'enflamment d'autant plus qu'il peut moins se satisfaite. Francisco Pusterla, très-jeune alors, avait connu la jeune fille, qui était du même âge que lui. Sa beauté (la beauté d'une vierge a tant de part aux sentiments qu'elle éveille!) avait augmenté la pitié du jeune homme pour les malheurs de Rosalia. Il la regardait comme la victime innocente des discordes civiles, martyre d'une faction dont sa famille avait fait partie, ennoblie par l'infortune; il aimait à se trouver avec elle, la traitait avec une vive amitié, et l'artifice délicat de sa bienfaisance pourvoyait aux besoins de la malheureuse orpheline. Ces soins furent si empressés et si ardents, que le grand nombre, qui ne croit point à une générosité gratuite, publiait les amours de Franciscolo et de Rosalia.
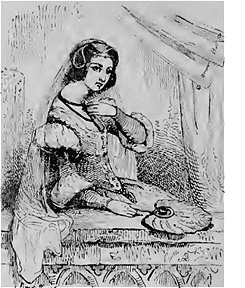
Ramengo la vit aussi et l'aima... Mais c'est profaner le nom de l'amour, qui enfante tant d'actions généreuses, que de l'appliquer aux sentiments qu'éprouvait Ramengo pour la soeur de Giroldello. Des calculs, des moyens de fortune et des avantages pour l'avenir, voilà ce qu'il voyait là où les jeunes gens de son âge ne voient que passion, fantômes brillants et plaisirs. S'élever au-dessus de la bassesse de sa naissance, s'avancer, par toutes les voies criminelles ou licites, dans les emplois et à la cour, c'était l'unique but de ses actions. Il avait vu plusieurs fois la fortune, dans ses vicissitudes, se décider tantôt pour les Visconti, tantôt pour les Torriani. Bien que le pouvoir des premiers parût alors solidement assis, qui pouvait dire qu'un caprice du hasard ne le remettrait pas aux mains des seconds? S'allier aux Visconti dans le temps même de leur puissance, c'était un rêve que l'imagination pouvait caresser, mais la raison devait le rejeter comme une folle espérance. Il était beaucoup plus habile de rechercher l'alliance des Torriani: s'ils triomphaient, que ne devait point attendre de leur reconnaissance l'homme qui n'aurait pas dédaigné de s'unir à eux lorsqu'ils étaient dans l'infortune! Si leur sort ne devait point changer, Rosalia était trop obscure et trop délaissée pour qu'un mariage avec elle inspirât ni jalousie ni soupçon de la part d'un serviteur des Visconti; et si ceux-ci venaient à être renversés, non-seulement elle serait pour Ramengo la planche de salut qui l'arracherait au naufrage, mais pourrait le faire aborder aux rivages fleuris de la faveur des Torriani triomphants. Il s'était en outre aperçu de l'affection de Pusterla pour Rosalia, et il était de ceux qui ne croyaient point à l'innocence de cette tendresse. La haine qu'il nourrissait contre Franciscolo le confirma dans ses projets d'union par l'idée de supplanter son jeune capitaine auprès de sa maîtresse. Il demanda donc la main de Rosalia à des parents éloignés à qui la garde de la jeune fille était confiée. Pour se décharger d'un fardeau, pour trouver un appui, et dans l'espoir de faire cesser les persécutions dont Giroldello était l'objet, ils consentirent à ce mariage. Lorsqu'il se conclut, Franciscolo pourvut généreusement à toutes les dépenses; mais les soupçons de Ramengo ne firent qu'en prendre une nouvelle force, et son aversion s'en accrut.
Rosalia, comme il arrivait alors et comme il arrive encore à la plupart des jeunes filles ne fut informée de ce projet que lorsqu'il fut arrêté. Elle ne connaissait point Ramengo; il n'avait rien faire pour gagner sa bienveillance; mais, lorsqu'elle se vit unie à lui par un lien que la mort seule pouvait rompre, elle fis ses délices de son devoir, et, heureuse de trouver un objet à cette flamme intérieure qui s'était jusqu'alors alimentée d'elle-même, elle aima son mari avec toute l'impétuosité d'une première passion.
Ramengo lui-même, quelque grossière que fut son âme, ne put s'empêcher d'abord d'aimer cette vierge ingénue dont il avait fait sa femme. Il goûta un moment les douceurs d'une affection partagée, et pensa même un moment à mettre tout son bonheur dans l'accomplissement de ses devoirs.

Mais ses vertueux élans ne furent pas de longue durée Bizarre, inégal, capricieux, ses caresses et sa courtoisie se mêlèrent bientôt de brutalité et de colère. Il sentait ses torts et, loin de s'en repentir, il s'en excitait à les aggraver. Loin de faire un mérite à Rosalia de la divine patience qu'elle opposait aux mauvais traitements, cette patience lui fit croire qu'elle se vengeait en le trahissant. Ses premiers soupçons grandirent, et il les accueillit avec empressement comme la justification de sa haine. Pusterla se promenait volontiers avec Rosalia sur les bords du fleuve; son coeur aimait cette âme ingénue et passionnée, et, lorsqu'il parlait d'elle, c'était avec ce chaleureux accent de la jeunesse qui ne sait ni craindre ni dissimuler. Ramengo ordonna sévèrement à sa femme de ne plus souffrir Pusterla dans sa maison sous aucun prétexte, et lui imposa en même temps de se garder de laisser croire qu'il lui donnait cet ordre. C'était la jeter dans cet abîme de duplicité et de détours où les âmes loyales trouvent le plus cruel supplice. Ses tortures n'échappaient point à Ramengo, qui en sentait croître sa barbare défiance.
Vers ce temps, la victoire de Vaprio, remportée par les Visconti, ruina de fond en comble le espérances des Torriani et dispersa leurs partisans. Marengo se montra un de leurs plus cruels persécuteurs. Rosalia, qui avait cru que les prières auraient quelque pouvoir sur son mari, osa intercéder en faveur de Giroldello; mais l'insolence de Ramengo n'avait plus de bornes: il repoussa brutalement la suppliante Rosalia. Comme elle était désormais inutile à sa fortune, il la prit en dégoût et s'en serait volontiers défait par un crime, s'il eût pu espérer de le cacher à tous les yeux, et vaincre le reste de pitié dont les coeurs les plus barbares ne peuvent se défendre au moment d'immoler un innocent.
Modes.
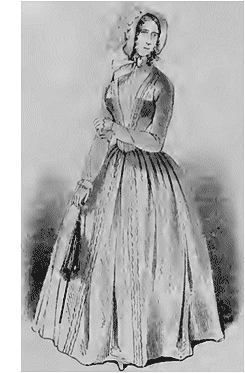
A cette époque de morte-saison, constatons moins les derniers caprices de la mode d'été qui déjà décline et dont le règne expirera dans quelques semaines. Les vacances sont l'occasion de nouvelles toilettes; on fait surtout provision de chapeaux; il faut avoir un chapeau de paille arrangé simplement, qui puisse résister au vent et à la rosée; un autre frais et gracieux comme le riant jardin dans lequel on se promène; il en faut encore pour le soir, qui aient toute la légèreté et la coquetterie des coiffures d'assemblées. Aussi madame A... envoie-t-elle aux élégantes qui ont l'habitude de se fier à son bon goût des chapeaux différents, depuis le plus simple jusqu'à la capote de gaze bouillonnée où s'entrelacent de légères branches de fleurs..
Ainsi que nous l'avons dit, les robes de soie se garnissent le plus souvent en tablier: le modèle que donne notre gravure a beaucoup de succès; les biais qui ornent la jupe et le corsage sont festonnés en soie de la couleur de la robe.
On fait encore des robes en barège; les corsages sont demi-décolletés, soit à revers avec un fichu plissé à jabot, soit froncés sur un poignet, à la Lucrèce; alors les fichus es mettent en dessus; ils sont pour la plupart brodés en semé à pois ou grains d'orge, et entourés d'une garniture festonnée. Les mantelets à gros pois avec une garniture de mousseline plissée à la vieille, sont très en faveur: on passe un ruban dans les bouillons du milieu et quelquefois dans le petit ourlet qui borde la garniture tuyautée.
En fait de modes agréables et nouvelles à exécuter soi-même, nous citerons les canezons de batiste brodée en soutache de fil d'Écosse; fine et bien faite, son application produit l'effet d'une broderie en relief; puis, les mitaines longues au crochet en soie noire ou de couleur foncée, que sont terminées en haut par un dessin or et soie nuancée faisant l'effet d'un bracelet; une frange en feston et des glands complètent cet ornement, qui se retrouve autour du pouce et autour de la main; ces mitaines faciles et promptes à exécuter, s'appellent des mitaines algériennes.
Mais l'ouvrage toujours en grande vogue, c'est la tapisserie, surtout les bandes mêlées au velours pour composer fauteuils, rideaux et portières, ou entourer un tapis de table à fond de velours uni.
AMUSEMENT DES SCIENCES
SOLUTIONS DES QUESTIONS PROPOSÉES DANS LE DERNIER NUMÉRO.
I. Prenez une boîte de forme à peu près cubique. Dans la figure, nous supposons que l'une des faces latérales soit enlevée pour laisser voir l'intérieur de la boîte A B C D. Placez dans l'intérieur et vers le bas de cette boîte un plan légèrement incliné H G D C, sur la surface duquel vous aurez tracé une rainure curviligne et en zigzag, assez large et assesz profonde pour qu'une balle de plomb puisse rouler et descendre tout au long. H G F I est un miroir incliné. Enfin M est une ouverture pratiquée à la face opposée de telle manière qu'en y mettant l'oeil on ne puisse pas voir le plan incliné H D, mais seulement le miroir. D'après les positions respectives de l'oeil, du plan incliné et du miroir, l'image de ce plan sera presque verticale, et un corps qui roulera de G en C le long de la rainure, paraîtra monter en suivant une route ondulée de G en L. L'illusion pourra être parfaite si le miroir est bien net et si le jour est bien ménagé à l'intérieur de la boîte.
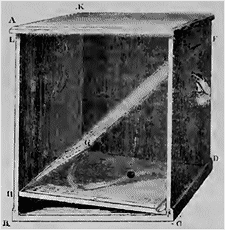
Il L'énoncé du problème est tiré de l'anthologie grecque, dont nous avons déjà parlé, et a été traduit en vers latins par le savant Bachet de Miziriac, qui a inséré ces vers dans une note de son édition de Diophante:
Aurea mala ferunt Charites, aequalia cuisque
Mala insunt calatho; Musarum his obvia turba
Mala petunt, Charites cunetis aequalia donant;
Tune aequalia haec contingit habere, novemque.
Hic quantum dederint, numerus sit ut omnibus idem?
Le moindre nombre d'oranges qui satisfasse à la question est 12, car en supposant que chaque Grâce en eût donné une à chaque muse, elles se trouveront en avoir chacune trois, et il en restera trois à chaque Grâce.
Tous les multiples de 12, tels que 24, 36, 48, etc. satisferont également à la question; et après la distribution faite, chacune des Grâces et des Muses en eût eu 6, ou 9, ou 18, etc.; en un mot, le multiple correspondant de 3.
NOUVELLES QUESTIONS À RÉSOUDRE.
I. Un lion de bronze, placé sur le bassin d'une fontaine, peut jeter l'eau par la gueule, par les yeux, par le pied droit. S'il jette l'eau par la gueule, il remplira le bassin en six heures: s'il la jette par l'oeil droit, il la remplira en deux jours; la jetant par l'oeil gauche, il la remplirait en trois; enfin en la jetant par le pied, il la remplira en quatre jours. En combien de temps le bassin sera-t-il rempli, lorsque l'eau sortira à la fois par toutes ces ouverture?
II. Sur le bord d'une rivière se trouvent un loup, une chèvre et un choux: il n'y a qu'un bateau si petit, que le batelier seul et l'un d'eux peuvent y tenir. Il est question de les passer de sorte que le loup ne fasse aucun mal à la chèvre, ni la chèvre au chou.
III. Mesurer une hauteur verticale inaccessible, même par le pied, au moyen de son ombre.
La voiture de mariage de l'empereur du Brésil.
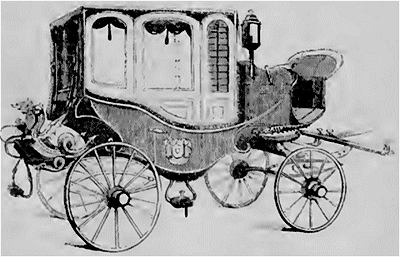
Cette voiture, commandée par l'empereur du Brésil à l'occasion de son mariage, sort des ateliers de M. Palliser, de Londres. Elle est surtout remarquable par son extrême légèreté unie à une grande solidité. Elle est peinte en vert et en jaune, et orné de filets d'or et d'argent. Les encadrement des glaces sont en acajou. Le mécanisme des stores, nouveau et ingénieux obéit aux moindres mouvements, et laisse pénétrer dans la proportion exacte que l'on désire, l'air et la lumière. L'intérieur est garni en satin blanc, et tout y est disposé de manière à ce que toutes les attitudes soient faciles, et que l'on y soit doucement et mollement porté. Sur le devant on a sculpté deux plantes, le café et le tabac, emblèmes de la richesse du Brésil; derrière sont des figures dorées de serpents et de dragons. Quoique ce travail, dans son ensemble et ses détails, fasse assurément honneur au carrossier anglais, et qu'il puisse, sous le rapport surtout de la légèreté, servir de modèle aussi bien à l'industrie du Brésil qu'à celle de tout autre pays, il n'est pas douteux qu'une voiture impériale de mariage eut été exécutée en France avec plus de goût encore. Il est probable que la commande est venue de Naples. On peut espérer que la princesse Joinville fera un peu mieux apprécier à son frère l'industrie française.
Observations Météorologiques
FAITES À L'OBSERVATOIRE DE PARIS
1843--AOÛT
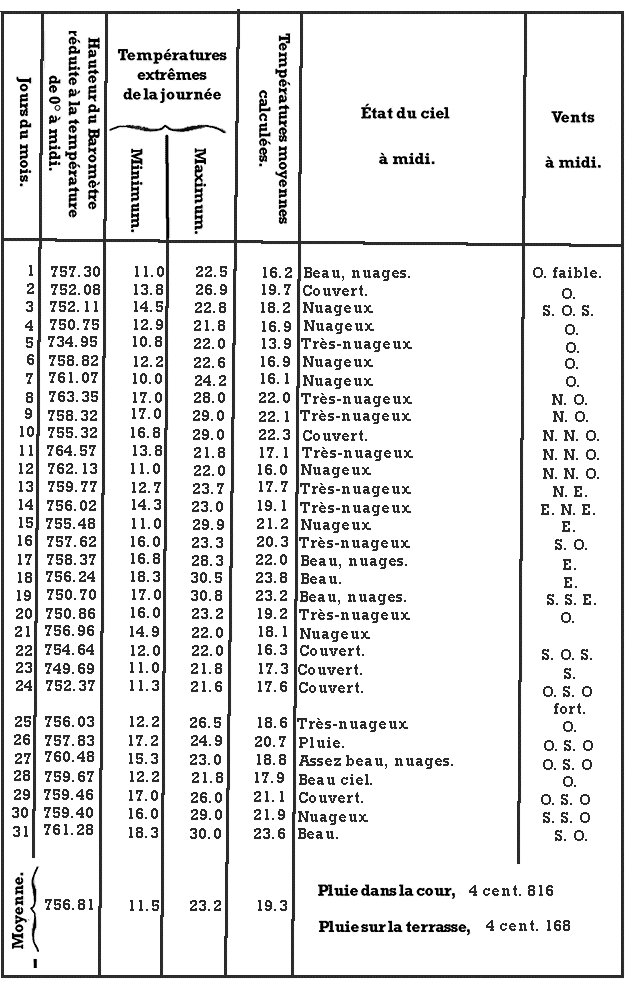
RÉBUS.
EXPLICATION DES DERNIERS RÉBUS
La sensible beauté
Est prompte à s'enflammer.
Bon vin de Beaune et de Nuits à six sous la bouteille.